
GUSTAVE DE MOLINARI,
The Bicentennial Anthology of His Writings on the State (1846-1911) (2023 Edition)
 |
 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
[Created: 5 November, 2018]
[Updated: 1 January, 2024 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, The Bicentennial Anthology of His Writings on the State (1846-1911). Edited and with Introductions by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Anthology/2019/index.html
Gustave de Molinari, The Bicentennial Anthology of His Writings on the State (1846-1911). Edited and with Introductions by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).
Editor’s Introduction
This collection of texts was first compiled at the end of 2018 as part of the bicentennial celebrations of the birth of the Franco-Belgian economist Gustave de Molinari who was born on 3 March 1819 in Liège and died at 92 years of age on 28 January, 1912 in Adinkerke, Belgium.
I first put together a collection of extracts in 2012 which were in PDF format only. As I converted more of his texts into HTML I was able to put together a collection in 2019 in HTML format, which has been expanded and improved at the end of 2023.
The most complete (but still not "the" complete) list of his works contains some 44 stand alone books, 9 books for which he wrote a preface or an introduction, 18 pamphlets or reprints of articles he had written, and 240 articles:
- Bibliography of the Works of Molinari (3 January, 2021) online.
To assist in reading and understanding Molinari’s work, in addition to the introductions I have written for each extract below, I suggest the reader also look at the following anthologies (with their accompanying introductions) and other papers and essays I have written:
Anthologies of his Work:
- Gustave de Molinari, Thoughts on the Future of Liberty (1901-1911). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023). The articles are in French. online.
- Gustave de Molinari, The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023). Edited as part of the 200th anniversary celebrations of Molinari's birth. With 5 biographical articles and 25 "principle articles". online The material is in French.
- Some of his DEP articles were translated into English in the late 19thC. See the seven entries translated for "Labor’s Cyclopedia" and edited by me online.
Papers on Molinari I have written:
- David M. Hart, "Was Molinari a true Anarcho-Capitalist?: An Intellectual History of the Private and Competitive Production of Security." A paper given at the Libertarian Scholars Conference, NYC (Sept. 2019). online.
- David M. Hart, "Gustave de Molinari (1819–1912): A Survey of the Life and Work of An "Économiste Dure" (a Hard-Core Economist)" (Oct. 2018). online. This is currently being reformatted and edited.
- David M. Hart, "Charles Coquelin, Gustave de Molinari, Frederic Bastiat and the "Austrian Moment" in French Political Economy 1845-1855: Part II. Molinari and the Private Production 0f Security". A Paper given at the Southern Economic Association Annual Meeting,19-21 Nov., 2016, Washington, DC. online.
- David M. Hart, "Gustave de Molinari and the Seven Musketeers of French Political Economy in the 1840s (2015, 2023)" online.
- David M. Hart, "Molinari, Gustave de (1819-1912)," The Encyclopedia of Libertarianism (2008), pp. 336-37 online
- David M. Hart, "The Struggle against Protectionism, Socialism, and The Bureaucratic State: The Economic Thought of Gustave de Molinari, 1845-1855". This is a book-length manuscript, a portion of which was given as a Paper at the Austrian Economics Research Conference (31 March to 2 April 2016), The Mises Institute, Auburn, Alabama. online.
- David M. Hart, "Gustave de Molinari and the Future of Liberty: ‘Fin de Siècle, Fin de la Liberté'?" A paper presented to the Australian Historical Association 2000 Conference on "Futures in the Past", The University of Adelaide, 5-9 July, 2000. Revised Sept. 2013. online.
- My undergraduate Honors Thesis written in 1979 and published a few years later in the Journal of Libertarian Studies: HTML version of Thesis online.
- JLS articles: "Gustave de Molinari and the Anti-statist Liberal Tradition" Journal of Libertarian Studies, in three parts, (Summer 1981), V, no. 3: 263-290; (Fall 1981), V. no. 4: 399-434; (Winter 1982), VI, no. 1: 83-104. S11 was translated as an Appendix to Part III, pp. 88-102. Part I PDF; Part II PDF; Part III PDF
Papers on French Liberalism in general:
- David M. Hart, "The Paris School of Liberal Political Economy, 1803-1853". A Paper given at the History of Economic Thought Society of Australia Annual Conference, Melbourne VIC, 22 Sept. 2022. online.
- David M. Hart, "The Paris School of Liberal Political Economy" in The Cambridge History of French Thought, ed. Michael Moriarty and Jeremy Jennings (Cambridge University Press, 2019), pp. 301-12. A much shorter version of the above.
- David M. Hart, "For Whom the Bell Tolls: The School of Liberty and the Rise of Interventionism in French Political Economy in the Late 19thC," and a translation of Frédéric Passy, "The School of Liberty" in Journal of Markets and Morality, vol. 20, Number 2 (Fall 2017), pp. 383-412. Online edition and here. And my online version "Frédéric Passy and ‘The School of Liberty’ (April, 1890)" (Dec. 2017) online.
Table of Contents
- Editor’s Introduction
- PART I. MOLINARI’S POLITICAL CREDO: "LA LIBERTÉ, LA PROPRIÉTÉ, ET LA PAIX"
- His "Spartacus speech" on the oppressed throwing off their chains (1849)
- Molinari’s Credo: "la Liberté et la Paix" (1861)
- Programme économique: Le libre-échange et la simplification de l'État (1891)
- PART II. THE FIRST FORMULATION OF THE THEORY OF ANARCHO-CAPITALISM (1846–1849)
- PART III. MOLINARI’S THEORY OF THE STATE I (1852-1853
- "Le Despotisme et les mangeurs des taxes" (1852)
- "Le fractionnement de l'humanité en nations autonomes" (1853)
- PART IV. THE FURTHER DEVELOPMENT OF MOLINARI’S THEORY OF PURE ANARCHO-CAPITALISM (1852–1863)
- PART V. MOLINARI’S THEORY OF THE STATE II: THE "TEMPERED" REPUBLIC (1873)
- PART VI. MOLINARI’S GRADUAL RETREAT FROM STRICT ANARCHO-CAPITALISM (1880–1908)
- "Le régime de la grande industrie et de la concurrence universalisées" (1880)
- "Les gouvernements de l’avenir" (1884)
- "La liberté de gouvernement" (1887)
- "Projet d’Association pour l’établissement d’une Ligue des neutres" (1887)
- "La décadence de la guerre" (1898)
- "La constitution libre" (1899)
- "Le problème du gouvernement individuel" (1900)
- PART VII. HIS LAST WORDS ON THE MATTER (1901–1911)
PART I. MOLINARI’S POLITICAL CREDO: "LA LIBERTÉ, LA PROPRIÉTÉ, ET LA PAIX"↩
I.1. His "Spartacus speech" on the oppressed throwing off their chains (1849)↩
Source
Gustave de Molinari, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (Paris: Guillaumin, 1849). Concluding section of S12 at the end of the book, pp. 348-63.
Introduction
On several occasions in Les Soirées "The Economist" (i.e. Molinari) stops the conversation he is having with "The Socialist" and "The Conservative" to deliver a speech on some topic. This one here, what I have called his "Spartacus Speech," comes at the very end of the book where he sums up the main ideas he has been presenting and gives the reader a rousing speech in favor of individual liberty. The most passionate section is the following:
| La liberté! c’était le cri des captifs d’Égypte, des esclaves de Spartacus, des paysans du moyen âge, et, plus tard, des bourgeois opprimés par la noblesse et les corporations religieuses, des ouvriers opprimés par les maîtrises et les jurandes. La liberté! c’était le cri d’espérance de tous ceux dont la propriété se trouvait confisquée par le monopole ou le privilége. La liberté! c’était l’aspiration ardente de tous ceux dont les droits naturels étaient comprimés sous la force. | Liberty! This was the cry of the captives of Egypt, of the salves of Spartacus, of the peasants of the middle ages, and later of the bourgeoisie oppressed by the nobility and the religious corporations, of the workers oppressed by their masters and the guilds. Liberty! this was the cry of hope of all those whose property was confiscated by monopoly or privilege. Liberty! This was the fervent aspiration of all those whose natural rights were restricted by the use of force. |
| Un jour vint où les opprimés se trouvèrent assez forts pour se débarrasser des oppresseurs. | A day will come when the oppressed will find themselves strong enough to get rid of their oppressors. |
There are several key ideas in this speech which Molinari will continue to pursue over the course of his long life: only in "un milieu libre" where property rights are respected will there be a maximum of production and a just distribution of rewards for work done; that throughout history the strongest and the most crafty ("rusé") seize control of the state in order to have "l’esclavage, les monopoles et les priviléges" (slavery, monopolies, and privileges) at the expense of ordinary people; that those who are oppressed by this will one day rise up in rebellion and seize their liberty back; that the future battle for freedom will be between the defenders of the "status quo" (the conservatives), the advocates of new "artificial" ways of organizing society who ignore the natural laws of political economy (the socialists), and the true defenders of liberty ("les partisans de la liberté").
Text
L’Économiste.
Malheureusement, si de nombreux efforts ont été accomplis pour développer économiquement la production, de nombreux obstacles ont été élevés, en même temps, par l’ignorance ou la perversité humaine, pour entraver ce développement comme aussi pour troubler la distribution naturelle et équitable de la richesse.
C’est dans un milieu libre, dans un milieu où le droit de propriété de chacun sur ses facultés et les résultats de [358] son travail est pleinement respecté, que la production se développe au maximum, et que la distribution de la richesse se proportionne irrésistiblement aux efforts et aux sacrifices accomplis par chacun.
Or, dès l’origine du monde, les hommes les plus forts ou les plus rusés attentèrent à la propriété intérieure ou extérieure des autres hommes, afin de consommer à leur place une partie des fruits de la production. De là l’esclavage, les monopoles et les priviléges.
En même temps qu’ils détruisaient l’équitable distribution de la richesse, l’esclavage, les monopoles et les priviléges ralentissaient la production, soit en diminuant l’intérêt que les producteurs avaient à produire, soit en les détournant du genre de production qu’ils pouvaient le plus utilement accomplir. L’oppression engendra la misère.
Pendant de longs siècles, l’humanité gémit dans les limbes de la servitude. Mais, d’intervalle en intervalle, de sombres clameurs de détresse et de colère retentissaient au sein des masses asservies et exploitées. Les esclaves se soulevaient contre leurs maîtres en demandant la liberté.
La liberté! c’était le cri des captifs d’Égypte, des esclaves de Spartacus, des paysans du moyen âge, et, plus tard, des bourgeois opprimés par la noblesse et les corporations religieuses, des ouvriers opprimés par les maîtrises et les jurandes. La liberté! c’était le cri d’espérance de tous ceux dont la propriété se trouvait confisquée par le monopole ou le privilége. La liberté! c’était l’aspiration ardente de tous ceux dont les droits naturels étaient comprimés sous la force.
[359]
Un jour vint où les opprimés se trouvèrent assez forts pour se débarrasser des oppresseurs. C’était à la fin du dix-huitième siècle. Les principales industries qui pour-voyaient aux besoins de tous n’avaient point cessé d’être organisées en corporations fermées, privilégiées. La noblesse qui pourvoyait à la défense intérieure et extérieure, corporation; les parlements qui rendaient la justice, corporation; le clergé qui distribuait les services religieux, corporation; l’université et les ordres religieux qui pourvoyaient à l’enseignement, corporation; la boulangerie, la boucherie, etc., corporations. Ces différents états étaient, pour la plupart, indépendants les uns des autres, mais tous se trouvaient subordonnés au corps armé qui garantissait matériellement les priviléges de chacun.
Malheureusement, lorsque l’heure sembla venue d’abattre ce régime d’iniquité; on ne sut par quoi le remplacer. Ceux qui avaient quelques notions des lois naturelles qui gouvernent la société opinaient pour le laisser-faire. Ceux qui ne croyaient point à l’existence de ces lois naturelles s’élevaient, au contraire, de toutes leurs forces contre le laisser-faire, et demandaient la substitution d’une organisation nouvelle à la place de l’ancienne. A la tête des partisans du laisser-faire figurait Turgot, à la tête des organisateurs ou néo-réglementaires figurait Necker.
Ces deux tendances opposées, sans compter la tendance réactionnaire, se partagèrent la révolution française. L’élément libéral dominait dans l’Assemblée constituante, mais il n’était pas pur. Les libéraux eux-mêmes n’avaient pas encore assez de foi en la liberté pour lui abandonner [360] entièrement la direction des affaires humaines. La plupart des industries matérielles furent affranchies des liens du privilége, mais les industries immatérielles et, en première ligne, la défense de la propriété et la justice, furent organisées en vertu des théories communistes. Moins éclairée que l’Assemblée constituante, la Convention se montra plus communiste encore. Comparez les deux déclarations des Droits de l’homme de 1791 et 1793, et vous en acquerrez la preuve. Enfin, Napoléon, qui réunissait les passions d’un jacobin aux préjugés d’un réactionnaire, sans aucun mélange de libéralisme, essaya de concilier le communisme de la Convention avec les monopoles et les priviléges de l’ancien régime. Il organisa l’enseignement communautaire, subventionna des cultes communautaires, institua un corps des ponts et chaussées dans le but d’établir un vaste réseau de voies de communication communautaires, décréta la conscription, c’est-à-dire l’armée communautaire; en outre, il centralisa la France comme une grande commune, et ce ne fut pas sa faute s’il n’organisa point dans cette commune centralisée toutes les industries sur le modèle de l’Université et de la régie des tabacs. [27] Si la guerre ne l’en avait empêché, comme il le déclare lui-même dans ses Mémoires, il aurait certainement accompli ces grandes choses. D’une autre part, il ressuscita dans cette France organisée la plupart des priviléges et des restrictions de l’ancien régime; il reconstitua la noblesse apanagée, rétablit les priviléges de la boucherie, de la boulangerie, [361] de l’imprimerie, des théâtres, des banques, limita la libre disposition du travail par la législation de l’apprentissage, des livrets et des coalitions, le droit de prêter par la loi de 1807, le droit de tester par le Code civil, le droit d’échanger par le blocus continental et la multitude de ses décrets et règlements relatifs aux douanes; il refit, pour tout dire, sous l’influence de deux inspirations venues de points opposés, mais également réglementaires, le vieux réseau d’entraves qui opprimait naguère la propriété.
Nous avons vécu jusqu’à présent sous ce déplorable régime, encore aggravé par la Restauration (rétablissement de la vénalité des charges, en 1816, exhaussement des barrières douanières, en 1822), mais bien loin de lui imputer les iniquités et les misères de la société actuelle, c’est la propriété et la liberté qu’on a accusées. Les docteurs du socialisme méconnaissant l’organisation naturelle de la société, ne voulant point voir les déplorables résultats de la restauration des priviléges de l’ancien régime et de l’instauration du communisme révolutionnaire ou impérialiste, affirmèrent que la vieille société péchait par sa base même, la propriété, et il s’efforcèrent d’organiser sur une autre base une société nouvelle. Cela les conduisit à des utopies, les unes simplement absurdes, les autres immorales et abominables. Au reste, on les a vus à l’œuvre.
Les conservateurs opposèrent heureusement une digue à l’invasion foudroyante du socialisme; mais n’ayant pas plus que leurs adversaires des notions précises de l’organisation naturelle de la société, ils ne pouvaient les vaincre ailleurs que dans la rue. Partisans du statu quo parce [362] qu’ils y trouvaient profit et sans s’inquiéter du reste, les conservateurs s’opposèrent aux innovations socialistes, comme ils s’étaient, dans le courant des années précédentes, opposés aux innovations propriétaires des partisans de la liberté de l’enseignement et de la liberté du commerce.
C’est entre ces deux sortes d’adversaires de la propriété, les uns voulant augmenter le nombre des restrictions et des charges qui pèsent déjà sur la propriété, les autres voulant conserver purement et simplement celles qui existent, que le débat se trouve actuellement porté. D’un côté apparaissent M. Thiers et l’ancien comité de la rue de Poitiers; de l’autre MM. Louis Blanc, Pierre Leroux, Cabet, Considérant, Proudhon. C’est Necker sons les deux espèces. Mais je ne vois plus Turgot.
Le Socialiste.
Si la société est naturellement organisée et s’il suffit de détruire les obstacles apportés au libre jeu de son organisation, c’est-a-dire les atteintes portées à la propriété pour élever le chiffre de la production au maximum que comporte l’état actuel d’avancement des arts et des sciences, et rendre la distribution de la richesse pleinement équitable, il est fort inutile assurément de chercher encore des organisations factices. Il n’y a autre chose à faire qu’à ramener la société à la propriété pure.
Le Conservateur.
Mais combien de changements à opérer pour en venir la? Cela fait trembler!
L’Économiste.
Non! car toutes les réformes à accomplir ayant un caractère de justice et d’utilité ne sauraient offenser aucun [363] intérêt légitime ni causer aucun dommage à la société.
Le Socialiste.
Au reste, dans un sens ou dans un autre, pour la propriété ou contre la propriété, les réformes ne peuvent manquer de se faire. Deux systèmes, sont en présence: le communisme et la propriété. Il faut aller vers l’un ou vers l’autre. Le régime mi-propriétaire, mi-communiste sous lequel nous vivons ne saurait durer.
L’Économiste.
Il nous a déjà valu de déplorables catastrophes et peut-être nous en réserve-t-il de nouvelles.
Le Conservateur.
Hélas!
L’Économiste.
Il faut donc en sortir. Or, on n’en peut sortir que par la porte du communisme ou par celle de la propriété:
Choisissez!
Endnotes
[27] La fabrication du tabac, rendue libre par l’Assemblée constituante, fut mise en régie par un décret du 29 décembre 1810.
I.2. Molinari’s Credo: "la Liberté et la Paix" (1861)↩
Source
Gustave Molinari, Questions d'économie politique et de droit public. Two Volumes. (Paris: Guillaumin et cie, 1861), Vol. 1, Introduction, pp. v-xxxi.
Introduction
The following extract is the introduction to Molinari's two volume collection of essays and articles which he had written over the previous 15 years, Questions d'économie politique et de droit public (1861). They cover topics such as the freedom of speech (in particular theatres which was a passion of his), free trade, the private provision of security, the law of war, and intellectual property. In the introduction Molinari provides a very useful summary of his liberal ideas which had been evolving from the time he first came to Paris in 1840, his activity as an economic journalist, his voluntary exile in Belgium after the coup d'état of Louis Napoleon, and his work as an academic economist in Brussels during the 1850s. As he concludes, throughout this entire period his "Credo" had remained the same, namely a firm belief in "la Liberté et la Paix."
This piece should be compared to later, similar statements of his beliefs which he made towards the end of his long life, such as "Le problème du gouvernement individuel" (1900), "Où est l’utopie ?" (1904), and his final book Ultima Verba: Mon dernier ouvrage (1911), where he seems to have been remarkably consistent. For example, in "Où est l’utopie ?" he is still putting forward his utopian vision of a fully free society which would be "un seul et vaste marché" (a single huge market) for everything.
Building upon some of the ideas he expressed ten years previously in "Revolutions and Despotism" (1852) Molinari returns to the idea of the economist as "le teneur de livres de la politique" (the book keeper of public policy) who weights up the costs and benefits of different courses of political action. This is an approach he would turn to repeatedly in his writings, such as in "De l'administration de la Justice" (1855), "La décadence de la guerre" (1898), and "Le XXe siècle" (1902). In this case he examines two different strategies for achieving radical change in society, namely the use of "la force" by means of revolutions and wars, versus the use of "la persuasion" by means of peaceful propaganda. Molinari categorically rejects the use of violence to realize the ideas he favors, even when one is faced with "des griefs légitimes" (legitimate grievances). Events which one might have thought he would have supported, such as the American and French Revolutions of 1776 and 1789, the revolts of the Spanish colonies in the 1820s, the revolutions of 1830 in France and Belgium, he also rejected as causing more loss of life and property than they were worth and leaving behind "les habitudes de la violence et de la spoliation" (habits of violence and plunder). Thus, "le bilan de ces révolutions se solde en déficit" (the balance sheet of these revolutions is in deficit) and "leur passif matériel et moral dépasse de beaucoup leur actif" (their material and moral costs greatly exceeds their benefits).
Molinari's conclusion was that
| Nous repoussons de toute notre énergie l’intervention de la force pour imposer les idées; nous nous en tenons à l’emploi exclusif de la persuasion pour les faire accepter. | We reject with all our energy the use of force in order to impose ideas (on others); we limit ourselves to the exclusive use of persuasion in order to get (others) to accept them. |
He cites two historical examples of the successful use of peaceful persuasion to change society in a more liberal direction, the early centuries of the Christian religion (before it became the state religion of the Roman Empire) and the success of the Anti-Corn Law League in ending protection in England in 1846. He is confident that the liberals of his own day should take advantage of the technological revolutions which had taken place in communications, what he called "les moyens matériels de propagande",(steam power, the printing press, and the telegraph), to influence the new force of "l'opinion publique". Even in very authoritarian and dictatorial states which attempted to keep out liberal ideas by erecting "une douane intellectuelle, restrictive ou prohibitive" (an intellectual customs barrier, either a restrictive or a prohibitory one)the attempt would ultimately fail as ideas would become a form of "contrebande" which would be smuggled across any protectionist "intellectual border."
There is also a strong suggestion in this introduction that Molinari had not retreated from his anarchist views of 1849 as his article on "Nations" might have suggested in 1853. First of all, he reprints in this collection of essays the article "La production de la sécurité" from February 1849. Secondly, he claims that "les guerres politiques" (political wars) would lose all meaning:
| lorsque chacun, individuellement, peut donner librement sa clientèle à l’établissement dans lequel il a le plus de confiance pour assurer sa liberté et garantir sa propriété. | when each peson individually is able to freely give his custom to the business (company) which he has the greatest confidence will ensure his liberty and proect his property. |
And thirdly, in his concluding paragraph he explicitly states that his theory of "la liberté de gouvernement" had barely been sketched ("à peine ébauchée"), thus implying that he planned to continue to develop it further in the future.
Text
INTRODUCTION.
[v]
I
En réunissant quelques travaux publiés dans une période de quinze années en France, en Belgique et en Russie, nous nous sommes proposé pour but d'aider à la démonstration d'une vérité que la science économique a commencé à mettre en lumière, mais qu'elle n'a point réussi encore à vulgariser, savoir que les sociétés humaines s'organisent, se développent et progressent d'elles-mêmes, en vertu de lois inhérentes à leur nature; qu'il suffit, en conséquence, de laisser les individualités dont elles se composent pleinement libres de déployer leur activité, d'user et de disposer à leur guise des produits créés et des capitaux accumulés en les déployant, en d'autres termes de respecter et de [vi] faire respecter la liberté et la propriété de chacun pour que le progrès s'accomplisse aussi largement et aussi rapidement que possible.
La liberté et la propriété, telles sont donc les bases sur lesquelles repose l'organisation naturelle de la société, et les conditions nécessaires de tout développement, de tout progrès social.
D'où il résulte que l'œuvre des amis du progrès doit consister uniquement à dégager la liberté des entraves artificielles qui la restreignent dans l'ordre matériel, intellectuel et moral, à affranchir la propriété des servitudes qui l'entament ou des charges qui la grèvent, en sus de ce qui est rigoureusement nécessaire pour assurer sa conservation.
Cette œuvre est, au surplus, beaucoup plus vaste et plus difficile que ne le supposent ceux qui prennent le mot liberté dans l'acception étroite et fausse que lui ont donnée les partis politiques; ceux encore qui s'en tiennent aux définitions que les codes ont formulées de la propriété et aux limites arbitraires et variables que les législateurs lui ont marquées.
La liberté embrasse, en effet, toute la vaste sphère où se déploie l'activité humaine. C'est le droit de croire, de penser et d'agir, sans aucune entrave préventive, sous la simple condition de ne point porter atteinte au [vii] droit d'autrui. Reconnaître les limites naturelles du droit de chacun, et réprimer les atteintes qui y sont portées, en proportionnant la pénalité au dommage causé par cet empiétement sur le droit d'autrui, telle est la tâche qui appartient à la législation et à la justice, et la seule qui leur appartienne.
La propriété qui n'est, en quelque sorte, que la condensation de l'activité humaine, se manifeste comme la liberté dans l'ordre moral, intellectuel et matériel. Il suffit de même de la reconnaître dans ses limites, en la grevant simplement des frais nécessaires pour la garantir.
Or, si nous examinons les sociétés qui se disent ou se croient le plus libres et où la propriété passe pour être le mieux respectée, quel spectacle frappera nos regards?
Nous verrons que, nulle part, la liberté et la propriété ne sont reconnues et garanties dans leurs limites naturelles; qu'il existe partout des entraves au déploiement de l'activité de l'homme; que la liberté des entreprises, du travail, de l'association, de l'échange, de l'enseignement, de la charité, des cultes, du gouvernement, est encore chargée de restrictions ou de prohibitions; que la propriété, à son tour, n'a point cessé d'être accablée de servitudes et de charges de tous genres; que la [viii] propriété des associations, par exemple, est étroitement garrottée; que la propriété intellectuelle est soumise dans sa durée au régime barbare du maximum; que la propriété morale est à peine définie; bref que le développement harmonique de la société sur la double base de la liberté et de la propriété, est de toutes parts enrayé et faussé par des abus ou des lacunes de la législation, qui maintiennent le privilége et le monopole à la place de la liberté, le communisme à la place de la propriété.
Différentes causes contribuent à perpétuer ces obstacles au progrès des sociétés : d'abord, les intérêts ordinairement mal entendus et à courte vue des classes qui détiennent les priviléges et les monopoles; ensuite et plus encore l'ignorance des lois naturelles en vertu desquelles les sociétés naissent, se conservent et se développent.
Ainsi, il existe dans chaque pays des classes politiquement et économiquement privilégiées. Ici, c'est la liberté du travail de toute une race qui est confisquée dans l'intérêt d'une classe de propriétaires d'esclaves; là, c'est la liberté des entreprises qui est sacrifiée à l'intérêt de corporations d'artisans, d'agents de change, de courtiers, etc.; ailleurs, la liberté des banques qui est confisquée au profit d'une banque d'État, [ix] investie du monopole du crédit; ailleurs encore, la liberté des échanges qui est surchargée de restrictions ou de prohibitions pour satisfaire à l'intérêt prétendu d'un petit nombre d'industries qualifiées de nationales, à l'exclusion des autres; ailleurs enfin, la liberté des cultes qui est immolée sur l'autel d'une religion d'État. Les privilégiés, ordinairement maîtres de l'appareil gouvernemental, emploient le pouvoir dont ils disposent à maintenir et à accroître leurs monopoles, ou si l'on veut, à étendre abusivement les limites de leurs libertés et de leurs propriétés aux dépens des libertés et des propriétés des autres membres de la société.
Mais les intérêts particuliers des classes influentes n'agissent pas seuls dans ce sens. L'ignorance et les préjugés des masses ne leur viennent que trop souvent en aide pour imposer des bornes arbitraires à la liberté et à la propriété, en invoquant l'intérêt général.
C'est à l'ignorance et aux préjugés des masses que doit revenir par exemple la responsabilité des doctrines du socialisme et des pratiques de l'interventionisme, qui n'est qu'un acheminement au socialisme.
Les socialistes voient bien, quoique parfois avec un verre grossissant, les maux qui affligent la société, mais ils en voient mal les causes. Ils en accusent la propriété et la liberté, et ils proposent d'organiser la [x] société sur d'autres bases. Leurs systèmes sont tombés aujourd'hui dans un profond discrédit; mais c'est le feu qui couve sous la cendre, et le jour n'est pas éloigné peut-être où les révolutions sociales succéderont aux révolutions politiques.
Les interventionistes partagent, au sujet de la propriété et de la liberté, l'erreur des socialistes, mais ils sont moins avancés ou plus timides. Ils pensent que la société ne peut être abandonnée à elle-même sous peine de demeurer stationnaire ou même, pis encore, de retourner à la barbarie, qu'elle a besoin d'être poussée en avant par un gouvernement faisant office de Providence. Ce gouvernement-Providence emploie dans l'accomplissement de sa tâche des procédés de deux sortes : d'abord il réglemente, en suivant les inspirations de son intelligence supposée supérieure, la liberté et la propriété des particuliers dans l'intérêt prétendu de la généralité; ensuite il s'empare de certaines branches de travail, il en subventionne ou il en protége d'autres, aux frais de la communauté. Ainsi, il construit des routes, des canaux, des chemins de fer, il transporte les lettres et les dépêches, il organise l'enseignement, il salarie les cultes, il subventionne les théâtres et encourage les arts, etc., etc. Cette intervention dans le domaine de la production a pour objet d'y [xi] faire régner l'ordre et d'y susciter le progrès; mais elle a pour résultat inévitable d'y jeter le trouble et de ralentir l'essor naturel des branches de travail dont il s'agit précisément de hâter le développement. En effet, tantôt, comme dans le cas de l'enseignement et des travaux publics, le gouvernement a pour principe de ne point couvrir ses frais, et il ralentit ou il empêche la multiplication des entreprises libres qui sont tenues de couvrir les leurs pour subsister; tantôt, au contraire, comme dans le cas du transport des lettres et des dépêches télégraphiques, il veut réaliser des bénéfices supérieurs à ceux des entreprises libres, et dans ce but, il interdit à l'industrie privée de lui faire concurrence. Dans les deux cas l'ordre naturel du développement de la production est troublé et ce développement est ralenti. Il en est de même encore lorsqu'il subventionne ou protége certaines branches particulières de la production matérielle ou intellectuelle, aux dépens des autres; comme s'il était plus capable que les intéressés eux-mêmes de savoir quels besoins il est plus essentiel ou moins urgent de satisfaire.
Les privilégiés, les socialistes et les interventionistes, tels sont donc les adversaires que nous avons à combattre pour asseoir la société sur ses deux bases naturelles : la liberté et la propriété.
[xii]
II
Il s'agit maintenant de savoir quelle voie il faut suivre pour obtenir ce résultat le plus promptement et de la manière la moins coûteuse.
On peut employer deux procédés essentiellement différents : la force ou la persuasion. On peut imposer le progrès ou le faire accepter.
Jusqu'à nos jours, l'école de la force, procédant par voie de révolutions et de guerres est demeurée prépondérante, et, à une époque récente, un souverain puissant, en jetant l'Europe dans les hasards d'une nouvelle crise, se glorifiait de faire « la guerre pour une idée. » Depuis la fin du siècle dernier, l'école de la force bouleverse le monde en vue de hâter ses progrès et, selon toute apparence, elle le bouleversera longtemps encore.
[xiii]
L'école de la persuasion, procédant par voie de propagande pacifique, en revanche n'est guère en crédit; au moment où nous écrivons (1861) du moins elle est complétement effacée par les hauts faits de sa rivale.
Enfin, il y a l'école des éclectiques qui sont tantôt pour l'emploi de la force, tantôt pour l'emploi de la propagande pacifique, selon que les circonstances leur paraissent devoir faire préférer l'un ou l'autre de ces procédés.
Nous appartenons pour notre part, exclusivement, à l'école de la persuasion. Nous répudions, de la manière la plus absolue, le concours de la force pour la réalisation de nos idées. Nous condamnons, en conséquence, à priori, toute révolution, toute guerre entreprise en vue d'accomplir un progrès, si légitime et si nécessaire que ce progrès puisse paraître.
Peut-être n'est-il pas inutile dans un moment où les révolutions et les guerres « pour une idée » sont populaires , de résumer les raisons qui nous portent à les condamner comme instruments de progrès, et à séparer ainsi complétement notre cause de celle des révolutionnaires.
En premier lieu, c'est parce que nous ne nous croyons point, nous créature sujette à l'erreur, le droit d'imposer nos idées. Nous sommes, par exemple, [xiv] bien convaincu que l'amélioration matérielle, intellectuelle et morale du sort de nos semblables, dépend de l'application de nos principes ; nous croyons que l'abondance dans la production, la justice dans la répartition de la richesse ne peuvent être obtenues que par la suppression des monopoles, des priviléges, des réglementations et des interventions de tous genres qui attentent à la liberté et à la propriété des classes les plus nombreuses de la société. C'est là une vérité qui nous paraît claire comme la lumière du soleil, et nous sacrifierions au besoin toute la part de biens moraux et matériels que nous possédons, notre réputation et notre vie, pour l'attester. Mais si nous avons le droit de sacrifier les biens qui nous appartiennent (encore faudrait-il cependant que nous eussions satisfait à toutes nos obligations positives envers nos proches, pour avoir pleinement le droit de nous donner ce luxe du martyre) sommes-nous les maîtres de disposer, au profit de notre cause, de ce qui appartient à autrui? En admettant même que notre jugement, naturellement faillible, ne nous ait point trompés, en admettant que la théorie dont nous sommes les propagateurs, soit la seule juste, la seule utile, la seule vraie, avons-nous bien le droit de lever, pour l'établir, des impôts sur la vie et sur la propriété de nos semblables? [xv] Avons-nous bien le droit d'apporter au milieu d'eux la dévastation et le carnage, sous le prétexte d'améliorer non leur sort, qui ne peut que s'aggraver dans la tourmente, mais celui des générations à venir? Avons-nous bien le droit de décimer une génération par la conscription, les mitraillades ou la guillotine, de la ruiner par les assignats, les réquisitions et les contributions de guerre pour augmenter le bien-être des générations futures? Qui nous a rendus ainsi les maîtres de la vie et de la mort? Qui nous a investis du droit d'offrir au Dieu que nous adorons des sacrifices humains? Sommes-nous des prêtres de Jaggernaut (sic) et la vérité est-elle une idole barbare qui ne puisse se frayer un chemin que sur des cadavres? Et si nous nous trompons, si cette théorie que nous prétendons imposer par les baïonnettes et la guillotine, si cette théorie est fausse! Si au lieu de la vérité nous n'en possédons que le vain mirage, de quelle responsabilité terrible n'aurons-nous pas à supporter le poids pour avoir sacrifié des millions de créatures humaines à ce fantôme décevant, à cette ombre engendrée par notre orgueil et notre ignorance? Car si on peut nous contester même le droit d'imposer la vérité, ne nous exposons-nous pas à commettre le plus grand et le moins excusable des crimes en imposant l'erreur?
[xvi]
En second lieu, si nous quittons le terrain des idées pour descendre sur celui des faits, nous trouverons que l'expérience condamne chaque jour davantage la force comme instrument de progrès.
De tous temps, on a troublé et ensanglanté le monde au nom du progrès; mais depuis la fin du siècle dernier, cette mauvaise pratique des temps de barbarie a passé à l'état de système. Tantôt, c'est la monarchie constitutionnelle qu'il s'agit de substituer violemment à la monarchie absolue; tantôt la république qu'il s'agit de mettre à la place de la monarchie constitutionnelle; tantôt encore, c'est un gouvernement étranger qu'on veut renverser pour le remplacer par un gouvernement national; tantôt une nouvelle organisation de la société que l'on veut substituer à l'ancienne. La révolution américaine, la révolution de 1789, les guerres de la République et de l'Empire, les insurrections des colonies espagnoles, les révolutions réussies de 1830 en France et en Belgique, les révolutions avortées en Italie et en Pologne; enfin, la nouvelle série de révolutions et de guerres dont le coup de pistolet du boulevard des Capucines, en 1848, a donné le signal ont eu, toutes, le Progrès pour objet. Toutes aussi pouvaient invoquer des griefs légitimes. Car les gouvernements contre lesquels elles étaient dirigées laissaient évidemment fort [xvii] à désirer. Mais si l'on fait le compte des millions de vies qu'elles ont sacrifiées, des milliards qu'elles ont coûtés, soit par les frais et les ravages immédiats des appareils de destruction qu'elles ont mis en œuvre, soit par les crises qu'elles ont occasionnées; si encore de la sphère des intérêts matériels on passe à celle des intérêts moraux et que l'on fasse le compte des atteintes portées à la moralité générale par la pratique du meurtre, du pillage et des confiscations en masse, on se convaincra qu'à tous égards le bilan de ces révolutions se solde en déficit; que si elles ont emporté quelques-uns des obstacles qui obstruaient la route du progrès, elles ont ralenti en revanche la marche des sociétés, en décimant les populations, en dévorant leurs capitaux actuels et en hypothéquant leurs capitaux futurs par les emprunts publics, qu'elles ont enfin abaissé l'étalon de leur moralité en propageant dans leur sein les habitudes de la violence et de la spoliation. En faisant, pour tout dire, l'inventaire complet de ces révolutions, si légitimes qu'aient pu être les griefs qu'elles avaient pour objet de redresser, en comparant ce qu'elles ont coûté avec ce qu'elles ont rapporté, on se convaincra certainement que leur passif matériel et moral dépasse de beaucoup leur actif et on les condamnera comme des banqueroutes de la civilisation.
[xviii]
— Mais, objectent les adeptes de l'école de la force, supposons que ces révolutions et ces « guerres pour une idée » n'eussent pas eu lieu; supposons que les amis du progrès se fussent interdit de recourir à la force pour le faire prévaloir, les nations ne seraient-elles pas demeurées au point où elles étaient il y a un siècle? Nous avons marché dans le sang et à travers les ruines, cela est vrai; mais nous avons marché. Eussions-nous mieux fait de demeurer immobiles?
— Vous attribuez, répondrons-nous, aux révolutions et aux guerres révolutionnaires, les progrès que la société a réalisés depuis un siècle. Êtes-vous bien sûrs que ces progrès ne se soient pas accomplis malgré les révolutions et les guerres? Examinez-les un à un, en appliquant aux faits politiques et économiques la seule méthode qui puisse donner des résultats positifs, la méthode d'observation et d'analyse, et vous vous convaincrez aisément que ces progrès avaient été préparés aux époques où l'ancien Régime subsistait encore; qu'ils étaient en voie d'accomplissement lorsque la tourmente des révolutions et des guerres révolutionnaires a éclaté sur le monde; enfin que la société marchait, qu'elle ne demeurait pas immobile, et que chaque progrès accompli soit dans l'ordre moral, soit dans l'ordre matériel frayait la route à un autre progrès. La société ne serait [xix] donc pas demeurée stationnaire, en admettant qu'elle eût été privée de l'auxiliaire prétendu des révolutions et des guerres « pour une idée. » A quoi nous ajouterons qu'elle aurait marché plus vite si, au lieu de demander à la force le triomphe de leur cause, les hommes du progrès s'en étaient absolument interdit l'usage pour recourir seulement à la propagande pacifique, si, en prenant le progrès pour but, ils avaient pris pour moyen non la force, mais la persuasion.
Citons deux exemples à l'appui, l'un choisi dans les temps anciens, l'autre à l'époque actuelle.
Le premier et le plus significatif, c'est l'exemple du christianisme. A l'époque où cette nouvelle doctrine religieuse apparut dans le monde, les circonstances étaient certes peu favorables à la propagande pacifique. Il fallait lutter à la fois contre des difficultés matérielles et des difficultés morales qui pouvaient sembler insurmontables. Les moyens de circulation pour les hommes étaient lents, et pour les idées plus lents encore. Le paganisme était tout puissant et il avait pour appui d'un côté la forte organisation de l'Empire romain, de l'autre les appétits brutaux et l'ignorance des masses. Il fallait que les apôtres de la foi nouvelle, après avoir surmonté l'obstacle des distances et de l'insuffisance des moyens matériels de [xx] propagande, se résignassent à être lapidés par le peuple ou livrés aux bêtes par les Césars. Cependant, le christianisme, précisément parce qu'il s'interdisait l'emploi de la force, vint à bout de tant d'obstacles et il acquit, par cette libre conquête des âmes, un ascendant moral que ses fautes et ses crimes, son intolérance et sa corruption, résultats de son alliance impie avec la force, ont pu affaiblir plus tard, mais qu'ils n'ont pu réussir encore à effacer.
Eh bien! si la propagande pacifique a pu donner ces résultats éclatants il y a dix-huit siècles, dans un temps où les instruments matériels qui lui servaient d'auxiliaires étaient si imparfaits, et où l'éducation intellectuelle et morale des masses était si peu avancée, que ne pouvons-nous pas attendre d'elle aujourd'hui ? Les moyens matériels de propagande ont acquis une puissance et un développement qui tiennent du prodige. Nous avons la vapeur pour transporter les hommes, la presse et l'électricité pour transporter et propager les idées. Grâce à ces outils merveilleux de la circulation, une idée peut se répandre aujourd'hui plus rapidement dans le monde civilisé tout entier qu'elle ne le pouvait autrefois dans une seule province ou dans un canton. En outre, les idées nouvelles trouvent partout pour les accueillir une classe chaque jour plus nombreuse d'esprits avides de [xxi] lumières et sympathiques à tout progrès. L'opinion publique subit leur impulsion et malgré la routine, malgré la résistance des intérêts et des préjugés, elle finit toujours par accepter et par faire prévaloir les idées vraiment justes, vraiment progressives. Sans doute, il y a encore des pays où toutes les voies ne sont pas ouvertes à la propagande pacifique, où les idées nouvelles, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, sont arrêtées par une douane intellectuelle, restrictive ou prohibitive. Mais il en est des idées comme des produits matériels; quand on refuse de les laisser passer librement, elles passent en fraude, et la contrebande qui s'en fait est d'autant plus active que la prohibition dont elles sont l'objet est plus rigoureuse. Nulle part donc la propagande pacifique ne rencontre plus d'obstacles qu'elle ne puisse surmonter et qu'elle ne surmonte. D'ailleurs, en rencontrât-elle, le progrès se ferait encore. Car il en est des institutions comme des machines : quand les nouvelles sont vraiment supérieures aux anciennes, quand elles constituent un progrès réel, elles s'imposent par la force des choses, et soit par la propagande directe de la vérité, soit par le rayonnement naturel de la vérité, le progrès s'accomplit.
N'en avons-nous pas eu un exemple merveilleux, et [xxii] c'est le second que nous nous proposions de citer, dans l'agitation anglaise pour la liberté commerciale? Quelques hommes obscurs, mais pleins de foi dans leur idée se réunissent pour attaquer le monopole des lois céréales, que l'aristocratie la plus riche et la plus puissante du globe considérait comme le fondement même de sa grandeur. D'abord, leur entreprise est taxée de chimérique et ils parlent dans le vide. Ils ne se laissent point décourager. Ils se servent sans relâche de la parole et de la presse pour gagner des partisans à leur cause et, au bout de dix ans, ils obtiennent, non seulement l'abolition des lois-céréales, mais encore celle du système protecteur tout entier. Mieux encore. Cette réforme pacifiquement accomplie se répercute dans le reste du monde : partout des réformes douanières sont entamées à l'imitation des réformes anglaises, et sans les révolutions et les guerres qui sont venues se mettre en travers de l'œuvre des réformateurs, le monde jouirait aujourd'hui du bienfait de la liberté commerciale. En présence de ces résultats du procédé de la force se servant des baïonnettes, au besoin même de la guillotine pour frayer la voie aux idées, et répandant dans le monde la dévastation et le carnage pour le faire progresser, et du procédé de la persuasion qui s'adresse à la raison, à l'esprit de justice, et dont les victoires plus [xxiii] complètes et plus sûres que celles de la force ne coûtent aucune larme à l'humanité, nous n'hésitons point. Nous repoussons de toute notre énergie l'intervention de la force pour imposer les idées; nous nous en tenons à l'emploi exclusif de la persuasion pour les faire accepter. Nous sommes, dans l'intérêt bien entendu du progrès, hostile à toute révolution, si légitime qu'elle puisse paraître, et nous considérons les révolutionnaires comme des esprits arriérés qui, en mettant au service de la Civilisation les procédés de la Barbarie, ralentissent ses progrès au lieu de les accélérer. Alors même que les doctrines dont ils se font les apôtres armés se confondraient avec les nôtres; alors même qu'ils travailleraient comme nous à dégager la liberté et la propriété de leurs entraves séculaires, au lieu de les renforcer et de les étendre, nous répudierions leur concours. Car ils suivent la tradition du Koran, tandis que nous suivons celle de l'Évangile.
[xxiv]
III
Les travaux qui forment la matière des deux volumes que nous publions aujourd'hui ne sont qu'un développement de ces idées.
Dans la première partie (l'équilibre du monde économique) nous nous sommes appliqué à mettre en lumière la grande loi qui gouverne la production et la distribution de la richesse; nous avons montré comment la production naît et se développe d'une manière harmonique, à mesure qu'elle est sollicitée par les besoins de la consommation, dans l'ordre et dans la proportion de ces besoins, sans pouvoir les dépasser ni demeurer en dessous, au moins d'une manière permanente; comment encore, sous l'influence de la même loi d'équilibre qui règle le développement de la [xxv] production, la justice tend incessamment et d'elle-même à s'établir dans la distribution des richesses; comment les profits des différentes branches de l'industrie humaine et les rémunérations de leurs agents productifs, travail, capital et agents naturels appropriés, tendent, en vertu d'une force irrésistible, à se mettre en équilibre, de manière à attribuer à chacun la juste part qui lui revient dans les résultats de la production.
Cette loi d'équilibre, qui agit par le moyen des quantités et des prix, et que nous avons pour cette raison désignée sous le nom de loi des quantités et des prix, a pour condition la liberté. Il faut que la production soit libre pour pouvoir se développer toujours conformément aux besoins de la consommation et dans la mesure de ces besoins; il faut de même qu'aucun obstacle ne vienne entraver les mouvements ou l'échange des produits et des agents productifs, ou interdire leur accès quand il s'agit de capitaux immobiliers, pour que la distribution de la richesse puisse s'opérer d'une manière conforme à la justice. Toute restriction opposée à la liberté ou à la propriété, n'est pas seulement inutile en ce sens que la production et la distribution de la richesse tendent d'elles-mêmes, par une impulsion naturelle, à s'opérer de la manière la plus utile et la plus équitable, elle est encore nuisible en ce sens qu'elle [xxvi] empêche ou qu'elle trouble l'action du mécanisme naturel qui fait graviter le monde vers l'abondance et la justice.
Cela étant, en quoi doit consister l'œuvre des amis du progrès? Elle doit consister uniquement à détruire les entraves que des intérêts étroits et égoïstes, des passions aveugles ou des préjugés à courte vue ont opposés depuis des siècles à la liberté et à la propriété. Restituer aux hommes la liberté de travailler, de s'associer, d'échanger, de prêter, de donner, la libre jouissance et la libre disposition de leurs propriétés, en empêchant simplement les uns d'empiéter sur la liberté et sur la propriété des autres, et pour éviter d'attenter à la liberté et à la propriété sous prétexte de les garantir, en se bornant à réprimer les atteintes qui y sont portées, voilà ce qu'il y a à faire aujourd'hui, rien de moins, mais aussi rien de plus!
Pour rendre aussi saisissable que possible cette démonstration capitale, nous avons passé en revue les différentes branches de l'activité humaine et nous avons examiné quelle influence exercent sur elles les entraves, les restrictions et les charges de tous genres dont on les a accablées, tantôt dans des intentions simplement et naïvement spoliatrices, tantôt encore, et plus souvent en vue de les protéger. Comme résultats de cet examen, [xxvii] nous avons constaté que partout les restrictions ou les interventions artificielles dans le domaine de la production et de la distribution des richesses, ont ralenti l'une et faussé l'autre, soit qu'il s'agisse de l'industrie agricole ou manufacturière, soit qu'il s'agisse encore de l'enseignement, des cultes et des arts, soit enfin même qu'il s'agisse de cette industrie spéciale qui a pour objet de procurer à toutes les autres branches de la production la sécurité qui leur est indispensable. Nous sommes convaincu que cette industrie, qui est la branche essentielle des attributions gouvernementales, est destinée à passer, tôt ou tard, du régime du monopole ou de la communauté forcée au régime de la liberté pure et simple, et que tel sera le « couronnement de l'édifice » du progrès politique et économique. En un mot, nous croyons que tout ce qui est organisation imposée, rapports forcés, doit faire place à l'organisation volontaire, aux rapports libres.
Si nous sommes dans le vrai sur ce point, si la liberté est destinée à se substituer à la contrainte et au monopole dans toutes les branches de l'activité humaine, on conçoit que la Paix puisse s'établir d'une manière permanente entre les différentes ramifications de la grande famille humaine. La paix est, en effet, la conséquence naturelle et nécessaire de la liberté. La liberté [xxviii] commerciale, par exemple, rend sans objet les guerres entreprises pour conquérir un marché puisqu'elle rend tous les marchés accessibles à tous; les guerres religieuses n'ont plus de motifs ou de prétextes lorsque chacun peut exercer, sans entraves, le culte particulier dans lequel il a foi; les guerres politiques enfin n'ont plus de raison d'être lorsque chacun, individuellement, peut donner librement sa clientèle à l'établissement dans lequel il a le plus de confiance pour assurer sa liberté et garantir sa propriété. La paix naît ainsi d'elle-même, non d'une organisation artificielle, d'un système quelconque destiné à assurer la paix perpétuelle, mais de l'élimination successive des causes de guerre.
En attendant toutefois que ces causes de conflagrations aient été éliminées, on peut, en s'appuyant sur les vrais principes du droit public, invoquer le droit d'intervention actuellement méconnu par une réaction inévitable de l'opinion contre l'abus qui en a été fait, pour empêcher la guerre et les révolutions de troubler et de désoler le monde. On peut encore diminuer les maux de la guerre en soustrayant, autant que possible à ses atteintes, la propriété et la liberté des particuliers. A l'époque où nous avons abordé cette dernière question (au commencement de la guerre d'Orient), la thèse que [xxix] nous soutenions paraissait entachée d'utopie, et le Journal des Débats entre autres se moquait agréablement des disciples du bon abbé de Saint-Pierre, qui essayaient de prouver que le pillage, le viol et le massacre ne sont pas des nécessités de la guerre. Mais, bientôt après, le gouvernement des États-Unis, en accordant son adhésion à cette prétendue utopie et en proposant de la consacrer par l'accord des puissances, a donné à réfléchir à nos adversaires, et si le respect de la propriété et de la liberté des particuliers en temps de guerre n'a pas passé encore complétement dans le droit des gens, il a du moins gagné du terrain dans l'opinion publique.
Nous avons consacré notre dernière partie à l'examen et à la démonstration du principe de la propriété intellectuelle, question encore fort controversée parmi les économistes eux-mêmes. Les uns refusent, comme on sait, absolument, de reconnaître ce genre de propriété; les autres, tout en admettant la propriété littéraire, repoussent la propriété des inventions. A nos yeux, la propriété intellectuelle, dans ses diverses applications, est aussi légitime et aussi utile que la propriété matérielle; elle sert à assurer une juste et nécessaire rémunération à la catégorie la plus importante des travaux de l'intelligence, à celle qui agit de la [xxx] manière la plus directe pour améliorer le sort de l'espèce humaine en agrandissant la sphère de la civilisation.
En résumé, les questions diverses qui se trouvent exposée dans ces deux volumes gravitent autour d'une même idée, d'un même principe, qu'elles servent à illustrer, savoir que le monde économique obéit comme le monde physique à une loi naturelle d'équilibre en vertu de laquelle la production tend à s'organiser toujours de la manière la plus utile, et la distribution des produits à s'opérer de la manière la plus équitable; qu'il suffit en conséquence d'assurer à chacun des membres de la société le libre usage de son activité et la possession des fruits de cette activité libre, pour arriver au maximum possible de richesse et de justice.
Ainsi donc, établir dans toutes les branches de l'activité humaine la liberté, et garantir la propriété qui n'en est que le corollaire; substituer les rapports libres aux rapports forcés, voilà le but que doivent poursuivre les amis du progrès.
Ce but, ils doivent encore s'en tenir pour l'atteindre à la persuasion et à l'exemple, comme aux moyens les plus efficaces et les plus économiques, dans l'état actuel de la civilisation, de réaliser le progrès au meilleur marché possible.
[xxxi]
Nous ne nous dissimulons pas, au surplus, tout ce que les travaux que nous réunissons aujourd'hui présentent d'incomplet et d'insuffisant. Plusieurs démonstrations, et en particulier celles qui concernent la liberté des cultes et la liberté de gouvernement sont à peine ébauchées, d'autres manquent tout à fait. Nous espérons toutefois que la grandeur et l'harmonie du système dont nous avons esquissé les principaux traits éclateront aux regards, malgré ces lacunes de nos démonstrations, et nous nous croirons suffisamment récompensé de nos peines si nous sommes parvenu à recruter quelques prosélytes de plus à la cause à laquelle nous avons voué notre vie, et dont le Credo peut se résumer en ces mots : la Liberté et la Paix.
I.3. Programme économique: Le libre-échange et la simplification de l'État (1891)↩
Source
Gustave de Molinari, Notions fondamentales d’Économie politique et programme économique (Paris: Guillaumin, 1891).
- III: PROGRAMME ÉCONOMIQUE. CHAPITRE III: PROGRAMME ÉCONOMIQUE Le libre-échange. — L’assurance contre la guerre. La simplification de l’État. pp. 381-96.
Introduction
In this book published late in his career Molinari returns to one of his favorite topics, namely the natural laws of political economy and what impact following or ignoring them will have on human prosperity. The final section of the books is a restatement of the economists’ program and a critique of the socialists’ programme, something he had spent his entire life opposing.
Molinari believes that there are three essential components of the economists’ program: free trade, "L’assurance Contre La Guerre" (guarantees or protection against war), and "la simplification de L’État" (the reduction in the size of the state).
In the first section he summaries the economists’ defence of free trade, how it allows the benefits of competition to have a world-wide reach, and how the gradual spread of peace made more international trade possible as well as making the world trade system more interconnected and mutually dependent and thus more likely to encourage the continued spread of peace. He also reiterates his class analysis of the powerful vested interests who have formed an alliance with the state to pursue mutually beneficial gains at the expense of ordinary taxpayers and consumers: the industrialists and landowners who call for more subsidies and protection, and the state which uses hard to see indirect taxes (les impôts indirects et invisibles) to expand its power and the number of state employees. In spite of this, Molinari is convinced that the pressure of universal competition ("la pression de la concurrence universalisée") had become so strong that its final victory, along with free trade, was unstoppable.
In the second section he continues to defend his 1888 argument in favour of a "League of Neutrals" to help bring an end to the threat of war. In place of the traditional idea of "the law of war" which states had used for centuries to defend their right to go to war, Molinari wants to see a new "le « Droit de la paix »" (the law of Peace) put in its place, which would allow small and neutral powers the right to intervene to prevent larger and more aggressive states going to war against their neighbors. This would include arbitration by an international tribunal as well as organised public opinion to shame violators of the peace in an international forum. By doing this Molinari believed, states could cut the size of their military budgets by at least 90%.
The third section contains his plea for a massive reduction in the size of the state in all the other areas of its activity, so that it would reach its ideal size, namely that of l’État-Gendarme (the nightwatchman state). He believes that the activities of the state should be reduced to the single duty of guaranteeing the life and property of individuals against domestic and foreign risks by charging "les « consommateurs de sécurité »" (the consumers of security) an insurance premium (une prime d’assurance) which competitive forces among "les assureurs" (insurance providers) have lowered to the minimum set by the costs of production of security. This competition will bring better service and lower costs to "cette industrie, les services de la justice et de la police demeurant partout dans un état d’imperfection grossière" (this industry, where the services of providing justice and police protection remain everywhere is a state of rough imperfection). He concludes by stating that his aim is:
| Simplifier l’État, réduire les gouvernements au rôle de producteurs de sécurité, en leur enlevant toutes les attributions et fonctions qu’ils ont usurpées et usurpent chaque jour sur le domaine de l’activité privée, en un mot, substituer à l’État socialiste, en voie de devenir le producteur universel, l’État-Gendarme des pères de l’Économie politique … | To reduce the size of the State, to limit governments to the role of producers of security, by removing from them all the duties and functions which they have stolen and which they (continue to) steal every day from the domain of private activity. In a word to replace the Socialist State, which is in the process of becoming the "universal producer", with the "Nightwatchman State" (advocated by) the fathers of Political Economy … |
Text
[381]
CHAPITRE III
PROGRAMME ÉCONOMIQUE.↩
Le libre-échange. — L'assurance contre la guerre. La simplification de l'état.
I. La concurrence véhicule du progres et régulateur de la production, de la distribution et de la consommation de la richesse. — Ne peut remplir ce double rôle qu'à la condition d'être libre. — Obstacles naturels au libre-échange. — Progres qui ont contribué à les aplanir. — Exhaussement des obstacles artificiels. — Explication de cette contradiction. — L'intérêt fiscal et l'intérêt protectionniste. — Progrès qui ont augmenté les profits de la fiscalité et de la protection. — Puissance actuelle des intérêts fiscaux et protectionnistes. — Faiblesse et désunion de leurs adversaires. — Progres qui agissent en faveur du libre-échange. — L'accroissement du marché général. — La nécessité vitale de l'abaissement des prix de revient. — Que le libre-échange s'impose aux nations concurrentes sous peine de ruine. — II. Comment pourra s'établir l'assurance contre la guerre. — Le Droit des gens et ses progrès. — Le Droit des neutres. — Droit et intérêt des neutres à empêcher la guerre. — Conséquences d'une assurance contre la guerre. — III. Les attributions nécessaires de l'état. — Progrès qui ont permis de les diminuer. — Causes qui ont empêché leur diminution. — Charges qu'elles infligent et nuisances qu'elles déterminent. — L'état-gendarme.
I. Le Libre-échange. — Si le mobile organique de la loi de l'économie des forces: la crainte de la souffrance et l'appât de la jouissance est le propulseur de l'activité individuelle, s'il pousse toutes les créatures vivantes à s'infliger la peine au prix de laquelle elles achètent les choses nécessaires à la [382] conservation de leurs forces vitales, l'expérience démontre cependant qu'à défaut de la pression de la concurrence ce propulseur demeure trop faible pour déterminer l'individu à dépenser le supplément de forces, à s'infliger le supplément de peines qu'exige la découverte ou l'invention des procédés et des instruments propres à lui procurer éventuellement, par l'augmentation de sa capacité productive, une somme de forces vitales plus grande en échange d'une dépense plus petite. C'est la concurrence qui pousse les moins capables à faire cet effort, à se donner cette peine, en les exposant à une souffrance portée à son maximum d'intensité: celle de la destruction. La concurrence apparaît ainsi comme le véhicule nécessaire du progrès. Selon que sa pression est plus ou moins intense, le progrès s'accélère ou se ralentit. Tout obstacle à la concurrence est un obstacle au progrès. De plus, à sa fonction de propulseur, la concurrence joint celle de régulateur: c'est elle qui détermine l'équilibre de la production et de la consommation au niveau du prix nécessaire, la répartition proportionnelle des produits entre les agents productifs et l'attribution de ces produits à leur destination utile, actuelle ou future, en sorte que tout obstacle opposé à son jeu naturel et libre occasionne encore une perturbation, dans la distribution et la consommation, laquelle détermine, à son tour, une déperdition de forces vitales.
Ce double rôle de propulseur du progrès et de régulateur de la production, de la distribution et de la consommation des forces vitales, la concurrence ne peut donc le remplir qu'à la condition d'être libre. Si elle s'exerce en vue de la destruction, il faut que les combattants puissent déployer librement leurs forces, et que rien n'entrave leurs mouvements. Si les plus forts sont chargés de liens, ils seront vaincus et détruits par les plus faibles, et l'espèce subira de ce chef une déperdition de forces. Si la concurrence s'exerce en vue de la production, il faut que les concurrents soient libres non seulement de créer leurs produits ou leurs services, mais encore de les échanger. Si les plus capables, ceux qui produisent le mieux et aux moindres frais sont exclus des marchés d'échange, ou n'y sont admis qu'en payant une taxe, les moins capables demeureront, dans le premier cas, les maîtres du [383] marché; dans le second cas, ils pourront continuer à produire avec un excédent de frais égal au montant de la taxe, ou s'attribuer l'excédent du prix et il en résultera encore une déperdition de forces au détriment de l'espèce. Bref, le « libre-échange » est la condition nécessaire de l'exercice utile de la concurrence.
Les obstacles que rencontre le libre échange sont de deux sortes: naturels et artificiels.
Si l'on considère la diversité du sol, du climat et des productions des différentes régions de notre globe, on reconnaît qu'il existe entre elles une division naturelle du travail, que chaque région peut fournir un certain nombre de produits en plus grande abondance et à moins de frais que les autres; que ses habitants doivent par conséquent trouver profit à en entreprendre la production de préférence, et à se procurer par le procédé de l'échange, ceux qu'elle ne peut créer qu'en moindre abondance et à plus grands frais. C'est en employant ce procédé que l'espèce humaine peut obtenir la plus grande somme de pouvoirs réparateurs de ses forces vitales au prix de la plus petite dépense, et, tout en augmentant ses jouissances et en diminuant ses peines, arriver à son plus complet développement.
Mais dès l'origine, l'extension du procédé de l'échange a rencontré des obstacles difficiles et lents à surmonter, dans le défaut de sécurité et de moyens de communication. L'aire de la sécurité ne s'est agrandie que successivement, dans le cours d'une longue suite de siècles, pendant lesquels chaque nation était obligée de vivre dans l'enceinte fortifiéc de son établissement politique et réduite à se contenter, presque exclusivement, des articles de consommation qu'elle y pouvait produire. Et nous avons vu qu alors même qu'elle aurait pu se procurer à moins de frais ces articles, en employant le procédé de l'échange, la nécessité d'assurer sa subsistance et son travail à une époque où la guerre était la règle et la paix l'exception, lui aurait commandé de les produire elle-même. A ce défaut de sécurité s'ajoutait l'absence ou l'insuffisance des moyens de communication pour empêcher les échanges en dchors des frontières de l'état et même de la province ou du canton. Nous avons vu aussi, par l'opération de quels progrès [384] la sécurité s'est étendue sur la presque totalité de la surface du globe, comment encore, la paix, après avoir été l'exception est devenue la règle; comment, enfin, dans le cours de ce siècle, l'obstacle des distances a été entamé, jusqu'à disparaître pour les communications immatérielles et, de manière à n'en laisser subsister que la plus faible part pour le transport des produits matériels et de l'homme lui-même. A mesure que ces progrès se sont réalisés, la sphère des échanges s'est agrandie, et l'on a vu approcher l'époque où la division naturelle du travail pourrait s'établir entre les différentes parties du globe, au profit général de l'espèce humaine.
Au moment où nous sommes, cette œuvre de la suppression des obstacles naturels qui s'opposent à l'extension des échanges se poursuit plus activement que jamais: l'aire de la sécurité s'agrandit par l'annexion au monde civilisé des vastes régions du continent africain, et, chaque année, des milliers de kilomètres s'ajoutent au réseau des chemins de fer, des lignes de navigation à vapeur, des télégraphes et des téléphones. Cette œuvre libre-échangiste, il importe de le remarquer, n'est pas seulement entreprise par l'industrie privée aussitôt que l'aplanissement d'un obstacle naturel est assez demandé, partant assez utile pour lui procurer un profit rémunérateur, elle l'est fréquemment par les gouvernements lorsque le profit n'est pas suffisant pour rémunérer l'esprit d'entreprise et les capitaux: alors, les gouvernements, s'érigeant en juges souverains de l'emploi des capitaux de leurs sujets, mettent la main sur ces capitaux pour entreprendre des conquêtes africaines et autres, créer ou subventionner des chemins de fer, des lignes de navigation à vapeur et de télégraphic, et étendre ainsi le domaine de l'échange.
Cependant, par une contradiction singulière, tandis que les gouvernements contribuent d'une main, — et ils s'en font gloire — à aplanir les obstacles naturels qui empêchent les échanges entre les peuples, de l'autre main, ils multiplient et exhaussent l'obstacle artificiel des barrières douanières. Cette contradiction s'explique par les impulsions diverses et opposées, au moins dans leurs résultats, auxquelles les gouvernements obéissent.
Ce n'est point dans l'intention humanitaire de contribuer à [385] l'établissement du libre-échange que les gouvernements agrandissent le domaine de la sécurité, créent ou subventionnent des instruments de communication internationale, c'est tout simplement pour donner satisfaction à des groupes d'intérêts influents: intérêts de la classe, au sein de laquelle se recrute principalement le personnel des fonctionnaires civils et militaires, et qui demande l'accroissement continu de son débouché, intérêts des armateurs et des autres entrepreneurs de l'industrie des transports qui disposent d'une influence électorale dans les pays constitutionnels, d'une influence de cour dans les autres.
Ce n'est pas davantage en vue d'empêcher l'établissement du libre-échange que les gouvernements multiplient et exhaussent l'obstacle artificiel des douanes; c'est pour donner satisfaction d'abord à leur intérêt fiscal, ensuite à la coalition des intérêts protectionnistes. Or, il convient de remarquer que, dans l'état actuel des choses, ces deux sortes d'intérêts exercent sur eux une pression de plus en plus vive.
Chaque fois que les gouvernements entreprennent des guerres devenues improductives et dont le compte se solde en conséquence par une perte que la nécessité de déployer une somme croissante de puissance destructive ne manque pas d'aggraver, chaque fois qu'ils augmentent leurs armements, chaque fois qu'ils empiètent sur le domaine de l'activité libre, individuelle ou collective, et remplacent les services privés par des services publics qui ne couvrent pas leurs frais, ils voient s'élever le chiffre de leurs dépenses et se trouvent dans la nécessité d'élever, en proportion, le chiffre de leurs recettes. Ils ont le choix entre deux sortes d'impôts: les impôts directs et visibles, dont le contribuable connaît le montant et qui excitent par là même son mécontentement chaque fois qu'il les paye, et les impôts indirects et invisibles qui renchérissent sans qu'il s'en doute ses articles de consommation, qu'il paie sans s'en apercevoir et dont il lui est impossible, en tous cas, de connaître la charge. Parmi ces impôts invisibles figurent, au premier rang, les droits de douane, qui ont, en outre, l'avantage de satisfaire, avec l'intérêt fiscal, les intérêts protectionnistes, dont l'appui est acquis d'avance au gouvernement qui les établit ou les exhausse. Il y a, à la [386] vérité, un moment où l'intérêt fiscal et l'intérêt protectionniste se séparent et se trouvent en opposition, c'est lorsque le droit de douane vient à dépasser le point où il a son maximum de rendement, mais comme ce point est communément assez élevé pour satisfaire les industries les plus exigeantes, l'accord entre ces deux intérêts se maintient d'habitude.
Nous connaissons la généalogie des intérêts protectionnistes. Ils sont issus de l'état d'insécurité, d'absence ou d'insuffisance des moyens de communication, qui obligeait chaque nation à produire elle-même les articles nécessaires à sa consommation, quand même elle aurait pu se les procurer plus économiquement ailleurs dans les intervalles de paix. A mesure que la sécurité s'est étendue, que les guerres sont devenues plus rares, que l'obstacle des distances a été surmonté, les industries créées ou protégées sous l'empire de cette nécessité ont été exposées à une concurrence de plus en plus pressante de la part des industries similaires de l'étranger, mieux situées ou plus avancées. Dans ce nouvel état des choses, l'intérêt général de la nation commandait de laisser périr celles qui étaient impropres au sol et au climat, et n'avaient pu subsister que grâce à une protection naturelle qui avait disparu et une protection artificielle qui avait cessé d'avoir sa raison d'ètre. Quant aux industries en retard mais naturelles au pays, la pression de la concurrence n'aurait pas manqué de les contraindre à renouveler leur outillage et leurs procédés, et ce progrès eut été d'ailleurs secondé par l'accroissement de la demande des moyens d'échange pour les articles qu'il était désormais plus avantageux d'acheter à l'étranger que de produire dans le pays. Mais cette évolution nécessaire exigeait des efforts et des sacrifices actuels auxquels répugnaient les industriels, pour la plupart routiniers et à courte vue. Au lieu de se protéger eux-mêmes en se mettant au niveau des progrès de leurs concurrents, ils employèrent leur influence politique grandissante à faire remplacer les obstacles naturels en voie d'aplanissement par l'obstacle artificiel des douanes et ils trouvèrent dans l'intérêt fiscal un concours sympathique pour l'accomplissement de cette œuvre rétrograde.
Ainsi s'explique la contradiction qui se manifeste entre la destruction des obstacles naturels, que les gouvernements [387] opèrent pour satisfaire des intérêts influents, et la construction de l'obstacle artificiel des barrières douanières, qu'ils élèvent pour satisfaire d'autres intérêts influents, à commencer par le leur.
Il convient de remarquer encore que la construction et l'exhaussement de ces obstacles artificiels sont devenus plus profitables à l'intérêt fiscal aussi bien qu'aux intérêts protectionnistes, à mesure que les progrès de l'industrie se sont multipliés sous l'influence de l'aplanissement des obstacles naturels et que l'accroissement de la puissance productive des nations a déterminé l'accroissement parallèle de leur puissance de consommation. Ces progrès ont provoqué l'augmentation continue de la demande de nombreux articles que le sol et le climat « nationaux » se refusent obstinément à produire et qu'il faut bien tirer de l'étranger. Même dans les pays où la muraille douanière est la plus haute, le commerce extérieur n'a pas cessé de se développer, grâce à la sagesse de la Providence qui a rendu nécessaires la division du travail et l'échange entre les différentes régions du globe, en dépit de l'imbécillité et de la cupidité des hommes. La douane est devenue, en conséquence, un instrument fiscal de plus en plus productif, et une ressource à laquelle les gouvernements sont de moins en moins disposés à renoncer. Elle est devenue en même temps plus productive comme instrument de protection. Malgré le développement extraordinaire du commerce extéricur depuis l'avènement de la grande industrie, le marché intérieur a conservé, dans la généralité des pays civilisés, une importance supérieure à celle du marché étranger. Dans un pays tel que la France, dont la production agricole et industrielle s'élève annuellement à une trentaine de milliards, il n'y a que trois ou quatre milliards de produits qui soient exportés, en échange des articles que la France ne peut produire ou qu'elle produit avec moins d'économie que l'étranger. Ce marché intérieur dont l'importance est prépondérante, les producteurs ont le choix entre deux procédés pour le défendre: le progrès et la protection. Ils sont naturellement portés à choisir celui qui leur coûte le moins de peine et ils sont d'autant plus excités à l'employer qu'il leur rapporte davantage.
[388]
On voit par là combien sont fortes les positions du parti protectionniste, et combien l'avènement du libre-échange peut sembler éloigné. D'une part, les douanes ont pour appui l'intérêt fiscal des gouvernements, intérêt qui devient chaque jour plus exigeant et auquel la douane procure, chaque jour aussi, une satisfaction croissante; d'une autre part, elles sont défendues par les intérêts, demeurés en majorité, des industries pour lesquelles le marché intérieur est demeuré plus important que le marché étranger.
Cependant, malgré la puissance des étais de soutènement des intérêts fiscaux des gouvernements et des intérêts protectionnistes des industries arriérées, les murailles douanières finiront par être démolies. Elles tomberont bien moins sous l'effort de la propagande libre-échangiste que sous la pression continue et irrésistible du progrès industriel, accéléré par l'aplanissement successif des obstacles naturels. Si étendu que soit le marché national, il ne peut suffire aux industries dont le progrès a décuplé, centuplé même parfois, la puissance productive. Ces industries ont dû chercher et elles ont trouvé un accroissement de débouché dans les pays étrangers que l'extension de la sécurité et l'abaissement des prix de transport leur a ouverts. Il s'est créé ainsi un « marché général » où toutes les nations apportent en concurrence, les unes leurs produits agricoles, les autres leurs produits industriels et artistiques. Au début et aussi longtemps que cet apport est demeuré insuffisant pour satisfaire à la demande, les prix de ce marché se sont maintenus à un niveau assez élevé pour couvrir les frais de production les plus hauts, mais à mesure que les apports se sont accrus et que la concurrence est devenue plus serrée, les prix sont descendus, et le jour n'est pas éloigné où ils ne couvriront plus que les frais de production les plus bas. De là, pour les industries concurrentes, la nécessité de plus en plus pressante d'abaisser leurs prix de revient au minimum sous peine d'être exclues du marché général. Or, les droits de douane ont pour effet inévitable d'exhausser artificiellement les prix de revient, soit qu'ils augmentent les frais d'alimentation, d'entretien et de renouvellement du personnel de la production, partant sa rétribution nécessaire, ou qu'ils élèvent le prix des agents, intruments et matières [389] premières qui constituent le matériel. Cette surélévation artificielle des prix de revient n'aurait, toutefois, d'autre inconvénient que de restreindre le débouché commun si toutes les nations concurrentes protégeaient également leurs différentes industries. Dans ce cas, les conditions de la concurrence demeureraient les mêmes sur le marché général, tous les prix de revient se trouvant surélevés dans la même proportion. Mais il n'en est plus ainsi depuis que l'Angleterre a donné l'exemple de la suppression de la douane protectionniste pour ne conserver qu'une douane fiscale, réduite à son expression la plus simple. L'industrie britannique a acquis alors sur le marché général un avantage équivalent à la somme des frais dont la protection grevait les produits de ses concurrents de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, etc.; en un mot, le libre-échange a été pour elle « une machine à produire à meilleur marché. » La réforme accomplie en Angleterre ayant été imitée par la plupart des autres nations industrielles, cet avantage a été en partie neutralisé, et les produits français, allemands et autres ont pu continuer à soutenir la concurrence des produits anglais sur le marché général. Ils la soutiennent plus difficilement depuis que la réaction protectionniste a réussi à faire relever les tarifs continentaux, et l'on peut prédire, à coup sûr, qu'ils finiraient par être exclus du marché général, si cette réaction des intérêts à courte vue demeurait maîtresse du terrain.
Que conclure de là, sinon que le libre-échange s'impose désormais aux nations, sous peine de décadence et de ruine des industries naturelles et progressives qui sont les sources les plus abondantes de leur richesse. Alors même que les économistes s'abstiendraient de faire de la propagande en faveur de l'abaissement ou de la suppression des tarifs de douane, elles seraient forcées de les démolir sous la pression croissante de la concurrence comme elles ont été forcées, sous la même pression et en dépit de toutes les résistances, de mettre leur vieil outillage au rebut et de le remplacer par des machines à produire à bon marché.
Mais en étendant la pression de la concurrence et en rendant ainsi nécessaire l'abaissement général des frais de la production, le libre-échange a des effets bien autrement [390] considérables que ceux de l'introduction d'une machine perfectionnée. Les frais de production ne consistent pas seulement dans la rétribution des agents et dans le coùt des matériaux employés à la confection du produit, ils sont grevés encore des charges et des servitudes qui sont les frais généraux de l'établissement national. Ces frais généraux s'ajoutent aux frais particuliers qui constituent le prix de revient de tous les produits et services. En soumettant la généralité des branches de la production à la pression de la concurrence universalisée, le libre-échange a non seulement pour effet d'obliger chaque industrie à abaisser ses frais particuliers, par le perfectionnement continu de son outillage et de ses procédés, mais encore de contraindre chaque nation de diminuer ses frais généraux, en réduisant au strict nécessaire les frais d'assurance de la sécurité extérieure, et en simplifiant économiquement son appareil d'administration intérieure. A quoi on peut ajouter qu'il rend plus nécessaire l'amélioration du gouvernement individuel, dont les défectuosités et les vices se traduisent toujours par une déperdition des forces vitales de la nation.
Voilà pourquoi le libre-échange est le premier article de tout programme économique: c'est parce qu'il est la condition indispensable du progrès de la concurrence, qui est le véhicule de tous les autres progrès.
II. L'assurance Contre La Guerre. — Le second article d'un programme économique, c'est la réduction au strict nécessaire de l'énorme appareil de guerre qu'entretiennent et augmentent sans cesse la plupart des états civilisés et qui impose à leurs populations des charges hors de toute proportion avec le service en vue duquel il est établi. Cependant, ce service qui consiste dans la garantie de la sécurité extérieure des états doit être rempli. On va voir comment il pourrait l'être dès à présent par l'application d'un simple progrès du Droit des gens.
Si, comme nous avons essayé de le démontrer, après avoir été productive et nécessaire, la guerre est devenue improductive et nuisible, si elle cause une perte de forces vitales qui n'est plus compensée par un accroissement de la sécurité [391] commune, l'intérèt général et permanent de l'espèce commande de supprimer cette nuisance comme toute autre. De là un nouveau droit, que l'on pourrait nommer le « Droit de la paix », dont nous allons résumer brièvement l'origine et les progrès.
Aussi longtemps que la guerre a été nécessaire à la sécurité du monde civilisé, le Droit de la guerre est demeuré sans limites, quels que fussent les dommages que l'exercice de ce droit utile à la généralité pût imposer aux intérêts particuliers des neutres. Les belligérants avaient le droit, universellement reconnu, d'imposer aux neutres des servitudes plus ou moins dommageables et gênantes, telles que l'interdiction de fournir à leur adversaire des recrues, du matériel de guerre et même d'autres articles, de continuer leur commerce avec les ports déclarés en état de blocus; ils visitaient les navires suspects de transporter de la contrebande de guerre, et allaient jusqu'à saisir les marchandises neutres sous pavillon ennemi et les marchandises ennemies sous pavillon neutre. La guerre étant conforme à l'intérêt général, par conséquent à l'intérêt des neutres eux-mêmes, ils n'étaient fondés à réclamer aucune indemnité pour les dommages particuliers que leur causaient ces servitudes, et, encore moins, d'en empêcher l'établissement.
Mais, à mesure que la prépondérance croissante du monde civilisé a rendu la guerre moins nécessaire à sa sécurité, et que, d'une autre part, le développement de la production et l'extension du commerce international ont augmenté le chiffre des dommages directs ou indirects que toute guerre inflige à la généralité des peuples désormais unis par les liens multiples de l'échange, une réaction s'est opéréc contre le droit de la guerre et les servitudes qu'il impose. Les neutres se sont ligués pour limiter ces servitudes et ils ont réussi, dans le cours des deux derniers siècles, à faire réduire le nombre des articles qualifiés de contrebande de guerre, a interdire la visite de leurs navires de commerce, la confiscation de leurs marchandises sous pavillon ennemi, celle des marchandises ennemies sous leur pavillon, enfin à restreindre le droit de blocus [30]. Cependant, en dépit de ces limitations des servitudes [392] auxquelles les assujettissait le droit de la guerre, l'exercice de ce droit ne leur occasionne pas moins des dommages de plus en plus graves: dommages résultant de la crise financière internationale que suscite désormais toute guerre, dommage causé par l'interruption partielle de leur commerce et, parfois aussi, la privation des matériaux nécessaires à leur industrie: la guerre de la sécession américaine, par exemple, en causant une disette de coton a infligé une perte de plusicurs milliards à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne et aux autres pays manufacturiers et réduit aux plus dures extrémités de la misère les ouvriers auxquels l'industrie cotonnière fournissait leurs moyens d'existence. Ces dommages que le développement des échanges internationaux a rendus inévitables et qui ont cessé d'être compensés par l'accroissement de la sécurité commune, les neutres ont le droit de s'en préserver, et le seul moyen efficace de s'en préserver, c'est d'intervenir pour empêcher les actes nuisibles qui les produisent. Ce droit d'intervention, fondé sur la nuisance qu'elles subissent, ce sont les nations dont les relations internationales ont le plus d'étendue, auxquelles par conséquent la guerre est le plus dommageable, qui sont principalement intéressées à l'exercer. De même qu'elles se sont liguées, à diverses époques, pour faire diminuer ou supprimer les servitudes que leur imposaient les belligérants, elles peuvent se liguer pour supprimer la guerre elle-même. Or, en supposant qu'une « Ligue des neutres », constituée pour le maintien de la paix entre les peuples civilisés, joigne ses forces à celles de tout Etat attaqué par un autre, sous n'importe quel motif ou prétexte, son intervention rendrait la guerre impossible. Cela étant, les lourds appareils de défense et d'agression que les classes intéressées à la prolongation artificielle de l'état de guerre accroissent tous les jours, en invoquant les nécessités de la sécurité extérieure et de la sauvegarde de « l'honneur national», deviendraient, en grande partie, inutiles, et la multitude qui en supporte le poids en exigerait la réduction au strict nécessaire. Ce strict nécessaire ne consisterait plus que dans la force de police destinée à pourvoir à la sécurité intérieure, et dans un contingent apporté à la force internationale, ayant pour mission d'empêcher toute nation civilisée ou non de rompre la paix. La guerre [393] entre les nations étant désormais interdite dans la communauté civilisée comme elle l'est entre les individus dans la communaûté nationale, les différends qui surgiraient entre les états seraient vidés, soit par la voie de l'arbitrage, soit par des tribunaux institués ou reconnus par la Ligue, et aux verdicts desquels elle apporterait sa sanction matérielle. Cette » assurance de la paix « procurerait au monde civilisé toute la sécurité extérieure dont il a besoin, en présence de ce qui reste du monde barbare, et elle réduirait dans la proportion des neuf dixièmes au moins, les frais de son appareil de défense, en lui épargnant les dépenses et les dommages de luttes intérieures, devenues nuisibles après avoir été utiles [31].
III. La Simplification De L'état. — Aussi longtemps que » l'état « a été une forteresse continuellement assiégée ou menacée de l'être, le gouvernement chargé de la défendre a eu et dû avoir pour mission principale d'entretenir et de développer la puissance destructive indispensable à sa sécurité. De cette condition nécessaire d'existence de l'état dérivaient, comme nous l'avons vu, le mode de constitution et les attributions du pouvoir dirigeant, les charges et les servitudes de tout genre qu'il imposait à la population, et auxquelles elle se soumettait pour échapper au péril toujours imminent de la destruction ou de l'asservissement. Ce pouvoir dirigeant devait être investi, pour remplir sa mission, d'une autorité souveraine et d'attributions pour ainsi dire illimitées. La nécessité de pourvoir à la sécurité extérieure de l'état impliquait celle de veiller au maintien de la sécurité intérieure, toute atteinte à la vie et à la propriété des individus, à plus forte raison toute rebellion contre le pouvoir, chargé de sauvegarder l'existence de l'état, étant une cause d'affaiblissement nuisible en tous temps et surtout aux époques et dans les régions où cette » forteresse « était exposée aux attaques d'ennemis nombreux et redoutables. Après avoir pourvu à la constitution et au recrutement d'une garnison capable de déployer la puissance destructive nécessaire à la sécurité [394] extérieure, il fallait organiser une police politique et civile qui assurât l'ordre intérieur. Il fallait encore assurer l'approvisionnement permanent de la forteresse, en protégeant l'agriculture et l'industrie contre la concurrence intermittente de l'étranger, et même, dans le cas fréquent où la concurrence demeurait insuffisante à l'intérieur pour régler utilement les prix, il fallait que le pouvoir dirigeant intervint pour y suppléer, soit en établissant un tarif régulateur, soit en apportant sa sanction aux coutumes qui l'établissaient, de manière à empècher les producteurs, les capitalistes, parfois aussi les ouvriers, d'abuser du monopole naturel que leur valait le défaut de sécurité extérieure et de moyens de communication. Le pouvoir dirigeant était encore fondé à intervenir pour proportionner le nombre des entreprises aux besoins d'un marché limité, se charger de celles auxquelles l'industrie privée ne suffisait point et même pour empêcher, par des lois somptuaires, le gaspillage des revenus des particuliers, source des revenus de l'état. Ces différentes fonctions, il les remplissait avec plus ou moins d'efficacité: l'état, dans lequel elles étaient le mieux remplies, où il était le plus complètement et exactement pourvu à toutes les nécessités qu'impliquait l'état de guerre, avait la plus grande chance de se conserver et de l'emporter sur ses rivaux dans l'arène de la concurrence destructive.
Mais du moment où la sécurité du monde civilisé s'est trouvée assurée, cet appareil de protection pouvait être successivement réduit. Il n'était plus nécessaire de soumettre les » consommateurs de sécurité « aux servitudes politiques et militaires qu'exigeait la production de cet article indispensable, puisqu'ils n'étaient plus exposés au risque de destruction ou d'asservissement que leur faisaient courir les invasions du monde barbare. On pouvait encore renoncer à les soumettre aux servitudes économiques, qui assuraient leurs approvisionnements et leurs moyens d'existence, aux règlements et aux coutumes qui refrénaient des monopoles que l'extension de la sécurité et le développement des communications faisaient disparaître. Tout cet appareil lourd et compliqué devenait nuisible en cessant d'être nécessaire. Les fonctions de l'état pouvaient être simplifiées et réduites à l'assurance de la [395] vie et des biens des individus contre les risques intérieurs et extérieurs, ceux-ci diminués sinon annulés: en même temps la multitude des impôts et charges qu'exigeait la vieille machinery du gouvernement, pouvaient être remplacés par une prime d'assurance que la concurrence entre les assureurs, la servitude politique ayant disparu, aurait fini par abaisser au niveau minimum des frais de production de la sécurité [32]. Nous avons analysé les causes qui ont empêché la réalisation de cette réforme d'un régime qui avait perdu sa raison d'être. Nous avons vu comment les intérêts engagés dans ce régime ont réussi à en conserver les parties essentielles, comment ils ont prolongé artificiellement l'existence de l'état de guerre, maintenu et développé l'appareil de la paix armée, accru au lieu de les réduire les attributions et les fonctions des gouvernements. Mais, nous avons constaté aussi que l'accroissement du nombre des fonctions et des attributions des gouvernements est en opposition avec la loi naturelle de l'économie des forces, que les services publics, l'enseignement, la poste, le télégraphe, etc., etc., sont incapables de soutenir la concurrence des services privés [33]. Non seulement les gouvernements [396]produisent à plus grands frais et en moindre qualité les articles qu'ils ont annexés à celui qui est l'objet naturel de leur industrie, mais la dispersion anti-économique de leurs forces a pour résultat d'enrayer les progrès de cette industrie, les services de la justice et de la police demeurant partout dans un état d'imperfection grossière; enfin, les impôts croissants que nécessite cette prolongation et cette aggravation d'un régime qui a cessé d'avoir sa raison d'être, infligent aux nations civilisées une double charge: celle du tribut qu'ils prélèvent et celle des servitudes fiscales auxquelles ils les assujettissent et qui dépassent fréquemment le poids même du tribut.
Simplifier l'état, réduire les gouvernements au rôle de producteurs de sécurité, en leur enlevant toutes les attributions et fonctions qu'ils ont usurpées et usurpent chaque jour sur le domaine de l'activité privée, en un mot, substituer à l'état socialiste, en voie de devenir le producteur universel, l'état-Gendarme des pères de l'économie politique, tel est le troisième article, et non le moins important, d'un programme économique.
Endnotes
[30] Voir les Questions d'economie politique et de droit public. Progres réalises dans les usages de la guerre. t. II. page 277.
[31] Voir la Morale economique. Appendice. Projet d'association pour l'établissement d'une Ligue des neutres.
[32] Voir Les lois naturelles. L'abolition de la servitude politique. p. 238.
[33] Une demonstration detaillee de l'inferiorite des services publics compares aux services privés, sous le double rapport de la qualite et du prix, exigerait a elle seule un ouvrage spécial. Nous avons esquisse cette démonstration dans les Soirées de la rue Saint-Lazare, et nous n'avons cessé de la poursuivre, depuis plus de quarante ans dans la série de nos publications. Avons-nous besoin d'ajouter qu'elle a éte un des principaux objets des travaux de la plupart des economistes dignes de ce nom, Adam Smith. J. B. Say. Ch. Dunoyer, Bastiat, Joseph Garnier. Tous ont été d'accord pour combattre l'extension des attributions de l'état. Leurs successeurs ont suivi leurs traces, et c'est le merite des économistes français d'avoir résisté résolument au socialisme d'état, aujour d'hui prédominant en Allemagne, en Italie, aux états-Unis, et propagé en Angleterre par l'école de Stuart Mill.
Nous nous bornerons à signaler sur la question generale des attributions de l'état, le Traite d'economie politique, de M. Courcelle Seneuil, les Leçons d'economie politique, de M. Frédéric Passy. les Progres de la science economique, de M. Maurice Block, le Manuel d'economie politique, de M. H. Baudrillart, le Traité d'economie politique, de Charles Lehardy de Beaulieu, l'état moderne et ses fonctions, de M. Paul Leroy Beaulieu, le Socialisme d'état de M. Léon Say. — Sur la question speciale de l'Enseignement, les Lettres sur l'enseignement des colleges, de Ch. Clavel, les articles de M. Rouxel dans le Journal des économistes. Sur l'intervention du gouvernement en matiere de crédit: Le crédit et les banques, de Ch. Coquelin, la Liberte des banques, de Horn, l'Histoire des banques en France, de M. A. Courtois. la Monnaie, le credit et l'impôt, de M. G. du Puynode, etc., etc.
PART II. THE FIRST FORMULATION OF THE THEORY OF ANARCHO-CAPITALISM (1846–1849)↩
II.4. "Un État n'est autre chose qu'une grande compagnie d'assurances mutuelles" (1846)↩
Source
"Le Droit électoral" was originally published in the Courrier français, 23 juillet 1846; reprinted in Questions d'économie politique et de droit public (Paris: Guillaumin; Brussels: Lacroix, 1861), 2 vols. Vol. 2, pp. 271-275 in a section entitled "La liberté de government" (along with a reprint of "De la production de la sécurité" and the SEP debate in the JDE).
Introduction
In this early article for Le Courrier français (23 juillet 1846) Molinari develops a metaphor which later (in 1849) he thinks could become a real possibility, namely that that the state is like "une grande compagnie d'assurances mutuelles" (a large mutual insurance company),that tax payers are like "un actionnaire de la société" (a shareholder in the company), and taxes are like "charges de l’association" (membership dues).
In this early expression of his idea, he thinks the state should charge the shareholders/taxpayers an amount which is proportional to the amount of property to be protected. And like any other publicly owned company the shareholders or their representatives on the Board had the right to say how the company is managed and run. This implied that all French taxpayers should have the right to vote and to have a say in how their taxes/membership dues were being spent.
Of course, this was not how things worked in England or France. As he would later argue in the article "La Production de la sécurité" in February 1849, the English Crown and the aristocracy created a monopoly in the use of violence (or in the "provision of security") which Molinari thought had many features in common with a privileged feudal corporation. The English Revolution forced the crown and the aristocracy to share this monopoly with the Commons who were able to exercise some power to limit taxes, or what he called the "price of security," at least for a short period.
A similar situation existed in the July Monarchy in France. Molinari argued that the 250,000 richest taxpayers (what Bastiat termed "la classe électorale") who were allowed to vote exercised similar monopoly powers over the state as the English Crown and aristocracy did in the 17th century. They controlled the army and the police as well as the votes required to introduce tariff protection and subsidies for the industries from which they made their livelihoods. Molinari thought this was unfair because the vast bulk of the French taxpayers were excluded from any say in how much taxation could be imposed upon them or how this money would be spent. One of the arguments he used in arguing for an expansion of the franchise in France was the idea that the main reason for having a government in the first place was to provide all citizens with a guarantee of security of their persons and property.
Molinari thought there were two ways in which a state acting like a large insurance company might be run: the largest shareholders have a monopoly in running the state, as in France, or the right to vote by shareholders is "à universaliser et à uniformiser le droit électoral" (universalised and made uniform) as in the United States, which runs the risk of seeing the democratic masses imposing a higher tax burden on the wealthiest groups in society:
| Sous l’empire d’un tel système (France), on sait ce qui arrive : les gros actionnaires, les censitaires pourvus du droit électoral, gouvernent la société uniquement à leur profit; les lois qui devraient protéger également tous les citoyens servent à grossir la propriété des forts actionnaires au détriment de la propriété des faibles; l’égalité politique est détruite. (p. 273) | Under the influence of such as system (in France) one knows what happens: the big shareholders, the "censitaires" who have the right to vote, govern society exclusively for their own profit; the laws which should protect all citizens equally serve to expand the property of the strong shareholders at the expense of the weak ones; political equality is destroyed. |
The problem was to find a system which would avoid the weakness of both systems. Molinari thought this could be achieved by having a universal right to vote as in America (where all shareholders could participate in choosing the management of the company) but making the payment of member’s dues (taxes) limited to a fixed proportion of the value of the property which they wanted to protect (such as a flat rate of taxation on income or the value of property). This was in order to prevent a democratic majority of voters voting for confiscatory taxes on the property and income of the rich, which Molinari thought was a major weakness in the American system of government.
These ideas first expressed here have some similarity to the constitutional proposals Molinari would put forward in La République tempérée in 1873 when the new constitution for the Third Republic was being discussed. In that work Molinari proposed two chambers, an upper house elected by the largest tax payers which would have a right of veto on spending bills, and a lower chamber elected by universal suffrage, with an executive with very limited powers elected by both chambers.
Text
[271]
Les hommes se réunissent en société dans le but de garantir la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. Un État n'est autre chose qu'une grande compagnie d'assurances mutuelles.
Tout homme qui consent à faire partie d'une société, tout homme qui veut jouir des avantages que la société assure à ses membres doit naturellement contribuer aux charges de l'association; il doit contribuer à l'entretien du gouvernement chargé par la société d'établir la sécurité au profit de tous.
Tous les membres de l'association ont droit à une égale protection de la part du gouvernement. Tous cependant ne contribuent point d'une manière égale aux dépenses publiques.
L'inégalité qui existe dans la répartition des charges dérive de l'inégalité qui existe dans les facultés humaines et dans l'inégalité des fortunes, qui en est la conséquence naturelle.
[272]
Tous les hommes n'étant point doués de facultés égales, tous n'obtiennent point par le travail de ces facultés des valeurs égales. Dans une société où rien ne viendrait troubler le libre emploi des facultés humaines, la richesse des divers membres de l'association serait proportionnée à l'étendue et à la puissance des facultés de chacun.
Les richesses ou propriétés étant inégales, l'État consacre naturellement à leur protection des sommes inégales. En général, il dépense pour la protection de chaque propriété une somme proportionnée à la valeur qu'il protège ou qu'il assure.
De là, la combinaison du principe de la proportionnalité des charges publiques avec le principe de l'égalité de protection.
Maintenant il s'agit de savoir dans quelle mesure les citoyens également protégés par le gouvernement, mais inégalement grevés pour contribuer à l'entretien du gouvernement, doivent prendre part à la gestion des affaires publiques.
Tout citoyen qui paie une part dans les charges publiques est un actionnaire de la société. Il contribue au maintien de la société dans la proportion de la valeur de son action, dans la proportion de l'impôt qu'il paie.
Dans toute association bien organisée, les droits d'un actionnaire sont proportionnels à la valeur de sa mise de fonds. Une mise de fonds représente en effet une certaine quantité de travail dont l'actionnaire se dessaisit volontairement, mais à la condition d'en diriger et d'en surveiller l'emploi. Si ce pouvoir de direction, de surveillance ne répondait pas à la mise de chacun, si, par exemple, les actionnaires dont la mise est égale à deux ne possédaient point un pouvoir de direction et de surveillance plus considérable que ceux dont la mise ne vaut que [273] un, évidemment il y aurait injustice, inégalité; il y aurait d'une part diminution, et d'une autre part augmentation irrationnelle de droits; il y aurait spoliation des travailleurs plus intelligents et plus actifs au profit des travailleurs moins intelligents et moins actifs.
En suivant cet ordre d'idées, on arrive irrésistiblement à cette conclusion : que le droit électoral, le droit de prendre part à la gestion des affaires de cette grande compagnie d'assurances mutuelles que l'on nomme une société est proportionnel et par conséquent doit être proportionné à la mise de chaque actionnaire, c'est à dire à l'impôt prélevé sur chaque citoyen.
Cette proportionnalité du droit électoral, bien loin de nuire à l'égalité politique, comme on l'a affirmé à tort, en est la plus sûre, la plus forte garantie.
En dehors de cette proportionnalité équitable et nécessaire, il n'y a en effet que deux systèmes également contraires à l'égalité politique.
Le premier consiste à refuser tout droit électoral aux plus faibles actionnaires de la société, aux citoyens qui paient la plus faible somme d'impôt. Sous l'empire d'un tel système, on sait ce qui arrive : les gros actionnaires, les censitaires pourvus du droit électoral, gouvernent la société uniquement à leur profit; les lois qui devraient protéger également tous les citoyens servent à grossir la propriété des forts actionnaires au détriment de la propriété des faibles; l'égalité politique est détruite.
Le second système consiste à universaliser et à uniformiser le droit électoral. Dans ce système, un inconvénient opposé à celui qui vient d'être signalé se produit : les propriétés des hommes d'intelligence et de travail se trouvent à la merci de la masse des incapables et des paresseux. Aucun respect des droits [274] acquis, aucune protection efficace pour la vie et la propriété de chacun ne peut subsister sous un tel régime. Or, quand les droits des citoyens cessent d'être efficacement protégés, quand le caprice des masses prévaut sur la loi, quand il arrive, comme aux États-Unis, par exemple, que la crainte de déplaire au peuple paralyse le libre exercice du droit des individus, que devient l'égalité politique?
Conséquence naturelle de la proportionnalité des charges publiques, la proportionnalité du droit électoral est donc, nous le répétons, la véritable garantie de l'égalité politique et, par conséquent, la seule base rationnelle du gouvernement chargé de la maintenir.
Il nous reste maintenant à examiner les moyens d'appliquer ce système.
Sans doute, il est impossible aujourd'hui d'évaluer la quotité de l'impôt payé par chaque citoyen; mais, en revanche, on peut évaluer le revenu de chacun. Tout citoyen disposé à jouir du droit électoral peut faire connaître et faire vérifier la quotité de son revenu. Or, en principe du moins, l'impôt représentant une fraction proportionnelle du revenu de chacun, il est indifférent de prendre pour base du droit électoral le revenu ou l'impôt.
Nous savons bien que dans la pratique l'impôt n'est pas exactement proportionnel au revenu de chacun, mais c'est là un vice de notre machine fiscale dont nous croyons qu'il est inutile de tenir compte, en présence du résultat général que donnerait l'application de ce système.
On évalue le revenu de la France à 8 ou 9 milliards. Le revenu total de la classe actuelle des censitaires (en prenant pour moyenne un revenu de 10,000 fr., somme évidemment exagérée) ne dépassant pas en conséquence la somme de 2 [275] milliards 500 millions, si le droit électoral se trouvait à la fois universalisé et proportionnalisé, les censitaires actuels ne nommeraient plus qu'un quart de la représentation nationale.
Quelles que fussent donc les inégalités particulières , inégalités que la généralisation du principe de liberté ferait au reste promptement disparaître, les droits des masses recevraient inévitablement par l'application de ce système une satisfaction sérieuse et immédiate, sans toutefois que les droits de la minorité aujourd'hui privilégiée se trouvassent sacrifiés.
II.5. "La Production de la sécurité" (1849)↩
Source
Gustave de Molinari, "De la production de la sécurité," in Journal des Economistes, Vol. XXII, no. 95, 15 February, 1849, pp. 277-90.
First Translation: Gustave de Molinari, The Production of Security, trans. J. Huston McCulloch, Occasional Papers Series #2 (Richard M. Ebeling, Editor), New York: The Center for Libertarian Studies, May 1977. It can be found in various formats at the Mises Institute website online.
My revised translation: online.
Introduction
This breakthrough article which Molinari published in the JDE in February 1849 is the first explicit statement of the anarcho-capitalist position ever written, namely that private companies acting competitively in a free market could and should provide the public goods of police and national defense which were normally reserved as a monopoly of the state.
The intellectual leap he made from his 1846 article to this one was to stop thinking metaphorically, that society was "like" an insurance company and that taxpayers were "like" share holders in that company, and to see it as an actual possibility that real insurance companies could sell premiums to willing customers for specific services which could be agreed upon contractually in advance and provided competitively on the free market.
This article was his first attempt to explore the possibilities which this new way of thinking about government opened up; the second would be S11 in the book Les Soirées de la rue Saint-Lazare, and the third would be a lengthy section on "La Consommation publique" (Public Consumption) in the Cours d’économie politique which was published six years after Les Soirées.
In this article Molinari make the case that "la production de la sécurité" (the production of security) was just any another government monopoly which should be liberalized. He turns the counter-argument on its head by challenging the economists, who want to de-monopolize nearly everything the government does, to justify why they have made this important exception to the general principle. Why should there be a government monopoly in this case when the theory of political economy shows conclusively that monopolies lead to higher prices, lack of innovation, poor service to consumers, and high profits for a privileged protected minority?
Some inspiration no doubt came from a passage in Adam Smith’s Wealth of Nations (which Molinari quotes several times in his many works) where he talks about competing courts in England where litigants could shop around for a court which best suited their needs and which would charge fees according to the type of case involved. [1] This was a clear example of how legal services could be provided on the free market between competing institutions for profit. Given the powerful need for protection of person and property felt by consumers ("les consommateurs de sécurité"), and the fact that there were individuals who had the knowledge and skill to provide protection services for a fee ("les producteurs de sécurité"), Molinari thought it was inevitable that an individual or association of individuals would emerge as a producer of security to do just that.
In this article Molinari does not yet talk about "les compagnies d’assurances" (insurance companies) providing security services (this would come later in his book Les Soirées de la rue Saint-Lazare published later that same year) but refers to "un simple entrepreneur" (a simple entrepreneur) or "une compagnie" which would be "le producteur (de la sécurité)" (the producer of security) and "les consommateurs (de la sécurité)" (the consumers of security) who would pay for it with "une prime" (a premium).
In a key passage Molinari even spelled out some of the terms and conditions which a budding security entrepreneur in "l'industrie de la sécurité" (the security industry) would have to offer consumers in order to get their business and to provide an effective service:
| 1.) Que le producteur établisse certaines peines contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs des propriétés, et que les consommateurs acceptent de se soumettre à ces peines, au cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés; | 1.) that the producer (of security) would establish certain penalties for those who committed offences against individuals and those who violated property, and that the consumers (of security) (would) accept being subjected to these penalties in the case where they themselves committed these abuses against person or property; |
| 2.) Qu’il impose aux consommateurs certaines gênes, ayant pour objet de lui faciliter la découverte des auteurs de délits; | 2.) that (the producer of security) would impose on the consumers (of security) certain obligations for the purpose of assisting it (the producer) in discovering the perpetrators of the crimes/offences |
| 3.) Qu’il perçoive régulièrement, pour couvrir ses frais de production ainsi que le bénéfice naturel de son industrie, une certaine prime, variable selon la situation des consommateurs, les occupations particulières auxquelles ils se livrent, l’étendue, la valeur et la nature de leurs propriétés. | 3.) that (the producer of security) would regularly impose a certain premium to cover its costs of production as well as the normal profit (le bénéfice naturel) for its industry, which would vary according to the situation of the consumers, their particular occupations in which they were engaged, and the extent, value, and nature of their property |
This key passage would be changed slightly in S11 where Molinari replaced the terms "le producteur" (the producer of security) with "les compagnies d’assurances" (insurance companies) and "les consommateurs" (consumers) with "les assurés" (the insured). The word "prime" (premium) remained the same in both cases. He would return to the terms he originally used in the "La production de la sécurité" article when he quoted this passage in L´Esquisse (1899).
Endnotes
[1] Adam Smith, Wealth of Nations , V.i.b. part ii: Of the Expence of Justice. See my online version the first edition of Smith’s Wealth of Nations (1776), vol. 2, pp. 324-26 online.
Text
DE LA PRODUCTION DE LA SÉCURITÉ [1]
[277]
Il y a deux manières de considérer la société. Selon les uns, aucune loi providentielle, immuable, n'a présidé à la formation des différentes associations humaines; organisées d'une manière purement factice par des législateurs primitifs, elles peuvent être, en conséquence, modifiées ou refaites par d'autres législateurs, à mesure que la science sociale progresse. Dans ce système le gouvernement joue un rôle considérable, car c'est au gouvernement, dépositaire du principe d'autorité, qu'incombe la tâche de modifier, de refaire journellement la société.
Selon les autres, au contraire, la société est un fait purement naturel; comme la terre qui la supporte, elle se meut en vertu de lois générales, préexistantes. Dans ce système, il n'y a point, à proprement parler, de science sociale; il n'y a qu'une science économique qui étudie l'organisme naturel de la société et qui montre comment fonctionne cet organisme.
Quelle est, dans ce dernier système, la fonction du gouvernement et son organisation naturelle, voilà ce que nous nous proposons d'examiner.
I.
Pour bien définir et délimiter la fonction du gouvernement, il nous faut rechercher d'abord ce que c'est que la société et quel est son objet.
[278]
À quelle impulsion naturelle obéissent les hommes en se réunissant en société? Ils obéissent à l'impulsion ou, pour parler plus exactement, à l'instinct de la sociabilité. La race humaine est essentiellement sociable. Comme les castors et, en général, comme les espèces animales supérieures, les hommes sont portés d'instinct à vivre en société.
Quelle est la raison d'être de cet instinct?
L'homme éprouve une multitude de besoins à la satisfaction desquels sont attachées des jouissances et dont la non-satisfaction lui occasionne des souffrances. Or, seul, isolé, il ne peut pourvoir que d'une manière incomplète, insuffisante à ces besoins qui le sollicitent sans cesse. L'instinct de la sociabilité le rapproche de ses semblables, le pousse à se mettre en communication avec eux. Alors s'établit, sous l'impulsion de l'intérêt des individus ainsi rapprochés, une certaine division au travail, nécessairement suivie d'échanges; bref, on voit se fonder une organisation; moyennant laquelle l'homme peut satisfaire à ses besoins, beaucoup plus complétement qu'il ne le pourrait en demeurant isolé.
Cette organisation naturelle se nomme la société.
L'objet de la société, c'est donc la satisfaction plus complète des besoins de l'homme; le moyen, c'est la division du travail et l'échange.
Au nombre des besoins de l'homme, il en est un d'une espèce particulière et qui joue un rôle immense dans l'histoire de l'humanité, c'est le besoin de sécurité.
Quel est ce besoin?
Soit qu'ils vivent isolés ou en société, les hommes sont, avant tout, intéressés à conserver leur existence et les fruits de leur travail. Si le sentiment de la justice était universellement répandu sur la terre ; si, par conséquent, chaque homme se bornait à travailler et à échanger les fruits de son travail, sans songer à attenter à la vie ou à s'emparer, par violence ou par ruse, des fruits du travail des autres hommes; si chacun avait, en un mot, une instinctive horreur pour tout acte nuisible à autrui, il est certain que la sécurité existerait naturellement sur la ferre, et qu'aucune institution artificielle ne serait nécessaire pour la fonder. Malheureusement il n'en est point ainsi. Le sentiment de la justice semble n'être l'apanage que de certaines natures élevées, exceptionnelles. Parmi les races inférieures, il n'existe qu'à l'état rudimentaire. De là, les innombrables atteintes portées depuis l'origine du monde, depuis l'époque de Caïn et Abel, à la vie et à la propriété des personnes.
De là aussi, la fondation d'établissements ayant pour objet de garantir à chacun la possession paisible de sa personne et de ses biens.
Ces établissements ont reçu le nom de gouvernements.
Partout, au sein des peuplades les moins éclairées, on rencontre un gouvernement, tant est général et urgent le besoin de sécurité auquel un gouvernement pourvoit.
Partout, les hommes se résignent aux sacrifices les plus durs plutôt que [279] de se passer de gouvernement, partant de sécurité , et l'on ne saurait dire qu'en agissant ainsi, ils calculent mal.
Supposez, en effet ; qu'un homme se trouve incessamment menacé dans sa personne et dans ses moyens d'existence, sa première et sa plus constante préoccupation ne sera-t elle pas de se préserver des dangers qui l'environnent? Cette préoccupation, ce soin, ce travail absorberont nécessairement la plus grande partie de son temps, ainsi que les facultés les plus énergiques et les plus actives de son intelligence. Il ne pourra, en conséquence, appliquer à la satisfaction de ses autres besoins qu'un travail insuffisant, précaire et une attention fatiguée.
Alors même que cet homme serait obligé d'abandonner une partie très-considérable de son temps, de son travail à celui qui s'engagerait à lui garantir la possession paisible de sa personne et de ses biens, ne gagnerait-il pas encore à conclure le marché?
Toutefois, son intérêt évident n'en serait pas moins de se procurer la sécurité au plus bas prix possible.
II.
S'il est une vérité bien établie en économie politique, c'est celle-ci:
Qu'en toutes choses, pour toutes les denrées servant à pourvoir à ses besoins matériels ou immatériels, le consommateur est intéressé à ce que le travail et l'échange demeurent libres, car la liberté du travail et de l'échange ont pour résultat nécessaire et permanent un maximum d'abaissement dans le prix.
Et celle-ci:
Que l'intérêt du consommateur d'une denrée quelconque doit toujours prévaloir sur l'intérêt du producteur.
Or, en suivant ces principes, on aboutit à cette conclusion rigoureuse:
Que la production de la sécurité doit, dans l'intérêt des consommateurs de cette denrée immatérielle, demeurer soumise à la loi de la libre concurrence.
D'où il résulte:
Qu'aucun gouvernement ne devrait avoir le droit d'empêcher un autre gouvernement de s'établir concurremment avec lui, ou d'obliger les consommateurs de sécurité de s'adresser exclusivement à lui pour cette denrée.
Cependant, je dois dire qu'on a, jusqu'à présent, reculé devant cette conséquence rigoureuse du principe de la libre concurrence.
Un des économistes qui ont étendu le plus loin l'application du principe de liberté, M. Charles Dunoyer, pense « que les fonctions des gouvernements ne sauraient jamais tomber dans le domaine de l'activité privée.» [2]
Voilà donc une exception claire, évidente, apportée au principe de la libre concurrence.
Cette exception est d'autant plus remarquable, qu'elle est unique.
Sans doute, on rencontre des économistes qui établissent des exceptions plus nombreuses à ce principe; mais nous pouvons hardiment affirmer que [280] ce ne sont pas des économistes purs. Les véritables économistes s'accordent généralement à dire, d'une part, que le gouvernement doit se borner à garantir la sécurité des citoyens; d'une autre part, que la liberté du travail et de l'échange doit être, pour tout le reste, entière, absolue.
Mais quelle est la raison d'être de l'exception relative à la sécurité? Pour quelle raison spéciale la production de la sécurité ne peut-elle être abandonnée à la libre concurrence? Pourquoi doit-elle être soumise à un autre principe et organisée en vertu d'un autre système?
Sur ce point, les maîtres de la science se taisent, et M. Dunoyer, qui a clairement signalé l'exception, ne recherche point sur quel motif elle s'appuie.
III.
Nous sommes, en conséquence, amenés à nous demander si cette exception est fondée, et si elle peut l'être aux yeux d'un économiste.
Il répugne à la raison de croire qu'une loi naturelle bien démontrée comporte aucune exception. Une loi naturelle est partout et toujours, ou elle n'est pas. Je ne crois pas, par exemple, que la loi de la gravitation universelle, qui régit le monde physique, se trouve en aucun cas et sur aucun point de l'univers suspendue. Or, je considère les lois économiques comme des lois naturelles, et j'ai autant de foi dans le principe de la division du travail et dans le principe de la liberté du travail et de l'échange que j'en puis avoir dans la loi de la gravitation universelle. Je pense donc que si ces principes peuvent subir des perturbations, en revanche, ils ne comportent aucune exception.
Mais, s'il en est ainsi, la production de la sécurité ne doit pas être soustraite à la loi de la libre concurrence; et, si elle l'est, la société tout entière en souffre un dommage.
Ou ceci est logique et vrai, ou les principes sur lesquels se fonde la science économique ne sont pas des principes.
IV.
Il nous est donc démontré à priori, à nous qui avons foi dans les principes de la science économique, que l'exception signalée plus haut n'a aucune raison d'être, et que la production de la sécurité doit, comme toute autre, être soumise à la loi de la libre concurrence.
Cette conviction acquise, que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à rechercher comment il se fait que la production de la sécurité ne soit point soumise à la loi de la libre concurrence, comment il se fait qu'elle soit soumise à des principes différents.
Quels sont ces principes?
Ceux du monopole et du communisme.
Il n'y a pas, dans le monde, un seul établissement de l'industrie de la sécurité, un seul gouvernement qui ne soit basé sur le monopole ou sur le communisme.
[281]
A ce propos nous ferons, en passant, une simple remarque.
L'économie politique réprouvant également le monopole et le communisme dans les diverses branches de l'activité humaine , où elle les a jusqu'à présent aperçus, ne serait-il pas étrange, exorbitant qu'elle les acceptât dans l'industrie de la sécurité?
V.
Examinons maintenant comment il se fait que tous les gouvernements connus soient soumis à la loi du monopole, ou organisés en vertu du principe communiste.
Recherchons d'abord ce qu'on entend par monopole et par communisme.
C'est une vérité d'observation que plus les besoins de l'homme sont urgents, nécessaires, plus considérables sont les sacrifices qu'il consent à s'imposer pour les satisfaire. Or, il y a des choses qui se trouvent abondamment dans la nature, et dont la production n'exige qu'un très-faible travail; mais qui, servant à apaiser ces besoins urgents, nécessaires, peuvent en conséquence acquérir une valeur d'échange hors de toute proportion avec leur valeur naturelle. Nous citerons comme exemple le sel. Supposez qu'un homme ou une association d'hommes réussisse à s'attribuer exclusivement la production et la vente du sel, il est évident que cet homme ou cette association pourra élever le prix de cette denrée bien au-dessus de sa valeur, bien au-dessus du prix qu'elle aurait sous le régime de la libre concurrence.
On dira alors que cet homme ou cette association possède un monopole, et que le prix du sel est un prix de monopole.
Mais il est évident que les consommateurs ne consentiront point librement à payer la surtaxe abusive du monopole; il faudra les y contraindre, et pour les y contraindre, il faudra employer la force.
Tout monopole s'appuie nécessairement sur la force.
Lorsque les monopoleurs cessent d'être plus forts que les consommateurs exploités par eux, qu'arrive-t-il?
Toujours, le monopole finit par disparaître, soit violemment, soit à la suite d'une transaction amiable. Que met-on à la place?
Si les consommateurs ameutés, insurgés, se sont emparés du matériel de l'industrie du sel, il y a toutes probabilités qu'ils confisqueront à leur profit cette industrie, et que leur première pensée sera, non pas de l'abandonner à la libre concurrence, mais bien de l'exploiter, en commun, pour leur propre compte. Ils nommeront, en conséquence, un directeur ou un comité directeur de l'exploitation des salines, auquel ils alloueront les fonds nécessaires pour subvenir aux frais de la production du sel; puis, comme l'expérience du passé les aura rendus ombrageux, méfiants; comme ils craindront que le directeur désigné par eux ne s'empare de la production pour son propre compte, et ne reconstitue à son profit, d'une manière ouverte ou cachée, l'ancien monopole, ils éliront des délégués, des représentants chargés de voter les fonds nécessaires pour les frais de production, [282] d'en surveiller l'emploi, et d'examiner si le sel produit est également distribué entre tous les ayants droit. Ainsi sera organisée la production du sel.
Cette forme d'organisation de la production a reçu le nom de communisme.
Lorsque cette organisation ne s'applique qu'à une seule denrée, on dit que le communisme est partiel.
Lorsqu'elle s'applique à toutes, les denrées, on dit que lé communisme est complet.
Mais que le communisme soit partiel ou complet, l'économie politique ne l'admet pas plus que le monopole, dont il n'est que l'extension.
VI.
Ce qui vient d'être dit du sel n'est-il pas visiblement applicable à la sécurité ; n'est-ce pas l'histoire de toutes les monarchies et de toutes les républiques?
Partout, la production de la sécurité à commencé par être organisée en monopole, et partout, de nos jours, elle tend à s'organiser en communisme. Voici pourquoi.
Parmi les denrées matérielles ou immatérielles nécessaires à l'homme, aucune, si ce n'est peut-être le blé, n'est plus Indispensable, et ne peut, par conséquent, supporter une plus forte taxe de monopole.
Aucune, non plus, ne peut aussi aisément tomber en monopole.
Quelle est, en effet, la situation des hommes qui ont besoin de sécurité? C'est la faiblesse. Quelle est la situation de ceux qui s'engagent è leur procurer cette sécurité nécessaire? C'est la forcé. S'il en était autrement, si les consommateurs de sécurité étaient plus forts que les producteurs , ils n'emprunteraient évidemment point leur secours.
Or, si les producteurs de sécurité sont originairement plus forts que les consommateurs, ne peuvent-ils pas aisément imposer à ceux-ci !e régime du monopole?
Partout, à l'origine des sociétés, on voit donc les races les plus fortes, les plus guerrières, s'attribuer le gouvernement exclusif des sociétés; partout on volt ces races s'attribuer, dans certaines circonscriptions plus ou moins étendues, selon leur nombre et leur force, le monopole de la sécurité.
Et, ce monopole étant excessivement profitable par sa nature même, partout on voit aussi les race» investies du monopole de la sécurité se livrer à des luttes acharnées, afin d'augmenter l'étendue de leur marché, le nombre de leurs consommateurs forcés, partant la quotité de leurs bénéfices.
La guerre était la conséquence nécessaire, inévitable de l'établissement du monopole de la sécurité.
Comme une autre conséquence inévitable, ce monopole devait engendrer tous les autres monopoles.
[283]
En examinant la situation des monopoleurs de la sécurité, les producteurs des autres denrées ne pouvaient manquer de reconnaître que rien ail monde n'était plus avantageux c|Ue le monopole. Ils devaient, en conséquence, être tentés, à leur tour, d'augmenter par le même procédé les bénéfices de leur industrie. Mais pour accaparer, au détriment des consommateurs, le monopole de la denrée qu'ils produisaient, que leur fallait-il? II leur fallait la force. Or, cette force, nécessaire pour comprimer les résistances des consommateurs intéressés, ils ne la possédaient point. Que firent-ils ? Ils l'empruntèrent, moyennant finances, à ceux qui la possédaient. Ils' sollicitèrent et obtinrent, au prix de certaines redevances, le privilège exclusif d'exercer leur industrie dans certaines circonscriptions déterminées. L'octroi de ces privilèges rapportant de bonnes sommes d'argent aux producteurs de sécurité, le monde fut bientôt couvert de monopoles. Le travail et l'échange furent partout entravés, enchaînés, et la condition des masses demeura la plus misérable possible.
Cependant, après de longs siècles de souffrances, les lumières s'étant peu à peu répandues dans le monde, les masses qu'étouffait ce réseau de privilèges commencèrent à réagir contre les privilégiés, et à demander la liberté, c'est-à-dire la suppression des monopoles.
Il y eut alors de nombreuses transactions. En Angleterre, par exemple, que se passa-t-il? La race qui gouvernait le pays et qui se trouvait organisée en compagnie (la féodalité), ayant à sa tête un directeur héréditaire (le roi), et un Conseil d'administration également héréditaire (la Chambre des lords), fixait, à l'origine, au taux qu'il lui convenait de fixer, le prix de la sécurité dont elle avait lé monopole: Entre les producteurs de sécurité et les consommateurs il n'y avait aucun débat. C'était le régime du bon plaisir. Mais, à la suite des temps, les consommateurs, ayant acquis la conscience de leur nombre et de leur force, se soulevèrent contre le régime de l'arbitraire pur, et ils obtinrent de débattre avec les producteurs le prix de la denrée. A cet effet, ils désignèrent des délégués qui se réunirent en Chambre des communes, afin de discuter la quotité de l'impôt, prix de la sécurité. Ils obtinrent ainsi d'être moins pressurés. Toutefois, les membres de la Chambre des communes étant nommés sous l'influence immédiate des producteurs de sécurité, le débat n'était pas franc, et le prix de la denrée continuait à dépasser sa valeur naturelle. Un jour, les consommateurs ainsi exploités s'insurgèrent contre les producteurs et les dépossédèrent de leur industrie. Ils entreprirent alors d'exercer eux-mêmes cette industrie et ils choisirent dans ce but un directeur d'exploitation assisté d'un Conseil. C'était le communisme se substituant au monopole. Mais la combinaison ne réussit point, et, vingt ans plus tard, le monopole primitif fut rétabli. Seulement les monopoleurs eurent la sagesse de ne point restaurer le régime du bon plaisir; ils acceptèrent le libre débat de l'impôt, en ayant soin, toutefois, de corrompre incessamment les délégués de la partie adverse. Ils mirent à la disposition de ces délégués divers emplois de l'administration de la sécurité, et ils allèrent même jusqu'à admettre les plus influents au sein de [284] leur Conseil supérieur. Rien de plus habile assurément qu'une telle conduite. Cependant les consommateurs de sécurité finirent par s'apercevoir de ces abus, et ils demandèrent la réforme du Parlement. Longtemps refusée, la réforme fut enfin conquise, et, depuis cette époque, les consommateurs ont obtenu un notable allégement de leurs charges.
En France, le monopole de la sécurité, après avoir, de même, subi des vicissitudes fréquentes et des modifications diverses, vient d'être renversé pour la seconde fois. Comme autrefois en Angleterre, on a substitué à ce monopole exercé d'abord au profit d'une caste, ensuite au nom d'une certaine classe de la société, la production commune. L'universalité des consommateurs, considérés comme actionnaires, ont désigné un directeur chargé, pendant une certaine période, de l'exploitation, et une assemblée chargée de contrôler les actes du directeur et de son administration.
Nous nous contenterons de faire une simple observation au sujet de ce nouveau régime.
De même que le monopole de la sécurité devait logiquement engendrer tous les autres monopoles, le communisme de la sécurité doit logiquement engendrer tous les autres communismes.
En effet, de deux choses l'une:
Ou la production communiste est supérieure à la production libre, ou elle ne l'est point?
Si oui, elle l'est non-seulement pour la sécurité, mais pour toutes choses.
Si non, le progrès consistera inévitablement à la remplacer par la production libre.
Communisme complet ou liberté complète, voilà l'alternative!
VII.
Mais se peut-il concevoir que la production de la sécurité soit organisée autrement qu'en monopole ou en communisme? Se peut-il concevoir qu'elle soit abandonnée à la libre concurrence?
A cette question les écrivains dits politiques répondent unanimement: Non.
Pourquoi? Nous allons le dire.
Parce que ces écrivains, qui s'occupent spécialement des gouvernements, ne connaissent pas la société; parce qu'ils la considèrent comme une œuvre factice, que les gouvernements ont incessamment mission de modifier ou de refaire.
Or, pour modifier ou refaire la société, il faut nécessairement être pourvu d'une autorité supérieure à celle des différentes individualités dont elle se compose.
Cette autorité qui leur donne le droit de modifier ou de refaire à leur guise la société, de disposer comme bon leur semble des personnes et des propriétés, les gouvernements de monopole affirment la tenir de Dieu [285] lui-même; les gouvernements communistes, de la raison humaine manifestée dans la majorité du peuple souverain.
Mais cette autorité supérieure, irrésistible, les gouvernements de monopole et les gouvernements communistes la possèdent-ils véritablement? Ont-ils, en réalité, une autorité supérieure à celle que pourraient avoir des gouvernements libres? Voilà ce qu'il importe d'examiner.
VIII.
S'il était vrai que la société ne se trouvât point naturellement organisée; s'il était vrai que les lois en vertu desquelles elle se meut dussent être incessamment modifiées ou refaites, les législateurs auraient nécessairement besoin d'une autorité immuable, sacrée. Continuateurs de la Providence sur la terre, ils devraient être respectés presque à l'égal de Dieu. S'il en était autrement, ne leur serait-il pas impossible de remplir leur mission? On n'intervient pas, en effet, dans les affaires humaines, on n'entreprend pas de les diriger, de les régler, sans offenser journellement une multitude d'intérêts. A moins que les dépositaires du pouvoir ne soient considérés comme appartenant à une essence supérieure ou chargés d'une mission providentielle, les intérêts lésés résistent.
De là la fiction du droit divin.
Cette fiction était certainement la meilleure qu'on pût imaginer. Si vous parvenez à persuader à la foule que Dieu lui-même a élu certains hommes ou certaines races pour donner des lois à la société et la gouverner, nul ne songera évidemment à se révolter contre ces élus de la Providence, et tout ce que fera le gouvernement sera bien fait. Un gouvernement de droit divin est impérissable.
A une condition seulement, c'est que l'on croie au droit divin.
Si l'on s'avise, en effet, de penser que les conducteurs de peuples ne reçoivent pas directement leurs inspirations de la Providence même, qu'ils obéissent à des impulsions purement humaines, le prestige qui les environne disparaîtra, et l'on résistera irrévérencieusement à leurs décisions souveraines, comme on résiste à tout ce qui vient des hommes, à moins que l'utilité n'en soit clairement démontrée.
Aussi est-il curieux de voir avec quel soin les théoriciens du droit divin s'efforcent d'établir la surhumanité des races en possession de gouverner les hommes.
Écoutons, par exemple, M. Joseph de Maistre:
« L'homme ne peut faire de souverains. Tout au plus il peut servir d'instrument pour déposséder un souverain et livrer ses Etals à un autre souverain déjà prince. Du reste, il n'a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l'origine plébéienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde.
« ... Il est écrit: C'est moi qui fais les souverains. Ceci n'est point une phrase d'église, une métaphore de prédicateur; c'est la vérité littérale, [286] simple et palpable. C'est une loi du monde politique. Dieu fait les rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales, il les mûrit au milieu d'un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d'honneur; elles se placent.» [3]
D'après ce système, qui incarne la volonté de la Providence dans certains hommes et qui revêt ces élus, ces oints d'une autorité quasi-divine, les sujets n'ont évidemment aucun droit; ils doivent se soumettre, sans examen, aux décrets de l'autorité souveraine, comme s'il s'agissait des décrets de la Providence même.
Le corps est l'outil de l'âme, disait Plutarque, et l'âme est l'outil de Dieu. Selon l'école du droit divin, Dieu ferait choix de certaines âmes et s'en servirait comme d'outils pour gouverner le monde.
Si les hommes avaient foi dans cette théorie, rien assurément ne pourrait ébranler un gouvernement de droit divin.
Par malheur, ils ont complètement cessé d'y avoir foi.
Pourquoi?
Parce qu'un beau jour ils se sont avisés d'examiner et de raisonner, et qu'en examinant, en raisonnant, ils ont découvert que leurs gouvernants ne les gouvernaient pas mieux qu'ils n'auraient pu le faire eux-mêmes, simples mortels sans communication avec la Providence.
Le libre examen a démonétisé la fiction du droit divin, à ce point que les sujets des monarques ou des aristocraties de droit divin ne leur obéissent plus qu'autant qu'ils croient avoir intérêt à leur obéir.
La fiction communiste a-t-elle eu meilleure fortune?
D'après la théorie communiste, dont Rousseau est le grand-prêtre, l'autorité ne descend plus d'en haut, elle vient d'en bas. Le gouvernement ne la demande plus à la Providence, il la demande aux hommes réunis, à la nation une, indivisible et souveraine.
Voici ce que supposent les communistes, partisans de la souveraineté du peuple. Ils supposent que la raison humaine a le pouvoir de découvrir les meilleures lois, l'organisation la plus parfaite qui conviennent à la société ; et que, dans la pratique, c'est à la suite d'un libre débat entre des opinions opposées que ces lois se découvrent; que s'il n'y a point unanimité, s'il y a partage encore après le débat, c'est la majorité qui a raison, comme renfermant un plus grand nombre d'individualités raisonnables (ces individualités sont, bien entendu, supposées égales, sinon l'échafaudage croule); en conséquence, ils affirment que les décisions de la majorité doivent faire loi, et que la minorité est tenue de s'y soumettre, alors même qu'elles blesseraient ses convictions les plus enracinées et ses intérêts les plus chers.
Telle est la théorie; mais, dans la pratique, l'autorité des décisions de la majorité a-t-elle bien ce caractère irrésistible, absolu qu'on lui [287] suppose ? Est-elle toujours, en tous cas, respectée par la minorité? Peut-elle l'être? Prenons un exemple.
Supposons que le socialisme réussisse à se propager parmi les classes ouvrières des campagnes, comme il s'est déjà propagé parmi les classes ouvrières des villes; qu'il se trouve, en conséquence, à l'état de majorité dans le pays, et que, profitant de cette situation, il envoie à l'Assemblée législative une majorité socialiste et nomme un président socialiste ; supposez que cette majorité et ce président, investis de l'autorité souveraine, décrètent, ainsi que le demandait M. Proudhon, la levée d'un impôt de trois milliards sur les riches, afin d'organiser le travail des pauvres, est-il probable que la minorité se soumettra paisiblement à cette spoliation ini~ que et absurde, mais légale, mais constitutionnelle?
Non sans doute, elle n'hésitera pas à méconnaître l'autorité de la majorité et à défendre sa propriété.
Sous ce régime, comme sous le précédent, on n'obéit donc aux dépositaires de l'autorité qu'autant qu'on croit avoir intérêt à leur obéir.
Ce qui nous conduit à affirmer que le fondement moral du principe d'autorité n'est ni plus solide ni plus large, sous un régime de monopole ou de communisme, qu'il ne pourrait l'être sous un régime de liberté,
IX.
Supposez néanmoins que les partisans d'une organisation factice, monopoleurs ou communistes, aient raison; que la société ne soit point naturellement organisée, et qu'aux hommes incombe incessamment la tâche de faire et de défaire les lois qui la régissent, voyez dans quelle lamentable situation se trouvera le inonde. L'autorité morale des gouvernants ne s'appuyant, en réalité, que sur l'intérêt des gouvernés, et ceux-ci ayant une naturelle tendance à résistera tout ce qui blesse leur Intérêt, il faudra que la force matérielle prête incessamment secours à l'autorité méconnue.
Monopoleurs et communistes ont, du reste, parfaitement compris cette nécessité.
Si quelqu'un, dit M. de Maistre, essaye de se soustraire à l'autorité des élus de Dieu, qu'il soit livré au bras séculier, que le bourreau fasse son office.
Si quelqu'un méconnaît l'autorité des élus du peuple, disent les théoriciens de l'école de Rousseau, s'il résiste à une décision quelconque de la majorité, qu'il soit puni comme criminel envers le peuple souverain, que l'échafaud en fasse justice.
Ces deux écoles, qui prennent pour point de départ l'organisation factice, aboutissent donc nécessairement au même terme, à la TERREUR.
X.
Qu'on nous permette maintenant de formuler une simple hypothèse.
[288]
Supposons une société naissante : les hommes qui la composent se mettent à travailler et à échanger les fruits de leur travail. Un naturel instinct révèle à ces hommes que leur personne, la terre qu'ils occupent et cultivent, les fruits de leur travail, sont leurs propriétés, et que nul, hors eux-mêmes, n'a le droit d'en disposer ou d'y toucher. Cet instinct n'est pas hypothétique, il existe. Mais l'homme étant une créature imparfaite, il arrive que ce sentiment du droit de chacun sur sa personne ou sur ses biens ne se rencontre pas au même degré dans toutes les âmes, et que certains individus attentent par violence ou par ruse aux personnes ou aux propriétés d'autrui.
De là, la nécessité d'une industrie qui prévienne ou réprime ces agressions abusives de la force ou de la ruse.
Supposons qu'un homme ou une association d'hommes vienne et dise:
Je me charge, moyennant rétribution, de prévenir ou de réprimer les attentats contre les personnes et les propriétés.
Que ceux donc qui veulent mettre à l'abri de toute agression leurs personnes et leurs propriétés s'adressent à moi.
Avant d'entrer en marché avec ce producteur de sécurité, que feront les consommateurs?
En premier lieu, ils rechercheront s'il est assez puissant pour les protéger.
En second lieu, s'il offre des garanties morales telles qu'on ne puisse redouter de sa part aucune des agressions qu'il se charge de réprimer.
En troisième lieu, si aucun autre producteur de sécurité, présentant des garanties égales, n'est disposé à leur fournir cette denrée à des conditions meilleures.
Ces conditions seront de diverses sortes.
Pour être en état de garantir aux consommateurs pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, et, en cas de dommage, de leur distribuer une prime proportionnée à la perte subie, il faudra, en effet:
1° Que le producteur établisse certaines peines contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs des propriétés, et que les consommateurs acceptent de se soumettre à ces peines, au cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés;
2° Qu'il impose aux consommateurs certaines gênes, ayant pour objet de lui faciliter la découverte des auteurs de délits;
3° Qu'il perçoive régulièrement, pour couvrir ses frais de production ainsi que le bénéfice naturel de son industrie, une certaine prime, variable selon la situation des consommateurs, les occupations particulières auxquelles ils se livrent, l'étendue, la valeur et la nature de leurs propriétés.
Si ces conditions, nécessaires à l'exercice de cette industrie, conviennent aux consommateurs, le marché sera conclu; sinon les consommateurs ou se passeront de sécurité, ou s'adresseront à un autre producteur.
Maintenant si l'on considère la nature particulière de l'industrie de la sécurité, on s'apercevra que les producteurs seront obligés de restreindre [289] leur clientèle à certaines circonscriptions territoriales. Ils ne feraient évidemment pas leurs frais s'ils s'avisaient d'entretenir une police dans des localités où ils ne compteraient que quelques clients. Leur clientèle se groupera naturellement autour du siège de leur industrie. Ils ne pourront néanmoins abuser de cette situation pour faire la loi aux consommateurs. En cas d'une augmentation abusive du prix de la sécurité, ceux-ci auront, en effet, toujours la faculté de donner leur clientèle à un nouvel entrepreneur, ou à l'entrepreneur voisin.
De cette faculté laissée au consommateur d'acheter où bon lui semble la sécurité, naît une constante émulation entre tous les producteurs, chacun s'efforçant, par l'attrait du bon marché ou d'une justice plus prompte, plus complète, meilleure, d'augmenter sa clientèle ou de la maintenir. [4]
Que le consommateur ne soit pas libre, au contraire, d'acheter de la sécurité où bon lui semble, et aussitôt vous voyez une large carrière s'ouvrir à l'arbitraire et à la mauvaise gestion. La justice devient coûteuse et lente, la police vexatoire, la liberté individuelle cesse d'être respectée, le prix de la sécurité est abusivement exagéré, inégalement prélevé, selon la force, l'influence dont dispose telle ou telle classe de consommateurs, les assureurs engagent des luttes acharnées pour s'arracher mutuellement des consommateurs; on voit, en un mot, surgir à la file tous les abus inhérents au monopole ou au communisme.
Sous le régime de la libre concurrence, la guerre entre les producteurs de sécurité cesse totalement d'avoir sa raison d'être. Pourquoi se feraient-ils la guerre? Pour conquérir des consommateurs? Mais les consommateurs ne se laisseraient pas conquérir. Ils se garderaient certainement de faire assurer leurs personnes et leurs propriétés par des nommes qui auraient attenté, sans scrupule, aux personnes et aux propriétés de leurs concurrents. Si un audacieux vainqueur voulait leur imposer la loi, ils [290] appelleraient immédiatement à leur aide tous les consommateurs libres que menacerait comme eux cette agression, et ils en feraient justice. De même que la guerre est la conséquence naturelle du monopole, la paix est la conséquence naturelle de la liberté.
Sous un régime de liberté, l'organisation naturelle de l'industrie de la sécurité ne différerait pas de celle des autres industries. Dans les petits cantons un simple entrepreneur pourrait suffire. Cet entrepreneur léguerait son industrie à son fils, ou la céderait à un autre entrepreneur. Dans les cantons étendus, une compagnie réunirait seule assez de ressources pour exercer convenablement cette importante et difficile industrie. Bien dirigée, cette compagnie pourrait aisément se perpétuer, et la sécurité se perpétuerait avec elle. Dans l'industrie de la sécurité, aussi bien que dans la plupart des autres branches de la production, ce dernier mode d'organisation finirait probablement par se substituer au premier.
D'une part, ce serait la monarchie, de l'autre la république; mais la monarchie sans le monopole, et la république sans le communisme:
Des deux parts ce serait l'autorité acceptée et respectée au nom de l'utilité, et non l'autorité imposée par la terreur.
Qu'une telle hypothèse puisse se réaliser, voilà sans doute ce qui sera contesté. Mais, au risque d'être qualifiés d'utopistes, nous dirons que cela n'est pas contestable, et qu'un attentif examen des faits résoudra de plus en plus, en faveur de la liberté, le problème du gouvernement, de même que tous les autres problèmes économiques. Nous sommes bien convaincus, en ce qui nous concerne, que des associations s'établiront un jour pour réclamer la liberté de gouvernement, comme il s'en est établi pour réclamer la liberté du commerce.
Et nous n'hésitons pas à ajouter qu'après que ce dernier progrès aura été réalisé, tout obstacle factice à la libre action des lois naturelles qui régissent le monde économique ayant disparu, la situation des différents membres de la société deviendra la meilleure possible.
G. DE MOLINARI.
Endnotes
[1] Bien que cet article puisse paraître empreint d'utopie dans ses conclusions, nous croyons, néanmoins, devoir le publier pour attirer l'attention des économistes et des publicistes sur une question qui n'a encore été traitée que d'une manière accidentelle et qui doit, néanmoins, à l'époque où nous sommes, être abordée avec plus de précision. Tant de gens exagèrent la nature et les attributions du gouvernement, qu'il est devenu utile de formuler strictement la circonscription hors de laquelle l'intervention de l'autorité cesse d'être tutélaire et profitable pour devenir anarchique et tyrannique. (Note du rédacteur en chef.)
[2] Dans son remarquable livre De la liberté du travail, t. III, p. 353, éd. Guillaumin.
[3] Du principe générateur des constitutions politiques. — Préface.
[4] Adam Smith, dont l'admirable esprit d'observation s'étendait à toutes choses, remarque que la justice a beaucoup gagné, en Angleterre, à la concurrence que se faisaient les différentes Cours:
« Les honoraires de Cour, dit-il, paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes Cours de justice eu Angleterre. Chaque Cour lâchait d'attirer à elle le plus d'affaires qu'elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles même qui ne tombaient point sous sa juridiction. La Cour du Banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s'était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La Cour de l'Échiquier, préposée pour la levée des deniers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagegements (sic) pour dettes, le plaignant alléguant que, si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu'elles voulaient, et chaque Cour s'efforçait d'attirer le plus de causes qu'elle pouvait au sien, par la diligence et l'impartialité qu'elle mettait dans l'expédition des procès. L'admirable constitution actuelle des Cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie, le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun d'eux s'efforçant à l'envi d'appliquer à toute sorte d'injustice le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi.» (De la Richesse des nations, livre V, chap. Ier.)
II.6. "Du gouvernement et de sa fonction" (1849)↩
Source
Gustave de Molinari, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (Paris: Guillaumin, 1849), The 11th Soirée, pp. 303-337.
Introduction
Six months or so after his JDE article on "La Production de la sécurité" Molinari returned to the topic of the private provision of police and defense in the eleventh "soirée" (chapter) of his book Les Soirées la rue Saint-Lazare which is the form of a discussion between "a Socialist", "a Conservative," and "an Economist" over the course of twelve evenings. The discussion of the private provision of security (in Soirée eleven) takes place in a much broader context developed throughout the book concerning the private and competitive provision of many other public goods as well, such as mineral resources, state owned forests, canals, rivers, city water supplies, the post office, public theatres, libraries; and the ending of private monopolies protected by government licences and heavily regulated professions such as bakeries, butchers, printing, lawyers, brokers, funeral parlors, cemeteries, medicine, teaching, and even brothels.
A new twist which he adds in S11 is that he introduces the radically new idea that an actual insurance company might be the type of private company best suited to providing security services for person and property. In "The Production of Security" article he did not specify exactly what kind of company he had in mind other than general references to small local single entrepreneurs, or larger companies based in towns. In S11 he talks about much larger companies ("vastes compagnies") and even "ces compagnies d’assurances sur la propriété" (these property insurance companies) and how they would have an economic incentive to cooperate with each other in settling disputes between their consumers and compensating them for lost property or violated liberty.
Some of the other issues he deals with in this Soirée are his distinction between free governments and "communist" governments, by which he meant what we might call "communal" or "state monopoly" governments; the pros and cons of centralisation versus decentralisation of state power; his objections to the jury system; and the problem of nationalism.
Molinari’s book aroused considerable opposition in the Political Economy Society where it was debated shortly after it appeared in its October 10, 1849 meeting where not one of those present came to Molinari's defense. [2] This was the first of three such debates Molinari’s writings triggered on the general topic of the legitimate functions of the state. [3] The sentiments of the Society were summed up by its president Charles Dunoyer who concluded that :
| M. de Molinari s'est laissé égarer par des illusions de logique; et que la concurrence entre des compagnies gouvernementales est chimérique, parce qu'elle conduit à des luttes violentes. Or, ces luttes ne finiraient que par la force, et il est plus prudent de laisser la force là où la civilisation l'a mise, dans l'Etat. | Molinari had let himself be mislead by illusions of logic, and that competition between companies exercising government-like functions was utopian because it would lead to violent struggles. Now, these struggles would be resolved only by force, and that it would be more prudent to leave (the use of ) force where civilisation had put it, in (the hands of) the State. |
Endnotes
[2] The minutes of the the October meeting of the Société d'Économie Politique in JDE, October 1849, T. 24, pp.314-316. Dunoyer's comment is on p. 316.
[3] The second was held on January 10, 1850 and the third on February 10, 1850.
Text
[303]
ONZIÈME SOIRÉE
SOMMAIRE: Du gouvernement et de sa fonction. [22] —Gouvernements de monopole et gouvernements communistes.—De la liberté de gouvernement.—Du droit divin.—Que le droit divin est identique au droit au travail.—Vices des gouvernements de monopole.—La guerre est la conséquence inévitable de ce système.—De la souveraineté du peuple.—Comment on perd sa souveraineté.—Comment on la recouvre.—Solution libérale.—Solution communiste.—Gouvernements communistes.—Leurs vices.—Centralisation et décentralisation.—De l’administration de la justice.—Son ancienne organisation.—Son organisation actuelle.—Insuffisance du jury.—Comment l’administration de la sécurité et celle de la justice pourraient être rendues libres.—Avantages des gouvernements libres.—Ce qu’il faut entendre par nationalité.
Le Conservateur.
Dans votre système d’absolue propriété et de pleine liberté économique, quelle est donc la fonction du gouvernement?
[304]
L’Économiste.
La fonction du gouvernement consiste uniquement à assurer à chacun la conservation de sa propriété.
Le Socialiste.
Bon, c’est l’État-gendarme de J.-B. Say.
A mon tour, j’ai une question à vous faire:
Il y a aujourd’hui, dans le monde, deux sortes de gouvernements: les uns font remonter leur origine à un prétendu droit divin.....
Le Conservateur.
Prétendu! prétendu! c’est à savoir.
Le Socialiste.
Les autres sont issus de la souveraineté du peuple. Lesquels préférez-vous?
L’Économiste.
Je ne veux ni des uns ni des autres. Les premiers sont des gouvernements de monopole, les seconds sont des gouvernements communistes. Au nom du principe de la propriété, au nom du droit que je possède de me pourvoir moi-même de sécurité, ou d’en acheter à qui bon me semble, je demande des gouvernements libres.
[305]
Le Conservateur.
Qu’est-ce à dire?
L’Économiste.
C’est-à-dire, des gouvernements dont je puisse, au gré de ma volonté individuelle, accepter ou refuser les services.
Le Conservateur.
Parlez-vous sérieusement?
L’Économiste.
Vous allez bien voir. Vous êtes partisan du droit divin, n’est-il pas vrai?
Le Conservateur.
Depuis que nous vivons en république, j’y incline assez, je l’avoue.
L’Économiste.
Et vous vous croyez un adversaire du droit au travail?
Le Conservateur.
Si je le crois? mais j’en suis sûr. J’atteste.....
L’Économiste.
N’attestez rien, car vous êtes un partisan avoué du droit au travail.
Le Conservateur.
Mais encore une fois, je.....
L’Économiste.
Vous êtes partisan du droit divin. Or le principe du droit divin est absolument identique au principe du droit au travail.
Qu’est-ce que le droit divin? C’est le Droit que possèdent certaines familles au gouvernement des peuples. Qui leur a conféré ce droit? Dieu lui-même. Lisez plutôt [306] les Considérations sur la France, et la brochure sur le Principe générateur des Constitutions politiques, de M. Joseph de Maistre:
« L’homme ne peut faire de souverain, dit M. de Maistre. Tout au plus il peut servir d’instrument pour déposséder un souverain, et livrer ses États à un autre souverain déjà prince. Du reste, il n’a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l’origine plébéienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde.
..... Il est écrit: C’est moi qui fais les souverains. Ceci n’est point une phrase d’église, une métaphore de prédicateur; c’est la vérité littérale, simple et palpable. C’est une loi du monde politique. Dieu fait les rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales, il les nourrit au milieu d’un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d’honneur; elles se placent. » [23]
Ce qui signifie que Dieu a investi certaines familles du droit de gouverner les hommes, et que nul ne peut les priver de l’exercice de ce droit.
Or, si vous reconnaissez à certaines familles le droit exclusif d’exercer cette espèce particulière d’industrie qu’on appelle le gouvernement, si, encore, vous croyez avec la plupart des théoriciens du droit divin, que les peuples sont tenus de fournir, soit des sujets à gouverner, soit des dotations, en guise d’indemnités de chômages aux membres de ces familles,—et cela pendant toute la durée des siècles,—êtes-vous bien fondé à repousser le [307] Droit au travail? Entre cette prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers le travail qui leur convient, ou une indemnité suffisante, et cette autre prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers des familles royales un travail approprié à leurs facultés et à leur dignité, un travail de gouvernement, ou une Dotation à titre de minimum de subsistances, où est la différence?
Le Socialiste.
En vérité, il n’y en a aucune.
Le Conservateur.
Qu’importe! si la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société.
L’Économiste.
Les socialistes ne pourraient-ils pas vous répondre que la reconnaissance du droit au travail n’est pas moins nécessaire au maintien de la société? Si vous admettez le droit au travail pour quelques-uns, ne devez-vous pas l’admettre pour tous? Le droit au travail est-il autre chose qu’une extension du droit divin?
Vous dites que la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société. Comment donc se fait-il que tous les peuples aspirent à se débarrasser des monarchies de droit divin? Comment se fait-il que les vieux gouvernements de monopole soient les uns ruinés, les autres sur le point de l’être?
Le Conservateur.
Les peuples sont saisis de vertige.
L’Économiste.
Voilà un vertige bien répandu! Mais, croyez-moi, les peuples ont de bonnes raisons pour se débarrasser de [308] leurs vieux dominateurs. Le monopole du gouvernement ne vaut pas mieux qu’un autre. On ne gouverne pas bien, et surtout on ne gouverne pas à bon marché, lorsqu’on n’a aucune concurrence à redouter, lorsque les gouvernés sont privés du droit de choisir librement leurs gouvernants. Accordez à un épicier la fourniture exclusive d’un quartier, défendez aux habitants de ce quartier d’acheter aucune denrée chez les épiciers voisins, ou bien encore de s’approvisionner eux-mêmes d’épiceries, et vous verrez quelles détestables drogues l’épicier privilégié finira par débiter et à quel prix! Vous verrez de quelle façon il s’engraissera aux dépens des infortunés consommateurs, quel faste royal il étalera pour la plus grande gloire du quartier... Eh bien! ce qui est vrai pour les services les plus infimes ne l’est pas moins pour les services les plus élevés. Le monopole d’un gouvernement ne saurait valoir mieux que celui d’une boutique d’épiceries. La production de la sécurité devient inévitablement coûteuse et mauvaise lorsqu’elle est organisée en monopole.
C’est dans le monopole de la sécurité que réside la principale cause des guerres qui ont, jusqu’à nos jours, désolé l’humanité.
Le Conservateur.
Comment cela?
L’Économiste.
Quelle est la tendance naturelle de tout producteur, privilégié ou non? C’est d’élever le chiffre de sa clientèle afin d’accroître ses bénéfices. Or, sous un régime de monopole, quels moyens les producteurs de sécurité peuvent-ils employer pour augmenter leur clientèle?
[309]
Les peuples ne comptant pas sous ce régime, les peuples formant le domaine légitime des oints du Seigneur, nul ne peut invoquer leur volonté pour acquérir le droit de les administrer. Les souverains sont donc obligés de recourir aux procédés suivants pour augmenter le nombre de leurs sujets: 1° acheter à prix d’argent des royaumes ou des provinces; 2° épouser des héritières apportant en dot des souverainetés ou devant en hériter plus tard; 3° conquérir de vive force les domaines de leurs voisins. Première cause de guerre!
D’un autre côté, les peuples se révoltant quelquefois contre leurs souverains légitimes, comme il est arrivé récemment en Italie et en Hongrie, les oints du Seigneur sont naturellement obligés de faire rentrer dans l’obéissance ce bétail insoumis. Ils forment dans ce but une sainte alliance et ils font grand carnage des sujets révoltés, jusqu’à ce qu’ils aient apaisé leur rébellion. Mais si les rebelles ont des intelligences avec les autres peuples, ceux-ci se mêlent à la lutte, et la conflagration devient générale. Seconde cause de guerre!
Je n’ai pas besoin d’ajouter que les consommateurs de sécurité, enjeux de la guerre, en payent aussi les frais.
Tels sont les avantages des gouvernements de monopole.
Le Socialiste.
Vous préférez donc les gouvernements issus de la souveraineté du peuple. Vous mettez les républiques démocratiques au-dessus des monarchies et des aristocraties. A la bonne heure!
L’Économiste.
Distinguons, je vous prie. Je préfère les gouvernements [310] issus de la souveraineté du peuple. Mais les républiques que vous nommez démocratiques ne sont pas le moins du monde l’expression vraie de la souveraineté du peuple. Ces gouvernements sont des monopoles étendus, des communismes. Or, la souveraineté du peuple est incompatible avec le monopole et le communisme.
Le Socialiste.
Qu’est-ce donc à vos yeux que la souveraineté du peuple?
L’Économiste.
C’est le droit que possède tout homme de disposer librement de sa personne et de ses biens, de se gouverner lui-même.
Si l’homme-souverain a le droit de disposer, en maître, de sa personne et de ses biens, il a naturellement aussi le droit de les défendre. Il possède le droit de libre défense.
Mais chacun peut-il exercer isolément ce droit? Chacun peut-il être son gendarme et son soldat?
Non! pas plus que le même homme ne peut être son laboureur, son boulanger, son tailleur, son épicier, son médecin, son prêtre.
C’est une loi économique, que l’homme ne puisse exercer fructueusement plusieurs métiers à la fois. Aussi voit-on, dès l’origine des sociétés, toutes les industries se spécialiser, et les différents membres de la société se tourner vers les occupations que leurs aptitudes naturelles leur désignent. Ils subsistent en échangeant les produits de leur métier spécial contre les divers objets nécessaires à la satisfaction de leurs besoins.
L’homme isolé jouit, sans conteste, de toute sa [311] souveraineté. Seulement ce souverain, obligé d’exercer lui-même toutes les industries qui pourvoient aux nécessités de la vie, se trouve dans un état fort misérable.
Lorsque l’homme vit en société, il peut conserver sa souveraineté ou la perdre.
Comment perd-il sa souveraineté?
Il la perd lorsqu’il cesse, d’une manière totale ou partielle, directe ou indirecte, de pouvoir disposer de sa personne et de ses biens.
L’homme ne demeure complétement souverain que sous un régime de pleine liberté. Tout monopole, tout privilége est une atteinte portée à sa souveraineté.
Sous l’ancien régime, nul n’ayant le droit de disposer librement de sa personne et de ses biens, nul n’ayant le droit d’exercer librement toute industrie, la souveraineté se trouvait étroitement limitée.
Sous le régime actuel, la souveraineté n’a point cessé d’être atteinte par une multitude de monopoles et de priviléges, restrictifs de la libre activité des individus. L’homme n’a pas encore pleinement recouvré sa souveraineté.
Comment peut-il la recouvrer?
Deux écoles sont en présence, qui donnent à ce problème des solutions tout opposées: l’école libérale et l’école communiste.
L’école libérale dit: Détruisez les monopoles et les priviléges, restituez à l’homme son droit naturel d’exercer librement toute industrie et il jouira pleinement de sa souveraineté.
L’école communiste dit, au contraire: Gardez-vous d’attribuer à chacun le droit de produire librement [312] toutes choses. Ce serait l’oppression et l’anarchie! Attribuez ce droit à la communauté, à l’exclusion des individus. Que tous se réunissent pour organiser en commun toute industrie. Que l’État soit le seul producteur et le seul distributeur de la richesse.
Qu’y a-t-il au fond de cette doctrine? On l’a dit souvent: il y a l’esclavage. Il y a l’absorption et l’annulation de la volonté individuelle dans la volonté commune. Il y a la destruction de la souveraineté individuelle.
Au premier rang des industries organisées en commun figure celle qui a pour objet de protéger, de défendre contre toute agression la propriété des personnes et des choses.
Comment se sont constituées les communautés dans lesquelles cette industrie s’exerce, la nation et la commune?
La plupart des nations ont été successivement agglomérées par les alliances des propriétaires d’esclaves ou de serfs et par leurs conquêtes. La France, par exemple, est un produit d’alliances et de conquêtes successives. Par les mariages, par la force ou la ruse, les souverains de l’Ile de France étendirent successivement leur autorité sur les différentes parties des anciennes Gaules. Aux vingt gouvernements de monopole qui occupaient la surface actuelle de la France, succéda un seul gouvernement de monopole. Les rois de Provence, les ducs d’Aquitaine, de Bretagne, de Bourgogne, de Lorraine, les comtes de Flandres, etc., firent place au roi de France.
Le roi de France était chargé du soin de la défense intérieure et extérieure de l’État. Cependant il [313] ne dirigeait pas seul la défense ou police intérieure.
Chaque seigneur châtelain faisait originairement la police de son domaine; chaque commune, affranchie de vive force ou à prix d’argent de l’onéreuse tutelle de son seigneur, faisait la police de sa circonscription reconnue.
Communes et seigneurs contribuaient, dans une certaine mesure, à la défense générale.
On peut dire que le roi de France avait le monopole de la défense générale, et que les seigneurs châtelains et les bourgeois des communes avaient celui de la défense locale.
Dans certaines communes, la police était sous la direction d’une administration élue par les bourgeois de la cité, dans les principales communes des Flandres par exemple. Ailleurs, la police s’était constituée en corporation comme la boulangerie, la boucherie, la cordonnerie, en un mot comme toutes les autres industries.
En Angleterre, cette dernière forme de la production de la sécurité a subsisté jusqu’à nos jours. Dans la cité de Londres, la police était naguère encore entre les mains d’une corporation privilégiée. Et chose singulière! cette corporation refusait de s’entendre avec les polices des autres quartiers, si bien que la Cité était devenue un véritable lieu de refuge pour les malfaiteurs. Cette anomalie n’a disparu qu’à l’époque de la réforme de sir Robert Peel. [24]
Que fit la Révolution française? Elle déposséda le roi de France du monopole de la défense générale, mais elle ne détruisit pas ce monopole; elle le remit entre les mains [314] de la nation, organisée désormais comme une immense commune.
Les petites communes dans lesquelles se divisait le territoire de l’ancien royaume de France continuèrent de subsister. On en augmenta même considérablement le nombre. Le gouvernement de la grande commune eut le monopole de la défense générale, les gouvernements des petites communes exercèrent, sous la surveillance du pouvoir central, le monopole de la défense locale.
Mais on ne se borna pas là. On organisa encore dans la commune générale et dans les communes particulières d’autres industries, notamment l’enseignement, les cultes, les transports, etc., et l’on établit sur les citoyens divers impôts pour subvenir aux frais de ces industries ainsi organisées en commun.
Plus tard, les socialistes, mauvais observateurs s’il en fut jamais, ne remarquant point que les industries organisées dans la commune générale ou dans les communes particulières, fonctionnaient plus chèrement et plus mal que les industries laissées libres, demandèrent l’organisation en commun de toutes les branches de la production. Ils voulurent que la commune générale et les communes particulières ne se bornassent plus à faire la police, à bâtir des écoles, à construire des routes, à salarier des cultes, à ouvrir des bibliothèques, à subventionner des théâtres, à entretenir des haras, à fabriquer des tabacs, des tapis, de la porcelaine, etc., mais qu’elles se missent à produire toutes choses.
Le bon sens public se révolta contre cette mauvaise utopie, mais il n’alla pas plus loin. On comprit bien qu’il serait ruineux de produire toutes choses en commun. On [315] ne comprit pas qu’il était ruineux de produire certaines choses en commun. On continua donc de faire du communisme partiel, tout en honnissant les socialistes qui réclamaient à grands cris un communisme complet.
Cependant les conservateurs, partisans du communisme partiel et adversaires du communisme complet, se trouvent aujourd’hui divisés sur un point important.
Les uns veulent que le communisme partiel continue à s’exercer principalement dans la commune générale; ils défendent la centralisation.
Les autres réclament, au contraire, une plus large part d’attributions pour les petites communes. Ils veulent que celles-ci puissent exercer diverses industries, fonder des écoles, construire des routes, bâtir des églises, subventionner des théâtres, etc., sans avoir besoin de l’autorisation du gouvernement central. Ils demandent la décentralisation.
L’expérience a montré les vices de la centralisation. L’expérience a prouvé que les industries exercées dans la grande commune, dans l’État, fournissent des produits plus chers et plus mauvais que ceux de l’industrie libre.
Mais est-ce a dire que la décentralisation vaille mieux? Est-ce à dire qu’il soit plus utile d’émanciper les communes, ou, ce qui revient au même, de leur permettre d’établir librement des écoles et des institutions de bienfaisance, de bâtir des théâtres, de subventionner des cultes, ou même encore d’exercer librement d’autres industries?
Pour subvenir aux dépenses des services dont elles se chargent, que faut-il aux communes? Il leur faut des capitaux. Ces capitaux où peuvent-elles les puiser? Dans [316] les poches des particuliers, non ailleurs. Elles sont obligées, en conséquence, de prélever différents impôts sur les habitants de la commune.
Ces impôts consistent généralement aujourd’hui dans les centimes additionnels ajoutés aux contributions payées à l’État. Toutefois certaines communes ont obtenu aussi l’autorisation d’établir autour de leurs limites une petite douane sous le nom d’octroi. Cette douane, qui atteint la plupart des industries demeurées libres, augmente naturellement beaucoup les ressources de la commune. Aussi les autorisations d’établir un octroi sont-elles fréquemment demandées au gouvernement central. Celui-ci ne les accorde guère, et en cela il agit sagement; en revanche il permet assez souvent aux communes de s’imposer extraordinairement, autrement dit, il permet à la majorité des administrateurs de la commune d’établir un impôt extraordinaire que tous les administrés sont obligés de payer.
Que les communes soient émancipées, que, dans chaque localité, la majorité des habitants ait le droit d’établir autant d’industries qu’il lui plaira, et d’obliger la minorité à contribuer aux dépenses de ces industries organisées en commun; que la majorité soit autorisée à établir librement toute espèce de taxes locales, et vous verrez bientôt se constituer en France autant de petits États différents et séparés qu’on y compte de communes. Vous verrez successivement s’élever, pour subvenir aux taxes locales, quarante-quatre mille douanes intérieures sous le nom d’octrois; vous verrez, pour tout dire, se reconstituer le moyen âge.
Sous ce régime, la liberté du travail et des échanges [317] sera atteint et par les monopoles que les communes s’attribueront de certaines branches de la production, et par les impôts qu’elles prélèveront sur les autres branches pour alimenter les industries exercées en commun. La propriété de tous se trouvera à la merci des majorités.
Dans les communes où prédomine l’opinion socialiste, que deviendra, je vous le demande, la propriété? Non seulement la majorité lèvera des impôts pour subvenir aux dépenses de la police, de la voirie, du culte, des établissements de bienfaisance, des écoles, etc., mais elle en lèvera aussi pour établir des ateliers communaux, des magasins communaux, des comptoirs communaux, etc. Ces taxes locales, la minorité non socialiste ne sera-t-elle pas obligée de les payer?
Sous un tel régime, que devient donc la souveraineté du peuple? Ne disparaît-elle pas sous la tyrannie du plus grand nombre?
Plus directement encore que la centralisation, la décentralisation conduit au communisme complet, c’est-à-dire à la destruction complète de la souveraineté.
Que faut-il donc faire pour restituer aux hommes cette souveraineté que le monopole leur a ravie dans le passé; et que le communisme, ce monopole étendu, menace de leur ravir dans l’avenir?
Il faut tout simplement rendre libre les différentes industries jadis constituées en monopoles, et aujourd’hui exercées en commun. Il faut abandonner à la libre activité des individus les industries encore exercées ou réglementées dans l’État ou dans la commune.
Alors l’homme possédant, comme avant l’établissement des sociétés, le droit d’appliquer librement, sans entrave [318] ni charge aucune, ses facultés à toute espèce de travaux, jouira de nouveau, pleinement, de sa souveraineté.
Le Conservateur.
Vous avez passé en revue les différentes industries encore monopolisées, privilégiées ou réglementées, et vous nous avez prouvé, avec plus ou moins de succès, que ces industries devraient être-laissées libres pour l’avantage commun. Soit! je ne veux pas revenir sur un thème épuisé. Mais est-il possible d’enlever à l’État et aux communes le soin de la défense générale et de la défense locale.
Le Socialiste.
Et l’administration de la justice donc?
Le Conservateur.
Oui, et l’administration de la justice. Est-il possible que ces industries, pour parler votre langage, soient exercées autrement qu’en commun, dans la nation et dans la commune.
L’Économiste.
Je glisserais peut-être sur ces deux communismes-là si vous consentiez bien franchement à m’abandonner tous les autres; si vous réduisiez l’État à n’être plus désormais qu’un gendarme, un soldat et un juge. Cependant, non!...car le communisme de la sécurité est la clef de voûte du vieux édifice de la servitude. Je ne vois d’ailleurs aucune raison pour vous accorder celui-là plutôt que les autres.
De deux choses l’une, en effet:
Ou le communisme vaut mieux que la liberté, et, dans ce cas, il faut organiser toutes les industries en commun, dans l’État ou dans la commune.
[319]
Ou la liberté est préférable au communisme, et, dans ce cas, il faut rendre libres toutes les industries encore organisées en commun, aussi bien la justice et la police que l’enseignement, les cultes, les transports, la fabrication des tabacs, etc.
Le Socialiste.
C’est logique.
Le Conservateur.
Mais est-ce possible?
L’Économiste.
Voyons! S’agit-il de la justice? Sous l’ancien régime, l’administration de la justice n’était pas organisée et salariée en commun; elle était organisée en monopole, et salariée par ceux qui en faisaient usage.
Pendant plusieurs siècles, il n’y eut pas d’industrie plus indépendante. Elle formait, comme toutes les autres branches de la production matérielle ou immatérielle, une corporation privilégiée. Les membres de cette corporation pouvaient léguer leurs charges ou maîtrises à leurs enfants, ou bien encore les vendre. Jouissant de ces charges à perpétuité, les juges se faisaient remarquer par leur indépendance et leur intégrité.
Malheureusement ce régime avait, d’un autre côté, tous les vices inhérents au monopole. La justice monopolisée se payait fort cher.
Le Socialiste.
Et Dieu sait combien de plaintes et de réclamations excitaient les épices. Témoin ces petits vers qui furent crayonnés sur la porte du Palais de Justice après un incendie:
[320]
Un beau jour dame Justice
Se mit le palais tout en feu
Pour avoir mangé trop d’épice.
La justice ne doit-elle pas être essentiellement gratuite? Or, la gratuité n’entraîne-t-elle pas l’organisation en commun?
L’Économiste.
On se plaignait de ce que la justice mangeait trop d’épices. On ne se plaignait pas de ce qu’elle en mangeait. Si la justice n’avait pas été constituée en monopole; si, en conséquence, les juges n’avaient pu exiger que la rémunération légitime de leur industrie, on ne se serait pas plaint des épices.
Dans certains pays, où les justiciables avaient le droit de choisir leurs juges, les vices du monopole se trouvaient singulièrement atténués. La concurrence qui s’établissait alors entre les différentes cours, améliorait la justice et la rendait moins chère. Adam Smith attribue à cette cause les progrès de l’administration de la justice en Angleterre. Le passage est curieux et j’espère qu’il dissipera vos doutes:
« Les honoraires de cour paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d’attirer à elle le plus d’affaires qu’elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles mêmes qui ne tombaient point sous sa juridiction. La cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s’était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La [321] cour de l’échiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagements pour dettes, le plaignant alléguant que si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu’elles voulaient, et chaque cour s’efforçait d’attirer le plus de causes qu’elle pouvait au sien, par la diligence et l’impartialité qu’elle mettait dans l’expédition des procès. L’admirable constitution actuelle des cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun s’efforçant à l’envi d’appliquer à toute sorte d’injustices, le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi. » [25]
Le Socialiste.
Mais, encore une fois, la gratuité n’est-elle pas préférable?
L’Économiste.
Vous n’êtes donc pas revenu encore de l’illusion de la gratuité. Ai-je besoin de vous démontrer que la justice gratuite coûte plus cher que l’autre, de tout le montant de l’impôt, prélevé pour entretenir les tribunaux gratuits et salarier les juges gratuits. Ai-je besoin de vous démontrer encore que la gratuité de la justice est nécessairement inique, car tout le monde ne se sert pas également de la justice, tout le monde n’a pas également l’esprit processif? Au reste, la justice est loin d’être gratuite sous le régime actuel, vous ne l’ignorez pas.
[322]
Le Conservateur.
Les procès sont ruineux. Cependant pouvons-nous nous plaindre de l’administration actuelle de la justice? L’organisation de nos tribunaux n’est-elle pas irréprochable?
Le Socialiste.
Oh! oh! irréprochable. Un Anglais que j’accompagnai un jour à la cour d’assises, sortit de la séance tout indigné. Il ne concevait pas qu’un peuple civilisé permit à un procureur du roi ou de la république, de faire de la rhétorique pour demander une condamnation à mort. Cette éloquence, pourvoyeuse du bourreau, lui faisait horreur. En Angleterre, on se contente d’exposer l’accusation; on ne la passionne pas.
L’Économiste.
Ajoutez à cela les lenteurs proverbiales de nos cours de justice, les souffrances des malheureux qui attendent leur jugement pendant des mois, et quelquefois pendant des années, tandis que l’instruction pourrait se faire en quelques jours; les frais et les pertes énormes que ces délais entraînent, et vous vous convaincrez que l’administration de la justice n’a guère progressé en France.
Le Socialiste.
N’exagérons rien, toutefois. Nous possédons aujourd’hui, grâce au ciel, l’institution du jury.
L’Économiste.
En effet, on ne se contente pas d’obliger les contribuables à payer les frais de la justice, on les oblige aussi à remplir les fonctions de juges. C’est du communisme pur: Ab uno disce omnes. Pour moi, je ne pense pas que [323] le jury vaille mieux pour juger, que la garde nationale, une autre institution communiste! pour faire la guerre.
Le Socialiste.
Pourquoi donc?
L’Économiste.
Parce qu’on ne fait bien que son métier, sa spécialité, et que le métier, la spécialité d’un juré n’est pas d’être juge.
Le Conservateur.
Aussi se contente-t-il de constater le délit, et d’apprécier les circonstances dans lesquelles le délit a été commis.
L’Économiste.
C’est-à-dire d’exercer la fonction la plus difficile, la plus épineuse du juge. C’est cette fonction si délicate, qui exige un jugement si sain, si exercé, un esprit si calme, si froid, si impartial que l’on confie aux hasards du tirage au sort. C’est absolument comme si l’on tirait au sort les noms des citoyens qui seront chargés, chaque année, de fabriquer des bottes ou d’écrire des tragédies pour la communauté.
Le Conservateur.
La comparaison est forcée.
L’Économiste.
Il est plus difficile, à mon avis, de rendre un bon jugement que de faire une bonne paire de bottes ou d’aligner convenablement quelques centaines d’alexandrins. Un juge parfaitement éclairé et impartial est plus rare qu’un bottier habile ou un poëte capable d’écrire pour le Théâtre-Français.
Dans les causes criminelles, l’inhabileté du jury se [324] trahit tous les jours. Mais on ne prête, hélas! qu’une médiocre attention aux erreurs commises en cour d’assises. Que dis-je? on regarde presque comme un délit de critiquer un jugement rendu. Dans les causes politiques, le jury n’a-t-il pas coutume de prononcer selon la couleur de son opinion, blanc ou rouge, plutôt que selon la justice? Tel homme qui est condamné par un jury blanc ne serait-il pas absous par un jury rouge, et vice versâ?
Le Socialiste.
Hélas!
L’Économiste.
Déjà les minorités sont bien lasses d’être jugées par des jurys appartenant aux majorités. Attendez la fin...
S’agit-il de l’industrie qui pourvoit à la défense intérieure et extérieure? Croyez-vous qu’elle vaille beaucoup mieux que celle de la justice? Notre police et surtout notre armée ne nous coûtent-elles pas bien cher pour les services réels qu’elles nous rendent?
N’y a-t-il enfin aucun inconvénient à ce que cette industrie de la défense publique soit aux mains d’une majorité?
Examinons.
Dans un système où la majorité établit l’assiette de l’impôt et dirige l’emploi des deniers publics, l’impôt ne doit-il pas peser plus ou moins sur certaines portions de la société, selon les influences prédominantes? Sous la monarchie, lorsque la majorité était purement fictive, lorsque la classe supérieure s’arrogeait le droit de gouverner le pays à l’exclusion du reste de la nation, l’impôt ne pesait-il pas principalement sur les consommations des [325] classes inférieures, sur le sel, sur le vin, sur la viande, etc.? Sans doute, la bourgeoisie payait sa part de ces impôts, mais le cercle de ses consommations étant infiniment plus large que celui des consommations de la classe inférieure, son revenu s’en trouvait, en définitive, beaucoup plus légèrement atteint. A mesure que la classe inférieure, en s’éclairant, acquerra plus d’influence dans l’État, vous verrez se produire une tendance opposée. Vous verrez l’impôt progressif, qui est tourné aujourd’hui contre la classe inférieure, être retourné contre la classe supérieure. Celle-ci résistera sans doute de toutes ses forces à cette tendance nouvelle; elle criera, avec raison, à la spoliation, au vol; mais si l’institution communautaire du suffrage universel est maintenue, si une surprise de la force ne remet pas, de nouveau, le gouvernement de la société aux mains des classes riches à l’exclusion des classes pauvres, la volonté de la majorité prévaudra, et l’impôt progressif sera établi. Une partie de la propriété des riches sera alors légalement confisquée pour alléger le fardeau des pauvres, comme une partie de la propriété des pauvres a été trop longtemps confisquée pour alléger le fardeau des riches.
Mais il y a pis encore.
Non seulement la majorité d’un gouvernement communautaire peut établir, comme bon lui semble, l’assiette de l’impôt, mais encore elle peut faire de cet impôt l’usage qu’elle juge convenable, sans tenir compte de la volonté de la minorité.
Dans certains pays, le gouvernement de la majorité emploie une partie des deniers publics à protéger des propriétés essentiellement illégitimes et immorales. Aux [326] États-Unis, par exemple, le gouvernement garantit aux planteurs du sud la propriété de leurs esclaves. Cependant il y a, aux États-Unis, des abolitionnistes qui considèrent, avec raison, l’esclavage comme un vol. N’importe! le mécanisme communautaire les oblige à contribuer de leurs deniers au maintien de cette espèce de vol. Si les esclaves tentaient un jour de s’affranchir d’un joug inique et odieux, les abolitionnistes seraient contraints d’aller défendre, les armes à la main, la propriété des planteurs. C’est la loi des majorités!
Ailleurs, il arrive que la majorité, poussée par des intrigues politiques ou par le fanatisme religieux, déclare la guerre à un peuple étranger. La minorité a beau avoir horreur de cette guerre et la maudire, elle est obligée d’y contribuer de son sang et de son argent. C’est encore la loi des majorités!
Ainsi qu’arrive-t-il? C’est que la majorité et la minorité sont perpétuellement en lutte, et que la guerre descend parfois de l’arène parlementaire dans la rue.
Aujourd’hui c’est la minorité rouge qui s’insurge. Si cette minorité devenait majorité, et si, usant de ses droits de majorité, elle remaniait la constitution à sa guise, si elle décrétait des impôts progressifs, des emprunts forcés et des papiers-monnaie, qui vous assure que la minorité blanche ne s’insurgerait pas demain?
Il n’y a point de sécurité durable dans ce système. Et savez-vous pourquoi? Parce qu’il menace incessamment la propriété; parce qu’il met à la merci d’une majorité aveugle ou éclairée, morale ou immorale, les personnes et les biens de tous.
Si le régime communautaire, au lieu d’être appliqué [327] comme en France à une multitude d’objets, se trouvait étroitement limité comme aux États-Unis, les causes de dissentiment entre la majorité et la minorité étant moins nombreuses, les inconvénients de ce régime seraient moindres. Toutefois ils ne disparaîtraient point entièrement. Le droit reconnu au plus grand nombre de tyranniser la volonté du plus petit pourrait encore, en certaines circonstances, engendrer la guerre civile.
Le Conservateur.
Mais, encore une fois, on ne conçoit pas comment l’industrie qui pourvoit à la sécurité des personnes et des propriétés pourrait être pratiquée si elle était rendue libre. Votre logique vous conduit à des rêves dignes de Charenton.
L’Économiste.
Voyons! ne nous fâchons pas. Je suppose qu’après avoir bien reconnu que le communisme partiel de l’État et de la commune est décidément mauvais, on laisse libres toutes les branches de la production, à l’exception de la justice et de la défense publique. Jusque-là point d’objection. Mais un économiste radical, un rêveur vient et dit: Pourquoi donc, après avoir affranchi les différents emplois de la propriété, n’affranchissez-vous pas aussi ceux qui assurent le maintien de la propriété? Comme les autres, ces industries-là ne seront-elles pas exercées d’une manière plus équitable et plus utile si elles sont rendues libres? Vous affirmez que c’est impraticable. Pourquoi. D’un côté, n’y a-t-il pas, au sein de la société, des hommes spécialement propres, les uns à juger les différends qui surviennent entre les propriétaires et à apprécier les délits commis contre la propriété, les autres [328] à défendre la propriété des personnes et des choses contre les agressions de la violence et de la ruse? N’y a-t-il pas des hommes que leurs aptitudes naturelles rendent spécialement propres à être juges, gendarmes et soldats. D’un autre côté, tous les propriétaires indistinctement n’ont-ils pas besoin de sécurité et de justice? Tous ne sont-ils pas disposés, en conséquence, à s’imposer des sacrifices pour satisfaire à ce besoin urgent, surtout s’ils sont impuissants à y satisfaire eux-mêmes ou s’ils ne le peuvent à moins de dépenser beaucoup de temps et d’argent?
Or s’il y a d’un côté des hommes propres à pourvoir à un besoin de la société, d’un autre côté, des hommes disposés à s’imposer des sacrifices pour obtenir la satisfaction de ce besoin, ne suffit-il pas de laisser faire les uns et les autres pour que la denrée demandée, matérielle ou immatérielle, se produise, et que le besoin soit satisfait?
Ce phénomène économique ne se produit-il pas irrésistiblement, fatalement, comme le phénomique physique de la chute des corps?
Ne suis-je donc pas fondé à dire que si une société renonçait à pourvoir à la sécurité publique, cette industrie particulière n’en serait pas moins exercée? Ne suis-je pas fondé à ajouter qu’elle le serait mieux sous le régime de la liberté qu’elle ne pouvait l’être sous le régime de la communauté?
Le Conservateur.
De quelle manière?
L’Économiste.
Cela ne regarde pas les économistes. L’économie politique [329] peut dire: si tel besoin existe, il sera satisfait, et il le sera mieux sous un régime d’entière liberté que sous tout autre. A cette règle, aucune exception! mais comment s’organisera cette industrie, quels seront ses procédés techniques, voilà ce que l’économie politique ne saurait dire.
Ainsi, je puis affirmer que si le besoin de se nourrir se manifeste au sein de la société, ce besoin sera satisfait, et qu’il le sera d’autant mieux que chacun demeurera plus libre de produire des aliments ou d’en acheter à qui bon lui semblera.
Je puis assurer encore que les choses se passeront absolument de la même manière si, au lieu de l’alimentation, il s’agit de la sécurité.
Je prétends donc que si une communauté déclarait renoncer, au bout d’un certain délai, un an par exemple, à salarier des juges, des soldats et des gendarmes, au bout de l’année cette communauté n’en posséderait pas moins des tribunaux et des gouvernements prêts à fonctionner; et j’ajoute que si, sous ce nouveau régime, chacun conservait le droit d’exercer librement ces deux industries et d’en acheter librement les services, la sécurité serait produite le plus économiquement et le mieux possible.
Le Conservateur.
Je vous répondrai toujours que cela ne se peut concevoir.
L’Économiste.
A l’époque où le régime réglementaire retenait l’industrie prisonnière dans l’enceinte des communes, et où chaque corporation était exclusivement maîtresse du [330] marché communal, on disait que la société était menacée chaque fois qu’un novateur audacieux s’efforçait de porter atteinte à ce monopole. Si quelqu’un était venu dire alors qu’à la place des malingres et chétives industries des corporations, la liberté mettrait un jour d’immenses manufactures fournissant des produits moins chers et plus parfaits, on eût traité ce rêveur de la belle manière. Les conservateurs du temps auraient juré leurs grands dieux que cela ne se pouvait concevoir.
Le Socialiste.
Mais voyons! Comment peut-on imaginer que chaque individu ait le droit de se faire gouvernement ou de choisir son gouvernement, ou même de n’en pas choisir... Comment les choses se passeraient-elles en France, si, après avoir rendu libres toutes les autres industries, les citoyens français annonçaient de commun accord, qu’ils cesseront, au bout d’une année, de soutenir le gouvernement de la communauté?
L’Économiste.
Je ne puis faire que des conjectures à cet égard. Voici cependant à peu près de quelle manière les choses se passeraient. Comme le besoin de sécurité est encore très grand dans notre société, il y aurait profit à fonder des entreprises de gouvernement. On serait assuré de couvrir ses frais. Comment se fonderaient ces entreprises? Des individualités isolées n’y suffiraient pas plus qu’elles ne suffisent pour construire des chemins de fer, des docks, etc. De vastes compagnies se constitueraient donc pour produire de la sécurité; elles se procureraient le matériel et les travailleurs dont elles auraient besoin. Aussitôt qu’elles se trouveraient prêtes à fonctionner, [331] ces compagnies d’assurances sur la propriété appelleraient la clientèle. Chacun s’abonnerait à la compagnie qui lui inspirerait le plus de confiance et dont les conditions lui sembleraient le plus favorables.
Le Conservateur.
Nous ferions queue pour aller nous abonner. Assurément, nous ferions queue!
L’Économiste.
Cette industrie étant libre on verrait se constituer autant de compagnies qu’il pourrait s’en former utilement. S’il y en avait trop peu, si, par conséquent, le prix de la sécurité était surélevé, on trouverait profit à en former de nouvelles; s’il y en avait trop, les compagnies surabondantes ne tarderaient pas à se dissoudre. Le prix de la sécurité serait, de la sorte, toujours ramené au niveau des frais de production.
Le Conservateur.
Comment ces compagnies libres s’entendraient-elles pour pourvoir à la sécurité générale?
L’Économiste.
Elles s’entendraient comme s’entendent aujourd’hui les gouvernements monopoleurs et communistes, parce qu’elles auraient intérêt à s’entendre. Plus, en effet, elles se donneraient de facilités mutuelles pour saisir les voleurs et les assassins, et plus elles diminueraient leurs frais.
Par la nature même de leur industrie, les compagnies d’assurances sur la propriété ne pourraient dépasser certaines circonscriptions: elles perdraient à entretenir une police dans les endroits où elles n’auraient qu’une faible clientèle. Dans leurs circonscriptions elles ne pourraient néanmoins opprimer ni exploiter leurs clients, sous peine de voir surgir instantanément des concurrences.
Le Socialiste.
Et si la compagnie existante voulait empêcher les concurrences de s’établir?
L’Économiste.
En un mot, si elle portait atteinte à la propriété de ses concurrents et à la souveraineté de tous... Oh! alors, tous ceux dont les monopoleurs menaceraient la propriété et l’indépendance se lèveraient pour les châtier.
Le Socialiste.
Et si toutes les compagnies s’entendaient pour se constituer en monopoles. Si elles formaient une sainte-alliance pour s’imposer aux nations, et si fortifiées par cette coalition, elles exploitaient sans merci les malheureux consommateurs de sécurité, si elles attiraient à elles par de lourds impôts la meilleure part des fruits du travail des peuples?
L’Économiste.
Si, pour tout dire, elles recommençaient à faire ce que les vieilles aristocraties ont fait jusqu’à nos jours... Eh! bien, alors, les peuples suivraient le conseil de Béranger:
Peuples, formez une Sainte-Alliance
Et donnez-vous la main.
Ils s’uniraient, à leur tour, et comme ils possèdent des moyens de communication que n’avaient pas leurs ancêtres, comme ils sont cent fois plus nombreux que leurs vieux dominateurs, la sainte-alliance des aristocraties serait bientôt anéantie. Nul ne serait plus tenté alors, je vous jure, de constituer un monopole.
[333]
Le Conservateur.
Comment ferait-on sous ce régime pour repousser une invasion étrangère?
Le Socialiste. [rather L’Économiste]
Quel serait l’intérêt des compagnies? Ce serait de repousser les envahisseurs, car elles seraient les premières victimes de l’invasion. Elles s’entendraient donc pour les repousser et elles demanderaient à leurs assurés un supplément de prime pour les préserver de ce danger nouveau. Si les assurés préféraient courir les risques de l’invasion, ils refuseraient ce supplément de prime; sinon, ils le payeraient, et ils mettraient ainsi les compagnies en mesure de parer au danger de l’invasion.
Mais de même que la guerre est inévitable sous un régime de monopole, la paix est inévitable sous un régime de libre gouvernement.
Sous ce régime, les gouvernements ne peuvent rien gagner par la guerre; ils peuvent, au contraire, tout perdre. Quel intérêt auraient-ils à entreprendre une guerre? serait-ce pour augmenter leur clientèle? Mais, les consommateurs de sécurité étant libres de se faire gouverner à leur guise, échapperaient aux conquérants. Si ceux-ci voulaient leur imposer leur domination, après avoir détruit le gouvernement existant, les opprimés réclameraient aussitôt le secours de tous les peuples....
Les guerres de compagnie à compagnie ne se feraient d’ailleurs qu’autant que les actionnaires voudraient en avancer les frais. Or, la guerre ne pouvant plus rapporter à personne une augmentation de clientèle, puisque les consommateurs ne se laisseraient plus conquérir, les [334] frais de guerre ne seraient évidemment plus couverts. Qui donc voudrait encore les avancer?
Je conclus de là que la guerre serait matériellement impossible sous ce régime, car aucune guerre ne se peut faire sans une avance de fonds.
Le Conservateur.
Quelles conditions une compagnie d’assurances sur la propriété ferait-elle à ses clients?
L’Économiste.
Ces conditions seraient de plusieurs sortes.
Pour être mises en état de garantie aux assurés, pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, il faudrait:
1° Que les compagnies d’assurances établissent certaines peines contre les offenseurs des personnes et des propriétés, et que les assurés consentissent à se soumettre à ces peines, dans le cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés.
2° Qu’elles imposassent aux assurés certaines gênes ayant pour objet de faciliter la découverte des auteurs de délits.
3° Qu’elles perçussent régulièrement pour couvrir leurs frais une certaine prime, variable selon la situation des assurés, leurs occupations particulières, l’étendue, la nature et la valeur des propriétés à protéger.
Si les conditions stipulées convenaient aux consommateurs de sécurité, le marché se conclurait, sinon les consommateurs s’adresseraient à d’autres compagnies ou pourvoiraient eux-mêmes à leur sécurité.
Poursuivez cette hypothèse dans tous ses détails, et vous vous convaincrez, je pense, de la possibilité de [335] transformer les gouvernements monopoleurs ou communistes en gouvernements libres.
Le Conservateur.
J’y vois bien des difficultés encore. Et la dette, qui la payerait?
L’Économiste.
Pensez-vous qu’en vendant toutes les propriétés aujourd’hui communes, routes, canaux, rivières, forêts, bâtiments servant à toutes les administrations communes, matériel de tous les services communs, on ne réussirait pas aisément à rembourser le capital de la dette? Ce capital ne dépasse pas six milliards. La valeur des propriétés communes en France s’élève, à coup sûr, bien au delà.
Le Socialiste.
Ce système ne serait-il pas la destruction de toute nationalité? Si plusieurs compagnies d’assurances sur la propriété s’établissaient dans un pays, l’Unité nationale ne serait-elle pas détruite?
L’Économiste.
D’abord, il faudrait que l’Unité nationale existât pour qu’on pût la détruire. Or, je ne puis voir une unité nationale dans ces informes agglomérations de peuples que la violence a formées, que la violence seule maintient le plus souvent.
Ensuite, on a tort de confondre ces deux choses, qui sont naturellement fort distinctes: la nation et le gouvernement. Une nation est une lorsque les individus qui la composent ont les mêmes mœurs, la même langue, la même civilisation; lorsqu’ils forment une variété distincte, originale de l’espèce humaine. Que cette nation [336] ait deux gouvernements ou qu’elle n’en ait qu’un, cela importe fort peu. A moins toutefois que chaque gouvernement n’entoure d’une barrière factice les régions soumises à sa domination, et n’entretienne d’incessantes hostilités avec ses voisins. Dans cette dernière éventualité, l’instinct de la nationalité réagira contre ce morcellement barbare et cet antagonisme factice imposés à un même peuple, et les fractions désunies de ce peuple tendront incessamment à se rapprocher.
Or, les gouvernements ont jusqu’à nos jours divisé les peuples afin de les retenir plus aisément dans l’obéissance; diviser pour régner, telle a été, de tous temps, la maxime fondamentale de leur politique. Les hommes de même race, à qui la communauté de langage offrait un moyen de communication facile, ont énergiquement réagi contre la pratique de cette maxime; de tous temps ils se sont efforcés de détruire les barrières factices qui les séparaient. Lorsqu’ils y sont enfin parvenus, ils ont voulu n’avoir qu’un seul gouvernement afin de n’être plus désunis de nouveau. Mais, remarquez bien qu’ils n’ont jamais demandé à ce gouvernement de les séparer des autres peuples... L’instinct des nationalités n’est donc pas égoïste, comme on l’a si souvent affirmé; il est, au contraire, essentiellement sympathique. Que la diversité des gouvernements cesse d’entrainer la séparation, le morcellement des peuples, et vous verrez la même nationalité en accepter volontiers plusieurs. Un seul gouvernement n’est pas plus nécessaire pour constituer l’unité d’un peuple, qu’une seule banque, un seul établissement d’éducation, un seul culte, un seul magasin d’épiceries, etc.
[337]
Le Socialiste.
Voilà, en vérité, une solution bien singulière du problème du gouvernement!
L’Économiste.
C’est la seule solution conforme à la nature des choses.
Endnotes
[22] Pendant longtemps, les économistes ont refusé de s’occuper non seulement du gouvernement, mais encore de toutes les fonctions purement immatérielles. J.-B. Say a fait entrer, le premier, cette nature de services dans le domaine de l’économie politique, en leur appliquant la dénomination commune de produits immatériels. En cela, il a rendu à la science un service plus considérable qu’on ne suppose:
« L’industrie d’un médecin, dit-il, et, si l’on veut multiplier les exemples, d’un administrateur de la chose publique, d’un avocat, d’un juge, qui sont du même genre, satisfont à des besoins tellement nécessaires, que, sans leurs travaux, nulle société ne pourrait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas réels? Ils sont tellement réels qu’on se les procure au prix d’un autre produit matériel, et que, par ces échanges répétés, les producteurs de produits immatériels acquièrent des fortunes.—C’est donc à tort que le comte de Verri prétend que les emplois de princes, de magistrats, de militaires, de prêtres, ne tombent pas immédiatement dans la sphère des objets dont s’occupe l’économie politique. » (J.-B. Say. Traité d’Économie politique, l. 1, chap. XIII.)
[23] Du Principe générateur des Constitutions politiques.—Préface.
[24] Voir les Études sur l’Angleterre, de M. Léon Faucher.
[25] De la Richesse des Nations, liv. 5, chap. I[st].
PART III. MOLINARI’S THEORY OF THE STATE I (1852-1853)↩
III. 7. "Le Despotisme et les mangeurs des taxes" (1852)↩
Source
Gustave de Molinari, Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels; précédé d'une lettre à M. le Comte J. Arrivabene, sur les dangers de la situation présente, par M. G. de Molinari, professeur d'économie politique (Brussels: Meline, Cans et Cie, 1852), selections from "Les Révolutions et le despotisme," pp. 81-152.
The entire book in PDF.
Only the second part on "Les Révolutions et le despotism" online.
Introduction
In a lecture given at the Musée de l’Industrie in Brussels, where he was a newly appointed professor of political economy, on 4 October 1852, Molinari presented an economic assessment of the costs and benefits of two important phenomena which France had experienced several times since 1789, that is revolution and despotism. What is interesting about his analysis is that he wanted to do this from the perspective of the "material interests" (des intérêts matériels) of the various parties involved - the ordinary taxpayers, consumers, and conscripted soldiers on the one hand, and the political, military, and economic elites who controlled France on the other. In other words, he was presenting in some detail his theory of class.
The lecture is also interesting because Molinari argues for the first time that he thinks it is the role of the economist to draw up a balance sheet of the costs and benefits of government policies and actions and to come to some conclusion about whether they had been worth while or not. In other words, he wanted economists to be "les teneurs de livres de la politique" (the bookkeepers of politics) (p. 116). In the lecture he begins by examining the costs and benefits of the French Revolution of 1789, and controversially concludes that the costs outweighed the benefits because of the massive loss of lives, destruction of property, and the conscription of productive workers caused by the revolutionary wars, or what he called "ce bilan monstrueux"(this horrendous balance sheet). He then applies a similar analysis to the recent 1848 Revolution in which he himself had participated.
The second half of the lecture is devoted to an economic analysis of the state, in this particular case to what he called "despotism" in contrast to representative forms of government. This was especially relevant given the timing of his lecture which was given two months before the "Prince-President" Louis Napoléon declared himself "Napoléon III." Molinari wanted to know what groups or classes supported the rise of a despot likeLouis Napoléon and how they expected to benefit from his régime. He focuses on two groups, administrators and senior bureaucrats in the government and the military.
The administrators and senior bureaucrats in any government are what he colorfully calls "des mangeurs de taxes" (the tax eaters) who push for ever more government expenditure because it is in their professional interests to do so: [4]
| Ils vivent du produit des contributions levées sur le pays. Quel est en conséquence leur intérêt immédiat? C’est d’avoir de bonnes taxes à manger; c’est d’avoir un gros budget à faire. Plus les contribuables sont accablés d’impôts, plus l’administration est florissante. | They live off the taxes imposed upon the country. As a result, what is their immediate interest? It is to have a good (supply) of taxes to eat; it is to have a large budget to work with. The more the taxpayers are weighed down by taxes, the more the administration flourishes. |
The government is now "a new market where they can practice their industry in a more permanent way" (un nouveau débouché qui s’ouvre d’une manière permanente à son industrie).
The second major group of beneficiaries is the military who push for ever more war since they regard it as "la source de la gloire, de la fortune et des honneurs" (the source of glory, fortunes and honors).
In opposition to these two groups are the taxpayers (les payeurs de taxes) who are in favour of cheap government and peace. Molinari is thus arguing that there is deep-rooted conflict between these two fundamentally opposed classes, "les mangeurs des taxes" and "les payeurs des taxes" (the tax eaters and the tax payers).
Molinari concludes that his warnings about the high costs and meagre benefits of despotism on the eve of Napoléon’s new regime would not be heeded, since "malheureusement, on n’écoute guère les économistes" (unfortunately no-one listens to the economists).
Molinari would return to the idea of the conflict between these two classes many times in his future writings.
Endnotes
[4] Molinari would also use another colorful term to describe the class of people who lived off taxpayers, "la classe budgétivore" (the budget eating class) in "Le XXe siècle" (1902).
Text
Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels. [1]
[83]
Les changements brusques ne se font jamais sans une certaine perte de forces vives; d'après ce principe, les révolutions politiques sont toujours funestes, à moins que l'on ne donne aux forces une direction plus utile, en consentant à une partie.
QUETELET. Du système social et des lois qui le régissent.
I
L'économie politique a deux ennemis irréconciliables : l'esprit de révolution et l'esprit. de réaction. Savez-vous pourquoi? Parce que l'un conduit à l'anarchie et l'autre au despotisme , et qu'au point de vue des intérêts généraux de la [84] société, l'anarchie et le despotisme sont presque également funestes. Aussi, chose digne d'attention, aux époques où la société s'est trouvée à la merci des partis extrêmes, où les garanties nécessaires et légitimes de la propriété ou de la liberté des citoyens ont été foulées aux pieds, on chercherait vainement un économiste au nombre des défenseurs et des courtisans du pouvoir. Au XVIIIe· siècle, les économistes, l'illustre Turgot à leur tête, dirigeaient tous leurs efforts vers la réforme des abus que la féodalité et le despotisme avaient accumulés en France. Un moment, Turgot fut ministre, et ce moment il l'employa à affranchir l'industrie des vieilles entraves qui pesaient sur elle, il supprimer les maîtrises et les jurandes, il établir la liberté du commerce des grains, à réformer les dépenses de la cour. Mais les gens qui vivaient des abus et qui s'en trouvaient bien, se liguèrent contre Turgot, et le ministre réformateur fut obligé de quitter le pouvoir. Quand je dis que Turgot fut obligé de quitter le pouvoir, je me trompe. Il aurait pu [85] rester ministre s'il l'avait voulu. Il lui aurait suffi pour cela de mettre une sourdine à ses convictions, et de fermer les yeux sur les abus. On n'exigeait pas autre chose de lui. Mais Turgot était un homme intelligent, et un honnête homme. En étudiant la société, en consultant ses besoins, en allant à la source de ses maux, il s'était convaincu de la nécessité de réformer le régime alors en vigueur, et il ne voulut point se rendre complice de ce régime. Il préféra une retraite honorable à un pouvoir sans honneur. A quelques années de distance, la révolution française donnait raison il Turgot. Ces réformes dont il apercevait la nécessité, mais qu’il voulait accomplir lentement, pacifiquement, la révolution les improvisa et les imposa avec une irrésistible violence. Bientôt même, dans ce brusque mouvement imprimé à des masses qui étaient naguère vouées à une immobilité séculaire, le but qu'il s'agissait d'atteindre fut dépassé. De la liberté constitutionnelle on tomba dans l'anarchie démagogique. Que firent alors les économistes ? [86] Ils demeurèrent ce qu'ils étaient auparavant : des libéraux, Comme ils avaient poursuivi, au nom de la liberté, la réforme des abus de l'ancien régime, ils résistèrent, au nom de la liberté encore, à la tyrannie sanguinaire du régime nouveau. Dans la fatale journée du 10 août, un économiste qui avait joué un rôle important. à l'Assemblée constituante, Dupont de Nemours, était au premier rang des gardes nationaux volontaires qui coururent défendre le malheureux Louis XVI. Proscrit sous la Terreur, il dut la vie à la journée du 9 thermidor, A quelque temps de là , il plaidait de nouveau la cause des libertés constitutionnelles, et il se faisait proscrire une seconde fois par le Directoire. Sous l'Empire, les économistes étaient enveloppés dans la réprobation dont Bonaparte frappait les idéologues, c'est-à-dire les hommes qui se permettaient de trouver que le régime du sabre n'était pas le plus parfait des régimes possibles, et la police interdisait, à cette époque, la réimpression du Traité d'économie politique de J .-B. Say. Sous la restauration, [87] deux économistes, MM. Comte et Dunoyer, s'honoraient par l'énergique résistance qu'ils opposaient aux doctrines ultra-réactionnaires des revenants de l'ancien régime. Enfin, à une époque récente, nous avons vu les économistes défendre la liberté contre les successeurs de Robespierre et de Babeuf, contre la queue de 95, comme ils la défendaient sous la restauration contre la queue de l’émigration. Et si le malheur du temps condamnait la société à séjourner de nouveau dans les limbes du despotisme, l'exemple des Dupont de Nemours, des J.-B. Say, des Comte et des Dunoyer, trouverait, croyez-le bien, des imitateurs.
Comment donc se fait-il qu'on n'ait pas rencontré encore un seul économiste parmi les fauteurs de l’anarchie ou parmi les courtisans du despotisme? Comment se fait-il que tous les hommes qui ont cultivé, depuis un siècle, la science économique, soient demeurés toujours entre ces deux extrêmes? Comment se fait-il qu'aucun d'eux ne se soit laissé entraîner par l'esprit de [88] révolution jusqu'à la démagogie, par; l'esprit de réaction jusqu'au despotisme? A quoi cela tient-il?
Cela tient à ce qu'en étudiant l'organisation de la société, en recherchant les causes de la prospérité ou de la décadence des nations, on acquiert la conviction profonde, irrésistible, que les deux situations extrêmes dont je viens de parler sont, presque également funestes au bien-être, à la santé du corps social.
Que les révolutions, considérées au point de vue de la prospérité et de l'avancement des sociétés, soient généralement des oeuvres funestes, de véritables catastrophes, cela ne saurait plus, je crois, faire l'objet d'un doute. On peut disputer sur les causes qui amènent les révolutions. On peut en rejeter la responsabilité de préférence sur tel parti ou sur tel autre. On peut se demander, par exemple, ce qui, de l'orgueil, de l'entêtement et de la cupidité des bénéficiaires des vieux abus, ou de la fougue impatiente et de l'inexpérience présomptueuse des novateurs, a le [89] plus contribué à déchainer la tempête. Les avis peuvent être partagés à cet égard. Mais quand on observe la société, en butte à ce terrible conflit des passions humaines, quand on compte, plus tard, les existences que la révolution a déracinées, les intérêts qu'elle a brisés, les épargnes qu'elle a dissipées, on s'aperçoit, à n'en plus pouvoir douter, que la révolution est un mal. On plaint alors les peuples qui n'ont pas su gouverner, contenir assez efficacement leurs passions pour les empêcher de se heurter comme les rafales d'un ouragan. On les plaint, mais parfois aussi, quand ou a été victime de leurs imprudences, quand on se trouve exposé par un fatal voisinage à supporter une part imméritée de leur châtiment, on finit par les maudire.
Je n'ignore pas que cette manière de juger les révolutions n'est pas conforme il l'opinion généralement répandue. Notre génération, par exemple, a été élevée à admirer, à vénérer la révolution de 1789. Dès notre enfance, nous avons été dressés à répéter comme des [90] perroquets ces phrases toutes faites: que la révolution française a émancipé le monde; que la France révolutionnaire a élaboré le progrès au profit de tous les peuples; que les armées de la révolution ont été les messagères glorieuses des idées de la révolution, des principes de la révolution; qu'elles portaient au bout de leurs baïonnettes la liberté, l'égalité et la fraternité, etc. Voilà les billevesées creuses dont nous avons été nourris et dont nous n'aurions pas manqué, à notre tour, de nourrir nos enfants, si nous n'avions pas eu la triste occasion d'en reconnaître l'inanité. Ce n'est pas que ,je veuille méconnaître l'utilité et la grandeur de quelques-uns des principes que la Révolution française a essayé de faire prévaloir. Non! je ne dirai pas de la révolution ce qu'en disait M. de Maistre: qu'elle est la pure impureté. J'admire l'élan généreux qui lui a donné naissance, je m'incline devant les nobles principes de tolérance et de liberté qu'elle n proclamés à la face du monde. Mais cet élan, mais ces principes, ils sont antérieurs à la [91] révolution, et, je tiens pour ma part que la révolution les a compromis au lieu de les servir. Je tiens que les moyens révolutionnaires, l'échafaud à l'intérieur, les baïonnettes au dehors ont été des instruments de la barbarie, et non des véhicules de progrès.
Les historiens qui ont raconté les événements de la révolution française ne possédaient, pour la plupart, que des notions économiques incomplètes ou superficielles. Aussi se sont-ils abstenus de la juger au point de vue économique. Aussi ne s'est avisé de dresser le bilan de la révolution. Aucun n'a recherché, même d'une manière approximative, ce qu'elle a coûté et ce qu'elle a rapporté.
Permettez-moi de vous donner une simple esquisse de ce bilan monstrueux. Permettez-moi de jeter un simple coup d'oeil sur le passif de la révolution de 1789 et sur son actif. Cet aperçu vous fera comprendre mieux que toute autre démonstration pourquoi les économistes ne sont pas révolutionnaires.
[92]
Dans le passif de la révolution de 1789, il faut d'abord comprendre les existences que les échafauds et les guerres révolutionnaires, mille fois plus meurtrières que les échafauds, ont tranchées. Il faut y compter la perte de tant d'hommes qui ont été arrachés à des occupations paisibles et productives pour aller périr sous le couteau des guillotines ou sous la mitraille des champs de bataille. On a l'habitude, je le sais, de compter pour peu de chose la vie des hommes. On a coutume de dire que les vides que les proscriptions, la guerre, la peste, ou tout autre fléau destructeur, occasionnent dans la population, sont bientôt comblés de telle manière qu'il n'y paraît plus. Cela me rappelle un mot, souvent répété, du grand Frédéric, à l'aspect du champ de bataille de Rosbach : Une nuit de Berlin réparera tout cela. Eh bien, ce mot n'était pas seulement inhumain, il était encore économiquement faux. Un homme, en effet, c'est un capital. Quand un fléau moissonne un homme dans la force de l'âge, toute la dépense [93] qui a été faite pour élever cet homme et pour le rendre propre à la production se trouve perdue. Sans doute, le vide finit par se combler, mais, en attendant, la société est privée des services d'un travailleur instruit, dressé, formé, et elle est obligée de dépenser un capital supplémentaire pour former un nouveau travailleur qui soit apte à remplacer celui qui a péri. Quand donc on dit que la destruction d'hommes occasionnée par une guerre ne coûte rien à la société, c'est, pardonnez-moi cette comparaison peu noble, mais d'une exactitude rigoureuse, c'est comme si l'on disait que la destruction de chevaux occasionnée par la morve ne coûte rien à l'agriculture. Or savez-vous combien d'hommes la révolution française et les guerres qui en ont été les conséquences, ont fait périr de mort violente? Sir Francis d'Ivernois, un des rares écrivains qui ont étudié cette lamentable époque au point de vue économique, n'en porte pas le nombre à moins de deux millions et demi, pendant la période de 1789 à 1799, et je suis [94] convaincu que son estimation est des plus modérées. Il convient de remarquer encore que les hécatombes humaines que la révolution sacrifiait sur ses échafauds et sur ses champs de bataille étaient généralement prélevées sur les classes utiles ; qu'elles se composaient d'individus dont l'intelligence et l'industrie étaient auparavant appliquées à la production. [2]
L'élite des hommes d'intelligence et d'énergie que comptait la forte génération de 89 fut sacrifiée sur les échafauds. Quant aux armées, elles cessèrent de se composer, comme auparavant, de la tourbe des mauvais sujets et des paresseux, de la lie de la population. Ces hommes nuisibles qui recrutaient jadis les armées, où leurs passions violentes se trouvaient à la fois satisfaites et refrénées, ces hommes nuisibles ne suffisaient plus à la révolution. Elle inventa cette terrible machine de la conscription, à l'aide de laquelle elle moissonna lies hommes dans tous les rangs [95] de la société, elle enleva le laboureur à sa charrue, l’artisan à son métier, le négociant à son comptoir, le savant ou l'homme de lettres à son cabinet pour envoyer pèle-mêle, ces hommes utiles à l'abattoir de ses champs de bataille.
Les hommes que la conscription lui livrait par centaines de mille et que ses généraux sacrifiaient avec une prodigalité jusqu'alors inouïe dans les fastes de la guerre, avaient donc bien une antre valeur que ceux qui périssaient dans les guerres de l'ancien régime. De là, en grande partie, la stérilité, l'absence de talent et de vigueur dans les arts, dans les lettres, dans l'industrie, qui se remarquent après la grande explosion révolutionnaire. C'est que l'élite de la nation avait été décimée et que les nouvelles générations n'avaient pu se former pour la production, au milieu des fureurs et des désastres de la guerre civile et de la guerre étrangère.
Mais la perte que la révolution causait à la société ne se bornait pas à une destruction d'hommes utiles. Non-seulement ces hommes [96] étaient enlevés aux emplois productifs, ils cessaient de contribuer à la production de la richesse et aux progrès des arts de la civilisation, mais encore ils étaient entretenus aux dépens des producteurs et employés, pour la plupart, à détruire de la richesse.
La révolution détruisait les hommes de deux manières, par la main du bourreau et par le fer des batailles.
Or, ces deux procédés de destruction étaient presque également coûteux. Sans doute, le terrorisme révolutionnaire ne se mettait pas en frais pour l'entretien de ses victimes. D'ailleurs, ils ne les gardait pas longtemps. Mais ce qui était horriblement coûteux, c'était l'appareil dont il se servait pour les atteindre et les détruit'e; c'était la multitude des dénonciateurs, des geôliers, des juges, des bourreaux, qu'il fallait alimenter, gorger, pour maintenir en activité la hideuse machine de la Terreur. En même temps, il fallait entretenir d'innombrables armées pour les besoins sans cesse renaissants de la guerre civile [97] et de la guerre étrangère. Comment s'y prenait la révolution pour faire face à des dépenses si formidables? Elle inventait des assignats, elle renouvelait, sur une échelle immense, les confiscations, les réquisitions, les contributions de guerre, et elle mettait la banqueroute à l'ordre du jour; en dix ans, elle émettait pour 45 milliards d'assignats. C'était, à la vérité, une valeur nominale, car cette masse de papier-monnaie ne représenta jamais plus de quinze cents millions ou deux milliards en valeur effective; mais ce ne fut pas moins un emprunt forcé, prélevé sous la plus désastreuse des formes, et qui ne fut jamais remboursé. Quant aux confiscations, aux réquisitions et aux contributions de guerre, il serait impossible d'en évaluer le montant même d'une manière approximative. Rien n'échappait aux confiscations et aux réquisitions. Quand on avait enlevé à un malheureux paysan, les fils qui l'assistaient dans son travail, on requérait son cheval et sa charrette pour les transports militaires, son bétail pour la subsistance [98] de l'armée, et jusqu'au soc de sa charrue pour en forger des armes de guerre.
On requérait encore, pour l'alimentation des armées ou pour celle des villes, la provision de blé qu'il avait dans son grenier, et on la lui payait en assignats dépréciés, au taux d'un tarif maximum. Lorsqu'il s'avisait de résister à de si abominables exactions, on le traitait d'aristocrate ou d’accapareur, et on l'envoyait à l'échafaud. Encore si les aliments et les autres objets extorqués au moyen des réquisitions étaient arrivés à leur destination! Mais le plus souvent ils demeuraient consignés dans les magasins de la république, où les charançons et les munitionnaires en faisaient leur profit.
Car les armées manquaient de tout, et elles .vivaient de maraude. Lorsque, faute de pouvoir les nourrir à l'intérieur, on les précipita sur l'Europe, elles vécurent de contributions de guerre. Les peuples oublient vite et le souvenir des contributions de guerre de la première révolution commence à se perdre; c'était pourtant [99] un gros chapitre, et un chapitre instructif! Certains pays s'étaient engraissés pendant la période de paix assez longue qui précéda la révolution, la Belgique et l'Italie par exemple. La révolution se chargea de les dégraisser. Ses généraux et ses proconsuls entendaient merveilleusement cette besogne-là. Danton se chargea de la Belgique, et Danton ne faisait pas les choses à demi. L'embonpoint ne nous gênait plus après la visite de Danton et des patriotes de 92.
En Italie, où comme en Belgique les révolutionnaires arrivaient en libérateurs, la seule ville de Milan fut soumise, en une fois, à une légère contribution de guerre de vingt millions. Jusqu'à l'époque des grands désastres de l'Empire, les contributions de guerre et les amendes infligées aux peuples vaincus, les recettes extérieures, comme on les nommait alors, suffire ut en grande partie pour subvenir à l'entretien des armées françaises. Et remarquez bien que les peuples n'avaient pas seulement à nourrir les armées de la révolution; ils étaient obligés encore [100] d'entretenir les armées qui luttaient contre celles-là. On les saignait à blanc, tant pour faire triompher la révolution que pour lui résister. En vingt années, l'Angleterre dépensait environ vingt milliards pour refouler la révolution, et l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne la secondaient, dans la mesure de leurs forces et de leurs ressources.
Cc n'est pas tout. Non seulement les immenses armées que la révolution fit lever et s'entrechoquer dans toute l'Europe, non seulement ces armées, composées de tant de millions de bras robustes, furent perdues pour la production, non seulement elles absorbèrent des milliards sous forme d'impôts, d'emprunts, de réquisitions, de contributions de guerre, mais encore elles furent employées à détruire par le fer et par le feu, les moyens de subsistance des populations.
Avant la révolution, le respect des propriétés particulières, pendant la guerre, était devenu peu à peu une règle du droit des gens. Lorsqu'une puissance méconnaissait cette règle [101] tutélaire, l'opinion du monde civilisé censurait rigoureusement sa conduite. Ainsi, l'incendie du Palatinat fut reproché comme un crime à Louis XIV. Cc respect des propriétés pendant la guerre, la révolution ne le connut jamais. A l'intérieur, la confiscation et la destruction des propriétés étaient ses procédés ordinaires. Après deux années de guerre civile, la Vendée ne présentait plus qu'un effroyable monceau de ruines. Environ 900,000 individus, hommes, femmes, enfants, vieillards, avaient péri, et le petit nombre de ceux qui avaient survécu au massacre trouvaient à peine de quoi s'alimenter et s'abriter. Les champs étaient dévastés, les enclos détruits, les maisons incendiées. Un ancien administrateur des armées républicaines, (lui a laissé les mémoires curieux sur cette guerre d'extermination, décrivait ainsi le spectacle qui s'était offert à lui dans une de ses tournées:
« Je n'ai pas vu, disait-il, un seul homme dans les paroisses de Saint-Harmand, Chantonnay et les Herbiers. Quelques femmes seulement [102] avaient échappé au glaive. Maisons de campagne, chaumières, habitations quelconques, tout était brûlé. Les troupeaux erraient comme frappés de terreur autour de leurs habitations fumantes. Je fus surpris par la nuit; mais les flammes de l'incendie éclairaient tout le pays. Aux beuglements et aux bêlements des troupeaux se joignaient les cris rauques des oiseaux de proie et des animaux carnassiers, qui. du fond des bois, se précipitaient sur les cadavres. Enfin, une colonne de feu que je voyais augmenter à mesure que j'approchais, me servit de fanal. C'était l'incendie de la ville de Mortagne. Quand j'y arrivai, je n'y trouvai d'autres êtres vivants que de malheureuses femmes, qui cherchaient à sauver quelques effets de l'embrasement général. »
Voilà la guerre civile. Voilà la révolution. Et ce système de destruction ne fut pas employé seulement dans les guerres civiles de la révolution. Il passa, plus tard, dans les guerres étrangères. En Espagne, les envahisseurs s'en servaient pour terrifier les populations qu'ils [103] voulaient assujettir ; en Russie, les peuples, menacés dans leur indépendance, s'en servaient pour affamer les envahisseurs. De toutes parts, on entassait ruines sur ruines, et le continent européen n'offrait plus qu'un vaste champ de désolation et de carnage.
Ainsi donc deux à trois millions d'hommes sacrifiés dans les luttes civiles ou dans les guerres étrangères; vingt ou trente milliards au moins prélevés sous forme d'impôts, d'emprunts, de confiscations, de réquisitions, de contributions de guerre pour subvenir aux frais de cette gigantesque boucherie d'hommes, sans parler des capitaux consommés ou détruits par le fer, l'incendie et la maraude, sans parler encore des capitaux consommés dans l'inaction, par suite de la crise révolutionnaire; voilà, au seul point de vue des intérêts matériels, le passif de la révolution française.
Maintenant, examinons son actif.
La révolution a détruit en France les maitrises et les jurandes, supprimé les douanes [104] intérieures et les anciennes servitudes féodales, mis dans la circulation les biens de la noblesse et du clergé. Voilà quels sont les articles principaux de son actif. Cet actif, les défenseurs de la révolution ont l'habitude de le l'aire sonner bien haut; mais pour peu qu'on se donne la peine de l'examiner de près, on 's'aperçoit qu'il y a beaucoup à l'abattre de l'éloge qu'ils en font. Lorsqu'on étudie l'ancien régime, tel qu'il subsistait en 1789, on s'aperçoit que ses vieux engins de servitude avaient été singulièrement affaiblis, rouillés par l'action du temps; on s'aperçoit aussi que, chaque jour, de nouvelles idées, de nouvelles découvertes, de nouveaux besoins se dressaient comme de véritables machines de guerre pour réduire en poussière les obstacles que ce régime opposait encore au développement de la richesse, à l'expansion de la civilisation.
Déjà Turgot avait fait une première tentative pour détruire les maîtrises et les jurandes ainsi que les douanes intérieures. Cette tentative avait échoué. Mais telles étaient les nécessités du temps [105] qu'une seconde aurait infailliblement abouti un peu plus tard. D'ailleurs, quelles ont été les conséquences finales de la révolution an point de vue de la liberté du travail et du commerce? Ces conséquences ont été funestes: la révolution a été fatale à la liberté des transactions comme à bien d'autres libertés, car elle a, sinon engendré, du moins renforcé et universalisé le régime prohibitif.
Avant la révolution, l'école de Quesnay et de Turgot, en France, celle d'Adam Smith, en Angleterre, avaient plaidé avec succès la cause rie la liberté commerciale, et un traité, basé sur la nouvelle doctrine économique, avait été conclu, en 1786, entre la France et l'Angleterre. Mais la révolution survint, et aussitôt on vit succéder au traité libéral de 1786 des mesures prohibitives d'une rigueur jusqu'alors sans exemple. Dans un de ses décrets fiévreux, la Convention avait enjoint à ses armées de ne plus faire de prisonniers anglais ; ce qui était revenir tout simplement aux coutumes de la primitive barbarie, Eh bien, ce système de destruction [106] impitoyable, la Convention ne se borna pas à l’appliquer aux soldats de l'Angleterre, elle l’appliqua encore à ses marchandises.
Les marchandises anglaises furent prohibées, et lorsqu'on parvenait à les saisir, on les brûlait sur les places publiques. Napoléon continua ce système barbare, il lui donna même des proportions colossales et il l'imposa à toutes les nations alliées de la France. Sous le régime du blocus continental, la plus grande partie du continent fut interdite aux marchandises anglaises, et les auto-da-fé de ces denrées proscrites se multiplièrent sur les places publiques. [3]
Enfin, après la chute de l'empire, l'industrie anglaise, qui avait été préservée des confiscations, des réquisitions, des assignats, du pillage et de l'incendie, l'industrie anglaise était si supérieure à celle des contrées de l'Europe occidentale, où la révolution avait étendu ses ravages, que les gouvernements furent partout obligés, par les ([107] clameurs des propriétaires et des industriels, de maintenir le régime prohibitif, tel que la révolution l'avait inauguré. Je suis convaincu, pour ma part, que la révolution française a retardé d'un siècle au moins l'avénement de la liberté commerciale, et ce n’est point là, à mon avis, un des moindres griefs que l'on puisse élever contre elle, au nom de la civilisation.
Quant à la réforme des impôts de l'ancien régime, ç'a été une simple mascarade. D'abord, les anciens impôts ont été abolis, en effet; mais comme le gouvernement révolutionnaire ne s'était point avisé de réduire les dépenses publiques, il fallut bien combler le vide causé par l'abolition des anciens impôts. Ce vide, on essaya de le remplir au moyen du papier-monnaie, des confiscations et des réquisitions; mais ces ressources révolutionnaires eurent une fin, et un beau jour le trésor public se trouva complétement à sec. Alors que fit-on? On rétablit purement et simplement les impôts que la révolution avait abolis. Seulement on eut soin de leur [108] donner d'autres noms, afin de ne pas trop effaroucher les contribuables. Ainsi la taille et les vingtièmes prirent le nom de contribution foncière; la taxe des maitrises et jurandes, le droit de marc d'or, que l'on payait pour être admis à faire le commerce ou à exercer une profession industrielle, furent remplacés par les patentes; le droit de contrôle fut désormais connu sous le nom de droit de timbre; les aides se nommèrent contributions indirectes, droits réunis; la gabelle, si odieuse, reçut la dénomination anodine d'impôt du sel; les octrois furent d'abord abolis, mais on ne tarda guère à les rétablir sous la philanthropique désignation d'octrois de bienfaisance; les corvées demeurèrent supprimées, mais les paysans furent assujettis aux prestations en nature. Bref. tout le vieux système d'impôts reparut; on prit seulement la peine de le débaptiser.
Pour ce qui concerne les droits féodaux sacrifiés dans la fameuse nuit du 4 août, ils avaient perdu presque toute leur importance, par suite des l'achats successifs qui en avaient été faits. S'ils [109] avaient eu encore quelque valeur, soyez surs qu'on ne les aurait pas lâchés si légèrement! Pour ce qui concerne enfin la confiscation et le morcellement des terres de la noblesse et du clergé, c'est une opération dont les avantages sont singulièrement contestés aujourd'hui, même au simple point de vue économique. Le produit de la vente de ces biens (estimé par l'ancien ministre Ramel à environ 2 milliards 500 millions) a été promptement englouti par les guerres de 1a révolution, et, plus tard, il a fallu endetter le pays pour indemniser les émigrés; il a fallu encore salarier le clergé pour le dédommager de l'inique spoliation dont on l'avait rendu victime. Quel a donc été le bénéfice de l'opération?
Veuillez remarquer, du reste, que cet ancien régime, que la révolution a renversé en France, a subsisté en Angleterre. Les Anglais ne se sont pas avisés, eux, de faire table rase de leurs antiques institutions; ils se sont contentés de les réformer, quand cela leur paraissait utile. Eh bien, comparez le développement que la richesse [110] publique a reçu en Angleterre, depuis un demi-siècle, à celui qu'elle a reçu en France; comparez encore, si vous le voulez, les libertés civiles et politiques que les deux pays ont acquises dans le même intervalle, et prononcez sur la valeur des deux systèmes!
Envisagé au point de vue des intérêts matériels, l'actif de la révolution française n'est pas lourd. Si l'on considérait la même révolution au point de vue moral, si l'on examinait l'influence que le papier-monnaie, les confiscations, la guerre, le despotisme et les autres fléaux qu'elle a engendrés, ont exercée sur la moralité des peuples. oh! alors le déficit monterait bien plus haut encore et la perte semblerait irréparable. On prétend, à la vérité, que la révolution française a jeté dans le monde une foule de germes admirables de liberté, d'égalité et de fraternité, et l’on répète, avec emphase, la phrase ronflante que vous savez sur les idées portées au bout des baïonnettes. Mais ne vous semble-t-il pas que ces fameux germes de liberté, d'égalité et de [111] fraternité que la révolution à l'épandus dans le monde, ont bien tardé à fructifier même en France? Ne vous semble-t-il pas aussi que les baïonnettes révolutionnaires ont été ne mauvais supports pour les idées libérales et progressives ?
Je suis convaincu, pour ma part, que la révolution avec son funèbre cortége de luttes civiles et de guerres d'invasion, a été funeste à la propagation des idées françaises, bien loin de la servir. Au XVIIIe siècle, la France était le grand foyer intellectuel de l'Europe. Ses philosophes réformateurs étaient écoutés comme des oracles. Les Polonais demandaient des constitutions à Mably et à Rousseau; un économiste français, Mercier de la Rivière, était appelé en Russie pour donner son avis sur les changements qu'il convenait d'apporter à la législation de l’empire. Enfin, Voltaire, le grand apôtre de l'esprit de tolérance et de liberté, Voltaire était l'idole de l'Europe, et ses livres faisaient la récréation des souverains et l'espoir des peuples.
Eh bien, quel peuple s'aviserait aujourd'hui [112] de demander des constitutions à la Fronce? Quel peuple se soucierait d'expérimenter les idées françaises? On s'en préserve comme de la peste, et l'on confond même les bonnes avec les mauvaises dans une réprobation commune. Avant la révolution, tous les esprits libéraux, toutes les intelligences progressives, tous les coeurs où vibrait le sentiment de l'amour de l'humanité, se tournaient du côté de la France. Ils s'en détournent aujourd'hui, et c'est vers l'Angleterre que se dirigent leurs voeux et leurs espérances. C'est l'Angleterre qui est devenue l'appui et l'espoir de la liberté en Europe.
Quand donc on dresse le bilan de la révolution française ; quand on considère d’une part les immenses ravages qu'elle a causés, les sacrifices d'hommes et de capitaux qu'elle a coûté au monde; quand on examine d'une autre part les· acquisitions presque toutes illusoires ou précaires qui lui sont dues; quand on balance son actif avec son passif, on s'aperçoit, il n'en plus pouvoir douter, que l'affaire a été mauvaise pour la France, mauvaise pour l'humanité.
[113]
Que si l'on applique les mêmes procédés d'analyse économique à la révolution de 1848, si l'on dresse le bilan de la révolution de février, on aura moins de peine encore à s'assurer que l’affaire a été mauvaise. Au passif, il convient de placer d’abord l'augmentation des dépenses militaires que cette révolution a occasionnées en Europe, les frais des guerres intestines qui ont éclaté en France, en Italie, en Allemagne, sans parler des éventualités possibles. Or la guerre est la seule industrie qui n'ait point progressé de nos jours, dans le sens du bon marché. pour ne citer qu'un seul exemple, on évalue à plus de 70 millions les frais de répression de la seule insurrection de juin. Et pourtant ce douloureux chapitre des dépenses directes de la révolution est insignifiant en comparaison de celui des pertes et des dépenses indirectes qu'elle a causées.
A dater du 24 février 1848, l'industrie européenne a subi une dépression effrayante, occasionnée par la crise révolutionnaire , et ce n’est point par millions, c'est par milliards qu'il faut [114] compter ses pertes. Une enquête, dressée per les soins de la chambre de commerce, et sous la direction de M. Horace Say, digue héritier d’un père illustre, atteste que la production industrielle de Paris, qui s'élevait à 1,463 millions en 1847, est descendue à 677 millions en 1848. C'est donc une perte de plus de 700 millions en une seule année et dans une seule ville. Calculez, d'après cela, ce que la France a perdu, ce que l'Italie, l'Autriche, l’Allemagne ont perdu. Les nations mêmes qui avaient eu la sagesse de se préserver de la contagion révolutionnaire ont subi le contre-coup de la crise. Le commerce extérieur de la .Belgique, par exemple, qui présentait en 1847 un total de 732 millions pour les importations et les exportations, est descendu à 631 millions en 1848. Enfin l'Angleterre, que 1'on accuse avec si peu de raison de semer le trouble en Europe pour développer sa production aux dépens de celle de ses rivales, l'Angleterre a vu ses exportations tomber de 78 millions de liv. st. en 1847 à 71 millions [115] en 1848. En un mot, ç'a été un désastre universel. Voilà pour le passif de la révolution de février. Quant à son actif, vous savez de quel supplément de libertés cette révolution de malheur a doté le monde, et peut-être le compte n'eu est-il pas encore fermé. Son actif n'est pas même nul, il est en moins. C'est une banqueroute politique, comme peut-être jamais le monde n'en avait vu.
Vous devez comprendre maintenant pourquoi les économistes ne sont point partisans des révolutions; pourquoi, après le 24 février 1848 comme après le 10 août 1792, ils se sont efforcés de lutter contre l'esprit révolutionnaire. C'est que les économistes ne se contentent pas de phrases creuses et de formules vides de sens; c'est qu'ils vont an fond des choses; c'est qu'ils se donnent la peine de dresser le compte des révolutions, expédient dont ne s'avisent guère les esprits enthousiastes qui poussent à la roue des révolutions et qu'elles ne manquent jamais d'écraser dans leurs reculs. Or, comme les [116] révolutions ne résistent pas à l'épreuve de la tenue des livres en partie double; comme les révolutions sont de grandes mangeuses, des dissipatrices effrénées qui engloutissent en quelques jours les épargnes accumulées pendant des siècles; comme elles n'ont le plus souvent à donner au peuple, en échange de son épargne et de la vie de ses enfants, que des paroles échauffantes et des utopies malsaines, les économistes, qui sont les teneurs de livres de la politique, ont crié haro sur les révolutions et déclaré une guerre mortelle aux révolutionnaires.
II
[117]
Il me reste à expliquer, à présent, pourquoi l'économie politique est hostile au despotisme, pourquoi les économistes n'ont pas plus de goût pour les despotes qu'ils n'en ont pour les révolutionnaires.
A quoi sert un gouvernement? Quelle est sa fonction principale dans la société? Un gouvernement, vous le savez, a pour fonction principale de garantir la sécurité publique. La sécurité est une denrée indispensable à la société. Quand elle vient à faire défaut, quand la vie et la propriété des citoyens cessent d'être suffisamment garanties, la production et l'épargne se [118] ralentissent et la société rétrograde vers la barbarie.
Eh bien, au point de vue de la sécurité nécessaire à tous les intérêts, lequel vaut le mieux, dans l'état actuel de la civilisation, d'un gouvernement représentatif ou d'un gouvernement despotique? Laquelle de ces deux formes de gouvernement peut donner aux nations civilisées, les meilleures garanties de sécurité ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner.
Depuis quelque temps, on vante beaucoup le despotisme. Le despotisme est à la mode. On le prône comme ayant des vertus infaillibles pour réparer les maux causés par l'anarchie, pour raffermir la société ébranlée jusque dans ses fondements, etc ., etc. C'est la phraséologie consacrée.
Et, chose triste il dire, cette phraséologie-là a autant de succès auprès d'une certaine portion arriérée, ignorante, imprévoyante, des classes supérieures, que la phraséologie révolutionnaire en avait naguère auprès d'une certaine portion arriérée, ignorante, imprévoyante des classes inférieures. Le despotisme fait maintenant [119] des prosélytes dans les classes élevées, comme le socialisme en faisait, il y a quelque temps, dans les basses classes. Cela se conçoit, du reste, car le despotisme et le socialisme s'appuient, en définitive, sur les mêmes passions et ils exploitent les mêmes illusions. Pourquoi les classes inférieures se jetaient-elles dans les bras du socialisme? Parce qu'on leur avait fait croire que le socialisme possédait des recettes merveilleuses pour améliorer leur condition sociale; parce qu'elles étaient convaincues que le socialisme avait le pouvoir de les enrichir en un tour de main. Pourquoi le despotisme trouve-t-il maintenant des panégyristes au sein des classes élevées? Parce qu'on lui attribue des vertus merveilleuses pour garantir les intérêts que la révolution a menacés, parce qu'on croit que c'est un véhicule de conservation d'une irrésistible puissance.
Les illusions des classes qui s'étaient jetées dans les bras du socialisme, ces illusions ont été cruellement dissipées. Une déception non moins [120] cruelle attend les hommes assez imprévoyants, assez aveugles, assez insensés pour abandonner leur vie et leur fortune à la merci du despotisme.
Si nous voulons nous en convaincre, examinons les garanties de sécurité que le régime parlementaire, d'une part, le despotisme d'une autre part, peuvent donner aux intérêts, et comparons.
Dans les pays qui jouissent encore du bienfait du régime parlementaire, en Angleterre et en Belgique, par exemple, sur quelle base s'appuie le gouvernement? Il s'appuie immédiatement sur un corps électoral composé des couches supérieures de la nation, sur un corps électoral qui possède la plus grande partie du capital productif du pays, et qui réunit, en même temps, je ne dirai pas la plus grande partie de l'intelligence de la nation, mais la plus grande partie de ses lumières.
Ce corps électoral, composé de propriétaires, d'industriels, de négociants grands et petits, d'hommes appartenant aux professions libérales, ce corps électoral qui renferme la plupart [121] des capitalistes qui fournissent les éléments nécessaires de la production et des hommes intelligents, industrieux et laborieux qui la dirigent, ce corps électoral nomme des mandataires chargés de fournir un gouvernement les ressources dont il a besoin et de contrôler ses actes. Rien ne peut se faire sans leur assentiment, car ils tiennent les cordons de la bourse du pays. Cc que veut ce corps électoral, représenté par ses mandataires, le gouvernement doit l'exécuter, sous peine non-seulement de se rendre impopulaire, odieux, mais de compromettre son existence même.
La volonté du corps électoral, voilà le régulateur suprême d'un gouvernement représentatif. Cette volonté exprimée par la représentation nationale, est éclairée et fortifiée par la presse.
La presse n'est, pas moins que le parlement lui-même, un élément essentiel du régime représentatif, et vous allez voir quel rôle admirable, quelle fonction tutélaire elle y remplit, à la considérer au simple point de vue des intérêts matériels.
[122]
On s'est plaint fréquemment de ce que la presse égarait ou tyrannisait l'opinion. Ces plaintes peuvent être jusqu'à un certain point fondées dans un pays où la presse se trouve constituée en monopole, où des entraves politiques et fiscales rendent difficile, sinon impossible, la multiplication des journaux. Mais quand la presse est pleinement libre comme elle l'est, grâce au ciel, en Belgique, [4] la presse n'apparaît plus que comme instrument à l'aide duquel se formule et s'exprime, dans ses mille nuances, l'opinion d'un pays ; à l'aide duquel aussi cette opinion peut être mesurée, pesée, évaluée avec une exactitude presque mathématique.
Au premier aspect, la presse a, j'en conviens, quelque chose de peu rassurant. C'est une machine affreusement bruyante et dont tous les mouvements paraissent désordonnés, anarchiques. On en est ahuri et épouvanté. La surprise et l'épouvante redoublent encore lorsqu'on [123] considère en quelles mains peut tomber ce formidable levier. Car la presse est une industrie dans laquelle le premier venu peut s'engager. On n'exige du journaliste aucune garantie de savoir ou de moralité, I.'accès de la presse n’est interdit ni aux ignorants ni même aux hommes flétris par la justice ou réprouvés par l'opinion.
Voilà, se dit-on , un lamentable désordre et un affreux péril. Comment la société peut-elle subsister, ainsi livrée aux excitations journalières d'une classe d'hommes qui ne lui présentent aucune garantie? N'est-ce pas une situation intolérable? Cependant, que l'on se donne la peine d'examiner de plus près le mécanisme de la presse, et le péril disparaît. On aperçoit alors une puissance cachée dont la presse n'est que l'instrument, et qui en détermine ou qui en règle tous les mouvements. Je veux parler de l'opinion et des intérêts des classes auxquelles les journaux s'adressent.
Assurément, les hommes qui tiennent entre leurs mains le levier de la presse, sont les [124] maîtres d'en disposer à leur guise, absolument comme les fabricants de drap sont les maîtres de fabriquer, selon leur convenance, du gros drap ou du drap fin, et de le teindre en rouge, en jaune, en bleu ou en vert. Le journaliste est le maître de donner à son journal la couleur qui lui plaît le mieux, la couleur rouge, par exemple, comme le fabricant est le maître de teindre son drap en écarlate ou en jaune serin. A cet égard, la société n'a d'action ni sur l'un ni sur l'autre, du moins en apparence. Je dis, en apparence, car, en réalité, la société est parfaitement sûre qu'elle ne sera jamais réduite à ne lire que des journaux rouges et il ne porter que des habits écarlates ou jaune-serin. Et savez-vous pourquoi sa sécurité est entière sous ce double l'apport? Parce que journalistes et fabricants de draps sont intéressés à fournir à leur clientèle non pas les couleurs qui leur conviennent à eux, mais les couleurs qui lui conviennent à elle; parce que la liberté de la presse oblige le journaliste à se conformer à l'opinion de sa clientèle, comme la [125] liberté de l'industrie oblige le fabricant de drap à se conformer au goût de la sienne.
Supposez que deux ou trois grands fabricants de Verviers aient la fantaisie de teindre leurs draps en écarlate ou en jaune, serin, leur clientèle ne s'empressera-t-elle pas de leur tourner le dos? Et grâce il la liberté de l’industrie, cette clientèle, dont le goût modeste et tranquille aura été imprudemment méconnu, ne trouvera-t-elle pas ailleurs assez de drap noir, bleu. vert ou brun pour se vêtir? Supposez de même que nos journaux monarchiques et constitutionnels s'avisent de prêcher demain les doctrines de la république rouge, supposez qu'ils s'avisent de glorifier Robespierre, Marat et Baboeuf, leur clientèle ahurie et offensée ne se hâtera-t-elle pas de les quitter en masse pour s'adresser ailleurs? Et, comme nous jouissons de la liberté de la presse, des feuilles nouvelles ne surgiront-elles pas du jour au lendemain pour recueillir cette bonne clientèle monarchique et constitutionnelle?
La presse, au moins dans les pays où les [126] gouvernements n'ont pas commis la folie d'entraver son développement et de limiter sa liberté, la presse est obligée de se conformer exactement, scrupuleusement à l’opinion. Sous peine de perdre leurs lecteurs et leurs abonnés, c'est-a-dire sous peine de mort, les ,journaux sont tenus d'approprier leur langage à l'esprit de leur clientèle, et les journalistes sont bien moins les gouvernants, les directeurs de l'opinion, que ses hérauts ou ses trompettes.
Dans les pays libres, chacune des mille nuances de l'opinion se trouve ainsi exprimée, représentée dans la presse, et chacune y figure précisément au rang que lui assigne son importance. Les nuances les plus répandues sont celles qui comptent le plus de journaux ou dont les journaux comptent le plus d'abonnés et de lecteurs. En sorte qu'il suffit de faire le dénombrement de la presse et de sa clientèle pour connaître avec une exactitude presque mathématique l'état de l'opinion. Dans les pays libres, la presse n'est autre chose qu'un véritable pèse-opinion. [5]
[127]
Que résulte-t-il de là? c'est que, dans les pays libres, le gouvernement ne marche jamais en aveugle; c'est qu'il n'est jamais exposé il se briser contre des écueils cachés, à moins qu'il ne ferme volontairement les yeux à la lumière. Il peut connaître, jour par jour, l'état des esprits, et il lui suffit de s'appuyer toujours sur l'opinion dominante pour demeurer solide, inébranlable.
Sans doute, l'opinion peut se fourvoyer. Mais quand on examine de près les intérêts que l'opinion représente, dont elle est l'expression immédiate, on s'aperçoit que ses écarts ne sauraient être dangereux. Quelle prenne, en effet, une direction fausse et mauvaise, que le gouvernement la suive dans cette direction-là, et les intérêts ne tardent pas d'en souffrir. Aussitôt l'opinion se convertit sous la pression irrésistible des intérêts; le langage de la presse, d'une part, les choix du corps électoral, de l'autre, se modifient en conséquence et la direction du gouvernement est changée.
C'est ainsi, par exemple, que le régime [128] représentatif a maintenu pendant plus de trente années, presque sans aucune altération, la paix du monde. C'est ainsi que la paix a pu devenir l’état normal des sociétés, tandis qu'elle apparaissait naguère encore comme un état exceptionnel et transitoire, comme un phénomène aussi rare qu'il était souhaitable. Pourquoi un changement si bienfaisant s'est-il opéré? Pourquoi le règne de la paix a-t-il pu succéder à celui de la guerre? Parce que les classes industrieuses et éclairées qui composent le corps électoral et la clientèle des journaux, parce que ces classes dirigeantes des pays représentatifs savent ce que la guerre coûte et ce qu'elle rapporte, parce qu'elles ne se soucient point de s'embarquer dans des entreprises qu'elles savent être ruineuses pour elles, ruineuses pour leur pays. Et comme la volonté de ces classes industrieuses et intelligentes est le régulateur suprême des gouvernements représentatifs, ceux-ci évitent aujourd'hui la guerre avec autant de soin que les gouvernements d'autrefois en mettaient à la provoquer et à la perpétuer.
III
[129]
Maintenant., supposez que la tribune soit brisée et 1a presse bâillonnée, supposez que le despotisme se substitue au régime représentatif, et voyez ce qui va se passer, Cette grande classe de propriétaires, de capitalistes, d'industrie!s, de négociants, dont l'opinion manifestée à la tribune et de la presse était souveraine hier, cette grande classe si profondément intéressée il la conservation sociale, se trouve aussitôt privée de tout pouvoir, de toute influence, Ce n'est plus sur elle que l'on s'appuie, ce n'est plus elle que l'on [130] consulte. Elle ne compte plus, elle n'existe plus.
Comment, en effet, conserverait-elle la moindre influence politique? Le despote n'a-t-il pas brisé ou faussé les instruments à l'aide desquels l'opinion de celle classe intelligente et libre pouvait se produire au grand jour? N'a-t-il pas fait taire les idéologues et les bavards? N'a-t-il pas ordonné que le silence se fît, autour de lui?
C'est désormais à l'Administration qu'est commis le soin de manifester ce que pense et ce que veut le pays? C'est l'Administration qui est chargée d'instruire le souverain de l'état de l'opinion. Or peut-on espérer que ce bilan de l'opinion, dressé par voie administrative, sera toujours bien véridique? Peut-on espérer encore que les intérêts des classes industrieuses et éclairées trouveront dans l’Administration un avocat bien fidèle? Ceci vaut la peine d'être examiné de près.
Sous un régime de despotisme, l'opposition à la volonté du souverain apparaît comme une chose si inouïe, si exorbitante, si éloignée de toutes les notions du sens commun, que, dans [131] les monarchies du bon vieux temps, un seul homme avait le privilége de faire entendre au maître des vérités désagréables: c'était le fou. Et il ne paraît pas que ce genre de folie ait jamais été contagieux. Cela se conçoit aisément. Un despote n'est-il pas le souverain dispensateur des grâces, des honneurs, de la richesse? Comme il puise à même dans 1a bourse de la nation, sa faveur n'est-elle pas un Pactole inépuisable ? Ne peut-il pas d'un mot combler ses favoris? Or cette faveur dorée, quel est le moyen le plus sûr de l'obtenir ? N'est-re pas de flatter les goûts ou les penchants du maître et de dire amen il toutes ses volontés? Car l'homme est ainsi fait, que soit qu'il se trouve placé au point le plus élevé ou au degré le plus bas de l'échelle sociale, sur le trône ou dans la fange, il aime ceux qui l'approuvent, il déteste ceux qui le critiquent. C'est sa nature, Depuis que l'humanité subit la dure expérience du despotisme, combien pourrait-on citer d'exemples de récompenses accordées pour avoir désapprouvé les [132] vues d'un souverain et critiqué ses actes? En revanche, les faveurs jetées en pâture à la détestable engeance des flatteurs ne sont-elles pas plus nombreuses que les sables de la mer? On conçoit donc parfaitement que l'opposition soit rare sous un régime de despotisme : c'est que là plus qu'ailleurs l'opposition est improductive ou ruineuse, et la flatterie lucrative.
Quand un souverain despotique manifeste sa volonté, on ne s'occupe point de la discuter, on la suit. Que s'il lui convient par hasard de consulter l'opinion du pays, comment les conseillers investis de sa confiance donnent-ils satisfaction à ce voeu? N'est-ce pas toujours en faisant en sorte que le pays n'ait d'autre opinion que celle du souverain? S'ils s'avisaient naïvement de faire parler le pays comme il parle en réalité, ne courraient-ils pas risque de compromettre leur position? Ne les rendrait-on pas responsables de ce qu'on ne manquerait pas de nommer les écarts de l'opinion ? Tel est le vice organique du despotisme que jamais sous ce régime l'opinion [133] vraie du pays ne peut être connue du souverain.
Il n'en est pas ainsi, comme chacun sait, sous le régime représentatif. Sans doute, il y a encore, sous ce régime, un monarque naturellement disposé à écouter ses penchants et il faire prévaloir sa volonté; il y a encore des administrateurs de haut et de bas étage, naturellement disposes aussi à flatter les penchants du monarque et à exécuter d'une manière passive ses volontés pour peu qu'ils y trouvent leur profit. Malheureusement, la situation n'est plus la même: le monarque n'est plus le suprême dispensateur des honneurs et de la fortune, la fontaine inépuisable des grâces, car les idéologues et les bavards ont rigoureusement limité ses attributions et ses appointements, ils ont mis un robinet à la fontaine. Si le monarque déploie sa munificence, ce n'est plus aux dépens des économies de la nation, c'est aux dépens des siennes. Dans cette situation nouvelle, le métier de courtisan devient presque improductif, et comme ce métier n'a rien, après tout, de bien [134] attrayant, on s'en lasse. On ne flatte plus autant les princes parce qu'on ne trouve plus autant le profit à les flatte. C'est une industrie perdue. D'un autre côté, le prince n'a plus besoin de s'adresser à son administration pour savoir ce que la nation pense et veut; il y a une tribune et une presse qui se chargent de le lui dire.
Sous un régime de despotisme, l'administration est, par le vice même de ce régime, excitée à sacrifier l'opinion du pays aux penchants du souverain. Il y a pis encore: son intérêt immédiat la pousse à conseiller au souverain une conduite contraire aux intérêts du reste de la nation.
Que sont, en effet, les administrateurs? Des mangeurs de taxes. Ils vivent du produit des contributions levées sur le pays. Quel est en conséquence leur intérêt immédiat? C'est d'avoir de bonnes taxes à manger; c’est d'avoir un gros budget il faire. Plus les contribuables sont accablés d'impôts, plus l'administration est florissante. C'est un administrateur qui a émis cet axiome demeuré célèbre: l'impôt est le meilleur des [135] placements. Pour l'administration, oui à coup-sûr! Toute entreprise publique, qu'elle soit onéreuse ou productive pour la communauté, ne profite-t-elle pas, quand même, à l'administration? Si l'entreprise échoue, qu'importe aux administrateurs? N'ont-ils pas, eu attendant, administré la dépense? Et alors même qu'une nation subit dans ses affaires industrielles et commerciales lc contre-coup des fausses spéculations de son gouvernement, voit-on baisser les salaires administratifs ? Que si, au contraire, l'entreprise réussit, l'administration n'en tire-t-elle pas le profit le plus clair? N'est-ce pas un nouveau débouché qui s'ouvre d'une manière permanente à son industrie?
Comment donc l'administration serait-elle un organe véridique de l’opinion? Comment les mangeurs de taxes seraient-ils les défenseurs fidèles des payeurs de taxes?
Aux influences administratives se joignent les influences militaires pour diriger le mécanisme primitif et grossier du despotisme, et celles-ci pont pires encore que les premières. Car si [136] l'administration pousse à la dépense, l'armée pousse à la guerre, c'est-à-dire à la plus onéreuse de toutes les dépenses. La guerre n'est-elle pas pour l'armée la source de la gloire, de la fortune et des honneurs? Les campagnes ne comptent-elles pas double dans les états de services militaires? Comment l'armée ne pousserait-elle pas à la guerre?
Ces garanties de bonne économie et de paix que possède à un si haut degré une nation lorsqu'elle tient elle-même les cordons de sa bourse, lorsque toutes les entreprises, partant toutes les dépenses du gouvernement, sont soumises aux libres discussions de la presse et aux votes des mandataires des « payeurs de taxes, » ces garanties précieuses des intérêts que deviennent-elles donc sous un régime où l'influence des « mangeurs de taxes » de l'administration et de l'armée demeure seule debout?
Je n'ignore pas que la prétention du despotisme, c'est de n'obéir à aucune influence, c'est de suivre toujours sa propre impulsion. Mais je ne connais pas de prétention qui soit moins [137] justifiée que celle-là. Il y a bien longtemps que l'on a dit que si le despote est un tyran, c'est aussi un esclave. A Rome, l'empereur était à la merci de ses prétoriens; à Constantinople, le sultan était il la discrétion de les janissaires. Quand les janissaires étaient mécontents, ils renversaient leurs marmites et le sultan tremblait dans son palais.
Qu'il le veuille ou non, le despote subit l'influence des corps organisés sur lesquels il est obligé de s'appuyer pour gouverner son peuple et le maintenir dans l’obéissance. L'empereur Napoléon Ier était certainement le despote le plus absolu qui fut jamais, et cependant, sans s'en douter, il n'agissait guère que d'après les impulsions combinées de son administration et de son armée. Ai-je besoin d'ajouter qu'elles le poussaient incessamment à la guerre, alors même que la nation voulait le plus énergiquement la paix? Ainsi, par exemple, lorsque le projet de l'expédition de Russie eut commencé à s'ébruiter l'opinion se montra universellement contraire à cette folle entreprise, Pourtant, chose curieuse! [138] de toutes parts les corps constitués envoyèrent, au nom du pays, des adresses de félicitations à l'empereur. C'est que les administrateurs, intéressés à flatter le penchant du Maître, intéressés encore à l'accroissement de leur débouché extérieur, avaient traduit à leur manière le voeu de l'opinion. Quant à l'armée, elle était, comme toujours, remplie d'enthousiasme. L'expédition de Russie, n'était-ce pas pour elle une nouvelle moisson de lauriers à recueillir'! Une moisson de lauriers, c'est-à-dire, en langage vulgaire, de l'avancement, des pensions, des croix et de la maraude. Un seul homme osa se rendre, en cette circonstance, l'organe de l'opinion, ce fut l'ex-ministre de la police, Fouché. Fouché envoya à l'empereur un mémoire dans lequel il exprimait la pensée publique au sujet de l'expédition projetée. Napoléon Ier fit appeler l'auteur de cet impertinent mémoire, et lui lava la tête, pour employer une de ses expressions familières, en lui demandant pourquoi il se mêlait de ce qui ne le regardait pas:
[139]
« J'ai huit cent mille hommes, dit-il, et pour quelqu'un qui possède une pareille armée, l'Europe n'est qu'une vieille prostituée qui doit obéir à ses volontés. Ne m'avez-vous pas dit vous-même qu'impossible n'était pas français? Je règle ma conduite plutôt sur l’opinion de mes armées que sure les sentiments de vos grands, qui sont devenus trop riches, et qui, tandis que vous affectez d'être inquiet pour moi, ne craignent que la confusion générale qui suivrait ma mort. Ne vous tourmentez pas; mais regardez la guerre de Russie comme une mesure sage que commandent les véritables intérêts de la France et la tranquillité générale. Suis-je blâmable si le haut degré de puissance que j'ai déjà acquis me force à prendre la dictature de l'univers ? Ma destinée n'est pas encore accomplie ; ma position actuelle n'est que l'ébauche d'un tableau qu’il faut que j'achève, etc., etc. »
L’auteur du mémoire essaya de défendre son oeuvre. Le maître ne voulut rien écouter, et Fouché tomba complétement en disgrâce. Bel encouragement pour ceux-là qui auraient voulu faire entendre la voix mâle de la vérité, au milieu des fades concerts des séraphins administratifs!
[140]
L'année suivante, après les effroyables désastres de la campagne de Russie, l’opinion de 1a France se prononça plus énergiquement encore en faveur de la paix. Mais l'administration ne manqua pas de l'intercepter de nouveau au passage pour la frelater. Après avoir passé à travers l'alambic administratif, les voeux unanimes de la nation pour la conclusion de la paix se trouvèrent soudainement transformés en voeux pour la continuation de la guerre. Dans sa Vie de Napoléon, un ouvrage auquel, pour le dire en passant, on n'a pas assez rendu justice, sir Walter Scott fait remarquer judicieusement combien la destruction de tous les organes libres de la pensée du pays fut alors funeste à la France et à l'empereur lui-même:
« Une des mesures les plus impolitiques et les plus inexcusables de Bonaparte avait été de détruire complétement tous les moyens par lesquels l'opinion publique pouvait se manifester en France. Son système de despotisme, qui n'avait laissé aucune manière de faire connaître le sentiment national sur les affaires publiques, [141] soit par la presse, soit par des corps de représentants, devint alors un inconvénient sérieux. La voix de l'opinion publique était misérablement remplacée par celles de fonctionnaires stipendiés, qui, comme des fontaines artificielles, ne faisaient que rendre avec des enjolivements les opinions qui leur étaient transmises du réservoir général à Paris. S’il eût été permis à des agents libres, de quelque genre que ce fût, de parler de l'état de l'esprit public, Napoléon aurait eu sous les yeux un tableau qui l"aurait promptement rappelé en France. Il aurait. appris que la nation, moins touchée des maux de la guerre tant qu'elle avait été éblouie par l'éclat des conquêtes et de la gloire militaire, y était devenue vivement sensible depuis que des défaites s'y étaient jointes, et avaient imposé de nouvelles levées à la population. Il aurait appris que la fatale retraite de Moscou, et cette campagne précaire de Saxe, avaient éveillé des partis et des intérêts qui sommeillaient depuis longtemps; que le nom des Bourbons se faisait entendre de nouveau dans les frontières de l'Ouest; que cinquante mille conscrits réfractaires erraient dans toute la France, et se formaient en bandes prêtes à se réunir sous le premier étendard qu'on lèverait coutre l'autorité impériale; enfin que dans le corps législatif, de même que dans le sénat., il s'était déjà organisé une [142] opposition tacite à son gouvernement qui n'attendait qu'un moment de faiblesse pour éclater. [6] »
Aussi, chose bonne à signaler, les capitalistes, les industrie et les négociants, qui avaient d'abord acclamé le régime impérial, cessèrent peu à peu d'avoir confiance dans ce régime. A l'origine, ils l'avaient adopté avec enthousiasme, parce qu'ils le considéraient comme une sûre garantie contre le retour de l'anarchie. Leur enthousiasme s'était encore accru à la suite des solennelles assurances de paix, pur lesquelles Bonaparte avait eu l'habileté d'inaugurer l'avénement de son pouvoir souverain, (Voir la première partie, p. 27.) La confiance, qui avait disparu dans la tourmente révolutionnaire, renaquit comme par enchantement sous le consulat. Il y eut alors dans toutes les branches de l'activité nationale une magnifique reprise des affaires, une merveilleuse impulsion donnée à toutes les [143] entreprises. Malheureusement, l'influence néfaste des intérêts de guerre auxquels la constitution de l'empire donnait la prépondérance, fit bientôt succéder le malaise à la prospérité. Les classes industrieuses et capitalistes demeurant sans représentation sérieuse, sans organes libres, les corps constitués, civils et militaires ayant seuls la parole, les assurances pacifiques s'envolèrent en fumée et l'Europe redevint une sanglante arène. A mesure que l'expérience démontra plus clairement aux classes industrieuses et capitalistes qu'elles étaient dépourvues des organes politiques nécessaires pour faire prédominer leurs intérêts de paix sur les intérêts de guerre de l'administration et de l'armée, leur confiance dans le régime impérial alla s'affaiblissant. Leurs illusions paraissent avoir duré jusqu'en 1807, mais, à dater de cette époque, bien que l'établissement impérial continuât de se consolider et de prendre même des proportions de plus en plus colossales, la confiance diminua graduelement, et les fonds baissèrent d'une manière [144] continue. [7] C'est que les intérêts avaient compris décidément que le régime impérial, par le vice même de son despotisme, ne pouvait leur [145] donner toute la sécurité qui leur était nécessaire, Enfin, quand l'empire vint à succomber sous l'effort de l'Europe coalisée, on sait ce qui arriva. Il arriva que les intérêts se rassurèrent et que les fonds montèrent dans toute l'Europe, même en France. Au point de vue des intérêts, cette grande bataille qui mit fin au despotisme impérial, en établissant le régime constitutionnel sur ses débris, cette grande bataille qui inaugura et assura la paix générale fut peut-être la meilleure affaire que les peuples eussent jamais faite, car elle anéantit une cause de perturbation, d'insécurité qui ralentissait l'essor de la production et de l'épargne dans le monde entier.
Si Bonaparte avait accordé dans sa constitution une part légitime d'influence aux classes intéressées à la paix, au lieu de bâillonner l'opinion avec le pommeau de son épée et de s'appuyer uniquement sur des intérêts de guerre, les destinées de la nation et les siennes n'eussent-elles pas été bien différentes? Permettez-moi de citer encore, à ce sujet, un passage de la Vie de [146] Napoléon, passage empreint d'un merveilleux bon sens, et malheureusement aussi d'un bon sens prophétique:
« Quoique nous admettions tout ce qui peut excuser Bonaparte d'avoir choisi le premier rôle du gouvernement, et que nous accordions même à ses admirateurs qu'il était nécessaire, pour le bien de la France, qu’il occupât la place de premier consul, notre franchise ne peut aller plus loin. Nous ne pouvons, par exemple, sanctionner l'accumulation d'autorité qui concentra dans ses mains tous les pouvoirs de l'État, et priva, dès ce moment, le peuple français du moindre espoir de liberté et de la possibilité de se défendre contre la tyrannie. Il serait inutile de prétendre que les Français n'avaient pas encore appris à faire un bon usage de ces inappréciables priviléges dont on les dépouilla ou qu'ils consentirent à abandonner ce qu’il n'était pas en leur pouvoir de défendre. C'est une triste apologie du vol que de dire que la personne dépouillée ne connaissait pas la valeur de la pierre précieuse qu'on lui a dérobée; et c'est une mauvaise excuse pour le voleur, que d'avouer que sa victime était désarmée, couchée à terre et qu'elle ne pouvait faire aucune résistance sans s'exposer à perdre la vie.
[147]
« En choisissant le poste de chef d'une monarchie régulière et limitée, Bonaparte aurait mieux agi dans son propre intérêt qu'en préférant, comme il le fit, de devenir l'âme unique d'un monstrueux despotisme. La. concession des priviléges d'un État libre, en même temps qu'elle aurait réuni les factions ennemies, aurait fixé l'attention de tous sur le chef du gouvernement et l'aurait fait considérer comme leur bienfaiteur. Les droits constitutionnels réservés à la couronne auraient été respectés quand on se serait rappelé que la liberté du peuple avait été réglée sur des bases raisonnables, et ses privilèges reconnus par la libéralité du cbef de l'État.
« Ces restrictions à son pouvoir eussent été également profitables à son peuple et à lui-même. Si, dans le cours de son règne, il eût rencontré une opposition constitutionnelle à ses vastes projets de conquête, qui coutèrent tant de sang et causèrent tant de ravages, il aurait eu à cette opposition la même obligation qu'aurait un homme, privé quelquefois de la raison, aux liens par lesquels on l'empêcherait, pendant ses accès, de faire du mal à personne. Si Bonaparte n'avait pas eu la facilité de faire la guerre quand il le trouvait bon, son esprit actif eût fait prospérer en France toutes les branches d'industrie: en ne se servant de son pouvoir [148] que pour favoriser les intérêts de son pays, il eût fait oublier l’illégalité de son titre; et, bien qu'il n'eût pas été l'héritier légitime du trône, il se serait ainsi montré l'un des princes les plus dignes d'y avoir été appelés.
« S'il y avait eu en France des chambres libéralement instituées et qui eussent représenté franchement l'opinion nationale, si les droits du peuple eussent été respectés et garantis, l'occupation de l'Espagne, la guerre de Russie et je système prohibitif à l'égard de l'Angleterre n'auraient pas eu lieu. Instruite par les libres discussions de ses députés, la nation se fût opposée à des mesures violentes et fatales, assez à temps pour les prévenir. Enfin, avec un pouvoir moins absolu, Napoléon n'eût point été renversé du trône, une sage administration l'y eût maintenu en dépit de son titre, et il eût pu léguer à ses descendants la souveraineté de la France. La réputation qu'il eût laissée après lui n'aurait pu être surpassée que par celle d'un héros qui, après avoir rendu d'aussi éminents services à son pays, aurait refusé de satisfaire son ambition personnelle. »
Soit donc que l'on se place au point de vue de l'intérêt des gouvernés ou à celui des gouvernants eux-mêmes, on demeure frappé de l'immense supériorité du régime représentatif sur le [149] despotisme. On s'aperçoit que les gouvernants sont aussi intéressés que les gouvernés à ce que la nation ait son mot à dire dans la gestion de ses affaires. On s'aperçoit qu'il est à la fois plus honorable, plus digne et plus sûr d'être un souverain constitutionnel qui s'appuie sur les classes industrieuses et éclairées d'une nation, que d'être un despote qui s'appuie sur une administration et sur une armée. Sans doute, un gouvernement constitutionnel, obligé comme il l'est de subordonner son opinion et sa volonté à l'opinion et à la volonté du pays, se trouve toujours quelque peu gêné dans ses allures; il n'a pas ses coudées franches.
Mais le despotisme a-t-il les siennes? Si le monarque constitutionnel est obligé de consulter les urnes de la représentation nationale, le despote n'est-il pas tenu, de son côté, sous peine de déchéance et de mort, de fixer incessamment ses regards sur les marmites des janissaires? Laquelle de ces deux situations est la plus honorable, la plus digne et la plus sûre?
[150]
Vous devez comprendre, maintenant, pourquoi les économistes ne sont pas partisans du despotisme. C'est qu'ils appliquent aux résultats, aux produits du despotisme, la même méthode d'observation et d'analyse dont ils se servent pour apprécier les résultats, les produits des révolutions. C'est qu'en employant cette méthode d'observation et d'analyse, en examinant les gouvernements comme des machines, comme des instruments destinés à garantir, à sauvegarder les intérêts de la société, à procurer aux peuples la sécurité qui leur est indispensable pour croître en nombre, en richesse, en civilisation; ils acquièrent la conviction que les gouvernements représentatifs sont des machines infiniment supérieures aux gouvernements despotiques.
En conséquence, ils sont tout. aussi hostiles aux hommes qui s’efforcent de détruire on de fausser les gouvernements représentatifs; ils sont tout aussi hostiles à ces hommes qu'ils le sont, par exemple, aux briseurs de machines, et pour les mêmes raisons. Car les fauteurs du despotisme [151] sont de nos jours de véritables briseurs de machines; ce sont des hommes qui, aveuglés sur les intérêts des masses et sur leurs propres intérêts, s'efforcent de substituer aux nouvelles machines, aux instruments perfectionnés de la civilisation, les vieilles mécaniques, les outils imparfaits et grossiers de la barbarie.
Malheureusement, on n'écoute guère les économistes. Je viens de parler des briseurs de machines. Malgré les démonstrations et les conseils des économistes, on a vu bien souvent les ouvriers, égarés par des meneurs inintelligents ou pervers, briser les machines nouvelles. En Angleterre, les briseurs de machines avaient acquis, il y a trente ans, une puissance formidable. Ils s'on allaient de ville en ville, de district en district, accomplissant leur oeuvre de destruction forcenée. Un instant on put croire que les progrès de l'industrie, que le développement de la civilisation seraient arrêtés par ces nouveaux barbares.
Mais enfin, les intérêts prirent l'alarme, les [152] forces de la civilisation furent opposées à ce débordement de la barbarie, et les briseurs de machines furent vaincus. Eh bien, les briseurs de machines de la politique auront beau faire, ils auront beau étendre leur oeuvre de destruction et s'en glorifier, ils finiront, quoi qu'ils fassent, par avoir le dessous, car leur système a vieilli, leurs mécaniques sont usées, la civilisation n'en veut plus. La civilisation repousse le despotisme comme elle repousse les révolutions.
Endnotes
[1] Discours prononcé au Musée de l'Industrie à Bruxelles, le 4 octobre 1852.
[2] Voir la note à l’appendice. [Appendix A. "Des pertes d'hommes causées par la révolution française. De la conscription sous l‘empire."
[3] Voir à l’appendice. [Appendix B. "Du blocus continental."]
[4] Ceci était écrit avant la présentation du nouveau projet de loi sur la presse.
[5] See appendix (c).
[6] Vie de Napoléon, t. VIII, p. 180.
[7] Cours du 5 p. 100 français, à la fin du Directoire, sous le Consulat et l'Empire.
|
Cours |
Cours |
Dates. |
le plus haut. |
le plus bas. |
1799 |
22,50 |
7 |
1800 |
44 — |
17,38 |
1801 |
68 — |
39,30 |
1802 |
59 — |
50,15 |
1803 |
66,60 |
47 — |
1804 |
39,75 |
52,20 |
1805 |
63,30 |
51,90 |
1806 |
77 — |
61,60 |
1807 |
93,40 |
70,75 |
1808 |
88,15 |
78,10 |
1809 |
84 — |
76,26 |
1810 |
84,50 |
78,40 |
1811 |
83,25 |
77,70 |
1812 |
83,60 |
76,50 |
1813 |
80,20 |
47,50 |
1814 |
57,50 |
45 — |
1815 |
69 — |
53 — |
Annuaire de l'économie politique et de la statistique pour 1851, p. 450.
III.8. "Le fractionnement de l'humanité en nations autonomes" (1853)↩
Source
Gustave de Molinari, "Nations," in Dictionnaire de l’économie politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM Charles Coquelin et Guillaumin (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie., 1852–53), T. 2, pp. 259-62.
Molinari wrote 5 biographical articles and 25 "principle articles" for the DEP which i have collected into an anthology: "Gustave de Molinari’s Collected Articles from the Dictionnaire de L’Économie Politique (1852-53)" online.
Seven of these principle articles were translated into English ask were published in John Joseph Lalor, Cyclopaedia of Political Science, Political Economy, and of the Political History of the United States by the best American and European Authors , ed. John J. Lalor (New York: Maynard, Merrill, & Co., 1899). 2 vols. online.
Introduction
In this article he wrote for the DEP, for which he served as a co-editor especially after the death of the original editor Coquelin from a heart attack soon after volume 1 had been completed in 1852, Molinari seems to backtrack from the radical anarchism he expressed in the "Production of Security" article. Here he seems to adopt a more moderate (but still quite radical) view more like J.B. Say’s of an "ultra-limited" government. In fact, he explicitly denies that political economy is "an-achiste" and states quite clearly that "L'économie politique sainement entendue ne conduit pas plus à la suppression des gouvernements" (political economy wisely understood does not lead to the elimination of government). Without "un gouvernement régulier" ( arugula government) there would be no protection of property, no peace, and thus no capital accumulation which leads to prosperity. Perhaps he had felt the weight of the opposition of the other economists to the ideas he had put forward in 1849 and was attempting to be more moderate in these dictionary articles and was expressing the consensus view of his editor and colleagues and not just expressing his own views.
Nevertheless, Molinari makes a number of statements which have very radical implications.Firstly, he argues that those who want to create a "universal" empire or state of some kind (whom he calls "unitéistes"), whether "la monarchie universelle", "la république universelle," or "l'unité de religion" are both morally wrong and doomed to failure. Secondly, he argues that "le morcellement" or "le fractionnement" (the splitting up) of humanity into small and autonomous nations is desirable because it keeps political institutions small, cheap, and accountable to the people; it creates competition between nations to adapt "best practice" concerning laws and economic policies which promote freedom and prosperity; [5] and it limits the damage caused by bad policies to only one state, not the entire world. And thirdly, he quotes with approval Say’s very colourful expression ("cette expression pittoresque") that a government which exceeded his proper bounds was "un véritable ulcère" which the political surgeon has to remove from the body politic or else the patient would die. [6]
His overall conclusion was that "les mêmes pratiques" (the same practices) which govern the operation of private companies (such as competition, cost cutting, providing services to consumers, using the division of labour to improve output) should also be applied to the governments of nations; and that they should also "gouverner aussi peu que possible" (govern as little as possible) He would go into more detail about what he meant by this in a later work [7] but the implications of using "les mêmes pratiques" in government as in business are quite radical, and so he may not have strayed as much from his earlier radicalism as one might think by reading this article.
Endnotes
[5] Molinari would take up this idea again in "Les gouvernement de l’avenir" in Évolution politique (1884) where he talked about privately owned and operated towns or communities which would compete for residents, and "Les liberties de gouvernement" in Lois naturelles (1887) where he talked about competition between communes and provinces within the country seeking to attracted residents and taxpayers from elsewhere.
[6] Molinari uses the word "plaie" (wound, sore, or plague) in Les Soirées to describe the government and its actions. He goes a step further in his article "Nation" in DEP where he describes governments which overstep the boundaries of their proper sphere of activity as "ulcerous" and the economist as the surgeon who must cut out the dead or cancerous flesh from the social body in order to save its life; and in the article "Ville" (Towns), DEP, T. 2, pp. 833-38, he describes high-taxing and spending city governments as "cette peste économique" (this economic plague).
[7] See the section on "Les consommations publiques" in Cours d'économie politique (1863), tome 2, pp. 480-534.
Text
Text
[259]
Nations
Dès les premiers âges historiques, l'humanité apparaît fractionnée en une multitude de nations dissemblables par les mœurs, par les aptitudes, par le langage, et soumises à des institutions différentes. Chacune de ces nations a sa physionomie particulière et son existence propre, son autonomie.
Ce phénomène, qui intéresse à un haut degré toutes les branches des sciences morales et politiques, doit être envisagé ici seulement au point de vue économique.
L'économiste doit se demander d'abord si le fractionnement de l'humanité en une multitude de nations est utile, ou s'il ne vaudrait pas mieux, comme quelques-uns l'affirment, que l’espèce humaine ne formât qu'une seule communauté, une monarchie ou une république universelle. A cette question, la réponse ne saurait être douteuse. Le morcellement de l'humanité en nations a son utilité, en ce qu'il développe un principe d'émulation d'une puissance considérable. Il y a, dans chaque nation, un point d'honneur ou, si l'on veut, une sorte d'amour-propre collectif qui, dirigé vers des objets utiles, peut enfanter des merveilles. On en a eu un exemple à l'Exposition universelle de Londres, où la plupart des nations civilisées ont apporté le tribut de leur industrie et où chacune a tenu à honneur de ne point demeurer trop au-dessous de ses rivales. Si l'humanité ne constituait qu'une seule agrégation politique, l'esprit d'émulation, dépourvu du stimulant du point d'honneur national, ne se manifesterait-il pas à un degré moindre? Un autre inconvénient plus sérieux encore résulterait de l'unification de l'humanité; c'est que les fautes commises dans le gouvernement de la société auraient bien plus de portée qu'elles n'en ont dans l'état actuel des choses. Qu'une mauvaise mesure soit prise aujourd'hui par un gouvernement, qu'une fausse théorie soit appliquée à la gestion des affaires d'une nation , et le mal qui en résulte demeure jusqu'à un certain point local. Les autres nations peuvent s'abstenir de renouveler une expérience dont les résultats ont été désastreux. Que l'humanité tout entière vienne, au contraire, à être soumise à une loi uniforme, et le mal résultant de l'application d'une fausse mesure ne sera-t-il pas universel? Quant au progrès qui améliorent la [260] condition de l'homme, chacun sait que le fractionnement des sociétés n'est aucunement un obstacle à leur diffusion. Lorsqu'une expérience a réussi chez un peuple, tous les autres peuples ne sont-ils pas intéressés à se l'approprier? Le plus souvent même n'y sont-ils pas obligés par la pression de la concurrence?
Le fractionnement de l'humanité en nations autonomes peut donc être considéré comme essentiellement économique. D'ailleurs ce fractionnement résulte de l'arrangement primitif des choses; c'est un phénomène naturel qu'aucune combinaison artificielle ne saurait détruire ni même sensiblement modifier. Des conquérants , par exemple, ont rêvé l'utopie de la monarchie universelle. Ont-ils réussi à la réaliser? Ceux qui en ont le plus approché n'ont-ils pas vu leurs gigantesques établissements politiques se dissoudre par la force même des choses? L'expérience ne leur a-t-elle pas appris qu'il y a des limites qu'aucune domination ne peut dépasser d'une manière durable? D'autres utopistes ont rêvé l'unité de religion, et quelques-uns ont voulu l'imposer par la violence ; mais ils ont eu beau employer le fer et le feu pour venir à bout de leur dessein , ils ont échoué. Les religions ont continué de refléter la diversité des tempéraments, des mœurs et des lumières des peuples. D'autres enfin ont rêvé l'unité de langage, et l'on a vu des gouvernements s'efforcer d'imposer à des peuples d'origine différente, qu'ils avaient réunis sous leur domination , une langue uniforme. A une époque encore récente, le gouvernement hollandais, par exemple, a entrepris de substituer la langue hollandaise à la langue française dans quelques-unes des provinces méridionales de l'ancien royaume des Pays-Bas. Qu'en est-il résulté? Tout simplement que la langue légale a été prise en aversion par les populations auxquelles on voulait l'imposer, et que cette expérience, contraire à la nature des choses, a contribué pour beaucoup à la chute du gouvernement qui l'avait tentée. C'est que les langues, comme les religions, comme les institutions politiques, sont l'expression du génie particulier des différents peuples, et qu'elles répondent à des besoins ou à des convenances qu'on essaierait en vain de satisfaire autrement. On peut, sans aucun doute, modifier d'une manière artificielle la forme des institutions et du langage, mais le fond subsiste quand même : si les mots changent, l'accent reste.
Cependant, de ce qu'il serait absurde de vouloir effacer, en vue d'une unité chimérique, les signes caractériques des nationalités, il ne s'ensuit pas qu'il faille isoler les nations et les maintenir les unes vis-à-vis des autres dans un état permanent d'hostilité. Non! l'autonomie des nations n'implique ni l'isolement ni l'hostilité. Les nations sont intéressées à communiquer librement entre elles pour croître en richesse et en puissance, elles le sont plus encore à vivre en paix les unes avec les autres.
Ces vérités, trop longtemps méconnues, ont été admirablement mises en lumière par les économistes, notamment par J.-B. Say. A ceux qui prétendent, par exemple, qu’une nation ne; peut s'enrichir que par l'appauvrissement de ses rivales, l'illustre auteur de la théorie des débouchés répond avec raison :
« Une nation, par rapport à la nation voisine, est dans le même cas qu'une province par rapport à une autre province, qu'une ville par rapport aux campagnes : elle est intéressée à les voir prospérer, et assurée de profiter de leur opulence. C'est donc avec raison que les États-Unis, par exemple, ont toujours cherché à donner de l'industrie aux tribus sauvages dont ils sont entourés : ils ont voulu qu'elles eussent quelque chose à donner en échange, car on ne gagne rien avec des peuples qui n'ont rien à vous donner. Il est précieux pour l'humanité qu'une nation , entre les autres, se conduise, en chaque circonstance, d'après des principes libéraux. Il sera démontré, par les brillants résultats qu'elle en obtiendra, que les vains systèmes, les funestes théories, sont les maximes exclusives et jalouses des vieux États de l'Europe, qu'ils décorent effrontément du nom de vérités pratiques, parce qu'ils les mettent malheureusement en pratique . » [144]
Rien de plus trompeur, ajoute ce judicieux économiste, que l'avantage qu'une nation croit retirer d'un empiétement sur le domaine d'autrui, de la conquête d'une province ou d'une colonie sur une puissance rivale.
« Si la France avait joui, dit-il, à quelque époque que ce fût, d'un gouvernement économique, et qu'elle eût employé à fertiliser des provinces au centre du royaume l'argent qu'elle a dépensé à conquérir des provinces éloignées et des colonies qu'on ne pouvait conserver, elle serait bien plus heureuse et plus puissante. Les routes, les chemins vicinaux, les canaux d'irrigation et de navigation, sont des moyens qu'un gouvernement a toujours à sa disposition pour fertiliser des provinces qui ne produisent pas. La production est toujours chère dans une province lorsque beaucoup de frais sont nécessaires pour en transporter les produits. Une conquête intérieure augmente indubitablement la force d'un État, tandis qu'une conquête éloignée l'affaiblit presque toujours. Tout ce qui fait la force de la Grande-Bretagne est dans la Grande-Bretagne ; elle a été plus forte en perdant l'Amérique ; elle le sera davantage quand elle aura perdu les Grandes-Indes . » [145]
Aussi J.-B. Say est-il bien convaincu que, lorsque les lumières économiques seront plus répandues, lorsque les véritables sources de la prospérité et de la grandeur des nations seront mieux connues, la vieille politique qui consiste à conquérir de nouveaux territoires pour en taxer à outrance les populations, à s'emparer de nouveaux marchés pour les soumettre à une exploitation égoïste et impitoyable, cette mauvaise politique d'antagonisme et de haine finira par perdre tout crédit ;
« Toute cette vieille politique tombera, dit-il. L'habileté sera de mériter la préférence et non de la réclamer de force. Les efforts qu'on fait pour s'assurer la domination ne procurent jamais qu'une grandeur factice, qui fait nécessairement de tout étranger un ennemi. Ce système produit des dettes, des abus, des tyrans et des révolutions ; tandis que l'attrait d'une convenance réciproque procure [261] des amis, étend le cercle des relations utiles; et la prospérité qui en résulte est durable parce qu'elle est naturelle. » [146]
Si donc les économistes ne partagent point les illusions des socialistes humanitaires qui voudraient réunir toutes les nations en un seul troupeau gouverné par un berger omniarcal ; s'ils ne pensent point qu'il y ait utilité à effacer, d'une manière artificielle, les différences caractéristiques des nationalités; s'ils n'acceptent qu'en faisant leurs réserves ces beaux vers de l'auteur de la Marseillaise de la paix :
Nations ! mot pompeux pour dire barbarie ! …
1382.Déchirez ces drapeaux ! une autre voix vous crie :
1383.L'égoïsme et la haine oui seuls une patrie ;
1384.La fraternité n’en a pas;
s'ils pensent que les nations ont leur raison d'être même au sein de la civilisation, ils ne travaillent pas moins activement à démolir les murs de séparation que de vieilles erreurs, des préjugés séculaires, des haines barbares ont élevés entre les peuples ; ils démontrent aux nations qu'elles ont intérêt à échanger leurs idées et leurs produits afin d'augmenter leur richesse, leur puissance, leur civilisation ; ils condamnent la guerre comme une mauvaise spéculation, comme une opération dans laquelle les risques de perte dépassent toujours les chances de gain, et sans être humanitaires ou unitéistes, ils enseignent aux peuples les vrais moyens de réaliser la fraternité pratique. ( Voyez Paix. )
Des erreurs non moins funestes, au sujet du gouvernement intérieur des nations, ont encore appelé l'attention des économistes. De même qu'on était convaincu autrefois qu'une nation ne pouvait se fortifier et s'enrichir que par l'affaiblissement et l'appauvrissement de ses rivales, on attribuait au gouvernement une part d'influence et d'action singulièrement exagérée dans la vie des peuples. Parce que le gouvernement et la société demeuraient confondus au sein des communautés primitives, lorsque la division du travail n'avait pas encore séparé les fonctions sociales, on croyait qu'il en devait toujours être ainsi ; on croyait qu'il appartenait au gouvernement d'imprimer le mouvement, l'activité à l'organisme social et d'y faire circuler la vie; on croyait que rien ne pouvait se faire si ce n'est par l'impulsion de ce moteur souverain. L'économie politique a fait bonne justice d'une erreur si désastreuse. Les économistes ont démontré que les fonctions du gouvernement devaient se simplifier et se spécialiser de plus en plus, en vertu du principe de la division du travail, bien loin de s'étendre et de se multiplier; ils ont démontré que le communisme appartenait à l'enfance des sociétés et qu'il cessait de convenir à leur maturité. Avec le sang-froid d'un chirurgien expert qui extirpe des chairs cancéreuses, J.-B. Say a fait voir à quel point un gouvernement, qui ne se borne pas strictement à remplir ses fonctions naturelles, peut jeter le trouble, la corruption et le malaise dans toute l'économie du corps social, et il a déclaré qu'à ses yeux un gouvernement de cette espèce était un véritable ulcère.
Cette expression pittoresque de gouvernement-ulcère, employée par l'illustre économiste pour désigner tout gouvernement qui intervient mal à propos dans le domaine de l'activité privée, les écrivains réglementaires et socialistes l'ont fréquemment reprochée à l'économie politique. Quelques-uns même en ont pris texte pour prétendre que l'économie politique méconnaissait l'importance de la mission dont les gouvernements sont chargés dans la société, et ils l'ont accusée d'avoir enfanté la trop célèbre doctrine de l’an-archie. Rien de moins mérité cependant qu'un tel reproche. L'économie politique sainement entendue ne conduit pas plus à la suppression des gouvernements qu'elle n'aboutit à la destruction des nationalités, et J.-B. Say lui-même a été au devant de ce grief en donnant un aperçu des services qu'un gouvernement sage peut rendre à une nation :
« Lorsque l'autorité n'est pas spoliatrice elle-même, elle procure aux nations le plus grand des bienfaits, celui de les garantir des spoliateurs. Sans cette protection qui prête le secours de tous aux besoins d'un seul, il est impossible de concevoir aucun développement important des facultés productrices de l'homme, des terres et des capitaux; il est impossible de concevoir l'existence des capitaux eux-mêmes, puisqu'ils ne sont que des valeurs accumulées et travaillant sous la sauvegarde de l'autorité publique. C'est pour cette raison que jamais aucune nation n'est parvenue à quelque degré d'opulence sans avoir été soumise à un gouvernement régulier ; c'est à la sûreté que procure l'organisation politique que les peuples policés doivent non-seulement les productions innombrables et variées qui satisfont à leurs besoins, mais encore les beaux-arts, les loisirs, fruits de quelques accumulations, et sans lesquels ils ne pourraient pas cultiver les dons de l'esprit, ni par conséquent s'élever à toute la dignité que comporte la nature de l'homme. [147]
L'économie politique n'est donc pas an-archiste. Les économistes sont parfaitement convaincus que les gouvernements remplissent au sein de la société un rôle nécessaire, et c'est même parce qu'ils apprécient toute l'importance de ce rôle qu'ils sont d'avis que les gouvernements ne doivent pas s'occuper d'autre chose. Enfin , les économistes pensent que les mêmes pratiques de scrupuleuse économie dont l'application est de règle dans l'industrie privée doivent être appliquées aussi au gouvernement des nations.
Écoutons encore à ce sujet J.-B. Say :
« Un peuple qui ne sait respecter son prince que lorsqu'il est entouré de faste, de dorures, de gardes, de chevaux, de tout ce qu'il y a de plus dispendieux, paye en conséquence. Il économise, au contraire, quand il accorde son respect à la simplicité plutôt qu'à l'étalage, et quand il obéit aux lois sans appareil.
«… Les causes purement politiques, et la forme du gouvernement qui en dérive, influent sur les frais de traitements des fonctionnaires civils et judiciaires, sur ceux de représentation, et enfin [262] sur ceux qu'exigent les institutions et les établissements publics. Ainsi, dans un pays despotique, où le prince dispose des biens de ses sujets, lui seul réglant son traitement, c'est-à-dire ce qu'il consomme de deniers publics pour son utilité personnelle , ses plaisirs, l'entretien de sa maison, ce traitement peut être fixé plus haut que dans le pays où il est débattu entre les représentants du prince et ceux des contribuables.
« Le traitement des subalternes dépend également, soit de leur influence particulière, soit du système général du gouvernement. Les services qu'ils rendent sont coûteux ou à bon marché, non-seulement en proportion du prix qu'on les paye, mais encore selon que les fonctions sont moins bien ou mieux remplies. Un service mal rendu est cher, quoique fort peu payé ; il est cher s'il est peu nécessaire. Il en est de cela comme d'un meuble, qui ne remplit pas bien l'office auquel il est destiné, ou dont on n'avait pas besoin, et qui embarrasse plutôt qu'il ne sert. Telles étaient, sous l'ancienne monarchie, les charges de grand-amiral, de grand-maître, de grand-échanson, de grand-veneur et une foule d'autres, qui ne servaient pas même à relever l'éclat de la couronne, et dont plusieurs n'étaient que des moyens employés pour répandre des gratifications et des faveurs.
« Par la même raison, lorsque l'on complique les ressorts de l'administration, on fait payer au peuple des services qui ne sont pas indispensables pour le maintien de l'ordre public : c'est une façon inutile donnée à un produit qui n'en vaut pas mieux pour cela, et qui communément en vaut moins. Sous un mauvais gouvernement qui ne peut soutenir ses empiétements, ses injustices, ses exactions, qu'au moyen de nombreux satellites, d'un espionnage actif et de prisons multipliées ; ces prisons , ces espions, ces soldats coûtent au peuple, qui certes n'est pas plus heureux. [148]
En résumé, l'économie politique reconnaît que le fractionnement de l'humanité en nations a son utilité, sa raison d'être; elle reconnaît qu'aucune nation, à moins de la supposer composée d'anges, ne saurait se passer de gouvernement; mais, en même temps, elle démontre que les nations ont intérêt à baser leur politique extérieure sur la paix et leur politique intérieure sur l'économie ; elle démontre que les nations ont intérêt à entretenir les unes avec les autres des relations libres et amicales, comme à se laisser gouverner aussi peu que possible.
PART IV. THE FURTHER DEVELOPMENT OF MOLINARI’S THEORY OF PURE ANARCHO-CAPITALISM (1852–1863)↩
IV.9. "La concurrence politique" (1855, 1863)↩
Source
Molinari, Cours d'économie politique, professé au Musée royal de l'industrie belge, 2 vols. (Bruxelles: Librairie polytechnique d'Aug. Ecq, 1855). 2nd revised and enlarged edition (Bruxelles et Leipzig: A Lacroix, Verbroeckoven; Paris: Guillaumin, 1863).
- Tome I. La Production et la Distribution des Richesses. PDF.
- Tome II. La Circulation et la Consommation des Richesses. PDF.
Vol. 2 deals with " La circulation et la consommations des richesses," Part 4 with "De la consommation publique," and the final 12th lesson covers "Public consumption" in which Molinari continues his discussion of what he calls "la concurrence politique" (political competition, or competing governments). "Douzième leçon. Les consommations publiques", pp. 480-534.
Both volumes are combined in this single HTML file online.
Introduction
This extract comes from the lectures Molinari gave as a professor at the Musée royale de l'industrie belge where he moved after the coup d'état of Emperor Napoleon III in December 1851. They were first published in 1855 and a revised edition appeared in 1863.
In a 100 page final section of the Cours d’économie politique dealing with "Consumption" Molinari develops his ideas on the nature of plunder and coerced labour such as slavery, the wastefulness of government spending and monopolies, the private provision of public goods, the proper functions of government in the era of competition, and a restatement of the benefits of what he now calls "la concurrence politique" (political competition, or competing governments) or "la liberté de gouvernement" (this was analogous to "la liberté des échanges" or free trade, so perhaps something like "free governments").The idea of insurance companies providing security services to clients in S11 has been expanded into a more generalized economic theory of the state, how it provides all kinds of services, not just security services, and how this evolves over time towards the future era of competition in which the private and competitive provision of all so-called "public goods" has become the norm.
The important insight Molinari had, with interesting similarities to the Pubic Choice approach to understanding politics, was to treat the state in the same way he would treat a firm or a company, that the people who owned or ran the firm had goals which they wanted to achieve with limited resources, that they responded to changing relative costs and benefits, and that they had to adjust to technological and other systemic changes. The terminology Molinari used to describe the state here is quite instructive. The following is a sample: "les entreprises gouvernementales" (government enterprises), "les entreprises politiques" (political enterprises), "l’industrie du gouvernement" (the industry of government), "une vaste entreprise, exerçant des industries et des fonctions multiples et disparates" (a vast enterprise which carried out multiple and various enterprises), and "ateliers de production de la sécurité" (workshops which produced security). He was even working on a public choice-like notion of "le marché politique" (the political marketplace) in which politicians bought and sold favours in order to get or to stay in power.
The difference between the state treated in this economic fashion and a true firm was that the state had access to coercive powers which were denied most firms, except for those "rent-seeking" firms which could get government privileges or monopolies of some kind. Nevertheless, Molinari thought it was very important to use economics to analyse the operation of the state, especially the "anti-économique" aspects of state activity which led to waste, corruption, and the poor provision of services like security. It was a mistake he thought to exempt the state from the economists’ scrutiny.
He continued to develop his theory of the production of security in the Cours along the following lines: that as economies and trade became more complex there would be greater division of labour in the security industry; he further developed the idea of "nuisance" (harm) which was caused by accidents (like fire or floods) or by theft or fraud, or what might also be called torts, which he thought insurance companies would be especially good at "policing"; that governments could be seen as another way in which risk to individuals and businesses arising from theft or fraud could be managed and reduced with benefits for society as a whole; and that the growing complexity of the market would result in innovative security firms creating new types of law ("une justice ad hoc") in order to offer new forms of protection for persons and property. [8] Most importantly, he developed a list of reasons why the monopoly provision of security by the state was more costly and less efficient than private companies, all of which were based upon his theory of the natural laws of political economy and how the state violated them.
The first reason he gave was that government monopolies tended to overproduce goods or services beyond the needs of the consumers because, in the absence of prices and freely negotiated contracts, the government monopoly did not know how much production is optimal. A second reason was that government had become too big and complex, and was active in too many fields to be expert in all of them. This also suggests he had an inkling of Hayek’s problem of knowledge which was faced by monopolists and central planners in the absence of adequate information provided to planners by the wishes of consumers and suppliers by means of price signals. A final reason he gave was that firms had a natural size limit (la loi des limites naturelles) beyond which they could not operate effectively. In an insight that suggests thinking along the lines of Ronald Coase’s theory of the firm, Molinari gave as an example the dream of some rulers to build "la monarchie universelle" (the universal monarchy) which would govern huge territories, with millions of people, and supplying them with myriads of services. Molinari thought that the market should determine the optimal size of firms which would best be able to satisfy the needs of its consumers as well as make a profit for its owners.
We see in this extract a practice Molinari used on occasion to disarm critics , that is his "hypothesis" or story of the monopolist grocer (sometimes also the baker) which is a "stand in" for the government’s monopoly of the provision of security. [9] People opposed the introduction of competition into the grocery business because it had always been a monopoly. There is something about the government that made its actions "sublime" and unlike any other. Attempts were made to introduce "a constitution" which would limit any abuses of this monopoly at the expense of ordinary consumers, but these restrictions were always undermined by the political class and all too often became "des instruments d’exploitation entre les mains des classes supérieures" (the tools of exploitation by the upper classes).
The solution for Molinari was to to destroy (démolir) this political monopoly and open it up to competition; to force government institutions to behave in a more economic fashion (such as covering their costs and being exposed to competition on order to lower costs and improve services), and to drastically simplify and reduce the activities of government to its absolute core functions of the protection of its citizens lives and property. These things could be achieved, he believed, under the twin pressure of growing consumer demand for cheaper and better government services, and the threat of the "right of secession", as was happening in a spectacular way in the United States when he wrote this chapter (1863). [10]
Endnotes
[8] See "Le problème du gouvernement individuel" (JDE Dec. 1900) for a discussion of the several legal codes ("un triple code des lois") which were necessary to help people learn to be free and responsible individuals: the civil and penal code, the religious code, and the code of custom and public opinion.
[9] See my discussion of "this hypothesis" in my paper "Was Molinari a true Anarcho-Capitalist?: An Intellectual History of the Private and Competitive Production of Security." A paper given at the Libertarian Scholars Conference, NYC (Sept. 2019). online. A good example of the "Simple Hypothesis" of the Monopolist Baker can be found in L’évolution Politique (1884), pp. 399 ff especially pp. 404-410.
[10] See his discussion of secession in "Le gouvernement de l’avenir" in Evolution politique (1884) on individual or collective secession; and "La liberté de gouvernement" in Les lois naturelles (1887) on the right of communes and provinces to secede.
Text
DOUZIÈME LEÇON
[II-480]
les consommations publiques
Du partage du revenu entre les consommations publiques et les consommations privées. — Proportion dans laquelle se fait ce partage. — En quoi consistent les services publics. — Que l'ensemble de ces services constitue la tutelle sociale exercée par les gouvernements. — Des attributions et de la constitution naturelles ou utiles des gouvernements dans les trois phases du développement économique des sociétés, — sous les régimes de la communauté, du monopole et de la concurrence. — Que les gouvernements débutent par la communauté et que leurs fonctions se spécialisent avec celles de l'industrie privée. — Que toute fonction ou toute industrie spécialisée existe d'abord à l'état de monopole naturel. — Exemples. — Comment les monopoles naturels se transforment en monopoles artificiels. — Que tout monopole est productif de nuisances. — Que les gouvernements doivent réprimer les nuisances causées par le monopole. — Raison d'être du régime réglementaire dans la seconde phase du développement économique de la société. — Que les gouvernements eux-mêmes sont constitués dans cette seconde phase sous la forme de monopoles plus ou moins limités. — Pourquoi le régime communautaire est alors populaire. — Comment la société passe de la phase du monopole à celle de la concurrence. — Des attributions utiles des gouvernements dans la phase de la concurrence. — Que la production de la sécurité doit se développer et se perfectionner dans cette phase; — que l'intervention du gouvernement dans la production [II-481] et dans la distribution de la richesse cesse, en revanche, d'avoir une raison d'être. — Des nuisances de la consommation et de la mesure dans laquelle le gouvernement doit intervenir pour les empêcher. — Que la constitution du gouvernement se modifiant avec celle des autres entreprises, l'unité économique s'établit dans chaque phase du développement des sociétés. — Que cette unité a maintenant cessé d'exister. — Que le gouvernement est demeuré à l'état de monopole, tandis que les autres entreprises entraient dans la phase de la concurrence. — Maux qui découlent de cette dissonnance entre la constitution du gouvernement et celle de la société. — Pourquoi un gouvernement de monopole devient de plus en plus anti-économique au sein d'une société régie par la concurrence. — Comparaison. — Pourquoi les gouvernements sont demeurés des monopoles, tandis que les entreprises privées étaient soumises à la loi de la concurrence. — Comment la question de la constitution des gouvernements était en visagée à l'époque de la révolution française. — Que, dans l'opinion générale, cette question se trouvait en dehors du domaine de l'économie politique. — Solutions qu'on lui a données. — Du régime constitutionnel et de son insuffisance. — Autres solutions, le socialisme, le principe des nationalités. — Inanité de ces utopies. — Que la constitution des gouvernements est du ressort de l'économie politique aussi bien que celle des autres entreprises. — Critique de la constitution des gouvernements modernes au point de vue économique. — Qu'ils pèchent contre les lois de l'unité des opérations, de la division du travail, des limites naturelles, de la concurrence, de la spécialité et de la liberté des échanges. — Nuisances qui résultent pour la société de ces vices de constitution des gouvernements. — Mauvaise qualité et cherté croissante des services publics, inégalité de leur distribution. — Que les gouvernements sont les ulcères des sociétés. — Remède économique que ce mal comporte. — Qu'il faut simplifier les gouvernements et les soumettre à la loi de la concurrence comme toutes les autres entreprises. — Que l'unité économique se trouvera ainsi rétablie. — Possibilité et résultats de la concurrence politique.
Quoique la consommation ait généralement cessé d'être réglementée, le domaine du self government en cette matière n'est [II-482] pas cependant illimité. Tout revenu se divise en deux parts: l'une est saisie par l'impôt et sert à alimenter les consommations publiques, standis que l'autre est abandonnée au self government du producteur du revenu et sert à alimenter les consommations privées.
La somme qui est prélevée dans chaque pays pour subvenir aux consommations publiques est plus ou moins considérable. On l'évalue communément, dans les pays civilisés, à la sixième ou à la septième partie du revenu de chacun des membres de la société. Mais les statistiques laissent encore beaucoup à désirer sur ce point. Si elles spécifient exactement le montant de l'impôt par tête d'habitant, en revanche elles ne fournissent que des renseignements incomplets sur le montant des valeurs imposées et des indications vagues sur la répartition et l'incidence de l'impôt. En outre, elles négligent le plus souvent de faire la somme des taxes générales et des taxes locales, de l'impôt en argent et de l'impôt en nature (de la conscription par exemple), en sorte que la part proportionnelle de revenu qui est enlevée à chacun pour les consommations publiques demeure fort incertaine.
Quoi qu'il en soit, c'est au moyen de cette portion du revenu de chacun des membres de la société ou des capitaux à l'aide desquels le revenu se constitue, qu'il est pourvu aux dépenses des gouvernements producteurs des services qui font l'objet des consommations publiques. En quoi consistent ces services et les gouvernements qui les produisent?
Le premier et le plus essentiel des services publics concerne le besoin de sécurité. Ce besoin est provoqué, d'un côté, par l'imperfection morale de l'homme, de l'autre par la nature du milieu où il se trouve placé. Dès l'origine, les hommes paisibles [II-483] eurent à se défendre soit contre les agressions individuelles, soit contre les agressions collectives des hommes de proie, sans parler des périls auxquels les exposaient les attaques des autres créatures vivantes ou les cataclysmes de la nature. En conséquence, il leur fallut, de bonne heure, établir un appareil destiné à les préserver des risques de destruction qui menaçaient incessamment leurs propriétés personnelles, mobilières ou immobilières. D'un autre côté, les races de proie, qui combinaient leurs forces en vue d'assujettir les races laborieuses et paisibles, ne tardèrent pas à reconnaître la nécessité d'observer dans leurs rapports mutuels et de faire régner au sein des communautés qu'elles avaient asservies une certaine justice. C'est ainsi que nous voyons les brigands eux-mêmes se soumettre à des règles fondées toujours à quelque degré sur la justice, sans lesquelles leurs bandes ne pourraient subsister. Produire de la sécurité, telle est en résumé la fonction essentielle des gouvernements. Dans ce but, ils établissent et ils entretiennent, d'une part, des tribunaux et une police, d'une autre part, une armée. Les tribunaux et la police ont pour mission de faire régner la sécurité à l'intérieur, en préservant les différents membres de la communauté, de l'assassinat, du vol et, en général, de toute atteinte contre leurs personnes et leurs propriétés. L'armée a pour mission de défendre la communauté contre les agressions ou les prétentions abusives des autres communautés comme aussi d'étendre au besoin la clientèle de la classe gouvernante par voie de conquête.
Ces fonctions sont communes à tous les gouvernements; elles l'ont été partout et de tous temps. Beaucoup d'autres encore viennent se joindre à celles-là, mais sans avoir le même caractère de permanence et d'universalité. Non seulement les [II-484] gouvernements produisent de la sécurité, mais encore ils entretiennent les voies de communications naturelles et ils en créent d'artificielles, ils battent monnaie, ils distribuent l'enseignement, ils commanditent le culte, ils subventionnent les beaux-arts, ils protégent diversement l'agriculture, l'industrie, le commerce, la navigation, ils assistent les pauvres, enfin, ils interviennent plus ou moins dans toutes les branches de l'activité humaine. Ces attributions qui varient en nombre et en étendue suivant les lieux et les époques constituent la tutelle sociale qui est exercée au nom et dans l'intérêt de tous sur chacun des membres de la communauté ou de « l'État. »
Considérée dans ses conditions d'existence et de développement, d'une part, dans ses rapports avec le besoin auquel elle est destinée à pourvoir, de l'autre, la tutelle sociale exercée par les gouvernements ne diffère pas des autres branches de l'activité humaine. Elle est soumise aux mêmes lois et elle passe par les mêmes phases. En général, elle tend à s'organiser de la manière la plus économique et à satisfaire aussi complétement que possible aux besoins de la consommation. Cependant, au moment où nous sommes, elle est visiblement en retard sous ce double rapport, si on la compare aux autres branches de la production, et, à mesure que celles-ci progressent, les maux qui résultent de ce retard de développement de la plus importante des industries, deviennent plus sensibles.
Si nous voulons connaître la cause de cette discordance qui se manifeste de nos jours entre l'état des gouvernements et celui des autres branches de l'activité sociale, nous devrons d'abord jeter un coup d'œil sur les phases naturelles du développement économique des sociétés, et rechercher quelles sont, dans chacune, les attributions et la constitution utiles des gouvernements. [II-485] Ces phases sont au nombre de trois: 1° la communauté, 2° le monopole, 3° la concurrence.
I. la Communauté. A l'origine, les sociétés se constituent par l'aggrégation d'un certain nombre de familles qui s'associent en vue de la protection et de l'assistance mutuelles. Cette réunion de familles forme une tribu ou une commune. Lorsque les familles composant la tribu ou la commune trouvent leurs moyens d'existence dans une industrie rudimentaire, telle que la chasse, la communauté est à peu près complète. Lorsque l'agriculture se substitue à la chasse, chaque famille se met à produire isolément ses moyens de subsistance, et la propriété privée ou patrimoniale remplace de plus en plus la propriété cômmunale. La communauté ne subsiste plus alors que pour les services qui requièrent l'association et la combinaison des forces particulières: ces services consistent d'abord dans l'établissement et la mise en œuvre d'un appareil de défense, parfois aussi, d'aggression, s'il s'agit d'une tribu guerrière dont les moyens d'existence résident en partie dans le brigandage. Mais d'autres besoins se manifestent successivement qui ne peuvent de même être satisfaits que par une action commune: ce sont des routes et des ponts qu'il faut établir dans le village et aux environs, un puits qu'il faut creuser, un temple qu'il faut élever pour le culte, etc., etc. D'un autre côté, la commune ne demeure point isolée, elle a des rapports inévitables avec ses voisines. Il faut délimiter les domaines de chacune et résoudre les litiges généraux ou particuliers qui résultent incessamment du voisinage; il faut encore conclure, en cas de nécessité, des ligues offensives ou défensives. Que si enfin une commune en assujettit une autre, il faut maintenir celle-ci dans l'obéissance. — En même temps, se développent au sein de la petite communauté [II-486] certains vices auxquels on reconnaît à la longue le caractère de nuisances sociales: l'imprévoyance, la corruption des mœurs, l'ivrognerie. La portion de la communauté qui en est atteinte va s'appauvrissant et se dépravant de génération en génération. Elle devient, en conséquence, pour la communauté tout entière une cause d'affaiblissement et de ruine. Il est donc nécessaire d'extirper ces germes de dissolution ou, du moins, de les empêcher de se développer. On y avise par l'établissement de coutumes fondées sur l'expérience des nuisances qui résultent de certains actes, et c'est le gouvernement qui est chargé de faire observer ces coutumes indispensables au maintien et au progrès de la communauté.
A mesure que les services publics deviennent ainsi plus nombreux et plus compliqués pour répondre aux besoins croissants de la communauté, l'organisation de ces services tend davantage à se spécialiser. D'abord chacune des familles dont se composait la tribu ou la commune primitive contribuait, dans la mesure de ses forces et de ses ressources, à fournir le matériel et le personnel nécessaires au gouvernement: dans cet état primitif, de même que les membres de chaque famille pourvoyaient grossièrement à la subsistance et à l'entretien de la famille en cumulant les métiers de pasteurs ou de cultivateurs, de tisserands, de forgerons, de charrons, etc., ils concouraient au gouvernement de la communauté des familles en cumulant les fonctions de juges, de gendarmes, de soldats, etc., etc. Mais du moment où la commune grandissant en nombre et en richesse, les services publics se multiplièrent, en se perfectionnant, il fallut les spécialiser. Les nécessités de la défense ou de l'attaque, par exemple, donnèrent naissance à l'art militaire; les nécessités de l'ordre intérieur et de la paix [II-487] extérieure firent naitre, de même, les sciences du droit privé et du droit public ainsi que l'art de la police. Ces arts nouveaux, qui exigeaient des aptitudes et des connaissances spéciales, ne pouvaient être qu'imparfaitement exercés par tous, et à mesure qu'ils se développaient, ils échappaient davantage à la communauté. Aussi voit-on la « spécialisation » s'opérer peu à peu dans les services publics comme dans les travaux privés. Elle n'apparaît jamais, toutefois, qu'au moment où elle devient absolument nécessaire. Le métier de soldat, par exemple, demeure longtemps dans le domaine de la communauté, tandis que les officiers qui ont besoin de s'assimiler un capital de connaissances spéciales pour pratiquer utilement leurs fonctions, deviennent uniquement des hommes de guerre. Les fonctions des hommes politiques, des administrateurs, des juges, des prêtres, des instituteurs, se spécialisent sous l'influence de la même cause. Parmi ces fonctions gouvernantes, celles qui ont une certaine affinité demeurent d'abord unies, tout en se séparant des autres, puis, à mesure que la société en se développant leur offre un marché plus vaste, elles se séparent pour constituer autant de ramifications distinctes de la tutelle sociale. Comme toutes les autres branches de travail, celles-ci deviennent le domaine d'un groupe de familles qui s'en transmettent, de génération en génération, les aptitudes, les connaissances et les procédés.
En résumé, la société apparaît, dans la première phase de son existence, comme une réunion de familles, dont chacune produit isolément ce qu'elle peut produire avec ses seules forces, et, en commun, ce qui ne peut être produit que par l'association et la combinaison des forces de toutes, savoir la sécurité intérieure et extérieure, les voies de communication, [II-488] etc. Les membres de chaque famille contribuent à produire l'ensemble des services nécessaires à la communauté, comme ils produisent l'ensemble des services nécessaires à la famille, jusqu'à ce que le progres amène dans la production des services publics comme dans celle des services privés, la spécialisation des fonctions et, avec elle, une nouvelle phase de développement économique de la société.
II. le Monopole. A mesure que la spécialisation des industries prend naissance, on voit apparaître le monopole. Toute industrie spécialisée constitue d'abord un monopole. Éclaircissons ceci par quelques exemples. Avant l'établissement d'un atelier spécial de forgeron ou de charron au sein de la société embryonnaire, chacun exerçait plus ou moins grossièrement ce métier dans la mesure de ses besoins. Mais du moment où le marché de la commune devient assez étendu pour fournir des moyens d'existence à un forgeron ou à un charron, il ne manque pas de s'en établir un, et l'on trouve aussitôt plus d'avantage à s'adresser à lui pour les travaux de forgerie ou de charronnage qu'à les exécuter soi-même; on cesse, en conséquence, de savoir forger ou charronner, comme aussi de posséder les outils du métier, et l'on est alors à la merci du forgeron ou du charron. Un autre exemple plus frappant encore est celui de la fabrication du pain. Lorsque chaque famille fait elle-même son pain, quelques-uns de ses membres savent pratiquer, à la vérité d'une manière imparfaite, les métiers de meunier et de boulanger; en outre, elle possède, soit isolément, soit en commun, un moulin et un four. Lorsque la séparation des industries intervient, on cesse au sein de chaque famille de moudre le blé et de faire le pain, surtout lorsqu'on s'adonne à d'autres industries spécialisées; on perd, en conséquence, peu à peu, la [II-489] connaissance et la pratique de la meunerie et de la boulangerie; enfin, on laisse tomber en ruines le moulin et le four. On est alors à la merci du meunier et du boulanger. Sans doute, dans le cas où ceux-ci se feraient payer à un taux usuraire leurs services, on pourrait en revenir au système primitif de fabrication; mais il faut du temps pour reconstruire le moulin et le four, comme aussi pour retrouver les procédés et les tours de main maintenant oubliés des métiers de meunier et de boulanger. En général, s'il s'agit de l'approvisionnement des denrées nécessaires à la vie, au début du régime de la spécialisation des industries, la situation des consommateurs pourra être des plus critiques, elle deviendra même pire que ne l'était leur situation primitive, si les monopoleurs n'imposent point de limites à leurs exigences. Objectera-t-on que les consommateurs sont les maitres d'abandonner leurs industries spéciales pour redevenir producteurs de denrées alimentaires? Soit! mais ils ne possèdent plus les agents productifs, les instruments, les matériaux et les connaissances nécessaires à la production agricole, et, en attendant qu'ils aient pu se les procurer, les mettre en œuvre et en obtenir des produits, ils seront obligés de subir les exigences des monopoleurs ou de mourir de faim. Ce que nous disons de la production des denrées alimentaires s'applique également à toutes les branches de l'activité humaine, toute industrie passant nécessairement par la phase du monopole au sortir de la production embryonnaire. Seulement, il est dans la nature du monopole de causer des nuisances plus ou moins graves selon qu'il s'applique à un produit ou à un service plus ou moins nécessaire. Lorsqu'il s'agit de produits ou de services de première nécessité, le monopole peut engendrer une usure meurtrière; lorsqu'il s'agit de produits ou de services de luxe, sa [II-490] puissance demeure, au contraire, très faible, la demande diminuant alors avec l'offre, souvent même dans une progression plus rapide (Voir la 1re partie, 3e leçon: La valeur et le prix) et il ne peut occasionner qu'une nuisance insignifiante.
Né avec la spécialisation de l'industrie, le monopole subsiste jusqu'à ce que la concurrence ait pu s'établir pleinement dans la fonction spécialisée. Or, c'est une erreur de croire que l'établissement de la concurrence soit partout et toujours immédiat. La concurrence tend à s'établir sans doute, et cette tendance est d'autant plus forte que le monopole porte sur des produits ou des services plus nécessaires et qu'il est, par là même, plus productif; mais il ne s'ensuit pas que la concurrence doive remplacer immédiatement le monopole. Elle rencontre des obstacles à la fois dans la nature et dans l'homme lui-même, et ces obstacles sont quelquefois bien lents à surmonter.
La science économique distingue deux sortes de monopoles: les monopoles naturels et les monopoles artificiels. D'abord, toute industrie spécialisée est à l'état de monopole naturel, mais cet état est essentiellement transitoire; il disparaît à mesure que le nombre des producteurs spéciaux et la masse de leurs produits venant à s'augmenter, ils se font davantage concurrence. Seulement, des obstacles, les uns naturels, les autres artificiels péuvent intervenir pour retarder l'accroissement du nombre des producteurs et de la quantité des produits. Il peut arriver que l'approvisionnement des agents ou des matériaux nécessaires à une production soit naturellement limité, en sorte qu'on ne puisse élever l'offre des produits au niveau de la demande. Tel est le cas de certains vins et de certains tabacs; tel est encore le cas de certaines aptitudes [II-491] extraordinaires pour le chant, la danse, l'art d'écrire, l'éloquence, etc.; tel est enfin le cas de certaines machines ou de certains procédés économiques dont on ne possède point les équivalents jusqu'à ce que ces équivalents soient découverts. Dans ces différents cas, le monopole existe par le fait de la limitation naturelle de la production. Il peut arriver encore que la consommation soit insuffisante pour alimenter une industrie spécialisée, autrement qu'à l'état de monopole, et ce cas est beaucoup plus fréquent qu'on ne le suppose. Admettons qu'il s'agisse d'enseignement: il y a dans une localité isolée une population exactement suffisante pour fournir un marché à une école. Celui qui entreprendra cette école jouira donc d'un monopole jusqu'à ce que la population se soit assez accrue pour fournir un marché à plusieurs établissements d'éducation, ou bien encore, jusqu'à ce que la sécurité et les communications se soient développées et perfectionnées de manière à permettre aux parents d'envoyer, sans risques et à peu de frais, leurs enfants dans les écoles ou dans les pensions des autres localités. Admettons encore qu'il s'agisse de commerce. Il y a dans une localité, un marché de consommation des produits du dehors, qui suffit exactement pour alimenter une boutique spécialement approvisionnée de ces produits. En conséquence, la boutique s'établit, mais elle demeure maîtresse du marché jusqu'à ce que celui-ci devienne assez important pour en alimenter une seconde. Que si le boutiquier abuse de son monopole, un entrepreneur, alléché par les profits extraordinaires qu'il réalise, pourra bien, à la vérité, venir lui faire concurrence; mais si le marché est insuffisant pour alimenter les deux établissements rivaux, le plus faible devra nécessairement succomber. Dans ce cas, les consommateurs se trouveront à la [II-492] discrétion du boutiquier et ils seront plus ou moins durement exploités par lui, selon qu'il leur sera plus ou moins difficile de se passer des articles dont il possède le monopole de vente, selon encore qu'ils auront ou non la possibilité de les acheter à des foires temporaires ou à des marchands ambulants. Dans les deux cas que nous venons de citer et dans bien d'autres, le monopole existe par le fait de la limitation naturelle de la consommation.
A ces monopoles naturels, qui proviennent de circonstances indépendantes de l'homme, viennent se joindre des monopoles artificiels qui sont le fait de la volonté humaine. Dans toute industrie, l'avénement de la concurrence a pour résultat immédiat et sensible la diminution des profits. Il est donc tout simple que les producteurs s'efforcent d'éloigner une si dangereuse ennemie, en prolongeant artificiellement la durée naturelle de l'existence de leurs monopoles. S'ils disposent d'une certaine force ou d'une certaine influence, ils ne manqueront pas de l'utiliser dans ce but; ils feront prohiber l'établissement des entreprises similaires; ou si les entreprises similaires qui leur font concurrence se trouvent placées en dehors des limites de la communauté dont ils sont membres, ils feront prohiber l'importation des produits de ces entreprises. Dans ce cas, le monopole existera par le fait de la limitation artificielle de la production.
Or tout monopole soit naturel soit artificiel est essentiellement productif de nuisances. Les producteurs qui en sont investis prélèvent sur toutes les autres branches de la production une rente ou une usure égale à la différence existant entre le prix naturel ou nécessaire du produit et le prix auquel le monopole parvient à le porter. Cette différence varie, comme [II-493] nous l'avons vu, suivant la nature du produit; elle peut être énorme, et engendrer par conséquent une nuisance meurtrière, quand il s'agit d'articles de première nécessité; en revanche, elle ne peut jamais s'élever bien haut quand il s'agit d'articles de luxe. Là ne s'arrêtent point toutefois les nuisances que cause le monopole. D'une part, la facilité à réaliser des bénéfices usuraires ralentit les progrès des industries monopolisées et les fait même tomber en décadence; d'une autre part, le tribut que la société paye aux monopoleurs empêche le développement de la population et de la richesse générales. La consommation, en conséquence, ne s'accroît point, trop souvent même elle diminue, et les monopoleurs finissent ainsi par être enveloppés dans la ruine qu'ils ont provoquée. Le monopole a été la cause originaire de l'affaiblissement et, par là même, de la destruction violente des anciennes sociétés, et de nos jours, une communauté livrée au monopole s'exposerait non moins infailliblement à être ruinée par la concurrence pacifique des autres communautés.
Dans cette seconde phase du développement économique des sociétés quelles sont les attributions et la constitution utiles des gouvernements?
Les attributions ou les fonctions gouvernementales doivent nécessairement croître en nombre et en importance à mesure que la spécialisation des industries, et les échanges qui en découlent, succèdent à la production embryonnaire. Dans cet état nouveau, les échanges nécessitent, d'abord, la création d'un appareil spécial de protection, ayant pour objet la police des marchés, la vérification des poids et des mesures, le contrôle des monnaies. Ensuite, la société prise dans son ensemble exige une somme plus grande de sécurité. La spécialisation des [II-494] industries ayant pour résultat d'augmenter dans une proportion considérable la richesse produite, la société est plus exposée à des agressions du dehors; à l'intérieur même, l'accroissement de la masse des valeurs appropriées ou des « propriétés » , multiplie le nombre et aggrave l'importance des conflits qui surgissent entre les propriétaires. Il faut, en conséquence, développer les services publics qui ont pour objet la sécurité extérieure et intérieure. Mais à ces attributions qui ne sont qu'une extension de celles de la première phase viennent s'en ajouter de nouvelles, qui appartiennent particulièrement à la seconde, nous voulons parler de la police des monopoles.
On a vu plus haut que toutes les branches d'industrie constituent d'abord, en se spécialisant, des monopoles naturels, lesquels ont une tendance irrésistible à se transformer en monopoles artificiels. Un individu s'adonne à une spécialité dont il a par là même le monopole; si le marché suffit pour alimenter un plus grand nombre d'entreprises, elles s'établissent, mais aussi longtemps que le marché n'est point illimité, et par conséquent que les entrepreneurs possibles sont peu nombreux, ils ont une tendance naturelle à s'entendre et à se coaliser pour limiter la concurrence, celle-ci ayant pour résultat immédiat de limiter leurs profits. C'est ainsi que, dès le début de cette seconde période, on voit toutes les branches de travail s'organiser en corporations composées de groupes plus ou moins nombreux dont les membres sont coalisés d'une manière permanente. Ces différents groupes, coalisés ou organisés en vue du monopole de la branche spéciale d'industrie qui leur fournit des moyens d'existence, se partagent le domaine de la production, et la société entière n'en est bientôt que la collection. Ces groupes ont leurs [II-495] états-majors d'entrepreneurs et leurs armées d'ouvriers, auxquels une clientèle appropriée, en partage de laquelle les étrangers à la corporation ne peuvent entrer, fournit des moyens d'existence assurés. Sous ce régime, le plus nécessaire des instruments de travail, la terre, constitue, comme tout le reste, un monopole entre les mains d'une corporation qui a seule le droit de la posséder. D'abord, les membres de cette corporation exploitent eux-mêmes leurs domaines en se faisant assister par leurs serviteurs ou leurs esclaves; ensuite, lorsque les serviteurs ou les esclaves ont acquis la capacité requise pour entreprendre eux-mêmes une exploitation agricole, les propriétaires divisent entre eux une partie du domaine seigneurial, à la charge de cultiver le restant; autrement dit, ils leur donnent en location une partie du domaine, en exigeant pour prix de loyer une certaine quantité de travail sous forme de corvées. Mais le monopole foncier subsiste toujours: d'une part, les terres ne peuvent être possédées par d'autres que par des membres de la corporation, d'une autre part, les consommateurs de cet instrument de travail sont immobilisés sur la terre seigneuriale, et ils subissent ainsi le monopole de location du seigneur; tandis que le seigneur, de son côté, ne peut louer sa terre à des travailleurs étrangers. Le domaine entier de la production est donc partagé entre une multitude de monopoles. Mais ces monopoles sont extrêmement inégaux en puissance, selon qu'ils portent sur des articles plus ou moins nécessaires à la vie. En les supposant abandonnés à eux-mêmes, ceux qui accaparent la production des articles de première nécessité peuvent exploiter les autres, en raison directe de l'intensité des besoins auxquels ils correspondent. C'est pourquoi, il est nécessaire d'opposer une limite ou un frein à ceux dont la puissance [II-496] est la plus grande, et qui en abusant de cette puissance causeraient à la société la nuisance la plus dommageable. En conséquence, le gouvernement intervient pour réglementer et limiter les monopoles les plus dangereux, il soumet à un maximum les prix des denrées nécessaires à la vie, et le loyer des capitaux; il limite de même le loyer de la terre, en établissant des maximums pour le nombre et la durée des jours de corvée. Cette limitation des monopoles les plus productifs de nuisances demeurait toujours imparfaite sans doute, mais elle était indispensable sous peine de livrer la société à l'exploitation effrénée des monopoles qui se trouvaient, en vertu de leur nature, investis d'une puissance supérieure à celle de la généralité. Dira-t-on qu'au lieu de réglementer les monopoles, il aurait mieux valu de les supprimer? Mais, dans la plupart des cas, cette suppression était impossible. En vain, par exemple, aurait-on supprimé les corporations des boulangers, des bouchers, des marchands de grains, dans les marchés resserrés du moyen âge, elles se seraient incessamment reformées par des coalitions d'autant plus dangereuses qu'elles auraient été secrètes. Mieux valait donc laisser subsister au grand jour des monopoles, dont la suppression effective était impossible, et leur imposer les limites que l'expérience démontrait être les plus utiles dans l'intérêt de la communauté. Le régime réglementaire contre lequel nous nous élevons avec raison aujourd'hui avait alors pleinement sa raison d'être, en ce qu'il était le seul frein possible et efficace que l'on pût opposer aux nuisances du monopole.
Enfin, dans cette seconde phase du développement économique des sociétés, la police des nuisances de la consommation acquiert plus d'importance à mesure que les articles de [II-497] consommation deviennent plus nombreux et peuvent être mis plus aisément à la portée des masses encore incapables d'un bon self government. Les lois somptuaires doivent être incessamment étendues à un plus grand nombre d'objets. Il convient de remarquer toutefois que cette partie de la tutelle sociale tend à sortir des attributions gouvernementales, à mesure que la communauté se spécialise. Les entrepreneurs d'industrie groupés dans les corporations, les ouvriers agglomérés dans les sociétés de compagnonnage font eux-mêmes la police de leurs consommations, dans l'intérêt de l'existence et des progrès des communautés spéciales dont ils font partie, et leurs règlements somptuaires contre l'ivrognerie et la débauche par exemple, rendent superflue l'intervention du gouvernement, investi de la tutelle de la communauté générale, composée de la somme des communautés spéciales.
Maintenant, quelle est dans cette phase du développement de la société, la constitution naturelle, ou, ce qui revient au même, la constitution utile du gouvernement? Nous avons vu que les fonctions gouvernantes tendent à se spécialiser comme toutes les autres branches de l'activité humaine. Partout, on les voit devenir la spécialité d'un groupe plus ou moins nombreux de familles, qui se les partagent et qui s'efforcent d'en conserver le monopole. Le gouvernement apparaît comme une corporation ou une réunion de corporations superposées à celles qui ont monopolisé les autres branches de travail. Ces corporations gouvernantes non seulement repoussent la concurrence des intrus qui essayent d'entrer en partage avec elles, mais encore elles repoussent, autant qu'elles le peuvent toute tentative de limitation de leur monopole par voie de réglementation et de maximum. De là, d'incessants débats entre la corporation [II-498] gouvernante, et les masses qui subissent son monopole, celles-ci s'efforçant incessamment d'en limiter la puissance qu'elle s'efforce à son tour de maintenir intacte. De là encore, les tentatives qui sont faites pour confisquer ce monopole, le plus puissant, puisqu'il dispose de la force organisée pour la défense commune, et par là même le plus productif, tentatives qualifiées de criminelles quand elles échouent, de glorieuses et de libératrices quand elles réussissent, mais n'aboutissant, en ce cas, presque toujours, qu'à remplacer des monopoleurs expérimentés et repus par des monopoleurs in expérimentés et à repaitre.
La spécialisation des fonctions gouvernantes n'en a pas moins été un progrès. C'est pourquoi les républiques démocratiques au sein desquelles le gouvernement était l'affaire de tous les membres de la communauté se sont successivement transformées en républiques oligarchiques ou en monarchies, présentant pour caractère essentiel la spécialisation des fonctions gouvernantes dans la classe d'individus qui possédait les aptitudes requises pour les exercer. Comment donc se fait-il que ces communautés primitives soient demeurées un idéal que les hommes se sont efforcés incessamment, quoique en vain, de ressaisir? C'est que les gouvernements en se spécialisant sont devenus des monopoles, et que l'abus qu'ils n'ont pas manqué de faire de leur puissance d'une part, l'insuffisance et l'inefficacité des mesures auxquelles les « consommateurs des services gouvernementaux » de l'autre, ont eu recours pour prévenir ou corriger cet abus, ont dû naturellement faire regretter l'état de choses antérieur. Éclaircissons ceci par une simple comparaison. Supposons que chaque famille cesse de produire elle-même ses aliments pour s'adonner à une industrie spécialisée, elle [II-499] devra désormais s'approvisionner auprès des producteurs ou des marchands de denrées alimentaires. Si les circonstances sont telles qu'une concurrence suffisante ne puisse s'établir entre ces fournisseurs des nécessités de la vie, si, d'un autre côté, la réglementation établie pour limiter la puissance de leur monopole demeure inefficace, les consommateurs ainsi exploités ne pourront-ils pas regretter l'ancien état de choses? Leur sera-t-il possible cependant de le rétablir, et, en admettant même qu'ils y parviennent, qu'ils retournent de la production spécialisée à la production embryonnaire, auront-ils réalisé un progrès? Non! ils auront reculé, et le cours naturel des choses ne tardera pas à les ramener au point d'où ils étaient partis. La république démocratique, dans laquelle chacun remplit sa part dans les fonctions publiques, nécessaires à la communauté, est, comme on voit, un idéal rétrograde, mais on conçoit que l'abus du monopole politique des classes gouvernantes ait rendu cet idéal populaire, de même qu'on conçoit que l'abus du monopole des denrées nécessaires à la vie ait pu faire considérer comme un âge d'or cet état primitif de la société, dans lequel chacun était son marchand de grains et son boulanger.
III. La concurrence. C'est l'agrandissement successif du marché de la consommation qui détermine le passage de la société de la production embryonnaire et communautaire, à la production spécialisée et monopolisée d'abord, à la production de concurrence ensuite. Comment s'opère cet agrandissement du marché? Par le développement progressif de la production dans l'intérieur de la commune et au dehors. Du moment où un débouché se forme pour une entreprise spécialisée, cette entreprise ne manque pas de naître. Ainsi, du moment où il existe [II-500] dans un village assez d'agriculteurs pour fournir des moyens d'existence à un charron, on voit s'établir un atelier de charronnage. Si le nombre des agriculteurs s'accroît, si leur richesse s'augmente, si encore des moyens de communication s'établissent entre le village et les hameaux des environs, le charron pourra agrandir ses ateliers et se faire aider par un nombre croissant de compagnons et d'ouvriers. Bientôt, le débouché suffira pour alimenter un second atelier, puis un troisième; mais les entrepreneurs qui exercent cette industrie ne manqueront pas de se coaliser, puis de former une corporation permanente pour l'exploitation exclusive du marché. Cependant, si le marché vientà s'étendre encore, un moment arrivera où les entreprises existantes ne suffisant plus pour l'approvisionner, on réclamera la liberté de l'industrie, c'est à dire la concurrence et où, malgré la résistance désespérée des monopoleurs du charronnage, on finira par l'obtenir. Alors, que se passera-t-il? D'abord les constructeurs de charrettes, voitures, etc., essayeront de se coaliser de nouveau, mais s'ils y réussissent et si, en conséquence, leurs bénéfices s'élèvent à un taux exceptionnel, de nouvelles entreprises s'établiront pour leur faire concurrence; ensuite, s'ils ne peuvent plus interdire la concurrence intérieure ils essayeront du moins de se protéger contre la concurrence étrangère, en faisant prohiber l'importation de ses produits sur les marchés de la communauté dont ils sont membres, et tous les autres producteurs se comporteront de même. Mais si le marché continue néanmoins à s'étendre, si des voies de communications rapides et à bon marché s'établissent entre les différentes communautés devenues plus nombreuses et plus riches, ces restrictions opposées à la concurrence finiront par devenir nuisibles aux intérêts mêmes qu'elles avaient [II-501] pour objet de protéger. En effet, si les constructeurs de charettes, de voitures, etc., sont intéressés à conserver le monopole de leur marché, en revanche ils sont intéressés aussi à le voir s'agrandir. Or ce marché est susceptible d'agrandissement dans l'intérieur de la communauté et au dehors. Dans l'intérieur, son agrandissement peut provenir de deux causes: de l'augmentation du nombre et des ressources des consommateurs de charrettes, voitures, etc., et de l'abaissement du prix de ces véhicules, abaissement qui les mette à la portée d'un plus grand nombre de consommateurs. Au dehors, l'agrandissement du marché peut provenir des mêmes causes, auxquelles s'ajoute le progrès des voies de communication qui n'est autre chose qu'une diminution des frais de production dans l'espace. Mais, l'expérience démontre, peu à peu, que si la limitation de la concurrence assure le marché, c'est en faisant obstacle à son extension au dedans comme au dehors. C'est ainsi notamment que la protection accordée à ceux qui fournissent les matières premières nécessaires à la construction des charrettes et des voitures, élève les frais de production de ces véhicules et diminue par là même l'étendue de leur marché à l'intérieur et à l'étranger. A la vérité, l'exclusion des voitures de l'étranger en agrandissant artificiellement le débouché des producteurs nationaux peut compenser cette diminution; mais il n'en est pas de même à l'extérieur. Là, il faut lutter contre des concurrences étrangères, et ceux-là dont les frais de production sont grevés des surtaxes de la protection des matières premières, etc., y luttent avec un désavantage marqué. Un moment arrive donc, où les marchés étrangers devenant de plus en plus accessibles, le régime protecteur y fait perdre beaucoup plus qu'il ne fait gagner sur le marché national, en admettant qu'il y fasse gagner quelque [II-502] chose. La protection est alors abandonnée, la liberté du commerce s'ajoute à la liberté de l'industrie et l'on entre, malgré les efforts désespérés des intérêts qui s'accrochent au monopole, dans l'ère de la concurrence.
Quelles sont, dans cet état nouveau, les attributions et la constitution naturelles du gouvernement?
Nous connaissons les attributions naturelles du gouvernement dans les deux phases précédentes du développement économique des sociétés. Dans la phase de la concurrence, où nous commençons à nous engager, elles subissent de nouvelles modifications en plus et en moins. Dans cette phase, les sociétés, croissant rapidement en nombre et en richesse, ont besoin par là même d'une sécurité plus parfaite, mieux assise et plus étendue. Pour faire naître et maintenir l'ordre au sein d'une multitude d'intérêts incessamment en contact, il faut à la fois une justice plus exacte et une puissance plus grande pour la faire observer. En outre, les propriétés se multipliant et se diversifiant à l'infini, il faut multiplier et diversifier les appareils qui servent à les défendre. La production des inventions et la production littéraire, par exemple, donnent naissance, en se développant, à un nombre considérable de propriétés d'une espèce particulière, dont les limites soit dans l'espace soit dans le temps, engendrent des contestations continuelles. Il faut pour résoudre ces questions litigieuses une justice ad hoc. En d'autres termes, la justice devra s'étendre et se diversifier en raison de l'extension et de la diversification du débouché que l'accroissement et la multiplication de toutes les branches de la richesse ouvrent à la fraude et à l'injustice. Enfin, la sécurité doit s'allonger, pour ainsi dire, dans l'espace et dans le lemps. Si le développement des voies de communication et les progrès [II-503] de l'industrie permettent aux hommes et aux produits de se transporter aux extrémités du globe, ils devront y trouver des garanties de sécurité suffisantes, sinon ils ne se déplaceront point. Si des contrats ou des engagements sont effectués à longue échéance ou même sans limites de temps, comme dans le cas des rentes perpétuelles, l'exécution de ces contrats ou l'accomplissement de ces engagements devra encore être assuré, sinon on ne les conclura point. La « production de la sécurité » doit donc se développer et se perfectionner dans cette nouvelle phase de l'existence des sociétés, en raison même de l'extension et du raffinement du besoin auquel elle doit pourvoir.
En revanche, si les attributions naturelles du gouvernement s'augmentent et se compliquent de ce côté, elles se réduisent et se simplifient d'un autre. Le gouvernement n'a plus à intervenir ni dans la production ni dans la distribution de la richesse. Il lui suffit de cesser de prêter son appui aux monopoles artificiels et de laisser la concurrence agir pour faire disparaître successivement les monopoles naturels. Cela fait, la production et la distribution de la richesse tendent d'ellesmême à s'opérer de la manière la plus utile.
Nous croyons superflu de revenir en détail sur ces deux points, que nous avons mis, croyons-nous, suffisamment en lumière. (Voir la 1re partie, VIe leçon, et la 2e partie, XIe leçon.) S'agit-il de la production? Non seulement les entreprises se constituent toujours, sous un régime de pleine concurrence, dans le nombre, dans les formes, dans le lieu, et dans les limites d'espace et de temps les plus utiles, mais encore les entrepreneurs sont obligés d'adopter les procédés et les méthodes les plus économiques. Car le progrès devient pour eux une condition d'existence. S'ils produisent à plus haut prix [II-504] que leurs concurrents, leurs frais de production cessent bientôt d'être couverts, ils entament leurs capitaux, et ils sont condamnés à liquider leurs entreprises ou à faire banqueroute. S'agit-il de la distribution de la richesse? De même que la concurrence agit incessamment pour rendre la production plus économique, elle agit aussi pour rendre la distribution des produits aussi utile ou, ce qui revient au même, aussi équitable que possible. Sous un régime de pleine concurrence, les prix de toutes choses ont une irrésistible tendance à se mettre au niveau des frais et de la rémunération nécessaires pour produire ces choses et les mettre au marché. Quand, sous ce régime, une marchandise est accidentellement rare sur un marché, quand, d'un autre côté, le besoin qu'on en a est considérable et urgent, quand le prix s'élève en conséquence, de manière à fournir une rente aux bénéficiaires de ce monopole accidentel, l'appât de cette rente ne manque pas d'attirer la concurrence, l'offre s'augmente, le prix baisse et la rente disparaît. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à une réglementation artificielle pour limiter l'usure qui n'est autre chose que la rente d'un monopole; le régulateur naturel de la concurrence, agissant par le mécanisme de la loi des quantités et des prix, rend l'usure impossible ou la fait disparaître dès qu'elle se produit. En faisant graviter les prix courants de toutes choses vers le niveau des frais nécessaires pour les produire, la concurrence attribue aux détenteurs des divers agents productifs une part exactement proportionnée à la quantité de forces qu'ils ont dépensées, ni plus ni moins.
L'intervention du gouvernement dans la production et dans la distribution de la richesse cesse, comme on voit, d'avoir une raison d'être sous un régime de pleine concurrence. Il y a plus. [II-505] Après avoir été utile dans les deux phases précédentes soit pour suppléer à l'insuffisance des forces individuelles soit pour limiter la puissance abusive des monopoles, elle est maintenant nuisible. Si le gouvernement entreprend une industrie, il est obligé d'en écarter artificiellement la concurrence pour compenser son infériortié industrielle, et d'en faire ainsi un monopole. Si le gouvernement réglemente une industrie, il éloigne encore la concurrence des entreprises réglementées, et il replace de même ces entreprises dans l'état économiquement inférieur du monopole.
En revanche, le gouvernement ne peut-il pas continuer utilement à intervenir pour écarter les nuisances de la consommation? Si les masses sont incapables d'un bon self government de leur consommation, le gouvernement est fondé évidemment à intervenir pour réprimer ou prévenir les nuisances qu'elles commettent en négligeant, par exemple, l'accomplissement de leurs obligations morales pour gorger leurs appétits matériels. Deux cas peuvent ici se présenter. S'il s'agit d'individualités ayant les aptitudes réquises pour se gouverner, le gouvernement doit se borner à réprimer les nuisances qu'elles commettent en se gouvernant mal, sans entreprendre de substituer sa direction à la leur. Sinon il empêcherait les forces morales nécessaires pour pratiquer un bon self government de se développer par un constant exercice, et d'arriver ainsi à faire une concurrence suffisante aux appétits purement matériels. Une individualité gouvernée n'ayant pas, en effet, à exécuter le travail nécessaire au gouvernement de soi-même, les facultés qu'elle possède pour exécuter ce travail et qui demeurent inactives ne peuvent évidemment recevoir tout leur développement utile, et elles courent, de plus, le risque de s'atrophier. S'il [II-506] s'agit, au contraire, d'individualités qui ne possèdent pas encore les facultés requises pour le self government, autrement dit d'hommes-enfants, ayant besoin d'une tutelle appropriée à leur état moral, le gouvernement peut être fondé à se charger de cette tutelle. Mais ses autres attributions l'empêcheront, en ce cas, de remplir les fonctions de tuteur des incapables aussi utilement que pourrait le faire une entreprise spéciale. C'est pourquoi la tutelle des individualités incapables du self government est destinée, selon toute apparence, à devenir l'objet d'une branche d'industrie qui naîtra tôt tard de la transformation progressive de la servitude. (Voir la 2e partie, IXe et Xe leçons.)
Ainsi, dans les trois états économiques que nous venons de passer en revue, les attributions naturelles ou utiles du gouvernement consistent à écarter autant que possible les nuisances qui se manifestent dans la production, dans la distribution et dans la consommation des richesses. Ces nuisances diffèrent selon les états de la société; d'où il résulte que l'intervention du gouvernement pour les empêcher doit différer aussi: dans la première phase du développement social, par exemple, le gouvernement doit se charger de certains travaux qui ne pourraient être exécutés par les forces individuelles et dont la non exécution serait nuisible à la société, tandis que, dans les deux phases suivantes, il doit se borner à interdire les actes positivement nuisibles.
La constitution naturelle ou utile des gouvernements se modifie comme leurs attributions selon l'état de la société. Dans la première phase du développement social, les fonctions gouvernementales sont exercées par tous les membres de la communauté. Dans la seconde phase, elles se spécialisent et [II-507] elles deviennent le monopole d'une classe ou d'une corporation. Au moyen âge, par exemple, la société entière est partagée en corporations, au sein desquelles se spécialisent et se monopolisent les différentes branches de l'activité humaine, depuis les plus élevées jusqu'aux plus basses, sécurité, culte, enseignement, beaux-arts, industrie, commerce. Il y a alors unité dans la constitution du gouvernement et de la société. Les corporations gouvernantes sont constituées exactement comme celles des maçons, des tailleurs, des cordonniers, des boulangers. Chaque corporation, haute ou basse, a son domaine qu'elle exploite d'une manière exclusive et qu'elle s'efforce incessamment d'étendre aux dépens des autres corporations, tant au dedans qu'au dehors: dans ce domaine, les consommateurs sont à sa merci, à moins qu'ils n'aient réussi à opposer des restrictions au pouvoir que son monopole lui confère. Ces restrictions, dont le maximum est la pièce principale, forment un ensemble de garanties contre l'abus du monopole. Les corporations gouvernantes finissent comme les autres par y être assujetties, malgré leurs efforts pour maintenir leur monopole intact et pour en user dans toute son étendue. En langage économique, les chartes ou les constitutions ne sont autre chose que des applications du régime du maximum, faites au profit des consommateurs des services publics. En Angleterre, par exemple, où la corporation gouvernante fut obligée, de bonne heure, de compter avec les consommateurs, la constitution se grossit successivement des garanties qu'ils réussirent de gré ou de force à obtenir. Sauf dans les pays où la classe gouvernante elle-même est assujettie à un chef héréditaire comme l'équipage d'un navire à son capitaine (et ce gouvernement absolutiste même peut avoir sa raison d'être dans certaines circonstances) on voit partout [II-508] cette classe se gouverner comme une grande corporation; elle a son parlement, où siégent ses principaux membres et sans l'assentiment duquel aucune mesure importante n'est prise. En présence de ce parlement, qui est le conseil de la corporation politique, vient se placer, dans les pays où les consommateurs ont réussi à limiter plus ou moins son monopole, une assemblée composée de leurs délégués, et ayant pour mission de défendre leurs droits et leurs intérêts contre les abus particulièrement dangereux de ce monopole. Cette assemblée des représentants ou des délégués des consommateurs surveille la production et la distribution utiles des services publics, elle en débat les prix, et elle se trouve par là même en opposition constante avec les chefs ou les mandataires de la corporation gouvernante quand elle ne se laisse pas intimider ou corrompre par eux. Telles apparaissent, d'une part, la Chambre des lords, de l'autre, la Chambre des communes en Angleterre.
En résumé, dans la première phase de l'existence des sociétés, les services publics sont produits comme les autres par ceux-là mêmes qui les consomment; dans la seconde phase, ils passent, en se spécialisant, entre les mains de corporations, dont le monopole d'abord illimité est successivement, — à mesure que ses abus se font sentir, — restreint au profit des consommateurs. On le restreint au moyen du système de garanties et de maximum que l'expérience fait reconnaître comme le plus propre à assurer la production la meilleure et la plus économique des services publics, et ce système ne diffère pas de celui qui est appliqué aux corporations qui monopolisent de même les autres branches de la production. La constitution naturelle ou utile du gouvernement se trouve ainsi pleinement en harmonie avec celle de toutes les autres entreprises; [II-509] autrement dit, il y a unité dans la constitution politique et économique de la société.
Or, si nous savons, d'une part, quelles ont été dans les deux premières phases du développement social, la constitution utile de la production des services publics et celle des services privés, d'une autre part, quelle est dans la troisième phase la constitution utile des services privés, il nous sera facile de savoir encore quelle doit être, dans cette troisième phase, la constitution utile des services publics. Si, grâce à l'agrandissement progressif des marchés de consommation, les entreprises qui fournissent les produits ou les services nécessaires à la consommation privée passent d'un régime de monopole plus ou moins limité à un régime de concurrence, il y a apparence que la constitution des gouvernements producteurs des services publics devra inévitablement subir une transformation analogue; qu'ils passeront de même du régime du monopole à celui de la concurrence, et que l'unité économique finira ainsi par s'établir dans la troisième phase du développement des sociétés comme elle s'est établie dans les deux précédentes.
Au moment où nous sommes toutefois, cette unité économique ne semble pas près encore d'être reconstituée. Tandis que les entreprises qui pourvoient à la consommation privée sont déjà, pour le plus grand nombre, placées sous le régime de la concurrence, les gouvernements producteurs des services publics se trouvent encore attardés dans le vieux régime du monopole. De là, une situation anormale et périlleuse, car, de même que des gouvernements communautaires ne pouvaient plus suffire à des sociétés qui étaient entrées dans la phase du monopole, des gouvernements de monopole ne peuvent plus suffire à des sociétés qui sont entrées dans la phase de la concurrence. [II-510] En termes plus brefs, si les gouvernements de la première phase étaient antiéconomiques dans la seconde, ceux de la seconde doivent être antiéconomiques dans la troisième.
Nous nous servirons encore d'une simple comparaison pour mettre en pleine lumière ce défaut d'unité qui se manifeste de plus en plus entre la constitution des gouvernements et celle de la multitude des entreprises entre lesquelles se partage l'activité sociale. Reportons-nous à la boutique de village, et recherchons quand elle s'établit et comment elle se développe. Elle s'établit quand les familles dont la réunion constitue la société embryonnaire du village sont devenues assez nombreuses et assez aisées pour lui fournir un débouché permanent, et pour procurer ainsi des moyens d'existence suffisants au boutiquier. A l'origine toutefois le boutiquier est obligé, à cause de l'exiguité de son marché de consommation, d'exercer avec son commerce un ou plusieurs métiers et de comprendre dans ce commerce des articles fort divers. Mais que le village devienne un bourg, puis une ville, que le « marché » de la boutique s'étende en conséquence, le boutiquier devra spécialiser davantage ses occupations et sa vente. S'il continue à exercer quelque autre métier, il ne pourra plus suffire à son commerce dont le débouché aura grandi. S'il continue à débiter les mêmes articles, il lui sera également de plus en plus difficile d'y suffire, car la consommation exigera à la fois une plus grande quantité et un assortiment plus varié de chaque marchandise. S'il s'agit de coutellerie, il lui faudra désormais non seulement des couteaux, mais encore des ciseaux, des canifs, des rasoirs, etc.; s'il s'agit de parfumerie, au lieu d'une espèce grossière de savon, il lui en faudra d'une douzaine de qualités, sans parler des essences et des cosmétiques. De boutiquier devenu commerçant dans un [II-511] marché de consommation agrandi, il devra donc spécialiser de plus en plus son commerce. Au lieu de vendre des épiceries, de la mercerie, de la parfumerie, de la coutellerie, il devra se borner à vendre des épiceries ou même une seule sorte d'épiceries, du thé ou du café par exemple. Bref, au lieu d'exercer une vingtaine de commerces à l'état embryonnaire, il devra se borner à en exercer un à l'état de spécialité. Les choses ne manqueront pas de se passer ainsi, en admettant que le commerce demeure libre dans les phases successives du développement économique du village. Dans ce cas, la pression de la concurrence obligera le boutiquier primitif à spécialiser sa vente; car, en la maintenant sur l'ancien pied, il s'exposerait à perdre sa clientèle, qu'il ne pourrait plus servir aussi bien et à aussi bas prix que ses concurrents dont les établissements seraient spécialisés. Mais il en sera autrement si le boutiquier, d'abord investi du monopole naturel de l'approvisionnement du village, a eu assez de pouvoir ou d'influence pour maintenir ensuite ce monopole à l'état artificiel. Dans ce cas, comment les choses se passeront-elles? Le boutiquier continuera d'exercer son commerce sur l'ancien pied; seulement, à mesure que son débouché s'agrandira, il sera obligé d'augmenter les proportions de son établissement, et finalement, lorsque le village sera devenu une grande ville, d'en faire un bazar colossal. Que s'il lui est impossible de subvenir à une demande qui comprend maintenant autant de milliers d'articles qu'elle comprenait primitivement d'unités, il abandonnera peut-être quelques-unes des branches les moins lucratives de son monopole, ou du moins il tolérera l'établissement de quelques autres magasins pour ces branches secondaires, à la condition qu'ils ne subsisteront que sous son bon plaisir et qu'ils lui payeront tribut. En revanche, il ne manquera [II-512] pas de conserver et de défendre avec un soin jaloux les branches principales de son monopole.
Cependant, à mesure que le marché de consommation s'agrandit ét se diversifie, l'établissement de l'épicier monopoleur se trouve placé dans des conditions de production moins économiques. Tandis que les autres branches de travail se séparent en vertu du principe de la division du travail, se développent dans leurs limites naturelles et se perfectionnent sous le stimulant de la concurrence, celles qu'il monopolise grandissent artificiellement, en dehors de ces conditions organiques de la croissance économique. Qu'en résulte-t-il? c'est que les industries de concurrence livrent à la consommation des produits de plus en plus parfaits et à des prix décroissants, tandis que le commerce monopolisé demeure chaque jour davantage en retard sous ce double rapport. Néanmoins, si ce commerce porte sur des articles indispensables à la consommation, les bénéfices du monopoleur croîtront quand même, par le seul fait de l'agrandissement progressif du marché.
Poursuivons jusqu'au bout notre hypothèse. A mesure que les progrès des industries de concurrence rendront plus sensible et plus dommageable le retard de perfectionnement du commerce monopolisé, les consommateurs murmureront davantage contre ce monopole. Cependant, s'il est sauvegardé par quelque antique superstition, si l'on est universellement convaincu qu'il est dans la nature du commerce de l'épicerie d'être exercé sous forme de monopole, on se bornera d'abord à le réglementer, en imposant au monopoleur l'obligation d'approvisionner convenablement le marché qui lui est inféodé, comme aussi peut-être en soumettant ses marchandises à un maximum. Peut-être enfin, les consommateurs chargeront-ils des délégués de veiller [II-513] à ce que cette réglementation préservatrice de leurs intérêts soit strictement observée. Le monopoleur s'efforcera naturellement de repousser une semblable immixtion dans ses affaires, et il emploiera pour s'en débarrasser tantôt la violence et tantôt la corruption. En admettant qu'il réussisse à remettre les consommateurs complétement à sa merci, il aura le choix entre deux partis: 1° Il pourra interdire, sous des peines rigoureuses, toute plainte au sujet de la qualité et du prix de ses marchandises, et jouir ainsi de son monopole avec quiétude. Mais alors la société retardée et épuisée par un monopole sans frein ira s'affaiblissant, et elle finira par périr en entraînant le monopoleur dans sa ruine. 2° Il pourra donner satisfaction à ses consommateurs mécontents, en amélioraut ses marchandises sous le double rapport de la qualité et du prix, mais l'assiette antiéconomique de son commerce l'empêchera quoi qu'il fasse, d'opérer cette amélioration d'une manière suffisante et durable. Le mécontentement renaîtra bientôt, et si les consommateurs ont crû en nombre et en puissance, ils réussiront peut-être, à leur tour, à mettre le monopoleur à leur discrétion. Quelles seront les conséquences de cette « révolution? » De deux choses l'une, ou les consommateurs se borneront à imposer au monopoleur un ensemble de règles et de garanties destinées à assurer la bonne qualité et le bas prix de ses marchandises, en d'autres termes, ils l'obligeront à accepter une constitution, ou ils voudront exploiter pour leur propre compte le monopole de l'épicerie en constituant une gérance et un conseil de surveillance ad hoc, avec diverses précautions pour en assurer la bonne gestion, mais l'un et l'autre remèdes seront presque également inefficaces. De quelque façon qu'il soit organisé et géré, le monopole de cette multitude de branches dans lesquelles se [II-514] ramifie maintenant le petit commerce de l'épicier primitif n'en demeurera pas moins antiéconomique, et, chaque jour même il le deviendra davantage; chaque jour, en conséquence, il causera à la société des nuisances plus nombreuses et plus sensibles. Peut-être cherchera-t-on alors des remèdes d'une autre nature à ce mal chronique. On s'imaginera, par exemple, que le débouché ouvert au commerce monopolisé est insuffisant, et l'on s'efforcera de l'agrandir par « l'annexion » de nouveaux consommateurs, ou bien encore on se persuadera que le mal vient de ce que ceux qui vendent les épiceries et ceux qui les achètent n'appartiennent pas tous à la même race, et l'on s'appliquera à réorganiser le monopole de l'épicerie conformément au « principe des nationalités. » Mais l'expérience ne tardera pas à démontrer que ces soi-disant panacées aggravent le mal au lieu de le guérir. Enfin, en désespoir de cause, la série des remèdes empiriques étant épuisée, on aura recours aux procédés de l'observation et de l'analyse pour remonter à la source du mal, et l'on découvrira, non sans surprise, qu'il n'est pas vrai, ainsi que les monopoleurs s'étaient appliqués à le faire croire, le croyant du reste eux-mêmes, que le monopole soit la forme nécessaire et providentielle du commerce de l'épicerie. En conséquence, au lieu de poursuivre l'œuvre impossible d'une meilleure « organisation » de ce monopole, on travaillera à le démolir, en faisant passer successivement les différentes branches de commerce qui s'y trouvent agglomérées, dans le domaine de la concurrence. Cette agglomération contre nature étant dissoute, chaque branche devenue libre pourra se développer dans ses conditions normales, en proportion des besoins du marché, et la société débarrassée d'un monopole qui la retardait et l'épuisait croîtra plus rapidement en nombre et en richesse.
[II-515]
C'est là l'histoire des gouvernements depuis que la société a commencé à passer de la phase du monopole dans celle de la concurrence.
Lorsque les progrès généraux de la population et de la richesse d'une part, les progrès particuliers de la sécurité et des moyens de communication de l'autre, eurent agrandi les marchés de tous les produits et services, les corporations qui possédaient depuis des siècles, dans chaque localité, le monopole des différentes branches de l'activité humaine devinrent de plus en plus insuffisantes pour satisfaire aux besoins croissants de ces marchés agrandis. Des apôtres d'une science nouvelle apparurent alors, et ils s'appliquèrent à démontrer que cette antique organisation de l'industrie était maintenant surannée, qu'il fallait, dans l'intérêt de la société, substituer la concurrence au monopole. Les corporations privilégiées ne manquèrent pas de se défendre, mais les intérêts auxquels leurs monopoles portaient atteinte grandissant chaque jour, les plus faibles, celles qui occupaient les régions inférieures et moyennes de la société finirent par succomber. En revanche, celles qui occupaient les régions supérieures et dont les fonctions étaient environnées d'un prestige particulier échappèrent à ce régime nouveau qui était imposé aux autres. On s'était accoutumé à croire que les gouvernements, ayant à remplir une mission d'un caractère sublime, ne pouvaient rien avoir de commun, dans leur mode d'établissement et de fonctionnement, avec la multitude des autres entreprises, et l'on n'eut pas même l'idée que les règles qui s'appliquaient à celles-ci pussent également leur être applicables. Telle était la situation des esprits, lorsque la révolution française vint mettre à l'ordre du jour la reconstitution du gouvernement et celle de la société elle-même. L'opinion [II-516] dominante à cette époque, au moins parmi les classes éclairées, dont l'influence, malgré des éclipses temporaires, finit toujours et nécessairement par prévaloir, était que la multitude des branches inférieures de l'activité humaine devaient être abandonnées à la concurrence, sauf toutefois un certain nombre de restrictions. Ainsi, on croyait que les industries et les professions qui concernent la subsistance des masses devaient continuer à être sévèrement réglementées; on croyait encore qu'il importait d'empêcher la formation de grandes associations, afin d'éviter le retour des abus du régime des corporations; on croyait enfin, — et ceci était un reste du droit économique de l'ancien régime, — que le marché national était la propriété de l'industrie indigène, et qu'il fallait, par conséquent, en écarter aussi complétement que possible la concurrence étrangère. Mais, ces restrictions faites, — à la vérité, elles étaient nombreuses, — les esprits éclairés s'accordaient à considérer la concurrence comme le seul régime applicable à la plupart des branches du travail matériel, et c'était en même temps à ces branches qu'ils restreignaient le domaine de la science nouvelle qui se résumait dans la théorie de la concurrence. En revanche, ces mêmes esprits qui appartenaient presque sans exception, notons-le bien, au personnel des anciennes corporations gouvernantes, étaient convaincus que les fonctions qui avaient jusqu'alors formé le domaine de ces corporations supérieures, la sécurité, le monnayage, les transports, le culte, l'enseignement, etc., devaient être nécessairement réservées, en vertu de leur nature propre, au gouvernement; à quoi ils ajoutaient que l'économie politique n'avait point à s'en occuper. Cela étant, il s'agissait de constituer le gouvernement, sans avoir égard aux données de la science économique, [II-517] mais de manière cependant à ce qu'il pût remplir, aussi avantageusement que possible pour la société, les fonctions nombreuses et importantes qu'on lui attribuait.
La compétence de l'économie politique en matière de gouvernement étant ainsi récusée, on ne doit pas s'étonner, si, pour résoudre le problème de la constitution utile de la production des services publics, on prit d'abord la voie qui en éloignait le plus. Que fit-on en effet? On commença par fusionner tous les services qui formaient, sous l'ancien régime, le domaine de corporations séparées, service de la sécurité, service de l'enseignement et des cultes, service du monnayage, service des transports, etc., et l'on constitua ainsi une énorme « régie » des services publics; ensuite, on essaya de remettre cette régie aux mains d'une démocratie communautaire, dont les institutions étaient empruntées à celles de la phase embryonnaire de l'existence des sociétés. Mais s'il était possible, à la rigueur, — quoique ce fût visiblement une œuvre rétrograde, — de fusionner des services de nature diverse dans une régie unique, il était impossible de faire manœuvrer cette lourde et monstrueuse machine autrement que par un personnel spécial. En conséquence, on vit se reconstituer une classe gouvernante dans laquelle l'ancien personnel gouvernemental se fondit avec l'élément nouveau que la révolution avait fait surgir. Cette classe nécessaire pouvait à la vérité se recruter désormais plus aisément qu'autrefois dans la masse de la nation à laquelle tous les emplois publics devenaient accessibles, mais les familles dont elle se composait ne manquèrent pas de se transmettre de génération en génération, les fonctions politiques, militaires, judiciaires et administratives qui leur fournissaient des moyens d'existence; car elles s'en léguaient les traditions par l'éducation [II-518] du foyer, et leurs relations habituelles leur permettaient d'en assurer la conservation à leurs descendants. C'est ainsi que les familles adonnées à l'agriculture, à l'industrie et au commerce se transmettent de même, communément, de génération en génération, les entreprises à l'aide desquelles elles subsistent.
Le monopole gouvernemental se reconstitua donc, dans les différentes branches de travail qui lui étaient auparavant dévolues, — on pourrait ajouter même qu'il rétrograda en fusionnant des industries que le progrès avaient séparées sous le régime du monopole; il se reconstitua encore dans le personnel spécial que nécessitait la production des services publics.
A la vérité, ce monopole fut plus rigoureusement réglementé et maximé qu'il ne l'avait été auparavant et l'on conçoit qu'il ne pouvait l'ètre trop. En effet, en reconstituant, d'un côté, avec les débris des anciennes corporations gouvernantes, une corporation colossale que l'on investissait du monopole des services les plus nécessaires à la société; en dissolvant, de l'autre, toutes les corporations inférieures et en empêchant leur reconstitution sous des formes nouvelles, appropriées au régime de la concurrence, on faisait de la société gouvernée une poussière sans consistance, et on livrait les consommateurs ainsi individualisés des services publics, à la discrétion de l'aggrégation formidable à laquelle on en conférait de nouveau le monopole. Il importait donc que des garanties aussi complètes et aussi clairement spécifiées que possible fussent accordées à la masse des consommateurs contre l'abus de ce monopole, que la nature même des choses allait faire retomber, à peu près comme autrefois, entre les mains d'une classe spécialement adonnée à la production des services publics. Tel fut l'objet [II-519] des constitutions, c'est à dire des procédés de réglementation et de limitation du monopole gouvernemental qui ont été particulièrement en vogue depuis la révolution française. A l'origine, on avait une confiance illimitée dans cette réglementation politique; on était convaincu qu'avec une constitution bien faite un peuple ne pouvait manquer de se trouver garanti à perpétuité contre les abus d'un mauvais gouvernement. L'expérience ne tarda pas à faire justice de ces illusions. Au lieu de procurer aux peuples un bon gouvernement, les constitutions ne devinrent que trop souvent des instruments d'exploitation entre les mains des classes supérieures, qui avaient eu l'habileté de se faire attribuer le contrôle du gouvernement qui se trouvait, de fait, monopolisé par elles. Alors, les classes exploitées par ce monopole firent des révolutions pour s'en emparer à leur tour. Mais les révolutions n'aboutissant qu'à déplacer le monopole gouvernemental, et presque toujours même à l'aggraver, — car il fallait l'élargir et par conséquent l'alourdir pour y faire entrer les classes conquérantes plus nombreuses et plus faméliques que les classes auxquelles elles se substituaient, — le mal subsista. Les panacées constitutionnelles perdirent peu à peu de leur crédit, et l'on se mit à en chercher d'autres. On s'imagina, par exemple, que le mal provenait non de la mauvaise constitution du gouvernement, mais de la mauvaise constitution de la société elle-même, et l'on voulut étendre le système d'organisation des services publics à tous les autres services, en un mot, englober la société dans le gouvernement. Telle fut la panacée du socialisme, qui prenait précisément le progrès à rebours. L'économie politique, appuyée sur les intérêts que le socialisme menaçait, en eut facilement raison, mais le malaise social persistant toujours, une autre [II-520] panacée succéda à celle-là. On affirma que le mal provenait de ce que les gouvernements n'étaient pas suffisamment « nationaux, » c'est à dire de ce que le monopole des services publics se trouvait, en tout ou en partie, entre des mains étrangères, et l'on se mit à agiter la question dite des nationalités. On en est là aujourd'hui. On croit que le malaise dont souffre la communauté des peuples civilisés provient uniquement de ce que quelques-uns de ces peuples sont soumis à des gouvernements étrangers, et l'on en conclut qu'il importe par dessus tout de remettre les « natifs » en possession des monopoles gouvernementaux. Cela fait, et quelles que soient d'ailleurs l'ignorance et l'immoralité des natifs, — les services publics ne laisseront plus rien à souhaiter, et les nations entreront dans l'ère bénie de la liberté et de la paix. En conséquence, on convie les peuples à verser leur sang et à dépenser leur argent pour reconstituer au plus vite les « nationalités, » ou, ce qui revient au même, pour livrer chaque variété ou sous-variété de la race humaine à un monopole gouvernemental appartenant exclusivement à des hommes de cette variété ou sous-variété. Nous ignorons encore ce qui adviendra de cette nouvelle utopie; mais en admettant qu'on réussît à l'incarner dans les faits, nous pouvons affirmer que le malaise social n'en subsisterait pas moins. Il y a apparence même qu'il s'en trouverait aggravé, d'abord par suite des dépenses énormes qu'exigeraient les révolutions et les guerres nécessaires pour instituer, partout, des gouvernements purement nationaux, ensuite parce que, dans beaucoup de pays, où les aptitudes gouvernantes sont rares et de basse qualité, les gouvernements étrangers sont préférables aux gouvernements nationaux.
Ces utopies et bien d'autres ont leur source dans l'erreur que [II-521] nous avons signalée plus haut, savoir que la constitution des gouvernements n'est point, comme celle des autres entreprises, du ressort de l'économie politique, d'où il résulte que la solution du problème d'un bon gouvernement doit être cherchée ailleurs. L'échec désastreux de toutes les tentatives qui ont été faites pour améliorer les services publics, tant sous le rapport de leur production que sous celui de leur distribution, sans avoir égard aux lois économiques qui président à la production et à la distribution des autres services, démontre suffisamment, croyons-nous, que l'on se trompait en plaçant ainsi les gouvernements dans une région inaccessible à l'économie politique. Science de l'utile, l'économie politique est seule compétente, au contraire, pour déterminer les conditions dans lesquelles doivent être établies toutes les entreprises, aussi bien celles que les gouvernements accaparent que celles qui sont abandonnées à l'activité privée.
Du moment où l'on restitue à l'économie politique cette partie essentielle de son domaine, sans se laisser arrêter davantage par un préjugé trop respéctueux pour des puissances que la crainte des uns, l'orgueil des autres, avaient divinisées, la solution du problème d'un gouvernement utile devient non seulement possible mais encore facile. Il suffit de rechercher, en premier lieu, si les entreprises gouvernementales sont constituées conformément aux lois économiques qui président à la constitution de toutes les autres entreprises, quelle que soit la nature particulière de chacune, en second lieu, comment, dans la négative, on peut les y conformer.
De même qu'il y a des lois physiques et des principes de mécanique qui doivent être observés dans la construction des édifices, il y a des lois économiques qui doivent l'être dans la [II-522] constitution des entreprises. Ainsi, pour produire de la manière la plus économique, toute entreprise doit être construite et mise en œuvre conformément aux principes de l'unité des opérations et de la division du travail, des limites naturelles et de la concurrence; pour distribuer ses produits ou ses services de la manière la plus équitable et par conséquent la plus utile, toute entreprise doit encore se conformer aux principes de la spécialité et de la liberté des échanges. Or les entreprises gouvernementales, telles qu'elles sont construites et mises en œuvre de nos jours, pèchent essentiellement contre ces lois naturelles de la production et de la distribution des services.
I. Les gouvernements pèchent visiblement contre les lois de l'unité des opérations et de la division du travail. Comment nous apparaissent-ils en effet? Comme des entreprises colossales, exerçant à la fois une multitude de fonctions et d'industries. Non seulement les gouvernements pourvoient à la sécurité publique, mais encore, pour la plupart du moins, ils distribuent l'enseignement, ils commanditent le culte et les beaux-arts, ils transportent les lettres, expédient les dépêches télégraphiques, construisent et parfois exploitent les voies de communication, enfin ils interviennent plus ou moins dans les autres branches de l'activité humaine. Comment donc pourraient-ils s'acquitter utilement de ces fonctions multiples? Supposons qu'une compagnie s'établisse pour exploiter à la fois: 1° des chemins de fer et des bateaux à vapeur; 2° des fabriques de tissus de laine et de coton; 3° des magasins d'épiceries; 4° des théâtres, etc., etc., en admettant même que le gouvernement consentit à lui accorder l'anonymat (ce que l'administration ne ferait point, car elle considère naïvement le principe de l'unité des opérations comme essentiel. . .pour autrui), une entreprise pareille ne trouverait [II-523] pas un souscripteur. Pourquoi? Parce que si peu familière que soit la masse du public avec l'admirable livre de la Richesse des nations, elle refuserait de confier ses capitaux à une compagnie qui poursuivrait une foule d'objets différents et disparates: â défaut de la science, le bon sens appuyé sur une expérience de tous les jours lui démontrerait qu'on ne peut utilement, dans aucune direction de l'activité humaine, « chasser plusieurs lièvres à la fois; » qu'alors même que les diverses industries qu'il s'agirait d'entreprendre seraient avantageuses séparément, elles deviendraient mauvaises par leur réunion contre nature. Or qu'est-ce qu'un gouvernement sinon une vaste entreprise, exerçant des industries et des fonctions multiples et disparates? Au point de vue des lois de l'unité des opérations et de la division du travail, un gouvernement qui entreprend la production de la sécurité et de l'enseignement, le transport des lettres et des dépêches télégraphiques, la construction et l'exploitation des chemins de fer, la fabrication des monnaies, etc., n'est-il pas un véritable monstre?
II. Les gouvernements ne pèchent pas moins contre la loi des limites naturelles. Comme nous l'avons remarqué précédemment (T. Ier, Ve leçon. L'Assiette de la production) toute entreprise a ses limites dans lesquelles elle peut s'exercer avec un maximum d'utilité. Si elle les excède et si elle demeure en deçà, sa production devient moins économique. Or les gouvernements n'ont jamais eu aucun égard à cette loi. De tous temps, on les a vus s'appliquer à étendre le domaine soumis à leur monopole, et, « la monarchie universelle » est demeurée l'idéal des politiques sinon des économistes. En tous cas, ce sont les hasards de la guerre ou des alliances de familles et non point des considérations tirées de l'étude des lois de l'utilité qui ont déterminé [II-524] la grandeur des États. Comment d'ailleurs des gouvernements qui exercent plusieurs industries ou plusieurs fonctions se conformeraient-ils à la loi des limites naturelles? Chaque industrie a les siennes, et telle limite qui est utile pour la production de la sécurité cesse de l'être pour celle de l'enseignement. Cela étant, un gouvernement ne peut évidemment observer une loi qui lui imposerait autant de limites différentes qu'il exerce d'industries ou de fonctions.
III. Les gouvernements pèchent contre la loi de la concurrence. Sous ce rapport cependant leur constitution n'est pas uniforme. Pour certains services publics, la sécurité, le transport des lettres et le monnayage par exemple, ils prohibent absolument la concurrence dans les limites de leur domaine; pour d'autres, tels que l'enseignement, la charité, le transport des hommes et des marchandises, ils l'admettent dans une mesure plus ou moins étendue, mais presque toujours dans des conditions fort inégales. Ainsi, en matière d'enseignement, ils ont pour système de produire à perte, en rejetant les déficits de leurs établissements sur les contribuables parmi lesquels sont compris leurs concurrents eux-mêmes; en matière de charité, ils refusent d'autoriser la fondation d'établissements privés, sous forme de sociétés perpétuelles jouissant du droit de propriété dans toute sa plénitude, comme les établissements de la charité publique. Aucun service public, pour tout dire, n'est produit et distribué dans des conditions de pleine concurrence, c'est à dire en laissant le champ entièrement libre aux entreprises rivales et en subissant l'obligation de couvrir les frais de sa production, avec la rémunération ordinaire des capitaux qui y sont engagés. Les industries monopolisées par les gouvernements, pouvant ainsi subsister sans couvrir leurs frais de production, [II-525] n'ont pas besoin, comme les entreprises de concurrence, de perfectionner incessamment leurs procédés et leurs méthodes; elles s'empressent donc moins de satisfaire à ce besoin qui n'est pas pour elles de première nécessité, et elles demeurent par là même en retard sur les autres branches de l'activité sociale.
IV. Les gouvernements pèchent, enfin, dans la distribution de leurs services, contre les principes de la spécialité et de la liberté des échanges.
Dans les industries de concurrence, ces deux principes sont rigoureusement observés. D'une part, chaque consommateur demande spécialement l'espèce de produits ou de services dont il a besoin, dans les quantités et qualités qui conviennent le mieux à son usage, et ces produits ou services lui sont fournis conformément à sa demande; d'une autre part, il en débat librement les prix et les conditions de payement. En matière de services publics, au contraire, l'échange est commun et obligatoire, au lieu d'être spécial et libre. Le gouvernement met ses services à la disposition de la communauté des consommateurs, assujettis à son monopole, et ils sont tenus de les accepter tels quels, sans pouvoir en débattre individuellement les prix et les conditions de payement, à moins qu'ils ne puissent s'en passer, et dans ce cas même, ils sont obligés, le plus souvent, d'en payer leur part. La valeur de l'ensemble des services fournis par le gouvernement est totalisée et elle constitue la dépense publique. La somme nécessaire pour couvrir cette dépense est totalisée de même, et prélevée, d'après une règle de répartition plus ou moins arbitraire, sur la communauté des consommateurs. Si, comme c'est le cas ordinaire, elle demeure insuffisante, le gouvernement comble le déficit au moyen d'un emprunt, en rejetant [II-526] ainsi sur les générations futures une partie de la dépense des services fournis à la génération actuelle.
De la méconnaissance de ces différents principes qui régissent la constitution utile des entreprises, il résulte que les services publics demeurent dans un état de flagrante infériorité, en comparaison des services privés. La différence serait bien plus sensible encore si les gouvernements ne soumettaient point à une réglementation antiéconomique les branches de travail qu'ils n'ont point accaparées, en les empêchant de se constituer dans les formes et dans les limites les plus utiles, en interdisant, par exemple, au plus grand nombre des entreprises de se constituer sous forme de sociétés anonymes, à toutes de se fonder pour une durée illimitée, et, par conséquent, d'émettre des obligations perpétuelles. En entravant le développement utile des entreprises privées, ces restrictions et ces prohibitions ont pour résultat uniforme de diminuer la différence qui existe entre elles et les entreprises dont les gouvernements se sont attribué, à des degrés divers, le monopole.
Néanmoins cette différence est encore énorme, soit que l'on se place au point de vue de la production ou de la distribution utile des services.
I. En ce qui concerne la production, la méconnaissance des principes de l'unité des opérations, de la division du travail, des limites naturelles et de la concurrence a pour résultats inévitables de surélever les prix des services publics et d'en abaisser la qualité. Tandis que tous les produits et services des industries de concurrence sont fournis incessamment en plus grande abondance, en meilleure qualité et à plus bas prix, les services des gouvernements demeurent insuffisants, grossiers et chers. Cependant, à mesure que la population devient plus [II-527] nombreuse et que ses ressources augmentent, grâce à la productivité croissante des industries constituées et mises en œuvre conformément aux lois économiques, les besoins auxquels correspondent les services publics exigent une satisfaction plus ample et plus raffinée. S'agit-il de la sécurité? Elle doit être nécessairement plus complète et plus diversifiée dans une société riche et civilisée, où les propriétés à protéger se sont multipliées et ramifiées à l'infini, que dans une société pauvre et barbare. S'agit-il de l'euseignement? A l'origine, la somme de connaissances que chaque génération avait à léguer à la génération suivante était peu considérable et peu variée; en outre, ces connaissances, pour peu qu'elles dépassassent les notions élémentaires des métiers manuels, n'étaient nécessaires qu'à la classe peu nombreuse qui gouvernait la société: il suffisait donc, pour satisfaire aux besoins de ce petit nombre de consommateurs d'enseignement, de quelques écoles dans lesquelles toutes les sciences connues étaient mises à leur portée, comme tous les produits de l'industrie naissante étaient réunis dans la boutique de village. Mais à mesure que le capital intellectuel et moral de l'humanité s'est grossi par le travail des générations successives; à mesure encore que le besoin des connaissances nécessaires pour créer des richesses ou en gouverner l'emploi a été ressenti par une classe plus nombreuse, il a fallu multiplier et diversifier davantage les ateliers d'enseignement. De nos jours, au moins dans les sociétés où prédomine le self-government, l'acquisition d'une certaine somme de connaissances est devenue un besoin universel. Qui osera affirmer cependant qu'il y soit suffisamment pourvu? Que l'on compare l'extension qu'ont prise et les progrès qu'ont réalisés, depuis un demi-siècle, les industries qui pourvoient à la satisfaction de besoins bien [II-528] moins nécessaires, mais qui sont entrées dans le domaine de la concurrence, à l'extension si insuffisante et aux progrès si lents de l'enseignement accaparé partout, plus ou moins, par le gouvernementalisme? De tous les produits, l'homme est celui que l'on excelle aujourd'hui le moins à façonner: si l'on réussit à lui inculquer, d'une manière suffisante, l'art de gouverner les machines dont il fait usage, combien peu, en revanche, l'art de se gouverner soi-même est avancé et vulgarisé! A quoi peut servir cependant de multiplier et de perfectionner les produits si les hommes n'en savent point faire un emploi utile? S'ils ne se servent des ressources et de la puissance croissantes que leur confère une industrie progressive que pour s'adonner à des vices abrutissants ou pour s'entre-détruire dans des luttes sauvages? Ce retard de l'industrie qui sert à façonner les hommes en leur inculquant les principes du self-government, de tous les arts à la fois le plus difficile et le plus nécessaire, n'est-il pas et ne deviendra-t-il pas de plus en plus une nuisance sociale? — La même observation s'applique aux autres industries que les gouvernements ont accaparées: toutes demeurent en retard sur les industries de concurrence, et à mesure que la société croît en nombre, en richesse et en puissance, elle souffre davantage de ce retard de quelques-unes des branches les plus élevées et les plus nécessaires de son organisme.
II. Envisagée au point de vue de la distribution utile des services, la méconnaissance des principes de la spécialité et de la liberté des échanges, engendre des nuisances plus graves encore, en ce qu'elle entraîne une inévitable inégalité dans la répartition des services publics et des frais de leur production, en ce qu'elle permet même de rejeter sur les générations futures une partie de la dépense des services fournis à la génération [II-529] actuelle. D'un côté, en effet, nul ne peut savoir quelle est sa quote-part dans la distribution des services publics et qu'elle est sa quote-part dans la dépense. On peut affirmer toutefois que les classes les plus pauvres, partant, les moins influentes dans l'État, sont celles qui reçoivent la moindre proportion des services publics, et qui contribuent cependant, pour la plus forte proportion, à les payer. D'un autre côté, la totalité des recettes, quelle qu'en soit du reste la provenance, ne suffit plus que bien rarement à couvrir la totalité des dépenses. Tous les gouvernements sont régulièrement obligés d'emprunter pour combler les déficits sans cesse renaissants et grossissants des branches de travail qu'ils ont monopolisées. Au moment où nous sommes, leurs dettes réunies (sans compter celles des sous-gouvernements provinciaux, cantonnaux ou communaux) dépassent 60 milliards, et elles augmentent d'année en année [101]. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une partie des frais de production des services publics est mise à la charge des générations futures au lieu d'être acquittée bond fide par la [II-530] génération qui a consommé ces services. Cette facilité immorale à rejetter sur l'avenir une partie des frais des consommations présentes ne doit-elle pas avoir pour résultat inévitable d'exciter les gouvernements à augmenter incessamment leurs dépenses? Que l'ou se représente ce qui arriverait si une pratique analogue était possible en matière de consommations privées: quelles dettes on ferait chez son épicier, chez son tailleur, chez son bottier, si l'on pouvait, en s'autorisant d'une pratique généralement admise, rejeter sur « les générations futures » l'obligation de les payer! De deux choses l'une, on les générations futures succomberont un jour sous le fardeau de ces dettes accumulées, ou elles refuseront, comme ce sera leur droit, de les acquitter, autrement dit, elles feront banqueroute.
C'est ainsi, par le fait de leur constitution antiéconomique, que les gouvernements sont devenus, suivant une expression énergique de J. B. Say, les ulcères des sociétés [102]. A mesure que la population et la richesse augmentent, grâce au développement [II-531] progressif des industries de concurrence, une masse croissante de forces vives est soutirée à la société, au moyen de la pompe aspirante des impôts et des emprunts, pour subvenir aux frais de production des services publics ou, pour mieux dire, à l'entretien et à l'enrichissement facile de la classe particulière qui possède le monopole de la production de ces services. Non seulement, les gouvernements se font payer chaque jour plus cher les fonctions nécessaires qu'ils accaparent, mais encore ils se livrent, sur une échelle de plus en plus colossale, à des entreprises nuisibles, telles que les guerres, à une époque où la guerre, ayant cessé d'avoir sa raison d'être, est devenue le plus barbare et le plus odieux des anachronismes [103].
A cet ulcère qui dévore les forces vives des sociétés, à mesure que le progrès les fait naître, quel est le remède?
Si, comme nous avons essayé de le démontrer, le mal provient de la constitution antiéconomique des gouvernements, le remède consiste évidemment à conformer cette constitution aux principes essentiels qu'elle méconnait, c'est à dire à la rendre économique. Il faut pour cela, en premier lieu, débarrasser les gouvernements de toutes les attributions qui ont été annexées à leur fonction naturelle de producteurs de la sécurité, en faisant rentrer l'enseignement, le culte, le monnayage, les transports, etc., dans le domaine de l'activité privée; en second lieu, soumettre les gouvernements, comme toutes les autres entreprises, à la loi de la concurrence.
Déjà, la cause de la simplification des attributions gouvernementales est gagnée dans la théorie, si elle ne l'est pas encore [II-532] dans la pratique [104]. En revanche, l'idée de soumettre les gouvernements au régime de la concurrence est généralement encore regardé comme chimérique [105]. Mais sur ce point les faits devancent peut-être la théorie. Le « droit de sécission » qui se fraye aujourd'hui son chemin dans le monde aura pour conséquence nécessaire l'établissement de la liberté de gouvernement. Le jour où ce droit sera reconnu et appliqué, dans toute son étendue naturelle, la concurrence politique servira de complément à la concurrence agricole, industrielle et commerciale.
Sans doute, ce progrès sera lent à accomplir. Mais il en est ainsi de tous les progrès. Quand on considère la masse d'intérêts et de préjugés qui leur font obstacle, on désespère même de les voir se réaliser jamais. Écoutons plutôt ce que [II-533] disait an siècle dernier, Adam Smith, de la liberté commerciale:
« S'attendre, disait-il, que la liberté du commerce soit jamais rétablie entièrement dans la Grande-Bretagne, ce serait une bonhommie aussi absurde que de compter d'y voir jamais réaliser l'Oceana ou l' Utopie. Non seulement les préjugés, mais, ce qui est bien plus insurmontable, les intérêts particuliers d'un certain nombre d'individus s'y opposent irrésistiblement.
« Si les officiers d'une armée s'opposaient à toute réduction des troupes avec autant de zèle et d'unanimité que les maîtres manufacturiers en déploient pour s'élever contre toute loi tendante à augmenter la concurrence sur le marché intérieur; si les premiers animaient leurs soldats comme les autres enflamment leurs ouvriers pour les soulever et les déchaîner contre toute proposition d'une pareille mesure, il n'y aurait pas moins de danger à réduire une armée, qu'il n'y en a eu dernièrement à vouloir diminuer à quelques égards le monopole que nos manufacturiers ont obtenu contre leurs concitoyens. Ce monopole a tellement grossi parmi nous le nombre de certaines races d'hommes, que, semblables à un déluge de troupes sur pieds, elles sont devenues formidables au gouvernement et ont intimidé la législature dans mainte occasion.
« Le membre du parlement qui vient à l'appui de toute proposition faite pour fortifier le monopole est sûr d'acquérir non seulement la réputation de bien entendre le commerce, mais de la faveur et du crédit dans un ordre d'hommes à qui leur multitude et leurs richesses donnent une grande importance. S'il s'y oppose, au contraire, et qu'il ait de plus assez d'autorité pour les traverser dans leurs desseins, ni la probité la plus reconnue, ni le plus haut rang, ni les plus grands services rendus au public ne peuvent le mettre à l'abri de la détraction et des calomnies les plus infâmes, des insultes personnelles, et quelquefois du [II-534] danger réel que produit le déchaînement des monopoleurs furieux et déçus dans leurs espérances [106]. »
Cependant, la liberté commerciale a fini par avoir raison des « monopoleurs furieux » dont parle le père de l'économie politique, et l'on peut aujourd'hui, sans s'abandonner à des rêves utopiques, espérer qu'avant un siècle le système protecteur n'existera plus qu'à l'état de mauvais souvenir dans la mémoire des hommes. Pourquoi les monopoles politiques ne disparaîtraient-ils pas à leur tour comme sont en train de disparaître les monopoles industriels et commerciaux? S'ils disposent d'une puissance formidable, les intérêts auxquels ils portent dommage grandissent aussi, chaque jour, en nombre et en force. Leur heure suprême finira donc par sonner, et l'Unité économique se trouvera ainsi établie dans la phase de la concurrence comme elle l'a été dans les phases précédentes de la communauté et du monopole. Alors, la production et la distribution des services, enfin pleinement soumises, dans toutes les branches de l'activité humaine, au gouvernement des lois économiques, pourront s'opérer de la manière la plus utile.
Notes
[101] Le capital nominal des dettes publiques se montait en 1859, d'après l'Annuaire de M. J. E. Horn, aux sommes que voici: États-Unis, 241. 1 millions de fr.; Autriche, 6.850; Bade, 186.5; Bavière, 684.1; Belgique, 599,7; Brésil, 400; Danemark, 313.3; Espagne, 3.658,7; France, 9113.3; GrandeBretagne, 20,093.3; Grèce, 17; Hanovre, 170; Italie, 2500; PaysBas, 2.354.1; Portugal, 501,8; Prusse, 1200; Russie, 6.480; Saxe royale, 227,5; Suède et Norwége, 452; Turquie, 885; enfin, Wurtemberg, 119,3; ee qui donnerait un total de cinquante un milliards cent cinquante-trois millions trois cent mille francs. (Annuaire international du crédit public pour 1860, par J. E. Horn, p. 292.)
Depuis que ce relevé a été fait;, la seule dette des États de l'Union américaine s'est accrue de près de dix milliards.
[102]
Si par une suite des profusions où nous jettent des machines politiques abusives et compliquées, dit encore J. B. Say, le système des impôts excessifs prévaut, et surtout s'il se propage, s'étend et se consolide, il est à craindre qu'il ne replonge dans la barbarie les nations dont l'industrie nous étonne le plus; il est à craindre que ces nations ne deviennent de vastes galeres, où l'on verrait peu à peu la classe indigente, c'est à dire le plus grand nombre, tourner avec envie ses regards vers la condition du sauvage. . .du sauvage qui n'est pas bien pourvu, à la vérité, ni lui ni sa famille, mais qui du moins n'est pas tenu de subvenir, par des efforts perpétuels, à d'énormes consommations publiques, dont le public ne profite pas ou qui tournent même à son détriment. (J. B. Say. Traité d'économie politique. Liv. III, chap. X.)
[103] Voir à ce sujet le Dictionnaire de l'économie politique, art. Paix, et L'abbé de Saint-Pierre, sa vie et ses œuvres. Introduction.
[104] Nos deux précédents ouvrages, les Soirées de la rue Saint-Lazare et les Questions d'économie politique et de droit public, auxquels nous prenons la liberté de renvoyer nos lecteurs, sont presque entièrement consacrés à la démonstration des nuisances de l'intervention gouvernementale. Nous avons fondé, dans le même but, le journal l'Economiste belge.
[105] Nous n'en croyons pas moins devoir revendiquer, hardiment, la priorité de cette prétendue chimère. Voir les Questions d'économie politique et de droit public. La liberté du gouvernement. T. II, p. 245, et les Soirées de la rue Saint-Lazare. 11e soirée. P. 303. Consulter encore, pour les développements, L'Économiste Belge, le Sentiment et l'intérét en matière de nationalité, no du 24 mai 1862, polémique avec M. Hyac. Deheselle sur le même sujet, nos des 4 et 21 juin, 5 et 19 juillet, le Principe du sécessionisme, 30 août; Lettres à un Russe sur l'établissement d'une constitution en Russie, 2 et 30 août; 19 septembre 1862; la Crise américaine, 17 janvier 1863; un nouveau Crédit Mobilier, 14 février; une Solution pacifique de la question polonaise, 9 mai, etc., etc.
[106] Adam Smith. La Richesse des nations. Liv. IV. Chap. II.
IV.10. "De l’administration de la Justice" (1855↩
Source
"De l'administration de la Justice," L'économiste belge, No. 11, 5 Juin 1855, pp. 1-3.
All the issues for 1855 PDF.
Introduction
In his economic treatise Cours d’économie politique (1855) Molinari argued that the state was "antiéconomique" because it tried to do too many things at once, did not take advantage of the benefits of the division of labour and specialization, did not cover its costs, and because of the absence of competition generally did things very poorly. In this short article for his weekly journal L’Économiste belge he provides a case study of this very phenomenon, namely the way the Belgian state investigated crimes and punished the perpetrators.
Because the state was "un gouvernement omnibus" and "à la fois juge, gendarme, instituteur, entrepreneur de canaux, de chemins de fer et de télégraphes, fabricant de drains, irrigateur, etc" (at the same time (was) judge, policeman, school teacher, an entrepreneur providing canals, railways, and the telegraph, a builder of drains, an irrigator, etc), it was structurally unable to satisfactorily protect the lives and property of its citizens. He takes data on arrest rates and convictions for crimes committed in Belgium between 1840 and 1849 and demonstrates how low the arrest and conviction rate is. Acting once more as "le teneur de livres de la politique" (the book-keeper of policy) he draws up a general balance sheet "un bilan général" and concludes that the state is so inefficient in convicting murderers that coal miners have a greater chance of being killed in accidents than murders getting convicted and executed for their crimes.
He thought reforming the system was pointless as the incentives of the bureaucracy were so poor and entrenched. Because of the many other tasks the government undertook, if it transferred resources from other areas to devote to better police work the opportunity costs would mean that these areas would then have less resources to do their jobs. As he quoted Adam Smith at the start of the article "il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois" (one shouldn’t chase several hares at the same time).
Text
[1]
I.
S'il est un principe économique dont l'expérience ait confirmé la justesse, c'est assurément celui de la division du travail ou de la séparation des occupations. Qu'un homme se charge à la fois de plusieurs fonctions; qu'il veuille être, en même temps, industriel, négociant, avocat, médecin, professeur, et l'expérience atteste qu'il ne remplira d'une manière satisfaisante les devoirs d'aucune des professions qu'il aura embrassées. Ce qui est vrai d'un individu ne l'est pas moins d'une association, si vaste et si puissante qu'on la suppose. Qu'une compagnie de chemins de fer, par exemple, se mette il exploiter Iles mines, il fonder des manufactures et des maisons de commerce, il y aura cent à parier contre un qu'elle finira par la banqueroute. Mille exemples d'ailleurs viennent tous les jours confirmer la vérité du proverbe populaire dont la célèbre théorie d'Adam Smith, sur la division du travail, n'est que le commentaire: Il ne faut pas courir deux lièvres à la foi.
Eh bien! que sont les gouvernements sinon de grandes compagnies, des mutualités, qui ont pour mission spéciale de garantir la vie et la propriété des citoyens, en d'autres termes, de véritables compagnies d'assurances sur la vie et la propriété? C'est là leur fonction essentielle, et nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance suprême de cette fonction: il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour se convaincre que la prospérité des différentes contrées de notre globe se développe en raison directe non pas de la fertilité du sol, de la douceur du climat ou même de l'aptitude au travail et de l'esprit d'économie des populations, mais bien de la sécurité dont elles jouissent. Des institutions qui protégent la vie et la propriété de chacun contre le brigandage et le vol, sous quelque forme qu'ils le manifestent, voilà le premier besoin de toute société.
Or, si le proverbe populaire que nous venons de citer et vrai, si le principe de la division du travail est fondé, il est impossible qu'un gouvernement comme le nôtre, qui l'occupe de toutes choses, qui est à la fois juge, gendarme, instituteur, entrepreneur de canaux, de chemins de fer et de télégraphes, fabricant de drains, irrigateur, etc., etc., il est impossible, disons-nous, que ce gouvernement omnibus remplisse d'une manière convenable la multitude de fonctions dont il s'est chargé, à commencer par celles qui devraient constituer son unique spécialité; il est impossible qu'il protège suffisamment la vie et la propriété des citoyens; qu'il nous procure une sécurité qui vaille le prix qu'elle nous coûte. S'il en était autrement, si un gouvernement surchargé d'attributions de toute sorte, réussissait à les bien remplir, s'il attrapait les lièvres qu'il court, évidemment le proverbe populaire aurait menti, et Adam Smith, le profond observateur du principe de la division du travail, devrait être relegué au rang des Fourier, des Cabet, des Louis Blanc, des Pierre Leroux et autres songe-creux. Que disons-nous? Il devrait être placé beaucoup plus bas, car ces utopistes n'ont fait autre chose que de soutenir l'omnipotence et l'omni-capacité du gouvernement, et de demander, en conséquence, qu'on lui confie toutes les fonctions économiques et sociales, au lieu de lui en attribuer seulement quelques-unes. Si le gouvernement remplissait bien n'importe laquelle des nombreuses fonctions dont il est chargé, le principe de la division du travail serait caduc, et nous n'aurions rien de mieux à faire que de nous lancer, tête baissée, en plein socialisme.
Examinons donc de quelle façon notre gouvernement remplit ses fonctions de grand justicier et de grand policier du royaume, fonctions en vue desquelles il a été institué; voyons de quelle façon il garantit la vie et la propriété des citoyens.
II.
L'Exposé de la situation du royaume, pendant la période décennale 1841–50, nous fournit les principaux renseignements dont nous avons besoin pour nous faire une idée de l'efficacité et du coût de l'administration de la justice dans notre pays. Pour ne point nous noyer dans les chiffres, nous nous contenterons de ceux qui concernent les crimes contre les personnes et les propriétés, en laissant de côté les simples délits.
Dans la période 1840 à 1849, le nombre des crimes dénoncés à la justice a été de 12,795. Sur ce nombre, 3,188 seulement, impliquant 4,986 accusés, ont été portés devant les tribunaux. Il y en a eu 9,607 dont les auteurs sont restés inconnus.. En [2] admettant que la proportion des accusés soit la même pour les crimes restés inconnus que pour les autres, on aurait donc 15,025 individus qui auraient échappé à l'action de la police judiciaire.
Ainsi, d'emblée, nous trouvons que les TROIS QUARTS du nombre des crimes dénoncés à la justice, échappent complètement à son action repressive ; nous trouvons que sur quatre criminels, il y en a trois qui lui restent inconnus.
Ce n'est pas tout. Sur les 3,188 accusations dont les cours d'assises ont été saisies, sur les 4,986 accusés qu'elles ont eu à juger, il y a eu 1,410 acquittements, et 235 contumaces. Ainsi donc sur un chiffre probable de 20,01l auteurs ou complices des crimes commis dans la période de 1840–49, 3,341 seulement, c'est-à-dire un sur six ont été atteints et punis. Encore sommes-nous obligés d'admettre pour arriver à cette proportion, que nos tribunaux ont été infaillibles dans leurs jugements; qu'il ne leur est point arrivé de condamner des innocents.
Tel a été le bilan général des opérations de la police judiciaire et de la justice criminelle dans la période de 1840–49.
Entrons maintenant dans quelques détails. Examinons d'abord quelques-uns des principaux articles de la formidable liste des crimes dont les auteurs sont restés inconnus, et comparons-les aux articles correspondants de la liste des crimes portés devant les cours d'assises.
| Auteurs restés inconnus. | Auteurs mis en jugement. | |
| Assassinat | 55 | 177 |
| Empoisonnement | 21 | 17 |
| Infanticide | 126 | 86 |
| Meurtre | 105 | 234 |
| Avortement | 28 | 5 |
| Incendie | 1,507 | 160 |
| Vol de nuit à l'aide d'effraction, fausses clefs, etc. | 7,266 | 2,605 |
| Id. dans une maison habitée | ||
| Id. sur un chemin pubic | ||
| Id. avec circoncit. aggravantes |
Il ressort de ce tableau comparatif que de toutes les catégories de criminels, les assassins sont ceux que l'action de la justice atteint de la manière la plus efficace, la plus complète; en revanche, qu'elle est beaucoup moins efficace contre le vol, et qu'elle demeure presque impuissante contre l'incendie. Maia, il y a encore un autre enseignement à tirer de ce tableau, c'est qu'il se commet un bon nombre de crimes dont la justice n'a même pas connaissance, et qui doivent, en conséquence, grossir dans une proportion qu'il est impossible d'apprécier, le nombre des "crimes dont lea auteurs sont restés inconnus." C'est ainsi, par exemple, qu'alors que les incendies figurent dans le tableau pour un nombre total de 1,667, nous n'y voyons figurer que 33 avortements, c'eat-à-dire un peu plus de trois avortements par année pour une population de près de 4,500,000 individus. D'où provient la différence si considérable qui existe entre ces deux chiffres? Uniquement de ce que l'incendie est un crime visible, un crime qui se dénonce de lui-même, tandis que l'avortement est un crime caché, et qu'il est nécessaire de rechercher. La police judiciaire, si mal faite qu'elle soit, ne peut ignorer qu'un incendie a été commis. Il en est autrement pour l'avortement et pour les autres crimes dont la recherche est plus ou moins difficile. Si l'avortement était un crime visible comme l'incendie, ce ne serait point par unités ou par dixaines, qu'il se compterait, mais par centaines ou par milliers. Il y a donc, comme on voit, à ajouter à la formidable liste des "crimes dont les auteurs sont restés inconnus," une autre liste peut-être encore plus longue sinon plus effroyable, celles des "crimes dont la justice n'a pas eu connaissance."
Mais laissons de côté les crimes que la justice voit sans en découvrir les auteurs, tels que les incendies, et ceux qu'elle ne voit même pas, tels que les avortements; arrêtons-nous à ceux dont la répression est la plus efficace, à l'assassinat, à l'empoisonnement, à l'infanticide et au meurtre, et recherchons comment sont punis ces crimes que l'on poursuit avec un soin particulier; examinons, par exemple, jusqu'à quel point le métier d'assassin peut être considéré en Belgique comme une profession dangereuse.
Sur un nombre total de 826 assassinats, meurtres, etc., venus à la connaissance de la justice, en 1840–49, il y a eu 311 condamnations a mort, et 23 exécutions seulement. 23 exécutions sur 826 assassinats, cela fait 1 sur 36 environ, et cela signifie qu'un homme qui en assassine un autre, dans notre beau pays, ne court qu'un risque sur trente-six d'être retranché, à son tour, du nombre des vivants.
Examinons maintenant quelle est l'intensité des risques qui pèsent sur les industries dites dangereuses, et prenons pour exemple, la plus importante de ces industries, celle de l'extraction de la houille. Dans la période dé 1835 à 1844, sur laquelle nous avons des renseignements détaillés, cette industrie a employé 45,000 ouvriers, dont 35,000 à l'intérieur des exploitations. Dans la même période de dix années, les accidents dans l'intérieur des mines de houille ont fait 2,035 victimes, dont:
| 1,175 tués. | |
| 860 blessés. | |
| Total. | 2,035 |
En ne comptant que les tués, nous avons 1,175 victimes sur 35,000 ouvriers, c'est-à-dire 1 sur 30, tandis que nous ne comptons parmi les assassins, dans la période de 1840–49, qu'une "victime" de la peine de mort sur 36. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans notre Belgique civilisée, le métier d'assassin est moins périlleux que celui d'ouvrier mineur; cela signifie qu'une compagnie d'assurances sur la vie qui assurerait chez nous des assassins et des ouvriers mineurs, pourrait demander aux premiers une prime inférieure à celle qu'elle serait obligée d'exiger des seconds ; cela signifie qu'il est plus dangereux de s'exposer chez nous au grisou qu'à la guillotine.
III.
Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur les conséquences de la déplorable inefficacité de notre administration de la justice. Ces conséquences peuvent être rangées en trois catégories.
- Insuffisance de la sécurité pour les personnes et les propriétés;
- Barbarie nécessaire des peines;
- Cherté de l'appareil destiné à protéger les personnes et les propriétés.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur le dommage matériel que cause à la société tout entière l'insuffisance de la sécurité accordée aux personnes et aux propriétés; nous n'avons pas besoin d'insister non plus sur le mal moral qui résulte de la quasi-impunité dévolue à certains crimes tels que l'avortement et l'incendie, et de la répression incomplète des autres. Passons donc à l'influence qu'exerce l'inefficacité de la recherche et de la répression des crimes sur la pénalité elle-même.
Depuis un siècle, la pénalité a été considérablement adoucie. La torture a été abolie, le régime pénitentiaire amélioré, la peine [3] de mort moins prodiguée, et tous les jours des écrivains animés d'une louable philanthropie, demandent que ce vestige des époques de barbarie soit enfin effacé de nos codes. Récemment encore, deux des journaux les plus progressifs de nos provinces, le Journal de Bruges et la Vedette du Limbourg, faisaient éloquemment le procès de la guillotine, en arguant surtout de son inefficacité prétendue. "La statistique criminelle a démontré, disait le Journal de Bruges, que le crime suit toujours la progression de la peine, et qu'il est d'autant plus implacable que celle-ci est plus terrible." — "Voudra-t-on songer enfin, ajoutait la Vedette du Limbourg, en se rappelant les faits de l'histoire, que c'est alors que les peines étaient les plus atroces et les plus hideuses, alors que chaque jour pour ainsi dire on voyait le dresser sur les places publiques les chevalets, les roues, les potences, les buchers, etc., etc., que c'était alors que les crimes étaient les plus hideux et les plus atroces."
Nous en demandons bien pardon à nos honorables confrères, mais les crimes n'étaient point jadis nombreux et atroces parce que la pénalité était cruelle; ils l'étaient quoique la pénalité fut cruelle. S'il en était autrement, en effet, si les crimes croissaient avec la rigueur des peines, le procédé il suivre pour diminuer le nombre des crimes et les rendre moins atroces, serait simple et commode. Il suffirait d'adoucir la pénalite et finalement de la supprimer. Il suffirait de bannir les gendarmes, les geôliere et les bourreaux de notre société pour en bannir du même coup les assassins et les voleurs. Or, nous ne conseillerions pas au gouvernement d'essayer de ce procédé-là, et nous doutons que, la Vedette du Limbourg et le Journal de Bruges, eux-mêmes poussassent la philanthropie jusqu'à l'engager à en faire l'expérience.
Non ! ce n'était point la rigueur barbare des peines qui multipliait les crimes au moyen âge; c'était l'insuffisance, la corruption, parfois même l'absence de la police. Qui donc ignore que les voleurs et les assassins étaient alors organisés en corporation, qu'ils possédaient à Paris même, tout un quartier où la police ne s'aventurait point et où ils avaient leurs dépôts, leur arsenal et leurs écoles d'apprentissage? Qui ignore que leurs bandes infestaient les campagnes sans courir le risque d'y rencontrer la moindre escouade de gendarmes et que dans les villes, nul ne s'avisait de leur disputer la voie publique, après le coucher du soleil? A cette époque bienheureuse, dans ce bon vieux temps où le grand Coësre régnait paisiblement sur des légions de cagous, de rifodés, de malingreux, de sabouleux et de francs mitoux, l'impunité était presque assurée aux criminels, à moins qu'ils ne commissent l'imprudence d'attenter à la sûreté des classes privilégiées. Quelquefois cependant l'audace des malfaiteurs devenait telle, qu'ils empêchaient même le recouvrement de l'impôt. Alors, le monarque s'émouvait et il envoyait ses gens d'armes faire des razzias soit dans la Cour des Miracles, soit dans les campagnes. Pendant huit jours, on pendait, on rouait, on ténaillait, on écartelait sur la place de Grève, et la population retrouvait un peu de sécurité; mais bientôt l'impression causée par ce terrible exemple s'effaçait et les malandrins recommençaient leurs exploits un moment interrompus. Voilà comment on entendait la police au moyen âge.
Qu'en résultait-il? C'est qu'il était nécessaire de suppléer par l'intensité des peines à leur incertitude et à leur rareté; c'est qu'on était obligé de punir de mort même de simples délits, et de déployer pour la répression des grands crimes tous les raffinements de la barbarie. Peu à peu, heureusement, l'administration de la justice s'est améliorée, et l'expérience a démontré que la sûreté et la régularité de la répression ont plus d'efficacité que l'intensité des peines. On a pu alors, sans inconvénient, adoucir la pénalité. Que le même progrès se poursuive; que le risque que courent les auteurs d'attentats contre les personnes et les propriétés d'être saisis et frappés par la justice, au lieu d'être simplement de 1 sur 6 en moyenne, soit de 2, 3, 4 et 5 sur 6, et la pénalité pourra être de nouveau adoucie, sans qu'il en résulte aucun dommage pour la société. C'est ainsi que la peine de mort, par exemple, qui est aujourd'hui encore indispensable à la sécurité publique, pourra être abandonnée, lorsque les assassins, au lieu d'avoir une chance sur deux d'échapper complètement à l'action de la justice, n'en auront plus qu'une sur dix ou sur vingt. C'est ainsi, pour tout dire, que les peines pourront diminuer d'intensité à mesure que l'application en deviendra plus assurée.
Ce progrès si désirable aura, en même temps, pour résultat de réduire dans une proportion considérable le coût de la sécurité intérieure. Les frais de police et de justice s'élèvent actuellement en Belgique à plus de dix millions. Sur ce chiffre, il faut compter environ cinq millions pour le logement, l'entretien et la surveillance d'une population de 7,773 individus qui habitent les 32 prisons ou pénitenciers du royaume. Si l'action de la justice était plus efficace, si le métier d'assassin et de voleur devenait à la fois plus dangereux et moins productif, si le personnel du crime diminuait en conséquence, il est évident que la population de nos prisons finirait par diminuer aussi, au grand profit de nos finances.
On voit donc que le progrès de l'administration de la justice aurait ce triple résultat d'augmenter la sécurité et la moralité publiques, de rendre possible l'adoucissement de la pénalité et de réduire les dépenses de la sécurité intérieure.
IV
Mais ce progrès si souhaitable, ce progrès qui intéresse à un si haut degré les éléments vitaux de notre civilisation, est-il possible avec notre système actuel de gouvernement? Disons-le franchement: non, il ne l'est point. Vainement on augmenterait le personnel de la police de sûreté, vainement on donnerait à cette administration essentielle l'unité d'action qui lui manque, vainement encore on se préoccuperait moins de la sécurité des gouvernements étrangers et davantage de celle des citoyens belges, vainement enfin on réformerait la constitution vicieuse du jury, on n'obtiendrait qu'un résultat insignifiant et purement temporaire. Notre administration de la justice est aussi bonne qu'elle peut l'être sous le régime actuel, et nous devons même rendre grâce au ciel de ce qu'elle n'est pas plus mauvaise. Il est impossible, en effet, de demander à un gouvernement que l'on accable des attributions les plus diverses et les plus disparates, que l'on oblige d'exercer à la fois une quarantaine de métiers, depuis celui de pédagogue jusqu'à celui de porteur d'eau, il est impossible, disons-nous, d'exiger de ce gouvernement maître-Jacques qu'il remplisse bien tous les devoirs de toutes les professions dont on le charge. C'est merveille même de le voir s'en tirer comme il le fait. Ne soyons donc pas trop sévères à son égard, et s'il arrive par hasard à l'un de nos lecteurs d'être volé ou assassiné, qu'il se garde bien de rendre le gouvernement responsable d'un si fâcheux accident; qu'il se console en pensant que si le gouvernement s'était occupé plus assiduement de protéger sa vie ou sa propriété, c'eût été aux dépens de la construction de quelque pont ou de quelque viaduc, de la collocation d'une prise d'eau ou de la remonte d'un haras. Car Adam Smith n'était décidément pas un songe-creux et l'on peut appliquer aux gouvernements comme aux particuliers le proverbe populaire: Qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois.
PART V. MOLINARI’S THEORY OF THE STATE II: THE "TEMPERED" REPUBLIC (1873)
V.11. "La République tempérée" (1873)↩
Source
Gustave de Molinari, La République tempérée (Paris: Garnier, 1873). Sections I (pp. 5-14), II (pp. 15-25), V (pp. 59-77), and VI (pp. 79-90).
PDF.
Introduction
Molinari wrote this book two years after the socialist experiment of the Paris Commune (March-May 1871) frightened the liberals about the possibilities of a violent socialist group taking control of the government, and 27 years after his first essay on electoral reform (1846) in which he likened the taxpayers to shareholders in a mutual insurance company which would protect their liberty and property according to the amount they had at stake in society and would thus pay for "proportionally." The book, his first and only entry into the field of political and constitutional theory, was written at a time when the constitution of the Third Republic was being discussed before it was introduced in 1875.
The recent Paris Commune explains his very anti-socialist rhetoric, calling their ideas "antisociales," "subversives," and "pernicieuses" and the socialists themselves "les apôtres de la liquidation sociale" (the apostles of social destruction), "une classe hostile à la propriété" (a class hostile to private property), and "une classe politiquement et socialement dangereuse" (a politically and socially dangerous class). He even comes close to arguing that the new government might need to be able to "repousser par la force une invasion brutale du socialisme révolutionnaire" (to repulse by force the brutal invasion of revolutionary socialism) which it could do by denying even a socialist majority from exercising power in the name of internal security and order: [11]
| il faut encore qu’il soit constitué de manière à en empêcher l’invasion légale. En d’autres termes, il faut que le gouvernement demeure inaccessible aux socialistes, eussent-ils de leur côté la majorité numérique, — sinon point de sécurité intérieure. | it is necessary that the government be constituted in a way to prevent a "legal invasion". In other words, it is necessary that the government remain inaccessible to the socialists (even if) they had the numerical majority on their side, otherwise there would be no internal security. |
In spite of these words, Molinari actually wanted to introduce a very broad franchise in the new republic that would include anybody who had "civic rights" and who paid taxes. This of course would include all socialists and radicals except for the most violent and those who were convicted criminals.
In his conclusion to the book he returned to some of his favorite political ideas concerning the purpose of government (to protect life, liberty, and property) and who should vote and how people could vote to get this kind of government, namely, all property owners and taxpayers in proportion to the amount of property they owned and paid in taxes.
To achieve this, Molinari drew upon three historical examples for lessons: the relative stability of the Restoration and July Monarchies with their limited voting class of "les censitaires," and the British and American systems with their two Houses of Parliament and their in-built checks and balances and limited terms in office. His ideal would be a new kind of republic, what he called "une république de compromis, une république tempérée" (a republic of compromise, a tempered (or limited) republic)) which would be neither completely "democratic" nor completely "oligarchic" but a compromise between the two.
There would be two Chambers and an executive President. The First or Upper Chamber "une première chambre ou chambre haute" would be made up of no more than 300 people drawn from the highest taxpayers in France (over 200 fr. per annum) whatever might be the source of their income. Their role was to be a conservative or protective force (la forteresse des intérêts conservateurs) which would be able to draw upon their abilities and experience as an elite ("l'aristocratie des capacités" (the aristocracy of abilities) and "la majorité des intelligences d'élite" (the majority of the elite minds)) to guarantee the nation’s security and the people’s property. They would closely examine any budget or legislation which was brought before them, and would "’approuver ou de censurer les actes du pouvoir exécutif" (approve or veto the actions of the executive power). Members would sit for 9 years and as in the American Senate, one third would be elected every three years.
The Second Chamber or Lower House would be elected by universal manhood suffrage and its task would be to vote on the budget, and make or reform the laws. The Chamber would represent the interests of "la généralité des contribuables" (the majority of taxpayers) and would therefore act on their behalf to "consentir l'impôt" (consent to taxation) and "consentir la loi" (consent to the law). In other words, they would "défendre la bourse des contribuables" (protect the stock market of the taxpayers). Given the tendency all governments have to increase the number of its functions, to multiply the number of government jobs which it can provide to its supporters, and constantly to increase the burden of taxes, the Lower House would have a particularly difficult task to keep the government limited and in check, and to preserve the essential liberties "des libertés nécessaires" of the people.
Like the American President, the French President would be an "executive" one, carrying out the laws agreed to by the two Chambers. In case of a deadlock, the President could dissolve the Second Chamber and call a new election. The President would be elected by the Lower House from a short list of three candidates chosen by the Upper House (thus excluding the danger of revolutionary socialists getting elected), and would serve for 4 years, again like the American President.
Molinari summarised his case for "une république modérée" by stating that his system would create:
| un gouvernement solidement fixé dans la classe qui réunit au plus haut degré la richesse et la capacité politique, préservé d’un autre côté des abus et de la corruption du monopole par l’intervention et le contrôle de la masse de la nation représentée dans la seconde chambre et pourvue des « libertés nécessaires, » ce gouvernement à la fois conservateur et libéral | a government which was solidly rooted in the class which united to the highest degree the wealth and political capacity (of the nation), protected on the other side from the abuses and corruption of monopoly by the intervention and control of the mass of the nation who were represented in the Second Chamber and who were provided with the "necessary liberties"; this government (would be) at the same time conservative and liberal… |
Endnotes
[11] Molinari also talks about the high cost to the state of countering "l’invasion du socialisme" which he considers to be a kind of "l’état de guerre" (state of war) in the section on "Le Socialisme" in La Grandeur et decadence de la guerre (1898).
Text
[5]
I. A quoi sert un gouvernement? — Des biens nécessaires qu'il est tenu de garantir. — La sécurité et la liberté. — Les services publics.
Que sont de nos jours les nations civilisées? De vastes associations politiques et économiques, qui se trouvent parfois à l'état d'hostilité et toujours en concurrence. Quand l'état d'hostilité devient aigu, quand la guerre éclate, — et elle n'éclate, hélas ! que trop souvent, — la victoire se fixe presque toujours du côté de la nation dont les forces et les ressources de toute sorte ont été aménagées avec le plus de sagesse et développées avec le plus d'intelligence et d'activité [6] pendant la paix. Or il y a deux conditions qui ont été de tout temps presque également nécessaires au bon aménagement des forces et des ressources des nations, et dont le caractère de nécessité est devenu de plus en plus marqué sous l'influence des changements que le courant naturel de la civilisation amène : ce sont la sécurité et la liberté. Le besoin de sécurité s'est étendu à la fois dans l'espace et dans le temps, parce que les intérêts qui demandent à être protégés se sont développés graduellement sur une aire plus vaste, tout en croissant en durée. Tandis que dans les anciennes sociétés l'agriculture et l'industrie elle-même n'exigeaient qu'une faible application de capital, tandis qu'une seule récolte suffisait le plus souvent à rembourser le laboureur de ses avances, de nos jours, grâce aux progrès qui ont renouvelé et augmenté successivement le matériel de la production, le capital a pris un rôle de plus en plus considérable dans toutes les branches de l'activité humaine. Le seul capital placé dans les chemins de fer de la France dépasse actuellement le chiffre do 25 milliards, et, si nous voulions évaluer l'ensemble des capitaux qui alimentent la production française, c'est par centaines de milliards que nous devrions compter; ces capitaux, engagés généralement pour un temps indéfini, ont besoin aussi d'une sécurité [7] indéfinie, et ce besoin s'accroît encore par le fait qu'ils sont fournis en grande partie par le crédit, et qu'ils se renouvellent incessamment au moyen de l'échange. Dans les anciennes sociétés, chaque famille, avec ses serviteurs, esclaves ou serfs, produisait à peu près toutes les choses dont elle avait besoin sur ses propres terres et avec ses propres capitaux, en n'échangeant que la plus faible portion de ses produits contre des articles provenant d'autres sols et d'autres climats ; aujourd'hui on ne possède plus guère .que par exception la totalité de ses moyens de production, et d'un autre côté, dans le.plus grand nombre des industries, on ne consomme rien ou presque rien de ce que l'on produit. Divisée en une multitude de branches qui vont chaque jour se subdivisant encore, la production exige, comme règle, le concours du crédit et de l'échange. Si dans l'industrie agricole il y a des paysans propriétaires qui exploitent eux-mêmes leur lopin de terre et qui consomment eux-mêmes aussi une partie des produits qu'ils en tirent, la plupart des grandes et des moyennes propriétés sont affermées, le capital d'exploitation appartient au fermier ou est emprunté par lui, le travail est loué, et les produits sont en presque totalité vendus. Dans les entreprises industrielles, le capital fixe est réuni le plus souvent par voie d'association soit qu'il s'agisse de simples partnerships ou [8] de vastes sociétés anonymes, le capital roulant est en plus grande partie encore fourni par le crédit, et c'est par le moyen de l'échange que toutes ces entreprises réalisent les résultats de leur production. Le cultivateur échange son blé, son vin ou son bétail, le manufacturier ses fils et ses tissus par l'intermédiaire du commerce, qui se charge de mettre toute sorte de produits à la disposition du consommateur, en tout temps, en toutes quantités et en tous lieux soit à l'intérieur du pays, soit au dehors et jusqu'aux extrémités du globe.
Nous n'avons pas à faire ressortir ici les avantages de cette organisation nouvelle de la production ; on sait à quel point elle a contribué à multiplier la richesse; mais cet organisme économique, si puissant et si complexe, est en même temps d'une sensibilité extrême, comme toute machine perfectionnée. Il suffit de la rupture d'un rail pour faire dévier une locomotive et broyer un convoi, tandis qu'une lourde et grossière charrette peut cheminer sans encombre dans les ornières d'une route négligée. Il suffit non pas même d'une perturbation, mais de la seule crainte d'une perturbation dans le milieu où fonctionne le mécanisme délicat du crédit et des échanges pour frapper de paralysie cet appareil vital qui fournit à chacun ses moyens d'existence. Qu'une guerre menace, ou, [9] pis encore, une révolution intérieure, et voici que les capitaux cessent à l'instant de se prêter ou ne se prêtent plus qu'avec la surcharge d'une prime destinée à couvrir ce risque ou cette appréhension d'un risque, voici que les entreprises existantes, — et elles se comptent par centaines de mille, — sont obligées d'arrêter ou de restreindre leur production, voici que les entreprises en projet ou en voie de formation sont ajournées jusqu'après la crise. Il en résulte que tous ceux qui contribuent à créer, à entretenir et à mettre en oeuvre l'immense et multiple appareil de la production et de l'échange, propriétaires, capitalistes, industriels, négociants, ouvriers, se trouvant atteints ou menacés dans leurs moyens d'existence, restreignent leur consommation, et que tous les débouchés se resserrent soit directement, soit par répercussion, à commencer par ceux des industries ou des arts qui fournissent les articles de luxe ou de nécessité secondaire. N'a-t-on pas constaté par exemple que la révolution de février 1848 avait abaissé en une seule année la production de l'industrie parisienne de 1463 millions à 767? N'en faut-il pas conclure que le besoin de sécurité s'est accru, et que cette entreprise supérieure qui s'appelle un gouvernement, et dont la fonction essentielle consiste à produire de la sécurité, doit développer et perfectionner sa production dans la mesure [10] du développement et du progrès de toutes les autres branches de l'activité humaine?
Est-ce tout ? la sécurité est-elle le seul bien nécessaire qu'une nation attende de son gouvernement, et qu'il ait l'obligation de lui procurer ? Non ! il faut y joindre la liberté, et ici encore les garanties qui pouvaient suffire dans les anciennes sociétés sont devenues insuffisantes pour les nôtres. Dans le milieu social que nous a fait la civilisation accumulée de tant de siècles, l'individu s'appartient presque complétement, il est le maître de sa destinée, mais c'est à la charge de se procurer lui-même des moyens d'existence et d'en régler l'emploi. Et pour remplir cette obligation, naturellement attachée au self-government, il faut que chacun ait la liberté, entière de donner à ses facultés et à ses biens l'emploi le plus utile ; sinon, il ne pourra s'acquitter complétement de ses obligations, et sa condition deviendra difficile et précaire. Que si on lui enlève une portion de liberté pour l'ajouter à celle d'un ou plusieurs individus par la création d'un monopole ou d'un privilège, la condition des bénéficiaires de ce monopole ou de ce privilége se trouvera sans aucun doute facilitée et assurée ; mais on aura ainsi créé une injustifiable inégalité et suscité entre les membres d'un même État des germes d'antagonisme qui grandiront tôt ou tard. On aura de plus entravé le développement [11] général de la société en frappant d'une paralysie partielle les facultés productives du grand nombre sans augmenter en compensation l'activité des privilégiés : l'expérience montre au contraire qu'ils ralentissent d'autant plus leurs efforts qu'ils ont moins à redouter la concurrence. Il faut donc que le gouvernement s'applique à garantir à chacun le libre usage de ses facultés et de ses biens, s'il veut faire régner dans la société cette bonne entente qui ne peut se fonder que sur la justice, s'il veut encore y provoquer le déploiement utile de toutes les forces physiques et morales à l'aide desquelles se crée la richesse publique et se fonde la puissance d'un État.
Les libertés du travail, du commerce, de l'enseignement, des cultes, concourent par des voies diverses à ce résultat final. On peut en dire autant des libertés politiques, qui permettent à tous les membres de la nation de participer à la gestion des affaires publiques ou tout au moins de la contrôler. Quand elles font défaut, quand le gouvernement est le monopole d'une classe, ce monopole excite la légitime jalousie des autres, et de plus il limite le choix des hommes capables de prendre part à la direction des affaires communes; quand à ce monopole se joignent, comme il arrive presque toujours, des restrictions à la liberté d'examiner et de contrôler les actes des gouvernants, [12] les rouages de la machine gouvernementale ne tardent guère à se rouiller, faute de surveillance ; elle se détraque, elle s'effondre, et ce n'est trop souvent qu'après de longs efforts, d'immenses sacrifices et de cruelles souffrances que l'on parvient à la reconstituer. Voilà donc tout un faisceau de libertés dont les gouvernés et le gouvernement lui-même ne peuvent se passer longtemps, et qui ont été qualifiées à bon droit de ce libertés nécessaires. » Il convient d'ajouter que ce caractère de nécessité devient plus prononcé à mesure que la concurrence internationale oblige les peuples à déployer plus d'activité pour se maintenir à leur rang. Une nation pouvait s'endormir autrefois dans les limites fermées de son territoire ; elle ne le peut plus depuis que ses frontières sont devenues perméables au courant sans cesse grossissant de la civilisation générale. Du moment par exemple où elle entr'ouvre une porte aux échanges extérieurs, elle subit, quoi qu'elle fasse pour s'y soustraire ou pour en amortir l'effet, l'action de la concurrence. Elle est obligée de se tenir au niveau du progrès général dans toutes les branches de sa production, sous peine d'être débordée par ses rivales, et de subir un amoindrissement absolu ou relatif des ressources qui sont les matériaux de sa puissance. La concurrence internationale suscite, fomente le progrès chez tous les peuples que l'expansion irrésistible [13] de 1'industrie, servie par des voies de transport multipliées et perfectionnées, a mis en communication; elle leur est un aiguillon puissant et inexorable qui les pousse en avant, mais qui peut aussi infliger des blessures mortelles à ceux dont la liberté d'action est entravée ou mutilée.
Ce n'est pas tout encore. Les gouvernements modernes ont bien d'autres fonctions que celles qui consistent à garantir la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, la propriété et la liberté des citoyens, quoique celles-ci soient de beaucoup les plus importantes. Ils empiètent continuellement sur le domaine de l'activité privée, et leurs attributions vont en s'étendant à mesure que leur intervention semble devenir moins nécessaire. Ils distribuent l'instruction à tous les degrés, ils encouragent et subventionnent les arts, ils créent et ils exploitent les voies et les instruments de communication ; enfin ils se croient obligés d'exercer « une tutelle administrative » sur de nombreux intérêts. Ces fonctions, jointes aux services qui sont plutôt de leur ressort naturel, savoir la garantie de la sécurité et de la liberté, exigent le concours d'un personnel nombreux, actif, instruit et par-dessus tout inaccessible à la vénalité et à la corruption. Ce personnel, on ne l'improvise pas plus que celui de toute autre branche de l'activité humaine. Il ne peut se former qu'à la longue, [14] par des générations successives engagées dans les divers services d'un gouvernement, l'administration, la la justice, l'armée, l'enseignement, et qui s'en lèguent en la grossissant l'expérience acquise. Sans doute il n'est pas bon que ces services soient monopolisés au profit d'une caste, et le régime des maîtrises gouvernementales ne vaut pas mieux que celui des maîtrises industrielles. En revanche, on ne peut contester que l'hérédité libre des fonctions publiques ne procure des avantages analogues à ceux dont elle est la source dans les professions et les industries privées. Gouverner et administrer un Etat avec un personnel temporaire, continuellement renouvelable au gré du caprice populaire, ne serait pas plus facile que de faire prospérer une industrie avec un personnel qui pourrait être complétement changé tous les trois ans ou tous les quatre ans, de telle sorte que les bottiers fussent chargés de fabriquer du drap et les drapiers réduits à faire des bottes. On serait probablement très-mal habillé et non moins mal chaussé sous ce régime ; comment pourrait-on être bien gouverné et administré?
[15]
II. Comment la tâche des gouvernements s'est agrandie et diversifiée chez les peuples modernes. — Qu'ils sont obligés de remplir cette tâche sous peine de mort.
Voilà donc, dans ses traits essentiels, la tâche des gouvernements modernes. Non-seulement cette tâche est plus vaste que ne l'était celle des gouvernements d'autrefois, mais encore elle présente un surcroît de difficultés et de périls.
Examinons par exemple à ce point de vue les rapports des États entre eux. Ne sont-ils pas infiniment plus fréquents et compliqués qu'ils ne l'étaient jadis, ne le deviennent-ils pas tous les jours davantage? Les progrès de l'industrie et le développement prodigieux des voies de communication, en mettant en relation tous les peuples civilisés ou à demi civilisés du globe, [16] n'ont-ils point par là même multiplié entre eux les occasions de querelles et de conflits? Ces différends, la sagesse commande aux Etats plus encore qu'aux particuliers de les éviter ; mais enfin cela n'est pas toujours possible, et, comme il n'existe point de tribunaux d'Etats assistés d'une force publique internationale pour les résoudre, ils ne peuvent être vidés le plus souvent que par la force. C'est ainsi que la civilisation, au lieu de diminuer les risques de guerre, comme il semblait permis de l'espérer, a eu au contraire pour résultat de les augmenter. Elle n'a pas davantage atténué les maux de la guerre. La guerre est plus destructive, et elle exerce une influence perturbatrice plus étendue qu'aux époques où la richesse accumulée était moindre et, où les relations de peuple à peuple étaient plus rares. La paix elle-même revient aujourd'hui plus cher. L'historien Gibbon, faisant le dénombrement des forces qui suffisaient sous Auguste pour protéger l'empire romain contre les barbares et en assurer la sécurité intérieure, n'arrive qu'à un total d'environ 175,000 hommes. Combien nous sommes loin aujourd'hui de ce chiffre modeste! Et pourtant nous n'avons plus à redouter les invasions des barbares, ce sont bien plutôt les barbares qui ont à redouter les nôtres ; la civilisation ne se défend plus, elle attaque. Malheureusement les nations civilisées sont restées les unes à [17] l'égard des autres à l'état de barbarie, et il faut bien qu'elles augmentent leurs défenses à mesure que s'accroissent entre elles les risques de guerre. Il y a un siècle, on se contentait d'armées relativement peu nombreuses, qui pouvaient être levées au moyen d'un recrutement à peu près volontaire. Depuis la Révolution, les armées se recrutent par voie d'impôt, et leur nombre n'a plus d'autre limite que celle de la récolte annuelle des hommes mûrs pour le service militaire. La conscription elle-même ne suffisant plus, on l'a remplacée par le service entièrement obligatoire. Ces effectifs de plus en plus nombreux que l'on enlève aux travaux productifs, il faut les entretenir, au moins en partie, d'une manière permanente, il faut encore les pourvoir d'un armement qui devient chaque jour plus efficace, mais aussi plus dispendieux. C'est ainsi que la paix subit un renchérissement continu, ce qui n'empêche pas, hélas! les guerres de coûter infiniment plus cher. C'est par milliards qu'on en calcule maintenant les frais, et si l'on songe que les guerres futures mettront aux prises tout ce que les nations belligérantes pourront fournir d'hommes valides, pourvus d'un armement qu'on s'ingénie sans cesse à perfectionner, si l'on songe que la richesse, exposée aux ravages des armées, va de même en s'augmentait, on acquerra la triste conviction que le prix de la guerre est destiné [18] à monter plus encore que celui de la paix. La conclusion pratique qu'il faut tirer et de cette multiplication des risques de guerre et de cette aggravation des frais et des dommages que la guerre occasionne de nos jours, c'est que les gouvernements doivent se tenir continuellement en éveil pour éviter des conflits que tant de points de contact entre eux et entre leurs nationaux, sans parler de leurs alliés, peuvent inopinément faire surgir, qu'ils doivent être toujours prêts, politiquement et militairement, à faire face à des agressions qu'il est quelquefois hors de leur pouvoir d'éviter, et qui peuvent causer des pertes et des dommages sans proportion avec ceux des anciennes guerres. Une politique extérieure inhabile, téméraire ou imprévoyante, un Etat militaire affaibli par la routine, n'exposent-ils pas en effet, aujourd'hui plus que jamais, une nation à subir des revers mortels pour sa prospérité et sa puissance?
La sécurité intérieure est-elle plus facile à sauvegarder? Nous ne nous arrêterons pas aux dangers que les crimes ou les délits privés font courir aux personnes et aux propriétés. Quoique l'art de la police ait encore plus d'un progrès à faire, il suffit à sa tâche dans la plupart des Etats civilisés ; mais il est un autre péril plus étendu et plus menaçant pour la société tout entière, et contre lequel les moyens de police demeurent [19] impuissants : nous voulons parler de celui qui résulte de l'existence et de la propagande de cet ensemble confus de doctrines antisociales connues sous la dénomination générique de socialisme. A vrai dire, ce péril n'est pas nouveau. Les sociétés à esclaves de l'antiquité ont eu leurs guerres serviles, le moyen âge a eu ses jacqueries, et la lutte que nous avons vue renaître entre le capital et le travail n'est autre chose qu'un prolongement ou une reprise de ces luttes anciennes. Seulement des circonstances particulières à notre temps, la centralisation industrielle, le développement extraordinaire des moyens de communication intellectuelle et matérielle, ont contribué à les généraliser. Ni les esclaves ni les serfs ne savaient lire, et dans l'état d'isolement où ils vivaient il leur était difficile de combiner leurs révoltes contre un ordre social dont ils étaient victimes, mais qu'il eût été, au surplus, hors de leur pouvoir de modifier. Il n'en est plus de même aujourd'hui. La classe qui occupe les régions inférieures de la société a cessé d'être disséminée et assujettie : des centaines de milliers d'ouvriers sont agglomérés dans les grands centres d'industrie ; les plus intelligents ont reçu les premiers rudiments de l'instruction, ils ont leurs journaux, et à défaut de réunions autorisées n'ont-ils pas les conversations du cabaret et de l'atelier? Il leur est permis de s'entendre, de se liguer pour [20] soutenir ou pour augmenter le prix de leur travail ; comment d'ailleurs le leur défendre? Ces circonstances réunies ne favorisent-elles pas singulièrement la propagande et les tentatives de subversion du socialisme révolutionnaire? Dira-t-on que les classes inférieures n'ont plus contre la société les griefs qui soulevaient les révoltes des esclaves et des serfs? Soit; mais elles en ont d'autres, et, pourquoi ne le dirions-nous pas? il y en a bien quelques-uns de fondés, car la société où nous vivons est perfectible, elle n'est pas parfaite. Nous ajouterons même que les maux, qui naissent de ses imperfections, de ses vices, doivent être surtout ressentis par la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Comme dans les grandes compagnies industrielles où ce sont les petits actionnaires qui pâtissent le plus des fautes ou des abus de la direction, dans une société la mauvaise gestion des affaires publiques, les dépenses improductives ou nuisibles auxquelles se livre le gouvernement, les priviléges qu'il accorde, la corruption qu'il entretient, retombent principalement sur le grand nombre, dont ils augmentent les charges et tarissent les ressources.
Allons plus loin, et convenons que la liberté n'a pas été pour les classes ouvrières une source de biens sans aucun mélange de maux. Lorsqu'elles ont été émancipées de la tutelle de leurs maîtres détestés, avaient-elles [21] bien le jugement assez formé pour se gouverner utilement elles-mêmes? Déclarées majeures et comme telles astreintes aux obligations que la majorité impose, possédaient-elles toute la capacité nécessaire pour s'en acquitter? La nature n'était-elle pas trop souvent ici en retard sur la loi? Combien d'ouvriers sont demeurés imprévoyants comme des enfants ou des sauvages, vivant au jour le jour, n'ayant aucune idée de la responsabilité ! Comment la liberté ne leur aurait-elle pas été dure? comment ne l'auraient-ils pas maudite, et la société avec elle? Faut-il donc s'étonner s'ils ont prêté une oreille complaisante à ceux qui leur montraient le remède à leurs maux dans une révolution sociale? Connaissaient-ils les conditions d'existence de la société? Dans leur état d'ignorance ou de demi-instruction, pouvaient-ils se rendre compte des impossibilités économiques du collectivisme, du mutuellisme ou du crédit gratuit ? Quand on examine de près la situation matérielle des classes ouvrières, quand on considère surtout l'état de minorité naturelle où elles sont en grande partie demeurées, on s'explique la faveur avec laquelle elles ont accueilli des doctrines qui sont à la mesure de leur développement intellectuel, et qui répondent à leurs dispositions morales. On peut combattre sans doute la propagande du socialisme, on peut encore l'affaiblir en pratiquant avec intelligence [22] et résolution une politique réformiste, mais cela ne peut se faire en un jour. Ni l'instruction sérieuse, ni les réformes vraiment efficaces ne s'improvisent ; en attendant les doctrines subversives font leur chemin dans les esprits. Nous savons parfaitement que ces doctrines sont inapplicables, et qu'une société collectiviste ou communiste ne pourrait pas vivre; mais on peut, en vue d'établir cette société chimérique, bouleverser la société existante, et, par ce que nous ont coûté de simples révolutions politiques, nous pouvons conjecturer ce que nous coûterait une révolution sociale. Des années seraient nécessaires pour relever les ruines qu'elle aurait faites en quelques mois ou en quelques jours. Les classes menacées par les apôtres de la liquidation sociale ont le sentiment très-vif de ce péril, peut-être s'en exagèrent-elles la proximité; mais il existe, et il faut s'en préserver. Or il ne suffit pas pour cela que le gouvernement soit capable de repousser par la force une invasion brutale du socialisme révolutionnaire, il faut encore qu'il soit constitué de manière à en empêcher l'invasion légale. En d'autres termes, il faut que le gouvernement demeure inaccessible aux socialistes, eussent-ils de leur côté la majorité numérique, — sinon point de sécurité intérieure.
De même que la sécurité intérieure, la liberté est exposée à des dangers particuliers, moins apparents [23] peut-être, mais qu'il n'est guère moins important d'écarter, soit qu'on se place au point de vue des progrès nécessaires des nations maintenant soumises à la loi de la concurrence, soit qu'on envisage simplement l'intérêt bien entendu des gouvernements eux-mêmes. Toute diminution de liberté implique, comme nous l'avons remarqué plus haut, une diminution d'activité productive, s'il s'agit des libertés économiques,—une diminution de contrôle, s'il s'agit des libertés politiques. Enfin, si l'on amoindrit la liberté des uns pour agrandir celle des autres en créant des monopoles et des priviléges, ou, ce qui revient au même, si l'on augmente les charges des uns pour alléger le fardeau des autres, on suscite des inégalités artificielles contre lesquelles les intérêts lésés finissent tôt ou tard par réagir. Malheureusement la plupart des constitutions existantes n'offrent sur ces différents points à la liberté que des garanties insuffisantes ou illusoires. En livrant sans contre-poids le gouvernement comme un monopole à une aristocratie ou à une bourgeoisie censitaire, elles ont rendu à peu près inévitable l'amoindrissement de la liberté du grand nombre au profit du petit. C'est ainsi qu'en Angleterre l'aristocratie territoriale n'avait pas manqué d'abuser de son influence pour protéger les intérêts de la propriété foncière aux dépens du reste de la nation. Cet exemple n'est pas [24] demeuré isolé, et l'on pourrait citer bien d'autres pays où le monopole politique n'a guère été plus respectueux pour les libertés économiques et pour le principe de la répartition équitable des charges publiques. Ce monopole n'a pas été plus favorable aux libertés politiques, droit de réunion ou d'association, liberté de la tribune et de la presse. Il les a trop souvent supprimées ou limitées, et non sans raison peut-être, car elles menaçaient son existence, mais elles n'en étaient pas moins indispensables au développement de l'activité nationale, au contrôle et à l'amélioration des services publics.
N'avons-nous pas eu raison de dire que les gouvernements modernes ont à remplir une tâche qui dépasse singulièrement en étendue et en difficulté celle de leurs devanciers? Il y a plus. Cette tâche compliquée et ardue, ils sont obligés de la remplir dans toutes ses parties essentielles, sous peine de mort. S'ils ne savent ni conserver la paix ni faire la guerre avec succès, ils courent le risque d'être emportés dans la catastrophe d'une invasion ; s'ils ne garantissent point d'une manière assez complète et assez sûre la sécurité intérieure et les libertés nécessaires, ils sont exposés à périr misérablement dans le guet-apens d'un coup d'État ou à sombrer dans une révolution. Tel a été le sort commun des gouvernements qui se sont succédé [25] en France depuis la chute de l'ancien régime : tous ont échoué dans l'accomplissement de la tâche qui s'imposait à eux. Cependant ces échecs successifs et les catastrophes auxquelles ils ont abouti constituent une " expérience » dont les fruits ne doivent pas être perdus. Ce n'est qu'en recherchant par où chacun de ces essais imparfaits de gouvernement a péché qu'on pourra réussir à élever une construction politique plus utile et plus résistante.
[Chapters 3 and 4 have been omitted]
[59]
V. Pourquoi la république démocratique et la république oligarchique ne sont pas viables, — Ce que doit être la république possible. — Constitution, rôle et attributions du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. — Leurs relations.
Si l'on veut savoir ce que doit être une république au temps et dans le pays où nous sommes, il faut — et c'est par là que nous avons commencé — se rendre exactement compte des besoins auxquels un gouvernement doit pourvoir et des conditions d'organisation ou de mécanisme qu'il doit observer pour être en état d'y pourvoir.
Les besoins qu'un gouvernement a pour mission de satisfaire varient, comme nous l'avons remarqué, selon les époques; mais le premier a été de tout temps le besoin de sécurité extérieure, et il ne semble pas [60] malheureusement que les progrès de la civilisation aient rendu en ce point la tâche des gouvernements plus facile, au contraire ! Entre des nations de plus en plus rapprochées et dont les rapports de toute sorte deviennent chaque jour plus fréquents, les occasions de conflits sont aussi plus nombreuses. Ces conflits, il faut savoir les éviter ou les résoudre à l'amiable, et, si une solution pacifique n'est pas possible, il faut être en mesure de les vider par la force. Voilà ce que demande la sécurité extérieure. Le besoin de sécurité intérieure et le besoin de liberté ne viennent qu'après ; ou pourrait soutenir même qu'ils en découlent. Une nation au sein de laquelle la propriété ne serait point sûrement garantie, dont l'activité ne pourrait prendre tout son essor faute de liberté, serait-elle en état de soutenir longtemps, soit dans la paix, soit dans la guerre, la concurrence de ses rivales en possession plus complète de ces éléments de prospérité et de puissance? En tout cas, la sécurité extérieure et intérieure avec la liberté, voilà bien ce qu'on pourrait appeler les besoins nationaux de première nécessité.
À quelles conditions un gouvernement peut-il y pourvoir d'une manière suffisante ? Ces conditions sont aussi de plusieurs sortes ; elles n'ont rien d'arbitraire, et elles veulent impérieusement être remplies. La première est la spécialité et la stabilité des fonctions gouvernementales. [61] La politique, l'administration, la justice et la guerre sont des arts qui exigent l'application continue de facultés d'un ordre élevé, façonnées par une éducation professionnelle et aidées par la tradition qui n'est que l'expérience accumulée. De là, la nécessité de la formation d'une classe adonnée particulièrement aux affaires et aux fonctions publiques et jouissant d'une sécurité de possession analogue à celle de la classe agricole ou industrielle par exemple, c'est-à-dire à l'abri du risque d'être brusquement expulsée de ses positions par quelque nouvelle couche sociale, dont la nation ait à payer les frais d'apprentissage. Dans ce cas seulement, un gouvernement peut soutenir, en ce qui le concerne, l'effort de la concurrence internationale, qui s'exerce par la politique et la guerre aussi bien que par l'industrie. De même là sécurité intérieure ne peut être préservée qu'à une condition : c'est que le gouvernement ne soit point exposé par un vice organique, à passer entre les mains d'une classe hostile à la propriété. Enfin la liberté ne peut être assurée qu'à cette autre condition, que le gouvernement ne soit point le monopole exclusif d'une classe quelconque. Ces deux dernières conditions sont particulièrement à noter dans un pays où, d'une part, les classes inférieures sont travaillées par le socialisme, où, d'une autre part, les classes dirigeantes [62] ont un goût des plus prononcés pour le monopole.
Or nous avons remarqué encore que la république telle qu'on l'avait instituée en 1848, s'était montrée radicalement impuissante à remplir cette mission complexe et difficile qui s'impose aujourd'hui à tout gouvernement, sous peine de mort. Que faut-il conclure de là, sinon que la République de 1873 périra comme a péri sa devancière, si elle suit les mêmes errements, si elle se constitue comme elle en vertu de « principes » abstraits et malheureusement aussi contestables qu'abstraits, sans tenir aucun compte des données pratiques que fournissent l'observation et l'expérience.
L'Assemblée nationale de 1848 avait établi, — il n'est pas superflu d'insister sur ce point — une république absolument démocratique. La souveraineté du nombre s'y exerçait dans toute sa plénitude en nommant, d'une part, les membres d'une Assemblée législative unique, de l'autre, le chef du pouvoir exécutif. Eh bien, quel usage le nombre a-t-il fait de sa souveraineté? Sous le coup des désastres causés par la Révolution et de la panique suscitée par le socialisme, le nombre souverain a nommé, aussitôt la constitution faite, une assemblée législative réactionnaire et royaliste, et un président dont les titres les plus notables [63] à sa confiance étaient les échauffourées de Strasbourg et de Boulogne. Qu'a fait cette Assemblée issue du suffrage universel? Elle s'est empressée, on sait avec quel entrain, de le mutiler par la loi du 31 mai 1850, en transformant ainsi la république démocratique dont elle avait reçu le dépôt en une oligarchie appuyée sur un corps électoral épuré de ses éléments populaires. Sans doute, l'épuration n'était pas complète, mais la loi du 31 mai n'était qu'un premier pas. Seulement, ce fut le président qui se chargea de faire le second, en substituant à cette ébauche informe d'une république oligarchique, le césarisme. Cette substitution, nul n'ignore qu'elle s'opéra avec l'assentiment tacite des masses, nous pourrions dire même à leur satisfaction, car les masses ont de tout temps préféré un seul César à un troupeau de Césars, et peut-être n'ont-elles pas tort. — Eh bien, n'y a-t-il pas apparence que ce qui s'est passé alors pourrait bien se renouveler aujourd'hui? Sous le coup de la réaction provoquée par la dictature malheureuse de M. Gambetta, le nombre souverain a nommé une Assemblée, en majorité, réactionnaire et royaliste. Cette assemblée à son tour a délégué le pouvoir exécutif à un homme qu'elle croyait animé de ses passions et de son esprit, au plus éminent des monarchistes constitutionnels, M. Thiers. Si elle s'est trompée en ce point, ce n'est pas sa faute, [64] car elle n'avait, Dieu merci! aucune envie de donner un Washington à la France. Si elle pouvait le remplacer, aujourd'hui ne choisirait-elle pas un Monk plutôt qu'un Washington? En attendant que les circonstances lui permettent de faire un roi, quel dessein favori caresse cette Assemblée ? N'est-ce pas encore une fois de substituer l'oligarchie à la démocratie, en mutilant par une nouvelle loi du 31 mai le suffrage universel? Et qu'adviendrait-il si elle réussissait dans ce dessein? Ne frayerait-elle pas de nouveau la route à un César quelconque, qui s'emparerait du pouvoir avec l'assentiment et peut-être avec le concours actif de la démocratie dépossédée ? L'expérience qui s'est faite après 1848 et celle qui est en train de se faire aujourd'hui, ne nous montrent-elles pas, d'une façon assez claire, que ni la République démocratique de 1848, ni la République oligarchique de 1850 ne sont possibles en France, Celle-là mène à celle-ci et celle-ci mène au césarisme.
Si l'on veut constituer une « république possible, » il faut prendre un autre point de départ et suivre une autre voie. Il faut tâcher d'oublier les principes abstraits et, en premier lieu, le principe de la « souveraineté du nombre, » et fonder un édifice politique à la manière anglaise ou américaine, en se préoccupant avant tout de sa destination et des règles que [65] l'expérience a consacrées en matière d'architecture politique.
Essayons d'appliquer ces règles, examinons comment la république devrait être constituée en France pour satisfaire aux conditions d'un bon gouvernement.
Toutefois, à moins d'écrire un traité complet sur la matière, nous sommes obligés de considérer comme démontrées ces deux vérités d'expérience, savoir qu'une République, comme tout gouvernement, doit se fonder, en premier lieu, sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, en second lieu, sur la dualité du pouvoir législatif et l'unité du pouvoir exécutif. Ces deux vérités élémentaires admises, il ne s'agit plus que d'étudier le mode de nomination, le rôle et les attributions des deux chambres et du chef du Pouvoir exécutif, ainsi que les relations de ces différents pouvoirs.
I. La première chambre ou chambre haute. — Pour répondre au but spécial de son institution qui serait de garantir la sécurité des intérêts et la direction intelligente dés affaires publiques, la chambre haute devrait naturellement être la représentation de la classe qui possède avec la capacité politique la portion la plus considérable du capital de la nation. Mais cette classe où est-elle? comment la reconnaître et la délimiter? [66] On ne peut, cela est évident, résoudre cette question avec une précision mathématique. Comme dans toutes les questions qui appartiennent au domaine des sciences positives, il faut consulter l'observation et l'expérience, et se contenter de la solution approximative qu'elles peuvent fournir. Or, l'expérience a déjà prononcé en cette matière. L'expérience a démontré qu'aux époques où le pouvoir législatif était issu en France d'une classe limitée par un cens de 300 francs sous la Restauration, de 200 francs sous la monarchie de Juillet, la capacité politique et la propriété s'y trouvaient représentées d'une manière suffisante. Ce qui le prouve, c'est qu'à ces époques, les deux premiers besoins de toute société, la sécurité extérieure et intérieure, étaient amplement satisfaits. La France était respectée et honorée au dehors, tout en conservant le plus précieux des biens : la paix ; au dedans, la sécurité des intérêts était entière, le crédit florissant : en 1846, la rente 5 p. 100 s'élevait au taux de 125 francs, qu'elle n'a plus atteint depuis, même aux jours les plus prospères de la dictature impériale. Cette expérience n'est-elle pas concluante? La sagesse ne commande-t-elle pas à la République d'en faire son profit, en empruntant, au moins comme l'un de ses éléments constitutifs, une institution qui a permis à la monarchie de subsister pendant trente-quatre ans? [67] Supposons qu'elle adopte, pour la formation de la première chambre, le cens en vigueur sous la monarchie de Juillet, supposons d'un autre côté que cette fraction du pouvoir législatif se trouve investie d'attributions et de pouvoirs tels que la gestion des affaires publiques soit en réalité entre ses mains, et, en tout cas, qu'aucune loi, aucune mesure législative ne puisse être préparée et mise en vigueur sans sa participation, n'est-il pas certain que la République offrira des garanties de capacité et de sécurité au moins égales à celles que possédait la monarchie ? Sans doute, un corps électoral limité par un cens de 200 francs ne contiendrait pas toute la capacité politique de la nation, il ne contiendrait pas non plus tout le capital national, mais il renfermerait, sauf de bien rares exceptions, l'aristocratie des capacités ; il renfermerait la plus grande partie des familles vouées à la politique, à l'administration, aux fonctions de la magistrature et aux autres services publics ; il renfermerait la majorité des intelligences d'élite qui forment l'état-major de la science, des arts, des professions libérales, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ; il renfermerait enfin toute la grande et la moyenne propriété. Ne serait-ce pas tout ce qu'il faudrait pour procurer la sécurité aux intérêts, une direction intelligente et expérimentée aux affaires publiques? [68] D'ailleurs, s'il existait en dehors du corps électoral de la première chambre des capacités politiques éminentes, rien n'empêcherait les électeurs de mettre leurs lumières et leur expérience à profit, en les élisant. Dans l'hypothèse de la formation de la première chambre par un corps de censitaires, un cens ou des conditions quelconques d'éligibilité seraient complétement superflues — elles seraient même nuisibles en limitant le choix utile des électeurs, — car il ne serait guère probable qu'un démagogue, un partageux, fût-il un génie politique de premier ordre, obtînt les suffrages d'électeurs censitaires à 200 francs et au-dessus. Toutes les capacités dignes de ce nom pourraient donc arriver à la première chambre, tandis que la propriété trouverait dans la constitution de cette chambre toutes les garanties de sécurité désirables.
La chambre haute ainsi constituée, quels devraient être son rôle et ses attributions? Représentation des classes les plus capables et les plus intéressées à la bonne gestion des affaires publiques, elle devrait être à l'exemple des sénats des anciennes républiques, et dans une certaine mesure, du sénat des Etats-Unis la « chambre de gouvernement, » sauf à subir le contrôle de la seconde chambre. C'est à elle que reviendrait d'abord l'examen des budgets et des projets de loi de toute sorte, c'est à elle qu'appartiendrait le droit [69] d'approuver ou de censurer les actes du pouvoir exécutif, représenté devant elle par un ministère responsable. Après avoir discuté et adopté les budgets et les projets de loi qui lui seraient soumis, elle en assumerait la responsabilité et se chargerait de les présenter à la ratification de la seconde chambre, en déléguant cette mission aux rapporteurs de ses commissions ou à des commissaires spéciaux. Bref, la première chambre occuperait effectivement le premier rôle dans la constitution républicaine, au lieu d'être réduite, comme la plupart des chambres hautes des monarchies constitutionnelles, au rôle de comparse. Ce ne serait pas trop de trois cents membres pour suffire aux attributions importantes et diverses dont elle serait chargée. Ajoutons que ce personnel investi de la gestion et de la responsabilité des affaires devrait posséder une certaine stabilité, sans être voué cependant à l'immobilité. On pourrait appliquer à la première chambre le système du renouvellement partiel, usité aux États-Unis pour le sénat, et la renouveler par tiers tous les trois ans, ce qui porterait à neuf ans la durée du mandat d'un membre de la chambre haute.
II. La seconde chambre. — On peut admettre qu'une nation accorde, ou abandonne à une classe plus ou moins nombreuse le droit de la gouverner, si l'expérience lui a prouvé qu'elle ne possède point [70] elle-même, dans son ensemble, la capacité requise pour s'acquitter de cette tâche ardue, si cette même expérience lui a démontré encore qu'elle renferme dans son sein des classes politiquement dangereuses, que leur ignorance, les doctrines pernicieuses dont elles sont infectées, doivent faire écarter à tout prix de la direction des affaires. C'est pourquoi la constitution d'un pays légal investi d'une sorte de gérance politique peut être une nécessité. Mais ce qu'on ne saurait admettre, c'est qu'un peuple s'abandonne complétement à la discrétion de la classe gouvernante ou dirigeante, sans se réserver aucune garantie, aucun recours contre l'abus qu'elle peut faire de sa situation, abus inhérent, hélas ! à la nature humaine et qui se produit invariablement chaque fois qu'un pouvoir quelconque est attribué sans contre-poids à un homme ou, pis encore, à une classe d'hommes. Voilà pourquoi, n'en déplaise aux doctrinaires du régime constitutionnel, une nation considérée dans son ensemble ne peut se désintéresser complétement de ses affaires, si peu capable qu'elle soit d'intervenir dans leur gestion ; voilà pourquoi elle doit se réserver le droit d'empêcher la classe dirigeante d'abuser du pouvoir dont elle l'a investie et des ressources qu'elle met à sa disposition. Elle ne peut, en aucun cas, se dessaisir du droit de voter les budgets et de participer à la confection [71] ou à la réforme des lois sous lesquelles elle est appelée à vivre. C'est là un contre-poids indispensable aux pouvoirs spéciaux accordés à la classe dirigeante. En absence de ce contre-poids, tout gouvernement devient un monopole, monopole d'autant plus oppressif et plus insupportable qu'il est exercé par une classe plus puissante et plus nombreuse.
Ce contre-poids trouve sa place naturelle dans une seconde chambre issue de la totalité de la nation et chargée de contrôler la gestion de la première. Comment devrait-elle être constituée pour représenter la généralité des intérêts nationaux, sans qu'aucun de ces intérêts pût être sacrifié? Elle devrait avoir pour base le suffrage universel, dans son acception la plus large, c'est-à-dire entendu de telle façon que la majorité politique coïncidât avec la majorité civile, ou, si l'on veut encore, que le droit de participer à la gestion des affaires publiques, considérées justement comme une portion intégrante des affaires privées de chacun des membres de la nation, fût rangé parmi les droits civils ; d'où cette conséquence que l'exercice des droits politiques devrait être subordonné aux mêmes conditions que celui des droits civils, ni plus, ni moins. Conçoit-on, par exemple, qu'une condition de domicile soit exigée de l'électeur quand il s'agit de la représentation nationale? Tout citoyen, qu'il soit sédentaire, [72] ou obligé par les nécessités de sa profession à mener une existence plus ou moins nomade, n'est-il pas intéressé à la bonne gestion des affaires de la communauté? Ne serait-il pas souverainement inique d'exproprier de leur droit électoral, sans aucune indemnité ni compensation, des Français établis en France, et contribuant pour leur part aux charges publiques, — ce qui leur confère un droit indiscutable d'intervenir dans l'emploi de leur part contributive, — sous le prétexte ridicule qu'ils ont cessé d'habiter le lieu de leur naissance? Tout déplacement, tout changement de domicile serait donc considéré comme une preuve d'immoralité et d'incapacité politique? Est-il rien de plus contraire au droit et à la raison? A ce compte, l'huître attachée à son rocher ne serait-elle pas le plus parfait des électeurs? Nous concevons toutefois que l'on songe à recourir à cet expédient, si peu justifiable qu'il soit, quand tout l'édifice politique repose sur le suffrage universel. C'est un moyen comme un autre d'éliminer du corps électoral une partie de la classe réputée dangereuse, et de retarder l'avénement de la démagogie en attendant que les circonstances permettent de recourir à un procédé plus efficace ; mais cette raison de salut public pourrait-elle encore être invoquée sous un régime où la capacité et la propriété entreraient en partage [73] de pouvoirs avec le nombre? Sous un tel régime, il n'y aurait aucune raison de mutiler le suffrage universel. On pourrait établir même que toute confiscation partielle du droit électoral serait aussi nuisible qu'injuste. Ce ne serait pas trop, en effet, pour la seconde chambre, d'être la représentation de la nation tout entière, si l'on voulait qu'elle fit réellement contre-poids à la première, en possession d'une influence prépondante, grâce à sa composition et à ses attributions. Enfin cette classe de citoyens expropriés de leur droit électoral, dont les intérêts ne seraient plus représentés, ce qui est synonyme de n'être plus défendus, cette classe de parias politiques ne formerait-elle pas une pépinière naturelle de mécontents et de recrues pour l'armée de la révolution ?
La seconde chambre devrait donc être élue par le suffrage universel, sans restriction aucune. Quels seraient son rôle et ses attributions? Elle n'aurait point à intervenir dans le gouvernement proprement dit et par conséquent point de relations directes avec le pouvoir exécutif : ce serait là le rôle de la première chambre. Mais en sa qualité de représentation de la généralité des contribuables, c'est à elle que reviendrait le droit essentiel de « consentir l'impôt, » impliquant le droit d'examiner, de discuter, d'approuver, de modifier ou de rejeter les budgets des recettes [74] et des dépenses ; elle devrait encore être investie du droit non moins essentiel de « consentir la loi, » impliquant le droit d'accepter ou de refuser toute modification du régime légal sous lequel tous les Français sont appelés à vivre.
Ce rôle et ces attributions d'une seconde chambre ne sont pas seulement fondés en droit, ils ont encore une raison d'être pratique, dont il est aisé de se rendre compte. La classe dirigeante a partout et toujours, l'expérience de tous les peuples est là pour l'attester, une tendance naturelle à augmenter ses attributions, à multiplier les emplois qui lui sont ouverts et à accroître ainsi, incessamment, le fardeau des charges publiques. Comment en serait-il autrement ? La classe dirigeante ne prend-elle pas toujours et nécessairement dans le budget une part supérieure à sa propre contribution? Une autre tendance de la classe dirigeante, c'est d'augmenter incessamment aussi ses pouvoirs aux dépens de la liberté générale. Cela étant, n'importe-t-il pas qu'un frein soit opposé à ces deux tendances corruptrices, et, ce frein n'est-ce pas dans une chambre issue de la généralité des citoyens que se trouve sa place naturelle? Tandis que la mission particulière de la première chambre serait de garantir la stabilité du gouvernement et la sécurité des intérêts, le rôle de la seconde chambre consisterait [75] plutôt à défendre la bourse des contribuables et les libertés publiques.
De là, à la vérité, entre les deux chambres un état naturel d'opposition, analogue à celui qui existe entre le producteur et le consommateur, le vendeur et l'acheteur, le contrôlé et le contrôleur. Cette situation aurait ses difficultés et ses périls : il s'agirait d'aplanir les unes et de prévenir les autres. Comment les choses se passeraient-elles? Deux cas pourraient se présenter : ou la seconde chambre ratifierait, sans modifications, les budgets et les autres projets de lois adoptés par la première, et dans ce cas aucune difficulté ne surgirait : budgets et projets de lois de toute nature seraient renvoyés après leur adoption à la première chambre, qui les transmettrait au pouvoir exécutif, chargé de les promulguer, ou bien ils seraient amendés ou même rejetés par la seconde chambre. Dans ce cas, la première aurait à examiner de concert avec le pouvoir exécutif, s'il y a lieu ou non, dans l'intérêt public, d'accepter ces amendements ou ce rejet. Si des concessions mutuelles ne parvenaient pas à résoudre le différend, le gouvernement et la chambre gouvernante devraient être autorisés à en appeler au pays. Le Président de la République serait armé du pouvoir de dissoudre la seconde chambre, avec l'assentiment de la première. L'expérience atteste que les gouvernements [76] n'abusent pas volontiers du droit de dissolution, car une dissolution, c'est une crise, et les gouvernements, qu'ils soient républicains ou monarchiques, n'ont pas intérêt à multiplier les crises. Ce serait la ressource dernière, l'ancre de salut, dans le cas d'ailleurs peu probable où la démagogie bannie de la première chambre parviendrait à se rendre maîtresse de la seconde. La classe dirigeante pourrait néanmoins, il faut bien en convenir, faire abus de ce droit et affaiblir ainsi, sinon paralyser le contrôle de la nation, mais entre deux maux il convient de choisir le moindre. Mieux vaut s'exposer à rendre le contrôle difficile qu'à rendre le gouvernement impossible. Reste enfin l'opinion publique, qui finit toujours par donner raison à qui a raison, et qui remédie ainsi à l'imperfection inévitable des mécanismes politiques.
III. Le pouvoir exécutif. — Il est clair que toutes les garanties de sécurité résultant de l'institution d'une première chambre pourraient être affaiblies ou compromises, si cette chambre n'intervenait pas efficacement dans le choix du chef du pouvoir exécutif. Cependant pourrait-elle y intervenir seule? Serait-il admissible que toute la nation contribuât à la formation du pouvoir législatif et qu'une partie de la nation seulement fût appelée à choisir, par ses délégués, le chef du pouvoir exécutif ? Serait-ce logique? Enfin, en abandonnant [77] exclusivement à la première chambre la nomination du chef de l'État ne s'exposerait-on pas à la voir devenir un foyer de corruption et de népotisme? On éviterait ces inconvénients et ces abus, tout en assurant l'accord nécessaire du pouvoir exécutif avec la chambre haute, si le Président de la République était nommé par la seconde chambre sur une liste de trois candidats proposés par la première. On aurait ainsi toute garantie que la première fonction de l'État ne pourrait tomber entre les mains d'un démagogue ou d'un socialiste, puisque le Président de la République serait désigné par la représentation du corps des censitaires. On serait assuré en même temps que cette fonction si importante dans un pays centralisé, où les fonctionnaires se comptent par centaines de mille, ne deviendrait point la proie de quelque ambitieux, habile à se créer un parti dans la première chambre pour monter au pouvoir et s'y perpétuer, puisque le choix définitif appartiendrait à la seconde chambre. On pourrait nommer le Président de la République pour quatre ans comme aux États-Unis en le rendant indéfiniment rééligible. Comme aux États-Unis encore, et conformément au principe de la séparation des pouvoirs, ses attributions seraient purement exécutives.
[79]
VI. Conclusion. — Raison d'être de la République tempérée
Ce serait en vain que l'on proclamerait la République définitive, si on ne lui donnait point une constitution capable de la faire durer. Cette constitution viable, réussira-t-on à la faire? Il est malheureusement encore permis d'en douter. La République a déjà fourni à la France un bon nombre de constitutions, mais les unes n'ont pas même été pratiquées et les autres n'ont guère tardé à être reconnues impraticables. Ajoutons que ces expériences avortées, ces écoles sont demeurées à peu près comme non avenues. Les républicains de toute nuance continuent volontiers à croire qu'il suffit de donner à la constitution destinée à régir la France une étiquette démocratique et d'inscrire à [80] son préambule, en style lapidaire, la série des droits qu'elle garantit, y compris même « le droit d'aller et venir, » pour la rendre possible. Il n'était peut-être pas inutile de réagir contre celte illusion et de montrer à quelles conditions une constitution républicaine peut répondre à sa destination, qui est de garantir l'ordre avec la liberté; à quelles conditions, par conséquent, elle peut vivre et faire vivre la République. C'est pourquoi nous avons esquissé l'ébauche d'une constitution remplissant ces conditions révélées par l'observation et l'expérience, sans nous dissimuler tout ce que cette ébauche a d'imparfait. Mais le but que nous nous sommes proposé n'en serait pas moins atteint si nous avions réussi à éveiller l'attention des esprits sur les difficultés particulières et techniques du problème à résoudre ; si nous avions réussi à faire comprendre qu'une constitution est un mécanisme comme un autre, et qu'on ne peut construire ce mécanisme à moins d'avoir quelques notions positives sur la destination à laquelle il doit être appliqué et sur les règles qu'il faut suivre pour l'y approprier. En dernière analyse, c'est là le point essentiel. Si la constitution qu'il s'agit de donner à la République ne fonctionne point de manière à procurer à tous les intérêts la sécurité, dont ils ne peuvent point se passer, tout en garantissant les " libertés nécessaires, » elle [81] périra, et la République avec elle. Car ce n'est pas, quoi qu'on en dise, en dehors des gouvernements qu'il faut chercher les causes de leur chute. Ils ne peuvent durer qu'à la condition d'être appropriés aux besoins qu'ils ont à satisfaire, adaptés aux services qu'ils sont destinés à rendre.
Cela dit pour justifier l'incursion que nous nous sommes permis de faire dans le domaine des législateurs ou des constituants à mandat, examinons si la constitution dont nous venons d'esquisser les linéaments répondrait à sa destination, si elle serait capable de garantir la sécurité des intérêts avec les libertés nécessaires.
La pièce principale de ce mécanisme serait la première chambre issue d'un corps de censitaires, et particulièrement destinée à servir de sauvegarde à la propriété. Cette chambre posséderait-elle l'autorité nécessaire pour remplir ce rôle ?
On prétend, nous ne l'ignorons pas, qu'une chambre haute émanée du suffrage restreint demeurerait sans autorité en présence d'une seconde chambre nommée par le suffrage universel ; on soutient même d'une manière générale que les chambres hautes, à l'exception de la chambre des lords et du sénat américain, jouent aujourd'hui un rôle secondaire, et qu'on pourrait à la rigueur les supprimer comme des rouages inutiles ; [82] mais est-il besoin de faire remarquer que l'autorité d'une chambre dépend avant tout de l'importance des intérêts qu'elle représente et de l'étendue de ses prérogatives, quels que soient d'ailleurs son mode de formation et le rang qui lui est assigné? Si, comme le sénat belge, elle représente le même corps électoral que la seconde chambre, et si elle est chargée de la même besogne, pourra-t-elle être autre chose qu'une doublure? Si elle est nommée par un roi ou un empereur, comme la chambre des pairs de la monarchie de Juillet ou le sénat de l'empire, et ne représente que l'intérêt dynastique, aura-t-elle dans le pays d'autres racines que celles de la dynastie elle-même? De plus, comme elle lui empruntera toute sa force, elle ne pourra évidemment lui en prêter aucune, elle sera une non-valeur politique. Si, au contraire, comme la chambre des lords, elle est la représentation d'une classe puissante par la richesse et l'influence unies à la capacité politique, elle sera puissante et influente, quand même elle ne procéderait pas de l'élection et se trouverait en présence d'une chambre élective. Or, si l'on songe qu'un corps de censitaires limité à 200 fr. contiendrait toute la grande et la moyenne propriété avec la plus grande partie de la capacité politique du pays, on demeurera convaincu que la chambre qui en serait la représentation jouirait d'une autorité égale [83] sinon supérieure à celle que la chambre des lords a possédée dans ses plus beaux jours. Objectera-t-on encore — et cette objection serait peut-être irrésistible si elle était fondée — que cette représentation spécialement accordée à une classe constituerait un privilège, qu'il serait contraire à la justice et à l'égalité de conférer à un corps de censitaires un double droit électoral ? Mais s'il est vrai que la propriété doive être comptée comme un élément de représentation aussi bien que le nombre, s'il est vrai que le droit électoral dans une société politique soit proportionnel et non point égalitaire, cette objection ne tombe-t-elle pas d'elle-même? [1]
[84]
La première chambre serait la forteresse des intérêts conservateurs ; cependant tout en leur assurant [85] la sécurité qui leur est indispensable, elle ne pourrait plus leur attribuer le monopole illimité dont ils étaient pourvus sous la monarchie constitutionnelle. [86] Le contre-poids de ce monopole se trouverait dans la seconde chambre, tenant, comme la chambre des communes en Angleterre, les cordons de la bourse, et ayant sa juste part dans le pouvoir législatif. La sécurité des petits intérêts se trouverait par là même garantie comme celle des grands. Enfin, cette organisation constitutionnelle n'assurerait-elle point, cette fois d'une manière stable et régulière « les libertés nécessaires ? » Si le gouvernement était, par la constitution de la première chambre, irrévocablement fixé dans cette région supérieure et moyenne de la nation où se trouve concentrée la capacité politique, où, d'une autre part, on trouve aussi réunies les garanties les plus complètes de la propriété, si l'on ne pouvait plus craindre que « la souveraineté du nombre » fît tomber quelque jour le gouvernement entre les mains d'une classe politiquement et socialement dangereuse, aussitôt les libertés politiques, la liberté électorale, la liberté parlementaire, la liberté de la presse, des associations et des réunions, perdraient tout caractère de « nuisance » pour n'être plus que d'utiles instruments de contrôle et de réforme. Désormais à l'abri de leurs erreurs et de leurs excès, les intérêts dont elles ont jusqu'à présent menacé la sécurité ne seraient plus dans la nécessité de se protéger contre elles par la dictature ou l'état de [87] siége. Il resterait sans doute toujours aux ennemis de l'ordre social la ressource de recourir aux moyens révolutionnaires; mais un gouvernement solidement fixé dans la classe qui réunit au plus haut degré la richesse et la capacité politique, préservé d'un autre côté des abus et de la corruption du monopole par l'intervention et le contrôle de la masse de la nation représentée dans la seconde chambre et pourvue des « libertés nécessaires, » ce gouvernement à la fois conservateur et libéral ne pourrait-il pas mieux qu'une dictature ou une monarchie appuyée exclusivement sur un pays légal de censitaires défier les tentatives révolutionnaires, surtout s'il évitait prudemment de placer son siége au foyer même des révolutions?
Ainsi constituée, la République ne serait ni démocratique, ni oligarchique, dans le sens absolu attaché à ces deux mots. Ce serait une république de compromis comme l'a été, à son origine, la monarchie constitutionnelle. La puissance politique avait été jusqu'à l'avénement de cette nouvelle forme de gouvernement entre les mains de l'aristocratie. Il s'agissait pour les classes moyennes d'entrer en partage de pouvoir avec elle : que fit-on ? On partagea la puissance législative entre deux chambres représentant l'une les intérêts de l'ancienne couche politique, l'autre les intérêts de la nouvelle et l'on constitua ainsi la [88] « monarchie tempérée. » Aujourd'hui l'aristocratie et la bourgeoisie ne forment plus qu'une seule classe politique et sociale, en présence des masses populaires, qui ont fait à leur tour invasion dans l'Etat. On conçoit que les premières ne veulent point se laisser déposséder par ces nouvelles « couches sociales » numériquement plus fortes et auxquelles la « souveraineté du nombre » finirait inévitablement par livrer la puissance politique; cependant il faut bien qu'elles se résignent à faire sa part à la démocratie. La lutte est engagée depuis l'avénement du suffrage universel et cette lutte se poursuivra selon toute apparence avec des alternatives violentes d'action révolutionnaire et de réaction conservatrice jusqu'à ce que la paix se fasse, comme elle se fait toujours, comme elle s'est faite entre l'aristocratie et la bourgeoisie, par un compromis. Si la République s'établit en France, elle ne sera ni démocratique, ni oligarchique. Ce sera une république de compromis, une république tempérée.
P. S. Quelques jours avant sa chute, le gouvernement de M. Thiers a déposé (dans les séances des 19 et 20 mai) le projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics et le projet de loi électorale. On peut le féliciter d'avoir adopté le système des deux chambres et repoussé l'élection du président [89] par le suffrage universel direct ; sur ces deux points la constitution proposée est évidemment supérieure à la constitution de 1848, mais pour le reste, elle laisse singulièrement à désirer. — En enlevant, par exemple, le droit de voter à tous les électeurs qui ne peuvent justifier de deux années de domicile on crée une classe nombreuse de mécontents, sans protéger, avec une efficacité certaine, la propriété contre le nombre. Le seul préservatif assuré contre les dangers inhérents au suffrage universel réside dans la création d'une chambre haute représentant franchement la propriété et largement accessible à la capacité politique. Cette chambre, on la crée, mais… c'est le suffrage universel que l'on charge de la composer. À la vérité, c'est le suffrage universel mis au piquet et obligé à limiter ses choix dans un cercle aussi restreint que possible. C'est tout au plus si l'on comptera deux ou trois mille éligibles, pris les uns parmi les anciens députés et les membres de l'Institut, les autres parmi les hauts fonctionnaires, anciens ou nouveaux. Seulement, on ne paraît pas se douter qu'il y a parmi les anciens députés un bon nombre de radicaux et que si le radicalisme venait à se rendre maître des élections il y eu aurait de plus en plus. Pourquoi donc le suffrage universel ne les ferait-il pas sénateurs après les avoir faits députés, et à quoi servirait alors la première chambre? quel frein opposerait-elle au radicalisme s'il plaisait au suffrage universel de la remplir de radicaux ? Conçoit-on d'ailleurs une chambre particulièrement chargée de sauvegarder les intérêts de la propriété et du capital mis en péril par la souveraineté du nombre, de laquelle seraient exclus les propriétaires, les chefs d'industrie, les négociants, les financiers, — à moins qu'ils n'eussent en même temps l'avantage d'être anciens députés, fonctionnaires ou membres de l'Institut? Conçoit-on encore une chambre qui pourrait se composer mi-partie de radicaux, mi-partie de hauts fonctionnaires, d'amiraux, d'évêques, d'archevêques ou de [90] cardinaux? Conçoit-on enfin une chambre destinée à empêcher l'invasion du communisme et dans laquelle le département du Nord ou de la Seine ne serait pas plus représenté que les Basses-Alpes? De quelle autorité pourrait-elle jouir? Ce n'était pas évidemment à des conditions d'éligibilité, c'était à des conditions d'électorat qu'il fallait recourir pour composer une première chambre capable de représenter les intérêts conservateurs, d'opposer un rempart solide à la démagogie, et d'assurer ainsi l'existence de la République. Au surplus, est-ce bien de constituer la République qu'il s'agit en ce moment? Savons-nous si elle existera encore demain?…
Endnotes
[1] Il y a, disions-nous dans une conférence sur le suffrage universel, deux sortes de représentation : celle qui ne tient compte que du nombre et celle qui se règle sur la valeur des intérêts représentés ; l'une est égalitaire, l'autre est proportionnelle.
… Pour rendre bien clairement ce qu'il faut entendre par cette expression : Suffrage proportionnel, je citerai comme exemple la manière dont le suffrage est établi dans une société industrielle, commerciale ou financière convenablement organisée. Tout actionnaire a droit d'intervenir dans les assemblées générales ; il y a suffrage universel, mais chacun possède autant de voix qu'il a d'actions, en sorte que tous les intérêts y sont représentés en raison de leur valeur.
Eh bien, je le dis que même principe est applicable à la société politique. Nous contribuons tous, en effet, à l'entretien du gouvernement, nous sommes tous responsables des dettes qu'il peut contracter ; mais nos contributions ne sont pas égales, et les égalitaires les plus fervents eux-mêmes ne demandent pas qu'elles le soient ; notre responsabilité, en ce qui concerne les dettes, n'est pas égale non plus : contribution et responsabilité sont proportionnelles au montant de notre avoir, ou du moins sont censées l'être; d'où je conclus que notre droit d'intervenir dans la gestion des affaires publiques doit être, non pas égal, mais proportionnel au montant de notre mise, ou, ce qui revient au même, au montant de notre quote-part dans l'avoir social.
Voilà le principe. On ne manquera pas certainement d'élever contre ce principe des objections de toute nature; en laissant même de côté celles des théoriciens politiques, les hommes pratiques diront qu'il est inapplicable, parce qu'on ne peut savoir quelle est la contribution payée par chacun à cause de la complication des impôts directs et indirects et des impôts en nature ou en services ; qu'il faudrait pour le rendre applicable établir un impôt direct et unique, puis, cet impôt direct et unique établi, attribuer à chacun une voix proportionnée à la valeur de la contribution fournie, double impossibilité, double chimère ! A cela je pourrais répondre à mon tour que la tendance actuelle, au moins en théorie, est de simplifier le mécanisme de l'impôt et d'arriver à l'impôt direct et unique, perçu à la manière d'une prime d'assurance; je pourrais répondre aussi qu'en Angleterre, par exemple, on a adopté pour l'administration de la taxe des pauvres, le principe de la proportionnalité du suffrage, en raison du montant de l'impôt payé [Footnote within footnote], mais il y a une réponse beaucoup plus simple et plus pratique à faire, c'est qu'il faut avant tout, poser le principe, sans avoir la prétention de l'appliquer immédiatement, dans toute sa rigueur. C'est l'a ce qu'on a fait pour l'impôt. On a posé en principe que l'impôt doit être proportionnel aux facultés des contribuables; mais combien on est éloigné encore dans la pratique de l'application de ce principe ! C'est un simple idéal, mais il n'est pas moins bon que cet idéal existe, et qu'on soit convaincu qu'il est juste et qu'il est utile d'en approcher autant que possible. J'en dirai autant du principe de la proportionnalité en matière de suffrage, et j'ajouterai que si l'on ne peut pas espérer de l'appliquer d'une manière rigoureuse, mathématique, dans l'état actuel des choses, on peut du moins en approcher.
Pour ne citer qu'une simple preuve, mais une preuve concluante de l'applicabilité du suffrage proportionnel, je ferai remarquer qu'il est appliqué, quoique sur une base incomplète et fausse, dans la plupart des pays constitutionnels, notamment en Belgique. Il y a en Belgique, au-dessus de la masse dont les intérêts ne sont pas représentés, 103,000 électeurs payant un cens de fr. 42.52, mais ce serait commettre une erreur grave que de croire que ces électeurs possèdent tous un droit égal. Non ! il y en a un peu plus de 102,000 qui ont droit seulement à une représentation simple, il y en a environ 1,000 qui ont droit à une représentation double. Ces 1,000 sont les grands propriétaires payant 2,116 fr. 40 c. de contributions directes, avec adjonction de la liste des plus imposés à raison d'un sur 6,000 habitants, qui ont seuls, en vertu du cens d'éligibilité, le droit de fournir des sénateurs ; il est clair que ce millier, ou pour prendre le chiffre exact, ces 855 grands propriétaires parmi lesquels se recrute le sénat', sont plus représentés que les 102,000 autres censitaires, moyens ou petits propriétaires, puisqu'ils possèdent deux chambres au lieu d'une. C'est un privilége dans le privilége.
Voilà une application détournée du principe de la proportionnalité; application qui pèche même par excès, car elle donne en réalité une représentation en raison progressive : les petits intérêts ont 0, les moyens 1, les grands 2. La proportionnalité n'est donc pas une utopie, puisqu'on va même au delà, on va jusqu'à la représentation des intérêts en raison géométrique. On pourrait proposer certainement, pour corriger ce que cette progression a d'excessif, l'établissement d'une chambre du peuple, faisant contre-poids au Sénat de la grande propriété. Cela ne serait guère plus étrange que l'état actuel des choses et ce serait plus équitable. (Conférence sur le Suffrage universel, faite à Verviers le 25 février 1866.)
FN within FN: Tout contribuable de l'Union des paroisses qui a été imposé à la dernière taxe pour les biens situés dans l'Union, a le droit de voter pour l'élection des maîtres des pauvres. — Chaque contribuable occupant ou propriétaire de terre ou de dîmes, a une voix si le bien est d'un revenu de 20 livres; il a deux voix si le revenu est de 20 à 50 livres et ainsi de suite jusqu'au maximum de six voix pour un revenu de 200 livres et au-dessus. (Institutions et taxes locales du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par MM. Fisco et J. Van der Straeten, page 546.)
PART VI. MOLINARI’S GRADUAL RETREAT FROM STRICT ANARCHO-CAPITALISM (1880–1908)↩
VI.12. "Le régime de la grande industrie et de la concurrence universalisées" (1880)↩
Source
From L'Évolution économique du dix-neuvième siècle. Théorie du progrès (Paris: C. Reinwald 1880). "Conclusion," pp. 439-69.
This book originally appeared as series of articles in the JDE:
- "L’évolution économique du XIXe siècle," Journal des économistes, S. 3, T. 45, N° 133, janvier 1877 ;
- 2e article, S. 3, T. 46, N° 136, avril 1877 ;
- 3e article, S. 3, T. 48, N° 142, octobre 1877 ;
- 4e article, S. 4, T. 1, N° 1, janvier 1878 ;
- 5e économiste, S. 4, T. 2, N° 6, juin 1878 ;
- 6e article, S. 4, T. 5, N° 13, janvier 1879 ;
- 7e article, S. 4, T. 6, N° 18, juin 1879.
Introduction
Just before and just after he took over as editor of the JDE in 1881 Molinari wrote a pair of books on political and economic sociology around the theme of the "evolution" and "progress" towards a fully free society.These two volumes constitute a magnum opus of nearly 1,000 pages which were written as a series of articles in the JDE between January 1877 and June 1879; and then between August 1881 and December 1883. The first volume dealt with economic evolution and the second volume with political evolution. (It should be noted that Molinari would write two more books on the theme of the evolution of society, La Grandeur et decadence de la guerre (1898) and Économie de l’histoire. Théorie de l’évolution (1908), thus making his magnum opus a tetralogy.)
It is interesting to note that Molinari was not alone in writing such a broad and sweeping survey of humankind’s economic, political, and social development over a span of hundreds perhaps even thousands of years. Herbert Spencer was doing much the same thing in England with his multi-volume works on evolution, especially his Principles of Sociology which began to appear in 1874 and which were not completed until 1896 (a French translation began to appear in 1878). [12] And Karl Marx had begun to do something very similar in his unfinished work Das Kapital the first volume of which had appeared in 1859 and subsequent volumes posthumously.
Molinari’s basic idea in these works was that societies have evolved through a series of three stages (or "l’ère" (eras)) based upon how they went about creating wealth: "l’ère des temps primitifs" (the era of primitive hunting and gathering), "l’ère de la petite industrie" (the era of small-scale industry), and "l’ère de la grande industrie" (the era of large-scale industry). Each of these eras had their own political and economic organisations which matched the underlying "means of production" (to use a term coined by Marx but which also fits Molinari’s way of thinking as well). Thus, in the "l’ère des temps primitifs" we have a political system based upon the tribe "le régime de la tribu primitive" and economic production based upon communal agriculture "la communauté agricole" and where there is little or no trade with other groups. In the second era, "l’ère de la petite industrie" there is the beginning of the division of labour and trade with others but this trade is very limited and does not extend very far, domestic industry is the monopoly of state protected "corporations" who are able to exclude competitors from entering the business, and weaker members of society are controlled by various forms of servitude and tutelage ("la tutelle"). In this era the monopoly form of government (whether oligarchical or monarchical) matched the economic policy of monopolized industries run by a small group of government owned or favored private interests. However, as markets developed and new ones opened up, as individuals began to specialize in different trades and occupations, as education spread, as "la petite industrie" began to be replaced by more competitive "la grande industrie," and as the inefficiencies of the old monopolistic ways began to be more deeply felt , the demand for competition and free trade increased to the point where first of all some of the old monopoly practices in the economic realm began to be challenged and then overthrown (e.g. "la liberté des échanges" (free trade, or the freedom of trading) with the Anti-Corn Law League which opened up free trade in England in 1846), which later spread to the political realm where a similar demand for "la liberty de gouvernement" (free government, or the freedom of government) also began to be expressed.
The third and final era, "l’ère de la grande industrie," Molinari thought was in the process of emerging during the 19th century was not not yet fully formed but the general outlines were beginning to become visible. This new régime would be one of large scale industry, both national and international, where trade and competition had become universal and unlimited in scope ("la concurrence universalisée"; "des marchés unifiés et illimités"), and liberty as well was entering every aspect of human existence. As he states in the "Conclusion" to the first volume he predicts that the world would one day become:
| un seul et immense atelier dans lequel se casera l’humanité, sans distinction de races, de nationalités, de croyances, tous travaillant pour chacun et chacun travaillant pour tous. | a single and immense workshop which will accommodate (all of) humanity, without distinction of race, nationality, or belief, (where) everyone works for each other, and each person works for everyone. |
As this economic transformation of the world was taking place, he predicted a parallel political change would also be taking place. Unfortunately, the political transformation was lagging behind the economic because the ruling elites were reluctant to give up the power and privileges which they had accumulated over the centuries. Nevertheless, older forms of servitude and tutelage were gradually being replaced by "self government" (Molinari frequently uses this English expression) and Molinari looked forward to a future society where "la machinery du gouvernement" (another English word Molinari liked to use) would also feel the effects of unlimited and universal competition. Before this political change could be completed there would have to be a revolution in the way people thought about politics:
| Cependant, un moment arrive où une société, dont les conditions d’existence ont changé sous l’influence du progrès matériel, ne peut plus supporter son ancienne machinery de gouvernement. Elle fait alors une « révolution ». | However, a moment will come when a society, whose conditions of existence have changed under the influence of material progress, can no longer support its ancient "machinery of government." It will then have a "revolution." |
Endnotes
[12] Herbert Spencer, The Principles of Sociology, in Three Volumes (New York: D. Appleton and Company, 1898). Authorized third edition. 12/27/2023. Thee volumes in one HTML file online.
Text
[439]
CHAPITRE XII.
Conclusion.↩
Malgré des interruptions partielles et des retours temporaires, l'histoire de l'humanité nous présente le phénomène d'un progrès en voie d'accumulation constante. Sans remonter au delà des données positives qui nous sont fournies par les monuments de l'âge de pierre, sans rechercher comment l'homme a été créé ou s'est successivement créé, par le développement et l'adaptation de ses éléments de vitalité physique et morale, nous le voyons apparaître, au début de l'histoire, dans une condition peu différente de celle des autres espèces animales. Moins bien armé qu'un grand nombre d'entre elles, il n'a acquis, selon toute apparence, qu'au bout de longs siècles, une supériorité décisive sur le reste de l'animalité. Cet ascendant, il l'a obtenu, grâce à la possession d'un clavier intellectuel et moral plus complet que celui des autres espèces. Il est doué, à un plus haut degré qu'aucune de celles-ci, des facultés d'observation et de l'esprit de combinaison : c'est un animal inventeur. C'est aussi un animal religieux. Sans doute, il existe des animaux qui se soumettent par crainte ou par amour à des espèces supérieures et notamment à l'homme; mais l'objet de leur crainte ou de leur amour est visible à leurs regards. Ils sont incapables d'imaginer des êtres auxquels ils seraient obligés d'obéir. Cette faculté qui leur manque, l'homme la possède, et elle a été le principal [440] coopérateur de l'esprit d'observation et de combinaison dans le travail primitif de la civilisation. [39]
C'est une question aujourd'hui fort débattue que celle de savoir si les espèces animales inférieures ont possédé, dès l'origine, les procédés dont nous les voyons se servir pour trouver leur subsistance, se préserver des intempéries et se défendre contre les autres espèces, ou bien si elles les ont créés; autrement dit, si elles ont progressé ou non jusqu'au point que comportaient leur structure physique et leur appareil intellectuel. Cette question est résolue pour l'espèce humaine. On sait que l'homme a créé et perfectionné successivement le matériel et les [441] procédés dont il se sert pour produire, aussi bien que ses institutions civiles, politiques et religieuses. Nous avons distingué, dans cette création du matériel, des procédés et des institutions, qui ont été les facteurs du grand phénomène de la civilisation, trois périodes : 1° l'âge primitif, qui va de la naissance de l'humanité à la découverte des plantes alimentaires et à leur mise en culture régulière; 2° l'âge de la petite industrie, qui va de l'invention de la charrue à celle de la machine à vapeur, et 3° l'âge de la grande industrie, dans lequel nous entrons. Comme toutes les classifications, celle-ci a certainement quelque chose d'arbitraire. Il est clair qu'on ne saurait préciser le moment où une de ces périodes a fini, où une autre a commencé; de plus, elles ont continué de coexister, et on pourrait même indiquer leurs limites topographiques, en dressant une carte économique du globe. On trouve encore aujourd'hui, dans les différentes parties du monde, des populations dont l'outillage et les institutions sont demeurés ceux de l'âge primitif. Le domaine qu'elles occupent vase rétrécissant tous les jours, mais il comprend encore au moins le quart de la terre habitable. L'âge de la petite industrie subsiste dans tout le reste, ici d'une manière exclusive, là en partage avec l'ère naissante de la grande industrie, laquelle empiète incessamment sur les domaines des deux âges précédents, sans avoir acquis toutefois nulle part la prépondérance.
Au point de vue de la science, cette coexistence des trois âges de la civilisation présente un avantage précieux, en ce qu'elle permet d'étudier sur le vif les phénomènes qui les caractérisent et d'observer, à la fois, le passé, le présent et les rudiments de l'avenir. Résumons les caractères de l'âge primitif. Les hommes nous apparaissent alors réunis en troupeaux comme les autres espèces animales, à l'exception de celles où [442] l'individu peut se passer de l'aide de son semblable. La nature de leurs moyens de subsistance ne permet point à ces premières agglomérations humaines de dépasser un nombre fort limité, quelques centaines ou quelques milliers d'individus : l'homme primitif est obligé d'occuper et d'explorer de vastes espaces pour subsister, au moyen de la chasse, de la pêche ou de la recherche des fruits naturels du sol. Il gîte sur des arbres, comme le Papou, dans des cavernes, comme le Troglodyte, dans des huttes de branchages ou de terre glaise, et ses vêtements, quand la rigueur du climat lui en fait sentir le besoin, se composent de la dépouille brute des végétaux et des animaux. On s'explique aisément cette réunion originaire de la généralité de l'espèce en troupeaux, par la nécessité de se défendre contre des animaux et des hommes, individuellement supérieurs en force. On s'explique aussi que cette nécessité ait eu pour résultat de développer les instincts et les qualités de combat, la force, l'agilité, le courage, la ruse, et que l'ensemble de ces qualités constituât la plus haute expression de la valeur. N'en déplaise aux philanthropes, il fallait que l'homme eût, à l'origine, les instincts d'une bête féroce pour réussir à triompher des bêtes féroces. Sous peine de périr misérablement, il devait être, avant tout, un animal de combat. Le lutte permanente avec les animaux et les hommes de proie, voilà le caractère dominant de cette première période, et les nécessités de cette lutte déterminent le mode de constitution des troupeaux ou des tribus : le choix du chef le plus capable de diriger les opérations de chasse et de guerre, la formation d'une hiérarchie, l'établissement d'une discipline, la limitation du nombre des femmes, et, en général, la suppression des bouches inutiles, tout cela s'impose comme dans une ville assiégée ou une armée en campagne. Dans chacune de ces petites sociétés, entourées d'ennemis et [443] perpétuellement sur le qui-vive, une opinion ne manque pas de se former sur tout ce qui, dans les manières d'être et d'agir de chacun, semble conforme ou contraire aux intérêts de la communauté, intérêts qui se résument dans sa sécurité et sa subsistance. Cette opinion impose en toutes choses, et pour tous les actes de la vie, une coutume qui doit être obéie comme les prescriptions d'un code militaire. Les coutumes diffèrent de tribu à tribu quoiqu'on puisse observer dans toutes un fonds commun de dispositions essentielles, car elles répondent partout à des nécessités pareilles. Elles sont aussi bien adaptées que le comporte l'état des intelligences et des mœurs aux besoins des sociétés embryonnaires qu'elles régissent. Ces troupeaux humains, épars sur le globe encore livré à l'animalité, se créent un armement, un outillage, de même qu'une langue et des institutions qui leur sont propres, tout en présentant des analogies tirées de l'identité générale des situations et des besoins. Mais les forces physiques et morales, comme les autres biens naturels, sont inégalement distribuées entre les troupeaux et entre les individualités dont ils se composent. Il y a chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux, des variétés supérieures et des individus d'élite. C'est à cette aristocratie, capable d'observer, de découvrir et d'inventer, que sont dus les progrès qui ont permis à l'espèce humaine de s'élever peu à peu au-dessus des autres espèces animales; c'est grâce à elle que la frontière de l'âge primitif a pu être franchie.
Avec la petite industrie, un monde nouveau commence. La mise en culture régulière du sol permet à des millions d'hommes de naître et de subsister sur une étendue de terre qui était naguère à peine suffisante pour procurer à un millier de chasseurs une subsistance précaire. Aussitôt, par l'action de cette loi naturelle, en vertu de laquelle [444] les hommes, comme toutes les autres espèces animales, se multiplient en raison de leurs moyens d'existence, aussitôt, disons-nous, à la place des tribus primitives, on voit apparaître des sociétés nombreuses, et s'établir des États puissants. Non seulement l'agriculture fournit les moyens de faire subsister cent fois plus d'hommes sur une étendue déterminée de territoire, mais encore le nouveau matériel permet de tirer du sol beaucoup plus de subsistances qu'il n'en faut pour nourrir ceux qui le cultivent. D'où il résulte qu'à côté et au-dessus de ce personnel appliqué à la production des articles de première nécessité, peut prendre place un personnel presque aussi nombreux, voué à d'autres travaux. Alors apparaît la division du travail: la production se spécialise. Tandis qu'une partie de la population s'occupe de produire et de façonner les matériaux de l'alimentation, une autre partie fabrique des armes, des outils et l'immense variété des articles nécessaires au vêtement, à l'habitation, au luxe du corps et de l'esprit, une troisième partie pourvoit aux services domestiques, une quatrième, la plus importante quoique la moins nombreuse, s'emploie à gouverner la société et à la défendre. Cette division du travail, qui demeure toutefois plus ou moins incomplète — l'exercice de divers métiers industriels et autres demeurant fréquemment joint aux travaux agricoles — favorise à un haut degré les progrès ultérieurs de la société. Les échanges en sont la conséquence, et la monnaie est inventée pour les faciliter. Les industries se multiplient et se perfectionnent, les sciences physiques et morales se constituent, un état économique, politique et social nouveau a surgi, et va se développant.
Cependant, le matériel de la production demeure encore imparfait et grossier, la petite industrie est peu productive en comparaison de ce que sera plus tard la grande. [445] A défaut de la force mécanique, elle emploie principalement la force physique de l'homme. Qu'il s'agisse de cultiver la terre, de construire des habitations, de filer et de tisser les étoffes, d'extraire et de façonner les métaux, de transporter les produits et les hommes eux-mêmes, c'est la force physique qui apparaît comme l'agent ou le véhicule universel. Enfin, ces produits insuffisants, créés à grand renfort de main-d'œuvre ne peuvent, sauf de rares exceptions, être transportés qu'à de courtes distances : leur marché est naturellement limité.
Ainsi, l'insuffisance de la productivité, la prépondérance du travail physique et la limitation naturelle des marchés, tels sont les phénomènes qui caractérisent la petite industrie et, l'on peut ajouter, qui déterminent la constitution économique, politique et sociale de ce régime.
L'imperfection du matériel agricole et industriel ne permettait point de multiplier la richesse de manière à satisfaire, même dans une faible mesure, tous les besoins des différents membres de la société. Chez les nations les plus florissantes, la grande majorité de la population était obligée de se contenter du strict nécessaire; la minorité seule vivait dans l'aisance et la richesse était l'exception. Même de nos jours, malgré tant de progrès réalisés, la masse de richesse, annuellement produite, en admettant qu'elle fut répartie également entre tous les membres de la société, ne donnerait à chacun qu'un revenu dépassant de bien peu la somme indispensable à la satisfaction des premières nécessités de la vie. Le caractère dominant des sociétés vivant de la petite industrie, c'est la pauvreté ou l'insuffisance de la richesse; armé d'un outillage encore grossier et incomplet, le travail est peu productif, par conséquent peu rémunérateur. Or, tout travail implique une peine. Pour qu'on consente volontairement à subir cette peine, il faut qu'elle soit rachetée par la [446] perspective d'une jouissance qui la dépasse ou la compense. Cette compensation, pouvait-on l'offrir à la multitude à laquelle on demandait le travail physique nécessaire à l'accomplissement des travaux inférieurs de la production? Non! Même sous un régime aussi égalitaire que possible, l'insuffisance des résultats de la production n'aurait guère permis de lui donner au delà d'un minimum de subsistance, en échange d'un labeur long, pénible et monotone. Mais comment aurait-on pu persuader à des sauvages accoutumés à une vie errante et relativement libre, de s'astreindre volontairement aux travaux prolongés et rebutants du défrichement du sol, de la mouture du blé dans les moulins à bras, du transport des fardeaux, du maniement de la rame, en échange d'une pitance étroitement rationnée? Comment aurait-on pu obtenir de ces hommes-animaux un travail effectif et régulier sans employer la contrainte? L'esclavage apparaît donc comme le seul régime applicable à la multitude, qui remplissait, à l'origine de la petite industrie, les fonctions qui ont été ensuite dévolues, en partie, aux bêtes de somme et aux machines.
Il y a plus. Pour que cette multitude consentit de son plein gré, non seulement à s'astreindre d'une manière continue à des travaux ingrats, mais encore à remplir toutes les obligations qu'implique le self government, il lui aurait fallu un développement intellectuel et moral qu'elle n'avait pu acquérir dans sa condition précédente, et qu'elle ne pouvait acquérir davantage dans sa condition actuelle. De même que l'exercice continu d'une profession intellectuelle a pour effet de développer l'intelligence, au détriment de la force physique, à moins que celle-ci ne soit entretenue au moyen d'une gymnastique et d'une hygiène spéciales, l'application continue à une occupation purement physique monopolise l'activité vitale au profit [447] exclusif de la force musculaire. Dans toutes les sociétés vivant de la petite industrie, la multitude, vouée aux travaux inférieurs de la production, est d'autant plus réfractaire à une culture intellectuelle et morale que sa besogne exige moins le concours de l'intelligence, et implique un moindre degré de responsabilité. On s'explique ainsi l'incapacité que les classes, aujourd'hui émancipées, mais encore attachées à l'ancien matériel, montrent dans l'exercice du self government. En vain essaierait-on d'élever, par des moyens artificiels, leur niveau intellectuel et moral. L'instruction et la moralisation n'ont qu'une bien faible prise sur des êtres dont toute l'activité se résout dans la dépense et la réparation de leur force musculaire. C'est là un point dont les réformateurs modernes, socialistes ou philanthropes, ne tiennent aucun compte, mais qui n'avait pas échappé au pénétrant esprit d'observation des anciens. Aristote disait : Si la navette marchait seule, on pourrait se passer d'esclaves, — sans prévoir, à la vérité, qu'un jour viendrait où la navette marcherait seule. Mais aussi longtemps que la navette n'a pas marché seule, aussi longtemps que la multitude a dû faire la besogne de la bête de somme et de la machine, elle n'a pu acquérir la capacité qu'exige le self government, et il a fallu la maintenir sous un régime de tutelle adapté à l'état d'infériorité auquel la condamnait la nature même de ses occupations. A cela, il n'y avait qu'un remède : il fallait élever la nature du travail en remplaçant l'homme par la machine, pour ne lui laisser que les fonctions de directeur ou de surveillant de la production, et telle est l'œuvre de la grande industrie.
Cette insuffisance de la productivité de l'industrie et cette matérialité de la plus grande partie des fonctions de la production, qui rendaient nécessaire l'asservissement des classes inférieures, obligeaient aussi les classes [448] dirigeantes à se soumettre à une discipline presque aussi rude que celle de l'esclavage.
La richesse ne pouvait être créée avec quelque abondance que dans les régions dont le sol était exceptionnellement fertile et le climat chaud, telles que les deux péninsules de l'Inde, la Mésopotamie et l'Egypte, où l'agriculture donnait un rendement considérable, et où l'on pouvait entretenir, à peu de frais, la masse de maind'œuvre qu'exigeaient les travaux de la production. Plus tard, quand les moteurs de chair et d'os, nourris de blé ou de riz, eurent été remplacés économiquement par des moteurs de fer et d'acier, alimentés avec du charbon de terre, l'industrie a quitté ses foyers primitifs pour se concentrer dans les régions où abondent le fer et le charbon. En dehors des contrées privilégiées, où le blé rendait, au témoignage d'Hérodote, 200 grains pour un, et où un peu de nourriture végétale, un abri et un vêtement légers suffisaient à l'esclave, la richesse ne pouvait être obtenue qu'en petite quantité et à grande peine. Qu'en résultait-il? C'est que, pour les peuples qui n'avaient en partage ni un sol fertile, ni un climat doux, l'industrie la plus productive était la guerre. Malgré toute l'intelligence et l'énergie qu'ils pouvaient déployer, ils demeuraient pauvres, tandis que la conquête d'une contrée favorisée du ciel leur procurait d'emblée, avec la richesse déjà accumulée, la possibilité d'en acquérir davantage. De là, un risque permanent de guerre et de dépossession, et la nécessité pour les classes gouvernantes des sociétés industrieuses et riches de se soumettre à une discipline qui n'était autre chose qu'une forme de la servitude. L'État se trouvant incessamment menacé, la liberté de chacun devait être sacrifiée au salut commun : toutes les manières d'agir qui pouvaient l'affaiblir et compromettre sa sûreté devaient être rigoureusement interdites; toutes celles qui [449] étaient de nature à augmenter sa puissance, encouragées et ordonnées. A mesure que l'industrie est devenue plus productive, qu'elle s'est spécialisée dans les régions les mieux appropriées à chacune de ses branches, que son matériel et ses procédés se sont perfectionnés, en diminuant ainsi la valeur des différences de sol et de climat; à mesure enfin que le développement progressif du matériel de guerre a exigé l'avance et l'immobilisation d'un capital plus considérable, la guerre a cessé, même pour les peuples placés dans de mauvaises conditions naturelles, d'être le plus profitable des moyens d'acquérir de la richesse; les risques d'invasion et de dépossession ont diminué alors, la sécurité générale des peuples civilisés s'est augmentée, mais ces divers progrès ont été lents à s'accomplir, et, en attendant, les nécessités de la sécurité extérieure obligeaient les classes possédantes et gouvernantes à sacrifier la liberté de chacun à l'intérêt de tous.
Les exigences de la sécurité intérieure n'étaient guère moindres. Il fallait d'abord contenir les masses esclaves, dont le nombre dépassait celui de leurs maîtres. Il fallait ensuite empêcher la majorité de la classe non asservie, demeurée pauvre ou peu aisée, de se ruer sur la propriété du petit nombre des riches, comme la tentation ne pouvait manquer de lui en venir quand la richesse était si difficile à acquérir. Il fallait enfin empêcher, dans toutes les classes de la société, le mauvais emploi et le gaspillage de cette richesse dont la conservation et le bon aménagement importaient au salut commun. Ce n'était pas trop du concours de la religion, de la coutume, de l'opinion, de la répression et de la tutelle collective pour maintenir la discipline étroite et rude à laquelle les classes dominantes étaient obligées de s'assujettir afin de se préserver des risques extérieurs ou intérieurs qui menaçaient leur domination et leur existence.
[450]
Enfin, la limitation naturelle des marchés s'ajoutait aux deux causes précédentes pour déterminer le mode de constitution et d'organisation des sociétés vivant de la petite industrie. Si, comme nous l'avons démontré (chapitre IV), la concurrence agit comme un régulateur de la production et de la distribution de la richesse, cette action régulatrice, elle ne peut l'exercer avec une pleine efficacité que dans un milieu libre, c'est-à-dire dans un marché d'une étendue illimitée. Or, l'imperfection de l'outillage, la difficulté des transports, l'insuffisance de la sécurité concouraient partout, sous le régime de la petite industrie, à limiter l'étendue des marchés. Il n'y avait que des marchés locaux, presque toujours fort étroits : il n'y avait pas de marché général. Dans cet état de choses, en l'absence du régulateur naturel de la concurrence, il avait bien fallu recourir à des moyens artificiels pour obtenir un équilibre approximatif de la production et de la consommation, ainsi qu'un règlement utile des prix des produits et des rétributions des agents productifs. Comment y était-on arrivé? Par la constitution des corporations, l'appropriation des marchés et l'établissement des coutumes régulatrices des prix. Dans chaque industrie, les entrepreneurs formaient une corporation limitée et fermée, à laquelle le marché était approprié, à l'exclusion des industries similaires ou même approchantes du dedans et du dehors. L'équilibre pouvait ainsi s'établir entre la production et la consommation. En même temps, l'opinion intervenait par l'établissement de la coutume, pour fixer les prix au taux nécessaire, en y réduisant du même coup les profits. Elle limitait encore l'intérêt et réglait le taux des redevances et des salaires. La coutume était un régulateur grossier, mais indispensable, et l'on est bien obligé d'y recourir actuellement encore, en imposant d'autorité un maœirn um aux industries dont le marché [451] n'est pas assez étendu pour que la concurrence y puisse remplir son office. Mais ce qui n'est plus aujourd'hui que l'exception était la règle dans cette phase du développement de l'industrie, où tous les marchés étaient naturellement limités.
En résumé, les sociétés vivant de la petite industrie ne pouvaient subsister qu'aux conditions suivantes : 1° Que la multitude vouée aux travaux de force de l'agriculture, de l'industrie et des transports par terre ou par eau, fût assujettie à un régime qui la contraignît à exécuter ces travaux, à la fois pénibles et peu productifs, et qui, en même temps, aménageât utilement sa consommation en lui imposant d'autorité les dures privations qu'elle n'avait ni la capacité, ni la force morale nécessaires pour s'imposer elle-même. Or, il ne faut pas oublier que la nature de ses occupations l'empêchait d'acquérir cette capacité et cette force morale qui pouvaient seules la déterminer à travailler librement et à consommer utilement les produits de son travail. 2° Il n'était pas moins nécessaire que la classe possédante et dirigeante fût soumise à une discipline assez forte et assez rigide pour lui permettre de maintenir sous le joug la multitude asservie, et de résister aux agressions du dehors en empêchant ses propres membres de commettre des nuisances et des manquements à leurs devoirs, qui auraient affaibli et désorganisé l'État auquel l'existence de tous était attachée. Il fallait les empêcher de gaspiller les ressources et les capitaux dont le peu de productivité de l'industrie et l'insuffisance de la prévoyance individuelle rendaient l'acquisition si difficile et l'accumulation si laborieuse. Il fallait les préserver surtout de l'affaiblissement physique et moral qu'entraînait une consommation déréglée, et tels étaient les objets que se proposaient les institutions politiques, civiles et religieuses, les coutumes et l'opinion. Elles ne [452] les atteignaient jamais cependant que d'une manière incomplète, tant par suite de l'imperfection inévitable de cette machinery gouvernante que de la résistance des appétits brutaux, des passions vicieuses et destructives qu'il s'agissait de discipliner. Enfin, 3°, il fallait remédier au défaut d'étendue des marchés au moyen d'un ensemble d'institutions et de coutumes qui empêchassent les producteurs de faire la loi aux consommateurs, les prêteurs d'exploiter les entrepreneurs et les entrepreneurs d'exploiter les ouvriers.
Ce régime de tutelle universelle était nécessaire, et il n'a pu être utilement modifié qu'autant que l'industrie est devenue plus productive, que la nature du travail s'est élevée et que les marchés se sont agrandis. C'est seulement à la suite de ces progrès essentiels que l'esclavage a pu se transformer en servage; que le servage, à son tour, a disparu, et, d'une manière générale, que la discipline sociale est devenue moins étroite et moins rude; enfin, que le régime des corporations fermées et des marchés appropriés, avec la réglementation compliquée qui y était adaptée, a commencé à faire place à la concurrence.
Au moment où nous sommes, quoique nous nous trouvions encore certainement fort éloignés de l'époque où la grande industrie aura terminé son évolution et où la société aura, de son côté, achevé de construire l'organisme adapté à ses nouvelles conditions d'existence, nous possédons cependant déjà quelques données positives sur la constitution économique, politique et sociale de l'avenir. Ce que nous apercevons, dès à présent, de l'édifice grandiose qui est en voie de s'élever pour abriter les générations futures nous permet de conjecturer ce qu'il sera plus tard. Nous avons essayé d'en esquisser quelques-unes des lignes principales, sans quitter le terrain solide de la réalité, en montrant simplement le développement [453] logique et harmonieux des constructions encore à l'état d'ébauche.
Comment nous apparaît la production sous le régime de la grande industrie et de la concurrence universalisées? Elle nous apparaît d'abord géographiquement, spécialisée dans les différentes régions du globe, conformément aux conditions du sol, du climat et du travail, en raison de l'abondance des matériaux nécessaires à chacune de ses branches et des facilités à les mettre en œuvre.
« La terre, disions-nous (article Liberté du commerce du Dictionnaire de l'Économie politique), la terre, avec ses innombrables variétés de minéraux, de végétaux et d'animaux, ses océans, ses montagnes, son humus fertile, l'atmosphère qui l'environne, les effluves de chaleur et de lumière qui alimentent la vie à sa surface, voilà le fonds abondant que la Providence a mis au service de l'humanité. Mais, ni les éléments divers qui composent ce fonds naturel de subsistance, ni les facultés dont l'homme dispose pour les utiliser, n'ont été distribués d'une manière égale et uniforme. Chacune des régions du globe a sa constitution géologique particulière : ici, s'étendent d'immenses couches de charbon, de fer, de plomb, de cuivre; là, gisent l'or, l'argent, le platine et les pierres précieuses. Même diversité dans la distribution des espèces végétales et animales : le soleil, qui échauffe et éclaire inégalement la terre, qui prodigue dans certaines zones la chaleur et la lumière, tandis qu'il abandonne les autres à la frigidité et à l'ombre, marque à chaque espèce les limites qu'elle ne peut franchir. Même diversité dans la répartition des facultés humaines. Un court examen suffit pour démontrer que tous les peuples n'ont pas été pourvus des mêmes aptitudes, que les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Russes, les Chinois, les Indous, les Nègres, etc., ont leur génie particulier, provenant soit de [454] la race, soit des circonstances naturelles du sol ou du climat; que les forces physiques, intellectuelles et morales de l'homme varient selon les races, les peuples et les familles; qu'il n'y a pas dans le monde deux individus dont les capacités soient égales et les aptitudes semblables. Diversité et inégalité des éléments de la production dans les différentes régions du globe; diversité et inégalité non moins prononcées des aptitudes parmi les hommes : tel est donc le spectacle que nous présente la création... Mais si, comme l'observation l'atteste, les différents peuples de la terre sont pourvus d'aptitudes particulières, si chaque région du globe a ses productions spéciales, à mesure que s'étendra la sphère des échanges, on verra chaque peuple s'adonner de préférence aux industries qui conviennent le mieux à ses aptitudes, ainsi qu'à la nature de son sol et de son climat; on verra la division du travail s'étendre de plus en plus parmi les nations. Chaque industrie se placera dans ses meilleures conditions de production, et le résultat final sera que toutes les choses nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme pourront être obtenues avec un maximum d'abondance et en échange d'un minimum de peine. »
Cette distribution naturelle des éléments multiples et divers de la production ne semble-t-elle pas attester aussi que notre globe a été façonné pour devenir un seul et immense atelier dans lequel se casera l'humanité, sans distinction de races, de nationalités, de croyances, tous travaillant pour chacun et chacun travaillant pour tous? Mais que fallait-il pour en arriver là? Il fallait, en premier lieu, que le travail se divisât, et que l'industrie, en se spécialisant, devînt assez productive pour subvenir aux besoins d'un nombre de plus en plus considérable de consommateurs. Il fallait, en second lieu, que les obstacles naturels ou artificiels qui rétrécissaient les marchés [455] de consommation, en empêchant les communications d'une région, et même d'une localité à une autre, fussent aplanis. Cette œuvre d'agrandissement et d'unification des marchés est en voie d'accomplissement, et il n'est pas chimérique de croire qu'elle se poursuivra jusqu'à son entier achèvement. Ce qui serait chimérique, ce serait de croire qu'elle puisse être arrêtée.
Comment se présente la production, ainsi économiquement localisée? Chacune de ces branches apparaît distribuée en une série d'entreprises plus ou moins nombreuses. Établies généralement sur un plan colossal, en raison de la puissance et de la perfection de leur outillage, et de l'extension illimitée de leur débouché, ces entreprises versent, sur le marché universel, leurs produits fabriqués dans les conditions naturelles les plus favorables, avec les machines et les procédés les plus économiques; ce qui signifie que les consommateurs peuvent obtenir les produits dont ils ont besoin au meilleur marché possible, ou, ce qui revient au même, « avec un maximum d'abondance et en échange d'un minimum de peine ».
Entrons cependant plus avant dans l'organisation de la production transformée par le progrès. Voyons comment elle est constituée et alimentée de capital et de travail, comment enfin elle met, en tout temps, en tous lieux, et dans les quantités utiles, ses produits à la portée des consommateurs. Elle est constituée sous la forme d'entreprises collectives, et cette constitution est déterminée à la fois par la grandeur des dimensions des entreprises et par l'économie résultant de la division du capital en coupures mobilisables; elle est alimentée par des établissements de crédit de toute sorte qui récoltent le capital chez ceux qui le produisent, et, à mesure qu'ils le produisent, pour le transmettre à ceux qui l'emploient. D'autres intermédiaires leur fournissent régulièrement toutes les quantités [456] et toutes les sortes de travail dont elles ont besoin; enfin, une troisième catégorie d'intermédiaires s'empare de leurs produits au sortir de la fabrication, et se charge de les mettre à la portée des consommateurs. Tel est le mécanisme de l'organisation de la production. Mais quelle est l'àme de ce mécanisme? Quel en est le moteur et le régulateur? C'est la concurrence.
La concurrence agit à la fois pour provoquer la création des produits et des agents productifs, pour la régler et la faire progresser. Comment procède-t-elle?
Sur le triple marché unifié et universalisé — du capital, du travail, des produits — il y a une demande et une offre permanentes de chacun de ces agents ou de ces fruits de la production. Si la demande dépasse l'offre, le prix hausse; si l'offre dépasse la demande, le prix baisse, non pas seulement en progression arithmétique, mais en progression géométrique, en vertu de la loi d'équilibre qui régit les valeurs. Le marché étant désormais pleinement libre, le monopole ayant partout fait place à la concurrence, cette loi agit avec une efficacité entière. Elle agit, en premier lieu, pour déterminer la création des entreprises, l'apport du capital et du travail, la fabrication et la mise au marché des produits, dans la proportion utile. Que, dans une branche quelconque de la production, la demande vienne à dépasser l'offre, les prix s'élèvent et les profits avec eux, l'esprit d'entreprise s'y porte, entraînant à sa suite le capital et le travail, la production se développe, l'offre s'accroît, les prix baissent, les profits diminuent jusqu'à ce que l'offre et la demande se mettent en équilibre au niveau des frais nécessaires pour rétribuer les agents productifs investis dans cette branche de travail comme ils sont rétribués dans les autres. Si le prix du marché, après avoir atteint ce niveau, ne s'y arrête point et descend plus bas, un mouvement inverse se [457] produit, et le prix est toujours, par le fait de cette gravitation économique, agissant dans un milieu libre, irrésistiblement ramené à son taux nécessaire. L'ordre s'établit de lui-même dans l'immense atelier de la production.
En second lieu, la concurrence agit pour rendre le progrès indispensable dans toutes les parties de cet atelier. Il n'y a plus qu'un prix courant sur le marché que la locomotion à vapeur, la télégraphie électrique et la liberté du commerce ont universalisé; mais il peut y avoir une multitude de prix de revient. Les entreprises les mieux localisées, organisées, outillées et desservies ont un prix de revient minimum, et elles jouissent d'une rente, tandis que les autres ont des prix de revient échelonnés jusqu'à un maximum qui couvre simplement les frais de la production. Le désir d'obtenir une rente ou d'augmenter celle que l'on a, la crainte de subir une nonrente, autrement dit, de travailler à perte, agissent incessamment sur les producteurs concurrents pour les déterminer à se placer dans les conditions les plus économiques et à employer les machines, les procédés et les méthodes les plus propres à abaisser leurs prix de revient. Chacun profite d'abord du progrès qu'il a réalisé, mais ce progrès se traduit nécessairement par une augmentation de la production et de l'offre, le prix du marché s'abaisse, et c'est, en définitive, le consommateur ou l'universalité des membres de la société qui profite de tous les progrès réalisés sous l'impulsion de la concurrence.
La concurrence ne joue pas un rôle moins considérable dans la distribution de la richesse. Nous venons de voir comment elle agit pour régler la production de toutes choses dans la proportion utile, et les mettre à la disposition des consommateurs à un prix qu'elle travaille incessamment à réduire au dernier minimum possible, mais il faut que ce prix soit payé. Comment les consommateurs [458] peuvent-ils le payer? Autrement dit, comment peuventils se procurer toutes les choses dont ils ont besoin, en remboursant aux producteurs les frais qu'elles ont coûté, et que représente, en dernière analyse, le prix du marché? Ils ne le peuvent qu'à la condition de contribuer, à leur tour, directement ou indirectement, à la production, à titre de travailleurs ou de capitalistes, et de se créer ainsi un revenu. Tous les revenus proviennent de la mise en œuvre des agents et des instruments qui constituent le matériel de la production, des forces, des aptitudes et des connaissances qui se trouvent investies dans le personnel, ou, en deux mots, que l'on pourrait même réduire à un seul, du capital et du travail. Or, c'est encore la concurrence qui règle la rétribution du capital et du travail, ou la proportion qui leur revient dans les résultats de la production, comme elle règle la proportion des différentes sortes de produits et leur prix. Sur le marché universalisé, le taux courant de l'intérêt, des loyers, des profits, des dividendes, c'est-à-dire des formes diverses de la rétribution du capital, s'unifie, et il gravite vers le taux nécessaire, lequel va s'abaissant d'une manière indéfinie, sous l'influence des progrès qui diminuent la privation et les risques de l'emploi du capital. Sur le même marché, le taux courant des salaires et des autres formes de la rétribution du travail s'unifie aussi au niveau du taux nécessaire, mais avec cette différence que le progrès élève celui-ci en substituant à la mise en œuvre des forces physiques celle des forces intellectuelles et morales. La part du capital diminue, la part du travail augmente, et le résultat final, c'est une tendance à l'égalisation des conditions.
Telle nous apparaît, dans ses traits caractéristiques, la constitution économique que la grande industrie et la concurrence préparent à la société de l'avenir. Grâce à la [459] puissante machinery de la grande industrie, la richesse pourra être produite avec assez d'abondance pour suffire à tous les besoins de la consommation, pendant que l'ordre dans la production, la justice dans la distribution de la richesse s'établiront d'eux-mêmes par l'action de la loi d'équilibre des valeurs, sous le régime de la concurrence universalisée.
Deux autres phénomènes, procédant de ceux-là, caractérisent encore cet état nouveau, savoir l'extension indéfinie de la solidarité parmi les hommes et la généralisation de la lutte pour l'existence.
Tandis que dans les sociétés économiquement isolées de l'ère de la petite industrie, les manières d'agir utiles ou nuisibles des différents membres de ces sociétés n'exercent leur influence, bonne ou mauvaise, que dans les limites de la tribu ou de l'État, il en est autrement dans ce nouvel ordre de choses, où la sphère des échanges embrasse la terre entière, en établissant entre tous les hommes une liaison et une communauté d'intérêts. Il n'y a plus désormais de sociétés isolées, vivant de leur vie propre, et dont les membres n'ont rien de commun avec ceux des autres; il n'y a plus qu'une société universelle, dans laquelle la manière dont chacun gouverne ses affaires et sa vie influe sur la condition de tous; d'où résulte encore pour tous le droit de se défendre contre les manières d'agir nuisibles de chacun, et le devoir pour chacun d'agir de la manière la plus conforme à l'intérêt de tous, impliquant la création d'un code universel de droit et de morale, supérieur à tous les codes particuliers et destiné à les remplacer.
De même, la lutte pour l'existence, qui n'avait, à l'origine, d'autre manifestation que la guerre, s'étend à toutes les branches de l'activité humaine, sous un régime de concurrence universalisée. Les moyens de produire la richesse [460] ont acquis plus de puissance, le mécanisme de la distribution de cette richesse est devenu plus parfait, mais encore faut-il que chaque génération parvienne à caser la multitude de ses membres dans l'atelier universel. Il n'y a plus de privilèges et de situations réservées dans cet atelier: toutes les places, toutes les fonctions sont accessibles à tous, sans distinction de races et de nationalités, mais c'est à la condition qu'ils possèdent la capacité physique, morale et intellectuelle avec les connaissances requises pour les remplir. Cette capacité est naturellement inégale: les uns sont pourvus d'un ample fonds de facultés productives et dirigeantes; ils apportent au capital social, une valeur personnelle considérable, tandis que les autres sont pauvrement doués et n'apportent qu'une valeur minime; quelques-uns même, entièrement disgraciés de la nature, ou, pis encore, nés avec des instincts pervers, sont des non-valeurs qui constitueront une charge pour la société; enfin, les capitaux qui sont investis dans l'atelier, et qui consistent dans l'ensemble des valeurs représentées par le sol, le sous-sol, les constructions, les matériaux de la production, le fonds de consommation, etc., ne sont pas distribués d'une manière moins inégale : de même que le fonds de valeurs personnelles que chacun reçoit de ses ascendants, force physique, beauté, intelligence, aptitudes spéciales, diffère d'un individu à un autre, le fonds de valeurs immobilières et mobilières qui s'ajoute à cet héritage, sous forme de terres, de maisons, de meubles, de parts dans les entreprises, etc., présente dans sa distribution une diversité extrême. Mais l'atelier est immense, et l'on y trouve des places appropriées aux facultés les plus inégales et les plus diverses. D'un autre côté, les titres de propriété des capitaux investis dans l'atelier sont divisés et rendus circulables au point de devenir accessibles aux plus humbles coopérateurs de la production. [461] Chacun peut obtenir sa part dans la propriété de l'atelier, à la seule condition de gouverner utilement sa production et sa consommation, ses affaires et sa vie, ou de se soumettre à une tutelle qui supplée à l'insuffisance de ses facultés dirigeantes. Ajoutons qu'à mesure que la société acquiert plus de richesse et de bien-être, elle devient plus secourable pour les déshérités; elle ne voue pointa la destruction les non-valeurs qui pèsent sur elle, mais elle s'applique à en diminuer le nombre, en perfectionnant les méthodes de la répression, de la bienfaisance et de la tutelle.
Ainsi, nul ne peut plus se dérober à la lutte pour l'existence; nul ne peut plus s'abriter derrière un privilège de caste, de nationalité ou même de sexe; nul ne peut plus se cantonner dans une sinécure; nul, pour tout dire, ne peut plus vivre aux dépens d'autrui. Il faut que chacun fournisse aux autres l'équivalent de ce qu'il reçoit d'eux, mais l'arène est librement ouverte à tous, et en remplissant les conditions requises pour la lutte, chacun peut obtenir, dans les résultats de la production de l'atelier universel, une part proportionnée à l'importance de son apport et à la valeur de ses services.
Voilà l'idéal de bien-être et de justice vers lequel se dirige l'humanité. Elle en est sans doute encore bien éloignée, mais elle y marche; elle n'a jamais cessé d'y marcher depuis le jour où l'invention du premier outil l'a élevée au-dessus des autres espèces animales. Elle est arrivée maintenant à la dernière étape qui précède l'ère nouvelle; il dépend d'elle de la franchir plus ou moins vite. Plus tôt elle aura remplacé le matériel de la petite industrie par celui de la grande; plus tôt elle aura détruit les obstacles naturels et artificiels qui s'opposent à l'universalisation de la concurrence; plus tôt enfin elle aura adapté l'individu, aussi bien que l'appareil qui supplée à son insuffisance intellectuelle et morale à pratiquer le [462] self government, aux conditions d'existence que lui a faites la transformation de la machinery de la production, plus promptement et plus économiquement elle accomplira cette évolution, dont le terme est le bien-être général, la justice et la paix.
Mais la tâche est énorme et compliquée, et le temps qu'elle exigera pour être remplie dépendra, non seulement de la somme des forces et des ressources que les sociétés en voie de civilisation peuvent mettre au service du progrès, mais encore de l'efficacité et de l'économie avec lesquelles ces forces et ces ressources seront mises en œuvre. A cet égard, la « production du progrès » ne diffère pas des autres branches de l'activité humaine, et elle va se développant et se perfectionnant comme elles.
A l'origine, la production du progrès ne dispose que d'un petit nombre d'agents et de matériaux, ses procédés sont grossiers et incertains, et elle ne réussit qu'à grande peine à faire entrer ses produits dans la consommation. Les hommes pourvus de l'esprit d'observation et du génie de l'invention sont rares, et ils ne possèdent le plus souvent ni les loisirs nécessaires pour observer et inventer, ni les ressources non moins nécessaires pour mener à bonne fin leurs recherches et leurs expérimentations; ils ont à lutter avec les habitudes que les innovations dérangent, avec les intérêts établis auxquels elles portent dommage : il ne faut rien moins que l'intervention des dieux pour les imposer. Grâce à cette intervention secourable, les premiers progrès s'accomplissent, les sociétés naissantes sont mises en possession du matériel de la petite industrie et d'une machinery de gouvernement appropriée à leur condition morale et aux nécessités de leur situation, la population se multiplie, la richesse s'accroît, le capital des connaissances acquises s'accumule. Les sciences, d'abord confondues, se divisent, et chaque [463] branche attire les intelligences qui s'y adaptent le mieux; les arts et les industries se spécialisent de même. Il semble que le travail de la civilisation doive redoubler d'activité et de fécondité, mais les obstacles qui l'entravaient se sont multipliés de leur côté. L'atelier du progrès s'est agrandi, soit! les matériaux qui l'alimentent sont devenus plus abondants et plus variés, les ouvriers qui mettent ces matériaux en œuvre sont mieux pourvus de capitaux; ils ont acquis plus d'habileté et leurs méthodes sont plus sûres; mais leur industrie est à l'index. Ces mêmes dieux, qui la patronaient jadis, se sont retournés contre elle. Les classes dominantes conservent avec un soin jaloux les institutions qui assurent leur domination, et elles considèrent comme un sacrilège tout changement qu'un esprit d'innovation impie et téméraire tenterait d'apporter à ces institutions d'origine divine. On ne peut les changer qu'après avoir détrôné les divinités dont elles sont l'œuvre, et voilà pourquoi, dans cette phase de la civilisation, toute réforme politique et sociale procède d'une révolution religieuse. Mais cette révolution ne s'accomplit point sans lutte; les dieux établis se défendent; parfois des siècles s'écoulent avant que l'esprit de progrès ne réussisse à renverser ces idoles surannées et à mettre à leur place un dieu nouveau révélateur d'une loi nouvelle, moins grossière, plus saine et mieux adaptée à la condition actuelle des hommes et des choses. Dans les régions inférieures, les corporations industrielles, instituées à l'imitation et sur le modèle des corporations politiques et religieuses, n'opposent pas au progrès de moindres obstacles. Partout, non seulement les lois et les coutumes, mais les procédés mêmes de la production et les habitudes de la consommation sont comme figés dans le moule qu'il a plu à une sagesse surhumaine de façonner à l'usage de l'homme.
[464]
L'atelier du progrès est alors presque réduit à chômer, car il n'y a plus de débouché pour l'esprit d'observation et d'invention. C'est l'époque des subtilités de la scolastique et des disputes stériles des commentateurs. Cependant, on se lasse des formules vides et du pédantisme de l'école; on se lasse aussi de la vie monotone du château, de la boutique ou de l'atelier dans l'étroite enceinte des villes murées; le goût des nouveautés et des aventures se réveille, et il se propose d'abord un but religieux. On part pour aller délivrer le tombeau du Christ et on finit par découvrir l'Amérique et la nouvelle route de l'Inde. Les esprits en mouvement se dégagent peu à peu de la tutelle immobile du catholicisme, tandis que l'industrie, le commerce et les arts, dont les débouchés se sont agrandis, s'affranchissent de la réglementation étroite des corporations.Le vieux moule social éclate de toutes parts. En vain, on persécute les novateurs de la religion, de la science et de l'industrie, les nouveautés subsistent, et il devient impossible, malgré tout, de ramener la société au point où elle était avant les armes à feu, la boussole, l'imprimerie, la découverte de l'Amérique et la Réforme. Une réaction s'opère contre les institutions et les préjugés qui arrêtent l'essor des idées et des intérêts auxquels ces nouveautés ont donné naissance, et cette réaction est d'autant plus violente et aveugle que la défense de l'ancien régime avait été plus intolérante et plus obstinée. Au dix-huitième siècle, le progrès, naguère prohibé, est l'objet d'une demande universelle; sous cette étiquette favorite, on accepte même les paradoxes les plus subversifs et les utopies les plus malsaines. On ne distingue point ce qui doit être conservé dans l'organisation du passé et ce qui doit être réformé ou supprimé; on veut tout abattre, jusqu'au jour où les désastres que cette exagération a causés ramènent brusquement à l'exagération opposée.
[465]
A travers ces vicissitudes, la production du progrès a réussi cependant à se débarrasser de la plupart de ses entraves, et elle s'est prodigieusement, quoique inégalement accrue. Au petit atelier clandestin, dont les ouvriers étaient proscrits et les produits prohibés, a succédé une immense manufacture qui travaille au grand jour, si elle ne possède pas encore dans toutes ses parties l'ensemble des conditions nécessaires à son développement régulier.
Cette manufacture se partage, au moment où nous sommes, en deux ateliers bien distincts: l'atelier du progrès matériel et celui du progrès moral et politique.
Le premier de ces deux ateliers se divise à son tour en deux compartiments séparés : les savants extraient et préparent, dans l'un, les matériaux que les inventeurs façonnent dans l'autre, en appliquant la science'à l'industrie. Savants et inventeurs jouissent maintenant d'une liberté entière : aucune partie du domaine de la science ou de l'industrie ne leur est plus interdite, mais la liberté seule ne suffit pas pour déterminer la pleine croissance d'une branche quelconque de l'activité humaine, il faut encore que les garanties de la propriété viennent s'y joindre. Sous ce dernier rapport, la condition des savants est inférieure à celle des inventeurs : on ne considère point leurs découvertes comme appropriables, et ils n'en peuvent tirer, directement du moins, aucun profit. Les gouvernements s'appliquent à combler cette lacune, en mettant au service de la science des observatoires et des laboratoires, en accordant des places aux savants et en les ornant de décorations, mais il est permis de douter que ces allocations et ces faveurs officielles remplacent suffisamment la perspective d'un profit pour attirer les intelligences et les capitaux vers les recherches et les expérimentations de la science pure. L'industrie des inventeurs qui utilisent les découvertes des savants se trouve dans [466] une situation économiquement plus favorable. Quoique la propriété des inventions industrielles ne soit encore qu'incomplètement garantie dans l'espace et dans le temps, elle peut être exploitée, et, s'il y a des inventeurs qui ne couvrent pas leurs frais, il y en a, en revanche, qui réalisent des bénéfices extraordinaires. [40] Ces bénéfices ont été croissant à mesure que le débouché des découvertes et inventions s'est agrandi sous l'influence de l'avènement de la liberté de l'industrie et de l'extension de la liberté du commerce. Grâce à la liberté de l'industrie, les obstacles qui s'opposaient à l'adoption des machines et des procédés nouveaux ont disparu : chacun est devenu libre d'adopter l'outillage et les méthodes qui lui paraissent les plus économiques. D'un autre côté, à mesure que s'étend la sphère des échanges, que la concurrence devient plus générale et plus pressante, chacun est obligé de « demander » cet outillage et ces procédés qui permettent de produire à meilleur marché. La production du progrès matériel est donc placée aujourd'hui dans des conditions, sinon absolument satisfaisantes, du moins bien supérieures à celles où elle se trouvait sous l'ancien régime; aussi cette branche de la manufacture du progrès est-elle particulièrement active et florissante.
Il n'en est pas ainsi malheureusement de l'atelier où s'élabore le progrès moral et politique, où l'on s'occupe d'améliorer, non le matériel, mais le personnel de la civilisation, de rendre l'homme plus capable de gouverner ses affaires et sa vie, comme aussi de perfectionner la machinery qui supplée à l'insuffisance de sa capacité gouvernante. La production de ces deux catégories de progrès est loin d'avoir acquis son développement utile. Comme [467] toutes les autres branches de l'activité humaine, elle exige la coopération du capital et du travail. Or, elle réunit bien moins encore que la production du progrès matériel les conditions propres à les attirer. Ni les découvertes, ni les inventions, dans le domaine des sciences morales et politiques et des arts qui en dérivent, ne sont appropriables, et la seule manière d'en tirer parti, c'est de les consigner dans des ouvrages dont la propriété n'est même pas entièrement sauvegardée, et qui sont d'ailleurs peu « demandés ». Aucune branche de littérature ne possède une clientèle moins nombreuse : le roman le plus fade, le vaudeville le plus insignifiant, rapporte plus qu'un traité d'économie politique, de morale ou de droit des gens, qui résume le labeur de toute une vie. Cette indifférence du public pour des travaux qui intéressent au plus haut degré les destinées de la société, tient sans doute à sa légèreté et à son ignorance, mais elle provient aussi de ce que les inventions et découvertes qui appartiennent au domaine des sciences morales et politiques n'ont guère plus de chances d'être appliquées qu'elles n'en avaient à l'époque où elles étaient prohibées et où l'on brûlait leurs auteurs. Tandis que la liberté de l'industrie permet au premier venu d'utiliser une nouvelle invention mécanique ou une combinaison chimique, et que la liberté du commerce l'y oblige, dès que l'expérience en a démontré la supériorité, les inventions et découvertes qui ont pour objet de perfectionner, soit l'homme, soit les institutions politiques, économiques et sociales, sont obligées de demander leur application précisément aux préjugés qu'elles offensent et aux intérêts qu'elles menacent. S'il s'agit, par exemple, d'un nouveau système d'études, on se heurtera à un programme officiel, rédigé par les occupants de l'ancien système et imposé d'autorité, comme un Koran infaillible et immuable, à tous les jeunes gens qui aspirent à [468] entrer dans une carrière libérale. S'il s'agit d'une innovation en matière d'association et de crédit, on aura à compter avec les prescriptions et les interdictions d'un code qui ne reconnaît comme licites que les formes et les applications déjà existantes et autorisées de l'association et du crédit. S'il s'agit enfin de nouvelles institutions politiques, comment pourraient-elles être acceptées par le personnel en possession des anciennes? Supposons que l'introduction de la locomotive, de l'éclairage au gaz, etc., eût été subordonnée au consentement des propriétaires de la machinery existante, ne serions-nous pas réduits encore à voyager en diligence et à nous éclairer à la chandelle? Supposons qu'en ce moment, les actionnaires des compagnies du gaz aient le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non d'utiliser la lumière électrique : un homme qui passerait son temps et dépenserait sa fortune à chercher la solution du problème de l'éclairage par l'électricité, ne serait-il pas considéré à bon droit comme un esprit chimérique et ne mériterait-il pas d'être pourvu d'un conseil judiciaire? Telle est la situation des hommes qui entreprennent d'innover dans un domaine encore fermé à la concurrence. Cependant, un moment arrive où une société, dont les conditions d'existence ont changé sous l'influence du progrès matériel, ne peut plus supporter son ancienne machiner)/ de gouvernement. Elle fait alors une « révolution »; elle renverse violemment des institutions qui ne s'adaptent plus à ses besoins et elle s'efforce d'en créer d'autres. Malheureusement, les sciences morales et politiques en retard ne lui fournissent point les lumières nécessaires pour accomplir cette tâche difficile; elle demeure livrée aux tâtonnements des empiriques et aux chimères des utopistes jusqu'à ce qu'une réaction la ramène au point d'où elle était partie, et rétablisse les institutions qu'elle avait renversées, en se bornant le plus souvent à en [469] changer le nom et les apparences extérieures. En attendant, cette convulsion douloureuse et stérile a coûté cher, et elle a retardé l'évolution qu'elle avait pour objet d'accélérer.
Nous examinerons d'une manière plus complète, dans une autre série d'études qui sera consacrée à l'Évolution politique, les maux et les désordres qu'engendre cette inégalité du développement des deux grands ateliers de la « manufacture du progrès ». Cependant, en dépit de cette discordance entre le progrès matériel et le progrès moral et politique, le monde marche, et nous commençons à voir poindre à l'horizon l'aurore des temps nouveaux.
Notes
[39] A quel mobile l'homme a-t-il obéi en créant avec la machinery de la production, celle du gouvernement? Il a obéi, avant tout, à la nécessité de pourvoir à ses besoins; en d'autres termes, de conserver et d'accroître l'ensemble des matériaux et des forces qui constituent son être — nécessité qui se manifeste à lui par le plaisir et la peine — toute déperdition de force, sauf dans le cas de surabondance, étant productive d'une peine ou d'une douleur croissante, toute acquisition de force étant, au contraire, productive d'un plaisir. Mais, en vertu de la nature du milieu où nous vivons, la plupart de nos besoins ne peuvent être satisfaits sans un travail qui implique une dépense de force, c'est-à-dire une peine préalable. C'est à diminuer celte peine, tout en augmentant le plaisir contenu dans les résultats du travail, que s'applique l'esprit de recherche et d'invention.
Il semblerait donc que toute machine ou tout procédé qui diminue la somme de nos peines et accroît celle de nos plaisirs dût être acceptée, sans rencontrer d'obstacles. Cependant, l'expérience atteste qu'il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce que, sans parler du dérangement qu'ils apportent dans les habitudes et du dommage qu'ils causent aux intérêts existants, les machines et les procédés nouveaux exigent d'abord un accroissement ou une capitalisation d'efforts qui se traduit par une augmentation de peine. Sans doute, le régime alimentaire des peuplades qui vivaient de la récolte incertaine des fruits naturels du sol ne comportait qu'un minimum de satisfactions et de plaisir avec un maximum de privations et de peine; mais il n'en était pas moins difficile de faire adopter par ces peuplades d'hommes-enfants un système régulier de culture. Comment leur persuader, en effet, de se donner la peine nécessaire pour façonner des instruments aratoires, défricher et cultiver le sol, en vue d'un résultat qui n'était point aussitôt tangible, d'une satisfaction ou d'un plaisir qui ne devait échoir que plus tard, tandis que la peine était immédiate? Comment encore les astreindre aux gênes et aux privations actuelles que leur causaient le respect des droits d'autrui, les prescriptions hygiéniques, etc., en vue d'un bien éventuel, qu'ils étaient incapables d'apprécier? Il ne fallait rien moins que l'intervention d'une autorité toute puissante et infaillible pour imposer des progrès qui commençaient par accroître la privation et la peine présentes en considération d'un bien futur, et telle fut l'autorité religieuse.
[40] On trouvera la démonstration de la légitimité et de l'utilité de la propriété des inventions dans nos Questions d'économie politique et de droit public, t. II, p. 336.
VI.13. "Les gouvernements de l’avenir" (1884)↩
Source
From L'Évolution politique et la Révolution (Paris: C. Reinwald, 1884). Chap. X "Les gouvernements de l'avenir," pp. 351-423.
This book originally appeared as series of articles:
- "L’évolution politique du XIXe siècle," Journal des économistes, S. 4, T. 15, N° 44, août 1881 ;
- 2e article, S. 4, T. 16, N° 47, novembre 1881 ;
- 3e article, S. 4, T. 17, N° 2, février 1882 ;
- 4e article, avril 1882 (source uncertain);
- 5e article, S. 4, T. 19, N° 8, août 1882 ;
- 6e article, S. 4, T. 19, N° 9, septembre 1882 ;
- 7e article, S. 4, T. 21, N° 1, janvier 1883 ;
- 8e article, S. 4, T. 23, N° 8, août 1883 ;
- 9e article, S. 4, T. 24, N° 12, décembre 1883.
Introduction
In chapter X of L’Évolution politique (1884) on "Les gouvernements de l’avenir" (governments of the future) Molinari continued to explore some of the ideas which he had first expressed in the article "La production de la sécurité" (1849) written 35 years previously. They are now part of a much broader canvass which covered many centuries of historical development and introduced some new twists.
He discusses how the economic changes he discussed in the first volume (L'Évolution économique 1880)will affect what he calls "l’industrie du gouvernement" (the industry of government). As in other industries the spread of the division of labour and competition will inevitably change the way governments function and they too will be run like private enterprises - "un gouvernement d’entreprise" (a government enterprise).And just as "la servitude économique" (economic slavery) created by monopolies and tariffs lead to the movement to introduce "la liberté des échanges" (freedom to trade), so would "la servitude politique" lead to a similar movement to introduce "la liberté de government" (freedom of governing).He predicted that this was not too far off in the future:
| Un jour viendra toutefois, et ce jour n’est peut-être pas aussi éloigné qu’on serait tenté de le supposer en considérant la marche rétrograde que la révolution a imprimée aux sociétés civilisées; un jour viendra, disons-nous, où la servitude politique perdra toute raison d’être et où la liberté de gouvernement, autrement dit la liberté politique, s’ajoutera au faisceau des autres libertés. Alors, les gouvernements ne seront plus que des sociétés d’assurances libres sur la vie et la propriété, constituées et organisées comme toutes les sociétés d’assurances. | Nevertheless, the day will come, and this day is perhaps not as far off as one might be tempted to believe considering the retrograded steps which revolution has imposed upon civilised societies; we say the day will come when "political slavery" will lose all its raison d'être and when the liberty of governing, otherwise known as political liberty, will be added to the bundle of(our) other liberties. Then governments will only be "free" insurance companies for life and property, which are constituted and organised like all the other insurance companies. |
One historical example he considers is that of the British East India Company which was a privately charted joint-stock company which ruled much of India between 1757 and 1858. He thought this was an example of "une « compagnie de gouvernement »" (a government company) which with some modifications (such as government imposed limits on how much tax it could raise and guarantees to protect essential individual liberties) might show how alternatives to monopoly government might operate.
Another example was the right of "les consommateurs de sécurité" (consumers of security) to secede from the monopoly state and either provide security themselves or contract with another state to do it for them. This could be achieved by "un acte de sécession individuelle par voie d’émigration" (an act of individual secession by means of emigration) or "un acte de sécession collective" (or an act of collective secession) like the recently concluded American Civil War.
A third very interesting example was a private version of "la concurrence intercommunale et régionale" (inter-communal and inter-regional competition) which had not emerged in France as a result of the centralisation tendencies of the ancien régime and then the post-1789 French state. Molinari "hypothesized" about "une société immobilière" (a privately owned real estate company) which might go into "l’industrie du logement" (the housing industry) by building entire privately owned and run communities or "les villes" (towns). The company would build the roads and provide water, gas, electricity, and security to those people who rented or bought the houses in their private community. As other private towns were built or older ones grew in size, associations would be established to settle disputes between their members - "une union ou un syndicat permanent pour régler ces différentes questions et les autres affaires résultant de la juxtaposition de leurs propriétés" (an organisation or permanent syndicat to rule on these different questions and other matters which result from the juxtaposition of their property). These property owner associations would be free to disband or join with others as they saw fit and as economic circumstances changed. The central state would gradually lose its "raison d’être" and its policing and protecting functions would be absorbed into the broader community and its network of associations.
| C’est ainsi qu’au lieu d’absorber l’organisme de la société, suivant la conception révolutionnaire et communiste, la commune et l’Etat se fondent dans cet organisme. Leurs fonctions se divisent et la société est composée d’une multitude d’entreprises formant, sous l’empire de nécessités communes qui dérivent de leur nature particulière, des unions ou des États libres exerçant chacun une fonction spéciale. L’avenir n’appartient donc ni à l’absorption de la société par l’État, comme le prétendent les communistes et les collectivistes, ni à la suppression de l’État, comme le rêvent les anarchistes et les nihilistes, mais à la diffusion de l’État dans la société. C’est, pour rappeler une formule célèbre, l’État libre dans la Société libre. | Thus, instead of the Commune and the State absorbing the organism of society, according to the ideas of the revolutionaries and the communists, they will melt into this organism. Their functions will be divided and society (will) be composed of a multitude of enterprises which will form, according to the local and particular requirements of the communes, unions or free states each of which will exercise a special function. Thus, the future will result neither in the absorption of society by the State as the communists and collectivists claim, nor in the abolition of the State as the anarchists and nihilists dream, but in the diffusion of the State within society. This will be be, according to the famous saying, "a Free State in a Free Society." |
Text
[351]
CHAPITRE X.
Les gouvernements de l'avenir
I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires.— II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées. § 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises, g 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — III. Du régime économique des Etats politiques dans l'ère de la grande industrie. § 1er. Les servitudes et leur raison d'être. § 2. La servitude politique. § 3. Raison d'être de la servitude politique. § 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. § 5. La liberté de gouvernement. — IV. La commune et son avenir. — V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — VI. La nationalité et le patriotisme.
I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires. — Si nous voulons savoir comment les nations civilisées sortiront de la voie rétrograde où la révolution les a engagées, il est nécessaire que nous nous reportions encore pour un moment à l'époque où le régime des entreprises privées, individuelles ou corporatives, a remplacé le communisme politique, et que nous revenions sur les causes qui ont déterminé cette évolution progressive de l'industrie du gouvernement.
Dans les temps primitifs, avant la création du matériel de la petite industrie, lorsque les hommes encore peu nombreux étaient rassemblés en troupeaux ou en tribus, les fonctions du gouvernement et de la défense de ces sociétés à l'état de germe étaient exercées par les différents [352] membres de la communauté, concurremment avec l'industrie rudimentairo qui leur fournissait leurs moyens de subsistance. Cette industrie, chasse, pêche, récolte des.fruits naturels du sol, ne leur procurant que le strict nécessaire, les fonctions gouvernantes ne pouvaient être rétribuées; elles constituaient autant de charges imposées dans l'intérêt commun et auxquelles on ne pouvait se soustraire sans aggraver celles d'autrui. comme il arriverait dans une association dont certains membres se refuseraient à payer leur cotisation, en prétendant cependant recueillir leur part des profits ou des avantages sociaux.
Mais, à la suite des temps, un progrès immense s'accomplit, le matériel de la petite industrie est créé. Aussitôt, par le fait de l'énorme accroissement de la productivité des industries alimentaires et autres, les fonctions gouvernantes deviennent productives d'onéreuses qu'elles étaient. On voit alors ces fonctions se spécialiser et devenir, comme les autres branches d'industrie, l'objet d'une exploitation par voie d'entreprise. Les hommes qui possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de cette sorte d'entreprise constituent des « sociétés » ayant pour but d'exploiter l'industrie du gouvernement et d'en tirer le plus grand profit possible. Ces sociétés s'approprient un marché dont elles s'efforcent d'exclure les entreprises concurrentes et qu'elles s'appliquent à agrandir en vue d'augmenter leurs bénéfices. En cela, leurs pratiques ne diffèrent point de celles des corporations industrielles ou commerciales auxquelles donnent naissance, dans la même période, les progrès du matériel de la production.
Cependant on peut se demander si les nations vivant de la petite industrie n'auraient pas trouvé plus d'avantage à conserver le régime de la communauté politique, tel qu'il existait dans le troupeau ou la tribu, et de continuer, par conséquent, à répartir entre tous leurs membres les [353] fonctions gouvernantes, devenues productives. Chacun aurait eu sa part dans les profits de l'industrie du gouvernement, tandis que ces profits ont été monopolisés par la société politique qui a imposé ses services à la nation réduite à Fêlat de sujétion. L'humanité n'aurait pas subi l'oppression que les monarchies et les oligarchies politiques et religieuses ont fait peser sur elle pendant une longue suite de siècles; elle eût continué de jouir des bienfaits de la démocratie ou du gouvernement du peuple par lui-même. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi?
Si les choses se sont passées autrement, si nulle part l'ancien régime de la communauté politique n'a pu subsister en concurrence avec le nouveau régime de la concentration du gouvernement dans une corporation particulière, c'est parce que celui-ci était plus efficace et plus économique; plus propre, par conséquent, à donner la victoire, dans la lutte pour l'existence, aux nations qui s'y trouvaient assujetties.
Quelles sont les causes de cette supériorité, démontrée par l'expérience, dos gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires? Ces causes résident, d'une part, dans le principe économique de la division du travail et de la spécialisation des fonctions, de l'autre dans les lois naturelles qui régissent la constitution et la mise en œuvre des entreprises.
En premier lieu, il en est des fonctions du gouvernement comme de toutes les autres. Elles exigent, aussi bien que les fonctions industrielles, artistiques, commerciales, des aptitudes et des connaissances spéciales avec une application continue et exclusive. C'est quand elles se trouvent séparées et spécialisées qu'elles sont le plus productives, qu'elles fournissent les produits et les services les plus abondants, les moins chers et les meilleurs. En supposant que les nations, vivant de la petite industrie, eussent [354] contiuué de se gouverner comme les tribus ou les troupeaux primitifs, que chacun de leurs membres eût coopéré au gouvernement et à la défense de l'Etat en même temps qu'il vaquait aux travaux nécessaires à sa subsistance et à son entretien, les nations eussent été plus mal défendues et gouvernées, défense et gouvernement leur eussent coûté plus cher. C'est exactement ce qui se serait passé si chacun avait continué à pourvoir à tous ses autres besoins, à cultiver son blé, à pétrir son pain, à fabriquer ses habits, à construire et à meubler son habitation, au lieu de s'adonner à une seule industrie et d'en échanger les produits ou les services contre les produits ou les services des autres industries.
En second lieu, un gouvernement est une entreprise comme une autre, et il se trouve à ce titre soumis aux lois naturelles qui régissent la généralité des entreprises. Que ses attributions soient étendues ou limitées, qu'il possède un marché plus ou moins vaste, un gouvernement a besoin d'un matériel et d'un personnel, il exige la concentration d'une quantité plus ou moins considérable de capital, de travail et de connaissances techniques, combinés et mis en œuvre en vue du but à atteindre qui est toujours de produire un maximum d'effet utile en échange d'un minimum de dépense. Or cette constitution et cette organisation économiques des entreprises ont leurs lois que l'expérience a fait découvrir comme elle a révélé celles de la construction des édifices ou de l'architecture, et dont la non-observation entraîne invariablement, au bout d'un temps plus ou moins long selon que les manquements sont plus ou moins graves, la chute des entreprises et l'effondrement des édifices. L'observation et l'expérience démontrent encore que ces lois sont les mêmes pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie, de commerce ou de gouvernement.
[355]
Voyons comment les choses se passent. Un produit ou un service vient à être assez demandé pour qu'on puisse trouver profit à en entreprendre la production. Qu'arrive-t-il alors? Si la demande est peu considérable, si le marché est peu étendu, un homme pourvu de la capacité, des connaissances et des ressources nécessaires entreprend cette production à ses frais et risques. Il fonde une entreprise individuelle. Si le marché est vaste et si le produit ou le service exige, en vertu de sa nature particulière, la mise en œuvre d'une grande agglomération de'forces et de ressources, une entreprise individuelle est ordinairement insuffisante, il faut une entreprise collective. Mais, individuelle ou collective, toute entreprise est soumise à des règles invariables. Ces règles, nous devons nous borner ici à les rappeler d'une façon sommaire. H faut : 1° qu'une entreprise ait la propriété ou la libre disponibilité de ses forces et de ses ressources, ainsi que des résultats de sa production; qu'elle puisse les augmenter ou les diminuer, conserver ses produits ou les mettre au marché aux conditions qu'il lui convient de stipuler; 2° il faut que les ressources et les forces dont elle dispose soient proportionnées aux exigences de la production, et, en même temps, qu'elle ne s'étende pas au delà de certaines limites, déterminées par le degré de puissance de son matériel, de capacité et de connaissances techniques de son personnel, de perfectionnement de ses procédés et de ses méthodes; il faut que sa direction soit une, et, à la fois, intéressée au succès de l'entreprise, libre d'agir et effectivement responsable de ses actes; 4° que tous les cointéressés dans l'entreprise possèdent un droit proportionné à leur intérêt de contrôler sa gestion avec la possibilité matérielle et la capacité d'exercer utilement ce droit de contrôle; 5° qu'elle n'ait autant que possible qu'un seul objet, qu'elle s'applique a une seule branche d'industrie, [356] qu'elle se conforme, en un mot, au principe de la division du travail et de la spécialisation des fonctions productives; 6° enfin et surtout qu'elle soit soumise, dans la mesure nécessaire, à la pression de la concurrence, sinon quelque solides et excellentes qu'aient été, à l'origine, sa constitution et:son organisation, elles finissent par se corrompre et devenir caduques.;
Telles sont, dans toutes les branches de l'activité humaine, les conditions principales et essentielles d'existence;et de succès des entreprises. Celles qui s'en écartent le'plus ne lardent pas à succomber, et, en général, elles ne durent et prospèrent que dans la mesure où elles les réalisent. Or, si l'on étudie la constitution et l'organisation des gouvernements institués sous forme d'entreprises individuelles ou collectives, dès l'époque où les fonctions gouvernantes sont devenues productives, on s'apercevra que ces conditions naturelles d'existence et de succès s'y trouvaient réunies beaucoup plus complètement qu'elles ne pouvaient l'être dans des communautés, composées désormais de millions d'individus, dont l'immense majorité n'avait ni la possibilité matérielle, ni la capacité d'intervenir utilement dans la gestion gouvernementale, sans .-parler des autres causes d'infériorité d'une entreprise communautaire. Qu'en faut-il conclure? C'est que les nations ont trouvé avantage à ce que le gouvernement devînt l'affaire d'une,entreprise particulière au lieu de continuer à être celle de la communauté elle-même. C'est qu'elles ont pu être gouvernées et défendues plus efficacement et à moins de frais.
Il serait impossible d'évaluer l'importance de l'avantage que les nations ont rencontré, au point de vue de l'efficacité des services, dans la substitution des gouvernements, constitués sous forme d'entreprises particulières, aux gouvernements communautaires des temps primitifs. On peut [357] soutenir cependant que cet avantage était illimité, en ce sens que les nations qui auraient conservé le régime de la communauté politique eussent été détruites par celles qui étaient assujetties à un gouvernement d'entreprise. Si lourd et si coûteux que pût être ce gouvernement, toujours valait-il mieux qu'un gouvernement communautaire, en ce qu'il procurait un sécurité extérieure et intérieure que celui-ci était incapable de produire dans la même mesure. Ce point paraîtra décisif si l'on songe que telle est la nature des services d'un gouvernement, que l'insuffisance et l'infériorité de ces services peuvent entraîner la destruction et la ruine de la nation qui les consomme.
Quoique la qualité des services doive passer ici avant le prix dont on les paye, cette dernière considération a cependant bien aussi son importance. Il est bien clair que les consommateurs des services politiques sont intéressés à se les procurer au meilleur marché possible, comme tous les autres. Or il peut arriver qu'une entreprise produisant un article de première nécessité, comme la sécurité ou le pain, en élève le prix non seulement à un taux bien supérieur à celui des frais de la production, mais encore à celui auquel il revenait aux consommateurs lorsqu'ils le produisaient eux-mêmes. Dans ce cas, qu'ont à faire les consommateurs? Avant d'entreprendre de le produire de nouveau eux-mêmes, — ce qui, à première vue, semble la solution naturelle du problème,—ils ont à considérer : 1° s'ils peuvent le produire en qualité aussi bonne et aussi régulière qu'un entrepreneur dont c'est la spécialité, 2° à un prix de revient aussi bas. Dans la négative, —et tel est le cas pour les services d'un gouvernement comme pour tous les autres, — c'est à l'analyse des causes qui permettent au producteur d'exploiter le consommateur et à l'examen des remèdes appropriés à cette nuisance qu'ils doivent s'appliquer d'une manière exclusive.
[358]
Quelles sont les causes qui agissent pour déterminer le prix des produits ou des services? L'observation la plus élémentaire nous apprend que le prix d'un produit ou d'un service quelconque dépend, d'une part, des frais de la production, d'une autre part, de la loi de l'offre et de la demande, et que celle-ci est influencée à son tour par la situation du producteur vis-à-vis du consommateur. Trois cas peuvent se présenter : une entreprise de production peut posséder 1° un monopole illimité, 2° un monopole limité, 3° être soumise à la libre concurrence. Dans le premier cas, les consommateurs sont entièrement à la discrétion du producteur. S'il s'agit d'un article nécessaire à la vie, il peut en élever le prix hors de toute proportion avec les frais de la production, jusqu'à la limite extrême des ressources des consommateurs. Dans le second cas, si le monopole est limité, soit par la coutume (appuyée sur une force suffisante), soit par une charte ou tout autre appareil protecteur, les consommateurs pourront être préservés, en partie du moins, de l'abus de la puissance que le monopole confère au producteur, à la condition cependant, — et cette condition a été rarement remplie, — que l'appareil préservatif possède et conserve une efficacité réelle. Dans le troisième cas, si l'entreprise est soumise à la concurrence, il n'y aura plus lieu de recourir à un appareil quelconque pour modérer le prix des produits ou des services et en maintenir la qualité, la concurrence suffira, pourvu qu'elle soit entièrement libre; le prix de vente ou prix courant couvrira simplement les frais de la production avec adjonction du profit nécessaire.
Les gouvernements de l'ère de la petite industrie appartenaient aux deux premières catégories. Les uns possédaient vis-à-vis des consommateurs politiques un monopole illimité, les autres un monopole limité. Les premiers pouvaient, en conséquence, augmenter selon leur bon plaisir [359] le prix de leurs services et en abaisser la qualité. Toutefois deux circonstances agissaient pour les empêcher d'abuser de ce pouvoir excessif. C'était, d'une part, la propriété perpétuelle ou tout au moins indéfinie de leur marché, qui les intéressait à ne point ruiner leur clientèle; c'était, d'une autre part, la pression continue de la concurrence politique et guerrière qui les obligeait de même à éviter de tarir la source où ils puisaient les moyens de la soutenir. Les seconds, ceux dont le monopole était plus ou moins efficacement limité, se trouvaient obligés de compter avec les consommateurs, mais nous avons vu qu'à mesure que les Etats politiques s'étaient agrandis et unifiés, leurs propriétaires s'étaient débarrassés d'une limitation et d'un contrôle qui leur paraissaient gênants et humiliants, et qu'ils avaient recouvré, pour la plupart, l'intégrité de leur monopole. Comme, dans l'intervalle, la pression de la concurrence politique et guerrière s'était ralentie et affaiblie, la gestion des gouvernements s'était relâchée, la qualité de leurs services avait baissé tandis que le prix s'en était élevé. De là, le mécontentement de plus en plus général et accentué des consommateurs politiques et la nécessité d'un changement de régime.
II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées.—§ 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises. — Qu'il existe des lois naturelles qui régissent les entreprises, que ces lois soient les mêmes pour toutes les entreprises, politiques, agricoles, industrielles ou commerciales; qu'elles continuent aujourd'hui de gouverner leur constitution et leurs opérations comme elles les gouvernaient il y a des milliers d'années, comme elles les gouverneront dans l'avenir le plus reculé; que la méconnaissance de ces lois naturelles et immuables de l'architecture et du gouvernement des entreprises ait [360] pour résultat inévitable de déterminer l'abaissement de la qualité et l'exhaussement du prix de leurs produits ou dé leurs services et finalement de précipiter leur chute, voilà ce que nous apprend l'étude économique de l'histoire du passé et mieux encore celle de l'histoire contemporaine.
Si nous considérons les gouvernements de l'ancien régime, nous constaterons, en effet, que les plus solides, ceux qui ont duré le plus longtemps et rendu les meilleurs services aux populations, étaient, invariablement, ceux-là dont la constitution et la gestion se conformaient de plus près aux lois que nous avons énumérées. Nous serons frappés aussi de la similitude qui existe entre leur constitution et leur gestion et celles des autres entreprises, industrielles ou commerciales. L'intérêt d'une famille ou d'une société limitée en nombre est le mobile qui préside à la fondation de l'établissement politique. Cet établissement est la propriété perpétuelle et héréditaire d'une « société » ou d'une «maison» qui l'exploite de père en fils, à ses frais et risques et qui subsiste des profits de son exploitation, après avoir pourvu à l'entretien et au renouvellement de son matériel et à la rétribution de son personnel. Le roi gouverne souverainement son Etat comme le chef d'industrie gouverne sa fabrique et le négociant son comptoir; il supporte toute la responsabilité de ses opérations et de ses obligations pécuniaires. L'établissement politique n'a que des attributions restreintes; il ne produit que des services essentiels mais peu variés, la sécurité intérieure et extérieure (encore les services de la justice proprement dite ont-ils fini par être confiés à une compagnie presque indépendante) et la monnaie. Toutes les autres productions sont abandonnées à la multitude des entreprises agricoles, industrielles, commerciales, constituées et gérées comme l'établissement politique qui les protège.
Si nous examinons maintenant la structure et le mode [361] de gestion des gouvernements issus de la révolution, nous reconnaîtrons qu'ils s'écartent par des points essentiels des lois qui président à la construction et à l'exploitation des entreprises industrielles ou commerciales. L'Etat a cessé d'être la chose d'une famille ou d'une association limitée, il appartient à une nation, c'est-à-dire à une communauté dont les membres se comptent par millions, dont l'intérêt dans cette entreprise est infinitésimal, et qui n'ont d'ailleurs pour la plupart ni la possibilité ni la capacité d'intervenir d'une manière active et utile dans sa gestion. Par suite de cet émiettement d'intérêts, de cet empêchement matériel et de cette incapacité de l'immense majorité de ses propriétaires, l'exploitation de l'État est livrée à des associations politiques qui tantôt s'en emparent en recourant à la force, tantôt en se la faisant adjuger pour un temps limité par l'assemblée des propriétaires, ou pour mieux dire par un corps électoral composé des propriétaires réputés politiquement capables. Sans parler des fraudes inévitables auxquelles donne lieu cette adjudication d'une entreprise dont les opérations se chiffrent par milliards, quel en est le résultat? C'est de remettre l'exploitation de l'État à une association qui, n'en ayant que la jouissance temporaire, est intéressée à en tirer la plus grande somme possible de bénéfices et d'avantages dans cet intervalle limité, dût-elle sacrifier au présent qui lui appartient l'avenir qui ne lui appartient pas. De là sa tendance irrésistible à augmenter les attributions de l'État, partant les bénéfices et avantages que son exploitation peut conférer, tendance encore développée par les nécessités de la compétition des associations organisées en vue de conquérir ou de se faire adjuger l'exploitation de l'État. Enfin, ces exploitants temporaires, quels que soient les erreurs, les fautes et même les crimes de leur gestion n'ont point à en supporter les conséquences : le seul risque qu'ils courent, c'est, à l'expiration [362] de leur jouissance, de voir l'État adjugé à d'autres; mais c'est la nation propriétaire qui supporte, avec la dépréciation de son domaine, la responsabilité des dettes dont ils l'ont grevé. Faut-il s'étonner si, en présence de ces dérogations aux lois essentielles de la construction et de la gestion des entreprises,les gouvernements n'ont plus qu'une durée éphémère, tout en imposant aux nations des sacrifices de plus en plus disproportionnés avec leurs ressources? On a remarqué avec raison qu'en admettant que les entreprises industrielles et commerciales fussent constituées et gouvernées comme les Etats politiques, elles seraient promptement vouées à la banqueroute. Si les États subsistent, c'est grâce à l'étendue des ressources des nations propriétaires et au développement progressif de leur industrie; mais si ce régime politique devait se perpétuer, il ruinerait à la longue les nations les plus riches et les plus industrieuses. Cela étant, quel est donc le problème à résoudre, problème qui s'imposera d'une manière plus pressante aux nations civilisées à mesure qu'elles subiront davantage les dommages de l'état présent des choses? Ce problème consiste à ramener les gouvernements modernes à l'observation des principes essentiels qui président à la construction et à la gestion des entreprises, en prenant pour modèles les entreprises industrielles et commerciales qui n'ont pas cessé d'être construites et gouvernées conformément à ces principes. Ainsi il faudra : 1° que l'État politique redevienne la chose d'une maison ou d'une association limitée en nombre, et dont tous les membres aient par conséquent un intérêt suffisant à ce qu'il soit bien constitué et géré; 2° que cette maison ou cette association en soit propriétaire à perpétuité, qu'elle le gère librement et souverainement sous sa responsabilité effective, sans pouvoir rejeter cette responsabilité sur les consommateurs politiques; en un mot, que la nation ne soit pas plus obligée de combler [363] les déficits et de payer les dettes de l'entrepreneur exploitant de l'État que ne l'est un consommateur de pain ou de viande de combler les déficits et de payer les dettes de son boulanger ou de son boucher; et telle était en droit, sinon toujours en fait, la situation sous l'ancien régime; enfin, que la maison ou l'association propriétaire exploitante de l'État limite, encore à l'exemple des gouvernements de l'ancien régime, et d'une manière plus rigoureuse, son industrie à la production de la sécurité, en abandonnant tous les autres produits et services, sans excepter la monnaie, aux autres entreprises. Alors, mais seulement alors, les gouvernements pourront de nouveau compter leur existence par siècles; ils cesseront d'être, suivant une expression pittoresque de J.-B. Say, les ulcères des nations.
§ 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — Est-ce à dire que le progrès politique consiste à revenir purement et simplement aux gouvernements de l'ancien régime? Non, pas plus qu'il ne consisterait à revenir pour la construction de nos maisons et de nos édifices à l'architecture de l'ancienne Egypte, sous le prétexte que les lois de l'architecture n'ont pas changé depuis les Pharaons. La forme des édifices a changé et changera encore, si les lois qui président à leur construction sont demeurées immuables. Il en est de même de la forme des entreprises politiques et autres.
Sous l'ancien régime, la forme des gouvernements était monarchique ou oligarchique, sauf dans quelques petits cantons de la Suisse où elle était demeurée communautaire ou démocratique. Autrement dit, l'État était la propriété d'une maison ou d'une association, et cette propriété se léguait de père en fils, suivant les lois naturelles de l'hérédité, plus ou moins modifiées par des dispositions ou des conventions particulières. Tel était aussi le régime des [364] autres entreprises. Ce régime a continué de prévaloir dans celles-ci : les entreprises industrielles ou commerciales appartiennent soit à des maisons, soit à des associations. Seulement, ces dernières, qui avaient jadis une forme identique à celle des oligarchies politiques, ont été transformées par l'invention des titres transmissibles et nous avons montré les avantages de cette nouvelle forme des entreprises, malgré ce qu'elle a encore d'imparfait et de défectueux. [58] Elle est, avons-nous dit, la forme adaptée au régime de la grande industrie comme l'entreprise patrimoniale a été celle qui s'adaptait le mieux à la petite industrie. On peut donc prévoir que les « maisons politiques » disparaîtront peu à peu, comme disparaissent, dans les exploitations qui exigent de grandes accumulations de capitaux et de forces, telles que les chemins de fer, les mines, etc., les « maisons » pour faire place aux « sociétés ». Déjà il n'est point sans exemple que cette forme progressive des entreprises ait été appliquée à des établissements politiques. La Compagnie des Indes anglaises en a été le spécimen le plus célèbre, et si l'invasion des doctrines communistes en Angleterre n'avait déterminé sa suppression, elle continuerait d'être citée camme un modèle de bonne gestion politique et d'administration économique. [59]
[365]
III. Du régime économique des États politiques dans tare de la grande industrie. — § 1er. Les servitudes et leur raison [366] d'etre. — Nous venons de voir quelle sera la forme probable des États politiques dans l'ère de la grande industrie; il [367] nous reste à rechercher maintenant quel sera leur régime économique. Sera-ce le monopole illimité ou limité vis-à-vis [368] des consommateurs, comme dans l'ère de la petite industrie, ou sera-ce la concurrence? Dans toutes les autres branches [369] d'industrie, ce dernier régime est celui qui a commencé généralement à prévaloir. Les entreprises peuvent se [370] constituer librement, en nombre illimité, tandis que les consommateurs, de leur côté, sont libres de s'adresser à celles qui leur offrent les produits ou les services qu'ils jugent les meilleurs et les moins cbers. Sous ce régime, le producteur est libre de constituer son entreprise, de confectionner ses produits ou ses services et d'en fixer le prix à son gré; mais le consommateur, à son tour, est libre d'accepter ou de refuser produits et services. La liberté, tel est donc le régime qui préside aux relations des producteurs et des consommateurs et qui est destiné à y présider de jour en jour davantage, dans les différentes branches de l'activité humaine.
Mais ce régime est-il actuellement applicable aux entreprises politiques? Le sera-t-il jamais?
Pour résoudre cette question, il est nécessaire que nous nous reportions encore au régime qui a prévalu jusqu'à une époque récente dans la production de la généralité des produits ou des services. Ce régime était celui de l'appropriation du marché, ou du monopole de son approvisionnement, monopole tantôt illimité, tantôt limité par la coutume ou un appareil réglementaire, et impliquant pour le consommateur une servitude restrictive de sa liberté naturelle. Les maisons ou les corporations industrielles et commerciales, aussi bien que les maisons ou les corporations politiques et religieuses, possédaient leur marché. Dans les limites de ce marché, elles ne souffraient point qu'aucun autre établissement se fondât pour leur faire concurrence ou que des établissements placés au dehors y importassent leurs produits ou leurs services. Cette propriété de leur [371] marché, elles la défendaient de tout leur pouvoir : en matière politique et religieuse, toute tentative d'empiéter sur ce marché ou de le morceler était recherchée avec un soin particulier et rigoureusement punie. L'inquisition, par exemple, avait été instituée dans le but de défendre les marchés approprié»au culte catholique, et par conséquent de sauvegarder les profits de leur exploitation, contre toute concurrence intérieure ou extérieure. De même les corporations industrielles et commerciales invoquaient le secours de la maison ou de la corporation politique pour empêcher l'importation des produits étrangers, et interdire aux autres corporations placées dans les limites de l'État d'empiéter sur leur domaine particulier. Sous le régime de l'état de guerre, ce régime, au moins dans ses applications aux articles nécessaires à la vie, ne garantissait pas seulement la sécurité des producteurs, mais encore celle des consommateurs. Dans un pays continuellement exposé à la guerre, — et n'oublions pas qu'aux époques où nous nous reportons la paix était l'exception et la guerre la règle, — si les entreprises agricoles et industrielles n'avaient point possédé leur marché, il leur eût été impossible de proportionner leur production aux besoins de la consommation. Dans les intervalles de paix, les produits importés du dehors auraient dérangé toutes lesprévisions des producteurs en leur causant des pertes ruineuses et déterminé, dans la production intérieure, une diminution qui, la guerre survenant de nouveau, et avec elle l'interruption des communications extérieures, eût exposé les consommateurs à la privation de produits nécessaires. Les servitudes agricoles et industrielles constituaient donc pour eux aussi bien que pour les producteurs une véritable assurance. Cependant, à mesure que les guerres sont devenues moins fréquentes et les communications internationales plus faciles, l'utilité de cette assurance a diminué, et les gouvernements se [372] sont moins appliqués à la garantir. Ils ont cessé de maintenir dans son intégrité la prohibition des produits étrangers, d'abord en autorisant, moyennant redevance, l'établissement des foires ou marchés temporaires libres; ensuite, en autorisant, en tous temps, l'importation de la plupart des denrées et marchandises, sous payement d'une taxe ou « droit d'entrée » ; ils ont laissé envahir le marché des corporations soit par de nouvelles maîtrises qu'ils autorisaient moyennant finance, soit par des entreprises libres qu'ils assujettissaient simplement au droit de patente; enfin, ils ont établi, comme un fait général, la liberté de l'industrie et du commerce à l'intérieur, substituant ainsi au dedans des frontières de l'État la concurrence au monopole.
La nécessité de cette assurance en cas de guerre était, comme on sait, le plus fort argument des protectionnistes anglais contre le rappel des lois-céréales. L'abrogation de ces lois tutélaires placerait, disaient-ils, l'Angleterre sous la dépendance de l'étranger pour sa subsistance, et ils faisaient ressortir, avec une inquiétude vraie ou simulée, les dangers d'un tel état de choses. L'événement leur a donné raison sur le premier point, car l'Angleterre achète aujourd'hui à l'étranger plus de la moitié de la masse des denrées alimentaires qui entrent dans sa consommation; en revanche, grâce au développement extraordinaire des moyens de communication le risque qu'une guerre peut lui faire courir de ce chef s'est singulièrement atténué. C'est pourquoi la nation anglaise a préféré s'y exposer plutôt que de continuer à payer, pour le couvrir, la prime de renchérissement des lois-céréales. [60]
Quant à la religion, aussi longtemps qu'elle est demeurée un instrument de gouvernement, son marché a été protégé à [373] l'égal de celui de l'Etat; mais à mesure que les liens qui attachaient l'Église à l'État se sont relâchés, la servitude religieuse a. été moins garantie et elle est en train de disparaître.
Au moment où nous sommes, le régime de la liberté de l'industrie, impliquant la concurrence intérieure, a généralement prévalu dans les États civilisés, tant pour les produits de l'agriculture, de Findustre et des arts que pour les services religieux, et les progrès de la liberté commerciale [374] y ajoutent, de plus en plus, la concurrence extérieure. L'ancien régime des marchés appropriés n'existe plus que pour un petit nombre d'industries, les unes réputées en possession d'un monopole naturel et soumises à une réglementation destinée à le limiter, les autres englobées, pour des raisons diverses, dans la régie de l'État.
§ 2. La servitude politique. — Cet ancien régime des marchés appropriés, tous les États se sont appliqués, en revanche, à le conserver pour leurs propres services. Les États issus de la révolution se sont même montrés plus encore que les autres jaloux de le maintenir, et de perpétuer, apparemment dans l'intérêt de la liberté, la servitude politique. En France, le gouvernement révolutionnaire a commencé par proclamer l'indivisibilité de la République, et le gouvernement de l'Union américaine a sacrifié à cette nécessité, réelle ou supposée, un million de vies humaines et quinze ou vingt milliards de francs, engloutis dans la guerre de sécession. Toute tentative de séparation est considérée comme un crime de haute trahison que les républiques démocratiques aussi bien que les monarchies absolues ou constitutionnelles réprouvent avec horreur et châtient avec sévérité. [61] On va même plus loin : en vue de prévenir [375] les tentatives de morcellement du marché politique, on oblige les populations suspectes de tendances sécessionnistes à renoncer à leurs institutions et à leur langue, et on leur impose les institutions et la langue dites « nationales».
Il s'agit de savoir si ces mesures répressives et préventives, sans parler de la réprobation morale, sont justifiées ou non; si, tandis que le progrès a consisté à supprimer les servitudes industrielles, commerciales et religieuses qui assuraient aux corporations de l'ancien régime la propriété de leur marché, à l'exclusion de toute concurrence intérieure ou extérieure, cette servitude doit être maintenue pour le marché politique; s'il est, et s'il sera toujours nécessaire que les consommateurs politiques demeurent assujettis à la maison, à la corporation ou à la nation propriétaire exploitante de l'Etat, et contraints de consommer ses services bons ou mauvais ; s'ils ne pourront jamais posséder la liberté de fonder des entreprises politiques en concurrence avec celle-là, d'accorder leur clientèle à des entreprises concurrentes ou même de ne l'accorder à aucune dans le cas où ils trouveraient plus d'avantage à demeurer les propres assureurs de leur vie et de leur propriété; s'il est, en un mot, dans la nature des choses que la servitude politique se perpétue et que les hommes ne puissent jamais posséder la liberté de gouvernement.
Il est clair que cette servitude, — la plus onéreuse de toutes, car elle s'applique à des services de première [376] nécessité, — ne peut être maintenue, sous un régime où la liberté est de droit commun, qu'à une condition, c'est d'être motivée par l'intérêt général. Si cet intérêt exige que les propriétaires exploitants des établissements politiques demeurent investis de lapropriété intégrale de leur marché, aussi longtemps du moins qu'ils ne sont pas obligés de céder une partie de ce marché, à la suite d'une guerre malheureuse, ou qu'ils ne jugent point avantageux de s'en dessaisir par une vente ou un troc, « la liberté de gouvernement » ne saurait être établie utilement comme l'ont été la liberté des cultes, de l'industrie et du commerce. Dans cette hypothèse le droit de sécession devrait être à jamais frappé d'interdit ou, pour mieux dire, il n'y aurait pas de droit de sécession. Il convient de remarquer toutefois que des brèches importantes ont déjà été faites à cette partie du vieux droit public, sous l'influence des changements que les progrès de la sécurité, de l'industrie et des moyens de communication ont introduits dans les relations des peuples civilisés. Si les gouvernements n'admettent aucune concurrence dans les limites de leur marché, ils ont généralement renoncé à empêcher leurs sujets de faire acte de sécession individuelle par voie d'émigration et de naturalisation à l'étranger. En revanche, ils n'admettent aucun acte de sécession collective, qui entame leur domaine territorial. Toutefois encore, si les sécessionnistes sont assez forts pour opérer cette séparation comme l'ont été les colons anglais et espagnols de l'Amérique du Nord et du Sud, les anciens propriétaires exploitants de ces marchés séparés se résignent à accepter le « fait accompli » et ils finissent même par reconnaître la légitimité des gouvernements sécessionnistes. Mais dans ce cas ils ne cèdent qu'à la force, et il est presque sans exemple qu'une sécession ait été accomplie à l'amiable.
Examinons donc quels motifs peuvent être invoqués en [377] faveur du maintien de la servitude politique, —en prenant ce mot dans son acception économique, — tandis que les autres servitudes ont cessé généralement d'être considérées comme nécessaires.
§ 3. Raison d'être de la servitude politique. — Sous l'ancien régime, cette servitude était, comme toutes les autres, motivée par les nécessités de l'état de guerre. En supposant qu'une partie de la nation eût possédé le droit de se séparer de l'État soit pour s'annexer à un État concurrent soit pour fonder un État indépendant, soit enfin pour vivre sans gouvernement, l'exercice de ce droit eût produit une nuisance générale, nuisance d'autant plus grande que la nation eût été exposée à être envahie, détruite ou assujettie par des peuples moins avancés, tels que les barbares qui menaçaient les frontières des Etats de l'antiquité et du moyen âge. La sécession d'une partie de la population, en diminuant ou simplement en divisant les forces de l'Etat eût aggravé le risque de destruction, d'asservissement et en tous cas de recul de civilisation qui pesait sur la nation à laquelle l'Etat servait de rempart. On peut comparer la situation des nations civilisées, dans cette période de l'histoire, à celle des populations des contrées menacées incessamment, comme la Hollande, par les flots de l'océan. Il est nécessaire que tous les habitants, sans exception, contribuent à l'entretien des digues; ceux qui s'y refuseraient profiteraient indûment d'un appareil de défense dont ils ne supporteraient point les frais; ils augmenteraient d'autant les charges des autres, et si les ressources de ceux-ci ne suffisaient point pour élever des digues assez solides et assez hautes, ils s'exposeraient eux-mêmes à être victimes de leur malhonnête égoïsme; ceux qui s'obstineraient à établir des digues particulières sans les rattacher au système commun compromettraient de même l'œuvre nécessaire de la défense contre l'élément destructeur. Aux époques où [378] la civilisation était menacée par la barbarie, la servitude politique s'imposait donc comme une absolue nécessité. En revanche, elle a perdu en grande partie sa raison d'être depuis que la supériorité des forces a passé du côté des peuples civilisés. Cependant elle peut encore être motivée, quoique à un degré moindre, par les inégalités de civilisation qui subsistent de pays à pays.
Dans l'état actuel du monde, bien que la supériorité des forces physiques et morales, des ressources et des connaissances techniques qui sont les matériaux de la puissance militaire, appartienne visiblement aux nations les plus civilisées, on ne saurait affirmer qu'elles soient entièrement à l'abri des invasions des peuples moins avancés. Sans doute, les populations de l'Empire russe, par exemple, n'ont aucun intérêt à envahir l'Europe centrale et occidentale, à la manière des hordes barbares et pillardes qui détruisirent jadis l'Empire romain ; mais dans l'état arriéré où se trouve encore la constitution politique de l'Europe, ce n'est pas l'intérêt général des populations qui décide de la paix et de la guerre. Tantôt, c'est l'intérêt bien ou mal entendu d'une maison souveraine et de l'armée de fonctionnaires militaires et civils sur laquelle elle s'appuie; tantôt c'est l'intérêt d'un parti, dont l'état-major se recrute dans une classe vivant du budget et de ses attenances et à laquelle la guerre fournit un accroissement de débouchés, partant de bénéfices, ou simplement dont elle peut, suivant les circonstances, consolider la domination. Dans cette situation et aussi longtemps qu'elle subsistera, les peuples les plus civilisés demeureront exposés au risque de l'invasion et de la conquête, et la « servitude politique » conservera jusqu'à un certain point sa raison d'être. Mais que cet état de choses vienne à cesser, que l'intérêt général des « consommateurs politiques » acquière assez de puissance pour maîtriser les appétits d'exploitation et de rapine des [379] producteurs, que le risque d'invasion et de conquête s'affaiblisse en même temps que s'effaceront, sous l'influence de la multiplicité des échanges, et du rayonnement des lumières, les inégalités de civilisation, la « servitude politique » perdra toute raison d'être, la « liberté de gouvernement » deviendra possible.
§ 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. — En attendant, les « consommateurs politiques » devront se résigner à supporter les défectuosités naturelles du vieux régime de l'appropriation des marchés, sauf à recourir aux moyens, malheureusement toujours imparfaits et insuffisants, de limiter la puissance du monopole auquel ils se trouvent assujettis. Le système adapté actuellement à cet état de choses est celui du gouvernement constitutionnel ou pour mieux dire contractuel, monarchique ou républicain, se résolvant dans un contrat débattu et conclu librement entre la « maison » ou la « société » productrice des services politiques et la nation qui les consomme.
Seulement, ce système doit être établi de manière à respecter les lois naturelles qui régissent toutes les entreprises, politiques, industrielles ou commerciales, soit qu'elles possèdent un monopole, soit qu'elles se trouvent soumises à la concurrence. Il faut que la mai son ou la société politique possède un capital proportionnné à l'importance et aux exigences de son entreprise, capital immobilier et mobilier, investi sous forme de forteresses, de matériel et de provisions de guerre, de bureaux d'administration et de police, de prisons, de monnaie destinée au paiement de ses employés et de ses ouvriers civils et militaires, etc., etc. ; qu'elle soit maîtresse d'organiser son exploitation et de recruter son personnel, sans qu'aucune condition ou limite lui soit imposée. En revanche, il faut qu'elle subisse la responsabilité pécuniaire de ses actes et de ses entreprises; qu'elle [380] en supporte les pertes sans pouvoir les rejeter sur les consommateurs, sauf dans les cas de force majeure, — une invasion de barbares par exemple, —spécifiés dans le contrat; qu'elle en recueille les bénéfices, sauf encore à partager ceux-ci avec les consommateurs, au-dessus d'un certain taux fixé de même dans le contrat ; il faut enfin que ses pouvoirs et ses attributions soient strictement limités à ce qu'exige le bon accomplissement de ses services, qui consistent à préserver de toute atteinte intérieure et extérieure la vie et la propriété des consommateurs politiques, sans qu'il lui soit permis d'empiéter sur le domaine des autres industries. Telles doivent être, en substance, les conditions du contrat si l'on veut que les maisons ou les sociétés productrices de services politiques puissent, de nouveau, fonctionner d'une manière utile et durable. C'est pour les avoir méconnues, sous l'influence des doctrines et des faits révolutionnaires, c'est pour avoir cessé de tenir compte, dans la constitution et le fonctionnement des entreprises politiques, des lois naturelles qui régissent toutes les entreprises que l'on a essayé en vain de fonder des gouvernements économiques et stables, et que l'on n'a pas réussi davantage à adapter à l'état présent des sociétés ceux que nous a légués l'ancien régime.
Cependant, ces conditions du contrat politique, les nations peuvent-elles les débattre elles-mêmes et en surveiller l'exécution? N'est-il pas indispensable qu'elles choisissent des mandataires, d'abord pour rédiger le contrat après en avoir débattu les clauses avec les délégués de la maison ou de l'association politique, ensuite pour le modifier et le perfectionner s'il y a lieu, enfin pour surveiller et contrôler la fourniture des services politiques, sous le double rapport de la qualité et du prix, régler le compte de participation de la nation aux pertes et aux bénéfices de l'entreprise? Cette nécessité a été considérée jusqu'à [381] présent comme indiscutable. Toutefois, en présence de la corruption à peu près inévitable du régime représentatif, on peut se demander si les garanties qu'on croit y trouver ne sont pas, le plus souvent, illusoires, s'il ne serait pas préférable d'abandonner aux consommateurs eux-mêmes le soin de débattre les conditions du contrat, de le modifier et d'en surveiller l'exécution, sans leur imposer aucune formule de représentation. Sans doute, les consommateurs politiques sont individuellement incapables de se charger de cette tâche, mais des associations librement formées entre eux ne pourraient-elles pas s'en acquitter avec l'auxiliaire de la presse? Dans les pays où la masse de la population ne possède ni la capacité ni les loisirs nécessaires pour s'occuper des choses de la politique, cette représentation libre des consommateurs, recrutée parmi ceux qui possèdent cette capacité et ces loisirs, ne serait-elle pas un instrument de contrôle et de perfectionnement de la gestion do l'État plus efficace et moins sujet à se rouiller ou à se vicier que la représentation officielle d'une multitude ignorante ou d'une classe privilégiée?
§ 5. La liberté de gouvernement. —Un jour viendra toutefois, et ce jour n'est peut-être pas aussi éloigné qu'on serait tenté de le supposer en considérant la marche rétrograde que la révolution a imprimée aux sociétés civilisées; un jour viendra, disons-nous, où la servitude politique perdra toute raison d'être et où la liberté de gouvernement, autrement dit la liberté politique, s'ajoutera au faisceau des autres libertés. Alors, les gouvernements ne seront plus que des sociétés d'assurances libres sur la vie et la propriété, constituées et organisées comme toutes les sociétés d'assurances. De même que la communauté a été la forme de gouvernement adaptée aux troupeaux et aux tribus des temps primitifs, que l'entreprise patrimoniale ou corporative, avec monopole absolu ou limité par des [382] coutumes, des chartes, des constitutions ou des contrats, a été celle des nations de l'ère de la petite industrie; l'entreprise par actions avec marché libre sera, selon toute apparence, celle qui s'adaptera aux sociétés de l'ère de la grande industrie et de la concurrence. [62]
IV. La commune et son avenir. — Dans les temps primitifs, les sociétés embryonnaires, vivant de la chasse, de la pêche et de la récolte des fruits naturels du sol, formaient des communautés politiques, au gouvernement et à la défense desquelles tous leurs membres étaient obligés de contribuer. Dans la période suivante, lorsque la mise en culture régulière des plantes alimentaires et la création de la petite industrie eurent permis aux hommes de se multiplier en proportion de l'énorme accroissement de leurs moyens de subsistance, les fonctions politiques, devenues productives, se séparèrent et se spécialisèrent entre les mains d'une corporation ou d'une maison, fondatrice et exploitante de l'État. Soit qu'il fût partagé entre les membres de la corporation et formât un ensemble de seigneuries rattachées par les liens de la féodalité, soit qu'il se concentrât entre les mains d'un seul maître et propriétaire héréditaire, ce domaine politique dut être subdivisé en raison des nécessités de sa gestion. Cette subdivision s'opéra de deux manières : tantôt elle fut l'œuvre des propriétaires exploitants de l'État, tantôt celle des populations qui leur étaient assujetties.
Dans tous les pays où la population conquise a été réduite en esclavage, la commune, par exemple, ne se constitue ou pour mieux dire ne se reconstitue qu'à l'époque où les esclaves passent à l'état de serfs; dans ceux où les [383] conquérants se bornent à assujettir les habitants au servage, la commune est constituée par la tribu ou le troupeau primitif, fixé au sol, d'abord par les nécessités de l'exploitation de l'agriculture et des métiers, ensuite par l'intérêt du propriétaire du domaine politique qui vit de l'exploitation du cheptel humain de ce domaine, en l'obligeant à en cultiver une partie à son profit, et en lui laissant la jouissance du reste. Mais soit qu'il s'agisse d'une population passée de l'esclavage au servage ou immédiatement réduite à cette forme progressive de la servitude, le propriétaire politique, roi ou seigneur, ne s'impose la peine et les frais nécessaires pour la gouverner qu'autant qu'il y est intéressé et dans la mesure de son intérêt. Il laisse les groupes ou les communautés se former à leur convenance suivant la configuration du sol, la facilité des communications locales, la langue et les affinités de race ou de caractère, sauf à empêcher chaque commune d'empiéter sur les limites des autres ou de franchir celles de son domaine. [63] Il les laisse encore suivre leurs coutumes, parler leur langue ou leur patois, se servir de leurs poids et mesures, pourvoir, à leur guise, à leurs divers besoins individuels ou collectifs, en exceptant seulement les services susceptibles de lui valoir une rétribution ou un profit. Il les oblige par exemple à lui acheter du sel, à se servir de sa monnaie, de son four et de son pressoir; enfin, il les soumet à sa justice, [384] au moins quand il s'agit de crimes ou de délits qui troublent la paix du domaine et surtout d'atteintes à ses droits et de révoltes contre sa domination. Les communes forment d'autres groupements, des cantons, des bailliages pour l'établissement et l'entretien des moyens de communication, la perception des redevances, et plus tard, lorsque les seigneuries sont absorbées dans le domaine royal, elles forment des provinces administrées par un intendant. Certaines communes favorablement situées pour l'industrie et le commerce prennent un développement considérable; elles deviennent des villes; les industries et les métiers se constituent en corporations, dont les chefs ou les notables administrent la cité sous l'autorité du seigneur. Il arrive alors, surtout lorsque le seigneur exige des redevances trop lourdes; lorsque son joug est tyrannique ou bien encore lorsque les magistrats et les meneurs du peuple sont affamés de domination, que les communes veulent s'affranchir de l'autorité seigneuriale et se gouverner ellesmêmes. Quelquefois le seigneur consent à leur vendre la franchise, en capitalisant la somme des redevances ; d'autres fois, elles entreprennent de la conquérir par la force. En France, le roi favorise cette insurrection des communes, en vue d'abaisser la puissance des seigneurs. Mais il arrive rarement que les communes affranchies réussissent à se bien gouverner elles-mêmes. Tantôt la population est exploitée par l'oligarchie des métiers, tantôt la commune est le théâtre de la lutte des partis, recrutés les uns dans la bourgeoisie, les autres dans la populace, qui se disputent l'exploitation du petit État communal. C'est une lutte analogue à celle dont nous sommes aujourd'hui témoins, dans les pays où l'État est devenu la propriété de la nation. Cependant, lorsque les grandes seigneuries eurent absorbé les petites et, plus tard, lorsque la royauté eut absorbé les grandes, on vit disparaître ce que les communes et [385] les provinces avaient acquis ou conservé d'indépendance. Telle était la disproportion entre les forces dont disposait le maître d'un grand État et celles d'une commune ou même d'une province que toute lutte était désormais impossible entre eux. La conséquence fut que communes et provinces ne conservèrent que la portion du gouvernement d'ellesmêmes que le maître de l'État ne trouva aucun profit à leur enlever ou qui aurait été pour lui une charge sans compensation suffisante. Telle était la situation lorsque la Révolution éclata.
Tout en faisant passer entre les mains de leurs intendants et de leurs autres fonctionnaires civils et militaires les attributions et les pouvoirs exercés auparavant par les seigneurs et leurs officiers, en augmentant même ces attributions et ces pouvoirs, aux dépens de ceux des agents du self government communal ou provincial, les rois avaient cependant respecté, dans une certaine mesure, les coutumes locales, et ils ne s'étaient point avisés de toucher aux groupements qui s'étaient formés naturellement, dans le cours des siècles, sous l'influence des besoins et des affinités des populations. Mais cet état de choses ne pouvait trouver grâce devant les novateurs ignorants et furieux qui prétendaient refondre et régénérer d'emblée la société française. Ils découpèrent, suivant leur fantaisie, les circonscriptions provinciales, et remplacèrent les trente-deux provinces du royaume par quatre-vingt-trois départements, en triplant ainsi ou à peu près le haut personnel à appointements de l'administration. En même temps, ils portèrent à son maximum de développement la centralisation qui avait été, sous l'ancien régime, la conséquence naturelle de l'absorption successive des petites souverainetés seigneuriales dans le domaine politique du roi, et à laquelle avait contribué aussi une cause purement économique. En effet, à mesure que la productivité de l'industrie s'augmentait sous [386] l'influence des inventions mécaniques et autres, on voyait s'accroître la rétribuabilité des fonctions gouvernantes de tout ordre; il devenait par conséquent avantageux de faire passer, dès qu'elles devenaient rétribuables, les fonctions du self government local dans le domaine de l'administration centrale. C'étaient autant de situations qui élargissaient le débouché administratif et augmentaient l'importance et l'influence du haut personnel, distributeur des places. L'administration centrale alla ainsi grossissant aux dépens du self governmenl local qui ne conserva plus que des attributions subordonnées, faiblement rétribuées ou gratuites.
Cette centralisation des services avait des avantages et des inconvénients : des avantages, en ce que les fonctionnaires ouïes employés spécialisés et suffisamment rétribués de l'administration générale d'un pays peuvent posséder, à un plus haut degré, les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et s'en acquitter mieux que des fonctionnaires ou des employés à besognes multiples, à appointements insuffisants ou sans appointements d'une administration locale; à quoi il faut ajouter qu'ils sont moins accessibles aux influences et aux passions de clocher; des inconvénients, en ce que les moindres affaires passant par une longue filière administrative ne peuvent être résolues qu'après de nombreux délais, quelle que soit l'urgence d'une solution. Ces avantages et ces inconvénients sont devenus, comme on sait, une source inépuisable de débats entre les partisans de la centralisation et ceux de la décentralisation : les uns voulant augmenter les attributions du gouvernement central aux dépens des sousgouvernements départementaux et communaux; les autres prétendant, au contraire, réserver au département et à la commune l'examen et la solution définitive de toutes les affaires locales. Mais ni les uns ni les autres ne se sont avisés [387] de rechercher s'il n'y avait pas lieu de diminuer et de simplifier ces attributions, en abandonnant à l'industrie privée une partie des services accaparés par l'État, le département ou la commune. Quelle que fût l'issue de ces débats, elle ne pouvait donc avoir pour résultat de diminuer les charges des consommateurs de services publics.
La décadence de l'ancien régime et la rétrogression vers le communisme politique qui a caractérisé le régime nouveau, en déterminant l'éclosion des partis et leur compétition pour l'exploitation de l'État devaient, au contraire, avoir pour conséquence d'accroître le nombre et le poids des fonctions de tout ordre constituant le butin nécessaire de ces armées politiques.'Sans doute, la portion de ce butin que pouvaient fournir les administrations locales était de moindre valeur que celle qui formait le contingent de l'administration centrale. Un bon nombre de fonctions même, celles de conseillers communaux et départementaux, de maires et d'adjoints étaient demeurées gratuites ou ne procuraient que de faibles indemnités, et ceux qui les briguaient ne manquaient pas de faire sonner bien haut leur désintéressement et leur dévouement patriotique,mais elles étaient investies d'une influence qui se monnayait d'une manière ou d'une autre en avantages matériels; elles étaient d'ailleurs le chemin qui conduisait aux autres. C'est pourquoi nous avons vu, sous l'influence des mêmes causes qui ont agi pour augmenter les attributions et grossir le budget de l'État, croître les attributions et les budgets locaux, particulièrement dans les villes. La tendance des administrations urbaines a été de transformer la commune en un petit État, autant que possible indépendant du grand, ayant entre ses mains non seulement les services de l'édilité et de la voirie, mais encore la police, l'instruction publique, les théâtres, les beaux-arts, taxant à sa guise la population et s'entourant, à l'instar de l'État central, d'une muraille [388] douanière fiscale, et même protectrice de l'industrie municipale. Les dépenses communales, départementales ou provinciales ont crû, en conséquence, dans une progressioa qui dépasse même, dans certaines communes, celle des dépenses de l'État, et le résultat a été que la vie y est devenue de plus en plus chère. Il semblerait au premier abord que le gouvernement central dût s'opposer à ce débordement des dépenses locales, en vue de sauvegarder ses propres recettes. Il a interdit, en effet, aux communes d'empiéter sur ses attributions et il a veillé à ce qu'elles n'établissent point des impôts qui puissent faire aux siens une concurrence nuisible, mais il n'a rien fait pour les empêcher d'étendre leurs attributions aux dépens de l'industrie privée, et cela se conçoit aisément : les partis politiques en possession du gouvernement ou aspirant à le posséder ne sont-ils pas intéressés à l'accroissement du butin des places et des situations influentes, aussi bien dans la commune, le département ou la province que dans l'État, puisque ce butin constitue le fonds de rétribution de leur personnel?
Cependant un moment viendra où ce fardeau, aujourd'hui si rapidement croissant, ne pourra plus s'accroître, où une évolution analogue à celle dont nous avons montré l'inévitable nécessité dans l'État, devra s'opérer dans la commune, le département ou la province. Cette évolution sera déterminée : 1° par l'impossibilité où se trouveront les administrations locales de couvrir plus longtemps leurs dépenses au moyen de l'impôt ou de l'emprunt; 2° par la concurrence intercommunale et régionale, activée par le développement des moyens de communication et la facilité croissante des déplacements de l'industrie et de la.population. Les localités où les frais de production de l'industrie et le prix de la vie seront surélevés à l'excès par les taxes locales courront le risque d'être abandonnées pour celles [389] où cette cause de renchérissement sévira avec une moindre intensité; elles seront obligées alors, sous peine de ruine, de restreindre leurs attributions et leurs dépenses. En dehors de l'édilité et de la voirie, comprenant les services des égouts, des moyens de communication, du pavage, de l'éclairage et de la salubrité, il n'y a pas un seul service municipal qui ne puisse être abandonné à l'industrie privée. Enfin, si nous considérons ces services mêmes, nous nous apercevrons que la tendance déjà manifeste du progrès consiste à les annexer aux industries immobilières qui pourvoient à l'exploitation des immeubles et du sol, et par conséquent à en incorporer directement les frais dans les prix de revient de ces industries.
Essayons, en recourant à une simple hypothèse, de donner une idée du modus operandi de cette transformation progressive. Supposons qu'une société immobilière se constitue pour construire et exploiter une ville nouvelle (et ne voyons-nous point déjà des sociétés de ce genre construire des rues et même des quartiers?) sous la condition de demeurer pleinement libre de la bâtir, de l'entretenir et de l'exploiter à sa guise, sans qu'aucune administration centrale ou locale s'avise de se mêler de ses affaires ; comment procédera-t-elle? Elle commencera d'abord par acheter l'emplacement nécessaire dans la localité qu'elle jugera la mieux située, la plus aisément accessible et la plus salubre; elle convoquera ensuite des architectes et des ingénieurs pour tracer les plans et faire les devis de la future cité, et, parmi ces plans et devis, elle choisira ceux qui lui paraîtront les plus avantageux. Les entrepreneurs et les ouvriers de l'industrie du bâtiment et de la voirie se mettront aussitôt à l'œuvre. On percera les rues, on construira des maisons d'habitation appropriées aux différentes catégories de locataires, on n'oubliera pas les écoles, les églises, les théâtres, les salles de réunion. Cependant il ne suffit pas, pour [390] attirer les locataires, de mettre à leur disposition des logements, des écoles, des théâtres et même des églises ; il faut que les habitations accèdent à des rues bien pavées et éclairées, que les habitants puissent se procurer chez eux l'eau, le gaz et l'électricité; qu'ils aient à leur service des véhicules variés et à bon marché, enfin que leurs personnes et leurs propriétés soient préservées de toute nuisance dans l'enceinte de la cité. Mieux tous ces services seront remplis, moins cher ils coûteront et plus rapidement se peuplera la nouvelle cité. Que fera donc la compagnie propriétaire? Elle fera paver les rues, établir des trottoirs, creuser des égouts, construire et décorer des squares; elle traitera avec d'autres entreprises, maisons ou compagnies, pour la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la sécurité,des tramways,des chemins de fer aériens ou souterrains, c'est-a-dire pour les services qui ne peuvent, en vertu de leur nature particulière,être individualisés ou faire l'objet d'une concurrence illimitée dans l'enceinte limitée de la cité. Pour les omnibus et les voitures de place, elle se bornera, au contraire, à faire appel à la concurrence, sauf dans le cas où celle-ci ne pourrait se développer par suite de l'insuffisance de la demande; elle stipulera dans ce cas l'établissement d'un tarif maximum, tout en demandant aux entrepreneurs de locomotion aussi bien qu'aux propriétaires de voitures particulières un abonnement au pavage et à l'éclairage. Elle établira des règlements de voirie et de salubrité; interdira ou isolera les entreprises dangereuses, insalubres, incommodes ou immorales. En outre, comme il est possible que le plan de la cité doive être modifié plus tard, qu'il faille élargir certaines rues, en supprimer d'autres, la compagnie se réservera le droit de reprendre la disposition de ses immeubles, moyennant une indemnité proportionnée à la durée des baux restant à courir ; mais il est clair qu'elle n'usera de ce droit qu'en vue d'augmenter les produits de. [391] son exploitation. Cette exploitation, elle l'administrera soit elle-même, soit au moyen d'une agence urbaine, chargée d'une part du bon entretien de la cité et de la surveillance des différents services y attenant, d'une autre part de la perception des loyers, dans lesquels seront compris les services qui ne peuvent être séparés de la jouissance de l'habitation, tels que la police locale, les égouts, le pavage et l'éclairage des rues.
Une compagnie ainsi constituée pour exploiter sur une grande échelle l'industrie du logement sera intéressée à diminuer autant que possible les frais de construction, d'entretien et de gestion de ses immeubles et elle aura pour tendance naturelle d'élever autant que possible le taux de ses loyers. Si elle jouissait d'un monopole, cette tendance ne pourrait être combattue et neutralisée que par une coutume ou une réglementation analogue à celle qui limitait jadis le pouvoir de toutes les industries de monopole; mais, grâce à la multiplicité des moyens de communication et à la facilité des déplacements, ce monopole n'existe plus pour l'industrie du logement. Il n'est besoin d'aucun appareil artificiel pour protéger les consommateurs; la concurrence suffit pour obliger les producteurs de logements, si vastes que soient leurs entreprises, à améliorer leurs services et à abaisser leurs prix au taux nécessaire pour rétribuer leur industrie.
Poursuivons maintenant notre hypothèse. Supposons que la situation favorable de la nouvelle cité, la bonne gestion des services urbains et la modicité du taux des loyers agissent pour attirer la population et qu'il devienne avantageux de construire un supplément d'habitations. N'oublions pas que les entreprises de tous genres ont leurs limites nécessaires, déterminées par la nature et le degré d'avancement de leur industrie, et qu'en deçà comme au delà de ces limites, leurs frais de production vont croissant [392] et leurs bénéfices diminuant. Si la compagnie qui a construit et qui exploite la cité estime que ces limites se trouvent atteintes, elle laissera à d'autres le soin de l'agrandir. On verra donc se former d'autres compagnies immobilières qui construiront et exploiteront des quartiers nouveaux, lesquels feront concurrence aux anciens, mais augmenteront cependant la valeur de l'ensemble, en accroissant le pouvoir d'attraction de la cité agrandie. Entre ces compagnies exploitantes celle-là du noyau de la cité, celles-ci de nouvelles rues ou quartiers, il y aura des rapports nécessaires d'intérêt mutuel pour le raccordement des voies, des égouts, des tuyaux du gaz, l'établissement des tramways etc. ; elles seront, en conséquence, obligées de constituer une union ou un syndicat permanent pour régler ces différentes questions et les autres affaires résultant de la juxtaposition de leurs propriétés, et la même union devra s'étendre, sous l'influence des mêmes nécessités, aux communes rurales du voisinage. Enfin, si des différends surgissent entre elles, elles devront recourir à des arbitres ou aux tribunaux pour les vider.
Ainsi se transformeront, selon toute apparence, les communes en entreprises libres pour l'exploitation de l'industrie du logement et de ses attenances naturelles. En supposant que la propriété et l'exploitation immobilières individuelles continuent de subsister à côté de la propriété et de l'exploitation actionnaires, — malgré la supériorité économique de celles-ci, — les différents propriétaires exploitants de la cité, individus ou sociétés, formeront une union pour régler toutes les questions d'intérêt commun , union dans laquelle ils auront une participation proportionnée à la valeur de leurs propriétés. Cette union, composée des propriétaires, individus ou sociétés, ou de leurs mandataires, réglerait toutes les affaires de voirie, de pavage, d'éclairage, de salubrité, de sécurité par abonnement [393] ou autrement, et elle se mettrait en rapport avec les unions voisines pour le règlement commun de ces mêmes affaires, en tant toutefois que la nécessité de cette entente se ferait sentir. Ces unions seraient toujours libres de se dissoudre ou de s'annexer à d'autres, et elles seraient naturellement intéressées à former les groupements les plus économiques pour pourvoir aux nécessités inhérentes à leur industrie.
Tandis que les doctrines révolutionnaires et socialistes ont pour tendance d'augmenter incessamment les attributions de la commune ou de l'État, transformé en une vaste commune, en faisant entrer dans sa sphère d'activité toutes les industries et tous les services, ainsi rassemblés et confondus dans un monstrueux monopole, l'évolution, suscitée parles progrès de l'industrie et de la concurrence, agit au contraire pour spécialiser toutes les branches de la production, en y comprenant celles qui sont exercées par la commune et l'Etat, et les attribuer à des entreprises librement constituées et soumises à Faction à la fois propulsive et régulatrice de la concurrence. Ces entreprises libres n'en ont pas moins des rapports déterminés par les nécessités de leur industrie, De là une organisation naturelle mais libre qui va se développant et se modifiant avec ces nécessités mêmes.
C'est ainsi qu'au lieu d'absorber l'organisme de la société, suivant la conception révolutionnaire et communiste, la commune et l'Etat se fondent dans cet organisme. Leurs fonctions se divisent et la société est composée d'une multitude d'entreprises formant, sous l'empire de nécessités communes qui dérivent de leur nature particulière, des unions ou des États libres exerçant chacun un'e fonction spéciale. L'avenir n'appartient donc ni à l'absorption de la société par l'État, comme le prétendent les communistes et les collectivistes, ni à la suppression de l'État, comme le [394] rêvent les anarchistes et les nihilistes, mais à la diffusion de l'État dans la société. C'est, pour rappeler une formule célèbre, l'État libre dans la Société libre.
V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — L'homme s'approprie l'ensemble des éléments et des forces physiques et morales qui constituent son être. Cette appropriation est le résultat d'un travail de découverte ou de reconnaissance de ces éléments et de ces forces, et de leur application à la satisfaction de ses besoins, autrement dit de leur utilisation. C'est la propriété personnelle. L'homme s'approprie et se possède lui-même. Il s'approprie encore,— par un autre travail de découverte,d'occupation, de transformation et d'adaptation, — le sol, les matériaux et les forces du milieu où il vit, en tant qu'ils sont appropriables. C'est la propriété immobilière et mobilière. Ces éléments et ces agents qu'il s'est appropriés dans sa personne et dans le milieu ambiant, et qui constituent des valeurs, il agit continuellement, sous l'impulsion de son intérêt, pour les conserver et les accroître. Il les façonne, les transforme, les modifie ou les échange à son gré, suivant qu'il le juge utile. C'est la liberté. La propriété et la liberté sont les deux facteurs ou les deux composantes de la souveraineté.
Quel est l'intérêt de l'individu? C'est d'être absolument propriétaire de sa personne et des choses qu'il s'est appropriées en dehors d'elle, et d'en pouvoir disposer à son gré; c'est de pouvoir travailler soit isolément, soit en associant librement ses forces et ses autres propriétés, en tout ou en partie, à celles d'autrui; c'est de pouvoir échanger les produits qu'il tire de l'exploitation de sa propriété personnelle, immobilière ou mobilière, ou bien encore de les consommer ou de les conserver : c'est, en un mot, de posséder dans toute sa plénitude la « souveraineté individuelle ».
Cependant l'individu n'est pas isolé. Il est perpétuellement en contact et en rapport avec d'autres individus. [395] Sa propriété et sa liberté sont limitées par la propriété et la liberté d'autrui. Chaque souveraineté individuelle a ses frontières naturelles dans lesquelles elle s'exerce et qu'elle ne peut franchir sans empiéter sur d'autres souverainetés. Ces limites naturelles, il faut qu'elles soient reconnues et garanties, sinon les faibles se trouvent à la merci des forts et aucune société n'est possible. Tel est l'objet de l'indusIrie que nous avons nommée « la production de la sécurité » ou, pour nous servir de l'appellation habituelle, tel est l'objet du « gouvernement ».
Comme toutes les autres industries, celle-ci a commencé par être imparfaite et grossière; elle s'est successivement perfectionnée, mais non sans avoir des phases de rétrogression et de décadence. Dans le premier âge de la civilisation, elle est exercée par la communauté des membres du troupeau ou de la tribu. Ne possédant qu'un outillage et un armement rudimentaires, qui suffisent à peine à subvenir aux premières nécessités de la vie, et ne pouvant s'accroître au delà de quelques centaines ou de quelques milliers de têtes, le troupeau primitif ne fournirait point un débouché assez large pour rémunérer une entreprise spéciale de gouvernement. Ses membres sont obligés de produire euxmêmes la sécurité dont ils ont besoin. Ils en sont à la fois les producteurs et les consommateurs. Ils partagent leur temps et leurs efforts entre la production alimentaire et la production de la sécurité. Seulement, avec cette différence qui tient à la nature particulière de ces deux industries, que l'une peut être, dans la plupart des cas, exercée individuellement, tandis que l'autre ne peut l'être que collectivement. Les membres du troupeau ou de la tribu constituent donc une communauté ou une mutualité d'assurance, dans laquelle, à défaut d'autre capital, chacun apporte une partie de son temps et de ses forces. Des souverainetés individuelles ainsi associées, en vue de [396] pourvoir à une nécessité commune, naît la souveraineté politique. Cette souveraineté appartient collectivement, mais non également, à tous les membres de l'association. Chacun en possède une part proportionnée à son apport.
Telle est l'origine et tels sont les éléments de la souveraineté politique. Comme la souveraineté individuelle, elle a ses limites. Celles-ci sont déterminées par l'objet en vue duquel elle est instituée, et qui consiste à assurer contre toute agression intérieure ou extérieure la vie et la propriété des membres de la mutualité, considérés comme consommateurs de sécurité. Elle ne peut atteindre ce but sans leur imposer des charges, des obligations et des règles qui diminuent d'autant leur propriété et leur liberté. Aussi longtemps que ces charges, ces obligations et ces règles n'excèdent pas le nécessaire, le souverain ne dépasse pas les limites de son droit. Mais où est la garantie qu'il ne les dépassera point? Comment le consommateur individuel de sécurité se trouve-t-il préservé de l'abus du pouvoir du producteur collectif? Cette garantie essentielle réside d'abord dans son droit de renoncer à faire partie de la mutualité, soit pour produire lui-même, isolément, sa sécurité, soit pour s'annexer à une autre mutualité; toutefois, en fait, ce droit demeure à peu près inapplicable; elle réside ensuite, dans la participation de l'individu à l'exercice de la souveraineté politique, et, au sein d'une mutualité peu nombreuse, cette garantie pouvait avoir une efficacité suffisante.
Dans le second âge de la civilisation, le mode de production de la sécurité subit un changement radical. Grâce aux progrès de l'outillage, la productivité du travail s'accroît dans une proportion telle que l'individu peut non seulement pourvoir largement à ses besoins de première nécessité, mais encore à beaucoup d'autres. Alors apparaît le phénomène de la séparation des industries et de la division du travail. Les industries séparées sont exercées [397] par des entreprises spéciales, dont l'importance varie suivant l'étendue et la richesse de leur débouché. La production de la sécurité suit la loi commune. Aux mutualités primitives succèdent, nous avons vu en quelles circonstances et sous l'impulsion de quelles nécessités, des entreprises organisées sous forme de sociétés en participation ou autrement qui fondent un État et établissent un gouvernement. Qu'advient-il de la souveraineté sous ce nouveau régime?
Il y a alors deux sociétés: la société possédante et exploitante de l'État, et la société, ou plutôt la multitude assujettie à sa domination. Les membres de la première possèdent, à l'origine, comme ceux des communautés ou des mutualités primitives, la souveraineté individuelle et la souveraineté politique. Toutefois, les nécessités du maintien et de l'agrandissement de la domination qui leur fournit leurs moyens d'existence ont pour effet ordinaire et presque général de déterminer la concentration de l'exercice de la souveraineté politique entre les mains d'un petit nombre de familles, et finalement même d'une seule. Ceux qui en sont exclus se trouvent alors à la discrétion du souverain, sauf les garanties qu'ils ont pu stipuler pour l'empêcher d'entamer, au delà du nécessaire, leur souveraineté individuelle. Si ces garanties n'existent point, ils subissent le régime du despotime et du bon plaisir : le souverain peut disposer à sa guise des éléments de la souveraineté individuelle de chacun : la propriété et la liberté. Cependant ils peuvent avoir intérêt à courir ce risque inhérent à la concentration de la souveraineté politique, si cette concentration a pour effet de mieux garantir la domination dont ils sont les coparticipants et bénéficiaires.
La multitude assujettie à la domination de la société maîtresse de l'État ne possède, au début de ce régime, ni [398] la souveraineté individuelle ni la souveraineté politique. Elle est esclave. Les individus qui la composent sont appropriés soit à un membre, soit à la collectivité des membres de la société dominante. Ce n'est qu'à la longue, grâce à une série de progrès, déterminés surtout par la concurrence politique, qu'ils parviennent à s'affranchir, c'est-à-dire à entrer en possession de la souveraineté individuelle. Toutefois elle ne leur est point accordée entière; elle demeure grevée de la sujétion ou de la servitude politique. L'affranchi n'est plus esclave ou serf, mais il est encore « sujet ». Il est propriétaire de sa personne et de ses biens; il est libre d'agir à sa guise, il possède, en d'autres termes, d'une manière plus ou moins complète la souveraineté, sauf l'obligation strictement et universellement réservée de la faire garantir par la société politique de ses anciens maîtres, aux prix et conditions qu'il plaît à celle-ci d'établir, soit qu'elle exerce elle-même la souveraineté politique, soit que l'exercice en soit concentré dans une oligarchie ou dans une « maison ». Le consommateur de sécurité se trouve ainsi à l'entière discrétion du producteur, car il lui est interdit non seulement de la demander à d'autres, mais encore de la produire lui-même. Et sa situation va même s'aggravant de ce côté à mesure que sa souveraineté individuelle devient plus complète: quand il était sous la dépendance d'un maître, appartenant à la société dominante, celui-ci était intéressé à le protéger de son influence contre l'abus du pouvoir du souverain, et il l'était d'autant plus que cette dépendance était plus étroite. Cet intérêt a disparu du moment où l'esclave ou le serf est devenu entièrement propriétaire et maître de luimême. Il s'est trouvé alors entièrement à la merci de la corporation ou de la maison politique, en possession du monopole de la production de la sécurité. Ce monopole sans contrepoids n'a pas manqué de devenir de plus en [399] plus lourd et oppressif. On a entrepris d'abord de le limiter par l'établissement d'un système analogue à celui qui restreignait le pouvoir des autres corporations, également investies d'un monopole. Les consommateurs de sécurité ont obtenu le droit de débattre le prix et les conditions de ce service. Mais, comme nous l'avons constaté, les deux parties en présence réussissaient rarement à s'accorder et, en dernière analyse, elles avaient recours à la force pour vider leurs différends.
Ce recours n'avait pas été favorable aux consommateurs de sécurité. A la fin du xvm8 siècle, les corporations ou les maisons en possession de la souveraineté politique avaient réussi partout, sauf en Angleterre, à récupérer l'intégrité de leur monopole, et il en était résulté un abaissement général de la qualité et l'exhaussement du prix de la sécurité ou de la garantie de la souveraineté individuelle. La Révolution française survint et eut pour premier résultat de donner la victoire aux consommateurs. L'établissement politique qui produisait la sécurité tomba entre leurs mains et ils eurent à aviser aux moyens de pourvoir à ce service. Ce problème comportait trois solutions différentes : 1° on pouvait laisser subsister l'ancien établissement politique, en revenant au système des garanties et des contrepoids, usité au moyen âge, conservé et amélioré en Angleterre; 2° rétrograder jusqu'au système de la mutualité primitive, ou de la production de la sécurité par les consommateurs eux-mêmes; 3° supprimer purement et simplement la servitude politique, et laisser à la concurrence le soin de pourvoir à la garantie de la souveraineté individuelle.
C'est le second système qui a prévalu, et qui prévaut encore aujourd'hui avec des applications et des tempéraments divers, et l'on peut se rendre aisément compte des causes qui l'ont fait prévaloir. Les consommateurs avaient [400] souffert des abus du monopole; il était naturel qu'ils s'imaginassent que le moyen le plus simple et le plus efficace d'éviter le retour de ces abus consistait à produire eux-mêmes, — collectivement puisqu'il n'était pas possible de la produire autrement, — la sécurité dont ils avaient besoin. C est ainsi que nous voyons les consommateurs de pain, dans les localités où la taxe a été abolie et où la concurrence demeure insuffisante, fonder des boulangeries coopératives, autrement dit des mutualités de production du pain. Mais il est rare que ces mutualités, quoique instituées librement, sans que personne soit contraint à en faire partie, réussissent à atteindre le but en vue duquel elles ont été établies, savoir : de produire du pain, en meilleure qualité et à meilleur marché que les boulangeries de l'ancien système, et elles finissent communément par se liquider ou à revenir au régime économique des entreprises ordinaires, individuelles ou collectives. Encore moins est-on parvenu à fonder des mutualités de production de la sécurité, économiques et durables, et il suffit de jeter un coup d'œil sur leur constitution et leur fonctionnement pour se rendre compte de cet insuccès.
De quels éléments se composent les mutualités politiques, dites nationales? Elles se composent de populations d'origine diverse, meublant un territoire conquis parles sociétés gouvernantes de l'ancien régime, et réunies sans leur consentement ou même malgré elles. Ces populations, on les a déclarées propriétaires (apparemment en vertu du droit de conquête) de l'établissement politique auquel elles étaient naguère assujetties, après avoir confisqué cet établissement à ses légitimes propriétaires, et on leur a commis le soin de le gérer à leurs frais, risques et profits, en attribuant arbitrairement soit à une portion de leurs membres, soit à tous, le droit de participer à sa gestion. Mais d'abord cette souveraineté collective ainsi artificiellement [401] façonnée et rendue obligatoire ne constitue-t-elle pas, aussi bien que celle à laquelle elle succède, une atteinte ou une « servitude » imposée à la souveraineté individuelle? Si je suis souverain (et la révolution n'a-t-elle pas été faite pour m'affranchir de la servitude politique, c'est-à-dire pour me restituer ma souveraineté dans toute sa plénitude?), si je suis souverain, et, comme tel, propriétaire et libre de ma personne et de mes biens, en vertu de quel droit m'imposeriez-vous l'obligation de m'associer à tels individus plutôt qu'à tels autres pour garantir ma personne et mes biens? Serait-ce parce qu'à l'époque où nous subissions en commun la servitude politique, où nous étions obligés, les uns et les autres de demander notre sécurité à la corporation ou à la maison qui en avait le monopole, nous étions placés sous le même joug? A quoi nous servirait d'avoir secoué ce joug, si c'était pour le remplacer par un autre, fût-ce même par celui de la collectivité des serfs, dans laquelle nous avions été englobés sans notre consentement et presque toujours malgré nous? En dépossédant la corporation ou la maison dont nous étions les sujets, vous prétendez nous avoir restitué la part de souveraineté dont elle nous avait dépouillés? Soit! mais, il fallait alors nous permettre d'en user librement pour produire nous-mêmes notre sécurité, individuellement — ou en nous associant à d'autres à notre convenance, en admettant que la production individuelle fût impossible. Ou bien encore, il fallait nous permettre de nous adresser à une société ou à une maison de notre choix, pour obtenir ce service indispensable, et de contracter librement avec elle. Mais nous contraindre à faire partie d'une mutualité composée de tous les anciens sujets de l'Etat confisqué, n'était ce pas comme si, après avoir aboli la corporation investie du monopole de la production du pain, et nous avoir ainsi affranchis de l'obligation onéreuse de nous pourvoir exclusivement [402] à la boulangerie du quartier, on nous avait contraints à exploiter nous-mêmes cet établissement, transformé en une boulangerie coopérative obligatoire, à en supporter les frais, à en combler les déficits, et à nous approvisionner exclusivement chez elle? N'était-ce pas remplacer une servitude par une autre?
Ajoutons que cette servitude transférée à un corps politique nombreux et dont font partie ceux-là mêmes qui la subissent, peut devenir incomparablement plus lourde et plus oppressive que lorsqu'elle était établie au profit d'une corporation ou d'une maison. C'est, en effet, en s'appuyant sur l'intérêt de la généralité de la nation, et non plus seulement en se fondant sur l'intérêt particulier de la corporation ou de la maison souveraine, que l'on attente à la propriété et à la liberté de chacun, Et quelle limite les intérêts particuliers peuvent-ils opposer à une puissance qui agit au nom de l'intérêt général? On peut opposer un frein à la tyrannie d'un seul, ne fût-ce que par le fer ou le poison; on est impuissant contre la tyrannie d'une multitude. Dira-t-on que dans ce système renouvelé des temps primitifs l'individu participe à la souveraineté politique, et que cette participation suffit à le garantir contre l'oppression d'un pouvoir qu'il contribue à former. Elle suffisait peut-être dans les temps primitifs, lorsque les mutualités politiques ne comprenaient que quelques centaines ou quelques milliers de membres, ayant les mêmes moyens d'existence, partant les mêmes intérêts, et surtout n'ayant aucun intérêt à former des ligues ou des sociétés particulières pour exploiter l'industrie encore improductive du gouvernement; elle ne suffit plus, elle est devenue purement illusoire dans des mutualités politiques dont les membres se comptent par millions, exercent les industries les plus diverses, et à une époque où l'industrie du gouvernement possède une productivité croissante, limitée [403] seulement par les facultés contributives que les progrès de l'industrie augmentent sans cesse. Dans ce nouvel état des choses, quand chacun des membres de la mutualité politique ne possède plus qu'une fraction infinitésimale de souveraineté, comment cette part ainsi diluée pourraitelle être efficace? Comment cette poussière de souveraineté devenue presque impalpable pourrait-elle résister à l'effort des agglutinations compactes d'intérêts qui se forment pour exploiter l'industrie du gouvernement, devenue de plus en plus productive? Nous avons vu où conduit ce système, dont l'expérience se poursuit et dont les conséquences s'aggravent tous les jours sous nos yeux : il conduit à renchérissement et à l'abaissement progressifs des services des gouvernements, constitués et gérés, nominalement du moins, par des mutualités nationales.
Au point où cette expérience est parvenue, elle atteste déjà, avec une évidence suffisante, que le système révolutionnaire et communiste des mutualités nationales ne résout point le problème de la garantie utile de la souveraineté individuelle. Deux solutions restent donc en présence : celle de la limitation par voie de contrat librement débattu du monopole naturel ou artificiel des établissements politiques, et celle de la concurrence. Il y a apparence que l'on reviendra au premier, tout en introduisant dans le fonctionnement des établissements politiques les progrès déjà réalisés dans les autres entreprises collectives, et qu'il subsistera jusqu'à ce que le développement de la grande industrie rende le second possible et finisse par l'imposer comme nécessaire. Mais quels sont, dans l'état présent des choses, les droits des producteurs de sécurité et les droits des consommateurs? En quoi consistent-ils et quelles sont leurs limites? Nous allons voir que ces droits sont les mêmes que ceux des [404] producteurs et des consommateurs des autres industries. Tous dérivent également du principe de la souveraineté individuelle.
Reprenons l'exemple dont nous venons de nous servir. J'ai besoin de pain. Si la localité que j'habite n'est pas assez populeuse et riche pour fournir un débouché à un boulanger, je serai obligé de le fabriquer moi-même, — je serai à la fois producteur et consommateur de pain. Si la population s'enrichit et s'accroît, ce débouché s'ouvrira, une boulangerie pourra s'établir et je trouverai avantage à lui acheter mon pain plutôt qu'à continuer à le fabriquer. Mais qu'advient-il alors de mes droits de producteur et de consommateur? Je cesse d'exercer mon droit de producteur de pain, mais je continue à le posséder, et même il s'est étendu au lieu de décroître : à mon droit, dont je puis continuer à user, de fabriquer du pain pour ma consommation, s'est joint celui d'en produire pour autrui, en fondant une boulangerie ou en contribuant à la fonder et à la mettre en œuvre par mes capitaux et mon travail. Mon droit de consommateur s'est étendu de même; car je puis demander le pain dont j'ai besoin à deux producteurs au lieu d'un : au boulanger et à moi. Si je m'adresse de préférence au boulanger, c'est parce que son pain est meilleur et me revient moins cher que celui que je produisais moimême. Je bénéficie de la différence, et, en admettant que l'industrie soit libre et la concurrence possible, cette différence de prix représentera celle d'une production isolée et d'une production spécialisée.
Supposons cependant que l'industrie ne soit pas libre. Une boulangerie s'est établie, et celui qui l'exploite m'interdit à la fois de fabriquer mon pain moi-même et de m'adresser à d'autres qu'à lui pour me procurer cet article de première nécessité. Aussi longtemps qu'il me fournira du pain de bonne qualité et à un prix modéré, il y a [405] apparence que je ne réclamerai point; mais que la qualité vienne à baisser et le prix à s'élever, — et il p«ut, dans ces conditions, s'élever bien au-dessus des frais de la production, — je m'efforcerai soit de limiter cette servitude, soit de m'y dérober. Si le monopole auquel j'ai affaire est « naturel », s'il ne peut être supprimé sans compromettre l'alimentation et l'existence de la société dont je fais partie, je ne revendiquerai point, à titre de producteur, mon droit primordial de fabriquer mon pain moi-même ou de fonder quelque boulangerie concurrente, mais je réclamerai en échange le droit d'être admis à participer à l'exercice de l'industrie de la boulangerie, si je possède les aptitudes et les connaissances techniques nécessaires. Je ne revendiquerai pas davantage, à titre de consommateur, le droit de me pourvoir chez moi ou à une autre boulangerie: mais en compensation de ce droit, j'exigerai celui de contrôler la qualité du pain et d'en limiter le prix jusqu'au niveau moyen où l'abaisserait la concurrence, en supposant qu'elle fût possible. Si, des deux parts, nous entendons bien nos intérêts, et si nous sommes animés d'un esprit d'équité, l'accord pourra s'établir sur ces bases. Le boulanger continuera d'exercer son industrie et de gouverner son établissement à sa guise, mais sans exclure de son personnel les membres de sa clientèle, et il acceptetera de bonne grâce la création et la mise en vigueur d'un système plus ou moins exact de contrôle de la qualité et de limitation du prix, sans entreprendre d'intimider ou de corrompre les mandataires que les consommateurs auront chargés de ce contrôle et de cette limitation.
Si l'accord ne s'établit point ou s'il vient à se rompre, soit par la mauvaise foi du producteur ou son impatience à subir un contrôle, soit par les exigences excessives et déraisonnables des consommateurs ou de leurs mandataires, avides de popularité; et si l'on a recours à la force [406] pour vider ce procès, qu'arrivera-t-il? Si le propriétaire exploitant du monopole l'emporte, il ne manquera pas de supprimer le contrôle des consommateurs, et même de les exclure de son personnel. Si les consommateurs ont le dessus, ils confisqueront l'établissement investi d'un monopole pour l'exploiter eux-mêmes ou le faire exploiter à leur profit, en se réservant de plus le droit exclusif defaire partie du personnel exploitant. Mais, dans l'un et l'autre cas, les deux parties auront dépassé les limites de leur droit : le propriétaire exploitant d'un monopole excède le sien et empiète sur celui des consommateurs, en supprimant l'appareil qui tient lieu du régulateur naturel de la concurrence pour maintenir la qualité et modérer le prix de ses produits ou de ses services. Les consommateurs excèdent, de même, leur droit en confisquant la propriété et l'industrie du producteur, et en s'emparant de son établissement pour l'exploiter à leur profit. Les « nuisances » que produisent ces dérogations au droit, ne se font, au surplus, pas attendre. L'absence d'un contrôle efficace engendre l'abus inévitable du monopole, et expose le monopoleur à de nouvelles revendications plus violentes des consommateurs; la confiscation de la propriété de l'établissement politique crée un risque qui met en péril toutes les autres propriétés. [64]
[407]
Remplacez la fabrication du pain par la production de a sécurité et vous aurez l'explication de tous les conflits [408] et de toutes les luttes entre les gouvernants et les gouvernés, depuis l'époque où la concurrence politique et [409] guerrière a commencé à s'affaiblir entre les premiers et où les seconds ont commencé à entrer en possession de la [410] souveraineté individuelle. Vous connaîtrez aussi l'origine et les limites de la souveraineté politique.
Résumons maintenant cette théorie:
La souveraineté réside dans la propriété de l'individu sur sa personne et ses biens et dans la liberté d'en disposer, impliquant le droit de garantir lui-même sa propriété et sa liberté ou de les faire garantir par autrui. Lorsqu'il les garantit lui-même, la souveraineté politique demeure confondue avec la souveraineté individuelle. Lorsque cette garantie devient l'objet d'une industrie spéciale, la souveraineté politique se spécialise de même; mais dans ce nouvel état de choses, comme dans le précédent, elle a ses limites qui sont marquées par la nature et les nécessités de la production de la sécurité et qui ne [411] diffèrent point de celles dans lesquelles s'exercent les autres industries.
Si un individu ou une collection d'individus use de sa souveraineté pour fonder un établissement destiné à pourvoir à la satisfaction d'un besoin quelconque, il a le droit de l'exploiter et de le diriger suivant les impulsions de son intérêt, comme aussi de fixer à son gré le prix de ses produits ou de ses services. C'est le droit souverain du producteur. Mais ce droit est limité naturellement par celui des autres individus non moins souverains, considérés en leur double qualité de producteurs et de consommateurs. Cette délimitation s'opère naturellement sous un régime de concurrence, les autres individus demeurant libres de fonder des établissements analogues et de se [412] pourvoir ailleurs, ce qui oblige le producteur à réduire son prix et ses conditions au nécessaire. Il en est autrement sous un régime de monopole. Le droit du producteur est, en ce cas, plus difficile à mesurer et il ne peut être délimité que par un compromis. En échange de leur droit de fonder et d'exploiter d'autres établissements, le monopoleur doit concéder à ses clients assujettis, à titre de producteurs, un droit éventuel de coopération à son entreprise; en échange de leur droit de se pourvoir ailleurs, il doit leur consentir, à titre de consommateurs, un droit de contrôle de la qualité et de limitation du prix de ses produits ou de ses services. Le droit d'un producteur investi d'un monopole peut être ramené ainsi à ses limites naturelles et se concilier avec les droits des autres membres de la société, considérés comme producteurs et consommateurs. L'expérience atteste malheureusement que cette conciliation n'est pas facile à accomplir dans la pratique. Il en sera ainsi, selon toute apparence, aussi longtemps que la production de la sécurité s'opérera sous le régime du monopole et que subsistera la « servitude politique ». Seule, la concurrence peut établir une exacte délimitation de la souveraineté politique.
De cette analyse, il ressort que la souveraineté politique est une partie intégrante de la souveraineté individuelle. Il en ressort aussi qu'il n'est point nécessaire de faire partie du corps en possession de l'exercice de la souveraineté politique pour obtenir la garantie de sa souveraineté individuelle, pas plus qu'il n'est nécessaire d'être boulanger pour se procurer du pain en belle qualité et à bon marché. Il suffit, dans le cas du monopole, de posséder le droit éventuel de coopération qui appartient au producteur et d'exercer, d'une manière efficace, le droit de contrôle et de limitation qui appartient au consommateur; enfin, dans le cas où le monopôle [413] n'est point nécessaire, de recourir à la concurrence. [65]
VI. Nationalité et patriotisme. — La suppression de la servitude politique, en vertu de laquelle la maison ou l'association exploitante d'un Etat impose ses services à la population du territoire soumis à sa domination, n'entraînera-t-elle pas la destruction de la nationalité et du patriotisme? Voilà ce qu'il s'agit encore d'examiner. Pour résoudre cette question, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les origines et le développement de ces deux phénomènes d'ordre politique et moral.
Dans les temps primitifs, le troupeau ou la tribu, réuni par des affinités de race et une nécessité commune, constituait la nationalité. La défaite et la dispersion de ce troupeau entraînait la destruction à peu près certaine de tous ceux qui en faisaient partie, hommes, femmes et enfants. De là, la formation d'une « opinion » qui exigeait de la part de chacun le sacrifice ou la subordination de [414] ses intérêts particuliers à l'intérêt général de l'association. De là aussi, et par contre-coup, le développement d'un instinct ou d'un sentiment analogue à celui de la famille, qui embrassait dans un même culte le troupeau, ses institutions, ses membres vivants ou morts. Cet instinct ou ce sentiment, c'était l'attachement à la nationalité et, lorsque le troupeau se fut établi en permanence dans les localités où il trouvait sa subsistance, ce même sentiment s'étendit au milieu ou à l'habitat, et il devint l'amour de la patrie ou le patriotisme.
Dans la période suivante, lorsque l'Etat politique se spécialise et appartient exclusivement à une corporation conquérante et gouvernante, la nationalité se spécialise de même. La nationalité dominante est celle des maîtres de l'État; au-dessous d'elle, les populations assujetties forment des nationalités diverses, selon leurs affinités de race, de mœurs et de langage. Le patriotisme subit une évolution analogue. L'existence de chacun des membres de la corporation dominante étant attachée à celle de cette corporation, au maintien de sa hiérarchie et des autres institutions qui sont les facteurs de sa puissance, l'opinion fait passer l'intérêt corporatif avant tout autre et le patriotisme se résout dans la fidélité au chef et la confraternité avec les membres du corps politique unis par la communauté des intérêts. Chez les populations assujetties, le patriotisme ne dépasse guère l'enceinte de la commune ou du canton, il ne réunit les maîtres et les sujets que lorsqu'un danger égal de dépossession et de destruction menace les uns et les autres. Mais cette communauté de patriotisme disparaît à mesure que le risque de dépossession et de destruction provenant de la guerre et de la conquête s'affaiblit et s'inégalise en s'affaiblissant. Lorsque les invasions barbares ont cessé d'être à craindre, la corporation propriétaire et gouvernante ou auxiliaire de la maison souveraine demeure [415] cependant exposée à perdre sa situation prépondérante, à la suite d'une conquête étrangère; tandis que les populations assujetties, protégées par les progrès des usages de la guerre, n'ont plus à redouter qu'un simple changement de domination, et qu'il arrive même parfois qu'elles gagnent à ce changement. On s'explique donc que leur patriotisme soit moins intense que celui de la classe gouvernante et qu'elles soient moins disposées à dépenser leur sang et leur argent pour défendre l'État : pourvu qu'elles ne soient point molestées dans leur existence, leur propriété, leur industrie ou leur commerce, qu'elles conservent leurs institutions locales, l'usage de leur langue et de leurs coutumes traditionnelles, et qu'elles n'aient point à supporter une augmentation de charges, peu leur importe le reste. Telle était la situation dans les derniers temps de l'ancien régime. Cependant la rétrogression déterminée par la Révolution française dans les usages de la guerre et de la conquête est venue modifier cet état des choses et des esprits. Les guerres et les conquêtes de la Révolution et du premier Empire n'ont pas intéressé seulement, comme les précédentes, les dominations politiques; elles ont atteint les propriétés et les institutions particulières des populations et même leur langue. Faute de ressources financières suffisantes, les énormes armées que le gouvernement révolutionnaire recrutait avec une facilité extraordinaire, grâce au rétablissement du servage d'État, vivaient sur les pays envahis; on ne se contentait pas même des réquisitions de subsistances, on dépouillait les églises et les musées, on confisquait sans scrupule les domaines des corporations; enfin, on obligeait, sous prétexte de progrès, les populations à renoncer à leurs vieilles institutions pour adopter celles des conquérants, au premier rang desquelles figurait la conscription. De là une recrudescence et on pourrait dire une unification du [416] patriotisme dans tous les pays envahis ou menacés par la révolution. De nos jours, cette unification tend de nouveau à s'effacer, bien que la pratique des usages de la guerre et de la conquête ne soit pas encore revenue au point d'avancement qu'elle avait atteint avant la révolution, et que les conquérants modernes, à l'imitation de leurs devanciers révolutionnaires continuent à vouloir imposer leurs institutions et leur langue aux populations qu'ils assujettissent. Mais la multitude des consommateurs politiques commence à comprendre, quoique d'une manière encore vague et confuse, que son intérêt à agrandir les frontières de l'État ou à les récupérer quand elles ont été entamées, ou même à conserver l'État, diffère sensiblement de celui des maisons et des associations politiques qui vivent de l'exploitation de l'Etat ou aspirent à en vivre. Cette différence apparaît clairement quand on analyse les effets de la guerre et de la conquête au point de vue des intérêts des producteurs de services politiques, d'une part, des consommateurs de ces services de l'autre. La guerre et la conquête, en cas de succès, augmentent à la fois la puissance, le prestige et les profits du personnel politique et militaire qui gouverne l'Etat; les officiers montent en grade à la suite d'une campagne victorieuse, et les fonctionnaires civils voient s'accroître le débouché administratif par l'annexion d'un nouveau territoire; les consommateurs politiques, en revanche, supportent les charges de la guerre, sans recueillir aucun bénéfice appréciable de la conquête. Ils alimentent la guerre au moyen de l'impôt du sang, qui n'est pas susceptible d'être remboursé, et au moyen d'emprunts dont les intérêts et l'amortissement exigent un accroissement d'impôts, que les plus fortes indemnités de guerre ne parviennent point à balancer, sans parler de la perturbation que toute guerre apporte dans l'industrie et les affaires. S'ils tirent quelque avantage [417] du reculement des lignes de douanes, ce profit est compensé le plus souvent par l'abaissement des services politiques et administratifs résultant de l'agrandissement de l'État au delà de ses limites utiles. Enfin, l'exhaussement du risque de guerre résultant de l'appréhension d'une revanche de l'Etat vaincu et diminué a pour conséquence inévitable d'augmenter, d'une manière permanente, leurs charges militaires. En cas de revers, au contraire, les effets de la guerre et de la conquête affectent dans une proportion plus forte les intérêts des maisons ou des associations exploitantes de l'État, et du personnel qui leur sert d'auxiliaires. La défaite leur enlève une portion notable de leur puissance et de leur prestige, elle diminue leur débouché si elles sont obligées de céder une partie du territoire national, elle le supprime si elles sont entièrement dépossédées, tandis que les consommateurs politiques ne subissent que le dommage résultant de la substitution d'une domination à une autre. De là, des différences notables entre l'opinion de la classe qui vit de l'exploitation de l'Etat et celle de la masse des consommateurs politiques en matière de guerre et de conquête. Autant la première est disposée à engager la nation dans une entreprise de ce genre, pour peu qu'elle ait confiance dans le succès, autant la seconde y répugne. Et, quand au lieu de succès viennent les revers, quand la maison ou l'association gouvernante se voit menacée d'une dépossession partielle ou totale, elle s'efforce de prolonger la lutte sans se faire scrupule d'imposer à la nation des sacrifices illimités; tandis, au contraire, que la multitude gouvernée réclame la paix avec une insistance plus marquée à mesure qu'elle estime que les sacrifices qu'on lui impose dépassent la mesure du dommage que lui infligerait une conquête partielle ou même une conquête entière. Sa voix ne tarde pas, à la vérité, à être étouffée par les clameurs des politiciens qui l'accusent [418] de manquer de patriotisme, et c'est seulement lorsque la nation est entièrement épuisée que la lutte cesse.
A. le bien considérer, le patriotisme, tel que l'entendent les politiciens modernes, et tel qu'ils sont parvenus à l'imposer à l'ignorance de la foule, en flattant ses passions grossières, n'est autre chose qu'une branche, on pourrait dire la branche maîtresse du protectionnisme. Sur quelle base se fonde la doctrine protectionniste? Sur l'appropriation du marché national aux producteurs indigènes; impliquant l'obligation pour les consommateurs de s'approvisionner exclusivement de produits nationaux, quand même ils pourraient se procurer ces articles en meilleure qualité et à meilleur marché à l'étranger. C'est une « servitude » économique qui avait sa raison d'être à l'époque où .les nations civilisées vivaient sous le régime de l'état de siège, mais qui l'a perdue depuis, nous avons vu sous l'influence de quels phénomènes d'évolution.
Dans l'opinion des protectionnistes, cette servitude n'a point cessé d'être nécessaire, et le devoir des consommateurs est de s'y soumettre quand même. Dans l'opinion du consommateur, au contraire, ce devoir n'existe pas, et c'est en vain qu'on a fondé des ligues ou des associations pour en raviver l'a notion, on n'a réussi nulle part à persuader aux consommateurs qu'ils devaient donner la préférence aux produits nationaux et à les détourner d'acheter des similaires étrangers quand ils croyaient y trouver avantage, ces produits similaires eussent-ils l'origine la plus détestée. Alors, qu'a-t-on fait? On a renforcé et étendu de plus en plus l'appareil de prohibitions et de pénalités qui avaient pour objet de contraindre les consommateurs à se soumettre à cette servitude, et quand les économistes ont entrepris de démolir cet appareil suranné, on les a accusés de vouloir ruiner l'industrie nationale au profit de l'industrie étrangère, en un mot, de manquer de patriotisme.
[419]
De même, la nation, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs politiques, dans les limites où s'étend la domination de l'État et de ses détenteurs, appartient ou est assujettie à l'État. Quelles que soient l'infériorité et la cherte des services qu'elle en reçoit, non seulement elle est obligée de s'en contenter, et ce serait un crime de les demander à un État étranger au moyen d'une annexion totale ou partielle; mais encore son devoir envers la patrie lui commande de mettre au besoin sans compter son sang et ses ressources à la discrétion des détenteurs de l'État pour empêcher la concurrence étrangère d'empiéter sur leur marché. Seulement, comme les consommateurs ne comprennent guère mieux ce qu'ils doivent à l'État que ce qu'ils doivent à l'industrie nationale, on les contraint à fournir par voie d'impôt, de réquisition ou de conscription, les capitaux et les hommes nécessaires à la défense des frontières de l'État et au besoin à leur agrandissement. Ceux qui refusent de se soumettre aux sacrifices qu'on leur impose dans l'intérêt de la patrie, ou même qui se contentent de protester contre leur exagération, sont accusés encore de manquer de patriotisme.
II y a toutefois une distinction à établir entre la protection de l'industrie et celle de l'État. En admettant que l'on cesse de protéger l'industrie, les consommateurs, libres de s'adresser aux industries concurrentes dans le pays et ù l'étranger, seront toujours assurés de pouvoir s'approvisionner des produits dont ils ont besoin aux conditions les plus avantageuses. Il en sera autrement pour les services politiques. Ces services, continuant partout d'être grevés d'une servitude au profit de l'État, la conquête expose les consommateurs à être assujettis à un Etat inférieur en civilisation, qui leur impose, à la mode révolutionnaire, ses institutions rétrogrades et son personnel de fonctionnaires aux allures despotiques et, de plus, leur [420] fasse payer à un plus haut prix des services de qualité moindre. Mais encore les sacrifices qu'on leur impose pour la protection de l'Etat devraient-ils être proportionnés à ce risque. Quand ils dépassent le montant de la prime nécessaire pour le couvrir, ils cessent d'être conformes à l'intérêt des consommateurs, c'est-à-dire à l'intérêt général, et la nation subirait un dommage moindre à être exposée à la conquête étrangère qu'à supporter des charges en disproportion avec le dommage auquel la conquête l'expose.
Malheureusement, ce n'est pas la masse des consommateurs politiques qui décide des questions de paix ou de guerre. Cette décision appartient encore, même dans les pays réputés les plus libres, au personnel gouvernant, qui, tirant ses moyens d'existence de l'industrie politique, a un intérêt illimité à imposer ses services aux consommateurs, tandis que ceux-ci n'ont qu'un intérêt limité à les recevoir de préférence à d'autres. On a pu constater fréquemment les différences d'opinion résultant de cette différence d'intérêt, dans les pays qui viennent à être assujettis à une domination étrangère, — ce qui, d'ailleurs, est parfois un avantage et un progrès, quand le gouvernement indigène était oppressif et vicieux. Si le gouvernement nouveau n'est pas plus lourd que l'ancien, s'il respecte les mœurs, les coutumes et la langue des populations, la masse des consommateurs politiques se résigne aisément k ce changement de domination. En revanche, la classe politique ne l'accepté que dans le cas où le conquérant lui conserve la situation prépondérante qu'elle possédait et qu'il est bien rarement en son pouvoir de lui conserver, car il est obligé de compter avec les appétits de son personnel. Cette classe politique dépouillée de son débouché demeure à l'état de conspiration et saisit toutes les occasions favorables de reconquérir l'État qu'elle a perdu. Il [421] arrive alors que les consommateurs politiques sont obligés de payer deux impôts : l'un à l'État étranger, sous la domination duquel la conquête les a fait tomber, l'autre à l'État national, représenté par les conspirateurs. Ils cherchent naturellement à sortir de cette situation critique et finissent d'ordinaire par faire cause commune avec les conspirateurs au milieu desquels ils vivent et qui se croient autorisés, d'ailleurs, à titre de représentants de la « nationalité », à soumettre ceux qui leur refusent obéissance et secours à des pénalités autrement terribles et sommaires que celles auxquelles peut avoir recours un gouvernement régulier. Ce qui ne les empêche pas de regretter plus tard, — quand la conspiration, devenue gouvernement, a augmenté leurs charges, — la domination étrangère.
Lorsque le gouvernement étranger a été expulsé, on ne manque pas de célébrer la délivrance de la patrie, mais ce n'est pas tout. Si quelque morceau du territoire réputé national reste soumis à ce gouvernement ou à un autre, on s'écrie douloureusement que la patrie n'est pas faite, et on soutient qu'aucun sacrifice ne doit lui coûter pour récupérer le morceau qui lui manque, — quand même la population de ce morceau manquant préférerait le statu quo. Au moins, lorsque la patrie est faite, renonce-t-on à l'agrandir? Nullement. Tantôt il lui faut des « frontières naturelles », tantôt elle a besoin de s'annexer des races approximativement de même famille pour faire contrepoids à des races naturellement ennemies, sauf à nationaliser de gré ou de force celles qui ne sont pas suffisamment nationales. Il est bien entendu encore que les hommes, qui s'opposent à cet agrandissement de la patrie ou, en d'autres termes, à l'extension du débouché des industriels politiques qui exploitent l'État, sont dépourvus de patriotisme.
Voilà comment le protectionnisme politique exploite et [422] fausse la notion de la nationalité et le sentiment de la patrie.
Maintenant, supposons que la nécessité, déjà contestable, de la servitude politique vienne à disparaître comme a disparu celle de la servitude économique : qu'adviendra-t-il de la nationalité et du patriotisme? Parce que les consommateurs politiques pourront, individuellement ou collectivement, demander la sécurité de leur vie, de leurs propriétés et de leurs transactions à l'établissement national ou étranger qui leur fournira ce service en meilleure qualité et au meilleur marché, s'ensuivra-t-il que la « nationalité » cessera d'exister? N'est-elle pas déjà mise en péril à un plus haut point par l'importation étrangère des produits agricoles qui s'incorporent au consommateur et font entrer dans sa chair et dans ses os des éléments étrangers? La nationalité dérive à la fois de phénomènes géographiques, physiologiques, économiques et moraux; elle dépend de la situation, des affinités de race, de l'ancienneté des relations, de la communauté du langage; aussi longtemps que ces facteurs de la nationalité subsistent, elle se maintient avec tous ses signes caractéristiques: c'est ainsi qu'il y a une nationalité anglaise, française, russe, allemande, espagnole. La servitude qui oblige une nation à demander les services politiques dont elle a besoin à un établissement indigène, à l'exclusion de tout autre, ne contribue pas plus à sauvegarder sa nationalité que ne le ferait l'obligation qui lui serait imposée de se pourvoir exclusivement de produits agricoles et industriels dans les fermes et les manufactures nationales. Au contraire! Si la servitude politique associe des races antipathiques ou simplement dissemblables, des Anglais et des Irlandais, des Russes et des Polonais, des Allemands et des Français, et si les plus fortes, suivant en cela la tradition révolutionnaire, prétendent imposer leurs institutions et leur [423] langue aux plus faibles, les caractères originaux et utiles de celles-ci finiront par s'effacer, tandis que l'amalgamation forcée d'un élément hétérogène altérera le type national de celles-là. Il en sera autrement si les peuples sont libres dans leurs relations politiques et autres : ces relations déterminées alors uniquement par l'intérêt et la sympathie seront les plus favorables à la conservation et au perfectionnement des types nationaux. Est-il nécessaire d'ajouter que l'amour de la patrie est indépendant de la provenance des services politiques comme de celle des produits agricoles ou industriels? Ce sentiment respectable se compose, comme nous l'avons remarqué, de deux sortes d'éléments: l'amour du sol et du milieu physique où la créature humaine a grandi, et l'attachement particulier à la tribu ou à la nation dont elle fait partie, impliquant le désir de la voir dépasser les autres en richesse, en puissance et en civilisation. Or, si la servitude politique, après avoir été une condition nécessaire de l'existence et de la prospérité des nations perd sa raison d'être et devient au contraire pour elles une cause d'affaiblissement et de retard, ne serace point faire acte de patriotisme que de les en affranchir?
Notes
[58] Voir L'Évolution économique.
[59] La conquête et l'occupation de l'Inde offrent cette particularité digne de remarque qu'elles ont été exécutées commercialement en vue des bénéfices qu'elles pouvaient procurer à une compagnie d'actionnaires. Fondée en l'an 1600, au capital assez modeste de 80,000 livres sterling, la « Compagnie des marchands de Londres faisant le trafic des Indes Orientales » obtint de la reine Elisabeth le monopole du commerce dans toutes les mers situées au delà du cap de Bonne-Espérance et du détroit de Magellan. Elle s'occupa d'abord uniquement d'opérations commerciales, et elle réalisa des bénéfices considérables : de 1603 à 1613, huit expéditions successives rapportèrent, en moyenne, aux actionnaires des dividendes de 171 p. 100. Ces bénéfices excitèrent naturellement la Compagnie à étendre la sphère de ses opérations et à multiplier ses comptoirs. Mais ceux-ci n'étaient pas toujours respectés par les princes indigènes. La Compagnie fut obligée d'enrôler des troupes pour les défendre. En 1686, Jacques II l'autorisa à attaquer les Mongols, dont elle avait à se plaindre, et peu de temps après elle fut investie des pouvoirs nécessaires pour faire la guerre et la paix « avec les princes et les peuples pourvu qu'ils ne fussent pas chrétiens ». La Compagnie des marchands de Londres cessa dès lors d'être purement commerciale ou pour mieux dire, elle fit entrer au nombre des opérations de son commerce le gouvernement des contrées où elle avait fondé ses établissements. « L'accroissement du revenu par l'impôt, écrivaient les directeurs à leurs agents, vers la fin du xvnc siècle, doit être désormais le but de nos efforts aussi bien que le développement de notre commerce. » Les agents de la Compagnie suivirent fidèlement ces nouvelles instructions et ils finirent, à force d'audace et de persévérance, par substituer dans l'Inde le pouvoir d'une simple compagnie dc marchands à celui du Grand Mogol. Les acquisitions territoriales, qui n'avaient d'abord été pour elle qu'un accessoire, devinrent peu à peu le principal. Elle conservait cependant encore le monopole du commerce avec l'Inde et la Chine ; mais sur les plaintes des négociants de la métropole, le Parlement lui enleva, en 1814,1e privilège exclusif du commerce de l'Inde et, en 1834, celui du commerce de la Chine. A dater de cette époque jusqu'en 1858, où le gouvernement l'a abolie pour se mettre à sa place, la Compagnie (les Indes a cessé entièrement d'être une compagnie de commerce pour n'être plus qu'une « compagnie de gouvernement ».
Au 30 avril 1856, la Compagnie des Indes exercait sa domination sur une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés et sur .une population de 131,990,000 habitants. En outre, son influence ou son patronage s'exerçait sur une série d'États indigènes comprenant ensemble une population de 48.376,000 habitants. 180 millions d'hommes se trouvaient ainsi soumis à sa domination ou à son influence.
Malheureusement, si l'Inde était -soumise à la Compagnie, la Compagnie était soumise à son tour à la couronne, et depuis 1784, époque de la fondation du Board ofcontrol, cette sujétion était devenue de plus en plus étroite. La Compagnie avait joui jusqu'alors d'une certaine indépendance, quoiqu'elle fût obligée de faire renouveler son privilège tous les vingt ans. Elle se gouvernait elle-même, et la couronne n'exerçait sur elle qu'un faible controle. Mais, à la fin du xviiie siècle, les conquêtes de Clive ayant rendu la Compagnie maîtresse de la plus grande partie de l'Inde, sa puissance croissante ne manqua point d'exciter la jalousie du gouvernement. Les déprédations de Warren Hastings et le procès scandaleux auquel elles donnèrent lieu, fournirent bientôt au Parlement un motif plausible pour intervenir dans l'administration de la Compagnie. Le Bureau de contrôle fut institué avec des pouvoirs qui lui attribuaient la prépondérance réelle dans la direction des affaires de l'Inde. A partir de ce moment, la Compagnie fut obligée de subir la politique qu'il plut au gouvernement de lui imposer. Cette politique n'était, il faut bien le dire, ni intelligente ni élevée. Le gouvernement anglais ne se préoccupait ni des intérêts de la compagnie ni de ceux des populations qu'elle gouvernait : il ne songeait qu'à étendre la domination britannique et, avec elle, le patronage lucratif de l'aristocratie gouvernante.
En conséquence, il imposait à la Compagnie l'obligation de maintenir sur pied une armée formidable, et il la poussait incessamment à faire de nouvelles conquêtes. Si la Compagnie objectait l'insuffisance de ses ressourceg,<m l'autorisait à contracter des emprunts; si elle objectait encore la nécessité de distribuer des dividendes à ses actionnaires, on lui permettait de leur allouer, en tout temps, un dividende ou un intérêt de 10 1/2 p. 100.
L'organisation de la Compagnie des Indes ne différait pas essentiellement de celle d'une compagnie ordinaire. Son capital, qui était de 6 millions sterling à l'époque où elle a été abolie, se trouvait réparti entre environ 4,000 actionnaires ; mais ceux-ci n'étaient admis à participer à la gestion de la Compagnie qu'à la condition de posséder des actions jusqu'àconcurrencc de 1,000 livres sterling. Une part de 1,000 livres dans le capital donnait droit à une voix ; une part de 3,000 livres, à deux voix ; une part de 6,000 livres, à trois voix; enfin une part de 10,000 livres et plus, à quatre voix. Le nombre des actionnaires admis à voter était, en dernier lieu, de 1,780. Les actionnaires étaient admis à exercer leur droit sans distinction de nationalité ni de sexe et, parmi les 1,780 votants, on ne comptait pas moins de 400 femmes. Ces 1,780 actionnaires actifs, qui possédaient une part de capital de 1.000 livres et au-dessus se réunissaient quatre fois par an en assemblée générale (cour des propriétaires). Ils nommaient le conseil d'administration (cour des directeurs), qui a été composé tantôt de 24 et tantôt de 18 membres ; ils contrôlaient les dépenses, votaient les budgets, etc., etc. Le conseil d'administration, ou la cour des directeurs, était chargé de la gestion de l'entreprise. Il'se divisait pour l'expédition des affaires en trois comités: finances et intérieur, politique et guerre, revenus et justice. Tous les ans, les 6 directeurs le plus anciennement élus étaient remplacés. Un directeur ne pouvait être réélu qu'un an après sa sortie de fonctions. La cour des directeurs se choisissait un 'président, lequel était chargé de présider aussi les assemblées générales des actionnaires.
La cour des directeurs constituait donc le pouvoir exécutif de la Compagnie. Seulement, depuis 1784, époque à laquelle le gouvernement avait constitué le Board of control, la cour des directeurs était obligée de soumettre toutes ses décisions et toutes ses mesures de quelque importance à l'approbation de ce bureau de contrôle ou de surveillance, dont les membres étaient nommés par le souverain dans son conseil privé. Le Board of control avait fini même par empiéter sur les pouvoirs du conseil d'administration de la Compagnie, de facon à s'attribuer la direction réelle du gouvernement de l'Inde et à entraîner la Compagnie dans la voie coûteuse de la politique d'annexions. La Compagnie était constituée pour une période illimitée ; pliais sou privilège avait été limité à vingt années. Au bout de cette période, il était soumis au Parlement qui le renouvelait, en en modifiant plus ou moins les conditions. Il expirait en 1854, mais à cette époque l'opinion favorable au gouvernement direct de l'Inde ayant commencé à prévaloir, on ne l'a renouvelé que d'une manière provisoire jusqu'à la dissolution de la Compagnie en 1858.
De l'aveu de tous les voyageurs, les régions soumises à la Compagnie étaient incomparablement mieux administrées que celles qui étaient demeurées assujetties à la domination des princes indigènes. La police y était mieux faite, le pauvre y pouvait obtenir justice contrôle riche, et la presse jouissait dans l'Inde d'une liberté entière. Au bienfait d'une sécurité et d'une liberté inconnues dans le reste de l'Asie et même dans une bonne partie de l'Europe, il faut ajouter encore une énergique impulsion donnée aux travaux publics.
La Compagnie avait fait exécuter d'immenses travaux d'irrigation, construit les canaux de la Jumma et du Gange, le barrage du Godavery, etc. Enfin c'est à l'époque de sa domination qu'ont été commencés les travaux des chemins de fer et des télégraphes. En 1858, un réseau télégraphique de 5,000 kilomètres reliait les principaux foyers de population de l'Inde et près de 4,000 kilomètres de chemins de fer étaient en construction. [Note: La Domination anglaise dans l'Inde. Economiste belge. (Avril-juin 1858.)]
Dans une remarquable brochure intitulée :Suggestions fur a future government of India, miss Harriet Martincau faisait ressortir la supériorité du gouvernement de la Compagnie sur le gouvernement colonial de la métropole et elle signalait les causes de cette supériorité, qu'elle qualifiait de « manifeste et indiscutable ».
« Pendant des siècles de changements continuels et de fréquentes perturbations que les Anglais pouvaient contrôler chez eux, mais qui ne pouvaient manquer d'être terriblement nuisibles aux intérêts des colonies, le gouvernement de l'Inde a été stable, consistant et aussi immuable aux yeux de ses sujets indiens que celui d'un Dieu assis sur un trône inébranlable. Dans ce ras particulier, cette stabilité du gouvernement a été un inestimable bienfait. Sou caractère corporatif, la succession de ses chefs d'origine diverse, l'ont préservé des maux du despotisme, tandis que son indépendance de la politique du jour l'a protégé contre la multitude des inconvénients des changements de partis, — inconvénients que nous reconnaissons être des maux chez nous, quoique nous les préférions à ceux de tout autre système. Dans l'Indoustan, le caractère non politique de la Compagnie a été absolument une question vitale. Notre domination n'aurait pu y être maintenue si les autorités d'lndia House avaient été changées avec chaque ministère...D'un autre côté, le public n'ignore pas que partout où l'on a pu établir une comparaison entre les fonctionnaires du gouvernement et ceux de la Compagnie, la supériorité de ces derniers a été manifeste et indiscutable. Les chefs militaires de la Compagnie ou les officiers de la reine à la solde de la Compagnie et accoutumés de la guerre indienne, ont remporté des succès aussi brillants que les déconvenues des autres ont été lamentables. Le public a eu moins souvent l'occasion de constater à quel point le même contraste existe dans le service civil, mais il n'est pas moins sensible pour tous ceux qui sont au courant des affaires des deux gouvernements. »
Miss Harriet Martineau terminait par cette prédiction:
« Si nous nous hâtons de décider que l'Inde sera une colonie de la couronne, gouvernée directement et entièrement par l'Angleterre, d'après les notions et les habitudes existantes de notre régime colonial, nous perdrons l'Inde promptement, honteusement et d'une manière si désastreuse que ce sera uue des calamités les plus mémorables de l'histoire des nations. »
La prédiction de miss Martineau ne s'est pas encore réalisée, mais le rapide accroissement du budget et de la dette de l'Inde, sous le régime du gouvernement direct, confirme amplement ce qu'elle disait de la supériorité économique du gouvernement de la Compagnie.
Dans' l'exercice finissant le 30 avril 1856, les dépenses de la Compagnie étaient de liv. 29,154,490; elles se sont élevées à liv. 71,113,079 dans l'exercice 1881-1882. La dette a monté de liv. 34,684,997 en 1840 à liv. 157,388,879 en 1881.
Il est permis de croire, avec miss Martincau, que l'Angleterre aura quelque our à se repentir d'avoir assumé la lourde tâche du gouvernement direct de l'Inde. A l'époque où a eu lieu cette annexion rétrograde et anti-économique du domaine de la Compagnie à la régie de la couronne, voici comment nous proposions de résoudre la question indienne. Si nous reproduisons celte solution, c'est parce que le gouvernement de la Compagnie des Indes est, à nos yeux, le type des gouvernements de l'avenir.
Eu définitive, disions-nous (La Domination anglaise dans l'Inde), l'Angleterre, tout en s'attribuant la possession politique de l'Inde, ou si l'on veut, le droit de la gouverner, délègue ce droit à une compagnie organisée commercialement, mais en intervenant d'une manière plus ou moins active dans la gestion de celte compagnie concessionnaire du service gouvernemental de l'Inde et en se réservant la faculté de rompre le contrat au bout de vingt années ou d'en modifier les conditions. C'est pour tout dire le système de Va/fermage, transporté dans le domaine gouvernemental et substitué à celui du gouvernement direct ou de la régie.
Le système de l'affermage constitue évidemment un progrès économique sur celui de la régie, et ce serait faire un pas rétrograde que de l'abandonner pour revenir à ce dernier. Mais il ne s'ensuit pas qu'il soit nécessaire de conserver intact le mode actuel de concession ou d'affermage du gouvernement de l'Inde. Il ne s'ensuit pas non plus qu'il faille s'en tenir toujours aux conditions stipulées avec les premiers concessionnaires.
Ainsi l'expérience a démontré que l'Inde est maintenant trop vaste pour être bien gouvernée par une seule compagnie. Pourquoi ne diviserait-on pas la concession primitive? pourquoi ne fractionnerait-on pas l'Inde entre trois ou quatre compagnies, ayant chacune 40 à KO millions d'âmes à gouverner, au lieu de 130? N'est-il pas évident que le fractionnement d'un service trop vaste permettrait de le mieux remplir, et quo l'Inde serait beaucoup mieux gouvernée par trois ou quatre compagnies qu'elle ne peut l'être par une seule?
Dans l'état actuel des choses, avec l'intervention continue et tracassière du gouvcr.icmcnt dans les affaires de l'Inde, avec son système militaire et annexionniste qui a été si ruineux pour les finances de la Compagnie actuelle, ou trouverait sans doute assez difficilement des capitalistes disposés à aventurer leurs fonds dans de semblables entreprises. Mais on pourrait accorder aux compagnies concessionnaires plus de liberté dans leurs allures, ainsi que des concessions à plus longs termes. D'un autre côlé,lc gouvernement stipulerait différentes garanties en faveur des populations dont il affermerait ou concéderait ainsi l'administration ; il stipulerait, par exemple, que les impôts ne pourraient dépasser un certain chiffre, que les libertés les plus essentielles, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté d'association, etc., devraient être respectées; enfin que la non-exécution de ces clauses rendrait le contrat nul de plein droit.
Ces compagnies ainsi maîtresses de leur gestion, à la seule condition d'exécuter les clauses de leur contrat, recruteraient leur personnel d'employés civils et militaires où ils seraient les meilleurs et au meilleur marché, sans faire aucune acception de nationalité. Le principe du fret trade serait appliqué à l'Inde pour les services aussi bien que pour les produits, et l'on verrait, en conséquence, s'y accroître rapidement l'élément européen qui s'y trouve aujourd'hui dans des proportions tout à fait insuffisantes.
Sans doute, l'Angleterre fournirait le plus grand nombre des actionnaires et du personnel des nouvelles compagnies, comme elle fournit encore les trois quarts des produits européens consommés dans l'Inde; mais enfin elle n'aurait plus, à aucun degré, le « monopole de l'Inde »; elle admettrait toutes les nations à concourir au gouvernement de ce vaste empire, au moyen de leurs capitaux ou de leurs services ; elle ne se réserverait qu'un simple patronage qui ne conférerait à ses nationaux aucun bénéfice, aucun avantage exclusif. Or, du moment où l'Inde ne procurerait plus aux Anglais aucun avantage particulier, du moment où tous les Européens seraient admis à y remplir toutes les fonctions publiques sur le même pied que les Anglais, nous ne voyons pas qui pourrait songer encore à déposséder l'Angleterre de ce patronage qu'elle exercerait pour l'avantage commun des peuples civilisés. Toutes les nations ne seraient-elles pas intéressées, au contraire, à le lui conserver, afin d'éviter le retour d'une domination exclusive qui substituerait, de nouveau, en matière de gouvernement, le principe du monopole à celui du Free trade?
Ce système ne serait, remarquons-le bien, qu'un perfectionnement du système actuel. Le principe demeurerait le même. Ce serait toujours la concession ou l'affermage substitué à la régie. Il n'y aurait de changé que le mode et les conditions de l'application. Au lieu d'une seule compagnie concessionnaire, devenue insuffisante pour gouverner un empire que des annexions successives ont rendu de plus en plus vaste, il y aurait autant de compagnies que cela serait nécessaire pour que l'Inde fût économiquement gouvernée. D'un autre côté, au lieu [de limiter la durée des concessions et d'assujettir les concessionnaires à l'intervention gênante et tracassière du Board of contrat, on leur assurerait une possession illimitée, à la seule condition d'exécuter fidèlement un cahier des charges dont les articles concerneraient surtout les garanties à accorder aux peuples gouvernés. Les compagnies réuniraient ainsi ces deux conditions essentielles à .toute bonne exploitation : la sécurité et la liberté. Elles seraient intéressées du reste à bien gouverner les peuples soumis à leur domination, afin de rendre plus productives les sources d'où elles tireraient leurs revenus; et l'Angleterre, de son côté, n'aurait pas moins d'intérêt à les empêcher de vexer et de pressurer leurs sujets. Car plus la situation des peuples de l'Inde deviendrait prospère, plus le commerce que font avec eux les nations européennes et l'Angleterre en particulier pourrait prendre d'extension, plus abondantes et plus fructueuses deviendraient les relations de l'Europe avec l'Inde. Les intérêts les plus élevés de la civilisation ne seraient pas moins bien servis par l'adoption de ce système qui détruirait les dernières barrières que l'esprit de monopole a élevées entre l'Inde ot le reste du monde; qui permettrait aux capitaux et aux intelligences, sans distinction d'origine, de contribuer à faire pénétrer dans ce foyer presque éteint de l'antique civilisation les idées, les inventions et les méthodes vivifiantes et progressives de la civilisation moderne.
[60] Voici, d'après le Financial reform Almanack pour 1884, le relevé des denrées alimentaires de toute espèce importées en Angleterre en 1840 sous le régime de la protection et en 1882, sous le régime du free trade:
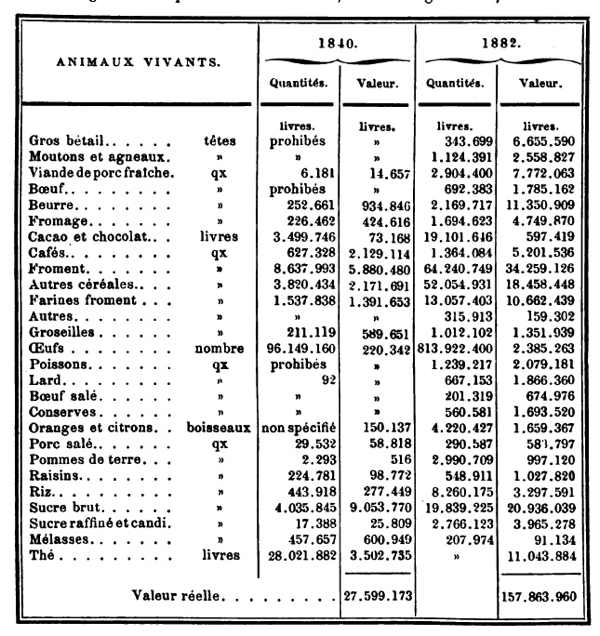
Tous ces articles entrent maintenant en franchise, à l'exception du cacao, du café, des groseilles, des raisins et du thé.
Ne suffit-il pas de jeter un simple coup d'œil sur ce relevé pour se convaincre que la paix s'impose aujourd'hui comme une nécessité aux peuples civilisés?
[61] Les pénalités contre les manœuvres séparatistes ont été renouvelées en France par la loi de 1871 contre l'Association internationale des travailleurs et le séparatisme.
« L'idée même de patrie, lisons-nous dans l'exposé des motifs du projet de loi, disparaîtrait s'il était loisible de proposer la rupture du lien national, sans que la loi pût réprimer de pareilles provocations.
« Les lois qui répriment les crimes et délits contre l'ordre public sont muettes cependant sur ce point et ne contiennent aucune peine contre ce genre de délit nouveau dans notre pays. L'article 77 du Code pénal punit de la peine capitale les intelligences entretenues et les manœuvres pratiquées avec les ennemis de l'Etat pour leur livrer une partie du territoire. La provocation par la voie de la presse à des crimes de cette nature est punie par les lois sur la presse, et notamment par les articles 1 et 2 de la loi du 17 mai 1819, qui punissent la provocation publique aux crimes et délits. Mais ces dispositions ne seraient pas facilement appliquées aux manœuvres ou aux manifestations publiques des séparatistes, ni à l'appel fait au suffrage universel pour le provoquer à se prononcer contre le maintien national.
« C'est cette lacune que le projet de loi soumis à l'Assemblée aurait pour objet de combler. Nous ne proposons que des peines modérées et prises dans la nature même du délit : le condamné sera privé de la qualité de citoyen français après en avoir méconnu et la dignité et les devoirs les plus essentiels. Soumis en France à la condition des étrangers, privé de cette nationalité qu'il aurait, en quelque sorte, abjurée par avance, il ne pourrait reconquérir la qualité de Français qu'en accomplissant les conditions prescrites à l'étranger qui aspire à devenir citoyen.
« La loi préserverait ainsi le principe de la souveraineté nationale d'attaques dont le danger n'est sans doute pas grand au milieu de populations françaises de cœur, mais qui ne sauraient rester impunies. »
[62] Voir les Soirées de la rue Saint-Lazare, 11e soirée, p. 303. — Les Questions d'économie politique et de droit public, la liberté de gouvernement, t. II, p. 24S. — Cours d'économie politique, les consommations publiques, 126 leçon, p. 480.
[63] La nécessité de ces groupements se fit sentir aussi pour l'administration des services religieux. C'est ainsi qu'on voit, à l'époque de l'établissement et de la propagation du christianisme, se former des communes religieuses ou paroisses, dans un rayon plus ou moins étendu selon la configuration du sol, la densité rtc la population, la facilité plus ou moins grande des communications. Lorsque la hiérarchie se constitue, ces paroisses se groupent ou sont groupées selon leur situation topographiquc et leurs affinités de race et de langue, et elles forment un évéché ; les évéchés à leur tour sont groupés en archevêchés toujours en tenant compte des circonstances naturelles parmi lesquelles il ne faut pas oublier l'appartenance politique; enfin, les archevêchés ressortent directement du pape, sous la réserve de leurs obligations envers le propriétaire politique de l'État.
[64] En confisquant l'État politique et en faisant suivre cette confiscation de celle des biens du clergé et d'une partie de la noblesse, la révolution a créé un « risque » qui menace tous les propriétaires et qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste se chargera de faire échoir. Quel langage tiennent, en effet, aujourd'hui les collectivistes et les anarchistes? Ils disent: La révolution bourgeoise de 1789 a donné la puissance politique au tiers état, et elle a fait passer entre ses mains, par voie de confiscation, les biens de la noblesse et du clergé! Eh bien, ce qui a été fait alors au profit du tiers état, c'est-à-dire de la bourgeoisie, il s'agit de le refaire au profit du quatrième état, c'est-à-dire du peuple. Notre tâche à nous, c'est d'achever l'œuvre de la révolution en transformant en « biens nationaux » les exploitations agricoles, minières, industrielles et autres appartenant à la bourgeoisie capitaliste, comme nos pères ont transformé en « biens nationaux u les propriétés de la maison souveraine, de la noblesse et du clergé.
« La révolution qu'il s'agit de faire aujourd'hui contre la bourgeoisie, dit un écrivain notable du collectivisme, M. Jules Guesde (Collectivisme et Révolution), la bourgeoisie, lorsqu'elle n'était encore que le tiers état, l'a faite elle-même contre la noblesse et le clergé! Il n'est personne qui ne se souvienne comment elle s'est approprié en 89 les « biens » de ces deux ordres après les avoir déclarés « nationaux ». Et ce n'est pas parce qu'au lieu de s'emparer comme elle l'a fait à son profit exclusif de plus des deux tiers de la France, les prolétaires entendent approprier collectivement la France entière au bénéfice de tous, — les bourgeois y compris (?), —• que leur révolution pourrait être moins justifiée que l'autre. Bien au contraire.
« Car, — on ne saurait trop insister sur ce point, — ce qui caractérise la révolution poursuivie par la B'rance ouvrière ou le quatrième état, c'est qu'elle ne tend pas à substituer une classe à une autre classe dans la possession du sol et des autres capitaux, mais à fondre toutes les classes en une seule, celle des travailleurs, au service desquels devra être mis l'ensemble des capitaux de production. »
A ce langage, nous ne voyons pas ce que pourraient répondre les écrivains qui se plaisent à justifier la légitimité des confiscations révolutionnaires en France, la « reprise » des biens du clergé et des couvents dans les autres pays. Si le tiers état a eu le droit de confisquer les biens de la noblesse et du clergé avec l'État lui-même, le quatrième état n'a pas un droit moins évident de confisquer les biens de la bourgeoisie capitaliste pour les mettre au service de la « classe des travailleurs ».
Il n'y a, quoi qu'en disent les sophistes prétendus libéraux et conservateurs, aucune différence substantielle entre ces deux sortes de propriétés. Les unes et les autres ont été également'le fruit du travail et des services rendus. Si la noblesse n'a pas défriché, avec la houe et la charrue, le sol de ses domaines, elle l'a défendu pendant des siècles et il n'est pas xm sillon qui n'ait été arrosé de son sang; elle a produit la sécurité sans laquelle aucune terre n'eût été cultivée, et ce service, comme nous l'avons démontré ailleurs (Cours d'économie politique, 13e leçon, la Part de la terre), s'est incorporé dans le sol, il a été l'un des premiers éléments de la râleur de la terre. Les biens du clergé n'ont pas eu une origine moins légitime; ils ont été la récompense de services non moins nécessaires : ceux du gouvernement politique et moral de multitudes encore à l'état demi-sauvage, et c'est aux monastères que l'on doit le défrichement de la plus grande partie du sol et la renaissance de l'industrie et des lettres après les grandes invasions barbares. Dira-t-on que ces propriétés ont été accrues et viciées par les privilèges et les monopoles? Mais n'en peut-on pas dire autant de celles de la bourgeoisie? Qncl a été l'objet des monopoles conférés aux banques, aux Compagnies de chemins de fer et, finalement, à tous les entrepreneurs d'industrie que protègent les tarifs douaniers, sinon d'augmenter leurs revenus, partant leurs propriétés, aux dépens de la masse des consommateurs de leurs produits ou de leurs services? Dira-t-on encore que la noblesse s'était amollie, que les moines s'étaient corrompus et que les couvents étaient devenus des repaires du vice et de la fainéantise, que noblesse et clergé avaient fini par soulever contre eux la haine de toutes les autres classes de la nation? Mais si l'on compare les mœurs de la bourgeoisie gouvernée du xvnc et du xvin" siècle à celles de la bourgeoisie politicienne du xixe siècle, est-ce bien un progrès que l'on pourra constater? Si la corruption et la fainéantise étaient des motifs suffisants pour légitimer la confiscation, l'État ne serait-il pas autorisé à reprendre les biens de tous ces beaux fils d'industriels, de négociants, de financiers, [qui dissipent dans l'oisiveté et la débauche la fortune que des pères entreprenants, laborieux et économes leur ont léguée? Enfin, si l'impopularité d'une classe devait justifier sa dépossession, les entrepreneurs d'industrie, les propriétaires de mines et autres ne seraient-ils pas exposés aujourd'hui à être expropriés au même titre que l'ont été les nobles, les prêtres et les moines? Ne pourrait-on pas prétendre même, en lisant les journaux socialistes, en écoutant les discours des meetings populaires et les conversations d'atelier que la domination de la classe moyenne a soulevé plus de haines et de rancunes en cinquante ans que celle de la noblesse et du clergé n'en avait accumulé en dix siècles?
On insiste et on essaye tout au moins d'établir une distinction entre la propriété patrimoniale qui se lègue de père en fils, et la propriété des associations religieuses qui se perpétuent comme personnes civiles et constituent une « mainmorte. » C'est l'État qui crée, dit-on, les personnes civiles; il a, par conséquent, le droit de les supprimer, quand leur existence est devenue nuisible à la société. S'il ne possédait pas ce droit, s'il lui était interdit de toucher à la propriété d'institutions qui ont cessé, pour une cause ou pour une autre, de répondre à un besoin social, voyez à quelles conséquences absurdes et monstrueuses aboutirait le fétichisme de la propriété! Lorsque le christianisme a pris la place du paganisme, u'aurait-il pas fallu respecter la propriété des prêtres de Jupiter et de Vénus, et laisser subsister indéfiniment leurs temples? On les a confisqués avec justice dans l'intérêt général de la société. N'cst-il pas juste et raisonnable de confisquer de même la propriété des moines, devenus non moins inutiles sinon nuisibles que les prêtres de Jupiter et de Vénus? — A cet argument spécieux, la réponse est facile. L'État ne crée point les personnes civiles, — pas plus qu'il ne crée les personnes de chair et d'os. Elles se créent par l'accord des volontés et l'apport des capitaux de ceux qui fondent une association quelconque, civile ou commerciale; l'État se borne à garantir leur vie et leurs propriétés, absolument comme pour les personnes de chair et d'os. Il n'a pas plus le droit de tuer et de dépouiller les unes que les autres. Cependant, si des institutions se perpétuent quand elles ont perdu leur raison d'être, quand elles sont devenues une « nuisance », peut-on lui refuser le droit de les supprimer comme toute autre nuisance? Non! mais encore faudrait-il que cette nuisance fût manifeste et qu'elle se traduisît par dos actes criminels. Est-il nécessaire d'ajouter que les personnes civiles sont, comme les autres, sujettes à mourir de leur belle mort et qu'elles meurent dès qu'elles ont cessé d'être utiles quand on ne prolonge point artificiellement leur existence par des protections, des subventions et des privilèges. Prenons le cas d'une religion à son déclin. Comme toutes les autres entreprises, les établissements religieux en décadence sont abandonnés successivement par leur clientèle: d'où il suit que leurs profits vont diminuant et finissent par faire place à des pertes et à des déficits. On comble d'abord ces déficits par des emprunts. Mais si la clientèle continue à déserter, si les déficits subsistent et vont croissant, les emprunts finissent par absorber la valeur de la propriété et les propriétaires sont obligés de liquider l'établissement. Telle eût été la destinée finale et inévitable des établissements religieux du paganisme, et tel est, aux États-Unis, le sort des religions ou des sectes qui ne réussissent point à recruter une clientèle suffisante pour couvrir leurs frais. Il suffit que l'État s'abstienne de les subventionner pour qu'elles ne traînent point une existence inutile; la concurrence se charge d'en faire justice.
En revanche, aussi longtemps qu'un établissement religieux ou autre répond à un besoin, il résiste aux réglementations les plus étroites et même aux prohibitions les plus rigoureuses. Tel est actuellement le cas pour les ordres monastiques et les couvents. On a beau les dissoudre, disperser leurs membres et confisquer leurs biens au nom de la « liberté », on n'a point réussi et on ne réussira point à les extirper. Pourquoi? Parce qu'ils répondent encore à un besoin religieux et surtout, plus que jamais, à un besoin de tutelle dans nos sociétés de self govermnent obligatoire. C'est une forme arriérée et surannée, si l'on veut, de la tutelle, mais qui est encore préférée par beaucoup d'individualités des deux sexes à la responsabilité et l'isolement de leur existence. En vain on la prohibera, elle subsistera quand même. Il n'y a qu'un moyen efficace de la supprimer, c'est la concurrence. Le jour où des institutions de tutelle, mieux adaptées à l'état actuel des hommes et des choses, seront offertes aux individualités qui se sentent incapables de supporter la responsabilité du self government, les ordres monastiques auront vécu et les couvents entreront en liquidation; mais jusque-là iU résisteront victorieusement aux interdictions et aux confiscations du prohibitionnisme libéral et conservateur-révolutionnaire.
On voit par là comment devrait être résolue la question actuellement pendante de la séparation de l'Église et de l'État. En échange des biens que la révolution lui a enlevés, l'Église a accepté une subvention annuelle qui constitue la dotation du culte catholique. Le capital de cette subvention devrait lui être remis avec les édifices affectés au culte. L'atteinte portée par la révolution à la propriété religieuse serait ainsi réparée autant qu'elle peut l'être, et le risque auquel elle a exposé toutes les autres propriétés diminué. Ce qui n'empêcherait pas le catholicisme de disparaître et ses établissements de se liquider le jour où, comme autrefois le paganisme, il aurait cessé do répondre aux besoins religieux de la société et où quelque autre croyance mieux adaptée à ces besoins viendrait lui faire concurrence.
Une dernière question soulevée par les héritiers du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple reste à résoudre. C'est la question de savoir si la confiscation de l'État et la dépossession de la noblesse et du clergé ont été avantageuses à la bourgeoisie; si, par conséquent, la dépossession de la bourgeoisie et la socialisation de l'État seraient avantageuses à la « classe des travailleurs ». Pour les collectivistes du quatrième état, l'affirmative n'est pas douteuse. Ils sont absolument convaincus que la bourgeoisie doit sa fortune à la dépossession de la noblesse et du clergé, à l'acquisition du monopole de l'exploitation de l'État, aux emplois, aux privilèges et aux faveurs que ce monopole lui a valus, et bon nombre de bourgeois, même éclairés, sont, au fond, du même avis. Cependant rien n'est plus contestable; disons mieux, rien n'est plus, contraire à la vérité.
Nous ferons remarquer d'abord que la classe moyenne de la GrandeBretagne s'est enrichie beaucoup plus encore que la nôtre, quoique la puissance politique soit restée jusqu'au Reform bill entre les mains de l'aristocratie. Nous ferons remarquer ensuite que la bourgeoisie française est, de toutes les classes de la nation, la noblesse et le clergé y compris, celle dont la fortune et l'influence se sont le plus augmentées dans les derniers siècles de l'ancien régime. En supposant que la révolution n'eût pas éclaté, et même que la bourgeoisie n'eût pas acquis jusqu'à présent la puissance politique, le développement prodigieux de l'industrie n'aurait pas manqué d'accroître sa fortune et son influence dans une mesure plus considérable encore qu'au siècle précédent. Elle n'aurait pas disposé peut-être d'une manière aussi complète du débouché des fonctions et des emplois politiques et administratifs, elle aurait moins émargé au budget, son industrie eût été moins protégée, le régime prohibitif n'eût point succédé au régime libéral inauguré par le traité de 1786, le monopole de la banque de France n'eût pas été institué, les ouvriers n'eussent pas été_mis à la discrétion des patrons par la suppression du droit d'association et les lois sur les coalitions; mais est-il bien avéré que l'émargement au budget, les monopoles et la protection ont contribué à augmenter la richesse, la vitalité et la puissance réelle de la bourgeoisie? Les emplois publics, en exigeant, avec un travail moins assidu, moins d'efforts d'intelligence et de volonté que les emplois de l'industrie privée, n'ont-ils pas pour effet d'affaiblir, à la longue, physiquement et intellectuellement ceux qui les exercent, et cet affaiblissement ne devient-il pas héréditaire? Si les monopoles et la protection enrichissent un petit nombre d'actionnaires d'établissements privilégiés, de propriétaires et d'entrepreneurs d'industrie, n'est-ce pas aux dépens du grand nombre des capitalistes et des hommes industrieux dont ils augmentent les charges et rétrécissent les débouchés? En laissant même de côté la démoralisation dont l'exploitation de l'État et les compétitions qu'elle provoque ont été la source pour la classe moyenne, on peut affirmer qu'elle serait aujourd'hui plus riche, plus influente, plus saine et aussi moins menacée si la révolution n'avait pas fait tomber entre ses mains la puissance politique. Maintenant supposons qu'une révolution complémentaire fasse descendre cette puissance dans le quatrième état, supposons même que ce quatrième état confisque les biens de la bourgeoisie capitaliste au profit de la « classe des travailleurs » et établisse en faveur de celle-ci un régime de monopole et de protection analogue à celui dont la première révolution a doté la classe moyenne, est-il bien certain que les travailleurs en deviendront plus riches? Il ne faut pas être bien fort en économie politique pour prévoir que la production de la richesse diminuera de la moitié ou des trois quarts sous ce nouveau régime ; que les biens et les capitaux confisqués aux bourgeois seront promptement gaspillés et détruits, et que le quatrième état ne régnera que sur des ruines et des cadavres. N'en déplaise aux collectivistes et aux anarchistes, ce n'est pas la possession de l'État qui a fait la fortune de la bourgeoisie; elle ferait encore moins celle du peuple.
Sans doute, la domination exclusive d'une classe est nuisible à toutes les autres. Mais s'ensuit-il que le monopole de la puissance politique soit avantageux, malgré ses bénéfices apparents, à la classe qui le possède? La noblesse et le clergé sont tombés en décadence pour l'avoir accaparé sous l'ancien régime. Il no se passera pas longtemps avant que les bourgeoisies politiciennes qui gouvernent actuellement la plupart des États modernes subissent le même sort. Tout ce que peuvent souhaiter les sincères amis du peuple; dans l'intérêt de son bien-être et de ses progrès matériels et moraux, c'est qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste ne lui ïasse point ce présent décevant et funeste.
[65] La souveraineté individuelle contient la souveraineté politique, et celleci a ses limites déterminées par la nature même du besoin auquel pourvoit la production de la sécurité ou le gouvernement. Est-il nécessaire de remarquer que cotte théorie est en opposition absolue avec la théorie monarchique et la théorie révolutionnaire de la souveraineté? Celles-ci, à les bien considérer, sont identiques, ou du moins elles se ressemblent eu ce point capital qu'elles ne comportent pas de limites. Le roi ou l'empereur, dans la théorie monarchique, tient sa souveraineté de Dieu lui-même; il ne doit compte qu'à Dieu de l'usage qu'il en fait; clic est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au souverain de lui imposer. Dans la théorie révolutionnaire, le peuple rentre en possession de la souveraineté qu'avait usurpée le roi ou l'empereur, et il n'en doit compte qu'à lui-même; elle est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au peuple ou à ses mandataires de lui marquer; encore est-ce une question de savoir si les mandataires peuvent, sans se rendre coupables d'usurpation, limiter le droit du souverain. Avons-nous besoin de remarquer encore que ces deux théories ou plutôt cette théorie place la souveraineté individuelle, c'cst-ù-dirc la propriété et la liberté de l'individu, entièrement à la merci de l'homme ou du parti qui exerce la souveraineté politique? C'est en vertu de cette théorie que les despotes asiatiques confisquent les biens et font tomber les tètes de leurs sujets; c'est en vertu de la mémo théorie que le « peuple souverain i/ a confisqué, en France, les biens de la noblesse et du clergé, — non sans couper le cou aux nobles et aux prêtres récalcitrants, — et qu'il confisquera, quelque jour, ceux de la bourgeoisie propriétaire et capitaliste; c'est, pour tout dire, la théorie du despotisme.
VI.14. "La liberté de gouvernement" (1887)↩
Source
Gustave de Molinari, Les Lois naturelles de l'économie politique (Paris: Guillaumin, 1887).
PDF.
This book originally appeared as series of articles in JDE Dec. 1884-July 1885 (300 pp. with appendices):
- "Les lois naturelles de l’économie politique," Journal des économistes, S. 4, T. 28, N° 12, décembre 1884 ;
- 2e article, S. 4, T. 29, N° 3, mars 1885 ;
- 3e article, S. 4, T. 30, N° 6, juin 1885 ;
- 4e article, S. 4, T. 31, N° 7, juillet 1885.
The extracts come from Book 4 "La servitude politique":
- chap. VII "Insignifiance des formes de gouvernement. Accroissement progressif du poids du gouvernement dans les états modernes," pp. 182-90
- chap. VIII "Comment les classes gouvernantes maintiennent leur prépondérance. Les impôts indirects. Le patriotisme et l’enseignement officiel", pp. 191-202
- chap. XIII "L'abolition de la servitude politique est-elle possible? en quoi consistait la servitude économique. La concurrence et la constitution naturelle de l’industrie" pp. 238-244;
- chap. XIV "La constitution naturelle des gouvernements. La commune. La province. L’état." pp. 245-259;
- chap. XV "La liberté de gouvernement" pp. 260-268.
- chap. XVI "La Tutelle imposée et la tutelle libre, pp.269-71
- chap. XVII "Comment la Servitude Politique pourra être abolie," pp. 272-77
Introduction
This large book, the third he had written in the previous 10 years, can be seen as a continuation of arguments about the natural laws of economics (which he had explored in Les Soirées de la rue Saint-Lazare: entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (1849)) and the impact of complete and unlimited competition in the realms of both economics and politics (which he explored in L’évolution économique du XIXe siècle (1880) and L’évolution politique et la Révolution (1884)).He may have written it to console himself and his colleagues that, in spite of the setbacks the liberal movement was experiencing in France with the return of protectionism and the rise of socialism, the natural economic laws which governed the world would lead eventually to both "la liberté de l’industrie" as well as the more difficult goal of "la liberté de gouvernement". He concludes the book with the statement that:
| Les amis de la liberté pourraient donc se croiser les bras et se contenter de « laisser faire » la force des choses pour assister au triomphe de leurs doctrines. | Thus the friends of liberty could fold their arms and content themselves with allowing free reign (he literally says "laisser faire") to the "force of things" to assist in bringing about the triumph of their beliefs. |
They might have to clear the path and continue to enlighten the people but the end result was not in doubt:
| Lorsque l’opinion sera convertie, l’évolution de l’ancien régime au nouveau s’accomplira d’elle-même sans secousses et sans violence, et la servitude politique fera place à la liberté | When (public) opinion has been changed, the evolution of the old regime to the new (regime) will be achieved by itself without upheaval and violence, and political servitude will make way for liberty. |
The fourth and final part of the book dealt with "La servitude politique" and how it could be "abolished".In chapter VII "Insignifiance des formes de gouvernement" (the insignificance of the form of government) he shows that no matter what form a particular government took, whether monarchical or republican, or authoritarian or democratic, the tendency in the late 19th century was for all governments to increase their power, the burden of taxation, and of debt. In chapter VIII "Comment les classes gouvernantes maintiennent leur prépondérance" (How the governing classes maintain their supremacy) he explains how this was possible through a combination of hidden indirect taxation, and the spread of patriotic views through the press and the state school system. The teaching of Greek and Latin in the state schools he thought was particularly pernicious as it inculcated classical notions of distain for labour and the honoring of martial values which filled the heads of the young men who entered the government bureaucracies.
In a series of five short chapters(XIII to XVII) he shows how the natural law of competition might still be applied to the provision of essential government services. He seems to have abandoned the idea that private insurance companies could provide police and defence services to individual consumers, and had taken up the idea of secession at all levels of local and regional government. The competition between private companies would now be replaced by competition between communes and provinces who would lose their citizens and taxpayers if they did not provide efficient public servies at a good price to their "consumers." Unhappy consumers could "émigrer dans les communes avoisinantes" (emigrate to neighboring Communes) or could secede and "former une commune indépendante" (form an independent Commune). Competition for consumers of public services would not only apply to the communes but also to the provinces in what Molinari called "ce double droit de sécession" (this double right to secession). These different levels of succession would force governments at all levels to keep down their costs (taxes) and improve their services. Another way communes and provinces could keep their costs down was to contract out these services to "des entreprises spéciales" (specialized enterprises) which would be private companies which specialized in the provision of public services like police.
However, before "la servitude politique" could be "abolished" the modern state and the vested interests which benefited from it had to be challenged. Molinari recognised that this would be an enormous task as the following passage makes clear:
| Calculez d’un autre côté la masse énorme des intérêts qui dépendent de l’État, le nombre et l’importance des fonctionnaires civils et militaires qui émargent au budget, considérez le nombre presque aussi considérable des intérêts engagés dans les monopoles, les privilèges et les protections que l’État accorde et garantit, et que l’abolition de la servitude politique laisserait sans support, et vous aurez une idée de la puissance presque inexpugnable de cette colossale place forte que l’on nomme l’État. | On the other side, add up the enormous mass of interests which are dependent upon the State, the number and importance of the civil and military funtionaries who draw their salaries from the budget; also consider the almost similar number of interests involved in monopolies, legal privileges and protection which the State grants and guarantees; and which the abolition of political servitude would leave without (state) support, and you will have an idea of the almost unshakeable power of this colossal fortification which is called the State. |
In spite of the problem which faced the EconomistsMolinari hoped that the "omnipotent state" would eventually run into a fiscal brick wall which would stop its growth for good, namely the fact that its expenses were increasing much faster than its tax base. This is why he thought that in the end "Les amis de la liberté pourraient donc se croiser les bras et se contenter de « laisser faire » la force des choses pour assister au triomphe de leurs doctrines."
Text
[182]
Chap. VII "Insignifiance des formes de gouvernement. Accroissement progressif du poids du gouvernement dans les états modernes," pp. 182–90
Nous pourrions prolonger davantage la revue des institutions politiques des États modernes et de leurs résultats, mais l'esquisse que nous venons d'en faire suffit pour démontrer que la question des formes de gouvernement, à laquelle on attache généralement une importance capitale, n'a qu'une portée fort secondaire. Au point de vue de l'intérêt des consommateurs des services publics, il importe peu que l'entreprise investie du monopole de la production de ces services soit entre les mains d'une famille qui en possède la gestion héréditaire ou qu'elle appartienne à une compagnie dont le personnel dirigeant se recrute par a voie de l'élection, autrement dit qu'elle ait la forme d'une monarchie ou d'une république. Cela leur importe aussi peu que de savoir si la mine qui leur fournit du combustible appartient à un propriétaire qui l'administre de père en fils ou à une société d'actionnaires qui élisent leur conseil [183] d'administration. Car cette différence de régime ne peut exerce qu'une influence insignifiante sur le prix et la qualité du charbon.
Supposons cependant que les consommateurs de combustible appartiennent à la mine comme les consommateurs politiques appartiennent à l'État, on verra se produire dans l'industrie minière des phénomènes analogues à ceux que nous venons de constater. Si la concurrence, agissant d'une manière ou d'une autre, ne vient pas les en empêcher, les propriétaires de charbonnages ne manqueront pas d'élever au maximum le prix du combustible. Les consommateurs mécontents finiront par se révolter contre celte exploitation abusive d'un monopole. Ou bien ils demanderont aux propriétaires des garanties contre leur tendance naturelle à augmenter le prix du charbon et peut-être le droit d'intervenir dans la direction de la mine, ou bien ils la confisqueront et se chargeront d'en organiser eux-mêmes l'exploitation. Mais s'ils sont trop nombreux et dépourvus des aptitudes et des connaissances nécessaires, ils ne pourront pratiquer eux-mêmes l'industrie charbonnière. Si cette industrie est particulièrement lucrative, on verra alors se constituer parmi eux des sociétés ou des coteries pour s'en disputer la direction et les bénéfices. Chacune recrutera des partisans parmi les consommateurs en leur offrant des avantages particuliers, et si leurs forces se balancent, elles se succéderont tour à tour dans la gestion de la mine. Sous ce nouveau régime, l'exploitation des charbonnages ne tardera pas, selon toute apparence, à redevenir aussi coûteuse et routinière [184] qu'elle l'était sous l'ancien et le charbon deviendra de plus en plus cher.
Tels sont les phénomènes dont les États politiques nous offrent le spectacle, quelle que soit la forme de leur gouvernement, monarchique ou républicaine, depuis l'époque où la pression de la concurrence politique a commencé à se ralentir. Le prix dont les nations payent leurs services s'est accru d'une manière progressive, sans qu'on puisse dire que la qualité de ces services soit sensiblement meilleure.
On s'en convaincra facilement en consultant la statistique de l'accroissement- des dépenses et des dettes des États civilisés depuis la fin du siècle dernier.
Voici, d'après M. Paul Boiteau, [1] quelle a été la progression des dépenses en France sous les divers régimes qui se sont succédé depuis la révolution.
| Budgets moyens des périodes. (fr.) | Augmentation p. 100 de l'un sur l'autre | |
| Premier Empire | 985,770,1239 | |
| Restauration | 1,031,012,170 | 4,7 |
| Monarchie de 1830 | 1,287,499,905 | 24,8 |
| Seconde République | 1,587,808,016 | 23,3 |
| Second Empire | 2,150,293,852 | 35,4 |
| Troisième République (1871-1884) | 3,492,906,046 | 62,4 |
L'accroissement des dépenses n'a guère été moindre dans les autres pays :
« L'Angleterre, lisons-nous encore dans le remarquable travail de M. Paul Boiteau, a dépensé de 1688 à 1801 au total 2,088,639,531 liv. sterl., et de 1801 à 1877, 9,996,730,051; d'une période à l'autre et année par année, l'augmentation a été de 523 p. 100.
« Parmi ses colonies, l'Inde n'avait, en –1830–51, qu'une dépense de 27,000,624 liv. sterl. ; en 1SS2-S3, le compte des dépenses y a été de G9,41S,598 ou de 25S p. 100 de plus. Les dépenses du Canada étaient en 1867–68 de 13,480,093 dollars, et en 1SS1–82 de 27,067,104, juste le double, à quatorze ans de distance. Les colonies neuves vont d'un pas plus pressé encore : le Cap en 1865 avait un budget de dépenses de 870,089 liv. sterl,, et en 1878–79 de 3,994,933.
« L'Allemagne, comme empire, a augmenté déjà sa dépense déplus des deux tiers (330,970,000 marcs en 1872; 610,632,707 en 1SS2–83). En 1868, quand l'Empire n'était que la Confédération du Nord, son budget n'était que de 216,474,729 marcs. Dans le môme laps de temps, la Prusse économe a plus que doublé son budget (518,757,000 de dépenses en 1871; 1,237,725,000 pour 1885–86 avec les chemins de fer) et elle a dépensé cinq ou six fois plus qu'en 1821, moment où la cour de Potsdam paraissait satisfaite de son. sort, songeait à peine à l'hégémonie de l'Allemagne et n'eût pas osé rêver,-môme passagèrement, la direction de la politique de l'Europe.
« Si le budget commun des deux États d'Autriche et de Hongrie ne croît pas aussi vite que le budget fédéral de l'Allemagne (IH,714,641 florins de 2 fr. 50 en 1868, et 119,453,510 pour 1885), les budgets cisleithan et transleilhan n'imitent pas sa retenue. Le budget des dépenses de l'Autriche était de 324,968,163 florins en 1868, et il est de 519,893,166 au projet de 1885; le budget de la Hongrie était de 170,037,593, et il dépasse 338 millions de florins. Les trois budgets réunis font 977 millions de florins (2,442,500,600 fr.). En 1816, la dépense totale de l'Empire n'était que de 131,486,466 florins; en 1840, que de 164,647,036, et encore en 1860 que de 344,554,316. Elle a presque triplé en vingt-cinq ans.
[186]
« Prenons un État qui n'a pas eu maille à partir avec la guerre, la Belgique, et ne nous étonnons pas de la rapidité de l'accroissement de ses premiers budgets qui sont des budgets de premier établissement. De 1830 à 1840, elle monte d'un budget de 27,981,169 fr. à un budget de 165,914,371, aucun pays n'a fait une aussi large enjambée, mais elle n'est guère qu'à 200 millions en 1870, et son budget de dépenses, qui a dépassé la somme de 3H0 millions, marche sur celle de 400. La Hollande, pays des ménagères, dépensait 67,787,000 florins de 2 fr. 10 en 1852, et 99,107,000 en 1870. Son compte de 1882 est de 129,889,000 et ses derniers budgets s'élèvent plus haut avec l'inconvénient, depuis quelques années, de n'être plus en équilibre. Les budgets des colonies hollandaises ne sont pas, d'ailleurs, inférieurs à ceux de la métropole; elles ne dépensaient que 84,347,000 florins, en 1867 sur une recette de 111,400,000; en 1876, elles ont été jusqu'à dépenser 153,177,000 florins, avec un premier déficit, et, en 1882, la dépense prévue était de 145,870,000 florins quand la recette descendait à 125,218,000.
« Au moment de sa première unification, en 1860, l'Italie s'est trouvée devant un budget de recettes de469,115,000 fr., un budget de dépenses de 571,277,000 fr. et une dette de 2,241,870,000 fr. Le compte de 1882 donne : 1° finances et charges financières, 887,298,970 fr. ; '2° services militaires 306,389,729; 3° services civils,343,437,486. Total 1,537,126,185,
« Autant qu'elle le peut, l'Espagne empêche ses budgets de s'élever, mais ils s'élèvent malgré elle, et doublés, de 1846 à 1870, ils ont encore augmenté d'un quart dans les années suivantes.
« S'il était vrai que les gouvernements d'autocratie sont les moins dépensiers, la Russie n'augmenterait que très faiblement ses budgets, mais même sans vivre sous une constitution, la Russie est un pays qui se meut, et, de plus, un pays qui, sans avoir une vieille histoire, s'est donné un rôle historique à jouer, et ses budgets s'en ressentent. Ils sont maintenant les plus gros de l'Europe après ceux dé la France. [187] Les dépenses, en 1873, étaient déjà de 539,140,337 rouilles, après avoir été de 432,669,012 en 1866; elles ont atteint la somme de 600,510,612 roubles en 1878, et celle de 732,413,150 en 1881. Lo budget de 1885 est de 584,113,934 roubles pour les dépenses ordinaires, et de 866,204,997 en tout, avec la construction des chemins de fer et, pour la première fois, en absorbant le compte de rachat du servage…, enfin, depuis 1866, les dépenses de la Russie ont juste doublé.
« Combien les États-Unis n'ont-ils pas mis de temps à sortir des limites du programme de leurs fondateurs ! Ils ne dépensaient que 12,273,377 dollars en 1800–1801, que 13,592,605 en 1810–1811, que 48,470,104 en 1840–1841, que 85,387,313 encore en 1860–1861, et c'était déjà le double en dix ans. La guerre de la sécession a tout changé; en 1861–1862, la dépense est de 565,667,564 dollars; en 1865, elle dépasse 1,906 millions de dollars, plus que tout ce que la république a levé et employé d'argent depuis son origine. En 1883–1884, les dépenses sont retombées à 244,123,000 dollars (trois fois plus que dans l'année qui a précédé la guerre, cinq fois plus qu'en 1840–1841).
« La luxuriance des dépenses a été un fait universel depuis quinze ou vingt ans. En 1880, on avait déjà calculé que le budget européen, en quatorze ans, de 1865 à 1879, s'était élevé d'une dépense de 9,965 millions à une dépense de 14,641 millions, et d'après un autre calcul, qui ne tenait compte que des grands États, que de 1867–1868 à 1877–1878, eu iix ans, la différence était de 9,361 millions à 14,146 millions. Arrondissons les chiffres et mettons 10 et 15 milliards; c'est 50 p. 100 et 5 milliards de plus.
« Les deux tiers de cette augmentation sont des dépenses militaires et des charges de dettes contractées pour la guerre, soit que les peuples y aient pris part directement, soit qu'ils aient dû craindre d'y être entraînés.
« Malgré la multiplication générale des impôts, les recettes n'ont pu suffire aux dépenses, et les dettes des seuls États Européens, contractées en presque totalité [188] depuis un siècle, s'élèvent actuellement à 110 milliards de francs. » [2]
[189]
Cette statistique suggère des observations de diverses sortes. Elle atteste : 1° que les formes de gouvernement peuvent être considérées comme n'ayant aucune influence appréciable sur l'accroissement des dépenses publiques, autrement dit sur le prix des services des gouvernements. On peut ajouter qu'elles n'influent pas davantage sur la qualité de ces services. Si le despotisme moscovite ou turc ne fournit que de faibles garanties à la propriété et à la liberté des consommateurs politiques, le républicanisme constitutionnel ou dictatorial de certains États de l'Amérique du sud en offre-t-il de plus fortes? 2° Que cependant la mobilité de la gestion des affaires publiques a pour effet d'augmenter le prix des services des gouvernements et d'en détériorer la qualité, que ce prix s'élève et cette qualité s'abaisse d'autant plus vite que les changements dans la gestion politique sont plus fréquents ; 3° qu'en dépit de tous lés efforts qui ont été faits pour enrayer le développement des dépenses et des dettes publiques, soit par des réformes, soit par des révolutions ayant pour programme invariable la diminution des charges de la nation, au moyen de l'extension du suffrage ou du changement de la forme du gouvernement, les dépenses elles dettes des États civilisés ont cru dans une progression plus rapide que le nombre et les ressources des [190] consommateurs politiques qui y pourvoient; que celle inégalité des deux progressions va s'accentuant de plus en plus, enfin que le cours naturel des choses doit la précipiter, le fardeau croissant des dépenses publiques et la multiplication des impôts qu'il nécessite ayant pour effet de ralentir le mouvement ascensionnel de la puissance productive des nations.
D'où cette conclusion finale que les nations civilisées seront contraintes, par une nécessité de jour en jour plus pressante, de transformer l'État, devenu un monopole et un instrument d'exploitation abusive entre les mains de ceux qui le possèdent, en abolissant la « servitude politique ».
Mais est-il possible d'abolir la servitude politique ? peut-on concevoir l'existence d'un État qui n'imposerait point ses services avec l'obligation d'en acquitter le prix, à la population vivant dans les limites du territoire soumis à sa domination? Voilà ce qu'il nous reste à examiner.
Achevons toutefois auparavant d'étudier l'état des choses et des esprits sous le régime en décadence de la concurrence politique.
[191]
Chap. VIII "Comment les classes gouvernantes maintiennent leur prépondérance. les impôts indirects. Le patriotisme et l'enseignement officiel", pp. 191–202
Dans toutes les branches de l'activité humaine, qu'il s'agisse des services publics ou des industries privées, il y a un antagonisme naturel entre les producteurs et les consommateurs. Les producteurs s'efforcent d'augmenter les prix de leurs produits ou de leurs services et d'en abaisser la qualité, en vue d'élever leurs profits, c'est-à-dire, en dernière analyse, d'accroître leurs jouissances et d'économiser leur peine. La concurrence seule oppose un contrepoids efficace à cette tendance. Quand elle est libre et ne rencontre point d'obstacles naturels ou artificiels elle agit avec une force d'impulsion progressive pour réduire le prix des produits et des services au taux nécessaire, soit au taux qui couvre exactement, ni plus ni moins, les frais qu'il a fallu faire pour les créer. Quand la concurrence est absente ou insuffisante, les consommateurs se trouvent à la merci des producteurs et ceux-ci peuvent les exploiter d'autant plus qu'ils leur fournissent un produit ou un [192] service plus nécessaire. Lorsque l'oppression et l'exploitation sont devenues intolérables, les consommateurs se soulèvent et ils s'efforcent de s'emparer du monopole dont ils sont victimes ou d'en limiter la puissance. Mais on ne détruit pas les monopoles en s'en emparant et l'expérience a montré l'insuffisance de tous les procédés qui ont été inventés pour les limiter, et suppléer ainsi à l'action naturelle de la concurrence.
Tel est le cas de l'industrie de première nécessité qui procure aux hommes la sécurité, depuis que le frein de la concurrence politique s'est irrémédiablement affaibli. Les consommateurs de sécurité sont livrés à la merci des producteurs, en dépit de tous les freins: artificiels qui ont été inventés et mis en oeuvre pour les préserver de l'oppression et de l'exploitation politiques. La lutte entre ces deux catégories d'intérêts — ceux des classes gouvernantes et ceux des classes gouvernées — se poursuit avec une intensité croissante et elle a engendré un état des choses et des esprits intéressant à observer.
La tendance naturelle de la classe qui lire ses moyens d'existence des fonctions gouvernantes et des industries monopolisées ou privilégiées grâce à l'appui particulier que les gouvernements leur accordent contre la concurrence indigène ou étrangère, c'est d'étendre son débouché à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur, par l'augmentation des attributions du gouvernement et le renforcement du régime protecteur, à l'extérieur par l'agrandissement du territoire de l'État, au moyen de l'annexion de provinces avoisinantes ou de la fondation de [193] colonies. Mais à mesure que les armées civiles et militaires croissent en nombre, il faut aussi que les gouvernants exigent des gouvernés une somme de ressources plus considérable. Ces ressources, c'est l'impôt qui les fournit pour la plus grande part, les revenus des propriétés de l'État étant généralement insignifiants. Si l'accroissement des dépenses des gouvernements ne dépassait pas celui des ressources de la masse gouvernée, les impôts anciennement établis pourraient suffire; mais il n'en est pas ainsi. Malgré les merveilleux progrès de la machinerie industrielle, les dépenses publiques s'accroissent partout d'un mouvement plus rapide que les revenus privés. Il faut donc prélever par l'impôt une portion plus forte de ces revenus et, par conséquent, tantôt élever le taux des impôts existants, tantôt en augmenter le nombre, tout en évitant autant que possible de provoquer le mécontentement et les résistances des contribuables. Tel est l'objet essentiel que se propose la science des finances. Cet objet a été atteint par la multiplication des impôts indirects qui se confondent avec le prix des choses et qui sont acquittés par le contribuable au moment où il paye ses articles de consommation sans qu'il se doute qu'il les acquitte. Sous l'ancien régime, à l'époque où la science des finances et l'art des financiers étaient encore dans l'enfance, les impôts étaient pour la plupart perçus directement en travail (la corvée), en nature (la dîme), ou en argent. Levés par des procédés grossiers, ils excitaient les plaintes amères et trop souvent légitimes des contribuables, qui pouvaient se rendre un compte à peu près [194] exact de ce qu'ils payaient au fisc. Les impôts indirects ne formaient alors qu'un faible appoint des ressources du gouvernement. Aujourd'hui, sous l'influence combinée des progrès de la fiscalité et de l'accroissement de la richesse qui a développé toutes les consommations, la situation a complètement changé. Les impôts directs dont le contribuable porte le montant chez le percepteur et dont il connaît le chiffre ne forment plus que la fraction la plus faible de la totalité des sommes que le mécanisme perfectionné de la fiscalité au service des gouvernements et de leurs protégés, enlève aux gouvernés. En France, ce serait un quart environ si l'on ne comptait que les impôts perçus au profit du gouvernemental. [3] Mais aux impôts indirects dont le montant va [195] dans les caisses du Trésor, il faut ajouter ceux qui sont prélevés au profit des industries monopolisées, privilégiées ou protégées, la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, les entrepreneurs d'industries protégées par le tarif des douanes. Or si l'on peut [196] calculer d'une manière approximative, la portion de leurs revenus que les impôts indirects enlèvent aux contribuables au profit du Trésor public, il est presque impossible de se rendre compte de celle que les monopoles, les privilèges et les protections accordés et garantis par l'État leur soustrayent au profit des particuliers. Mais les impôts qu'on ne voit pas et dont l'existence même est ignorée le plus souvent par ceux qui les payent n'en sont pas moins sentis ; ils renchérissent d'autant l'existence et exigent de la multitude un supplément de travail quotidien. De là, le phénomène de l'augmentation de la durée de la journée de travail, à une époque où les progrès de l'industrie agissent constamment pour diminuer la somme d'efforts nécessaire à l'acquisition des éléments du bien-être. Ce phénomène serait inexplicable si la pompe aspirante de l'impôt n'enlevait point à la multitude au delà de l'excédent de moyens de jouissance que lui procurent les progrès de la production.
Si l'on songe cependant combien la classe qui vit directement ou indirectement de l'exploitation politique est peu nombreuse relativement à la masse de la population, on pourra se demander comment elle parvient à maintenir sa domination et à imposer à la multitude des sacrifices hors de toute proportion avec la valeur réelle des services qu'elle lui rend ; comment, à une époque où le monde civilisé n'a plus rien à craindre des barbares, où il déborde de toutes parts sur le domaine de la barbarie, la classe gouvernante a réussi à imposer aux populations laborieuses et paisibles, les frais croissants d'un appareil militaire plus vaste et plus [197] coûteux que ne l'était jadis celui des nations les plus exposées aux invasions barbares.
Ce phénomène peut être ramené à deux causes principales : l'exploitation du patriotisme et l'accaparement de l'éducation par l'Etat.
L'amour de la patrie est un sentiment naturel et l'un des plus forts qui existent dans le coeur de l'homme. Il attache l'individu au sol où il est né, à la société dans laquelle il a vécu depuis son enfance et à laquelle le lie la communauté du langage, la manière d'être et de vivre. C'est une sorte de parenté agrandie et, à l'époque où la guerre était universelle et permanente, c'était une sorte de fraternité, resserrée par la communauté du danger. Ce sentiment, les politiciens modernes l'ont exploité au profit de leur domination, et en l'exploitant ils l'ont faussé, exagéré et dénaturé. Le patriotisme signifie, à leurs yeux, la haine de l'étranger, et il se fonde sur cet aphorisme suranné, qu'une nation ne peut prospérer et grandir qu'aux dépens des autres. Leur politique consiste à réveiller les haines nationales et à persuader aux nations qu'elles sont perpétuellement en danger d'être humiliées, insultées, envahies et pillées par leurs rivales, qu'il est par conséquent indispensable qu'elles entretiennent un appareil militaire de plus en plus formidable pour défendre l'honneur et l'intérêt national. Dans ces derniers temps surtout, ils ont activement travaillé à fomenter les antipathies de race et ils ont provoqué ce qu'on est convenu d'appeler le « réveil des nationalités » par un redoublement d'oppression et de vexations motivées par la nécessité « d'unifier » [198] les populations soumises à leur domination. Tandis que, dans les industries de concurrence, les producteurs sont obligés d'accommoder leurs produits et leurs services aux besoins et aux goûts de consommateurs, les gouvernements modernes, débarrassés du frein de la concurrence politique, obligent les gouvernés à accepter leurs services, tels qu'il leur plaît de les rendre. Chacun d'eux impose indistinctement à tous ses « sujets » — et on se fait gloire de ce progrès à rebours — des lois et une langue uniformes, sans se soucier de savoir si ces lois sont adaptées à leurs moeurs et s'ils comprennent la langue dans laquelle on les juge, on les administre et on prétend les instruire. Les gouvernements « unificateurs » rendent ainsi leur domination odieuse et insupportable aux populations d'origine différente de la leur. Qu'arrive-t-il alors? c'est qu'au sein de ces populations opprimées et vexées, des esprits généreux auxquels se joignent des ambitieux qui aspirent à des situations politiques que leur interdit l'esprit de monopole de la classe dominante, s'efforcent de reconstituer leur nationalité en lui donnant un gouvernement autonome. Parfois ils échouent dans leur entreprise comme en Pologne; parfois ils réussissent comme en Hongrie. Mais, chose digne de remarque, ces apôtres et ces régénérateurs de nationalités ne manquent jamais, quand ils sont arrivés à leurs fins, d'opprimer et de vexer les nationalités assujetties à la leur.
L'accaparement de l'éducation par l'État et ses subdivisions provinciales et communales prépare et facilite [199] l'exploitation du patriotisme. L'intérêt du consommateur, les avantages que l'enfant ou l'adolescent peut tirer de l'éducation dans la pratique de la vie ne sont pour les gouvernements éducateurs qu'un objet secondaire. L'intérêt de l'État ou ce que les exploitants de l'éducation publique croient être son intérêt, est leur objectif principal, sinon unique. On s'applique à donner avant tout à l'éducation un caractère national; on développe chez l'enfant un sentiment de vanité collective qui imprime dans son esprit la conviction de la supériorité incommensurable du peuple dont il fait partie; on lui montre les nations étrangères animées de sentiments de jalousie et de haine à l'égard de ce peuple d'élite et perpétuellement préoccupées de lui nuire. De leur histoire, on ne lui apprend guère que la partie qui concerne les démêlés de leur État politique avec l'État national. Leurs moeurs, leur littérature, les services , qu'elles ont rendus à la civilisation, demeurent pour lui lettres closes. Au lieu d'enseigner à l'enfant les langues vivantes qui le mettraient en communication avec les autres membres de la grande famille humaine, on voue à la stérilité ses années les plus fécondes, en le contraignant à étudier, je ne dis pas à apprendre, deux langues mortes qui ne peuvent lui être d'aucune utilité et dont l'étude lui inspire même une répugnance instinctive, car il pressent qu'elles ne lui serviront à rien. On le plonge ainsi dans des sociétés mortes comme leurs langues, on en fait un citoyen d'Athènes ou de Rome sans l'avoir averti que l'état du monde a changé, que les nécessités auxquelles obéissaient les sociétés mortes [200] n'ont plus rien de commun avec celles qui s'imposent aux sociétés vivantes; que notre grande affaire n'est plus de nous défendre contre des barbares qui ont cessé de nous assaillir, de les détruire ou de les asservir pour n'être pas détruits ou asservis par eux ; que l'étranger n'est plus un ennemi naturel, mais un client avec lequel nous sommes intéressés à entretenir des relations d'affaires et d'amitié, et dont la fortune bonne ou mauvaise est liée à la nôtre. La génération qui a reçu cette éducation rétrograde, superficielle et fausse, se distribue dans toutes les carrières que l'extinction successive de la génération précédente laisse vacantes. Celles-ci se partagent en deux branches : les fonctions publiques, politiques, militaires ou administratives, et les emplois privés de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des arts. Les jeunes gens qui entrent dans les fonctions publiques avec les idées et les sentiments qu'ils ont puisés et nourris dans l'éducation dite classique, sont parfaitement préparés à continuer les traditions d'un passé suranné. Ils considèrent les consommateurs des services publics comme un troupeau dont ils sont les pasteurs et dont la destination naturelle est de pourvoir à leur subsistance. Parmi les carrières privées, un certain nombre sont liées à l'Etat par les subventions, les monopoles et les protections qu'il leur accorde, et l'esprit qui y règne se rattache, sous l'influence delà communauté des intérêts, à celui qui domine dans la classe investie des fonctions publiques. Dans les carrières libres qu'il ne faut pas confondre avec les carrières dites libérales, les intérêts qui gouvernent les opinions [201] diffèrent, sans doute, de ceux des carrières publiques ou privilégiées, et on devrait croire que l'esprit qui y prévaut est mieux en harmonie avec les conditions actuelles d'existence des sociétés civilisées; que l'obligation onéreuse de pourvoir aux frais alourdis du gouvernement y a créé une opinion hostile à l'augmentation des charges publiques, à l'accroissement des dépenses de l'État, à l'extension du régime des monopoles, des privilèges et des protections qui s'exercent aux dépens des industries et des professions libres ; hostile aussi à la politique d'antagonisme international qui maintient les États civilisés sur un pied de guerre ou de paix armée de plus en plus dispendieux. Cependant il n'en est rien, et il est facile de s'expliquer pourquoi.
Il faut remarquer d'abord que les fonctions publiques et les carrières privilégiées attirent de préférence l'élite intellectuelle de chaque génération et que la masse vouée aux fonctions réputées inférieures ne reçoit qu'une instruction incomplète et subalterne; ensuite que les loisirs sont rares dans les carrières libres qui alimentent le budget, tandis qu'ils abondent dans les fonctions et les industries qui y émargent; enfin, que les hommes qui arrivent à la fortune dans une carrière libre mais considérée comme subalterne, éprouvent généralement le besoin de se hausser dans leur estime et dans celle de leurs proches, en jouant un rôle officiel ou en obtenant une distinction honorifique et en se rattachant ainsi à la classe gouvernante. Voilà comment on s'explique que cette classe, malgré son infériorité numérique, impose son opinion aux autres, et voilà [202] pourquoi on n'a vu jusqu'à présent nulle part se créer parmi les consommateurs politiques un noyau résistant de défense contre la tendance naturelle des producteurs à abuser de leur monopole. Une autre cause est venue s'ajouter à celle-là pour maintenir l'ascendant de la classe gouvernante, c'est la crainte du socialisme. La multitude des gens paisibles dont les intérêts sont menacés par la future « révolution sociale » se rassemblent comme un troupeau effaré sous l'abri tutélaire de l'État, sans s'aviser davantage de rechercher ni ce que vaut cet abri ni ce qu'il coûte.
[238]
Chap. XIII "L'abolition de la servitude politique est-elle possible? en quoi consistait la servitude économique. La concurrence et la constitution naturelle de l'industrie" pp. 238–244.
Avant d'aborder la question que nous venons de poser, savoir si la sécurité des personnes et des propriétés peut être assurée sans que les « consommateurs de sécurité» soient assujettis à la servitude politique, et obligés, en conséquence, d'accepter les services d'un gouvernement aux prix et conditions qu'il impose à la population établie sur le territoire soumis à sa domination, en d'autres termes, si l'industrie qui produit la sécurité peut être soumise à la loi de la concurrence industrielle, comme l'est déjà la généralité des autres branches de l'activité humaine, il importe de savoir quels ont été les effets de son application et comment elle opère dans les industries qu'elle régit.
Dans la période qui a précédé l'avènement de la liberté de l'industrie, la plupart des branches de la production étaient placées sous le même régime que les gouvernements. Elles étaient constituées en [239] corporations et ces corporations avaient, comme les gouvernements, leurs limites territoriales. Dans l'intérieur de ces limites, les consommateurs étaient obligés de s'approvisionner exclusivement auprès de la corporation propriétaire du marché, de subir ses prix et conditions, sauf les restrictions plus ou moins efficaces qui avaient pour objet de limiter la puissance de son monopole ; en un mot, ils étaient assujettis à la servitude économique. Ajoutons que cette servitude était universellement considérée comme naturelle et nécessaire, et qu'à l'époque où elle a été abolie, où le consommateur a été rendu libre de demander les produits ou les services dont il avait besoin aux associations ou aux individus auxquels il lui plaisait d'accorder sa clientèle, où il a été permis à ces associations et à ces individus de s'établir dans les localités qui constituaient auparavant le domaine des corporations, les conservateurs du temps prétendaient que ce régime de concurrence libre aboutirait à la plus épouvantable anarchie, que l'industrie serait ruinée et bientôt anéantie, que les consommateurs cesseraient d'être approvisionnés et que la société retournerait à la barbarie. [4] On sait ce qu'il est advenu de ces [240] prévisions sinistres. Depuis l'avènement de la concurrence industrielle et grâce à sa pression bienfaisante, toutes [241] les industries libres ont réalisé des progrès incessants, leur production s'est accrue dans des proportions extraordinaires, les consommateurs ont eu à leur disposition à des prix de plus en plus réduits une abondance et une variété de produits et de services, telles qu'ils n'auraient pas osé les rôver sous le régime de la servitude économique. Seules, les industries encore soumises à ce régime sont demeurées en retard et d'autant plus qu'elle continuent à imposer à leurs consommateurs une servitude à laquelle il leur est plus difficile d'échapper.
Remarquons enfin que l'action de la concurrence serait encore bien autrement efficace et bienfaisante si elle n'était pas entravée par les obstacles de la protection, du monopole et de la fiscalité. Mais c'est un [242] point que nous avons déjà touché et sur lequel il nous paraît inutile d'insister. Ce qu'il nous importe de considérer à présent, c'est le mode d'action de la concurrence, abstraction faite des obstacles qui le troublent. Ce mode d'action est lié à la constitution naturelle de l'industrie, et il n'est pas le môme dans toutes les branches de la production.
Observez la plupart des industries, et vous constaterez que les produits n'arrivent point directement du producteur au consommateur. La constitution de chacune, constitution qui s'est faite d'elle-même, comporte d'abord une série d'entreprises de production ou de fabrication; c'est l'industrie proprement dite; ensuite une autre série d'entreprises commerciales, magasins de gros, de demi-gros et de détail, qui servent d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Cette constitution de l'industrie peut se modifier et se modifie : parfois le nombre des intermédiaires augmente et parfois il diminue, mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'elle s'impose. Qui voudrait se soustraire à cet ordre naturel des choses, fondé sur la loi de l'économie des forces,, ne manquerait pas d'en être puni. Un manufacturier qui voudrait vendre directement ses produits au consommateur en vue de réaliser lui-môme les profits des intermédiaires ne tarderait pas à se ruiner, car il ne pourrait établir et faire fonctionner le rouage nécessaire du commerce à aussi bon marché et avec autant d'efficacité que les commerçants dont c'est la spécialité.
Les établissements appartenant à chacune de ces [243] catégories, industrie, commerce de gros, de demi-gros et de détail se font concurrence entre eux, et leur compétition profite en dernière analyse au consommateur.. Lorsque la concurrence est insuffisante ou excessive dans l'une ou dans l'autre, elle engendre des perturbations temporaires qui rompent l'équilibre des prix, tantôt au profit, tantôt au détriment des autres catégories et des consommateurs, mais qui sont d'autant moins durables qu'elles sont plus fortes.
Voilà un premier point à observer dans le mode d'action de la concurrence et qui tient à la constitution générale de l'industrie. Il y en a un second qui tient à la nature particulière de chacune des branches de la production. Comparons par exemple l'industrie de la confection des vêtements et celle des transports. Dans la première, l'action de la concurrence est immédiate et prochaine; aucun obstacle naturel n'empêchant, d'habitude, les magasins de confection de s'établir en nombre illimité dans le voisinage les uns des autres. Il arrive fréquemment, au contraire, que la nature et la configuration du terrain, sans parler des autres obstacles, empêchent la multiplication illimitée des chemins de fer dans une certaine.région, mais est-ce à dire qu'ils y soient soustraits complètement à l'action de la concurrence? Les lignes et les réseaux de chemins de fer se font concurrence à des centaines et même à des milliers de kilomètres de distance, et les entreprises qui prétendent se soustraire à cette loi naturelle, en persistant à conserver les prix et les habitudes du monopole, sont obligées à la longue, sous peine de ruine, de se [244] courber sous son inflexible niveau. La concurrence agit dans l'espace et dans le temps et son action, pour être médiate et lointaine, n'en est pas moins sûre.
Tels sont les deux points qu'il faut considérer dans le mode d'action de la concurrence. Il faut avoir en vue la constitution qui est commune à l'ensemble des branches de la production, la nature et les circonstances particulières de chacune si l'on veut savoir comment la concurrence peut y intervenir, et de quelle manière immédiate ou médiate, prochaine ou lointaine, elle peut y faire sentir son action propulsive et régulatrice.
[245]
Chap. XIV "La constitution naturelle des gouvernements. La commune. La province. L'état." pp. 245–259.
Recherchons donc quelle est la constitution naturelle et quelles sont les circonstances particulières de l'industrie qui produit la sécurité et quel pourrait être dans cette industrie, en admettant qu'elle vînt à passer du régime de la servitude politique à celui de la liberté, le mode d'application et d'opération de la concurrence.
Si nous étudions la structure des États politiques, nous reconnaîtrons qu'elle comporte partout une division de services analogue à celle qui existe dans toutes les industries arrivées à un certain degré de développement. L'État ne rend directement qu'un petit nombre de services aux consommateurs; entre lui et l'individu, il y a deux intermédiaires, la province, sous des dénominations qui diffèrent de pays à pays, et la commune. Et si l'on remonte à la formation originaire des États, des provinces et des communes, on s'aperçoit qu'elle n'a rien eu d'artificiel et d'arbitraire, qu'elle a été déterminée par des nécessités inhérentes à la nature des services qu'ils étaient appelés à rendre, ou, si l'on [246] veut, de l'industrie qu'ils étaient appelés à exercer.
C'est la commune qui s'est constituée la première sous forme de troupeau, de tribu, de clan, et finalement, lorsque l'agriculture et l'industrie eurent fixé les populations au sol, sous sa forme actuelle ; l'association volontaire ou forcée des communes a constitué la province ; celle des provinces a constitué l'État. Les guerres étrangères et les révolutions intérieures ont pu modifier cette -formation primitive, mais sans en altérer la nécessité et le caractère. Voyons donc en quoi consiste la commune, et ce qui a déterminé sa constitution. Une commune est une association naturelle, déterminée par certains besoins individuels mais qui ne peuvent être satisfaits individuellement. Si nous étudions, à cet égard, les communes que nous avons sous les yeux, rurales et urbaines, nous remarquerons qu'elles pourvoient à une série de services nécessaires aux individus, mais qu'ils ne peuvent recevoir isolément, sans que d'autres y participent, tels sont les services de la voirie, du pavage^ de l'éclairage, de l'entretien des rues et de la police. Ces services se distinguent par un caractère de collectivité naturelle, en ce qu'ils ne profitent pas seulement à l'individu, mais à l'ensemble du groupe local dont il fait partie. Supposons qu'un ou. plusieurs habitants d'une localité dépourvue de police en établissent une à leurs frais, tous les habitants de; la localité profiteront de l'accroissement de sécurité qui; en résultera. Il en sera de même s'ils pavent la rue devant leur habitation, s'ils y élèvent un réverbère, etc. Qr plutôt que de se charger seuls d'une dépense qui [247] profitera à la communauté entière, ils s'abstiendront de la faire. Il s'ensuivra que les habitants de la localité ne posséderont ni pavage, ni éclairage, ni police, à moins qu'ils ne consentent tous à en faire les frais.; De là, la nécessité de constituer une association communale pour satisfaire à des besoins qui ont un caractère commun. Mais cette association communale implique une organisation, une direction et un contrôle, autrement dit, un gouvernement. Ce gouvernement a sa constitution et ses attributions naturelles.
Les attributions du gouvernement de la commune sont naturellement limitées aux services ayant le caractère de là collectivité. L'obligation de participer à ces services collectifs, dans la mesure des avantages qu'ils en retirent, constitue pour les individus une servitude naturelle, c'est-à-dire une diminution de la liberté individuelle. Or, si nous nous reportons à la loi de l'économie des forces, nous remarquerons que toute diminution de la liberté de l'individu détermine une diminution correspondante de sa puissance productive; qu'il est essentiel par conséquent que les servitudes, qu'on lui impose soient réduites au strict nécessaire dans son intérêt et dans l'intérêt général de la société, dont les intérêts individuels forment la collection. En revanche, cette servitude implique l'obligation pour les membres de la commune de participer aux frais des services ayant un caractère collectif, dans la proportion de l'usage qu'ils en font et des avantages qu'ils en tirent. Car ceux qui refuseraient de s'acquitter de cette obligation rejetteraient sur les autres membres de [248] commune leur part naturelle dans les frais des services dont ils jouissent.
Mais si les services de la voirie et de la police ont un caractère collectif, il en est autrement de ceux qui pourvoient à la nourriture, au vêtement, au logement et à la généralité des autres besoins des membres de la commune, en y comprenant l'élève et l'éducation de leurs enfants. Une boulangerie, une boucherie, un magasin d'épiceries, ne sont utiles qu'à ceux qui vont s'y pourvoir; une école n'est utile qu'à ceux qui ont des enfants à instruire. Pourquoi obligerait-on les individus qui produisent eux-mêmes leurs articles d'alimentation ou qui les demandent à des entreprises particulières à participer aux frais d'une boulangerie ou d'une boucherie communale? Pourquoi contraindrait-on ceux qui n'ont point d'enfants, ou bien encore les pères de famille qui élèvent eux-mêmes les leurs ou qui les font instruire dans une école privée, à contribuer à l'établissement et à l'entretien d'une école communale? Ils ne profitaient point nécessairement de l'existence de ces services communaux, comme ils profitent nécessairement, en vertu de la nature des choses, des services de la voirie et de la police.
Cependant, parce qu'il y a des services ayant un caractère naturel de collectivité ou de communauté, il ne s'ensuit pas que la commune soit obligée de les établir et de les gérer elle-même; elle peut trouver et elle trouve, dans les pays où l'industrie est suffisamment avancée et spécialisée, des entreprises qui se chargent de construire et d'entretenir les égouts, de paver, de [249] balayer et d'éclairer les rues; elle pourrait en trouver de même, sous un régime de liberté politique, qui se chargeraient de faire la police. En admettant que ces entreprises spéciales pussent se multiplier de manière à se faire une pleine concurrence, le gouvernement de la commune trouverait avantage à leur confier les services dont la réunion constitue ses attributions naturelles. Ces services, il les rétribuerait en gros, et s'en rembourserait en détail, au moyen d'une cotisation spéciale pour chaque service, prélevée sur tous les habitants de la commune, et c'est ainsi en effet que les choses se passent dans les communes bien constituées et gouvernées.
En supposant, — et cette hypothèse deviendra une realité à mesure que l'industrie progressera et se développera sur un plan plus vaste, — en supposant, disons-nous, que des sociétés particulières se constituent pour fonder et exploiter des villes ou de grands domaines agricoles, pourvus des habitations nécessaires au personnel, la rétribution des services ayant un caractère collectif cessera d'être perçue sous la forme d'une cotisation spéciale; elle s'ajoutera simplement au prix du loyer, librement débattu entre la société propriétaire et le locataire. Le poids de la servitude naturelle qu'impliquent les services collectifs se trouvera alors réduit à son minimum, grâce à la double concurrence des entreprises ayant pour spécialité la production de ces services et de celles qui fonderont et exploiteront les villes et les domaines agricoles.
Mais nous n'en sommes pas là, et, dans l'état présent [250] des choses, les gouvernements des communes, comme ceux des États, ont une tendance de plus en plus, marquée à augmenter leurs attributions, par conséquent à alourdir les charges qui pèsent sur leurs sujets, et, en même temps, à s'écarter de plus en plus de la justice dans l'administration de ces charges. Cette tendance vicieuse provient d'une part de l'ignorance ou de la méconnaissance des lois naturelles qui président à la constitution des associations communales ou autres ; d'une autre part, de l'impossibilité où se trouvent les victimes des abus du gouvernement communal, de s'y soustraire autrement qu'en quittant la commune. La constitution naturelle de toute association implique, pour tous ses:. membres, le droit de participer à sa gestion ou bien encore à la nomination des mandataires chargés de la gérer à leur place, de contrôler leurs actes, et de vérifier leurs comptes. Ce droit n'est pas égalitaire, il est proportionnel au montant de leur apport dans l'association ou de la contribution qu'ils lui fournissent. Mais il est presque sans exemple que cette règle ait été, observée dans la constitution et la gestion des associations communales, et elle l'est aujourd'hui de moins en moins. Ou bien la portion la plus riche et la plus influente des habitants de la commune s'est emparée du gouvernement de cette association, à l'exclusion.du grand nombre, et dans ce cas, elle ne manque pas de. faire peser principalement la dépense sur. la catégorie exclue; elle établit par exemple aux frontières de la commune un octroi qui prélève la plus grande partie du revenu communal. sur la subsistance du grand [251] nombre. Les droits d'octroi s'ajoutant au prix des choses, ceux qui les payent ignorent ce qu'ils payent, en sorte qu'il est facile de leur extorquer au delà de leur part légitime dans la dépense. Dans cet état des choses la minorité gouvernante, qui reçoit toute sa part des services communaux, souvent même au delà de sa part sans fournir toute sa part de la dépense, est intéressée à les multiplier, c'est-à-dire à étendre les attributions de la commune au delà de leurs limites naturelles. Ou bien tous les habitants de la commune possèdent un droit égal de participer à son gouvernement, quelle que soit l'inégalité de leur contribution à la dépense. En ce cas, le grand nombre des contribuables pauvres a une tendance naturelle à faire porter le fardeau delà dépense sur le petit nombre des contribuables riches que se trouvent à sa merci. L'impôt progressif est substitué à l'octroi, et le gouvernement communal livré à la classe inférieure des contribuables n'est pas moins que dans le cas précédent, intéressé à augmenter ses attributions. Seulement; c'est au profit du grand nombre et aux dépens du petit, qu'il les augmente.
Dans la plupart des pays du continent, on a essayé de remédier à ces vices des gouvernements communaux en plaçant les communes sous la tutelle du gouvernement de l'État. Mais l'expérience a démontré que ce remède est généralement inefficace, et, le plus souvent même, nuisible. Le gouvernement de l'État n'intervient guère pour empêcher les administrations communales d'augmenter abusivement leurs attributions ou d'asseoir arbitrairement leurs taxes ; il n'intervient que [252] lorsqu'elles lui paraissent empiéter sur son domaine, particulièrement en matière fiscale; parfois aussi il leur impose l'obligation de pourvoir à des services qui sortent de leurs attributions naturelles, telle est par exemple l'obligation de construire et d'entretenir des écoles.
En présence de l'impuissance avérée de l'État à les protéger, que peuvent faire les victimes des abus du gouvernement communal? Ils peuvent quitter la commune. Mais tout en subissant les dommages et les inconvénients d'un changement de résidence, ils courent le risque de retrouver les mêmes abus, parfois même des abus plus graves dans une autre commune.
Telle est cependant, l'unique et insuffisante garantie qui existe sous le régime actuel de la servitude politique contre les vices et les abus du gouvernement communal.
Chaque commune se trouve naturellement liée aux autres et particulièrement à celles qui occupent la même région par des intérêts et des rapports résultant de la contiguïté du territoire. Ces intérêts communs et ces rapports nécessaires déterminent la constitution d'une seconde association ayant pour fonction de gérer les uns et de régler les autres. C'est la province. Enfin, de même que les communes, les provinces d'une région dont les habitants se trouvent rattachés par des affinités particulières, peut-être aussi séparés des populations des autres régions par des mers, des fleuves ou des montagnes, ont des intérêts communs et des rapports nécessaires, lesquels déterminent la constitution [253] d'une troisième association supérieure aux deux autres. C'est l'État. Outre le règlement des rapports inter-provinciaux et inter-communaux ou de ceux de ces rapports qui ne peuvent être réglés directement de commune à commune et de province à province, l'État est chargé de pourvoir à la sécurité extérieure et d'entretenir des rapports avec les autres États. Ajoutons que les mêmes tendances vicieuses que nous avons signalées plus haut dans le gouvernement de la commune s'observent sous l'influence des mêmes causes dans les gouvernements de la province et de l'État.
Si nous examinons la contexture des États modernes, nous la trouverons dans tous, à quelques variantes près, telle que nous venons de l'esquisser. Tous sont superposés à des provinces ou à des agrégats analogues à la province, et les provinces à leur tour sont superposées aux communes, parfois avec un intermédiaire de plus, le district ou le canton. La constitution et la superposition de ces trois agrégats ne s'est point opérée partout de la même manière, et leurs limites, particulièrement celles des provinces et des États, ont subi des changements fréquents. Généralement, la constitution originaire des communes, des provinces et des États a été « naturelle », en ce qu'elle a été déterminée par les besoins collectifs auxquels ces trois associations superposées pouvaient seules pourvoir, notamment par le besoin de sécurité. Les limites des communes ont peu varié, dans le cours, des siècles; en revanche, la conquête a fréquemment changé les limites des provinces et surtout celles des États. Les conquérants d'une [254] province se sont bornés d'habitude à lui imposer une nouvelle administration sans modifier sa circonscription territoriale, mais il est arrivé aussi que la conquête a morcelé une province en attribuant ses parties à des états différents. A peu près seuls, les révolutionnaires français ont prétendu faire mieux que là nature en défaisant son oeuvre pour la remplacer par la leur : à la division naturelle des provinces, ils ont substitué la division artificielle et arbitraire des départements. Cette innovation révolutionnaire n'a eu d'autres résultats que de diminuer la vitalité des provinces en congestionnant la capitale et d'augmenter le nombre des fonctionnaires en remplaçant un gouverneur par trois préfets. Quant aux limites des États, on sait que la guerre et la conquête les ont constamment modifiées.
Mais s'il y a des différences dans la manière dont les communes, les provinces et les États se sont constitués, si leur constitution a changé, si leurs limites ont varié, ils ont conservé un trait commun et immuable, c'est la servitude politique.
De même que les consommateurs des produits de l'industrie étaient obligés, sous l'ancien régime, de demander ces produits exclusivement à la corporation propriétaire du marché, dans toute l'étendue de in circonscription de ce marché, les consommateurs de services politiques et administratifs continuent à être obligés de les demander au gouvernement de la commune, de la province ou de l'État auxquels ils appartiennent. Les constitutions politiques ont pu changer, l'organisation et les rapports des communes, des [255] provinces et de l'État ont pu recevoir des modifications de toute sorte, leur droit exclusif de pourvoir les consommateurs de leurs services dans les limites de leurs circonscriptions territoriales est demeuré immuable. De plus, et c'est là un droit que ne possédaient point les corporations industrielles de l'ancien régime, dont les attributions étaient strictement limitées, et qui s'exposaient à des procès quand elles empiétaient sur le domaine des autres corporations, les gouvernements ont le droit d'étendre et de multiplier leurs attributions; ils ont le droit de s'emparer d'une industrie étrangère à la leur pour l'exercer eux-mêmes en totalité ou en partie, de légiférer et réglementer sur toutes sortes de matières, d'établir de même des taxes, de créer des monopoles et des privilèges et nul ne peut, sans s'exposer à des pénalités variées, se soustraire à l'observation de leurs lois et règlements, au payement de leurs taxes, au tribut de leurs monopoles et privilèges, dans toute l'étendue de leur circonscription territoriale. Ce droit est illimité pour le gouvernement de l'État; il est limité plus ou moins pour le gouvernement de là commune et de la province, mais seulement en ce sens que ces deux gouvernements subordonnés ne peuvent jamais empiéter sur le domaine de l'État, à moins que celui-ci n'y consente, tandis que le gouvernement de l'État peut toujours, en observant certaines formes, augmenter ses attributions aux dépens des provinces et des communes ; enfin, le gouvernement de l'État exerçant d'habitude une certaine tutelle sur les deux autres, ils ne peuvent généralement augmenter leurs [256] attributions et modifier leurs taxes sans son consentement.
Dans toute l'étendue de sa circonscription territoriale, les droits du gouvernement de l'État sont donc illimités, et ceux des gouvernements de la commune et de la province ne sont limités dans les leurs que par la tutelle de l'État. D'un autre côté, ces droits sont réputés perpétuels comme les gouvernements eux-mêmes, et les limites des circonscriptions dans lesquelles ils s'exercent sont fixées à perpétuité. Toutefois le gouvernement de l'État, en sa qualité de tuteur des autres, a le droit de changer leurs circonscriptions territoriales ; il a aussi le droit de les céder, à l'amiable ou autrement, à un autre État, tandis que le droit de séparation est refusé aux provinces et aux communes. Sous l'ancien régime ce droit de cession était illimité ; la « maison » ou la corporation en possession de l'État avait le droit de le morceler, de donner une province en dot à une fille, de l'échanger ou de la vendre. La Révolution française a supprimé ce droit en déclarant la République « une et indivisible », ce qui signifie que le gouvernement de l'État n'a pas le droit de rétrécir son territoire ; en revanche, il lui est toujours permis de l'agrandir.
En dépit de cette perpétuité du droit du gouvernement de l'État sur l'ensemble des territoires soumis à sa domination et qui constituent sa propriété politique, on a vu des provinces se soustraire au joug de l'État auquel elles appartenaient, les provinces hollandaises se sont séparées de la monarchie espagnole, et plus récemment les provinces belges du royaume des Pays-Bas; enfin on a vu et on voit, tous les jours, des [257] États céder de gré (ordinairement par voie d'échange ou de vente) ou de force une partie de leur territoire à d'autres. Mais il faut bien remarquer que jamais un État n'a reconnu à une province ou même à un État placé sous sa dépendance le droit de se séparer de lui, et que le gouvernement de l'union américaine a fait une des guerres les plus meurtrières et les plus coûteuses du siècle plutôt que de consentir à la sécession des États du Sud. Il faut remarquer aussi que dans le cas où un État cède de gré ou de force une partie de son territoire, la population qui meuble ce territoire n'est pas plus consultée sur cette cession que l'esclave africain, lorsqu'on juge à propos de le vendre. A la vérité, on peut citer quelques exceptions à cette règle : lorsque le comté de Nice et la Savoie ont été cédés à la France, en échange du concours que le gouvernement impérial avait prêté à la formation de l'Italie « une », les populations ont été consultées, mais on connaissait d'avance le résultat de celte consultation bénévole. C'était une simple politesse qui ne tirait pas à conséquence. Est-il nécessaire d'ajouter que le gouvernement allemand ne s'est pas avisé de consulter les populations de l'Alsace-Lorraine pour savoir s'il leur convenait de se séparer de la France?
Tel est le droit public en vigueur dans tous les Etats civilisés. Partout ce droit public d'un autre âge confère aux gouvernements des états — et sous la réserve de la tutelle de l'État—des provinces et des communes, le droit illimité de légiférer, réglementer et taxer les populations qui meublent leurs territoires, sans qu'il soit [258] permis à celles-ci de se soustraire à leur domination; partout aussi ce droit est perpétuel, perpétuelles enfin sont les frontières dans lesquelles il s'exerce, et où sont enfermées, sans avoir le droit de les changer,.les populations assujetties à la servitude politique.
Nous avons vu quelle avait été, à l'origine, la raison d'être et la nécessité de celte servitude et comment la perpétuité de la possession de l'État et la concurrence politique, manifestée par la guerre, contribuèrent à en réfréner l'abus, comment à mesure que ces deux freins naturels ont disparu ou se sont affaiblis, on a entrepris de les remplacer par des freins artificiels, en changeant la constitution des gouvernements et en réglementant leur pouvoir de légiférer et taxer ; comment ces freins artificiels sont demeurés impuissants à contenir dans dès limites utiles la puissance d'oppression et d'exploitation des classes en possession de l'État ; comment enfin l'abus de cette puissance doit inévitablement conduire les nations à la ruine. Si l'on veut avoir une idée des excès auxquels elle peut se porter sans que les « consommateurs politiques » puissent s'en préserver autrement qu'en recourant à l'emploi hasardeux de la force, il nous suffira de remarquer qu'aucun obstacle constitutionnel ou légal ne pourrait empêcher une aristocratie en possession du mécanisme de l'État de replacer la multitude sous le joug de l'esclavage ou du servage, ou bien encore, chose plus probable, une démocratie souveraine de confisquer les biens de la minorité capitaliste, de supprimer le grand livre de la dette publique et de transférer aux ouvriers la propriété [259] du sol, du sous-sol et de l'outillage de la production, en réduisant à la misère les propriétaires actuels et, en cas de résistance, en les supprimant eux-mêmes. Ces mesures d'exploitation et d'oppression pourraient être prises légalement, en vertu des droits souverains et illimités que possède tout gouvernement dans toute l'étendue de son domaine politique, et les populations de ce domaine ne pourraient invoquer aucun droit pour s'y dérober. C'est encore grâce aux droits que lui confère ce régime que le gouvernement russe par exemple peut entreprendre d'interdire aux Polonais l'usage de leur langue maternelle et que le gouvernement de l'union américaine peut obliger les Étals agricoles du Sud à payer le tribut onéreux de la protection aux manufacturiers du Nord ; c'est en un mot la servitude politique qui place aujourd'hui plus que jamais les consommateurs des services publics à la discrétion des producteurs, naturellement intéressés à les exploiter, et qu'aucun frein efficace n'empêche plus d'abuser du pouvoir illimité qu'elle confère. La seule voie qui leur soit ouverte pour se dérober à l'oppression et à l'exploitation, c'est d'émigrer; encore ne font-ils, en émigrant, que changer de servitude.
[260]
Chap. XV "La liberté de gouvernement" pp. 260–268.
Peut-on concevoir cependant un état de choses différent de celui que nous venons de décrire? Peut-on admettre qu'un gouvernement soit capable de rendre les services en vue desquels il est institué s'il ne possède point le droit exclusif de les imposer dans toute l'étendue du territoire soumis à sa domination ? Nous avons remarqué que ce régime était autrefois commun à la généralité des industries et qu'on ne concevait pas alors la possibilité d'un autre régime. Il est assez naturel qu'on ne conçoive pas aujourd'hui que les hommes puissent être pourvus de sécurité s'ils renoncent à s'assujettir à la servitude politique, de-même qu'on ne concevait pas qu'ils pussent être nourris, vêtus et logés s'ils commettaient l'imprudence de s'affranchir de la servitude économique.
Essayons donc de rechercher ce qui arriverait si la servitude politique venait à être abolie, si la «liberté de gouvernement » venait à être établie comme un complément logique et nécessaire de la liberté de l'industrie. [261] Que seraient les gouvernements et comment fonctionneraient-ils sous ce nouveau régime?
Les prévisions que l'on peut formuler sur l'avenir de la liberté de gouvernement ont, à certains égards, un caractère hypothétique. A l'époque où la servitude économique a été abolie, on pouvait bien affirmer avec certitude que les articles de nécessité ou de luxe dont la production était rendue libre continueraient à être produits, et qu'ils seraient même livrés au consommateur en plus grande abondance et à meilleur marché, mais quelle serait l'influence de la liberté de l'industrie sur la constitution des établissements industriels et quel serait le mode d'action de la concurrence devenue libre, voilà ce que l'expérience seule pourrait révéler. De même, nous pouvons affirmer qu'après l'abolition de la servitude politique, les services dont les gouvernements ont aujourd'hui le monopole continueront à être rendus aux individus et aux sociétés et qu'ils le seront en plus grande abondance et à meilleur marché, ce qui, à tout prendre, est l'essentiel, mais nous ne pouvons pas plus prédire ce que sera l'organisation politique de l'avenir que nos devanciers ne pouvaient prévoir, à l'époque de l'établissement de la liberté industrielle, l'avenir de l'industrie. Nous ne pouvons faire à cet égard que de simples conjectures.
Toutefois, ce qu'il est permis d'affirmer encore, c'est que l'abolition de la servitude politique déterminerait nécessairement la simplification de l'énorme et coûteux appareil de gouvernement qui écrase aujourd'hui les peuples civilisés, et qui, par la complication de ses [262] rouages et la lenteur de ses mouvements, ressemble à une sorte de colossale machine de Marly que là routine aurait conservée au milieu des appareils perfectionnés de l'industrie moderne.
Commençons par rappeler les conditions générales d'organisation qui s'imposent à toutes les industries et les conditions particulières qui caractérisent l'industrie du gouvernement. Toutes les industries arrivées à un certain degré de développement, et quel que soit le régime de liberté ou de monopole auquel elles sont soumises, comportent l'établissement d'une série d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. L'industrie du gouvernement ne fait pas exception à cette règle : entre le consommateur et le producteur des services publics, l'État, on compte au moins deux intermédiaires, la commune et la province.
D'un autre côté, les services qui constituent les attributions naturelles des gouvernements et en vue desquels ils ont été institués, ont pour caractère d'être non point individuels, mais collectifs; ils profitent, en vertu de leur nature, à la totalité des habitants du territoire où ils sont établis ;.de là, l'obligation qui s'impose à l'individu ou de quitter le territoire ou de participer pour sa part proportionnelle aux frais de ces services. C'est une servitude naturelle.
L'individu vit dans la commune. Sous le régime actuel, il est obligé de pourvoir aux frais de tous les services que le gouvernement communal lui impose, que ces services soient individuels ou collectifs, Supposons que la servitude politique vienne à être abolie, il pourra [263] refuser ceux de ces services qui ont un caractère individuel, il s'abstiendra de faire usage de l'école communale, il n'ira point à l'église ou au théâtre s'il y a un. théâtre, etc., etc., mais il ne pourra pas ne pas user des services de la voirie, des égouts, du pavage, de l'éclairage des rues et finalement de la police. La société communale dont il fait partie aura le droit de le contraindre à en payer sa part sous peine d'expulsion du territoire de la commune. En revanche, à moins de réduire ses attributions aux services ayant le caractère de la collectivité, le gouvernement communal ne pourra plus établir d'impôts ayant ce même caractère, les octrois par exemple. Enfin, ses attributions étant ainsi limitées aux services naturellement collectifs, il sera amené par la pression de la concurrence à réduire au minimum les frais de chacun et à établir pour couvrir ces frais une cotisation spéciale, proportionnelle à la consommation de chacun des participants. La concurrence interviendra ici de deux manières : d'une part, si la commune est trop petite pour être morcelée, les habitants qui se jugeront frustrés dans la répartition des dépenses collectives pourront émigrer dans les communes avoisinantes, ce qu'ils peuvent faire au surplus sous le régime actuel ; d'une autre part, si la commune est vaste, les habitants d'un quartier riche, surtaxés au profit des autres ou vice versa, pourront se séparer de l'ensemble, ce qui leur est interdit sous le régime actuel, soit pour former une commune indépendante, soit pour s'annexer à la commune voisine.
Supposons maintenant que des « anarchistes » se [264] refusent à participer aux frais des services collectifs qui nécessitent un gouvernement communal avec des règlements de voirie et de police. Ils seront libres de s'établir dans une localité à part où ils seront les maîtres de se passer de gouvernement et de services collectifs, où il n'y aura ni égouts, ni pavage, ni éclairage, ni police. Seulement, il y a apparence qu'ils ne manqueront point de se convaincre bientôt à leurs dépens de la nécessité de ces services. Quelle que soit leur confiance dans la bonté native de la nature humaine, ils ne tarderont pas à s'apercevoir qu'il existe des gens qui trouvent plus d'avantage à s'approprier les valeurs créées par autrui que de les créer eux-mêmes et qu'il est plus économique et plus efficace de payer une police spéciale pour se protéger contre ces gens-là que de faire soi-même sa police. De plus, ils auraient probablement maille à partir avec la province Sont leur commune anarchique ferait partie et à laquelle l'État réclamerait sa quotepart dans les frais du service naturellement collectif de la défense extérieure, aussi longtemps que subsistera le risque d'invasion.
Si l'individu reçoit des services de la commune, celle-ci, à son tour, en reçoit de la province, et la province de l'État, services de moyens de communication par terre et par eau, services de sécurité intérieure et extérieure. Ces services de la province et de l'État aboutissent à l'individu, comme le produit d'une manufacture aboutit, en passant par les magasins de gros et de détail, au consommateur qui rembourse dans le prix qu'il paye au détaillant tous les frais de production et [265] d'intermédiaires. L'organisation naturelle des services collectifs implique la répartition des frais des services de l'État entre les provinces, celle des frais des services des provinces en y ajoutant ceux de l'État entre les communes, enfin, celle des frais des services des communes, augmentés de ceux de la province et de l'État entre les individus. Mais, sous le régime actuel, les communes n'ont aucun moyen efficace de se préserver de la mauvaise qualité ni de l'exagération du prix des services de la province non plus que de la multiplication indue de ces services et la province est désarmée de même vis-à-vis de l'État, car la commune est liée et subordonnée à la province et la province à l'État. Il en serait autrement sous un régime de liberté de gouvernement. La commune, affranchie de la servitude politique, aurait le droit de se séparer de la province et la province de l'État.
Les conséquences de ce double droit de sécession sont faciles à apercevoir. Si les services que la commune reçoit de la province, augmentés de ceux que la province reçoit de l'État et qu'elle reporte sur la commune sont surabondants, s'il en est qui n'aient point le caractère de collectivité et que les individus aient par conséquent le droit de refuser, la commune refusera de payer sa quote-part de leurs frais de production; si les services collectifs qu'elle est obligée de recevoir sont de mauvaise qualité ou à trop haut prix, elle se séparera de la province pour se joindre à une autre et les provinces en useront de même vis-à-vis de l'État. Sans doute, des circonstances locales pourront faire obstacle à l'exercice de ce droit de sécession, mais si l'on songe [266] que la contiguïté des territoires n'est point—l'expérience l'atteste — nécessaire à la constitution d'une province et d'un État, qu'une commune on une province peut subsister comme une enclave, on se convaincra que le droit de sécession communal ou provincial suscitera une concurrence suffisante entre les Etats et les provinces pour améliorer la qualité de leurs services et en abaisser le prix. En tous cas, ce droit aurait pour résultat de déterminer la suppression de tous les services qui n'ont point, dans l'État ou la province, un caractère de collectivité, en même temps que tous les impôts ayant ce caractère, les douanes et les monopoles par exemple, soit que ceux-ci se trouvent établis au profit de l'État ou de la province, ou des particuliers. La spécialité s'imposerait pour la rétribution des services des provinces et de l'État comme pour celle des services des communes, et l'antique et barbare appareil de la fiscalité, avec la multiplicité des impôts et des entraves que leur perception nécessite serait remplacé par la perception annuelle d'une simple cotisation dans laquelle seraient compris, avec les frais des services communaux, ceux de la province et de la commune, divisés et spécialisés.
Telles seraient les premières conséquences de l'application du droit de sécession, du moment où l'abolition de la servitude politique autoriserait l'exercice de ce droit, actuellement interdit dans toute l'étendue du monde civilisé, et dont la simple revendication n'a pas cessé d'être considérée comme un « crime contre la sûreté de l'État».
[267]
A ces premières conséquences, savoir la réduction des attributions de la commune, de la province et de l'Etat aux services naturellement collectifs, et la suppression des impôts qui frappent, également en vertu de leur nature particulière, la généralité de la population d'un territoire, sans qu'il soit possible de s'y soustraire individuellement, tels que les monopoles et les douanes, s'en joindraient d'autres, non moins avantageuses aux consommateurs de services collectifs. Ces services, les collectivités de consommateurs ne se chargeraient point nécessairement de les produire elles-mêmes. Déjà, dans les pays où l'industrie et l'esprit d'entreprise sont suffisamment développés, les gouvernements municipaux ne se chargent pas eux-mêmes du service des eaux, de l'éclairage au gaz, de l'établissement des tramways. Ils trouvent plus d'économie à les confier à des entreprises spéciales. Ce qui est avantageux pour certains services communaux pourrait l'être en vertu du même principe pour les services de la province et de l'Etat, et notamment pour le service essentiel de la sécurité intérieure et extérieure. Cela étant, les consommateurs de ces services profiteraient, d'une part, de la concurrence des collectivités dont ils feraient partie à titre de consommateurs, d'une autre part de celle des entreprises spéciales qui se chargeraient de la production des services collectifs; ils bénéficieraient en un mot de tous les progrès que susciterait cette double concurrence appliquée à des services, dont le monopole augmente continuellement le prix sans en améliorer la qualité.
[268]
Une autre conséquence ultérieure de l'abolition de la servitude politique serait l'impossibilité des guerres de conquêtes entre les peuples civilisés. Du moment où le droit de sécession serait appliqué et entré dans les moeurs de la civilisation, du moment où la commune serait toujours libre de se séparer de la province et la province de l'Etat, il ne serait plus possible à un gouvernement de s'emparer d'une population comme d'un troupeau pour l'annexer à son domaine politique. Cette infraction au droit public des peuples civilisés serait considérée comme un crime analogue à la piraterie, et réprimée, comme l'est déjà la piraterie, par l'accord général des Etats. Au besoin, tous se réuniraient pour châtier le gouvernement pirate qui entreprendrait de rétablir, sous un régime de liberté, la servitude politique.
[269]
Chap. XVI "La tutelle imposée et la tutelle libre," pp. 269–71
Tous les hommes ne sont pas également capables de supporter la responsabilité naturellement attachée à la liberté. Sans doute, l'état de liberté est celui où l'individu peut développer au maximum ses facultés productives, mais c'est à la condition d'en faire un usage utiles Or d'une parties hommes sont encore, en grande majorité, incapables de réfréner les passions et les vices qui font obstacle à l'emploi utile de la liberté de se gouverner soi-même; et la conséquence de cette incapacité, c'est de les plonger dans la misère, et de les rendre nuisibles à la société dans laquelle ils vivent; d'une autre part, à mesure que la civilisation se développe, le gouvernement de soi-même devient plus difficile et exige une capacité plus grande. Au point de vue de la consommation, les hommes sont assiégés par des tentations plus nombreuses; des jouissances plus variées et plus raffinées sont offertes aux classes moyenne et supérieure, tandis que la classe inférieure est exposée à la tentation violente et presque irrésistible des liqueurs fortes. Au point de vue de la [270] production, l'agrandissement des marchés, sans parler même des causes artificielles qui lès troublent, les guerres, la fiscalité et la protection, en ne tenant compte que des causes naturelles, telles que l'inégalité des récoltes, les épidémies, etc., l'agrandissement des marchés, disons-nous, expose la multitude à des risques contre lesquels l'individu abandonné à lui-même est impuissant à se prémunir. De là, la nécessité de la tutelle. Dans les anciennes sociétés, la tutelle était le régime normal, et elle avait généralement pour caractère d'être imposée. En premier lieu, la majorité de la population était esclave et assujettie entièrement à la tutelle du maître pour sa production et sa consommation. Lorsque le servage a succédé à l'esclavage, la tutelle du maître s'est amoindrie et relâchée, mais elle a été remplacée en partie par celle de la commune et de la religion. En second lieu, les classes qui n'étaient point soumises au joug de l'esclavage subissaient la tutelle des corporations dont elles faisaient partie, corporations politiques, religieuses ou industrielles. La part qui était laissée, sous ce régime, à la liberté des individus était certainement moindre que celle de la tutelle collective. L'esclavage, le servage et les corporations ont disparu, mais le besoin de tutelle a subsisté, et il s'est même accru sous l'influence des progrès généraux de l'industrie et du développement de la civilisation. C'est l'État qui s'est chargé d'y pourvoir, et il a multiplié dans ce but les lois et les règlements de tutelle, en même temps que les secours aux individus dont le self government se soldait en perte. Mais l'inefficacité de cette tutelle [271] imposée n'est que trop sensible. Son insuffisance et ses défauts ont aggravé la démoralisation, les vices et la misère auxquels elle avait pour objet de porter remède, tandis qu'elle entravait le développement de la tutelle libre. En supposant que les gouvernements de la commune, de la province et de l'Etat soient obligés, sous l'influence de l'abolition de la servitude politique, à borner leurs attributions aux services ayant le caractère de la collectivité, tout l'appareil compliqué de la tutelle imposée ne tarderait pas à s'effondrer, mais le besoin de tutelle continuant de subsister, la tutelle libre prendrait sa place. Selon toute apparence et eu égard à l'incapacité de la grande majorité des hommes à gouverner utilement leurs affaires et leur vie, ainsi qu'aux difficultés croissantes de ce self government, la tutelle libre sera pendant longtemps le régime sous lequel se placera de préférence le plus grand nombre des créatures humaines. Nous avons donné ailleurs un aperçu de ce régime et nous avons esquissé quelques-unes des institutions qu'il comporte, notamment pour la tutelle des individus appartenant aux classes ouvrières. Nous nous bornons à y renvoyer le lecteur. [5]
[272]
Chap. XVII "Comment la Servitude Politique pourra être abolie," pp. 272–77
Affranchie des contrepoids naturels qui en réfrénaient l'abus et qu'aucun contrepoids artificiel n'a pu remplacer avec une efficacité appréciable, la servitude politique place aujourd'hui plus que jamais l'individu à la merci de l'État; c'est la servitude politique qui rend possible la continuation de l'état de guerre entre les peuples civilisés à une époque où la guérie a cessé d'avoir sa raison d'être, ainsi que le rétablissement de la forme la plus lourde et la plus cruelle du servage, — le service militaire obligatoire — dans la plus grande partie du monde civilisé ; c'est la servitude politique qui permet à l'État d'augmenter continuellement ses attributions et démultiplier ses charges aux dépens delà liberté et de la propriété de chacun, en contraignant ceux-là mêmes qu'il dépouille à lui fournir les moyens de les dépouiller. Ce serait cependant une illusion de croire que les nations civilisées s'en affranchiront de sitôt, quelles que soient l'étendue et la gravité des maux dont elle est la source.
L'état de choses qu'elle a produit s'appuie sur des [273] croyances qu'on essayerait en vain de déraciner dans la disposition actuelle des esprits et sur des intérêts encore plus intraitables que les croyances. Songez à la subordination absolue, dans laquelle l'individu a vécu et dû vivre pendant des milliers d'années vis-à-vis de l'État, sous peine d'être la proie de barbares pires que les bêtes féroces ; songez à l'opinion qui s'est alors formée dans son esprit et enracinée davantage de génération en génération, car elle s'appuyait sur l'expérience visible de la nécessité de l'omnipotence de l'État pour sauvegarder la sécurité de chacun; songez enfin à l'éducation routinière et rétrograde que nous avons reçue dans les officines de l'État et qui nous enseigne comme un dogme que rien n'est changé dans le monde, depuis l'antiquité, et que nous sommes, nous, les héritiers directs de la civilisation d'Athènes et de Rome, entourés de barbares qui envient nos richesses et guettent perpétuellement le moment favorable pour nous en dépouiller. Calculez d'un autre côté la masse énorme des intérêts qui dépendent de l'État, le nombre et l'importance des fonctionnaires civils et militaires qui émargent au budget, considérez le nombre presque aussi considérable des intérêts engagés dans les monopoles, les privilèges et les protections que l'État accorde et garantit, et que l'abolition de la servitude politique laisserait sans support, et vous aurez une idée de là puissance presque inexpugnable de cette colossale place forte que l'on nomme l'État.
Cette forteresse, la garnison qui l'occupe n'est pas seule à vouloir la garder intacte; les socialistes qui [274] veulent s'en emparer sont d'accord sur la nécessité de la conserver, en élargissant même son enceinte afin qu'elle puisse contenir leur multitude, et de la rendre inexpugnable, quand ils l'auront conquise.
L'omnipotence de l'État et la servitude de l'individu qui sont les supports de l'ordre actuel des choses sont ainsi protégées par la coalition formidable des idées dominantes dans toutes les classes de la société et des intérêts des classes prépondérantes qui exploitent l'État à leur profit sans oublier ceux de la multitude qui prétend l'exploiter à son tour. Ce serait une entreprise vaine de prétendre l'emporter sur cette coalition universelle des idées et des intérêts. On peut se convaincre d'ailleurs, en constatant le peu de faveur dont jouissent les théories économiques et la vanité de nos efforts pour limiter même dans la plus faible mesure les attributions de l'État et arrêter l'essor du fonctionnarisme, du protectionnisme et du socialisme, combien serait vaine l'espérance de convertir prochainement l'opinion publique à l'abolition de la servitude politique.
Mais ce qu'aucune propagande libérale ne pourrait faire, la force des choses, c'est-à-dire l'opération naturelle et inévitable de l'omnipotence de l'État et de la servitude de l'individu se chargera, quoi qu'il arrive, de l'accomplir.
Nous pouvons constater les résultats de cette opération, et ces résultats sont particulièrement sensibles depuis un siècle. Ils se résument dans l'inégalité croissante de la progression des dépenses des États et de celle des ressources des nations qui sont obligées [275] d'y pourvoir. Malgré l'essor énorme que l'avènement de la grande industrie, et en particulier le progrès des moyens de communication, ont imprimé à la production et à la richesse, la progression des dépenses et des dettes des États civilisés a été constamment supérieure à celle des revenus qui servent à acquitter les unes et à servir les intérêts des autres. De plus, cette inégalité va croissant et il est facile de prévoir qu'elle est destinée à s'accélérer encore. Tandis que le volume et le poids de l'État augmentent à mesure que des classes plus nombreuses entrent en partage de la puissance politique, et prétendent avoir leur part dans le budget, l'essor de la production qui alimente le budget est ralenti par le poids croissant des impôts, des monopoles, des protections, et des entraves qu'ils nécessitent. Depuis quelques années déjà, le ralentissement est sensible; le mouvement ascendant de la richesse s'est affaibli et avec lui le mouvement de la population. Un moment viendra où les nations les plus progressives et les plus riches seront dans l'impossibilité de faire face à des charges plus rapidement multipliées que leurs ressources. En admettant même que la progression de ces charges demeure ce qu'elle est depuis un siècle, la France par exemple aura à alimenter à la fin du siècle prochain un budget de 12 milliards et à servir les intérêts d'une dette de 120 milliards. Pourra-t-elle y suffire avec sa production surchargée de taxes et de protections et sa population presque stationnaire? En attendant, le mal causé par cette inégalité progressive des charges et des ressources [276] ira s'aggravant. On ne manquera pas d'y chercher des remèdes ou des dérivatifs en recourant aux panacées en crédit de la guerre et des révolutions. Mais la guerre est désormais frappée d'improductivité : toute guerre victorieuse ou non a pour conséquence une augmentation du chiffre de la dette publique. Les révolutions, ces guerres intérieures, ont des résultats plus désastreux encore; elles arrêtent la production et augmentent d'une manière permanente les charges de l'État en rendant nécessaire l'extension de ses attributions. De plus les révolutions futures, en cessant d'être exclusivement politiques pour devenir sociales, placeront le matériel et la direction de la production entre les mains d'une classe moins capable d'entretenir et d'augmenter l'un et de gouverner l'autre, elles occasionneront une déperdition de richesse bien autrement considérable que les révolutions politiques. Un moment viendra alors où l'État omnipotent et absorbant s'effondrera faute de support et où il faudra bien le reconstituer sur une autre base.
Les amis de la liberté pourraient donc se croiser les bras et se contenter de « laisser faire » la force des choses pour assister au triomphe de leurs doctrines. Mais, si le développement de la civilisation est soumis à des lois naturelles qui gouvernent la marche de l'humanité et qui prévalent en dépit de tous les obstacles que leur opposent l'ignorance et la folie humaines, on peut cependant aplanir ces obstacles, accélérer ou ralentir la marche de l'humanité, diminuer ou augmenter la somme des forces qui la conduisent au but mystérieux qui lui est assigné.
[277]
Montrer les vices et les résultats funestes du système actuel de gouvernement des sociétés civilisées, et s'efforcer d'en hâter la transformation, voilà en quoi se résume aujourd'hui la tâche des amis du progrès. Si modeste et si ingrate que soit parfois cette tâche, ils ne doivent point l'abandonner. Leur devoir est de s'appliquer incessamment à éclairer l'opinion publique, dussent-ils lutter en vain contre le courant qui l'entraîne. Lorsque l'opinion sera convertie, l'évolution de l'ancien régime au nouveau s'accomplira d'elle-même sans secousses et sans violence, et la servitude politique fera place à la liberté.
Endnotes
[1] Article Budget du Dictionnaire général des finances, publié sous la directions de M. Léon Say.
[2] Voir à l'Appendice le tableau, dressé par M. Paul Boiteau, des dépenses prévues pour l'exercice 18S5, des dettes publiques et des sommes absorbées par les dépenses militaires et le service des dettes des États européens.
Certains optimistes prétendent, a la vérité, que la diminution de la valeur ou du pouvoir d'achat de la monnaie a allégé progressivement le poids des budgets et que les Français, par exempta, payent aujourd'hui plus facilement un budget de 4 milliards qu'ils ne payaient, il y a soixante ans, un budget d'un milliard. Mais il suffit de consulter les prix du blé et de la plupart des autres articles de consommation pour se convaincre que le pouvoir d'achat de la monnaie no s'est pas sensiblement abaissé depuis un demi-siècle, c'est-à-dire pendant la période où les dépenses publiques se sont accrues dans la proportion la plus considérable. C'est le développement de la production et l'augmentation de la richesse et de la population, conséquence des progrès dé la production, qui ont rendu les budgets plus supportables et non la diminution prétendue de la valeur de la monnaie ; mais le taux d'accroissement des dépenses publiques no dépasse pas moins, chaque jour davantage, celui de la richesse et de la population.
En France, le nombre des naissances pour une population de 10,000 âmes a suivi, d'après le Dr Bertillon, la progression décroissante que voici :
| Nombre de naissances pour une population de 10,000 âmes. | |
| 1770–80 | 380 |
| 1801–11 | 325 |
| 1811–20 | 316 |
| 1821–30 | 309 |
| 1831-40 | 289 |
| 1841–50 | 274 |
| 1851-60 | 267 |
| 1861-68 | 264 |
| 1869-80 | 245 |
Dans la plupart des autres pays, notamment en Allemagne, en Angleterre et en Russie, le taux d'accroissement de la population, quoique plus considérable qu'en France, tend également a s'abaisser depuis quelques années. En Allemagne, la moyenne de l'excédent des naissances sur les décès, qui a été de 550,993, de 1875 à 1884, est tombé îi 493,697 en 1883, et s'il s'est relevé en 1884 à 522,083, il est resté cependant encore au-dessous de la moyenne. En Angleterre, d'après les rapports officiels, le nombre des naissances tend à baisser et l'accroissement de la population tient surtout à la diminution constante des décès. En Russie, l'accroissement annuel de la population avait été de 1,44 p. 100 de 1815 à 1835, de 1,21 de 1835 k 1856 et de 1,14 seulement de 1858 à 1883; en 1882, cet accroissement était descendu à 1,06.
Ces renseignements sont empruntés à l'Affaiblissement de la natalité en France, ses causes et ses conséquences, par M. le marquis de Nadaillac, correspondant de l'Institut. F. 6, 18, 25 et 118.
[3] D'après le tableau publié par M. Richard de Kaufmann, dans son livre des Finances de la France, cette proportion serait même inférieure à un quart. D'après M. de Kaufmann, la proportion de l'impôt indirect sur la totalité des recettes serait, en France, de 84 p. 100; en Angleterre, 82; en Suède, 78; en Autriche, 76; en Danemark, 76; en Hollande, 74; en Russie, 74; en Portugal, 73; en Belgique, 70; en Espagne, 65; en Italie, 65; en Prusse, 64; en Saxe, 56 ; en Hongrie. 52.
« Dans l'histoire de nos finances, dit M. Yves Guyot, dans son remarquable rapport relatif à l'impôt sur le revenu, nous constatons les variations suivantes du rapport de nos contributions directes à nos contributions indirectes. D'après M. Clamagerau, les impositions indirectes n'auraient pas, avant François Ier, atteint la proportion de 50 p. 100, et, à la fin du règne de Louis XI, cette proportion n'aurait même été que de 22,8 p. 100. Mais, sous Louis XIV, leur part, certaines années, fut de 175, lorsque l'imposition directe ne donnait que 100 de contribution.
« Les calculs de M. Paul Boiteau, sur le budget de Necker du 5 mai 1789, ont établi, qu'au moment où la Révolution commença, les contributions indirectes étaient aux contributions directes comme 115,8 est à" 100.
« L'Assemblée nationale avait la haine de ces taxes. La proportion fut renversée. Dans le budget de 1791, l'impôt indirect ne produit plus que 66,1 relativement à 100, et en l'au VII, après divers rétablissements, il no représente encore que 51,4 contre 100. Sous le Consulat et lé premier Empire, il atteint 91,8 contre 100.
« Sous la Restauration, les contributions indirectes sont de 143,1, à peu près la proportion du ministère de Colbert; sous la monarchie de 1830, elles sont de 173,2; sous la seconde République, la charge dc3 centimes additionnels généraux ayant reparu dans nos budgets, elles no sont plus que de 168,4.
« La moyenne du second Empire est de 225,2 contre 100, si l'on continue de joindre aux fonds généraux des contributions directes, les fonds spéciaux du budget des départements et des communes passés en 1863 au budget sur ressources spéciales; elle est de 368,5 si on les en détache.
Proportionnalité des impôts et revenus indirets, les contributions directe étant 100.
| Avec les fonds spéciaux. | Sans les fonds spéciaux. | |
| 1870 | 197,1 | 343,7 |
| 1875 | 299,9 | 534,7 |
| 1880 | 322,4 | 605,3 |
| 1881 | 323,9 | 610,6 |
| 1882 | 307,4 | 557,7 |
| 1885 | 304,4 | 550,1 |
« Il est clair, ajoute avec raison M. Yves Guyot, que la comparaison établie avec les fonds spéciaux est fausse, puisqu'ils comprennent des centimes destinés à des dépenses locales ; autrement, il faudrait ajouter aussi les octrois aux contributions indirectes. Dans ces conditions, on voit que, tandis que le contribuable paye 100 de contributions directes, il paye 550 de contributions indirectes ; ou, si l'on aime mieux, il paye 1 franc de contributions directes quand il paye 5,50 de contributions indirectes. »
Yves Guyot. Rapport fait au nom de la commission du budget, sur les questions soulevées par diverses propositions relatives à l'impôt sur le revenu. P. 6.
[4] « La liberté, disait l'avocat général Antoine-Louis Séguier, dans sa célèbre protestation faite au nom du parlement contre l'abolition des maîtrises et des jurandes (lit de justice du 12 mars 1170), la liberté est sans doute le principe de toutes les actions; elle est l'âme de tous les états; elle est principalement la vie et le premier mobile du commerce. Mais, Sire, par cette expression si commune aujourd'hui et qu'on a fait retentir d'une extrémité du royaume à l'autre, il no faut point entendre une liberté indéfinie, qui ne connaît d'autres lois que ses caprices, qui n'admet d'autres règles que celles qu'elle se fait à elle-même. Ce genre de liberté n'est autre chose qu'une véritable indépendance; cette liberté se changerait bientôt en licence; ce serait ouvrir la porto à tous les abus, et ce principe de richesse deviendrait un principe de destruction, uno source de désordre, une occasion de fraude et de rapines dont la suite inévilablo serait l'anéantissement total des arts et des artistes, de la confiance et du commerce.
« … Tous vos sujets, Sire, sont divisés en autant de corps différents qu'il y a d'états différents dans le royaume. Le clergé, la noblesse, les cours souveraines, les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à ces tribunaux, les universités, les académies, les compagnies de finances, les compagnies de commerce, tout présente et dans toutes les parties de l'État, des corps existants qu'on peut regarder comme les anneaux d'une grande chaîne dont le premier est dans la main de Votre Majesté, comme chef et souverain administrateur de tout co qui constitue le corps de la nation.
« La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante. Les communautés de marchands et artisans font uno portion de co tout inséparable qui contribue à la police générale du royaume ; elles sont devenues nécessaires et pour nous renfermer dans ce seul objet, la loi, Sire, a érigé dos corps de communautés, a créé des jurandes, a établi des règlements, parce que l'indépendance est un vice dans la constitution politique, parce que l'homme est toujours tenté d'abuser de la liberté. Elle a voulu provenir les fraudes en tout genro et remédier à tous les abus. La loi veille également sur l'intérêt de celui qui vend et sur l'intérêt de celui qui achète; elle entretient uno confiance réciproque entre l'un et l'autre; c'est, pour ainsi dire, sous le sceau de la foi publique que le commerçant étale sa marchandise aux yeux de l'acquéreur et que l'acquéreur la reçoit avec sécurité des mains du commerçant.
« … Relâcher les ressorts qui font mouvoir cette multitude de corps différents, anéantir les jurandes, abolir les règlements, en un mot, désunir les membres des communautés, c'est détruire les ressources dé toute espèce que le commerce lui-môme doit désirer pour sa propre conservation. Chaque fabricant, chaque artiste, chaque ouvrier se regardera comme un être isole, dépendant de lui seul et libre de donner dans tous les écarts d'une imagination souvent déréglée ; toute subordination sera détruite ; il n'y aura plus ni poids ni mesure; la soif du gain animera tous les ateliers, et comme l'honnêteté n'est pas toujours la voie la plus sûre pour arriver à la fortune, le public entier, les nationaux comme les étrangers, seront toujours la dupe des moyens secrets préparés avec art pour les aveugler et les séduire Et ne croyez pas, Sire, que notre ministère, toujours occupé du bien public, se livre en ce moment à de vaines terreurs; les motifs les plus puissants déterminent notre réclamation, et Votre Majesté serait en droit de nous accuser un jour de prévarication si nous cherchions à les dissimuler. Lo principal motif est l'intérêt du commerce en général, non seulement dans la capitale, mais encore dans tout lo royaume, non seulement dans la France mais dans toute l'Europe, disons mieux, dans le monde entier.
« Le but qu'on a proposé à Votre Majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Nous osons avancer à Votre Majesté les propositions diamétralement contraires; ce sont ces gênes, ces eutraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France.
« … La liberté indéfinie fera bientôt évanouir cette perfection qui est seule la cause de la préférence que nous avons obtenue j cette foule d'artistes et d'artisans de toutes professions, dont le commerce va se trouver surchargé, loin d'augmenter nos richesses, diminuera peut-être tout à coup le tribut des deux mondes… Le commerce deviendra languissant; il retombera dans l'inertie dont Colbert, ce ministre si sage, si laborieux, si prévoyant a eu tant de peine à le faire sortir. » (OEuvres de Turgot, t. II, p. 332. Ed. Guillaumin.)
[5] Voir l'Evolution politique et la Révolution. Chap. XI. Tutelle et liberté. Voir aussi à l'Appendice le projet d'établissement d'une société pour le placement dos ouvriers et le plan d'émancipation des esclaves au Brésil.1.
VI.15. "Projet d’Association pour l’établissement d’une Ligue des neutres" (1887)↩
Source
"Projet d’Association pour l’établissement d’une Ligue des neutres". Publié par le Times, 28 juillet 1887. Republished in Gustave de Molinari, La morale économique (Paris: Guillaumin, 1888), pp. 431-38).
Introduction
This is an interesting article which Molinari got published in The Times of London in July 1887. In it he puts the case for the creation of a League of Neutral states (such as Holland, Belgium, Switzerland and Denmark under the general leadership of the great free trade nation of Great Britain) in order to act as a counterweight to the growing military power of the other large states of Europe, in particular Germany.
The aim of the League would be to "Garantir la paix entre les peuples civilisés et provoquer ainsi le désarmement en rendant les armements inutiles" (to ensure peace among the civilized nations and thus to encourage disarmament by making arms useless) by pooling their armies and navies. He thought it would the fitting conclusion to the process begun 40 years previously by the free trade and anti-war group, the Anti-Corn Law League led by Richard Cobden.
His argument is that the economies of the European states had become so intertwined and dependent on each other that a war between them would have dreadful consequences, not just for the country which had been invade and conquered, but for all the other non-belligerent countries whose trade would also be disrupted.
By publishing his plan for such an Association in the Times Molinari hoped to win over public opinion in England, which still remained pro-free trade by and large, and to exert pressure on its European neighbors before it was too late. But one might say that it was Molinari who was too late to head off what would become the First World War.
Text
[431]
II
En admettant que les classes intéressées au maintien de la paix eussent conscience de leur puissance d'opinion avec la ferme volonté d'en user, elles trouveraient, dans la constitution d'une Ligue des neutres,l'instrument efficace de la pacification et du désarmement ; voilà ce que nous avons voulu démontrer en formulant ce projet, sans nous dissimuler d'ailleurs que nous n'avions aucune chance de le réaliser dans l'étal présent des esprits et des choses.
La situation actuelle de l'Europe est de nature à inspirer les craintes les plus sérieuses aux amis de la paix. Depuis la funeste guerre de 1870, cette situation s'est continuellement aggravée. Quoique la France ait manifesté, à diverses reprises, son attachement à la politique de la paix, l'Allemagne, devenue une nation essentiellement militaire, a été sur le point, en 1873 et au commencement de 1887, de déchaîner de nouveau la guerre, en vue d'assurer les résultats acquis par la campagne de 1870–71 et sanctionnés par le traité de Francfort. En présence de cette éventualité redoutable et de la menace qu'elle contient pour la sécurité générale, toutes les nations ont augmenté leurs armements et les ont portés finalement à un point qui n'avait jamais été atteint, même aux époques des grandes invasions barbares. L'Europe continentale est devenue un vaste camp. Les effectifs militaires qu'elle maintient sur pied en pleine paix s'élèvent au chiffre énorme de [432] 3,860,000 hommes. En temps de guerre, ils peuvent être portés à 12,453,000. L'entretien de ces effectifs, sans compter les frais de construction des forteresses et de la réfection périodique du matériel que nécessite le perfectionnement continu des instruments d'attaque et des appareils de défense, absorbe annuellement une somme de 4,600 millions de francs. Les revenus ordinaires des États n'y peuvent pas suffire, et depuis 1870, les dettes des nations européennes se sont élevées, sous l'influence de cette cause, de 73 milliards à 115. Mais l'accroissement du risque de guerre et la multiplication des armements qui en a été la conséquence n'ont pas seulement augmenté les. charges militaires et fiscales qui accablent les populations; ils ont causé un autre mal, à la fois moral et économique, non moins menaçant peut-être pour l'avenir. Ils ont réveillé les haines nationales que la paix et le développement des relations commerciales avaient assoupies et provoqué une réaction protectionniste qui tend à exclure du marché de chaque pays, avec les produits du travail, les travailleurs eux-mêmes. A la fin d'un siècle marqué par tant d'inventions merveilleuses qui ont rapproché les peuples et rendu les régions les plus reculées du globe accessibles à la civilisation, l'étranger redevient ce qu'il était aux époques d'isolement et de barbarie : un ennemi.
Les choses en sont arrivées à ce point qu'on s'est demandé si la guerre elle-même ne serait pas préférable au régime ruineux et démoralisateur de la paix armée. Il en serait ainsi peut-être si une conflagration européenne devait avoir pour conséquence la suppression ou tout au moins l'abaissement du risque de guerre et le désarmement. Malheureusement, l'expérience nous apprend que la guerre n'engendre pas la paix, mais la guerre. Toute lutte entre deux nations contient, quelle qu'en soit l'issue, le germe d'une guerre future. Ce germe grandit pendant la trêve que l'épuisement de leurs forces et de leurs ressources a imposée aux adversaires; il se développe et porte tôt ou tard ses fruits empoisonnés. La guerre de 1870 a augmenté la somme des haines politiques qui existaient auparavant en Europe. Comment la guerre future, en mettant aux prises des peuples en proie à une animosité devenue plus violente, contribuerait-elle à les réconcilier? Elle les conduira probablement à la banqueroute, elle ne les conduira pas au désarmement.
Ce n'est donc pas à la guerre qu'il faut demander l'établissement d'un régime de « paix désarmée ». Ce régime, serait-il possible de l'instituer, en se bornant, comme le veut l'International arbitration and peace association,à créer un tribunal pour vider les différends des Etats sans mettre à la disposition de ce tribunal la force nécessaire pour faire exécuter ses verdicts? De bienveillants amis de la paix continuent à nourrir cette illusion philanthropique, mais sans réussir à la propager. Le bon sens public se refuse à croire que des puissances animées de passions hostiles et disposant d'armements formidables se résignent bénévolement à accepter les décisions d'un tribunal investi d'une autorité purement morale : soit qu'il s'agisse des nations ou des individus, il ne croit pas à l'efficacité d'une justice sans gendarmes. Aussi les [433] Sociétés de la paix ne recrutent-elles aujourd'hui que de rares adhérents, en dépit de l'ardeur convaincue de leurs dignes promoteurs et quoique le besoin de la paix soit de plus en plus ressenti par la généralité des classes industrieuses, qui supportent le lourd fardeau des armements, en attendant les calamités de la guerre. C'est que le bon sens pratique du public lui enseigne qu'on n'arrête pas le cours d'un torrent avec une toile d'araignée, et que la force morale ne peut avoir raison de la force matérielle qu'à la condition de lui opposer une force matérielle supérieure.
Mais peut-on, dans l'état présent des choses en Europe, mettre au service de la paix une force matérielle suffisante pour empêcher la guerre? La constitution d'une telle force serait-elle conforme au droit des gens, et, d'une autre part, y a-t-il en Europe des États assez intéressés au maintien de la paix pour constituer et mettre en œuvre, à leurs frais et risques, cet instrument de pacification?
Le droit des gens reconnaît aux États le droit de faire la guerre; mais comme tous les droits, le droit de la guerre est limité par le droit d'autrui. Un État n'a, pas plus qu'un simple individu, le droit d'infliger un dommage à autrui, même en poursuivant un but qu'il considère comme légitime. Or, à cet égard, les progrès île l'industrie et du commerce ont complètement changé la situation des États belligérants vis-à-vis des neutres. Jusqu'à une époque relativement récente, le commerce extérieur des États civilisés et le placement des capitaux à l'étranger n'ont eu qu'une faible importance : chaque pays produisait lui-même la presque totalité des articles de sa consommation et employait ses capitaux exclusivement dans ses propres entreprises. En 1613, par exemple, la valeur totale des importations et des exportations de l'Angleterre et du pays de Galles ne dépassait pas 4,628,000 liv. st., et, un siècle plus tard, le commerce extérieur de toutes les nations européennes n'égalait pas en importance le commerce actuel de la petite Belgique. Le prêt international des capitaux était moins développé encore que le commerce des marchandises. On ne trouvait guère qu'en Hollande des capitalistes disposés à confier leurs fonds à des gouvernements étrangers et encore moins à les aventurer dans des affaires industrielles au delà des frontières de leur pays ou même de leur province.
Il résultait de là que lorsqu'une guerre venait à éclater entre deux États, elle ne faisait subir aux populations des États neutres qu'un dommage partiel et insignifiant. Une guerre entre la France et l'Espagne ou l'Allemagne n'affectait pas beaucoup plus les intérêts de l'Angleterre que n'aurait pu le faire une guerre entre la Chine et le Japon. La guerre avait alors un caractère purement local et les dommages qu'il est dans sa nature de causer ne dépassaient que par exception les limites des pays et même des localités qui en étaient le théâtre. Le progrès de la machinerie industrielle et, en particulier, des moyens de communication ont créé, sous ce rapport, un ordre de choses entièrement nouveau. Le commerce des marchandises et le prêt des capitaux se sont, depuis un demi-siècle surtout, progressivement accrus et internationalisés. Le [434] commerce extérieur des peuples civilisés, qui n'atteignait pas deux ou trois milliards il y a deux siècles, dépasse actuellement quatre-vingts milliards, et c'est également par dizaines de milliards qui se chiffre le prêt des capitaux à l'étranger. Dans chaque pays une portion de plus en plus nombreuse de la population dépend, pour ses moyens d'existence et sa subsistance, de ses relations avec l'étranger, soit qu'il s'agisse de l'exportation des produits de son industrie ou du prêt de ses capitaux, qui lui fournissent, sous forme de salaires, de profits ou d'intérêts, les revenus avec lesquels elle achète les objets de sa consommation, soit qu'il s'agisse de l'importation des denrées nécessaires à sa subsistance. En France, c'est environ le dixième de la population qui se trouve ainsi immédiatement dépendante de l'étranger; en Belgique, la proportion s'élève au tiers et elle ne doit pas être en Angleterre bien éloignée de ce chiffre.
Aussi longtemps que la paix subsiste, on ne peut que s'applaudir de ce développement et de cet entrecroisement des relations internationales, car ils se traduisent par une augmentation progressive de bien-être et de civilisation; mais qu'une guerre vienne à éclater parmi les peuples civilisés, aussitôt ce qui était un bien pour tous devient un mal pour chacun. Sans parler des frais extraordinaires d'armement que le soin de leur sécurité inflige aux neutres, ils sont atteints, quoi qu'ils fassent, et par la crise que toute grande guerre déchaîne sur le marché des capitaux, et par l'interruption ou la diminution de leur commerce avec les belligérants. Qu'on se rappelle, pour ne citer qu'un seul exemple, les désastres et la misère effroyables que la guerre de la Sécession américaine a occasionnés dans tous les centres manufacturiers auxquels les États du Nord fournissaient la matière première de leur industrie! C'est que la guerre n'est plus comme autrefois une nuisance locale, c'est qu'elle atteint les intérêts des neutres presqu'autant que ceux des belligérants, en un mot, c'est qu'à une époque où, en dépit de toutes les barrières, le commerce a lié et solidarisé de plus en plus les intérêts des peuples, la guerre est devenue une nuisance générale.
Cela étant, les neutres n'ont-ils pas le droit d'empêcher cette nuisance de se produire? En vain un gouvernement belliqueux invoquerait-il, à rencontre de ce droit nouveau, issu des progrès de l'industrie et de la civilisation, l'antique droit de la guerre; comme il n'est plus en son pouvoir d'exercer ce droit sans causer aux neutres un dommage qu'aucune indemnité ne suffirait à compenser, les neutres peuvent, en invoquant à leur tour l'intérêt légitime de leur conservation, lui en interdire l'exercice. Que deux duellistes s'en aillent vider leur querelle dans un endroit écarté, où leurs pistolets ne peuvent atteindre personne, il n'y aura pas grand inconvénient à leur permettre d'exercer librement leur « droit de la guerre »; mais qu'ils s'avisent de se tirer des coups de revolver dans un carrefour populeux, les passants, à défaut de la police, ne seront-ils pas pleinement autorisés à empêcher ce mode d'exercice du droit de la guerre, en raison du danger auquel il les expose? Il en est ainsi de la guerre entre les États: les neutres n'avaient qu'un faible intérêt à l'empêcher lorsqu'elle ne [435] leur causait qu'un dommage insignifiant; on pouvait même leur en contester le droit; mais ce droit n'est-il pas devenu manifeste depuis que la guerre ne peut plus se fairesans mettre en péril les intérêts et l'existence même d'une portion de plus en plus nombreuse de leurs populations?
Il importe de remarquer encore qu'en exerçant leur droit d'interdire des guerres devenues, par le fait du progrès, nuisibles à la communauté civilisée tout entière, les neutres auraient pour eux non seulement l'opinion de leurs propres populations, mais encore celle de l'immense majorité des populations vivant de l'agriculture, de l'industrie et du commerce dans les pays entraînés à la guerre. Ce n'est pas, en effet, le peuple lui-même qui est appelé à décider de la justice et de la nécessité d'une guerre à laquelle tous les citoyens sont contraints aujourd'hui à participer de leur sang et de leur argent; cette décision appartient à un petit nombre d'hommes politiques et de chefs militaires, dont les intérêts sont étrangers à ceux de l'industrie; souvent même elle appartient à un seul homme, et ce n'est rien exagérer de dire que la paix du monde est actuellement à la merci de trois ou quatre personnages, souverains ou ministres, qui possèdent le pouvoir de déchaîner, du jour au lendemain le fléau de la guerre, et, en le déchaînant, de causera la communauté civilisée, en y comprenant les neutres, sur lesquels ils n'ont cependant aucune juridiction, des maux et des dommages sans nombre. Ce pouvoir exorbitant, les despotes les plus absolus des époques de barbarie ne l'ont pas possédé; les nations indépendantes et libres de notre époque de civilisation sont obligées de le subir, faute de s'accorder pour y mettre un frein.
Cet accord pour maintenir un état de paix commandé par l'intérêt général et conforme aux vœux de l'immense majorité des populations réputées les plus belliqueuses, cet accord que le développement croissant des relations internationales rend de plus en plus nécessaire, n'y a-t-il pas lieu de le réaliser avant qu'une guerre, qui s'annonce comme plus sanglante, destructive et coûteuse qu'aucune des guerres précédentes, vienne à éclater? Les Etats qui en prendront l'initiative n'auront-ils pas rendu à l'humanité et à la civilisation le plus signalé des services? Et cette initiative n'est-ce pas aux nations auxquelles la guerre peut causer aujourd'hui la plus grande somme dédommages, soit en atteignant leurs intérêts économiques, soit en menaçant leur indépendance politique, qu'il convient de la demander? telle est, au premier de ces points de vue, l'Angleterre; tels sont, au second, les petits États du continent, la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark.
En inaugurant dans le monde la politique du libre-échange, l'Angleterre a, sinon créé, du moins avancé et développé l'état nouveau de dépendance mutuelle des peuples pour la satisfaction économique de leurs besoins. Au début de cette politique, en 1820, son commerce extérieur ne s'élevait qu'à 79,426,000 livres sterling; soixante ans après, en 1880, il montait à 591,744,000 livres sterling. Il avait septuplé. Dans le même intervalle, les capitaux anglais s'étaient répandus dans le monde entier pour créer des [436] chemins de fer, des lignes de navigation, des entreprises industrielles de tout genre à l'avantage réciproque des emprunteurs et des prêteurs; mais si cette politique de free tradeet d'internationalisation croissante des intérêts a contribué à augmenter, dans des proportions inattendues et extraordinaires, le bien-être des populations, elle a rendu l'Angleterre plus dépendante des autres nations. Une circonstance spéciale a accru encore cette dépendance: c'est que les articles d'importation de l'Angleterre consistent principalement en denrées alimentaires. L'abolition des corn lawsa permis aux Anglais de se procurer, par l'échange de leurs produits industriels contre les produits agricoles de l'étranger, la plus grande partie de leur nourriture à meilleur marché qu'ils ne pourraient l'obtenir en la produisant eux-mêmes. Sur 35 millions d'habitants du Royaume-Uni, environ 20 millions sont nourris de viande, blé, légumes, fruits, etc., provenant de l'étranger, et plusieurs millions d'Anglais tirent leurs revenus des industries dont les produits servent à acheter économiquement cette subsistance de la majorité de la population. Aussi longtemps que la paix subsiste dans le monde civilisé, cet état de choses ne présente que des avantages; il permet au peuple anglais de dépenser moins de travail que tout autre peuple pour se procurer les nécessités de la vie; mais qu'une guerre éclate, qu'une partie des marchés de vente et d'approvisionnement de l'Angleterre viennent à se fermer ou simplement à se rétrécir, de quels revenus vivront les ouvriers de Manchester, de Glasgow, Birmingham, etc., qui produisent les articles avec lesquels s'achètent à l'étranger les denrées alimentaires? De quoi se nourrira la multitude des consommateurs auxquels l'étranger cessera de pouvoir fournir son contingent habituel de subsistances ? C'est là, on le sait, l'argument capital que les fair tradersopposent au free trade;mais, au point actuel de développement de l'industrie britannique, ne serait-il pas impossible et chimérique de retourner en arrière, en réduisant la production des cotonnades, des lainages, des fers, des machines, etc., aux besoins du marché du Royaume-Uni et de ses colonies? Le danger que signalent les fair tradersn'en est moins réel. Plus un pays dépend de l'étranger pour ses revenus et sa subsistance, plus grands sont les dommages et les périls auxquels la guerre l'expose. La conclusion de ce fait, ce n'est pas qu'il faut revenir à la politique commerciale en vigueur avant l'avènement de la vapeur et du free trade,c'est qu'il faut compléter et assurer la politique du free tradeen garantissant la paix. Et c'est, par là même, à l'Angleterre, qui a inauguré la politique du free trade,qu'il appartient de prendre l'initiative d'une politique destinée à empêcher la guerre.
Aux intérêts économiques que la guerre met en péril se joint, pour les petits Etats du continent, la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark, un intérêt politique de premier ordre: l'intérêt de leur indépendance ou tout au moins de l'intégrité de leurs frontières. Les petits Etats n'ont rien à gagner à une guerre européenne, au contraire; car l'expérience atteste que c'est presque toujours à leurs dépens que se concluent les arrangements territoriaux auxquels aboutissent les guerres entre les grands Etats.
[437]
Supposons maintenant que l'Angleterre, en s'appuyant d'une part sur le droit des gens, d'une autre part, sur des intérêts communs, particulièrement menacés par une nouvelle guerre européenne, s'associe avec les petits Etats continentaux que nous venons de nommer pour constituer une Ligue des neutres,et voyons de quelle force millitaire pourra disposer cette Ligue. En temps de paix, l'effectif militaire des cinq Etats est de 453,432 hommes, dont 200,785 pour l'Angleterre et 252,647 pour la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark. En temps de guerre, il peut être porté à 1,095,223 hommes [1]. A cette armée de plus d'un million de soldats se joindrait, par l'union des flottes de l'Angleterre, de la Hollande et du Danemark, la marine militaire la plus puissante qui existe; enfin, pour mettre en œuvre ce colossal instrument de coercition, la Ligue aurait à son service les ressources financières d'une nation qui possède le premier crédit du monde. En admettant qu'un nouveau conflit vienne à se produire entre deux des grandes puissances continentales, l'Allemagne, la France, l'Autriche ou la Russie, n'est-il pas certain que la Ligue, en unissant ses forces à celles de l'Etat menacé d'une agression, comme l'a été la France en 1875 et au commencement de 1887, comme pourrait l'être toute autre puissance, lui assurerait la victoire? Cette intervention d'un pouvoir pacificateur, disposant d'une force égale, sinon supérieure à celle de la plus grande puissance militaire du continent, et secondé moralement par l'opinion universelle, ne guérirait-elle point les Etats les plus belliqueux de la tentation de troubler désormais la paix du monde?
Mais s'il était bien avéré qu'aucun Etat, si puissant qu'il soit, ne peut plus troubler la paix sans s'exposer à avoir affaire à une force supérieure à la sienne, qu'arriverait-il? Il se produirait alors dans l'Europe moderne le même phénomène qui s'est produit à la fin du moyen âge au sein des Etats où le souverain est devenu assez fort pour contraindre les seigneurs à observer la paix : les plus puissants et les plus ambitieux ont désarmé, après avoir éprouvé à leurs dépens qu'ils ne pouvaient désormais troubler la paix sans s'exposer à un rude et inévitable châtiment. Chacun se trouvant protégé par une puissance supérieure à celle des plus puissants, les propriétaires de châteaux forts ont comblé leurs fossés pour y semer du blé et les villes se sont débarrassées des enceintes fortifiées dans lesquelles elles étouffaient ou les ont transformées en [438] promenades. De même, les puissances actuellement les plus agressives finiraient par désarmer si, chaque fois qu'elles emploieraient leurs armements à menacer la paix, elles rencontraient des armements plus forts employés à la défendre.
Garantir la paix entre les peuples civilisés et provoquer ainsi le désarmement en rendant les armements inutiles, tel serait le but de l'institution de la Ligue des neutres.
Cette Ligue, les gouvernements ne prendront pas d'eux-mêmes, est-il nécessaire de le dire? l'initiative de l'établir. La pression de l'opinion seule pourra les y déterminer. C'est pourquoi nous nous adressons à l'opinion en fondant une « Association pour l'établissement d'une Ligue des neutres ». Cette Association aura pour objet spécial et limité de provoquer en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse et en Danemark, par des publications et des meetings, une agitation qui exerce sur les gouvernements une pression assez énergique pour les décider à constituer entre eux la Ligue, tout en la laissant ouverte aux autres Etats. Ce but atteint, l'Association se dissoudra, comme s'est dissoute, après l'abolition des lois-céréales, son aînée, la Ligue du free trade,dont elle se propose de compléter l'œuvre de liberté et de paix.
Endnotes
[1]
Effectifs Militaires.
| Temps de paix. | Temps de guerre. | |
| Angleterre | 200,785 | 607,090 (*) |
| Hollande | 51,709 | 131,709 (**) |
| Belgique | 47,290 | 103,860 |
| Danemark | 36,469 | 50,469 |
| Suisse | 117,179 | 201,225 |
| 453,432 | 1,095,223 |
(*) Non compris l'armée de l'Inde.
(**) Non compris l'armée des Indes hollandaises.
VI.16. "La décadence de la guerre" (1898)↩
Source
Gustave de Molinari, La Grandeur et decadence de la guerre (Paris: Guillaumin, 1898).
Selected chapters:
- Chapitre IV: Les intérêts qui déterminent la politique pacifique ou belliqueuse des gouvernements des principaux états modernes, pp. 113-26.
- Chapitre VI: Le bilan des guerres des états modernes. la paix armée, pp. 142-50.
- Chapitre VII: Les chances de paix et les risques de guerre, pp. 151-59.
- Chapitre VIII: Les chances de paix et les risques de guerre (suite), pp. 160-72.
PDF.
Introduction
Ten years after he wrote his appeal for a League of Neutral Powers Molinari returned to the problem of war in yet another book (this is perhaps his 39th book) in which he argued that, if war had been necessary at some time in the past to secure the borders against barbarian invasions, in the present world of international trade and the division of labour war had completely lost its "raison d’être" and had become "decadent".
As he had done before, Molinari examines those interests and "classes" who benefited from war and continued military spending in time of peace (des fonctionnaires militaires et civils), and draws up a balance sheet showing the costs/debts (le passif) and benefits/assets (l’actif) of war and peace. He had first attempted to do this in his essay Les Révolutions et le Despotisme written at the end of 1852 where he argued that economists were "the book keepers of politics". In these chapters he provides a brief survey of the major states of Europe and America and identifies the same groups who benefited from war no matter what particular form of government they lived under. These were the officer class, "les fonctionnaires militaires et civils" (military and civil functionaries of state employees), appointed or elected politicians (which he now describes as "la classe de politiciens" (the class of politicians)), and various banking and industrial interests who benefited from lending money to government to fight wars or making war materiel.
Under the costs of war he includes the "dépenses extraordinaires occasionnées directement" (extraordinary expenses which result directly) such as the loss of life, the destruction of property, and the "l’impôt du sang ou du service obligatoire" (the tax of blood or compulsory service) paid by the young men who have been conscripted into the new mass armies, as well as the "dommages indirects" (indirect damage) such as economic recession, the depreciation of money caused by inflation, and debts which have to be paid off. All these costs he argues are borne by the ordinary citizens and tax payers.
On the other hand, the benefits of war and "the armed peace" (ce régime de paix armée à outrance - this regime of an armed piece pushed to the limit) are the small minority of individuals who enjoy an expanded and protected "débouché assuré’ (guaranteed market) in which they can practice their trade of war and enjoy the prestige and fame of leading the country into battle: the officiers, bureaucratic functionaries, and politicians. Molinari notes in particular "Les banques d’État ou les banques privilégiées" (the State Banks and state privileged banks) which enable the government to fund wars without the need to impose heavy taxation up front, but instead to hide the true cost of war by lending money which may take decades to pay off after the war is over.
Molinari is not optimistic about the chances for preventing another war in the near future and concludes that
| dans tous ces États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, monarchie absolue, constitutionnelle ou république, la direction des affaires publiques demeure entre les mains d’une classe intéressée à la persistance de l’état de guerre et de l’énorme et coûteux appareil de destruction qu’il nécessite. | in all these States, whatever form their government may take, whether an absolute monarchy, a constitutional monarchy, a republic, the control of government affairs remains in the hands of a class which is interested in the continuation of a state of war and the enormous and costly apparatus of destruction which it necessitates. |
Text
[113]
CHAPITRE IV LES INTÉRÊTS QUI DÉTERMINENT LA POLITIQUE PACIFIQUE OU BELLIQUEUSE DES GOUVERNEMENTS DES PRINCIPAUX ÉTATS MODERNES
Aperçu des institutions politiques des États civilisés, au point de vue de la question de la paix ou de la guerre. — Les intérêts prédominants dans l’organisation politique de la Russie. — Qu’ils sont plutôt belliqueux que pacifiques. — L’Allemagne. Causes qui y maintiennent la prépondérance de l’élément militaire : le danger du socialisme, la question de l’Alsace-Lorraine. — L’Angleterre. Circonstances qui ont favorisé le progrès de ses institutions. — Recrudescence du pouvoir de son aristocratie, déterminée par la Révolution française. — Tendances pacifiques de ses classes industrieuses. — Recul qu’elles ont subi depuis la guerre de 1870. — Nécessités de défense qu’impose à l’Angleterre le militarisme continental. — La France et ses révolutions politiques. — Garanties pacifiques résultant de la forme actuelle de son gouvernement. — Les deux catégories de républiques américaines. — Que dans l’ensemble du monde civilisé, la multitude vouée aux industries productives est intéressée à la paix, mais qu’elle ne possède nulle part le pouvoir de la maintenir.
Si nous étudions, au point de vue de la question de la paix ou de la guerre, l’État dont la constitution politique est demeurée la plus approchante de celle des [114] États de l’ancien régime, la Russie, nous y trouverons une « maison » souveraine appuyée sur un corps de fonctionnaires militaires et civils recrutés dans une classe dite « civilisée », relativement peu nombreuse, au-dessous de laquelle gît une multitude de paysans et d’ouvriers, à peine affranchis de la servitude et qui n’exercent aucune influence appréciable. De quoi se compose la classe civilisée, dont l’opinion dirige beaucoup plus que la volonté particulière du souverain, nominalement, « autocrate », la politique du gouvernement ? En grande majorité, de familles qui ont pour débouché les fonctions publiques et vivent aux dépens du budget ; une simple minorité seulement constitue l’état-major des propriétaires et du personnel dirigeant des entreprises financières, industrielles et commerciales. Si l’on n’oublie pas que les opinions sont, sauf de rares exceptions, déterminées par des intérêts particuliers et à courte vue, on s’apercevra que l’état politique actuel de la Russie ne présente que de faibles garanties de paix. En effet, la nombreuse catégorie des fonctionnaires militaires, composée des officiers de tous grades, est immédiatement intéressée à la guerre. La profession des armes qui constitue son industrie et lui fournit ses moyens d’existence ne lui procure, en temps de paix, sauf dans les échelons supérieurs de la hiérarchie, que de minces profits. Ces profits, tant matériels que moraux, [115] la guerre les augmente, en élevant la solde pendant la campagne et en accroissant la chance d’obtenir de l’avancement et des distinctions honorifiques. Les fonctionnaires civils, tout en demeurant assurés de la conservation de leurs appointements, acquièrent sur leurs administrés, dans le tumulte de la guerre, un pouvoir discrétionnaire ; enfin, si la guerre est heureuse, elle leur ouvre un surcroît de débouché dans le pays conquis. Quant à la minorité des propriétaires et du personnel dirigeant des entreprises de production, ses intérêts ne sont pas sensiblement atteints par la guerre, dans un pays comme la Russie, dont le commerce extérieur, enrayé par le protectionnisme, n’a acquis encore qu’un faible développement. La guerre ouvre même à un grand nombre d’industries qui fournissent le matériel et les approvisionnements des armées, sans oublier les capitaux, un débouché supplémentaire ; si elle augmente finalement leurs charges, elle leur procure un surcroit de bénéfices actuels qui exerce, sur l’opinion des industriels et des financiers, une influence belliqueuse bien autrement active que l’action pacifiante de la prévision d’un accroissement de charges futures.
Mais la Russie est restée seule en Europe — car la Turquie est plutôt asiatique, — un État d’ancien régime. La plus grande partie des États de notre continent ont successivement adopté le régime de la [116] monarchie constitutionnelle. Quoique ce régime diffère d’un pays à un autre, il a des caractères essentiels qui lui sont communs. De même que sous l’ancien régime, l’État appartient, au moins nominalement, au chef héréditaire de la maison souveraine. Mais cette propriété qui était entière, illimitée en droit, sinon en fait, à l’époque où Louis XIV pouvait dire « l’État, c’est moi », est actuellement limitée par divers côtés, même dans les États politiquement les plus arriérés, et, dans les autres, elle est subordonnée au Droit supérieur de la nation. En premier lieu, le chef de la maison souveraine a perdu le droit de partager son domaine politique entre ses enfants et même d’en échanger ou d’en céder une partie, à moins d’y être contraint par la force ; il est tenu de le léguer intact à son héritier. En second lieu, il ne puise plus dans les revenus de l’État une part discrétionnaire pour subvenir à ses dépenses et à celles des membres de sa famille : il lui est alloué une liste civile et des dotations qui constituent des appointements fixes comme ceux des autres fonctionnaires publics. Il gouverne l’État avec le concours d’un Parlement, généralement partagé en deux chambres. C’est le Parlement qui vote les lois et le budget des recettes et des dépenses. Déchargé de toute responsabilité dans la gestion intérieure et extérieure des affaires publiques, le chef de l’État, roi ou empereur constitutionnel, [117] ne peut agir que par l’intermédiaire d’un ministère responsable qu’il nomme mais qu’il est tenu de choisir dans la majorité du Parlement. En fait, il possède une part plus ou moins considérable d’influence sur la direction des affaires de l’État, mais cette direction n’appartient pas moins aux membres du Parlement qui représente ou est censé représenter la nation consommatrice des services publics. Tel est, dans ses traits généraux, le mécanisme de la monarchie, dite constitutionnelle.
Mais, dans les monarchies constitutionnelles actuellement existantes, nous trouverons des différences plus ou moins marquées, selon le degré d’importance et d’influence des différentes classes de la population. Dans la plus puissante de toutes, l’Allemagne, c’est une aristocratie qui possède la plus grande partie du sol et qui occupe la presque généralité des emplois supérieurs de la hiérarchie militaire, et la plupart des emplois supérieurs de la hiérarchie civile. À ce double titre, elle jouit d’une influence hors de toute proportion avec son importance numérique. À la vérité, en Allemagne, l’industrie et le commerce bien autrement développés qu’en Russie, ont créé une classe moyenne, nombreuse et éclairée, au-dessous de laquelle les progrès qui ont pour ainsi dire intellectualisé le travail de la grande industrie ont fait apparaître une aristocratie ouvrière, dont l’intelligence [118] commence à s’ouvrir aux questions d’intérêt général. Le suffrage, devenu presque universel, confère à ces deux classes, de plus en plus nombreuses, le pouvoir d’intervenir avec une certaine efficacité dans le gouvernement des États allemands. Malheureusement, l’action pacifique qu’elles pourraient exercer, en cas de conflit avec l’étranger, est amoindrie sinon annulée sous l’influence de deux causes : d’abord, l’antagonisme d’intérêts demeuré jusqu’à présent sans solution entre la classe des entrepreneurs et de leurs commanditaires capitalistes, et la classe ouvrière ; ensuite, la situation critique qu’a faite à l’Allemagne la conquête de l’Alsace-Lorraine. Contre le socialisme qui va se propageant rapidement dans la classe ouvrière, la bourgeoisie industrielle et financière cherche naturellement une sauvegarde dans l’armée dont l’Empereur est le chef et à laquelle l’aristocratie terrienne et militaire fournit sa hiérarchie. Cette même sauvegarde, la bourgeoisie et la classe ouvrière, socialiste ou non, la demandent contre une revanche toujours imminente des vaincus de 1870. De là, la puissance presque dictatoriale de l’Empereur, maitre de la force organisée qui garantit la sécurité de la nation, menacée par l’état de guerre latent entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, d’une part, entre les vainqueurs et les vaincus de 1870 de l’autre. Sans doute, l’Empereur est obligé de compter avec les intérêts [119] pacifiques de la grande majorité de ses sujets, mais, en attendant, peut-on lui refuser les ressources nécessaires pour soutenir une guerre défensive, et même pour prendre l’offensive s’il la juge indispensable à la sécurité future de la nation ?
L’Angleterre nous offre un type différent et presque opposé de monarchie constitutionnelle. Après la conquête normande, la nécessité de concentrer les pouvoirs de la classe en possession de l’État a été moins pressante qu’elle ne l’était dans les États continentaux, le domaine des conquérants étant naturellement protégé par la mer. Le chef héréditaire de l’armée conquérante a été obligé de concéder à ses compagnons et, plus tard, à l’élite influente des classes assujetties, des garanties contre l’abus de son pouvoir souverain. Un parlement issu de l’aristocratie et de la bourgeoisie a été investi du droit de consentir l’impôt et la loi. Cependant, jusque vers le milieu de ce siècle, l’aristocratie en possession de la plus grande partie du sol a partagé, presque seule, avec le chef de la maison souveraine, le gouvernement de l’État. Elle occupait les fonctions supérieures de l’État et de l’Église, et des coutumes plus fortes encore que les lois lui interdisaient la pratique de l’industrie et du commerce. Son intérêt particulier et immédiat, d’accord cette fois, dans quelque mesure, avec l’intérêt général et permanent de la nation, l’excitait à étendre [120] au dehors la domination de celle-ci. Après avoir perdu ses possessions continentales, l’Angleterre chercha une compensation dans la conquête du nouveau monde que les découvertes du XVe et du XVIe siècle avaient ouvert, et elle s’y tailla un immense domaine. Grâce à ces débouchés que la classe gouvernante ouvrait à l’industrie des autres classes de la nation en même temps qu’à la sienne, grâce surtout à la sécurité exceptionnelle que sa situation insulaire procurait à la Grande-Bretagne, les différentes branches de la production y reçurent une vive impulsion dans le cours du XVIIIe siècle. Les classes industrieuses, intéressées à la paix, croissaient en nombre, en richesse et en influence, lorsque la sécurité de l’Angleterre, menacée par la France révolutionnaire et impériale, rendit à l’aristocratie politique et militaire sa prépondérance primitive. Ses hommes d’État réussirent à préserver l’Angleterre de ce péril, en organisant et en soldant des coalitions sous l’effort répété desquelles la puissance guerrière et dominatrice issue de la Révolution finit par succomber. Il sembla alors que la possession du gouvernement de l’Angleterre dût se perpétuer entre les mains de l’aristocratie. Mais le rétablissement de la paix et l’essor prodigieux de l’industrie, transformée par les applications de la science, allaient déplacer bientôt à son détriment l’axe de la puissance politique. Les réformes [121] économiques et en particulier l’abrogation des lois céréales ont porté un coup sensible à son influence, à la fois en diminuant sa richesse et en augmentant celle des classes qui tirent leurs moyens d’existence de l’industrie et du commerce. Ces classes intéressées à la paix ont obtenu une part croissante dans le gouvernement, et l’Angleterre des Cobden et des Bright est devenue le foyer de la propagande pacifique. Toutefois, on peut constater depuis la guerre franco-allemande un revirement manifeste de l’opinion. L’accroissement continu des armements des puissances continentales a obligé l’Angleterre à augmenter ses moyens de défense et, en particulier, sa marine de guerre. C’est qu’il ne dépend pas d’elle de conserver la paix. L’invasion et la mise en coupe réglée de l’Angleterre est demeurée le rêve favori des militaires et des politiciens continentaux. [10] [122] Aucune entreprise ne serait, évidemment, plus productive. Le vainqueur ne pourrait sans doute dépouiller brutalement le vaincu à la manière des Vandales, des Franks et des Visigoths. Mais les procédés de spoliation dont usent actuellement les peuples civilisés diffèrent plutôt par la forme que par le fond de ceux de leurs ancêtres barbares. On ne réduit plus les populations en esclavage, on ne les soumet plus à la corvée, mais on leur impose des indemnités de guerre, qui se résolvent en un prélèvement sur le produit annuel du travail de la nation, c’est-à-dire en une corvée collective perçue au profit du vainqueur. En 1871, les Allemands victorieux ont imposé à la France une indemnité de 5 milliards, et leurs hommes d’État ont regretté plus tard de ne l’avoir pas portée au double. L’Angleterre ne pourrait-elle pas fournir une somme quintuple, décuple même, au moyen de paiements annuellement échelonnés, et pourvoir, dans l’intervalle, à l’entretien d’une [123] armée d’occupation de plusieurs centaines de mille hommes ? On conçoit donc que l’Angleterre s’impose les sacrifices nécessaires, si lourds qu’ils soient, pour se préserver du péril dont pourrait la menacer quelque jour un émule de Guillaume le Bâtard. Mais l’appréhension de ce péril ne doit-elle pas avoir et n’a-t-elle pas en réalité pour effet de restituer à la classe, au sein de laquelle se recrute surtout la hiérarchie politique et militaire, l’influence qu’elle était en train de perdre, et de faire reculer ainsi, dans le principal foyer des intérêts pacifiques, la cause de la paix ?
Les républiques offrent-elles aujourd’hui des garanties de paix plus sûres que les monarchies absolues ou plus ou moins constitutionnelles ? Ces garanties dépendent, nous l’avons dit, moins de la forme du gouvernement, quoique celle-ci ne soit pas dénuée d’importance, que de l’état d’avancement de leur industrie, de la nature et de la composition de la population.
En France, la République, issue de la Révolution, a eu des fortunes diverses, et l’on ne saurait dire qu’elle se soit implantée d’une manière définitive. Elle n’a été d’abord que la dictature d’une minorité aussi brutale qu’ignorante et ne s’est imposée que par la terreur. Une dictature impériale appuyée sur l’armée et acceptée par la nation qu’elle débarrassait du [124] jacobinisme lui a succédé, puis sont venues deux monarchies constitutionnelles, la première amenée par l’invasion, la seconde engendrée par une révolution, et, après un court intermède de république, une nouvelle dictature impériale, puis finalement, à la suite d’une invasion et d’une révolution, une troisième république. Sous ces divers régimes, les intérêts pacifiques l’ont certainement emporté en nombre et en valeur sur les intérêts belliqueux et ils l’emportent aujourd’hui plus que jamais. Mais, sous la dictature jacobine et sous la dictature impériale, ils étaient condamnés au silence. Sous les deux monarchies constitutionnelles, ils ont pu faire prévaloir leur influence, grâce à l’épuisement de la nation dans la première, à la crainte de la révolution dans la seconde, et de même sous la République intérimaire de 1848, grâce à la terreur inspirée par le spectre rouge. Mais les intérêts de la hiérarchie militaire, complice du coup d’état du 2 décembre, ont pris leur revanche sous le second empire et provoqué la série de guerres qui ont abouti au désastre de 1870, en dépit de la volonté pacifique de la masse de la nation, — volonté formellement attestée par le plébiscite de mai. Si les influences pacifiques ont repris le dessus, si la paix a été maintenue depuis plus d’un quart de siècle, malgré les excitations du chauvinisme, c’est bien moins, il faut le dire, à l’intervention de l’opinion qu’à l’intérêt [125] particulier du parti républicain, en possession du gouvernement, que la France en est redevable. Les politiciens qui constituent les fractions diverses de ce parti n’ignorent pas, en effet, qu’une guerre entrainerait inévitablement sa déchéance. Si elle était malheureuse, elle engendrerait une Commune démagogique et socialiste, bientôt suivie d’une dictature réactionnaire : si elle était couronnée de succès, elle porterait au pouvoir, par une acclamation irrésistible, le général victorieux. La République offre donc, dans l’état actuel des choses, des garanties spéciales de paix. Malheureusement, nul ne pourrait dire si la République résistera longtemps encore la politique de gaspillage financier et aux pratiques relâchées de ses politiciens.
En Amérique, où existent deux catégories de républiques, celles qui appartiennent à des peuples de race latine, avec un fond de race indigène, et celles qui ont été instituées par la race anglo-saxonne avec un contingent d’irlandais, d’allemands, de français, d’italiens, de nègres etc. ; la classe dirigeante des premières constitue une oligarchie politicienne et militaire, partagée en partis concurrents qui se disputent, le plus souvent les armes à la main, l’exploitation du budget et qui demeurent continuellement sur le pied de guerre, sans trouver aucun contrepoids dans les intérêts pacifiques d’une masse [126] ignorante et passive. Les secondes sont composées en immense majorité d’une population industrieuse, dont les intérêts sont essentiellement pacifiques, mais qui abandonne la direction des affaires publiques à des politiciens, à l’industrie desquels la guerre ne cause aucun dommage et dont elle accroit l’importance. En toute occasion, ils affichent, sous prétexte de patriotisme, une raideur hostile dans leurs relations avec les puissances étrangères ; après avoir déchaîné la guerre civile, dans un intérêt d’ambition, n’ont-ils pas, récemment encore, manifesté leur répugnance à se dessaisir du pouvoir de déchaîner la guerre étrangère, en repoussant le traité d’arbitrage qui leur était proposé par l’Angleterre ?
En dernière analyse, dans l’ensemble du monde civilisé, les intérêts pacifiques l’emportent en nombre et en valeur sur ceux auxquels l’état de guerre et la guerre elle-même sont demeurés profitables, mais la direction des affaires des États continue, en dépit de toutes les révolutions et réformes politiques, à appartenir à une classe dont les intérêts professionnels n’ont cessé d’être, à cet égard, en opposition immédiate avec ceux de la multitude qu’elle gouverne. Nous trouverons dans cet état de choses, la cause réelle des guerres qui ont, plus que jamais, désolé le monde depuis que la guerre a perdu sa raison d’être.
[127]
CHAPITRE V LES GUERRES DES ÉTATS CIVILISÉS DEPUIS LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Récapitulation des mobiles déterminants des guerres de l’ancien régime. — Pourquoi la guerre a subsisté sous le nouveau, quoiqu’elle ait perdu sa raison d’être. — L’opposition immédiate d’intérêts entre les gouvernants et les gouvernés. — Que cette opposition était atténuée par la perpétuité de possession du gouvernement de l’État. — Qu’elle a cessé de l’être depuis que cette possession est devenue précaire. — Causes déterminantes des guerres de la Révolution française. — Nécessités que subissaient les partis qui se succédaient au pouvoir. — Caractère économique des guerres de l’Empire. — Que les unes et les autres étaient suscitées par des intérêts particuliers et immédiats en opposition avec l’intérêt général et permanent de la nation. — Qu’il en a été ainsi de toutes les guerres qui se sont succédé depuis le commencement du siècle. — La guerre d’Orient. — La guerre d’Italie. — La guerre franco-allemande. — La guerre de la sécession américaine. — Que ces guerres ont été engagées sans que les nations qui en ont payé les frais eussent été consultées et sans qu’elles eussent le pouvoir de les empêcher.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les guerres avaient été entreprises dans l’intérêt de la maison souveraine et de la classe gouvernante, noblesse et clergé, sur laquelle elle s’appuyait. Les chefs des maisons [128] souveraines entreprenaient des guerres pour étendre leur domaine et augmenter ainsi les profits que rapportait, à eux et à leurs auxiliaires, fonctionnaires militaires et civils, l’industrie du gouvernement. Quoique ces profits eussent diminué depuis que la conquête n’entraînait plus la confiscation des biens des vaincus et leur réduction en esclavage, ils dépassaient encore ceux de la plupart des autres industries. Aux profits matériels s’ajoutaient encore les profits moraux consistant dans la gloire qu’acquérait le vainqueur et dans l’accroissement de prestige et d’influence que lui valait la victoire. À la vérité, la guerre devenue plus coûteuse, à mesure qu’elle employait un matériel plus perfectionné et que les ressources des nations, en s’accroissant grâce aux progrès de leur industrie, fournissaient aux gouvernements les moyens de grossir davantage leurs armements, la guerre, disons-nous, infligeait aux nations des charges de plus en plus lourdes, mais ces charges ne pesaient que pour une faible part sur la classe dont l’opinion décidait de la paix ou de la guerre. C’était la multitude vouée aux travaux de l’agriculture, de l’industrie et du commerce qui en supportait presque exclusivement le poids, et cette multitude n’avait aucune part ou, comme en Angleterre, elle n’avait qu’une part restreinte et presque infinitésimale dans le gouvernement de l’État. On pouvait croire que [129] cette situation changerait du tout au tout lorsque la nation s’attribuerait la propriété de l’établissement politique, après en avoir dépouillé la maison souveraine, comme il arriva en France. Mais si une nation peut comme une « maison » ou une oligarchie posséder un État, elle ne peut le gérer elle-même. Elle est obligée d’en confier la gestion à des mandataires. Ces mandataires, elle possède le droit de les choisir, mais, en fait, ce choix ne tarde pas à appartenir à des associations ou partis qui se constituent pour s’emparer du gouvernement, en raison des profits et avantages qu’il est dans sa nature de procurer. Nous avons remarqué, et nous ne saurions trop insister sur ce point, qu’un personnel gouvernant, en sa qualité de producteur de services publics, se trouve en opposition immédiate d’intérêts avec la nation consommatrice de ces services, comme tout autre producteur vis-à-vis de ses consommateurs. Sous l’ancien régime, cette opposition immédiate d’intérêts se trouvait toutefois atténuée par la perpétuité de possession de la maison souveraine, intéressée par là même d’une manière permanente à la conservation et à la prospérité de la nation. Un parti qui n’a que la possession temporaire et précaire du gouvernement n’est pas retenu par cette considération d’avenir, et on peut en dire autant des dynasties qu’une révolution implante dans un pays, qu’une autre révolution [130] peut déraciner, et qui se préoccupent, avant tout, de se constituer un fonds d’assurance contre le risque de dépossession. Un parti est d’ailleurs obligé, pour se maintenir au pouvoir ou pour y arriver, d’augmenter son effectif, et par conséquent d’agrandir le débouché des emplois et des faveurs qui servent à le rétribuer. Si donc la nation n’a point l’intelligence et l’énergie nécessaires pour défendre ses intérêts de consommatrice des services publics, elle aura beau être devenue propriétaire de l’État, elle sera plus mal et plus chèrement servie qu’elle ne l’était lorsque l’État appartenait à une maison souveraine, intéressée en raison de sa perpétuité de possession à ne point ruiner sa clientèle. Cette considération ne doit point être perdue de vue dans l’examen de la conduite des partis, lorsqu’il s’agit d’engager une guerre ou de la poursuivre. Nous apercevons visiblement son influence dans la série de guerres qu’a ouverte la révolution de 1789.
Lorsque le mouvement réformateur, préparé par les philosophes et les économistes, eut abouti en France à la convocation de l’Assemblée constituante, on vit se créer aussitôt dans cette Assemblée des partis qui étaient l’expression des intérêts divers ou immédiatement opposés qui se partageaient la nation. C’étaient, d’un côté, la noblesse et le haut clergé qui voulaient défendre leur situation privilégiée, de l’autre [131] la bourgeoisie ou le Tiers-État qui aspirait à les supplanter et qui promettait à la multitude la diminution des charges dont elle était accablée. Chacun de ces partis ne manquait pas d’identifier ses intérêts avec ceux de la nation, et recourait aux moyens qu’il croyait les plus prompts et les plus sûrs pour les faire triompher : les uns réclamaient le secours des maisons souveraines et des classes dirigeantes de l’étranger, les autres enrôlaient la populace des villes et des campagnes, au moyen d’une solde et de l’appât du pillage. Dans ce conflit violent et désordonné que la faiblesse et l’inexpérience du détenteur du pouvoir était impuissant à maîtriser, la guerre apparut d’abord comme un dérivatif, ensuite comme une nécessité économique. L’industrie paralysée par la crise révolutionnaire laissait sans travail et sans ressources la multitude des ouvriers et des employés. Ils allèrent remplir les cadres des armées, transformées en ateliers nationaux, et entretenues au moyen des assignats et des réquisitions. Mais les assignats ne tardèrent pas à se déprécier et les réquisitions à s’épuiser, L’invasion de la Belgique, de la Hollande, de l’Allemagne, de l’Italie, fournit au dehors les ressources qui commençaient à manquer au dedans pour l’entretien de cette foule de « sans travail [12] ». Grâce aux [132] aptitudes guerrières de la nation, grâce encore à l’abondance extraordinaire d’hommes que la crise d’abord, le service forcé substitué à l’enrôlement volontaire ensuite, mettaient au service des chefs et qui leur permettait de faire bon marché de la vie des soldats, les armées de la révolution remportèrent des succès et enrichirent le pays de dépouilles qui valurent à la guerre un renouveau de popularité.
Sous la direction du chef génial et peu scrupuleux qui confisqua la République à son profit, la guerre redevint même pour la France ce qu’elle avait été jadis : la plus productive des industries. Les pays conquis fournissaient des couronnes à la famille du dictateur impérial, des dotations à ses généraux et à ses familiers, des emplois largement rétribués au nombreux personnel de politiciens que lui avait légués la Révolution et qu’il avait transformés en fonctionnaires ; enfin des subsistances et des indemnités qui subvenaient, pour une grosse part, à l’entretien des armées. La conscription seule causait à la nation un dommage sensible, en épuisant son sang le plus vigoureux, mais ce dommage ne devait être ressenti que plus tard, par l’affaiblissement des générations futures. Dans le présent, au contraire, la guerre, en ouvrant un débouché supplémentaire à la multitude, avait pour effet d’élever le niveau général des salaires. [133] Sans doute, sous un régime de paix, le développement régulier et normal de l’industrie eût élargi encore davantage le débouché du travail, mais la foule grisée par la victoire ne s’en avisait point et la guerre conserva sa popularité aussi longtemps que le succès couronna les entreprises du maitre souverain de l’État.
Mais à quel mobile obéissaient les fauteurs des guerres de la Révolution et de l’Empire ? Sous la République, c’était l’intérêt immédiat de la domination de leur parti : sous l’Empire, c’était à l’intérêt de l’Empereur et de la dynastie qu’il prétendait fonder. Sans doute, chacun croyait volontiers que cet intérêt particulier de parti ou de dynastie était conforme à l’intérêt général et permanent de la nation. Les Jacobins étaient convaincus qu’ils sauvaient la France en recourant à la Terreur pour se maintenir au pouvoir, et Napoléon était sans aucun doute imbu de la même croyance en revenant de l’île d’Elbe. C’est l’excuse de tous les hommes qui s’efforcent per fas et nefas de conquérir ou de conserver la possession d’un État, et quelquefois elle est sincère ; mais il est rare que les deux intérêts s’accordent, et que l’intérêt particulier et actuel qui dicte les actes d’un parti ou d’un homme ne se satisfasse point aux dépens de l’intérêt général et permanent que ce parti ou cet homme prétend servir.
[134]
Il en a été ainsi dans la période des luttes civiles et des guerres étrangères qui a commencé par la dépossession et a fini par la restauration de la monarchie française. Sous la République, les membres des partis qui ont occupé le pouvoir et leurs soutiens se sont élevés à un rang et ont réalisé une fortune auxquels ils n’auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas déchainé la révolution et la guerre. Sous l’Empire, la guerre a créé et doté une nouvelle aristocratie de fonctionnaires militaires et civils, avec l’annexe de la classe médiocrement intéressante des acheteurs des biens nationaux. Mais qu’y a gagné la nation ? Il est hors de doute que la réforme de l’ancien régime se fût opérée plus largement et plus sûrement si la paix avait été conservée à l’intérieur et au dehors et que la France n’eût pas été affaiblie par les effroyables saignées de la Terreur et de la Conscription, par les frais et dommages des deux invasions et de la lourde indemnité qu’elle a dû payer à ses vainqueurs. Si la Révolution et la guerre ont été conformes à l’intérêt immédiat et particulier du personnel gouvernant de la République et de l’Empire, elles ont été contraires à l’intérêt général et permanent de la France.
On peut en dire autant de toutes les guerres qui ont succédé à celle-là, en Europe et dans les autres parties du monde civilisé. Elles ont toutes été déterminées par l’intérêt particulier et immédiat du chef [135] et de la classe dirigeante de l’État, auquel elles donnaient satisfaction quand elles étaient couronnées de succès : en revanche, elles ont été invariablement contraires à l’intérêt général et permanent de la nation, dont elles diminuaient les ressources et augmentaient les charges, sans lui procurer la compensation qu’elles lui offraient auparavant par l’accroissement général de la sécurité.
Après un intervalle de paix de près de quarante ans, interrompu seulement par des explosions révolutionnaires, l’ère des grandes guerres s’est ouverte de nouveau : guerre d’Orient, guerre d’Italie, guerre austro-allemande, guerre franco-allemande guerre turco-russe, etc., en Europe, et, dans le Nouveau Monde, guerre de la sécession américaine, sans compter les luttes intestines des États de l’Amérique du Sud. Toutes ces guerres ont été engagées par des chefs d’État appuyés sur les classes gouvernantes, en vue d’un intérêt particulier et immédiat de domination, qu’ils se plaisaient, à la vérité, à déclarer conforme à l’intérêt général et permanent des nations mais si les gouvernements vainqueurs ont tiré quelque avantage de ces guerres, il n’en a pas été ainsi des peuples qui en ont payé les frais. Aucune ne leur a rapporté, à beaucoup près, ce qu’elle leur a coûté. Si la guerre d’Orient, engagée sous un prétexte de protection des Lieux-Saints, a eu pour résultat de [136] consolider l’Empire issu du coup d’État en augmentant son prestige, et de procurer de l’avancement et des honneurs à la hiérarchie militaire, qu’a-t-elle rapporté à la nation française en échange du sang et de l’argent qu’elle lui a coûtés ? A-t-elle été plus avantageuse à la nation anglaise ? A-t-elle enrayé les progrès de la puissance de la Russie et ceux de la décadence de la Turquie ? La guerre d’Italie, fomentée par des conspirateurs, des aventuriers et des politiciens retors, avec le concours d’un rêveur couronné, a eu, en revanche, pour résultat l’unification politique des différents États de l’Italie. En France, cette guerre a valu à l’Empire un regain de popularité, mais la création d’une puissance militaire, gouvernée par des politiciens qui n’ont pas tardé à attester que la reconnaissance n’est pas une vertu politique, a-t-elle augmenté de ce côté la sécurité de la nation française ? En Italie, l’unification a été immédiatement profitable à la classe moyenne, qu’elle a élevée à la condition de classe gouvernante, en mettant à sa disposition la hiérarchie des emplois civils et militaires, avec la machine à fabriquer les lois, machine dont elle s’est hâtée de se servir pour protéger une poignée d’industriels et de capitalistes aux dépens des consommateurs. Mais quel profit a retiré la multitude des gouvernés de cette exaltation et de cet enrichissement d’une classe gouvernante ? Les frais de gouvernement [137] ont quadruplé, la dette a décuplé, et nul ne pourrait dire que les services publics se soient améliorés dans une proportion équivalente. La corruption a fleuri dans le Parlement autant qu’elle le faisait auparavant dans les Cours, la justice est à la merci des politiciens, la loi du domicile forcé leur permet de traiter leurs concurrents radicaux et socialistes comme ils étaient traités eux-mêmes par les tyrans de l’ancien régime, et la misère plus noire que jamais chasse de l’Italie une multitude croissante d’émigrants faméliques. Ce qui peut excuser les fauteurs de cette guerre c’est que le plus grand nombre d’entre eux étaient sincèrement convaincus que tout en faisant leurs affaires ils faisaient celles de la nation.
Cette excuse, les fauteurs de la guerre franco-allemande ne peuvent pas l’invoquer. Cette guerre, engagée sous un prétexte futile et presque ridicule, a eu pour unique mobile l’intérêt particulier et immédiat de l’établissement impérial à son déclin, et pour objectif, la conquête des provinces rhénanes. Si elle avait réussi, elle aurait certainement consolidé l’Empire, mais, dans cette éventualité même, qu’aurait gagné la nation française en échange des sacrifices de sang et d’argent que la guerre lui aurait coûtés ? Les profits que l’annexion d’une ou de deux provinces [138] auraient rapportés à la hiérarchie gouvernante, civile et militaire, auraient-ils compensé les charges accrues par les risques d’une revanche de l’Allemagne ? L’entreprise a échoué et la nation a supporté d’abord les frais énormes de la guerre et de l’indemnité qu’elle a été condamnée à payer, ensuite, ceux de la réfection et de l’augmentation démesurée de son appareil de guerre. La seule compensation de ce désastre a été le remplacement du personnel gouvernant de l’Empire par un personnel issu du parti républicain ; mais l’avenir seul pourra attester si cette compensation a été suffisante. Quant à la nation allemande, quel profit a-t-elle retiré de sa victoire ? L’indemnité de cinq milliards payée par la France a servi à fournir des récompenses à la hiérarchie militaire et à développer l’appareil de guerre ; les deux provinces conquises ont ouvert un débouché supplémentaire à la classe des fonctionnaires, mais les charges de la nation ont été constamment accrues par suite de l’exhaussement du risque de guerre, suscité par la crainte toujours subsistante d’une revanche du vaincu. Les bénéfices de la classe en possession du gouvernement en Allemagne, de celle que la révolution du 4 septembre a intronisée en France, ont-ils compensé les pertes subies par les deux nations ?
[139]
En Amérique, la guerre de la sécession a-t-elle produit des résultats plus avantageux pour la nation ? Elle a eu pour conséquence l’émancipation des nègres, mais elle les a placés dans une condition matériellement et moralement pire que celle où ils se trouvaient sous le régime de l’esclavage, et ceux-là même qui les ont émancipés les menacent aujourd’hui d’une expulsion en masse. [16] Elle a ruiné les États du Sud et propagé dans toute l’Union un système de corruption politique et économique sans précédent dans le monde, en y implantant le politicianisme sous sa pire forme et le protectionnisme dans ses pires excès.
Au moins toutes ces guerres dans lesquelles les nations ont été engagées depuis un siècle et qui leur ont coûté si cher, les ont-elles voulues ? Nous venons de voir qu’elles ont été déclarées sans que les multitudes gouvernées qui devaient y contribuer de leur sang et de leur argent aient été consultées, sans qu’elles aient eu, même dans les pays où la nation a été proclamée souveraine, la possibilité de les empêcher. Comme sous l’ancien régime, le pouvoir de faire la guerre appartient au chef et à l’état-major de la classe gouvernante et quoiqu’ils ne manquent jamais d’invoquer pour l’engager l’intérêt et l’honneur de la nation, c’est à leur propre intérêt [140] qu’ils obéissent. Si cet intérêt considéré dans le temps s’accorde avec celui de la nation, il lui est actuellement opposé, et c’est cet intérêt immédiat et égoïste qui sert de règle habituelle à leur conduite. Si la nation française eût été consultée par ses gouvernants, aurait-elle fait la guerre à la Prusse pour empêcher un Hohenzollern de devenir roi d’Espagne ? La guerre de la sécession a-t-elle été davantage voulue par la nation américaine ? Nul n’ignore que si les politiciens du Sud ont pris l’initiative de la sécession, c’est parce qu’ils avaient perdu l’espoir de gouverner l’Union entière et que si les politiciens du Nord ont voulu la maintenir, c’est parce qu’ils étaient assurés d’y obtenir désormais la suprématie. Mais la masse de la nation aurait-elle des deux parts engagé la lutte si elle eût été consultée ? Nul ne pourrait l’affirmer. En tout cas, l’évènement a prouvé que la séparation eût été moins nuisible que la guerre et ses conséquences pour les États du Nord, et le maintien de l’Union pour les États du Sud.
Jadis la guerre était indirectement utile à toutes les classes qui composaient les nations, aussi bien aux classes assujetties qu’aux oligarchies possédantes et gouvernantes des États, en ce qu’elle était le véhicule nécessaire des progrès de l’industrie destructive et par conséquent le seul moyen d’assurer leur sécurité contre les invasions des peuples barbares. [141] Cette sécurité acquise, elles n’ont plus aucun profit à retirer de la guerre ; elles en supportent, sans aucune compensation appréciable, les charges et les dommages.
Dans quelle situation les guerres inutiles que nous venons de passer en revue les ont-elles placées ? Quel est le montant des charges qu’elles subissent et de la prime qu’elles paient pour s’assurer contre le risque que font peser sur elles les intérêts prépondérants qui perpétuent dans le monde civilisé l’état de guerre, contrairement aux intérêts et à la volonté pacifiques des masses industrieuses ? Comment enfin ceux-ci pourront-ils prévaloir sur ceux-là, voilà ce qu’il nous reste à rechercher.
[142]
CHAPITRE VI LE BILAN DES GUERRES DES ÉTATS MODERNES. LA PAIX ARMÉE
Le passif de l’état de guerre. — Difficulté de faire le compte des frais et dommages causés par la guerre. — Les pertes et les dépenses directes. — Les dommages indirects. — Accroissement progressif des dettes et des budgets des États civilisés depuis le commencement du siècle. — L’augmentation des effectifs militaires. — L’impôt du sang et la charge qu’il impose. — L’actif de l’état de guerre. — Débouché qu’il procure au personnel de la hiérarchie militaire et civile. — Que la multitude gouvernée n’en tire aucun profit appréciable. — Élévation progressive du risque de guerre et augmentation correspondante de l’appareil d’assurance de la paix armée. — Causes qui contribuent à aggraver ce risque. — La politique coloniale. — La politique protectionniste. — L’absorption des petits États par les grands. — Que le risque de guerre et les armements qu’il suscite sont portés actuellement à leur maximum.
Des statisticiens ont entrepris de faire le compte de ce qu’ont coûté, en hommes et en capitaux, les guerres qui ont désolé le monde civilisé depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces estimations sont toutefois inévitablement incomplètes, car elles ne peuvent s’appliquer qu’aux pertes d’hommes et aux dépenses extraordinaires [143] occasionnées directement par la guerre. Il est impossible d’évaluer les dommages indirects que cause la crise industrielle, commerciale et financière qu’elle engendre, et qui va s’étendant et s’aggravant à mesure que se multiplient les relations internationales. On ne peut pas davantage faire le compte de ce que coûtent aux nations les fluctuations et la dépréciation finale du papier-monnaie, auquel les gouvernements recourent d’habitude dans les moments où ils ne pourraient se procurer, par la voie ordinaire des emprunts, les ressources nécessaires pour continuer la guerre. Mais si toutes les évaluations sont, en cette matière, forcement inexactes et incomplètes, on peut cependant, en examinant la situation des budgets et des dettes publiques des États civilisés, se faire une idée du fardeau dont les guerres modernes ont chargé les nations. Dans l’ensemble des budgets des l’États de l’Europe, les dépenses militaires et navales et le service de la dette absorbent plus des deux tiers des recettes, et le total des dettes accumulées depuis un siècle et contractées presque exclusivement pour subvenir à des dépenses de guerre dépasse 130 milliards. Pour subvenir à cet énorme accroissement de charges, les gouvernements ont été obliges de multiplier les impôts, et ils ont eu [144] principalement recours aux impôts indirects, plus faciles à faire accepter parce qu’on ne les voit pas. Pour ne parler que de la France, cette catégorie d’impôts qui ne fournissait qu’environ un tiers du total des recettes sous l’Ancien régime en fournit aujourd’hui les deux tiers. Sans doute, les progrès extraordinaires de l’industrie ont augmenté dans des proportions considérables la richesse des nations ; elles peuvent supporter aujourd’hui des charges qui les auraient écrasées, il y a un siècle ; mais il n’est pas moins vrai qu’au lieu de s’abaisser, le tantième que les gouvernements prélèvent sur les revenus des nations va s’élevant tous les jours, et qu’il tend de plus en plus à absorber, comme sous le régime de l’esclavage, le produit net de leur industrie. La charge de l’impôt du sang ou du service obligatoire s’est élevée dans une proportion plus forte encore. Ceci à une époque où le péril des invasions de barbares qui pouvait seul justifier les sacrifices imposés aux peuples pour assurer leur sécurité a complètement cessé d’exister.
Encore faut-il ajouter que le montant de ces impôts, destinés à assurer une sécurité qui n’est plus menacée, ne constitue qu’une partie de la charge et des dommages qu’ils infligent. La perception des droits de douane et des autres taxes indirectes nécessite des restrictions et des gênes qui entravent le développement [145] de la production. Quant à l’impôt du sang, outre la perte et les dommages qu’il cause directement en prélevant sur le travail une dîme stérile, il atteint la vitalité même des nations en enlevant à la reproduction ses agents les plus vigoureux, dans l’âge où ils y sont particulièrement aptes, pour les livrer aux périls et à la corruption de la prostitution la plus basse.
En présence de cet énorme passif d’impôts, de dettes et de dommages de tous genres, dans lequel nous n’avons pas compris les souffrances physiques et morales qu’il est dans la nature de la guerre de causer, qu’avons-nous à placer à l’actif de la continuation de l’état de guerre ? Quels bénéfices les nations civilisées en ont-elles retirés depuis un siècle ?
Ici apparait l’opposition immédiate d’intérêts qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Si l’on considère l’intérêt particulier et actuel des classes gouvernantes des États civilisés, on devra reconnaitre que ces classes ont bénéficié de la continuation de l’état de guerre, — quoique l’établissement d’un régime de paix leur eût été, selon toute apparence, encore plus avantageuse. Il a fourni un débouché assuré sinon lucratif, — au moins dans les emplois inférieurs de la hiérarchie, — aux familles dans lesquelles se recrute, de génération en génération, la [146] plus grande partie, on pourrait dire même la presque totalité des fonctionnaires militaires et civils. Il a augmenté le prestige des souverains et des politiciens qui ont conservé le pouvoir illimité de disposer des ressources des contribuables et même d’hypothéquer leurs ressources futures pour entreprendre des guerres en opposition manifeste avec l’intérêt général et permanent de la nation. Nous venons de donner un court aperçu de ce qu’elles ont coûté à la communauté civilisée. Quels progrès matériels et moraux ont-elles suscités ? Le compte en serait facile à faire, et ce compte se solderait presque invariablement par un déficit supplémentaire. Dans toute l’Europe, les guerres de la Révolution et de l’Empire ont retardé la réforme de l’ancien régime, en investissant les chefs d’état du pouvoir dictatorial que la guerre nécessite et en leur permettant d’ajourner les réformes demandées par leurs peuples. C’est seulement après un long intervalle de paix que l’opinion est devenue assez forte pour les obliger à compter avec elle. Si ces guerres et celles qui les ont suivies ont favorisé un certain nombre d’intérêts, plus ou moins recommandables, elles ont retardé le développement général de la richesse et de la civilisation.
Enfin, en sus des frais qu’elles ont coûtés et des dommages qu’elles ont causés pendant leur durée, ces guerres ont rendu la paix de plus en plus précaire ; [147] en d’autres termes, elles ont élevé le taux du risque de guerre.
« Le risque de guerre, remarquions-nous dans un de nos précédents ouvrages [18], surélevé par la Révolution et l’Empire, redescendit et tomba même à son point le plus bas de 1815 à 1830. La révolution de 1830 le fit remonter de plusieurs points, sous l’influence de la crainte que les passions et les intérêts belliqueux ne vinssent à reprendre le dessus en France, mais la politique résolument pacifique du roi Louis-Philippe le fit ensuite redescendre de nouveau. On pourrait, au surplus, dresser un tableau très approximativement exact de ses fluctuations en notant les fluctuations en sens contraire de la Bourse, à chacun de ses mouvements. Il s’est relevé brusquement en 1848, mais c’est du rétablissement de l’Empire que date son mouvement presque constamment ascensionnel. Depuis la guerre de 1870, ce mouvement de hausse s’est encore accentué quoiqu’on puisse signaler de nombreuses fluctuations dans son développement.
« À mesure que le risque de guerre s’est élevé, l’appareil nécessaire pour y pourvoir a reçu un accroissement correspondant : la servitude militaire, d’abord limitée, en fait, à la classe inférieure de la population, a été étendue à toutes les classes, chaque pays [148] s’est entouré d’une ceinture de fortifications, comme au Moyen âge chaque seigneurie, et les budgets de la paix armée se sont élevés à un taux que n’atteignaient pas auparavant les budgets mêmes de la guerre ».
Cette élévation progressive du risque de guerre n’est pas toutefois causée uniquement par la guerre elle-même.
Parmi les causes qui l’ont suscitée, il faut signaler, en premier lieu, la multiplication des occasions de conflits depuis que le développement extraordinaire des moyens de communication et des relations commerciales a rapproché les peuples et internationalisé les intérêts, depuis encore que les gouvernements des États civilisés ont entrepris de soumettre à leur domination les régions du globe occupées par les peuples inférieurs ou moins avancés. Ces conflits sont fomentés tantôt par la jalousie qu’inspire aux nations les moins capables de tirer parti de leurs acquisitions territoriales, le succès de celles qui se montrent plus aptes à mener à bien leurs entreprises de colonisation, tantôt par l’esprit de monopole qui suscite les relèvements et les guerres de tarifs, en vouant à la ruine les populations de plus en plus nombreuses auxquelles les débouchés extérieurs fournissent leurs moyens d’existence. Ces confiscations de clientèle que votent tous les jours des politiciens aux gages d’intérêts influents, entretiennent [149] entre les peuples les passions haineuses que les guerres du passé avaient créées, en envenimant les difficultés qui naissent de leur rapprochement et de la multiplicité croissante de leurs rapports, et elles fournissent ainsi aux chefs d’États ou aux partis politiques qui croient tirer profit d’une guerre, l’occasion de la provoquer en invoquant l’intérêt ou l’honneur national. En second lieu, l’absorption, opérée à la suite des guerres de la Révolution et de l’Empire, d’une foule de petits États qui servaient, en quelque sorte, de tampons entre les grandes puissances, a eu pour effet, sinon de rendre les guerres plus fréquentes, au moins d’en aggraver les risques et les conséquences. L’Europe est actuellement partagée entre six grandes puissances, dont aucune n’est séparée d’une rivale, et chez la plupart desquelles les intérêts attachés à la conservation de l’état de guerre l’emportent en influence sinon en volume sur les intérêts pacifiques. Comment le contact immédiat d’intérêts belliqueux n’aurait-il pas élevé le risque de guerre et déterminé l’accroissement de l’appareil d’assurance nécessaire pour le couvrir ? Chaque fois qu’une de ces grandes puissances a développé ou perfectionné ses armements, les autres se sont crues obligées de suivre son exemple. Chaque fois encore qu’une guerre a éclaté, en aggravant le risque de nouvelles ruptures de la paix par les passions haineuses et les [150] désirs de revendication ou de revanche qu’il est dans la nature de la guerre de susciter, l’appareil d’assurance de ce risque a été renforcé. Les choses en sont venues au point, depuis que la guerre franco-allemande en a élevé le taux au maximum, que les armements ont fini par être portés aussi au maximum que comportent les ressources de chaque puissance, en personnel et en matériel, et les possibilités de l’impôt. Les petits États, même ceux que leur neutralité semblait devoir protéger, ont cru, non sans raison peut-être, qu’ils ne pouvaient se dispenser d’imiter les grands. C’est ainsi que l’Europe est devenue une vaste place de guerre, hérissée de fortifications formidables, et qu’elle tient sur pied, en temps de paix, des armées dix fois plus nombreuses que celles qui suffisaient jadis à la préserver des invasions des Barbares.
Sous ce régime de paix armée à outrance, il serait, comme on va le voir, téméraire d’affirmer que les chances de paix doivent l’emporter sur les risques de guerre.
[151]
CHAPITRE VII LES CHANCES DE PAIX ET LES RISQUES DE GUERRE
État actuel de l’Europe. — Les grandes puissances et les États secondaires. — Les États neutres. — Le Concert Européen. — Que le pouvoir de décider de la paix ou de la guerre est concentré entre les mains des grandes puissances. — Leur partage actuel eu deux groupes. — Les chances de paix sous ce régime. — Chances provenant du risque de dépossession du gouvernement à la suite d’une guerre malheureuse, — de la situation financière des États, — de l’accroissement des frais de la guerre et des charges qu’il nécessite. — Insuffisance de ces freins pour arrêter la poussée des intérêts belliqueux. — Facilités que le développement du crédit apporte à l’action de ces intérêts. — Les banques transformées en trésors de guerre. — Le papier-monnaie. — Le service militaire obligatoire. — Appréciation du pouvoir de résistance des intérêts pacifiques. — Que ces intérêts ne se sont pas accrus dans une proportion supérieure à elle des intérêts belliqueux. — En revanche, que les dommages causés par la guerre aux classes industrieuses se sont accrus en raison des progrès de l’industrie.
Si l’on veut se rendre compte des chances de paix et des risques de guerre au moment où nous sommes, il faut examiner la situation politique des États qui ont le pouvoir de déchaîner la guerre et évaluer l’influence qu’y possèdent sur la direction des affaires [152] publiques les intérêts pacifiques et les intérêts belliqueux.
En Europe, les médiatisations, les annexions et les unifications ont successivement réduit, comme dans les autres branches de l’activité humaine, le nombre des petits établissements politiques au profit des grands. On en comptait plusieurs centaines au siècle dernier, il en reste aujourd’hui à peine une vingtaine. Ce sont, en premier lieu, les grandes puissances, la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie, la Russie et l’Angleterre, en second lieu, les États moyens ou petits la Scandinavie (Suède et Norvège, politiquement unies pour leurs relations extérieures), le Danemark, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l’Espagne, le Portugal, les États Balkaniques, la Turquie et la Grèce ; parmi ces puissances secondaires la Belgique et la Suisse forment une catégorie particulière d’États neutres auxquels il est interdit de faire la guerre, sauf dans le cas où leur neutralité viendrait à être violée. En fait le maintien de la paix de l’Europe dépend exclusivement des grandes puissances. Elles constituent ce que l’on a nommé le concert Européen, et chaque fois qu’un différend surgit entre deux États secondaires, elles s’efforcent de se mettre d’accord pour le résoudre et au besoin pour imposer la solution qu’elles jugent équitable et utile. Parfois, elles laissent s’engager la lutte, comme il est [153] arrivé récemment dans le cas de guerre gréco-turque, sauf à intervenir pour empêcher le vainqueur d’abuser de sa victoire et pour régler les conditions de la paix. Ce droit d’intervention qu’elles se sont attribué dans l’intérêt de la communauté européenne, — car il ne peut avoir un autre fondement, — elles l’ont même exercé à l’égard de l’une d’elles, à l’issue de la guerre turco-russe en révisant et en modifiant les conditions du traité de San-Stefano. Elles auraient pu réviser de même le traité de Francfort, et il est permis de regretter qu’elles ne s’en soient point avisées.
Ces grandes puissances qui décident souverainement de la paix ou de la guerre en Europe sont actuellement partagées en deux groupes : l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, formant la triple alliance, la France et la Russie constituant la double alliance, l’Angleterre demeurant isolée. Ces deux alliances ont été conclues uniquement dans l’intérêt de la défense commune des États qui y sont compris, s’il faut ajouter foi aux déclarations formelles de leurs auteurs, et l’isolement de l’Angleterre attesterait au besoin, le caractère essentiellement pacifique de sa politique extérieure. Ajoutons qu’en toute occasion les souverains et les hommes d’État qui dirigent les affaires des grandes puissances ont affirmé solennellement leur ferme volonté de conserver la paix. Personne n’ayant l’intention de la [154] rompre, il semblerait qu’elle fût assurée à jamais, et l’on pourrait se demander pourquoi ces mêmes chefs d’État s’appliquent constamment à renforcer des appareils de guerre dont aucun d’entre eux n’a l’intention de se servir, pourquoi ils font plier leurs peuples sous le fardeau des dépenses militaires en invoquant la nécessité de se défendre puisque personne ne veut attaquer.
Mais les déclarations pacifiques, si solennelles et même si sincères qu’elles soient, n’offrent que de faibles garanties de paix. N’est-ce pas après que ces paroles rassurantes : l’Empire, c’est la paix, eurent été prononcées, que s’est ouverte la série des guerres du second Empire ? C’est l’examen de la puissance comparée des intérêts belliqueux et des intérêts pacifiques qui peut seul permettre d’apprécier, d’une manière approximative, les chances de paix et les risques de guerre.
Les chances de paix résident d’abord dans l’intérêt que les gouvernements eux-mêmes peuvent avoir à la maintenir. Le premier de ces intérêts est celui de leur propre conservation. Si une guerre heureuse a pour effet d’augmenter la puissance et le prestige d’un gouvernement, en revanche une guerre malheureuse peut, comme il est arrivé en France, provoquer une révolution qui l’emporte. Ce risque de dépossession est toutefois fort inégal. En Russie, en Allemagne, [155] en Autriche-Hongrie, en Angleterre, où les maisons souveraines ont une existence séculaire et où des intérêts considérables sont attachés à leur conservation, elles semblent n’avoir rien à redouter, actuellement du moins, de l’issue malheureuse d’une guerre. Il en est autrement en Italie, où la monarchie unitaire de fraîche date n’est pas solidement enracinée, et en France, où la république l’est encore moins. Une garantie plus générale de paix semblerait devoir résider dans la situation financière des États, dans le poids de leurs dettes et l’énormité des dépenses qu’implique l’augmentation du prix de revient de la guerre, à une époque où les armées se composent non plus de milliers mais de millions d’hommes et où elles mettent en œuvre un matériel dont le coût s’est augmenté avec la puissance. Mais l’expérience démontre que les charges éventuelles qu’une guerre peut ajouter à celles que la nation supporte déjà n’exercent qu’une faible influence sur les décisions de son gouvernement. Ce supplément de charges n’atteint pas, d’une manière immédiate et sensible, les gouvernants eux-mêmes ; il n’a pas pour effet de diminuer la liste civile des souverains et les appointements des fonctionnaires civils et militaires. S’il a pour résultat inévitable d’affaiblir et d’appauvrir la nation qui leur fournit leurs moyens d’existence, et de compromettre ainsi l’avenir de leur propre descendance, [156] ce résultat ne se produit qu’à la longue ; et quand même ils en auraient la vague prévision, suffirait-elle pour arrêter la poussée des intérêts et des passions qui les entraînent à la guerre ? L’insuffisance des ressources dont les gouvernements peuvent disposer actuellement pour la guerre serait, sans aucun doute, plus efficace. Mais la guerre trouve aujourd’hui, dans le développement des institutions de crédit et dans le régime monétaire des peuples civilisés, des ressources extraordinaires et toujours prêtes qui lui faisaient défaut autrefois. Avant de s’engager dans l’aventure d’une guerre, les souverains du passé étaient obligés d’accumuler non sans peine un « trésor » et de demander à leurs sujets un supplément de subsides ; ils ne pouvaient que rarement et à des conditions onéreuses recourir à l’emprunt. Il n’en est plus ainsi à présent. Les gouvernements n’ont plus besoin d’accumuler des trésors de guerre. Seul, le gouvernement allemand a eu recours à cette pratique surannée, en mettant en réserve dans la forteresse de Spandau une somme de 120 millions de marks, prise sur l’indemnité de 5 milliards payée par la France. Les banques d’État ou les banques privilégiées mettent au service de la guerre des sommes bien autrement considérables. Au lieu de conserver seulement en métal la somme reconnue nécessaire, soit le tiers au plus du montant de leur [157] circulation fiduciaire, ces banques, que l’État dirige ou privilégie et qu’il pourvoit d’un gouverneur à sa dévotion, entassent, sous la pression avouée ou non du gouvernement, une encaisse métallique presque égale au montant de leurs billets, en renchérissant ainsi, sans nécessité, les frais et le prix de leurs services de prêt ou d’escompte. En cas de guerre, les gouvernements ne se font aucun scrupule de mettre la main sur ces trésors qu’ils n’ont pas pris la peine d’accumuler eux-mêmes, en autorisant les banques à suspendre leurs paiements en espèces. Ils peuvent encore, après avoir épuisé ces stocks métalliques, recourir au papier-monnaie, soit en l’émettant directement, soit en obligeant les banques à multiplier leurs émissions. Sans doute, ces émissions surabondantes ont pour effet de déprécier la circulation, mais cette dépréciation ne devient sensible qu’après que le papier a expulsé entièrement la monnaie métallique, et, en attendant, elles peuvent fournir d’abord une somme égale au montant de la monnaie expulsée, ensuite une autre somme égale à la différence du pouvoir d’acquisition du papier déprécié et de la monnaie métallique qu’il remplace. Enfin, les gouvernements dont le crédit est le plus solide peuvent encore continuer, pendant la guerre, à contracter des [158] emprunts, sauf à les payer plus cher que d’habitude. Grâce à ces divers expédients, ils peuvent se dispenser de recourir à des augmentations d’impôts qui ne manqueraient pas de soulever la résistance énergique de l’opinion et ne fourniraient d’ailleurs qu’un supplément de recettes d’une insuffisance presque ridicule. Les grandes puissances européennes trouveraient ainsi, en cas de guerre, des ressources immédiates qu’il est permis d’évaluer, sans exagération, à une cinquantaine de milliards. D’un autre côté, le service obligatoire universalisé leur fournirait sur l’heure dix ou douze millions de soldats. Ce n’est donc pas l’insuffisance des ressources en argent et en hommes qui pourrait empêcher les intérêts belliqueux de transformer l’Europe en un vaste champ de bataille.
Cela étant, il s’agit de savoir quelle résistance ils pourraient rencontrer dans les intérêts pacifiques. Les éléments dont il faut tenir compte pour calculer la puissance possible de cette résistance sont d’abord le volume des intérêts pacifiques, ensuite le montant des dommages que la guerre peut leur causer, et par conséquent l’intensité et l’étendue du mouvement d’opinion que l’appréhension de ce dommage peut provoquer.
Le développement extraordinaire de la production depuis un siècle a déterminé un accroissement [159] correspondant de la population qui vit du produit de ses capitaux et de son travail. Mais si cette population, qui est appelée à supporter, de génération en génération, le fardeau de la guerre, s’est considérablement accrue, on peut en dire autant de celle des fonctionnaires militaires et civils, à laquelle la guerre n’inflige aucun dommage et procure au contraire un supplément de profits, de pouvoir et d’influence. On ne saurait affirmer que la proportion qui existait sous l’ancien régime entre ces deux catégories sociales se soit sensiblement modifiée. Si elle a subi un changement, c’est plutôt à l’avantage de la population qui vit du budget que de celle qui l’alimente.
Mais si l’on ne peut pas dire que les intérêts pacifiques se soient accrus dans une proportion plus forte que les intérêts belliqueux, nous allons voir que la guerre leur est infiniment plus dommageable qu’elle ne l’était avant l’extension moderne des débouchés de la production industrielle et agricole et la transformation progressive de son matériel, en un mot qu’elle est devenue de plus en plus incompatible avec les conditions actuelles d’existence des classes industrieuses.
[160]
CHAPITRE VIII LES CHANCES DE PAIX ET LES RISQUES DE GUERRE (SUITE)
Que les dommages causés par la guerre, après avoir été simplement locaux, sont devenus généraux. — Perturbations que cause la guerre dans le marché internationalisé des produits, du capital et du travail. — Qu’elle est devenue une nuisance universelle, mais que cette nuisance est inégale, ainsi que la force de résistance des intérêts pacifiques. — Que la paix trouve son appui le plus solide dans la classe capitaliste et, en particulier, chez les détenteurs des valeurs mobilières. — Que le partage des grandes puissances en deux groupes n’est qu’une garantie incertaine de la paix de l’Europe. — Que la paix n’est pas mieux assurée en Amérique et dans le reste du monde. — Que les classes intéressées à la permanence de la paix n’ont pas encore acquis la puissance nécessaire pour mettre fin à l’état de guerre.
Depuis l’avènement de la grande industrie et surtout depuis la transformation progressive qui s’est opérée dans les moyens de transport maritimes et terrestres, les pertes et dommages causés par la guerre se sont étendus, de proche en proche, dans toutes les régions du monde civilisé, mises en [161] communication et solidarisées par les liens multiples de l’échange. De locaux, ils sont devenus généraux.
Quel était le caractère de l’industrie jusqu’à l’époque récente où la transformation de son outillage a augmenté dans des proportions extraordinaires sa puissance productive ? C’était, sauf de rares exceptions, la localisation la plus étroite. L’insuffisance et la cherté des moyens de communication, jointes au défaut de sécurité, limitaient les débouchés. Les denrées alimentaires, qui constituaient et n’ont pas cessé de constituer la grande masse des articles nécessaires à la satisfaction des besoins de l’homme, étaient généralement consommés dans la localité même où ils étaient produits. Le commerce extérieur des nations les plus industrieuses ne comprenait guère que des articles de seconde nécessité ou de luxe, à la portée seulement des classes aisées. Il y a deux siècles à peine, le commerce de l’ensemble des peuples de l’Europe n’atteignait pas en valeur celui d’un des plus petits États d’aujourd’hui — la Belgique, la Hollande ou la Suisse. Que résultait-il de cette localisation de la production et de la consommation, lorsqu’une guerre venait à éclater ? C’est que les nations qui n’y étaient point engagées, n’ayant avec les belligérants que des rapports d’intérêts de peu d’importance, ne s’en ressentaient que faiblement. Même dans les pays en état de guerre, les localités seules [162] qui étaient le théâtre de la lutte soufraient sensiblement de l’interruption de leurs relations commerciales et de leurs moyens d’approvisionnement. Quand les armées de Louis XIV ravageaient le Palatinat, le reste de l’Allemagne ne subissait point un dommage appréciable. Il n’en est plus ainsi depuis que toutes les nations sont rattachées les unes aux autres par un réseau de plus en plus serré d’échanges et de prêts. C’est pendant le cours de ce siècle et, en particulier, depuis que l’application de la vapeur et de l’électricité aux moyens de communication a si prodigieusement élargi les débouchés de l’industrie, et malgré les obstacles artificiels que le protectionnisme a substitués à l’obstacle naturel des distances, que s’est opérée cette internationalisation des intérêts. Au moment où nous sommes, le commerce extérieur de l’ensemble des nations civilisées dépasse 80 milliards et le montant des prêts effectués par les nations productrices de capitaux, l’Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, etc., à celles chez lesquelles cette production demeure insuffisante, la Russie, l’Espagne, l’Italie, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie, l’Afrique, l’Australie, n’est probablement pas moindre ; enfin, une circulation de travail a commencé de même à s’établir tant entre les différents pays de l’Europe qu’entre l’Europe et les autres parties du globe. En temps de paix, cette internationalisation [163] des produits, des capitaux et du travail suit son cours régulier et toutes les nations en recueillent les bénéfices. Quelle énorme économie de travail et de peine l’Angleterre, par exemple, ne réalise-t-elle pas dans l’acquisition des matériaux de la vie, en achetant plus de la moitié de la quantité de ses subsistances aux nations qui les produisent au meilleur marché ! Et ces nations auxquelles elle fournit en échange des articles qui leur coûteraient plus de travail si elles les produisaient elles-mêmes, ne trouvent-elles pas dans cet échange un profit analogue ? De même, les pays où la production des capitaux est abondante, où ils se louent à bon marché, ne bénéficient-ils pas de la différence des deux taux en les portant dans ceux où ils sont rares et chers, tandis que les nations emprunteuses peuvent fonder et alimenter à moins de frais des entreprises productives et en augmenter le nombre. La même observation s’applique aux importations et aux exportations du travail. Pour les importateurs de produits, de capitaux et de travail, aussi bien que pour les exportateurs, il y a augmentation des facilités d’acquisition des matériaux de la vie, accroissement de la richesse et du bien-être.
Mais qu’une guerre vienne à éclater sur un point quelconque de ce marché internationalisé, aussitôt une perturbation inévitable se produit et se propage [164] dans toute son étendue. Les relations des pays en état de guerre avec les autres se ralentissent ou même subissent une interruption totale, au détriment des consommateurs aussi bien que des producteurs. Pendant toute la guerre de la Sécession, le coton des États-Unis a cessé d’arriver en Europe. Faute de cette matière première indispensable, un grand nombre de manufactures de cotonnades ont été réduites à chômer ; des milliers d’ouvriers ont été privés de leurs moyens d’existence en Angleterre et dans les autres parties de l’Europe. Et cette crise de l’industrie cotonnière s’est aussitôt répercutée à des degrés divers sur la généralité des branches de la production. Car le revenu, partant le pouvoir d’achat des entrepreneurs, des capitalistes et des ouvriers qui y étaient engagés, ayant baissé, ils ont dû réduire leur demande de tous les articles qu’ils avaient l’habitude de consommer, et il en est résulté de proche en proche une diminution successive du pouvoir d’achat de l’ensemble des producteurs. Dans le marché des capitaux, la guerre engendre une perturbation analogue à celle qui bouleverse le marché des produits. Toutes les industries dont le débouché se resserre, en demandent moins ou deviennent moins capables de les rétribuer. À la vérité, la guerre en fait une consommation extraordinaire, et cet accroissement de la demande a pour effet d’en élever le prix de location. [165] Mais ces capitaux que la guerre absorbe, à la différence des autres industries, elle ne les reproduit point, elle les détruit. S’ils avaient continué à être employés dans les industries productives, ils auraient contribué à l’accroissement général de la richesse. Employés à la guerre, ils disparaissent ; mais ce qui ne disparait point, c’est la nécessité d’en payer l’intérêt avec l’amortissement, et par conséquent de prélever sur la génération actuelle et les générations futures, jusqu’à ce qu’ils soient remboursés, des impôts qui non seulement dévorent une partie des revenus des contribuables, mais ralentissent le développement des entreprises productives dans lesquelles ils les puisent. Enfin, la guerre occasionne les mêmes perturbations et les mêmes déperditions dans le marché du travail. Elle enlève aux champs et aux ateliers des multitudes qui sont employées à détruire au lieu de produire ; d’ou une double perte : celle de la richesse qu’ils détruisent et celle de la richesse qu’ils manquent à produire.
La guerre inflige ainsi aux nations, maintenant solidarisées par l’échange, des dommages d’autant plus considérables que les liens qui les rattachent sont plus nombreux et plus étroits. Si l’on songe que les nations les plus avancées en industrie, l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse, dépendent de l’étranger pour les moyens de subsistance d’une [166] portion tous les jours croissante de leur population (en Angleterre et en Belgique, c’est déjà près d’un tiers), on s’expliquera qu’une guerre, en jetant la perturbation sur le marché universalisé de la production, mette en péril l’existence de plusieurs millions de familles. Bref, dans l’ancien état de l’industrie, la guerre n’était qu’une nuisance locale, dans l’état nouveau, elle est devenue une nuisance universelle.
Cependant, ce serait une illusion de croire que cette nuisance qu’il est dans la nature de la guerre de causer puisse opposer un frein suffisamment efficace aux passions et aux intérêts belliqueux. Il faut remarquer d’abord que cette nuisance est essentiellement inégale d’un pays à un autre, qu’elle est beaucoup moins grave et moins sensible dans les pays où le commerce est encore, en grande partie, localisé, que dans ceux où il s’est internationalisé davantage. Il faut remarquer ensuite que la puissance de réaction des intérêts pacifiques et l’influence de l’opinion suscitée par ces intérêts ne sont pas moins inégales ; enfin que les classes les plus intéressées au maintien de la paix n’ont qu’une notion vague et obscure des maux que la guerre peut leur causer et qu’elles sont, de plus, particulièrement sujettes à céder à l’entraînement des excitations belliqueuses.
Si nous cherchons quelle est la classe de la population qui a le mieux conscience de son intérêt en cette [167] matière, nous reconnaitrons que c’est incontestablement la classe capitaliste, et surtout la portion de cette classe dont la fortune consiste principalement en valeurs mobilières. Cela tient à ce que le dommage que la guerre lui inflige ne se fait pas attendre : il se manifeste même avant que la guerre ait éclaté par la chute rapide et presque foudroyante des fonds d’États et des valeurs industrielles. Les fauteurs de la guerre, patriotes ou chauvins, se plaisent, en cette occasion, à dénoncer l’égoïsme et le manque de patriotisme des capitalistes. Pendant la Révolution, ils avaient fait fermer la Bourse, et sous le premier Empire, Napoléon essayait mais en vain d’empêcher la baisse que provoquait sa politique, en employant les fonds du Trésor à des achats de rente et en menaçant les baissiers de sa colère. L’opinion de la multitude qui vit de son travail quotidien a, sur la politique des gouvernements, une influence bien moindre que celle de la classe dite capitaliste, et d’ailleurs, quoiqu’elle soit la plus intéressée au maintien de la paix, elle est facilement accessible aux excitations du chauvinisme. Toutefois, les ouvriers intelligents commencent à comprendre que les travailleurs ont plus encore que les capitalistes besoin de la paix, et au milieu de l’ivraie des idées fausses et subversives que le socialisme propage, l’opposition à la politique de guerre s’est glissée comme un épi de bon grain.
[168]
Enfin, le service militaire universalisé, en soumettant les classes aisées et influentes à la plus lourde et à la plus cruelle des servitudes, est certainement devenu un facteur important et actif de la politique de paix. Mais l’intérêt de la multitude qui fournit l’impôt du sang n’est-il pas balancé et au-delà, dans les pays tels que l’Allemagne et la Russie, par celui de la classe bien autrement influente à laquelle la hiérarchie militaire fournit son principal débouché ?
Si donc les intérêts pacifiques et l’opinion qu’ils déterminent l’emportent en Angleterre par exemple sur les intérêts belliqueux, on ne pourrait affirmer qu’il en soit de même sur le continent. On se plait à considérer le partage des grandes puissances continentales en deux groupes à peu près égaux en forces comme une garantie de paix. Est-ce une garantie bien sûre ? En tout cas, ce partage implique le maintien du lourd régime de la paix armée. Même en admettant que la question de l’Alsace-Lorraine vint à être résolue, ce serait une illusion de croire que cette solution, si désirable qu’elle fût, eût pour conséquence le désarmement. D’autres causes de conflits existent et il en surgit tous les jours de nouvelles : questions d’Orient et d’extrême Orient, questions coloniales, etc., etc. L’affaiblissement ou la rupture de l’une des deux alliances concurrentes ne peut-elle même avoir pour [169] résultat d’exciter l’autre à user de ses forces pour déchainer la guerre ?
En Amérique, la paix est-elle mieux assurée ? Dans les États de l’Amérique du Sud, le gouvernement est entre les mains d’une oligarchie issue des conquistadores qui en accapare les fonctions civiles et militaires, qui est, par conséquent, intéressée à les multiplier et à laquelle une guerre heureuse procure un accroissement de débouché. Les populations qu’elle gouverne, composées d’Indiens, de nègres, de sangs mêlés et d’émigrants ne possèdent point une influence qui puisse balancer la sienne. Cette situation pourra, sans doute, se modifier à la longue par le développement de l’immigration et des industries productives. Mais, en attendant, la balance des influences penche visiblement du côté du maintien de l’état de guerre.
Aux États-Unis, les intérêts pacifiques sembleraient, en revanche, devoir posséder une influence tout à fait prépondérante. Cependant, dans l’affaire de la sécession, les intérêts protectionnistes du Nord ont apporté à la guerre un concours décisif, en faisant cause commune avec ceux des politiciens menacés comme eux d’un amoindrissement de leur débouché par la séparation des États du Sud. S’ils n’ont pas réussi encore à augmenter les effectifs de l’armée de terre et de mer, ils ont néanmoins porté les dépenses de guerre à un taux presque aussi élevé que celui des [170] États les plus militarisés de l’Europe, en faisant allouer aux vétérans plus ou moins authentiques de la guerre de la Sécession des pensions dont le montant, au lieu de s’abaisser, s’élève à mesure que la mort éclaircit les rangs de la génération qui a pris part à cette guerre. C’est que ces pensions sont devenues une simple monnaie électorale. Vis-à-vis des puissances de l’Europe et en particulier de l’Angleterre, les politiciens américains se montrent, en toute occasion, rogues et agressifs : il n’a pas dépendu d’eux que les différends suscités par le Venezuela et les pêcheries de Behring n’aboutissent à une rupture.
En ce moment même, ils s’efforcent de créer un mouvement d’opinion en faveur de l’établissement d’un système de fortifications des côtes et d’une augmentation de la marine militaire. Quoique la classe des politiciens ne forme qu’une infime minorité, la puissante organisation des partis entre lesquels elle se partage et qui ont, malgré leur lutte pour la conquête du pouvoir, un intérêt commun, celui de grossir le budget dont ils vivent, cette classe, disons-nous, supplée à son petit nombre par son activité dénuée de scrupules, et elle trouve dans les intérêts protectionnistes des auxiliaires zélés chaque fois que naît un différend entre l’Union et un État dont les produits font concurrence à ceux des industries indigènes. Pas [171] plus que la situation politique de l’Europe, celle de l’Amérique ne présente donc de solides garanties de paix.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire la situation et les tendances actuelles des États de l’Asie et de l’Afrique. La Russie, au nord de l’Asie, l’Angleterre et la France au midi, possèdent une puissance absolument prépondérante, qui va sans cesse s’étendant aux dépens des États indigènes et dont l’Allemagne s’apprête maintenant à prendre sa part. La conquête tartare au XVIIe siècle et récemment les guerres qui ont ouvert les ports chinois et la guerre sino-japonaise ont attesté le peu de résistance que la Chine pourrait opposer à une domination européenne. Le Japon lui-même n’est pas de taille à faire obstacle à l’extension inévitable de cette domination sur le continent asiatique. En Afrique, les races indigènes sont moins encore qu’en Asie capables de résister à l’invasion de la race blanche, mais, de même qu’en Asie, le partage de leurs immenses territoires demeure une cause permanente de conflits entre les puissances européennes.
Quelle conclusion faut-il tirer de cet aperçu de la situation politique des États civilisés au point de vue de la question de la paix ou de la guerre ? C’est que, dans tous ces États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, monarchie absolue, constitutionnelle [172] ou république, la direction des affaires publiques demeure entre les mains d’une classe intéressée à la persistance de l’état de guerre et de l’énorme et coûteux appareil de destruction qu’il nécessite ; c’est que la multitude intéressée à l’avènement d’un régime d’assurance permanente de la paix ne possède pas encore l’influence nécessaire pour déterminer les gouvernements à l’instituer.
Cependant l’état de guerre affecte d’autres formes encore que celle du militarisme. Il apparait, avec le même mobile intéressé sinon avec les mêmes procédés, dans le protectionnisme, l’étatisme et le socialisme. Une courte analyse de ces méthodes d’invasion du bien d’autrui nous en fournira la preuve.
Endnotes
[10] Signalons à ce propos le projet d’invasion de l’Angleterre, récemment publié, du capitaine Von Luttwitz, du grand état-major allemand :
« Il faut tout préparer avec méthode, dit-il, et agir sans hésitation. La mobilisation des troupes à débarquer et de la flotte seront poussées le plus activement possible. Aujourd’hui, les vents ne sont plus les meilleures sentinelles de la Grande-Bretagne. La flotte allemande devra profiter de la prépondérance momentanée que lui procurera la dispersion des forces navales anglaises sur toutes les mers du globe. Courant au-devant de la flotte ennemie, elle s’efforcera de lui infliger une défaite décisive, ouvrant aux transports de troupes la route de l’invasion. »
L’auteur de ce projet invite ensuite, gracieusement, la France à participer à la curée :
« Il serait à désirer, dans l’intérêt de la civilisation, que la France ne se laissât pas leurrer par l’Angleterre, sa véritable ennemie héréditaire, et qu’elle poursuivit une politique d’expansion coloniale plutôt qu’un re-maniement à son profit de la carte d’Europe. L’Allemagne ne peut se soustraire aux devoirs que la guerre de 1870-1871 lui a imposés. Elle est, du reste, en droit d’espérer qu’une guerre continentale lui sera épargnée d’ici longtemps. Sa population dépasse de 14 millions celle de la France. Le temps fera son œuvre, et les intérêts naturels des deux pays les amèneront à une alliance contre l’Anglais. »
[12] Voir l’Évolution politique et la Révolution, chap. IX. La Révolution française.
[16] Voir le Journal des Économistes, n° du 15 avril 1897. Le Negro problem aux États-Unis.
[18] Comment se résoudra la question sociale, p.192.
VI.17. "La constitution libre" (1899)↩
Source
From Gustave de Molinari, Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future (Paris: Guillaumin, 1899).
- Chaps. III, IV, V. "La constitution libre," pp. 69-93.
- And chap. VI "La sujétion et la souveraineté individuelle," pp. 94-100
English translation: Gustave de Molinari, The Society of Tomorrow: A Forecast of its Political and Economic Organization, ed. Hodgson Pratt and Frederic Passy, trans. P.H. Lee Warner (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1904).
Introduction
This late summary of Molinari’s views is interesting as it was only the second book of his translated into English in his lifetime. (The other was Religion (1892, 1894)) [13] This was a pity as he had backtracked a bit from his earlier radicalism concerning private insurance companies providing police and other security services, as well as from his later idea of "la liberté de gouvernement". Nevertheless, his views as expressed in this book were far more radical than those of his colleagues even if they were not as radical as the views he expressed when he was 30 years old.
Where he changed his mind was the idea of there being a few things which were a "collective good" which private businesses or individuals could not provide and which had to be provided by the community. He now thought that the provision of security was such a good which was "naturellement collectif" (naturally collective). Where he differed from other people who thought of police and defence as "public goods" which could only be provided by the state was his belief that smaller political communities had the right to secede from the central state if they did not like the "service" they were getting, that private real estate companies could build private cities where all these public goods would be provided as part of "buying into" the community, and by introducing competitive market forces into the provision of police and defence by "contracting out" to private firms and not providing them as a protected and subsidised government monopoly. If he no longer talked so much about individual "consommateurs de la sécurité" (consumers of security) and the entrepreneurs who would provide them with the service, he still quoted the three conditions for the competitive provision of security which he had set out in his path-breaking 1849 article. What had changed was that he now referred to "la nation" or its "délégués" (delegates) or "des mandataires" (representatives) as the ones entering into contracts with private security providers, not individual consumers of security services.
Endnotes
[13] Molinari, Gustave de. Religion, translated from the second (enlarged) edition with the author’s sanction by Walter K. Firminger (London: Swan Sonnenschein, 1894).
Text
[69]
CHAPITRE III. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles.
La souveraineté politique découlait, comme nous l'avons vu, du droit de propriété. La société guerrière qui avait fondé un établissement politique en s'emparant d'un territoire et en assujettissant sa population était propriétaire des hommes et des choses, et pouvait en user à son gré. Les nécessités de la conservation de l'État, sous la pression de la concurrence politique et guerrière, ayant fait concentrer l'exercice de la souveraineté entre les mains d'un chef héréditaire, il put dire comme Louis XIV: l'État, c'est moi. S'il octroyait à ses sujets certains droits, tels que le droit de travailler, d'échanger, de léguer et certaines garanties de propriété et de liberté, c'était de sa libre volonté et il était toujours le maître de les leur reprendre. Il se réservait, en tout cas, un droit illimité de [70] réquisition sur leur vie, leur propriété et leur liberté, sauf à n'en user qu'autant qu'il le jugeait nécessaire pour le salut ou simplement pour le bien de l'État. Ce droit illimité, afférent à la souveraineté, a passé à la nation dans les États modernes et elle le délègue à son gouvernement. Il avait sa raison d'être dans le risque illimité de destruction ou de dépossession auquel la concurrence politique et guerrière exposait la société propriétaire d'un État, et cette raison d'être, quoique singulièrement affaiblie depuis que la conquête n'implique plus qu'un simple changement de sujétion et un dommage plutôt moral que matériel, subsiste néanmoins et continuera de subsister aussi longtemps que les nations seront obligées de recourir à la force pour se préserver d'une agression ou faire prévaloir, dans leurs différends, ce qu'elles considèrent comme leur droit.
Mais supposons que leur sécurité et leurs droits cessent d'être menacés, supposons qu'une assurance collective vienne à remplacer pour les nations l'assurance isolée comme elle l'a remplacée pour les individus, aussitôt la situation change, le risque illimité qu'implique la guerre disparaît et avec lui [71] la nécessité de conférer au gouvernement chargé de garantir la sécurité de la nation un droit illimité de réquisition sur la vie, la propriété et la liberté individuelles. Dans ce nouvel état des choses, les charges et les servitudes que le service de la sécurité nationale impose à l'individu n'ont plus rien d'incertain et d'aléatoire; on peut les évaluer et les fixer car ce service se réduit:
1° A participer à l'assurance de la communauté civilisée contre les agressions des hordes barbares ou des États appartenant à une civilisation inférieure et demeurés en dehors de l'assurance collective. Or, la prépondérance que les nations civilisées ont acquise, grâce à l'accroissement extraordinaire de leur puissance destructive et productive, est telle que le risque qu'elles peuvent courir de ce chef est devenu insignifiant et qu'il suffirait d'une centaine de mille hommes pour préserver de toute atteinte les frontières du monde civilisé;
2°A maintenir sur pied, au service de la collectivité, un contingent de forces suffisant pour assurer l'exécution des verdicts de la justice internationale, dans le cas où l'État contre lequel la sentence aurait été rendue refuserait de s'y soumettre et [72] recourrait à la force pour l'aire prévaloir ce qu'il croirait être son droit. Mais une association ayant pour objet d'assurer collectivement la sécurité des nations exigerait de chacune la renonciation au droit de juger dans sa propre cause et d'exécuter ses verdicts par la force. Cette renonciation est déjà imposée à tous les membres de la nation comme une condition sine qua non de la garantie de leur sécurité. Le plus grand nombre d'entre eux s'y soumettent : seuls, les malfaiteurs et les duellistes s'y dérobent, les premiers, parce qu'ils obéissent aveuglément à leur cupidité ou à des passions qui ne peuvent se satisfaire qu'aux dépens d'autrui, les seconds parce qu'ils estiment que la justice collective ne leur fournit pas une réparation adaptée à certaines offenses. Sans reconnaître à ceux-ci un droit qui serait la négation du sien, le pouvoir chargé de la sécurité publique en tolère généralement l'exercice. Il se livre, en revanche, à la poursuite incessante des malfaiteurs, et il assure, à la vérité d'une manière imparfaite, la vie et la propriété individuelles au moyen d'une police relativement peu nombreuse. Des États civilisés ne pourraient être assimilés à des malfaiteurs, mais peut-être des [73] instincts belliqueux et quelque fausse notion de l'honneur national les pousseraient-ils à se comporter comme des duellistes. Dans ce cas, il y aurait lieu de recourir à la force collective pour leur remettre en mémoire leur renonciation au droit de se faire justice eux-mêmes, et les obliger à conserver la paix. Toutefois, la puissance de la collectivité dépassant celle de ses membres les plus puissants, ce recours cesserait bientôt d'être nécessaire. Alors chacun des États associés pourrait congédier le contingent de forces destiné à assurer l'exécution des arrêts dela justice internationale, la puissance morale de l'opinion suffirait. La garantie de la sécurité extérieure et de la paix intérieure de la communauté civilisée n'exigerait plus qu'une contribution minime et toujours décroissante, imposée aux membres des États associés.
Or, du moment où l'intérêt supérieur de la conservation de la nation cesserait de commander l'attribution au gouvernement d'un droit illimité sur la vie, la propriété et la liberté individuelles, il deviendrait possible d'établir une limite exacte et infranchissable entre les droits du gouvernement et ceux de l'individu. Cette limite serait déterminée [74] et marquée, comme nous l'allons voir, par la nature et les conditions nécessaires de la production des services publics.
Quels sont ces services? Qu'est-ce qui les différencie de ceux que l'individu demande à l'industrie privée?
Les services qui constituent les attributions naturelles des gouvernements sont de deux sortes: généraux et locaux. Les premiers sont du ressort du gouvernement proprement dit, les seconds appartiennent aux administrations provinciales et communales. Le service principal qui incombe au gouvernement consiste dans l'assurance de la sécurité extérieure et intérieure de la nation et de l'individu. Ce qui caractérise ce service et le différencie de ceux de l'industrie privée, c'est qu'il est naturellement collectif. Un appareil de guerre assure toute la population d'un pays contre le péril d'une invasion étrangère, et un poste de police garantit la sécurité de tous les habitants d'un quartier, comme une digue protège contre l'inondation tous les riverains d'un fleuve. Cela étant, il est juste et nécessaire que les consommateurs de ces services naturellement collectifs en paient, [75] collectivement aussi, les frais, en proportion de la valeur des biens garantis. Si l'un d'entre eux se refusait à fournir sa quote-part de ces frais, ce serait aux dépens des autres assurés dont la contribution devrait être augmentée d'autant. Mais nous n'avons pas besoin de dire que ce caractère de collectivité n'appartient qu'à un petit nombre d'articles. Tandis qu'un poste de police procure de la sécurité à l'ensemble des habitants d'un quartier, il ne suffit pas d'établir une boulangerie pour apaiser leur faim. C'est que le pain, comme les autres aliments, les vêtements, etc., etc., est un article de consommation naturellement individuelle, et la sécurité un article de consommation naturellement collective.
En supposant donc que la sécurité extérieure des nations civilisées soit assurée par leurs forces associées au lieu de l'être par leurs forces isolées, les fonctions naturelles et essentielles de leurs gouvernements se réduiront: 1° à participer à la défense commune de l'association et au maintien de la paix entre ses membres; 2° à pourvoir à l'assurance de la sécurité intérieure et aux autres services naturellement collectifs.
[76]
CHAPITRE IV. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles (suite).
Comment et à quelles conditions les gouvernements pourront-ils pourvoir au maintien de la paix internationale et à la production de la sécurité intérieure, voilà ce qu'il s'agit maintenant d'examiner.
Du moment où les nations seront libérées de la servitude que leur impose encore l'état de guerre, où leurs parties constitutives pourront se séparer pour former de nouveaux groupements ou constituer des États autonomes, les risques de révolution et de guerre civile qui naissent d'une union forcée d'éléments hétérogènes et incompatibles disparaîtront, et avec eux les motifs ou les prétextes d'un appel à une intervention étrangère. L'association des États n'aura donc à s'occuper que des dissentiments et des procès qui pourront survenir entre [77] ses membres, à en saisir les tribunaux institués ad hoc, lesquels appliqueront à la solution de ces différends et de ces procès les mêmes principes de droit qu'ils appliquent à ceux qui se produisent entre les individus, enfin à sanctionner au besoin par la force les arrêts de la justice internationale. Ainsi se trouvera assurée, avec un maximum d'efficacité et un minimum de frais, la sécurité extérieure des nations associées.
La production de la sécurité intérieure implique des conditions analogues et qui dérivent de la nature de ce service.
Nous les avons ainsi résumées dans une de nos premières publications:
« Pour être en état de garantir aux consommateurs pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, et, en cas de dommage, de leur distribuer une somme proportionnée à la perte subie, il faut:
« 1° Que le producteur établisse certaines peines contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs des propriétés, et que les consommateurs acceptent de se soumettre à ces peines, au cas où ils [78] commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés;
« 2° Qu'il impose aux consommateurs certaines gênes, ayant pour objet de lui faciliter la découverte des auteurs de délits.
« 3° Qu'il perçoive régulièrement, pour couvrir ses frais de production ainsi que le bénéfice naturel de son industrie, une certaine prime, variable selon la situation des consommateurs, les occupations particulières auxquelles ils se livrent, l'étendue, la valeur et la nature de leurs propriétés . » [9]
A quoi il faut ajouter l'interdiction de juger dans sa propre cause et de se faire justice soi-même.
La production de la sécurité intérieure exige donc un ensemble de lois, un « code » spécifiant et définissant les atteintes aux personnes et aux propriétés avec les pénalités nécessaires pour les réprimer ainsi que d'autres lois établissant les servitudes et les charges non moins nécessaires pour rendre cette répression possible.
L'exécution de ces lois et conditions de la [79] production d'un service indispensable à la conservation de toute société, nécessite encore:
1° L'institution d'une justice ayant en premier lieu pour mission d'ordonner la recherche des auteurs présumés des délits et des crimes commis contre les personnes et les propriétés, de constater s'ils sont innocents ou coupables, et, dans le cas de culpabilité, de leur appliquer les pénalités édictées par le code; en second lieu, de juger les différends et les procès;
2° L'institution d'une police chargée de la découverte et de la poursuite des auteurs des délits et des crimes; ensuite, de l'exécution des pénalités répressives.
Telles sont les différentes parties de l'organisme de la production de la sécurité intérieure et les conditions de son fonctionnement. Cet organisme nécessaire existe déjà au sein des sociétés les plus voisines de l'animalité, mais on sait combien il est demeuré imparfait, môme chez les plus avancées en civilisation. La cause de son imperfection n'est pas difficile à découvrir : elle réside dans l'état de guerre et les conditions d'existence qu'il a faites aux gouvernements, producteurs de sécurité.
[80]
Investis de l'exercice du pouvoir souverain de la société propriétaire d'un territoire conquis et de la population qui le meublait, le gouvernement ne devait aucun service de sécurité ou autre à cette population appropriée, pas plus qu'un propriétaire de bétail n'en doit à ses bœufs ou à ses moutons. Mais il y avait cette différence entre une population appropriée à la suite d'une conquête ou du transfert de la propriété d'un territoire par héritage, achat ou échange, et un troupeau de bœufs et de moutons, qu'on pouvait craindre qu'elle ne se révoltât contre ses maîtres, tandis qu'on n'avait pas à redouter une révolte du bétail. Le gouvernement de la société propriétaire de l'État pouvait craindre encore qu'il ne se formât au sein même de cette société des complots pour lui enlever le pouvoir. Le soin de sa sûreté qu'il ne séparait point de celle de l'État lui-même, lui commandait donc de pourvoir, avant tout, à ce double péril. Il y pourvoyait d'abord, en plaçant sous sa dépendance l'appareil de la justice aussi bien que de la police et en lui assignant pour fonction principale la répression des atteintes à sa domination, la découverte des menées de ses rivaux et la surveillance [81] des actes et même des paroles des mécontents; ensuite, en interdisant de constituer sans son autoririsation tout groupement de forces qui aurait pu devenir un foyer de résistance ou de révolte, en soumettant à son contrôle les associations qu'il autorisait, en limitant leur durée et en se réservant toujours le droit de les dissoudre. Cependant, si sa sécurité était la première et la plus constante de ses préoccupations, il lui importait aussi de garantir dans quelque mesure la vie et la propriété individuelles, car l'absence de cette garantie empêchait tout développement des industries dans lesquelles l'État puisait ses revenus. Mais c'était là, surtout pour les gouvernements dont l'existence était précaire, un objet secondaire. Ce qui l'attesterait au besoin, c'est que les pénalités établies pour assurer la sécurité des détenteurs et des agents du pouvoir souverain étaient bien autrement rigoureuses que celles qui avaient simplement pour objet de garantir la vie et la propriété des sujets.
Lorsque les nations eurent cessé d'être appropriées à une société ou à une maison souveraine, on put croire que cet état de choses allait changer du tout au tout. Le gouvernement que la nation, [82] maintenant en possession d'elle-même, instituait ou acceptait lui devait les services pour lesquels elle s'imposait les charges et les servitudes nécessaires, il devait encore s'appliquer à les améliorer et à en réduire les frais. Mais l'état de guerre continuant de subsister, la sécurité de la nation continuait aussi à passer avant celle de l'individu et, au lieu de diminuer de prix, elle coûtait de plus en plus cher à mesure que s'accroissait la puissance productive et destructive des nations entre lesquelles pouvaient chaque jour éclater des conflits. D'un autre côté, sous le nouveau régime plus encore que sous l'ancien, la possession devenue précaire du pouvoir est l'objet de compétitions ardentes et peu scrupuleuses sur le choix des moyens de l'atteindre. Le gouvernement doit donc aviser à se protéger lui-même avant de s'occuper de la protection des gouvernés. Enfin, les partis qui se bornent à employer les moyens légaux pour s'emparer du pouvoir ou pour le conserver sont obligés de grossir incessamment ce qu'on pourrait appeler le fonds des salaires politiques, c'est-à-dire le nombre des emplois, partant, des attributions de l'État. Constamment préoccupés d'assurer la sécurité de la [83] nation, plus préoccupés encore du soin de garantir la leur, chargés d'ailleurs de fonctions multiples et disparates, les gouvernements modernes peuvent de moins en moins suffire à leur tâche, et l'on s'explique ainsi l'imperfection grossière du service qui est en réalité aujourd'hui le plus important de tous : la protection de la vie et de la propriété individuelles.
Mais supposons que l'état de paix succède à l'état de guerre, que la sécurité extérieure des nations soit assurée par leur association collective et qu'elles puissent en conséquence se constituer librement, que les gouvernements soient réduits à leurs attributions naturelles, on verra se réaliser, sous l'impulsion de la concurrence, dans la production de ce service essentiel, des progrès qui sembleraient aujourd'hui chimériques.
Dans ce nouvel état des choses, une première question se posera, celle de savoir s'il est plus avantageux pour une nation d'entreprendre elle-même la production de la sécurité dont elle a besoin ou d'en charger une « maison » ou une compagnie possédant les ressources et la capacité techniques qu'exige ce genre d'industrie. [84] L'expérience ayant suffisamment démontré l'infériorité économique de la production dite en régie, on peut prévoir que la nation contractera de préférence, par l'entremise de délégués ou autrement, avec la maison ou la compagnie qui lui offrira les conditions les plus avantageuses et les garanties les plus sûres pour la fourniture de cet article de consommation naturellement collective.
Ces conditions ne différeront, théoriquement du moins, de celles du régime actuel de production de la sécurité que sur un point, mais sur un point essentiel, savoir : l'obligation imposée à l'assureur de payer aux assurés, victimes des atteintes à la vie ou à la propriété, des indemnités proportionnées au dommage causé, sauf recours aux auteurs de ces atteintes. Encore cette condition ne serait-elle pas entièrement nouvelle. Dans l'état actuel de la législation, le droit à une indemnité est reconnu aux victimes d'un pillage. Les gouvernements des États civilisés exigent, en vertu du même principe, une indemnité dans le cas d'un assassinat ou même d'un sévice moindre commis sur un de leurs sujets dans un pays appartenant à une race inférieure ou réputée telle, tout en s'abstenant de [85] l'accorder chez eux. On appréciera toute l'importance de cette condition si l'on songe qu'elle intéressera plus qu'aucune autre les gouvernements à perfectionner leur appareil de recherche et de répression des atteintes à la vie et à la propriété individuelles.
Quant aux conditions qui concernent le prix de la sécurité et les servitudes qu'elle nécessite, elles différeront d'un pays à un autre, selon le degré de moralité et de civilisation de la population, selon encore les difficultés plus ou moins grandes de la répression. En ce qui concerne le jugement des délits et des crimes, l'assureur et la collectivité assurée seront également intéressés à ce qu'il émane d'une justice éclairée et impartiale. Comme le constatait Adam Smith, la concurrence a déjà résolu ce problème. [10] Il n'est pas douteux que des compagnies judiciaires pleinement indépendantes et concurrentes le résoudront de même dans l'avenir.
[87]
CHAPITRE V. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles (suite).
En possession d'un pouvoir illimité sur la personne et les biens de leurs sujets, les gouvernements de l'ancien régime étaient naturellement tentés d'abuser de ce pouvoir. Ils en abusaient pour satisfaire leur intérêt immédiat et celui de la société politique et guerrière dont ils étaient les mandataires. Mais si ces deux intérêts les excitaient à augmenter les charges et servitudes de la multitude assujettie, ils ne les poussaient point à s'emparer des industries d'où elle tirait ses moyens d'existence et les leurs. Cela tenait surtout à ce que l'oligarchie propriétaire de l'État limitait communément son débouché aux fonctions gouvernantes, militaires et civiles. Elle n'avait, en conséquence, aucun intérêt à s'emparer d'industries [88] réputées inférieures et qui l'étaient, en effet, dans cette période de l'existence de l'humanité. Elle pressait seulement sur le gouvernement pour le déterminer à agrandir, par la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux sujets, le débouché qui lui était propre. Les gouvernements de l'ancien régime n'empiétaient donc que rarement sur le domaine de l'activité privée. S'ils se réservaient la production de certains articles, tels que la monnaie, le sel, le tabac, c'était uniquement dans un but fiscal; encore, ces monopoles, ne les exerçaient-ils pas eux-mêmes; ils les affermaient comme la plupart des autres impôts, l'expérience leur ayant démontré que l'affermage était plus productif que la régie.
Cet état de choses a complètement changé depuis que l'extension de la sécurité, et les progrès de l'industrie et du commerce qui en ont été la conséquence, ont fait surgir une classe moyenne, nombreuse et puissante, qui participe au gouvernement, et dont l'influence politique est même devenue prépondérante chez les nations les plus avancées. C'est principalement au sein de cette classe que se recrutent les partis qui se disputent la possession [89] du gouvernement. De plus, c'est un fait d'observation que dans les pays mêmes où l'ancienne oligarchie propriétaire de l'État a conservé la prépondérance, où elle continue à fournir la grande majorité du personnel politique, militaire et administratif, ses intérêts ont changé de nature et se sont rapprochés de ceux de la classe moyenne. Les progrès qui ont rendu les guerres plus coûteuses et moins productives, partant plus rares, ayant diminué les profits qu'elle en tire, elle a dû chercher des compensations à cette perte par l'accroissement de ses revenus fonciers, sa participation aux entreprises industrielles et son accession à des fonctions qu'elle dédaignait auparavant. Les partis politiques recrutés dans ces deux classes n'ont pu conquérir le pouvoir ou le conserver qu'à la condition de se mettre au service de leurs intérêts ou de ce qu'elles croyaient être leurs intérêts. Aux propriétaires fonciers et aux industriels ils ont fourni des protections et des subventions en échange de leurs votes, à tous les fils de famille qui manquaient de l'énergie nécessaire pour se créer une situation par eux-mêmes, des fonctions publiques, civiles ou militaires. De là le poids énorme et toujours [90] croissant dont le militarisme, l'étatisme et le protectionnisme accablent la multitude qui en supporte les frais.
Essayons de donner une idée de ce que lui coûte l'abus du pouvoir illimité que possèdent les gouvernements sur la vie et la propriété individuelles et qu'ils mettent au service des classes dont ils dépendent. Si l'on considère les deux gros chapitres des budgets de la généralité des États civilisés, ceux de la guerre et de la dette, on constate, non sans surprise, qu'ils absorbent les deux tiers des revenus publics. Sans doute, il faut, sous le régime actuel de l'assurance isolée, que chaque nation se prémunisse contre le risque de guerre, mais n'est-il pas manifeste que la prime qu'elle paie de ce chef dépasse le risque? Si des millions d'hommes sont soumis en Europe à la servitude militaire, n'est-ce pas surtout parce que les armées offrent un débouché avantageux aux professionnels qui se recrutent, pour le plus grand nombre, dans les familles influentes de l'aristocratie et de la bourgeoisie ? Et la plupart des guerres qui ont ravagé inutilement le monde depuis un siècle ont-elles été entreprises pour satisfaire à la demande de la foule laborieuse [91] qui fournit, qu'elle le veuille ou non, le sang et l'argent nécessaires pour les soutenir? Que l'on calcule enfin ce que coûte le renchérissement des produits et des services que les gouvernements ont enlevés au domaine de l'activité privée: postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, etc., etc., et celui que cause la protection des rentes des propriétaires fonciers, des profits ou des dividendes des entrepreneurs d'industrie et de leurs commanditaires, on trouvera que l'ensemble des frais directs et indirects de gouvernement absorbe au moins la moitié des revenus de la multitude qui vit du produit de son travail quotidien. Sous le régime du servage, elle travaillait trois jours par semaine pour le seigneur ; elle travaille aujourd'hui tout autant pour le gouvernement et ses soutiens privilégiés, quoique les services qu'elle reçoit en échange valent à peine une demi-journée!
Cependant, à mesure que la concurrence internationale ira se développant et fera sentir davantage sa pression dans toutes les parties du marché des échanges, la nécessité de mettre fin à ce système de renchérissement deviendra plus urgente. Sous peine de succomber dans la lutte et de disparaître, [92] les nations concurrentes seront obligées de réduire les attributions de l'État au lieu de les accroître et, finalement, de se borner à charger le gouvernement de la production des services naturellement collectifs de la sécurité intérieure et extérieure.
A ces services qui sont du ressort du gouvernement de l'État se joignent ceux qui appartiennent aux sous-gouvernements des provinces et des communes. Comme le gouvernement de l'État, et sous la pression des mêmes influences, ces sous-gouvernements augmentent continuellement leurs attributions aux dépens de l'activité privée, et le fardeau de leurs budgets locaux s'ajoute à celui du budget général. Ils ne possèdent point, à la vérité, un pouvoir illimité sur la liberté et la propriété individuelles, mais les limites de leur pouvoir ne sont point marquées, et son extension n'est arrêtée, dans quelque mesure, que par le veto du gouvernement de l'État qui les tient dans une dépendance plus ou moins étroite. Seulement, ce veto, il ne l'applique guère que lorsqu'il juge que le pouvoir local empiète sur le sien, et ce que l'on désigne sous le nom de « libertés communales » n'est autre chose que la latitude qu'il laisse aux sous-gouvernements [93] de réglementer la liberté et de taxer la propriété individuelle. En réalité, le domaine des gouvernements locaux est fort étroit, il ne s'étend qu'à un petit nombre de services naturellement collectifs, tels que l'établissement et l'entretien de la voirie, le pavage, l'éclairage, l'enlèvement des immondices, etc., (on n'y doit même pas comprendre la police qui est plutôt du ressort du gouvernement de l'État), et ces différents services locaux, comme les services généraux de la sécurité intérieure et extérieure, peuvent être effectués avec plus d'efficacité et d'économie par des entreprises spéciales que par le gouvernement provincial ou communal lui-même. [11]
[94]
CHAPITRE VI. La sujétion et la souveraineté individuelle.
L'appropriation des plus faibles par les plus forts a été, comme nous l'avons vu, une nécessité inhérente à l'état de guerre. Ils fallait que ceux-ci fussent intéressés à protéger ceux-là plutôt qu'à les dépouiller et à les massacrer, et cet intérêt ils ne pouvaient le trouver que dans l'appropriation. Grâce à un ensemble de progrès matériels et moraux et par une série de transitions, l'approprié, esclave ou serf, devint son propre propriétaire, mais s'il était affranchi de la domination d'un maître, il demeurait assujetti comme membre d'une société, d'une nation, à celle du pouvoir chargé par cette société ou cette nation de la préserver du risque de destruction ou d'asservissement qu'impliquait l'état de guerre et investi, à ce [95] titre, d'un droit illimité sur la vie, la liberté et la propriété de ses membres. Cette servitude sans limites annulait, en fait, la souveraineté individuelle. Car l'individu avait beau être déclaré maître souverain de sa vie et de ses biens, il était à la merci du pouvoir investi d'un droit qui primait le sien. C'est pourquoi les individus libérés de cette servitude personnelle, et constituant des nations réputées libres, avisèrent de bonne heure aux moyens de se défendre contre l'abus de ce droit. Ils chargèrent d'abord des mandataires d'en contrôler l'exercice; ils allèrent ensuite jusqu'à en dépouiller l'oligarchie propriétaire de l'État pour se l'attribuer à eux-mêmes, et en conférer l'exercice à leurs mandataires. Mais ces précautions sont demeurées vaines. L'abus a persisté, autant même dans les pays où le droit illimité sur la vie et la propriété de l'individu appartient à la nation et est exercé par ses mandataires, sous un régime de suffrage universalisé, que dans ceux où il n'a pas cessé d'être concentré entre les mains du chef héréditaire de l'oligarchie propriétaire de l'État.
Le seul remède à cet abus consisterait à limiter la servitude qui pèse sur la souveraineté [96] individuelle et l'annule; mais ce remède est incompatible avec l'état de guerre. Aussi longtemps que subsistera le risque illimité qu'implique l'état de guerre, il sera nécessaire que le pouvoir responsable de la sécurité de la nation conserve un droit illimité sur la vie et les biens de ses membres.
Mais que l'état de paix vienne à succéder à l'état de guerre, que la sécurité des nations civilisées soit garantie par un pouvoir collectif, émané d'elles, aussitôt la situation change. Ce pouvoir possédant une prépondérance assez grande, sinon pour supprimer le risque de guerre au moins pour le réduire dans des proportions telles qu'il suffise d'une faible prime pour subvenir aux frais de la sécurité collective, la servitude illimitée à laquelle l'individu était assujetti cesse d'avoir sa raison d'être. Elle est remplacée par une servitude limitée à l'obligation de fournir une quote-part minime de la prime d'assurance, part toujours réductible jusqu'à ce que l'extension de la civilisation la rende inutile.
La souveraineté individuelle, voilà donc quelle est, en dernière analyse, la base des institutions politiques de la société future. La souveraineté n'appartient plus à une société propriétaire d'un [97] territoire et d'une population esclave ou sujette, ou à une sorte d'entité idéale héritière de l'établissement politique de sa devancière et investie, comme elle, d'un droit illimité sur la vie, la liberté et la propriété individuelles. Elle appartient à l'individu lui-même. Il n'est plus un sujet, il est son maître, son propre souverain, et il est libre de travailler, d'échanger les produits de son travail, de les prêter, de les donner, de les léguer, etc., suivant sa convenance. Il peut employer à son gré les forces et les matériaux dont il dispose à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Cependant, quelques-uns d'entre ces besoins ne peuvent, en raison de leur nature particulière, être satisfaits isolément, tel est le besoin de sécurité. Que font les individus, consommateurs de sécurité? Ils s'associent et forment une collectivité assez nombreuse pour y pourvoir d'une manière à la fois économique et efficace. Ils choisissent des mandataires qu'ils chargent de traiter, en faisant appel à la concurrence, avec une entreprise, — maison ou société, — réunissant les aptitudes et les capitaux nécessaires à la production de ce service d'assurance. Comme toute autre assurance, celle de la [98] vie, de la liberté et de la propriété individuelles implique des conditions de deux sortes : conditions de prix (paiement d'une prime destinée à couvrir les frais de production de la sécurité avec adjonction d'un profit), conditions techniques (imposition aux assurés des servitudes indispensables à la production de ce service). Ces conditions sont librement débattues entre les mandataires de la collectivité des consommateurs et les entrepreneurs de cette sorte d'assurance. Lorsque l'accord se fait avec l'un d'entre eux, les conditions du marché sont spécifiées dans un contrat, conclu pour un terme plus ou moins long, à la convenance des parties. Il en va de même pour les autres besoins natuturellement collectifs, besoins locaux de voirie, de salubrité, etc. La collectivité qui éprouve ces besoins contracte elle-même, si elle est peu nombreuse, ou élit des mandataires qui contractent en son nom, avec une entreprise capable de produire le service dont elle a reconnu la nécessité. Dans ces différents cas, l'individu exerce collectivement sa souveraineté, soit par des mandataires, soit par lui-même, tandis qu'il l'exerce isolément pour la généralité de ses autres besoins.
[99]
L'office des mandataires se réduit à la conclusion des contrats ; cet office rempli, leur mandat expire. Cependant, il peut être nécessaire de surveiller l'exécution de ces contrats et d'en modifier les termes quand l'expérience en a montré les défauts ou les lacunes, ou bien encore quand des faits nouveaux apportent quelque changement dans les conditions d'existence de la société. Une délégation permanente des consommateurs de services collectifs peut donc avoir sa raison d'être. Mais il se peut aussi que l'observation des clauses du contrat soit suffisamment garantie par la surveillance de la presse ou des associations librement instituées dans ce but, et que ces clauses n'aient pas besoin d'être modifiées. Dans ce cas, une représentation officielle des consommateurs serait inutile et la collectivité nationale pourrait en faire l'économie.
Si, comme il y a apparence, la production de chacun des services naturellement collectifs était entreprise par une société, celle-ci s'organiserait et se comporterait comme toute autre société industrielle; elle aurait son conseil d'administration, son directeur chargé d'exécuter les décisions du Conseil et des assemblées générales auxquelles [100] il serait publiquement rendu compte de ses opérations.
Ainsi se résoudrait économiquement le problème de la constitution et de la mise en œuvre des services du gouvernement sous un régime d'assurance collective de la paix.
Endnotes
[9] La production de la sécurité. Journal des Économistes, n° du 15 février 1849. Reproduit dans les Questions d'économie politique et de droit public, t. II, p. 245.
[10] Les honoraires de cour, dit Adam Smith (Richesse des Nations, liv. V, chap. paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour lâchait d'attirer a elle le plus d'affaires qu'elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles mêmes qui ne tombaient point sous sa juridiction. La cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s'était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La cour de l'Échiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagements pour dettes, le plaignant alléguant que, si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu'elles voulaient, et chaque cour s'efforçait d'attirer le plus de causes qu'elle pouvait au sien, par la diligence et l'impartialité qu'elle mettait dans l'expédition des procès. L'admirable constitution actuelle des cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie, le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun s'efforçant à l'envi d'appliquer, a toutes sortes d'injustices, le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi.
[11] Voir Les lois naturelles de l'économie politique, chap. xiv. La constitution naturelle des gouvernements. La commune. La province. L'État.
VI.18. "Le problème du gouvernement individuel" (1900)↩
Source
Gustave e Molinari, "Le problème du gouvernement individuel," Journal des économistes, S. 5, T. 44, N° 3, décembre 1900, pp. 321-39.
Introduction
Within Molinari’s work there is a tension between his support for, on the one hand, individual liberty and what he calls (in English) "self government" or here "le gouvernement de l’individu par lui-même" (government of the individual by him or herself), and on the other hand, for "la tutelle" (tutelage). As part of his theory of history, the weak, the incapacitated, and the ignorant need guidance from their "superiors" for as long as they unable to care for themselves and their families "utilement" (in a useful way). [14] In the ancient and medieval world this tutelage was provided by powerful kings, the military, the instituions of slavery and then serfdom, a highly regulated economy of "corporations" and guilds, and the church. Part of the transition to a modern world of political and economic freedom was the gradual escape of more and more individuals from "le régime de la tutelle" to "le régime de la liberté".
Another important way individuals learnt "how to be free and responsible individuals" was the moral lessons they learned from "un triple code de lois" (a triple code of laws) which consisted of the civil and penal code which taught them about the rights and duties every citizen had; "un code de lois religieuses" ( a code of religious laws) which taught people about their moral duties towards others more broadly understood; and "un code de coutumes et d’usages édictés par l’opinion" (a code of customs and behaviour dictated by public opinion) which supplemented the other two codes.
However, by the end of the 19th century Molinari believed that the codes promulgated and enforced by the state and the church were breaking down and were no longer providing ordinary people with the moral guidance they needed. The government regularly broke its own moral code by taking from some people (ordinary taxpayers) and giving to others whom it favored (special interests, members of the ruling elite). Molinari summed up these favored groups in the following way: "le politicianisme, l’étatisme, le militarisme et le protectionnisme" (politicianism, statism, militarism, and protectionism).
The church did much the same by pursuing "l’intérêt temporel de clergé" (the temporal interests of the clergy) in order to "augmenter leurs revenus" (to increase their income), and by refusing to modify "les dogmes immobiles des anciennes" (the rigid dogmas of the old (believers)) to fit the demands of modern science and the needs of the modern economy.
In several works Molinari talks about private and voluntary alternatives to state provided tutelage (or what he called "la solution socialiste du problème" (the socialist solution to the problem)) as a way of bridging the gap during this transition period. In this late work, he is still hopeful that this will happen but he has become discouraged by the behavior of modern voters who behave as if they want a system of state tutelage to continue. He sadly notes how the majority of voters do not use their right to vote to further "l’intérêt général et permanent de la société" (the general and permanent interest of society) but rather put their vote "au service d’intérêts particuliers, — intérêts de leur industrie; de leur profession ou de leur localité" (in the service of particular interests, such as the interest of their particular industry, of their profession, or off the region). Since past experience showed that limiting the right to vote did not work either, the solution he believes is to drastically limit the powers and the functions of the state, and thus limit its ability to give favors to some groups at the expense of others. Only then will ordinary people regain their respect for the laws and the moral codes which lie behind them and thereby begin to learn how to be free and responsible individuals who can "govern themselves."
Endnotes
[14] As was typical for the time Molinari included women in the group who needed tutelage. He opposed granting women the right to vote, not because he is "antiféministe" (anti-woman ), but because "plus il y aura d'électeurs, plus les résultats seront mauvais" (the more voters there are the more bad results there are).
Text
[321]
1
Plus loin on remonte dans le passé, moindre apparait la part du gouvernement de l'individu par lui-même. Dans les tribus du premier âge de l'humanité, dont le régime politique et social s'est perpétué parmi les races inférieures de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie, l'individu est assujetti à un ensemble de coutumes qui enserrent dans un réseau étroit toutes les manifestations de son activité. Comme le remarquait Sir John Lubbock, le sauvage est le moins libre des hommes. Les coutumes auxquelles il est tenu d'obéir sont inspirées par les esprits protecteurs de la tribu, et il ne peut les enfreindre sans s'exposer aux châtiments les plus redoutables. Ces coutumes répondent généralement à des nécessités, quoiqu'elles soient fréquemment viciées par l'intérêt particulier des sorciers, mandataires ou interprètes des esprits. C'est seulement lorsqu'elles subsistent après la disparition des nécessités auxquelles elles ont pourvu, qu'on peut les qualifier d'absurdes comme le fait un peu légèrement l'auteur de l'Homme avant l'histoire.
Dans un état politique et social plus avancé, lorsque l'agriculture et les autres industries productives, en remplaçant les industries destructives du premier âge, eurent rendu possible l'accroissement de la population et fait succéder les nations aux tribus, la part du gouvernement individuel s'augmente, mais seulement dans la région supérieure de la société. Soit au sein d'une caste comme dans l'Inde, d'un patriciat comme à Rome, d'une aristocratie comme dans les Etats qui ont succédé à l'empire romain, la liberté individuelle est réduite presque au minimum. Les mariages [322] sont interdits, en dehors de la caste, et, dans les monarchies, ils sont soumis à l'autorisation du souverain. Les règlements relatifs au mariage des officiers dans la plupart des armées modernes sont un reste de ce régime de tutelle, auquel étaient assujettis les membres de la classe gouvernante. Le souverain lui-même, dans les Etats despotiques, est obligé de se conformer aux prescriptions d'une étiquette qui règle tous ses mouvements comme ceux d'une machine. Dans les couches inférieures de la population, la part de la liberté individuelle était naturellement encore moindre. L'esclave n'avait que la part de liberté qu'il plaisait à son maître de lui accorder. La liberté du serf, attaché a la glèbe, était plus étendue, et elle se trouvait. plus ou moins efficacement garantie par la coutume; mais la coutume elle-même la restreignait parfois plus encore que le despotisme du seigneur. Enfin, dans toutes les industries et les professions incorporées, la liberté de l'ouvrier aussi bien que celle du maître était limitée par une multitude de règlements dictés par l'intérêt de la corporation.
Que ce régime de servitude universelle ait eu sa raison d'être, qu'il ait été nécessaire à la conservation des sociétés et la condition des progrès qui ont élevé l'espèce humaine au-dessus de l'animalité, on commence aujourd'hui à le comprendre. Une société ne peut subsister qu'à la condition d'imposer à ses membres ou d'exiger qu'ils s'imposent à eux-mêmes l'accomplissement d'une série d'obligations ou de devoirs : devoir de pourvoir a leur subsistance et à celle des êtres dont ils sont naturellement responsables, devoir de respecter la vie et les biens d'autrui. devoir de contribuera à la défense de la société, etc., etc. Ces obligations, ces devoirs, l'individu possédait-il l'intelligence nécessaire pour en comprendre la raison d'être et la force morale non moins nécessaire pour les remplir? L'une et l'autre sont encore visiblement insuffisantes de nos jours ne l'étaient-elles pas davantage dans les périodes antérieures de l'existence de l'humanité? En présence de l'incapacité de la multitude à remplir des devoirs indispensables au salut commun, et même de les connaître, le problème de la conservation des sociétés était certainement difficile à résoudre. Il a été résolu par l'intelligence du petit nombre, avec l'auxiliaire du sentiment religieux. L'intelligence a découvert les règles nécessaires du gouvernement individuel, et le sentiment religieux en a imposé l'observation aux plus forts. Ceux-ci y ont assujetti les plus faibles. Sans doute, ces règles étaient toujours imparfaites; elles ne répondaient qu'incomplètement à leur objet, mais telles qu'elles, malgré leur imperfection et leurs vices, elles établissaient [323] une discipline que le plus grand nombre des membres de la société eussent été incapables de s'imposer d'eux-mêmes. La crainte des châtiments par lesquels les Divinités sanctionnaient les lois qu'elles imposaient aux plus forts et ceux-ci aux plus faibles, sans oublier l'espoir des récompenses, assuraient l'accomplissement des devoirs, et, en créant l'habitude de les accomplir, rendait possible l'avènement d'un état de choses, dans lequel l'individu les accomplirait de lui-même. Cependant l'habitude seule eût été impuissante à résister à l'impulsion des appétits qui excitaient incessamment l'individu à enfreindre les lois nécessaires à la conservation de la société et la sienne, et plus encore à lui commander les sacrifices qu'impliquait leur observation. Il fallait que ses facultés intellectuelles se développassent assez pour lui faire comprendre que les lois auxquelles il était tenu d'obéir lui étaient utiles à lui-même, et que ses facultés morales devinssent assez fortes pour contenir et régler ses appétits.
Que les facultés intellectuelles et morales de la grande majorité de l'espèce humaine se soient développées, qu'un nombre croissant d'individus, même parmi les moins doués, aient participé à ce développement depuis les premiers âges de la civilisation, il suffit pour s'en assurer de comparer la moyenne d'intelligence et de moralité d'un nombre donné d'individus demeurés à l'état primitif de sauvagerie, à celle du même nombre d'individus appartenant aux nations en voie de civilisation. Comme les forces physiques, les forces intellectuelles et morales se développent par la culture et l'exercice, De siècle en siècle, sauf dans les périodes de décadence ou d'invasion des barbares et de recul qui les ont suivies, la culture de l'intelligence s'est perfectionnée et propagée. Elle s'est perfectionnée par l'acquisition successive et la capitalisation de notions plus exactes et plus complètes sur les êtres et les choses, elle s'est propagée par la diffusion de l'instruction dans les couches inférieures de la population. Enfin, plus encore que par la culture, l'intelligence s'est développée par l'exercice des professions et des industries qui demandent sa coopération. Si l'on peut contester que les professions dites libérales exigent aujourd'hui l'emploi d'une somme d'intelligence supérieure à celle qui leur suffisait jadis, il n'en est pas de même des industries dans lesquelles l'introduction d'une machinerie plus parfaite comporte la mise en œuvre des facultés intellectuelles de l'ouvrier plutôt que celle de sa force physique.
De même que les facultés intellectuelles, les facultés morales se sont développées, quoique dans une mesure moindre, par la culture [324] et l'exercice. La morale du christianisme, du bouddhisme, du brahmanisme ou du mahométisme est incontestablement plus pure que celle du fétichisme, et ses enseignements constituent une culture supérieure. D'une autre part, les industries qui fournissent leurs moyens d'existence aux membres des sociétés civilisées exigent beaucoup plus que celles des sauvages l'intervention des facultés morales. Tandis que la chasse aux animaux et aux hommes ne demande guère que de la force, de l'adresse et du courage physique, la production et l'échange dans l'espace et le temps impliquant le respect de la propriété et des contrats, nécessitent la mise en oeuvre des facultés morales non moins que celle des facultés intellectuelles. La culture et l'exercice ont donc concouru à susciter chez les peuples en voie de civilisation des progrès qui ont accru la somme d'intelligence et de moralité nécessaire à l'accomplissement des devoirs qu'impose à l'individu la conservation de la société.
Les vieilles formes de la tutelle, l'esclavage, le servage, la sujétion corporative ont cessé d'exister chez les peuples civilisés, mais les progrès de sa mentalité ont-ils été suffisants pour rendre l'individu capable de se gouverner utilement lui même, utilement c'est-à-dire d'une manière conforme à l'intérêt général et permanent de la société et de l'espèce? Telle est la question qu'il s'agit de résoudre.
II
Quelle est actuellement la situation de l'individu, chez les nations qui ont supprimé les anciennes formes de la tutelle? Il est libre, il s'appartient à lui-même, il peut employer son capital de forces productives de la manière qui lui paraît la plus profitable, et disposer à son gré des produits de leur mise en oeuvre, les échanger, les épargner, les léguer, les consommer, sauf certaines charges et restrictions qui lui sont imposées dans l'intérêt réel ou supposé de la nation. Mais la liberté dont il jouit, et qui n'a, du moins en théorie, d'autre limite que la liberté d'autrui, implique la responsabilité de son existence et de celle des êtres placés sous sa tutelle. Il doit pourvoir à sa subsistance et à la leur, se gouverner et les gouverner. C'est une tâche difficile et laborieuse, mais dont l'accomplissement exact importe à la fois, à l'individu lui-même et à la société tout entière. S'il n'y suffit point, s'il ne met pas en œuvre, activement, les facultés dont il est doué pour couvrir sa responsabilité, s'il se montre incapable de gouverner [325] utilement sa production et sa consommation, et celles des êtres dont il est responsable, son gouvernement se solde par une perte de forces, qui appauvrit et affaiblit d'autant la société. S'il dépasse les limites de sa liberté, s'il porte atteinte à la liberté d'autrui, les dommages que cause ce gouvernement individuel vicieux, sont plus graves encore en se multipliant, ils déterminent la décadence et la destruction finale de la société.
A la pratique vicieuse ou insuffisante du gouvernement individuel, la société oppose un triple code de lois : 1° un code de lois civiles et pénales, qui définissent les droits et les devoirs de chacun, en sanctionnant l'observation des uns et des autres par des pénalités matérielles proportionnées à la gravité des atteintes portées au droit et des manquements au devoir; 2° un code de lois religieuses concernant la généralité des devoirs, avec la sanction de pénalités ultra-terrestres, proportionnées de même à l'importance des manquements; 3° un code de coutumes et d'usages édictés par l'opinion et imposés par elle. A ces trois codes, s'ajoute un quatrième, le plus important, sinon toujours le plus efficace, celui de la conscience de l'individu, avec la sanction morale qui lui est propre la satisfaction que procure le sentiment du devoir accompli et le remords que cause le manquement au devoir.
Ces différents codes s'accordent sur les points essentiels, mais les plus conformes à l'intérêt général et permanent de la société et de l'espèce, les plus « justes », présentent encore des imperfections et des lacunes.
Les gouvernements établissent une multitude de lois de toutes sortes politiques, économiques, financières, civiles, pénales, etc., etc. Ces lois concernent les fonctions diverses qui leur sont dévolues et principalement les services de la sécurité extérieure et intérieure, avec les charges et servitudes imposées aux individus pour en couvrir les frais. Elles doivent répondre à l'intérêt général et permanent de la nation. Y répondent-elles toujours ? De tout temps et partout elles ont été plus ou moins viciées par l'insuffisance de moralité et d'intelligence des gouvernements qui les établissent.
L'insuffisance de moralité des classes gouvernantes joue, en cette matière, le premier rôle. Ces classes. en possession de la machine à confectionner les lois, en ont usé pour augmenter leurs revenus particuliers aux dépens de ceux des autres classes et réduire de même leur part dans la répartition des charges publiques. De nos jours, le politicianisme, l'étatisme, le militarisme et le protectionnisme se joignent, d'une part, pour élever, au-dessus du taux nécessaire, le prix des services que les gouvernements [326] s'attribuent et qui, pour le plus grand nombre, pourraient être remplis d'une manière plus économique et plus efficace par l'industrie privée, d'une autre part, pour en faire supporter le fardeau par les classes les moins influentes. L'insuffisance d'intelligence, l'ignorance de ce qui est véritablement conforme à l'intérêt de la nation, vient en aide au défaut de moralité pour vicier les lois auxquelles l'individu est tenu d'obéir. Quels sont les effets de cette aggravation constante des frais du gouvernement collectif et des vices de ses lois sur le gouvernement individuel? Ces effets sont de deux sortes matériels et moraux. Les impôts en disproportion avec les services qu'ils servent à rétribuer, sans parler de ceux qui ne rétribuent aucun service et tels sont les impôts protectionnistes, les servitudes que nécessite leur recouvrement, en diminuant les moyens de subsistance du grand nombre, rendent plus difficile l'accomplissement de l'ensemble des devoirs de l'individu et l'excitent par là même à empiéter sur la propriété d'autrui. Ajoutons que cette excitation est d'autant plus vive que les gouvernements qui se montrent les plus actifs à augmenter le prix de leurs services sont ceux qui se préoccupent le moins de les améliorer et, en particulier, de sauvegarder la vie et la propriété individuelles. Les conséquences morales de l'imperfection des lois sont peut-être plus nuisibles encore. Lorsqu'une loi a visiblement pour objet d'enrichir une catégorie d'individus aux dépens des autres, ou bien encore d'empêcher l'exercice d'un droit reconnu par la conscience universelle, elle affaiblit l'autorité de toutes les lois, et jette le doute sur la légitimité des plus nécessaires.
Le code du gouvernement religieux s'accorde, avons-nous dit, sur les points essentiels, avec celui du gouvernement civil. Cela tient surtout à ce qu'à l'origine les deux gouvernements se confondaient et n'avaient par conséquent qu'un seul et même code. Lorsqu'ils se sont séparés, le gouvernement civil n'a compris dans son code que les actes qui intéressaient l'existence temporelle de la société et plus encore la sienne le gouvernement religieux a continué, au contraire, à s'occuper de l'ensemble des manifestations de l'activité des individus, toutes ces manifestations, même les moindres devant influer, en bien ou en mal, sur leur destinée future. A la différence du gouvernement civil, le gouvernement religieux est devenu moins onéreux pour l'individu. Les lourdes charges que la dîme et les autres redevances imposaient jadis aux populations ont été sensiblement réduites. Mais les lois religieuses n'ont pas cessé d'être viciées sous l'influence de l'intérêt temporel [327] de clergé. Elles contribuent à fausser la conscience individuelle en attribuant aux prescriptions relatives au culte, une valeur égale, sinon supérieure à celle des devoirs qui' intéressent la société, et en autorisant le rachat des atteintes à la loi morale par des offrandes ou des donations, au profit de l'Eglise.
Les lois du gouvernement religieux ont, de plus, perdu de leur efficacité morale, non seulement sous l'influence du vice que nous venons de signaler, mais encore parce que les dogmes immobiles des anciennes religions ont cessé d'être en harmonie avec les données progressives de la science. La foi s'est affaiblie dans les âmes et avec elle l'efficacité de la sanction religieuse de la morale.
Enfin, le gouvernement de l'individu par lui-même est soumis au contrôle de l'opinion. Comment se forme l'opinion? De quelles sanctions dispose-t-elle, et quelle est leur valeur? L'opinion est née de la solidarité qu'implique l'état de société. Dans une association quelconque, tous les actes des individus qui en font partie sont conformes ou contraires à l'intérêt collectif, utiles ou nuisibles, dans quelque mesure. Chacun est donc intéressé à les connaître et à les juger, en prenant pour critérium l'intérêt de la société. Une enquête et un jugement, telle est l'opération utile de l'opinion. Le jugement qu'elle prononce est sanctionné par l'approbation ou le blâme, lesquels ont des conséquences avantageuses ou désavantageuses à l'individu qui est l'objet de ce jugement. Malheureusement l'opinion est faillible. Elle est rarement capable de procéder à une enquête approfondie et impartiale, et ses jugements sont influencés par des intérêts ou des passions,, qui n'ont rien de commun avec l'utilité sociale. Quant aux sanctions dont elle dispose, leur efficacité a naturellement diminué, depuis que l'accroissement de la facilité des déplacements a permis de se dérober plus aisément aux condamnations qu'elle prononce. L'opinion n'en est pas moins un frein aux passions et aux intérêts qui excitent l'individu à manquer à ses devoirs, mais c'est un frein qui porte trop souvent à faux, et dont l'influence sur la vie privée a diminué plutôt qu'elle ne s'est accrue.
A ces freins extérieurs des lois civiles, et religieuses, et des jugements de l'opinion, se joint le frein intérieur de la conscience individuelle. Qu'est-ce que la conscience et quelle est sa fonction? La conscience est un régulateur. Elle a pour fonction nécessaire de régler les impulsions des appétits et des passions de l'individu de manière à les empêcher de produire des actes nuisibles à autrui et à lui-même. Elle examine les actes qu'il se propose de commettre, ou, si elle est trop lente ceux qu'il a commis et le [328] juge. Comment s'opère ce jugement et quelle est sa sanction? C'est l'intelligence qui instruit le procès et prcnonce le jugement, sous l'excitation du sentiment de la justice, inné mais inégalement fort dans l'espèce humaine. L'intelligence juge que l'acte est juste ou injuste, utile ou nuisible, selon qu'il est ou non conforme à la loi civile ou religieuse, à l'appréciation de l'opinion ou à sa propre appréciation du caractère d'utilité ou de nociveté sociale des actes de cette sorte. Si elle le juge juste, utile, le sentiment de la justice en éprouve une satisfaction si elle le juge injuste, nuisible, le sentiment de la justice en ressent une peine. Cette satisfaction ou cette peine est proportionnée au caractère plus ou moins juste ou injuste, utile ou nuisible, de l'acte et elle agit pour en autoriser ou en interdire la production ou la reproduction.
Nous avons remarqué que ces diff'érents codes s'accordent généralement sur les points essentiels. Cependant, il n'en est pas toujours ainsi. Le code de la société civile est sur plus d'un point en désaccord avec le code de la société religieuse, et ni les jugements de l'opinion ni ceux de la conscience individuelle ne sont toujours d'accord avec l'un ou avec l'autre. Auquel de ces codes ou de ces jugements l'individu doit-il obéir? Sans aucun doute, au code que la société a établi dans l'intérêt de sa conservation, car il est le produit d'observations et d'expériences accumulées de génération en génération. Il y a toutefois des lois, visiblement dictées par des intérêts et des passions de caste ou de parti qui peuvent faire hésiter la conscience. Il y en a même, telles sont les lois de proscription, politiques ou religieuses, auxquelles la conscience doit refuser d'obéir, si redoutables que soient les pénalités qui les sanctionnent.
III
Les deux gouvernements, civil et religieux, qui établissent les lois auxquelles ils obligent l'individu d'obéir, ne se font d'habitude aucun scrupule de déroger à ces lois, quand leur intérêt est en cause. La morale qu'ils pratiquent est trop souvent en opposition avec celle qu'ils imposent. Ils la justifient en invoquant la « raison d'Etat », c'est-à-dire l'intérêt de conservation de leur existence, soit qu'ils aient à lutter contre des ennemis du dehors ou des concurrents du dedans, soit encore qu'ils veuillent augmenter leurs revenus ou obtenir un appui qui leur est nécessaire. Ils se plaisent à croire que l'existence de la société est liée à la leur, par conséquent que tous leurs actes sont conformes à l'intérêt de la société et à ce titre « moraux », quand même ces actes [329] sont condamnés par les lois dont ils prescrivent l'observation aux individus. Cette morale de la raison d'Etat n'a pas cessé d'être celle de tous les gouvernements civils ou ecclésiastiques. Il convient de remarquer, toutefois, à la décharge des personnalités dirigeantes des gouvernements des nations ou des églises, qu'elles obéissent généralement aux lois de la morale individuelle dans le gouvernement de leurs affaires et de leur vie, tout en pratiquant la morale de la raison d'Etat dans le gouvernement de la nation ou de l'Eglise. Elles ne sont donc qu'à demi immorales et malhonnêtes.
Elles n'en donnent pas moins un exemple démoralisateur. L'individu, assujetti à l'observation des lois de la morale ordinaire, en présence de la violation de ces lois par le gouvernement, qui a pour mission de les faire observer, ne peut manquer d'être troublé dans sa conscience. Car il s'aperçoit qu'il y a deux justices, deux morales, et il se demande pourquoi il ne suivrait pas celle que pratique le gouvernement plutôt que celle qu'il impose. Si on lui objecte que le gouvernement a sa raison d'Etat, déterminée par les nécessités de sa conservation, ne peut-il pas répondre qu'il a la sienne, et qu'il obéit, lui aussi, aux nécessités de sa conservation en faisant main basse sur le bien d'autrui ?
De là, une diminution de la capacité morale nécessaire à l'accomplissement de l'ensemble des devoirs qu'implique le gouvernement individuel. Or le gouvernement de l'individu par lui-même est devenu plus difficile, sous le régime de la liberté, qu'il ne l'était sous le régime de la servitude, et il exige, par conséquent, une capacité morale plus grande.
IV
La responsabilité de l'individu s'est naturellement accrue avec sa liberté et dans la même proportion. Elle n'existait point chez l'esclave, qui était entretenu par son maître et n'avait point de famille. Elle commence à apparaître lorsque le servage et la sujétion corporative succèdent à l'esclavage. Le serf, attaché à la glèbe et l'ouvrier, attache à la corporation, sont obligés de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance et à celle de leur famille; mais le serf est pourvu d'un morceau de terre dont l'étendue est communément proportionnée au nombre de bras que chaque foyer peut fournir à la corvée, et l'ouvrier des corporations, le compagnon aussi bien que le maître, possède un emploi qui lui est assuré de génération en génération. La limitation des [330] marchés et même l'êtât stationnaire de l'industrie contribuent à procurer aux coopérateurs de la production une sécurité qui allège le poids de leur responsabilité. Dans des marchés étroitement limités par des obstacles de toute sorte, défaut de moyens de communication, morcellement.des Etats politiques, guerres, etc., la production pouvait être aisément mise en équilibre avec la consommation, au niveau du prix nécessaire, imposé par la coutume. Seuls, les accidents de la température troublaient temporairement cet équilibre, qu'aucune des crises que suscite le progrès ne venait rompre. De là une certaine stabilité économique qui se répercutait sur les moyens de subsistance de l'individu. En revanche, il n'avait guère la possibilité de les accroître. Mais il n'y était que faiblement sollicité par suite de la distance qui séparait les prix des articles de luxe et même de simple confort de ceux des nécessités de la vie. Les consommations de luxe n'étaient généralement accessibles qu'à l'aristocratie gouvernante. D'ailleurs, des coutumes ou des lois somptuaires les interdisaient. fréquemment aux classes moyenne et inférieure. Dans ces classes, de beaucoup les plus nombreuses, l'individu était donc peu intéressé à augmenter ses moyens de subsistance, car les jouissances qu'il aurait pu se procurer en les augmentant, lui étaient défendues. Si cet état de choses enrayait le développement de son activité et faisait obstacle aux progrès de l'industrie, il modérait l'excitation à s'enrichir, fût-ce au.dépens d'autrui.
Il n'en est plus ainsi depuis que l'agrandissement des marchés et les progrès de l'industrie ont accru pour l'individu la possibilité d'augmenter ses moyens de subsistance, tout en les rendant moins stables. Or il ne faut pas oublier qu'en même temps que s'accomplissait cette évolution économique, l'abolition de l'esclavage, du servage et du régime corporatif imposait à l'individu l'obligation de pourvoir lui-même à sa subsistance, sans qu'il pût compter désormais sur aucun secours extérieur. Il acquérait, à la vérité, la liberté d'employer à sa convenance son capital de forces productives, la liberté de travailler et de disposer des fruits de son travail. mais sa production et sa consommation demeuraient grevées d'impôts et de servitudes, hors de proportion avec les services qu'ils avaient pour objet de rétribuer, et aggravaient ainsi les difficultés du problème du gouvernement de soi-même. Aux risques qui avaient leur source dans la transformation progressive de l'industrie s'ajoutaient ceux de l'instabilité des lois fiscales et protectionnistes. Et tandis que ses ressources étaient rendues précaires sinon diminuées, l'individu, [331] libre maintenant d'en user à sa guise, voyait s'accroître le nombre dés articles de consommation et parmi eux les excitants qui lui apportaient les jouissances les plus vives en lui faisant oublier les embarras et les misères de sa situation.
De cette augmentation de l'instabilité et des risques qui ont rendu de plus en plus difficile l'acquisition des moyens de subsistance, tandis que les matériaux de jouissance, en se multipliant, aiguillonnaient des tentations qui ne pouvaient être apaisées que par cette acquisition, est née la préoccupation constante et exclusive de la recherche de la richesse. Sans doute, le désir de la richesse est légitime en soi. Il faut que l'individu se crée les ressources nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble de ses devoirs envers lui même et envers autrui. De plus, en s'enrichissant, au moins par les voies légitimes, il augmente ce qu'on pourrait appeler son pouvoir d'utilité. Mais il est rare que l'appétit immodéré de la richesse ne pousse pas l'individu à sortir de ces voies légitimes.
Bref, l'exercice du gouvernement individuel est devenue plus difficile depuis que l'individu est devenu plus libre et que les progrès de l'industrie ont augmenté à la fois les risques de la production et les tentations de la consommation, sans que la capacité du gouvernement de soi-même se soit développée dans la même proportion. Et si l'on songe que l'insuffisance et les vices du gouvernement individuel aussi bien que ceux du gouvernement collectif se répercutent sur la condition générale des sociétés, on s'expliquera que la somme du bien-être de la multitude ne se soit pas accrue, à beaucoup près, dans la mesure du progrès des moyens d'acquisition de la. richesse.
V
Comme nous l'avons vu plus haut, les causes de l'imperfection du gouvernement individuel sont les unes extérieures, les autres intérieures. Les premières consistent dans la diversité et l'imperfection des codes qui prescrivent à l'individu les règles qu'il doit suivre dans le gouvernement de sa vie.
Le code de la société civile énumère et définit les actes contraires à la justice, qu'il qualifie, selon la gravité qu'il leur attribue, de crimes ou de délits, et qu'il sanctionne par des pénalités matérielles, proportionnées à leur gravité; le code de la société religieuse comprend, avec les mêmes actes, un grand nombre d'autres, sous la domination générique de péchés, et les [332] sanctionne par des pénalités exclusivement spirituelles, depuis que l'Eglise a cessé d'avoir à son service le bras séculier; enfin l'opinion contrôle plus attentivement encore que le gouvernement religieux les actes individuels, et sanctionne ceux qu'elle condamne par des pénalités morales, rupture des relations sociales, etc., qui ont des effets matériels. Quand ces différents codes ne s'accordent point, leur autorité se trouve naturellement affaiblie par leur désaccord; elle l'est plus encore lorsque les gouvernements civils ou religieux n'observent pas eux-mêmes les lois dont ils imposent l'observation, ou lorsqu'ils établissent une inégalité monstrueuse entre les pénalités repressives des actes qu'ils jugent contraires à leur intérêt particulier et ceux qui portent dommage à la société. Comment l'individu peut-il démêler ce qui est juste, ce qui est moral, ce qui doit être la règle immuable de sa conduite dans ce fatras de lois et de jugements qui se contredisent ou qui sont visiblement adultérés par les intérêts ou les passions de ceux qui les imposent?
On peut soutenir toutefois qu'en dépit des contradictions et des imperfections des codes des gouvernements civils et religieux, sans oublier le code changeant de l'opinion, la morale, dont ils ont imposé les règles et assuré l'obéissance de génération en génération, suffit à guider la conscience de l'individu dans le gouvernement de soi-même. Il en est ainsi peut-être quand la conscience est éclairée et forte, mais combien sont peu nombreux les hommes capables de discerner en toute occasion, ce qui est juste et d'y conformer leurs actes!
Aux incertitudes résultant des contradictions, des imperfections des codes, se joignent, pour augmenter les difficultés du gouvernement de soi-même, les circonstances du milieu, l'état moral et matériel de la société, et en particulier de la catégorie sociale à laquelle appartient l'individu et dans laquelle il est, pour ainsi dire, immergé. Si la classe de la population au sein de laquelle s'écoule son existence lui donne l'exemple de la moralité, il sera naturellement porté à suivre cet exemple. Et, de même, l'observation de la loi morale lui sera rendue facile s'il trouve dans cette classe une situation qui lui procure la sécurité de l'existence. Mais les circonstances morales et matérielles du milieu sont inégales et variables, et elles aggravent les difficultés naturelles du gouvernement de soi-même plus souvent qu'elles ne les allègent. S'il n'y a, dans la plupart des sociétés, qu'un petit nombre d'individus qui ne se font aucun scrupule de manquer aux prescriptions de la lui morale, le nombre est plus petit encore de [333] ceux qui s'appliquent à n'y jamais manquer. La masse se compose d'individus d'une moralité moyenne et rarement capables de résister aux impulsions des intérêts qui constituent leur « raison d'état ». De même les circonstances matérielles du milieu ne favorisent guère que le petit nombre, et les statistiques de la criminalité attestent que les infractions à la loi morale se multiplient en raison des difficultés de la vie.
Mais tout manquement à la loi morale a pour conséquence invariable, certaine, une déperdition de forces vitales, partant un affaiblissement de la société dont l'individu est membre, et, par répercussion, de l'espèce humaine tout entière, dont la société fait partie. Cela étant, la société a le droit incontestable de se défendre contre les atteintes que les vices et même la simple insuffisance du gouvernement individuel portent à son existence. Jusqu'où s'étend ce droit? Voilà ce qu'il importe de savoir.
VI
Si tous les individus qui constituent la multitude des sociétés entre lesquelles se partage l'espèce humaine étaient également capables de supporter la responsabilité attachée à la liberté, s'ils remplissaient pleinement les obligations qu'elle implique, ils useraient de leur liberté de la manière le plus utile a eux-mêmes et à leurs semblables. Dans ce cas, la société n'aurait aucun motif et aucun droit d'intervenir dans leur gouvernement individuel. Mais la capacité de se gouverner soi-même n'existe qu'à des degrés fort inégaux, et elle est loin d'être complète chez les individus qui la possèdent au degré le plus élevé. Même dans les sociétés les plus avancées en civilisation, combien sont nombreux les individus incapables de régler et de contenir les appétits qui les poussent à porter atteinte au bien ou à la liberté d'autrui! Or, et ceci est une observation essentielle, chaque atteinte au bien ou à la liberté d'autrui cause non seulement un dommage aux individus lésés, mais encore à la société entière dentelle diminue la sécurité et compromet par là même l'existence.
Mais l'insuffisance de la capacité de se gouverner soi-même n'a pas pour résultat unique et fatal de pousser l'individu à empiéter sur le domaine d'autrui. Il peut respecter le Code, ne pas dépasser les limites de sa liberté, et cependant se gouverner d'une manière nuisible à lui-même et à la société, en ne remplissant qu'imparfaitement les obligations qu'implique la responsabilité attachée à [334] la liberté. S'il détériore ses facultés productives par des consommations déréglées et des habitudes vicieuses, s'il n'élève pas ses enfants de manière à en faire des membres utiles de la société, s'il gouverne mal son domaine, s'il ne remplit pas correctement les devoirs de sa profession, il ne nuit pas seulement à lui-même, il nuit encore à la société dont il est membre. Tous les manquements au devoir, même quand ils ne portent aucune atteinte au bien et à la liberté d'autrui, ont pour conséquence une déperdition de forces. Or si les forces de la société diminuent par le fait des appétits vicieux des individus, des unions imprévoyantes, de la mauvaise éducation des enfants, si le sol mal cultivé et réparé s'épuise, la société tombera en décadence. Et si elle se trouve en concurrence avec d'autres sociétés mieux gouvernées, elle succombera inévitablement dans la lutte. N'a-t-elle pas le droit de se défendre, et, au besoin, d'enlever aux individus les libertés dont ils sont incapables de faire un usage utile? En les leur enlevant, ne sert-elle par leur intérêt même? Sa décadence et sa ruine n'entraînent-elles pas la leur?
N'oublions pas que dans toutes les anciennes sociétés, la multitude, incapable du self governement, était assujettie à la tutelle des plus capables, tutelle imposée sous les formes de l'esclavage, du servage ou de la sujétion, et que les plus capables eux-mêmes étaient soumis à des lois ou à des coutumes qui réglaient l'emploi de leur liberté, d'après un concept d'utilité, attribué à l'inspiration divine. Ce régime de tutelle imposée avait sa raison d'être à une époque où la capacité individuelle du gouvernement de soi-même était, pour ainsi dire, encore à l'état embryonnaire. Peut-on affirmer qu'il l'ait complètement perdue, et que les sociétés dans lesquelles l'individu se gouverne lui-même, quelle que soit sa capacité gouvernante, ne se trouvent pas exposées à la décadence et à la ruine?
Mais, s'il en était ainsi, quel serait le remède? Consisterait-il à dépouiller l'individu du gouvernement de lui-même pour le remettre à la société ? C'est la solution socialiste du problème. La société, agissant au moyen d'un pouvoir émané d'elle, assumerait la responsabilité de l'existence de chacun de ses membres, en leur assurant à tous des moyens de subsistance. Selon l'école communiste, toutes les parts devraient être égales; selon les autres écoles, elles pourraient être plus ou moins inégales, mais cette dissidence en matière de distribution n'a qu'une importance secondaire. Le trait essentiel du système, c'est la suppression de la responsabilité individuelle et, par conséquent, de la liberté. Si la société est [335] responsable de l'existence de l'individu, si elle se charge de toutes les responsabilités individuelles, elle doit s'emparer aussi de toutes les libertés qui étaient employées à pourvoir à ces responsabilités. Dans ce concept, l'individu appartient à la société qui en dispose à son gré, il est sa chose, et, en fait, celle du gouvernement investi du pouvoir social. En admettant qu'un tel régime fût possible, ne réduirait-il pas l'individu, débarrassé de toute responsabilité, mais privé de toute liberté, à la condition d'animal domestique?
Cependant, si la tutelle universalisée et imposée du socialisme n'est autre chose qu'une utopie rétrograde, l'expérience du régime actuel de liberté et de responsabilité individuelle, n'atteste-t-elle pas que ce régime est une source abondante de maux, et n'est-ce pas une autre utopie que de vouloir le perpétuer? En cela, les socialistes auraient raison, si les maux dont souffrent les sociétés étaient causés uniquement par l'imperfection et les vices du gouvernement individuel; mais la responsabilité n'en doit-elle pas être attribuée au moins, pour une grosse part, au gouvernement collectif de l'Etat, et est-ce bien en universalisant les attributions de ce gouvernement, dont ils dénoncent tous les jours l'incapacité, qu'on le rendra plus capable de les remplir?
VII
Sans doute, tous les individus dont se compose une société ne sont pas capables de faire un usage utile à la société et à eux-mêmes des droits constitutifs de la liberté; il en est aussi dont la capacité est limitée à l'exercice d'un certain nombre de droits, et qui se montrent incapables d'user utilement des autres. Tel est, parmi ceux-ci, le droit de participer par son vote au gouvernement collectif de la société. Partout, quoiqu'il y ait à cet égard des différences sensibles d'un pays à un autre, entre les nations de race anglo-saxonne et les nations dites de race latine, par exemple, —partout, disons-nous, la grande majorité des électeurs sont incapables d'user de leur droit d'une manière conforme à l'intérêt général et permanent de la société. La plupart d'entre eux mettent leur vote au service d'intérêts particuliers, — intérêts de leur industrie; de leur profession ou de leur localité, — sans s'inquiéter de savoir si ces intérêts particuliers s'accordent ou non avec l'intérêt général. La société n'est-elle pas, en conséquence, autorisée dans l'intérêt supérieur de sa conservation, à limiter le droit électoral aux individus capables de l'exercer [336] utilement? Mais comment reconnaître cette limite et où la placer ? On l'a établie tantôt en exigeant le paiement d'une contribution plus ou moins élevée, d'un « cens électoral », tantôt certaines conditions d'instruction. Quel a été le résultat? Comme ni la contribution ni l'instruction n'apportaient avec elles des garanties de moralité, la classe pourvue du monopole électoral se servait, sans scrupule, de ce monopole pour favoriser ses intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt général de la nation. On a cru remédier à ce vice du suffrage restreint par l'établissement du suffrage universel. Mais l'expérience a démontré encore que l'étalon moral ne s'élève pas à mesure que l'on descend dans les couches inférieures des sociétés, et que l'étalon intellectuel s'abaisse. L'extension du droit électoral a simplement grossi le nombre des électeurs incapables et peuplé les Parlements des individus les plus aptes à exploiter l'ignorance de la multitude et à flatter ses passions. C'est ainsi que le niveau de la représentation s'est abaissé à mesure que s'étendait le droit électoral, et que le régime parlementaire est devenu moins intelligent sans devenir plus moral. Le remède à l'insuffisance de la capacité électorale n'est donc ni dans la restriction ni dans l'extension de l'électorat. Nous avons vu ailleurs [155] que ce remède réside dans la limitation des attributions des gouvernements et des parlements, partant de leur pouvoir, demeuré illimité, de protéger certains intérêts aux dépens des autres.
Dans tous les pays civilisés, les gouvernements restreignent plus ou moins, ou même suppriment des libertés individuelles, en invoquant l'intérêt de la société.
Mais en supprimant, par exemple, la liberté d'association ou la liberté de la presse, c'est avant tout l'intérêt de leur domination qu'ils ont en vue, et en restreignant la liberté des échanges, ils obéissent à des intérêts dont l'appui leur est ou leur paraît nécessaire. D'ailleurs, même quand ces restrictions ou ces suppressions sont inspirées bona fide par l'intérêt de la société, elles ont un vice radical, en ce qu'elles atteignent les individus qui sont capables d'user de la liberté d'une manière utile à la société et à eux-mêmes, aussi bien que ceux qui en font un usage nuisible. D'où il résulte que la somme d'utilités dont elles empêchent la production, d'un côté, dépasse le plus souvent la déperdition qu'elles préviennent de l'autre. Ajoutons que l'assistance que les gouvernements, en leur qualité de mandataires de la société, accordent aux individus les [337] moins capables, c'est-à-dire à ceux qui ont besoin de recourir à l'aide d'autrui pour subsister, loin de remédier à ce mal, a pour résultat ordinaire de l'aggraver.
N'en déplaise aux socialistes et aux philanthropes, l'assistance de la société ne leur est point due, et ils n'ont aucun droit de la lui réclamer. Si un individu en tutelle a le droit d'être assisté par son tuteur, et tel est le droit de l'enfant à l'égard de ceux qui l'ont appelé à la vie, il en est autrement de l'individu libre et responsable de sa destinée, à l'égard de la société. Elle lui doit le service naturellement collectif de sécurité, pour lequel il lui fournit une contribution, de même que, de son côté, il lui doit cette contribution, rien de plus. En aidant un individu à vivre, quand il ne parvient pas lui-même à pourvoir à sa subsistance, soit par sa faute, soit par suite de calamités imprévues, ses semblables remplissent un devoir auquel ne correspond aucun droit, et on peut se demander. si le Gouvernement n'abuse pas de son mandat en imposant à tous les membres de la société l'exercice de ce devoir. En tout cas, si la charité, soit publique, soit privée, peut bien remédier à des maux actuels et urgents, elle est incapable d'apprendre à l'individu à se mieux gouverner elle a, au contraire, pour effet accoutumé, de diminuer l'aptitude du gouvernement de soi-même ou d'empêcher de l'acquérir, en affaiblissant le sentiment de la responsabilité individuelle.
VIII
Est-ce à dire qu'il n'y ait aucun remède à l'insuffisance flagrante, même dans les sociétés les plus avancées en civilisation, de la capacité de se gouverner soi-même?
Si les charges et servitudes du gouvernement collectif étaient réduites à la somme nécessaire à la garantie de la sécurité publique, si les lois dont il impose l'observation étaient uniquement inspirées par l'intérêt général et permanent de la nation, si elles n'étaient point employées à favoriser un petit nombre d'intérêts prépondérants aux dépens de la multitude, en un un mot, si elles étaient justes : si la morale religieuse n'était point viciée par la raison d'état du clergé, si l'opinion publique était assez éclairée et morale pour ne rendre que des jugements équitables, si ces freins extérieurs prêtaient, en conséquence, un concours plus efficace au frein intérieur de la conscience individuelle, le gouvernement de soi-même deviendrait, sans aucun doute, à la fois plus facile et meilleur. Mais ces progrès sont lents et ils [338] demeureront toujours incomplets. Or, si l'on songe que toute loi injuste, comme toute action, ou toute pratique immorale du gouvernement individuel, aussi bien que du gouvernement collectif, détermine une déperdition de forces vitales que cette déperdition, soit qu'elle diminue la vigueur physique ou morale de l'homme, soit qu'elle, atteigne les forces et les ressources du milieu où il vit, affaiblit la société et l'achemine à la décadence, que toutes les sociétés entre lesquelles se partage l'espèce humaine se trouvant en concurrence pour l'acquisition des subsistances, — concurrence manifestée tantôt par la guerre, tantôt par la lutte industrielle, — les moins fortes, celles qui sont le plus affaiblies par les vices de leur gouvernement collectif et individuel sont fatalement condamnées à périr, on sera amené à conclure que l'intérêt supérieur de la conservation des sociétés pourra exiger dans l'avenir, comme il a exigé dans le passé, la mise en tutelle des individus incapables de se gouverner utilement eux-mêmes, utilement, c'est-à-dire d'une manière conforme à l'intérêt général et permanent de la société et de l'espèce.
Mais il ne s'ensuit pas que les sociétés n'aient d'autre alternative que de revenir au anciennes formes de la tutelle, ou de laisser se perpétuer ces formes anti-économiques de la tutelle gouvernementale, qui ont pour vice commun de restreindre la liberté des individus capables de se gouverner avec celle des incapables. On peut demander à là liberté elle-même une solution plus utile du problème de la tutelle.
A la fin du XVIIIe siècle, la décadence des formes vieillies de la tutelle avait provoqué une réaction universelle contre ce régime. Les théoriciens du temps n'admettaient point que l'individu eût le droit d'aliéner sa liberté, en totalité ou même en partie, quand même il se sentirait, incapable de supporter la responsabilité, inséparable de la liberté, autrement dit qu'il fût libre de n'être pas libre. De nos jours, l'expérience: des maux causés par l'insuffisance de la capacité gouvernante a ébranlé la foi en cette théorie, qui.ne tenait aucun compte de la responsabilité. D'ailleurs, elle a subi dans la pratique des atteintes multipliées. Quoique les vœux religieux aient cessé d'être reconnus et sanctionnés par la loi, les Congrégations monastiques se sont rétablies étoiles recrutent un nombre croissant d'individus qui consentent de leur plein gré à se soumettre à des règles restrictives de leur liberté. De même, les armées attirent des volontaires qui acceptent la plus dure des servitudes pour se décharger du soin de leur subsistance. C'est, du moins, en partie, au même [339] besoin de sécurité, qu'il faut attribuer l'affluence des candidats aux fonctions de l'Etat, malgré les restrictions qu'elles apportent à l'indépendance individuelle. D'autres applications, à coup sûr plus fécondes, de la tutelle libre sont possibles mais nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'elles ne seront utiles qu'à la condition de développer le sentiment de la responsabilité et de rendre ainsi l'individu plus capable de se gouverner lui-même. Car tel est le but auquel il faut tendre. Comme le disait Charles Dunoyer dans son beau livre, un peu trop oublié, de La Liberté du travail, « c'est quand les hommes peuvent se servir avec le plus de liberté des facultés naturelles qui leur ont été données pour satisfaire leurs besoins de toutes sortes, qu'ils acquièrent le plus de puissance. »
Endnotes
[155] Voir l'Évolution politique et la Révolution, et La Morale économique.
PART VII. HIS LAST WORDS ON THE MATTER (1901–1911)↩
VII.19. Summing up the liberal successes and failures of the 19th Century (January, 1901)↩
Source
Gustave de Molinari, "Le XIXe siècle", Journal des Économistes,S. 5, T. 45, N° 1, janvier 1901, pp. 5-19.
online and (FrenchClassicalLiberals/Molinari/Articles/FutureLiberty/Molinari-19thC- JDE-1901-T45-JanMar.pdf).
Introduction
For Molinari the distinguishing feature of the 19th century, which made it different from all previous centuries in human history, had been the "prodigious" increase in productive power (le développement extraordinaire de la puissance productive de l'homme) made possible by economic liberty and the industrial revolution. Wealth in the United States had doubled in the second half of the 19th century and it had increased at twice the rate of population increase in Western Europe in the same period. The introduction of steam power had vastly increased the productivity of human labour, whilst the quality of labour had changed as a result of factory production, city life, and international trade. The "ties of solidarity" among people (les liens de solidarité entre les hommes) had multiplied as opportunities for trade and cooperative economic activity had developed. Molinari believed that, in the 19th century, the system of isolated and hostile states which had emerged in the 18th century had been replaced by nations linked together by international trade and mutual economic dependence. War and economic antagonism in the 18th century had been replaced, for a brief period at least, by peace and prosperity.
The key period of the 19th century for Molinari had been the two or three decades of the 1840s to the 1860s when Britain took the momentous step towards free trade, with the abolition of the Corn Laws in 1846. This liberalisation of trade enabled Britain to leap ahead of the other European nations in economic development and wealth creation, thus placing strong competitive pressure on them to do likewise. The Cobden-Chevalier free trade treaty between France and Britain in 1860 was a key part of the "internationalisation of progress" (internationaliser le progrès lui-même). For a brief period in the mid-19th century it seemed possible to liberals like Molinari that peace and free trade would henceforth "rule the world" (désormais régir le monde civilisé).
But unfortunately, like someone who has just won a huge amount of money in a lottery, Europeans in the late 19th century were not able to use this new-found wealth wisely. Traditional ruling elites from the landed aristocracy and the military remained politically powerful and resisted the process of economic liberalisation which brought in its train international peace and solidarity between peoples. The political agenda of the old ruling elites in the second half of the century had been to forge new coalitions with the two new classes which were emerging from industrialisation - wealthy industrialists and the urban working class. The traditional military elites forged an alliance with the new industrialists and the new democratic political parties to channel industrial technology and tax money into expanding and updating the army and navy, thus creating a new wave of militarism and imperialism from the 1870s onwards. With the notable exception of Britain which retained its policy of free trade, in Europe and America landed and industrial elites forged an alliance to reintroduce tariffs which retarded economic development, inflamed international rivalry, and placed a large burden on ordinary consumers and taxpayers, thus hampering their rise out of poverty. The result was a return to economic protectionism and ultimately tariff wars between the major powers.
In addition to the rise of militarism, imperialism, and protectionism in the second half of the century, there was also the growth of what Molinari called "l’étatisme" (or "fonctionnairisme") or even in some circumstances "the leprosy of Statism" (la lèpre de l'Etatisme).In his view, the state is a mechanism which enables a small group of people (perhaps 10% of the population) to gain economic and political benefits for themselves at the expense of ordinary taxpayers and citizens. In pre-democratic and early industrial societies, the state was the tool of the traditional landed, military and commercial elites. With the extension of the franchise to most working males in the late 19th century there arose a new, more numerous group who wished to use the state to gain benefits for themselves at the expence of others. Labor and socialist parties emerged to service the political needs of the newly enfranchised working class. Traditional conservative parties and even the more recently formed liberal parties adopted parts of the socialist political and economic agenda in order to appeal to the new electorate. The result, in Molinari's view, was a major unraveling of liberal reform and a defeat for the "party of cheap government" (le gouvernement à bon marché) or the "party of the least government" (le parti du moindre gouvernement). The state expanded rapidly in size at all levels (local, departmental, and provincial) in order to provide jobs for the new political constituencies, thus creating a powerful mechanism for patronage and vote-buying at election time. Entire sectors of the economy had been nationalised or "municipalised" (such as gas, water, electricity, post office, railways) for the same purpose. The result was statism, "fonctionnaireisme", or "socialism", which increased the number of people dependent upon the state for income, raised taxation for the ordinary taxpayer, and caused economic losses due to the higher cost and greater inefficiency of state-supplied services.
Molinari was very concerned about the direction European society was heading at the turn of the century. Although technology and industrialisation and international trade had vastly increased wealth (and seemed ready to continue doing so in the new century), the combined effect of protectionism, militarism, imperialism, and statism (especially in its new guise of socialism) would result in economic breakdown, wars unprecedented in their destructiveness, political tyranny and socialist revolution. One of the biggest problems was government debt which he estimated, if it kept increasing at current levels, the total public debt of the European nations would reach the figure of 400 billion by the year 2000 which was an economic burden he predicted would be too great for the wealth creators to sustain. In his role as "the bookkeeper of policy" (le teneur de livres de la politique) Molinari concluded that at the time of writing this essay "en regard des progrès qui constituent son actif, elles ont produit un passif qui a absorbé, sinon la totalité, au moins une part trop considérable de cet actif de progrès" (on the opposite side of the ledger showing the credit produced by (economic) progress there is a debit which has absorbed, if not the totality but at least a very considerable part of the credit produced by progress ).
However, Molinari still remained hopeful that the principles of peace and free trade would be rediscovered sometime in the future, but not until after civilisation as he knew it had been destroyed.
Text
Le XIXe siècle
[5]
I.
Le trait caractéristique du siècle qui vient de finir, ce qui le distingue de tous ceux qui l'ont précédé, c'est le développement extraordinaire de la puissance productive de l'homme. Par la conquête et l'asservissement des forces mécaniques et chimiques, ajoutées ou substituées à sa force physique dans l'œuvre de la production, il a pu augmenter, dans des proportions qui eussent semblé autrefois invraisemblables, les matériaux de la vie. On aura une idée de ce progrès, accompli surtout dans la seconde moitié du siècle, en consultant les tableaux de l'accroissement de la richesse aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans le pays où l'industrie est arrivée à son plus haut point de productivité. Tandis qu'en 1850 la richesse de l'Union américaine n'était évaluée qu'à 7 milliards 135 millions de dollars, soit à 308 dollars par tète, elle s'élevait, d'après le dernier recensement de 1900, à 90 milliards, soit à 1. 180 dollars par lote. Dans la dernière décade seule, l'augmentation avait été de 35 milliards, — une somme de richesses plus considérable, au dire du Dr Powers, que celle que le continent américain tout entier avait pu accumuler depuis la découverte de Christophe Colomb jusqu'au commencement de la guerre de la Sécession. Il y a sans doute quelque chose à rabattre dans cette statistique américaine, et nous devons confesser, en toute humilité, que la richesse de l'Europe n'a pas fait depuis un demi-siècle une aussi prodigieuse enjambée; mais nous pouvons conjecturer, d'après les chiffres du rendement des impôts, sans parler d'autres indices, que dans tous les pays où le vieil [6] outillage de la production industrielle et agricole a été transformé et renouvelé, la richesse s'est accrue dans une proportion au moins double de celle de l'augmentation de la population, malgré les charges et les obstacles de tous genres que les vices et l'ignorance des gouvernements aussi bien que ceux des gouvernés opposent à son développement naturel et régulier.
On s'expliquera ce phénomène,si l'on songe à la somme énorme de travail à bon marché que nous ont procurée l'invention et les perfectionnements successifs de la machine à vapeur. On estime au plus bas mot que le travail d'un cheval-vapeur équivaut à celui de 10 hommes. [1] Or, la statistique officielle nous apprend que le nombre des chevaux-vapeur s'est élevé en France de 60.000 en 1840 à 6.300.000 en 1897. C'est donc une somme de travail égal à celle de 63 millions d hommes qui a été mise au service de l'industrie française. Et non seulement ce travail est plus économique de toute la différence du prix de la houille, nourriture de la machine, et de celui de l'alimentation végétale ou animale de l'homme, mais encore il développe une puissance et obtient des résultats qu'aucun déploiement de forces humaines ne pourrait atteindre. On aurait beau accumuler une masse de travail humain décuple de celle de la machine d'un train express, c'est à peine si l'on obtiendrait une vitesse dix fois moindre. Et en supposant que des milliers d'hommes échelonnés à portée de la voix fussent employés à transmettre un message, leur travail serait impuissant à rivaliser de vitesse avec celui du télégraphe, tout en coûtant des milliers de fois plus cher.
Mais l'accroissement de la quantité des produits et des services qui constituent la richesse n'a pas été le seul ni peut-être même le plus important résultat de la transformation de la machinerie de l'industrie; elle en a eu deux autres d'une portée supérieure, en élevant la nature du travail réservé à l'homme dans l'œuvre de la production, et en étendant avec la sphère des échanges celle de la solidarité humaine.
Les machines ne fournissent qu'un travail matériel dont les opérations doivent être dirigées ou tout au moins surveillées par l'intelligence de l'homme. Si elles le dispensent d'un effort physique, [7] elles exigent une application constante de sa force intellectuelle et elles engagent souvent au plus haut degré sa responsabilité morale. Un conducteur de locomotive et un aiguilleur, par exemple, ne dépensent dans leur journée qu'une faible somme de force physique, mais leur attention doit être appliquée sans relâche à l'opération qui leur est confiée. Si leur intelligence n'y est pas suffisamment tendue, s'ils n'ont qu'à un faible degré le sentiment de leur responsabilité, ce défaut d'application à leur devoir peut causer la perte de centaines de vies, sans parler des dommages purement matériels. Mais l'exercice de l'intelligence et de la responsabilité ont pour effet naturel de développer les facultés mises en œuvre, et c'est ainsi que le niveau intellectuel et moral des ouvriers qui dirigent ou surveillent le travail des machines apparaît dans toutes les branches d'industrie que le progrès a touchées comme manifestement supérieur à celui des simples manœuvres qui font l'office de machines.
Le progrès industriel n'a donc pas eu seulement pour effet d'augmenter la quantité des produits, il a élevé, pour ainsi dire, la qualité des producteurs. Il a eu encore un autre effet, non moins bienfaisant, c'est d'étendre et de multiplier les liens de solidarité entre les hommes. Dans les siècles qui ont précédé le nôtre, la sphère de la solidarité ne dépassait guère les frontières des Etats. Les membres de chaque nation formaient une société d'assurance mutuelle contre le risque d'invasion et de pillage, quand ils n'étaient pas eux-mêmes envahisseurs et pillards. S'ils étaient intéressés à la prospérité les uns des autres, ils ne l'étaient point à celle des membres des autres nations. Ils avaient, au contraire, intérêt à la diminution des forces et des ressources des peuples avec lesquels ils étaient continuellement en guerre. Cet état de choses a changé, la solidarité a succédé à l'antagonisme, lorsque les échanges ont associé les intérêts des individus appartenant à des nations différentes. Or, c'est l'accroissement de la productivité de l'industrie qui a provoqué en la nécessitant l'extension de la sphère des échanges. Lorsque le travail, assisté par une machinerie de plus en plus puissante, — et pour emprunter un exemple au rapport de Michel Chevalier sur l'Exposition de 1867, lorsque l'introduction du moteur circulaire a porté de 80 à 480.000 le nombre de mailles qui peuvent être confectionnées en une minute dans la fabrication des tricots, — le marché local a cessé de suffire à cette production exubérante, il a fallu agrandir son débouché, et il en a été ainsi dans toutes les industries où le travail à la machine se substituait au travail à la main. Alors, [8] pour répondre à ce besoin d'extension des marchés s'est produite une demande extraordinaire de progrès des moyens de communication. Les inventeurs, utilisant les découvertes de la science, se sont appliqués à satisfaire à cette demande; la vapeur, puis l'électricité ont été employées à surmonter l'obstacle des distances. 780.000 kilomètres de chemins de fer, 1.800.000 kilomètres de lignes télégraphiques, construits presque en totalité dans la seconde moitié du siècle, des lignes de navigation à vapeur qui établissent des communications régulières entre les parties les plus éloignées du globe ont commencé l'œuvre de l'unification des marchés des produits, des capitaux et du travail.
Malgré les obstacles que cette extention de la sphère des échanges a rencontrés dans les intérêts attachés à l'ancien état des choses, elle se poursuit avec une force d'impulsion irrésistible, et on peut déjà en apprécier la portée finale en comparant l'état de développement des rapports économiques des nations au début et à la fin du siècle.
Nous n'avons que des données partielles et incertaines sur le commerce extérieur des nations civilisées dans les siècles précédents; nous savons seulement que le commerce de l'Angleterre en 1800 n'atteignait pas 2 milliards de francs [2] et que celui des autres nations réunies s'élevait à peine à ce chiffre; en sorte que le commerce du monde civilisé tout entier ne dépassait pas le commerce actuel de la Belgique. M. Levasseur l'évaluait dernièrement à 87 milliards pour la période 1894-95, [3] c'est-à-dire qu'il aurait au moins vingtuplé dans le cours du siècle. Le commerce international des capitaux ne s'est pas moins développé que celui des produits. La statistique ne nous fournit, à la vérité, aucune donnée sur la production du capital dans la période qui a précédé l'avènement de là grande industrie, et elle ne nous renseigne encore que d'une manière approximative sur son importance actuelle. M. Robert Giffen a évalué à 200 millions sterl. — 5 milliards de francs — le montant de l'épargne annuelle du Royaume-Uni, ce qui est peut-être excessif. Mais on peut affirmer avec certitude que la productivité de l'épargne s'est accrue avec celle de l'industrie, et on sait que les pays où la production des capitaux s'est particulièrement développée, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, en fournissent des quantités [9] croissantes au reste du monde. La transformation de l'outillage de la production industrielle et agricole, sans oublier celle du matériel de guerre, maritime et terrestre, en a demandé des quantités énormes, surtout dans !e dernier quart de siècle. Seule, la construction des chemins de fer en a absorbé environ 200 milliards. Mais, non moins que l'exportation des produits, celle des capitaux crée et multiplie les liens de solidarité entre les peuples. Les pays importateurs de capitaux sont intéressés à la prospérité de ceux qui les produisent, afin de les obtenir en abondance et à bon marché, les pays exportateurs le sont plus encore à celle de leurs débiteurs.
Le développement de la production, déterminé par la création d'une machinerie à la fois plus puissante et plus économique, a élargi aussi, quoique dans une proportion moindre, les débouchés du travail. La population s'est accrue dans la mesure de l'extension de son débouché ; elle a doublé en Europe dans le cours du xixe siècle, et elle a fourni, en outre, à l'émigration un contingent qui a dépassé en une seule année celui qu'elle lui fournissait auparavant en un siècle. De 10.000 individus en 1820, l'émigration s'est élevée à 871.000 en 1887 et, en l'espace de quatre-vingts ans, elle n'a pas porté moins de 15 millions d'hommes de race blanche dans les autres parties du globe. Ces émigrants ont fécondé par leur travail et acquis au domaine de la civilisation d'immenses régions, dont les ressources naturelles demeuraient improductives; ils ont fait souche de peuples nouveaux, approvisionné l'Europe de matières premières et de denrées alimentaires, agrandi les débouchés de son industrie et étendu, avec la sphère de l'échange, celle de la solidarité des intérêts.
Telle a été l'œuvre capitale du xixe siècle, et la meilleure part de son actif. A des Etats isolés et politiquement hostiles, il a commencé à substituer des nations économiquement unies par les liens de plus en plus nombreux et serrés de l'échange. Et cette extension de la sphère de l'échange a eu, en même temps, pour résultat d'internationaliser le progrès lui-même. Toutes les nations se trouvant désormais en concurrence, leurs industries sont obligées de s'assimiler tous les progrès réalisés ailleurs, sous peine d'être exclues du marché général, et même de leur propre marché. Au commencement du siècle ces progrès qui multipliaient les produits en abaissa ut les frais de la production étaient,pour ainsi dire, le monopole de l'Angleterre. Après s'être efforcés de se protéger contre eux, par les barrières de la douane, les industriels du continent ont compris la nécessité de les imiter, et c'est ainsi [10] que les produits manufacturés de la France, de la Suisse et, en dernier lieu, de l'Allemagne, ont réussi, grâce au stimulant de la concurrence britannique, à dépasser en quantités croissantes les frontières du marché national.
Aujourd'hui a surgi un nouveau concurrent, l'industrie américaine, armée de machines-outils qui abaissent encore les prix de revient, demain surgira peut-être la concurrence chinoise, dont la bienfaisante influence s'ajoutera à celle de la concurrence américaine pour provoquer en Europe un mouvement de réforme des impedimenta politiques, fiscaux, protectionnistes, qui élèvent artificiellement le prix des matériaux de la vie.
Avons-nous besoin d'ajouter que des siècles se passeront avant que l'humanité soit exposée à produire plus qu'elle ne peut consommer. Malgré l'essor que la conquête d'un contingent colossal de forces naturelles est en train d'imprimer à sa capacité productive, l'humanité est encore pauvre, très pauvre, et il faudra que sa production annuelle soit au moins décuplée pour lui assurer une modeste aisance.
Mais c'est seulement par l'extension de l'organisme de la production et de l'échange que le travail, assisté des forces de la nature, pourra satisfaire avec une abondance de plus en plus grande les besoins, encore aujourd'hui si incomplètement desservis, de la consommation. Or cet organisme est d'une sensibilité extrême, et à mesure qu'il s'étend et solidarise des intérêts plus nombreux dans les différentes parties du globe, les causes de perturbation, telles que les guerres et les autres calamités dues aux vices et à l'ignorance des gouvernements et des individus, qui se manifestent sur un point du marché agrandi des échanges, se répercutent sur tous les autres. Ces causes de désordre et de ruine n'ont pas cessé de se multiplier et même de s'aggraver dans le cours du siècle, et, en regard des progrès qui constituent son actif, elles ont produit un passif qui a absorbé, sinon la totalité, au moins une part trop considérable de cet actif de progrès.
II.
Il semblerait que l'accroissement extraordinaire du commerce international, en développant entre les peuples la solidarité des intérêts et en augmentant, parla même, le besoin de la paix, eût dû rendre les guerres plus rares. On pouvait d'autant plus se bercer de cette espérance que les progrès de l'industrie augmentaient chaque jour le nombre et la richesse de la classe [11] dirigeante de la production et lui valaient une part d'influence plus considérable dans le gouvernement des Etats. Cependant, il n"en a pas été ainsi. Les guerres n'ont pas été moins nombreuses au xixe siècle, et elles ont été bien autrement destructives et coûteuses qu'elles ne l'avaient été au xviiie.
Nous ne possédons pas le compte des vies humaines que la guerre a consommées depuis les dernières années du règne de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, mais c'est le porter fort haut que de l'évaluer à un million. Les armées étaient alors peu nombreuses et les difficultés du recrutement obligeaient les généraux à ménager la vie de leurs soldats. La Révolution a changé cet état de choses en mettant à la disposition des chefs des armées républicaines ou impériales un nombre illimité de réquisitionnaires ou de conscrits. Ils ont obtenu ainsi un avantage décisif sur leurs adversaires, accoutumés aux pratiques de l'ancien système, et l'on sait que Moreau qualifiait Napoléon de vainqueur à raison de 10.000 hommes par heure. Le peu de développement du crédit public obligeait de même les gouvernements à limiter leurs armements, et à conclure la paix aussitôt que leur trésor était épuisé. La faible augmentation des dettes publiques dans le cours du xviiie siècle nous fournit à cet égard une indication positive. D'après une statistique dressée par Dudley-Baxter, elles ne se seraient accrues que de 5 milliards dans la période de 1715 à 1793; [4] mais, à dater de cette époque,on voit l'industrie destructive de la guerre prendre un essor plus prodigieux encore 12] que celui des industries productives. Les guerres de la Révolution et de l'Empire consommèrent environ 5 millions d'hommes; et ce compte s'est particulièrement accru dans la seconde moitié du siècle. En additionnant les victimes de la guerre depuis la Révolution, on est arrivé au monstrueux total de 9.840.000, près de 120 millions pour les pays appartenant à notre civilisation. La consommation des capitaux a progressé plus rapidement encore que celle des hommes. En sus des dépenses couvertes annuellement par l'impôt, la guerre et la paix armée, autrement dit la préparation à la guerre, ont participé pour cent milliards, au plus bas mot, à l'augmentation des dettes publiques dans le cours du siècle.
Cependant, ce qui était jadis la raison d'être de la guerre a cessé d'exister. Aussi longtemps que les peuples civilisés ont été menacés de destruction ou tout au moins de dépossession par les invasions des barbares, la guerre a été une nécessité. Car il fallait bien s'assurer contre un péril toujours imminent et inévitable.
Mais grâce aux progrès du matériel et de l'art de la destruction — et ces progrès n'ont pas été, pour le dire en passant, moins utiles que ceux du matériel et des arts de la production — ce péril a disparu. Les peuples civilisés envahissent au contraire et s'approprient les régions occupées par leurs anciens envahisseurs. La guerre ne s'impose plus à eux. Elle dépend de leur volonté.
Il s'agit donc de savoir s'ils ont encore intérêt à la vouloir. Cet intérêt existait sans aucun doute pour les aristocraties qui trouvaient dans la conquête d'un Etat ou d'une province un supplément de serfs ou de sujets qui leur fournissaient, par les corvées, les redevances ou les impôts, un supplément de revenus. Mais que peut bien rapporter la conquête de la province ou de l'Etat le plus riche à une nation qui demande ses moyens de subsistance non plus au pillage ou à l'exploitation du travail de ses esclaves, de ses serfs ou de ses sujets, mais à la culture de son sol et à la pratique honnête de son industrie ? L'expérience de toutes les guerres qui ont ravagé le monde dans le cours de ce siècle n'a-t-elle pas attesté qu'elles ont coûté aux vainqueurs plus qu'elles ne leur ont rapporté ? Comment donc s'expliquer que des êtres pourvus de raison et sachant compter continuent à pratiquer une industrie qui travaille à perte? Ce serait là sans doute un phénomène inexplicable, et une aberration du ressort des médecins aliénistes si les producteurs — chefs d'industrie, capitalistes et ouvriers qui paient les frais de toutes les guerres, possédaient [13] dans le gouvernement des nations une influence prépondérante. Mais, en dépit des révolutions, des unifications et des constitutions politiques qui ont eu pour objet d'affranchir les nations de l'exploitation d'une caste nationale ou étrangère, la forme de leurs gouvernements seule a changé, le fond est demeuré le même. Les intérêts particuliers n'ont pas cessé de se coaliser pour faire la loi à l'intérêt général. Et dans toute l'Europe les intérêts engagés dans la conservation de l'état de guerre, intérêts militaires et politiques, sont demeurés prépondérants. Les armées et les fonctions publiques qui étaient sous l'ancien régime l'unique débouché de la classe gouvernante, n'ont pas cessé d'être considérées comme supérieures aux autres emplois de l'activité humaine. Elles attirent encore de préférence les rejetons de l'ancienne classe dominante avec les parvenus de la nouvelle, et constituent un puissant faisceau d'intérêts, aussi bien dans la plupart des républiques que dans les monarchies. Or, la guerre étant aujourd'hui comme elle l'était jadis une source de profits et d'honneurs pour les militaires professionnels, il est naturel qu'ils y poussent. « Connaissez-vous bien mon armée, disait Napoléon? C est un chancre qui me dévorerait, si je ne lui donnais de la pâture ! » [5]
Cette pâture, les détenteurs du pouvoir, chefs d'Etats et politiciens, sont d'autant plus disposés à la lui donner que la guerre fait taire les oppositions et ajourne, sauf à les aggraver plus tard, les difficultés intérieures. On s'explique donc que la guerre ait survécu aux périls qui menaçaient la civilisation, et il y a grande apparence qu'elle leur survivra aussi longtemps que cette industrie destructive disposera d'une influence politique supérieure à celle des industries productives qui en supportent les frais et les dommages. On s'explique aussi que l'accroissement extraordinaire de la productivité de l'industrie, en augmentant la richesse et la puissance des nations, ait déterminé un développement correspondant des appareils de guerre. Du moment où le risque de guerre subsiste et peut échoir du jour au lendemain, sous la pression d'intérêts qui demandent une pâture, il faut bien s'armer contre ce risque, opposer à l'ennemi une puissance destructive au moins égale à la sienne et, par conséquent, l'augmenter dans la proportion des forces et des ressources que créent et développent les progrès de l'industrie. Cette proportion, le régime de la paix armée l'a certainement atteinte aujourd'hui en Europe, s'il ne l'a point dépassée.
[14]
Ces énormes effectifs que nécessite le régime de la paix armée ne peuvent, d'ailleurs, sous peine de se rouiller, demeurer toujours inactifs. Un chômage trop prolongé détériore les ateliers de la destruction aussi bien que ceux de la production. La guerre est nécessaire à la santé des armées. Aussi ensigne-t-on dans les écoles militaires que chaque génération doit avoir la sienne. Mais les dettes publiques se sont tellement alourdies et le prix de revient d'une guerre entre des nations égales en puissance s'est tellement accru, qu'il est devenu de plus en plus difficile de donner satisfaction aux professionnels de l'art. Qu'a-t-on fait? On a remplacé, dans ce dernier quart de siècle, les guerres, désormais trop coûteuses entre les nations civilisées, par des guerres de conquête, d'exploitation ou de rapine, en dehors du domaine de la civilisation. Les gouvernements européens se sont partagé l'Afrique et ils mettent aujourd'hui la Chine au pillage, sous prétexte d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'industrie et de faire participer les nègres, sans oublier les Chinois, aux bienfaits de notre civilisation. Mais il suffit d'additionner et de comparer les frais de conquête et de conservation des colonies, des protectorats et des zones d'influence avec les profits qu'en tirent l'industrie et le commerce, pour être édifié sur la valeur de ce prétexte. La conquête, l'assujettissement, l'exploitation fiscale et protectionniste n'ont pas la vertu d'étendre les débouchés de l'industrie et du commerce. Ils contribuent plutôt à les resserrer en augmentant les charges que les budgets de la guerre, de la marine et des colonies font peser sur toutes les branches de la production. Quant à la civilisation, est-ce bien par le massacre et le pillage qu'on peut en faire apprécier les bienfaits aux « Barbares »?
Aux frais d'armement hors de toute proportion avec les besoins réels de sécurité des peuples civilises, aux guerres engagées pour donner satisfaction à des intérêts de caste, de parti ou de dynastie, il faut ajouter, dans la colonne du passif du xixe siècle, une augmentation continue du prix des services sur lesquels les gouvernements font main basse aux dépens de l'activité privée, et les frais d'un système de prétendue protection de l'industrie qui ne rétribue aucun service.
Les révolutions et les réformes politiques qui ont eu pour objet d'enlever aux oligarchies nobiliaires et cléricales de l'ancien régime le monopole du gouvernement des nations n'ont eu, en fait, d'autres résultats que d'étendre successivement ce monopole, et de conférer ainsi à une classe de plus en plus nombreuse le pouvoir et l'influence naturellement attachés à la possession de [15] l'Etat. Les fonctions qui servaient de débouchés à l'ancienne classe gouvernante n'ont plus suffi à la nouvelle. Il a fallu les multiplier pour satisfaire à l'accroissement de la demande. L'extension des attributions de l'Etat est devenue par conséquent une nécessité politique. En vain, les économistes, gens naïfs et incapables d'apprécier ce genre de nécessité, se sont évertués à démontrer que les produits et les services de l'Etat reviennent plus cher aux consommateurs que ceux de l'industrie privée ; que les fonctionnaires de l'Etat sont plus mal recrutés, moins laborieux et moins serviables que ceux des entreprises particulières, rien n'y a fait. Sous la pression irrésistible des influences électorales et autres, l'Etat a étendu ses attributions et multiplié ses fonctionnaires, et les petits Etats municipaux, départementaux ou provinciaux ont suivi partout l'exemple du grand. Pour ne citer que la France, le nombre des fonctionnaires publics de tout ordre s'y est élevé, dans le cours du siècle, de 60.000 à 400.000, et l'étatisme va, de même, se propageant dans les autres pays, sans excepter l'Angleterre, à mesure que l'extension de la classe gouvernante augmente la demande des places.
Aux bénéfices provenant du monopole des fonctions publiques se joignaient, sous l'ancien régime, ceux des privilèges en matière d'impôts et des redevances féodales. Ces privilèges et ces redevances, après avoir été abolis sous leurs anciennes formes, ont peu à peu reparu, sous d'autres formes adaptées aux intérêts dominants. Les impôts indirects et les monopoles qui pèsent principalement sur les couches politiquement les moins influentes de la population, et qui ne figuraient en France que pour un tiers dans le budget des recettes, ont atteint successivement la proportion des deux tiers. Les droits de douane que le traité de 1786 avait abaissés, sous l'influence des doctrines libérales, propagées en Angleterre par l'école d'Adam Smith, en France par celle de Quesnay et de Turgot, ont été relevés, d'abord à titre d'instruments de guerre, ensuite d'instruments de protection et mis au service des intérêts politiquement influents. Ils ont remplacé, pour les grands propriétaires terriens, les redevances féodales et ont été étendus aux détenteurs de la propriété industrielle coalisés avec eux.
Cette coalition s'est rompue en Angleterre, et les intérêts agrariens réduits à leurs propres forces ont succombé sous l'effort de la Ligue contre les lois céréales. La multitude, exonérée du tribut qu'elle payait aux intérêts privilégiés, a pu augmenter sa consommation des articles de nécessité et de confort, tout en accroissant son épargne, et l'industrie britannique, encouragée par [16] le développement de la consommation et stimulée par la concurrence, a pris un essor merveilleux. [6]
L'exemple de l'Angleterre a été suivi d'abord par les autres nations et on a pu croire, un moment, qu'une nouvelle ère de liberté et de paix allait s'ouvrir pour le monde. Mais l'illusion a été courte. Les intérêts militaristes et protectionnistes n'ont pas tardé [17] à reprendre le dessus. La guerre de la Sécession américaine, en donnant la victoire aux Etats protectionnistes, leur a permis d'élever le tarif au gré de leurs appétits. La guerre franco-allemande, en provoquant, avec une recrudescence du militarisme, l'accroissement général des budgets de la guerre, a obligé les gouvernements à demander à leurs parlements un complément de ressources. La coalition protectionniste a trouvé cette occasion favorable pour se reformer et mettre à prix son concours.
Les tarifs de douane ont été relevés dans le double intérêt de la fiscalité et de la protection. En Allemagne, en Italie, en France les droits sur les articles de première nécessité, le pain et la viande, ont été exhaussés de manière à en élever les prix d'un tiers ou de moitié, dans l'intérêt des propriétaires fonciers, tandis que d'autres exhaussements de tarifs sur les matériaux des vêtements, de l'ameublement, des transports, fournissaient, avec l'adjonction d'un système de primes, la part de leurs alliés, les propriétaires d'industries, aux dépens de la généralité des consommateurs et des contribuables. Aux impôts que ceux-ci doivent à l'Etat s'ajoutent les impôts qu'ils ne doivent pas, et qui ne sont, en réalité, autre chose que les vieilles redevances féodales transformées et modernisées.
On s'explique donc que l'augmentation extraordinaire de la richesse, déterminée par une merveilleuse efflorescence de progrès, n'ait pas accru d'une manière équivalente le bien-être des peuples civilisés. L'incapacité et les vices des gouvernements, le militarisme, l'étatisme, le protectionnisme ont dévoré une forte part de cette plus-value de l'industrie. L'ignorance et l'insuffisance morale des individus émancipés de l'onéreuse tutelle de la servitude, mais encore incapables de supporter tout le poids de la responsabilité attachée à la liberté, en ont détruit ou stérilisé une autre part. Il faut bien le dire. La multitude qui vivait au jour le jour du produit de son travail ne possédait ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour mettre en pleine valeur son capital de forces productives. Comme le constatait Adam Smith, l'ouvrier dépourvu d'avances se trouvait vis-à-vis de l'employeur dans une situation inégale, qu'aggravait la défense de remédier à cette inégalité par l'association. D'un autre côté, il avait à faire le difficile apprentissage de la liberté, il devait régler et contenir ses besoins actuels en prévision des nécessités futures, pourvoir aux accidents et aux chômages, remplir toutes ses obligations envers lui-même et envers les êtres dont il était responsable. Doit-on s'étonner s'il n'a point suffi à cette tâche, si, avec un salaire [18] débattu dans des conditions inégales et diminué par les charges des impôts qu'il devait et celles des impôts qu'il ne devait pas, il a trop souvent succombé sous le faix, et si, en même temps que croissait la richesse, se propageaient la misère et la dégradation morale?
Ces maux qui ont accompagné la transformation de l'industrie et l'émancipation des classes ouvrières, les économistes se sont appliqués à les rattacher à leurs véritables causes, et à réclamer les réformes propres à y remédier. Mais ces réformes se heurtent à des intérêts puissants et intraitables, et elles n'ont point d'ailleurs une efficacité immédiate et radicale. Les socialistes ont eu plus de succès en attribuant en bloc les souffrances de la multitude à un pouvoir mystérieux et redoutable qu'ils ont désigné et stigmatisé sous le nom de tyrannie du capital. Cette tyrannie, ils convient les masses ouvrières à la renverser, en employant le procédé expéditif d'une révolution sociale. La révolution faite les socialistes autoritaires, collectivistes ou communistes, se proposent de charger l'Etat de réorganiser la société ; les socialistes anarchistes, au contraire, veulent abolir l'Etat, mais les uns et les autres s'accordent sur un point essentiel : la confiscation du capital.
Et telle est la solution de la question sociale qui tient le record de la popularité à l'aurore du xxe siècle.
III.
Le xixe siècle lègue à son successeur un héritage de milliardaire. Aucun de ses prédécesseurs n'a autant grossi la fortune qu'il avait reçue. Mais s'il a agrandi son domaine et augmenté dans des proportions auparavant inconnues la somme de ses richesses immobilières et de ses valeurs mobilières, il laisse cet énorme héritage fortement grévé de dettes. Il lègue aussi à ses héritiers, sans parler des vices communs à tous les siècles, et dont il ne s'est guère appliqué à se corriger, des habitudes enracinées et aggravées de dissipation et de gaspillage.
Le xxe siècle continuera sans aucun doute à accroître la productivité de l'industrie et à multiplier la richesse. Ses savants, ses inventeurs, ses industriels, ses capitalistes, ses ouvriers ne chômeront point, ils travailleront sans relâche à augmenter la somme des matériaux de la civilisation et du bien-être. Mais il est malheureusement permis de craindre que l'œuvre de ces artisans laborieux de la production ne continue aussi à être contrariée, par [19] l'aveugle égoïsme des intérêts, que ses fruits ne soient, comme d'habitude, détournés de leur destination utile, et employés à des fins nuisibles.
Pendant que la science et l'industrie multiplient la richesse, le militarisme, l'étatisme et le protectionnisme, en attendant le socialisme, s'associent pour la détruire, et en épuiser la source. Les recettes que le travail annuel des nations fournit au budget des gouvernements ne suffisent plus à leurs dépenses. C'est en grévant le travail des générations futures qu'ils rétablissent l'équilibre. Les dettes publiques de l'Europe ont doublé dans la seconde moitié du siècle. En suivant la même progression, elles atteindront pour le moins 400 milliards en l'an 2000. Quels que soient les progrès de la production, ce fardeau ne dépassera-t-il pas les forces des producteurs ? Souhaitons donc — et c'est le vœu le plus utile que nous puissions adresser à notre descendance —, que le xxe siècle n'excelle pas seulement, comme son devancier, à produire de la richesse, mais qu'il apprenne à la mieux employer.
G. DE MOLINARI.
Endnotes
[1] L'homme ne peut, dans les meilleures conditions possibles, effectuer en dix heures qu'un travail de 220.000 kilogrammètres. En une heure, une machine de 1 cheval-vapeur fait 270.000 kilogrammètres, soit plus qu'un homme en dix heures. On peut donc avancer qu'il faut, en général, 10 hommes pour faire le travail d'une machine de 1 cheval-vapeur. (Henri De Pahville. Causeries scientifiques).
[2] 30.570.000 liv. st. à l'importation et 43 152.000 liv. st. à l'exportation.
[3] L'influence des voies de communication au xixe siècle, par E. Levasseur, p. 12.
[4] D'après les recherches de M. Dudley-Baxter (dans son ouvrage National Debts), recherches qui sont, il est vrai, en partie conjecturales pour les périodes un peu éloignées de nous, l'ensemble des dettes nationales des pays civilisés montait, en 1715, à 7 milliards 500 millions de francs. En 1793. l'ensemble des dettes publiques des contrées de notre groupe de civilisation y compris les Etats-Unis et l'Inde anglaise, s'élevait à 12 milliards et demi de francs ; l'Angleterre devait à elle seule plus de la moitié de cette somme. De 1793 à 1820, les dettes nationales s'accrurent infiniment plus que dans les quatre-vingts années précédentes : l'ensemble, à la dernière de ces dates, peut être évalué à 38 milliards de francs dont 23 milliards pour la seule dette anglaise. De 1820 à 1848, le monde jouit d'une paix profonde. Aussi les engagements des nations ne s'élevaient-ils, en 1848, qu'à 13 milliards environ. La Révolution de 1848, les guerres du second Empire, etc., ont porté cette somme à 97.774.000.000 de francs en 1870. On peut estimer enfin que l'ensemble des dettes des nations plus ou moins civilisées dépasse actuellement 130 milliards. (Paul Leroy-Beaulieu. Traité de la science des finances, T. II. chap. XIV. Les dettes des grands Etats).
[5] Henri Welschlinger. Journal des Débats, 11 juillet 1900.
[6] Nous empruntons à notre jeune confrère l'Individualiste, le tableau suivant des résultats de la politique du libre-échange en Angleterre:
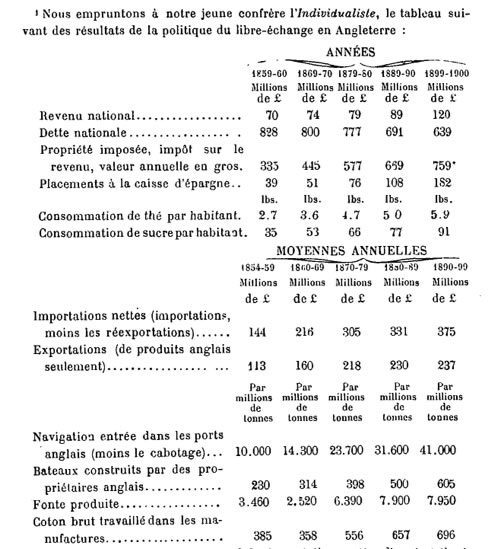
Or accumulé : De 1858 à 1899 le total des importations nettes d'or s'est élevé a £ 148.000.000 ou 3.700.000.000 de francs. 1 livre sterling ou £ = 2b francs. 1 livre anglaise vaut 497 grammes. (*) Ce dernier chiffre aurait môme été plus fort; mais des changements fiscaux récents ont exempté d'impôts certains petits revenus.
VII.20. Predicting the Catastrophes of the 20th Century (January, 1902)↩
Source
Gustave "de Molinari, Le XXe siècle", Journal des Économistes, S. 5, T. 49, N° 1, janvier 1902, pp. 5-14.
Introduction
Molinari had very little which was good to say about the state. Such was his dislike of the state and its "spirit of monopoly" (l'esprit de monopole des classes gouvernementes et légiférantes - the spirit of monopoly of the governmental and law-making classes) that he labeled "statism" a kind of "leprosy" (la lèpre de l'Etatisme) which ate away the wealth created by private economic activity. In autocratic states like Russia, with most of the population excluded from having any say in how they were governed, it was not surprising that the most powerful members of the bureaucracy, the landed nobility, and the owners of large industry would join together to exploit the taxes and tariffs imposed by the state on the mass of the people. What was surprising was that this same process took place in the so-called "constitutional states" (les pays dits constitutionnels) like France, where a growing percentage of the population could participate in elections. In both types of states the same class structure emerged - a class of "budget eaters" ("cette classe budgétivore") living off the productive activity of the mass of taxpayers and consumers.
The newest manifestation of statism in the late 19th century was socialism. Like any form of statism, Molinari opposed it because it violated private property rights, individual liberty, and the natural laws of economic activity. In its parliamentary or social democratic form, socialism, Molinari predicted, would end up like any statist regime - a small group of people would control the mechanisms of power and operate them for the benefit of a few at the expence of the majority. One of the innovations socialism promised was to open up government jobs and state owned industries to a broader group of people who had been excluded from office-holding in earlier regimes (la clientèle du collectivisme - the clientele of collectivism). The consequence of this democratisation of the state would be a huge increase in taxes to pay for the new "bureaucratic class" (la classe bureaucratique) which lived off the state and a crippling of economic productivity as entire sectors of the economy were nationalised or heavily regulated by the economic planners. In Molinari's view, an even more dangerous type of socialism was revolutionary socialism which came to power by overthrowing the old ruling class in a violent and bloody revolution. However the socialists came to power, the final result was a new form of class rule and the spread of "functionary-ism" (le fonctionnairisme).
Molinari was pessimistic about the future for many reasons. Perhaps in the very long term (a century or longer) he was optimistic that people would eventually come to realise that free trade and peace were the only way to ensure steady wealth creation for all classes in society and so they would eventually eschew war, protectionism and socialism. In the meantime, he was very pessimistic about the short to medium term (the next 50 to 100 years) because the forces he could see at work at the turn of the century were very powerful and would have to work their way through society before their harmful effects would be seen by all. If the first couple of years of the new century were anything to go by, he predicted that the new century would be much like the old. All states would continue to follow "a policy of waste and privilege" (cette politique de gaspillage et de privilège) with increasing state debt, increasing levels of tariff protection, higher taxes, and greater risks of war.
Molinari concluded his article on the 20th century in 1902 with a more pessimistic analysis of the possible direction political conflict would take. His prognosis for the 20th century was that the struggle to control the state would again be a two-sided affair between the conservative party and the socialist party. The liberal party would gradually disappear and the conflict between the conservative party and socialist party in the 20th century would be even more bloody and destructive than the struggle between the conservatives and the liberals had been in the 19th. Molinari predicted that a series of bloody wars, revolutions and colonial conquests would break out in the medium term, with a deleterious impact on individual liberty and on wealth creation. He thought the violence which would be unleashed in the 20th century's class wars between the conservative party and the socialist party would be unprecedented in human history. Molinari "the book keeper" concluded sadly that the liabilities (passif) built up in the late 19th century would continue to build well into the 20th.
Only after wars and revolutions had devastated 20th century society would a new liberal party emerge. This new anti-socialist and anti-protectionist party - what he called "le parti du moindre gouvernement" (the party of least government) - would emerge eventually out of the economic rubble. However, he worried how such a new liberal party might attract supporters since it had no political or economic privileges to dispense to favoured businesses, no promotions or sinecures to offer the soldiers and the politically ambitious, no spoils of office to distribute. His only hope was that liberal principles would eventually appeal to enough people to make such of party of liberty viable, some time in the 20th century.
Text
Le XXe siècle
[5]
I.
Le caractère particulier du xixe siècle, disions-nous dans notre revue de l'année dernière, ce qui le distingue de tous les siècles qui l'ont précédé, c'est une augmentation prodigieuse de la puissance productive de l'homme, en d'autres termes, de sa capacité de créer de la richesse. Mais comme il arrive d'habitude aux nouveaux enrichis, les peuples dont la fortune s'est subitement accrue grâce à une efflorescence extraordinaire de progrès matériels, n'ont pas acquis en même temps la capacité morale nécessaire pour en gouverner honnêtement et utilement l'emploi. Ils ont donné le spectacle des appétits grossiers et des vices des parvenus. Les classes en possession de la machine à faire les lois s'en sont servis pour satisfaire leurs intérêts particuliers au détriment de 1 intérêt général : le militarisme, l'étatisme et le protectionnisme se sont joints pour détourner de leur destination utile, détruire ou stériliser les fruits du progrès. Chose à peine croyable ! à mesure que s'est amoindrie l'utilité des coûteux appareils de guerre que l'ancien régime avait légués au nouveau, on les a renforcés et développés au lieu de les réduire. Tandis que les progrès de la puissance destructive, allant de pair avec ceux de la puissance productive, assuraient d'une manière définitive les nations civilisées contre le risque des invasions des barbares, et que, d'une autre part, la guerre cessait d'être un mode avantageux d'acquisition de la richesse pour devenir une cause d'endettement [6] et de ruine, les armements prenaient des proportions de plus en plus formidables, et la guerre dévorait, dans le cours du xixe siècle, dix fois plus d'hommes et de capitaux que dans aucun des siècles antérieurs. De même, tandis que le développement de l'esprit d'entreprise et d'association permettait d'abandonner désormais à l'initiative libre des individus les travaux et les services d'intérêt public, on a vu l'Etat empiéter chaque jour davantage sur le domaine de l'activité privée, et remplacer l'émulation féconde des industries de concurrence par l'onéreuse routine de ses monopoles. Moins l'intervention de l'Etat est devenue utile, plus s'est étendue la lèpre de l'Etatisme ! Enfin, tandis que la multiplication et le perfectionnement merveilleux des moyens de transport, à l'usage des agents et des matériaux de la production, égalisaient partout les conditions d'existence de l'industrie, et, en mettant en communication constante les marchés de consommation auparavant isolés, enlevaient sa raison d'être originaire au régime de la protection, l'esprit de monopole des classes gouvernantes et légiférantes exhaussait et multipliait les barrières du protectionnisme.
A en juger par ses débuts, le xxe siècle suivra sous ce triple rapport l'exemple de son devancier. Pendant l'année qui vient de finir, les dépenses des gouvernements de l'ensemble des pays civilisés se sont augmentées comme d'habitude,et cette augmentation a porté, comme d'habitude aussi, sur les moins utiles. Nulle part, les services de la justice et de la police qui intéressent la sécurité des individus ne reçoivent une allocation proportionnée aux risques auxquels sont exposées la vie et la propriété de chacun. Aussi ne voit-on nulle part s'abaisser le taux de ces risques et l'industrie des malfaiteurs de toute espèce demeure-t-elle aussi florissante que jamais. Quoique les risques extérieurs qui peuvent menacer la vie et la propriété individuelles, du fait des invasions étrangères, soient devenus à peu près nuls depuis que l'expérience a démontré que toute guerre coûte aujourd'hui plus qu'elle ne rapporte, les budgets de la guerre et de la marine ne cessent point de s'accroître. Ils s'accroissent en raison non de l'augmentation mais de la diminution des risques qu'ils ont pour objet de couvrir. Tous les jours, on met sur les chantiers des cuirassés qui reviennent à une trentaine de millions au bas mot, et qui ne serviront qu'à de fastueuses et vaines parades. A cet égard, l'Espagne a donné un exemple caractéristique. Loin de réduire du montant des frais de garde des colonies qu'elle a perdues les budgets de ses armées de terre et de mer, et de réaliser ainsi une [7] économie indispensable à ses finances délabrées, elle les a augmentés, ses politiciens, — les libéraux aussi bien que les conservateurs, — ayant déclaré « intangibles » ces dépenses désormais inutiles. Quant au budget de la protection qui se superpose au budget de l'Etat, il n'a pas cessé davantage de s'épanouir. En France, la commission des douanes a continué activement à compléter et à perfectionner le tarif Méline, les primes à la marine marchande ont été renouvelées sauf un léger correctif, le régime des admissions temporaires a été modifié dans un sens restrictif etc. etc., en Suède les droits sur les denrées agricoles et la plupart des produits de l'industrie ont été aggravés, en Hollande même, le régime traditionnel de la liberté commerciale est sérieusement menacé par les appétits protectionnistes, en Allemagne, le gouvernement, dominé par une féodalité agrarienne, a présenté au Reichstag un projet de tarif destiné à élever le taux de la rente du sol aux dépens du salaire du travail.
Comment les nations civilisées peuvent-elles consentir à supporter cette politique de gaspillage et de privilège qui a plus que triplé en cinquante ans le chiffre de leurs dettes [7], multiplié et alourdi les impôts qu'elles doivent et ceux qu'elles ne doivent pas? On s'explique ce phénomène, d'ailleurs peu flatteur pour leur moralité et leur intelligence, quand on examine de près leurs éléments constitutifs. Elles se composent au moins pour les neuf dixièmes d'individus, préoccupés uniquement de leurs intérêts particuliers et immédiats, ignorants ou insouciants des intérêts généraux et permanents de la nation, à plus forte raison de [8] l'humanité. Dans les pays tels que la Russie où la multitude des gouvernés est privée des droits politiques qu'elle est, au surplus, incapable d'exercer, le gouvernement se trouve entre les mains d'une classe mi bureaucratique, mi-propriétaire et industrielle qui tire la plus grosse part de ses revenus du budget de l'Etat et du budget de la protection. Dans les pays dits constitutionnels où les gouvernés sont en nombre plus ou moins considérable pourvus du droit électoral, la grande majorité use de ce droit pour en tirer un profit quelconque ou s'abstient d'en user. A la condition de favoriser les intérêts les plus influents, le gouvernement peut impunément sacrifier ou négliger les autres. Or les intérêts les plus influents sont précisément ceux de la classe dans laquelle se recrutent les hauts fonctionnaires civils et militaires qui demandent leurs moyens d'existence au budget de l'Etat, les propriétaires fonciers et les industriels qui se partagent le budget de la protection. Comment donc cette classe budgétivore ne pousserait-elle pas à l'augmentation continue des dépenses dont elle profite, et n'emploierait-elle pas à les multiplier la puissance de l'Etat dont elle dispose?
Et remarquons que la puissance de l'Etat, investie dans l'appareil gouvernemental, s'est singulièrement accrue sous l'influence des progrès des moyens de mobilisation de ses forces et de ses ressources. Cet le puissance est telle qu'elle défie toutes les résistances individuelles et donne aux gouvernements modernes une capacité d'oppression des minorités bien supérieure à celle des gouvernements de l'ancien régime. Quand un souverain d'autrefois entrait en possession d'une province, soit par la guerre, soit par héritage, il se gardait prudemment de loucher aux institutions particulières de ses nouveaux sujets. Il respectait leurs coutumes et leur langue. Lorsque Louis XIV s'empara de l'Alsace, il s'abstint même de changer son régime douanier. L'Alsace demeura une province dite d'étranger effectif et, comme telle, affranchie des charges du tarif protectionniste de Colbert. Il n'en est plus ainsi de nos jours. Les gouvernements usent sans ménagement du droit du plus fort vis-à-vis des populations qui tombent sous leur domination. C'est ainsi que le gouvernement russe, méconnaissant ses engagements formels, a assujetti la Finlande au régime autocratique du reste de l'Empire, et que le gouvernement allemand a interdit aux Danois du Schleswig et aux Polonais de la Posnanie l'usage de leur langue maternelle, en sanctionnant cette prohibition aussi inepte qu'odieuse par l'abus le plus insolent et le plus brutal de la force.
[9]
II.
Malgré la rapidité avec laquelle se développe le budget de l'Etat, il pourrait cependant être bientôt dépassé par le budget de la protection grâce au perfectionnement que l'esprit de monopole a apporté au mécanisme protectionniste par l'invention et la propagation des trusts, des cartels et des syndicats.
Les trusts aux Etats-Unis, les cartels eu Allemagne, les syndicats et les comptoirs de vente en France sont, avec des différences d'organisation, constitués en vue d'un double objet, l'un de diminuer les frais de la production et de l'échange des produits, l'autre, d'élever les prix au niveau des droits protecteurs et de les y maintenir, en supprimant la concurrence intérieure, de manière à procurer aux industries protégées la totalité du bénéfice de la protection. En effet, l'expérience a démontré qu'il ne suffit pas d'exclure du marché intérieur les produits concurrents de l'étranger pour exhausser de tout le montant des droits, les prix au-dessus du taux du marché général; qu'il arrive même, lorsque les droits portés à un taux prohibitif procurent d'emblée des bénéfices extraordinaires aux industries protégées,que l'esprit d'entreprise et les capitaux s'y portent avec surabondance, en déterminant une surproduction cl une baisse qui ramènent les prix au taux du marche général et les l'ont parfois tomber au-dessous. Alors, aux bénéfices plantureux de la première heure succèdent des pertes ruineuses. La chute des entreprises les moins solides dégage,a la vérité, le marché de l'excédent de la production et relève les prix, mais ce relèvement, en attirant de nouveau l'esprit d'entreprise et les capitaux, détermine un retour de la baisse.
Le régime de la protection engendre ainsi un état permanent d'instabilité, dans lequel à une période de hausse provoquée par l'exclusion de la concurrence extérieure succède une série de mouvements alternatifs de rétraction et d'expansion de la concurrence intérieure. Dans les périodes de rétraction les prix peuvent s'élever de tout le montant des droits, et s'il s'agit de denrées de première nécessité, être portés à un taux de famine. Les droits jouent alors entièrement et les producteurs réalisent la totalité des bénéfices possibles de la protection. Dans les périodes d'expansion, au contraire, les droits cessent de jouer, les producteurs vendent à perte et se ruinent. C'est, disons-nous, pour prévenir [10] ces fluctuations désastreuses, élever et stabiliser les prix au niveau des droits protecteurs, que les industriels américains ont entrepris de supprimer la concurrence intérieure, en constituant des trusts qui fusionnent les entreprises concurrentes de la même industrie. Dans quelques cas, ils ont complètement atteint leur but : la Standard Oil Co. et le Sugar trust fournissent la presque totalité du pétrole et du sucre consommés aux Etats-Unis et sont, en fait, maîtres du marché. Le dernier et le plus colossal des trusts, l'United States Steel Co. constitué au mois de mars dernier par la réunion de huit groupes d'entreprises, commande de même le marché des branches principales delà métallurgie. Ce trust monstrueux est formé au capital de 1.100 millions de dollars, et l'ensemble des capitaux des trusts est évalué à 7 milliards de dollars, soit 35 milliards de francs. Les cartels allemands, les syndicats français, syndicat des sucres, comptoir métallurgique à Longwy et autres, sont loin d'avoir atteint le développement des trusts, mais tous, trusts, cartels, syndicats, poursuivent le même objectif, qui est de s'assurer intégralement les bénéfices de la protection en empêchant la concurrence intérieure de troubler le jeu des droits protecteurs.
En Allemagne et en France ces tentatives encore partielles de monopolisation du marché n'ont pas sérieusement ému l'opinion publique. Il en a été autrement aux Etats-Unis. Comme d'habitude, c'est au gouvernement que l'opinion alarmée a eu recours pour défendre les intérêts menacés par la surpression de la concurrence intérieure. Dans la plupart des Etats de l'Union, des lois ont été faites pour empêcher la formation des trusts ou limiter leur pouvoir, mais ces lois, qui avaient pour défaut commun de faire obstacle au développement légitime et utile des entreprises sont demeurées impuissantes contre les manœuvres de l'esprit de monopole : aux combinaisons interdites par les lois, les trusts ont substitué des formes d'association inattaquables. Rien ne serait plus facile cependant que de leur porter un coup mortel : au lieu de faire des lois pour les réglementer, il suffirait de défaire la loi, qui a limité artificiellement la concurrence, en entourant le marché intérieur d'une muraille douanière. Le fondateur du trust des sucres n'a-t-il pas attesté, lui-même, l'efficacité de ce remède en avouant que le tarif est le « père des trusts? »
Mais les tarifs de douane, soit qu'on les considère comme des instruments de fiscalité ou de protection sont défendus par des intérêts puissants. Ils fournissent partout une portion notable des ressources qui alimentent le militarisme et l'étatisme, et la [11] totalité de la dîme que le protectionnisme prélève sur la généralité des consommateurs et des contribuables. L'Angleterre seule a enlevé à son tarif tout caractère protectionniste, mais son exemple n'a été suivi que d'une manière momentanée, et on n'oserait affirmer que la réforme bienfaisante dont elle est redevable aux Cobden, aux Robert Peel, aux Gladstone, soit pleinement assurée contre un retour offensif du protectionnisme allié à l'impérialisme.
III.
Cependant, il serait injuste de rendre les classes gouvernantes responsables de tous les maux qui affligent nos sociétés, ainsi que le font d'habitude les socialistes. Une part de ces maux, et peut-être la plus grosse part, a sa source dans l'incapacité et l'immoralité du gouvernement de l'individu par lui-même. Le budget de la débauche et de l'ivrognerie, par exemple, atteint, s'il ne le dépasse point, dans le plus grand nombre des pays civilisés, le budget du militarisme. Mais, quel que soit le point de partage de la responsabilité des erreurs et des vices du gouvernement de la société et du gouvernement de l'individu, ces erreurs et ces vices causent invariablement une déperdition des richesses qui se répercute sur les classes les moins capables d'en supporter le dommage. De là un malaise et un mécontentement qui semblent, au premier abord, inexplicables, à une époque où des progrès de toute sorte permettent à l'homme d'acquérir les matériaux de la vie en échange d'une somme de plus en plus réduite de travail et de peine.
C'est de ce malaise et de ce mécontentement succédant à des espérances excessives et prématurées qu'est né le socialisme.
A ses débuts, dans la première partie du siècle dernier, le socialisme apparaît sous la forme de simples utopies, conçues par des esprits bienveillants et chimériques. Sans tenir aucun compte des conditions naturelles d'existence de la société, les Saint-Simon, les Fourier et leurs émules rêvent de la reconstruire sur un plan nouveau, mais ils ne songent point à en appeler à la force pour réaliser leurs utopies. Ils sont convaincus qu'il suffira de les propager à la manière des apôtres, pour les faire adopter sans résistance, car ce qu'ils apportent à l'humanité c'est le bonheur universel. D'ailleurs, où trouveraient-ils la force [12] nécessaire pour les imposer? Ils la demanderaient en vain aux classes en possession du pouvoir et de la richesse. Quant à la multitude disséminée en groupes peu nombreux et sans liens dans les ateliers de la petite industrie, cette multitude à l'état amorphe ne pouvait leur fournir aucun point d'appui dans la première moitié du xixe siècle. Privée de tout droit politique, elle ne comptait point dans l'Etat.
Mais dans la seconde moitié du siècle, la situation a changé du tout au tout. La grande industrie a rassemblé dans ses ateliers des milliers de travailleurs, que la transformation et la multiplication des moyens de communication a contribué encore à rapprocher, les lois sur les coalitions ont été abolies et les droits politiques sont descendus dans les couches inférieures de la société : au suffrage restreint qui en conférait le monopole aux classes supérieure et moyenne, a succédé le suffrage universel. Dans ce nouvel état des choses, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, comme la nommait Saint-Simon, a cessé d'être une poussière sans consistance pour devenir une masse compacte et en voie de s'organiser. Elle a fourni au socialisme le point d'appui qui lui manquait à ses débuts. A son tour, il s'est transformé pour s'adapter à l'état d'esprit de sa clientèle. Cet état d'esprit ne diffère point de celui des classes supérieure et moyenne et comment serait-il plus éclairé et plus moral? Imbue à leur exemple de la doctrine héritée de l'époque où la guerre était le mode le plus lucratif d'acquisition de la richesse, où, par conséquent, le profit de l'un faisait le dommage de l'autre, la démocratie ouvrière est naturellement convaincue qu'elle ne peut s'enrichir qu'en dépouillant les riches. En conséquence, ce qu'elle demande a la loi, c'est de confisquer le capital ou tout au moins de le mettre à la merci du travail. Le collectivisme a répondu à cette demande. En vain, les classes encore en possession du pouvoir défaire la loi s'efforcent aujourd'hui de parer à ce danger, en offrant au cerbère de la démocratie le gâteau des lois dites ouvrières, loi limitative de la durée du travail, en attendant la loi du minimum du salaire, loi reportant sur les employeurs la responsabilité des accidents, naturellement afférente aux employés, loi imposant aux patrons et à l'Etat une part du fardeau des pensions ouvrières, etc., etc., ces offrandes de la peur n'ont pas la vertu de détourner la clientèle du collectivisme, car il lui promet la totalité des biens dont l'Etat bourgeois ne lui offre qu'une part; encore n'est il pas bien certain que cette part ne lui aura point été reprise par la répercussion des lois naturelles qui régissent l'impôt et le salaire.
[13]
IV.
Aux deux partis qui se sont disputé pendant le cours du xixe siècle la possession de l'Etat et la confection des lois, l'un, le parti conservateur recruté principalement dans la classe gouvernante de l'ancien régime, l'autre, le parti libéral issu de la bourgeoisie, enrichie par l'industrie, se joint maintenant un troisième parti, représentant la classe ouvrière investie des droits politiques : le parti socialiste. Il semble même que ces trois partis doivent bientôt se réduire à deux. Ne voyons-nous pas le parti libéral se dissoudre partout, et ses éléments constitutifs s'unir suivant l'affinité de leurs intérêts au parti conservateur ou au parti socialiste? On peut donc prévoir que la lutte pour la possession de l'Etat et la confection des lois, qui s'est poursuivie dans le cours du xixe siècle entre le parti conservateur et le parti libéral se poursuivra au xxe entre le parti conservateur et le parti socialiste. On peut prévoir aussi que cette lutte ne sera pas moins ardente, et selon toute apparence moins stérile que ne l'a été sa devancière, et qu'elle engendrera la même série de révolutions, de coups d'état, avec le dérivatif sanglant des guerres étrangères et des expéditions coloniales, qui ont constitué ce qu'on pourrait appeler le passif de la civilisation du xixe siècle.
Si ces prévisions auxquelles conduit, il faut bien le dire, l'enchaînement logique des faits devaient se réaliser, elles justifieraient le pessimisme qui a succédé à l'optimisme des premiers temps du nouveau régime politique et économique. Il est en effet trop évident que la lutte pour la possession du gouvernement ne pourra que croître en violence et que le jour où le parti socialiste aura le pouvoir de faire la loi,il en usera avec moins de discrétion que le parti soi-disant libéral et réformateur dont il est en train de recueillir l'héritage. Il taillera dans le vif de la propriété et de la liberté individuelles. Il brisera ou faussera les ressorts du mécanisme délicat de la production des matériaux de la vie... Mais n'est-il pas permis d'espérer que l'échec inévitable des tentatives de réorganisation artificielle de la société, et le surcroît de misère et de souffrances dont elles seront suivies,feront naître une conception plus saine du rôle de la loi et détermineront la création d'un parti anti-socialiste aussi bien qu'anti-protectionniste. Nous n'ignorons pas que la constitution d'un parti qui n'aurait à offrir à ses officiers et à ses soldats ni « places », ni protections ou subventions, ni bureaux de tabac, pourrait, au premier abord, sembler [14] une entreprise chimérique. On connaît le mot du président Jackson: aux vainqueurs les dépouilles! Pourquoi lutterait-on s'il n'y avait pas de dépouilles, se disent les politiciens de l'école de Jackson ; mais, ne leur en déplaise, il y a encore, il y aura toujours des hommes disposés à servir gratis une bonne cause, et c'est pourquoi nous ne désespérons pas de voir se fonder, au xxe siècle, un parti qui a manqué au xixe : le parti du moindre gouvernement.
G DE MOLINARI.
[7] Dans notre chronique du mois de mai dernier, nous avons reproduit une communication de lord Avebury à la Société de statistique sur l'augmentation énorme et continue des dettes publiques. De 42 milliards en 1848 les dettes des Etats civilisés ont monté à 117 milliards en 1873, à 128 milliards en 1888 et à 160 milliards en 1898. La plus forte part, on pourrait dire la presque totalité de ces dettes, a servi à alimenter la guerre ou cette préparation à la guerre qui a pris le nom de paix armée. D'après lord Avebury, les dépenses militaires et navales des grandes puissances européennes se sont augmentées depuis vingt ans dans les proportions suivantes:
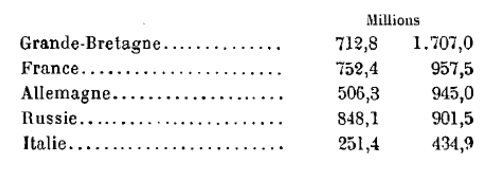
VII.21. "Où est l'Utopie?" (1906)↩
Source
Gustave de Molinari, "Où est l'Utopie?," Questions économiques à l’ordre du jour (Paris: Guillaumin, 1906), pp. 367-87. Originally published inJDE: "Où est l’utopie ?," Journal des économistes, S. 6, T. 3, N° 2, août 1904.
PDF.
Introduction
A common rhetorical strategy Molinari used when he wanted the reader to consider his radical liberal and anarcho-capitalist ideas was to ask them merely to consider it as "an hypothesis". He did this several times with his story of "the monopolist grocer" (or sometimes a baker) where the reader had to imagine the objections of a town’s inhabitants to the argument that there should be a completely free, open, private, and competitive provision of groceries after centuries of there being only one, monopoly grocer in the town. In this late article written for the JDE in 1904 he again asks the reader to make an hypothesis - to consider his utopian vision of a fully free society - "un seul et vaste marché" *a single vast market), which suggests his radicalism had barely weakened over the years and that his vision of a completely free market in everything operating everywhere was still with him. When compared to the future which he thought lay in store if the current regime of protectionism, statism, and militarism continued to expand, or to the future proposed by the socialist parties of government planning and regulation of the economy and society in general, then his liberal utopia did not seem any more utopian than theirs did:
| Faisons maintenant une hypothèse. Supposons que cette action de la concurrence puisse, un jour, s’opérer sans obstacles sur toute la surface du globe et dans toutes les branches de l’activité humaine ; que tous les marchés, maintenant encore séparés par des barrières naturelles ou artificielles, ne forment plus qu’un seul et vaste marché … | Let me now put forward a hypothesis. Let us suppose that one day this process of competition is operating across the entire surface of the globe and in all areas of human activity without any obstacles in its way; that all the markets which are currently separated by natural or artificial barriers now make up one single vast market … |
| Nous convenons volontiers que cette hypothèse peut sembler chimérique, mais lorsque nous considérons l’avenir que nous prépare le régime protectionniste, étatiste et militariste actuellement en vigueur dans toute l’étendue du monde civilisé, et celui par lequel le socialisme se propose de le remplacer, nous nous demandons si cet avenir ne serait point par hasard encore plus utopique que le nôtre. | We readily agree that this hypothesis might seem fanciful, but when we consider the future being prepared for us by the protectionist, statist, and militarist regime which is at present in power throughout the entire civilised world, and that which the socialists plan to put in its place, we have to asks ourselves if this future wouldn’t end up being even more utopian than ours. |
He argues that some aspects of his utopian vision had already been reached with the globalisation of the world market which had been underway for a couple of decades. If trade in goods had become liberalized it was also clear that some markets had remained shackled and highly regulated, such as the labour market (which was one of his pet concerns). Even worse, was that some aspects of a liberal "dystopia" were increasingly visible which might undo all the previous good work in expanding free market, most notably because of triple threat of "le protectionnisme, l’étatisme et le militarisme." The last two in particular had led to a huge growth in the tax burden, especially for war and social programs, resulting in "un budget parasite" (a parasitical budget). Once again, he returns to quoting J.B. Say’s idea that these massive budgets were the "ulcères les gouvernements de son temps" (the government ulcers off his day) and asks what Say would think of the "ulcerous budgets" of his own day.
Just as industries compete against each other for customers within a market , political ideologies compete for supporters and voters in the political market. All political ideologies Molinari believes have their own utopian vision of what a perfect society wold like. He dismisses the socialist vision as "la plus invraisemblable des utopies" (the most unreasonable of the the utopias) and the conservative one as a proven failure. Yet both traditions had a lot in common, as they were both "également étatistes" (equally statist). Unfortunately the liberals of his day were not good advocates of their utopian visions and Molinari feared that only after the inevitable failure of their utopian visions in the near future would people finally realize where the true utopia lay. He hoped that some future liberals like him would be around to pick up the pieces:
| On pourrait dire d’eux ce qu’on disait des doctrinaires de la Restauration: qu’ils tiendraient sur un canapé. Mais ils ont cette fortune de posséder comme auxiliaires leurs adversaires eux-mêmes. Il leur suffirait de laisser faire le militarisme, le protectionnisme et finalement le socialisme pour avoir gain de cause. Car un moment viendra où l’Etat, soit qu’il demeure dans les mains des conservateurs ou qu’il tombe dans celles des socialistes, pèsera sur la société d’un tel poids qu’elle cessera de pouvoir le porter. Souhaitons qu’elle n’attende pas ce moment-là pour savoir où est l’utopie. | One could say of them (the liberals) what one said about the Doctrinaires of the Restoration (period) that they liked to sit around on the sofa (waiting for something to happen?). But they (the liberals) have the great fortune of having as auxiliaries (in their battle) their own adversaries. All they have to do is allow free reign (he literally says "laisser faire") to militarism, protectionism, and finally socialism in order to have won the day. Because the moment will come when the State, whether it remains in the hands of the conservatives or falls into the hands of the socialists, will impose such a burden on society that it will no longer be able to bear/support it. Let us hope that it (society) does not have to wait until that moment to realise where Utopia is. |
Text
[369]
I
Nous commençons seulement à apercevoir les conséquences de la prodigieuse augmentation de la productivité de l'industrie et des progrès dont elle a été la source. Cependant les esprits les plus rebelles aux nouveautés, eux-mêmes, ne peuvent plus se dissimuler qu'il y a quelque chose de changé dans le monde depuis que l'homme a plié à son service des agents naturels d'une puissance illimitée. Pourvue d'une machinerie qui va se perfectionnant chaque jour, l'industrie apporte à la consommation des masses croissantes de produits et demande des marchés de plus en plus étendus. Pour répondre à ce besoin nouveau, les moyens de communication ont été transformés et multipliés en même temps que les agents de mobilisation des produits, des capitaux et du travail. Aux marchés locaux qui suffisaient à alimenter [370] le plus grand nombre des petits ateliers d'autrefois a succédé un marché général sur lequel s'échangent les produits et les agents productifs de toutes les nations. Dans le cours du dernier siècle, les échanges internationaux ont décuplé et c'est par milliards que se comptent les capitaux qui vont féconder la production dans des régions du globe qui leur étaient naguère inaccessibles. Et quoique les agents de mobilisation qui desservent les produits et les capitaux fassent encore défaut au travail, l'Europe exporte maintenant chaque année un million de travailleurs dans le nouveau monde.
A mesure que la sphère de l'échange allait ainsi s'étendant sous l'influence de l'augmentation progressive de la puissance productive de l'industrie, nous avons vu se dégager des obstacles qui entravaient son opération le plus énergique moteur de l'activité humaine, la loi naturelle de la concurrence. Sans doute, cette loi a agi de tout temps pour donner, à l'avantage de l'espèce, la victoire aux plus forts et aux plus capables. Sous sa forme destructive de guerre elle a acquis la maîtrise de notre globe aux nations qui ont apporté dans ra lutte pour la domination les forces matérielles et, plus encore, les forces morales de la civilisation; mais, dans son application à l'industrie, elle rencontrait dans le milieu et dans l'homme lui-même, des obstacles qui enrayaient son [371] action propulsive et régulatrice. Ces obstacles n'ont pas tous disparu: tandis que ceux qui sont le fait de la nature sont en voie de s'aplanir, ceux qui sont le fait de l'homme continuent de subsister et même de se multiplier. Aux monopoles naturels a succédé une floraison touffue de monopoles artificiels. L'aire de la concurrence ne s'est pas moins agrandie avec celle de l'échange, et nous pouvons déjà, en considérant les résultats actuels de son opération dans un milieu devenu malgré tout plus libre, nous faire une idée de ceux que cette opération produira dans un milieu que l'esprit de monopole aura cessé d'obstruer et de limiter.
Sauf les inégalités provenant des droits de douane, la concurrence a déjà unifié les prix des articles de consommation qui possèdent le marché le plus vaste, les céréales, le coton, la laine, le fer, l'acier, et elle tend continuellement à les faire descendre au niveau des frais de production les plus bas. C'est vers ce niveau que gravitent les prix du marché général et que s'établit l'équilibre entre la production et la consommation. A la vérité, cet équilibre est troublé tantôt par une appréciation inexacte des besoins de la consommation, tantôt, et plus souvent, par l'influence perturbatrice des accidents de la température, mais soit qu'il y ait surabondance ou déficit, les lois de la concurrence et de la valeur, en déterminant une [372] baisse ou une hausse immédiate et progressive des prix, diminuent ou augmentent les profits de manière à faire disparaître la surabondance ou combler le déficit.
Ces ruptures d'équilibre n'occasionnent pas moins des dommages et des souffrances, mais elles ne sont pas, sans remède. Les progrès de l'agriculture contribuent efficacement à rendre la production des denrées alimentaires moins dépendante des caprices des saisons, tandis que le développement de la spéculation, - laquelle n'est autre chose qu'une application utile de la prévoyance, - permet d'étendre dans le temps le marché de l'échange et d'y égaliser les prix au double avantage des producteurs et des consommateurs. En ramenant ainsi, par une impulsion irrésistible, les prix du marché au niveau des frais de production les plus bas, les lois naturelles de la concurrence et de la valeur obligent, d'une part, les producteurs, sous peine de ruine, à réaliser sans retard tous les progrès dont les plus intelligents d'entre eux ont pris l'initiative, et, d'une autre part, elles règlent leurs profits au taux nécessaire pour assurer l'existence de la production, ni plus ni moins. Ajoutons que sur ce marché généralisé, elles suppriment une cause de perturbations qui résidait sur les marchés locaux, dans l'inégalité personnelle des besoins d'acheter ou de vendre et viciait l'échange par l'exploitation [373] de la souffrance ou de l'ignorance de l'acheteur ou du vendeur. En impersonnalisant l'échange elles règlent les prix uniquement en raison des quantités offertes et demandées.
Cette même action propulsive et régulatrice que la concurrence exerce, avec l'auxiliaire de la loi de la valeur, pour abaisser le prix des produits au taux nécessaire et établir à ce taux l'équilibre de la production et de la consommation sur un marché où aucun obstacle ne vient entraver ses mouvements, elle l'exerce aussi pour régler au même taux le partage des fruits de la production entre ses coopérateurs, capitaux investis dans les choses et capitaux investis dans l'homme lui-même, ou, pour nous servir de l'expression usitée, capital et travail.
Nous savons en quoi consiste le taux nécessaire de la rétribution de ces deux catégories de capitaux. S'il s'agit du capital investi dans les choses, il faut que sa part dans le produit qu'il contribue à créer suffise à le reconstituer avec le profit nécessaire pour déterminer le capitaliste à l'engager dans la production plutôt qu'à le conserver inactif. C'est vers ce taux que la concurrence fait graviter la rétribution du capital. Si les prix du marché des capitaux tombe au-dessous, les capitaux engagés dans la production se détruisent faute de pouvoir être reconstitués et ceux qui étaient disponibles cessent d'être offerts ou prennent une autre [374] direction. Si, au contraire, le prix du marché dépasse le taux nécessaire, les capitaux sont attirés vers l'industrie dans laquelle ils reçoivent cet excès de rétribution, et l'offre s'en accroît jusqu'à ce que le prix du marché soit redescendu au taux nécessaire. Et ces mouvements de hausse et de baisse s'opérant, comme nous l'avons vu, dans une progression plus rapide que l'écart des quantités, l'équilibre tend rapidement à se rétablir au niveau utile de la rétribution. Seulement, c'est à la condition qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'action des lois rétributrices. Dans un marché où cette action régulatrice se heurte à un monopole naturel ou artificiel, c'est la différence d'intensité des besoins d'emprunter et de prêter qui détermine le prix, et comme le besoin d'emprunter est généralement plus pressant que le besoin de prêter, cette différence d'intensité a donné naissance au phénomène de l'usure. Répandu, sous le régime de la petite industrie et des marchés isolés, au point d'avoir été considéré comme inhérent au prêt des capitaux, ce phénomène est aujourd'hui en voie de disparaître. Depuis que les moyens de communication et les intermédiaires du crédit, bourses, banques, organes de publicité financière, en se multipliant ont fait reculer partout les limites des marchés des capitaux, l'opération de la concurrence, bien autrement efficace que celle des lois limitatives [375] du taux de l'intérêt, a commencé à avoir raison de l'usure.
Les mêmes lois gouvernent la rétribution du capital investi dans l'homme lui-même soit que le travail de cet agent productif soit rétribué par une part aléatoire dans le produit ou une part fixe et assurée, un salaire. Mais l'opération régulatrice de ces lois a rencontré ici des obstacles plus difficiles à aplanir ou à surmonter que ceux qui troublent et inégalisent les prix des produits et la rétribution du capital investi dans les choses.
Sous l'influence de causes que nous ayons analysées, les organes nécessaires que la concurrence s'est créés et qui se sont développés à mesure que s'étendaient ses marches: maisons ou sociétés de commerce, bourses, banques, publicité commerciale et financière, font encore défaut au travail de l'ouvrier devenu libre. Si, à l'époque où ils ont été affranchis de la servitude, les travailleurs ont acquis le droit de débattre les prix et conditions de la location de leur capital de forces productives (capital qu'ils pouvaient rarement employer eux-mêmes), l'immense majorité d'entre eux ne pouvait, en fait, user librement de ce droit. Plus encore que les emprunteurs faméliques en quête d'un capital les ouvriers étaient pressés d'échanger leur travail contre un salaire. Dans les marchés isolés où ils se trouvaient confinés tant par la [376] rareté et la cherté des moyens de communication que par l'absence des agents de mobilisation, ils étaient à la merci des salariants et obligés de subir leurs conditions, fussent-elles usuraires.
Car dans ces marchés étroits l'inégalité des besoins des salariés et des salariants beaucoup plus que le rapport des quantités existantes pour l'offre et la demande déterminait le prix du travail aussi bien que le taux de l'intérêt et le prix des marchandises. Cette inégalité, les ouvriers auraient pu la corriger par l'association si elle ne leur avait pas été interdite. L'échange individuel du travail contre un salaire seul était licite. Les maux qui ont accablé la classe ouvrière dans cette période initiale de son émancipation, où l'ouvrier était rendu complètement responsable de son existence tout en étant placé dans des conditions qui ne lui laissaient qu'incomplètement les moyens d'y pourvoir, ces maux ont été imputés, comme on sait, à la liberté elle-même et ils ont provoqué la réaction du socialisme. Cependant cette situation, que bien d'autres causes contribuaient d'ailleurs à aggraver, s'est modifiée à la longue. Les lois sur les coalitions ont été abolies, les ouvriers ont pu s'associer pour débattre les conditions de l'échange du travail contre un salaire, et, plus encore que la liberté des coalitions, des unions ou des syndicats, l'augmentation de la productivité de l'industrie par l'emploi des [377] machines et la multiplication des moyens de communication rapides et à bon marché ont contribué à relever les salaires. Tout en s'étendant, les marchés du travail n'en sont pas moins demeurés localisés, et l'inégalité des besoins des salariants et des salariés continue à y être un facteur influent sinon déterminant du prix du travail. De là la lutte qui est partout engagée entre les unions ou les syndicats et les entrepreneurs d'industrie. Mais on peut, dès à présent, prévoir que les dommages énormes et toujours croissants que cause cette lutte, en rendant plus urgente la nécessité d'y porter remède, auront pour résultat de mettre au service du capital investi dans l'homme les mêmes organes de mobilisation qui étendent chaque jour davantage les marchés des capitaux investis dans les choses. Alors, dans un milieu où la concurrence munie de ses organes nécessaires pourra exercer librement son action régulatrice, le prix du travail comme le taux d'intérêt du capital tendra à s'unifier et à se fixer au point utile du partage des produits entre ces deux coopérateurs de la production.
Faisons maintenant une hypothèse. Supposons que cette action de la concurrence puisse, un jour, s'opérer sans obstacles sur toute la surface du globe et dans toutes les branches de l'activité humaine; que tous les marchés, maintenant encore séparés par des barrières [378] naturelles ou artificielles, ne forment plus qu'un seul et vaste marché, dont toutes les parties seront éclairées à giorno et mises en communication instantanée par des instruments et des agents de mobilisation des produits, des capitaux et du travail, supposons encore qu'aucune des industries qui, dans chaque pays, fournissent les produits ou les services nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme ne soit soustraite à l'opération propulsive et régulatrice de la concurrence, que tous les obstacles qui entravent cette opération monopoles, douanes, règlements restrictifs du travail et de l'échange, viennent à être levés; enfin que l'expérience ayant suffisamment démontré que la guerre a cessé d'être un mode avantageux d'acquisition de la richesse, les nations civilisés réduisent leurs armements au quantum nécessaire pour se préserver des invasions des peuples arriérés qui continuent à demander leurs moyens d'existence à la conquête et au pillage, quel sera le résultat de cette élimination des obstacles que le protectionnisme, l'étatisme et le militarisme opposent au développement naturel de la production et de l'échange, et des charges dont ils les grèvent? Ce sera, dans un marché élargi jusqu'aux limites de notre globe, et débarrassé de l'énorme fouillis des lois artificielles, dictées par des intérêts égoïstes et aveugles, la loi naturelle de la concurrence vitale, désormais libre [379] de ses mouvements et en possession de toute sa puissance qui assurera la conservation et le progrès de l'espèce humaine, comme elle assure ceux de toutes les autres espèces vivantes.
Or, nous avons vu comment procède cette loi pour multiplier la production des matériaux de la vie et en déterminer la distribution utile. D'une part, associée à une autre loi naturelle, la loi de l'économie des forces, elle oblige tous les producteurs, sous peine de ruine, à réaliser incessamment les progrès qui augmentent la puissance productive de l'industrie et abaissent les frais de la production.
D'une autre part, associée à la loi de la valeur, elle fait graviter par une impulsion irrésistible les prix des matériaux de la vie vers le niveau des moindres frais, et en détermine la répartition utile entre les coopérateurs de la production.
En supposant donc que les hommes, après avoir supprimé les obstacles naturels qui entravent l'opération propulsive et régulatrice de la concurrence, cessent de les remplacer par des obstacles artificiels, le résultat final sera l'accroissement continu de leur puissance productive jusqu'à la limite marquée par la nature, l'acquisition de la plus grande somme possible des matériaux de vie en échange de la moindre somme de travail et de peine et la distribution de ces matériaux la plus utile, partant la plus [380] conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce humaine.
Nous convenons volontiers que cette hypothèse peut sembler chimérique, mais lorsque nous considérons l'avenir que nous prépare le régime protectionniste, étatiste et militariste actuellement en vigueur dans toute l'étendue du monde civilisé, et celui par lequel le socialisme se propose de le remplacer, nous nous demandons si cet avenir ne serait point par hasard encore plus utopique que le nôtre. Examinons, en effet, ce qu'il pourra bien être.
II
Si, dans le siècle qui vient de finir, l'accroissement de la productivité des industries de concurrence a augmenté dans des proportions extraordinaires la richesse de la plupart des nations civilisées, en revanche elles alimentent un monopole qui leur rend, sans doute, un service indispensable, celui de la sécurité intérieure et extérieure, mais qui le leur fait payer de plus en plus cher, sans qu'on puisse dire qu'il s'améliore dans la même mesure. S'il s'agit de la sécurité intérieure, on ne peut affirmer que la vie et la propriété soient plus sûrement garanties aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a un siècle. A la vérité, le budget de la police et de [381] la justice ne s'est pas sensiblement grossi dans cet intervalle, et quoique ce service puisse être à bon droit considéré comme le plus important de ceux que nous rend l'Etat, il ne figure qu'à un des derniers rangs dans la liste de ses dépenses. Mais il en est tout autrement pour la sécurité extérieure. C'est de beaucoup le plus gros chapitre de son budget et celui dont l'accroissement est partout le plus rapide. Cependant si l'on considère le péril qui menace l'ensemble des nations civilisées du fait des invasions des barbares, ce péril est allé décroissant depuis que la puissance destructive des peuples civilisés a égalé, si elle n'a pas dépassé, leur puissance productive. D'après l'historien Gibbon, l'empire romain ne maintenait sur pied que 120000 hommes pour se protéger contre la multitude des barbares belliqueux et avides de pillage qui se pressaient à ses frontières, et ce n'est pas l'insuffisance de ses forces militaires qui a causé sa chute. Les nations civilisées n'auraient pas besoin d'une armée beaucoup plus nombreuse si leurs gouvernements voulaient bien s'entendre. Quoiqu'elles aient horreur de la guerre, quoiqu'elles répètent depuis des siècles cette prière que nous avons lue à un fronton de la place de l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles:
A peste, a fame, a bello, libera nos Domine.
elles n'ont pas réussi encore à conserver la paix. [382] Loin de s'abaisser avec les progrès de la civilisation, l'adoucissement général des moeurs et l'effacement des haines nationales, le risque de guerre n'a pas cessé de s'élever et, avec lui, plus encore, la prime que perçoivent les gouvernements pour le couvrir. Et pourtant on cherche en vain quelle peut être aujourd'hui l'utilité de la guerre. Dans les temps primitifs, les tribus faméliques se la faisaient pour suppléer à l'insuffisance de leur gibier de poil ou de plume; plus tard les peuples guerriers s'y livraient soit en vue du pillage, soit pour s'emparer d'un territoire garni d'un cheptel d'hommes laborieux et paisibles qu'ils réduisaient à l'état d'esclaves, de serfs ou de sujets :
Avec ma lance je moissonne,
19. Avec ma lance j'exprime le doux jus de la treille,
chantaient les guerriers crétois, et, à leur point de vue, ils n'avaient peut-être pas tort de considérer la guerre comme la plus productive des industries. On peut en dire autant des patriciens de Rome qui accaparaient les dépouilles des vaincus, ou bien encore de Guillaume le Conquérant et de ses compagnons qui descendaient en Angleterre pour «gaigner». Aucune entreprise, aucun trust industriel ou commercial n'aurait pu, en effet, leur procurer d'aussi merveilleux dividendes. Mais la situation a changé. Si la guerre donne encore des dividendes ils sont [383] pris sur le capital des nations. Les bénéfices dont elle est la source et qui consistent dans la gloire dont se couvrent les généraux victorieux, et les dotations plus substantielles que leur décerne la reconnaissance nationale, dans l'avancement et la solde de campagne des officiers, dans les profits plantureux des fournisseurs du matériel de guerre, de la nourriture et du vêtement du personnel, etc., etc., ces bénéfices ne sont qu'un bien faible item, en comparaison de l'énorme dépense que la guerre coûte aux nations et des dommages qu'elle inflige à leur industrie et à leur commerce. Que le personnel gouvernant qui décide de la guerre soit peu sensible à ces considérations matérielles, cela se conçoit. Comme le remarquait Kant, la guerre ne prive pas le chef d'Etat qui la déclare d'un seul plat de son dîner, mais que les nations qui doivent en payer les frais consentent bénévolement à la supporter, bien qu'elles aient, théoriquement du moins, le droit de l'empêcher, ce n'est pas le moins étonnant des phénomènes.
Cependant la croyance en la nécessité et en la perpétuité de la guerre est demeurée un article de foi chez les classes dirigeantes du monde civilisé. On peut donc, en calculant ce qu'elle a coûté depuis un siècle, se faire une idée du fardeau qu'elle imposera aux siècles à venir. Au moment où a éclaté la révolution française, les dettes de l'ensemble des nations civilisées ne [384] dépassaient pas une vingtaine de milliards ; elles s'élèvent aujourd'hui à 177 milliards dont la presque totalité doit être mise au compte de la guerre et de la paix armée. Et si on analyse les budgets des dépenses, à la seule exception du budget de l'Union américaine, on constate que les budgets de la dette, de la guerre et de la marine en absorbent les deux tiers. [1] Quant aux autres services que les gouvernements ont accaparés, il se soldent en perte, en ce sens que l'industrie privée les fournirait en meilleure qualité et à meilleur marché.
A ces dépenses colossales et toujours croissantes du monopole gouvernemental, il est pourvu au moyen d'une série d'impôts qui atteignent et renchérissent tous les matériaux de la vie, sans excepter l'air respirable et la lumière du soleil. Et tandis que chacun, en achetant un produit ou un service à l'industrie privée, connaît exactement le prix dont il le paie, nul ne peut savoir ce que lui coûte l'un ou l'autre des services qui lui impose l'Etat, et encore moins quel est le montant de sa contribution à la dépense commune. Car le problème de l'incidence de l'impôt est demeuré aussi insoluble que celui de la quadrature du cercle. Au moins l'impôt est-il employé uniquement à rétribuer des services affectés à la nation toute entière, [385] conformément à l'adage des économistes: on ne doit d'impôts qu'à l'Etat? Nous savons ce que le protectionnisme a fait de cet adage: sur le budget de l'Etat il a greffé un budget parasite, alimenté par une dîme agricole et industrielle plus lourde que ne le furent jamais la dîme ecclésiastique et les redevances féodales. La statistique, en sa qualité de science officielle, ne nous fournit que des données incertaines sur le poids et l'étendue de cette double charge, sur le tantième que l'Etat et ses protégés enlèvent au revenu annuel de la nation. Est-ce le cinquième, le quart ou la moitié? Et dans quelle proportion les différentes catégories d'imposés y contribuent-ils? Nous ne pouvons faire à cet égard que des conjectures. Mais ce qui est clair et certain, c'est que cette proportion va s'élevant tous les jours, c'est qu'en dépit de l'accroissement continu de la productivité de l'industrie, les charges publiques s'augmentent plus vite que les revenus privés et qu'un jour viendra où ils cesseront d'y suffire. J.-B. Say qualifiait d'ulcères les gouvernements de son temps. Que dirait-il des nôtres?
Les choses en sont venues au point que les conservateurs les plus endurcis eux-mêmes commencent à envisager l'avenir avec inquiétude. Ils s'effraient avec raison des progrès du socialisme, sans paraître se douter que le socialisme est un effet, non une cause. Les uns croient [386] conjurer le péril dont il les menace en lui faisant des concessions, les autres ne voient de salut que dans la dictature. Mais s'imaginer que les concessions désarmeront le socialisme ou que la société puisse être sauvée par la dictature, n'est-ce pas la plus décevante des utopies?
Les socialistes ont un autre remède qu'ils s'accordent à considérer comme infaillible, c'est de supprimer l'odieuse concurrence qu'ils rendent responsable de tous les maux de l'humanité, c'est d'absorber la société dans l'Etat, lequel se chargera d'organiser l'industrie et d'en distribuer les produits au travail à l'exclusion du capital. Mais cette conception d'une organisation de l'industrie en opposition avec les lois naturelles qui gouvernent l'activité humaine n'est-elle pas aussi chimérique que celle d'une ville bâtie sur les nuées, qui excitait la verve d'Aristophane aux dépens des socialistes d'il y a 2500 ans ? N'est-ce pas, à son tour, la plus invraisemblable des utopies?
Cependant nous ne pouvons nous le dissimuler: les classes pensantes et dirigeantes des sociétés civilisées, si opposés que soient leurs intérêts et leurs tendances, sont également étatistes. La seule différence que l'on puisse signaler entre les conservateurs et les socialistes, c'est que ceux-là veulent conserver l'Etat pour l'exploiter à leur profit tandis que ceux-ci veulent s'en emparer pour l'accommoder au leur. [387] Les partis intermédiaires, libéraux et radicaux, sont en voie de disparaître, les libéraux se joignant de préférence aux conservateurs, les radicaux aux socialistes. Après avoir dénoncé la faillite de la science, on proclame celle de la liberté. Bien peu nombreux sont les libéraux qui lui sont demeurés entièrement fidèles. On pourrait dire d'eux ce qu'on disait des doctrinaires de la Restauration: qu'ils tiendraient sur un canapé. Mais ils ont cette fortune de posséder comme auxiliaires leurs adversaires eux-mêmes. Il leur suffirait de laisser faire le militarisme, le protectionnisme et finalement le socialisme pour avoir gain de cause. Car un moment viendra où l'Etat, soit qu'il demeure dans les mains des conservateurs ou qu'il tombe dans celles des socialistes, pèsera sur la société d'un tel poids qu'elle cessera de pouvoir le porter. Souhaitons qu'elle n'attende pas ce moment-là pour savoir où est l'utopie.
Endnotes
[1] Voir Grandeur et Décadence de la Guerre, chap. VI. Le bilan des guerres des États modernes.
VII.22. "Le vol et l’échange" (1908)↩
Source
Gustave de Molinari, "Le vol et l’échange," Journal des Économistes, S. 6, T. 19, N° 1, juillet 1908. Reprinted in Ultima verba (1911), pp. 3-31.
PDF.
Introduction
This article is interesting because in it he restates one of his key ideas about there being two different means of acquiring wealth - either by means of peaceful production and exchange, or by means of violence and theft; he summarizes his theory of the history of the emergence of the state and the ruling class which controls it; and discusses the nature of the class warfare which had emerged in France in the late 19th and early 20th centuries and his predictions about how this would play out in the future.
In his history of the emergence of the state Molinari uses a concept popularized 100 years later by the American economist Mancur Olson in his book Power and Prosperity (2000). [15] Olson distinguished between "roving bandits" who pillaged productive farmers and then moved on to other groups to do the same thing; and "stationary bandits" who settled down among the farmers and exacted payments from them on a regular basis, in return for providing them with "security" from other roving bandits. The terminology Molinari used for the productive farmers was "les tribus industrieuses" (industrious tribes) and for the bandits "les tribus qui vivent de vol" (tribes which live by theft) some of whom eventually became "les fondateurs d'Etats" (the founders of States) and defended the productive farmers from other roving "barbarian" invaders. Thus began the uneasy relationship in Europe between "la population assujettie" (the subject population) and the ruling class which continued up until Molinari’s own day.
With the dramatic rise of modern industry unleashed by competition, free and global trade, and secure property rights in the 19th century, a struggle eventually emerged between "une bourgeoisie industrieuse et l'aristocratie gouvernante" (an industrious bourgeoisie and the governing aristocracy), the latter enjoying "un monopole permanent" (a permanent monopoly) of control of the state.With the rise of democracy and universal suffrage modern political parties emerged which were able to replace the permanent monopoly of power of the traditional elites with "le monopole temporaire d'un parti" (the temporary monopoly of a party). In the second half of this article Molinari explores the significance of this profound political change.
"Las bourgeoisie industrieuse," which tends to favour free trade and peace, formed "un parti libéral" (a liberal party) and fought for liberal reforms in the mid-19th century. With the emergence in the late 19th century of a resurgence in militarism on the one hand, the rise of socialism and on the other, the liberal party split. Some of the wealthier members allied themselves with the older "aristocratic party" and entered their government to work in the foreign affairs department, or sold their services to it as producers of war matériel or bankers providing the government with loans. Another faction of the liberal party joined the radical working class or socialist party. The end result by the turn of the century was a serious weakening the liberal party and the emergence of a new kind of party politics which would have dire consequence for the future of liberty in Europe.
The things Molinari feared most were the following: "une nouvelle forme de la corruption" (a new form of corruption), namely "la corruption électorale" (electoral or voting corruption) where voters would sell their votes to ambitious politicians for tax-payer funded benefits; the use of the threat of external wars "comme un moyen de conservation à un chef de gouvernement autocratique ou constitutionnel, menace par une opposition à laquelle elle permet d'imposer silence" (as a means of preservation for the head of an aristocratic or constitutional government, which was threatened by an opposition (party) by allowing them (the ruling party) to impose silence (on its opponents)); and the rise of public debt to pay for both these things, a burden which would be born on the shoulders of future generals and which he regarded as "un simple vol" (simple theft).
His pessimistic conclusion was that, without a change in the way people thought about "government theft" "on peut craindre que le vol sous ses formes multiples ne continue à détruire plus de richesses que n'en créent la production et l'échange" (one fears that theft in these multiple forms will continue to destroy more wealth than production and exchange can create).
Endnotes
[15] Mancur Olson, Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships (New York: Basic Books, 2000).
Text
[3]
I
L'espèce humaine, formée des mêmes éléments que les espèces végétales et animales, doit pourvoir, avant tout, aux besoins qui lui sont communs avec elles. Elle doit chercher sa subsistance et défendre sa vie contre les espèces concurrentes, en suppléant à son infériorité physique par l'exercice et le développement des facultés intellectuelles et morales qui lui sont propres. Dans les différentes parties du globe où ils sont nés, les hommes unissent leurs forces pour se défendre contre leurs ennemis ; ils forment des sociétés, dans ou tribus, inventent dés armes et des outils. Et tandis que les espèces inférieures ne possèdent que le pouvoir de détruire et de consommer les matériaux de subsistance à leur portée, ils peuvent les multiplier. Ils peuvent produire. Comment? En substituant l'échange au vol dans l'acquisition des subsistances. Le vol est lé procédé [4] commun à toutes les espèces végétales et animales. Elles s'emparent des matériaux nécessaires à l'entretien de leur vie et les consomment, mais sont incapables de les reproduire. Or, quelle est la conséquence inévitable de l'emploi de ce procédé? C'est l'épuisement final des matériaux de la vie et l'extinction des espèces. Quelle est, au contraire, la conséquence de l'échange ? C'est la reconstitution des matériaux de la vie, aussi longtemps que les éléments constitutifs de ces matériaux existent.
La civilisation qui a élevé l'espèce humaine au-dessus des espèces végétales et animales, s'est opérée par la substitution de l'échange au vol, accomplie sous la pression du moteur de l'activité de tous les êtres pourvus de vie : la concurrence. Sous la pression de la concurrence, les tribus industrieuses ont mis en oeuvre leurs facultés d'observation et d'invention, créé l'agriculture et les premiers arts, décuplé ainsi la productivité de leur travail. Mais en réalisant ces progrès, elles offraient une plus riche proie aux tribus mieux pourvues des facultés destructives qui continuaient à vivre de vol. Les plus intelligentes de celles-ci ont fini par découvrir qu'elles trouveraient plus de profit à les assujettir qu'à les dépouiller et à les détruire. Dès ce moment, l'échange a commencé à se substituer au vol. Les hommes forts et courageux qui s'étaient emparés des producteurs de subsistances et du domaine qu'ils cultivaient ont été intéressés à les conserver et à les défendre [5] comme auparavant ils l'étaient à les piller et à les massacrer. Alors s'est ouverte une longue période de luttes entre les fondateurs d'Etats et les tribus vivant encore uniquement de vol. Dans cette période, la nécessité qui s'imposait aux sociétés fondatrices et propriétaires d'Etats consistait à augmenter leur puissance et leurs ressources, sous peine de dépossession et de destruction, c'est-à-dire d'empêcher leurs membres d'user à l'égard les uns des autres du procédé du vol, et tel a été l'objet des premiers codes ; ensuite de conserver et de multiplier les producteurs de subsistances qu'ils avaient assujettis et d'augmenter le profit qu'ils tiraient d'eux. Avec cette population assujettie, ils faisaient un échange — échange de services de gouvernement et de sécurité contre des produits matériels ou des services domestiques. Seulement, cet échange, opéré sous un forme primitive de monopole, contenait une part de vol. Le maître pouvait imposer à son esclave la totalité d'efforts, de travail, que l'esclave était capable de fournir, et lui enlever de même la totalité des produits de ce travail, Dans ce cas, le monopole n'aurait été qu'un vol pur et simple, Mais la nature s'y opposait. Quelle que fût la rapacité du maître, il ne pouvait conserver son esclave qu'à la condition de lui abandonner la part de produit nécessaire à sa subsistance, en sus lies services de gouvernement et de sécurité qu'il lui endait.
[6]
Sous la pression de la lutte entre les sociétés qui vivaient de l'échange sous forme de monopole et celles qui subsistaient uniquement par le vol, des progrès s'accomplirent qui mirent à la longue les premières à l'abri des invasions des secondes. Mais la lutte n'en continua pas moins. Elle eut désormais pour objet principal, non plus la défense contre les tribus barbares qui vivaient de vol, mais la pratique du vol entre les propriétaires d'Etats plus ou moins civilisés. Cette pratique avait pour objet l'agrandissement de leurs Etats, l'accroissement du nombre de leurs esclaves, de leurs serfs ou de leurs sujets, partant, des revenus qu'ils leur fournissaient sous forme de corvées ou d'impôts, La guerre, savoir le mode d'acquisition de la richesse par le vol, restait la principale industrie des sociétés propriétaires d'Etats. C'était une industrie aléatoire, mais, néanmoins, la plus avantageuse de toutes les branchés de l'activité humaine. À la société victorieuse, elle valait une augmentation plus ou moins considérable de territoire garni de sujets, partant d'impôts et de revenus. À la société vaincue, elle en enlevait temporairement une partie, mais en lui laissant d'ordinaire l'espoir de la recouvrer. Dans les deux cas, vaincue ou victorieuse, elle n'en supportait pas elle-même les frais. Ces frais étaient couverts par les sujets de l'une aussi bien que de l'autre. Au temps où ils étaient menacés de destruction par les invasions des barbares, la guerre, en [7] suscitant dès progrès qui augmentaient la puissance de leurs maîtres, leur valait un supplément de sécurité. Mais depuis que l'accroissement de cette puissance a mis fin aux invasions des barbares, ils n'en tirent plus aucun profit. Au contraire, la guerre entre les Etats devenus plus nombreux et plus puissants leur coûte plus de frais et leur cause plus de dommage. Or, les esclaves, passés à l'état de serfs puis de sujets, sont devenus à leur tour riches et puissants. Le fardeau des redevances et des impôts allant s'alourdissant, par l'accroissement des frais de la guerre, ils les supportèrent de plus en plus impatiemment. Ils ont fini par vouloir les débattre et les fixer de gré à gré. Autrement dit, ils ont voulu être appelés à consentir l'impôt en échange duquel ils reçoivent les services de gouvernement et de sécurité de la société propriétaire de l'Etat. Cette prétention, d'abord considérée comme insolente et rigoureusement réprimée, acquit une force croissante par suite de l'extension du domaine de l'échange et l'avènement de la concurrence sous sa forme productive.
Sous l'impulsion des progrès que suscita la concurrence, l'industrie prit un essor extraordinaire et détermina un accroissement rapide de là richesse et de la puissance dès propriétaires et des directeurs des entreprises de production. Une lutte s'engagea entré cette bourgeoisie industrieuse et l'aristocratie gouvernante. [8] Cette lutte so termina tantôt par une révolution violente, tantôt par une évolution pacifique qui plaça l'Etat, avec les services de sécurité et de gouvernement dont il possède le monopole, entre les mains de la nation. Mais la nation ne peut exercer elle-même ces services. Des associations politiques — des partis — se constituent pour les remplir et ils y sont d'autant plus excités que c'est une industrie qui procure, plus qu'aucune autre, des profils matériels et moraux. Au monopole permanent d'une aristocratie ou d'une maison propriétaire de l'Etat a succédé le monopole temporaire d'un parti. Quelles ont été les conséquences de ce changement qui a fait succéder le régime constitutionnel et parlementaire, au régime plus ou moins autocratique du chef héréditaire de la classe des propriétaires de l'Etat ? La première de ces conséquences a été la mobilité du pouvoir et la lutte ouverte entre les partis pour s'en emparer. Ces partis ont pour objectif nominal l'intérêt de la nation et, à leurs débuts, ils avaient sincèrement l'intention de lui être fidèles, Mais en leur qualité de concurrents, ils croyaient aussi non seulement qu'ils étaient seuls capables de se charger des services essentiels de l'Etat, que ces services, en tombant entre les mains des autres partis subiraient une inévitable décadence et finiraient par causer la ruine de la nation. De là, l'ardeur de la lutte et, particulièrement en France, la violence initiale de ses procédés.
[9]
Comment se forment les partis et recrutent-ils leur état-major et leurs soldats ? Ils se forment et se recrutent dans chacune des classes dont se compose la nation. Quoiqu'on ait prétendu que ces classes n'avaient point survécu à la suppression de l'ancien régime et à l'avènement du nouveau, elles ont continué de subsister sous l'influence, celle-ci permanente et indestructible, de la nature des sociétés et des choses. Les fondateurs du nouveau régime ont dû eux-mêmes en convenir, en finissant par reconnaître la nécessité de restreindre l'exercice du droit de posséder l'Etat et d'élire les mandataires chargés de gouverner la nation. La classe peu nombreuse seule réputée en France comme politiquement capable, se composa d'abord de l'aristocratie auparavant propriétaire de l'Etat et d'une ample part du domaine territorial, ensuite de la bourgeoisie enrichie par l'industrie et le commerce. Enfin, un progrès considéré généralement comme le plus nécessaire de tous, a conféré à une foule de plus en plus nombreuse l'exercice du pouvoir d'élire les mandataires chargés de la direction de l'Etat. Ce progrès est partout en train de se réaliser et il ne reste, plus guère aujourd'hui qu'à adjoindre au suffrage universel masculin le suffrage féminin.
Dans les divers pays où ces progrès politiques ont été accomplis : avènement du régime constitutionnel et parlementaire, extension du suffrage à la multitude [10] auparavant en tutelle, il importe avant tout d'examiner quels sont les opinions et les intérêts de chacune des classes dont se compose la nation.
Là classe supérieure, en minorité dans chaque pays, se compose, en revanche, de membres individuellement plus puissants, sinon toujours plus riches et plus intelligents, que les individus des classes inférieures. Ils appartiennent, les uns à l'aristocratie autrefois en possession des fondions supérieures militaires et civiles de l'Etat, les autres à la portion la plus riche de la bourgeoisie propriétaire de la plupart dés entreprises de production industrielle et commerciale. Comme celles de l'immense majorité des hommes, leurs opinions sont gouvernées par leurs intérêts. Occupant les principales fonctions de l'Etat, ils emploient leur influence politique à s'en assurer la conservation et à en accroître l'importance. Propriétaires fonciers, ils sont protectionnistes agraires comme les chefs d'industrie, et les capitalistes leurs commanditaires, sont protectionnistes industriels, Quoique leurs intérêts soient divergents; ils trouvent cependant profit à se coaliser contre les partisans de la liberté du commerce. La même divergence d'intérêts lés sépare sur la question de la paix ou dé la guerre, Les descendants de l'ancienne aristocratie sont naturellement intéressés à la persistance de la guerre qui leur avait valu leur prééminence et à laquelle leurs instincts combatifs les rendaient particulièrement [11] propres, tandis, au contraire, que la classe qui tire ses moyens d'existence de l'industrie et du commerce est généralement intéressée à la paix. Cependant, quelques-uns de ses membres les plus riches et les plus influents trouvent dans l'état de guerre des jouissances exceptionnelles de situation et de vanité ; ils se mêlent à l'aristocratie en envahissant, par exemple, les fonctions de la diplomatie que la permanence de l'état de paix achèverait de rendre inutiles. D'autres trouvent de fructueux profits dans les industries qui fabriquent et renouvellent le matériel de guerre.
Au-dessous de cette classe essentiellement conservatrice, apparaît une classe composée de la plupart des membres des professions libérales et du personnel de la moyenne industrie. C'est dans celle-ci, que se recrute principalement le parti dit libéral Il dispute la possession de l'Etat au parti conservateur, et réussit souvent à la lui enlever, en suppléant à l'influence du nom ou de la richesse par l'ardeur et le nombre, On distingue toutefois dans cette classe moyenne deux tendances opposées selon qu'elle se rapproche de la classe supérieure ou confiné à la masse ouvrière. L'une grossit je parti conservateur et participe à ses bénéfices lorsqu'il est au pouvoir ; l'autre s'allie plutôt à la classe ouvrière depuis qu'elle a obtenu par l'abaissement du cens électoral une chance d'y arriver. Du parti libéral se détache alors un parti radical, puis, l'avènement du [12] suffrage universel fait surgir un parti socialiste. Comme ses ainés, celui-ci a pour objectif la possession du pouvoir et de ses avantages, Mais, conscient de la puissance que la richesse et l'occupation du pouvoir donnent à ses concurrents, il n'a qu'une faible confiance dans la supériorité du nombre et lui préfère volontiers, comme plus expéditif et plus sûr, l'emploi des moyens révolutionnaires,
Si donc on considère les résultats de la substitution du régime constitutionnel et parlementaire à l'ancien régime autocratique, on est amené à craindre qu'il ne résolve pas encore le problème du meilleur gouvernement possible. D'abord, il a le défaut de coûter plus cher sans offrir toujours des garanties plus sûres de sécurité et de liberté. Il coûte plus cher, en premier lieu, à cause de la mobilité de la possession du pouvoir : le parti qui a réussi à l'obtenir n'en a que la' jouissance précaire, il est en conséquence obligé de fournir à ses soldats, s'il veut les conserver, une solde proportionnée aux risques de chômage auxquels ils sont exposés, en second lieu, à une classe à laquelle la possession permanente du pouvoir avait conféré de génération en génération les avantages matériels et moraux attachés à son exercice, a succédé, en concurrence avec elle. Une classe parfois famélique, en tout cas formée de membres occupant des situations inférieures et d'autant plus ardents à combler la différence qu'elles étaient [13] plus basses. Enfin, et ce n'est pas le moindre vice du système qui a transformé les gouvernés en électeurs, il a inauguré une nouvelle forme de la corruption, parente du vol : la corruption électorale. On ne peut, en effet, participer à la production des services de l'Etal et aux bénéfices qu'elle confère qu'a la condition d'être élu par les consommateurs de ces services ; c'est-à-dire après avoir obtenu la majorité dans une circonscription électorale. Il faut donc demander le vote des électeurs, et ce vote a une valeur puisqu'il est demandé. Les électeurs n'ont pas tardé à s'en apercevoir et ils l'estiment d'autant plus haut que la fonction à laquelle il donne accès devient plus profitable : pourquoi n'en tireraient-ils pas, eux aussi, quelque profit ? Ils réclament en conséquence une part des subventions que leurs mandataires ont le pouvoir d'accorder sous une forme ou sous une autre, une protection particulière pour leur industrie, parfois un adoucissement des rigueurs de la loi ; les plus besogneux et lés moins scrupuleux vont même jusqu'à monnayer leur vote. Et plus la concurrence de la demande est vive, plus naturellement s'élève la valeur du vote. En supposant que la généralité des branches de la production vienne à être placée sous l'autorité souveraine des mandataires de la nation, ils acquerraient un pouvoir autrement étendu que celui d'un Louis XIV ou d'un Napoléon, et la valeur du vote qui conférerait ce pouvoir serait à son maximum.
[14]
II
Quoique le monopole temporaire d'une association politique ou d'un parti ait succédé au monopole permanent d'une aristocratie ou d'une maison propriétaire de l'Etat, son intérêt consiste, comme celui de sa devancière, à étendre le domaine sur lequel il s'exerce. En cela il ne diffère point de celui d'une société industrielle quelconque, toutefois avec une différence essentielle du mode d'acquisition : l'agrandissement du domaine de l'Etat ne pouvant s'opérer que par une guerre de conquête, c'est-à-dire par le procédé du vol. On a d'abord quelque peine à s'expliquer que l'emploi de ce procédé primitif ait subsisté depuis qu'il se solde en perte et qu'il est généralement réprouvé comme immoral sous la plupart de ses autres formes,
Cela tient à un retard partiel de la mentalité de l'homme civilisé. Ses facultés morales ne se sont pas développées, à l'égal de son intelligence ni suffisamment pour maîtriser ses autres penchants. Tout en pratiquant l'échange et quoiqu'il lui soit redevable de l'accrosisement de sa richesse et de son bien-être, il n'a pu encore se dépouiller entièrement de son penchant au mode primitif d'acquisition, le vol. Une loi naturelle, amorale, la loi de l'économie des forces, le porte instinctivement à choisir entre ces deux modes, celui qui lui paraît le [15] plus avantageux, celui qui lui procure instantanément la plus grande somme de matériaux de jouissance en échange de la moindre somme de travail et de peine. Cependant, l'expérience des siècles ayant démontré l'incompatibilité de ces deux modes d'acquisition et la supériorité manifeste de l'échange, a fait rigoureusement prohiber le vol au sein do chaque société. Et c'est pour assurer cette interdiction qu'ont été établies et sanctionnées par un pouvoir souverain toutes les lois qui en répriment et en punissent l'emploi. Le penchant à s'emparer du bien d'autrui n'en a pas moins subsisté et l'on ne saurait dire qu'il se soit sensiblement affaibli. Il s'est même développé en devenant plus productif à mesure que la production et l'échange ont accru la richesse, car le vol a pu alors faire main-basse sur une partie croissante de cette richesse. Toutefois, il a été de plus en plus activement poursuivi et puni par un pouvoir devenu de plus en plus fort. Aussi, sans disparaître sous sa forme primitive, n'est-il plus guère pratiqué que par une minorité demeurée réfractaire à la civilisation. Mais, tout en étant prohibé comme nuisible, immoral et déshonorant dans l'intérieur de chaque Etat, il est resté permis et même considéré comme honorable et glorieux à l'extérieur, quand il s'opère aux dépens des autres Etats sous la forme d'une guerre de conquête.
Ce phénomène et cette anomalie morale paraîtraient, [16] disons-nous, incompréhensibles depuis que l'Etat appartient à la nation et que la guerre se solde par une perte, aussi bien en cas de victoire qu'en cas de défaite, si elle n'était partout décidée et engagée par le monarque ou le chef d'un parti en possession du puissant mécanisme de l'Etat, sous la pression d'une minorité politiquement influente à laquelle la guerre rapporte, quelle qu'en soit l'issue, plus qu'elle ne coûte. Cette minorité se compose du haut personnel des armées, des fournisseurs du matériel et des approvisionnements, des banquiers qui négocient les emprunts de guerre, etc., etc., qui trouvent les uns et les autres dans une guerre des profits qui dépassent leur part des frais et des pertes qu'elle cause. Enfin, la guerre apparaît souvent comme un moyen de conservation à un chef de gouvernement autocratique ou constitutionnel, menace par une opposition à laquelle elle permet d'imposer silence.
Cependant la guerre exige aujourd'hui des quantités croissantes d'hommes et de capitaux. Le service obligatoire devenu presqu'universel, bien que la civilisation n'ait plus à redouter les invasions des barbares, fournit les premiers en abondance, les seconds sont puisés, d'abord, dans le stock monétaire des banques nationales, ensuite dans les emprunts auxquels prennent part les étrangers aussi bien que les nationaux. Et telle est l'impartialité des capitalistes qu'il leur arrive parfois de [17] prêter aux deux belligérants. Ajoutons qu'un Etat belliqueux n'a point à redouter les résistances de la nation, si pacifique qu'elle soit, car, si le progrès politique l'a munie abondamment de garanties théoriques, le progrès économique a armé l'Etat moderne d'instruments pratiques irrésistibles, chemins de fer, télégraphes, etc., pour réprimer toute tentative de résistance à ses volontés. Il est facile, d'ailleurs, d'éveiller les passions belliqueuses de la multitude, d'autant plus qu'elle ne supporte pas immédiatement — et c'est un outre progrès — les frais et dommages de la guerre. Ses pires désastres demeurent simplement locaux même en cas de défaite. La région envahie souffre seulement de la présence de l'ennemi. Et si c'est un ennemi suffisamment discipliné et civilisé, il respecte les personnes et les propriétés de la population civile, il paye même comptant ses achats. Le reste du pays n'en éprouve aucun dommage matériel. Au contraire, le départ d'une partie de la population valide, en diminuant le nombre des bras empêche les salaires de baisser et parfois même les fait hausser. Les vides causés par les pertes d'hommes ont un effet analogue, au retour de la paix, quelle que soit l'issue de la guerre. Quelle est alors la situation? Si la guerre a été heureuse, le vainqueur reçoit d'habitude une indemnité, laquelle s'est élevée après ta guerre franco-allemande à cinq milliards, mais le vaincu n'a pas eu besoin de la prélever [18] immédiatement sur ses contribuables. Le crédit la lui a fournie. On conçoit qu'une somme de cinq milliards ajoutée au capital de la nation victorieuse ait causé un vif stimulant à son industrie et l'on s'explique l'impulsion extraordinaire qu'elle en a reçue. II semblerait que la nation vaincue ait dû subir une perte au moins équivalente. On a vu, au contraire, l'industrie française prendre un essor presque égal à celui de l'industrie allemande. Cela tient à ce qu'une faible partie seulement des frais de la guerre a été demandée à une augmentation d'impôts et à ce qu'une somme équivalente au montant de l'indemnité l'a été au crédit pour refaire et accroître le matériel de guerre. Le capital disponible de la nation, au lieu d'avoir été entamé, s'est trouvé, en conséquence, aussitôt augmenté, et il a fourni un supplément d'aliment à l'industrie.
La nation vaincue s'est ainsi promptement relevée. Mais quel a été le résultat final de la guerre? Ça a été de reporter, en France, sur, les générations futures, la grosse part des frais qu'elle a coûtés, et sur les deux nations ceux de l'augmentation de l'armement qu'elle a provoquée. Et remarquons que les générations futures n'ont pas été consultées et pour cause ; qu'elles supporteront indéfiniment des impôts qui diminueront leur capacité productive, avec la perspective d'une guerre de revanche. Or, une dette léguée par la génération présente aux générations futures, sans aucune [19] valeur matérielle ou morale, est-elle outre chose qu'un vol?
Tandis donc que la production et l'échange, stimulés par la concurrence, augmentent les forces et la richesse d'une nation, le vol, sous la forme d'une guerre de conquête, les détruit, en léguant aux générations futures une masse croissante de dettes. Actuellement sur les 150 milliards de dettes dont les contribuables de l'ensemble des peuples civilisés ont à payer les intérêts, plus des deux tiers, soit 100 milliards, doivent être mis au compte des guerres passées. Les contribuables, qui ont de ce chef à fournir annuellement de 4 à 5 milliards, y compris les frais de perception, commencent à supporter impatiemment ce fardeau, surtout quand ils s'avisent de rechercher le profit qu'ils en ont tiré. Aussi tous les gouvernements ont-ils pris l'habitude invariable de réclamer l'augmentation, devenue habituelle de leurs budgets de la guerre, uniquement pour la défense nationale, Cependant, s'il est bien avéré que la civilisation n'a plus rien à craindre de l'invasion des barbares, et si aucun peuple civilisé ne nourrit le projet antiéconomique et pervers d'attaquer les autres, on peut se demander s'il y a lieu d'augmenter chaque année les frais de la défense nationale. A la vérité, des procès peuvent surgir entre les gouvernements comme entre les particuliers. Ils peuvent avoir à défendre, suivant l'expression du Président de la Conférence de La Haye, [20] « les intérêts essentiels et l'honneur de la patrie ». Mais il en est de même pour les procès qui surgissent entre les particuliers dont la collectivité constitue la nation. Ces procès, si importants et délicats qu'ils soient, les tribunaux se chargent de les résoudre, et ils déploient dans cette besogne plus d'intelligence et de sens de là justice qu'on n'en trouve dans les torpilles et les schrapnells les plus perfectionnés. Enfin, la puissance nécessaire pour faire exécuter leurs jugements, les gouvernements pacifiques pourraient s'associer pour la leur fournir.
III
Aux charges résultant de la persistance de l'état de guerre, c'est-à-dire du vol par voie de conquête, se joignent celles des monopoles exercés par les gouvernements et leurs protégés. Les industries monopolisées par un gouvernement fournissent des articles, produits ou services, qui coûtent aux consommateurs et aux contribuables plus cher que ceux des industries de concurrence, et causent par là-même à la nation une perte ou un ralentissement des progrès de la puissance et de la richesse.
Il est assez curieux d'examiner les raisons que les gouvernements invoquent pour monopoliser, en totalité ou en partie, certaines branches de l'activité humaine. [21] S'agit-il de l'enseignement par exemple? C'est une industrie qui ne couvre pas ses frais et dont les déficits permanents sont comblés par la généralité des contribuables. L'Etat s'est attribué l'enseignement supérieur et moyen, à la fois comme possédant au plus haut degré les capacités intellectuelles ou morales nécessaires pour l'exercer, et comme un moyen de venir en aide aux familles qui destinent leurs enfants aux fonctions les plus élevées et généralement les plus lucratives de la société. Mais l'expérience a suffisamment démontré que l'enseignement de l'Etat n'est aucunement supérieur à l'enseignement libre et que les familles qui destinent leurs enfants aux emplois supérieurs sont, sauf de rares exceptions, assez aisées pour subvenir aux frais de leur instruction. Ce qui le prouve, c'est qu'un bon nombre d'entre elles s'adressent à l'enseignement libre, quoiqu'il soit renchéri par la part qu'il supporte de l'impôt destiné à couvrir le déficit de l'enseignement de l'Etat. L'enseignement primaire a de même un double objet: inciter les parents à remplir leur devoir envers les enfants et inculquer à ceux-ci les sentiments de patriotisme et de respect de la propriété. Mais depuis que les parents les plus pauvres ont été reconnus capables de participer au gouvernement de l'Etat, n'est-ce pas leur faire injure que de les croire incapables de remplir leurs devoirs envers leurs enfants? Quant au patriotisme et au respect de la propriété, les instituteurs [22] de l'Etat se font-ils toujours un devoir scrupuleux de les enseigner?
S'agit-il des monopoles tels que ceux du tabac, des allumettes, des chemins de fer, etc., qui établissent un impôt particulier et parfois exhorbitant sur les consommateurs, en leur fournissant des produits ou des services inférieurs à ceux des industries de concurrence? La différence ne doit elle pas être portée au compte du vol? N'en est-il pas de même des impôts progressifs sur les revenus, sur les successions, etc., quoique les frais de l'assurance de la vie et de la propriété des riches s'élèvent simplement en proportion de leur valeur? Si le surcroît est employé à des oeuvres philanthropiques: à pourvoir, par exempté, aux frais de la vieillesse des ouvriers, n'en résulte-t-il pas encore un dommage moral et matériel? dommage moral infligé au vieil ouvrier réduit à vivre aux dépens d'autrui, dommage matériel infligé à la société tout entière par l'encouragement à l'imprévoyance, dans tous les cas, perte de puissance et de richesse.
Mais, c'est surtout en protégeant l'industrie par le tarif des douanes, que l'Etat cause à la nation et à l'humanité tout entière un dommage irréparable.
Le système qualifié de protecteur a eu toutefois, dans le passé sa raison d'être et il est le témoignage flagrant de l'évolution qui a rendu immorales et nuisibles des institutions et des pratiques justes et utiles dans un état [23] antérieur de l'existence des sociétés. — A l'époque où le mode d'acquisition par le vol était général entre les sociétés propriétaires d'Etats, où la guerre était considérée comme l'industrie la plus légitime et la plus avantageuse, où, en même temps, les différentes catégories de produits n'avaient pour débouché que le marché national, la sécurité de l'Etat et de la Nation exigeait, d'une part, que les articles nécessaires à l'existence et à la défense de la population — tels que les subsistances et le matériel de guerre — fussent produits par elle-même, et, d'une autre part, qu'elle fût assurée de la conservation permanente de son marché. L'importation temporaire d'une marchandise étrangère causait alors un abaissement des prix, dommageable pour les producteurs auxquels succédait, lorsque la guerre interrompait le commerce extérieur, un relèvement non moins dommageable aux consommateurs. Mais la situation a changé lorsque les guerres, moins productives, sont devenues moins fréquentes. En fait, la guerre est, aujourd'hui, interdite aux petits Etats européens, et elle n'éclate plus qu'après des périodes de paix de plus en plus longues entre les grands. L'état de paix est devenu, malgré les excitations des intérêts belliqueux, l'état normal du monde civilisé. Les relations commerciales se sont multipliées entre les nations dans ces intervalles de paix de plus en plus longs, et, lorsqu'une guerre a éclaté entre deux nations, elle a cessé d'interrompre le [24] commerce des neutres avec elles. Déjà au xviiie siècle, une ligue des neutres s'était constituée pour restreindre dans cet intérêt, les droits de la guerre. Aujourd'hui, l'adoption de la maxime que le pavillon couvre la marchandise assure, contre la guerre, le commerce international de la généralité des marchandises, à la seule exception de la contrebande de guerre. Aucune raison du sécurité ne peut donc plus être invoquée pour protéger les produits nationaux contre la concurrence des produits étrangers. Tous les consommateurs peuvent, en tout temps, être approvisionnés des articles qui leur sont nécessaires sans subir, même en temps de guerre, une hausse extraordinaire des prix. Et les producteurs, de leur côté, n'ont plus à redouter la fermeture de leurs débouchés étrangers, sauf à subir l'amoindrissement des relations commerciales causé par la guerre. Une nouvelle assiette de la production s'est ainsi peu à peu substituée à l'ancienne. Tandis qu'il fallait produire la presque totalité des articles nécessaires à la satisfaction des besoins de la population dans l'enceinte limitée de l'Etat, quelles que fussent les difficultés et la cherté de la production, il est devenu possible d'obtenir en tout temps, sur toute la surface du globe, ceux dont la production est la plus facile et la moins coûteuse. Mais le bénéfice de cet élargissement de la sphère de l'échange ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'une industrie ne possédait que le marché local ou même national, elle ne comptait [25] qu'un petit nombre de producteurs qui s'entendaient pour fixer les prix de leurs produits. Ils constituaient un monopole, à la vérité limité par la loi, mais qui leur attribuait au delà de la part des bénéfices nécessaires de l'échange. En revanche, la limitation de leur clientèle locale ou nationale les empêchait d'augmenter leurs profits en développant et en perfectionnant leur industrie par la division du travail ; l'extension de la sphère de l'échange leur a permis de les multiplier et de compenser ainsi leur abaissement : producteurs et consommateurs y ont gagné.
Cet élargissement de la sphère de la production et de l'échange devait avoir un effet analogue à celui de l'invention d'une machine nouvelle qui, en diminuant les frais de production et le prix d'un produit ou d'un service, les met à la portée d'un plus grand nombre de consommateurs.
On sait d'où provient cette diminution du prix qui permet au consommateur de réduire ta quantité de produits ou de monnaie qu'il donne en échange de l'article fabriqué à l'aide d'une machine ? Elle provient de ce que l'invention a mis au service de la production une force naturelle qui n'était pas utilisée auparavant : vapeur, électricité, etc. Cette force est gratuite, sauf la rétribution de l'inventeur, le coût et l'alimentation de la machine qui la met en oeuvre. Sa puissance est tellement supérieure à celle qu'elle remplace qu'un métier à [26] filer, par exemple, fabrique dans le même espace de temps, Un millier de fils de plus qu'un métier à la main. Quels que soient donc la rétribution de l'inventeur et le coût de la machine, la diminution des frais est énorme et la concurrence abaisse le prix dans la même proportion. D'où il résulte que le consommateur peut employer l'économie qu'il réalise de ce chef à acheter d'autres produits qui augmentent à la fois son bien-être et ouvrent un nouveau débouché au travail et au capital employés à les créer. D'où, en dernière analyse, augmentation de la richesse et accroissement de la population. Si l'élargissement de la sphère de la production et de l'échange vient à mettre à la disposition des consommateurs d'une nation des produits créés à moins de frais à l'étranger que les produits indigènes, par le fait d'une supériorité de la fécondité du sol ou de la capacité des producteurs, ils économisent de même la différence et peuvent l'appliquer à la satisfaction de leurs autres besoins au profit des autres industries. Ce gain qui enrichit d'une manière permanente, la nation sera toutefois acheté par une perte temporaire, si une branche quelconque de l'industrie indigène ne se met point au niveau de ses rivales et succombe. Mais si cette industrie possède une influence politique suffisante, elle en usera pour faire établir un droit protecteur qui empêchera l'entrée du produit étranger. Alors, si elle est vraiment incapable du fait de la nature ou de ses [27] propres aptitudes de soutenir la concurrence étrangère, elle devra être perpétuellement protégée, ses frais de production, ne seront pas diminués, la consommation ne pourra réaliser de ce chef aucune économie et les autres industries ne pourront recevoir aucun accroissement de débouchés et de profits. Si l'industrie que le besoin de sécurité avait fait protéger contre l'importation d'un produit nécessaire est, au contraire, capable de soutenir la concurrence étrangère, la prolongation de la protection, après qu'elle aura perdu sa raison d'être, lui sera d'abord nuisible, ensuite inutile. Elle lui sera nuisible aussi longtemps que la concurrence intérieure ne suffira point pour déterminer ses progrès et que ceux'd seront retardés par l'obstacle que le tarif opposera à la concurrence extérieure en protégeant son vieil outillage contre le nouveau ; elle deviendra inutile lorsque la concurrence intérieure se sera assez développée et sera devenue assez forte pour l'obliger à perfectionner son outillage et à abaisser ainsi ses prix au niveau de ceux du produit étranger. Notons qu'en ce cas, elle aura toujours l'avantage naturel d'une grande économie de temps et de frais de transport. Mais la concurrence, qu'elle soit nationale ou étrangère, n'en est pas moins redoutée des producteurs, car elle est à la fois un propulseur des progrès et un régulateur des profits. Elle oblige les producteurs routiniers à faire les efforts d'intelligence et les frais nécessaires pour [28] réduire les prix de leurs produits au niveau de ceux de leurs concurrents les plus capables; elle les oblige de même à les abaisser au taux nécessaire pour reconstituer les agents de la production avec un profit simplement rémunérateur. C'est pourquoi ils s'efforcent incessamment de rétablir le monopole dont ils jouissaient avant son apparition, et ils y sont d'autant plus ardents qu'il est devenu plus productif. C'est pourquoi encore nous voyons partout se créer des monopoles sous forme de trusts, de cartels ou de syndicats, dans le but d'élever les profits ou les salaires aux dépens d'autrui et de ressusciter ainsi la part du vol dans l'échange.
En supposant que le propriétaire d'une entreprise de production ou les propriétaires de plusieurs entreprises réussissent à supprimer la concurrence et à fixer le prix du produit à un taux de monopole, la différence constituera un impôt prélevé sur le consommateur, S'il s'agit d'un monopole établi par un gouvernement, tel en France que celui du tabac ou des allumettes, cet impôt servira à rétribuer des services plus ou moins utiles : services de sécurité ou autres. Mais il en est autrement d'un trust ou d'un syndicat particulier; l'impôt, dans ce cas, ne rétribue aucun service : c'est un simple vol.
Mais il y a encore d'autres différences entre ces deux sortes de monopoles. Si la prohibition du tabac est pleinement efficace, le prix pourra en être élevé d'une [29] manière illimitée, ou du moins n'aura d'autre limite que l'intérêt du monopoleur, SI l'élévation excessive du prix diminue la consommation du tabac, le monopole pourra même devenir moins productif qu'une industrie de concurrence. L'intérêt du monopoleur sera alors de l'abaisser jusqu'au taux qualifié de fiscal. Sous l'ancien régime, des financiers plus ingénieux qu'humains, avaient découvert le moyen d'empêcher la diminution de la consommation du sel ; c'était de la rendre obligatoire et de contraindre le consommateur à en acheter sous peine des galères, Mais cette obligation n'en diminuait pas moins, à la longue, la consommation en éclaircissant les rangs des consommateurs. A cette limitation naturelle s'ajoute, pour les trusts et les cartels une limitation artificielle : celle du tarif des douanes. Du moment où le prix s'élève au-dessus du montant du droit protecteur, la concurrence étrangère oblige à l'abaisser à ce niveau. Or, cette limite artificielle excitant le monopoleur à diminuer ses frais de production par l'agrandissement de son exploitation, il se trouve alors dans la nécessité, ou d'abaisser le prix de la totalité des produits, ou d'expédier le surplus dans les marchés de concurrence. C'est la pratique du «dumping».
A l'imitation des trusts et des cartels des industriels les syndicats ouvriers s'efforcent aujourd'hui de fixer à leur gré les prix du travail en imposant de ce chef aux [30] industriels consommateurs de travail un impôt égal à la différence du salaire syndical et du taux de la concurrence. Mais s'ils sont, comme aux Etal-Unis, protégés contre le travail jaune, ils ont affaire à la concurrence intérieure et extérieure du travail blanc. Comment s'y prennent-ils pour la supprimer? En obtenant de la législation, l'interdiction de l'importation des immigrés par contrat ; en établissant d'une part une douane prohibitive à l'entrée des ateliers contre les non-syndiqués et en exerçant eux-mêmes les fonctions de douaniers, d'autre part en mettant, en interdit les produits fabriqués par les non-syndiqués. A ce monopole, les industriels opposent un autre monopole en se syndiquant à leur tour. Si le syndicat ouvrier est le plus fort, il pourra élever le salaire au-dessus du taux de la concurrence ; si le syndicat des employeurs l'emporte, il pourra l'abaisser au-dessous. Mais dans l'un et l'autre cas, l'écart ne sera que temporaire, Toute hausse et toute baisse des salaires ayant pour effet de diminuer ou d'augmenter les profits d'une industrie quelconque, les capitaux s'y portent ou s'en retirent, la demande de travail augmente ou diminue jusqu'à ce que le taux particulier des salaires et des profits de cette industrie se mette en équilibre avec le taux général dès salaires et des profits de toutes les industries,
Toutefois, s'il existait entre les employeurs, consommateurs de travail, et les ouvriers, producteurs de [31] travail, une entente générale pour augmenter les profits aux dépens des salaires, ou vice-versa, cet état de choses pourrait se prolonger jusqu'à la ruine du capital ou la destruction du travail. On peut supposer encore que l'industrie d'un pays forme sous la protection d'un tarif des douanes un trust qui élève les prix de la généralité des produits au-dessus du taux de la concurrence, mais, dans ce cas, l'élévation artificielle des prix retombera sur les consommateurs et constituera un impôt égal au montant de la protection douanière. Cet impôt sera compensé par les bénéfices du monopole pour les participants aux trusts et aux syndicats, mais il ne fournira aucune compensation aux autres consommateurs. Ce sera un simple vol.
III
CONCLUSION, — A moins donc que le progrès moral ne s'élève au niveau du progrès matériel, on peut craindre que le vol sous ses formes multiples ne continue à détruire plus de richesses que n'en créent la production et l'échange.
VII.23. "La crise et la décadence" (1908)↩
Source
From Gustave de Molinari, Économie de l'histoire. Théorie de l'évolution (Paris: Félix Alcan, 1908), pp. 219-257.
- "Chap. XII "La crise" and
- Chap. XIII "Risques de décadence et chances de progrès"
Introduction
This comes from Molinari’s fourth book on the economic and political evolution of society and it is a much more pessimistic vision of the future. In the closing footnote on the last page he reveals that he had hoped that his 1899 book Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future would have shown the French people how they could have peacefully applied the natural laws of political economy to avoid the crisis caused by" la persistance artificielle de l’état de guerre et du régime de monopole et de protection qui lui était adapté" (the artificial persistence of a state of war and a regime of monopoly and protection which has adapted to suit it). Now he is no longer so confident. In 1908 it appeared that things were going in the other direction. Instead of trying to remove the state from the special interests which were trying to take control of it for their own benefit (enlever l’Etat-assureur aux intérêts particuliers qui s’en disputent la possession) the voters and the citizens were tryin to make "cette vieille et lourde machine" (this old and heavy machine) of state more complicated and more of a burden. The result he predicted would be a crisis and a high risk that France would collapse under the weight.
The crisis was already present in the form of high and increasing taxes and more and more public debt which the people seemed to accept as normal and inevitable. He estimated that among the European powers nearly half of each nation’s wealth was taken by the state for its own use. Molinari believed there were several causes of the increases in taxes and debt, namely war, the rise of socialist parties, the return of protectionism, and private monopolies. Concerning war, there was now a state of "les armements permanents" (permanent armaments) caused by the arms race which was underway between the other great powers of Europe. By introducing such high spending on the military the state had created an expanded "market" for the services of "ses fonctionnaires militaires et civils" (its military and cvivil functionaries) as well as for the manufacturers of weapons and other war material (fabricants et commanditaires de l’appareil de guerre).
Another cause was "l’accession d’une classe de plus en plus nombreuse à la possession de l’Etat" (the rise of a more and more numerous class to control the State) in order to direct tax-funded benefits and special privileges in their direction. With the rise of organized and politicized trade unions and the socialist parties there could erupt a new kind of "la guerre civile" (civil war) between the workers and the capitalists. Under pressure from these new groups the state felt obliged to nationalise industries such as the post and education in order to provide them with jobs and to subsidize the costs of these goods and services in order to fend off any political uprising.
Private industry was also lobbying strongly for government support such as subsides, tariff protection, or the outright grant of monopoly privilege. There were now "les industries de concurrence" (competitive industries) which made money only by providing consumers with goods they wanted at prices they could afford; as well as "les industries d’Etat" (state industries) which were state controlled and subsidized for any losses they might make. This constituted for Molinari an unsustainable "régime de demi-monopole et de concurrence faussée" (a regime of half-monopoly and false competition) which interfered with the natural economic processes of competition, profit making, and the development of markets.
In sum, there was now in France
| une classe en possession du pouvoir politique… vivant de l’Etat, puisant des moyens d’existence assurés contre la concurrence dans les industries qu’il accapare ou protège, elle est intéressée non seulement à les conserver, mais encore à les multiplier. Elle est étatiste, militariste et protectionniste. | a class in possession of political power … living off the State, drawing its means of existence protected from competition in the industries which it has seized or has protected; it is not only interested in preserving them (the protected industries) but in increasing their number. It is statist, militarist, and protectionist. |
His great fear was that the burdens placed on the economy by war expenditure, subsidies and protection to private industry, the state ownership of industry, and the increasing number of people who worked for the state, meant that France already was in a state of crisis which might ultimately lead to collapse and ruin:
| Cependant cette part déjà insuffisante est chaque jour menacée d’être restreinte davantage tant par les dépenses rapidement croissantes des guerres et des dettes de l’Etat que par la diminution de la productivité des industries qu’il accapare en les soustrayant à la concurrence. On peut donc craindre que les forces destructives de la richesse ne finissent par l’emporter sur les forces productives et que l’évolution ne se termine, après une période de décadence, par la ruine. | However, this sector of the economy (the competitive and productive sector) which is already insufficient (to pay the costs of government) is threatened every day with further controls, as much from the rapidly increasing costs of wars and state debt, as from the reduction in the productivity of the industries which it (the state) monopolises by removing their competitors. Thus one fears that the forces which destroy wealth will end up defeating the forces which produce wealth and that (economic) evolution will, after a period of decadence, end in ruin. |
Text
[219]
CHAPITRE XII. La crise.
I
Nous ne possédons que des données approximatives et incertaines sur la richesse des nations appartenant à notre civilisation, à la fin du xvme siècle; nous ne savons pas d'une manière plus exacte dans quelles proportions elle s'est accrue depuis cette époque, mais le progrès du rendement de certains impôts sur des articles de consommation générale, sans parler d'autres indices, semble attester qu'elle avait décuplé à la fin du xix" siècle, au moins dans les pays de grande industrie, tandis que la population ne s'y est augmentée que de moitié environ. Nous n'avons encore que des données purement conjecturales sur la part annuelle que l'Etat prend dans le revenu que chaque nation tire des différents éléments ou facteurs de sa richesse. Cette part, l'Etat [220] la prélève au moyen des impôts divers dont il frappe la production et la consommation et qui sont demeurés les mêmes sous des noms et avec des modes de perception différents, si ce n'est toutefois que le nombre s'en est visiblement accru, soit qu'ils atteignent les rares articles qui en étaient autrefois exempts ou des articles nouveaux nés des progrès de l'industrie. Malgré les lois qui ont eu pour objet d'en augmenter le rendement ou d'en modifier la répartition, on ignore sur qui et dans quelle mesure en retombe la charge car leur incidence est à la fois mystérieuse et variable, mais ce n'est pas trop s'éloigner de la vérité de soutenir que la part que prend l'Etat dans le revenu annuel de la nation n'a subi aucun changement. Il est d'ailleurs manifeste qu'elle tend partout à s'accroître plutôt qu'à diminuer. Ce qui pourrait faire croire qu'elle s'est amoindrie, c'est qu'elle est plus aisément supportée et que les augmentations d'impôts qui soulevaient jadis des révoltes ne causent aujourd'hui qu'une légère émotion. En effet, si la richesse d'une nation vient à doubler, si son revenu annuel s'élève, par exemple, de 2 milliards à 4, l'Etat, en lui en enlevant la moitié, lui laisse cependant le double de ce qui lui restait auparavant. Elle peut, en conséquence, augmenter son bien-être et son épargne, partant aussi fournir facilement, sans trop restreindre la satisfaction de ses besoins, la même proportion d'impôts qu'elle acquittait péniblement, au prix de la privation du nécessaire.
[221]
II
Si l'on examine les dépenses-de l'Etat moderne, on s'explique que la proportion que l'impôt enlève au revenu annuel de la nation n'ait pas diminué, qu'elle tende au contraire à s'élever progressivement. La guerre est demeurée de beaucoup le principal article de ces dépenses. Nous savons à quel point les progrès de son outillage l'ont rendue plus coûteuse, mais l'augmentation extraordinaire de la richesse de la nation n'en a pas moins permis à l'Etat de pourvoir avec une facilité croissante à celle de ses! frais. Car il a pu, grâce au développement du crédit public disposer non seulement des ressources de la génération présente, mais encore escompter celles des générations à venir. Sous l'ancien régime, l'Etat était obligé de subvenir aux frais de ses guerres presque exclusivement par l'impôt. Il ne pouvait recourir qu'exceptionnellement et dans une faible mesure à l'emprunt, d'abord parce que les capitaux étaient rares, ensuite parce qu'il ne pouvait offrir aux prêteurs que des garanties insuffisantes et douteuses. Les dépenses de l'Etat n'étant point, sauf en Angleterre, consenties et autorisées par la nation, elle n'en était point responsable. Et il aurait fallu à l'Etat plus de puissance qu'il n'en possédait communément pour ajouter aux impôts ordinaires qu'il ne percevait pas sans peine, un impôt supplémentaire destiné à payer ses dettes. Il avait moins à redouter [222] les réclamations de ses créanciers que les révoltes de ses sujets et, s'il portait atteinte à son crédit en retranchant un quartier de la rente, il s'épargnait les embarras du moment.
Mais la situation a changé le jour où les nations après avoir acquis de gré ou de force la propriété de l'Etat sont devenues responsables de ses dettes. Sans doute une nation peut répudier en totalité ou en partie les dettes d'un Etat prodigue, mais c'est à la condition d'être assez forte pour braver les revendications des Etats étrangers, dont les sujets ont participé à ses emprunts. Lorsqu'elle est faible, ils lui imposent à coups de canon l'obligation de les rembourser. Il arrive alors que les créanciers ainsi protégés après avoir prêté à grosse usure à un Etat dont ils suspectaient l'honnêteté se trouvent avoir fait une bonne affaire et sont encouragés à prêter aux Etats malhonnêtes de préférence aux autres.
L'Etat, quel qu'il soit, peut, au surplus, faire du crédit, un usage utile ou nuisible. Si les capitaux qu'il emprunte sont employés d'une manière utile à la nation, le profit qu'elle en tirera dépassera la charge des intérêts et de l'amortissement. Seulement, - l'Etat a l'habitude d'attribuer à ses entreprises l'accroissement de la richesse de la nation, sans tenir compte de l'enrichissement qu'ont pu lui valoir les outres. Si au contraire, les capitaux empruntés pari l'Etat ont servi à des entreprises engagées dans l'intérêt du chef de l'Etat et de la classe particulière; sur laquelle il s'appuie, on aura quelque raison de [223] douter que cet emploi procure à la nation un accroissement de puissance et de richesse supérieur ou même égal à l'affaiblissement et à. l'appauvrissement que lui causera la charge des intérêts et de l'amortissement des capitaux empruntés.
C'est principalement à des entreprises de guerre qu'ont été employés les capitaux fournis d'abord presque exclusivement par l'impôt, ensuite pour la, plus grande partie par le crédit. Il serait intéressant d'examiner et de comparer les motifs qui ont fait entreprendre les guerres à l'époque où l'Etat appartenait à une maison, et depuis qu'il appartient à la nation.
Si nous nous en tenons à la, période qui s'étend du règne de Louis XIV à la Révolution française, nous constaterons sans peine que la considération de l'intérêt des nations n'entre pour rien dans les motifs de la guerre, qu'il ne vient pas à la pensée de ceux qui l'engagent de calculer si les avantages qu'elle en tirera seront supérieurs ou non au prix dont elle la paiera. La guerre de la succession d'Espagne était motivée par un conflit d'ambition entre les maisons de France et d'Autriche, la guerre de Hollande a été causée par l'irrévérence des publications qui s'attaquaient à la personne sacrée du Roi-Soleil, et sous Louis XV une guerre désastreuse a été provoquée par des épigrammes qui égratignaient la favorite. La guerre avec l'Angleterre eut à la vérité un motif plus noble, l'entraînement à secourir les insurgents des coldnicfe d'Amérique; [224] Nul, à l'exception de Turgot, ne s'avisait de se demander s'il était sage de s'abandonner à cet acte de générosité aux frais de la nation épuisée par' les guerres précédentes.
Mais l'Etat était alors en France et ailleurs la propriété d'une maison. Les guerres qui ont ravagé le monde depuis que l'Etat appartient à la nation étaient, elles mieux justifiées et plus conformes à son intérêt ? Les guerres du Premier Empire ont été engagées par la volonté d'un seul homme qui concentrait entre ses mains tous les pouvoirs de la nation souveraine, dont il se plaisait à confondre l'intérêt avec le sien. Après une longue période de paix, les guerres se sont multipliées avec rapidité sans être mieux motivées que celles de l'ancien régime, mais avec des frais qui s'augmentent du même pas que les ressources que fournit pour les soutenir l'accroissement de la productivité de l'industrie et le développement du crédit. La guerre d'Orient avait pour prétexte la protection des Lieux Saints, et pour motif la satisfaction à donner aux intérêts professionnels des complices du coup d'Etat du 2 décembre, peut-être aussi une incorrection personnellement offensante du formulaire diplomatique; la guerre d'Italie a eu pour cause déterminante un attentat destiné à remettre en mémoire au maître de la France ses engagements d'ancien carbonaro; la guerre franco-allemande entreprise sous le prétexte ridicule d'une candidature allemande au trône d'Espagne était destinée à raviver l'existence de l'Empire, affaibli par [225] l'échec de ses réformes libérales, et menacé d'un retour offensif de la Révolution, malgré l'unanimité d'une consultation de l'opinion en faveur de la paix; la guerre russo-japonaise a été engagée dans l'intérêt d'une spéculation véreuse, sans que la multitude des pauvres moujiks qui devaient l'alimenter de leur sang et de leurs maigres ressources connussent même l'existence du Japon et des Japonais. C'étaient à la vérité des guerres dont le régime constitutionnel ne peut être rendu responsable. En revanche, la guerre de la Sécession américaine a été fomentée sous le prétexte humanitaire de l'abolition de l'esclavage d'une race pour laquelle ses libérateurs affichent plus d'antipathie et de mépris que ne faisaient ses maîtres, en réalité sous l'impulsion de la jalousie et des convoitises des politiciens et des protectionnistes des Etals du Nord; la guerre du Transvaal a été le résultat du conflit d'un groupe de capitalistes anglais avec les politiciens boers ; les guerres coloniales qui se soldaient en perte et avaient presque disparu au xvme siècle ont recommencé sous la poussée des intérêts de la hiérarchie professionnelle des armées et de la bureaucratie devenue pléthorique. Et n'importe sous quel régime, toutes ces guerres ont été entreprises sans que les nations qui en payaient les frais aient été consultées plus qu'elles ne l'étaient dans les siècles précédents, et bien que la guerre soit devenue incomparablement plus coûteuse. Si l'on compare à cet égard les guerres du xixe siècle à celles [226] du xviiie, on se convainc que la dépense d'argent et de sang qu'elles ont coù'ée s'est élevée pour le moins au décuple. Les dettes causées presque en totalité par la guerre dans la durée du siècle qui ai précédé la Révolution française n'atteignaient pas dix milliards, et celles de la France y étaient comprises pour moins de 2 milliards. Elles s'élèvent aujourd'hui à 148 milliards,[2] et la part de la France y figure pour plus de 30 milliards. Quant au sang répandu [227] dans les guerres du siècle antérieur à la Révolution, il remplirait un étang, celui des guerres du siècle suivant ferait déborder un lac.
III
Dans tous les pays civilisés, les budgets de la guerre et de la dette, incessamment grossis par les armements permanents que la guerre nécessite et qu'il faut renouveler le plus souvent avant qu'ils n'aient servi, absorbent généralement plus de la moitié des dépenses de l'Etat.
Le restant est employé à pourvoir à des services de plus en plus nombreux et divers. Les Etats de l'ancien régime n'avaient qu'un petit nombre d'attributions. Ils se bornaient à pourvoir à la sécurité extérieure et intérieure de leur domaine, à le conserver intact et à l'agrandir. Ils abandonnaient l'enseignement au clergé, et la généralité des industries aux corporations de métiers et aux entreprises individuelles ; enfin l'affermage de la plupart des impôts les exonérait de la nécessité d'entretenir une nombreuse bureaucratie. Ils avaient été amenés à cette organisation conforme à la loi de l'économie des forces par la pression de la concurrence guerrière, et d'autant plus que la société fondatrice et propriétaire de l'Etat n'avait ni le goût, ni les aptitudes requises par les industries dont elle assurait l'existence. La bourgeoisie, plus nombreuse que [228] l'aristocratie et plus capable d'exercer des professions que celle-ci avait considérées comme subalternes, en la dépossédant ou en entrant en partage avec elle devait naturellement s'efforcer d'agrandir l'Etat pour s'y faire une place. A la vérité on pouvait prétendre, et on n'y a pas manqué, que les besoins de l'industrie en progrès nécessitaient la création d'un nombre croissant de services, mais la liberté n'y aurait-elle pas pouïvu aussitôt qu'un service quelconque serait devenu assez utile pour attirer le capital et le travail par l'appât d'une rémunération équivalente à celle des autres emplois ? ce qui était même le signe certain de leur utilité. Cette considération économique ne pouvait toutefois arrêter la foule des aspirants à des fonctions dont la rétribution était assurée par l'impôt, et qui étaient garanties contre les exigences et les risques de la concurrence; il suffisait de posséder quelque influence électorale pour y avoir accès. Les partis organisés en vue de conquérir l'Etat, ou de le conserver après l'avoir conquis, rétribuaient leur armée avec cette monnaie; il fallait bien la multiplier à mesure que l'extension du droit électoral accroissait le nombre des électeurs. Peu importait que la fonction fut plus ou moins utile. Ce n'était pas le besoin auquel pourvoyait la fonction qui déterminait sa création, c'était le service politique dont elle était la rétribution. De là aussi ce sentiment naturellement ancré chez le fonctionnaire, — que, s'il a quelque obligation envers le parti auquel il doit sa nomination, [229] il n'en a aucune envers le public; qu'en exécutant une besogne à laquelle il n'est propre que par hasard, il remplit une fastidieuse corvée, et d'ailleurs que son avancement ne dépend point du service qu'il rend au public mais de celui qu'il rend et surtout de celui qu'il peut rendre encore à son parti. L'accession d'une classe de plus en plus nombreuse à la possession de l'Etat a été la cause déterminante de sa tendance croissante à s'emparer aussi d'un plus grand nombre d'industries. Que cette mainmise par l'Etat sur les entreprises de production ait pour résultat naturel et invariable de diminuer la richesse de la nation ou l'empêcher de s'accroître autant qu'elle le ferait si elle était abandonnée à l'activité privée, cela tient en dernière analyse, à ce que cet accaparement est en opposition avec les lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence. Les causes générales de cette infériorité productive de l'Etat résident 1° dans la multiplicité même et la diversité des entreprises dont il se charge et qui exigent chacune une unité de direction et de responsabilité. La direction suprême de l'Etat s'affaiblit en se multipliant et sa responsabilité en s'étendant s'évanouit et devient illusoire. Et si le directeur délégué et le personnel de chacune de ces entreprises multiples est choisi en raison de sa fidélité au parti gouvernant plutôt qu'en raison de ses aptitudes professionnelles, la diminution de leur productivité va s'accumulant chaque jour davantage. Ces causes générales agissent sur les différents modes [230] d'intervention de l'Etat dans l'industrie et chacun de ces modes a ses effets particuliers, mais tous plus ou moins nuisibles à la nation. 1° Si l'Etat monopolise dans un but fiscal la production et la vente de certains articles, tels que le tabac, les allumettes, etc., il perçoit sur les consommateurs un impôt égal à la différence du prix du monopole et de celui de la concurrence. Une partie de cette différence est absorbée par la supériorité des frais de production de l'industrie monopolisée, et constitue pour la nation une perte sèche. Si l'autre partie n'est pas employée par l'Etat plus utilement que ne l'aurait fait le consommateur, elle constitue une seconde perte. 2° L'Etat intervient dans l'industrie en comblant aux frais des contribuables les déficits des branches de la production qu'il exerce, soit qu'il les soumette ou non à la concurrence, en subventionnant celles dont les produits ou les services ne sont pas assez demandés pour obtenir un prix rémunérateur. Mais dans ces différents cas le montant des dépenses ou de la. subvention s'augmente pour le contribuable des frais de perception de l'impôt, lesquels constituent encore une perte sèche. Et ces modes d'intervention de l'Etat se sont particulièrement développés depuis que l'industrie privée est devenue plus puissante et s'est montrée capable de mener à bonne fin les plus vastes et les plus difficiles entreprises.
Mais l'Etat ne prélève pas seulement sur la nation des impôts destinés à pourvoir d'une part aux frais de ses services militaires et civils, d'une autre part à [231] combler les déficits des industries qu'il exerce lui' même, il y ajoute les charges du protectionnisme. A mesure que la classe propriétaire et dirigeante des entreprises de production est devenue plus puissante, elle a use de son influence politique pour faire protéger ses produits contre la concurrence étrangère A l'impôt fiscal que l'Etat perçoit à son profit s'e^t superposé lin impôt de protection, qu'il prélève au profit des producteurs protégés. Cet impôt est égal au montant de la différence des prix des produits protégés et de ceux des produits concurrents de l'étranger. Quoiqu'il soit invisible et variable, on l'évalue en Franco à un milliard qui s'ajoute aux 4 milliards des impôts d'Etat. Aux Etats-Unis et en Allemagne, il a été aggravé par la fondation des trusts et des cartels qui ont pour objectif la suppression de la concurrence intérieure et, par conséquent, l'élévation des prix au niveau des droits protecteurs. Le surcroît de profits que procure le monopole des trusts et des cartels se concentre entre les mains de leur état-major financier et industriel. Et c'est ainsi que se sont créées et accumulées les monstrueuses fortunes des milliardaires américains et que s'est accrue plus qu'à aucune autre époque l'inégalité de la distribution des richesses.
Malgré l'insuffisance et les lacunes des données des statistiques officielles, nous croyons qu'on peut évaluer en moyenne à la moitié du revenu annuel de l'ensemble des nations appartenant à notre civilisation la part que l'Etat leur enlève. En évaluant [232] donc encore en moyenne à 10 heures par jour la quantité de travail employée à la production de la richesse, on trouvera que sur ces 10 heures, 5 sont absorbées par le paiement obligataire des services du gouvernement et le restant par la satisfaction de tous les besoins matériels et moraux auxquels l'Etat laisse à l'individu le soin de pourvoir lui-même.
Cela ne veut pas dire que la moitié du revenu de la nation — ou la moitié de la quantité du travail qui est employé à le produire — constitue en totalité le revenu de la classe relativement peu nombreuse à laquelle l'Etat fournit directement ou indirectement ses moyens de subsistance. Une partie et probablement la plus forte est perdue et ne profite à personne.
L'Etat ne peut toutefois être rendu responsable de toutes les pertes que subit la richesse d'une nation et qui diminuent son revenu. Parmi ces pertes figurent en première ligne les risques qui pèsent sur la production. Ces risques sont de plusieurs sortes. Il en est auxquels l'Etat est étranger quoiqu'on le sollicite d'habitude d'y remédier, ce qui n'est pas en son pouvoir. Tels sont ceux qui proviennent de l'inégalité des récoltes, des entraînements qui surexcitent la production et font succéder à des périodes de hausse des périodes de baisse en occasionnant des crises désastreuses, des perturbations causées par le progrès de l'outillage, etc., etc. Il en est, en revanche, que l'Etat crée ou suscite, tels sont l'appréhension de la guerre, l'arrêt et les [233] perturbations que toute guerre occasionne, les changements dans l'assiette des impôts, et notamment du taux des droits de douane. Ces risques et les dommages qu'ils causent se propagent, à des degrés différents, dans tous les marchés du monde que la vapeur et l'électricité ont mis en communication et rendus solidaires. Ces deux catégories de risques et de dommages diminuent la richesse des nations, partant le montant des revenus que l'Etat frappe d'impôts directs ou indirects, visibles ou invisibles.
Ces impôts sont perçus sur les produits et les services créés par la coopération du capital et du travail, car le capital et le travail ne peuvent rien produire isolément. Il reste donc à savoir dans quelle proportion ils supportent le fardeau de l'impôt.
Jusqu'à présent les classes supérieure et moyenne entre les mains desquels se trouve principalement le capital ont exercé une influence prépondérante sur la gestion de l'Etat ; elles en ont profité pour faire peser sur la multitude qui vit du produit de son travail la plus grosse part du fardeau de l'impôt en taxant soit au profit du fisc, soit au profit des bénéficiaires de la production, les nécessités de la vie. Mais quel a été le résultat de cette politique égoïste ? Ça été de diminuer la consommation, partant la production des articles dont la plus forte proportion est consommée par la classe ouvrière, plus nombreuse à elle seule que les deux autres et plus prolifique. Le débouché du capital s'est trouvé ainsi artificiellement limité en même temps que celui du [234] travail, mais dans les pays de grande industrie la production du capital n'en est pas moins demeurée plus abondante que celle du travail. On en trouve la preuve dans la supériorité de l'accroissement de l’exportation du capital sur celle de l'émigration des travailleurs. Le résultat a été une baisse générale de l'intérêt et une hausse non moins générale du salaire. Mais voici maintenant que l'influence politique de la classe ouvrière va grandissant depuis qu'elle est en possession du suffrage universel. Sous cette nouvelle influence, l'Etat, tout en continuant cependant à frapper les nécessités de la vie pour satisfaire les appétits protectionnistes des classes supérieures, a commencé à pourvoir à l'accroissement continu de ses dépenses en atteignant le capital par des impôts progressifs sur les successions et sur le revenu, auxquels on peut d'ailleurs justement reprocher de n'être pas proportionnés au service rendu. Mais quel est l'effet de cette fiscalité démocratique? C'est de provoquer le capital à se dérober à l'impôt par l'émigration, et, pis encore, c'est de décourager l'épargne qui le crée ou d'encourager la prodigalité qui le dissipe. D'où une diminution générale de la quantité et de l'offre, partant une augmentation delà part du capital aux dépens de celle du travail dans le produit de leur collaboration, une hausse de l'intérêt et une baisse du salaire. C'est ainsi que l'Etat en frappant le capital, pour complaire à sa démocratie électorale, atteint le travail, et accroît la part des capitalistes dans le revenu qu'il laisse [235] aux deux catégories inégales en nombre des collaborateurs de la production, après en avoir pris la moitié.
Cependant cette part déjà insuffisante est chaque jour menacée d'être restreinte davantage tant par les dépenses rapidement croissantes des guerres et des dettes de l'Etat que par la diminution de la productivité des industries qu'il accapare en les soustrayant à la concurrence. On peut donc craindre que les forces destructives de la richesse ne finissent par l'emporter sur les forces productives et que l'évolution ne se termine, après une période de décadence, par la ruine.
Cette crainte est, non sans raison, devenue plus vive depuis que l'Etat est en voie de tomber entre les mains de la démocratie et de ses éducateurs syndicalistes ou socialistes.
IV
De même qu'à la veille de la Révolution française les hommes qui allaient faire couler le sang à flots se proposaient d'ouvrir une ère de paix et de fraternité des peuples, leurs descendants sont animés des sentiments les plus idylliques. Ils rêvent d'établir dans le monde une paix universelle et permanente en supprimant radicalement la guerre ; seulement on regrette de constater que leurs pratiques sont non moins radicalement en opposition avec leur idéal. [236] La guerre et la paix ont leur cause initiale dans deux modes contraires et qui s'excluent, d'acquisition des matériaux de la vie, l'un commun à toutes les espèces vivantes, l'autre seulement propre à l'espèce humaine, le vol et l'échange. Or, auquel de ces deux modes les ouvriers syndiqués ont-ils recours pour élever le taux de leur salaire? C'est à une des formes du vol, le monopole. Imitant en cela les protectionnistes inventeurs des trusts et des cartels, ils s'attribuent à la fois le monopole du travail aux dépens des ouvriers nationaux non syndiqués et des ouvriers étrangers syndiqués ou non et particulièrement de ceux des races de couleur. C'est ainsi qu'ils ont interdit aux ouvriers chinois et qu'ils veulent interdire aux Japonais l'accès des marchés de travail de l'Australie, des EtatsUnis, du Sud de l'Afrique. La conséquence inévitable de cet accaparement d'une vaste portion du globe au détriment de la portion la plus nombreuse de l'espèce humaine, c'est une guerre de races.
Quant aux socialistes révolutionnaires et aux anarchistes, ils s'en tiennent de préférence au vol pur et simple. Imitant encore en cela le fâcheux exemple qui leur ai été donné par la confiscation des biens de la noblesse et du clergé, ils se proposent de confisquer les propriétés et les industries de la classe dite capitaliste. Et comme il y a apparence qu'elle ne se les laissera pas enlever sans résistance, à la guerre de race se joindra la guerre civile.
L'accaparement de toutes les industries par l’Etat [237] conduira-t-il plus sûrement à la réalisation de l'idéal du bien-être universel ? Nous ne pouvons nous dissimuler que cet accaparement est la conséquence logique de l'appropriation de l'Etat à la nation et de la mise en régie de ses services. Si la nation s'est emparée de l'Etat pour organiser à sa manière l'industrie de l'assurance de la vie et de la propriété, si, convaincue de la supériorité de ses méthodes, elle a successivement étatisé la poste, l’enseignement, etc., pourquoi n'étatiserait-elle pas tous les produits et tous les services ? Mais nous savons par expérience que l'Etat est plus apte à détruire qu'à produire.
D'où nous pouvons conclure qu'aussi longtemps que l'Etat demeurera entre les mains des classes supérieure et moyenne la décadence des nations civilisées pourra se prolonger pendant des siècles avant d'aboutir à la ruine tandis qu'il suffira de quelques années à la démocratie socialiste pour mettre fin à leur existence et à celle de la civilisation.
[238]
CHAPITRE XIII. Risques de décadence et chances de progrès.
Quelle sera l'issue de la crise que traversent actuellement les sociétés civilisées? Sera-ce un accroissement continu et progressif de forces et de richesses oui une décadence ?Voilà ce qu'on commence à se demander non sans inquiétude. Au XVIIIe siècle, on croyait volontiers à la perfectibilité indéfinie de l'homme et des sociétés humaines, et cette croyance, les progrès extraordinaires accomplis dans le coure du xixe siècle ont naturellement contribué à la fortifier. Cependant l'expérience a maintes fois démontré qu'elle ne repose point sur un fondement inébranlable. Des sociétés florissantes sont tombées en décadence et ont péri, même sans avoir succombé à une lutte contre des rivales plus puissantes. Les causes de leur chute résidaient en elles-mêmes. Quelques-unes ont disparu sans laisser de traces, après avoir transformé en déserts des régions [239] fécondes. C'est ainsi que les sociétés guerrières qui avaient fondé les anciens empires de la Chaldée et de l'Assyrie, bâti Ninive, Babylone et d'autres foyers de population et de richesse n'ont laissé qu'un sol épuisé, un vaste désert de sable où ne croissent que des cactus, et que parcourent de rares tribus de Nomades pillards. Si l'homme a acquis le pouvoir de s'emparer des forces de la nature et de les utiliser, ne possède-t-il pas de même le pouvoir de les détruire ou de les employer à des fins nuisibles? Il peut, par exemple, rendre le sol plus fécond en le mettant en culture, mais il peut aussi l'épuiser et le rendre impropre à entretenir la vie. Quoi" qu'en disent les déterministes, l'homme est libre, et sa destinée bonne ou mauvaise dépend de l'usage, utile ou nuisible, qu'il fait de sa liberté. Ce qui est vrai de l'individu ne l'est pas moins des sociétés et de l'humanité. Les lois naturelles laissent sa liberté intacte, seulement, selon qu'il les observe ou les enfreint, il s'en trouve bien ou mal. Si l'on bâtit une maison sans tenir compte de la loi physique de la pesanteur, on s'expose à ce qu'elle s'effondre en ensevelissant sous ses ruines ceux qui l'habitent; en se conformant, au contraire, à cette loi naturelle on construit des édifices qui durent des siècles. Il en est de même des lois économiques. Si une société n'obéit pas dans la production de la richesse à la loi du moindre effort, si elle gaspille ses forces en les détournant- de leur destination utile, elle les affaiblit et finit par les épuiser. Alors, une autre loi [240] naturelle, celle-là même à l'impulsion de laquelle elle est redevable des progrès de sa richesse, la concurrence, précipite sa ruine.
II
L'analyse des causes de la crise qui menace l'existence des sociétés civilisées en fera apparaître les remèdes. Ces causes résident dans la persistance artificielle de l'état de guerre et du régime de monopole et de protection qui lui était adapté. Guerre, monopole et protection, après avoir été utiles, sont devenus nuisibles, et l'œuvre de la réforme consiste à écarter ces obstacles à la marche de l'Evolution.
I. La guerre. Aussi bien dans les pays où l'Etat appartient à la nation que dans les Etats d'ancien régime, la guerre continue de subsister comme un risque inévitable et fatal. Ce n'est pas cependant un phénomène naturel qui échappe au pouvoir de l'homme. Les guerres entre les peuples civilisés dépendent de la volonté des gouvernements, et elles peuvent toujours être évitées. Ce qui le prouve, c'est que les dissentiments et les conflits d'intérêt les plus sérieux sont fréquemment vidés par des négociations ou un arbitrage. Et quand on examine les causes ou les prétextes des guerres qui ont ravagé le monde depuis un siècle, on s'aperçoit qu'elles ont été engagées uniquement sous la pression des intérêts d'un petit nombre d'individus en possession du mécanisme de l'Etat. Enfin, [241] lors qu'on fait le compte des avantages qu'ils pouvaient en tirer en cas de succès, on est étonné de l'énormité du prix auquel ils les achètent. Il est vrai qu'ils profitent de ces avantages tandis que le prix en est payé par la nation. La guerre franco-allemande nous fournit à cet égard une illustration saisissante. Si la responsabilité de cette guerre peut justement être attribuée au vaincu, celle de l'annexion de l'Alsace-Lorraine au mépris de la volonté manifeste de la population annexée appartient au vainqueur. Quels en ont été les résultats ? Au point de vue des intérêts immédiats de la classe gouvernante de l'Etat allemand, ces résultats ont été évidemment avantageux. Elle y a gagné une augmentation du débouché de ses fonctionnaires militaires et civils, et subsidiairement celle des bénéfices que le maintien et l'accroissement nécessaires des armements procurent aux fabricants et commanditaires de l'appareil de guerre. En revanche, la nation est condamnée à supporter indéfiniment les frais de cet appareil et d'une guerre possible de revendication des provinces conquises. Entre les avantages de la classe gouvernante de l'Etat, les charges et les risques de la masse de la nation gouvernée, la disparité n'est-elle pas colossale? Autant peut-on en dire de toutes les guerres modernes, guerres entre les peuples civilisés et guerres coloniales. Elles ont, sans aucune exception, été entreprises en vue de satisfaire les intérêts de la classe ou du parti en possession de l'Etat, et il faut ajouter qu'elles n'ont point [242] rencontré d'obstacles dans les institutions constitutionnelles. La classe gouvernante a pu changer ou se modifier, mais son intérêt particulier et immédiat est demeuré le mobile permanent de sa politique. Lorsqu'une guerre lui paraît présenter plus de risques de perte que de chances de bénéfices, elle s'abstient de l'engager ; lorsque les chances de bénéfice l'emportent, elle n'hésite pas à l'entreprendre, sans rechercher ce qu'il en pourra coûter à la nation. C'est qu'il est dans la nature d'une classe ou d'un parti de n'envisager que son intérêt, sauf à le confondre avec l'intérêt national et à le cacher sous le masque flatteur du patriotisme. C'est encore que les sentiments altruistes lorsqu'ils dépassent l'étroite limite des sympathies que l'homme est capable de ressentir ne prévalent pas contre le plus faible intérêt, dût la satisfaction en être achetée par un dommage cent fois, mille fois plus considérable infligé à autrui. On pourrait aisément s'en convaincre en évaluant le montant des profits ou des avantages que les guerres modernes ont rapportés aux souverains et aux partis qui les ont engagées sans avoir pris la peine de consulter les nations, et en les comparant à l'énormité des frais et des souffrances- de la masse des gouvernés qui en ont pâti.
Au point de vue de l'intérêt général des nations civilisées, la guerre est la plus effroyable des calamités et la multitude qui en supporte partout les frais et les maux en est depuis longtemps convaincue. Peut-être les amis de la paix prennent-ils [243] une peine superflue en entreprenant de l'en persuader. Ils prêchent des convertis. En revanche, il est permis de douter que leurs prédications soient assez efficaces pour avoir raison des intérêts qui poussent à la guerre, à l'entretien et à l'accroissement continu des armements qu'elle nécessite. C'est au sentiment qu'ils font appel, mais si forts que soient les sentiments, ils le sont moins que les intérêts. Un intérêt ne peut être vaincu que par un intérêt plus fort.
Lorsque la conscience de sa force existera dans la multitude gouvernée, il lui suffira, pour établir la paix entre les nations civilisées et la perpétuer, de recourir au procédé par lequel le seigneur le plus fort l'imposait aux plus faibles, au temps de la féodalité. Ce serait certainement un rêve et même un rêve anti-économique de vouloir unifier le gouvernement des nations en établissant une monarchie ou une république universelle. Mas cette unification, qui ne serait ni praticable ni désirable entre les gouvernements, est en voie de s'opérer entre les nations. Il y a déjà entre les nations, même les plus éloignées, plus d'intérêts communs qu'il n'y en avait naguère entre les provinces les plus rapprochées de la même nation, et ces intérêts créés par l'échange des produits, des capitaux et du travail, ont un égal besoin dc la paix. Lors donc que ces intérêts pacifiques seront devenus assez forts et conscients de leur force, ils pourront obliger les gouvernements à s'associer pour interdire à un Etat quelconque de vider par la guerre [244] ses querelles ou ses différends, en appuyant cette interdiction par une force collective. Alors se produira le même phénomène qui a été, au sein de chaque nation, la conséquence de l'unification de l'Etat: le désarmement, impliquant la suppression des armées et des fortifications particulières, et leur remplacement par un armement commun, destiné à préserver la civilisation du risque des invasions des barbares. Grâce à la prépondérance acquise par les nations civilisées, ce risque ne comporterait plus que la moins coûteuse des primes d'assurance.
Remarquons qu'il suffirait même pour assurer la permanence de la paix entre les nations civilisées d'adapter le droit des gens aux conditions nouvelles d'existence que leur ont faites les progrès de l'industrie et l'extension des échanges.
En remontant à l'origine du droit des gens, on trouve que l'ensemble des règles qui constituent ce droit avait pour objet d'assurer le libre exercice de l'industrie des propriétaires d'Etat : la guerre. Non seulement toute société propriétaire d'un Etat entreprenait une guerre quand elle la jugeait conforme à son intérêt, elle la conduisait à sa guise, exterminait ses ennemis et s'appropriait leurs domaines sans que les autres sociétés eussent rien à y voir, mais si elle s'imposait l'obligation de respecter le domaine des neutres, ceux-ci s'abstenaient de leur côté d'entraver, d'une manière ou d'une autre, la liberté de ses opérations ; et ces deux règles s'étaient établies et généralisées comme des [245] coutumes dont l'expérience avait démontré l'utilité. Cependant quand les relations commerciales et en particulier le commerce maritime commencèrent à se développer, les opérations de guerre causèrent aux neutres des gênes et des dommages. Le blocus des ports de l'ennemi interrompait leur commerce; les marchandises neutres étaient capturées avec les navires qui les transportaient ; les belligérants recherchaient et confisquaient les marchandises ennemies sous pavillon neutre. Mais la guerre étant la plus productive de toutes les industries et celle de la caste souveraine des Etats, les gênes et les dommages qu'elle causait aux classes inférieures ne pouvaient être mis en balance avec les avantages que les belligérants pouvaient tirer de la destruction du commerce ennemi. Ces pratiques destructives étaient généralement acceptées comme utiles, les neutres sachant qu'ils en useraient à leur tour lorsqu'ils passeraient à l'état de belligérants, ce qui était le cas ordinaire. Il en alla ainsi aussi longtemps que les intérêts commerciaux n'eurent qu'une faible importance. Mais déjà à la fin du xviiie siècle, l'extension des relations internationales avait provoqué la résistance du commerce maritime contre le droit que s'attribuaient les belligérants de rechercher et de confisquer la marchandise ennemie à bord d'un navire neutre, et d'une autre part, des protestations de plus en plus vives s'élevaient contre le pillage de la propriété privée. Ces progrès du droit des gens ont fini par se réaliser, la maxime [246] que le pavillon couvre la marchandise a été adoptée par 1» généralité des Etats civilisés ; le respect de la propriété privée, de la vie et de la liberté des populations qui ne prennent point part à la guerre est devenu du moins en théorie, sinon toujours en pratique, une règle que les armées sont tenues d'observer et qui est d'ailleurs conforme à leur intérêt. Cependant d'autres progrès seront, selon toute apparence, suscités par le développement de la grande industrie. Avec l'extension du commerce international qui en a été la conséquence s'est accru dans des proportions croissantes le dommage que la guerre cause aux neutres.[3] La guerre de la sécession américaine a infligé à l'industrie cotonnière de l'Europe des pertes qui se chiffrent par centaines de millions sinon par milliards. La guerre franco-allemande a: provoqué une crise dont l'influence perturbatrice et déprimante ne s'est pas arrêtée aux frontières des belligérants. Dans l'état actuel du monde, la guerre prend de plus en plus le caractère d'une nuisance universelle. Or, c'est une règle fondamentale du droit que tout dommage causé à autrui, sauf le cas de force majeure, doit être réparé et donne lieu à une indemnité. La guerre entre les peuples civilisés ne peut plus invoquer le cas de force majeure ; elle est un acte libre et implique la [247] responsabilité naturellement attachée à la liberté. Les neutres seront donc fondés à exiger une indemnité pour les dommages qu'elle leur cause, et, ces dommages étant inévitables, à se liguer pour les prévenir. Ainsi le droit des gens, après avoir reconnu et sanctionné la liberté de la guerre, c'est-à-dire de la concurrence sous sa forme destructive, sera amené à l'interdire et à apporter sa sanction aux mesures désormais conformes à l'intérêt de l'espèce qui pourront être prises pour lai supprimer.
II. Le monopole et la protection. L'Etat ne continue pas seulement à pratiquer l'industrie destructive de la guerre, bien qu'elle ait cessé d'être nécessaire et qu'elle coûte à la multitude des consommateurs de sécurité incomparablement plus qu'elle ne rapporte à la classe particulière de ses producteurs: souverains, politiciens, diplomates, hiérarchie professionnelle des armées, fournisseurs du matériel de guerre, financiers négociateurs des emprunts, etc., l'Etat s'est emparé aussi d'un nombre croissant d'industries productives qu'il exerce tantôt en s'en réservant le monopole, tantôt en concurrence avec l'industrie privée :tels sont la fabrication de la monnaie, la poste, les travaux publics, l'enseignement. Ces industries se partagent en deux catégories bien distinctes : 1° les industries de concurrence ; 2° les monopoles naturels. Si l'Etat s'attribue le monopole des premières, les consommateurs ne tardent pas à souffrir de la cherté, du ralentissement du progrès et des autres vices inhérents à tout monopole. S'il s'agit par exemple du monopole de la production [248] de la monnaie, il a été vicié de bonne heure par l'altération de la monnaie métallique et plus tard par l'émission du papier-monnaie. Ces pratiques frauduleuses ont infligé aux consommateurs de monnaie des pertes et des dommages hors de toute proportion avec le gain que rapportait aux gouvernements monopoleurs et faussaires la différence entre les frais de production et la valeur rapidement décroissante de la monnaie altérée ou de la surémission du papier-monnaie. S'il s'agit du monopole postal, après avoir servi d'instrument d'espionnage aux beaux jours du cabinet noir, il est resté le plus lent, le plus inexact et le moins sûr des services. C'est qu'il manque à toutes les industries monopolisées par l'Etat les conditions nécessaires à leur bon fonctionnement et à leurs progrès : le stimulant de la concurrence et la responsabilité effective du producteur. Dans les industries de concurrence, toute perte causée par les vices ou les abus de la gestion est supportée par le capital d'entreprise, et elle détermine la recherche et l'application du remède : remplacement du matériel arriéré ou défectueux, renvoi du personnel incapable ou véreux. Dans les industries d'Etat, la perte — ou le manque à gagner — diluée dans la totalité des dépenses de l'Etat est presque insensible aux contribuables et elle est encore moins sensible à ceux domt l'incurie ou l'infidélité J'a causé. Il leur suffit, le plus souvent, de la protection du parti auquel ils rendent des services électoraux pour les exonérer du poids de leur responsabilité.
Dans les industries d'Etat qui partagent leur clientèle [249] avec les entreprises privées, ces industries se trouvent placées dans des conditions qui diminuent si elles ne suppriment pas entièrement l'efficacité de la concurrence. Elles fonctionnent avec un capital qui leur est fourni par les contribuables et dont elles n'ont à supporter ni les charges de l'intérêt ni celles de l'amortissement. De plus, leurs déficits sont toujours couverts par l'impôt, dont une partie est prélevée sur leurs concurrents eux-mêmes, en sorte que leur existence est assurée. Contre une industrie placée dans ces conditions, la concurrence d'entreprises obligées de couvrir elles-mêmes leurs frais et exposées à la faillite semble impossible. Tel est le cas de l'enseignement de l'Etat. Il faut qu'un intérêt extérieur, — l'intérêt religieux, — intervienne pour suppléer à l'intérêt économique. Mais quel est le résultat de ce régime de demi-monopole et de concurrence faussée? C'est que de toutes les industries celle de l'enseignement répond moins qu'aucune autre aux besoins qu'elle a pour objet de satisfaire, c'est que les produits en sont adultérés d'un côté par les intérêts de la classe dirigeante de l'Etat, d'un autre par ceux de l'Eglise; c'est, en un mot, qu'elle est à la fois la plus nécessaire au progrès et la plus arriérée des industries.
L'intervention de l'Etat dans les industries de concurrence se traduit donc par une déperdition inévitable des forces et de la richesse des nations, et par l'affaiblissement de leur capacité à soutenir la concurrence de leurs rivales sous sa forme destructive ou productive.
[250]
Or la presque généralité des industries sont devenues accessibles à la concurrence depuis que les progrès de la sécurité et des moyens de communication ont étendu le domaine des échanges. Il n'existe plus qu'un nombre chaque jour plus restreint de monopoles naturels. Ces monopoles, à commencer par celui de l'assurance de la vie et de la propriété individuelles et de la conservation du domaine national, sont gérés par l'Etat, les sous-Etats des provinces, des départements et des communes. Cette gestion en régie occasionne à la nation la même déperdition de forces qu'il est dans la nature de tout monopole de causer. Cependant, elle peut être évitée du moins en partie par un recours indirect à la concurrence. Il n'est pas nécessaire que l'Etat ou un sous-Etat se charge de gérer lui-même un monopole naturel. Il peut contracter pour cette gestion, d'une manière temporaire et même illimitée, sauf à surveiller l'exécution du contrat, avec des maisons ou des associations concurrentes, présentant les garanties .matérielles et morales nécessaires. Dans ce cas le prix du produit ou du service pourra ne pas dépasser celui d'une industrie de concurrence, quoique le stimulant qui pousse celle-ci à perfectionner ses procédés et son outillage soit moins pressant et plus faible.
Aux déperditions de forces et de richesses que causent aux nations la guerre et les armements qu'elle nécessite, l'accaparement anti-économique des industries et leur gestion par l'Etat, s'ajoutent celles de la protection des industries jugées incapables de [251] soutenir la concurrence étrangère. Le dommage qu'elle cause aux nations enserrées dans les lignes des douanes ne se borne pas à la différence des prix des produits à l'intérieur et au dehors; il s'augmente, dans une proportion bien supérieure, des effets destructeurs que la limitation artificielle des marchés oppose à l'opération propulsive et régulatrice de la concurrence ; il s'augmente enfin de la prime des risques que l'instabilité des tarifs de douane fait peser sur l'ensemble des branches de l'industrie humaine.
Telles sont les causes qui agissent pour détruire la richesse et en troubler la distribution utile, tandis que se multiplient et se perfectionnent les industries qui la produisent. D'où cette conséquence que la condition de la multitude n'a pu s'améliorer dans la proportion de l'accroissement de la productivité de son travail. Si elle ne s'est point aggravée comme le prétendent les socialistes, cela tient à ce que les progrès des facteurs de la production des richesses ont jusqu'à présent dépassé ceux de la destruction. Mais il n'en existe pas moins une différence manifeste entre la somme des matériaux de la vie que l'accroissement de la productivité de son travail a acquise au grand nombre et celle qu'il aurait pu lui acquérir. Et cette différence menace de devenir de plus en plus forte tant par l'augmentation continue de la puissance des facteurs de la destruction et du détournement de la richesse que [252] par l'obstacle qu'ils opposent aux progrès de la production et de la distribution utile des produits.
Nous avons évalué à la moitié du revenu annuel des nations civilisées, — et nous croyons être demeuré au-dessous de la vérité, — la part que l'Etat leur enlève, et à la moitié de la journée de travail celle qu'il impose à la multitude qui demande ses moyens d'existence aux industries productives. Cette somme de richesses et de travail ne profite pas tout entière à la classe en possession de l'Etat; elle est en partie perdue sans profit pour personne.
En résumé, les obstacles à l'adaptation de l'Etat aux nouvelles conditions d'existence que les progrès de la science et des industries destructives et productives ont faites aux sociétés en voie de civilisation, ces obstacles résident dans la persistance d'un état de guerre qui est devenu nuisible après avoir cessé d'être nécessaire, dans l'absorption anti-économique des industries libres dans le monopole de l'Etat, dans la limitation artificielle de la sphère des échanges, parlant de l'action propulsive et régulatrice de la concurrence. L'œuvre des hommes de progrès doit consister à éliminer ces causes de renchérissement de la vie, partant à diminuer la somme de travail el de peine qu'il nécessite. C'est ainsi qu'ils réaliseront le rêve des économistes du xviiiee siècle : le gouvernement à bon marché.
[253]
V
Cette évolution ne pourra toutefois s'accomplir qu'à la condition que l'intérêt général devienne assez fort pour l'emporter sur les intérêts particuliers auxquels profitent la conservation et l'aggravation de l'ancien régime de guerre et de monopole. Au temps où nous sommes et de tout temps bien peu d'hommes ont placé l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers, et lui ont obéi de préférence. Il en est ainsi de la classe en possession du pouvoir politique. Vivant de l'Etat, puisant des moyens d'existence assurés contre la concurrence dans les industries qu'il accapare ou protège, elle est intéressée non seulement à les conserver , mais encore à les multiplier. Elle est étatiste, militariste et protectionniste. Ce n'est pas qu'elle n'aperçoive les vices et la décrépitude du régime existant et qu'elle n'en prévoie la fin. Mais elle veut en conserver, et, s'il se peut, en augmenter les profits aussi longtemps qu'il sera debout, et elle s'imagine volontiers que l'Etat devient plus puissant en devenant plus volumineux. En vain entreprendrait-on de lui démontrer que l'accroissement de la richesse de la nation, débarrassée des charges improductives et nuisibles de l'état de guerre, des monopoles et de la protection, augmentera sa part dans cette richesse, tout en amoindrissant les inégalités parfois monstrueuses de la répartition, [254] la concurrence lui inspire les mêmes sentiments de crainte et de répulsion que ressentent les industriels lorsqu'elle les oblige à renouveler leurs procédés et leur outillage. Peut-être la diminution des profits et des avantages de sa situation dans une société en décadence l'excitera-t-elle à sortir de sa torpeur, mais alors ce sera bien tard.
Cette classe, à laquelle la possession des services de l'Etat et des industries qu'il protège rapportent plus que ne lui coûte le renchérissement de la vie, ne forme nulle part plus du dixième de la population, mais elle met une influence bien supérieure à cette proportion numérique au service de ses intérêts particuliers. La multitude sur laquelle retombe tout le poids de l'Etat est plus encore, du moins en grande majorité, incapable de s'élever à la notion de l'intérêt général. C'est que la nature même de ses occupations journalières en n'exigeant que dans une faible mesure l'exercice de ses facultés intellectuelles la retient dans la sphère étroite de ses intérêts particuliers et immédiats. On a attribué à l'instruction gratuitement et universellement répandue le pouvoir de la lui faire franchir. Mais l'expérience n'a pas tardé à démontrer que l'instruction ne possède nullement ce pouvoir, que l'intelligence ne se développe qu'autant que l'individu en possède le germe et que la nature de ses occupations l'obligent à l'exercer. Or les occupations du grand nombre n'exigent guère que la mise en œuvre de la force physique et d'une certaine adresse manuelle. Ce [255] n'est que par l'emploi des outils que l'homme a commencé à s'affranchir d'une portion du travail matériel de la production et cette portion est restée dominante jusqu'à ce que les machines aient remplacé les simples outils. Comme l'observait déjà Aristote, l'homme asservi au travail matériel est impropre aux travaux de l'intelligence. L'instruction ne peut suppléer à l'exercice d'une profession intellectuelle. Dans tous les métiers qui ont conservé l'outillage primitif, dans l'industrie agricole et dans les autres branches de la production où l'emploi de la force musculaire est demeurée prédominante, l'individu a promptement oublié les rudiments de l'enseignement primaire, à l'exception de ceux dont il éprouve le besoin journalier. On pourrait même soutenir que l'instruction lui est nuisible dans une plus forte proportion qu'elle ne lui est utile en ce qu'elle le rend accessible à des excitations dangereuses et corruptrices. Sa participation au gouvernement de l'Etat n'a pas eu la vertu de développer son intelligence ; et la cuisine électorale a-t-elle élevé sa moralité?
Les progrès de la machinerie en voie de s'opérer et de se multiplier sous l'impulsion de la concurrence n'ont pas seulement pour effet d'augmenter la productivité de l'industrie. Comme nous l'avons remarqué il y a longtemps, ils ont un résultat plus bienfaisant encore en élevant la nature du travail.[4] Ils [256] substituent au travail physique, commun à l'homme et à la bête de somme, le travail mécanique incomparablement moins coûteux et plus puissant,[5] et ne laissent à l'ouvrier que la direction, la surveillance et la responsabilité de son œuvre, impliquant l'emploi de ses facultés intellectuelles et morales. C'est ainsi que le progrès industriel, en exigeant la mise en œuvre de facultés différentes et plus hautes, augmente la différence entre l'homme et l'animal. A mesure que l'évolution progressive de l'industrie gagnerai les branches de la production qu'elle n'a pas encore atteintes, cette différence s'accroîtra et se généralisera. Le niveau intellectuel de la multitude s'élèvera sa vue dépassant le cercle étroit de ses intérêts particuliers [257] et prochains, s'étendra à la conception de l'intérêt général.
On peut donc espérer qu'il se produira une opinion assez intelligente pour comprendre que l'existence des sociétés civilisées peut désormais être assurée à moins de frais, et assez puissante pour enlever l'Etat-assureur aux intérêts particuliers qui s'en disputent la possession, et qui au lieu de simplifier et d'alléger cette vieille et lourde machine, s'évertuent tous les jours à la compliquer et à l'alourdir.[6]
Endnotes
[2] M. Alfred Neymarck a publié, dans le Rentier, cet aperu statistique de la progression des dettes publiques et des dépenses militaires de l'Europe depuis quarante ans.
Les dettes publiques européennes, d'après les chiffres officiellement constatés et publiés — car il y a dans les budgets ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas et bien des dépenses militaires restent inconnues pour le public — ont suivi depuis quarante ans, la progression suivante:
| 1846 | 1870 | 1887 | 1900 | |
| Milliards | ||||
| Capital nominal des dettes européenes | 66 | 75 | ¡17 | 148 |
| Dépenses militaires | 3 | 3.5 | 4.5 | 6.7 |
| Dépenses du service des intérêts | 2.4 | 3 | 5.8 | 5.9 |
Depuis 1887 seulement, c'est-à-dire depuis vingt ans le capital annuel des dettes publiques européennes a augmenté de 31 milliards, l'intérêt des dettes d'un demi-milliard, les charges militaires annuelles de 2 milliards.
La préparation à la guerre coûte annuellement à l'Europe près d'un milliard de plus que l'intérêt des dettes contractées. Y compris l'intérêt de ces dettes, il faut que les budgets européens payent près de 13 milliards par an!
[3] Progrès réalisés dans les usages de la guerre. Journal des Economistes des 15 août et 15 septembre 1854. Reproduit dans les Questions d'économie politique et de droit public. T. II, p. 278.
[4] Cours d'économie politique, 2e édition, 1863. T. 1er. La part du travail. Notions fondamentales d'économie politique. Chap. IX. La part du capital personnel.
[5] On cherche quelquefois à apprécier par un chiffre les avantages de la substitution des machines à la main d'œuvre humaine. C'est facile. L'homme adulte par son alimentation journalière engendre en énergie calorique de 2,500 à 3,000 calories qui lui servent à faire fonctionner ses organes, à maintenir fixe sa température et à effectuer une certaine somme de travail extérieur. On évalue le travail moyen et continu d'un ouvrier à 127.000 kilogrammètres. Ces kilogrammètres évalués en unités caloriques correspondent à 300 calories, un peu moins d'un demi-cheval vapeur.
Dans ces conditions, pour produire 100 chevaux-vapeur-heure, il faut environ 250 ouvriers à la moyenne de 3 fr. par jour au moins. Coût : 750 fr. Ou 20 chevaux de trait coût: 60 fr. Ou une machine à vapeur 6 fr. ou un moteur à gaz 3 fr. 50.
Donc la force motrice humaine est plus de cent fois plus chère que la force motrice mécanique.
Henri De Parville. Journal des Débats du 16 mai 1907.
[6] Nous avons supposé que la crise suscitée par la persistance artificielle du régime adapté à l'état de guerre et de monopole se terminerait par la victoire, malheureusement encore douteuse, de l'intérêt général, et nous avons esquissé dans un précédent ouvrage, en nous fondant sur l'application pacifique des lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence, l'organisation de la société future.
VII.24. Molinari’s "Last Words" (1911)
Source
Molinari’s last published work (the year before he died) was appropriately called Ultima Verba: Mon dernier ouvrage (Last Words: My Last Work) (Paris: V. Giard et E. Brière, 1911). "Préface" pp. i-xvii.
PDF.
Introduction
This Preface was one of the last things Molinari wrote before his death in 28 January 1912 so it is fitting that we end our collection of his writings with this. What is striking is that after nearly 70 years he is still advocating the same set of principles of "la liberté des échanges et la paix" (free trade and peace) and cheap government (‘le gouvernement à bon marché"), even though he now admits "ces idées fondamentales sont partout en baisse" (these fundamental ideas are everywhere in decline).
This has come about, he believes, because of four things:
- "une recrudescence de l'esprit militaire" (a revival of the military spirit)
- "une recrudescence de protectionnisme" (a revival of protectionism)
- the rise of socialism as both an ideal and an organised political party
- the bureaucratization of an expanded interventionist state and its resulting "fonctionnairisme"
Writing only a couple of years before the outbreak of the World War in August 1914 it is not surprising that he should include the growing threat of war as a key concern of his. He lists the 12 major conflicts both within Europe and elsewhere in the world which have taken place since the mid-19th century when he wrote his paean to peace L’Abbé de Saint-Pierre (1857). [16] All he notes here, since he has covered this topic in depth elsewhere, is that war is more costly than people ever imagine beforehand, that the benefits are concentrated in the hands of a very small minority (the generals and politicians who are able to advance their careers, the manufacturers of munitions and other war materiel, and the bankers who lend the state money to finance the wars), and that the direct and indirect costs of war are always met by the present and future taxpayers as well as the young men who have been conscripted into the armies (what he called "l’impôt de sang" (the blood tax)). He also mentions in passing the fact that the technological innovations which have brought such prosperity to Europe and North America have also increased the destructiveness of war, although he could have no idea how destructive as he died before the carnage of WW1 revealed this to the world. When he was writing only a small handful of people like Jean de Bloch had any inkling of what would lie ahead and they were largely ignored. [17] In spite of these concerns, Molinari still had hope that enough people would eventually see how destructive and costly modern war had become and would thus put pressure on their governments to pull bank from the brink.
However, in the short term he was less optimistic as he believed that the cause of liberalism had lost the moral battle with statism in its various forms. People had lost their earlier horror of war as fighting had become increasingly displaced to countries outside Europe in their colonies and the third world and people had forgotten the horrors of the wars which had been fought on European soil. The collective memory of the Napoleonic wars had faded and would only be revived on the fields of Flanders in WW1.
People had also lost their distrust of government and their wariness of high government expenditure and public debt. The latter he thought was particularly pernicious and was an example of "un simple vol" (simple theft) which was inflicted unjustly on future generations of taxpayers. Whether the government was run by "constitutional republicans" or the new breed of socialist politicians the end result would be the same: socialism under one name or another, socialism directly or indirectly, socialism "from below" (socialisme d’en bas) or "from above" (socialisme d’en haut). All democratic and constitutional governments were heading in the same direction, he thought. They were all becoming more interventionist, bellicose, and protectionist, and hence more expensive. This was partly driven by the self-interest of the ruling politicians and bureaucrats ("la classe bureaucratique"), and partly by deceived and confused voters who sold their votes to the highest political bidders during the elections.
The opposite, Molinari’s ideal, was cheap government ("le gouvernement à bon marché") and this was increasingly becoming an unreachable utopian ideal by 1911. Even so, he still argues for the idea of a government run like an insurance company in which tax-payers were treated like "actionnaires" or shareholders in the company or the insured paying premiums ("les primes") according to the risks they undertook and the amount of property they wished to insure from damage or theft. Government to him, while now no longer a private insurance competing for business in the security industry as he had imagined in 1849, should still be run like a private company to make it more efficient and much cheaper.
But since this was unlikely in the short term, Molinari’s longer term view was much more pessimistic. He thought that the modern bureaucratic, socialist, militaristic, protectionist state would one day crush society under the weight of debt and taxes like other civilisations had succumbed in earlier centuries. What would make this collapse more significant was what he calls "un nouveau mode de destruction" (a new method of destruction) - massive public debt and taxation:
| la richesse diminuera et les dettes s’accroîtront jusqu’à ce que le pays ne puisse plus en supporter le fardeau. Peut-être est-ce ainsi que, selon toute apparence et malgré le développement progressif de la civilisation, se perdront les Etats les plus florissants. C’est de cette sorte qu’a péri le monde romain, bien autrement civilisé que la nuée des barbares qui l’entourait. Les vices intérieurs et les dépenses excessives écraseront la civilisation actuelle comme les Barbares l’ont écrasée, dans l’antiquité. Ce sera un nouveau mode de destruction non moins certain et aussi complet que le précédent. | wealth will diminish and debts will increase up to the point where the country can no longer support the burden. Perhaps this is how, according to all appearances andin spite of the progressive development of civilisation, the most flourishing States will be lost. It is in this way that theRoman world died, (which was) much more civilised than the horde of barbarians which surrounded it. Internal vices and excessive costs will wipe out the present civilisation just as the Barbarians wiped it out in antiquity. This will be a new kind of destruction which will be no less certain and just as complete as the previous one. |
Endnotes
[16] Gustave de Molinari, L’abbé de Saint-Pierre, membre exclu de l’Académie française, sa vie et ses oeuvres, précédées d’une appréciation et d’un précis historique de l’idée de la paix perpétuelle, suivies du jugement de Rousseau sur le projet de paix perpétuelle et la polysynodie ainsi que du projet attribué à Henri IV, et du plan d’Emmanuel Kant pour rendre la paix universelle, etc., etc. (Paris: Guillaumin, 1857). PDF.
[17] Jean de Bloch (1836-1902) was a Polish born banker and railway financier who lived and worked in Russia. The quick Prussian defeat of France in 1870 led him to pursue a scientific study of what a modern war might look like in the near future. His 6 volume work published initially in Russian and German in 1899 is remarkably prescient in many of his predictions of what actually transpired in WW1 . A 1 vol. abridgement was published in English and a 4 vol. one in French. Since the Guillaumin firm published the French translation Molinari must have known about this work. See, La guerre : traduction de l’ouvrage russe "La guerre future aux points de vue technique, économique et politique". 4 vols. Paris: Guillaumin,1898-1900).
Text
[i]
PREFACE
Presque arrivé aux limites de la vie humaine — je suis maintenant dans ma 92e année — je vais publier mon dernier ouvrage. Il concerne tout ce qui a rempli ma vie: la liberté des échanges et la paix. Mais quoique la sphère de la paix se soit prodigieusement élargie et que les souverains prodiguent les démonstrations pacifiques, ces idées fondamentales sont partout en baisse. Pourtant il semblait vers le milieu du XIXe siècle qu'elles dussent désormais régir le monde civilisé. Le roi Louis-Philippe ne disait-il pas dans sa réponse à une députation « que la guerre coûtait trop cher et qu'on ne la ferait plus ».
Ces dispositions pacifiques avaient des antécédents: Henri IV endoctriné par Sully avait déclaré qu'il n'y aurait plus de guerre entre les prince chrétiens. Au XVIIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre [ii] s'était fait le bienfaisant propagateur des idées pacifiques et l'abbé Coyer engageait la noblesse à adopter un état plus lucratif quo le métier des armes. Telle était alors la force du mouvement pacifique que Turgot votait sans hésiter le maintien de la paix avec l'Angleterre, en dépit des velléités belliqueuses de la jeune noblesse, qui allait aider à conquérir l'indépendance des possessions anglaises d'Amérique. A la fin des hostilités, sous l'influence des physiocrates, et peut-être d'Adam Smith, le traité de 1786 lia la France et l'Angleterre par une convention qui serait aujourd'hui considérée comme un triomphe libre-échangiste.
***
Mais la Révolution devait bientôt ajourner pour longtemps l'application des principes de paix et de liberté. Après vingt-cinq années de guerre, les puissances européennes célébraient au Congrès de Vienne le retour de la paix générale et réduisaient à deux milliards la somme de leur appareil de guerre. — Elles ne devaient pas tarder à l'augmenter: les dépenses militaires et navales atteignent aujourd'hui, dans l'ensemble des pays civilisés, plus de douze milliards en pleine paix. Le budget de la France, qui à la veille de la [iii] Révolution était d'environ cinq cent millions, dépasse aujourd'hui quatre milliards dont la majeure partie est employée à préparer la guerre ou à solder les dettes laissées par les guerres antérieures. — Mais le milieu du XIXe siècle a vu surgir une recrudescence de l'esprit militaire; les conflits se sont multipliés: on a vu éclater les guerres d'Italie, de Crimée, austro-allemande, de Sécession, répression do la révolte des Sicks aux Indes, guerre franco-allemande, russo-turque, italo-abyssine, turco-grecque, hispano-américaine, russo-japonaise et marocaine qui ont éloigné les grandes espérances que les Congrès et les Ligues contre la guerre avaient fait concevoir. Les manifestations pacifiques dont le souverain de Russie avait pris l'initiative n'ont pas empêché les grandes puissances de décupler leurs armements. Et cependant la sécurité s'est considérablement accrue. I1 n'y a plus guère de peuples qui demandent à la guerre l'augmentation de leurs ressources. Au contraire, les nations victorieuses, aussi bien que les vaincues, voient s'aggraver leur dette. Autrefois la guerre était profitable à ceux qui l'entreprenaient, s'ils étaient vainqueurs, car ils conquéraient des provinces pu des royaumes qui augmentaient d'une manière permanente les bénéfices de la guerre, témoin la conquête de l'Angleterre par les Normands. Mais [iv] cette situation a changé; il n'est aucune guerre qui profite à ceux qui l'entreprennent, même s'ils sont vainqueurs: les profits qu'ils en retirent sont inférieurs à ce que vaudrait l'échange de leurs produits contre ceux d'une contrée réputée ennemie. C'est ainsi qu'il en a coûté à l'Allemagne une somme supérieure aux cinq milliards que lui avait rapporté le conflit avec la France: les armements auxquels l'a entraînée la crainte d'une revanche ont beaucoup dépassé les profits de l'annexion d'une province et de la contribution de guerre. N'oublions pas que les bénéfices en ont été perçus par une classe peu nombreuse de la population, alors que le fardeau de l'impôt a été alourdi pour les autres.
Cependant depuis près d'un demi-siècle les intérêts militaires ont toujours paru prendre une prépondérance de plus en plus grande. C'est une contradiction qui tient à ce que, dans l'ensemble des nations, les gouvernements et la classe sur laquelle ils s'appuient de préférence sont ou se croient intéressés à l'état do guerre. Il est évident que la situation des classes influentes n'a pas été amoindrie par la guerre: même en Amérique la guerre de Sécession qui avait ruiné les provinces vaincues a occasionné aux provinces du Nord et aux industriels dé l'Est vainqueurs une recrudescence de [v] protectionnisme qui a abouti au régime des trusts et engendré les milliardaires. En Allemagne, la classe militaire a vu sa puissance augmenter par l'accroissement des budgets de la guerre et de la marine, et les industriels ont exhaussé leurs bénéfices grâce aux tarifs protecteurs, mais la masse a vu enchérir ses denrées alimentaires et s'accumuler les emprunts dont elle doit, en définitive, payer les frais sans cesse croissants. Aussi les classes dominantes ont-elles intérêt à conserver la propriété des masses gouvernées qui leur fournissent la plupart des revenus militaires ou civils dont elles vivent.
***
Si, à l'encontre de ce que l'on espérait au début de ma carrière, en ces premières années du XXe siècle on peut constater le progrès des sentiments belliqueux dans les classes supérieures, on doit remarquer aussi que, dans ce même intervalle, le protectionnisme s'est étendu sur tout le monde civilisé, à l'exception de l'Angleterre restée jusqu'ici libre-échangiste. Cependant je demeure toujours un ferme partisan de la paix et de la liberté. Ce qui me fait croire à leur triomphe final c'est que des progrès de tout genre ont multiplié les échanges et diminué ainsi le coût de la vie tandis que là guerre a pour résultat de l'enchérir. Il y a ainsi entre la [vi] guerre et la paix une différence fondamentale. On ne peut pas dire que la guerre travaille gratis, même si elle est victorieuse, tandis que l'échange augmente quand même les profits des deux parties. Ce qui redouble mes espérances, c'est que depuis un siècle la face du monde a été modifiée: innombrables inventions, grâce auxquelles la richesse s'est développée et multipliée, ont ajouté à l'agrément de l'existence. La guerre empêche la richesse de s'accroître; elle a pour effet d'augmenter les frais de production tandis que les inventions ont généralement pour but de les abaisser. Cependant les inventions n'ont pas seulement pour résultat de rendre la vie meilleure, au contraire elles ont aussi perfectionné l'art de la guerre: fusils et canons ont augmenté leur portée destructive, on a ajouté aux anciens de nouveaux engins destructifs: torpilles, sous-marins, dirigeables et aéroplanes même, dynamite et autres explosifs. Enfin chaque jour apporte son perfectionnement dans l'art d'anéantir ses semblables et les fruits de leur activité, on sorte que les inventions qui ont pour objet de détruire pourraient bien dépasser celles qui concourent à améliorer le sort de l'humanité; les peuples seront ainsi obligés, s'ils ne se resaisissent promptement, de supporter le coût croissant de la guerre et de ses préparatifs. Le pourront-ils longtemps?
[vii]
Durant une assez longue période après la fin des guerres du premier Empire, le monde avait joui de la paix. On avait donc alors quelque raison de croire que la guerre cesserait de ravager le monde. Les Congrès de la paix commençaient à se multiplier. La liberté des échanges trouvait aussi d'ardents protagonistes. En Angleterre les réformes de M. Huskisson faisaient prévoir la disparition du protectionnisme, celles auxquelles Richard Cobden et Robert Peel ont attaché leur nom annonçaient sa fin prochaine. On pouvait se flatter de l'espoir que la civilisation aurait pour auxiliaire la paix et la liberté et que de cette époque daterait la cessation de l'hostilité des peuples. Les révolutions et les guerres ne tardèrent pas â faire rompre la paix et reparaître le protectionnisme. Les tarifs des douanes ont continué à séparer les nations, et même on peut craindre l'accroissement et l'extension du régime protecteur.
***
Cependant depuis plus d'un demi-siècle une véritable efflorescence a commencé à changer la face du monde. Dans le cours de ma longue existence j'ai vu naître les chemins de fer dont le réseau atteint actuellement un million de kilomètres. Des [viii] vapeurs traversent aujourd'hui les océans. L'électricité transmet les pensées du monde entier. La photographie est devenue l'auxiliaire des relations. Dans mon enfance on n'écrivait qu'avec des plumes d'oie; on ne connaissait pas plus les plumes métalliques que les timbres-postes ou la bougie, le gaz venait à peine de naître. Des milliers d'inventions facilitent la vie. Même les fruits de l'intelligence étaient alors moins nombreux et commençaient seulement à se répandre dans les masses. L'état mental actuel des esprits est à peine comparable à ce qu'il était à la veille du commencement du XIXe siècle. Mais l'état moral de l'humanité est inférieur à celui de son intelligence. De là, la grande crise dans laquelle se débattent aujourd'hui lés sociétés en voie de civilisation. On pourrait presque les comparer à ces gens auxquels les hasards de la loterie procurant soudainement un million ont modifié du jour au lendemain leur existence matérielle sans rien changer à leur état intellectuel: la plupart de ces gagnants ne songent qu'à améliorer leur bien-être matériel, quand ils ne se livrent pas aux pires jouissances, mais leur moralité reste la même, si même elle ne s'abaisse pas. C'est pourquoi l'on peut presque dire que le progrès de la civilisation s'est plutôt ralenti que précipité, car il dépend à la fois de l'intelligence et de là moralité.
[ix]
***
A peu près au même moment que cette efflorescence des inventions est apparu le socialisme.
C'est une tendance devenue universelle de renverser les gouvernements pour leur substituer un régime égalitaire. Le socialisme ne trouve, en somme, une absolue résistance que dans les classes dont il bouleverse les moyens d'existence. Jusqu'à présent il n'a pas découvert un système propre à remplacer l'ancien régime sous lequel l'humanité à vécu, quelques diverses qu'en aient été les formes. Il a suscité des révolutions et des guerres civiles et selon tout apparence il en suscitera encore d'autres.
Mais quel est le régime préconisé par le socialisme? Né de l'ensemble des souffrances que les peuples ont éprouvées du fait de leurs dominateurs, ils en voient le remède dans la propriété d'eux-mêmes. Ils travaillent, en conséquence, à expulser leurs dominateurs et à les remplacer par un gouvernement issu d'eux-mêmes: c'est ainsi qu'est né le gouvernement parlementaire ou constitutionnel. Et dans l'ignorance des lois naturelles par lesquelles la Providence gouverne les hommes en se bornant à en prescrire l'observation, -ils ont institué des lois multiples, plus souvent nuisibles [x] qu'utiles à ceux qu'ils voulaient protéger. C'est pourquoi le socialisme, dans l'ensemble de ses systèmes, en admettant qu'il réussisse à les installer, aboutirait à la ruine des sociétés. Et les chefs d'Etats, monarchistes ou républicains, quels que soient les mobiles auxquels ils obéissent, ont tort de leur céder, même s'ils sont poussés par les sentiments les plus purs et les plus élevés tels que ceux de la philanthropie.
Sans qu'il y paraisse, le régime parlementaire et constitutionnel aboutit au socialisme car de socialisme n'est autre chose que l'appropriation de tous les moyens de se procurer des richesses, y compris la direction de la société. Le régime constitutionnel et parlementaire est demeuré la propriété des classes supérieures qui se sont enrichies et possèdent la plus grande partie des moyens de subsistance. C'est pourquoi elles sont dénommées classe capitaliste et sont plus que jamais l'objet d'une envieuse considération. Mais le socialisme veut s'emparer de la richesse existante. La lutte entre le socialisme et le capitalisme est donc éternelle. Cependant, il est avéré que dès que les socialistes deviennent capitalistes, ils changent d'opinion et deviennent à leur tour les défenseurs du capital. Ils cèdent le moins possible au socialisme et c'est ainsi qu'on a pu dire, en modifiant les [xi] termes, qu'un jacobin ministre n'est pas nécessairement un ministre jacobin.
La direction de l'Etat est l'objet du régime parlementaire auquel presque tous les anciens maîtres des Etats se sont ralliés en considérant les avantages matériels qu'ils y trouvent.
La Révolution a simplement changé l'apparence du régime qui jusque-là avait été dominant. Les monarques étaient jusqu'alors considérés comme les propriétaires de leurs peuples; la Révolution a changé nominalement cet état de choses: les peuples devenus propriétaires d'eux-mêmes sont désormais chargés de se gouverner. Ils ont d'abord élaboré une constitution édictant leurs droits et leurs devoirs. Mais ils sont incapables de se conduire, et, en fait, ce régime n'est autre que la domination d'une classe sur la multitude. Cette domination d'une classe gouvernante peu nombreuse excite l'opposition de la masse exclue du gouvernement. Aussi, bien qu'il n'y ait qu'une classe qui exerce lé pouvoir et une opposition, comme il y a une masse électorale à peu près illimitée, on a vu se multiplier les partis avides de gouverner. Mais, que ce soit monarchie ou république, on peut constater la cherté progressive du gouvernement car la classe bureaucratique qui en dépend s'est prodigieusement accrue. Le gouvernement à bon marché [xii] semble plus que jamais devenir une utopie puisque le régime constitutionnel augmente encore ainsi les frais du gouvernement belliqueux et protectionniste quoiqu'il les reporte souvent, sur les générations futures en les laissant responsables de ses emprunts et de ses dettes.
On s'imagine communément que ce régime est le plus parfait possible, pourtant on remarque de nombreux symptômes de décadence même chez les peuples les plus avancés en civilisation. Nous croyons qu'il sera perfectionné comme l'a été la machine à vapeur et le métier à tisser. Et déjà l'on peut conjecturer ce que seront ces progrès en voyant quelles évolutions ont subies les entreprises financières ou industrielles. Mais si le perfectionnement du régime constitutionnel est possible, il peut aussi être retardé à cause du grand nombre d'individus incapables qui remplissent les devoirs électoraux. Nous ne parlons pas de l'extension aux femmes du droit de vote, que nous ne souhaitons pas, bien que nous soyons tout l'opposé d'un antiféministe, parce que plus il y aura d'électeurs, plus les résultats seront mauvais. Et ce n'est pourtant pas déjà brillant. Si l'on regarde d'un peu près les faits et gestes des représentants du peuple, on aperçoit partout leur inconséquence: En Espagne les uns consentent à [xiii] laisser fusiller Ferrer sous prétexte qu'il enseignait une morale contraire à celle du gouvernement, qui n'en a pas, et les autres sous prétexte de libéralisme, rompent avec le Pape à propos d'associations religieuses qui conviennent à certains partis mais non à tous. En France ils ont confisqué des biens et prononcé le bannissement de religieux et religieuses qui enseignaient une doctrine qui leur déplaisait; pour accomplir ce travail ils se sont adjugé individuellement quinze mille francs par an! En Belgique, nous avons été témoin d'une enquête libérale dirigée contre les pauvres femmes qui faisaient donner à leurs enfants l'enseignement congréganiste, le résultat a été d'amener le parti clérical au pouvoir, où il se maintient depuis vingt-six ans malgré la rancune d'une partie des électeurs mécontents de le voir monopoliser places et faveurs du gouvernement pour ses créatures au détriment de l'industrie et du commerce qui en font les frais. En Allemagne, les représentants du peuple se montrent les humbles serviteurs du gouvernement qui opprime les anciens sujets du Danemark et les Polonais obligés à un service militaire et à des impôts qu'ils ne doivent pas. En Russie, la Douma a accepté le transfert au peuple des charges et emprunts de là guerre avec le Japon et a, en outre, ratifié le despotisme infligé aux Juifs, [xiv] aux Polonais et aux Irlandais. En Amérique, les représentants du peuple ont ratifié la confiscation des intérêts des vaincus des Etats du Sud au profit des industriels protectionnistes du Nord et de l'Est qui en ont profité pour accaparer les industries protégées, d'où découlent les trusts avec les milliardaires, et remplacé l'esclavage par le mépris et le lynchage des noirs. Leurs politiciens sont pour la plupart tellement décriés que les honnêtes gens ne veulent pas les recevoir... et le malheur est qu'en nombre d'autres pays ils commencent aussi à glisser sur cette pente. En Italie ils ont augmenté le fardeau des impôts dans des proportions telles que l'émigration s'y est développée d'une façon intense. En Angleterre des scènes de pugilat se sont produites en plein Parlement de même qu'en Autriche-Hongrie où les antisémites se livrent à leurs fureurs et les diverses nationalités à leurs disputes pour la prééminence dans la direction des affaires de l'Empire, ne retrouvant un peu d'accord que lorsqu'il s'agit de s'emparer du bien d'autrui comme l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, par exemple. En Turquie, ne voit-on pas aussi une petite coterie, sorte de comité directeur, s'efforcer de faire prévaloir les intérêts du « turquisme » au lieu de régir équitablement ceux de toutes les populations qui forment l'ensemble du pays. Tels ont [xv] été quelques-uns des faits et gestes des représentants du peuple sous le régime qualifié de constitutionnel.
Mais on peut se figurer un régime supérieur au régime constitutionnel. Et ce régime, modelé sur là constitution naturelle de l'industrie, sera énormément simplifié. Déjà les compagnies de transport, les institutions financières, les sociétés industrielles et commerciales ont un conseil d'administration dont les opérations sont surveillées par des délégués des actionnaires et aussi par ces derniers qui se réunissent une fois l'an, parfois deux, pour examiner les affaires, prendre les décisions utiles et ratifier les comptes. Ils participent aux travaux de l'assemblée suivant le nombre d'actions qu'ils possèdent. Une partie du conseil d'administration est nommée par le fondateur de l'entreprise, la ratification des autres nominations est réservée aux actionnaires après proposition du président et du Conseil. Les membres de ces conseils sont généralement rééligibles et restent en fonctions leur vie durant. Ils diffèrent peu en cela des ministres de l'ancien régime monarchique, témoin Colbert, tandis que ceux du régime constitutionnel sont devenus d'une mobilité excessive, selon l'état des partis qui se partagent les parlements. — Dans les entreprises privées, les assemblées nomment un [xvi] président qui est le principal directeur des opérations de l'affaire et reçoit des appointements supérieurs à ceux des autres conseillers, sans être cependant excessifs. Ces appointements ne se comptent que par milliers de francs tandis que ceux des monarques constitutionnels, issus dé l'ancien régime, se comptent par millions. Tel est le progrès politique que nous avons en vue et qui sera suivi de tous les autres.
On pourrait objecter que la plupart des assemblées parlementaires travaillent activement et font des lois auxquelles tous les peuples de la monarchie ou de la république sont soumis bien qu'elles soient seulement l'oeuvre d'une partie du parlement. Mais on compte les lois utiles, à peine une seule sur une centaine, et les décrets d'un conseil d'administration seraient plus efficaces quoiqu'ils soient issus de la même source, savoir, de la généralité des actionnaires c'est-à-dire du suffrage universel. L'avènement du socialisme a sensiblement augmenté le nombre des lois car les socialistes ignorent en quoi consistent les lois naturelles; ils sont convaincus que celles qu'ils fabriquent sont supérieurement faites et ils en exigent l'application rigoureuse. Dans ce but leurs ministres multiplient les fonctionnaires. Mais à peu près toutes les lois inspirées par le socialisme sont faites pour une certaine classe [xvii] d'hommes à laquelle elles semblent profiter bien qu'elles leur soient nuisibles. Car tout ce qui change la destination de la fortune de l'ensemble des contribuables est loin d'être toujours favorable à la richesse publique. En faisant passer les ressources dés classes favorisées de la fortuné en des mains moins capables ou plus dispendieuses et en augmentant lès dépenses militaires, le protectionnisme et le fonctionnarisme, la richesse diminuera et les dettes s'accroîtront jusqu'à ce que le pays ne puisse plus en supporter le fardeau. Peut-être est-ce ainsi que, selon toute apparence et malgré le développement progressif de la civilisation, se perdront les Etats les plus florissants. C'est de cette sorte qu'a péri le monde romain, bien autrement civilisé que la nuée des barbares qui l'entourait. Les vices intérieurs et les dépenses excessives écraseront la civilisation actuelle comme les Barbares l'ont écrasée, dans l'antiquité. Ce sera un nouveau mode de destruction non moins certain et aussi complet que le précédent.