
GUSTAVE DE MOLINARI,
L’Évolution politique et la Révolution (1884)
 |
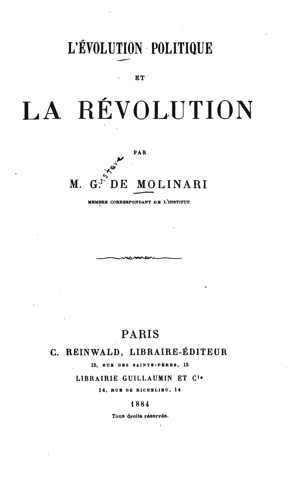 |
| Gustave de Molinari (1891-1912) |
[Created: 12 April, 2021]
[Updated: March 1, 2025 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, L’évolution politique et la Révolution (Paris: C. Reinwald, 1884).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Books/1884-EvolutionPolitique/index.html
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1891-1912).
TABLE DES MATIÈRES (bref)
- PREMIER . Constitution des sociétés. — Gouvernements primitifs - p. 1
- II. Les gouvernements de l'ère de la petite industrie - Le régime féodal - p. 23
- III. Les gouvernements de l'ère de 1a petite industrie (suite) - p. 48
- IV. Les gouvernements modernes La monarchie constitutionnelle - p. 87
- V. Les gouvernements modernes La république et le suffrage universel - p. 119
- VI. Politique extérieure des États modernes - La guerre - p. 139
- VII. Politique intérieure des États modernes - p. 191
- VIII. Évolution et révolution - p. 238
- IX. La Révolution française - p. 270
- X. Les gouvernements de l'avenir - p. 351
- XI. Tutelle et liberté - p. 424
- XII . RÉSUMÉ ET CONCLUSION - p. 486
- Notes
TABLE DES MATIÈRES
- PREMIER . Constitution des sociétés. — Gouvernements primitifs - p. 1
- I. Raison d'être de la formation des sociétés et de la constitution des gouvernements.
- II. Éléments et conditions d'existence et de progrès des sociétés primitives.
- III. Diversité originaire des gouvernements et des codes. Pourquoi la communauté a été la forme politique adaptée aux sociétés primitives
- II. Les gouvernements de l'ère de la petite industrie - Le régime féodal - p. 23
- I. Progrès qui ont déterminé l'avènement de la petite industrie. — Influence de ces progrès sur la constitution des gouvernements.
- II. Spécialisation des fonctions gouvernantes. — Substitution du régime des corporations à celui de la communauté.
- III. Causes de la diversité des institutions politiques. — Le régime féodal.
- IV. Mode économique de la formation des États dans l'ère de la petite industrie. — Les entreprises politiques
- III. Les gouvernements de l'ère de 1a petite industrie (suite) - p. 48
- I. Mobile déterminant des entreprises politiques dans l'ère de la petite industrie. Le profit. Conquête de l'Angleterre par les Normands.
- II. La constitution et l'organisation de l'État.
- III. L'agrandissemeiit de l'État.
- IV. L'exploitation de l'État.
- V. La politique.
- § 1er. La politique extérieure.
- § 2. La politique intérieure.
- VI. Résumé des nécessités qui ont déterminé la constitution et la politique des États. La concurrence politique
- IV. Les gouvernements modernes La monarchie constitutionnelle - p. 87
- I. En quoi les gouvernements modernes diffèrent des gouvernements de l'ancien régime.
- II. La monarchie constitutionnelle et son mécanisme.
- § 1er. Le pouvoir royal.
- § 2. Le corps électoral.
- § 3. Le parlement.
- § 4. Les libertés et les garanties constitutionnelles.
- III. Résultats de l'expérience de la monarchie constitutionnelle.
- IV. Les politiciens et les partis politiques
- V. Les gouvernements modernes La république et le suffrage universel - p. 119
- I. Formes et types des gouvernements modernes.
- II. La république. En quoi elle se différencie de la monarchie constitutionnelle.
- § 1er L'élection du chef de l'État.
- § 2. Le suffrage universel.
- III. Le stathoudérat et l'Empire.
- IV. Conclusion.
- VI. Politique extérieure des États modernes La guerre - p. 139
- I. Fatalité de la guerre dans les temps primitifs et dans l'âge de la petite industrie.
- II. Comment l'évolution vers l'état de paix est née et a progressé jusqu'à la Révolution française.
- III. Persistance anormale de l'état de guerre à l'époque actuelle. Causes qui ont fait succéder au risque naturel de guerre un risque artificiel.
- IV. Les motifs et les résultats des guerres contemporaines. Leur tendance à la périodicité.
- Conclusion.
- VII. Politique intérieure des États modernes - p. 191
- I. Apercu rétrospectif de la constitution des États de l'ancien régime et de leurs conditions d'existence.
- II. Le communisme politique.— Causes de son infériorité. — Conséquences de son établissement. A l'extérieur : recrudescence artificielle de l'état de guerre et aggravation de ses maux. A l'intérieur : détérioration des différentes parties de la gestion de l'État.
- 1° Exclusion des étrangers du personnel des services publics ;
- 2° Extension progressive des attributions du gouvernement;
- 3° Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale;
- 4° Restrictions opposées à l'exercice des libertés nécessaires au self government;
- 5° Impuissance et corruption de l'opinion publique;
- 6° Résultats
- VIII. Évolution et révolution - p. 238
- Sommaire : Comment les sociétés civilisées sortiront de l'ancien régime. — Les moyens révolutionnaires et la méthode évolutionnistc. La genèse du progrès politique. — Les trois périodes d'activité de la production des inventions et découvertes politiques et économiques.
- I. Première période. Industrie primitive et rudimentairc.
- II. Seconde période. Avènement de la petite industrie. — Caractères généraux des institutions politiques de ces deux périodes.
- III. Troisième période. Avènement de la grande industrie et de la suprématie militaire des peuples civilisés. — État des sciences politiques et économiques à la veille de la Révolution française. — Causes qui ont fait prévaloir les moyens révolutionnaires sur la méthode évolutionniste. — La journée du 14 juillet 1789.
- IV. La révolution à l'époque actuelle et ses effets de rétrogression
- IX. La Révolution française - p. 270
- I. Les réformes accomplies et les institutions créées par la Révolution française.
- II. Les causes de la révolution.
- § 1. En quoi consistait l'État.
- § 2. A qui appartenait l'État.
- § 3. Situation du roi propriétaire de l'État vis-à-vis de la nation.
- § 4. Causes qui ont empêché la réforme de l'ancien régime.
- § 5. Pourquoi la réunion de l'Assemblée nationale devait conduire à la révolution.
- III. Rétrogression produite par la révolution.
- § 1er. Récapitulation des causes de ce phénomène.
- § 2. Marche rétrogressive de la révolution jusqu'à nos jours.
- § 3. Marche ultérieure de la révolution.
- IV. Influence rétrograde de la révolution sur les sciences morales et politiques.
- § 1er. Sur la science de la politique.
- § 2. Sur l'économie politique.
- V. Pertes matérielles et démoralisation causées par la révolution.
- § 1er. Destruction des richesses.
- §2. Démoralisation.
- VI. Influence rétrograde de la Révolution française à l'étranger.
- VII. Comment les nations civilisées sortiront de la révolution pour rentrer dans l'évolution.
- X. Les gouvernements de l'avenir - p. 351
- I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires.
- II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées.
- § 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises.
- § 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie.
- III. Du régime économique des États politiques dans l'ère de la grande industrie.
- § 1er. Les servitudes et leur raison d'être.
- § 2. La servitude politique.
- § 3. Raison d'être de la servitude politique.
- § 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel.
- § 5. La liberté de gouvernement.
- IV. La commune et son avenir.
- V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique.
- VI. La nationalité et le patriotisme.
- XI. Tutelle et liberté - p. 424
- I. Nécessité de la tutelle.
- II. La tutelle dans le passé.
- III. La tutelle et la révolution.
- IV. Résultats de l'abolition de l'ancien régime de la tutelle par voie révolutionnaire et philanthropique.
- § 1er. L'abolition de l'esclavage des nègres.
- § 2. L'abolition du servage en Russie.
- § 3. La réforme du régime agraire en Irlande.
- § 4. Les rapports des peuples civilisés avec les races inférieures ou en retard. Le remplacement des institutions dites barbares par le self government combiné avec la tutelle gouvernementale.
- V. De la reconstitution libre de la tutelle par voie d'évolution.
- VI. Avenir de la liberté et de la tutelle
- XII . RÉSUMÉ ET CONCLUSION - p. 486
- Notes
[1]
CHAPITRE PREMIER.
Constitution des sociétés. — Gouvernements primitifs↩
I. Raison d'être de la formation des sociétés et de la constitution des gouvernements. — II. Éléments et conditions d'existence et de progrès des sociétés primitives. — III. Diversité originaire des gouvernements et des codes. Pourquoi la communauté a été la forme politique adaptée aul sociétés primitives.
I. Raison d'être de la formation des sociétés et de la constitution des gouvernements. — A toutes les époques de son existence, l'humanité nous apparaît divisée en sociétés plus ou moins nombreuses, — troupeaux, clans, tribus ou nations,— et ces sociétés à leur tour sont pourvues d'un gouvernement. Ce gouvernement se présente sous des formes diverses, mais que l'on peut ramener à un petit nombre de types; ses attributions sont plus ou moins variées et étendues; enfin, sociétés et gouvernements croissent, se transforment et périssent pour faire place à d'autres.
Quelle est la raison de ces phénomènes? Pourquoi les hommes ont-ils, dès l'origine, formé des sociétés? Pourquoi [2] ces sociétés nous apparaissent-elles universellement pourvues d'un gouvernement?
Ce mode de constitution et d'existence de la race humaine a été déterminé par des nécessités dérivant de la nature de rhomme et du milieu où il vit. L'homme ne peut subsister et se multiplier qu'à la condition de s'assimiler incessamment les éléments nécessaires à l'entretien de ses forces et de sa vie; si ce travail d'assimilation vient à s'arrêter ou demeure insuffisant, il souffre et il périt. Ces matériaux de l'existence, la terre qu'il habite les contient en abondance, mais il n'est pas seul à ressentir le besoin impérieux de se les procurer; il est obligé de les disputer non seulement à ses semblables, mais encore à une partie des autres espèces animales. Parmi ces espèces inférieures, les unes semblent naturellement destinées à lui servir de proie, elles sont trop faibles pour lui résister et constituent, avec les végétaux, les ressources alimentaires dont il peut disposer, à la condition de les découvrir, de s'en emparer et de les multiplier à son usage. Les autres, au contraire, lui font concurrence pour s'approprierce stock alimentaire et parfois même le considèrent comme une proie; quelques-unes, celles des grands carnassiers par exemple, lui sont supérieures en force, et elles sont pourvues d'armes naturelles bien autrement puissantes que les siennes. Si donc les premiers hommes n'avaient point, comme la plupart des espèces les moins fortes et les moins bien armées, formé des troupeaux, ils n'auraient pas manqué d'être victimes de ces-concurrents plus robustes, plus agiles et mieux endentés. S'ils n'avaient pas eu recours à l'association pour compenser cette inégalité des forces et de l'armement naturel, leur espèce aurait promptement disparu de la terre.
Comment se sont formés les premiers troupeaux qui ont été les embryons des sociétés humaines? Nous l'ignorons, mais l'observation des espèces animales inférieures nous [3] permet de conjecturer que les individus qui avaient entre eux des ressemblances ou des affinités de race se sont rassemblés et associés sous l'empire de nécessités communes. Ces troupeaux primitifs ne pouvaient comprendre, du moins à l'origine, qu'un nombre restreint d'individus. Vivant de la récolte des fruits naturels du sol, de la chasse ou de la pêche, industries qu'ils exerçaient au moyen d'armes et d'engins rudimentaires, les hommes avaient besoin d'explorer de vastes espaces pour y trouver leur subsistance, tandis que la nécessité de se protéger mutuellement les obligeait à se tenir rapprochés, et pour ainsi dire à portée de la voix. Dans ces conditions, un troupeau ne pouvait guère contenir plus de quelques centaines de tètes. Telles sont encore les tribus australiennes dont l'industrie n'a pas dépassé celle des âges primitifs.
Mais du moment où le troupeau était rassemblé, ne contînt-il que le plus faible nombre d'individus, un gouvernement lui devenait nécessaire, et il devait s'établir d'une manière ou d'une autre. Toute association implique une organisation adaptée aux nécessités qui ont déterminé sa formation. Ces nécessités, dans l'association primitive, étaient de deux sortes : extérieures et intérieures. Il fallait, en premier lieu, assurer l'existence des associés en pourvoyant à leur défense soit contre les autres espèces animales, soit contre les autres troupeaux humains, et leur procurer même, s'il se pouvait, un accroissement de subsistances aux dépens des individus ou des troupeaux concurrents. Il fallait, en second lieu, empêcher les associés de commettre des actes ou de contracter des habitudes nuisibles à l'association, et les dresser au contraire à agir, en toute circonstance, de la manière qui pouvait lui être la plus profitable. Cette double nécessité impliquait la création d'un gouvernement chargé, d'une part, d'organiser et de diriger les forces du troupeau, en vue de la défense ou de [4] l'attaque extérieure, d'une autre part, d'empêcher tout ce qui pouvait être nuisible à l'association, de susciter tout ce qui pouvait lui être utile.
Comment ce gouvernement indispensable a-t-il été institué? Les membres du troupeau se sont-ils réunis au fond des bois, comme le supposait Rousseau, pour élire un chef et discuter les articles du contrat social? [1] Ils ne [5] possédaient, selon toute apparence, que les premiers rudiments du langage et ils auraient été aussi incapables d'une délibération en règle que peuvent l'être les singes, les castors et les autres animaux qui vivent en troupes. Le mode naturel de formation des gouvernements a été, sans aucun doute, fort différent de celui-là. Les plus forts, les plus intelligents, les plus agiles, ceux dont la vue était la plus perçante, qui découvraient les premiers l'ennemi ou la proie, qui l'emportaient sur leurs compagnons par le courage et l'habileté dans les combats ou à la chasse, acquéraient un ascendant naturel, et l'homme que l'opinion désignait comme le plus capable de diriger le troupeau en devenait le chef. C'est ainsi qu'en l'absence d'une hiérarchie établie, ou lorsque cette hiérarchie ne répond pas aux nécessités du moment, on voit une troupe de naufragés se choisir pour chef l'homme qui a déployé, en présence du danger, le plus d'énergie et de sang-froid. Or, qu'étaient les premiers hommes sinon des naufragés sur une terre inconnue, où ils avaient à disputer leur subsistance et leur vie à une multitude d'espèces concurrentes et hostiles?
Les mêmes nécessités, qui déterminent la création d'un gouvernement dans chaque troupeau, déterminent aussi son organisation et ses attributions militaires et civiles. La première de ces nécessités c'était la guerre avec les autres hommes et les autres espèces animales, et cette nécessité s'imposait à chaque troupeau sans qu'il lui fût possible de l'éviter. Mais la guerre a ses conditions naturelles d'organisation, de stratégie et de tactique. On ne peut l'entreprendre ou la soutenir avec succès à moins de rassembler toutes les forces dont on dispose, de les combiner et de les mettre en mouvement, de façon à en obtenir un maximum d'effet utile en échange d'un minimum de dépense; en d'autres termes, à moins de faire une armée avec un troupeau. A défaut de la science qui est, en [6] cette matière comme en toute autre, le produit de l'expérience, de l'observation et de la réflexion, cette transformation ne pouvait s'opérer qu'à force de tâtonnements et d'essais. Elle exigeait, avant tout, l'unité dans le commandement, la transmission rapide et assurée des ordres indispensables à l'exécution des mouvements, l'obéissance absolue, passive, de ceux qui étaient chargés de les transmettre et de les exécuter. Il se passa longtemps selon toute apparence, avant que ces conditions naturelles d'organisation et de fonctionnement d'une armée fussent aperçues et comprises. Il fallut que des expériences cruelles et répétées eussent démontré que les compétitions entre les chefs, le défaut d'obéissance et de ponctualité dans la transmission et l'exécution des commandements entraînaient fatalement la défaite et la destruction du troupeau. Ce fut seulement lorsque ces expériences eurent porté leurs fruits, c'est-à-dire lorsque l'élite intellectuelle de chaque troupeau eut acquis la conviction que l'anarchie, le défaut de subordination et de discipline constituaient des nuisances destructives de tous et de chacun, que la hiérarchie et la discipline purent s'établir et se maintenir.
Cependant il ne suffisait pas que le troupeau s'organisât de manière à disputer victorieusement sa subsistance aux espèces et aux troupeaux concurrents, qu'il se hiérarchisât et se disciplinât en vue de la lutte extérieure, il fallait encore qu'il se prémunît contre les causes intérieures d'affaiblissement et de dissolution de la « société ». Ces causes, qui n'ont pas cessé d'agir depuis la naissance des associations humaines, résidaient dans l'imperfection native de l'homme, dans l'ignorance des conditions auxquelles l'association pouvait subsister et prospérer, enfin, ces conditions connues, dans l'absence et l'insuffisance de la force morale nécessaire pour les faire observer, en contenant les impulsions contraires des passions aveugles et [7] des intérêts égoïstes des associés. Ces impulsions, qu'aucun frein n'avait encore retenues et modérées, les portaient naturellement à satisfaire leurs besoins, c'est-à-dire à se procurer des jouissances et à s'épargner des souffrances, sans se préoccuper d'autrui et même aux dépens d'autrui. Les besoins de l'homme dans cet état primitif étaient, à la vérité, peu nombreux et peu développés; ils se réduisaient à des appétits presque exclusivement matériels et n'exigeaient qu'une satisfaction grossière, mais encore fallaitil les satisfaire et, eu égard à l'imperfection des moyens de production ou d'acquisition des nécessités de la vie, on n'y parvenait qu'à grand'peine. De là des conflits naturels d'intérêts. Le partage d'une proie ou d'un butin, par exemple, devait être une source permanente de querelles, jusqu'à ce qu'une règle utile eût été découverte et pût être imposée pour l'opérer. Les passions n'avaient encore subi aucun frein et, si quelques-unes étaient propres à unir les associés, d'autres au contraire étaient de nature à les diviser. Si l'on voit se manifester des sympathies parmi des individus rassemblés et rapprochés sous l'influence d'une nécessité commune, on voit aussi éclore des antipathies, et se produire toutes sortes de sentiments hostiles et nuisibles à autrui : la jalousie, l'envie, la haine, l'esprit de domination. Ces passions antisociales l'emportent même généralement sur les sentiments qui contribuent à cimenter l'union et la paix. On a prétendu, nous ne l'ignorons pas, qu'il existe entre les hommes une sympathie particulière, que l'on pourrait nommer la sympathie d'espèce. Mais ce n'est là qu'un simple germe, qui ne se développe qu'autant que des intérêts communs, des manières de voir et de sentir identiques agissent pour le faire éclore et grandir. On peut contester même que l'homme ait une propension naturelle à aimer ses semblables plutôt que les autres créatures. Combien d'hommes ont plus d'affection pour [8] les chevaux ou les chiens que pour les individus de leur propre espèce! Enfin, en dehors des relations sexuelles qui n'impliquent point nécessairement une sympathie morale, ils sont plutôt disposés à la défiance et à la malveillance qu'à la bienveillance les uns à l'égard des autres, surtout lorsqu'ils appartiennent à des races, à des professions ou à des localités concurrentes. Si rapprochés qu'ils soient d'ailleurs par la race, la nationalité ou même la parenté, .ne voyons-nous pas tous les jours qu'il suffit do la moindre opposition d'intérêts pour les rendre ennemis et les pousser à s'entre-nuirc et à s'entre-détruirc? Si donc il existe entre eux une sympathie naturelle, elle est bien faible et elle n'oppose qu'un obstacle singulièrement fragile à tant d'impulsions véhémentes qui agissent pour les désunir.
D'un autre côté , au début de l'association , comment les individus incultes et sauvages qui la constituaient auraientils su lesquels de leurs actes pouvaient lui être utiles et lesquels nuisibles? N'oublions pas qu'ils vivaient et qu'ils allaient pendant longtemps encore continuer à vivre au moyen de la destruction et de la rapine exercées aux dépens du reste de la création. Comment auraient-ils pu avoir la moindre notion de la nécessité de renoncer à ces pratiques à l'égard de leurs associés, tout en continuant à en user à l'égard des autres hommes et en vue même d'en user avec plus de succès? L'expérience seule pouvait les avertir que des actes, qu'ils avaient considérés jusqu'alors comme utiles et qu'ils devaient continuer à considérer comme tels en dehors du troupeau ou de la tribu, étaient nuisibles dans l'intérieur de leur « société », et qu'ils devaient s'en abstenir. Tels étaient notamment le vol, le meurtre et le rapt. Ces actes, et bien d'autres, ne pouvaient être reconnus et interdits comme des « nuisances » qu'autant que l'expérience avait clairement attesté leur nuisibilité, du moins entre [9] associés, et montré qu'ils compromettaient l'existence d'une association nécessaire à la prospérité et au salut de tous ses membres. C'est ainsi qu'on voit les voleurs les moins scrupuleux .et les bandits les plus féroces s'abstenir entre eux des actes de rapine et de violence qu'ils commettent habituellement, par profession, à l'égard des autres hommes. Ils se créent un code renfermant l'ensemble des règles sans lesquelles l'expérience a démontré que leur « société » ne saurait subsister, et telle a été l'origine de tous les codes.
Mais alors même que l'expérience a dénoncé les actes et les manières d'agir nuisibles à la société, et révélé les actes et les manières d'agir utiles, il faut encore que les associés aient la force morale nécessaire pour s'abstenir des uns et pour pratiquer les autres, en dépit des impulsions contraires de leurs intérêts et de leurs passions égoïstes. Cette force morale, comment la posséderaient-ils? Comment se serait-elle produite et développée chez les membres des sociétés primitives, puisqu'ils n'avaient pas eu auparavant à en faire usage? En attendant qu'elle se produisît et se développât dans la mesure nécessaire, il fallait bien suppléer à son absence ou à son insuffisance. On y suppléa au moyen d'un double appareil de pénalités et de récompenses qui est un des produits les plus merveilleux du génie humain.
Quand on considère, en effet, la nature de l'homme, quand on analyse les impulsions originelles de ses instincts et de ses passions, et que l'on constate l'état d'antagonisme où elles le placent vis-à-vis des autres créatures, sans excepter les individus appartenant à son espèce, on demeure frappé de l'énorme difficulté d'associer des êtres qui ignorent les conditions et les exigences de la vie en société et semblent si peu capables de s'y plier. Il ne fallait rien moins qu'une nécessité inexorable pour les déterminer à se rapprocher, [10] à former des sociétés et à se soumettre aux règles et aux contraintes indispensables à leur maintien. Mais cette nécessité existait, et l'expérience, — une expérience brutale et cruelle, —attestait incessamment sa présence aux yeux des hommes les moins capables d'observer et de réfléchir. Que des individus isolés ou rassemblés en trop petit nombre fussent incapables de soutenir la lutte pour l'existence, que la dissolution et la dispersion d'un troupeau entraînât promptement la destruction de ses membres, voilà ce qui était manifeste. La nécessité de l'association s'imposait donc avec une telle netteté et une telle violence qu'elle devait être perçue par les intelligences les moins lucides et être acceptée par les tempéraments les plus rebelles. Cependant il n'en était pas de même pour toutes les conditions accessoires. On conçoit que dans une expédition de chasse ou de guerre le troupeau acceptât la direction du plus capable et du plus habile, comme les oiseaux de passage se laissent diriger par ceux qui ont la vue la plus perçante , qu'il se soumît à ses ordres et qu'une hiérarchie grossière se constituât ainsi: car l'absence ou l'insuffisance de cette discipline engendrait un mal immédiat et aisément perceptible. L'expérience provoquait, en ce cas, d'une manière instantanée, la production d'une opinion qui condamnait tous les actes contraires à une discipline nécessaire au salut commun, qui approuvait tous ceux qui y étaient conformes. Il en était autrement pour tous les actes ou manières d'agir dont les effets n'étaient pas immédiatement perceptibles ou ne pouvaient être appréciés que par des intelligences capables de réflexion. Parmi ces actes ou ces manières d'agir, les uns étaient utiles: ils contribuaient à augmenter les forces et les ressources du troupeau; les autres,au contraire, contribuaient à l'affaiblir et à l'appauvrir. Mais l'expérience des effets bienfaisants de ceux-là, des effets malfaisants de ceux-ci, pouvait seule [11] décider de la catégorie dans laquelle il convenait de les ranger, et cette expérience ne pouvait porter ses fruits qu'à la condition d'être l'objet d'une observation attentive. L'élite intellectuelle du troupeau, seule aussi, avait la capacité, requise, — encore chez les races inférieures cetle capacité esl bien faible, — pour observer les résullats de lelle ou telle manière d'agir et reconnaître s'ils étaient avantageux ou nuisibles à la « société ». De plus, cette constatation faite, cette opinion formée, il fallait la faire accepter ou l'imposer, afin que les manières d'agir utiles fussent encouragées ou même rendues obligatoires, les manières d'agir nuisibles interdites dans l'intérêt commun. Ce n'est pas tout. Il fallait encore que cet encouragement et cette prohibition fussent efficaces et durables, il fallait que les différents membres du troupeau, qu'ils le voulussent ou non, fussent assujettis à s'abstenir des actes nuisibles et à produire des actes utiles. Ce problème nous paraît aujourd'hui fort simple, et cependant si l'on considère la nature animale de l'homme, son ignorance originaire, ses instincts sauvages et brutaux, il n'en est point dont la solution présentat plus de difficultés. Commenl a-t-il été résolu? Par l'action de l'opinion combinée avec celle de la religion.
Aux temps primitifs, aussi bien que de nos jours, c'est l'intérêt réel ou supposé de la « société » dont ils font partie, qui a provoqué, chez les hommes capables d'observer et de juger, la formation d'une « opinion » sur chacune des expressions ou des manifestations de l'activité individuelle ou collective, et c'est l'ensemble de ces opinions qui a constitué le code du troupeau, de la tribu et finalement de la nation. Cependant, nous pouvons constater tous les jours combien l'opinion est changeante et diverse. N'en devait-il pas être de même, à plus forte raison, aux époques de primitive ignorance, quand les observations qui sont les matériaux de l'opinion manquaient, plus encore qu'aujourd'hui, [12] d'exactitude et de précision, quand l'aptitude à les rassembler, à les combiner et à en tirer une conclusion était plus faible? Tous ceux qui ont étudié de près les tribus sauvages s'accordent à dire que rien n'est plus mobile et inconsistant que les impressions et les opinions de cette portion arriérée de notre espèce. Comment donc ces impressions et ces opinions mobiles ont-elles pu se figer dans des coutumes presque immuables? Car si rien n'est moins stable que les opinions des hommes dont l'intelligence est peu développée, rien n'est fixe comme les coutumes auxquelles ils obéissent. Cette consolidation des verdicts rendus par une opinion naturellement mobile est due à l'intervention de la religion.
La religion est le produit de facultés diverses, parmi lesquelles l'esprit de causalité est la principale. Les hommes d'élite chez qui cette faculté est puissante et active sont incités par elle à rechercher les causes des phénomènes de la nature, et ces phénomènes, utiles ou nuisibles, ils les attribuent à l'action de puissances ou de divinités, les unes bienfaisantes et amies, les autres malfaisantes et ennemies, auxquelles ils attribuent un pouvoir proportionné à l'importance des manifestations de leur activité. C'est ainsi que le plus puissant des dieux de la mythologie grecque est celui qui lance la foudre. Ces divinités, l'homme ne peut faire autrement que de leur attribuer ses sentiments et ses passions, en les agrandissant à leur taille. Mais à l'esprit de causalité, qui a fait naître l'idée de l'existence de puissances supérieures, se joint la faculté de traduire une idée par une image. On se représente la divinité sous une forme gracieuse ou terrible, avenante ou repoussante, avec des attributs conformes à la fonction ou au rôle qu'on lui confère, aux sentiments et aux passions qu'on lui prête, et cette divinité, on essaye d'en fixer l'image en la reproduisant avec de la terre glaise, du bois, de la pierre, et, plus [13] tard, du métal. Cette image est plus ou moins saisissante selon que celui qui l'a conçue et qui la façonne est plus ou moins artiste. Si elle est suffisamment expressive et si elle répond au concept confus que les autres membres de la tribu, inférieurs en imagination et en facultés artistiques, se sont fait de la divinité, elle en sera considérée comme la représentation authentique ou même l'incarnation, et elle passera à l'état d'idole. L'artiste, qui l'a conçue et façonnée lui-même, se prosternera naïvement pour l'adorer. Comment, en effet, cette image se serait-elle formée dans son esprit, comment en aurait-il découvert et rassemblé les traits, si la divinité ne lui était point en réalité apparue, si elle ne s'était point révélée à lui? Cette conviction ne doitelle pas s'enraciner davantage dans son esprit à mesure qu'il s'aperçoit qu'elle est partagée, que l'idole belle ou hideuse, bienfaisante ou malfaisante, est l'objet de l'amour ou de la crainte des autres hommes.
Mais ces idoles, auxquelles on attribue un pouvoir surhumain, deviennent le plus puissant des instruments de gouvernement. Ceux qui les ont façonnées ou qui en ont la garde ne manquent pas de les consulter sur toutes les questions qui intéressent l'existence et le bien-être de la tribu, et ils ne manquent pas, non plus, de leur attribuer leur propre manière de voir. Comment ne seraient-ils pas persuadés que l'opinion qui s'est formée et qui est devenue prédominante dans leur esprit pendant qu'ils contemplaient l'idole divine, leur a été suggérée ou dictée par elle? Et cette opinion inspirée ou révélée par la divinité elle-même, comment ir acquerrait-elle point, et pour ceux qui l'ont reçue et pour la foule à laquelle ils la communiquent, une autorité indiscutable et souveraine? Elle est acceptée comme une révélation de l'intelligence et de la volonté divines, et s'il arrive que l'inobservation de la coutume ou de la loi qui en est le produit soit suivie de conséquences [14] nuisibles à la tribu, cette coutume ou cette loi devient immuable; elle s'impose aux générations successives, alors même que les nécessités auxquelles elle pourvoyait se sont modifiées ou ont cessé d'exister.
Les coutumes ou les lois ainsi engendrées et imposées ne sont pas, sans doute, toujours pleinement adaptées aux nécessités qui les ont fait naître; mais, si imparfaites qu'elles nous paraissent, elles ont été le produit de l'opinion de l'élite intellectuelle de la tribu, c'est-à-dire des hommes les moins incapables de découvrir et de formuler les règles indispensables à la conservation et au développement de la société naissante. Elles ont une double sanction, investie dans un double appareil de pénalités pour ceux qui les enfreignent, de récompenses pour ceux qui leur obéissent; et l'expérience atteste qu'il ne faut rien, moins pour faire prévaloir l'intérêt commun sur les impulsions désordonnées des passions et des intérêts égoïstes. Quand cette machinery de gouvernement, à la fois divine et humaine, devient caduque, quand la loi cesse d'être adaptée à l'état de la société, celle-ci s'affaiblit et elle ne tarde pas à succomber dans la lutte pour l'existence.
II. Éléments et conditions d'existence et de progrès des sociétés primitives. — En résumé, les éléments de vitalité, de durée et de développement des sociétés embryonnaires du premier âge de l'humanité peuvent se résumer ainsi:
L'avenir de ces premiers groupes humains dépendait d'abord des qualités physiques et morales de leurs membres, de la bonté de la race, de la nature et des circonstances du milieu où ils se trouvaient jetés. Les troupeaux placés dans un milieu où ils avaient à supporter une lutte particulièrement rude avec la nature et les espèces ou les troupeaux concurrents devaient succomber dans cette lutte ou acquérir une supériorité de développement physique et moral.
[15]
La force, l'agilité, le courage physique, l'aptitude à supporter les privations étaient alors les qualités les plus nécessaires et celles qui devaient être les plus estimées; c'est pourquoi la notion de courage, par exemple, se confond avec celle de valeur, le courage étant la qualité la plus « demandée ». A ces qualités nécessaires pour lutter contre le milieu ambiant venaient se joindre celles qu'exigeaient l'association et le gouvernement sans lequel, à moins de supposer des individualités parfaites, aucune association ne peut subsister. Il fallait, avant tout, un certain esprit d'observation pour faire reconnaître ce qui, dans les manifestations de l'activité de chacun, constituait une nuisance pour la société, et ce qui, au contraire, lui était avantageux, de telle façon qu'une opinion utile pût se former sur les unes et sur les autres. Cette opinion, à mesure qu'elle se formait, suggérait les pratiques et les coutumes qui étaient ou que l'on croyait être les mieux appropriées à la situation et aux conditions d'existence du troupeau ou de la tribu. Comme la chose est arrivée de tout temps, les hommes doués de la plus forte dose d'intelligence naturelle formaient ou dirigeaient l'opinion de la foule. [2]
[16]
Cependant, à moins de joindre la supériorité de la force physique à celle de l'intelligence, ce qui ne pouvait être qu'accidentel et probablement exceptionnel, ces individus d'élite ne possédaient pas eux-mêmes la puissance requise pour commander une obéissance régulière et continue aux règles qu'ils jugeaient nécessaires à l'existence et à la prospérité de l'association. Pour obtenir celle obéissance indispensable, il leur fallait donc faire intervenir des êtres dont la puissance dépassât celle des individualités les plus fortes; et ces êtres imaginaires qu'ils concevaient bons ou méchants, beaux ou laids, mais dont ils empruntaient nécessairement les traits et les qualités soit à eux-mêmes, soit à la nature ambiante, — car l'esprit ne peut travailler que sur les données qu'il possède, — ces êtres imaginaires, disons-nous, ils les façonnaient lols qu'ils les avaient conçus. Selon toute apparence même, ils croyaient que les divinités que leur imagination avait engendrées, leur étaient réellement apparues, et ils étaient les premiers à adorer ces images informes et grossières. Mais dès ce moment le plus puissant des véhicules de gouvernement était trouvé. Quelle que fût leur infériorité numérique et physique, les individualités intelligentes, les voyants, les prophètes auxquels les divinités se révélaient, étaient désormais assurés de faire prévaloir leur opinion. En consultant leurs divinités, ou les signes par lesquels elles se manifestaient à eux, le vol des oiseaux, les entrailles des victimes, ils obtenaient dans toutes les circonstances, la révélation de la règle la meilleure à suivre ou du parti le plus utile à prendre. Les divinités indiquaient les manières d'agir qu'il importait d'adopter et celles dont il fallait s'abstenir; elles désignaient encore le chef le plus [17] capable de commander. Aucun compétiteur ne pouvait disputer la place à l'homme qu'elles avaient choisi, car il avait pour lui, avec le droit divin, toute l'irrésistible puissance que la divinité mettait au service de ses élus. En le combattant ou en lui désobéissant, on combattait la divinité elle-même ou on lui désobéissait, et on s'exposait ainsi aux châtiments terribles et inévitables qu'il était en son pouvoir d'infliger. De même, en enfreignant les règles qu'elle avait dictées pour toutes les circonstances de la vie, en refusant d'employer les procédés et les instruments qu'elle avait inventés (car les inventeurs comme les législateurs et les poètes se croyaient véritablement inspirés par les dieux, et, après tout, l'esprit qui se manifestait en eux n'avait-il pas une origine supérieure ou divine?) on s'exposait encore à son courroux. Plus la foi en l'existence des dieux était répandue et enracinée, plus le gouvernement était facile, mieux les coutumes ou les lois étaient obéies, moins aussi on avait besoin de recourir aux châtiments physiques. Ceux-là seuls s'y exposaient d'habitude à qui la foi manquait; et voilà pourquoi l'incrédulité, le mépris des divinités et de leurs injonctions étaient considérés avec raison comme la première des nuisances sociales, comme le plus grand des crimes. Sans doute, la foi aveugle de la multitude avait pour résultat de la livrer au pouvoir du petit nombre des hommes privilégiés qui se trouvaient en communication avec les dieux, mais ces hommes constituaient l'élite des sociétés primitives et ils étaient les plus propres à les gouverner. Ils pouvaient abuser et ils abusaient de l'autorité absolue que leur conférait la foi, mais cet abus était peu de chose en comparaison des maux dont l'absence ou l'insuffisance de ce ressort de gouvernement était la source. L'histoire nous montre, chez les peuples faiblement pourvus du sentiment religieux, l'autorité sans respect et sans force, l'État exposé [18] incessamment à l'anarchie, et, d'un autre côté, en Chine par exemple, une barbarie excessive des châtiments qui ne supplée qu'imparfaitement pour la répression des nuisances sociales aux châtiments divins. Sans la religion, il est douteux que les sociétés humaines eussent réussi à se développer ou même à subsister dans leur période de formation embryonnaire. C'est au point qu'on peut se demander s'il n'existe point dans les sociétés des animaux inférieurs quelque principe analogue d'obéissance et d'ordre.
III. Diversité originaire des gouvernements et des codes. — Pourquoi la communauté a été la forme politique adaptée aux sociétés primitives. — Si l'on se rend compte des nécessités qui ont déterminé la formation des troupeaux primitifs, embryons des sociétés humaines, ainsi que la constitution de leurs gouvernements et la création de leurs codes, autrement dit, de l'ensemble des coutumes et des règles morales auxquelles ils obéissaient; si l'on n'oublie pas que ces gouvernements et ces codes ont été partout le produit de la coopération de l'opinion et de la religion, on s'apercevra qu'ils ne pouvaient être uniformes; qu'ils devaient différer de troupeau à troupeau, ou de tribu à tribu, comme ils ont différé plus tard de nation à nation. Les nécessités déterminantes de la création des gouvernements et des codes étaient, sans doute, les mêmes partout, elles se résumaient dans l'établissement de l'ordre intérieur et de la sécurité extérieure; mais il existait des différences à la fois dans les conditions physiques et géographiques d'existence des troupeaux et dans le tempérament intellectuel et moral de leurs membres. Ceux qui vivaient dans les régions d'un accès difficile, sous un climat rude, avaient moins à craindre que les autres pour leur sûreté; ils n'étaient pas obligés, par conséquent, de se soumettre d'une manière permanente à un [19] chef, et l'histoire nous apprend qu'ils s'y soumettaient seulement d'une manière temporaire, pendant leurs expéditions de chasse ou de guerre. [3] Les troupeaux qui habitaient des plaines ouvertes, sous un climat chaud, dans des régions abondantes en gibier, mais où pullulaient leurs concurrents carnassiers, devaient, au contraire, sous peine [20] de destruction, se soumettre à une hiérarchie et se résoudre à obéir constamment à un chef. D'un autre côté, tous les troupeaux n'appartenaient pas à la même race, et n'étaient point pourvus de la même somme d'intelligence et de forces morales. A cet égard il y avait des inégalités sensibles de troupeau à troupeau; il n'y en avait pas moins dans l'intérieur de chacun. De là d'autres différences dans les gouvernements et dans les codes. Où la distribution de ce qu'on peut appeler les facultés gouvernantes était particulièrement inégale, le pouvoir dirigeant se concentrait naturellement chez le petit nombre, parfois même chez un seul; où cette distribution était suffisamment égale, le pouvoir dirigeant se distribuait dans la généralité, (/os sociétés embryonnaires allaient ainsi, en vertu de la nature du « milieu » où elles vivaient et de leur tempérament particulier, les unes à l'absolutisme monarchique, les autres à l'oligarchie ou à la démocratie. Néanmoins, audessus de ces diversités, surgit un régime politique qui dérive des conditions économiques de leur existence; il est le régime approprié aux sociétés dont le matériel productif est au degré le plus bas de l'échelle, les moyens de subsistance les moins suffisants et les plus précaires. C'est le régime de la communauté qui apparaît à la naissance des sociétés primitives et demeure prédominant jusqu'à l'avènement de la petite industrie.
Cette forme politique primordiale était, disons-nous, commandée par la situation économique des troupeaux primitifs, par l'imperfection de leur armement et de leur outillage. Il suffira d'un peu de réflexion pour se convaincre qu'elle était seule possible, à une époque où les fonctions dirigeantes qui sont devenues plus tard une source abondante de richesses étaient naturellement improductives. Quand on ne possède pour outillage que des armes grossières en bois ou en pierre non taillée, tout ce [21] qu'on peut faire c'est de pourvoir à sa subsistance] de chaque jour. La difficulté de résoudre le problème de l'existence est même tellement grande qu'on sacrifie sans pitié ou qu'on laisse périr les individus incapables de se suffire à eux-mêmes. On n'élève, par exemple, qu'un petit nombre de femelles sauf à s'en procurer économiquement par le rapt quand elles sont arrivées à l'âge utile. [4] Dans cet état de choses, comment serait-on en état d'acheter les services d'un gouvernement? Ou il faut s'en passer, chose impossible, ou il faut se résoudre à produire soi-mèmes ces services indispensables. Il faut que chacun des membres du troupeau ou de la tribu remplisse les fonctions politiques, militaires, législatives, administratives et judiciaires qui constituent l'office d'un gouvernement, si rudimentaire soit-il. Ajoutons que non seulement ces fonctions sont gratuites, mais encore qu'elles doivent être obligatoires. En effet, elles sont une charge, puisque les ressources nécessaires pour les rétribuer n'existent pas, et il faut bien que tous les membres du troupeau supportent leur part des charges communes.
Dans les âges suivants, à mesure que le matériel de la production s'est développé et perfectionné, à mesure que les sociétés se sont enrichies grâce à ces progrès de leur outillage, les fonctions gouvernantes ont pu être rétribuées et il est devenu avantageux de les exercer. Alors aussi, on a vu, dans chaque société, les hommes les plus forts et les plus intelligents s'en attribuer le monopole en vue des profits qu'ils en pouvaient tirer. Mais, dans les temps primitifs, ce monopole n'aurait eu d'autre résultat que d'augmenter les charges de ceux qui auraient commis l'imprudence de s'en emparer. Ils auraient perdu, à exercer les [22] fonctions gouvernantes à l'exclusion des autres membres de la communauté, un temps précieux, dérobé à la recherche de leur subsistance. La communauté politique était donc le seul régime qui convînt à des sociétés encore trop peu nombreuses et trop pauvres pour que le gouvernement pût s'y spécialiser et procurer des moyens d'existence suffisants à ceux qui en exerçaient les fonctions. Elle cessa d'exister seulement lorsque le matériel de la production se fut assez perfectionné pour que le gouvernement cessât d'être gratuit.
[23]
CHAPITRE II.
Les gouvernements de l'ère de la petite industrie Le régime féodal↩
I. Progrès qui ont déterminé l'avènement de la petite industrie. — Influence de ces progrès sur la constitution des gouvernements. — II. Spécialisation des fonctions gouvernantes. — Substitution du régime des corporations à celui de la communauté. — III. Causes de la diversité des institutions politiques. — Le régime féodal. — IV. Mode économique de la formation des États dans l'ère de la petite industrie. — Les entreprises politiques.
I. Progrès qui ont déterminé l'avènement de la petite industrie. Influence de ces progrès sur la constitution des gouvernements.— Malgré les progrès récents des sciences préhistoriques, nous n'avons aucune notion positive sur la durée de la période primitive, qui va de la naissance de l'humanité à la création de l'outillage agricole et à la mise en culture régulière des plantes alimentaires. Cette durée a-t-elle été de quelques centaines ou de quelques milliers de siècles? Nous l'ignorons. En revanche, nous savons que l'humanité a travaillé incessamment à améliorer ses conditions d'existence, dans cette période comme dans les suivantes. Il lui a fallu apprendre à distinguer les plantes utiles d'avec les végétaux nuisibles, inventer des armes et des outils, asservir et dresser les animaux qui pouvaient être réduits à l'état de domesticité et lui servir d'auxiliaires ou augmenter ses ressources alimentaires, se confectionner des vêtements avec des peaux ou des plantes textiles, se creuser ou se bâtir des abris, enfin, chose plus difficile [24] peut-être, plier sa nature animale et sauvage aux nécessités de la vie en société. Les inventions qui nous paraissent aujourd'hui les plus simples, l'art de faire du feu par exemple, ont présenté des difficultés, dont on peut se rendre compte en étudiant les coutumes des peuplades primitives. Avant l'invention du «briquet)), invention qui suppose la connaissance de l'art de travailler les métaux, on ne possédait aucun moyen assuré de se procurer du feu. Que faisait-on? On entretenait d'une manière permanente celui que le hasard avait fait obtenir, en le mettant sous la protection des divinités de la tribu ou même en l'adorant comme une divinité, et en chargeant de ce soin les jeunes filles, moins propres que les garçons aux travaux de fatigue. Les pénalités effroyables auxquelles on condamnait les gardiennes négligentes qui laissaient s'éteindre le « feu sacré » n'attestent-elles pas toute la difficulté que l'on éprouvait à le rallumer? Combien la découverte des métaux et l'art de les travailler ont coûté d'observations et de peines! Mais aussi combien la substitution des armes en métal aux engins primitifs en bois ou en pierre a accru la productivité du travail du guerrier ou du chasseur! La domestication des animaux, en créant l'industrie pastorale, a augmenté dans des proportions plus considérables encore les ressources des peuplades progressives, et rendu leur subsistance moins précaire.
L'état d'éparpillement et d'hostilité où vivaient les troupeaux humains ne pouvait manquer de retarder la propagation du progrès. Chaque troupeau inventait son armement, son outillage, aussi bien que les coutumes qui constituaient la machinery grossière de son gouvernement, en se gardant d'en faire part aux troupeaux avoisinants; plus tard encore et jusqu'à une époque récente, chaque invention qui augmentait la puissance et la richesse d'une nation devint un « secret » qu'il était interdit, sous les pénalités les plus [25] sévères, de communiquer à l'étranger, c'est-à-dire à l'ennemi. La guerre était alors pour ainsi dire le seul moyen de propagation des inventions et découvertes. En dépit de tous les obstacles, celles-ci allaient néanmoins s'accumulant et se propageant. A la veille de l'avènement décisif de la création de l'outillage agricole et de la mise en culture des plantes alimentaires, les peuplades en possession d'un stock d'animaux domestiques et d'un armement perfectionné en pierre polie ou en métal se trouvaient certainement dans des conditions d'existence et de sécurité fort supérieures à celles des troupeaux primitifs. Des progrès correspondants s'étaient accomplis dans la société et le gouvernement. L'accroissement des ressources provenant des progrès de l'outillage et de l'accumulation des capitaux, sous forme de bétail ou autrement, avait permis notamment d'élever un plus grand nombre de femmes. Chaque homme avait pu en avoir une ou même plusieurs pour son usage exclusif, et cette appropriation individuelle de la femme était devenue une nouvelle source de bien-être et de richesse. La femme était une servante et les enfants pouvaient être employés de bonne heure à la garde et aux soins des troupeaux. Ceux qui en possédaient un surcroît les échangeaient contre des têtes de bétail, et c'a été, selon toute apparence, une des premières opérations d'échange. [5] Le troupeau est devenu un clan ou une tribu, le cercle de ses migrations s'étend en raison de l'augmentation de son capital, il peut s'établir dans les localités plus favorables au développement de ses ressources. A mesure que la richesse s'accroît, on voit s'accentuer aussi les inégalités de sa distribution. Auparavant, l'inégalité se manifestait plutôt de troupeau à troupeau. Les uns, appartenant à une race supérieure en intelligence et en vigueur, s'étaient [26] emparés des cantons de chasse les plus giboyeux ou les plus abondants en fruits naturels du sol, ils étaient riches, tandis que les troupeaux inférieurs, réduits à se contenter du rebut des autres, demeuraient dans une condition misérable. Mais, dans le même troupeau, les inégalités provenant des différences individuelles d'intelligence, de force et de courage ne pouvaient se consolider et s'accroître aussi longtemps que chacun était obligé de vivre au jour le jour. Ce fut seulement lorsque la capitalisation devint possible, c'est-à-dire lorsque les tribus progressives commencèrent à s'adonner à l'élève des troupeaux que les inégalités s'individualisèrent : les hommes les plus habiles dans l'exercice de la nouvelle industrie augmentèrent rapidement la quantité de leur bétail; tandis que d'autres, moins industrieux, n'en possédaient que quelques têtes, que d'autres encore n'en possédaient point et se trouvaient réduits à se mettre au service des grands éleveurs. Ceux-là étaient les « riches », et ceux-ci les « pauvres ».
Pendant cette dernière époque de la période des temps primitifs, le gouvernement à son tour subit l'influence des progrès du matériel productif et des changements qui en avaient été la conséquence dans la création et la distribution de la richesse. Les membres les plus riches de la tribu virent croître naturellement leur pouvoir; c'est parmi eux que l'on choisissait de préférence le chef, et lorsqu'une famille devint tout à fait prépondérante on s'accoutuma à le prendre dans son sein. On voit apparaître alors, dans les tribus les plus avancées, le gouvernement patriarcal combiné avec le régime de la communauté. La tribu germaine, par exemple, élisait son chef, en le prenant habituellement dans la même famille; mais ce chef ne pouvait rien entreprendre sans consulter les anciens de la tribu; [6] parfois, il était élu seulement pour la durée d'une expédition de guerre. Lorsque la tribu était en paix.il n'y avait point de gouvernement, ou pour mieux dire chacun exerçait, avec l'industrie pastorale dont il tirait sa subsistance, les fonctions gouvernantes; il gouvernait sa famille, jugeait dans sa propre cause lorsqu'il était ou se croyait offensé, et exerçait le droit de vengeance conformément à la coutume; [7] [28] enfin, il était tenu de contribuer, en proportion des forces et des ressources dont il disposait, à la défense commune. Lorsque l'état de guerre venait à reparaître, on se soumettait de nouveau à l'autorité redevenue nécessaire du chef et aux lois naturelles de la hiérarchie et de la discipline. Remarquons bien que les fonctions gouvernantes n'avaient point cessé d'être des charges, et qu'aucune rétribution n'était attachée aux fonctions du chef ou du roi. Il vivait comme les autres propriétaires de la tribu du produit de ses troupeaux. Tout au plus lui permettait-on de s'attribuer une part plus forte dans le butin pris sur l'ennemi. Le gouvernement de la tribu était gratuit, ce qui ne l'empêchait pas de constituer pour ceux qui y participaient une lourde charge. De même, lorsque chacun cultivait son blé, le broyait sous la meule et faisait son pain, on ne payait rien pour sa nourriture, mais elle n'en coûtait [30] pas moins plus cher qu'à l'époque où ces diverses opérations vinrent à être divisées et où l'on se mit à acheter son pain chez le boulanger.
II. Spécialisation des fonctions gouvernantes. Substitution du régime des corporations à celui de la communauté. — Comme toute division du travail, la spécialisation des fonctions gouvernantes a constitué un progrès, en ce sens que ces fonctions spécialisées devaient être mieux remplies et revenir moins cher qu'à l'époque où chacun était obligé de les exercer, concurremment avec l'industrie qui lui fournissait sa subsistance. Seulement ce progrès n'a pu s'accomplir que lorsque la productivité de l'industrie alimentaire s'est accrue de façon à procurer, outre la subsistance régulière de ceux qui exerçaient cette industrie, un surplus assez considérable, pour faire subsister un personnel spécialement adonné à la création de produits et de services que chacun était réduit auparavant à produire soi-même, d'une manière grossière insuffisante et intermittente, comme dans le cas du gouvernement ou qui ne pouvaient être produits, comme dans le cas des articles de confort ou de luxe.
C'est la création du matériel agricole et la mise en culture régulière des plantes alimentaires qui a déterminé, avec l'accroissement énorme de la population et de la richesse, ce progrès de la machinery du gouvernement et substitué, dans l'organisation politique aussi bien que dans l'organisation économique des sociétés, le régime des corporations à celui de la communauté.
Comment cette évolution s'est-elle accomplie? On peut essayer de la reconstruire en analysant les nécessités qui naissaient de ce nouvel état des choses. Les témoignages historiques s'accordent pour attribuer la création du matériel de la petite culture et de la petite industrie aux tribus habitant la zone tempérée du continent asiatique. En [31] descendant vers le midi et en suivant le cours des grands fleuves, on trouvait, avec un climat plus doux, des terrains d'alluvion d'une fertilité extraordinaire. Cette direction paraît, en effet, avoir été généralement celle que suivirent les tribus en possession du nouveau matériel ou la portion aventureuse de ces tribus. [8] N'oublions pas que ces migrations étaient déjà auparavant un fait habituel, avec cette seule différence que le rayon dans lequel elles avaient lien était limité, parce que les ressources étaient moindres: [9] [32] lorsque les tribus demandaient leur subsistance à la chasse, elles allaient à la recherche des cantons les plus giboyeux; lorsqu'elles la demandaient à l'élève du bétail, elles émigraient vers les régions à pâturages. Il était naturel qu'elles se missent de même en quête des régions les plus propres à l'agriculture. Mais jusqu'alors leurs migrations avaient eu pour conséquence nécessaire l'extermination ou l'expulsion des troupeaux humains établis sur les territoires qu'elles allaient occuper. Cette nécessité se modifia par suite de l'invention du nouveau matériel agricole. Comme il fallait pour mettre ce matériel en œuvre non seulement des bêtes de somme, mais encore une proportion considérable de travail humain, adapté au climat, il devint plus avantageux d'asservir les peuplades vaincues que de les détruire. Sous ce rapport, la situation des tribus émigrantes pourvues du nouveau matériel peut être assimilée à celle des Européens, conquérants du nouveau monde. Après avoir dépouillé, à la mode barbare, les populations autochtones de toutes les richesses qu'ils pouvaient emporter, ils entreprirent d'exploiter les abondantes ressources naturelles, d'où ces richesses étaient tirées. Seulement cette exploitation ne pouvait être entreprise d'une [33] manière profitable qu'avec l'auxiliaire de bras nombreux et adaptés au climat. Que fit-on? On y assujettit d'abord les populations conquises, et comme elles ne purent résister aux travaux excessifs et aux traitements inhumains auxquels on les soumettait, on les remplaça par des esclaves, importés d'Afrique. Les choses ont dû se passer de la même manière lorsque les tribus progressives de race aryenne eurent fait la découverte et la conquête des régions méridionales de l'Asie et de l'Europe, et c'est ainsi que le progrès agricole a engendré l'esclavage en le rendant productif.
Il a engendré aussi le régime des castes ou des corporations gouvernantes. La mise en culture de contrées vierges, au moyen d'un matériel agricole desservi par des esclaves, donnant un énorme produit net, la population et la richesse devaient s'accroître dans une progression extraordinairement rapide. On vit alors s'établir de vastes et puissants empires contenant une population cent fois supérieure à celle que pouvaient faire subsister auparavant sur le même territoire les industries rudimentaires de la chasse et de la récolte des fruits naturels du sol. Ces établissements politiques appartenaient aux émigrants, pourvus du nouvel outillage, qui les avaient fondés en vue de les exploiter, en asservissant et en dressant aux travaux agricoles et industriels la population autochtone, et qui s'en réservaient naturellement, à titre de propriétaires, la direction et les profits.
C'est ainsi que l'appropriation de l'État politique à une classe, issue presque toujours d'une race étrangère et supérieure, remplaça la communauté primitive. Mais le changement provoqué dans la constitution politique des sociétés par l'invention de l'outillage agricole et l'avènement de la petite industrie ne devait pas s'arrêter là.
III. Causes de la diversité des institutions politiques. Le [34] régime féodal. — Relativement peu nombreux, obligés de se disséminer sur un vaste territoire, obligés encore de maintenir leurs esclaves ou leurs sujets dans l'obéissance et de protéger leur domaine contre les convoitises des autres tribus, avides de butin, les conquérants, fondateurs d'Etats ne pouvaient plus se contenter de l'organisation rudimentaire de la tribu. Cette organisation qui était adaptée à de petites sociétés composées de quelques centaines ou de quelques milliers d'individus, vivant de la même industrie, pouvait-elle encore suffire à de grandes sociétés, dont les membres se comptaient par millions, appliqués à des travaux variés, et parmi lesquels les conquérants ne formaient qu'une faible minorité? Ne fallait-il pas que les institutions politiques de la tribu se modifiassent, en vue de pourvoira ces nécessités nouvelles? Ce progrès ne manqua pas de s'accomplir, sous l'influence de la force irrésistible des choses, mais il ne s'accomplit point d'une manière uniforme et tout d'une pièce. Le mode de constitution et d'organisation des États que l'avènement de la petite industrie fit succéder aux tribus vivant, de la chasse et de l'élève des troupeaux dépendit, en premier lieu, de la condition politique des tribus dont ils étaient issus; en second lieu, des circonstances particulières de sol, de climat, de configuration physique et de situation géographique des régions où ces États se constituèrent. Nous avons remarqué que tantôt le pouvoir effectif avait fini par se concentrer dans la famille la plus nombreuse, la plus riche et par conséquent la plus puissante de la tribu, tantôt dans un certain nombre de familles, tantôt enfin, dans les tribus où la distribution de la richesse était demeurée plus égale, que ce pouvoir était resté en quelque sorte indivis parmi tous les membres de la communauté. Il est clair que la transformation politique déterminée par le nouvel état des choses devait porter l'empreinte de la condition politique [35] antérieure de la tribu conquérante; qu'elle devait s'opérer ici dans le sens monarchique, là dans le sens aristocratique, ailleurs dans un sens démocratique. Cependant une nécessité supérieure, — celle qui dérivait principalement de la situation ethnographique de la région où l'Etat se fondait, de l'étendue de l'État etdes risques auxquels il était exposé, — finissait toujours, après une période de tâtonnement plus ou moins longue, par déterminer son mode délinitit' de constitution, soit que ce mode s'accordât avec les précédents politiques de la tribu, soit qu'il les contrariât.
Mais avant d'arriver au mode de constitution politique approprié à leurs conditions d'existence, les Etats issus de la conquête, dans les premières époques de l'âge de la petite industrie, ont passé invariablement par une période de formation aristocratique et féodale. Chez les uns, ce mode de constitution est devenu définitif tout en se modifiant conformément aux tendances primitives des tribus conquérantes, et il a donné naissance à des républiques plus ou moins aristocratiques; chez les autres, il a abouti à des monarchies plus ou moins absolues.
Cette période de formation qui présente partout des caractères identiques dérivait des nécessités, partout idenques aussi, de la conquête.
Une conquête est une entreprise comme une autre, et les hommes qui s'associent pour s'y livrer ont en vue les bénéfices qu'elle peut procurer. C'est aussi une entreprise qui a ses conditions spéciales et ses procédés techniques, soit qu'il s'agisse de la conquête proprement dite ou de la conservation et de l'exploitation de la population et du territoire conquis. La conquête exige la constitution préalable d'une armée avec sa hiérarchie et sa discipline nécessaires, un matériel, des approvisionnements et quelques notions de stratégie et de tactique chez ceux qui la dirigent. A l'origine, cette armée est [36] invariablement constituée comme une société en participation. Chacun prend part à l'entreprise en vue du butin, et, ce butin conquis, chacun en reçoit un lot proportionné à son apport et à l'importance de ses services. C'est seulement plus tard, lorsque la richesse s'est accrue et inégalisée en s'accroissant, que les chefs de l'entreprise rétribuent leurs ouvriers, soit en leur fournissant la subsistance et l'entretien en nature, soit en leur allouant une solde en argent, à laquelle vient s'ajouter toutefois jusqu'à une époque récente une part, mais beaucoup plus faible et simplement accidentelle, dans le butin. Le résultat atteint, la conquête faite, le partage s'opère suivant les règles dont l'expérience a démontré l'utilité et qui ne diffèrent point de celles qu'une expérience analogue a fait adopter dans les autres entreprises. Alors apparaît la nécessité d'assurer la conservation et l'exploitation des fruits de la conquête, lesquels consistent principalement en terres, en habitations et en esclaves. Cette seconde opération a aussi sa technique, composée d'un ensemble de procédés adaptés au but à atteindre et que l'expérience révèle. L'organisation féodale est le produit de cette science, ou plutôt de cet empirisme technique de la conquête. Elle est en effet, comme on va le voir, le mode de constitution naturel d'un Etat issu de la conquête, sous le régime de l'association en participation, c'est-àdire avant l'institution des armées soldées.
Après une opération de partage, souvent laborieuse et féconde en querelles, surtout quand les divinités et leurs ministres manquent du prestige nécessaire pour régler les parts et prévenir les réclamations, chacun entre en possession de sa part, grande ou petite, du butin mobilier et immobilier. Il s'agit maintenant de la garantir contre tout risque de dépossession générale ou particulière provenant des révoltes et des agressions intérieures ou des invasions du dehors. Comment va s'organiser cette assurance, [37] d'autant plus indispensable que les risques sont plus nombreux et plus pressants? Elle s'organise simplement par l'application du mécanisme de l'instrument de la conquête à cette œuvre complémentaire. Au lieu de se dissoudre, l'armée conquérante demeure organisée en permanence. Cette permanence est obtenue au moyen d'une série d'obligations imposées aux bénéficiaires co-parlageants de la conquête, et dont l'ensemble constitue le code féodal. Les obligations militaires sont rendues héréditaires ct elles demeurent attachées, à perpétuité, à la possession des domaines partagés. Des précautions indispensables sont prises pour empêcher ces domaines, qui garantissent l'exécution des obligations requises pour la sécurité commune, d'être morcelés ou aliénés. Si les co-participants de la conquête étaient, en effet, demeurés libres de disposer à leur gré de la portion immobilière de leur butin, ils auraient probablement partagé leurs domaines entre leurs enfants, en introduisant ainsi une cause de désordre et de dissolution dans la hiérarchie; il aurait pu arriver même que ces domaines passassent par voie d'aliénation ou autrement entre des mains ennemies. Ou prévint ces causes d'affaiblissement et de dissolution de l'instrument de défense, en rendant inaliénables, indivisibles et insaisissables, les domaines grevés d'obligations militaires et en imposant à leurs titulaires l'obligation de les transmettre de mâle en mâle par ordre de primogéniture. De plus, à chaque décès des occupants, l'héritier dut recevoir l'investiture de son chef hiérarchique, et s'il existait contre lui quelque cause d'exclusion, motivée par son incapacité ou son indignité, le domaine était alloué à un autre, réputé plus capable de s'acquitter des obligations qui y étaient attachées. L'organisation militaire nécessaire à la conservation des fruits de la conquête pouvait ainsi se perpétuer à travers les générations successives, en constituant une véritable société [38] d'assurance mutuelle. [10] A côté et au-dessous de cette armée transformée, par les nécessités de la défense commune, en une corporation permanente, on voit se former sur le même modèle, et en vue d'un objet analogue, toute une série d'autres corporations. Les prêtres, qui remplissent les fonctions religieuses et civiles ou qui exercent les professions libérales de la société nouvelle, et auxquels une part du butin mobilier et immobilier a été allouée en reconnaissance de la protection des divinités dont ils sont les mandataires, forment une autre corporation égale, parfois même supérieure à celle des hommes de guerre. Au-dessous de ces deux corporations politiques qui se partagent la propriété du domaine immobilier et le gouvernement de l'Etat, on voit apparaître les corporations de métiers dans lesquelles se casent les hommes impropres à la guerre et aux fonctions dirigeantes, qui n'ont point obtenu de part dans la distribution des domaines, et qui vivent de l'exercice des industries inférieures. Ils se constituent en sociétés particulières, en vue de la protection de leur métier ou de leur commerce et des biens qu'il leur permet d'acquérir, et ces sociétés, ces castes ou ces corporations, se multiplient et croissent en importance à mesure que l'augmentation de la productivité de l'industrie humaine, et spécialement de l'industrie alimentaire, détermine une extension plus grande et une ramification plus étendue de la production. Au-dessous de la société conquérante, ainsi partagée en corporations ou en castes, apparaît la multitude assujettie, qui forme le cheptel du domaine conquis.
Cette organisation ne s'est évidemment pas établie d'emblée sur un plan préconçu; elle s'est faite peu à peu à mesure que se manifestaient les nécessités auxquelles elle devait pourvoir. C'est seulement lorsque des révoltes [39] intérieures ou des invasions du dehors ont montré aux conquérants le danger de se disséminer sur le territoire conquis, en laissant se relâcher les liens de leur association, qu'ils cherchent les moyens les plus propres de parer à ce danger et qu'ils rendent permanente pour l'occupation l'organisation hiérarchique à laquelle ils avaient dû s'astreindre pour la conquête. Ce qui prouve que la constitution féodale dérivait naturellement des nécessités de cette sorte d'entreprises, dans la période qui a suivi la naissance de la petite industrie, c'est qu'on la retrouve, avec de simples différences de formes et d'apparences, dans toutes les régions ou des tribus conquérantes ont fondé des Etats, en réduisant en servitude les populations autochtones. Partout elles forment des corporation s pl us ou moins étroitement hiérarchisées, partout le gouvernement est entre les mains d'une « société » de guerriers, alliée à une « société » de prêtres, à moins que ces deux associationsne se trouvent confondues; au-dessous s'étagent, suivant leur importance, les corporations de métiers, puis viennent les esclaves et les serfs, appliqués aux fonctions inférieures de la production agricole et industrielle. Ces diverses corporations sont constituées uniformément en vue de la protection mutuelle de la vie, dela propriété et de l'industrie de leurs membres. Les corporations de métiers ne diffèrent des autres ni dans leur but ni dans le mode d'organisation qu'elles adoptent pour l'atteindre. Il n'y a, pourrait-on dire, entre ces deux catégories d'associations qu'une différence de degré. Les corporations de métiers ne sont pas exposées comme les corporations politiques à un risque incessant de dépossession et de destruction; elles ont simplement à se protéger contre les empiètements de leurs quasi-similaires et à faire leur police intérieure. Elles ne sont pas obligées en conséquence de se soumettre à des obligations aussi étroites et à une discipline aussi rigide, quoiqu'on retrouve dans [40] leur organisation la plupart des traits qui caractérisent celle des corporations politiques.
De même, les inégalités d'importance et de pression des risques intérieurs et extérieurs, auxquels étaient exposés les États issus de la conquête, déterminent les différences de leur constitution politique.
Dans une région étendue et ouverte , où l'exploitation de riches terrains d'alluvion permettait à la population et à la richesse de se multiplier rapidement, où, en même temps, les conquérants étaient exposés plus qu'ailleurs aux convoitises des tribus ou des nations pauvres et avides de butin, qui occupaient des régions moins favorisées, la monarchie, autrement dit la dictature héréditaire d'un chef d'armée avec une hiérarchie fortement organisée et strictement obéissante, apparaissait comme la forme nécessaire de la constitution politique de l'État. Il en était autrement dans les régions montueuses, où les terres étaient moins fécondes et le climat plus rude. La tribu qui s'établissait dans une de ces régions d'un accès difficile avait moins à craindre le danger des invasions. Les révoltes de la population assujettie y étaient aussi moins à craindre, cette population, occupée aux travaux inférieurs de la production, ne pouvant s'y multiplier autant que dans les terres basses et chaudes. C'est pourquoi, tandis que la forme monarchique prévalait d'une manière définitive dans les grands États de la Chine, des deux péninsules de l'Inde, de la Mésopotamie et de l'Egypte; en Italie et en Grèce, les tribus conquérantes cessèrent, la conquête faite, de sentir la nécessité d'une dictature permanente; elles se débarrassèrent de leurs rois et constituèrent leurs États sous la forme d'une oligarchie plus ou moins rapprochée de la démocratie, selon que la richesse et la puissance qu'elle a conférées de tous temps étaient plus ou moins également partagées. Elles ne recouraient à un dictateur, c'est-à-dire à un roi [41] temporaire, que lorsque la nécessité s'en faisait de nouveau sentir, dans les moments d'extrême péril, quand il fallait que la « société » en possession de l'État se soumît à un chef, comme une armée obéit cà son général et l'équipage d'un navire à son commandant, en vue du salut commun.
De là encore des différences considérables dans la condition de la classe gouvernante et possédante des Etats, surtout au point de vue intellectuel et moral.
Dans une république aristocratique ou démocratique, la classe en possession de la souveraineté jouit d'une somme d'indépendance et de liberté supérieure à celle qui lui est laissée dans un État monarchique, où la souveraineté est concentrée entre les mains d'un roi ou d'un empereur. D'un autre côté, le personnel politique et administratif est recruté par voie d'élection dans un État aristocratique ou démocratique, et surveillé par les électeurs, tandis que dans un Etat monarchique il est nommé et surveillé par le monarque ou par ses mandataires. Sans doute, on ne saurait dire que l'élection par plusieurs et surtout par un grand nombre soit un mode de sélection intrinsèquement supérieur à la nomination par un seul; mais quand une classe est investie du pouvoir d'élire et de contrôler ceux qui gouvernent et administrent l'État, les facultés dirigeantes et les aptitudes politiques de cette classe acquièrent un développement auquel elles ne peuvent atteindre dans un État où l'exercice de la souveraineté appartient à un seul homme. Les sciences morales et politiques sont nées et ont grandi au sein des républiques grecques, et il est douteux qu'elles eussent réalisé des progrès analogues sous un régime monarchique. Ce qui semble l'attester, c'est que le développement des sciences et des arts politiques s'est arrêté aussitôt que les oligarchies républicaines qui gouvernaient les petits États de la Grèce eurent perdu le pouvoir souverain.
En revanche, la diffusion de la souveraineté était moins [42] favorable que sa concentration à la population assujettie et même aux classes simplement exclues des fonctions politiques. Sans doute, une monarchie absolue peut devenir très lourde, mais le monarque n'a aucun intérêt à sacrifier les faibles et les pauvres aux ricbes et aux puissants. Au contraire! il est intéressé plutôt à empêcher la classe aristocratique d'acquérir un ascendant dont elle pourrait être tentée de faire usage pour le déposséder. C'est pourquoi il s'appuie de préférence sur le grand nombre, et c'est ainsi que s'expliquent l'impopularité des oligarchies républicaines et la popularité de la monarchie ou du césarisme.
On remarquera que dans tous les grands États de l'antiquité où les nécessités de la sécurité et de la conservation de l'établissement politique fondé par la conquête avaient imposé le régime de la monarchie, c'est-à-dire de la dictature permanente et héréditaire, ce régime s'est perpétué. Les conquérants succédaient aux conquérants, mais les nécessités dérivant de l'occupation demeurant les mêmes, il fallait bien recourir au régime qui s'y trouvait le mieux adapté. Les Etats constitués sous la forme d'oligarchies républicaines dans le bassin de la Méditerranée ont eu une autre destinée. Aussi longtemps que ces Etats n'ont possédé qu'un petit territoire et des frontières faciles à défendre, leur constitution oligarchique et féodale apu subsister, avec des intermittences de dictature dans le moment d'extrême péril; mais lorsque le plus puissant de ces établissements politiques eut absorbé tous les autres, lorsque l'Etat romain eut englobé la plus grande partie du monde civilisé, et que d'un autre côté, cet immense Etat, formé d'éléments hétérogènes, se trouva continuellement en butte aux agressions des barbares, la dictature dut devenir permanente, d'intermittente qu'elle était auparavant, et l'empire succéda à la république.
Mais tous ces États, quelle que soit la forme de leur [43] constitution, ont doux caractères communs qui différencient essentiellement leur organisation politique de celle des tribus auxquelles ils ont succédé, savoir : l'appropriation exclusive du gouvernement à une classe particulière do la société et la spécialisation des fonctions gouvernantes. L'État n'est plus, — comme il Tétait dans la tribu, —la chose de la communauté entière, et ses membres cessent de combiner l'exercice gratuit des fonctions gouvernantes avec l'industrie qui leur fournit la subsistance. L'État appartient à l'association qui l'a fondé et qui se constitue comme une corporation permanente, avec une hiérarchie et une discipline plus ou moins étroites, selon le tempérament et la condition de ses différents membres, selon encore l'importance et l'imminence des risques qui menacent l'État. Les membres de l'État se partagent les fonctions gouvernantes, qu'ils exercent le plus souvent à l'exclusion de toute autre industrie, et qui leur fournissent leurs moyens d'existence. En d'autres termes, l'État a passé du régime de la communauté et des fonctions gratuites à celui des corporations et des fonctions spécialisées et rétribuées.
§ IV. Mode économique de la formation des Etats dans l'ère de la petite industrie. Les entreprises politiques. —
Insistons encore sur la cause première et déterminante de cette transformation capitale et sur la manière dont elle a agi.
Cette cause réside, comme nous l'avons vu, dans l'avènement de la petite industrie et, en particulier, dans la création du matériel agricole et la mise en culture régulière des plantes alimentaires. Jusque-là les fonctions politiques avaient été gratuites, car l'insuffisance de la productivité de l'industrie qui pourvoyait aux premières nécessités de la vie ne permettait pas d'en rétribuer d'autres. Au lieu d'être une source de profits, elles constituaient une charge, dont chacun des membres de la communauté devait supporter [44] sa part. Mais, à l'avènement de la petite industrie, la situation change du tout au tout. Au lieu de pourvoir seulement à la subsistance de celui qui s'y livre, la production alimentaire donne un surplus, parfois considérable. L'existence de ce surplus permet aussitôt de rétribuer des industries qui ne pouvaient pas l'être auparavant. Ces industries ne manquent pas de naître et de se multiplier à mesure que le matériel et les procédés de la production se perfectionnent et que la productivité du travail de l'homme augmente en conséquence.
Comment les fonctions politiques se séparent-elles alors de l'industrie alimentaire à laquelle elles étaient jointes, pour constituer une branche de travail subsistant par ellemême? Toute industrie nouvelle se crée sous la forme d'entreprises, soit qu'elle se sépare d'une autre, soit qu'elle naisse tout d'une pièce, d'un progrès de la machinery de la production. Du moment où elle peut donner un profit supérieur à celui que procurent les branches de travail déjà existantes, il se trouve des hommes prêts à l'entreprendre, en y appliquant les forces et les ressources dont ils disposent. Telle a été l'origine des entreprises politiques comme de toutes les autres. Aussi longtemps que les hommes n'ont possédé que des instruments et des procédés rudimentaires pour se procurer la subsistance, leurs entreprises ont eu uniquement pour objet la recherche ou la capture des aliments. Ces entreprises se réduisaient à des expéditions de chasse ou de guerre, celles-ci engagées en vue du pillage des provisions accumulées par d'autres ou de l'anthropophagie. Mais du moment où ils ont été en possession d'une machinery plus productive, la carrière ouverte à l'esprit d'entreprise s'est agrandie. Les hommes les plus industrieux ont entrepris l'élève des troupeaux et plus tard la culture des plantes alimentaires, avec quelques industries accessoires, la confection des vêtements, la fabrication des armes [45] et des outils. Toutefois ces nouvelles branches de travail que le progrès faisait pousser demeuraient associées aux anciennes. Les tribus en voie de progrès continuaient à s'adonner à la pratique du pillage, quand elles croyaient y trouver profit. De nos jours encore ne voyons-nous pas des peuples plus ou moins industrieux et civilisés, en Afrique et ailleurs, exécuter des razzias sur les terres de leurs voisins? La fondation des Etats politiques n'a été qu'un développement du système des razzias, à une époque où l'invention du matériel agricole avait augmenté, dans une proportion extraordinaire, la productivité de l'industrie alimentaire. Du moment où cette branche maîtresse de la production devenait assez féconde pour donner un surplus, les frais d'entretien et de renouvellement du personnel et du matériel agricoles étant couverts, il devenait avantageux de remplacer la simple razzia par une exploitation permanente des terres et du travail qui fournissaient le butin. En d'autres termes, on pouvait, en entreprenant cette exploitation, obtenir avec moins de peine un profit supérieur à celui que procurait la pratique ordinaire du pillage. On ne s'associa donc plus seulement en vue de faire des incursions et d'exécuter des razzias dans le domaine des autres tribus, on s'associa en vue de conquérir des terres, propres à l'agriculture, avec leur cheptel d'hommes et d'animaux domestiques, et de tirer un profit permanent et régulier de leur exploitation. Comment pouvait-on recueillir ce profit? Le moyen le plus expéditif et le plus simple consistait à réduire en esclavage la population qui meublait le sol, à la dresser à la pratique de l'agriculture si elle n'y était point déjà dressée, et à s'emparer du surplus ou du produit net de l'exploitation. Ce surplus ou ce produit net constituait la rétribution de l'industrie des fondateurs d'Etat, ou le profit de leurs entreprises. Dans les régions fertiles où la population était nombreuse et facile à plier au travail [46] et à l'obéissance, les entreprises de ce genre procuraient aux entrepreneurs, associés en participation, des bénéfices assez élevés pour les dispenser d'exercer d'autres industries. Dans les contrées moins favorisées, où la population asservie était moins nombreuse et plus difficile à plier au joug, les fondateurs de l'Etat étaient fréquemment obligés de diriger eux-mêmes l'exploitation du lot qui leur était échu en partage, parfois même de conduire la charrue ou d'exercer quelque autre industrie. Tel fut le cas à Athènes et àRome, avant que celle-ci n'eût multiplié ses acquisitions. Quoi qu'il en soit, les fondateurs d'État trouvaient la rémunération de leur industrie dans le produit de l'exploitation du domaine qu'ils avaient conquis et de son cheptel d'habitants réduits en servitude, et, grâce à l'invention du matériel agricole, ce produit, qui eût été nul avec l'outillage primitif, devint assez considérable pour rendre l'industrie de la conquête et de la fondation des Etats, la plus productive de toutes les branches du travail humain. C'était aussi, à la vérité, celle qui comportait le plus de risques, car il fallait non seulement gouverner et administrer les domaines conquis, mais les défendre contre des concurrents d'autant plus âpre à la curée que la proie était plus riche et qu'ils étaient plus pauvres.
Le taux de la rétribution de l'industrie des fondateurs d'États ou des conquérants qui parvenaient à les expulser et à prendre leur place dépendait, en premier lieu, de la fécondité du sol, des qualités industrieuses de la population qui le mettait en valeur, de la bonne organisation et de la gestion intelligente des exploitations agricoles et industrielles appartenant aux fondateurs ou aux maîtres de l'État, de l'efficacité de la protection des personnes et des propriétés contre toute agression intérieure ou extérieure; en second lieu, de la proportion qu'ils s'attribuaient dans le produit des exploitations. Cette proportion qu'ils étaient les maîtres de fixer à [47] leur guise, ils devaient naturellement s'attacher à la porter au maximum en ne laissant ainsi à la population assujettie qu'un minimum de subsistances. Telle a été, en effet, de tous temps leur tendance, dependant, cette tendance ne tarda pas à être combattue et, en partie, neutralisée par l'expérience de ses effets nuisibles. La population surmenée et surchargée se décourageait et s'affaiblissait quand elle ne se révoltait point, et le taux des redevances qu'on exigeait d'elle finissait par diminuer en raison même de leur exagération. Sous l'influence de cette expérience, et, comme nous le verrons plus loin, de la pression de la concurrrence politique, on vit s'établir successivement un ensemble de coutumes et de garanties limitatives du pouvoir discrétionnaire des maîtres de l'État. Grâce à ces coutumes et à ces garanties, du moins dans les pays où elles eurent une efficacité suffisante, la classe possédante et gouvernante dut se contenter d'une part plus modérée dans le produit du travail des classes assujetties, et celles-ci purent croître à la fois en nombre et en richesse. Peu à peu elles se rachetèrent de la servitude, et elles acquirent même une portion de plus en plus grande du sol qui avait été primitivement la propriété exclusive des conquérants. Alors elles prétendirent entrer en partage du pouvoir politique avec la classe gouvernante, et plus leurs industries se développaient grâce aux progrès de la machinery de la production, plus elles devenaient riches et puissantes, plus aussi leur compétition devenait redoutable pour les descendants de l'ancienne société des fondateurs ou des conquérants de l'État. C'est dans la seconde période de l'âge de la petite industrie qu'elles ont commencé à arriver à leurs fins et à jouer un rôle politique.
[48]
CHAPITRE III.
Les gouvernements de la petite industrie (suite)↩
I. Mobile déterminant des entreprises politiques dans l'ère de la petite industrie. Le profit. Conquête de l'Angleterre par les Normands. — II. La constitution et l'organisation de l'État. — 111. L'agrandissement de l'État. — IV. L'exploitation de l'État. — V. La politique g i". La politique extérieure § 2. La politique intérieure. — VI. Résumé des nécessités qui ont déterminé la constitution et la politique des États. La concurrence politique.
I. Mobile déterminant des entreprises politiques dans 1ère de la petite industrie. Le profit. Conquête de l'Angleterre par les Normands. — A dater de l'avènement de la petite industrie, la fondation d'un Etat politique est devenue une entreprise profitable, et même plus profitable qu'aucune autre. C'est pourquoi les entreprises de ce genre, malgré les risques qui y étaient attachés et dont l'élévation expliquait et justifiait celle de la prime nécessaire pour les couvrir, c'est pourquoi, disons-nous, ces entreprises ont été, pendant une longue série de siècles, le -débouché préféré de la portion la plus énergique, la plus forte et la plus intelligente de notre espèce. Cherchez dans la période qui s'ouvre à l'avènement de la petite industrie l'origine de tous les États, fondés n'importe sous quelle forme, monarchique ou républicaine, et vous trouverez une entreprise. Vous observerez aussi que cette entreprise politique n'a comme toutes ses congénères agricoles, industrielles ou commerciales d'autre mobile et d'autre objet que le profit. A l'appel d'un homme ou d'un [49] groupe d'hommes qui ont conçu le projet de fonder un nouvel État, on voit se rassembler des auxiliaires plus ou moins nombreux, recrutés dans une ou plusieurs tribus, peuplades ou nations, les uns munis de provisions, d'armes et de munitions de guerre, les autres n'apportant que leurs bras vigoureux, ceux-là arrivant isolément, ceux-ci par bandes, et formant de petites associations en participation, tous attirés par l'appât du gain. Après avoir réuni le matériel et les approvisionnements nécessaires, l'entrepreneur ou les entrepreneurs associés organisent une armée avec le personnel qu'ils ont rassemblé en le soumettant à la hiérarchie et à la discipline qu'exige ce genre d'entreprise : ils envahissent la contrée dans laquelle ils ont jugé avantageux de fonder leur établissement, ils en massacrent ou en asservissent les habitants, s'emparent de leurs terres et de leurs autres biens mobiliers ou immobiliers, et partagent ce butin entre eux et leurs auxiliaires, en proportion de l'apport de chacun et de l'importance des services rendus dans l'œuvre de la conquête. Si la contrée envahie est déjà le siège d'un Etat, dont les propriétaires leur opposent une résistance énergique, et s'ils ne se sentent pas assez forts pour surmonter entièrement cette résistance, ou s'ils jugent qu'elle leur coûterait des sacrifices hors de proportion avec le résultat à atteindre, ils transigent avec les anciens occupants et se contentent de faire main basse sur une partie de leurs domaines; parfois même ils fusionnent avec eux, en les admettant à titre de co-participants dans leur Etat. Cette transaction, les vaincus finissent communément par se résigner à l'accepter, et souvent ils y trouvent leur avantage. Si elle les prive d'une partie de leurs biens et de leurs profits, elle en rend la possession plus assurée, en leur adjoignant des coopérateurs plus capables qu'ils ne l'étaient eux-mêmes de les défendre et de les accroître. Quand, au contraire, la [50] résistance est faible, et surtout si les envahisseurs sont nombreux, ils s'emparent de tous les biens mobiliers et immobiliers et asservissent purement et simplement la population vaincue. [11]
[51]
Mais la conquête, avec la répartition de ses fruits entre ceux qui l'ont entreprise ou qui y ont participé n'est que [52] la première partie de l'œuvre de la fondation d'un État politique. La seconde consiste à le défendre soit contre les [53] revendications des vaincus dépossédés ou les usurpations des co-partageants, soit contre les agressions extérieures, [54] et, autant que possible, à l'agrandir. Enfin, la troisième consiste à l'exploiter de manière à en tirer, avec les [55] ressources nécessaires pour couvrir les frais de défense et de gestion, le profit le plus élevé possible.
[56]
Telles sont les « nécessités » inhérentes à la fondation et à l'exploitation d'un établissement politique; elles s'imposent aux fondateurs et aux exploitants de cette sorte [57] d'entreprise, et ils s'efforcent, sous l'impulsion de leur intérêt, de chercher les meilleurs moyens d'y pourvoir; elles déterminent, en dernière analyse, le mode de constitution et d'organisation des États, leur régime politique, aussi bien que leurs institutions économiques et fiscales.
II. La Constitution et l'organisation de l'État. — Le mode primitif de constitution d'un Etat dépend d'abord, comme nous l'avons remarqué, de la manière dont a été formée et conduite l'entreprise à laquelle il doit sa fondation. Si cette entreprise a eu pour promoteur et pour chef un homme d'une grande valeur personnelle et appartenant à une famille puissante, si ce chef a de nombreux parents sous sa dépendance et une foule de serviteurs à ses gages, il se fera la part du lion dans le partage du pays conquis et il exercera sur la constitution de l'Etat une influence prépondérante. De plus, si le nouvel établissement a une vaste étendue, et s'il est particulièrement exposé au risque des invasions, l'autorité se concentrera naturellement entre les mains du chef, sous la pression des nécessités de la défense. Si, au contraire, l'entreprise B. été faite, à frais communs, par des hommes à peu près égaux en valeur et en situation, la constitution de l'Etat sera plutôt oligarchique ou même démocratique, surtout si le pays conquis n'a qu'une faible superficie et s'il se trouve, par sa situation géographique, dans une certaine mesure à l'abri des invasions. Mais, en définitive, c'est toujours l'étendue et l'intensité des risques auxquels un état est exposé qui déterminent sa constitution, et les changements qu'elle subit.
Lorsque la conquête avait été effectuée et l'Etat fondé par une société en participation, et tel était le cas le plus fréquent avant que les chefs d'entreprise eussent accumulé des capitaux suffisants pour salarier leurs auxiliaires, les membres de l'association se partageaient les domaines [58] conquis, les gouvernaient et les exploitaient à leur guise, sauf à remplir les obligations nécessitées par la défense commune et à se soumettre aux ordres du chef élu ou héréditaire de leur hiérarchie. Ce chef, duc, [roi ou empereur n'exerçait sur eux aucun pouvoir, en dehors des nécessités de la défense, il vivait comme eux du produit du domaine qui lui était échu en partage et il ne pouvait lever sur les autres domaines que les subsides consentis par leurs propriétaires pour subvenir aux frais de répression d'une révolte, repousser une invasion ou agrandir l'État au profit de tous. Ce chef, disons-nous, était élu ou héréditaire. Les premières associations conquérantes, suivant en cela la coutume des tribus dont elles étaient issues, élisaient communément leur chef, et, à sa mort, elles lui choisissaient de même un successeur. Cependant, l'expérience des désordres et des périls qu'entraînaient, pour l'association, les compétitions entre les familles les plus puissantes avait fini par introduire la coutume de prendre le chef dans la même famille, la plus illustre, celle qui était réputée descendre des Dieux ou qui était désignée par eux. Enfin, des maux analogues provoqués par les compétitions qui surgissaient au sein de la famille élue conduisirent à l'adoption du principe d'hérédité. Toutefois, lorsque l'hérédité donnait des résultats nuisibles, en plaçant à la tête de la hiérarchie politique et militaire une série d'individualités incapables, on revenait à l'élection, sauf à recourir de nouveau, quand on avait expérimenté encore une fois les inconvénients de l'élection, à la pratique de l'hérédité. Les choses se passèrent de la même façon pour le règlement des droits de succession. Dans les États issus de la conquête germanique, les coutumes des tribus furent appliquées d'abord à la transmission des domaines politiques : on-les partagea d'une manière égale entre les enfants, comme on partageait les biens du chef de famille [59] au sein de la tribu; mais, à la longue, on ne manqua pas de s'apercevoir que ces partages étaient une source inépuisable de querelles et de luttes qui affaiblissaient l'Etat, en substituant à un commandement unique, des commandements morcelés et rivaux. On institua le droit d'aînesse qui remédia aux inconvénients du partage des successions, et les substitutions qui empêchèrent les propriétaires des domaines politiques de les aliéner. [12]
On peut observer la plupart des phénomènes que nous venons de décrire dans la formation des Etats modernes et notamment dans celle de la France. Lorsque l'empire romain succomba sous l'effort des Barbares, la Gaule fut d'abord envahie et mise au pillage par des bandes venues de la Germanie et même de l'Asie. Quelques-unes, les Alains, les Suèves, les Vandales passèrent ensuite en Espagne et en Afrique; d'autres telles que les Burgondes et les Franks s'y établirent, en vue d'exploiter le capital [60] immobilier qu'ils ne pouvaient emporter. Les Burgondes s'emparèrent des deux tiers des terres et d'un tiers des esclaves. On n'a pas de données certaines sur la part que s'attribuèrent les Franks. On sait seulement que le butin mobilier et immobilier était divisé en lots que l'on tirait au sort. Mais tous les membres des sociétés conquérantes n'étaient pas co-partageants au même titre. Les plus riches avaient avec eux des compagnons ou leudes auxquels ils se chargeaient de fournir la subsistance et l'armement, et qui demeuraient sous leur dépendance après la conquête comme ils l'étaient auparavant; les autres avaient au contraire participé à l'entreprise pour leur compte et à leurs frais, en se soumettant seulement aux chefs pour l'exécution des opérations militaires de la conquête. De là deux sortes de lots, les bénéfices et les alleux. [13] Aussi longtemps [61] que durèrent les luttes pour la conquête et les compétitions entre les sociétés conquérantes, le chef ou le roi conserva son pouvoir dictatorial, auquel se soumettaient indistinctement tous ceux qui étaient engagés dans l'entreprise, sauf à veiller avec un soin jaloux à ce qu'il ne s'attribuât point au delà de la part qui lui revenait dans le partage des dépouilles. [14] Mais la conquête achevée, chacun allait occuper son domaine, et alors apparaissait la différence des conditions auxquelles il avait été acquis. Tandis que les leudes pourvus de bénéfices temporaires demeuraient soumis, en tout temps, à l'autorité du chef, les ahrimans n'étaient obligés à lui fournir leurs services que dans le cas où la sûreté commune l'exigeait. La puissance du chef s'affaiblissait naturellement lorsque la conquête était terminée; elle s'affaiblit encore sous l'influence de la loi de succession des tribus germaniques qui partageait également entre les associés les domaines et la souveraineté politique. Ainsi émietté, l'État fondé par les Franks saliens sous la conduite de leur chef Clovis devint trop faible pour résister aux attaques des autres tribus germaines et des Arabes, attirés parles richesses de la Gaule. De nouvelles bandes germaniques, celles des Franks ripuaires se superposèrent aux premiers envahisseurs, repoussèrent les Arabes et fondèrent un empire, dont le chef exerça un pouvoir dictatorial, jusqu'à ce que la loi de partage des successions l'eût [62] de nouveau divisé et affaibli. Alors, la tendance naturelle des co-partageanls de la conquête à s'affranchir du pouvoir du chef de la hiérarchie l'emporte de nouveau et l'empire carlovingien s'émiette comme l'avait fait la monarchie mérovingienne. Les leudes du roi ou de l'empereur réussissent à obtenir l'hérédité de leurs bénéfices ; toutes les seigneuries quelles que soient leur origine et les conditions auxquelles elles ont été constituées, deviennent en réalité indépendantes, les guerres privées ne manquent pas de renaître et de se multiplier; d'un autre côté, à défaut des grandes invasions qui ont cessé et qui eussent peut-être rallié sous un chef investi d'un pouvoir dictatorial, la société conquérante, les pirates normands dévastent le pays sans trouver nulle part un faisceau de forces assez volumineux et assez consistant pour leur résister. Mais dans cet état de désorganisation et d'anarchie le besoin de sécurité agit pour déterminer la création d'un nouvel appareil de protection. Que fait-on? Les petits propriétaires de domaines incapables de protéger eux-mêmes leurs biens contre leurs voisins ou les pirates étrangers se mettent sous la protection des seigneurs plus puissants. Les « alleux » ou terres franches se transforment en « fiefs ». [15] Cette inféodation des terres allodiales n'est autre chose qu'un contrat d'assurance : le propriétaire du fief assuré devient le vassal de l'assureur ou du suzerain, il lui paye une redevance et lui fournit les services spécifiés dans le contrat en échange de sa protection. L'assureur, à son tour, s'inféode, lui et ses vassaux, à un seigneur plus puissant qu'il [63] ne l'est lui-même, en sorte qu'il n'est plus possible de toucher aux petites seigneuries sans avoir affaire aux grands suzerains, auxquels elles sont inféodées en première ou seconde main. La sécurité se rétablit peu à peu, et on voit sous la protection de ce vaste système d'assurances, l'industrie renaître, la richesse s'accumuler et s'ouvrir la belle période du moyen âge.
Pendant cette période, les rois de France ne se distinguent des autres seigneurs féodaux qu'en ce qu'ils sont les chefs héréditaires de la hiérarchie militaire. A ce titre, ils sont investis du droit de convoquer en certains cas, et de commander l'armée des propriétaires du sol, mais, en temps de paix, leur autorité ne s'exerce pas en dehors des limites de leur domaine particulier. Comment ce pouvoir s'est-il progressivement étendu? Comment ont-ils réussi à s'annexer toutes les autres seigneuries, dont quelquesunes dépassaient la leur, en puissance et en richesse? L'explication de ce phénomène historique se trouve à la fois dans l'avantage que procurait aux rois leur qualité de chef de la hiérarchie, dans l'établissement du droit d'aînesse et de substitution qui prévint le morcellement de leur domaine politique, [23] dans l'appauvrissement des petites seigneuries à la suite des croisades, dans la transformation du matériel de guerre, qui donna une prééminence marquée aux possesseurs des domaines les plus riches ; enfin dans l'application constante et heureuse d'une série de rois à augmenter per fas et nefas l'étendue de leurs domaines.
A quels mobiles obéissaient-ils dans ce long et patient travail d'agrandissement qui devait aboutir, après quatre ou cinq siècles, à l'absorption de toutes les petites [64] souverainetés féodales et à la constitution de la monarchie unitaire et absolue? C'est ce qu'il nous reste à examiner.
III. L'agrandissement de l'État. — Selon une habitude de notre temps qui consiste à antidater nos sentiments et nos idées, nous attribuons volontiers aux politiques et aux hommes de guerre qui ont fondé et successivement agrandi les Etats modernes, des intentions et des conceptions patriotiques dont ils n'ont jamais eu la pensée. Ils ne se souciaient en aucune façon de fonder une nation, et la preuve c'est qu'ils assujettissaient indifféremment à leur domination des populations, de races, de langues et de religions diverses. Si quelques-uns d'entre eux s'efforçaient, la conquête faite, d'établir l'unité religieuse, ou simplement d'interdire certains cultes, c'était dans des vues purement politiques, afin de protéger la religion établie, laquelle, en retour de cette protection, mettait à leur service son influence et ses pénalités spirituelles pour assurer l'obéissance do leurs sujets. Le but qu'ils poursuivaient, en s'efforçant d'agrandir leur Etat, était beaucoup plus terre à terre. Ils avaient simplement en vue d'augmenter la puissance et la richesse de la « maison » ou de l'association qui possédait et exploitait l'Etat. Ils ne se distinguaient à cet égard aucunement des industriels, des négociants et des banquiers qui s'appliquent à accroître leur clientèle et à élargir le cercle de leurs opérations, afin d'augmenter, eux aussi, la puissance, les profits et la renommée de leur « maison ». Les chefs des maisons politiques avaient exactement le même objectif que ceux des maisons de commerce ou autres, et ils subordonnaient communément leurs affections/leurs sentiments religieux, sans parler de leurs principes de morale, à l'intérêt bien ou mal entendu de leurs entreprises.
Ils étaient d'autant plus excités à étendre leur domination qu'ils n'avaient point, comme de nos jours, une liste civile [65] fixe, et qu'ils vivaient, à l'exemple des autres propriétaires et entrepreneurs d'industrie, du profit variable de leurs exploitations : chaque fois qu'ils réussissaient à agrandir leur « État », leur revenu s'augmentait, ils pouvaient accroître leur dépense, vivre sur un plus grand pied, occuper une place plus considérable dans le monde, acquérir une plus grande renommée, mieux assurer l'avenir de leur famille, et tels ont été de tous temps îles objets de l'ambition des hommes, et les mobiles de leurs actions, quelle que soit leur position sociale. Tous ceux qui servaient d'auxiliaires aux chefs des maisons souveraines, et en particulier les familles au sein desquelles ils recrutaient leur état-major politique et militaire, avaient un intérêt analogue : plus l'État croissait en étendue et en richesse, plus leur débouché s'élargissait, plus leurs fonctions acquéraient d'importance, plus s'élevaient aussi les profits qu'ils en pouvaient tirer. De là donc la tendance générale des chefs d'État et de la classe au sein de laquelle ils recrutaient l'état-major de leurs entreprises, à accroître incessamment l'étendue de leurs domaines et par conséquent à s'engager dans de nouvelles guerres. Sans doute, à la longue, quand certains États eurent acquis d'énormes proportions, les chefs des « maisons » souveraines cessèrent de mesurer leurs dépenses à leurs bénéfices. Ils s'étaient accoutumés à vivre sur un pied fastueux, et ils ne s'avisaient guère de diminuer leurs dépenses, après une entreprise malheureuse. Ils s'endettaient plutôt que de réformer leurbudget ou bien encore ils augmentaient les charges de leurs sujets, en s'exposant ainsi à les pousser à la révolte et à s'acheminer eux-mêmes à la banqueroute ou à la dépossession violente. Telle a été, comme on sait, la fin de la plupart des « maisons » politiques, propriétaires et exploitantes des États de l'ancien régime.
Les procédés auxquels les propriétaires exploitants des [66] États politiques pouvaient recourir pour les agrandir étaient les suivants : 1° la conquête, 2° l'acquisition par donation, legs ou héritage, 3° l'acquisition par voie d'échange ou à prix d'argent.
C'est par l'emploi de ces différents procédés que se sont fondés et agrandis successivement tous les Etats politiques.
Sans examiner en détail comment et dans quelle proportion ces procédés se sont combinés dans la formation des États modernes, ce qui exigerait un ouvrage spécial, nous pouvons, en jetant un coup d'œil sur la formation de l'État français, à partir de la dynastie capétienne, nous rendre compte des mobiles auxquels ont obéi les monarques qui ont « fait la France » et de la manière dont elle a été faite.
Nous avons assimilé plus haut les propriétaires exploitants des États politiques aux chefs des maisons de commerce ou d'industrie, en remarquant que l'objectif des uns et des autres étaient exactement le même : savoir l'augmentation de leur puissance et de leur richesse. C'est en vue de cet objectif que ceux-là aussi bien que ceux-ci travaillaient à développer leurs entreprises et à augmenter leurs acquisitions. Il faut ajouter qu'ils étaient d'autant plus excités à y travailler que les profits de l'industrie du gouvernement étaient plus élevés. A quel taux se montaient ces profits, à l'époque où les successeurs de Hugues Capet ont commencé à faire la France, en s'annexant peu à peu les domaines politiques de la féodalité? Nous trouvons sur ce point des indications intéressantes dans le savant ouvrage de M. Ad. Vuitry, sur le régime financier de la France.
L'importance d'un domaine seigneurial ou royal se mesurait, en France, par le nombre des prévôtés, entre lesquelles il était divisé au point de vue administratif et financier. Le prévôt, en effet, n'était autre chose qu'un intendant chargé d'administrer la partie du domaine qui [67] constituait la prévôté. [16] Les possessions territoriales de Hugues Capet, devenues le domaine royal par le fait de son avènement au trône, ne comprenaient que 16 prévôtés. A l'avènement de Philippe-Auguste (1180) on en comptait 38; à la mort de ce monarque conquérant et annexionniste il y en avait 94 et à la fin du xiiie siècle 263.
Si maintenant on veut savoir quel était le produit des prévôtés et par conséquent quel intérêt le propriétaire exploitant du domaine royal avait à en augmenter le nombre, les chiffres du budget de saint Louis, relevés par M. de Wailly, [24] pourront en donner une idée.
En 1238, les recettes perçues par les baillis et les prévôts s'élevaient à 235,286 livres, et les dépenses d'administration des bailliages et prévôtés seulement à 80,909 livres. Le produit net versé au Trésor royal était donc de [68] 154,377 livres; en sorte que les bénéfices du propriétaire étaient des 2/3 environ de son produit brut. Sur ces bénéfices, il avait à pourvoir aux frais généraux de son État et à ses dépenses personnelles; mais il faut remarquer que ces frais et dépenses ne croissaient pas à beaucoup près en raison de l'extension du domaine. D'après les estimations de M. de Wailly, elles absorbaient un autre tiers du produit brut. Il restait ainsi un-tiers, ou 33 pr. 100 du produit brut qui constituaient, au bout de Tannée, le profit de l'entreprise. C'était un bénéfice considérable, et on peut en inférer que l'exploitation d'un domaine politique, quand elle était bien conduite, devait être la plus productive des industries. Ce produit net annuel était naturellement variable; il dépendait, d'un côté, des recettes qui variaient suivant l'état des récoltes, de l'industrie et du commerce, etc.; d'un autre côté, du montant des dépenses. Les frais d'administration n'étaient point susceptibles de variations considérables; en revanche les frais généraux s'élevaient plus ou moins haut selon que les entreprises ayant pour objet la défense ou l'extension du domaine étaient plus ou moins importantes et heureuses. En l'absence d'un système de comptabilité en partie double, on ne pouvait toutefois s'en rendre compte. L'excédent de l'année était acquis au Trésor royal, et il s'y accumulait jusqu'à ce qu'il fût possible de lui donner un emploi productif. L'emploi considéré comme le plus avantageux consistait dans l'extension du domaine par voie de conquête ou d'acquisition à l'amiable, et ce n'était point là, remarquons-le bien, une particularité caractéristique des seules entreprises politiques. Dans toutes les industries, jusqu'à une époque récente, les entrepreneurs avaient l'habitude d'appliquer presque exclusivement leurs excédents de bénéfices au développement de leurs affaires, et telle est encore la destination préférée de l'épargne de la généralité de nos paysans propriétaires. Les propriétaires [69] d'un domaine politique suivaient en cela la pratique usuelle. Selon que leur Trésor était plus ou moins bien garni, ils ralentissaient ou multipliaient leurs entreprises d'annexion par la force ou d'acquisition à l'amiable des territoires qu'ils convoitaient en vue de s'agrandir. Avons-nous besoin d'ajouter que toutes leurs entreprises n'étaient pas également heureuses et qu'un bon nombre échouaient, en leur laissant une perte au lieu d'un bénéfice. Cependant, à mesure que leur domaine politique s'agrandissait, ils devenaient plus capables de l'agrandir encore, car la foule des propriétaires des petits domaines devenaient de moins en moins capables de leur résister. C'est ainsi que la maison de France finit, à la suite des siècles, par absorber par voie de conquête, d'héritage ou à prix d'argent, non seulement toutes les seigneuries constituées après la conquête, mais encore par empiéter sur les domaines politiques des « maisons étrangères ». [17] Un travail d'annexion et de concentration [70] analogue s'était opéré dans le reste de l'Europe, et, sauf en Allemagne, où les petites souverainetés avaient [71] réussi à se perpétuer, l'Europe ne formait plus, à la veille de la Révolution française, qu'un petit nombre de grands domaines politiques appartenant à des maisons royales ou impériales.
IV. Exploitation de l'État. — Nous venons de jeter un coup d'œil sur les nécessités qui déterminent le mode de constitution d'un État et les mobiles qui poussent ceux qui le possèdent à l'agrandir. Il nous reste maintenant à examiner à quel mode d'exploitation les propriétaires de l'État avaient recours, et sous l'influence de quelles causes ce mode d'exploitation, d'abord grossier et barbare, est venu successivement à se modifier et à se perfectionner.
Quelle est à cet égard la situation des co-partageants [72] d'un pays conquis sous le régime primitif de l'association en participation? Ils sont généralement les maîtres d'organiser à leur guise l'exploitation du sol qui leur est attribué dans le partage des fruits de l'entreprise. Le pays conquis est dans toute son étendue et avec tout ce qui le meuble, minéraux, végétaux, animaux, ressources naturelles et capitaux, la propriété de l'association conquérante; mais, dans le partage, cette propriété se dédouble enmême temps qu'elle se fractionne; l'association représentée par son chef ou l'assemblée de ses chefs n'en conserve plus que la souveraineté, ou, dans le langage des légistes, le domaine éminent, impliquant le droit d'imposer aux co-partageants les charges et obligations nécessitées par le bien commun. Ces charges et obligations se résument principalement dans l'apport d'un contingent d'hommes et de ressources proportionné à l'importance des domaines alotis, dans le cas où la propriété commune serait menacée ou bien encore dans le «as où quelque entreprise de guerre serait jugée nécessaire par l'assemblée des propriétaires ou par le chef auquel ils ont délégué l'exercice dela souveraineté. [18] En dehors de ces droits supérieurs de l'association dont ils font partie, chacun des co-partageants demeure le maître absolu du lot qui lui est échu, des hommes, des animaux et des choses qui en forment le cheptel. Il peut user et même abuser de sa propriété, suivant la définition du droit romain. [19] Comment va-t-il s'y prendre pour en tirer le profit le plus élevé possible? Quel système d'exploitation va-t-il adopter? Ce [73] système ne saurait évidemment être le même partout. Il différera selon la nature et le degré de développement de la population conquérante et de la population asservie, selon l'état d'avancement de l'industrie et de perfectionnement du matériel productif, selon l'étendue du débouché ouvert aux produits agricoles et industriels. Le système qui se présente d'abord comme le plus simple et. en apparence, le plus productif, c'est celui de l'exploitation directe du domaine. Le propriétaire applique la population vaincue et asservie à la production de tous les articles de consommation et de tous les services qui lui sont nécessaires; il crée des ateliers agricoles et industriels pour son usage, en se chargeant de l'entretien et du gouvernement du personnel, de la création et du renouvellement du matériel. C'est le régime de l'esclavage pur et simple. Mais l'expérience lui enseigne à la longue qu'il est plus profitable pour lui d'abandonner à ses esclaves le soin de leur subsistance et de leur entretien, en leur accordant, avec la jouissance d'un morceau- de terre pour y bâtir une cabane et y cultiver les denrées nécessaires à leur alimentation, la disponibilité d'une partie de leur travail. Le servage prend ainsi graduellement la place de l'esclavage, à l'avantage des deux parties : le propriétaire obtient pour lui, défalcation faite des produits et des services qui étaient absorbés par l'entretien et le gouvernement de ses esclaves, une part égale et même supérieure à celle qu'il obtenait auparavant, tout en se déchargeant du soin de son personnel. L'esclave devenu serf acquiert la disposition de ses forces et de ses facultés productives pendant tout le temps qui n'est point absorbé par l'acquittement de la corvée. Lorsqu'il est laborieux et économe, il peut non seulement vivre mieux qu'il ne le faisait sous le régime de l'esclavage, mais réaliser une épargne. La production stimulée par l'intérêt du cultivateur, désormais maître d'une partie des fruits de son [74] travail, ne manque pas de se développer et la richesse de s'accroître. D'autres arrangements deviennent possibles. Le propriétaire se débarrasse entièrement du soin de cultiver une portion de son domaine en la cédant à ses corvéables contre une redevance en nature, à laquelle se substituera finalement, lorsqu'un marché aura été créé dans le voisinage, une redevance ou une rente en argent. [20] Enfin, lorsque le cultivateur a pu réaliser une épargne suffisante, il rachète tout ou partie de cette redevance et devient propriétaire à son tour. La même évolution progressive s'accomplit dans les rapports du propriétaire avec les ouvriers de l'industrie ou des métiers. Il cesse de pourvoir à leur entretien en leur accordant la liberté de travailler pour eux-mêmes une partie de la semaine, puis il leur abandonne l'entière disponibilité de leur travail, en échange d'un tantième de leur production ou de son équivalent en argent; enfin, il consent, surtout lorsque la nécessité le presse, à les exonérer de toute redevance, en échange du capital de cette redevance. La population .asservie finit donc, sous l'influence de ce progrès naturel, par être affranchie de la servitude économique, tandis que le propriétaire de son côté est exonéré du soin de la gestion de son domaine; il n'a plus que des redevances à toucher ou des capitaux provenant du rachat des redevances à faire valoir. Toutefois, le seigneur-propriétaire trouve communément avantage à se réserver le monopole [75] de certains produits et de certains services. Il a son moulin et son four, où les habitants du domaine sont obligés de faire moudre leur blé et cuire leur pain, à des prix fixés par lui. Il a encore sa monnaie, dont il les contraint à se servir à l'exclusion de toute autre, et sur laquelle il perçoit un seigneuriage. Mais la gestion économique du domaine n'en est pas moins considérablement simplifiée et elle n'exige plus, de sa part, qu'une simple surveillance.
Ce progrès en entraîne un autre dans le gouvernement dela population du domaine. Sous le régime de l'esclavage, le propriétaire est obligé de pourvoir entièrement à ce gouvernement, de veiller lui-même au maintien du bon ordre et de la paix parmi ses esclaves, de s'occuper de l'élève des enfants, de l'entretien des vieillards, etc. Lorsque le servage se substitue à l'esclavage, le gouvernement de son personnel se simplifie du même coup. Le propriétaire n'a plus besoin d'intervenir dans tous les actes de l'existence de ses serfs. Il lui suffit, d'une part, que les corvées soient régulièrement fournies, d'une autre part, que la population du domaine demeure proportionnée à la quantité de travail nécessaire pour le mettre en valeur. Il peut donc se contenter désormais d'exiger l'acquittement ponctuel de la corvée et de veiller à la reproduction utile de la population en se réservant le droit d'autoriser ou d'interdire les mariages. Pour tout le reste, il peut, sans que ses intérêts en souffrent, abandonner ses serfs à eux-mêmes. Il n'y manque point, et l'on voit alors les serfs s'associer et constituer des « communes » pour remplir les fonctions d'administration, de justice et de police que le propriétaire laisse à leur charge. Les « anciens » sont chargés de veiller au maintien du bon ordre et des bonnes mœurs, à l'entretien des rues du village et des chemins vicinaux; bref, la commune s'acquitte de tous les services indispensables mais non rétribuables dont le propriétaire a trouvé avantageux [76] de se dessaisir. Il n'a plus à se préoccuper que des atteintes les plus graves à la propriété et à la vie de ses sujets, et surtout de celles qui l'intéressent directement lui et les siens, des actes de désobéissance ou de révolte contre son autorité, et telles sont, en effet, celles qu'il a soin de réserver à sa juridiction. En dernière analyse, il retient toutes les attributions et fonctions qui sont de nature à lui donner un profit ou qui intéressent sa sûreté et le maintien de sa domination; il abandonne les autres aux communes ou aux paroisses de son domaine. Il arrive eniiu, lorsque les communes deviennent des foyers importants d'industrie et de commerce, qu'elles veulent s'affranchir de sa sujétion, les unes en se révoltant, d'autres en se rachetant, et qu'elles entreprennent, avec plus ou moins de succès, de se gouverner elles-mêmes. [21]
[77]
Mais dans tous ces changements du mode d'exploitation du domaine qui lui fournissait ses moyens d'existence, le seigneur-propriétaire n'avait toujours en vue que l'augmentation de ses profits. En cela, les propriétaires exploitants d'un domaine politique ne différaient point des autres entrepreneurs d'industrie. Ajoutons qu'ils employaient, pour accroître les bénéfices de leur exploitation, et par conséquent la puissance et la richesse de leur maison, des procédés plus ou moins efficaces et louables. Les plus intelligents s'appliquaient à améliorer leur administration, à encourager l'industrie et le commerce de leurs sujets, en leur procurant toute la sécurité dont ils avaient besoin. D'autres, plus brutaux et plus avides, s'efforçaient plutôt de leur extorquer la plus forte somme possible de corvées et de redevances. Toutefois, l'excès de leurs exigences rencontrait un obstacle sérieux sinon toujours insurmontable dans la « coutume ». Les redevances et les corvées qui avaient remplacé l'exploitation directe du travail de l'esclave avaient été fixées originairement à un certain taux que les populations s'accoutumèrent à considérer comme le prix de leur demi-libération, et qu'elles refusaient au seigneur le droit d'augmenter à sa fantaisie, lorsque les profits qu'elles tiraient de l'exploitation de leur tenure ou de leur industrie venait à s'accroître. La « coutume » était protégée par la tradition, et la puissance seigneuriale trouvait dans cette force latente une résistance qu'elle ne réussissait pas toujours à surmonter. Si le seigneur augmentait les redevances et les corvées, le meurtre et l'incendie ravageaient son domaine ; s'il expulsait un tenancier récalcitrant, celui qui le remplaçait en consentant à subir [78] un accroissement de loyer contraire à la coutume était mis en interdit, et la vie devenait impossible dans une tenure frappée du « mauvais gré ». Il résultait de là que les revenus des domaines politiques ne s'augmentaient qu'avec lenteur, même aux époques où l'industrie progressait et où les besoins de luxe qu'elle permet de satisfaire allaient se développant. Il fallait alors recourir à un autre procédé pour augmenter des ressources qui ne suffisaient plus à satisfaire des besoins accrus. Ce procédé c'était la conquête, soit que la société des conquérants se réunît pour entreprendre une nouvelle expédition, destinée à agrandir le domaine commun, en répartissant entre ses membres les résultats de l'entreprise; soit que les propriétaires de domaines politiques travaillassent individuellement à arrondir leur lot aux dépens de leurs voisins.
V. La politique. — Tout propriétaire d'un État politique devait nécessairement adopter, en vue de le conserver, de l'agrandir et d'en tirer le profit le plus élevé possible, certaines règles de conduite. Ces règles, il s'agissait de les découvrir. De là, dans la suite des siècles, une accumulation d'observations et d'expériences qui ont fini par constituer une science spéciale, — la science de la politique, — qui est la technique de cette branche supérieure de l'industrie humaine. On peut, en effet, définir la politique la science des moyens de conserver, d'exploiter, de fortifier et d'agrandir un Etat. Cependant, si l'objectif de la politique, le but q'ue se proposent d'atteindre les « hommes d'Etat » qui pratiquent l'art tiré de cette science, est partout le même, les procédés qu'il convient d'employer pour atteindre ce but diffèrent selon les situations et les circonstances. Ces procédés, fruits de l'observation et de l'expérience, se lèguent de génération en génération, et ils constituent la « politique traditionnelle » de chaque Etat, politique appropriée aussi exactement que possible à sa situation particulière.
[79]
La politique se partage en deux branches maîtresses : la politique intérieure et la politique extérieure.
1° La politique intérieure. Dans la période dont nous venons d'esquisser les traits caractéristiques, l'objet principal de la politique intérieure consistait à maintenir les sujets dans la soumission et l'obéissance, et par conséquent, à écarter ou à supprimer tout ce qui était de nature à les en détourner. Les nécessités de la conservation de sa domination avaient conduit le souverain à restreindre, dans une mesure plus ou moins forte, la liberté de ses sujets ; il leur interdisait par exemple de s'assembler pour examiner et critiquer ses actes, et plus tard, de se livrer à cet examen au moyen de la parole imprimée. Il leur interdisait encore de constituer, pour un motif ou pour un autre, des groupes de forces, qui pussent devenir des foyers de résistance à son autorité. C'était une maxime fondamentale de la politique que l'on ne pouvait permettre d'instituer un État dans l'Etat. On ne faisait d'exception que pour l'État religieux dont le concours servait à assurer l'obéissance des sujets et qui était, à juste titre, considéré comme un instrumentum regni indispensable; mais encore prenait-on des précautions de toute sorte pour empêcher cet « Etat dans l'État » d'accroître sa puissance et ses ressources au delà de ce qui était jugé utile. On ne tolérait généralement qu'un seul culte, et, pendant des siècles, une des préoccupations principales des hommes d'État a été de placer ou de maintenir la corporation religieuse sous l'autorité directe du souverain. Enfin, la police et la justice avaient, avant tout, pour mission de rechercher et de punir les attentats contre le pouvoir du souverain et la sûreté de l'État, ou bien encore contre la religion de l'État, regardée comme l'auxiliaire nécessaire de la puissance politique , et les pénalités attachées à cette sorte de crimes avaient un caractère exceptionnel de rigueur. Au [80] lieu de s'adoucir sous l'influence des progrès de la civilisation, on les vit même devenir de plus en plus barbares, à mesure que les moyens d'attaque contre l'Église et l'État allaient se multipliant et se perfectionnant de leur. côté. La politique intérieure avait donc pour objet essentiel d'assurer la sécurité de l'État ou, ce qui revenait au même, la domination du souverain, propriétaire de l'État. Elle s'occupait aussi de l'amélioration de son exploitation et du développement de ses ressources. Comme nous l'avons remarqué plus baut, le propriétaire exploitant d'un État politique s'efforçait de tirer de cette propriété le plus gros revenu possible, et son objectilf ne différait pas en cela de celui de tout autre entrepreneur d'industrie. Seulement il y avait à cet égard deux systèmes : l'un consistait à encourager le développement des ressources des sujets, en se contentant d'exiger d'eux des redevances modérées, mais dont le produit allait croissant naturellement ù mesure qu'ils devenaient plus riches; l'autre s'appliquait, au contraire, à leur faire supporter, sous les formes les plus variées un maximum de charges, de manière à les laisser faibles et misérables. Les deux systèmes avaient leurs partisans et l'on pouvait invoquer en faveur de l'un et de l'autre des raisons valables. Si les sujets s'enrichissaient, le souverain participait sans aucun doute à l'accroissement de leur fortune; ses ressources s'augmentaient et sa puissance avec elles ; en revanche, ses sujets devenus plus riches, partant plus instruits et plus indépendants, étaient plus difficiles à gouverner et à maintenir dans l'obéissance. Des sujets misérables n'étaient pas d'un rapport aussi avantageux, mais peut-être leur soumission était-elle mieux assurée, leurs révoltes plus faciles à comprimer. [22] Quoi qu'il en soit, les financiers au service du propriétaire de l'État [81] s'appliquaient à chercher les moyens les plus propres à faire passer, avec le moins d'embarras et de difficultés, la plus forte part possible du revenu des sujets dans le Trésor du souverain. La machinery fiscale que l'ancien régime nous a léguée peut être considérée, sous ce rapport, comme un chef-d'œuvre. L'expérience avait montré successivement, quelles étaient les sources de revenus les plus fécondes, quelles étaient les matières les plus faciles à imposer et les plus productives, jusqu'à quel point on pouvait les imposer utilement, quel était enfin le système de perception le plus économique. Après avoir essayé de la perception directe, on avait eu recours à l'affermage et, malgré les abus qui ont déconsidéré ce système, il constituait incomparablement un progrès sur la régie.
2° La politique extérieure. La politique extérieure d'un État de l'ancien régime se proposait pour objet de le garantir contre les entreprises qui pouvait le menacer au dehors, comme aussi de lui permettre de s'agrandir et d'augmenter sa puissance et ses ressources aux dépens des autres Etats. C'était une science très importante et très compliquée. Elle avait pour principe essentiel, — et ce principe était encore un résultat de l'expérience, — de diviser pour régner, c'està-dire de maintenir autant que possible les autres dominations politiques dans un état de faiblesse, de division et d'antagonisme; d'empêcher la constitution de grands États, en faveur desquels la balance des pouvoirs se trouvât rompue; de veiller à ce que les États rivaux n'étendissent pas la sphère de leur influence; de chercher le moment favorable pour s'annexer un nouveau territoire par la force ou autrement, de contracter des alliances matrimoniales ou de former des ligues politiques de nature à fortifier l'État.
VI. Résumé des nécessités qui ont déterminé la [82] constitution et la politique des États. La concurrence politique.— Tels ont été, dans les deux premiers âges de l'industrie, la constitution et la politique des Etats. Cette constitution et cette politique, tout empreintes qu'elles soient du cachet de la barbarie, ont répondu à des nécessités dérivant de la nature de l'homme et du milieu où il s'est trouvé jeté.
Il ne faut pas oublier, en effet, que l'espèce humaine s'est trouvée exposée, dès son apparition sur la terre, à un risque permanent de destruction, et que ses efforts ont dû se partager entre la nécessité de pourvoir à sa subsistance et celle de se préserver de ce risque, autrement dit de se procurer de la sécurité. Cette seconde nécessité plus encore que la première a déterminé la formation des premières associations humaines. D'abord l'homme a été obligé de défendre sa vie contre les nombreuses et puissantes espèces carnassières qui occupaient le globe avant lui. Comme toutes les espèces faibles et mal pourvues d'armes naturelles, il n'a pu se conserver qu'à la condition de recourir à l'association. Des sociétés, limitées toutefois par l'insuffisance de leur matériel et de leurs procédés de production, se sont constituées comme autant d'assurances mutuelles contre les animaux et les hommes de proie. Ces sociétés ont dû assujettir leurs membres à des règles et à des obligations dérivées des nécessités du salut commun. Dans cette première période de leur existence, leur organisation est purement embryonnaire. La division du travail et la spécialisation des fonctions, qui est un des principaux facteurs du progrès, y apparaît seulement à l'état de germe.. Chacun des membres du troupeau ou de la tribu, quelles que soient ses aptitudes particulières, est obligé à la fois de concourir à la défense et au gouvernement de la société dont il fait partie et de pourvoir à sa propre subsistance. Cet état de choses subsiste aussi longtemps que l'imperfection du matériel et des procédés de la production réduit [83] l'homme à vivre de la chasse ou de la pêche et de la récolte des fruits naturels du sol. Si imparfaite et grossière que soit l'organisation de ces sociétés primitives, elle leur procure cependant la sécurité nécessaire pour se conserver, augmenter graduellement la somme de leurs découvertes et perfectionner leur outillage. Le matériel agricole est inventé, l'ère de la petite industrie commence. L'agriculture et l'industrie fournissent des moyens d'existence à des millions d'hommes sur un territoire où quelques milliers pouvaient à peine subsister auparavant. Mais dans cette nouvelle phase économique comme dans la précédente le risque originaire de destruction continue de menacer l'espèce humaine. S'il a diminué d'un côté, il s'est accru d'un autre. Des sociétés devenues plus nombreuses et pourvues d'un armement perfectionné n'ont plus rien à craindre des espèces animales inférieures; elles détruisent ou elles refoulent celles qu'elles n'asservissent point; en revanche, les richesses qu'elles accumulent deviennent l'objet des convoitises et des rapines des sociétés moins avancées dans les arts de la production et des individualités réfractaires au travail qu'elles renferment dans leur sein. Il faut pourvoir à la sécurité extérieure en mettant la société à l'abri des incursions et du pillage des tribus ou des peuplades étrangères, à la sécurité intérieure, en assujettissant au travail ceux qui y répugnent et en les empêchant de s'emparer des fruits du labeur d'autrui. Comment est-il pourvu à cette double nécessité? Par la spécialisation des fonctions de la défense et du gouvernement, spécialisation que le perfectionnement du matériel de la production a rendue possible. Grâce à ce perfectionnement, la productivité du travail de l'homme s'est augmentée. Avec le produit du travail de trois hommes, dans les régions propres à la culture, on peut en nourrir et en entretenir quatre et même un plus grand nombre. Que font alors les sociétés progressives [84] en possession du nouveau matériel? Elles se mettent à la recherche des territoires les plus propres à la culture, elles en asservissent la population et l'assujettissent aux travaux de la production. Ces terres qu'elles ont découvertes, ce matériel qu'elles ont inventé, ces populations qu'elles ont soumises au travail en échange d'une subsistance régulière, leur appartiennent, et elles subsistent au moyen du produit net qu'elles en tirent. Elles sont donc intéressées au plus haut point à les défendre et à les gouverner de manière à en obtenir le produit le plus élevé possible.
Le gouvernement et la défense des sociétés, en possession du nouveau matériel de la production, se trouvent ainsi placés entre les mains de.s hommes les plus capables de remplir les fonctions nécessaires à l'établissement de la sécurité extérieure et intérieure, et les plus intéressés à les bien remplir. Ajoutons que leur capacité s'accroît naturellement de génération en génération par l'exercice héréditaire des mêmes fonctions. En vue d'assurer la sécurité extérieure de leur « Etat », ils s'appliquent à découvrir le mode de constitution et d'organisation le plus résistant et le mieux approprié à leur situation particulière; ils s'appliquent aussi à perfectionner incessamment leur matériel et leurs procédés de défense. En vue d'assurer de même la sécurité intérieure de cet établissement, qui leur fournit leurs moyens d'existence, et d'en tirer le produit le plus considérable possible, ils cherchent les procédés les plus propres à y maintenir la paix, à assurer l'obéissance de leurs sujets, à encourager le développement de leur industrie, et à recouvrer en même temps, de la manière la plus commode et la plus sûre, la part qu'ils s'attribuent dans le produit général de l'exploitation.
Ces mobiles de conservation et de progrès, déjà extrêmement puissants par eux-mêmes, se trouvent encore excités [85] et maintenus en éveil par la concurrence politique qui naît du partage des territoires et des populations entre un nombre croissant d'États, dont les propriétaires exploitants sont intéressés à augmenter l'étendue et l'importance. Or les territoires accessibles et les populations exploitables étant limités en étendue et en nombre, un Etat ne peut s'agrandir que par la suppression ou la diminution d'un autre. Tous les propriétaires d'Etats sont donc « concurrents », et leur compétition se manifeste par la guerre. La guerre est une nécessité qui s'impose aux États politiques, dans l'âge de la petite industrie aussi bien que dans la période précédente ; seulement, au lieu d'avoir pour objet le pillage et l'anthropophagie, elle se propose pour but la conquête et l'exploitation d'un territoire et de ses habitants; mais, quel qu'en soit l'objet, elle agit, en définitive, comme un puissant véhicule de progrès. C'est sous la pression de cette forme primitive et barbare, mais efficace, de la concurrence, îi des époques où elle était la seule possible et dans les moments où elle était la plus active, que l'on a vu s'accélérer et se multiplier les progrès des sciences et des institutions politiques et militaires ainsi que du matériel de guerre; c'est alors aussi que les gouvernements se sont appliqués avec le plus d'ardeur et de zèle à développer leurs ressources économiques et financières. Enfin, c'est grâce à la guerre que la destinée finale des Etats politiques a été partout et toujours de tomber au pouvoir des hommes les plus experts dans l'art de les défendre et de les gouverner, c'est-à-dire d'assurer de la manière la plus efficace leur sécurité intérieure et extérieure. Le risque originaire de destruction qui pesait sur l'espèce humaine s'est ainsi successivement amoindri, en premier lieu par le perfectionnement de l'appareil destiné à le combattre, en second lieu par le progrès des industries qui augmentent la puissance productive de l'homme, progrè [86] dont la condition essentielle était l'accroissement de la sécurité. Mais à mesure que la puissance productive s'augmente, et que les échanges se multiplient en conséquence, il se crée entre les hommes, sans distinction d'espèces ou de nations, une communauté d'intérêts, qui fait dépendre le bien-être de chacun de la prospérité de tous et qui diminue par là même l'intensité du risque primitif de destruction et de guerre.
[87]
CHAPITRE IV.
Les gouvernements modernes. La monarchie constitutionnelle↩
I. En quoi les gouvernements modernes diffèrent des gouvernements d l'ancien régime. — II. La monarchie constitutionnelle et son mécanisme. § 1er. Le pouvoir royal. § 2. Le corps électoral. § 3. Le parlement. § 4. Les libertés ot les garanties constitutionnelles. — III. Résultats de l'expérience de la monarchie constitutionnelle. — IV. Les politiciens et les partis 'politiques.
I. En quoi les gouvernements modernes diffèrent des gouvernements de l'ancien régime. — Entre les gouvernements féodaux, monarchies plus ou moins dictatoriales ou républiques plus ou moins aristocratiques, il n'y a point de différences fondamentales. Les uns et les autres sont des entreprises individuelles ou corporatives. Dans les Etats issus de la conquête, après la chute de la domination romaine, l'Etat est la propriété de l'association des conquérants, qui l'exploite et s'applique à l'agrandir à son profit. Seulement la constitution de cette association et le mode d'exploitation de l'État qu'elle a conquis, varient suivant les circonstances. Tantôt le gouvernement de l'association et la gestion de l'État qu'elle possède et qui lui fournit ses moyens d'existence, sont concentrés entre les mains d'un chef héréditaire, investi, en raison surtout des nécessités de la défense commune, d'un pouvoir dictatorial; ce chef distribue à son gré les grades dans l'armée conquérante et avec eux les domaines qui servent à les rétribuer, tout en subsistant lui-même du produit du domaine qui lui es [88] échu en partage; il prend toutes les mesures et décide de toutes les entreprises qu'il juge utiles aux intérêts de l'association, sauf parfois à les soumettre à l'assemblée générale des associés; tantôt le pouvoir du chef est limité à la convocation et au commandement de l'armée conquérante, en cas de danger commun; les grades sont héréditaires avec les domaines qui les rétribuent, et chaque seigneur ou propriétaire de domaine se trouve dans une situation indépendante, sauf à fournir son contingent de services, quand il vient à en être requis par le chef, roi ou empereur; encore ne juge-t-il pas toujours à propos de satisfaire à cette obligation. Chacun vidant soi-même ses querelles et s'efforçant, en l'absence d'une autorité supérieure suffisamment puissante, de s'arrondir aux dépens de ses voisins, il en résulte un état d'anarchie auquel il est remédié par la constitution du système d'assurance politique connu sous le nom de régime féodal : les faibles se mettent sous la protection des forts, moyennant une redevance qui est une véritable prime d'assurance ; ceux-ci s'assurent à leur tour, eux et leurs protégés, auprès des seigneurs les plus puissants, et la sécurité renaît parmi la clientèle de ces grands suzerains, assureurs immédiats ou successifs de la foule des propriétaires politiques. Cependant ce régime qui rétablit la paix pendant plusieurs siècles et ouvre la période la plus prospère et la plus heureuse peut-être de l'ère de la petite industrie, finit par tomber en décadence.
Les seigneuries politiques, comme toutes les autres propriétés, se vendent à prix d'argent ou se lèguent par héritage. Les seigneurs riches achètent les domaines et seigneuries de ceux qui se sont appauvris; ils s'arrondissent par des mariages avec des héritières, par la confiscation des domaines de leurs vassaux, quand ceux-ci ne payent pas exactement leurs redevances ou leurs primes, etc., etc. Les grandes seigneuries absorbent ainsi successivement [89] les petites, et les États morcelés du régime féodal deviennent la propriété d'un nombre restreint de « maisons politiques », comme on voit, de nos jours, quelques maisons de commerce colossales se substituer à la multitude des petits magasins de nouveautés et autres. En France notamment, la « maison » fondée par Hugues Capet absorbe, dans le cours de quatre ou cinq siècles, tous les domaines seigneuriaux, en substituant à la multitude des petits gouvernements quasi indépendants des seigneurs ou des oligarchies municipales une domination unique.
Cette évolution qui s'est accomplie, à la même époque, dans la plus grande partie de l'Europe mais qui n'a été nulle part aussi complète qu'en France, a-t-elle constitué un progrès? A certains égards, oui; à d'autres égards, non.
Constatons d'abord qu'elle a eu plutôt pour résultat de modifier les dimensions des exploitations politiques que leur constitution même. Au lieu d'une foule d'Etats seigneuriaux ou municipaux, indépendants sauf leurs obligations féodales, il n'y a plus eu qu'un seul Etat, mais le changement s'est arrêté là. La constitution politique de lu monarchie de Louis XIV ne diffère pas d'une manière fondamentale, de celle de la seigneurie d'un châtelain du moyen âge. Le châtelain était propriétaire de sa seigneurie et il la gouvernait selon son bon plaisir, sauf ce qu'il devait à son suzerain; le roi était propriétaire de son Etat, c'està-dire de la monarchie française, et il la gouvernait de même selon son bon plaisir, — d'une manière plus absolue encore, car il n'avait pas de suzerain. Lequel de ces deux régimes était préférable au point de vue de l'intérêt des « sujets » qui formaient la généralité des consommateurs des services politiques, militaires et administratifs? Il serait malaisé de le dire. Sans aucun doute, les monarchies absolues et centralisées des xvie et xvne siècles étaient des [90] machines plus puissantes et plus parfaites que les gouvernements féodaux auxquelles elles avaient succédé. Elles l'étaient surtout au point de vue de la concurrence politique et militaire. Les États féodaux étaient visiblement moins bien organisés et outillés pour la guerre. Les vassaux ne devaient à leurs suzerains qu'un service conditionnel et les armées féodales, composées eu grande partie de simples milices obligées au service pour un temps limité, étaient des instruments de qualité inférieure. Les armées soldées et permanentes des monarchies unitaires, recrutées surtout parmi les populations belliqueuses qui faisaient de la guerre un métier, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Irlande, étaient plus maniables et plus solides. L'administration intérieure des grandes monarchies était composée de même d'éléments supérieurs, parce que ses fonctionnaires et ses agents étaient pris dans un marché plus étendu et qu'ils pouvaient être mieux rétribués que ceux des petites seigneuries ou des oligarchies municipales. En revanche, les « sujets » possédaient moins de garanties et pouvaient être assujettis à des obligations et à des taxes plus lourdes sous les grandes monarchies unitaires qu'ils ne l'avaient été sous le régime des seigneuries morcelées. Plus, en effet, l'État s'agrandissait, plus s'augmentait la disproportion des forces entre le maître et le sujet, le gouvernant et le gouverné. Les seigneurs avaient dû compter avec leurs sujets, soit que ceux-ci appartinssent à la race conquérante et qu'ils eussent obtenu des lots de terre en échange de leurs services militaires, soit que, adonnés à des occupations plus humbles, ils formassent des corporations industrielles ou commerciales; ils avaient été obligés de leur accorder des franchises ou des privilèges; ils ne pouvaient notamment les taxer sans leur consentement; ils avaient concédé ou vendu aux communes les plus riches et les plus puissantes le droit de se gouverner elles-mêmes. [91] Presque partout, il s'était constitué des parlements locaux, où figuraient les notabilités de la noblesse d'épée ou de robe, du clergé et du tiers état, c'est-à-dire des professions ou des métiers, qui votaient les taxes et exerçaient un certain contrôle sur les actes du seigneur. Tous ces freins et ces contrepoids au pouvoir des propriétaires exploitants des États seigneuriaux disparurent lorsque ces petits Etats eurent fait place à de grandes monarchies. Les maîtres de ces puissants États ne voulurent plus souffrir de contrôle de leurs actes ni de limitation de leur autorité, et, grâce à la force énorme qu'ils puisaient dans une armée et une administration à leur solde et sous leur entière dépendance, ils réussirent à briser toutes les résistances, et même à réduire aux fonctions d'une domesticité de cour les descendants de l'aristocratie féodale. C'est ainsi que Mme de Staël a pu dire avec vérité : « La liberté est ancienne sur la terre de France, c'est le despotisme qui est nouveau. » Mais sous le régime des petites seigneuries comme sous celui des grandes monarchies, l'Etat politique demeurait toujours la propriété d'une « maison », qui l'exploitait pour son compte, en s'appliquant continuellement à l'agrandir et à en tirer le profit le plus élevé possible, absolument comme s'il s'agissait d'une entreprise industrielle et commerciale.
Des changements plus considérables se sont opérés dans le mode d'existence et de gestion des Etats politiques, lorsque les monarchies ou les oligarchies de l'ancien régime ont été remplacées par les gouvernements modernes, monarchies ou républiques représentatives.
Ces changements, actuellement accomplis ou en voie d'accomplissement, concernent, en premier lieu, l'appropriation des États politiques, en second lieu la constitution des gouvernements.
Sous l'ancien régime, l'État politique, avec toutes les [92] propriétés et tous les droits qui lui étaient afférents, appartenait, comme nous venons de le dire, à la « maison » régnante ou à l'oligarchie gouvernante, sauf les garanties ou les privilèges qu'elle avait octroyés à ses sujets. En France, l'État politique était la propriété de la maison royale, qui l'avait acquis et successivement agrandi, on a vu par quels procédés, dans le cours des siècles; à Venise et à Berne, l'État politique appartenait à une oligarchie, formant une véritable société en participation pour l'exploitation de cette entreprise. Le changement, accompli sous le nouveau régime, a consisté a transférer la propriété de l'État politique, avec tous les droits qui en dérivent, à la nation, laquelle se compose des anciens propriétaires et gouvernants et de la généralité de leurs anciens sujets. Dans le droit public moderne, les nations sont considérées comme propriétaires de leur État politique et, par conséquent, comme maîtresses de le constituer et de l'exploiter à leur guise et à leur profit. Cependant ce transfert de la propriété de l'État n'a pas été aussi général et aussi complet qu'on pourrait le supposer. Dans les pays où la révolution n'a pas fait table rase du passé, la transformation de la monarchie dite patrimoniale de l'ancien régime en monarchie constitutionnelle s'est opérée sans dépossession de la « maison » régnante, et la question de la propriété de l'État est demeurée indécise. La maison de Hohenzollern se considère encore aujourd'hui comme propriétaire de l'État prussien, et la maison de Habsbourg de l'État autrichien. Sans doute, les chefs de ces deux maisons souveraines ont consenti à leurs sujets des droits et des garanties, spécifiés dans les constitutions modernes de la Prusse et de l'Autriche, mais ils ne se sont point formellement dessaisis des droits héréditaires de possession et de gouvernement des États politiques fondés ou acquis par leurs ancêtres. Ce droit a continué de leur appartenir, en [93] dépit des changements apportés au mode de gestion de l'État. [25]
Les choses se sont passées autrement dans les pays où le gouvernement a été renversé parla révolution. En France, par exemple, la journée du 10 août 1792 a eu pour conséquence la confiscation de l'Etat politique, qui était la propriété de la maison de Bourbon, au profit de la nation, c'est à-dire de l'ensemble des consommateurs politiques. L'État et toutes ses appartenances immobilières et mobilières ainsi que tous ses droits sont devenus des « propriétés nationales ». Depuis le 10 août 1792, l'État appartient, en vertu du droit de conquête populaire, non plus à la maison de France, mais à la nation française.
Mais la nation française, ou, pour être plus exact, la collection d'individus qui prétendaient la représenter et qui agissaient en son nom, a eu beau confisquer l'établissement politique de la maison de France, avec tout le matériel et tous les droits qui y étaient attachés, elle ne pouvait exploiter cette entreprise elle-même, comme le faisait la tribu primitive. N'en déplaise aux partisans du « gouvernement direct », la nature des choses s'y opposait. On conçoit que les quelques centaines de membres de la tribu participass ent dans la mesure de leurs moyens à la gestion de ses affaires; on ne conçoit pas que tous les membres d'une nation de plusieurs millions d'hommes puissent prendre part à son gouvernement. Les entreprises politiques ne diffèrent pas en ce point des entreprises industrielles et commerciales. Supposons que la nation française juge à propos de [94] confisquer, avec ou sans indemnité, l'industrie du coton, il est clair que tous les Français ne pourront pas s'occuper de la fabrication des cotonnades. Cette fabrication exige des aptitudes et des connaissances spéciales qu'ils ne possèdent pas tous; elle ne peut en outre être desservie, sous le régime économique de la division du travail, que par un personnel limité et concentré dans un nombre restreint de fabriques. En admettant que des législateurs communistes décidassent cependant que tous les Français en possession de leurs droits civils seraient appelés à y participer, le plus grand nombre d'entre eux s'acquitteraient fort mal de leur tâche, ou négligeraient de la remplir s'ils n'y étaient pas contraints, car elle les détournerait, — sans pouvoir leur accorder à tous une compensation suffisante, — de l'industrie qui leur fournit leurs moyens d'existence. .Qu'aurait donc à faire la nation française, en admettant qu'elle eût confisqué à son profit l'industrie du coton? De deux choses l'une, ou elle devrait en confier l'exploitation, dans des conditions à déterminer, à une maison ou à une compagnie possédant les ressources, les connaissances et l'expérience nécessaires à la pratique de cette industrie, ou elle devrait en organiser l'exploitation pour son compte. Il est permis de douter toutefois qu'elle réussît à établir cette exploitation d'une manière économique et efficace. Ajoutons que plus elle serait nombreuse, moins elle aurait de chances d'y parvenir.
C'est ainsi, au surplus, que les choses se sont passées dans les pays où la nation s'est emparée de l'établissement politique : ou bien elle en a concédé la gestion à une « maison », sous des conditions que le chef de cette maison a acceptées, en jurant d'observer, à peine de déchéance, la « constitution » dans laquelle elles se trouvaient spécifiées: c'est le régime de la monarchie constitutionnelle; ou bien la nation s'est chargée, nominalement du moins, de gérer [95] elle-même son établissement politique : c'est le régime de la république.
II. La monarchie constitutionnelle et son mécanisme. — Analysons d'abord rapidement le mécanisme des monarchies constitutionnelles, dans ses parties essentielles, savoir: 1° le pouvoir royal; 2° le corps électoral; 3° le parlement; 4° les libertés et les garanties constitutionnelles. Nous verrons ensuite comment fonctionnent ces différentes pièces du système et pourquoi ce système n'a point répondu aux espérances qu'il avait fait concevoir.
§ 1er Le pouvoir royal. — Tandis que, dans les monarchies de l'ancien régime, le roi tire son pouvoir ou son autorité de son droit de propriété; dans les monarchies constitutionnelles, ce pouvoir dérive d'un contrat passé entre la nation et le chef de la maison à laquelle elle concède la gestion de son établissement politique. Tantôt ce contrat résulte d'un accord fait avec la maison anciennement en possession de l'Etat, à laquelle la nation, émancipée et se considérant comme maîtresse de disposer de sa clientèle politique, confirme cette possession, sous des conditions et des garanties spécifiées dans une constitution; tantôt il est conclu, après la déchéance de la maison possédante, avec une nouvelle maison. Dans l'un et l'autre cas, les deux parties contractantes s'appliquent, chacune de son côté, à obtenir ou à imposer les conditions qu'elles regardent, à tort ou à raison, comme les plus conformes à leur intérêt; la maison s'efforce de conserver ou d'acquérir la plus grande somme de pouvoir, la nation d'en céder le moins possible. Si, comme en Prusse, la maison peut compter encore sur l'appui d'une aristocratie puissante, d'une administration et d'une armée fidèles, elle gardera l'essentiel du pouvoir pour n'en céder que les apparences; si, au contraire, une révolution a fait tomber l'État politique entre les mains de la nation, ceux qui stipuleront en son nom ne manqueront pas [96] de lui réserver la réalité du pouvoir pour n'en laisser que les apparences à la maison contractante. Tel a été le cas en France et en Belgique après les révolutions de juillet et septembre 1830. En vertu des théories les plus accréditées, c'est dans ce cas seulement que le régime constitutionnel existe dans toute sa pureté.
Il y a cependant un trait de ressemblance commun à toutes monarchies constitutionnelles : c'est l'établissement d'une liste civile. Dans une monarchie patrimoniale, le roi, comme tout autre propriétaire exploitant d'une entreprise, vit du. revenu de son exploitation; s'il dépense moins que ce revenu, son épargne va grossir le Trésor royal; s'il dépense davantage, il est seul responsable de ses dettes, quoiqu'il en fasse retomber d'habitude le fardeau sur ses sujets. Dans une monarchie constitutionnelle, le revenu du roi est entièrement distinct de celui de l'établissement politique dont il est le chef nominal. Cet établissement est exploité désormais pour le compte de la nation. Si les recettes dépassent les dépenses, c'est elle qui profite de la différence; si les dépenses excèdent les recettes, si des emprunts sont nécessaires pour combler les déficits, c'est elle qui supporte la responsabilité de la « dette publique ». Le roi reçoit, sous la dénomination de liste civile, une part fixe et assurée dans le produit éventuel ou aléatoire de l'exploitation, c'est-à-dire un salaire au lieu d'un/»'0/îf. Les listes civiles des monarchies constitutionnelles ont été généralement fixées à un taux assez élevé pour que les maisons régnantes n'aient point eu à se plaindre de ce changement; si des rois prodigues se trouvent à l'étroit dans leur liste civile, les rois économes peuvent réaliser de belles épargnes, et d'ailleurs la nation se charge communément de doter leurs enfants, sans parler des palais qu'elle met à leur disposition et des autres menus avantages qu'elle leur accorde.
[97]
En revanche, la puissance royale se trouve singulièrement diminuée, au moins dans les pays où le régime constitutionnel a été établi dans toute sa pureté. Le roi demeure nominalement le chef de l'État; il nomme à tous les emplois, sanctionne les lois, commande les armées de terre et de mer, il a le droit de grâce, il est inviolable et irresponsable; mais tous ses actes sont nuls et non avenus s'ils ne sont point revêtus de la sanction d'un ministre responsable. Il nomme ses ministres, mais il est obligé de les prendre dans la majorité du parlement. C'est donc la majorité qui possède la réalité du pouvoir, dont il n'a que l'apparence; et la majorité, à son tour, dépend du corps électoral qui est ou est censé être le véritable souverain.
§ II. Le corps électoral. — La nation, maintenant propriétaire de l'État politique, en a concédé la gestion à une maison, mais à la condition de conserver la haute main sur la direction des affaires publiques, ou, pour nous servir de la phraséologie consacrée, de se gouverner elle-même. Seulement il résulte de la nature des choses que l'unique fonction qu'elle puisse pratiquement remplir consiste à nommer des représentants ou des mandataires chargés de gouverner à sa place. C'est le « régime représentatif », qui est commun aux monarchies constitutionnelles et aux républiques de l'époque actuelle.
Mais comment le corps électoral doit-il être composé? Peut-il comprendre la nation tout entière? Non, cela est évident. Il est naturel et logique d'en exclure d'abord les mineurs, les enfants, les femmes, les aliénés, qui, étant jugés incapables de gérer leurs affaires privées, doivent l'être à fortiori de participer à la gestion des affaires publiques, à la fois plus importantes et plus compliquées. On n'a pas cru devoir s'arrêter à cette première élimination, et on avait d'ailleurs de bonnes raisons à faire valoir pour opérer un second triage. Il n'était que trop avéré que, [98] même parmi les nations les plus avancées en civilisation, la masse de la population demeurait encore plongée dans l'ignorance, et ne possédait guère que des notions grossières et erronées sur la nature et le rôle d'un gouvernement; qu'en limitant même son intervention à l'élection des membres de la représentation nationale, on s'exposait à ce que cette masse inculte et qu'il serait facile d'égarer en flattant ses préjugés et en excitant ses convoitises, se montrât incapable de faire de bons choix et qu'elle en fît de détestables. En conséquence, on déclara cette masse, réputée incapable et qui l'était en effet, politiquement mineure. Restait la difficulté de savoir à quel signe on pouvait reconnaître la majorité politique. Cette difficulté, on la résolut par l'établissement d'un cens électoral plus ou moins élevé, parfois avec quelques conditions accessoires. On supposait que la classe qui payait ce cens, et qui se composait de propriétaires fonciers, de fermiers, d'entrepreneurs d'industrie, de commerçants, de rentiers et de l'élite des professions libérales, réunissait les conditions requises pour s'occuper utilement des affaires publiques, savoir l'indépendance de situation et la capacité politique, et on lui conféra le monopole du droit électoral, sauf à élargir successivement ce monopole, à mesure que les classes exclues seraient jugées capables d'y participer.
Ce n'est pas tout. Pour que le régime représentatif soit parfaitement sincère, que faut-il? Il faut que la représentation soit toujours l'expression fidèle des sentiments, des idées et des volontés, autrement dit de l'opinion de ceux qui l'ont élue. Il faut, par conséquent, qu'elle se renouvelle aussi fréquemment que possible, afin que les changements qui se produisent dans l'opinion des mandants se répercutent aussitôt chez les mandataires. Sinon, il pourrait arriver que ceux-ci vinssent à se trouver en désaccord avec ceux-là et que la nation se trouvât obligée de subir, [99] comme il arrivait sous l'ancien régime, une politique intérieure et extérieure, opposée à son esprit et à sa volonté, et dont elle serait cependant obligée de supporter la responsabilité et de payer les frais. On stipula donc que le corps électoral serait appelé à renouveler périodiquement la représentation nationale, et on s'ingénia à fixer une époque qui ne fût ni trop longue ni trop courte. Trop longue, elle aurait eu l'inconvénient de laisser l'esprit du mandataire en retard sur l'esprit du mandant; trop courte, elle aurait pu nuire aux intérêts économiques de la nation, en multipliant les crises qui accompagnent d'ordinaire les agitations électorales.
§ 3. Le parlement. — La nation est propriétaire de l'État. mais le plus grand nombre de ses membres étant déclarés politiquement mineurs, c'est le corps électoral composé de citoyens possédant ou étant supposés posséder la capacité requise, qui est chargé d'exercer, au nom et dans l'intérêt dela communauté, ce droit de propriété politique. Mais, à son tour, il ne peut l'exercer que par voie de délégation, et c'est l'assemblée ou le parlement des délégués qui gère en ses lieu et place les affaires de la nation. Comment est constitué le parlement et quel est son rôle dans une monarchie constitutionnelle? Partout, sauf en Grèce, le parlement est partagé en deux chambres. La première, Chambre des lords, Chambre des pairs ou Sénat, n'émane point du corps électoral ou n'en est que l'émanation partielle; elle représente une aristocratie de propriétaires comme en Angleterre ou de censitaires comme en Belgique, ou bien elle est à la nomination du souverain et représente seulement la maison royale ou la dynastie; son autorité est naturellement proportionnée à l'importance des intérêts particuliers dont elle est l'expression et à la place qu'ils occupent dans le faisceau des intérêts de la communauté; c'est assez dire que cette autorité est secondaire, parfois même presque [100] nulle. La prépondérance appartient à la seconde chambre qui représente le corps électoral ou la « nation majeure ». Nominalement, le gouvernement de l'État appartient au chef de la maison à laquelle il a été concédé; il est, suivant l'expression consacrée, « le gouvernement du roi », mais il doit, en fait, être l'émanation de la Chambre des représentants de la nation. Comment ce problème est-il résolu? Par l'accord obligatoire du roi avec la majorité de la Chambre. Quoique la constitution laisse le roi libre de choisir les ministres qui dirigent les services publics et qui sont responsables de ses actes, il ne peut se dispenser de les prendre dans cette majorité. En effet, c'est la Chambre qui vote le budget; il dépend de la majorité d'arrêter instantanément les rouages de la machine gouvernementale en refusant de voter les recettes et les dépenses, les appointements des fonctionnaires et même la liste civile. Un ministère auquel la majorité refuse sa confiance et ses votes se trouve dans l'impossibilité de fonctionner à moins de dissoudre la Chambre, — droit que la constitution accorde d'habitude au roi; — mais si le corps électoral la renvoie, composée des mêmes éléments, il faut bien que le roi, qu'il le veuille ou non, congédie son ministère et en prenne un autre dans la majorité. C'est donc, en réalité, comme si la nation ellemême choisissait les hommes chargés de la gouverner. Le roi n'est qu'un intermédiaire, une sorte d'électeur du haut personnel politique, avec mandat impératif de nommer les bommes que la nation choisirait elle-même, si la chose était pratiquement faisable. Ce mécanisme est, à coup sûr, fort ingénieux, et l'on conçoit qu'il ait été l'objet d'un engouement général à une époque où la nation, lasse d'être gouvernée par un roi qui abandonnait à des favoris ou à des favorites le choix de ses ministres, aspirait à se gouverner elle-même. Le régime constitutionnel et parlementaire semblait résoudre ce problème en réduisant le roi à une [101] fonction dans laquelle sa volonté devait se plier à celle de la nation et se borner à l'exprimer, enfin en conservant de l'ancienne monarchie les apparences majestueuses et le décor pompeux, que l'on croyait indispensables au prestige du pouvoir.
§ 4. Les libertés et les garanties constitutionnel/es. — Dans l'ingénieux mécanisme que nous venons d'esquisser, le pouvoir souverain appartient à la majorité du corps électoral et il est exercé par ses délégués, formant la majorité parlementaire, dans laquelle le roi est tenu de choisir ses ministres. Mais ne pouvait-on pas craindre que les majorités n'abusassent de leur pouvoir pour opprimer les minorités, en vue de perpétuer leur domination ou de satisfaire leurs animosités et leurs rancunes? Ne fallait-il pas, soil dans l'intérêt des classes exclues de l'électoral ou des minorités, accorder aux citoyens certains droits constitutionnels auxquels les majorités n'eussent pas le pouvoir de toucher, ou qui ne pussent être modifiés que par une revision solennelle de la constitution? Tels furent l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics, le droit de pétition, le droit de réunion et d'association et la liberté de la presse, auxquels enjoignit même, dans certains pays, la liberté de l'enseignement et des cultes. [26] On ne prévoyait point, à la vérité, que ces droits et ces libertés pourraient être singulièrement diminués par les lois destinées à en « régler l'exercice ». Mais ne semblait-il pas que l'on eût fait tout ce qui dépend de la prévoyance humaine pour empêcher le retour des abus et de l'oppression de l'ancien régime, et pour assurer le fonctionnement utile et vrai du gouvernement de la nation pa elle-même?
III. Résultats de l'expérience de la monarchie constitutionnelle. — A l'époque où les monarchies constitutionnelles ont commencé à remplacer en Europe les monarchies absolues, on était généralement convaincu qu'elles résolvaient d'une manière définitive le problème du gouvernement. En tout cas, ne constituaient-elles pas un progrès manifeste sur l'ancien régime? Quoi de plus barbare, en eil'et, qu'un régime politique qui mettait une nation à la merci d'un seul homme? Le roi, propriétaire de l'État et chef du gouvernement, était le maître de disposer de la vie et de la fortune de ses sujets, sans qu'ils eussent le droit et encore moins le pouvoir de résister à son « bon plaisir ». N'avait-il pas à sa solde et à sa dévotion une administration [103] et une armée nombreuses qu'il recrutait à sa convenance, non seulement dans le pays, mais encore à l'étranger ; et n'empêchait-il pas avec un soin jaloux, sous le prétexte qu'on ne pouvait pas tolérer un État dans l'Etat, tous les groupements de forces qui auraient pu constituer des noyaux de résistance à son despotisme? Il pouvait, par exemple, dans le seul intérêt de la grandeur et du prestige de sa « maison », entreprendre une guerre dont la nation avait à payer les frais, sans en retirer le moindre profit. Il pouvait multiplier les sinécures pour complaire à ses favoris et à ses favorites; Aucun recours n'était possible contre l'abus qu'il pouvait faire de son pouvoir absolu : la critique même la plus modérée de ses actes, des faits et gestes de son entourage, des vices et de la corruption de son administration, exposait aux pénalités les plus arbitraires et les plus dures. Non seulement la nation n'avait aucun moyen de faire prévaloir son opinion dans les affaires qui l'intéressaient le plus, mais il lui était interdit de l'exprimer. — Sous le nouveau régime, grâce à la vertu efficace d'un mécanisme politique perfectionné, cette oppression et ces abus séculaires disparaissent comme par enchantement. De l'institution de la royauté, on ne conserve que ce qu'elle a d'utile, la stabilité résultant de la continuité héréditaire du pouvoir royal, mais si le roi règne, c'est la nation qui gouverne. Tandis que l'opinion publique était comptée pour rien sous l'ancienne monarchie, maintenant elle est tout, et la presse, son organe, est devenue un des grands pouvoirs de l'Etat. Ce n'est plus l'intérêt d'une « maison » qui est l'objectif de la politique intérieure et extérieure du gouvernement, c'est l'intérêt général de la nation. Or quel est cet intérêt? A -l'extérieur, c'est de vivre en paix avec tous les autres peuples; c'est d'éviter des guerres toujours stériles et coûteuses; à l'intérieur, c'est de pratiquer une rigoureuse économie dans l'administration des services publics, tout en les [104] rendant aussi efficaces que possible ; c'est de supprimer les sinécures et de réduire le nombre des emplois au strict nécessaire; c'est, en un mot, d'approcher incessamment, par des réformes judicieuses et opportunes, de l'idéal d'un bon gouvernement. Voilà l'intérêt de la nation, et voilà la tâche qu'elle impose à ceux qui la gouvernent, sans qu'il leur soit possible de s'y dérober; car c'est elle qui les nomme et qui les destitue. Telle est, en effet, la perfection ingénieuse du mécanisme constitutionnel et parlementaire, que le gouvernement est toujours inévitablement et, pour ainsi dire, mécaniquement l'expression de la volonté de "la nation, ou du moins de la majorité des citoyens possédant la capacité politique et constituant le corps électoral. De plus, ne doitil pas, par la vertu de ce même mécanisme, arriver toujours aux mains de l'élite intellectuelle et morale du pays? Les différents groupes d'opinions qui existent dans le corps électoral ne sont-ils pas intéressés à choisir les mandataires les plus capables et les plus estimables? Et le groupe qui se trouve en majorité dans le parlement n'est-il pas à son tour intéressé à être représenté dans le gouvernement par ses individualités les plus éminentes? N'est-ce pas une double sélection qui porte nécessairement au pouvoir les hommes les plus dignes de l'exercer? En supposant même que les choses viennent à se passer autrement, que le pouvoir tombe entre des mains indignes, que des gouvernants aveugles et infidèles veulent imposer à la nation une politique contraire à ses intérêts et à sa volonté, la tribune et la presse libres ne sont-elles pas là pour les rappeler à leur devoir et au sentiment de leur responsabilité? Enfin, les électeurs ne se chargent-ils pas d'en faire justice? En attendant, les minorités et les citoyens, électeurs ou non, ne sont-ils pas protégés au moyen des droits et libertés garantis par la constitution, contre tout abus de pouvoir? Bref, ce mécanisme ingénieux, quoique un peu compliqué, qui permet [105] aux nalions de se gouverner elles-mêmes, et de s'assurer ainsi le meilleur gouvernement possible, n'est-il pas une des plus belles inventions du génie humain?
Que l'on se reporte à un demi-siècle en arrière, et l'on se convaincra que nous n'exagérons point l'expression des espérances des théoriciens et des hommes d'État du nouveau régime. Ces espérances se sont-elles réalisées? Quels ont été jusqu'à présent les résultats de l'expérience de la monarchie constitutionnelle? Comment ont fonctionné les différentes parties de ce mécanisme perfectionné?
Le pouvoir royal d'abord. Les « maisons » auxquelles les nations devenues propriétaires de leur Etat politique en ont concédé ou continué la gestion héréditaire, sous des conditions spécifiées dans une constitution, ces maisons étaient, pour la plupart, anciennement propriétaires d'États. On leur a donné, non sans raison, la préférence sur des maisons nouvelles. Elles possédaient, en effet, l'habitude et les traditions d'une industrie qu'elles avaient pratiquée depuis des siècles, et dans laquelle elles avaient acquis une réputation ordinairement méritée ; ellesavaientdes relations de longue date avec les autres propriétaires ou chefs d'États; enfin, elles possédaient pour la plupart une fortune assise, elles n'avaient point de parenté pauvre à caser et à enrichir. C'étaient là des avantages réels que l'on ne rencontrait point chez les parvenus de la politique. En revanche, on pouvait craindre qu'un roi de vieille souche, surtout dans un pays où sa maison avait possédé la souveraineté, n'acceptât point sans regret et sans esprit de retour à l'ancien régime, les nouveautés constitutionnelles, et, en particulier, qu'il ne se résignât point sincèrement à renoncer à la réalité du pouvoir pour n'en conserver que l'apparence. Cette crainte n'était malheureusement point sans fondement. Si les rois constitutionnels se sont arrangés volontiers de la situation matérielle qui leur était faite, s'ils se sont [106] accommodés d'une liste civile fixe, au lieu d'une part arbitraire dans les résultats de l'exploitation de l'Etat, sauf à se faire accorder des allocations supplémentaires pour doter leurs enfants, etc., ils ont eu plus de peine à accepter la quasiannulation de leur pouvoir souverain. Les Bourbpns de la branche aînée n'ont pas su s'y résigner, et le roi Charles X a essayé de briser par un coup d'État les liens étroits dans lesquels la Charte avait enserré le pouvoir royal. L'insuccès de cette tentative n'a point été pour son successeur une leçon suffisante. Les liens que Charles X voulait briser, Louis-Philippe s'efforça de les relâcher en faisant prévaloir sa volonté personnelle dans la direction des affaires. De là des tiraillements qui affaiblissaient le pouvoir et devaient contribuer à la chute de la monarchie de Juillet. Le roi Léopold Ier de Belgique s'est montré plus habile sans se résigner davantage à un rôle effacé, et peut-être son expérience des grandes affaires a-t-elle suppléé utilement au défaut de préparation d'un personnel politique improvisé par la révolution. Mais, de deux choses l'une : ou le roi constitutionnel s'efforce de franchir les limites étroites que la constitution a assignées à son pouvoir, et, dans ce cas, son intervention indue dans la direction des affaires est presque toujours nuisible ; ou il se contente du rôle effacé qui lui est dévolu, et, en ce cas, ne peut-on pas lui reprocher de coûter trop cher?
Cependant, la royauté n'est qu'un rouage secondaire dans le mécanisme de la monarchie constitutionnelle, et ce n'est pas, à tout prendre, celui qui fonctionne le plus mal. L'âme ou le moteur de la machine, c'est le corps électoral agissant au nom de la nation, maintenant propriétaire de l'Etat. A la vérité, le rôle du corps électoral se réduit à nommer périodiquement des mandataires chargés de gérer cette propriété et à surveiller leur gestion; mais encore faut-il que les électeurs aient la volonté et la capacité requises [107] pour le remplir, qu'ils soient pénétrés du sentiment de leurs devoirs politiques, car ils n'agissent pas seulement pour eux-mêmes, ils agissent encore pour la « nation mineure », et ils ne doivent avoir en vue que l'intérêt général. On conçoit que l'aptitude à exercer le droit électoral, en remplissant le devoir qu'il implique, diffère selon les pays et les époques, comme aussi selon la composition du corps électoral. A cet égard, les différences sont sensibles, et le corps électoral de l'Angleterre, par exemple, est certainement de tous les souverains collectifs celui qui se montre le moins au-dessous de sa tâche. 11 est incomparablement supérieur à ses collègues du continent, quoiqu'il ne se soit pas amélioré en devenant plus nombreux, et c'est en grande partie à cette cause que l'Angleterre est redevable de la durée et du bon fonctionnement de son régime constitutionnel.
Le défaut commun et caractéristique de tous ces souverains collectifs, c'est la paresse à remplir leurs fonctions électorales, si simples qu'elles soient, quand l'intérêt général de la nation seul est en cause. Cette paresse s'explique, si elle ne se justifie point, par la situation particulière de la grande majorité des membres du corps électoral, même quand celui-ci est recruté seulement dans les couches supérieures de la société. Chacun est absorbé par le soin de ses affaires privées, et, à l'époque de concurrence où nous vivons, ce soin devient de plus en plus impérieux. Sans doute, les affaires publiques intéressent tous les membres d'une nation : selon qu'elles sont bien ou mal dirigées, le bien-être de chacun s'en trouve augmenté ou diminué, mais l'influence qu'exerce cette direction bonne ou mauvaise n'est point immédiate ; souvent elle ne se fait sentir qu'après un long intervalle et sans qu'il soit facile de rattacher les effets que l'on sent aux causes que l'on a cessé d'apercevoir. Ajoutons que la masse des électeurs n'a aucune connaissance du métier qu'elle est appelée à exercer, [108] qu'elle ignore même les premiers éléments de la science el de l'art de la politique; elle est incapable de se rendre compte de la valeur des programmes que lui présentent les candidats à la représentation nationale, de décider, en connaissance de cause, lequel est le plus conforme à l'intérêt général; il y a apparence même qu'elle serait plutôt séduite par t-eux qui le sont le moins; enfin, elle n'est que médiocrement portée à se mêler d'une affaire qui lui coûte des frais de déplacement et du temps, et dans laquelle elle ne voit pas clair. De là, sa paresse à aller voter. Cette paresse sidissipe toutefois aussitôt que l'intérêt particulier vient à être mis en jeu, car cet intérêt l'électeur le connaît, il le comprend bien ou mal, tandis qu'il ne connaît pas l'intérêt général. Il s'empressera d'aller voter si, en échange de son vote, on lui promet soit la construction, aux frais de l'État, d'une route ou d'un canal qui donne une plus-value à ses propriétés, soit une protection spéciale pour son industrie, une place ou une décoration pour lui ou quelqu'un des siens, ou même si on lui offre un régal ou une gratification en argent, qui compense ce qu'il considère comme une simple perte de temps. Il ira voter encore peut-être si l'on fait appel à ses passions, à ses préjugés, à ses haines; mais on peut se demander si, dans cet état d'esprit, il est capable de faire un bon choix et si son vote n'est pas pire que son abstention. C'est, pour tout dire, un roi fainéant et ignorant et cependant cupide et passionné. Faut-il donc s'étonner si, comme les monarques de l'ancien régime auxquels il a succédé, il se laisse duper par des courtisans intéressés à exploiter sa paresse, son ignorance et ses passions? Ces courtisans du peuple souverain, ce sont les « politiciens ».
IV. Les politiciens et les partis politiques.—Cette catégorie d'hommes qui vivent de la politique ou qui aspirent à en vivre a certainement sa raison d'être ; et elle a existé [109] de tout temps ou, pour mieux dire, depuis l'époque où, sous l'influence des progrès de la machinery de la production , les fonctions de tout ordre se sont séparées et spécialisées. Il se constitua alors une classe vouée au gouvernement et à la défense de l'État et qui trouva dans l'exercice de ces fonctions nécessaires ses moyens d'existence. Lorsque les Etats issus des invasions barbares eurent été unifiés et centralisés, lorsque le roi fut devenu le maître et le dispensateur des fonctions politiques, administratives et militaires les familles qui en vivaient durent s'appliquer à obtenir la faveur du monarque et, dans les emplois inférieurs,celle des favoris du monarque. Quand le souverain était un homme actif, intelligent et ferme, ce mode de recrutement des emplois publics donnait de bons résultats; en revanche, il ne manquait pas d'en donner de mauvais, sous un souverain ignorant, faible et vicieux. Alors le personnel dirigeant de l'État et, de proche en proche jusqu'aux fonctionnaires inférieurs, allait s'abaissant et se corrompant.
Sous l'ancien régime, le recrutement du personnel politique, administratif et militaire dépendait donc, comme dans toute autre entreprise, du roi proprétaire-exploitant de l'État. Sous le nouveau régime, l'Etat n'appartient plus au roi, il appartient à la nation, et c'est, en conséquence, la partie politiquement majeure de la nation, c'est-à-dire le corps électoral, qui est chargé de l'exercice des droits afférents à la propriété de l'État. Ce n'est plus au roi, devenu un simple comparse, et aux gens de sa cour qu'il faut s'adresser pour arriver aux emplois et aux honneurs, c'est au corps électoral et à ses mandataires. Voilà toute la différence, et cette différence n'est pas aussi considérable qu'on pourrait se l'imaginer. L'expérience a démontré que la flatterie, l'intrigue et les autres vices de cour n'étaient pas à mettre au rebut et que, sous le nouveau régime comme sous l'ancien, le plus sûr moyen de parvenir, c'est de flatter [110] les goûts, les passions et les préjugés du monarque collectif, sans se préoccuper d'ailleurs autrement des intérêts de l'État.
La transformation de la souveraineté, son attribution à un souverain collectif, a déterminé une transformation correspondante dans la constitution et le mode d'opération des groupes ou des coteries qui se disputaient autrefois la. faveur du monarque et qui s'efforçaient de le dominer dans le but de s'emparer, à leur profit exclusif, de l'exploitation de l'Etat. Ces associations, formées en vue de monopoliser les emplois et les avantages de tous genres que confère la possession du pouvoir, n'ont pas disparu; elles sont devenues des « partis politiques » et, sous cette nouvelle forme, adaptée au régime constitutionnel, elles ont agrandi leurs cadres et acquis une puissance qu'elles n'avaient jamais possédée.
De quels éléments sont composés les partis politiques? Dans les monarchies constitutionnelles, où le corps électoral comprend seulement la classe aristocratique et la classe moyenne, on a vu tout d'abord se constituer deux partis, représentant les intérêts de ces deux classes et imbus de leur esprit. La classe aristocratique, à laquelle les révolutions ont enlevé le monopole des emplois et des faveurs, est généralement en décadence, et elle ne parvient à conserver son influence diminuée qu'eu s'alliant à une autre puissance déchue, le clergé; la classe moyenne, au contraire, enrichie par une industrie en progrès, a vu croître rapidement sa puissance et, à son tour, elle aspire au monopole de la gestion de l'État. Les deux partis qui en sont issus forment de véritables armées; ils ont leurs états-majors, recrutés, l'un principalement dans les familles qui étaient en possession des hauts emplois et de l'influence politique sous l'ancien régime, l'autre dans les nouvelles couches bourgeoises et surtout parmi les membres des professions [111] libérales. L'habitude de la parole élant particulièrement nécessaire sous ce nouveau régime de souveraineté collective, les avocats n'ont pas manqué de fournir un contingent considérable aux états-majors politiques. L'état-major, composé des « politiciens » les plus actifs ou les plus habiles dans le métier, organise le parti et dirige tous ses mouvement en vue de la conquête ou de la conservation du pouvoir. Chaque parti a sa raison sociale et son programme, appropriés aux intérêts et à l'esprit de la fraction du corps électoral dans laquelle il se recrute. Communément le parti constitué au sein de l'ancienne classe gouvernante prend le nom de conservateur, le parti issu des nouvelles couches bourgeoises s'appelle le parti libéral ou progressiste; mais il ne faut pas se fier aux étiquettes; il n'est pas sans exemple de voir les conservateurs s'allier aux révolutionnaires quand l'intérêt du parti l'exige, et les libéraux arrivés au pouvoir recourir aux mesures les moins libérales pour assurer leur domination. Dans la confection de leurs programmes, les partis sont obligés de se conformer, au moins en apparence, à l'esprit et à la volonté de leurs électeurs. S'ils veulent conserver leur influence, ne faut-il pas en effet que leur programme réponde à la « demande » de la classe sur laquelle ils s'appuient; qu'il donne pleine satisfaction à ses intérêts, à ses préjugés, à ses craintes, en grossissant les avantages qu'elle ne manquera pas de tirer du triomphe du parti, en exagérant plus encore les dommages et les dangers auxquels elle se trouvera exposée si le parti concurrent vient à l'emporter? L'exagération, pour ne pas dire le mensonge, est l'arme naturelle et nécessaire des partis. Les conservateurs accusent les libéraux de compromettre par des innovations téméraires les intérêts sacrés de la propriété, de menacer l'existence de la famille et de conduire la société aux abîmes de la révolution. Les libéraux accusent les conservateurs, surtout dans les pays [112] où le clergé a conservé une grosse part de son influence, de vouloir rétablir les institutions oppressives et surannées de l'ancien régime, la mainmorte, l'inquisition et le reste. Cependant, le programme est toujours conçu dans des termes assez vagues et élastiques pour ne pas devenir un embarras et une gêne; les promesses et les engagements positifs sont remplacés par des effusions patriotiques et des protestations de dévouement cà l'intérêt public. La nation résumée dans le corps électoral ne pouvant exercer son droit de souveraineté que par le choix de ses mandataires, l'objectif des partis c'est d'obtenir la majorité dans les élections, et toute leur organisation, tous leurs efforts convergent vers ce but. Chaque parti est gouverné par un comité où siègent ses notabilités politiques, et auquel est confiée la direction générale de la campagne électorale.
Dans tous les arrondissements électoraux, des souscomités en relation avec le comité dirigeant se chargent de désigner les candidats qui présentent le plus de garanties au parti et qui ont le plus de chances de l'emporter, quelle que soit leur valeur intellectuelle et morale. Le résultat de cette organisation, c'est d'enlever à l'électeur la liberté de son choix; car il est obligé, sous peine de perdre son vote, de le donner au candidat désigné par l'un ou l'autre des deux comités concurrents. La « souveraineté » passe ainsi presque tout entière aux mains des « politiciens ». Le corps électoral ne la possède plus qu'en apparence. C'est ainsi que dans un pays comme la Belgique, qui possède environ 100,000 électeurs, les élections sont faites par 5 ou 6,000 politiciens qui forment les cadres des deux partis en lutte pour la possession du pouvoir. A la vérité, les électeurs indépendants pourraient, s'ils en avaient la volonté, se soustraire à la sujétion des partis, mais ce serait à la condition de créer une organisation assez forte pour entrer en lutte avec eux. Toutes les tentatives qui ont été faites dans [113] ce but ont échoué, et cela se conçoit; l'intérêt général qu'il s'agissait de faire prévaloir est, à cause de son étendue même, un mobile plus faible que l'intérêt particulier d'uu parti, et on ne se dérange guère pour le servir. Enfin, le jour des élections arrive. Les deux armées politiques , savamment organisées et disciplinées, commandées par des chefs qui ont de longue main fait leurs preuves sur les champs de bataille électoraux, et qui ont sons leurs ordres des officiers et des sous-officiers rompus au métier, tous intéressés directement ou indirectement à la victoire, sont en présence. Aucun moyen honnête ou malhonnête n'est négligé pour enlever le vote. Ici, on intimide les électeurs par la menace de la damnation éternelle ou du non-renouvellement d'un bail, là par crainte du rétablissement des droits féodaux et de la dîme; on prodigue l'injure et la calomnie, on multiplie les promesses, sauf à les oublier après l'élection, et si les promesses demeurent sans effet, on achète tout simplement le vote des électeurs positifs et méfiants, à la barbe des lois respectables et sévères qui punissent la corruption. L'élection est faite. Si le parti en possession du pouvoir l'emporte, il est à peu près assuré de conserver la direction des affaires jusqu'aux élections suivantes. Si l'opposition demeure maîtresse du terrain électoral, elle s'empare du pouvoir à son tour.
L'exploitation de l'État, la jouissance des revenus et des avantages de tout genre que cette exploitation confère, voilà le fruit de la victoire, le butin du vainqueur. Ce butin est d'autant plus considérable que les attributions du gouvernement sont plus nombreuses et plus importantes, qu'il dispose d'un plus grand nombre de places et de faveurs. Il convient de remarquer cependant que le parti vainqueur ne peut pas toujours le distribuer entièrement entre ses membres. En remplaçant, dans tous les emplois publics, un personnel conservateur par un personnel libéral, et [114] vice versa, on s'exposerait non seulement à désorganiser les services, ce qui aux yeux d'un parti est une considération fort secondaire, mais encore à se créer dans le personnel congédié des adversaires irréconciliables. On est obligé de se contenter d'une portion du butin et cette portion est d'autant plus faible que le parti vainqueur lui-même est moins fort; c'est ainsi qu'au temps des invasions barbares, les conquérants se contentaient le plus souvent de confisquer à leur profit et de se partager la moitié ou les deux tiers des domaines conquis pour ne point pousser à quelque retour offensif désespéré des vaincus encore redoutables. Dans ces circonstances, le prix de la lutte se trouve diminué d'autant et l'acharnement à "se le disputer est moins vif. En revanche, cet acharnement s'accroît et les luttes politiques prennent un caractère particulier de violence dans les pays où la population est serrée et surtout où les professions libérales sont encombrées, où une foule d'avocats sans causes, de médecins sans malades, de déclassés de toute sorte, en quête de moyens d'existence, se ruent sur le gâteau des fonctions publiques.
L'attraction particulière qu'exercent ces fonctions pourrait sembler peu justifiée si l'on ne considérait que le taux des revenus dkects qu'elles procurent. Ces revenus ne sont point, en effet, supérieurs à ceux de l'industrie privée; ils sont même généralement moins élevés. Mais il faut remarquer qu'ils exigent une bien moindre somme d'intelligence et surtout d'activité. Les fonctionnaires et les employés de l'administration de l'État, sauf peut-être dans les rangs tout à fait inférieurs, ne fournissent pas en moyenne la moitié de la somme de travail effectif que l'industrie privée demande à ses serviteurs. De plus, dans les pays de suffrage restreint, où l'on n'est pas obligé de récompenser le vote de la classe vouée aux fonctions les plus modestes, les « petits emplois » ont conservé une [115] stabilité presque entière et le petit employé a sa retraite assurée dans ses vieux jours, tandis que l'ouvrier peut être congédié du jour au lendemain, et se trouve exposé à aller mourir à l'hôpital.
Quoique les situations politiques proprement dites soient précaires et assez médiocrement rétribuées, on s'explique aussi l'attraction extraordinaire qu'elles exercent, par l'influence, les relations, les profits indirects, les satisfactions d'amour-propre qu'elles procurent et le relief particulier qui s'y attache. Voici un avocat dont le nom était ignoré à quelques kilomètres de sa petite ville. Il devient député , puis ministre. Aussitôt le Moniteur publie ses moindres paroles, les reporters s'occupent de ses mouvements, les photographes étalent son portrait, le pays entier connaît son nom. Il figure au premier rang dans les cérémonies officielles, il est chamarré de décorations et de rubans de couleurs variées. Il est un personnage. S'il vient à succomber momentanément dans la lutte des partis, rien ne lui sera plus facile que de monnayer son titre d'ancien ministre et son influence de ministre futur, en entrant dans l'état-major de quelque grande compagnie financière ou autre. La politique, c'est le Sésame, ouvre-toi! qui donne accès à tout ce qui peut séduire l'ambition, la vanité et la cupidité de l'homme. Comment s'étonner qu'elle exerce un attrait irrésistible?
Grâce à leur organisation savante, à leur hiérarchie et à leur discipline, empruntées à celles des armées, et en flattant les passions grossières et les moins avouables du souverain collectif, les partis lui ont dicté le choix de ses mandataires. La représentation nationale se réunit. De quelle manière va-t-elle fonctionner? Quel objet aurat-elle en vue? Evidemment elle ne doit avoir en vue que l'intérêt général de la nation. Toutes les paroles et tous les actes des représentants du pays doivent être dirigés [116] exclusivement vers ce but, qui est aussi celui du gouvernement formé par la majorité, mais tenu avant tout d'observer la constitution et de subordonner toujours l'intérêt particulier de son parti à l'intérêt général. Voilà l'idéal du régime parlementaire. Seulement, cet idéal est-il réalisable? Si le souverain collectif était éclairé, s'il connaissait ses vrais intérêts et s'il surveillait avec une attention constante la gestion de ses affaires, peut-être les partis et le gouvernement seraient-ils obligés de se conformer à son opinion et à sa volonté. Mais îe souverain n'est point à la hauteur de son rôle; il est incapable et il semble avoir le sentiment de son incapacité, car il laisse aux « politiciens » le soin de s'occuper de ses affaires, sans s'y appliquer lui-même. Un gouvernement qui n'aurait en vue que l'intérêt général serait promptement renversé. Qu'il veuille opérer une réforrne d'utilité publique par exemple, il succombera à la peine. En effet, toute réforme vient se heurter à des intérêts particuliers, lesquels sont bien plus actifs à attaquer ceux qui les offensent que l'intérêt général n'est zélé à défendre ceux qui le servent. Un gouvernement réformateur ne manque pas d'être promptement renversé par la coalition du parti opposant qui repousse systématiquement toutes les mesures dont il n'a point pris l'initiative, avec les mécontents de son propre parti, que la réforme atteint dans leurs intérêts ou dans ceux de leurs commettants. Sans doute, la presse, les associations et les réunions libivs pourraient soutenir un gouvernement réformateur, mais à la condition d'être soutenues à leur tour par le « souverain ».
Si le souverain est incapable et indifférent, les associations et la presse sont sans force pour le servir, et il ne leur reste qu'à disparaître ou à s'enrégimenter au service des partis. Aussi qu'arrive-t-il? C'est que l'intérêt général disparaît derrière les intérêts de parti : les budgets, dont [117] l'étude devrait être l'objet principal de l'attention des mandataires de la nation qui en fournit l'étoffe, sont votés presque sans examen, nul ne s'occupe sérieusement de la manière dont sont gérés les services publics, la routine s'y perpétue, les abus y foisonnent. Les réclamations qui les concernent sont à peine écoutées, l'attention du parlement et des politiciens du dehors ne s'éveille que lorsqu'une « question de parti » vient à surgir, c'est-à-dire une question dont la solution est de nature à modifier les forces et l'ascendant respectifs des partis en présence, et par là même à assurer à l'un d'eux, au détriment de l'autre, la possession et la distribution du « butin ».
Cependant, à mesure que le vice naturel de ce régime, savoir l'incapacité politique et l'indifférence du souverain collectif, produit ses effets inévitables, la nation, qui le considérait d'abord comme une panacée, s'en détache. On se met alors à chercher des remèdes à un mal dont on n'aperçoit pas la cause; et comment l'apercevrait-on? La souveraineté de la nation n'est-elle pas un dogme, et ne serait-ce pas blasphémer que de mettre en doute la capacité et la vertu de ce souverain dont on fait partie? Des théoriciens accrédités n'ont-ils pas été jusqu'à prétendre que le peuple est infaillible comme le pape? Alors, des hommes qui n'ont pas trouvé dans l'état-major des deux partis concurrents une situation à la hauteur de leur ambition, se joignent aux esprits sincères qui s'imaginent que le mal vient de la conservation d'un reste de monarchie et de l'attribution du monopole électoral aux classes supérieures, à l'exclusion de la masse du peuple. Un troisième parti se forme, dont l'objectif prochain ou lointain se résume en ces deux mots : république et suffrage universel. Ce parti manque rarement de protester de son respect de la légalité, mais il s'abstient plus rarement encore de recourir aux moyens révolutionnaires, quand l'occasion lui semble [118] propice. Ce n'est pas là, du reste, un reproche que l'on doive adresser exclusivement au'parti radical. L'expérience atteste qu'aucun parti ne recule devant l'emploi des moyens les plus énergiques et les moins scrupuleux pour arriver au pouvoir ou s'y maintenir : proscriptions, émeutes, insurrections, coups d'État, appels à l'intervention étrangère, etc. Le Prince de Machiavel est demeuré le code des politiciens modernes, comme il était celui de leurs devanciers. Quoi qu'il en soit, la destinée ordinaire des monarchies constitutionnelles a été de faire place à des républiques. Selon toute apparence, celles qui restent actuellement debout arriveront tôt ou tard à cette nouvelle étape, soit par une pente insensible, soit par une chute à pic. Est-ce un progrès? La république, appuyée sur le suffrage universel, est-elle une forme politique supérieure à la monarchie constitutionnelle appuyée sur le suffrage limité?
[119]
CHAPITRE V.
Les gouvernements modernes. La république et le suffrage universel↩
I. Formes et types des gouvernements modernes. — II. La république. En quoi elle se différencie de la monarchie constitutionnelle. § 1er. L'élection du chef do l'État. § 2. Le suffrage universel. — III. Le stathoudérat et l'Empire. — IV. Conclusion.
I. Formes et types des gouvernements modernes. — En laissant de côté les États de l'Asie et de l'Afrique qui n'appartiennent point à notre civilisation, nous trouvons, dans les États modernes, les trois formes politiques de ln monarchie absolue, de la monarchie constitutionnelle et de la république ; mais ces formes, malgré les différences qui les caractérisent, ne sont point nettement séparées. La monarchie constitutionnelle, telle qu'elle existe en Prusse par exemple, est une transition entre l'empire absolutiste de la Russie et la monarchie constitutionnelle de l'Angleterre ou de la Belgique. De même que le tsar, le monarque prussien se considère comme propriétaire de son État; la seule différence, c'est qu'il a consenti à accorder à ses sujets une certaine participation aux affaires publiques et quelques autres droits spécifiés dans une constitution, tandis que le tsar continue, nominalement du moins, à gouverner son État d'une manière autocratique. En Prusse, comme en Angleterre, et en Belgique, les pouvoirs politiques de la nation sont concentrés dans un corps électoral et délégués par celui-ci à un parlement. Seulement le pouvoir royal, [120] appuyé en Prusse sur une armée fortement disciplinée et sur une bureaucratie traditionnellement attachée à la maison souveraine, a conservé une influence et un ascendant qu'il a perdus dans la plupart des autres Etats constitutionnels. En Angleterre et en Belgique, la nation se considère comme propriétaire de l'État politique, et si elle en a concédé à perpétuité la gestion à une maison royale, c'est à la condition de s'en réserver la souveraineté effective. La monarchie constitutionnelle de ces deux pays ne diffère pas beaucoup plus de la république telle qu'elle existe en France, en Suisse et aux États-Unis, que de la monarchie mixte de la Prusse. Dans ces trois républiques, la nation souveraine, au lieu de concéder à perpétuité la gestion de l'État aune « maison », élit directement ou indirectement à des intervalles fixes le chef de l'État, mais le mécanisme du gouvernement n'est qu'une variante du type de la monarchie constitutionnelle. Toutefois, le corps électoral est plus étendu dans les républiques que dans les monarchies; elles ont adopté le suffrage universel, tandis que les monarchies s'en tiennent encore au suffrage limité; mais ni les unes ni les autres ne sont liées à un mode de suffrage plutôt qu'à un autre; dans la plupart des monarchies actuellement existantes, le corps électoral va s'élargissant et quelques-unes ne sont pas éloignées du suffrage universel; d'un autre côté, rien n'empêcherait les républiques de revenir au suffrage limité si elles en sentaient la nécessité.
Considérés au point de vue économique comme des « entreprises », les gouvernements actuels des peuples civilisés peuvent être rangés sous quatre types : 1° l'entreprise patrimoniale, sans limitation des pouvoirs de l'entrepreneur au profit de la nation sujette; 2° avec limitation de ces pouvoirs; 3° la concession ou l'affermage à un entrepreneur héréditaire, avec participation de la nation [121] propriétaire et souveraine; 4° l'exploitation en régie par la nation propriétaire et souveraine.
Le gouvernement russe appartient au premier type: c'est une entreprise patrimoniale, que le propriétaire exploitant dirige à sa volonté, comme s'il s'agissait d'une exploitation industrielle ou commerciale; il n'a point de liste civile; il tire son revenu ou il est supposé le tirer des profits de son entreprise; il n'a pas davantage de comptes à rendre à ses sujets, et ceux-ci n'ont aucun droit d'intervenir dans la gestion de l'État. Le gouvernement prussien appartient au second type; il est reslé une entreprise patrimoniale en ce sens que le roi continue à se regarder comme propriétaire de l'État, mais en renonçant à quelques-uns de ses droits au profit de ses sujets, et en consentant à en partager d'autres avec eux; au lieu de s'attribuer les profits de l'exploitation de son domaine politique, il se contente d'une liste civile fixe, en abandonnant le surplus, si surplus il y a, à la nation, devenue, en revanche, responsable des déficits; il exerce son pouvoir avec la coopération des représentants de la nation, il leur rend des comptes, soumet à leur approbation le budget des dépenses et des recettes de son État, ainsi que les lois civiles et autres sous lesquelles ses sujets sont appelés à vivre. L'Angleterre et la Belgique doivent être rangées sous le troisième type; l'état politique y a cessé d'être la propriété d'une maison, il appartient à la nation, laquelle en concède la gestion à un entrepreneur héréditaire sous des conditions spécifiées dans un contrat. Comme dans le cas de la monarchie patrimoniale limitée, ce contrat stipule, en faveur du roi, une liste civile, autrement dit des appointements fixes et assurés, quels que soient les résultats de l'entreprise; en revanche, la gestion effective des affaires de l'État est réservée au parlement qui représente la nation propriétaire et souveraine, et au ministère qui est issu de [122] la majorité du parlement et qui est déclaré responsable visà-vis de la nation. Enfin, nous trouvons le quatrième type en France, en Suisse et aux Etats-Unis. Ici, la nation n'est pas seulement propriétaire de l'État, elle l'exploite directement elle-même, en se constituant politiquement comme une mutualité ou une « société coopérative ». Elle délègue temporairement le droit de la gouverner à des assemblées et à un président.
II. La république. En quoi elle se différencie de la monarchie constitutionnelle. — La république se différencie principalement de la monarchie constitutionnelle en a ce qu'elle remplacé le roi héréditaire par un président élu, et substitué le suffrage universel au suffrage limité; encore avonsnous remarqué que le mode de suffrage est indépendant de la forme du gouvernement. Quels ont été les résultats de ces deux changements? Ont-ils constitué ou non des progrès dans l'assiette et le mécanisme du gouvernement?
§ 1er. L'élection du chef de l'État. — I1 semble, au premier abord, que la substitution d'un président élu, auquel on alloue des appointements relativement modestes, à un roi héréditaire pourvu d'une grosse liste civile, doive procurer une économie à la nation. Il n'en est pas nécessairement ainsi. Aux États-Unis, par exemple, où le président est élu tous les quatre ans par le suffrage universel, les frais électoraux sont évalués en moyenne à 4 ou 5 millions de dollars et la « crise électorale » coûte au monde des affaires une somme double ou triple de celle-là. Répartie sur les quatre années de la durée de la présidence, c'est une somme annuelle de 3 à 4 millions de dollars qu'il convient d'ajouter au salaire du président et qui en élève le montant presque au niveau de la liste civile d'un roi constitutionnel. [27] L'expérience atteste aussi que l'élection [123] ne procure pas plus sûrement que l'hérédité l'homme le plus capable et le plus digne d'exercer les fonctions de chef de l'Etat. Aux Etats-Unis, les conventions politiques des deux partis désignent ou, pour mieux dire, imposent aux électeurs les candidats dont elles ont fait choix, et ce choix se porte, le plus souvent, sur des hommes médiocres qui excitent moins de jalousie et sont plus facilement acceptés par l'état-major du parti. En outre, un roi constitutionnel n'appartient à aucun des partis qui se disputent le pouvoir, et s'il est pourvu d'une certaine dose de bon sens, il emploie l'influence morale que lui donne sa situation à modérer les conflits politiques et à empêcher les vainqueurs d'abuser par trop de la victoire. Le président élu, au contraire, est essentiellement un homme de parti, et il est choisi en cette qualité. Le plus souvent, il appartient au parti qui a la majorité dans le parlement, et alors les garanties que possède la minorité contre les abus de pouvoir de cette majorité ne se trouvent-elles pas singulièrement affaiblies? S'il arrive, par hasard, qu'il appartienne à la minorité, un conflit ne devient-il pas inévitable entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Le système de l'élection présente des inconvénients et des dangers bien autrement sérieux encore dans les pays, tels que l'Amérique du Sud, où le respect de la légalité existe à peine et où les populations n'ont que des notions confuses sur la nature du mécanisme constitutionnel. Le président élu profite volontiers de l'ascendant que lui procure sa double qualité de chef de l'armée et de l'administration civile pour [124] se débarrasser d'un parlement qui le gêne et se transformer en dictateur. Mais s'il y a dans l'armée quelque général influent qui aspire lui aussi à la dictature, il convoque ses partisans, fait un pronunciamiento, se met en campagne et le pouvoir devient le prix de la victoire, après une période plus ou moins longue de guerre civile et d'anarchie. Malgré ce qu'elle a de suranné, la monarchie héréditaire n'est-elle pas préférable?
§ 2. Le suffrage universel. — Peut-on affirmer aussi que le suffrage universel, qui sert de base à la plupart des républiques, s'il n'est point inhérent à cette forme de go uvernement, vaille mieux que le suffrage limité? Certes, le suffrage limité a ses imperfections et ses vices. Son défaut capital, c'est de conférer le monopole de la puissance politique à une petite classe, formée principalement de propriétaires fonciers, d'entrepreneurs d'industrie et de fonctionnaires, dont les intérêts se trouvent fréquemment en opposition avec ceux de la masse composée en grande partie de salariés qui est exclue de l'électorat. En outre, moins le corps électoral est nombreux, plus le vote de l'électeur a d'importance et plus s'élève aussi le prix qu'il en exige, aussitôt qu'il en connaît la valeur. Ordinairement, ce n'est pas avec de l'argent qu'on le paye; c'est avec des privilèges industriels et commerciaux, des subventions, des décorations, et surtout, avec des places. Après chaque élection, les élus ont une masse de dettes de ce genre à acquitter, et ils sont obligés d'y consacrer la meilleure part de leurs soins et de leur temps sous peine d'être expulsés du marché politique comme des débiteurs de mauvaise foi. Ceux qui remplissent avec conscience et activité leurs obligations électorales sont assurés, au contraire, d'être indéfiniment réélus. Sous un régime de suffrage limité, les « mandataires de la nation » sont donc, avant tout, les commissionnaires de leurs électeurs auprès de gouvernement, et l'Etat, avec tous [125] les bénéfices et avantages qui en dépendent, est exploité au profit exclusif du corps électoral. En revanche, sous ce régime, le personnel politique et administratif est d'une qualité d'autant plus élevée que le corps électoral est moins étendu, et cela s'explique. Un corps électoral peu nombreux renferme la plupart des familles qui forment l'élite d'une nation et ne renferme guère que celles-là. C'est dans ces familles que se recrute ordinairement, de père en fils, l'état-major de la politique et de l'administration. Si donc le gouvernement est la cbose d'une classe, s'il est obligé de subordonner aux intérêts de cette classe ceux de la masse de la nation, en compensation,le personnel qui le compose est recommandable par sa situation sociale, ses traditions et son éducation. Ces qualités, qui atténuent les vices du système, se perdent à mesure que le corps électoral s'agrandit, en s'annexant des couches sociales inférieures. En France, on reprochait surtout à l'ancien régime d'attribuer le monopole du gouvernement aux membres de l'aristocratie et du haut clergé; or qu'a-t-on fait en conférant l'exercice de la souveraineté à un corps électoral limité par le cens? On a, en réalité, simplement élargi l'ancien monopole en y faisant entrer la bourgeoisie, et l'expérience n'a pas tardé à montrer que cette nouvelle couche politique n'était pas moins avide d'emplois, de privilèges et d'honneurs que ne l'avait été auparavant sa devancière; qu'elle était même encore plus âpre à exploiter les avantages de sa situation, et qu'en se bornant ainsi à étendre le monopole politique on en avait rendu le fardeau plus lourd. D'où l'on a conclu que le remède au mal consistait à supprimer ce monopole, institué au profit d'une classe, en conférant à la nation entière le droit de suffrage. Du moment où toutes les classes de la nation participeraient à la souveraineté, celle-ci cesserait nécessairement, disait-on, d'être exploitée au profit d'une minorité; tous [126] les intérêts recevraient satisfaction dans une mesure équitable. Enfin, la corruption, qui pouvait facilement s'exercer sous le régime du suffrage limité, deviendrait impossible avec le suffrage universel.
L'expérience n'a point confirmé, il faut le dire, ces prévisions optimistes. Tout en n'atténuant que très légèrement les vices du monopole électoral, le suffrage universel a provoqué un nouvel abaissement de la qualité du personnel politique et placé la société sur la pente du communisme.
Le premier effet de l'extension illimitée du suffrage a été d'agrandir la sphère de recrutement de la profession de « politicien ». Sous le régime du suffrage limité, les politiciens étaient généralement fournis par les familles les plus considérables de la classe des censitaires. Grâce à leur influence et à leurs relations, ces familles pouvaient aisément procurer à quelques-uns de leurs membres des situations politiques et administratives. Elles y avaient un double intérêt : d'abord de se ménager des aboutissants auprès du gouvernement,dans le cas où elles éprouveraient le besoin d'obtenir des protections ou des faveurs particulières, ou simplement en vue d'augmenter leur importance sociale; ensuite, de procurer à leurs membres les moins bien doués des moyens d'existence faciles et assurés, les emplois publics ne demandant point un déploiement d'activité et des efforts d'intelligence comparables à ceux qu'exigent les industries de concurrence. Dans chaque localité, un petit nombre de familles influentes disposaient de l'élection, et leurs représentants, qui décidaient, à leur tour, du sort du ministère, qui pouvaient en toute occasion le renverser par un vote, se chargeaient d'obtenir de lui les emplois et les faveurs qu'elles réclamaient, à titre de maîtresses du marché électoral. Sous le régime du suffrage universel, les anciennes familles censitaires n'ont plu [127] été seules en possession de ce marché. Des éléments sociaux inférieurs sont entrés en concurrence avec elles et ont fini même par les supplanter. Il ne s'agissait plus seulement sous ce régime d'acquérir le vote de quelques centaines de censitaires, il s'agissait d'opérer sur des millions d'électeurs appartenant pour le plus grand nombre aux couches les plus basses de la population. Il fallait employer des moyens d'action nouveaux, plus énergiques et plus étendus, pour décider cette masse, encore plus ignorante des choses de la politique et plus indifférente que ne l'était sa devancière, à choisir un candidat plutôt qu'un autre ou simplement à aller voter. Une élection ne pouvait plus se faire pour ainsi dire en famille, dans une petite association locale, en mettant en jeu les rapports journaliers de clientèle et en négociant individuellement les votes. Il fallait s'adresser à une multitude inconnue et réclamer le concours des hommes qui exerçaient ou étaient propres à exercer une influence sur cette multitude, qui connaissaient le langage qu'elle aimait à écouter et les procédés les plus efficaces pour la séduire. Ces hommes, si peu recommandables qu'ils fussent d'ailleurs, devenaient des agents électoraux indispensables, mais ils n'apportaient pas gratuitement leurs services. Selon leur aptitude à agir sur les masses électorales et la popularité qu'ils avaient acquise, ils se montraient plus ou moins exigeants; les uns s'imposaient comme candidats du parti, les autres se contentaient d'une promesse d'emploi ou d'une rétribution en argent. On vit alors une foule d'hommes à la parole facile et bruyante, aux appétits aiguisés, qui avaient le plus souvent échoué dans les professions régulières et qui aspiraient à une existence large et en vue, envahir les cadres des partis politiques. Dépourvus de scrupules, peu soucieux du choix des moyens oratoires et autres, affamés de bruit, faisant bon marché de leur dignité personnelle, affrontant [128] sans dégoût les injures et les calomnies de leurs adversaires, auxquels ils les rendaient avec usure, toujours prêts à laisser couler leur vulgaire éloquence, ils excellaient à flatter les passions et les convoitises de la foule. Les anciennes influences s'effacèrent devant la leur, et les hommes que leur éducation et des sentiments plus raffinés rendaient moins propres à agir sur une multitude ignorante et grossière durent céder la place à ces nouveaux venus. La « qualité » de la classe politique se trouva ainsi abaissée. Une autre cause devait encore contribuer à la détériorer, savoir l'instabilité croissante de toutes les situations politiques et administratives, résultant du raccourcissement des périodes électorales et de la nécessité de distribuer entre les vainqueurs une part de plus en plus forte des fruits de la victoire. [28] Aux États-Unis, le président et les membres [129] du Congrès sont élus pour quatre ans seulement, et dans la plupart des États particuliers, la période de renouvellement [130] est encore plus courte. Les hommes qui se vouent à la politique et à l'administration ne sont donc jamais assurés de conserver pendant plus de quatre ans au maximum la situation ou l'emploi qui leur fournit les moyens d'existence. Sans doute, il leur arrive de s'y maintenir plus longtemps lorsque leur parti l'emporte de nouveau dans les élections ou lorsqu'ils réussissent à trouver grâce devant leurs adversaires vainqueurs. Mais ils n'en sont pas moins exposés à un risque périodique de dépossession et ce risque s'est aggravé à mesure que le cadre des partis s'est élargi et que le personnel de l'industrie politique s'est augmenté, en se recrutant dans des catégories plus basses et plus besogneuses. Sous peine de créer, après la victoire, des déceptions et des mécontentements qui auraient eu pour effet de diviser et d'affaiblir le parti, il fallait bien épargner moins les vaincus et distribuer aux vainqueurs une proportion croissante du butin. Cette instabilité des situations politiques et administratives, jointe à la nécessité humiliante de solliciter le patronage des politiciens inférieurs et de [131] faire la cour au peuple souverain, en s'extasiant, dans un langage ampoulé, sur sa grandeur et ses vertus de tout genre et en s'exposant à ses brutales rebuffades, —car le peuple souverain ne se pique pas toujours d'être poli et son humeur est fort inégale, — ne pouvait manquer d'éloigner de la politique et de l'administration les hommes qui se sentaient l'énergie et la capacité nécessaires pour faire leur chemin dans une carrière indépendante. La politique et l'administration sont devenues ainsi la proie de politiciens d'une qualité inférieure qui ne reculent pas devant les exigences du métier et ne se font aucun scrupule de s'assurer contre ses risques au moyen de gains illicites. Au lieu d'être gouvernés par les hommes les plus capables et les plus dignes, les Etats livrés au suffrage universel s'acheminent à grands pas vers la domination de partis recrutés dans ce que les différentes classes de la société ont de moins estimable. [29]
Ajoutons que cette domination est plus complète encore sous un régime de suffrage universel que sous un régime de suffrage limité, et qu'il est plus difficile de s'en affranchir.
A mesure que le corps électoral devient plus nombreux, il faut, pour l'entraîner et le dominer, une armée de politiciens plus nombreuse aussi, plus étroitement hiérarchisée et disciplinée, et mieux pourvue de ressources. Les frais des campagnes électorales vont croissant. Il faut louer des locaux pour les comités et les meetings, subvenir aux frais de voyage et d'entretien des orateurs et des agents électoraux, répandre par millions d'exemplaires les circulaires, [133] les affiches et les bulletins de vote. Ces dépenses sont couvertes au moyen de contributions levées sur les candidats, sur les membres actifs du parti ou même sur les fonctionnaires de tout ordre, si le parti est aux affaires. Plus elles sont élevées, plus ceux qui les ont supportées sont intéressés à rentrer dans leurs avances, plus, en conséquence, ils déploient d'ardeur dans la lutte. D'un autre côté, plus une armée est nombreuse et composée d'éléments hétérogènes, plus la nécessité d'une hiérarchie rigoureuse et d'une discipline étroite se fait sentir, surtout si elle a affaire à une armée dont les forces balancent les siennes. Comment des électeurs isolés lutteraient-ils avec leurs faibles ressources contre ces deux armées savamment organisées, commandées par des chefs habiles et abondamment approvisionnées? Bien plus encore que sous un régime de suffrage limité, où ils n'ont affaire qu'à de petits groupes locaux, ils sont obligés d'accepter les candidats imposés par l'un ou l'autre parti, sous peine de perdre leur vote. Chose digne de remarque, l'électeur est d'autant moins libre que le corps électoral est plus nombreux et semble par là même moins facile à dominer.
Enfin, l'extension illimitée du suffrage n'est pas sans danger pour l'ordre social. Le reproche, dans une certaine mesure fondé, que l'on adresse au suffrage limité, c'est de sacrifier aux classes pourvues de l'électoral les masses qui en sont exclues, c'est de faire peser principalement sur la multitude, par la multiplication et l'exagération des impôts indirects, par l'assiette inégale de l'impôt du sang, la charge d'un budget, dépensé pour la plus grosse part au profit d'un personnel politique et administratif recruté dans la classe des censitaires; c'est de perpétuer et d'aggraver des monopoles dont la nation entière supporte le fardeau. Sacrifier le grand nombre des pauvres et des ignorants au petit nombre des gens plus ou moins riches et éclairés, [134] voilà la tendance naturelle du suffrage limité. Sacrifier le petit nombre au grand, en retournant la progression des impôts, en privilégiant le travail aux dépens du capital, en favorisant l'application des théories communistes, destructives du capital et de l'industrie, voilà, au contraire, la tendance du suffrage universel. A la vérité, cette tendance ne s'accuse pas d'emblée et ses résultats ne peuvent se produire qu'à la longue. Le suffrage universel a une origine récente, et dans les pays où il a été établi, aux ÉtatsUnis et en France, les classes supérieure et moyenne possèdent une telle influence, elles disposent de moyens d'action si considérables, elles ont sous leur dépendance une clientèle si étendue, qu'elles ont pu, jusqu'à présent, grâce à la supériorité de leur situation, de leurs ressources et de leurs lumières, balancer et au delà la puissance du nombre. Mais leur ascendant est tout artificiel, et il est continuellement battu en brèche. Les doctrines socialistes et démagogiques ont fait depuis un demi-siècle des prosélytes de plus en plus nombreux parmi les classes ouvrières, l'antagonisme des entrepreneurs et des ouvriers n'a cessé de croître, les ouvriers se sont organisés pour la lutte et cette organisation sera tôt ou tard appliquée à la politique si elle ne l'est déjà. Nous n'ignorons pas que les gouvernements se piquent d'émulation pour généraliser l'instruction, en la faisant pénétrer jusque dans les couches les plus basses de la société;mais cette instruction, dont l'Etat et les communes s'efforcent d'accaparer le monopole, est incomplète et insuffisante : peut-être même est-elle, pour les intelligences incultes qui la reçoivent, plus dangereuse que l'ignorance. Les classes inférieures apprennent à lire, mais que lisent-elles de préférence? Des romans grossièrement immoraux ou des élucubrations communistes. N'est-il pas permis de craindre que ces classes mal instruites ne finissent par se débarrasser des influences qui les ont jusqu'à [135] présent maîtrisées et par faire pencher la balance politique du côté du nombre? Déjà, à mesure que le suffrage s'étend les gouvernements comptent davantage avec leurs tendances. C'est à une législation empruntée aux théories communistes que le gouvernement anglais a eu recours pour remédier à la crise irlandaise. En Allemagne, le gouvernement incline visiblement vers un socialisme d'État qui favoriserait les intérêts du grand nombre, aux dépens de la bourgeoisie capitaliste. Dans l'Union américaine, les tendances communistes de la législation sont plus marquées encore au sein des Etats, tels que la Californie, où les classes ouvrières organisées commencent à acquérir la prépondérance. On conçoit que les intérêts menacés prennent l'alarme et qu'ils mettent en œuvre ce qui leur reste de pouvoir et d'influence pour échapper au risque d'une dépossession révolutionnaire ou légale. Ce risque peut être encore éloigné, mais est-il purement chimérique? Supposons que les doctrines socialistes et communistes continuent à se propager et qu'elles s'emparent décidément de l'opinion de la multitude, le suffrage universel ne finirait-il point par les imposer légalement à la minorité des propriétaires et des capitalistes? Sans doute, l'état de choses qu'elles établiraient ne pourrait subsister; mais, en attendant, cette expérience d'une fausse doctrine économique et sociale ne coûterait-elle pas aussi cher qu'une invasion de barbares?
Mais en écartant même cette éventualité, il n'est que trop visible que la république appuyée sur le suffrage universel n'a pas été un progrès sur la monarchie constitutionnelle avec suffrage limité. Les défauts et les vices qu'on reprochait à celle-ci n'ont pas disparu lorsqu'on a remplacé le régime de la concession conditionnelle à un entrepreneur héréditaire par la régie gouvernementale ou l'exploitation directe de l'État par la nation et ses mandataires temporairement élus. On peut soutenir même que [136] ce dernier mode d'exploitation s'est montré inférieur à l'autre, que la gestion des affaires publiques est devenue moins économique et moins efficace; bref, que la nation a perdu au change. Aussi les illusions que cette nouvelle expérimentation politique avait fait naître n'ont-elles pas manqué de se dissiper. On s'est fatigué de la lutte stérile des partis et de l'instabilité du pouvoir, et cette réaction a donné naissance au stathoudérat en Hollande, au protectorat en Angleterre, au consulat et à l'empire en France.
III. Le Stathoudérat et l'Empire. — Nous avons remarqué plus haut que la forme économique à laquelle se rattachent les républiques modernes est celle de la « société coopérative ». Le stathoudérat, le protectorat ou le consulat appartiennent à la forme économique de la société en commandite. L'état politique dans ce système est dirigé par un gérant, assisté ou non d'un conseil, et qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs, sans que les membres de lasociétéaient le droit d'intervenir dans sa gestion. Le gérant est nommé ou accepté par l'assemblée générale des membres de la société, ordinairement pour un terme illimité. Dans le cas de l'empire, ses fonctions sont héréditaires, sauf ratification par l'assemblée générale formant un « plébiscite ». En théorie, c'est toujours la république, c'est la république dictatoriale substituée à la république parlementaire; mais, en pratique, il n'y a pas de différence substantielle entre ce régime, surtout lorsque le gérant devient héréditaire, et celui de la monarchie absolue; il n'y a que cette différence purement théorique que le roi, dans le système de l'ancienne monarchie, était le propriétaire de l'État, tandis que le stathouder, le protecteur, le consul ou l'empereur, n'en est que le gérant pour le compte de la nation propriétaire. Nous disons que c'est une différence purement théorique. En effet, dans le cas où la nation serait mécontente de son gérant et voudrait le changer, il lui serait extrêmement [137] difficile, pour ne pas dire impossible, d'arriver à ses fins par une voie légale.
Sous ce rapport, il y a une lacune dans le droit constitutionnel et il en résulte que la substitution d'une forme de gouvernement à une autre ne peut guère s'accomplir qu'au moyen d'une révolution ou d'un coup d'Etat. Si l'on a vu quelquefois des rois, propriétaires de l'État, suivant le droit public de l'ancien régime, accorder à leurs sujets, après de longues résistances et sous l'influence de la crainte d'une dépossession violente, une constitution qui leur confère le droit de nommer des mandataires et accorde à ceux-ci une certaine participation dans la gestion des affaires publiques, on n'a pas vu encore la république succéder légalement et pacifiquement à la monarchie ou faire place à son tour, d'une manière non moins légale et pacifique, au stathoudérat, au protectorat, au consulat ou à l'empire. C'est par voie de révolution ou de coup d'Etat que cette succession s'opère, chaque fois que le gouvernement existant, tombé en discrédit, ne trouve plus que des appuis insuffisants pour résister à l'effort de ceux qui aspirent à prendre sa place, ou qu'un chef politique ambitieux profite de sa situation, de ses moyens d'action et de sa popularité pour confisquer le pouvoir à son profit. C'est par des révolutions populaires que la république a été substituée en France aux monarchies constitutionnelles de Louis XVI et de Louis-Philippe et à l'empire constitutionnalisé de Napoléon III; c'est par des coups d'État que le consulat, puis l'empire ont pris la place de la première république et l'empire, encore une fois, de la seconde. Les nations modernes ne possèdent point la liberté de changer le mode de gestion de leur état politique, bien qu'elles en soient pour la plupart solennellement reconnues propriétaires. Mais aucune propriété n'est plus nominale que celle-là, et aucun propriétaire n'est moins libre d'user [138] de sa chose. Ne pouvant la gérer lui-même, il est obligé d'en confier la gestion à des maisons, à des associations ou à des individualités politiques, qui agissent en son nom et lui font supporter la responsabilité de leurs actes, mais qui commencent toujours par lui imposer l'engagement de conserver à perpétuité le régime qu'elles établissent à son usage et à ses frais. [30] Il est vrai que cette perpétuité est purement fictive et que les monarchies, les républiques et les empires perpétuels que notre époque a vus se multiplier, n'ont guère résisté à l'action du temps, qu'en France, par exemple, leur vie moyenne n'a pas excédé une quinzaine d'années, mais ils n'en ont pas moins été fondés « à perpétuité ».
IV. Conclusion. — Il n'entre pas dans le plan déjà bien assez étendu que nous nous sommes tracé de comparer les mérites et les défauts de ces formes modernes du gouvernement , la monarchie constitutionnelle et la république parlementaire, stathoudérienne, consulaire ou impériale; mais elles ont un trait commun, qu'il importe de noter, c'est leur fragilité. Qu'en faut-il conclure, sinon qu'elles ne donnent pas plus que les formes anciennes, auxquelles on les a substituées, la solution du problème du gouvernement adapté aux conditions actuelles et futures d'existence des sociétés? Cette conclusion va se trouver confirmée par l'examen de la politique extérieure et intérieure des gouvernements modernes, politique également arriérée et en désaccord avec l'intérêt des peuples, que ces gouvernements soient monarchiques ou républicains.
[139]
CHAPITRE VI.
Politique extérieure des états modernes. La guerre. ↩
I. Fatalité de la guerre dans les temps primitifs et dans l'àfre de la petite industrie. — II. Comment l'évolution vers l'état de paix est née et a progressé jusqu'à la Révolution francaise. — III. Persistance anormale de l'état de guerre à l'époque actuelle. Causes qui ont fait succéder au risque naturel de guerre un risque artificiel. — IV. Les motifs et les résultats des guerres contemporaines. Leur tendance à la périodicité. Conclusion.
Tous les Etats politiques ont été fondés, se sont agrandis et, finalement, ont péri par la guerre. Tous sont continuellement soumis à la nécessité de la faire et, jusqu'à présent, c'est cette nécessité, avec les risques de destruction, de démembrement et d'affaiblissement auxquels elle les expose, les chances d'agrandissement qu'elle leur offre, qui a déterminé leur politique extérieure, c'est-à-dire leur manière d'être et d'agir à l'égard des autres Etats.
Il s'agit donc d'examiner de près ce grand et redoutable phénomène de la guerre, d'en rechercher les causes naturelles ou artificielles, de reconnaître s'il a un caractère temporaire ou s'il est inhérent à la nature même de l'homme et des sociétés, s'il est destiné, par conséquent, à se perpétuer.
I. — Fatalité de la guerre dans les temps primitifs et dans F âge de la petite industrie. — § 1er. Temps primitifs.— Les philanthropes, amis de la paix, ont écrit force petits livres pour jeter l'anathème sur la guerre, en faisant un tableau pathétique des maux de toute sorte qu'il est dans sa nature [140] de causer, en dressant l'inventaire de ses ravages, en constatant, pour tout dire, que la guerre est un fléau et peutêtre le plus destructeur de ceux auxquels l'espèce humaine a été exposée depuis son apparition sur la terre. Mais ce fléau, dépendait-il de l'humanité de l'éviter?
Si, d'une part, les espèces animales qui ont précédé ou accompagné la naissance de l'homme avaient été inoffensives, s'il n'avait point existé d'espèces carnassières, faisant concurrence à l'homme, lui disputant sa subsistance et le traitant comme une proie; si, d'une autre part, l'homme avait été un simple herbivore et s'il était venu au monde avec la notion innée du respect de la vie et de la propriété d'autrui, le phénomène de la guerre n'aurait pas eu, selon toute apparence, l'occasion de se produire, et notre globe eût été, dès l'origine, un vaste paradis terrestre ou une Arcadie.
Mais les conditions d'existence et de développement qui lui étaient faites n'avaient rien de commun avec celles-là. Le monde primitif était peuplé d'espèces carnivores, pourvues d'un armement naturel dont l'homme lui-même était privé, et auxquelles il ne pouvait échapper qu'en recourant, comme les autres animaux inférieurs en force, à l'association. La guerre avec ces espèces pour lesquelles il était une proie, lions, tigres, ours, loups, serpents, etc., s'imposait à lui ; il devait les détruire ou les refouler, sous peine d'être détruit par elles. Ses instincts de destruction et de combat devaient, en conséquence, se développer ; pour lutter avec succès contre des bêtes féroces, il fallait bien qu'il eût quelque chose de la nature des bêtes féroces. Mais s'il ne dépendait pas d'eux, l'eussent-ils voulu, d'éviter la guerre avec les espèces concurrentes, les hommes primitifs ne pouvaient-ils, du moins, vivre en paix les uns avec les autres? Étaient-ils donc, fatalement aussi, condamnés à se faire la guerre? En considérant les instincts de combat que [141] la nécessité de la lutte avec les autres espèces avait dû développer en eux et rendre prédominants, en considérant encore la concurrence de plus en plus serrée qui s'établissait entre les troupeaux humains pour l'acquisition des subsistances à mesure qu'ils se multipliaient et se rapprochaient, on conçoit que la guerre entre ces troupeaux d'êtres affamés fût inévitable. Au sein de chaque troupeau, l'expérience avait sans doute fait reconnaître la nécessité d'observer des lois morales élémentaires, de s'abstenir du meurtre, du vol et du rapt, mais cette nécessité ne se faisait point sentir à l'égard des membres des autres troupeaux. On avait généralement, au contraire, plus d'intérêt à les détruire qu'à leur permettre de subsister et de se multiplier.
N'oublions pas, en effet, que le premier besoin de l'homme est celui de l'alimentation, et qu'il est un animal omnivore : il se nourrit à la fois de substances végétales et animales ; mais avant de découvrir les moyens de les multiplier par une culture régulière et une élève systématique, il a dû se contenter de la nourriture que lui procuraient la récolte des fruits naturels du sol et la chasse ou la pèche des animaux comestibles. Or, ces deux sortes de substances alimentaires sont très inégalement distribuées; il y a des régions abondantes en végétaux et en animaux comestibles, et d'autres où ils sont rares, où les subsistances sur lesquelles peut vivre un troupeau d'hommes primitifs, non encore pourvus du matériel et des procédés techniques de la petite industrie, sont promptement épuisées, ou deviennent bientôt insuffisantes si le troupeau s'accroît. Cela étant, la guerre n'est-elle pas inévitable entre les troupeaux qui se font concurrence pour la recherche des aliments? Ceux qui occupent des cantons abondants en substances végétales ou animales veulent naturellement en conserver la possession exclusive, tandis que ceux qui habitent, dans [142] leur voisinage, des cantons moins favorisés, s'efforcent, sous l'aiguillon de la faim, de leur enlever ces riches gisements alimentaires. De là, la guerre. Ajoutons que c'est, nécessairement, une guerre sans merci, analogue à la chasse, surtout dans les régions où, par suite de la rareté des espèces animales comestibles, l'homme est le principal gibier de l'homme.
§ 2. Age de la petite industrie. — Cependant l'homme est un animal supérieur; il est pourvu, à un plus haut degré que les. autres espèces, de l'esprit d'observation et d'invention ; il découvre successivement la multitude des matériaux et des agents naturels qui peuvent .servir à la satisfaction de ses besoins; il invente d'abord les armes nécessaires pour suppléer à l'insuffisance de ses moyens naturels de défense et d'attaque, ensuite les instruments et les procédés de la culture des substances alimentaires. Ces instruments et ces procédés ont une telle efficacité qu'ils lui permettent de recueillir, sur une surface déterminée de terrain, cent fois plus de subsistances qu'il ne pouvait s'en procurer auparavant au moyen de la chasse et de la récolte des fruits naturels du sol. Aussitôt, sous l'impulsion de la loi en vertu de laquelle les hommes, comme toutes les autres espèces vivantes, se multiplient en raison de leurs moyens de subsistance, ils croissent en nombre ; aux troupeaux et aux tribus de quelques centaines ou de quelques milliers d'individus succèdent des nations dont la population se compte par millions, et auxquelles la pratique de l'agriculture, de l'industrie et des arts permet d'accumuler une masse croissante de richesses. C'est une phase nouvelle de l'existence de l'humanité; elle sort de l'animalité et commence son ascension dans l'échelle de la civilisation.
Mais, dans cette période, comme dans la précédente, la guerre subsiste et elle conserve un caractère d'inévitabilité. La civilisation ne se produit pas, en effet, d'une [143] manière uniforme et générale. C'est un phénomène local qui apparaît sur quelques points du globe, au milieu de la barbarie universelle. Les peuples qui devancent les autres dans les arts de la production, et qui offrent par là même aux convoitises de la multitude des tribus et des peuplades demeurées en arrière l'appât d'un riche butin, sont exposés à être envahis, pillés et détruits. Alors même qu'ils voudraient s'adonner exclusivement aux travaux productifs et vivre en paix, ils ne le pourraient pas : ils subissent, quoi qu'ils fassent, le risque de guerre. Le monde civilisé, encore enfermé dans des limites étroites, est en état de siège, et cette situation se prolongera fatalement jusqu'au jour où la civilisation, ayant progressivement augmenté sa puissance et élargi ses frontières, aura acquis une prépondérance décisive.
La première nécessité qui s'imposât aux sociétés en voie de civilisation, c'était de s'assurer contre le risque d'invasion et de destruction, qui se trouvait alors à son maximum d'intensité, en raison du peu d'étendue et de puissance du monde civilisé en comparaison du monde barbare. Si cette assurance ne s'était point constituée de manière à préserver l'existence continuellement menacée des sociétés émergées de la barbarie, c'eût été en vain que les hommes appartenant aux variétés les plus intelligentes de l'espèce se fussent appliqués à inventer et à perfectionner le matériel et les méthodes de la production, à développer les sciences et les arts, à créer de la richesse; l'œuvre de la civilisation eût été sans cesse interrompue, peut-être même n'eût-elle pu se poursuivre et s'achever. Le monde serait retombé dans la barbarie, comme il est arrivé, selon toute apparence, sur le continent de l'Amérique du Nord, où les ruines de cités vastes et populeuses attestent qu'une ou plusieurs civilisations successives s'étaient créées et avaient été détruites par les tribus sauvages [144] d'Indiens chasseurs et guerriers, demeurés seuls maîtres de ce vaste continent jusqu'à l'arrivée des Européens.
Avant tout et par-dessus tout, il fallait préserver les sociétés qui naissaient à la civilisation des atteintes destructives du monde barbare. Il fallait que Jes hommes civilisés réussissent à refouler ou à assujettir les races de proie qui tiraient leurs moyens d'existence de la guerre, comme ils avaient refoulé ou réduit à l'état de domesticité les espèces animales inférieures. Cette dernière tâche, ils l'avaient accomplie en associant et en disciplinant leurs forces et en se créant un armement artificiel qui leur avait procuré la victoire sur les espèces mieux pourvues d'armes naturelles. Mais quand il s'agissait de lutter avec des hommes de proie, spécialement voués à la chasse et à la guerre, la tâche était plus difficile. Il semblait même que des sociétés, dont les membres étaient adonnés à la pratique de l'agriculture, de l'industrie et des arts, dussent inévitablement avoir le dessous dans cette lutte. Sans doute, ces sociétés, en possession du matériel de la petite industrie, avaient sur les tribus barbares de chasseurs et de guerriers l'avantage de la supériorité du nombre et des ressources ; mais cet avantage eût été insuffisant si elles n'avaient pu opposer à leurs ennemis, d'une manière permanente, une force armée supérieure à la leur. Or, cette force, destinée à assurer la s'écurité extérieure de la société, avait ses conditions naturelles de production. 11 fallait : 1° qu'elle se composât d'un personnel exclusivement voué à la guerre comme celui auquel il était opposé; 2° que ce personnel eût autant d'intérêt à défendre la société que les barbares du dehors en avaient à l'attaquer ; enfin, 3° qu'il fût le maître de disposer, en cas de nécessité, de toutes les forces et de toutes les ressources de la société pour les appliquer à sa défense, tout en ayant, en même temps, intérêt à n'en point abuser.
[145]
Cette constitution utile de la force défensive des sociétés en voie de civilisation n'a pas été inventée tout d'une pièce; elle a été le produit de nombreuses et cruelles expériences; bien des sociétés ont péri sous l'effort des barbares avant de l'avoir possédée, ou faute de l'avoir conservée dans ses parties nécessaires.
C'est en étudiant les sociétés qui ont victorieusement résisté aux barbares, et étendu, par la supériorité de leurs armes, le domaine de la civilisation, qu'on voit comment s'est constitué cet appareil d'assurance , qu'on se rend compte de l'utilité des différentes pièces qui le composent et de la raison d'être d'un ensemble d'institutions et de coutumes qui nous paraissent aujourd'hui barbares ou absurdes, parce que les nécessités en vue desquelles elles avaient été établies ont cessé d'exister.
Nous sommes disposés, par exemple, à qualifier de barbares la subalternisation et l'asservissement des classes productives à une caste de guerriers, sans remarquer que cette caste prétendue stérile, produisait la denrée la plus nécessaire à une société naissant à la civilisation dans un milieu barbare : la sécurité; sans remarquer encore que cette production, étant par sa nature essentiellement dangereuse et aléatoire, exigeait une rétribution plus élevée qu'aucune autre; sans remarquer enfin qu'elle ne pouvait être produite que par une caste spécialement adonnée à la guerre et ayant toutes les autres classes sous sa domination.
Supposons, par exemple, que les membres des tribus industrieuses qui avaient inventé le nouveau matériel de la production et qui le mettaient en œuvre eussent entrepris de combiner les travaux agricoles et industriels avec ceux du gouvernement et de la défense de leurs établissements, ils auraient eu certainement le dessous dans la lutte avec des barbares voués d'une manière exclusive à la chasse et [146] à la guerre. Ils auraient été dans une situation analogue à celle d'une garde nationale, composée de marchands, d'artisans, etc., en lutte avec une armée formée d'hommes uniquement dressés et occupés au métier des armes. La lutte n'était pas possible, l'Etat en voie de civilisation ne pouvait résister aux barbares qui convoitaient ses richesses qu'à la condition que la « production de la sécurité » y fût concentrée entre les mains les plus capables de l'exercer. Cette application du principe de la division du travail était nécessaire au salut de la société naissante. Comment pouvait-elle s'opérer? Comment pouvait s'effectuer la séparation des occupations?Qui défendrait l'Etat? Qui cultiverait la terre, qui s'adonnerait à la pratique de l'agriculture, de l'industrie et du commerce? La force seule pouvait en décider. Les plus forts et par conséquent les plus capables de défendre l'Etat asservissent les plus faibles, soit que ceux-ci appartiennent à la même race ou à une race différente et inférieure; ils forment une société pour l'exploitation de l'État, ce qui implique la nécessité de le gouverner et de le défendre. Leurs aptitudes politiques et militaires se fortifient et se développent naturellement par l'exercice des mêmes fonctions, et elles se transmettent par l'hérédité. L'industrie du gouvernement et le métier des armes, ainsi constitués conformément au principe de la division du travail, peuvent produire un maximum d'effet utile, et procurer à la société naissante la plus grande force de résistance possible. En même temps, la société ou la caste gouvernante et guerrière, propriétaire du sol et du cheptel d'hommes et d'animaux qui le garnissent, est intéressée au plus haut point, en raison même de l'étendue et du caractère absolu de son droit de propriété, à préserver de toute atteinte son établissement politique, à l'exploiter de la manière la plus économique, et, s'il se peut, à l'agrandir. Son intérêt à cet égard est analogue à celui du propriétaire de tout autre [147] établissement, agricole, industriel ou commercial. Ajoutons que la caste gouvernante et guerrière, en sa qualité de propriétaire du sol, des hommes et des choses, du cheptel vivant ou mort de son domaine politique, peut toujours appliquer à la défense ou à l'agrandissement de ce domaine toutes les ressources qu'il contient. A la vérité, cette appropriation des hommes et des choses se modifie dans le cours des temps, par l'action même de l'intérêt de la classe propriétaire et gouvernante de l'Etat : l'esclavage fait place au servage, puis les classes asservies deviennent libres et propriétaires. Cette transformation économique a pour conséquence d'accroître d'une manière incomparable la richesse de la société, mais sans la rendre moins disponible pour la défense d'Etat. Car tous les membres de la société demeurent soumis, dans les limites de l'État, à la souveraineté du chef de la corporation politique et militaire: ils sont « ses sujets ». Or, le souverain a le droit d'exiger de ses sujets le sacrifice de toute la portion de leurs ressources qu'il juge nécessaire à la conservation et à l'agrandissement de l'État, comme aussi de leur imposer toutes les gênes et servitudes que la sûreté de l'État lui paraît commander.
Telle était la seule organisation politique qui pût permettre aux sociétés en voie de civilisation de se soustraire au danger d'être détruites par les barbares. Encore n'y réussirent-elles pas toujours, et vit-on fréquemment des tribus de chasseurs ou de pasteurs ravager et conquérir les États les mieux constitués. Cela tenait à des causes diverses, mais surtout à ce que les propriétaires des premiers établissements de la civilisation demeuraient de préférence sur la défensive et perdaient ainsi, avec l'habitude de la guerre, l'aptitude à la faire. Quand la corporation ou la caste propriétaire et exploitante d'un État, fondé sur la petite industrie, en avait entouré les villes de solides murailles et [148] pourvu à la défense des frontières, elle devenait volontiers inactive. Quel profit aurait-elle pu tirer d'expéditions dirigées contre des tribus pauvres et belliqueuses? Ces expéditions ne couvraient point leurs frais, car le butin qu'on pouvait en rapporter n'était point proportionné aux dépenses qu'elles occasionnaient et aux risques qu'elles faisaient courir. Les corporations ou les castes propriétaires d'États populeux et florissants attendaient donc que les barbares vinssent les attaquer, et, dans l'intervalle, elles laissaient se rouiller leurs qualités militaires et leur armement. Les barbares au contraire se tenaient constamment en haleine; ils n'avaient point de périodes de chômage. Tantôt ils luttaient entre eux pour la possession de terrains de chasse ou de pâturages; tantôt ils faisaient des razzias sur les territoires des Etats civilisés. Cet exercice continu du métier de la guerre devait naturellement leur procurer l'avantage sur des adversaires qui pratiquaient ce métier seulement d'une manière intermittente, et c'est ainsi qu'on s'explique la destruction de la plupart des anciens empires par des tribus de chasseurs ou de pasteurs, bien inférieures en nombre et en ressources. Quand c'était une tribu de chasseurs qui n'avait pas encore franchi la première étape de la civilisation, la destruction était ordinairement complète. Les vainqueurs s'emparaient des provisions, des armes, des vêtements, des bijoux, et, en général, des articles mobiliers, et détruisaient ou abandonnaient ce qu'ils ne pouvaient emporter. La civilisation était alors déracinée, et il se passait parfois longtemps avant qu'elle ne germât de nouveau sur une terre semée de ruines. Quand les vainqueurs commençaient à sortir de l'état sauvage et s'adonnaient à l'industrie pastorale et aux pelits métiers qu'elle nécessite, leur victoire avait des conséquences moins funestes; ils pouvaient s'adapter à la civilisation naissante et remplacer la caste propriétaire et [149] exploitante qu'ils avaient vaincue. La civilisation en ce cas n'était pas anéantie, elle subissait un simple recul, jusqu'à ce que les nouveaux propriétaires de l'État eussent acquis le degré de culture de ceux qu'ils avaient dépossédés. On peut même prétendre que cette substitution d'une racn vigoureuse et guerrière à une race affaiblie était avantageuse à la civilisation, malgré le recul temporaire qu'elle occasionnait, car elle assurait plus efficacement sa défense et son développement futur.
Cette période dans laquelle les Etats fondés sur la petite industrie étaient comme des îlots au milieu d'un océan de barbarie fut certainement la plus critique de la civilisation, celle où son existence demeura la plus précaire, où les risques de destruction auxquels elle était exposée se trouvèrent à leur maximum. Mais peu à peu les États en voie de civilisation se multiplièrent, et ces risques allèrent s'affaiblissant. Ils s'affaiblirent d'abord par le fait du changement qui s'opéra dans la proportion de l'étendue et des forces du monde barbare et du monde civilisé; ils s'affaiblirent ensuite par le fait de la concurrence pour la domination et l'exploitation politique à laquelle se livraient les sociétés propriétaires d'États, concurrence d'autant plus active et plus serrée que les États devenaient plus nombreux et plus riches. A l'origine, ces sociétés propriétaires et exploitantes des établissements de la civilisation s'étaient tenues de préférence sur la défensive, les guerres engagées avec des tribns nomades et belliqueuses ne rapportant point, directement du moins, ce qu'elles coûtaient. Mais il en fut autrement lorsque les États fondés sur la petite industrie se furent accrus en nombre et en richesse. La guerre devint alors directement une source de profits pour les propriétaires d'États civilisés, comme elle l'était pour les tribus sauvages. En s'emparant des domaines de leurs voisins, ils augmentaient leurs revenus et leur puissance, sauf [150] toutefois lorsque les frais d'acquisition et de conservation de leur conquête excédaient les bénéfices et l'accroissement de forces qu'on en pouvait tirer. On vit en conséquence les propriétaires d'États civilisés se faire la guerre, soit en vue des profits attachés à la conquête, soit en vue de se débarrasser d'un concurrent en matière d'exploitation politique. Telle fut la guerre que Rome fit à Carthage et qu'elle poursuivit jusqu'à ce qu'elle eût détruit cette concurrente redoutable. Après la chute de Carthage, les Romains devinrent les maîtres du bassin de la Méditerranée ; ils n'eurent plus aucune compétition sérieuse à redouter dans la conquête des régions qui formaient le domaine de la civilisation ou qui y étaient attenantes. Cette conquête achevée, ils s'arrêtèrent; les vastes contrées situées au delà, et occupées par des tribus pauvres et belliqueuses, ne leur paraissait pas valoir le prix qu'elles auraient coûté. La guerre cessa d'être leur occupation permanente; ils ne la firent plus qu'aux confins de leur vaste empire, pour repousser les agressions des barbares. Ils y devinrent moins habiles, tandis que les barbares, qui se battaient entre eux, de tribu à tribu, quand ils ne s'unissaient pas contre l'ennemi commun, finirent par y exceller. L'empire romain succomba sous leurs efforts répétés, et ce vaste établissement politique se trouva morcelé en une foule d'Étals concurrents. La guerre redevint permanente dans la vaste région où Rome, après l'avoir conquise et assujettie, avait fait régner la paix. Grâce à ces luttes intestines qui maintenaient et développaient chez eux par un exercice continuel les qualités nécessaires à la guerre, les nouveaux propriétaires du monde civilisé purent arrêter le flot destructeur des invasions, et, plus tard, ils réalisèrent un progrès décisif par l'introduction des armes à feu dans le matériel de guerre. Nous avons exposé déjà (voir l' Évolution économique) les conséquences de ce progrès. Nous avons montré qu'il a [151] placé, désormais, la civilisation à l'abri des atteintes de la barbarie, en donnant dans la pratique de la guerre, la prédominance aux capitaux, à la science et à la force morale. Les effets de cette prédominance n'ont pas tardé à se faire sentir, et ils se sont accentués davantage à mesure que le nouveau matériel s'est perfectionné. Non seulement, les invasions barbares ont été arrêtées et la civilisation a cessé d'être en état de siège, mais elle a pris l'offensive à son tour; les peuples civilisés ont envahi et se sont approprié la plus grande partie du domaine occupé par les barbares. Du xv° au xvinc siècle, ils ont refoulé la domination musulmane, un moment menaçante, et conquis, avec le Nouveau Monde, une partie de l'Asie et de l'Afrique.
La facilité extraordinaire avec laquelle la supériorité de leur armement leur a permis d'accomplir ces conquêtes a démontré à l'évidence que le péril extérieur auquel la civilisation se trouvait exposée depuis sa naissance avait cessé d'exister; qu'elle était devenue incomparablement la plus forte, à ce point que le jour où il conviendrait aux peuples civilisés d'achever la conquête du domaine, maintenant exploré et connu, que les peuples barbares ou à demi civilisés occupaient encore, cette œuvre n'exigerait qu'une portion insignifiante de leurs forces et de leurs ressources; enfin, que le risque provenant de l'existence d'un monde barbare, demeuré pendant des milliers d'années d'autant plus redoutable et effrayant que l'on n'en connaissait ni l'étendue ni la puissance réelle, que ce risque, disons-nous, ayant disparu, la guerre entre les peuples civilisés cessait d'être un sport nécessaire pour assurer la défense de la civilisation, et l'état de paix pouvait succéder à l'état de guerre.
Cependant cet état de guerre, qui subsistait depuis la naissance de l'humanité, ne pouvait disparaître d'emblée. [152] Les institutions politiques, les mœurs, les croyances, les habitudes d'esprit avaient été façonnées par la guerre, des intérêts nombreux et puissants se trouvaient engagés dans l'organisation qui y était adaptée. Comment eût-il été possible que toute cette machinery matérielle et morale qui avait rendu à l'humanité des services indispensables, qui avait été le salut de la civilisation naissante, pût être mise à la réforme du jour au lendemain, et qu'à la guerre universelle succédât, sans transition et sans retour, la paix universelle? L'évolution vers la paix ne pouvait s'accomplir comme le changement en vue d'un décor de théâtre. Il convient de remarquer toutefois que cette évolution s'était préparée de longue main, qu'elle avait commencé à poindre au moment où le risque de destruction issu de la prépondérance originaire du monde barbare avait commencé à s'affaiblir. Ce risque venant à disparaître, on pouvait espérer qu'elle s'achèverait dans un délai proportionné à la résistance des institutions, des mœurs et des intérêts créés par l'état de guerre.
II. — Comment l'évolution vers l'état de paix est née et a progressé jusqu'à la Révolution française. — L'appropriation des Etats politiques à des associations organisées en vue du profit qu'elles en pouvaient tirer, qui avaient pour occupations spéciales le gouvernement et la guerre, et dont l'activité se trouvait constamment stimulée par la concurrence des autres propriétaires d'États, a eu, comme nous venons de le voir, pour résultats de préserver la civilisation de la destruction, dans la période où le monde barbare était encore prédominant et, plus tard, de lui permettre de refluer sur le domaine de la barbarie, et d'acquérir à son tour la prépondérance. Ces « sociétés » de fondateurs et de propriétaires d'États étaient obligées, en vertu des nécessités mêmes de leur exploitation, de déléguer l'exercice de leur souveraineté, — laquelle, il est [153] essentiel de le remarquer, dérivait purement et simplement de leur droit de propriété, — à un chef, roi, duc ou empereur, ou bien encore consul, dictateur, syndic, doge, assisté ou non d'un conseil d'administration, subordonné ou non à l'assemblée générale des membres de la société. Les autres classes de la population, vouées aux travaux de l'agriculture et de l'industrie et aux autres fonctions inférieures, étaient appropriées ou sujettes. D'abord, la propriété politique se confondait avec la propriété économique; les propriétaires de l'État possédaient en même temps le sol, avec le cheptel vivant ou mort qui le garnissait. Ensuite, ces deux sortes de propriétés se séparèrent; la population appropriée se racheta et acquit même une partie du sol; la propriété politique devint distincte de la propriété des terres, des personnes et des fruits de leur industrie, et elle finit, dans la plupart des Etats, à la suite d'évolutions que nous avons esquissées, par se concentrer entre les mains d'une famille. Le chef de cette famille ou de cette « maison » était propriétaire de l'État, qu'il exploitait pour son compte et qu'il léguait à ses héritiers. En cessant d'être appropriée, la population de l'Etat était demeurée sujette, et à ce titre obligée de se soumettre aux lois et servitudes que le souverain jugeait nécessaire d'établir dans l'intérêt de la conservation et de la bonne exploitation de son État, comme aussi de lui payer l'impôt, c'est-à-dire de lui fournir, sous une forme ou sous une autre, la portion de ses services ou des fruits de son industrie qu'il-lui plaisait d'exiger. A cet égard, l'intérêt du souverain était distinct de celui des sujets. Il était intéressé à tirer d'eux la plus grande somme possible de produits ou de services, sauf à leur laisser le minimum nécessaire pour subsister et se multiplier dans la mesure des besoins de l'établissement politique. Les sujets, au contraire, étaient intéressés à ne fournir au souverain que [154] la somme de produits et de services rigoureusement indispensables au maintien de l'État et à l'accroissement utile de sa puissance.
Dans la première période de l'existence des États civilisés, lorsque la propriété politique était encore jointe aux autres, aucun débat n'était possible sur ce point entre la « société » propriétaire et gouvernante et la population appropriée et assujettie. Celle-ci n'avait d'autre ressource que la révolte quand le fardeau qui pesait sur elle était excessif; encore était-elle incapable de juger si la prime qu'elle payait à ceux qui pourvoyaient à sa sécurité était ou non proportionnée au risque auquel elle était exposée. Ce risque était alors à son maximum et il pesait également sur la société propriétaire de l'État et sur la masse possédée, car les barbares n'établissaient aucune distinction entre elles; ils dépouillaient et massacraient les esclaves aussi bien que les maîtres, et la destruction de l'État avait pour conséquence celle de toute la population à laquelle il servait d'abri et de rempart. Si élevés que fussent les sacrifices que les propriétaires d'États exigeaient des classes assujetties, ils ne pouvaient guère dépasser le risque auquel elles étaient exposées, par le fait de la prédominance du monde barbare sur le monde civilisé.
Mais peu à peu les États civilisés devinrent plus nombreux, le risque de destruction s'amoindrit, et en même temps s'inégalisa. La conquête de l'État, dans cette phase nouvelle, affecta bien moins la population possédée que la classe possédante : celle-ci était dépouillée en totalité ou en partie des domaines qui lui fournissaient ses moyens d'existence, parfois même massacrée ou réduite en esclavage, tandis que la condition de la masse appropriée ne se trouvait pas sensiblement modifiée. Lorsqu'il s'agissait d'une guerre entre deux États parvenus à peu près au même degré de civilisation, la victoire ou la défaite de [155] ses propriétaires lui était, pour ainsi dire, indifférente: elle changeait simplement de maîtres et que lui importait? Ne pouvait-elle pas dire avec le fabuliste:
Notre ennemi, c'est notre maître?
A la vérité, lorsque le vainqueur était encore à demi barbare, comme il arriva lorsque les peuples du nord envahirent l'Empire romain, la condition de la population appropriée se trouvait aggravée au moins d'une manière temporaire, mais elle ne courait le risque d'être détruite que dans le cas où l'envahisseur était demeuré au plus bas échelon de la barbarie, et ce cas devenait de plus en plus rare. Son intérêt se séparait ainsi peu à peu de celui de la société des propriétaires de l'Etat.
Dans la même période, on voyait la propriété économique se dégager de la propriété politique; les classes appropriées ou asservies devenaient libres et même propriétaires, tout en demeurant politiquement sujettes. Leurs forces et leurs ressources allaient croissant en conséquence, et elles acquéraient assez d'influence pour obliger le souverain à compter avec elles et à limiter ses exigences fiscales. Dans les pays les plus avancés en civilisation, elles obtenaient le droit de consentir l'impôt, et elles en usaient pour refuser de contribuer à des guerres dont la nécessité ne leur était pas clairement démontrée ou pour marchander leur concours comme il arriva par exemple en Normandie, lorsque le duc Guillaume entreprit la conquête de l'Angleterre. Mais quoiqu'elles eussent grandi et se fussent enrichies à l'abri de l'appareil de défense élevé et successivement perfectionné par la société des propriétaires de l'État, elles n'étaient point cependant les plus fortes, et dans les conflits qui s'élevèrent entre elles et le souverain elles eurent d'abord le dessous. L'agrandissement et l'unification des États, après la chute de la féodalité, leur porta [156] un coup funeste, car la puissance du souverain s'accrut de façon à briser toute résistance. Sauf en Angleterre, les « sujets » furent dépouillés du droit de débattre et de consentir l'impôt et, par conséquent, de refuser au souverain les i-cssources nécessaires à la guerre.
Cependant, la continuation de l'état de guerre avait eu pour résultat utile de multiplier les progrès de l'armement et de mettre ainsi, le monde civilisé à l'abri des retours offensifs de la barbarie. D'un autre côté, l'agrandissement des débouchés, provenant de l'extension du domaine de la civilisation et les progrès qui préparaient l'ère de la grande industrie accroissaient dans des proportions énormes la richesse et, avec elle, l'influence des classes vouées à la production. Quoiqu'elles eussent perdu généralement le droit de consentir l'impôt, quoique le souverain pût les taxer à son gré pour subvenir aux charges de l'état de guerre, il devait tenir compte de leur opinion. Aussi n'est-ce plus seulement aux intérêts de la classe dans laquelle se recrute son état-major politique et militaire qu'il s'adresse pour faire la guerre; c'est encore aux passions et aux intérêts de la multitude. De là, les guerres de religion et les guerres commerciales qui, avec les guerres de succession, ont rempli les trois derniers siècles de l'ancien régime. Sans doute, le souverain en faisant la guerre, pour un motif ou sous un prétexte quelconque, continuait à n'avoir en vue que la défense ou l'accroissement de son Etat, c'est-à-dire de sa propre puissance et de ses profits, mais il fallait maintenant que la guerre fût acceptée par une classe de plus en plus nombreuse et influente pour laquelle elle n'était plus qu'une « nuisance ». Il fallait aussi alléger autant que possible les charges de l'état de guerre, et c'est ainsi que la plus lourde de toutes, le servage militaire, fut remplacé, dans les pays les plus avancés en civilisation, par le recrutement libre. De la condition [157] de serfs, les soldats s'élevèrent à celle d'engagés volontaires et de salariés, comme l'étaient déjà leurs officiers. Malgré cette atténuation, la guerre devint de jour en jour moins populaire et l'antagonisme qu'elle créait entre les gouvernants et les gouvernés plus sensible.
La maison souveraine demeurait comme auparavant intéressée à faire la guerre pour agrandir ou mieux assurer son domaine politique. Il en était de même de la classe gouvernante, qui lui fournissait la presque totalité de son état-major militaire et civil et dont la guerre augmentail l'importance et les profits en accroissant son débouché. Mais il en était autrement de la masse gouvernée, qui tirait ses moyens d'existence de la production agricole, industrielle et commerciale. La guerre, qu'elle fût heureuse ou malheureuse, qu'elle aboutît à un agrandissement ou à une diminution du territoire de l'État, n'avait pour elle que des charges; dans l'un ou l'autre cas, il fallait également qu'elle en payât les frais sans en tirer aucun profil. Avaitelle même un intérêt appréciable à se soustraire au péril d'une invasion ou à éviter un changement de domination? Le danger des invasions barbares, qui semaient sur leur passage la dévastation et la ruine, avait cessé d'exister. Les usages de la guerre entre les peuples civilisés s'étaient adoucis sous l'influence de l'intérêt même des belligérants, le respect des personnes et des propriétés privées était devenu une règle généralement observée. [31] Il en résultait [158] qu'une invasion, surtout lorsqu'elle était suivie d'une occupation définitive, rapportait parfois à la population envahie plus qu'elle ne lui coûtait : en procurant un accroissement extraordinaire de clientèle aux classes qui trouvaient leurs moyens d'existence dans le commerce des choses nécessaires à la vie et même d'un certain nombre d'articles de luxe, elle compensait pour elle les gênes, les inquiétudes et les autres maux attachés à la guerre. Un changement de domination était-il davantage à redouter [159] pour les populations, la classe gouvernante exceptée? Qu'elles fussent sujettes de telle ou telle maison souveraine, de la maison de France ou d'Autriche, de la monarchie espagnole ou de la république des Provinces-Unies, leurs charges demeuraient à peu près les mêmes et la manière dont elles étaient gouvernées et administrées ne se trouvait pas sensiblement modifiée. Elles n'avaient donc plus qu'un bien faible intérêt à éviter une invasion ou même un changement de domination. Il leur était assez indifférent [160] qu'une guerre fût heureuse ou malheureuse, mais elles avaient un intérêt positif et certain à ce que l'état de guerre vînt à cesser, car il n'était plus nécessaire à leur sécurité; elles n'en retiraient aucun bénéfice et elles en supportaient les charges.
Sans se rendre exactement compte de ce nouvel état des choses, l'opinion publique des pays civilisés, à laquelle les classes vouées à la production agricole, industrielle et commerciale fournissaient un contingent de jour en jour plus considérable en comparaison de celui de la classe qui trouvait ses moyens d'existence dans la politique, l'administration et la guerre; l'opinion publique, disons-nous, était devenue de plus en plus pacifique. Dès le commencement du xvnc siècle, les esprits avancés se préoccupaient des moyens de mettre fin à l'état de guerre, en établissant une paix permanente entre les princes chrétiens. Ces tendances pacifiques se développaient et s'accentuaient dans le courant du xvine siècle; l'abbé de Saint-Pierre formulait son projet de paix perpétuelle; un autre prêtre philosophe, l'abbé Coyer, engageait la noblesse à chercher pour ses enfants de nouveaux débouchés, et à se rabattre sur les professions dont l'exercice avait jus-. qu'alors fait « déroger ». Lorsque la Révolution française éclata, ces tendances étaient devenues absolument prédominantes, et c'était une croyance universelle qu'elle allait inaugurer une ère de paix et de fraternité entre les peuples. [32]
[161]
II en a été autrement, comme on sait. La Révolution a déterminé au contraire une recrudescence de l'état de guerre. [162] Tandis que le risque naturel de guerre disparaissait par lefait de l'extension du domaine de la civilisation et de la prépondérance décisive que les progrès de l'art militaire et de l'armement assuraient aux peuples civilisés, il était remplacé par un risque artificiel provenant de la reconstitution sur des bases élargies et consolidées d'une classe intéressée à la continuation de l'état de guerre.
III. Persistance anormale de l'état de guerre à l'époque actuelle. Causes qui ont fait succéder au risque naturel de guerre un risque artificiel. — En supposant que la transformation politique de l'ancien régime se fût opérée par voie d'évolution au lieu de procéder par voie de subversion ou [163] de révolution; en supposant qu'au lieu de déposséder violemment pour se mettre à leur place la maison souveraine et la classe gouvernante, intéressées au maintien do l'état de guerre, les classes gouvernées, intéressées à la paix, se fussent bornées à établir un contrôle efficace sur la gestion et les dépenses du gouvernemenl, il y a apparence que l'état de paix aurait déjà succédé, dans le monde civilisé, à l'état de guerre. On objectera peut-être que les maisons souveraines et les corporations gouvernantes du reste de l'Europe n'auraient pas manqué de se liguer pour ctouffer dans l'œuf ce progrès qui menaçait lour prépondérance et leurs revenus, mais elles avaient à compter aussi [164] avec leurs « consommateurs politiques », dont les regards se tournaient avidement vers la France, où semblait se préparer l'affranchissement général des peuples. Si donc les promoteurs et les artisans de la réforme de l'ancien régime, au lieu de s'emparer du pouvoir pour l'exploiter à leur tour, s'étaient contentés de le limiter dans la mesure utile, et d'offrir aux autres nations ce progrès comme un exemple sans prétendre l'imposer, il est permis d'affirmer que l'ère de la liberté et de la paix se fût ouverte deux ou trois siècles plus tôt.
Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, etj est-il besoin de dire qu'il n'était pas possible, eu égard à l'état arriéré des sciences morales et politiques, sans parler de l'ignorance et des convoitises de la multitude, qu'elles se passassent ainsi?
Dès la réunion de l'Assemblée constituante, on vit se grouper des partis politiques ayant pour objectif la possession du gouvernement. Les uns, recrutés dans la classe qui avait eu jusqu'alors le monopole presque exclusif des fonctions politiques, civiles et militaires, luttaient pour conserver ce monopole; les autres, recrutés principalement dans la masse gouvernée, mais aspirant avec toute l'ardeur de convoitises longtemps refoulées à devenir gouvernante, luttaient pour s'en emparer. Dans ce conflit, qui acquit rapidement une violence extraordinaire, les partis ne se contentèrent point de recourir aux moyens constitutionnels et parlementaires : les uns déchaînèrent la révolution pour renverser la monarchie, tandis que les autres faisaient appel à l'intervention étrangère pour la maintenir et, plus tard, pour la restaurer. Ce ne furent point cependant les partis extrêmes, qui ouvrirent la longue et sanglante période des guerres révolutionnaires, ce fut le parti modéré, qui se flattait de créer ainsi un dérivatif aux passions affolées, tout en augmentant sa propre importance ; mais [165] le gouvernement n'ayant point tardé à tomber aux mains du parti le plus violent et le moins scrupuleux, quoique le moins nombreux, la guerre devint pour ce parti un instrumentum regni, un moyen souverainement efficace d'imposer sa dictature au nom du « salut public ».
11 importe de remarquer que le gouvernement révolutionnaire pouvait employer, pour faire la guerre et en assurer le succès, des procédés et des ressources extrêmes auxquels la monarchie affaiblie de l'ancien régime eût été impuissante à recourir. Il avait l'avantage de s'appuyer sur des intérêts nouveaux que la Révolution avait créés et que sa défaite eût ruinés, comme aussi de disposer d'un mécanisme politique dont elle avait porté la puissance au plus haut degré. L'Etat avait cessé d'appartenir à la « maison de France », pour devenir la propriété de la nation, et cctto dépossession politique avait été accompagnée de la confiscation d'une portion considérable des propriétés des classes gouvernantes, noblesse et clergé. Ces propriétés avaient été livrées moyennant un prix dérisoire à une classe nombreuse qui se trouvait ainsi attachée par le plus solide des liens, celui de l'intérêt particulier, aux destinées bonnes ou mauvaises de la Révolution. Le gouvernement révolutionnaire s'appuyait encore sur tous les hommes qui avaient souffert dans leurs intérêts, leur vanité ou, chose plus respectable, dans leurs aspirations libérales, des abus et des privilèges de l'ancien régime, et qui redoutaient son rétablissement. Enfin il disposait souverainement, grâce à la dictature que l'état de guerre, à l'intérieur et au dehors, lui avait permis de s'attribuer, de l'énorme appareil de gouvernement, avec la puissante centralisation que les rois unificateurs de l'ancien régime et leurs ministres les plus réputés avaient pris à tâche d'établir. Cette centralisation, la Révolution l'avait encore renforcée, en achevant de dissoudre ou d'asservir les corps constitués et en possession [166] d'un reste d'indépendance, le clergé, la magistrature, les assemblées provinciales, les corporations industrielles, les compagnies commerciales et financières. Aucune résistance aux mesures les plus tyranniques et aux excès les plus barbares des détenteurs du pouvoir n'était possible désormais, car, en face de l'État tout-puissant, il n'y avait plus que des individus isolés. On s'explique ainsi que le gouvernement issu de la Révolution ait pu disposer, plus complètement que les monarques les plus absolus de l'ancien régime, des forces et des ressources de la nation pour réprimer les révoltes à l'intérieur et porter la guerre à l'étranger. On s'explique notamment qu'il ait pu étendre au profit de l'État le servage sous sa forme la plus lourde et la plus cruelle, en remplissant les cadres de ses armées au moyen des réquisitions d'hommes, puis de la conscription, tout en pourvoyant à leur entretien au moyen des réquisitions de denrées et du papier-monnaie.
Il lui fallait, pour faire la guerre avec succès, des hommes et des capitaux en abondance. L'expérience n'avait pas tardé à démontrer que le recrutement volontaire, désormais limité aux seuls nationaux, ne pouvait fournir des hommes en nombre suffisant. Le gouvernement révolutionnaire n'hésita pas à recourir au recrutement forcé, en invoquant les nécessités du salut public, appuyées sur la crainte salutaire de la guillotine. Les circonstances favorisèrent au surplus l'extension et l'aggravation de cet impôt odieux auquel la monarchie ne demandait plus qu'un contingent complémentaire de forces. La crise révolutionnaire, en paralysant le commerce et l'industrie, avait enlevé leurs moyens d'existence accoutumés à des multitudes d'hommes, qui trouvaient du moins sous les drapeaux la subsistance de chaque jour. Plus tard, les pénalités terribles, destinées à assurer le payement de « l'impôtdu sang », eurent raison des résistances individuelles et réussirent, [167] suivant l'euphémisme officiel, à faire entrer la conscription dans les mœurs. Les réquisitions de denrées et le papiermonnaie fournirent les ressources nécessaires pour approvisionner et armer les masses d'hommes que le recrutement forcé mettait à la disposition de l'État. Cependant ces ressources extraordinaires auraient fini par s'épuiser si la conquête n'y avait point suppléé. Composées d'éléments que l'abus de l'impôt du sang n'avait point encore affaiblis, commandées par des jeunes gens dégagés de la routine traditionnelle, les armées de la Révolution, d'abord sous la dictature du comité de salut public, ensuite sous la dictature consulaire ou impériale, conquirent la plus grande partie de l'Europe. Grâce aux tributs levés en argent ou en nature sur les États vaincus et au supplément régulier de ressources que fournissaient les pays conquis et annexés, la guerre redevint pendant quelques années pour les Français ce qu'elle avait été pour les Romains, la plus productive des industries. Mais les progrès du matériel de guerre avaient modifié les conditions de succès de cette industrie en changeant la proportion des agents qui y coopéraient, travail et capital, à l'avantage de ce dernier, «t en assurant, ainsi, au belligérant le mieux pourvu de capitaux la victoire finale. Or, les progrès agricoles, industriels et commerciaux, dont l'Angleterre avait pris l'initiative, et en particulier l'application de la vapeur à la production manufacturière et minière, avaient accru ses ressources dans une proportion inusitée, tandis que le gouvernement anglais, placé jusqu'à un certain point sous le contrôle des « consommateurs politiques », inspirait une confiance particulière aux capitalistes. Le crédit dont il jouissait lui procura les. capitaux nécessaires pour prolonger la lutte et finalement pour mettre en mouvement des forces supérieures à celles dont pouvait disposer le conquérant de l'Europe, affaibli d'ailleurs par des [168] entreprises malheureuses en Espagne et en Russie. Les coalitions organisées et commanditées par l'Angleterre eurent enfin le dessus; la France fut envahie à son tour et condamnée à restituer les produits de ses victoires. Au bout de ces vingt-cinq ans de guerres qui avaient exigé des sacrifices sans précédent d'hommes et de capitaux, toutes les nations civilisées se trouvaient affaiblies et appauvries, sans qu'il fût possible de découvrir quel profit la civilisation en avait tiré.
Après cette effroyable saignée d'hommes et de capitaux, le besoin de repos était général et ce fut en vue de le satisfaire que s'organisa la Sainte-Alliance, destinée dans la pensée de son promoteur mystique à établir par l'accord des souverains ce règne de la paix que les révolutionnaires avaient voulu, au début, réaliser par l'accord des peuples. Mais la Sainte-Alliance ne pouvait opposer qu'une barrière insuffisante et précaire aux intérêts auxquels profitait l'état de guerre. Aussi longtemps que ces intérêts réussiraient, d'une manière ou d'une autre, à maintenir leur prépondérance, les nations civilisées étaient condamnées à subir les maux et les charges de la guerre.
Il devait même arriver, tant par l'effet des changements que la Révolution avait accomplis et qu'elle allait accomplir encore dans les dimensions et la constitution des États que par l'effet de l'avènement de la grande industrie et en particulier du développement du crédit et des moyens de communication; il devait arriver, disons-nous, que l'ascendant des intérêts engagés dans l'état de guerre devînt plus marqué, et son action plus rapide et presque foudroyante, que le « risque de guerre » s'accrût en conséquence d'une manière artificielle,emmotivantun accroissement correspondant de l'appareil destiné à le prévenir et que le régime dit de la « paix armée » successivement aggravé finît par rendre la paix presque aussi lourde à supporter que la guerre.
[169]
En supprimant le plus grand nombre des petits États que leur faiblesse intéressait au maintien de la paix, pour constituer de grands États, rapprochés et rivaux, la Révolution et les guerres dont elle a été la source ont visiblement contribué à augmenter le « risque de guerre ». On peut en dire autant des changements qu'elles ont provoqués dans la constitution des États de l'Europe.
Quelques-uns de ces États, tels que la Russie, la Prusse et l'Autriche ont continué, malgré la Révolution, à appartenir à des maisons souveraines. Ces maisons s'appuient principalement, en dépit des concessions libérales qu'elles ont pu accorder à leurs sujets, sur une classe aristocratique ou bureaucratique qui a pour débouché la politique, l'administration et l'armée, qui est intéressée aujourd'hui, comme elle l'était autrefois, à la continuation de l'étal de guerre. A la vérité, cette classe a cessé d'être privilégiée en matière d'impôts, elle supporte ou est censée supporter sa part des charges publiques; mais elle retire du budget, sous forme d'appointements, de gratifications et de pensions, un contingent au moins décuple de celui qu'elle lui fournit sous forme d'impôts; plus s'élèvent les dépenses politiques, administratives et militaires, plus son débouché s'étend et devient avantageux, plus la somme de ses revenus augmente. Qu'une guerre survienne : la carrière militaire procure aussitôt un surcroît de bénéfices et d'avantages, les campagnes comptent double, l'avancement est rapide; si la guerre est couronnée de succès, les chefs et jusqu'aux moindres officiers acquièrent une importance et un relief extraordinaires, sans parler des menus profits de l'occupation des pays conquis. Alors même qu'il n'y serait point porté par ses traditions et son inclination naturelle, le chef de la maison souveraine est donc obligé, aussi souvent que les circonstances le lui permettent, à faire la guerre, afin de [170] donner satisfaction aux intérêts qui lui servent de soutien et dont l'appui lui est d'autant plus nécessaire qu'il se sent menacé davantage par la Révolution.
En revanche, les États que la Révolution a façonnés ou reconstitués, et qui appartiennent non plus à une «maison», mais à la nation elle-même, ne sont-ils pas intéressés à conserver la paix? Ces nations propriétaires d'elles-mêmes n'ont-elles pas la grande majorité de leurs intérêts engagés dans des industries pour lesquelles la guerre est une « nuisance »? Ne semblerait-il pas qu'elles dussent être essentiellement] pacifiques? Cependant, chose singulière, les grandes guerres qui ont inutilement désolé le monde civilisé, depuis la Révolution de 1789, ont été provoquées par les « nations politiques » bien plutôt que par les «maisons politiques ». A quoi tient cette anomalie apparente? Elle tient à ce que les nations ont beau être propriétaires de leur état politique, elles ne peuvent, en vertu de la nature des choses, gérer elles-mêmes cette propriété, et elles n'ont pas réussi jusqu'à présent à en organiser utilement la gestion. Nous avons analysé les différentes formes de cette gestion, monarchie constitutionnelle, république parlementaire ou dictatoriale, avec suffrage limité ou universel, et nous allons voir qu'elles ont placé uniformément la direction des affaires aux mains ou sous l'influence prépondérante d'une classe d'hommes, intéressée à la continuation de l'état de guerre.
Lorsque l'État est constitué sous la forme d'une monarchie constitutionnelle à suffrage limité ou d'une république parlementaire à suffrage illimité, le gouvernement se trouve entre les mains du parti qui possède la majorité électorale, et c'est l'intérêt de ce parti qui sert de règle à sa politique intérieure et extérieure. Cet intérêt lui commande avant tout de conserver le plus longtemps possible la gestion des affaires publiques, et le moyen le plus [171] efficace auquel il puisse recourir pour atteindre ce but. c'est d'augmenter le nombre de ses co-intéressés, en élargissant le débouché qu'il leur offre, c'est de multiplier les emplois de tous genres. Dans les pays où le suffrage est limité, ces emplois se concentrent entre les mains des familles influentes du corps électoral ou se distribuent sous leur patronage, et comme elles puisent dans les caisses de l'Etat plus d'argent qu'elles n'y versent, elles ont un intérêt manifeste à l'accroissement des budgets. Voilà pourquoi, même dans les pays neutres, le budget de la guerre va croissant d'une manière constante ; c'est que les emplois de la hiérarchie militaire servent de débouché aux lils de famille de la classe en possession de la souveraiiieté politique et leur procurent une existence honorable et assurée. Si le pays possède assez de puissance et de ressources pour participer à une guerre, sans courir trop de risques et avec la perspective d'un accroissement de territoire, la classe gouvernante ne manquera pas de profiter de quelque occasion favorable pour s'y engager: elle y sera d'autant plus portée que le débouché politique, administratif et militaire qu'elle exploite, aura plus d'importance en comparaison du débouché agricole, industriel et commercial. C'est ce qui explique l'humeur belliqueuse des politiciens italiens, tandis que la masse de la nation, exclue de l'électorat, est, comme dans les autres pays, essentiellement pacifique.
Les gouvernements fondés sur le suffrage universel sont-ils plus intéressés à faire succéder l'état de paix à l'état de guerre? Lorsqu'ils sont encore dans la période parlementaire, les partis qui se disputent le pouvoir doivent compter avec la masse de la nation, intéressée à la paix, et on pourrait croire qu'ils sont obligés d'obéir à sa volonté; mais il ne faut pas oublier que les partis étant organisés comme des armées, le droit électoral de chaque citoyen se [172] réduit, en fait, à la faculté de choisir entre les candidats qu'ils lui imposent. Ces candidats concurrents s'efforcent naturellement de gagner les suffrages des électeurs en s'adressant à leurs intérêts ou en flattant leurs passions, et le maintien de la paix figure partout au nombre des promesses de leurs programmes. Mais on sait ce que valent les promesses électorales! Quand un parti est arrivé au pouvoir, il est sujet à les oublier, et les promesses pacifiques font encore moins que les autres exception à cette règle. La guerre au dehors implique la dictature au dedans, c'est-à-dire une période de gouvernement facile, dans laquelle l'opposition est réduite au silence, sous peine d'être accusée de complicité avec l'ennemi. Et quoi de plus désirable, surtout quand l'opposition est tracassièrc et que ses forces balancent presque celles du gouvernement! A la vérité, si la guerre est malheureuse, elle entraîne la chute du parti qui l'a entreprise. En revanche si elle est heureuse, et on ne l'entreprend que lorsqu'on se croit assuré d'avoir les chances de son côté, le parti qui l'a engagée et menée à bonne fin acquiert pour quelque temps une prépondérance écrasante. Que de motifs, sans parler des menus profits que la guerre procure, de ne pas laisser échapper une occasion favorable de la faire!
Il peut arriver encore que la guerre soit engendrée par la lutte des partis. C'est alors une guerre civile, plus terrible et plus acharnée qu'une guerre étrangère, car celle-ci peut se terminer et se termine d'habitude par un compromis, dans lequel le vaincu se borne à fournir une indemnité et à céder une partie de son territoire au vainqueur, tandis que la guerre civile ne prend fin que par l'écrasement complet du vaincu. La guerre de la Sécession aux ÉtatsUnis présente un exemple caractéristique de cette transformation de la lutte politique en une lutte à main armée. Le parti démocrate, appuyé principalement sur les intérêts [173] esclavagistes du Sud, avait été longtemps prédominant, mais le développement plus rapide des États du Nord le menaçait d'être dépossédé à jamais du gouvernement de l'Union. En admettant au contraire que les États du Sud vinssent à former une confédération séparée, il pouvait se croire assuré de conserver indéfiniment le pouvoir. Or, mieux valait une diminution de son débouché politique que la perte totale de ce débouché. Invoquant donc les intérêts esclavagistes menacés par les abolitionnistes du Nord et les intérêts libre-échangistes menacés par les protectionnistes, les politiciens du Sud engagèrent la guerre de la Sécession. Ceux du Nord intéressés au contraire au maintien de l'Union, dont le gouvernement venait de tomber entre leurs mains et devait, selon toute apparence, s'y perpétuer , firent appel aux intérêts et aux sentiments hostiles au Sud; puis, la guerre engagée, à l'amour-propre et aux passions jqu'ii est dans la nature de la guerre de mettre enjeu. Grâce à la supériorité de ses ressources, le Nord finit par l'emporter, mais au prix du sacrifice d'un million d'hommes, du gaspillage d'une vingtaine de milliards, de la ruine d'une des plus belles parties de l'Union, du développement de la bureaucratie, de la corruption et du protectionnisme. Ces maux, la constitution vigoureuse dela société américaine lui a permis de les supporter, mais elle sera longtemps à s'en guérir et ils sont loin encore d'avoir produit tous leurs fruits malsains.
Lorsqu'ils sont arrivés à leur période dictatoriale, les gouvernements fondés sur le suffrage universel présentent encore moins de garanties de paix. Comme les chefs des anciennes maisons politiques, le dictateur, stathouder, consul ou empereur, dont l'ambition secrète ou avouée est de fonder lui aussi, une « maison », s'appuie principalement sur l'administration et l'armée, et il est obligé, soit pour arriver aux fins qu'il ambitionne, soit simplement [174] pour se soutenir, de donner une ample satisfaction à leurs intérêts. Or, cette satisfaction, il ne peut la leur donner qu'en augmentant leur débouché. Il peut sans doute toujours multiplier les emplois civils et élargir les cadres de l'armée, mais cette extension du débouché administratif et militaire pendant la paix est peu de chose en comparaison de celle que la guerre rend possible et même nécessaire. Enfin, la dictature ne s'établit généralement que par un coup de force et elle ne se soutient qu'avec l'auxiliaire d'un système de compression et de prohibitions qui empêche les partis vaincus et dépossédés de se réorganiser pour renverser la dictature et reconquérir le pouvoir. Il faut, pour maintenir ce système, à la fois gênant et humiliant, une puissance considérable. Cette puissance, la guerre la donne. Outre qu'elle sert de dérivatif aux passions politiques et absorbe l'attention publique, elle motive, pendant toute sa durée, un état de siège national. Les mesures les plus violentes et les plus arbitraires contre les « ennemis de l'État » ne sont-elles pas justifiées par les nécessités du salut public? L'opposition en temps de guerre n'est-elle pas synonyme de trahison? Enfin, après une guerre heureuse, le prestige du dictateur, dont l'effigie se couronne de lauriers sur les monnaies, ne se trouve-t-il pas accru, au moins pour quelque temps? A la vérité, le dictateur doit compter avec la nation qui est composée maintenant , pour les neuf dixièmes, de familles auxquelles l'agriculture, l'industrie, le commerce, les arts fournissent leurs moyens d'existence, qui sont par conséquent intéressées au maintien de la paix, et qui se trouvent en possession du droit électoral. Ne peut-il pas craindre qu'elles n'usent de ce droit pour nommer des représentants opposés à la guerre et décidés à refuser les contributions extraordinaires en hommes et en argent qu'elle nécessite? Cette éventualité peut se produire sans doute, mais n'est-il [175] pas facile d'y parer? Quand le dictateur possède, comme Napoléon Ier, une force et un prestige irrésistibles, il supprime purement et simplement l'exercice du droit électoral, il enlève aux membres de la « nation souveraine » tout moyen légal d'exprimer leur opinion et de faire opposition à sa volonté; quand il ne se croit point assez fort pour usurper ouvertement la souveraineté, il s'arrange de façon à faire manœuvrer à son gré le suffrage universel. Il ne s'agit que de savoir s'y prendre, et le second empire s'y prenait avec une habileté incomparable. En supposant toutefois que la représentation asservie au gouvernement, mais après tout issue de la nation, eût partagé les répugnances de celle-ci pour la guerre, pouvait-elle s'y opposer d'une manière opportune et efficace? Le dictateur impérial ne possédait-il point, comme les rois de l'ancien ou du nouveau régime, le droit de déclarer la guerre, et ne dépendait-il pas de lui de la rendre inévitable avant de réclamer le concours et les subsides de la prétendue représentation nationale? [33]
[176]
Les changements accomplis dans la constitution des gouvernements ont donc contribué à augmenter le risque de guerre au lieu de le diminuer. En même temps toute une série de progrès administratifs et économiques est venue accroître encore ce risque.
Sous l'ancien régime, la moindre guerre exigeait de longs préparatifs. Il fallait recruter des soldats, en leur offrant l'appât d'une paye suffisante, et comme on n'en trouvait pas toujours en assez grand nombre dans le pays même, on était obligé d'en importer un supplément de l'étranger. Il fallait ensuite posséder un « trésor » bien garni, car on ne pouvait recourir que dans une faible mesure à l'impôt et au crédit. Enfin, quand on avait à grand'peine rassemblé, outillé et approvisionné une petite armée, on ne pouvait, par suite de la difficulté des communications et de l'insuffisance des moyens de transport, la lancer du jour au lendemain en pays ennemi : ses mouvements étaient lents, et d'ailleurs la nécessité de ménager des soldats difficiles à remplacer et représentant une forte prime d'enrôlement contribuait encore à ralentir les opérations militaires; on évitait les grandes effusions de sang et les guerres se prolongeaient sans mettre sérieusement en péril l'existence des États belligérants.
[177]
Cet état de choses a complètement disparu par le fait des progrès de l'unification et de la centralisation qui ont accru démesurément la puissance de l'Etat en comparaison de celle de l'individu et rendu possible le rétablissement du servage militaire; par le fait encore du développement du crédit public, de l'invention et de la multiplication des télégraphes et des chemins de fer. Tous les pays civilisés, à l'exception de l'Angleterre et des États-Unis, ayant conservé ou rétabli, depuis la Révolution, le système du recrutement forcé, l'impôt du sang, levé pour ainsi dire d'une manière instantanée, grâce à la centralisation, aidée du télégraphe et armée de pénalités formidables contre les réfractaires, a permis de rassembler en quelques jours des armées innombrables, tandis que le papier-monnaie et le crédit fournissent au gouvernement les ressources extraordinaires que la guerre exige. Il n'est plus nécessaire d'accumuler un trésor ou de recourir à la maigre ressource de l'altération de la monnaie métallique, on peut émettre en déboursant simplement le prix du papier et de l'impression, une somme de papier-monnaie égale au montant de la circulation métallique, avant que cet instrument perfectionné ait subi une dépréciation sensible; on peut encore, si la nation propriétaire de l'État, partant responsable des engagements pris en son nom, jouit d'une réputation passable sur le marché financier, obtenir par voie d'emprunts une quantité de capital proportionnée à ses ressources, surtout si l'on ne marchande pas sur le taux de l'intérêt, et comment marchanderait-on quand « l'honneur national » et le «salut public» sont en jeu? Il suffit donc de quelques jours pour réunir et lancer au delà de la frontière des armées dix fois plus nombreuses que celles qu'on mettait quelques mois à rassembler il y a un siècle. Ces armées colossales se meuvent avec une rapidité foudroyante et aucun obstacle n'arrête les chefs qui dirigent leurs mouvements; [178] ils n'ont en vue que le résultat à atteindre, car ils ne sont pas obligés d'économiser la vie des hommes; ils peuvent puiser à même dans le grand réservoir des forces de la nation. Ils les renouvellent au besoin jusqu'à extinction, et alors l'État vaincu, complètement désorganisé, à bout de forces et de ressources, se trouve à la merci du vainqueur, qui exige naturellement une compensation d'autant plus considérable, sous forme d'indemnités en argent et en territoire, que la lutte a été plus intense et qu'elle lui a coûté davantage.
C'est ainsi que la paix, et avec elle la sécurité, la liberté et le bien-être de quelques centaines de millions d'hommes, se trouvent à la merci d'un petit nombre de personnages: empereurs, rois, ministres qui gouvernent les Etats agrandis, unifiés et centralisés, entre lesquels se partage aujourd'hui la portion la plus importante du domaine de la civilisation. Ces personnages sont eux-mêmes placés sous l'influence immédiate d'une classe intéressée à la continuation de l'état de guerre, classe dont la puissance n'a cessé de s'accroître par l'extension de son débouché politique, administratif et militaire; à quoi il faut ajouter l'exclusion absolue des étrangers de ce débouché, devenu le monopole des nationaux, et en particulier de ceux qui sont en possession de la souveraineté politique. De plus, ces chefs d'État peuvent déchaîner la guerre d'une manière instantanée en mettant à son services toutes les forces et les ressources d'un grand pays. Le « risque de guerre » s'est accru en conséquence, et il amotivé, àmesure qu'il s'accroissait, le développement de l'énorme appareil de la « paix armée ». Avons-nous besoin d'ajouter que cet appareil de protection n'«mpêche pas la guerre d'éclater et de dévorer périodiquement les fruits du progrès économique?
IV. — Les motifs et les résultats des guerres contemporaines. Leur tendance à la périodicité. Conclusion: - Cependant, [179] quelles que soient la puissance des hommes qui décident de la paix ou de la guerre et l'influence de la «lasse où se recrute l'état-major politique, administratif H militaire, ils sont obligés, comme nous venons de le remarquer, de compter dans une certaine mesure avec la niasse, bien autrement nombreuse, dont les intérêts sont engagés dans les différentes branches de la production, pour lesquelles la guerre est une « nuisance ». Les intérêts bien ou mal entendus de cette multitude, ses sentiments, ses passions sont un des éléments composants, sinon déterminants de l'opinion politique. Or, un gouvernement qui entreprendrait une guerre malgré l'opinion publique s'exposerait, en cas de revers, à être renversé. L'expérience démontre toutefois que la force de résistance de cet élément pacifique n'est aucunement proportionnée à sa masse. L'immense majorité des hommes qui le composent est absolument ignorante, et rien n'est plus facile que d'exciter ses passions et del'égarer sur ses intérêts. La minorité éclairée est peu nombreuse, et d'ailleurs quel moyen aurait-elle de faire prévaloir son opinion, en présence de la puissante organisation de l'État centralisé? En outre, les progrès, qui ont rendu la guerre plus facile et plus prompte à engager, ont contribué à en rendre aussi le fardeau immédiat plus supportable. C'est au papier-monnaie et au crédit que l'on a recours pour se procurer les ressources qu'elle exige. Il en résulte qu'elle n'est précédée ou accompagnée d'aucune surcharge des impôts ordinaires, et même que les dépenses extraordinaires qu'elle occasionne procurent un développement artificiel et temporaire de prospérité à une foule d'industries. C'est plus tard, quand la guerre est finie, qu'il faut bien se résoudre à augmenter les impôts pour retirer le pa~ pier-monnaie, pourvoir au service des intérêts et à l'amortissement des emprunts. Alors seulement on en ressent le fardeau, encore est-il dissimulé, sans être diminué, [180] par l'ingénieux artifice de l'impôt indirect, que la finance moderne a diversifié et perfectionné. A la vérité, c'est à l'impôt, sous sa forme la plus brutale, que l'on a recours pour remplir les cadres des armées; mais, jusqu'à nos jours, ce sont les classes inférieures, celles dont l'influence compte le moins, qui ont généralement fourni les simples soldats. Les classes aisées s'en tiraient au moyen d'un sacrifice d'argent et ce sacrifice, ordinairement très modique, était compensé, et au delà, par le débouché que l'état de guerre offrait à leurs membres, auxquels la prohibition des étrangers et l'obligation de passer par des écoles militaires dont l'accès était, en fait, impossible aux classes pauvres, conférait le monopole des emplois rétribués de la profession des armes. Enfin si la guerre est cruelle pour les conscrits qui fournissent, selon l'énergique expression populaire, « la chair à canon », le départ de ces corvéables, enlevés aux travaux de la ferme ou de l'atelier, en diminuant l'offre des bras, a pour résultat de faire hausser les salaires et d'atténuer ainsi, chez ceux qui échappent au service militaire, l'horreur de la guerre. C'est seulement lorsqu'elle se prolonge où lorsqu'elle éclate à des intervalles trop rapprochés, qu'on en sent tout le poids et qu'elle finit par provoquer le soulèvement de l'opinion publique.
Néanmoins, l'opinion, dans la majorité des éléments qui la constituent, se montre aujourd'hui de plus en plus attachée à la paix, et ce n'est pas un des moindres mérites d'un homme d'État de savoir l'entraîner à la guerre. Il faut faire valoir les motifs les plus propres à la toucher, invoquer ses intérêts, éveiller ses appréhensions, ses sympathies et ses haines, lui persuader que l'honneur national est engagé, faire vibrer, en un mot, les cordes du patriotisme; il faut encore et surtout saisir le moment opportun.
Le choix des motifs diffère naturellement selon le tempérament et les inclinations naturelles du peuple auquel [181] on s'adresse, et il est intéressant de les comparer à ceux qui étaient invoqués sous l'ancien régime.
Le mobile déterminant des guerres de l'ancien régime ne différait pas de celui de toutes les autres entreprises : c'était l'intérêt. Quel qu'en fut le motif ou le prétexte, la guerre avait toujours pour objet la conservation ou l'accroissement de la richesse et de la puissance de la « maison » propriétaire et exploitante de l'État, ainsi que des maisons subordonnées qui étaient en possession de fournir le personnel dirigeant de cette exploitation. Si l'État, par exemple, avait une frontière ouverte, on faisait la guerre pour la reculer jusqu'à un fleuve ou une montagne, de manière à être couvert par une frontière naturelle. Ou bien encore on faisait la guerre lorsqu'une puissance s'agrandissait de telle sorte que sa prépondérance devenait menaçante pour la sécurité des autres. Celles-ci se coalisaient contre elle jusqu'à ce qu'elles l'eussent diminuée et affaiblie. Mais la guerre était le plus souvent motivée par l'hérédité ou la parenté, parfois aussi par des sympathies ou des devoirs de famille. Un État politique étant une propriété comme une autre, on en héritait par voie de succession ou de legs, sauf les restrictions qui avaient pu être opposées à l'exercice de ce droit. De là l'importance exceptionnelle des alliances matrimoniales. Lorsque la maison propriétaire de l'État venait à s'éteindre en ligne directe, les branches collatérales ou les maisons qui lui étaient alliées ne manquaient pas de se disputer son héritage, et ce procès se vidait ordinairement par les armes. Ajoutons que les maisons alliées se soutenaient naturellement soit contre les révoltes de leurs sujets, soit contre les agressions des maisons étrangères. Telles étaient les guerres politiques. Les guerres religieuses avaient pour but de donner satisfaction aux intérêts du clergé que les schismes intérieurs ou étrangers menaçaient dans son monopole. Enfin, les guerres commerciales avaient [182] de même pour objet de préserver ou d'agrandir le monopole d'un marché, lorsque, comme à Venise et à Gênes, le gouvernement appartenait à une classe adonnée au commerce.
Depuis que la propriété des États politiques a commencé à passer, nominalement du moins, aux nations, les motifs ou les prétextes invoqués pour faire la guerre se sont modifiée en conséquence. Il y en a cependant qui sont communs aux deux régimes : telle est la nécessité de se procurer des frontières naturelles ou de s'unir contre une puissance dont la prépondérance menace l'équilibre général. Ily en a d'autres, en revanche, qui sont particuliers au nouveau régime ou, pour mieux dire, qui sont des applications nouvelles d'un principe ancien. C'est ainsi qu'aux guerres suscitées par les droits de la parenté des maisons propriétaires d'Etats, on a vu succéder celles qui dérivent de la parenté des races. Une nation politique d'une certaine race a des droits imprescriptibles sur les rameaux de cette même race, surtout s'ils se trouvent projetés dans le voisinage de ses frontières; en vertu de ce nouveau droit public, l'Italie a des droits sur le Tessin, sur le Tyrol, sur Trieste, sur le comté de Nice; la France a des droits sur la Belgique, ou du moins sur la partie wallonne de ce pays, et sur les cantons français et romans de la Suisse; l'Allemagne était fondée à réclamer l'Alsace et elle le serait à s'annexer les provinces baltiques, etc. Ces droits demeurent à l'état latent jusqu'au jour où se présente une occasion opportune pour les faire valoir, mais est-il nécessaire de dire que, cette occasion venant à s'offrir, on ne doit reculer devant aucun sacrifice pour faire rentrer ces enfants séparés, n'eussentils d'ailleurs aucun goût pour leur parenté,'dans le giron de l'unité nationale? On fait encore la guerre pour venir en aide à des nationalités consanguines, les aider à s'affranchir du « joug étranger » et s'en faire des alliés fidèles: [183] c'est ainsi que la France a aidé le Piémont à « faire l'Italie » et que la Russie a affranchi do la domination turque les Serbes et les Bulgares à titre de frères slaves. Bref, les motifs ou les prétextes de guerre ne manquent pas plus sous le nouveau régime qu'ils ne manquaient sous l'ancien; mais, sous l'un comme sous l'autre, le vrai mobile de toute guerre, c'est toujours l'intérêt do la classe ou du parti en possession du gouvernement, intérêt qu'il ne faut pas confondre avec celui de la nation ou de la masse dos consommateurs politiques, car autant la classe ou le parti gouvernant est intéressé à la continuation de l'état de guerre, autant la nation gouvernée l'est au maintien et à la consolidation de la paix.
Mais il ne suffit pas d'avoir un motif ou un prétexte plausible de faire la guerre, il faut encore choisir le moment opportun. Une génération qui a fourni la quantité de chair à canon qu'exige une grande guerre, qui a subi la gêne et le dommage de la dépréciation du papier-monnaie qu'il a fallu émettre pour la soutenir et, plus tard, des nouveaux impôts qu'il a fallu établir pour la liquider, qui a vu de près la guerre et ses horreurs, éprouve une invincible répugnance à s'y laisser entraîner une seconde fois. Il faut laisser s'affaiblir ces souvenirs douloureux et sinistres. Il faut que les morts aient été oubliés, que le papier-monnaie ait été retiré, que les impôts de guerre aient été abolis, que les progrès de l'industrie aient agi pour réparer les brèches faites à la fortune publique et privée, qu'une nouvelle génération ait fait son apparition sur la scène, pour que-1'opinion publique puisse être encore une fois entraînée à la guerre. Si l'on s'y prend trop tôt, elle ne manquera pas de demeurer sourde aux adjurations belliqueuses les plus éloquentes des politiciens patriotes.
Il ne faut pas non plus s'y prendre trop tard et laisser passer ce qu'on pourrait nommer le moment psychologique [184] d'une guerre. La monarchie de Juillet en a fait l'expérience à ses dépens. Il est visible que son attachement à la paix quand même a été une des principales causes de sa chute. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'existence des gouvernements modernes dépend encore beaucoup plus de la classe intéressée à la continuation de l'état de guerre que de celle dont les intérêts sont du côté de la paix. S'ils sont obligés de ménager celle-ci beaucoup plus que ne le faisaient les gouvernements de l'ancien régime, à cause de l'importance croissante que l'avènement de la grande industrie lui a value, ils sont sous la dépendance immédiate de celle-là. Si donc, quandlesmaux des guerres précédentes sont réparés et oubliés, quand les finances sont refaites, quand la nouvelle génération est mûre pour la guerre, c'est-à-dire au bout d'une période de quinze ou vingt ans au plus, [34] le gouvernement hésite soit à continuelles traditions glorieuses de la génération précédente, soit à venger les défaites qu'elle a subies et à réparer les brèches faites aux frontières et à l'honneur national, il s'expose à devenir impopulaire auprès de cette classe aujourd'hui plus nombreuse et plus puissante que jamais qui alimente les fonctions politiques, administratives et militaires. Une [185] fermentation malsaine s'opère dans cette classe qui se recrute à la fois dans les familles en possession d'alimenter le personnel exploitant de l'État et dans celles qui aspirent à les remplacer ou tout au moins à entrer en partage avec elles. Des fanatiques, qui s'imaginent de bonne foi qu'en s'emparant de l'État et en lui appliquant leur système politique et économique, ils mettront fin à tous les maux de la nation et de l'humanité, organisent des conspirations. L'excellence ou, suivant l'expression consacrée, la souveraineté du but, légitime tous les moyens qu'ils mettent en usage poury atteindre. Une révolution éclate, intronisant un nouveau gouvernement qui, sous peine d'être renversé à son tour, est irrésistiblement conduit à faire la guerre pour donner une pâture aux appétits que la révolution a déchaînés.
C'est ainsi que les révolutions et les guerres ont acquis un caractère de périodicité à une époque où la guerre a cessé d'avoir sa raison d'être, où elle n'est plus qu'une « nuisance » sans compensation. Elle absorbe la portion la plus considérable des forces et des ressources nouvelles que le progrès en voie d'accomplissement dans toutes les branches de l'activité humaine a mises à la disposition de l'homme civilisé; elle est le grand et affreux ulcère par lequel s'écoule, stérile et corrompue, la substance vivifiante du progrès. La statistique des pertes et dommages causés par la guerre depuis la Révolution française présente des chiffres effroyables, [35] et cependant les statistiques [186] ne peuvent en relever qu'une faible part : elle a affaibli la [187] race, en la mettant en coupe réglée, [36] détruit les capitaux, [188] imposé aux Etats civilisés une dette qui excède 100 milliards et dont les intérêts, joints aux dépenses de la paix armée, absorbent en moyenne les deux tiers des budgets; [37] elle oblige toutes les nations à subir le fardeau et les gênes d'un système d'impôts suranné qui ralentit la production et le développement normal de la richesse. Qu'a-t-elle rapporté en échange? On ne pourrait pas citer une seule guerre moderne qui n'ait été une banqueroute ; pas une seule qui ait rapporté, en bien-être, en sécurité et en liberté, à la masse des consommateurs politiques, la centième partie de ce qu'elle leur a coûté. Le plus souvent, elle a établi un régime pire que celui qu'elle a renversé, et dans le cas le [189] plus favorable, ce qu'il y a eu d'utile et de bienfaisant dans le régime qu'elle a fondé, eût été réalisé, à moins de frais et plus sûrement par les moyens pacifiques. Le seul résultat utile que l'on puisse mettre à son actif, et en méme temps le seul dont personne ne songe à tenir compte, c'est l'accroissement de la puissance et de l'efficacité du matériel de guerre. Les armes de précision et à longue portée ont achevé d'assurer la supériorité militaire des nations les plus avancées et les mieux pourvues de capitaux, mais ce résultat n'a-t-il pas été acheté bien cher? Si l'état de guerre avait cessé plus tôt, les progrès du matériel en eussent été sans doute ralentis, mais ceux qui se trouvaient déjà réalisés suffisaient pour écarter le péril d'une nouvelle conquête barbare et permettre aux peuples civilisés d'achever d'établir leur domination sur le reste du monde.
On peut donc affirmer que la guerre entre les peuples civilisés n'est plus nécessaire à la sécurité et aux progrès de la civilisation; qu'elle n'est plus que la prolongation artificielle et malfaisante de l'état originaire de barbarie de l'espèce humaine. Aussi faut-il remarquer qu'elle a perdu, à mesure qu'elle a cessé d'avoir sa raison d'être, sa poésie et son prestige; les motifs patriotiques, voire même humanitaires, qu'on met en avant pour lui rendre son ancienne popularité, sonnent faux; l'état militaire n'attire plus l'élite de la jeunesse, et la crainte des gendarmes amène et retient seule sous les drapeaux la masse des corvéables du service obligatoire. La gloire des guerriers n'éclipse plus celle des inventeurs, des savants, des artistes, dont les services étaient jadis moins prisés parce qu'ils étaient, en effet, moins utiles. Elle est en train de pâlir et ne jette plus que des lueurs douteuses; car c'est l'utilité qui est le premier élément du prix des services et, sans se rendre compte des causes qui ont rendu la guerre de moins en moins utile, on en a le sentiment. Voilà pourquoi l'état de guerre est [190] moralement condamné, malgré les efforts des intérêts qui y sont engagés, pour le maintenir et le perpétuer.
Comment pourra-t-il prendre fin? Suffira-t-il, comme se l'imaginent les naïfs apôtres de la paix, de recommander la pratique de l'arbitrage ou bien encore de perfectionner le droit des gens pour supprimer la guerre? Non, sans doute. Ce qui maintient artificiellement l'état de guerre parmi les peuples civilisés, c'est l'intérêt des classes gouvernantes, c'est la prépondérance qu'elles conservent et dont elles sont précisément redevables à la continuation de l'état de guerre. Cette situation se prolongera, le fléau de la guerre continuera de sévir, d'une manière périodique, jusqu'à ce que l'évolution de la grande industrie soit arrivée au point de donner une prépondérance décisive à la masse intéressée à l'établissement de l'état de paix.
En attendant, la politique extérieure des États modernes est demeurée et demeurera la même que celle des Etats de l'ancien régime. Agrandir l'établissement politique qu'ils exploitent, préparer des alliances, organiser des ligues, soit en vue de cet agrandissement, soit en vue de l'affaiblissement et de la diminution des États concurrents, sans se montrer autrement scrupuleux sur le choix des moyens d'arriver à leurs fins, voilà pour les politiciens d'aujourd'hui, comme pour ceux d'autrefois, l'objectif de la politique extérieure, et le principe dirigeant des relations internationales.
[191]
CHAPITRE VII.
La politique intérieure des États modernes↩
I. Aperçu rétrospectif de la constitution des États d« l'ancien régime et df leurs conditions d'existence. — II. Le communisme politique. — Causes de son infériorité. — Conséquences de son établissement. A l'extérieur: recrudescence artificielle de l'état de guerre et aggravation de ses maux. A l'intérieur : détérioration des différentes parties de la gestion de l'iïtat. 1° Exclusion des étrangers du personnel des services publics; 2° Extension progressive des attributions du gouvernement ; 3° Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale; i» Restrictions opposées à l'exercice des libertés nécessaires au self government; 5° Impuissance et corruption de l'opinion publique; 6° Résultats.
I. Aperçu rétrospectif de la constitution des États de l'ancien régime. — En étudiant la fondation et la constitution des États politiques, nous avons constaté qu'ils n'étaient autre chose que des entreprises instituées, comme toutes les entreprises, dans le but de réaliser un profit. Aussitôt que la création du matériel de l'agriculture et de la petite industrie eut rendu profitable l'exploitation régulière d'un territoire meublé de ses habitants, on vit des associations se former pour entreprendre cette branche d'industrie, qui était alors et devait être longtemps encore la plus lucrative de toutes : les promoteurs de ces entreprises s'adjoignaient un personnel suffisant, avec l'outillage et les approvisionnements nécessaires, en stipulant la part de chacun dans les résultats éventuels de l'entreprise et ils organisaient ce personnel conformément au but qu'il s'agissait d'atteindre, comme on organise un atelier [192] quelconque. Ils formaient une armée avec laquelle ils effectuaient la conquête du domaine qu'ils convoitaient, puis, cette opération achevée et le partage fait entre les coparticipants, ils constituaient un gouvernement chargé de défendre le domaine conquis contre la concurrence des autres sociétés politiques, de l'agrandir au besoin à leurs dépens et de l'exploiter de manière à en tirer le plus gros profit possible. Nous avons constaté encore qu'après le partage du domaine entre les membres de la société conquérante, le chef de la hiérarchie militaire, duc, roi ou empereur, devenu le chef héréditaire du gouvernement, s'était appliqué à absorber dans l'intérêt de sa maison les parts de souveraineté, autrement dit de propriété politique, échues à ses co-associés, et qu'à la fin du xviiie siècle, par suite de ce travail d'absorption, les Etats de l'Europe appartenaient, sauf en 'Allemagne, à un petit nombre de « maisons politiques » qui les exploitaient à leur profit et s'efforçaient de les agrandir aux dépens des maisons concurrentes.
Dans toute cette période de l'existence des États politiques, la nécessité principale à laquelle ceux qui les possédaient et les exploitaient avaient à pourvoir, c'était de se défendre contre la concurrence étrangère et, subsidiairement, de se fortifier et de s'agrandir aux dépens de leurs concurrents. Tel était l'objet de leur politique extérieure. Cette politique avait pour instruments la diplomatie et la guerre. Conclure des alliances politiques en vue d'augmenter les forces de l'Etat dans la prévision d'une guerre de défense ou de conquête, sauf, le résultat atteint, à se défaire de ses alliés, parfois pour en prendre d'autres parmi ses ennemis de la veille ; semer habilement la division parmi ses concurrents, fomenter entre eux des querelles et des guerres propres à les affaiblir, contracter des unions matrimoniales avantageuses, principalement au point de [193] vue des successions : voilà quelle était la mission de la diplomatie, mais cette mission n'était, en dernière analyse, qu'une préparation à la guerre. C'était la guerre, c'est-àdire la mise en œuvre de la force organisée, qui décidait des destinées des États. C'était principalement par la guerre qu'ils s'agrandissaient ou s'amoindrissaient et qu'ils finissaient par périr, absorbés par un concurrent plus habile et plus fort. La grande et incessante préoccupation des propriétaires exploitants des États politiques, — associations constituées sous forme de républiques ou de féodalités, maisons royales ou impériales, — était, en conséquence, d'avoir toujours prêtes des forces et des ressources suffisantes pour soutenir une guerre quand ils venaient à y être exposés, ou pour l'engager quand ils jugeaient le moment opportun. Bref, dans un État de l'ancien régime, tout était subordonné aux nécessités de la politique extérieure, car la grandeur et l'existence même de l'État en dépendaient immédiatement.
La situation extérieure de l'État influait de deux manières sur sa politique intérieure. D'abord la présence d'une concurrence toujours menaçante obligeait l'association ou la maison qui le possédait à le gérer de façon à en tirer la plus grande somme possible de forces et de ressources applicables à la guerre. Si elle le gérait mal, si elle laissait la division et le désordre s'y introduire, si elle épuisait les populations assujetties, elle diminuait les éléments de sa puissance et augmentait par là même le risque qu'elle courait de succomber dans une lutte extérieure, et d'être ainsi dépouillée du domaine qui lui fournissait ses moyens d'existence. Ensuite, l'état de guerre, surtout à l'époque où le risque qu'il faisait courir à la civilisation était à son maximum d'élévation, où les forces du monde barbare n'avaient pas cessé de balancer celles du monde civilisé, l'état de guerre nécessitait un ensemble de mesures d'ordre [194] et de précaution analogues à celles qui constituent le régime d'une ville en état de siège.
Dans une ville en état de siège, tout est subordonné aux nécessités de la défense. Le commandant de la place est investi de pouvoirs extraordinaires; il soumet les habitants à une discipline particulière et il leur impose des servitudes de toute sorte : il réglemente la plupart des manifestations de l'activité privée, interdit les réunions et les associations qui lui paraissent dangereuses, pourvoit aux approvisionnements, défend la sortie des subsistances et des articles nécessaires à la défense, etc., etc. Si l'on apprécie ces mesures sans tenir compte des nécessités de l'état de siège, elles paraîtront, sans aucun doute, oppressives et contraires aux principes les mieux établis de l'économie politique ; en revanche, elles se justifieront, au moins en grande partie, — car l'état de siège peut être surchargé de rigueurs inutiles et de règlements nuisibles, — si l'on tient compte de la présence de l'ennemi, de l'interruption ou de la difficulté des communications avec le dehors et de la situation anormale qui en résulte. Cela est si vrai que la population de la ville assiégée ou simplement exposée à un siège, consciente du danger qu'elle court et des mesures de précaution qu'il nécessite, consent volontairement à se soumettre aux gênes, aux servitudes et aux charges de l'état de siège, et qu'elle en réclame le maintien aussi longtemps qu'elle se croit menacée, parfois même après que le péril a disparu. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, quand on étudie la gestion intérieure des États de l'ancien régime dans ses différentes, branches, la police, l'administration et les finances.
La plus importante de ces branches était la police, et principalement la police politique. La maison ou l'association propriétaire n'avait pas seulement à redouter une dépossession partielle ou totale causée par la guerre extérieure, elle avait à se prémunir aussi contre les compétitions [195] dynastiques, les révoltes, les conspirations et les divisions intérieures, et ces périls se trouvaient naturellement aggravés par la présence et les machinations des concurrents du dehors, qui s'efforçaient d'en profiter. C'est pourquoi la police et la justice avaient pour premier objet de prévenir et de réprimer les attentats contre l'autorité du souverain et la sûreté de l'Etat, les crimes dits de lèse-majesté ou de haute trahison. On se préoccupait beaucoup moins des atteintes portées à la vie et à la propriété des particuliers et on les punissait avec moins de sévérité. Sans doute, l'intérêt bien entendu du souverain, propriétaire exploitant de l'État, lui commandait de les réprimer comme aussi de se garder lui-même d'en donner l'exemple, car l'insuffisance de la sûreté pour les personnes et les propriétés empêchait ou ralentissait le développement de la production et, par conséquent, du revenu qu'il en tirait; mais cette conséquence du défaut de sécurité était moins saisissante et on la rattachait rarement d'ailleurs à sa véritable cause. A peu près au même rang que les atteintes portées à l'autorité du souverain figuraient celles qui étaient dirigées contre la religion de l'Etat. De même que les hommes de guerre préservaient l'État des agressions du dehors, les hommes d'Église maintenaient chez les populations le sentiment de l'obéissance au souverain, élu du Seigneur, monarque par la « grâce de Dieu », et assuraient sa domination au dedans. Ils demandaient naturellement, en échange de ce service, à être protégés contre les cultes concurrents qui menaçaient de supplanter le leur et de leur enlever, avec leur clientèle, leurs moyens d'existence. Si deux ou plusieurs cultes rivaux avaient pu subsister en paix dans le même État, en enseignant à leurs ouailles le respect de l'autorité du souverain, celui-ci aurait pu sans inconvénient autoriser la liberté des cultes; mais il n'en était pas ainsi. L'esprit de tolérance n'existait ni chez les [196] orthodoxes ni chez les hérétiques. Les uns et les autres s'efforçaient de supprimer une concurrence qui leur portait dommage et, quand le gouvernement refusait de protéger leur monopole, ils soulevaient les populations ou même ils allaient chercher un appui à l'étranger. La prohibition des cultes concurrents paraissait donc nécessaire au maintien de l'ordre intérieur et à la sûreté de l'État. C'est pourquoi, sauf en Hollande où la pratique de la concurrence commerciale avait habitué les esprits à la concurrence religieuse, cette prohibition était universelle. Les nécessités de l'ordre intérieur combinées avec les périls du dehors commandaient encore d'empêcher toute agrégation de forces de se constituer, dans un but quelconque, sans l'autorisation du souverain et en dehors de son contrôle. On ne pouvait souffrir non plus que des doctrines, ayant pour tendance d'affaiblir, directement ou indirectement, l'autorité du souverain et de contester ses droits, se répandissent parmi ses sujets, et voilà pourquoi, lorsque les merveilleux instruments de propagande de l'imprimerie et de la presse eurent été créés, on vit s'établir ou se renforcer les pénalités contre les libelles politiques ou religieux et se généraliser le régime de la censure.
Les mêmes nécessités impliquaient, dans une mesure plus ou moins étendue, la réglementation de l'industrie et du commerce. Comme nous l'avons remarqué dans la première partie de cet ouvrage (voir l'Évolution écononomique, chap. vii), l'imperfection ou le défaut des moyens de communication, joint à l'insuffisance de la sécurité, limitait les marchés, de manière à y empêcher l'action régulatrice de la concurrence; en d'autres termes, la plupart des branches de la production constituaient autant de « monopoles naturels ». Il pouvait être nécessaire, en l'absence du régulateur naturel de la concurrence, de limiter artificiellement le pouvoir des détenteurs de ces [197] monopoles par l'établissement d'un maximum du prix et d'une réglementation de la fabrication quand la coutume n'y suffisait pas. [38] L'administration avait aussi, parmi ses attributions les plus importantes, l'approvisionnement des articles nécessaires à la défense de l'État et à la subsistance des populations dans le cas fréquent où la guerre venait interrompre les communications avec le dehors. Il pouvait être opportun à ce point de vue d'encourager la production à l'intérieur du fer, des subsistances, des vêtements, et le système protecteur, qui n'est plus de nos jours qu'un coûteux et malfaisant anachronisme, avait alors pleinement sa raison d'être. Il fallait encore que l'administration s'occupât des pauvres, des mendiants, des vagabonds et, en général, des individus dépourvus de moyens d'existence, dont la multiplication était une cause d'affaiblissement pour l'État. Il fallait enfin que les finances de l'État fussent administrées de manière à donner le produit le plus élevé possible, tout en excitant le moindre mécontentement, et c'est dans ce but que l'on avait diversifié les impôts et créé notamment les impôts indirects, qui incorporaient la taxe au prix des articles de consommation de telle façon que l'on ne pouvait l'en distinguer.
Telles étaient les nécessités qui déterminaient les règles et les procédés de la gestion et de la politique intérieure des États de l'ancien régime. C'étaient les règles et les procédés qui convenaient à un régime d'état de siège. Aussi longtemps que les populations des États en voie de civilisation se trouvèrent exposées aux invasions des barbares, elles subirent sans se plaindre les charges et les servitudes de ce régime; mais à mesure que les dangers qui menaçaient la sécurité des personnes et des propriétés allaient en s'affaiblissant, à mesure que les communications [198] avec le dehors devenaient plus sûres et plus faciles, elles supportaient moins patiemment un régime qui, après avoir été nécessaire, devenait inutile et nuisible. Elles réclamèrent alors des garanties contre le pouvoir arbitraire du souverain et surtout contre le droit qu'il s'attribuait de les taxer suivant son bon plaisir; elles réclamèrent encore la liberté pour les manifestations de leur activité, restreintes par des nécessités qui avaient disparu ou étaient en voie de disparaître.
Si les maisons ou les associations propriétaires des Etats politiques avaient eu une notion claire du progrès et de ses exigences, elles auraient sans aucun doute modifié leur gestion et leur politique intérieure, à mesure que se modifiait la situation extérieure de leurs États, à mesure que la sécurité s'étendait, que les guerres devenaient plus rares et elles auraient peu à peu supprimé le régime maintenant suranné de l'état de siège. Cependant les dangers extérieurs qui avaient motivé l'existence de ce régime n'avaient pas disparu aussi complètement que se l'imaginaient ceux qui l'attaquaient, en contestant même qu'il eût jamais été nécessaire; en outre, des intérêts puissants, intérêts de l'aristocratie politique et militaire, du clergé privilégié, des industriels, des artisans et des marchands investis du monopole du marché intérieur, s'opposaient à la réforme du régime existant. De là une Jutte qui a abouti en France à la dépossession violente de la maison propriétaire de l'Etat politique, ailleurs au transfert à l'amiable de la gestion effective de l'État aux mandataires dela nation.
Au premier abord, il semblerait que cette solution dût être la plus avantageuse à la nation. Lorsque l'État était la propriété particulière d'une maison ou d'une association, celle-ci l'exploitait à son profit exclusif comme toute autre entreprise, et son intérêt était d'en tirer le profit le plus élevé possible. Sans s'inquiéter des charges et des maux de [199] tout genre que la guerre imposait aux populations, elle faisait la guerre en vue d'agrandir son domaine, et tel était l'objectif constant de sa politique extérieure. A l'intérieur, elle se préoccupait avant tout de conserver intacte la propriété de ce domaine et le droit de l'exploiter sans partage: enfin elle faisait payer cherles services dont elle se réservait le monopole, sans s'appliquer à en améliorer la qualité. Bref, sa politique intérieure était tout entière conduite en vue de l'accroissement de ses profits. N'était-il pas naturel de croire que le moyen le plus efficace de mettre fin à cette exploitation, c'était d'exproprier la maison propriétaire de l'État, ou tout au moins de l'obliger à en remettre la gestion aux mandataires de la nation? N'était-ce pas le chemin le plus court pour arriver au régime de paix et de liberté, que la suprématie désormais acquise du monde civilisé sur le monde barbare et la généralisation progressive de la concurrence industrielle avaient rendu possible? D'une part, la guerre ayant cessé d'être une nécessité et ne se perpétuant plus que dans l'intérêt de la petite caste aristocratique qui en vivait, les nations ou leurs mandataires ne pouvaient manquer de s'accorder pour y mettre fin, en faisant l'économie des énormes dépenses de sang et d'argent qu'elle occasionnait et des maux dont elle était la source. Leur politique extérieure serait nécessairement dirigée vers la paix. D'une autre part, et grâce à l'établissement de la paix, du développement des moyens de communication et des progrès de la concurrence, elles pourraient supprimer les entraves de l'état de siège et établir dans toutes les branches de l'activité humaine un régime de complète liberté; enfin, elles concentreraient leurs efforts vers l'amélioration et la réduction des frais des services publics : aux gouvernements belliqueux, oppressifs et coûteux de l'ancien régime, elles substitueraient des gouvernements pacifiques, libéraux et à bon marché. Tel [200] serait l'objectif de leur politique extérieure et intérieure.
Cet objectif n'a pas été atteint. L'expropriation de la maison propriétaire de l'État au profit de la nation, ou la remise à l'amiable de la gestion de cette propriété aux mandataires de la nation, n'a pas eu pour résultats de faire succéder dans les relations internationales la politique de paix à la politique de guerre, encore moins de diminuer à l'intérieur les frais de la gestion gouvernementale et d'en améliorer les services.
C'est qu'il en est des phénomènes économiques comme des phénomènes astronomiques : ils présentent le plus souvent des apparences, contraires à la réalité. Qui n'aurait cru que le soleil tourne autour de la terre? Qui ne croirait que les nations ont intérêt à posséder et à gérer elles-mêmes leur gouvernement? Quoi! l'État était la propriété d'une maison qui l'exploitait à son profit exclusif, qui s'attribuait tous les bénéfices de l'exploitation comme s'il s'était agi d'une fabrique ou d'une ferme. Ne devait-on pas croire qu'en faisant passer entre les mains de la nation, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs politiques, cette exploitation lucrative, qui procurait à la « maison » propriétaire et à ses auxiliaires des revenus plantureux, on transférerait au nouveau propriétaire tous les bénéfices que s'attribuait l'ancien, sans parler de ceux que devait inévitablement produire une gestion améliorée, conformément aux progrès des sciences politiques? C'était l'apparence, et on conçoit qu'elle ait séduit des hommes qui n'étaient pas plus avancés eu économie politique qu'on ne l'était en astronomie avant Copernic et Galilée. Mais comment se fait-il que la réalité ait été contraire à l'apparence? Comment s'expliquer que les nations n'aient point gagné à devenir propriétaires de l'État politique et à le gérer elles-mêmes?
II. Le communisme politique. Causes de son infériorité. Conséquences de son établissement. — Cela tient à l'infériorité [201] économique du communisme national en comparaison de la propriété patrimoniale ou corporative. L'État, confisqué à son ancien propriétaire, était devenu la propriété commune de tous les membres de la nation; mais appartenant à tout le monde, c'était comme s'il n'appartenait plus à personne. Chacun, n'en ayant qu'une part pour ainsi dire infinitésimale, n'avait plus aussi, ou ne croyait plus avoir qu'un intérêt infinitésimal à s'occuper de sa gestion, à laquelle d'ailleurs l'immense majorité des nouveaux propriétaires n'entendait absolument rien, et sur laquelle la minorité qui croyait s'y entendre avait, à de rares exceptions près, les idées les plus fausses. De là la formation des partis politiques en vue d'exploiter cette propriété d'un « incapable » et la lutte qui ne manqua pas d'éclater entre ces partis, pour la conquête ou la conservation de ce riche domaine, chacun s'efforçant de faire prévaloir le type de gouvernement le plus propre à lui assurer la gestion de l'État. C'était, pour le parti aristocratique et clérical, la monarchie de l'ancien régime; pour le parti libéral, recruté dans la bourgeoisie riche ou aisée, la monarchie constitutionnelle à suffrage limité; pour le parti radical, la république avec le suffrage universel.
Ces deux derniers types subsistent aujourd'hui à peu près seuls, et nous en avons analysé le mécanisme. Dans la monarchie constitutionnelle, la gestion gouvernementale est concédée à perpétuité, au nom de la nation qui conserve la nu propriété de l'État, à une maison politique, dont le chef reçoit une rétribution fixe. Une minorité déclarée politiquement capable et composée, comme dans les sociétés industrielles, des gros actionnaires de la communauté, intervient seule, à l'exclusion des petits actionnaires, dans la gestion de l'État. Les partis se recrutent dans cette minorité investie des droits politiques et s'efforcent incessamment d'y conquérir ou d'y conserver la [202] majorité, qui leur assure la possession du pouvoir. Mais l'expérience a attesté partout que la minorité investie des droits politiques abuse de son monopole pour satisfaire ses intérêts aux dépens de ceux du reste de la communauté, et il en est résulté une réaction qui a emporté en France et emportera probablement ailleurs la monarchie constitutionnelle avec le monopole électoral. La république, appuyée sur le suffrage universel, qui lui succède d'habitude, est caractérisée par l'attribution directe et entière de la gestion gouvernementale à l'association politique qui possède la majorité électorale et parlementaire aussi longtemps qu'elle réussit à la conserver.
L'infériorité économique de ces deux types de gouvernement à base communiste, en comparaison des monarchies patrimoniales ou des républiques oligarchiques d'autrefois, tient à ce que celles-ci étaient propriétaires à perpétuité de l'État et, à ce titre, intéressées au plus haut point à sa bonne gestion, dont elles recueillaient les profits et supportaient les pertes, tandis que dans les gouvernements modernes, livrés à l'exploitation précaire et à court terme des partis, ceux-ci, comme les tenants at will d'une exploitation agricole, n'ont aucun intérêt à ménager les ressources du domaine qu'ils exploitent. Leur intérêt est au contraire d'en tirer le plus gros profit possible dans le moment de leur jouissance, d'autant mieux qu'ils n'ont pas à craindre d'avoir à supporter les pertes provenant d'une gestion imprudente et incapable : c'est la nation propriétaire qui est responsable des engagements de tout genre et particulièrement des dettes que ceux qui la gouvernent contractent en son nom. Sous l'ancien régime, cette responsabilité retombait tout entière sur la maison ou l'association propriétaire de l'État; la nation n'en supportait légalement aucune part et les créanciers de l'État n'avaient contre elle aucun recours; sa responsabilité n'était ni [203] matériellement ni moralement engagée; l'Etat pouvait faire banqueroute sans entacher le moins du monde l'honneur des « consommateurs politiques » ni diminuer leur crédit.
Dira-t-on qu'une monarchie constitutionnelle et héréditaire est perpétuelle comme l'étaient les monarchies patrimoniales de l'ancien régime? Mais la Constitution n'accorde au roi aucun des droits essentiels afférents à la propriété; ces droits sont exercés par l'état-major du parti qui a réussi à s'emparer du pouvoir; en outre, le roi pourvu d'un salaire fixe n'est que bien faiblement intéressé à la gestion économique de l'État. Que les dépenses publiques dépassent les recettes, que la dette de l'Etat aille grossissant, peu lui importe! Son revenu n'en est pas atteint. Quant aux partis politiques, nous venons de voir qu'ils.sont encore moins intéressés à la gestion économique des affaires publiques. Vivant du budget ou aspirant à en vivre, n'ont-ils pas intérêt à le grossir? En revanche, la nation, à défaut du roi et des partis n'est-elle 'pas intéressée au plus haut point à la bonne gestion de son établissement politique? Sans aucun doute; mais possède-t-elle la capacité nécessaire pour intervenir utilement dans cette gestion? Il arrivait aussi, sous l'ancien régime, qu'un roi fût au-dessous de sa tâche; seulement son règne était temporaire, tandis que celui de la nation est perpétuel. On peut prétendre, à la vérité, que les nations finiront par acquérir la capacité nécessaire pour se gouverner d'une manière conforme à leurs intérêts, mais ce n'est là qu'une espérance que les faits n'ont pas encore justifiée. En attendant, de deux choses l'une : ou l'on n'accorde le droit d'intervention dans la gestion de l'État qu'à une minorité réputée politiquement capable, et l'expérience atteste que cette minorité a pour tendance inévitable de servir son intérêt particulier aux dépens de celui du reste de la nation, en protégeant ses profits industriels, en augmentant le nombre des emplois [204] civils et militaires, etc., etc. ; ou le droit d'intervenir dans la gestion de l'Etat appartient à tout le monde, et alors l'intérêt de chacun à y participer est trop faible, en même temps que la capacité politique moyenne de cette masse est trop basse pour que sa participation soit suffisamment active et éclairée. Dans les deux cas, le contrôle que la nation exerce ou est supposée exercer sur la gestion du parti en possession du gouvernement est insuffisant ou vicieux. C'est comme si un mineur ignorant et passionné était appelé à contrôler la gestion d'un tuteur, intéressé à grossir ses frais de tutelle. Voilà pourquoi les nations modernes n'ont point gagné à exproprier les maisons ou les associations propriétaires des États politiques pour se mettre à leur place.
Ce n'est pas à dire certes qu'elles n'eussent point de griefs sérieux contre l'ancien régime, surtout dans la dernière période de son existence. Aussi longtemps que la guerre était demeurée une fatalité historique, aussi longtemps que l'existence du monde civilisé avait été menacée par l'ascendant du monde barbare, les nécessités de la défense avaient prévalu sur toutes les autres, et quels que fussent les sacrifices matériels et moraux qu'elles imposassent à la multitude, ces sacrifices n'égalaient point les dommages que lui aurait causés la destruction de l'État politique, entraînant sa propre destruction. D'ailleurs, la concurrence politique et militaire à laquelle les différents États étaient exposés d'une manière presque continue obligeait les propriétaires exploitants de ce genre d'entreprises à améliorer leur gestion afin de développer les forces et les ressources nécessaires pour y faire face. La situation a changé lorsque les invasions barbares ont cessé d'être à craindre, lorsque la civilisation a pris le dessus, grâce au perfectionnement du matériel de guerre. Alors, la pression de la concurrence extérieure s'est affaiblie et, avec elle la [205] nécessité d'une gestion économique de l'État. Dans les derniers temps de l'ancien régime, cette pression était devenue tout à fait insuffisante. Une convention tacite, à défaut de traités formels, assurait les différentes maisons souveraines de l'Europe contre les risques d'une dépossession totale, en sorte qu'elles n'étaient plus au même degré qu'autrefois intéressées à la bonne gestion de leurs domaines politiques ; d'un autre côté, leurs pouvoirs n'étaient plus limités; elles pouvaient, à leur gré, maintenir et même aggraver les charges, les servitudes et les gênes qui pesaient sur les populations, et qui paraissaient à celles-ci d'autant plus insupportables qu'elles n'étaient plus motivées par un péril sérieux. Bref, le monopole intérieur que possédaient les propriétaires exploitants des États politiques n'était plus corrigé alors ni par une concurrence extérieure, active et permanente, ni par les garanties que les consommateurs avaient possédées au moyen âge et que l'agrandissement et l'unification des États leur avaient ravies, et il devenait de plus en plus lourd. On s'explique donc qu'il ait fini par paraître insupportable, et qu'on ait cru que le moyen le plus efficace de remédier à ses abus consistait à le détruire en transférant à la nation la propriété et la gestion de l'État. Mais on ne prévoyait pas qu'aux maux du monopole allaient succéder ceux du communisme politique, et que ceux-ci ne tarderaient pas à dépasser ceux-là.
C'est dans ce régime de communisme politique qu'il faut chercher la cause de la recrudescence de l'état de guerre, à une époque où la guerre entre peuples civilisés a cessé d'être une nécessité pour devenir la pire des « nuisances ». C'est encore au communisme politique qu'il faut attribuer le gaspillage barbare de vies et de ressources qui caractérise les guerres modernes et l'énormité des dettes qui en sont la conséquence. Quand les États [206] politiques étaient des propriétés particulières, le propriétaire avait intérêt à ne pas achever d'épuiser ses ressources et de grever l'avenir en s'obstinant dans une entreprise malheureuse. Il faisait la paix aussitôt que la guerre cessait de lui présenter des chances raisonnables de succès. Son intérêt le défendait contre les entraînements de l'orgueil et de Tamour-propre. Il n'en est pas ainsi dans les États livrés au communisme politique. Les partis qui occupent le pouvoir à titre précaire n'ont aucun intérêt à ménager les forces et les ressources de l'État. Au contraire! Ils se font plutôt un mérite de les prodiguer. Ils engagent une guerre en n'écoutant que leurs intérêts de parti, qu'ils ne manquent d'identifier avec l'intérêt national, et ils la poursuivent, même quand toutes les chances raisonnables de succès sont épuisées, ne fût-ce que pour garder plus longtemps le pouvoir et sans s'inquiéter de l'effroyable déperdition de forces et de ressources qui en résultera pour la nation. Que leur importe! Ils ne s'occupent que du présent dont ils sont les maîtres; ils n'ont aucun intérêt à ménager un avenir qui appartiendra peut-être à d'autres.
C'est encore au communisme politique qu'il faut attribuer l'accroissement progressif des dépenses publiques, le développement anormal des attributions de l'État, la gestion arriérée et routinière de tous les services qui lui appartiennent, sans oublier sa tendance à restreindre les libertés politiques et économiques, à une époque où la suprématie acquise et incontestable des peuples civilisés et l'expansion de la concurrence industrielle commanderaient au contraire d'en finir avec le régime de l'état de siège international, de supprimer les douanes et toutes les autres entraves à la production et à la circulation des marchandises et des idées, de réduire les dépenses et la tutelle gouvernementales. Comme nous allons nous en assurer en passant en revue les différentes parties de la gestion des États modernes, [207] c'est le communisme politique qui a empêché cette gestion de s'améliorer quand il ne l'a pas fait rétrograder, comme il a enrayé l'évolution pacifique de leur politique extérieure.
§ 1. Recrutement du personnel des services publics. Exclusion des étrangers. Comme tout autre entrepreneur d'industrie, le souverain, propriétaire exploitant d'un Etal politique de l'ancien régime, était intéressé au plus haut point à la gestion économique de ce domaine qui lui appartenait en propre et à perpétuité, qu'il exploitait pour son compte, à ses frais et risques et dont les bénéfices constituaient ses moyens d'existence. Or, la première condition d'une gestion économique, c'est le bon recrutement du personnel. Quoique les souverains, surtout dans la période de décadence de l'ancien régime, subissent trop souvent les influences du favoritisme et du népotisme, ils ne souffraient point qu'on limitât leur droit de recruter suivant leur convenance leur personnel politique, militaire et administratif. Ils prenaient leurs officiers, leurs fonctionnaires et employés de tout ordre'où ils les trouvaient en meilleure qualité et au meilleur marché, sans s'inquiéter de la nationalité ni même de la religion, comme n'ont pas cessé de le faire les autres entrepreneurs d'industrie. Grâce à leur situation prépondérante, ils pouvaient même beaucoup mieux que les particuliers résister à l'esprit de monopole, affublé d'un déguisement patriotique ou religieux, qui a poussé, partout et de tous temps, les indigènes ou les orthodoxes à exiger qu'on leur réservât les emplois lucratifs à l'exclusion des étrangers ou des schismatiques. C'est ainsi que les rois de France allaient chercher en Allemagne, en Suisse, en Ecosse et en Irlande, des hommes de guerre, généraux, officiers et soldats; en Italie, des ministres, des administrateurs et des financiers, et qu'ils avaient réussi, grâce à ce système intelligent et libéral de recrutement, à constituer une armée et une administration [208] modèles. [39] L'avènement du communisme politique a eu, au contraire, pour premier résultat de faire exclure absolument les étrangers des fonctions publiques réservées désormais aux seuls nationaux. Cependant il était bien clair que l'intérêt général de la nation, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs des services publics, exigeait plus encore que sous l'ancien régime que ces services fussent produits en bonne qualité et à bon marché. Il n'était pas moins clair qu'une des conditions indispensables pour arriver à ce résultat, c'était la faculté de recruter librement le personnel politique, militaire et administratif sur un marché illimité, sans distinction de nationalité, de race, de couleur ou de religion. Tel était l'intérêt de la nation consommatrice des services publics, mais tel n'était point l'intérêt des associations politiques qui se disputaient le gouvernement ou, ce qui revient au même, les revenus et les autres avantages que la possession et l'exploitation du gouvernement procurent. Leur intérêt était, pour nous servir de l'expression américaine, de mettre à la disposition de leurs associés ou de leurs co-intéressés [209] le «butin » gouvernemental le plus considérable possible. Quoique les politiciens dissimulent d'habitude leurs convoitises sous les apparences d'un patriotisme brûlant, quoiqu'ils se déclarent prêts en toute occasion à sacrifier sur l'autel de la patrie leur vie, leur fortune et le reste, l'expérience démontre qu'en fait l'industrie politique ne differe pas des autres et qu'elle n'attire qu'en raison des profits qu'elle donne ou qu'elle promet. Protéger leurs associés ou leurs co-intéressés contre la concurrence étrangère , de manière à leur réserver le monopole de ces profits, sans rechercher si ce monopole serait avantageux ou nuisible à la nation, telle devait être et telle a été la première préoccupation des partis politiques, à l'époque où le transfert de la propriété de l'Etat à la nation a mis le gouvernement à leur discrétion. C'est ainsi qu'au régime de la libre concurrence internationale pour le recrutement du personnel des services publics a succédé le régime prohibitif, comme un des premiers fruits du communisme politique. Cependant, il convient de remarquer que ce changement ne s'est pas produit seulement dans les pays où la propriété de l'État a été transférée à la nation, et qu'on peut le constater encore dans ceux où l'ancien régime a continué de subsister, en Russie par exemple. Dans ceuxci, il est le résultat de la décadence et de la corruption d'un état de choses qui a cessé d'être en harmonie avec les conditions actuelles d'existence des sociétés. N'ayant plus à subir uu risque permanent de dépossession, assuré d'ailleurs de toucher un revenu suffisant et au delà pour satisfaire ses besoins et ses fantaisies, par suite de l'absence de tout frein à ses dépenses, le souverain a cessé d'être stimulé à gérer son État d'une manière économique, et il cède sans résistance aux convoitises de la classe influente qui vit de l'exploitation des fonctions publiques. Elle a fini même par lui persuader, en s'appuyant sur l'exemple des [210] nations réputées plus avancées, que l'intérêt des fonctionnaires se confond avec l'intérêt général, et que c'est faire une œuvre essentiellement patriotique que d'appliquer le système prohibitif aux services publics, en les réservant aux nationaux.
Mais le système protecteur en cette matière n'a pas seulement été dirigé contre les étrangers, il l'a été aussi contre les classes de la population les moins pourvues d'influence politique. Les « partis », surtout dans les pays où le suffrage est limité, se recrutent principalement parmi les classes supérieures et moyennes. En conséquence ils se sont appliqués, sous l'impulsion consciente ou inconsciente de leur intérêt, à leur réserver la meilleure part du butin gouvernemental, en écartant ou en diminuant la concurrence de la multitude. Dans ce but, qu'a-t-on fait? On a subordonné de plus en plus l'accès des carrières alimentées par le budget à la condition d'un séjour réglementaire dans des institutions spéciales, dont les programmes sont surchargés d'études inutiles ou même nuisibles. En allongeant la durée et en augmentant les frais des études, on rend moins accessibles à la foule les situations pour lesquelles elles sont exigées. On pourrait croire, au premier abord, que l'institution prétendue démocratique des bourses d'études sert de correctif à ce système qui multiplie les diplômes et tend à constituer un mandarinat à la manière chinoise. Mais la collation des bourses d'études n'a pas manqué de devenir une affaire de parti : on les attribue généralement aux familles en possession d'une influence politique, auxquelles on donne ainsi les moyens d'élever à prix réduit les candidats aux places rétribuées par le budget ou aux carrières qui y aboutissent. Grâce à ces applications ingénieuses du système de la protection, les familles politiques accaparent les fonctions publiques au détriment de celles qui [211] pourraient leur faire concurrence et de la masse des consommateurs des services publics, intéressés à ce que le marché d'approvisionnement de ces services soit aussi étendu que possible.
§ 2. Extension progressive des attributions du gouvernement. — I1 ne suffisait pas d'exclure les étrangers des fonctions publiques et d'en rendre l'accès difficile aux classes dépourvues d'influence politique, il importait encore d'augmenter le butin gouvernemental, afin de pouvoir rétribuerles membres etles soutiens du parti, et les détourner de porter leurs services et leur influence aux partis concurrents. Delà, l'accroissement inévitable et irrésistible des attributions du gouvernement et, par conséquent, des dépenses publiques.
En cela encore, le nouveau régime est économiquement inférieur à celui auquel il a succédé. Comme nous l'avons remarqué, le souverain de l'ancien régime, en sa qualité de propriétaire exploitant de l'état politique, était, aussi bien que tout autre propriétaire, directement intéressé à réduire au minimum les frais de la gestion de son domaine. C'est pourquoi il s'efforçait de la simplifier et d'en élaguer les branches parasites, au moins quand il entendait bien son intérêt et quand il subissait suffisamment la pression de la concurrence extérieure. Il ne se réservait que deux sortes de services : 1° ceux dont il pouvait, sans grande peine, tirer de gros profits, tels que la vente du sel et la fabrication de la monnaie; encore avait-il fini par reconnaître qu'il lui était plus avantageux de les affermer que de les exploiter lui-même; 2° ceux qui concernaient la sûreté de sa personne et de sa propriété, la conservation et l'agrandissement de son domaine; encore le système économique de l'affermage avait-il été introduit jusque dans la formation des armées. Il ne se préoccupait guère des autres services et il abandonnait volontiers aux [212] particuliers, aux corporations, aux communes ou aux paroisses, le soin de pourvoir à la sécurité des personnes et des propriétés privées, à l'éducation, aux institutions charitables, aux moyens de communication, excepté quand il s'agissait de routes militaires et, en général, à tous les besoins physiques et moraux des populations. Il ne s'occupait que de son affaire, laquelle consistait à préserver son domaine politique de la concurrence du dehors et à l'agrandir aux dépens de ses concurrents, enfin à l'exploiter de manière à en tirer la plus grande somme de profits, en évitant de toucher au capital. Toutefois, nous avons remarqué encore que, dans la période de décadence de l'ancien régime, lorsque les propriétaires des États politiques eurent cessé d'être exposés à un risque permanent et imminent de dépossession, leur gestion intérieure se relâcha peu à peu et se chargea de branches parasites, comme il arrive à toute exploitation qui n'est point soumise dans la mesure nécessaire à la pression de la concurrence. Aussi reprochait-on aux monarchies de l'ancien régime de coûter trop cher, et se proposait-on surtout, en les renversant, de les remplacer par des « gouvernements à bon marché ».
Mais cet idéal économique, il n'y avait qu'un moyen de le réaliser, c'était de simplifier la machine gouvernementale, en diminuant le nombre et l'importance des services publics alimentés par l'impôt. On a vu, au contraire, depuis que les nations ont été affranchies du joug de leurs anciens maîtres, ces services se multiplier et se développer tous les jours.
Ce n'est point cependant de dessein prémédité que les partis politiques qui se disputent la gestion de l'État augmentent ses attributions et ses dépenses. Non ! ils inscrivent même généralement et de bonne foi dans leurs programmes la diminution des dépenses publiques, mais aussitôt qu'ils arrivent aux affaires, ils subissent la nécessité impérieuse [213] de satisfaire leurs partisans comme aussi de ne pas désespérer leurs adversaires. Les prétextes ne manquent pas, au surplus, pour justifier le développement des attributions de l'État : on invoque l'accroissement des besoins qui naissent des progrès mêmes de la civilisation et l'impuissance de l'industrie privée à satisfaire quelques-uns des plus importants, la nécessité en matière d'enseignement de sauvegarder les jeunes générations contre les entreprises des ennemis de la « civilisation moderne », ou bien encore, s'il s'agit des chemins de fer, la nécessité de préserver le public de l'avidité des compagnies maîtresses d'un « monopole naturel ». Examinons brièvement ce que valent ces prétextes plus ou moins spécieux.
Il est évident qu'à mesure que la richesse augmente, grâce aux progrès de l'outillage et des méthodes de la production, — et jamais ces progrès n'ont été aussi considérables qu'à notre époque, — on voit les besoins se développer sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs de les y aider. On veut être mieux nourri, mieux vêtu, mieux logé, habiter des villes mieux éclairées, plus propres et plus saines, goûter des jouissances intellectuelles plus variées et plus raffinées. Ce développement des besoins sous l'influence de l'accroissement de la richesse est particulièrement visible, dans ce qu'il a parfois d'excessif et de vicieux, chez les ouvriers incultes qui s'élèvent à la condition d'entrepreneurs et s'enrichissent. Leurs appétits matériels et plus encore les besoins de leur vanité croissent pour ainsi dire à vue d'œil; ils ne possédaient même pas le nécessaire, ils ne se refusent maintenant aucune des jouissances du luxe. Ils ont des habitations somptueuses à la ville et à la campagne, une table plantureusement servie, leurs femmes ne portent que les étoffes les plus chères, leurs enfants apprennent le latin avec le grec; bref, les besoins de ces enrichis progressent du même pas que leur richesse et parfois d'un pas plus [214] rapide ; le cercle de leurs consommations s'élargit en peu de temps d'une manière démesurée. Ce qui est vrai pour des individus isolés ne l'est pas moins pour la collection de ces individus : plus une société s'enrichit, plus ses besoins se développent; mais s'ensuit-il que l'intervention du gouvernement soit nécessaire pour leur donner satisfaction? Il est facile de se convaincre, au contraire, que cette intervention ne peut être que perturbatrice et nuisible. Si nous examinons, en effet, les sociétés même les moins avancées, nous constaterons que c'est par l'initiative privée et libre qu'il est pourvu au plus grand nombre des besoins de leurs membres, que ceux de ces besoins auxquels il est satisfait d'autorité par l'intervention du gouvernement et le grossier mécanisme de l'impôt sont, en comparaison, de peu d'importance. L'initiative privée n'est pas impuissante même dans les pays où elle est le moins active. Supposons donc que le gouvernement avec ses annexes provinciales ou communales n'intervienne pas pour construire des voies de communication, transporter des lettres et des dépêches télégraphiques, ouvrir des écoles, subventionner des théâtres, créer des musées et des bibliothèques, qu'arrivera-t-il? C'est qu'à mesure que le besoin de ces divers produits ou services croîtra, on verra croître parallèlement les profits que l'on peut réaliser en les produisant. Un moment arrivera où le besoin non encore satisfait venant à dépasser en intensité ceux auxquels il est déjà pourvu par les industries existantes, le profit que l'on trouvera à le servir dépassera, à son tour, le niveau commun. Alors, par une impulsion irrésistible, les intelligences et les capitaux seront attirés dans cette direction et le nouveau besoin sera satisfait dans le moment et dans la mesure où il peut l'être utilement. [40] Utilement, disons-nous, car en voulant y pourvoir plus tôt [215] et plus amplement, que ferait-on? On détournerait les intelligences et les capitaux des industries qui alimentent les besoins de première nécessité pour lesappliquer à des besoins moins sentis, moins urgents. On renchérirait la subsistance, le vêtement et les autres articles produits librement, pour créer ou faire artificiellement baisser de prix, aux dépens des consommateurs de ces articles nécessaires, des produits ou des services dont ils sentent moins vivement le besoin. On prétend, à la vérité, que les consommateurs (que l'on estime d'ailleurs capables de gouverner leur état politique) sont incapables de gouverner sainement leur vie privée et qu'en admettant qu'on leur laissât à cet égard une liberté entière, ils ne s'imposeraient des sacrifices que pour satisfaire leurs appétits les plus grossiers et même leurs vices les plus immondes. Nous n'affirmerons pas certes que tous les membres des sociétés civilisées soient capables de gouverner utilement leur vie et nous sommes d'avis même qu'un régime de tutelle est aujourd'hui et sera encore longtemps nécessaire à un trop grand nombre d'entre eux, comme il l'a été de tous temps; seulement, l'expérience démontre, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, que le gouvernement est le plus incapable et le plus coûteux des tuteurs. Mais n'est-il pas superflu de remarquer que l'intérêt général des consommateurs n'est invoqué ici que pour la forme, et même que les « politiciens » obéissent à des mobiles diamétralement opposés à celui-là en transformant le gouvernement en entrepreneur ou en bailleur de fonds de toute sorte d'industries? Ce à quoi ils visent avant tout, c'est à augmenter le nombre des emplois, des situations et des faveurs dont ils disposent; c'est encore à acquérir ou à conserver l'appui des classes influentes, en leur aidant à satisfaire gratis ou à prix réduit des besoins que la multitude ressent à un moindre degré. La différence entre les frais de production des services adaptés à ces besoins et le [216] prix auquel on les met sur le marché est fournie par l'impôt et elle constitue, en dernière analyse, une subvention ou un tribut payé aux classes politiquement influentes par la généralité des contribuables.
On argue aussi de l'impuissance de l'initiative des individus ou des collectivités libres quand il s'agit d'entreprises dépassant, selon la formule consacrée, les forces de l'industrie -privée. Cette raison pouvait être fondée à l'époque où les gouvernements, obéissant à des motifs tirés des nécessités de leur sécurité, à laquelle celle de la nation était liée, refusaient d'autoriser la constitution de grandes agrégations de forces; mais, depuis que la guerre a cessé d'être une • fatalité inévitable et qu'aucune raison sérieuse ne peut plus, en conséquence, être opposée à la création et à l'extension indéfinies des associations libres, depuis que l'invention des actions et des obligations permet de réunir, avec une facilité extraordinaire, les capitaux les plus considérables, il n'existe plus d'entreprises dépassant les forces de l'industrie privée; partant, il n'y a plus de besoins qui ne puissent être satisfaits sans l'intervention de l'État, dans le moment et dans la mesure où il est utile de les satisfaire. Ce qui est vrai, c'est que les gouvernements continuent, sous un prétexte ou sous un autre, à faire systématiquement obstacle à la constitution des grandes entreprises par voie d'association libre, soit en limitant la durée de la société et en l'obligeant ainsi à déduire de ses dividendes annuels les frais d'amortissement de son capital, soit en lui imposant des règlements et un maximum qui constituent pour elle un supplément artificiel de charges ou un empêchement à réaliser toute la somme de profits que l'entreprise pourrait fournir. Ces profits étant ainsi rabaissés au-dessous du niveau commun, les intelligences et les capitaux évitent de s'engager dans des entreprises qui ne sont point suffisamment rémunératrices. On ne manque pas alors de [217] déclarer que l'initiative privée est impuissante à pourvoir à un besoin d'intérêt général et le gouvernement s'en charge à sa place, ou bien encore il comble, au moyen d'une subvention ou d'un monopole, l'insuffisance artificielle des profits après l'avoir créée lui-même. On peut citer comme exemple à l'appui les entreprises de chemins de fer, auxquelles la plupart des gouvernements imposent des directions peu productives de préférence à d'autres, ou des cahiers des charges compliqués et onéreux, pour satisfaire des exigences électorales et fournir de l'occupation aux ingénieurs officiels et aux bureaucrates du « ministère des travaux publics ».
En résumé, si l'on remonte à la cause originaire qui détermine l'extension des attributions du gouvernement, on finit toujours par découvrir un motif politique, savoir la nécessité de grossir le « butin » qui sert à rétribuer les membres ou les auxiliaires des associations organisées en vue de l'exploitation de l'État.
§ 3. Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale. — Sous l'ancien régime, le souverain propriétaire perpétuel de l'État et, comme tel, intéressé au plus haut point à la conservation et au développement des forces et des ressources de la nation, d'où il tirait les siennes, s'appliquait sous l'influence de cet intérêt, surtout quand la pression de la concurrence politique venait s'y joindre, à les préserver de toute atteinte extérieure ou intérieure, et à favoriser tout ce qui pouvait contribuer à-les accroître. Il était le tuteur ou le protecteur naturel de l'intérêt général. C'était une tutelle intéressée, mais par là même aussi soigneuse et efficace qu'elle pouvait l'être. L'état de guerre rendait cette tâche non seulement indispensable, mais encore singulièrement compliquée; les marchés étant resserrés par la quasi-permanence du risque de guerre, la plupart des branches de l'activité humaine constituaient, comme nous l'avons remarqué, autant de monopoles [218] naturels. Il fallait donc que le souverain, tuteur intéressé de l'intérêt général, opposât, à défaut de la concurrence, une limite au pouvoir des détenteurs de ces monopoles ou que les administrations locales, sous sa dépendance, s'en chargeassent à sa place. La nécessité de cette protection des intérêts des consommateurs était d'autant plus urgente et mieux motivée que les propriétaires exploitants des monopoles naturels formaient des associations ou des corporations plus puissantes, ou qu'ils produisaient des articles plus nécessaires à la vie. De là, le système réglementaire, la limitation du taux de l'intérêt, du prix du pain et des autres articles de nécessité, les règlements de fabrication, les mesures protectrices des ouvriers dans les ateliers, quand la « coutume » n'y pourvoyait point avec une efficacité suffisante. Cette réglementation n'était pas toujours intelligente, quoiqu'elle s'inspirât le plus souvent de la coutume, qu'elle se bornait à sanctionner; en tout cas, elle était un modérateur bien imparfait en comparaison de la concurrence, mais elle n'en eut pas moins sa raison d'être et son utilité en l'absence de cette dernière, aussi longtemps que les marchés demeurèrent resserrés par l'état de guerre. De là encore, la nécessité de protéger contre une concurrence intermittente et accidentelle, dans les courts intervalles de paix, les industries qui fournissaient des articles indispensables à la défense de l'État et aux besoins les plus urgents des populations.
Cependant, à mesure que les marchés s'étendaient grâce à l'accroissement de la sécurité et au développement progressif des moyens de communication, à mesure que l'état de paix tendait davantage à se substituer à l'état de guerre, la tutelle des consommateurs et des industries cessait d'avoir sa raison d'être. Après avoir été nécessaire lorsque la concurrence ne pouvait pas agir, elle devenait nuisible en entravant son action. A la vérité, les monopoles [219] naturels n'ont pas encore entièrement disparu, et nous assistons à une recrudescence artificielle de l'état de guerre; mais la concurrence et la paix n'en sont pas moins devenues la règle chez les peuples civilisés, le monopole et la guerre l'exception. Il semblerait donc que la réglementation et la protection eussent dû disparaître graduellement. Nous les avons vus au contraire reprendre une nouvelle vigueur depuis l'avènement du communisme politique. Sous prétexte que certaines industries, particulièrement importantes, nommément celles qui s'appliquent à la circulation des valeurs, des marchandises et des hommes, les banques d'émission et les chemins de fer, échappent par leur nature à l'action de la concurrence, on l'a limitée ou même absolument empêchée et on a greffé un monopole artificiel sur un monopole naturel, plus ou moins authentique. Quant à la protection de l'industrie contre la concurrence étrangère, on sait à quel point elle s'est aggravée et généralisée, bien qu'elle soit moins justifiable encore que la réglementation des « monopoles naturels ». Elle est devenue le plus puissant instrument d'exploitation et de rapine qui ait été jamais mis en œuvre pour enrichir des intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt général. A quelle cause faut-il attribuer cette extension et cette corruption de la tutelle gouvernementale? A l'époque de la décadence de l'ancien régime, elle s'expliquait par l'alliance des intérêts engagés dans les monopoles avec les influences de cour, tandis que l'affaiblissement de la concurrence politique au dehors et la destruction des garanties qui limitaient le pouvoir discrétionnaire du souverain en matière d'impôts rendaient celui-ci de plus en plus indifférent aux atteintes portées à l'intérêt général. Plus tard, elle s'est expliquée par l'alliance des mêmes intérêts monopoleurs et protectionnistes avec les partis politiques, bien moins intéressés encore à défendre l'intérêt général et permanent de la nation, toujours [220] prêts au contraire à le sacrifier à l'intérêt immédiat et temporaire de leur domination.
Si la protection des consommateurs dans l'âge économique des monopoles et celle des industries dans les intermittences de l'état de ,«iège international ont perdu leur raison d'être depuis que la concurrence est devenue généralement possible et que la guerre a cessé d'être une nécessité, il en est autrement de la tutelle qui a pour objet de remédier à l'incapacité du self government individuel. Celle-ci apparaît, au contraire, comme plus nécessaire que jamais depuis que tous les membres des sociétés civilisées sont devenus libres et, par conséquent, responsables de leur destinée, depuis encore que la crise suscitée par la transformation de la machinery de la production a augmenté les risques qui pèsent sur toutes les existences. Sous l'ancien régime, l'esclavage, le servage, les corporations industrielles ou religieuses, enserraient dans leurs bras rudes et grossiers, mais tutélaires, la grande majorité de la population dont ils diminuaient à la fois la liberté et la responsabilité. Après la disparition ou la suppression trop souvent hâtive de ces formes primitives de la tutelle, tous les membres des sociétés civilisées, quels que fussent leur degré .d'intelligence ou de moralité et leur situation matérielle, ont été appelés également à se gouverner eux-mêmes. Qu'en est-il résulté? Quel usage les classes émancipées ont-elles fait de leur liberté? Comment ont-elles rempli les obligations dans lesquelles se résumait leur responsabilité? N'ayant qu'une notion obscure et incertaine des conditions nouvelles de leur existence et des devoirs qui leur étaient désormais imposés, elles ont cédé à toutes les impulsions de leurs appétits; on les a vues se multiplier sans prévoyance, s'abandonner à la paresse, à l'ivrognerie, à la débauche, exploiter à outrance le travail de leurs enfants et de leurs femmes, laisser sans secours leurs infirmes, leurs [221] malades et leurs vieillards. C'est qu'il ne suffit pas, comme on l'a supposé trop légèrement, d'être libre pour être ou même pour devenir capable d'user utilement de la liberté. Le gouvernement de soi-même exige des qualités et des aptitudes qui n'existent qu'à l'état de germes chez l'immense majorité des créatures humaines et qui ne se développent qu'à la longue par la sélection, l'éducation et l'expérience. Même dans les régions supérieures de la société, où la culture est raffinée et la vie facile, bien peu d'hommes se montrant capables de gouverner leur vie sans nuire à euxmêmes et à autrui. Comment ne rencontrerait-on pas encore un plus grand nombre d'incapables du self government dans la multitude qui possède à peine les premiers éléments de la culture intellectuelle et morale, et qui est exposée à toutes les difficultés et à tous les périls de la lutte pour l'existence? Une tutelle destinée à suppléer à l'insuffisance de leur self government est donc aujourd'hui, comme elle l'était jadis, nécessaire à l'immense majorité des hommes. Certes, l'ancienne tutelle économique et religieuse était grossière et défectueuse, et l'on conçoit qu'elle ait fini par devenir insupportable à ceux qui la subissaient d'autorité sans qu'il leur fût possible de s'y soustraire; mais l'expérience a attesté qu'il ne suffisait pas de supprimer l'esclavage, le servage, les corporations et les couvents, qu'il eût fallu encore les remplacer.
Malheureusement, au lieu de procéder, dans cette affaire vitale, par voie de transformation ou d'évolution, qu'a-t-on fait? On s'est acharné à détruire l'ancienne tutelle forcée non seulement sans rien mettre à la place, mais encore en faisant systématiquement obstacle à la reconstitution d'une tutelle libre. On a condamné la multitude, incapable de se gouverner elle-même, au self government obligatoire. Le résultat a été un débordement des maux provenant de la misère et du vice. A défaut d'une autre, il a bien fallu alors [222] recourir à la tutelle gouvernementale. Cette tutelle s'est exercée de deux manières : par voie de répression et d'assistance. Des pénalités rigoureuses ont été établies contre les vagabonds et les mendiants, dont le nombre s'était progressivement accru depuis l'abolition de la servitude; puis, en présence de l'insuffisance de la répression, il a bien fallu multiplier les hôpitaux, les hospices et les autres institutions de bienfaisance ; enfin, distribuer aux pauvres des secours réguliers. La charité publique a été ainsi introduite dans tous les pays où le self government avait succédé à la servitude. Plus tard encore, on a senti la nécessité de protéger les enfants et les femmes contre l'imprévoyance et la cupidité de leurs tuteurs naturels et l'on a fait des lois pour l'églementer leur admission dans les manufactures et limiter la durée de leur travail. Bref, la tutelle gouvernementale a été se développant de plus en plus, et les philanthropes d'abord, les socialistes d'État ensuite, n'ont pas manqué d'en provoquer continuellement l'extension. Cependant, l'expérience n'en a déjà que trop montré l'insuffisance et les vices : la charité publique ne soulage la misère qu'en augmentant le nombre des pauvres, les lois sur le travail des enfants et des femmes ne remédient à l'abus du travail sur un point que pour l'aggraver sur d'autres, etc., etc. C'est que la tutelle, qu'elle s'applique soit à des enfants, soit à des hommes, est un art et même un art des plus difficiles et des plus compliqués, et que les gouvernements, surtout depuis l'avènement du communisme politique, n'ont point un intérêt suffisant à s'y appliquer. Sans doute, les maux qui résultent du mauvais self'government de la multitude sont une cause d'appauvrissement pour la nation, d'affaiblissement, peut-être même de subversion pour l'État; mais en quoi est-ce que cela touche les partis qui se disputent la possession et l'exploitation précaire du gouvernement? Pour eux, les mesures [223] et les institutions destinées à soulager la misère ou à venir en aide aux « classes laborieuses » ne sont guère autre chose que des moyens d'acquérir de la popularité quand ils sont dans l'opposition, d'augmenter le nombre des places et des situations dont ils peuvent disposer pour récompenser des services politiques, quand ils sont au pouvoir. Aussi n'existe-t-il aucun domaine dont la gestion coûte plus cher et soit plus remplie d'abus que celle du « patrimoine des pauvres ». [41] D'ailleurs, en admettant même que le gouvernement s'efforçât de remplir avec conscience son rôle de tuteur des incapables du self government, le pourrait-il? Cette tâche ne dépasserait-elle pas sa capacité et ses ressources? En attendant, si l'on étudie l'ensemble des institutions, des lois et règlements de tout genre qui constituent la tutelle gouvernementale des pauvres et des incapables, et le régime de « l'assistance publique », on se convaincra que ce n'est pas sans raison que les économistes les accusent d'aggraver les maux qu'ils ont pour objet de guérir ou tout au moins de diminuer.
4. Restrictions et prohibitions opposées aux libertés nécessaires à l'exercice du « self government ». —Nous venons de dire que le régime du self government obligatoire a été [224] appliqué également à toutes les classes de la société. Ce régime se compose, avons-nous besoin de le rappeler, de deux parties constituantes : la liberté d'agir et la responsabilité des actes. Or, tandis que la responsabilité a été imposée dans toute son étendue à tout le monde, il en a été autrement de la liberté. Sous l'influence des intérêts particuliers avec lesquels les partis politiques étaient obligés de compter, la liberté des uns a été agrandie aux dépens de la liberté des autres, la responsabilité demeurant la même pour tous. En accordant, par exemple, un monopole à une banque, on augmente artificiellement la liberté des bénéficiaires de ce monopole et on diminue celle de leurs concurrents et du public; en protégeant une industrie par l'exclusion de la concurrence étrangère, on augmente la liberté des industriels protégés aux dépens de celle des consommateurs, sans parler des industriels étrangers. On rend ainsi plus facile le self government des uns et plus difficile celui des autres.
Mais c'est surtout en ce qui touche la gestion de l'État que la liberté des gouvernants a été agrandie aux dépens de celle des gouvernés. On conçoit qu'un souverain de l'ancien régime ne consentît point volontiers à accorder à ses sujets la liberté d'examiner et de critiquer les actes de sa gestion. N'était-il pas propriétaire de l'État et, à ce titre, maître de le gouverner selon son bon plaisir? L'exploitation de l'État était une entreprise privée et, de nos jours encore, n'est-il pas interdit au public d'examiner et de critiquer la gestion des entreprises privées? On juge apparemment que la concurrence industrielle et commerciale donne aux consommateurs une garantie suffisante contre la tendance naturelle des entrepreneurs à abaisser la qualité de leurs produits ou de leurs services et à en élever le prix. Peut-être en était-il de même à l'époque où la concurrence politique, dans sa pleine activité, obligeait les [225] souverains à exploiter leur domaine de Ja manière la plus conforme à l'intérêt général. Mais lorsque la concurrence politique vint à s'affaiblir, les souverains auraient certainement trouvé avantage à suppléer à l'insuffisance du stimulant de la concurrence en autorisant le libre examen de leur gestion. Cependant, on s'explique, en tenant compte de leurs traditions et des habitudes d'esprit qu'elles avaient créées, que cet examen leur ait paru intolérable, et qu'ils aient rigoureusement limité, en ce qui concernait les affairas de l'État, la liberté de la parole et de la presse. Mais cet interdit, qui se comprenait encore s'il ne se justifiait plus dans les monarchies de l'ancien régime, pouvait-on invoquer une raison ou un prétexte quelconque pour le maintenir lorsque la nation est devenue propriétaire de l'État? La nation n'est-elle pas visiblement intéressée à ce que tous les actes de la gestion gouvernementale soient soumis à l'examen le plus complet et au contrôle le plus sévère? N'est-elle pas intéressée même à ce qu'on puisse critiquer librement le système de cette gestion, qu'il soit monarchique ou républicain, et en provoquer la réforme ou l'abandon au profit d'un autre? Comment donc se fait-il qu'il n'existe encore qu'un bien petit nombre de pays, parmi ceux qui se qualifient de « libres », où la liberté de se réunir, de s'associer, de fonder des publications ayant pour objet d'examiner et de critiquer les actes du gouvernement, de provoquer la réforme ou le changement des institutions politiques, soit entière et indiscutée? Comment se fait-il qu'en France, en particulier, ces libertés qu'un politicien illustre qualifiait de nécessaires, — non sans les avoir, en son temps, quelque peu mutilées, [42] — n'aient existé [226] que d'une manière intermittente et incomplète depuis que la nation est devenue propriétaire de l'État, et que leur avenir soit loin d'être assuré ? Comment se fait-il, pour tout dire, que les mandataires de la nation se permettent de lui refuser le plein exercice de la liberté d'examiner et de contrôler, par la parole ou la presse, une gestion dont elle est responsable? Cela tient à ce que les partis considèrent les libertés politiques non au point de vue de l'intérêt de la nation, mais au point de vue de leur intérêt de parti. Ils s'en accommodent volontiers quand ils sont dans l'opposition, parce qu'elles leur servent alors à renverser [227] le parti en possession du gouvernement; mais quand, à leur tour, ils arrivent au pouvoir, ils s'efforcent de briser ou de fausser ces armes dont ils ont éprouvé l'efficacité. Ils interdisent les associations politiques, opposent des entraves fiscales et autres à la publication des journaux qui leur sont hostiles, favorisent et subventionnent (bien entendu, avec l'argent des contribuables) les feuilles à leur dévotion. Ils ne se comportent, au surplus, pas autrement à l'égard des libertés non politiques : selon qu'elles leur sont plus ou moins avantageuses, ils les déclarent « vraies » ou « fausses », utiles ou nuisibles, ils les défendent ou les combattent. C'est ainsi que la liberté de l'enseignement est communément attaquée par les libéraux et défendue par les cléricaux, tandis que la liberté des cultes a pour champion le parti libéral et pour adversaire le parti clérical. En résumé, le critérium d'appréciation des libertés qui sont les instruments nécessaires du self government n'est point l'intérêt général et permanent de la nation, c'est l'intérêt contingent et actuel du parti gouvernant ou aspirant à gouverner, et voilà pourquoi le communisme politique n'a pas plus procuré la liberté aux nations « affranchies du joug des tyrans » qu'il ne leur a donné la paix.
§ 5. Impuissance et corruption de l'opinion publique. — Quoiqu'une nation ne puisse, en vertu de la nature des choses, gérer elle-même son État, elle est cependant, en sa qualité de propriétaire, investie de la souveraineté politique, et son opinion doit finir par prévaloir dans la gestion des affaires publiques. Les partis politiques seraient obligés de la gouverner de la manière la plus conforme à son intérêt, si elle avait la notion claire de cet intérêt et la ferme volonté de l'imposer. Mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur les éléments constitutifs des nations modernes, sans excepter les plus avancées en civilisation, pour se convaincre de l'incapacité et de [228] l'impuissancc de l'opinion publique en matière de gouvernement. Les nations les plus civilisées se composent d'abord d'une multitude qui possède à peine les premiers éléments des connaissances humaines et n'a qu'une idée confuse de la nature et des fonctions d'un gouvernement. Absorbée par le soin laborieux des nécessités de la vie, incapable, à cause de la nature encore purement physique de son travail, de se livrer à des spéculations intellectuelles, cette multitude ne sait pas et ne peut pas savoir en quoi consiste l'intérêt général et, encore moins, quelle politique il faut suivre pour s'y conformer. Ce qui domine chez elle, c'est une haine instinctive de l'étranger, suite naturelle de l'état de guerre, et un sentiment de défiance et d'antipathie jalouse à l'égard des classes supérieures qui l'ont courbée de tous temps sous leur joug, à quoi il faut ajouter communément une vanité puérile. A ses yeux, la nation à laquelle elle appartient est la première du monde, et ce travers naïf, les gouvernements, maîtres, pour la plupart, de l'instruction publique, n'ont pas manqué de le caresser et de le développer pour en tirer profit. Les favoris de cette multitude ignorante et vaniteuse sont les hommes qui ont vaincu et humilié les étrangers, les despotes qui abaissent toutes les classes de la société sous la même servitude, ou les démagogues qui flattent ses appétits et ses passions, en lui promettant à la fois d'améliorer son sort et de faire descendre les classes supérieures à son niveau. C'est pourquoi son intervention dans la politique a pour résultats invariables de livrer le gouvernement à des catégories de politiciens de plus en plus basses et, finalement, d'introniser la dictature du sabre.
Les classes moyennes et supérieures sont assurément plus capables d'intervenir dans la gestion des affaires publiques; mais si leur opinion est plus éclairée que celle de la multitude, en revanche elle est faussée par des [229] intérets en opposition avec l'intérêt général. Comment ces classes, qualifiées de dirigeantes et, en tout cas, influentes, sont-elles composées? En premier lieu, de familles en possession de fournir l'état-major politique, les fonctionnaires de l'administration et les officiers de l'armée et qui, vivant en grande partie du budget, sont naturellement intéressées à l'accroissement des dépenses publiques, (les familles politiques, administratives et militaires ne peuvent notamment que gagner à la guerre, et c'est pourquoi elles sont particulièrement chatouilleuses en matière d'honneur national et vibrantes de patriotisme. En second lieu, les classes dirigeantes se composent d'industriels, de propriétaires fonciers et autres, d'hommes appartenant aux professions libérales, gens raisonnablement intelligents et instruits, mais, pour le plus grand nombre, absorbés par le soin de leurs affaires privées et fort peu soucieux de l'intérêt public. S'il leur arrive de s'occuper de politique, c'est presque toujours en vue de satisfaire leur intérêt particulier aux dépens de l'intérêt général. Si l'on cherche, parmi les nations les plus civilisées, combien il y a d'hommes dont l'opinion, en matière de gestion gouvernementale, soit saine, raisonnée et surtout désintéressée, on se trouvera en présence d'une infime minorité. Comment donc l'intérêt général pourrait-il prévaloir? Dirat-on que l'opinion publique s'éclaire et se rectifie par les discussions du Parlement, des meetings et de la presse? Mais, sauf peut-être en Angleterre et aux États-Unis, ces discussions, quand il ne s'agit point d'une affaire de parti, n'attirent qu'un bien petit nombre d'auditeurs ou de lecteurs. L'opinion de chacun est presque toujours faite d'avance; elle est déterminée par des intérêts de situation ou des traditions de famille, lesquelles sont, à leur tour, fondées sur des intérêts, et il est bien rare qu'elle se modifie, à moins que l'intérêt auquel on obéit d'une façon [230] consciente ou inconsciente ne vienne à changer. Les journaux et les orateurs qui font profession d'agir sur l'opinion sont-ils plus dégagés des entraves et de la corruption de l'intérêt particulier? Sauf de bien rares exceptions, ils sont enrégimentés dans les partis politiques et tenus, avant tout, de défendre l'intérêt du parti. S'ils se plaçaient exclusivement au point de vue de l'intérêt général, où trouveraient-ils des auditeurs et des lecteurs?
Dans ces conditions, l'opinion publique ne saurait opposer un obstacle sérieux à la tendance naturelle et irrésistible des partis à augmenter le butin dont ils vivent. Sans doute, cette impuissance a ses degrés. L'opinion publique est plus forte en Angleterre, par exemple, qu'en Italie, en Espagne ou en Grèce; mais, nulle part, en Angleterre pas plus qu'ailleurs, on n'a vu encore cette infime minorité, qui possède la capacité et les connaissances requises pour apprécier sainement l'intérêt général, et dont le jugement n'est point faussé ou adultéré par quelque intérêt particulier, réussir à faire prévaloir son opinion dans la gestion des affaires publiques. L'établissement du free trade en Angleterre est peut-être le seul exemple que l'on puisse citer dans ce siècle, d'une réforme, complètement conforme à l'intérêt de la nation, qui ait été imposée aux partis politiques par l'opinion publique. Encore a-t-il fallu, pour faire tomber la citadelle des lois céréales, d'une part que l'intérêt d'un groupe puissant de manufacturiers s'accordât avec l'intérêt général ; d'une autre part, que la classe moyenne, à laquelle le reform bill venait de rendre accessibles les hautes situations politiques et administratives, vît dans l'abolition du régime de la protection un moyen d'affaiblir la puissance de l'aristocratie au profit de la sienne. Tel a été, au surplus, le résultat du free trade combiné avec le reform bill. Mais, chose digne de remarque, l'élargissement de la classe pourvue du droit [231] électoral, loin d'améliorer l'opinion publique, comme on s'y attendait, a contribué à la détériorer. Aussi longtemps que la puissance politique avait été presque entièrement monopolisée par l'aristocratie, l'opinion de la classe moyenne n'avait été que faiblement viciée par des intérêts de parti. Les situations budgétaires qui auraient pu tenter la bourgeoisie britannique étant hors de sa portée, elle n'avait aucun intérêt à l'accroissement du butin gouvernemental. Au contraire, comme ce butin était en grande partie fourni par elle, tandis qu'il était presque entièrement consommé par l'aristocratie, elle était intéressée à le diminuer, et si son opinion n'était point assez puissante pour faire prévaloir une politique d'économie et de paix, elle agissait du moins dans ce sens. Il en a été autrement depuis qu'elle a acquis des droits politiques qui lui permettent d'exiger sa part dans la distribution du butin. Elle est devenue moins pacifique et on a vu grandir rapidement, en Angleterre comme sur le continent, la tendance à la multiplication des attributions de l'État, partant à l'augmentation des dépenses publiques. Les doctrines de l'école de Manchester sont en baisse auprès de cette bourgeoisie politicienne. Aux États-Unis, où les partis politiques se recrutent dans la multitude investie du suffrage universel, la tendance à l'augmentation des dépenses publiques est encore plus marquée. Partout, en un mot, sous le régime du communisme politique et à mesure que ce régime s'approche davantage de l'idéal rêvé par les théoriciens du suffrage universel, l'intérêt général est de moins en moins protégé par l'opinion publique.
§ 6. Résultats. Si l'on considère les effets des progrèsdé la machinery de la guerre et de la production, si l'on observe que ces progrès ont eu pour résultats d'enlever toute raison d'être à la guerre entre les peuples civilisés en assurant leur prépondérance sur le [232] monde barbare, et d'élargir les marchés de toutes les industries en les rendant accessibles, d'une manière permanente, à la concurrence, on arrivera à cette conclusion que la politique extérieure et intérieure que commande aujourd'hui l'intérêt général de toutes les nations civilisées est une politique de paix au dehors, de liberté au dedans; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les armements au minimum nécessaire pour assurer contre le monde barbare la sécurité des confins de la civilisation, et de diminuer l'intervention du gouvernement dans toutes les branches de l'activité humaine; en un mot, que le rôle des gouvernements adaptés à l'ère nouvelle de la grande industrie devrait être de garantir la sécurité des personnes et des propriétés, ce qu'ils peuvent faire désormais à peu de frais et, pour le reste, de laisser faire. Des gouvernements pacifiques, libéraux, partant à bon marché, voilà ce que demande l'intérêt général des nations civilisées.
Comment il est arrivé que les gouvernements aient suivi, depuis la transformation progressive du matériel de la guerre et de l'industrie, une marche précisément opposée à celle-là, c'est un phénomène qui s'explique, pour les gouvernements de l'ancien régime, par l'affaiblissement successif de la concurrence politique. Lorsque la guerre qui était le mode d'action de cette concurrence eut cessé d'être continue pour devenir un accident temporaire, lorsqu'elle eut cessé, en même temps, d'avoir pour conséquence ordinaire la dépossession des propriétaires d'Etats et la ruine de leurs domaines, l'intérêt des souverains à gouverner leurs États de manière à en porter au plus haut point les forces et les ressources, autrement dit à les gouverner conformément à l'intérêt général de leurs sujets, auquel le leur était lié en leur qualité de propriétaires permanents de l'État, cet intérêt [233] alla s'affaiblissant et s'obscurcissant. La suppression du droit de consentir l'impôt, suite de l'unification trop vantée des États, en permettant au souverain de rejeter sur ses sujets les conséquences de sa mauvaise gestion sans les ressentir directement lui-même, contribua encore à le rendre indifférent au bon gouvernement de son domaine politique. On vit alors les intérêts et les convoitises des classes ondes coteries en possession d'une influence dans l'entourage du souverain prévaloir de plus en plus sur l'intérêt général, les dépenses s'accroître, les privilèges et les sinécures se multiplier, et, du même coup, se ralentir et se corrompre les pratiques de l'administration. A la longue, le mal s'aggrava au point de provoquer la subversion de l'ancien régime et l'attribution de la propriété de l'État à la nation elle-même, en substituant à la propriété patrimoniale ou corporative le « communisme national », comme base de la constitution et de la gestion politiques.
On supposait que la nation, devenue propriétaire, et par là même maîtresse souveraine de l'État, ne manquerait pas de le gérer de la manière la plus conforme à son intérêt, c'est-à-dire à « l'intérêt général ». Seulement, pour que cette hypothèse pût devenir une réalité, il aurait fallu non seulement que la nation possédât une capacité politique qu'elle n'avait pas, mais encore que la nature même des choses ne s'opposât point à ce qu'une communauté composée de plusieurs millions d'hommes s'occupât activement de la gestion de l'État comme de toute autre entreprise. Aussi qu'est-il arrivé? C'est que des sociétés en participation constituées sous le nom de partis politiques, ont exploité cette propriété d'un mineur incapable. Quel est l'intérêt de ces associations exploitantes? Cet intérêt consiste à tirer de la gestion de l'État le profit le plus élevé possible, et, pour obtenir ce résultat, elles n'ont qu'une voie à suivre, c'est d'augmenter le budget, et [234] par conséquent d'adopter la politique extérieure et intérieure la plus propre à le grossir, de perpétuer la politique de guerre, de multiplier les attributions du gouvernement, de façon à porter au maximum les rétributions et les autres avantages à partager entre les membres du parti et à distribuer dans la classe au sein de laquelle il s'est constitué et dont l'appui lui est nécessaire pour s'emparer de la gestion de l'État et la garder. Si un parti était assuré de conserver cette gestion à perpétuité, peutêtre serait-il intéressé à ménager les forces et les ressources de la nation, à ne point surcharger l'avenir de dettes écrasantes et épuisantes; mais cette sécurité de possession n'existe point, un parti est incessamment exposé à être dépossédé par l'un ou l'autre de ses concurrents. Il n'a donc qu'un faible intérêt à ménager un avenir sur lequel il ne peut compter que pour une part éventuelle et incertaine. Ajoutons que plus sa possession est précaire et contestée, plus il est intéressé à augmenter les dépenses d'où il tire ses profits, plus aussi il fait d'efforts et impose à la nation de sacrifices pour se maintenir au pouvoir. Identifiant son intérêt particulier avec l'intérêt national, il estime naturellement que la nation ne doit reculer devant aucun sacrifice d'hommes, d'argent et de liberté pour le conserver à la direction des affaires et en écarter ses concurrents. Non seulement il ne se fait point scrupule de l'obliger à lui livrer à discrétion son sang et son argent, mais encore il s'en fait gloire! En présence de ces associations, solidement organisées et intéressées à accroître leurs profits à ses dépens, que peut faire la nation? Elle ne peut se débarrasser d'un parti que pour se livrer à un autre, non moins intéressé à l'exploiter. A la vérité, si elle avait la notion claire de son intérêt et la volonté ferme de le faire prévaloir, elle finirait bien par imposer aux partis une politique extérieure et intérieure [235] conforme à « l'intérêt général » ; mais nous avons constaté que ni cette notion claire ni cette volonté ferme n'existent même chez les nations les plus avancées en civilisation, et rien n'annonce qu'elles les posséderont de sitôt. Cela étant, faut-il s'étonner si les intérêts de parti prévalent de plus en plus sur l'intérêt général; si. au lieu d'une politique de paix et de liberté les nations sont condamnées à subir une politique de guerre, de monopole, d'intervention et de réglementation, si les gouvernements vont se détériorant et renchérissant chaque jour davantage au lieu de s'améliorer et de coûter moins cher.
Mais sur qui retombe, en définitive, ce fardeau de plus en plus lourd? Sur la nation. Et comment se traduit-il en fait? Par une augmentation progressive de la quantité de travail que chacun est obligé de fournir, journellement, pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'État. C'est une remarque de M. Stuart Mill qu'en dépit de l'énorme économie de travail réalisée par l'introduction des machines, la quantité qui en est fournie par les peuples civilisés n'a pas diminué. On pourrait soutenir même qu'elle a augmenté, si l'on tenait compte de la suppression des jours fériés et de l'assujettissement au travail des enfants en plus grand nombre et à un âge plus tendre. D'un autre côté, on peut constater que la multitude n'a pas vu s'augmenter les fruits de son activité dans la proportion de l'accroissement de la productivité de l'industrie. A quoi cela peut-il tenir, si ce n'est à ce fait que le travail de la nation a été soumis à une dîme croissante de dépenses obligatoires, improductives ou nuisibles? Supposons qu'on dépense un milliard pour gouverner une nation quand cent millions suffiraient, les neuf cents millions qui constituent la différence ne vont-ils pas en déduction du revenu de chacun ou en augmentation de la somme de travail qu'il est obligé de s'imposer pour se procurer ce revenu? Où huit heures lui [236] auraient suffi pour obtenir la même somme de moyens de satisfaction de ses besoins, il est obligé d'en fournir dix, douze ou quatorze. En outre, en faisant même abstraction de l'utilité ou de la nocuité de ses services comparés à ceux des autres industries, il est facile de s'assurer que la partie de la nation qui vil du budget travaille, toute proportion gardée, moins que celle qui alimente le budget. Or ce que celle-là fournit en moins, il faut bien que celle-ci le fournisse en plus. Il n'est pas un bureaucrate ou un fonctionnaire quelconque, dont la cote de travail demeure au-dessous de la moyenne, qui ne contribue à élever au-dessus de cette moyenne la cote de travail d'un coopérateur de l'industrie privée. Que l'on réfléchisse maintenant aux inégalités plus ou moins inévitables de la répartition des charges publiques, et l'on ne s'étonnera pas si les dépenses improductives ou nuisibles que nécessite une politique contraire à l'intérêt général augmentent de plusieurs heures par jour la quantité de travail que la généralité des contribuables est obligée de produire pour vivre. Ce n'est pas tout. Aux dépenses improductives d'un budget passé à l'état de « butin » viennent se joindre les charges résultant des monopoles, des faveurs et des protections accordés aux intérêts affiliés aux partis politiques ou avec lesquels ceux-ci sont obligés de compter. Ce n'est rien exagérer, par exemple, que d'évaluer à deux heures par jour le surcroît de charges que le système protecteur impose à la généralité des consommateurs. Ajoutez-y l'obstacle qu'une réglementation surannée oppose aux entreprises et aux progrès dont l'effet naturel est d'accroître la productivité du travail et de permettre par conséquent de se procurer la même somme de jouissances en échange d'une moindre somme d'efforts; ajoutez-y le gaspillage des forces et des ressources d'une partie de la population par suite de l'insuffisance et des vices de la tutelle gouvernementale; ajoutez-y [237] la raréfaction du capital qui a été, depuis les temps primitifs, l'auxiliaire indispensable du travail, mais auquel l'avènement de la grande industrie a donné un surcroît d'importance, et dont les emprunts des Etats ou des villes écrèment la production annuelle, tandis que les impôts qui pèsent sur les revenus, matière première de l'épargne, en ralentissent la formation ; n'oubliez pas que la raréfaction détermine le renchérissement, c'est-à-dire l'augmentation de la part du capital au détriment de celle du travail, l'exhaussement de l'intérêt, du loyer, des profits et des dividendes aux dépens des salaires et des profits du travail intellectuel et matériel, et que cette cause de dépression de la part des travailleurs dans les résultats de la production agit avec une intensité extraordinaire, sous l'empire dela loi naturelle des quantités et des prix. Ajoutez-y enfin l'influence de la crise du progrès, crise sensiblement aggravée par la persistance d'une politique en contradiction avec le nouvel état économique des sociétés, et vous vous expliquerez que l'introduction des machines n'ait pas diminué le fardeau du labeur quotidien des peuples civilisés. C'est que les dépenses improductives que ce labeur est obligé d'acquitter se sont augmentées dans une proportion plus forte que sa productivité ne s'est accrue. On s'explique ainsi le mécontentement qui a gagné les classes de la population sur lesquelles pèse le plus lourdement ce fardeau, et qui les rend trop aisément accessibles aux utopies socialistes et aux excitations révolutionnaires.
[238]
CHAPITRE VIII.
Évolution et révolution↩
Sommaire : Comment les sociétés civilisées sortiront de l'ancien régime. — Les moyens révolutionnaires et la méthode évolutionnistc. — La genèse du progrès politique. — Les trois périodes d'activité de la production des inventions et découvertes politiques et économiques. — I. Première période Industrie primitive et rudimentaire. — IL Seconde période. Avènement de la petite industrie. — Caractères généraux des institutions politiques de ces deux périodes. — III. Troisième période. Avènement de la grande industrie et de la suprématie militaire des peuples civilisés. —État des sciences politiques et économiques à la veille de la Révolution française. — Causes qui ont fait prévaloir les moyens révolutionnaires sur la méthode évolutionniste. — La journée du 14 juillet 1789. — IV. La révolution à l'époque actuelle et ses effets de rétrogression.
Comment les sociétés civilisées sortiront-elles de l'ancien régime pour entrer en possession des institutions politiques et économiques adaptées aux nouvelles conditions d'existence que leur a faites l'avènement de la grande industrie et l'établissement de leur suprématie sur le monde barbare? Deux procédés peuvent être employés pour effectuer ce passage et accomplir ce progrès : 1° le procédé de la révolution, consistant dans le renversement violent et soudain des gouvernements établis et leur remplacement par d'autres réputés progressifs ; 2° le procédé de l'évolution, consistant dans la réforme de l'ancien régime, — réforme accomplie d'une manière successive, au moment et dans la mesure où la nécessité s'en fait sentir, — et dans le recours exclusif à la pression morale de l'opinion publique pour surmonter les résistances des intérêts et des préjugés qui s'opposent à cette réforme nécessaire.
[239]
A première vue, le procédé révolutionnaire semble le plus prompt et.le plus efficace, et il n'a pas cessé d'être considéré comme tel et employé par la plupart des hommes qui poursuivent le progrès politique. Cependant, en étudiant de près les révolutions qui ont éclaté depuis un siècle chez les peuples civilisés, on s'aperçoit qu'au lieu de réaliser un progrès devenu nécessaire, elles ont déterminé une rétrogression croissante des institutions aussibien que des idées, et accentué de plus en plus le désaccord existant entre le régime politique des États et les nouvelles conditions d'existence des sociétés.
Si nous voulons trouver la raison de ce phénomène, il nous faut avoir présenté à l'esprit la genèse du progrès politique.
Les institutions qui régissent les sociétés sont le produit d'une série d'inventions et de découvertes, c'est-à-dire d'une industrie particulière, laquelle apparaît et se développe, comme toute autre industrie, lorsque le besoin et, par conséquent, la demande de ses produits ou de ses services viennent à naître et à grandir. On trouve profit alors, — soit que l'on ait en vue une rétribution matérielle ou simplement morale, — à découvrir ou à inventerles institutions et les lois qui répondent à ce besoin. Ce travail se poursuit jusqu'à ce que la société, — troupeau, tribu ou nation, — soit pourvue de l'ensemble d'institutions et de lois qui sont ou qui lui paraissent le mieux adaptées à sa nature et à ses conditions d'existence. Lorsque ce résultat est atteint, lorsque la machinery du gouvernement approprié à la société est achevée, la production des inventions et découvertes politiques et économiques, après s'être ralentie, finit par s'arrêter. Cependant ce ralentissement et cet arrêt ne sont que temporaires, car chaque fois que les éléments et les conditions d'existence de la société viennent à se modifier, il devient nécessaire de modifier aussi ses institutions et [240] ses lois, de manière à les mettre en concordance avec le nouvel état des hommes et des choses.
On peut distinguer dans l'industrie des découvertes et des inventions politiques et économiques trois grandes périodes d'activité correspondant aux trois phases du progrès industriel, savoir : la création de l'industrie primitive et rudimentaire, de la petite industrie et finalement de la grande.
I. Première période. Industrie primitive et rudimentaire. C'est au début de cette période que se sont créées les institutions et les lois adaptées aux troupeaux, clans ou tribus vivant de la chasse, de la pêche et de la récolte des fruits naturels du sol. Comme nous l'avons vu, ces institutions et ces lois étaient simples; elles consistaient dans le choix volontaire ou forcé d'un chef et la création d'une discipline nécessaire au succès des expéditions de chasseou de guerre; dans l'établissement de règles non moins nécessaires pour le partage des produits des expéditions entre les participants, dans l'institution d'autres règles ayant pour objet de prévenir ou de réprimer les nuisances intérieures, telles que le meurtre, le vol, le rapt, etc. Comment avaient procédé les auteurs de ces découvertes et inventions politiques, dont l'ensemble formait la constitution et le code de chaque troupeau, clan ou tribu? Ils avaient observé les hommes et les choses; ils avaient appris, par exemple, d'une manière expérimentale, les conditions de réussite d'une expédition de guerre, et ils en avaient déduit la nécessité de l'unité du commandement, de la division et de la hiérarchie des fonctions; ils avaient encore observé et reconnu les conséquences nuisibles des revendications ou des vengeances individuelles que provoquait un meurtre, unjvol ou toute autre atteinte à la personne ou à la propriété d'un membre de la tribu, et ils avaient « inventé » l'institution d'un tribunal composé des anciens, c'est-à-dire des hommes les plus [241] capables d'apprécier avec maturité et sans passion les faits et circonstances de la cause; ils avaient inventé, en même temps, les pénalités qui leur paraissaient les plus propres à empêcher le renouvellement de ces nuisances. Pour faire accepter leurs « inventions et découvertes politiques », ils les attribuaient aux divinités de la tribu, et si l'expérience en montrait les effets utiles, elles ne manquaient pas de passer à l'état d'institutions ou de coutumes. Trop souvent, à la vérité, dans les tribus où la foi religieuse n'était pas suffisamment accompagnée d'intelligence et de sens critique, le patronage des divinités faisait accepter des institutions et des règles inventées en vue d'accroître le pouvoir et la richesse des inventeurs aux dépens de la communauté.
Ces institutions et ces règles nécessaires au gouvernement d'une simple tribu, vivant d'une industrie rudimentaire, étaient naturellement limitées en nombre. Quand elles étaient inventées et établies, il n'y avait plus lieu d'en créer de nouvelles. Alors l'industrie des inventeurs politiques était condamnée à chômer jusqu'à ce qu'un changement dans les conditions d'existence de la tribu vînt faire sentir la nécessité de modifier les anciennes institutions ou l'ancien code. De là une lutte entre l'esprit de conservation et l'esprit de progrès, et une crise qui se prolongeait jusqu'à ce que la transformation, dans ce qu'elle avait de nécessaire, fût accomplie. Les anciennes institutions, même et surtout dans ce qu'elles avaient de plus abusif et de plus suranné, trouvaient pour défenseurs les intérêts qui y étaient engagés. Ceux-ci s'appuyaient sur la tradition et l'habitude; et leur résistance aux innovations était fréquemment justifiée par l'impraticabilité ou l'imperfection des institutions et des règles que des novateurs incapables et infatués d'eux-mêmes prétendaient substituer à celles que les divinités avaient établies et que le temps et l'expérience avaient [242] consacrées. C'était seulement, d'une part, quand les changements dans les conditions d'existence de la communauté nécessitaient irrésistiblement, sous peine de ruine et de destruction, la transformation de l'ancien régime; d'une autre part, quand les institutions et les règles véritablement adaptées au nouvel état des choses étaient découvertes, que l'évolution s'accomplissait. On abandonnait alors le culte des vieilles divinités pour celui des nouvelles qui apportaient une loi mieux appropriée aux besoins de la tribu, et la crise prenait fin.
II. Seconde période. Avènement de la petite industrie. C'est ainsi que les choses se sont passées lorsque l'avènement de la petite industrie a changé, du tout au tout, les conditions d'existence des sociétés primitives. Les institutions qui convenaient à des tribus pauvres et peu nombreuses, éparses sur de vastes territoires, ne pouvaient plus s'adapter à des Etats renfermant plusieurs millions d'hommes, dont le travail, devenu incomparablement plus productif, grâce aux progrès de la machinery de la production, créait de la richesse en abondance. Ces États, fondés par des « sociétés » de conquérants, qui vivaient de l'exploitation du travail de la population assujettie, attachée au sol et aux différentes branches d'industrie, étaient soumis, dans leurs conditions d'existence, à des nécessités auxquelles la constitution et le code des tribus ne pouvaient plus suffire. Tout en se gardant de faire table rase de ces institutions embryonnaires qui contenaient le germe des institutions futures, il fallait les modifier et les développer de manière à les adapter à l'État qui était sorti de la Tribu et l'avait remplacée. Il ne suffisait plus, par exemple, d'élire un chef temporaire pour les expéditions de chasse ou de guerre. Il fallait que la « société » des conquérants, fondateurs et exploitants de l'État, eût un chef et une hiérarchie en permanence pour subvenir aux nécessités de la sécurité de sa [243] possession, se défendre contre les entreprises de ses concurrents du dehors ou s'agrandir à leurs dépens, réprimer les révoltes de ses esclaves ou de ses sujets, exploiter fructueusement son domaine ; il fallait, en même temps, que les droits et les obligations du chef et de chacun des membres de la hiérarchie fussent exactement fixés et délimités. Il fallait encore, par suite de la substitution de l'agriculture à la chasse et à la récolte des fruits naturels du sol, dans la production alimentaire, que le territoire de l'État cessât d'être une propriété commune comme l'avait été celui de la Tribu; qu'il fût partagé en domaines individuellement appropriés, que les nécessités de l'industrie agricole firent ensuite morceler en exploitations plus ou moins étendues selon que cette industrie était exercée par des esclaves, des serfs ou des hommes libres. Il fallait définir et fixer les droits et les obligations des propriétaires ou des détenteurs des domaines à l'égard de l'association conquérante à laquelle ils appartenaient, comme aussi de la population dépendante, régler les conditions des contrats de vente, de location et de prêt, l'état des successions, etc. Il fallait, en résumé, découvrir ou inventer les institutions et les règles appropriées à cet état nouveau de la société et des individus ainsi qu'à cette multitude de transactions inconnues à la tribu primitive, en d'autres termes, créer une constitution politique et religieuse, avec un code de lois civiles, industrielles et commerciales, infiniment plus étendues et compliquées que celles qui avaient suffi aux sociétés embryonnaires du premier âge.
C'était là une œuvre considérable.
De même que la découverte des plantes alimentaires et textiles, des métaux, des animaux utiles et l'invention du matériel de la guerre, de l'agriculture, de l'industrie et des arts avaient absorbé une somme énorme de travail intellectuel, consistant dans l'application de l'esprit d'observation et [244] de combinaison aux éléments et aux forces dela nature; il fallait dépenserunesommenonmoins grande d'intelligence, et mettre en œuvre des facultés supérieures à celles qui avaient été et qui étaient encore employées à la création du matériel de la production, en les appliquant à l'étude de l'homme et de la société, pour construire la machinery savante et compliquée du gouvernement politique, relio-ieux, civil et économique des États fondés sur la petite industrie. Ce travail commença avec l'apparition du nouveau régime de la production alimentaire et industrielle et il dut être particulièrement actif dans la période de fondation des États de ce second âge. Par suite de l'imperfection naturelle de l'esprit humain, il ne s'accomplit point sans de nombreuses écoles et sans une multitude de tâtonnements et d'essais avortés. Ces tâtonnements et ces essais infructueux eurent néanmoins leur utilité : c'est en tenant compte des expériences qui avaient échoué, ne fût-ce que pour éviter de les recommencer, parfois aussi en dégageant ce qu'elles contenaient d!utile, que l'on finit par découvrir et formuler les institutions et les lois qui convenaient à l'état nouveau des sociétés. Enfin, c'est en recueillant et en capitalisant les résultats de ce grand travail d'observation et d'invention que l'on constitua peu à peu le faisceau des sciences morales et politiques, le droit politique, civil et pénal, le droit des gens, le droit commercial, l'économie politique. Ces diverses sciences, si incomplètes qu'elles fussent d'ailleurs, apprenaient à connaître ce que l'expérience avait condamné et ce qu'elle avait sanctionné. Ceux qui les possédaient étaient des savants. Ils se servaient du capital des vérités acquises pour en acquérir de nouvelles. A ce capital de notions théoriques il fallait joindre la connaissance pratique du mécanisme qu'il s'agissait de perfectionner, enfin il fallait posséder une aptitude particulière aux découvertes et inventions. C'est à des hommes [245] réunissant ces diverses qualités de savant, de praticien et d'inventeur que l'on doit le plus grand nombre des progrès qui ont amélioré successivement l'appareil du gouvernement de l'homme et de la société. A côté d'eux apparaissent des empiriques et des utopistes qui ignorent les données de la science ou refusent d'en tenir compte. Ceux-ci n'ont que de bien faibles chances de grossir le contingent des inventions utiles; le plus souvent, ils imaginent des institutions prétendues nouvelles que l'expérience a depuis longtemps condamnées ou qui étaient appropriées aux conditions d'existence des sociétés à une époque antérieure. Ces conceptions utopiques contribuent néanmoins, pour une part, à l'œuvre du progrès, en ce qu'elles stimulent l'esprit de recherche et d'invention; elles deviennent dangereuses seulement lorsque leurs auteurs prétendent les imposer au lieu de les proposer.
Un moment arrivait où l'œuvre de la création de la Constitution et des lois appropriées aux conditions actuelles d'existence de la société se trouvait achevée. Alors le besoin des innovations se faisait moins sent'.r et la demande des découvertes et inventions politiques se ralentissait, sans cesser toutefois d'exister. Mais à mesure que le besoin de progrès s'affaiblissait, il devenait plus difficile d'y pourvoir. Aucun progrès ne peut s'accomplir sans endommager' ou tout au moins déranger les intérêts engagés dans l'ordre de choses qu'il modifie. Lorsque le besoin est intense, lorsque la nécessité presse, ces résistances naturelles et inévitables que le progrès rencontre sont aisées à surmonter. Il en est autrement lorsqu'il ne s'agit plus que d'adapter successivement un appareil déjà complet de gouvernement aux modifications lentes et insensibles qui se produisent au sein d'une société, dont les conditions et les moyens d'existence demeurent à peu près les mêmes, dans une longue suite de siècles, et telle [246] était la situation des États fondés sur la petite industrie jusqu'à l'avènement de la grande. Sans doute, l'organisation qu'avait produite l'industrie des découvreurs et des inventeurs politiques dans la période de fondation de l'État n'était point parfaite, et l'eût-elle été, elle eût exigé des modifications dans le cours des temps; mais ses avantages étaient consacrés par l'expérience, et elle était défendue par des intérêts nombreux et puissants, auxquels les innovations portaient atteinte. Enfin, ces innovations étaient rarement appropriées, du premier jet, au besoin qui les provoquait; leur imperfection ou leur non-applicabilité utile aggravait le mal auquel il s'agissait de remédier et discréditait les novateurs. On s'explique ainsi que les gouvernements, subissant l'influence des intérêts et de l'esprit conservateurs, aient fini par proscrire, comme des perturbateurs et des ennemis publics, les inventeurs politiques, religieux et autres qui entreprenaient d'introduire des changements plus ou moins profonds et radicaux dans les institutions établies, et qu'ils aient enveloppé dans la même proscription les inventeurs qui, en perfectionnant le matériel et les procédés de la production, jetaient le trouble dans l'ancienne organisation de l'industrie. Ces prohibitions étaient nuisibles en ce qu'elles retardaient des progrès nécessaires, mais elles n'étaient pas toujours dénuées de motifs sérieux. En effet, les novateurs politiques et religieux étaient aussi bien que les autres exposés à se tromper; ils inventaient des institutions et imaginaient des règles de conduite inférieures ou moins bien adaptées à l'état présent de la société que les institutions et les règles existantes, et ces innovations nuisibles, ils 'entreprenaient de les imposer, en demandant à la multitude ignorante un appui qu'ils ne trouvaient point ailleurs. Ils faisaient, en un mot, appel à la révolution. On conçoit donc que les gouvernements traitassent en ennemis ces esprits faux et [247] ces perturbateurs de l'ordre public; mais qu'en résultait-il? C'est que l'interdit jeté sur des innovations décevantes, que leurs auteurs prétendaient imposer, faisait obstacle à des progrès nécessaires. Les découvertes et les inventions industrielles rencontraient une opposition moins vive dans les classes dominantes, dont elles ne menaçaient point les intérêts, parfois même elles y trouvaient des encouragements; ce qui explique en partie le désaccord croissant qui se manifestait entre les conditions matérielles d'existence des sociétés civilisées et leurs institutions politiques.
Si maintenant on considère la nature des institutions politiques des sociétés dans ces deux premières phases de l'existence de l'humanité, on sera frappé d'abord de leur ressemblance générale et caractéristique dans chaque période, malgré des diversités locales provenant de la race ou du milieu; ensuite de la différence non moins générale et caractéristique des institutions d'une période à une autre. Dans la première, le régime politique est celui de la communauté : tous les membres de la petite société embryonnaire sont appelés à concourir à son gouvernement et à sa défense, les fonctions politiques et militaires ne sont point spécialisées; chacun les exerce avec l'industrie qui pourvoit à sa subsistance; la hiérarchie n'existe que d'une manière temporaire, pendant la durée d'une expédition de chasse ou de guerre. Dans la seconde période, au contraire, l'industrie du gouvernement s'est universellement spécialisée. A l'exception de quelques petites communautés isolées dans des régions montagneuses et des tribus sauvages qui ont continué à vivre de l'industrie des temps primitifs, tous les Etats politiques sont des entreprises spéciales, possédées et exploitées industriellement comme les autres entreprises. Elles ont été fondées par des sociétés en participation, en vue du profit qu'il était dans leur nature de procurer. Ces sociétés sont dirigées, selon [248] les dimensions et les circonstances particulières de l'entreprise, tantôt par l'assemblée des coparticipants, tantôt par un gérant temporaire ou héréditaire. Cette dernière forme du gouvernement des Etats politiques avait généralement prévalu comme la plus efficace, surtout dans les grands États continentaux, où le gérant héréditaire avait fini même par accaparer la propriété et la gestion de l'entrep rise, au détriment de ses coassociés. C'est ainsi notamment que les choses se sont passées en France. En Angleterre, au contraire, où la situation du pays, protégé par la mer, rendait moins nécessaire la concentration permanente des pouvoirs entre les mains d'un chef, le gouvernement est demeuré oligarchique, la société des conquérants, représentée par les principaux d'entre eux, siégeant dans la Chambre des lords, a continué de partager avec le roi la direction des affaires, tandis qu'au-dessous, la couche supérieure de la masse gouvernée conservait le droit, qui lui était enlevé dans les monarchies unifiées du continent, de consentir l'impôt et les lois sous lesquelles elle était appelée à vivre. Mais ces différences de régime n'avaient rien de fondamental. Le caractère général et typique du gouvernement des sociétés vivant de la petite industrie, c'était la constitution de l'État sous la forme d'une entreprise spéciale appropriée à une société ou à une maison, comme toute autre entreprise industrielle, et gérée par un conseil ou un chef tantôt élu et temporaire, mais le plus souvent héréditaire.
Telles étaient les institutions politiques de l'ancien régime et ces institutions répondaient, comme nous l'avons vu, à des nécessités dérivant à la fois du développement encore insuffisant de l'industrie et de la fatalité persistante de l'état de guerre.
III. Troisième période. Avènement de la grande industrie et de la suprématie militaire des peuples civilisés. — Cependant [249] l'invention des armes à feu, de la boussole, de l'imprimerie, la découverte de l'Amérique, accompagnées ou suivies d'une multitude croissante d'autres inventions et découvertes commencent à modifier profondément la situation et les conditions d'existence des peuples civilisés. L'invention des armes à feu, en faisant prédominer le rôle de la science et du capital dans la guerre, assure désormais leur prépondérance militaire et les garantit contre l'invasion des barbares. Le risque de destruction provenant de cette cause devient moins intense, il fait place à un simple risque de dépossession politique; encore ce dernier risque vient-il à s'atténuer par l'établissement successif d'une sorte d'assurance tacite entre les souverains, qui les préserve d'une dépossession complète quand le sort des armes leur est défavorable. La concurrence politique et guerrière à laquelle ils étaient exposés d'une manière permanente et avec un maximum d'intensité, à l'époque de la prédominance du monde barbare, devient intermittente et moins dangereuse dans ses conséquences. Moins pressés et stimulés par la concurrence, les propriétaires exploitants des États politiques sont moins intéressés à en développer le's forces et les ressources; leur gestion se relâche, l'intérêt général est sacrifié aux intérêts privés, les abus se multiplient au détriment de la puissance de l'État et du bienêtre de la multitude gouvernée. Les charges de celle-ci augmentent, tandis qu'elle est moins intéressée à les supporter depuis que la conquête partielle ou totale de l'État a cessé d'entraîner sa propre destruction. Le besoin d'un changement dans les institutions qui remédie à l'insuffisance de la concurrence politique et guerrière pour préserver l'intérêt général se fait de plus en plus sentir et sollicite l'activité des inventeurs politiques. La religion, qui était une des branches maîtresses de la gestion de l'État, a subi le contre-coup de l'affaiblissement de la [250] concurrence politique et guerrière, en même temps que sa décadence a été accélérée par l'interdiction de la concurrence religieuse. Qu'en est-il résulté? C'est qu'en l'absence du stimulant de la concurrence, les services du culte possessionné n'ont pas manqué de baisser de qualité et de hausser de prix, la tendance naturelle des producteurs de ce genre de services comme de tous les autres étant d'augmenter leurs profits et de diminuer leur peine; or, il ne faut pas oublier que le clergé était non seulement en possession du monopole du culte, mais qu'il avait accaparé l'éducation et qu'il était chargé de la gestion des institutions charitables. De ce côté encore apparaissait la nécessité de plus en plus urgente d'une réforme. Enfin l'agrandissement de la sphère des échanges, résultant des progrès de la sécurité et des moyens de communication, de la transformation commencée du matériel de la production, rendait surannée l'antique organisation des corporations et des marchés appropriés, qui avait été jusquelà adaptée au régime de la petite industrie; après avoir été une protection, cette organisation n'était plus qu'une gêne et un obstacle au développement de l'industrie et du commerce ; d'un autre côté, l'apparition des nouvelles machines et des nouveaux procédés de production, en déplaçant le travail et en changeant sa nature, engendrait une. crise meurtrière pour les ouvriers que la disparition du servage avait rendus responsables d'eux-mêmes et de leur famille, mais qui ne possédaient point, généralement, la capacité requise pour s'acquitter des obligations impliquées dans cette responsabilité, surtout dans l'état d'instabilité que créait le progrès industriel. De là la nécessité d'un changement dans le régime de l'industrie, et à partir du xve siècle, une impulsion extraordinaire imprimée à l'esprit d'invention et de découverte dans le domaine des sciences morales et politiques aussi bien que dans celui des sciences [251] naturelles et des arts mécaniques. Ce travail de rénovation prit d'abord, comme aux époques antérieures de renouvellement de la machinery du gouvernement des sociétés, la religion pour objectif; ralenti, sinon arrêté pendant plus d'un siècle par les guerres religieuses, il fut repris et poursuivi avec un redoublement d'énergie et d'activité, causé par ce retard même, au xvine siècle.
En dépit des résistances que les intérêts engagés dans l'ancien régime, l'esprit de conservation dans son excès, les préjugés et la routine opposaient aux idées nouvelles, celles-ci se frayaient leur chemin; elles gagnaient les sommets de la société et les souverains eux-mêmes. Néanmoins, ces résistances étaient puissantes et obstinées; et tout en condamnant ce qu'elles avaient d'excessif, on ne saurait méconnaître ce qu'elles avaient d'utile. Les inventeurs dans les sciences morales et politiques et les arts qui en dérivent n'étaient pas infaillibles, et si nous examinons l'état général des doctrines politiques, religieuses, morales, économiques, à la veille de la Révolution française, si nous étudions les systèmes de gouvernement de l'homme et de la société qui en ressortaient et que les novateurs prétendaient appliquer du jour au lendemain, nous serons frappés de ce qu'ils avaient d'insuffisant, d'incohérent, de contradictoire et, trop souvent, de radicalement faux. Dans cette moisson, la proportion de l'ivraie dépassait de beaucoup «elle du bon grain. Les théoriciens politiques ne s'entendaient point sur les institutions qu'il convenait de donner à la société en voie de transformation, et les ébauches inapplicables et grotesques que façonnèrent leurs disciples dans la période révolutionnaire attestent combien ils étaient éloignés de la solution utile de ce problème; les économistes eux-mêmes, quoique ayant une notion plus exacte des besoins nouveaux de l'industrie humaine et du régime qui lui était désormais approprié, se trompaient sur des [252] points essentiels; ils s'imaginaient, par exemple, que l'agriculture était seule véritablement productive, et c'est pourquoi ils voulaient faire peser exclusivement sur le sol le fardeau de l'impôt; les philanthropes comme M. Necker confondaient dans le même anathème le monopole et la propriété; les communistes, comme Rousseau, Mably et Morelly, voyaient le progrès dans le retour aux institutions politiques et économiques des sociétés primitives. Ces lacunes, ces confusions et ces erreurs étaient certainement inévitables et elles eussent été sans conséquence si l'application des conceptions nouvelles du gouvernement de l'homme et de la société s'était opérée graduellement, à mesure que la nécessité s'en faisait plus vivement sentir et que l'opinion de la partie la plus éclairée du monde civilisé s'accordait davantage à les accepter. A la vérité, l'opinion n'était pas plus infaillible que ne l'étaient les novateurs eux-mêmes, et les innovations accueillies par elle et soumises à l'épreuve de l'expérience auraient causé plus d'un mécompte. Mais introduites d'une manière successive et partielle, elles n'auraient point causé de dommages irréparables et suscité ces réactions violentes qu'engendre l'application soudaine et générale d'une fausse théorie et d'une pseudo-réforme. Il y a apparence qu'en dépit de toutes les résistances et à cause même de ces résistances, l'évolution politique se serait accomplie, à bien peu de chose près, dans le temps et dans la mesure où la marche de l'évolution industrielle la rendait nécessaire. En revanche, si l'on considère l'état des esprits, des doctrines et des systèmes à la fin du xvmc siècle, si l'on fait l'inventaire des nouveautés en vogue, on peut se rendre compte de l'effroyable désordre où la chute violente de l'ancien régime et la tentative de le remplacer par un régime nouveau, construit de toutes pièces d'après les principes et les plans des novateurs le plus en crédit, ne pouvaient manquer de plonger la société.
[253]
Il était malheureusement probable que le procédé révolutionnaire qui faisait servir la force matérielle de véhicule au progrès politique prévaudrait sur le procédé évolulionniste qui excluait la force matérielle pour recourir uniquement à l'action de l'opinion, c'est-à-dire a la force morale. Le procédé révolutionnaire n'avait-il pas, en effet, pour lui la tradition de tous les temps et la pratique de tous les peuples? La force matérielle n'avait-elle pas été jusqu'alors considérée universellement et non sans raison, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, comme un véhicule indispensable du progrès politique? La plupart, on pourrait dire la généralité des changements, progressifs ou non, qui s'étaient opérés dans la mac/iinery du gouvernement de l'homme et de la société n'avaicnt-ils pas eu lieu avec son secours? L'histoire de la Grèce et de Rome en particulier, où grâce à l'éducation classique on était habitué à aller chercher des exemples, n'attestait-elle pas que les changements, dans les institutions politiques avaient presque toujours été produits par des convulsions intérieures, conspirations, insurrections, coups d'Etat, guerres civiles, dans lesquelles la force matérielle avait joué un rôle décisif? Pouvait-on imaginer qu'il en serait autrement désormais? N'était-ce pas se repaître de chimères que de croire que des corporations puissantes, maîtresses souveraines de l'État, disposant à leur gré de ses forces et de ses ressources, céderaient à une simple pression morale? Sans doute, on ne méconnaissait point la puissance croissante que l'opinion était en train d'acquérir, grâce aux instruments matériels de propagande que l'imprimerie et la presse, aidées par le développement des moyens de communication et des relations commerciales, avaient mis à son service; mais pouvait-on supposer, à une époque où ces auxiliaires nouveaux de l'opinion étaient encore à l'état embryonnaire et où les gouvernements s'efforçaient [254] de les annuler ou de les asservir, — pouvait-on supposer qu'ils suffiraient pour emporter la réforme de l'ancien régime? Se fier exclusivement à l'action de la force morale dans cette lutte avec des intérêts disposant de la force piatérielle, n'était-ce pas ajourner indéfiniment des progrès nécessaires? Il ne fallait point certainement négliger la propagande morale, mais, avant tout, ne fallait-il pas s'efforcer de se rendre maître de la force matérielle, en s'emparant de l'État pour en faire l'instrument du progrès? Telle était l'opinion qui avait prévalu de tous temps chez les novateurs politiques et, à de rares exceptions près, chez les autres, et on ne doit pas s'étonner si elle était demeurée prédominante à la fin du xvmc siècle.
C'est dans la journée du 14 juillet 1789 que l'évolution politique, devenue nécessaire, a passé de sa période d'incubation à celle de l'action révolutionnaire. Depuis cette époque la révolution n'a pas cessé de bouleverser le monde civilisé et on ne peut prévoir encore quand elle aura terminé son cours. Mais ce qui est de plus en plus visible, c'est qu'au lieu d'être, comme on le supposait, un véhicule indispensable de progrès, elle a déterminé un recul général des institutions et même des idées politiques et économiques; elle a retardé, au lieu de l'accélérer, l'établissement de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société, adaptée aux nouvelles conditions d'existence que leur a faites l'acquisition du matériel perfectionné de la production et de la guerre; elle a ouvert une période de rétrogressioii qui a ramené et ramène tous les jours davantage en arrière les nations qui subissent directement ou indirectement son influence, en neutralisant et en corrompant les résultats bienfaisants de l'évolution industrielle.
Pourquoi l'emploi des moyens révolutionnaires, après avoir été utile aux époques précédentes de rénovation [255] politique, est-il devenu nuisible? Pourquoi la révolution estelle actuellement chez les peuples civilisés une cause de rétrogression au lieu d'être un véhicule de progrès? Voilà ce qu'il s'agit maintenant de rechercher.
IV. La révolution à l'époque actuelle et ses effets de rétrogression. — Si le procédé révolutionnaire a cessé d'être utile pour devenir nuisible, cela tient à ce que le but qu'il s'agit d'atteindre aujourd'hui en matière de progrès politique diffère essentiellement de celui qui s'imposait dans les deux premières périodes de l'histoire do la civilisation.
Aux époques où la guerre avait pour les peuples civilisés un caractère de fatalité, où, sous peine d'être dépossédées et exterminées, avec les populations qui leur étaient assujetties, les sociétés propriétaires et exploitantes des États politiques devaient être plus fortes que les peuplades barbares vivant de rapine et de butin, le progrès consistait à découvrir les institutions les mieux adaptées à cet état de choses et à en confier l'application aux hommes capables d'en obtenir le maximum d'effet utile. Quand l'expérience révélait l'insuffisance des institutions existantes ou bien encore l'affaiblissement de la classe qui les mettait en œuvre, il s'agissait, pour les esprits progressifs, de réformer ces institutions surannées ou d'en créer de plus résistantes, de renforcer ou de remplacer cette classe affaiblie par des éléments plus vigoureux. Si ce progrès ne pouvait être réalisé par des voies pacifiques, il fallait laisser décliner et périr l'établissement auquel l'existence de la société était attachée, ou recourir aux moyens révolutionnaires. L'emploi de la force matérielle était même particulièrement indiqué lorsqu'il s'agissait de savoir lequel des groupes ou des partis qui aspiraient à la direction des affaires était le plus fort et le plus habile à la lutte, partant le plus capable d'assurer l'existence et le développement de l'État. Les moyens révolutionnaires étaien [256] donc, en cette circonstance, parfaitement en harmonie avec l'objectif essentiel du progrès politique, savoir d'opposer l'organisation la plus puissante possible à une cause de destruction, à laquelle tous les Etats étaient exposés, sans -qu'il leur fût possible de s'en préserver autrement que par la force.
Si nous consultons l'histoire de cette période, nous la trouverons remplie de luttes pour la domination, c'est-àdire pour la possession et la gestion de l'Etat, des profits et avantages qu'elles confèrent; nous remarquerons aussi que ces luttes demeurent habituellement concentrées dans la société des propriétaires de l'État; les masses appropriées ou sujettes n'y prennent aucune part. C'est, par exemple, la lutte des patriciens et des plébéiens à Rome, dans laquelle il s'agit de savoir si le gouvernement de la cité et de ses dépendances demeurera le monopole de quelques familles puissantes, ou si la classe inférieure de la société politique, — nous dirions aujourd'hui les petits actionnaires de cette société, — sera admise à y participer. L'issue de la lutte n'intéressait, directement du moins, ni les esclaves, ni les populations assujetties à la domination romaine. Les plébéiens, pas plus que les patriciens, ne songeaient à leur donner la liberté, ni à améliorer leur sort. L'histoire nous apprend même que le fardeau qui pesait sur leurs épaules alla s'alourdissant à mesure que la classe admise à prendre part à la gestion de l'État devint plus nombreuse. Sans doute, les esclaves et les populations assujetties essayèrent à diverses reprises de secouer le joug, mais c'était pour se mettre à la place de leurs maîtres en réduisant ceux-ci à la condition d'esclaves ou de sujets. Toutes ces luttes civiles, avec ou sans recours à la force, n'avaient jamais qu'un objet : la domination. Ajoutons que -lorsqu'une guerre survenait, les partis concurrents se liguaient généralement contre l'ennemi commun. A la vérité, [257] cette règle n'était pas sans exception : il arriva plus d'une fois que le parti le plus faible eut recours à l'étranger. Seulement, comme l'expérience démontra que ce recours était peu sûr et que l'étranger s'attribuait volontiers tout le profit dela victoire, en asservissant son associé, le parli vainqueur, avec le parti vaincu, l'appel à l'étranger dans les luttes civiles ne manqua pas d'être frappé de discrédit et condamné même comme une infraction aux usages de cette sorte de guerre, si peu scrupuleux que fussent d'ailleurs les belligérants sur les moyens d'arriver à leurs fins. Ajoutons enfin que ces luttes pour la possession du gouvernement avaient des avantages qui compensaient, et au delà, les pertes d'hommes et de capitaux qu'elles occasionnent. Elles entretenaient, dans les intervalles de paix extérieure, les facultés nécessaires à la guerre et, d'un autre côté, en attribuant la direction des affaires publiques au parti le mieux organisé, le plus fort et le plus habile, elles augmentaient la puissance de l'Etat, et par conséquent la sécurité de tous ceux qu'il abritait sous son lourd mais indispensable bouclier. C'est pourquoi les Etats despotiques, où les compétitions pour la domination étaient rares ou resserrées dans le cercle étroit d'une famille et d'une cour, étaient moins résistants, moins capables d'affronter les risques des invasions que les États libres (ainsi nommés parce que la société des propriétaires de l'Etat eu avait conservé la gestion au lieu de l'abandonner à un chef héréditaire). L'effet naturel de ces compétitions était non seulement d'entretenir et de développer chez tous les membres de la société propriétaire de l'État, les facultés de combat, mais encore de provoquer la recherche et l'application des institutions les plus propres à procurer et à assurer la possession de l'établissement politique à la classe la plus capable de le gouverner, de le défendre et de l'agrandir à l'avantage de tous.
En dernière analyse, quel but poursuivaient les faction [258] s ou les partis politiques en recourant au besoin à la force pour s'emparer de la gestion de l'État ou en acquérir une part? C'était de s'attribuer les profits de cette exploitation ou d'y participer. Mais la poursuite de ce but était, en somme, malgré les frais et dommages qu'il était dans sa nature de causer, conforme à l'intérêt général de la société propriétaire de l'Etat : elle exerçait et développait les facultés nécessaires à la lutte, contribuait à perfectionner les institutions politiques et militaires ou à les empêcher de se rouiller, et augmentait ainsi les chances de succès de la société dans ses luttes extérieures.
Quand nous disons que les révolutionnaires de cette période visaient les profits, attachés aux exploitations politiques comme aux autres, nous n'entendons pas nier que quelques-uns n'obéissent à des mobiles plus nobles, soit qu'il voulussent établir une répartition plus équitable de ces profits entre les différentes classes de la société politique, soit qu'en voyant s'affaiblir et décliner dans des mains incapables, et sous un régime vieilli, l'établissement qui fournissait leurs moyens d'existence à tous les membres de cette société, ils voulussent s'emparer de sa gestion pour la relever et l'améliorer. En tous cas, quels que fussent leurs mobiles, les moyens qu'ils employaient étaient adaptés au but qu'ils poursuivaient.
En est-il encore ainsi aujourd'hui? Quel but doivent poursuivre les hommes de progrès? Est-ce d'augmenter la puissance politique et militaire de la société dont ils font partie, c'est-à-dire la force nécessaire, d'une part, pour maintenir sa domination sur ses esclaves, ses serfs ou ses sujets, conserver et accroître les profits qu'elle en extrait sous forme de redevances en nature ou d'impôts en argent; nécessaire d'une autre part, pour défendre cette domination contre ses concurrents étrangers et l'agrandir à leurs dépens, en leur enlevant des territoires garnis [259] d'esclaves, de serfs ou de sujets? Non! le but auquel doivent tendre les hommes de progrès n'a plus rien de commun avec celui-là. Transformer les institutions politiques adaptées à la situation et aux conditions d'existence des sociétés vivant sous le régime de la petite industrie et de l'état de guerre pour les approprier à des sociétés vivant de la grande industrie et qui ont cessé d'être fatalement vouées à la guerre, réformer les servitudes politiques et militaires et la réglementation des monopoles naturels et artificiels provenant de la limitation des marchés, sous ce même régime; établir, en un mot, la liberté et la paix, ou du moins supprimer les obstacles qui empêchent ou retardent leur établissement, voilà en quoi consiste désormais l'œuvre du progrès.
Or, nous allons nous convaincre, en analysant les « moyens révolutionnaires », que non seulement leur emploi ne peut hâter l'avènement d'un régime de liberté et de paix, mais qu'il doit, en vertu de la nature même de ces moyens surannés, déterminer nécessairement et, en quelque sorte, mécaniquement, une rétrogression dans l'ancien régime, une recrudescence de l'état de guerre et des servitudes qu'il impose.
Toute révolution implique une organisation ayant pour objet le renversement du gouvernement en possession de l'État politique. Ce gouvernement, quels que soient sa forme et son nom, est toujours entre les mains d'une société, plus ou moins solidement organisée et largement pourvue de forces et de ressources, enfin intéressée au plus haut point à conserver une exploitation qui fournit à ses membres une situation prépondérante avec des moyens d'existence amples et assurés. Cette société ne peut être dépossédée que par une association concurrente, disposant de forces et de ressources plus grandes ou, ce qui revient au même, plus habilement et efficacement employées. [260] Celle-ci se constitue communément lorsque le gouvernement est en décadence ou bien encore lorsqu'une portion de la classe gouvernante ou de la classe qui aspire à gouverner veut augmenter sa part dans l'exploitation de l'État ou en obtenir une. C'est alors seulement qu'une association concurrente peut rassembler les forces et les ressources nécessaires à son entreprise. On voit même parfois, en de telles circonstances, se former plusieurs associations politiques au lieu d'une, mais elles fusionnent ou se coalisent d'habitude, sauf à se séparer ensuite et à se disputer la proie après l'avoir abattue.
On conçoit que des associations de ce genre soient rigoureusement prohibées par les gouvernements qu'elles menacent de dépossession. C'est pourquoi elles sont généralement réduites à se constituer sous forme de sociétés secrètes. Entre les sociétés secrètes et les gouvernements qu'elles ont entrepris de déposséder, s'établit une lutte à outrance dans laquelle les belligérants ne reculent devant l'emploi d'aucun moyen, moral ou immoral. Les conjurés, proclamant « la souveraineté du but », ont recours sans aucun scrupule aux procédés qu'ils jugent les plus efficaces pour arriver à leurs fins, et ces procédés sont d'autant plus violents et terribles qu'ils ont affaire à un gouvernement plus puissant et redoutable, et qu'ils sont mieux convaincus de n'avoir aucune merci à attendre; ils soulèvent des émeutes dans les moments qui leur paraissent opportuns, sans s'inquiéter des vies innocentes qu'ils sacrifient; ils ne reculent pas même devant l'assassinat du chef du gouvernement et de ses fonctionnaires; ils infligent des supplices cruels aux déserteurs et aux traîtres. Les gouvernements, de leur côté, imbus de la maxime que « la fin justifie les moyens », opposent aux sociétés secrètes une police politique qui alloue des primes à l'espionnage et à la trahison; ils punissent le crime de conspiration et les « attentats contre la [261] sûreté de l'Etat », c'est-à-dire contre la leur propre, de pénalités plus rigoureuses que celles qui atteignent les crimes commis contre la vie et la propriété de leurs sujets. Dans les cas d'émeute ou d'insurrection, ils refusent de traiter avec ces concurrents interlopes et de leur accorder le bénéfice des lois ordinaires de la guerre. Ils s'attribuent le droit de les exterminer, sauf à apporter des atténuations à ce droit rigoureux, quand leur intérêt le leur commande ou que quelque sentiment d'humanité les y pousse.
Cependant, si les gouvernements attribuent un caractère exceptionnel de criminalité aux faits de guerre intérieure qui ont pour objet de les déposséder, la conscience universelle ne ratifie point cette manière de voir. C'est pourquoi les « crimes politiques » sont communément exceptés des traités d'extradition. Remarquons toutefois que cette exception cesserait d'être motivée si les gouvernements étendaient à leurs ennemis intérieurs le bénéfice des lois ordinaires de la guerre. Alors les faits que ces lois interdisent, l'assassinat politique par exemple, devraient être rangés dans la catégorie des crimes de droit commun; ils ne pourraient plus être, en aucun cas, considérés comme des représailles et admis, à ce titre, à bénéficier de l'exception que la législation internationale continue à leur acorder.
Dans cette lutte pour la possession de l'État, les associations révolutionnaires ont un avantage marqué sur le gouvernement qu'elles veulent déposséder, en ce qu'elles poursuivent un but unique, vers lequel tendent continuellement tous leurs efforts, tandis qu'un gouvernement moderne est encombré d'attributions et d'occupations multiples. Cet avantage est tel qu'il suffit souvent pour compenser l'énorme disproportion qui existe entre les forces et les ressources d'une société ou d'un groupe de sociétés secrètes réunissant quelques centaines ou quelques milliers d'adhérents tout [262] au plus, alimentées par des cotisations ou des subventions volontaires et précaires, et celles d'un gouvernement ayant à son service des centaines de milliers de fonctionnaires et de soldats et disposant d'un budget qui se chiffre par milliards. Toutefois, si le gouvernement, en butte aux tentatives révolutionnaires, possède une bonne police et une armée fidèle, s'il évite surtout de fournir des recrues à ses concurrents en mécontentant par la brutalité et la maladresse de ses mesures de défense et de répression la masse des indifférents en matière politique, la supériorité de ses forces et de ses ressources lui donnera de nombreuses chances de remporter la .victoire. A la vérité cette victoire est rarement définitive. Si, comme en Pologne, par exemple, le parti révolutionnaire s'est formé et se recrute dans une classe politiquement dépossédée et qui n'a point cessé de considérer l'État comme sa propriété, ce parti pourra subir des défaites, mais il ne renoncera à ses revendications qu'après avoir épuisé toutes ses chances de succès. En revanche, si, comme en Angleterre,Capres l'avènement de Guillaume III, le gouvernement nouveau réussit à se concilier assez complètement les intérêts et l'opinion des classes les plus influentes de la nation, s'il sait se rattacher par des faveurs habilement distribuées les partisans du régime déchu, à mesure qu'ils perdent l'espérance d'un secours intérieur ou extérieur, il finira par avoir raison de son concurrent. On verra se dissoudre peu à peu la société dépossédée et ses membres se rallier au vainqueur comme il est arrivé au parti jacobite.
Mais, quelle qu'en soit l'issue, cette lutte pour la possession et l'exploitation de l'État ne peut plus avoir aujourd'hui que des résultats nuisibles; elle ne peut que retarder l'évolution nécessaire des sociétés civilisées vers la liberté et la paix et accroître par conséquent le désordre, le malaise et les souffrances causés par ce retard. Deux cas peuvent se [263] présenter : ou le gouvernement réussit, après une lutte plus ou moins longue, à triompher de ses compétiteurs, ou il est vaincu et remplacé par la société politique qui a fomenté la révolution. Dans le premier cas, la « nuisance » est manifeste et sans compensation aucune. Elle consiste d'abord dans la perte matérielle infligée à la nation par les frais et les dégâts de la lutte, en y comprenant le dommage causé à l'industrie et au commerce par les crises qui précèdent et accompagnent les émeutes et les insurrections; elle consiste ensuite dans les passions mauvaises que la lutte développe, dans les haines qu'elle suscite et propage, dans la démoralisation que provoquent à la fois les moyens révolutionnaires et les moyens de répression, l'assassinat, l'incendie, la délation, les exécutions en masse. Enfin, la lutte terminée, à ce passif de pertes matérielles et de dommages moraux vient s'ajouter une autre cause de rétrogression : c'est l'accroissement de la puissance du gouvernement vainqueur et des classes qui lui servent d'appui, et le besoin qu'ils éprouvent de se venger des vaincus et de s'assurer contre leurs retours offensifs, comme aussi de tirer le plus grand profit possible de leur victoire. De là une « réaction », impliquant toujours une diminution des libertés politiques et économiques dont jouissait en droit ou en fait la masse gouvernée.
Dans le second cas, savoir lorsque le gouvernement établi vient à succomber, lorsqu'un gouvernement révolutionnaire s'installe à sa place, le dommage est, quoi qu'il arrive, incomparablement plus grand et la rétrogression plus sensible.
Une révolution, en effet, ne peut réussir et donner naissance à un nouveau gouvernement qu'à une condition: c'est que les associations politiques qui la préparent et la dirigent recrutent leurs forces et leurs ressources dans une classe plus nombreuse et plus puissante que celle sur [264] laquelle s'appuyait le gouvernement dépossédé. Cette classe commanditaire de la révolution veut naturellement recueillir les profits de l'opération. Dès le lendemain de la victoire, les chefs du gouvernement révolutionnaire sont assiégés par une nuée de solliciteurs, ardents à la curée, qui, ayant contribué de leur sang, de leur argent ou de leur influence à la chute de l'ancien régime, réclament une part dans ses dépouilles. Cependant, on ne peut expulser complètement le personnel des emplois publics; il faut bien en garder une partie, ne fût-ce que pour faire l'éducation politique et administrative des nouveaux venus; il est prudent aussi de ménager des gens qui ne demandent qu'à se rallier à la révolution pour conserver leurs places et qui, dépossédés, ne manquent pas de devenir ses ennemis implacables. On se trouve donc dans la nécessité non seulement de conserver les emplois existants, fussent-ils inutiles ou nuisibles, mais encore d'en accroître le nombre, et au lieu de réduire les dépenses publiques, de les augmenter. Si, dans les premiers jours de la révolution, on a supprimé quelques impôts pour satisfaire la multitude, on ne tarde guère à être obligé de les rétablir ou de les remplacer par d'autres. Ce n'est pas tout. Le gouvernement dépossédé a gardé des partisans, qui ourdissent des conspirations ou même entreprennent une lutte à main armée pour le restaurer, tandis que la possession du gouvernement révolutionnaire et le partage des dépouilles engendrent des divisions et des querelles parmi les vainqueurs. Les uns et les autres constituent des factions ennemies, qui ne reculent devant rien pour se procurer la victoire. Ceuxlà font appel à l'intervention étrangère, ceux-ci soulèvent les masses ignorantes, en excitant leurs appétits brutaux et leurs passions féroces. La guerre civile et trop souvent la guerre étrangère apparaissent comme des conséquences inévitables de la révolution. Toutefois, après une période [266] plus ou moins longue de luîtes, dont la nation a fait les frais et subi le dommage, le parti le plus fort, grâce au nombre ou à la qualité de ses adhérents ou au génie de son chef, finit par l'emporter. L'ordre se rétablit soit par l'installation d'une dictature, stathoudérat ou empire, soit par l'établissement d'un gouvernemeut parlementaire, monarchie ou république. Mais le progrès qu'il s'agissait de réaliser en renversant l'ancien gouvernement et qui seul pouvait légitimer sa dépossession, est-il accompli? La nation, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs politiques, sans distinction de classes, a-t-elle acquis, en échange des sacrifices extraordinaires de sang et d'argent que la révolution lui a coûtés, un gouvernement moins lourd et mieux approprié aux nouvelles conditions de son existence, plus pacifique et plus libéral? L'ancien régime a-t-il disparu? En apparence, oui sans doute. La vieille société politique qui possédait et exploitait l'État a été dépossédée et avec elle ont été emportés les monopoles et les privilèges à son usage; mais la nation y a-t-elle gagné quelque chose? Non, car une nouvelle société politique, recrutée dans une classe plus nombreuse et plus puissante, a pris la place de l'ancienne et, à son exemple, s'applique à tirer le plus gros bénéfice possible du domaine politique qu'elle a conquis et qu'elle exploite. D'ailleurs, elle subit des nécessités que son origine révolutionnaire lui a léguées. La révolution, par les luttes qu'elle a déchaînées, a élevé le risque de guerre; il faut bien que le gouvernement issu de la révolution développe ses armements en raison de l'accroissement de ce risque. La révolution a été obligée de récompenser les vainqueurs sans dépouiller entièrement les vaincus. Le gouvernement qui a accepté son héritage se trouve par là même dans la nécessité de pourvoir à des obligations plus nombreuses, partant d'imposer à la nation des charges plus lourdes. Il a dû augmenter ses [266] attributions et il n'a pu les augmenter qu'aux dépens de l'activité privée et de la bourse des contribuables. Il a dû encore remplacer les monopoles et les privilèges dont jouissait l'ancienne classe gouvernante par d'autres monopoles et d'autres privilèges, particulièrement adaptés aux intérêts non moins âpres et plus nombreux de la nouvelle. On s'est éloigné ainsi du but qu'il s'agissait d'atteindre, savoir de mettre les institutions politiques du passé en harmonie avec les conditions présentes d'existence des sociétés, de fonder un régime de liberté et de paix.
Cependant, le besoin de ce progrès politique subsiste après l'avortement révolutionnaire, comme il existait auparavant; il est même devenu plus intense, car l'évolution industrielle qui le provoquait ayant continué son mouvement, tandis que l'évolution politique subissait une rétrogression, l'écart entre l'état économique des sociétés et leur état politique s'est agrandi. Ce besoin non satisfait et plus pressant entretient, en l'aggravant, le malaise et le mécontentement de la.multitude, sur laquelle s'est appesanti le fardeau de l'exploitation politique, et encourage de nouvelles entreprises révolutionnaires. Des associations politiques se forment encore une fois pour renverser un gouvernement infidèle aux promesses de la révolution. Ces associations recrutent ordinairement leur état-major parmi les mécontents et les déclassés de la classe gouvernante, et elles s'appuient sur les classes qui supportent le poids de l'établissement politique sans obtenir une part proportionnelle dans les profits et avantages qu'il confère; elles font au gouvernement établi une guerre publique, quand il la tolère, secrète et peut-être plus dangereuse quand il l'interdit, jusqu'à ce qu'elles réussissent à le déposséder. Mais le gouvernement issu de cette seconde révolution subit les mêmes nécessités qui s'étaient imposées à son prédécesseur, nécessités aggravées par un nouvel exhaussement [267] du risque de guerre et une nouvelle augmentation du nombre des appétits à satisfaire, et la révolution aboutit encore une fois à une rétrogression.
Recrudescence du risque de guerre et des armements destinés à le couvrir, accroissement des attributions et des dépenses du gouvernement, abaissement de la qualité de son personnel, multiplication et aggravation des monopoles et privilèges adaptés aux intérêts particuliers de la classe gouvernante, se résumant dans l'alourdissement progressif du fardeau de l'exploitation politique, au profit d'une classe et aux dépens de l'ensemble de la nation: voilà les résultats inévitables des révolutions; inévitables, disons-nous, car ils découlent des nécessités engendrées par l'emploi des moyens révolutionnaires.
Ces nécessités, elles s'imposent, notons-le bien, quel que soit le but assigné à la révolution par ses promoteurs. Ceux-ci se partagent en deux catégories : une minorité de fanatiques à l'esprit étroit, mais aux convictions sincères et désintéressées, une majorité d'aventuriers et de déclassés de toute provenance, gens qui n'ont rien à perdre et se jettent dans une entreprise révolutionnaire comme dans toute autre affaire aléatoire, avec l'espoir d'y trouver du jour au lendemain une situation et une fortune qu'ils ne pourraient jamais obtenir ou qu'ils n'obtiendraient qu'après de longues années de travail, en suivant les voies régulières. La révolution faite, les fanatiques plutôt que de sacrifier leur programme à des nécessités qu'ils n'avaient pas prévues, se retirent pour la plupart et vont grossir l'armée des désillusionnés et des mécontents. Les autres renient et ajournent, sans aucun scrupule, des programmes qu'ils n'ont jamais considérés que comme des engins de guerre, des amorces jetées à la popularité ; ils s'empressent d'exploiter la situation inespérée que le succès de l'entreprise leur a value et d'en tirer tout ce qu'elle peut fournir [268] de bénéfices et d'avantages, d'autant plus pressés de jouir qu'ils ont été plus longtemps à la portion congrue et qu'ils peuvent craindre un retour de la fortune, facilement convaincus d'ailleurs que la conservation de leur pouvoir est nécessaire au salut de la société menacée par les utopies de leurs anciens associés et autorisés par là même à employer les mesures de répression les plus implacables contre ceux qui ne craignent pas de recourir aux moyens révolutionnaires pour leur enlever ce pouvoir tutélaire. Ces moyens qu'ils considéraient comme légitimes quand ils s'en servaient eux-mêmes deviennent maintenant criminels. De là, une perversion dans les idées morales qui apparaît comme la conséquence invitable de toute révolution : la moralité de la nation est ébranlée non seulement par une lutte dans laquelle les lois de la guerre civilisée sont méconnues et l'humanité outragée, par la confiscation des dépouilles des vaincus et le spectacle des querelles intestines que leur partage suscite entre les vainqueurs, par la curée effrénée des places, des bénéfices et des honneurs, mais encore par le manquement tantôt effronté, tantôt hypocrite aux promesses et aux engagements les plus solennels, par le reniement des principes passé à l'état de principe chez les hommes qui gouvernent l'Etat et représentent la loi.
Dans le domaine des idées politiques et économiques la perversion et le recul ne sont pas moindres, La science politique est désormais subordonnée tout entière à un dogme : celui de la souveraineté du peuple qui ramène les sociétés modernes aux institutions embryonnaires des troupeaux primitifs, et son œuvre doit consister uniquement à chercher les modes d'application de ce dogme. La science économique est entraînée dans le même mouvement de recul. En effet, s'il appartient à la nation d'organiser et d'exploiter à son profit les services politiques [269] de l'État, pourquoi son autorité et sa compétence ne s'élendraient-elles pas à tous les autres? La nation est souveraine et elle est intéressée au plus haut degré à la prospérité et au bonheur de ses membres. Qui donc, mieux qu'elle, pourrait organiser de la manière la plus utile et régler de la manière la plus équitable la production, la distribution et la consommation de la richesse? Comme la politique, la science économique a désormais pour tâche de chercher, dans la sphère qui lui est propre, les modes d'application du principe de la souveraineté du peuple, et elle rétrograde ainsi jusqu'au communisme.
[270]
CHAPITRE IX.
La Révolution française.↩
I. Les réformes accomplies et les institutions créées par la Révolution francaise. — II. Les causes de la révolution. § 1er. En quoi consistait l'État. § 2. A qui appartenait l'État. § 3. Situation du roi propriétaire de l'État vis-à-vis de la nation. § 4. Causes qui ont empêché la réforme de l'ancien régime. § 5. Pourquoi la réunion de l'Assemblée nationale devait conduire à la révolution. — III. Rétrocession produite par la révolution. § 1er. Récapitulation des causes de ce phénomène. § 2. Marche rétrogrcssive de la révolution jusqu'à nos jours. § 8. Marche ultérieure de la revolution. —IV. Influence rétrograde de la révolution sur les sciences morales et politiques. § 1er. Sur la science de la politique. § 2. Sur l'économie politique. —V. Pertes matérielles et démoralisation causées par la révolution. § 1er. Destruction des richesses. § 2. Démoralisation. — VI. Influence rétrograde de la Révolution française à l'étranger. — VII. Comment les nations civilisées sortiront de la révolution pour rentrer dans de l'évolution.
I. Les réformes accomplies et les institutions créées par la Révolution française. — Le résultat politique capital de la Révolution française a été de dépouiller la monarchie patrimoniale de la gestion de l'État, qu'elle exerçait conjointement avec la noblesse et le clergé, pour placer cette gestion entre les mains de la Bourgeoisie, à laquelle sont venus se réunir ensuite, toutefois sans fusionner entièrement avec elle, les débris de l'ancienne classe dirigeante, dépossédée et proscrite. Dans cette subversion violente, les privilèges de la noblesse et du clergé, les exemptions d'impôts, les droits féodaux, la possession exclusive de certains emplois et dignités, la dîme, la prohibition des schismes ou des cultes étrangers, ont été emportés avec les offices judiciaires, les corporations industrielles, les [271] compagnies privilégiées et les douanes intérieures. Ces réformes, auxquelles on ne manque pas d'ajouter l'établissement d'un code uniforme et d'un nouveau système de poids et mesures constituent le plus clair de l'actif de la Révolution, [43] mais les plus importantes étaient [272] accomplies ou en voie d'accomplissement, depuis l'avènement du roi Louis XVI. Si la révolution n'avait pas éclaté, les [273] réformes qu'on lui attribue se seraient poursuivies paisiblement dans ce qu'elles avaient d'utile, et ces réformes [274] eussent été définitives. L'influence grandissante que les progrès extraordinaires de l'industrie conféraient au tiers [275] état eût agi pour faire rentrer peu à peu la noblesse et le clergé dans le droit commun, en établissant une [276] répartition plus équitable de l'impôt, en rendant tous les emplois accessibles à tous, en supprimant les monopoles du [277] eulte et de l'enseignement, tandis que l'influence de l'ancienne classe gouvernante eût opposé, au profit de la [278] multitude gouvernée, un frein aux appétits d'exploitation des nouveaux venus. En annulant, au moins d'une manière temporaire, cette influence, La révolution laissa le champ libre à la classe moyenne, et celle-ci ne manqua point de profiter de l'avantage de sa situation pour remplacer les privilèges adaptés aux intérêts de la noblesse et du clergé par d'autres privilèges adaptés aux siens. De l'ancien régime, elle conserva ou rétablit ce qui convenait à ses [279] intérêts particuliers, en y ajoutant successivement ce qui lui paraissait de nature à consolider sa puissance et à accroître sa fortune.
Si l'on étudie le nouveau régime, on s'aperçoit que c'est une machine infiniment compliquée et dont les différentes pièces ne sont pas seulement plus nombreuses que celles de l'ancien régime, mais encore plus lourdes. Ceux qui l'ont construite se sont ingéniés, — le plus souvent à la vérité, d'une manière inconsciente et sous la pression d'intérêts qui se confondaient, de bonne foi, avec l'intérêt général, — à la rendre aussi productive que possible pour la classe aux mains de laquelle la révolution l'avait fait tomber.
Considérons, par exemple, le système des impôts. Ce système, tel qu'il avait été créé et développé dans le cours des siècles, a commencé par être aboli révolutionnairenient, mais pour être bientôt rétabli dans toutes ses parties essentielles et aggravé dans plusieurs, sauf un simple changement dans les dénominations. [44] Si les [280] immunités partielles dont jouissait l'ancienne classe gouvernante ont disparu, en revanche la multiplication des impôts indirects, frappant les quantités et non les valeurs, a incessamment aggravé l'inégalité initiale de l'assiette de la fiscalité ; plus que jamais, l'impôt a été fourni par les classes non participantes à la gestion de l'Etat, et consommé par les états-majors civils et militaires recrutés dans la classe gouvernante; à quoi il faut ajouter que la perception des impôts a rétrogradé du système perfectionné de l'affermage au système primitif et grossier de la régie : il a exigé ainsi un personnel plus considérable et mis un plus grand nombre de places à la disposition des maîtres de l'État, tout en devenant plus incommode et plus onéreux. Le servage militaire, qui était en voie de disparaître, sous l'ancien régime, a été rétabli et généralisé avec les exceptions du remplacement et, plus tard, du volontariat qui, eu le rendant plus léger pour la classe gouvernante, au sein de laquelle se recrute, presque exclusivement, la hiérarchie militaire à appointements, en alourdissent le poids pour la multitude. Cette rétrogression, dans [281] le régime du servage, suffirait seule à balancer toutes les réformes progressives, ou prétendues telles, que l'on a coutume de mettre à l'actif de la révolution. [45]
Cette extension du système des impôts a été nécessitée par celle des attributions du gouvernement, obligé [283] désormais de fournir des situations rétribuées à un personnel politique plus nombreux et non moins besogneux que [284] celui de l'ancien régime. L'enseignement, les routes, les canaux, les télégraphes et, en partie, les chemins de fer [285] ont été englobés dans l'exploitation de l'État; les attributions des administrations communales et [286] départementales (celles-ci multipliées par le morcellement artificiel des provinces) ont été augmentées avec celles du [287] gouvernement central; enfin, la sphère de l'activité libre de la généralité des membres de la nation a été restreinte plus [288] encore qu'elle ne l'était auparavant par une série de monopoles et de privilèges financiers et industriels: monopole de l'émission de la monnaie fiduciaire attribué à un établissement privilégié, qui a accaparé les bénéfices résultant de l'emploi de cet instrument de circulation perfectionné; monopole des chemins de fer, soustraits à la concurrence, au profit de quelques grandes compagnies associées à l'État; monopoles industriels, multipliés et alourdis aux dépens des consommateurs, par l'extension et le renforcement du système protecteur, dans le but [289] d'augmenter les profits des entrepreneurs d'industrie; lois restrictives ou prohibitives des associations, des grèves et des coalitions; obligation du livret imposée aux ouvriers, en vue d'accroître ces mêmes profits aux dépens de la classe des salariés, non admise à l'exercice des droits politiques; rétablissement des offices ministériels; subventions allouées aux théâtres à l'instar de l'ancien régime, etc., etc. Ainsi s'est construit, et successivement agrandi, le nouveau régime, en conservant du précédent ce qui paraissait avantageux à la classe que la révolution avait investie de la puissance politique, et en y ajoutant les [290] attributions, les monopoles et les privilèges qui s'adaptaient spécialement à ses intérêts. En comparant ce qu'étaient, en 1788, les services monopolisés par l'Etat et les sous-États provinciaux et communaux, les services attribués à des corporations ou à des sociétés privilégiées et l'ensemble des restrictions imposées à l'activité libre de tous au profit de quelques-uns à ce qu'ils sont aujourd'hui, on se convaincra que la révolution a diminué la somme des libertés dont jouissaient les Français, et doublé au moins le poids du gouvernement de la France. En d'autres termes, si aucun changement n'avait été accompli depuis 1789, dans le mécanisme politique et administratif, dans le régime fiscal et les institutions économiques, la masse des « consommateurs politiques » serait maintenant plus libre et supporterait moins de charges.
Cet ancien régime revu, augmenté et adapté aux intérêts de la nouvelle classe que la Révolution a mise en possession de l'appareil à confectionner les lois et règlements, a été cependant l'objet de diverses réformes et il a reçu un certain nombre d'améliorations ; mais ces réformes et ces améliorations, quand elles n'étaient pas purement illusoires, quand elles répondaient réellement à l'intérêt général, ont été produites par des causes étrangères à la révolution et qui auraient agi même avec plus de promptitude et d'efficacité si elle n'avait pas eu lieu. Tantôt elles ont été déterminées par les progrès de l'industrie, tantôt, par l'exemple et la concurrence des autres nations. C'est grâce à la transformation et au développement merveilleux des moyens de communication que l'ouvrier a pu se dérober à l'état de sujétion auquel le condamnait la législation de l'ancien régime, renforcée par les gouvernements issus de la révolution; c'est à l'exemple de l'Angleterre que l'on doit la réforme tardive de cette législation, en même temps que celle du régime prohibitif; [291] c'est le progrès mécanique de la typographie qui a provoqué le développement de la presse périodique, en dépit des efforts que les gouvernements ont faits pour l'enrayer. Dans l'intervalle de près d'un siècle qui s'est écoulé depuis la première explosion révolutionnaire, on ne pourrait pas citer un seul progrès politique ou économique dont la France, si richement douée cependant du génie de l'invention, ait pris l'initiative. Les progrès matériels qui ont transformé la production n'ont réussi, de même, à s'y implanter qu'après avoir été adoptés ailleurs, en luttant contre les entraves administratives et en payant la dîme aux intérêts privilégiés. En supposant que la Révolution française eût fait le tour du monde, le résultat eût été une rétrogression universelle et peutêtre, malgré les progrès de l'industrie, une immobilisation chinoise, sinon un retour à la barbarie.
Comment donc une révolution entreprise naïvement, pour établir au profit de l'humanité tout entière un régime de liberté et de paix, a-t-elle abouti à la reconstitution et à l'aggravation de l'ancien régime au profit d'une nouvelle classe gouvernante, à l'accroissement des servitudes et des charges qui pesaient sur les « consommateurs politiques » et à la recrudescence de l'état de guerre?
II. Les causes de la révolution. — § 1er. En quoi consistait l'État? — Pour trouver l'explication de ce phénomène, nous sommes obligés de revenir sur les causes de la révolution et de rappeler d'abord ce qu'était la constitution politique de la France avant 1789.
En quoi consistait l'État? L'Etat était une entreprise qui rendait à la nation formant sa clientèle politique un certain nombre de services, pour la plupart de première nécessité; il se chargeait de garantir la sécurité des personnes et des propriétés contre toute atteinte intérieure ou extérieure; il fabriquait de la monnaie, construisait des [292] routes, transportait les lettres, etc., etc. Il possédait des immeubles et un matériel d'exploitation appropries a ses diverses industries, tels que forteresses, armes et munitions de guerre, bâtiments et mobilier d'administration et de police, prisons, ateliers de fabrication de la monnaie, palais à l'usage du propriétaire de l'Etat, des membres de sa famille et de son état-major de fonctionnaires civils et militaires. Il avait à son service un nombreux personnel d'officiers, de soldats, d'administrateurs, de juges, de gens de police, d'employés et d'ouvriers. Pour subvenir aux frais d'entretien et de renouvellement de son matériel et de rétribution de son personnel, en même temps que pour réaliser les bénéfices nécessaires de son industrie, le propriétaire exploitant de l'État percevait, d'une part, les revenus des propriétés qui y étaient restées afférentes, forêts et autres biens domaniaux, d'une autre part des impôts variés auxquels il assujettissait les consommateurs politiques qui lui étaient appropriés. Nous avons remarqué que cette appropriation du marché des services politiques, judiciaires et administratifs n'était point particulière à l'État; qu'elle avait été le régime universel de l'industrie et des autres professions; que chaque corporation d'arts et métiers possédait son marché, dans toute l'étendue duquel elle ne souffrait ni l'établissement d'une entreprise concurrente, ni l'importation de produits similaires du dehors. En cela, le régime économique de l'État ne différait point de celui des autres entreprises.
§ 2. A qui appartenait l'État? — A l'origine, il était la propriété de l'armée barbare qui l'avait conquis sur d'autres conquérants, les Romains, et l'avait partagé entre ses membres , tout en demeurant constituée comme une corporation politique et militaire dans l'intérêt de la sûreté commune. Nous avons vu sous l'influence de quelles nécessités cette corporation s'était soumise à un chef [293] hèreditaire et comment ce chef avait, dans le cours des siècles, successivement agrandi son domaine particulier aux dépens de ceux des autres membres de la corporation et des propriétaires des États étrangers. C'est ainsi que la maison royale de France était devenue l'unique propriétaire de l'État auquel se trouvait assujetti l'un des pays les plus peuplés et les plus riches de l'Europe. Cet État, elle l'exploitait, le défendait et s'efforçait de l'agrandir avec le concours d'un état-major, composé principalement des héritiers des maisons qu'elle avait dépossédées, et auxquels, eu échange des profits aléatoires qu'ils tiraient de leurs petites souverainetés, elle allouait des émoluments fixes et réguliers, des parts de bénéfices dans ses nouvelles acquisitions, des privilèges et des exemptions d'impôts; elle complétait son personnel civil et militaire soit dans les couches inférieures de la population, soit à l'étranger. Tout en agrandissant ainsi son marché, la maison royale ne négligeait aucune occasion d'augmenter son pouvoir sur sa clientèle, toujours en vue de l'accroissement de ses profits. Le roi avait fini par gouverner son État selon son bon plaisir; il refusait absolument à ses sujets, ;dans les derniers siècles de la monarchie, le droit de contrôler la qualité de ses services et d'en débattre le prix, comme la chose s'était pratiquée jadis dans les petites souverainetés féodales et n'avait point cessé de se pratiquer en Angleterre.
En résumé, l'État de l'ancien régime n'était autre chose qu'une vaste entreprise politique, appartenant à une « maison », dont le chef l'exploitait pour son compte de père en fils, en assumant les risques et en sjattribuant les bénéfices de l'exploitation. Il la dirigeait souverainement,, prenait toutes les mesures qui lui paraissaient nécessaires au bien de l'entreprise, nommait et révoquait les subordonnés auxquels il confiait la gestion des différents services, et, à ces divers égards, sa situation ne différait pas de celle [294] du propriétaire exploitant d'une entreprise ordinaire. Enfin il était, comme la généralité des entrepreneurs de l'ancien régime, propriétaire de son marché. Nul ne pouvait lui faire conciu-rence dans toute l'étendue de ce marché. Il y imposait ses services, en fixait le prix à sa guise et percevait ce prix sous les formes qui lui paraissaient les plus commodes et les plus avantageuses. Il ne tolérait point que les consommateurs s'avisassent de le discuter ou de critiquer la qualité des services, et, en cela encore, il se comportait comme tout autre entrepreneur l'eût fait à sa place.
§ 3. Situation du roi, propriétaire-exploitant de l'État, vis-à-vis de la nation. — Le roi était vis-à-vis de la nation dans la situation du producteur vis-à-vis du consommateur. Il produisait des services de première nécessité, il assurait notamment à tous les membres de la nation la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. A ce titre de « producteur de sécurité », sans parler du reste, il était intéressé à la fois à élever le prix de ses services et à en abaisser la qualité. Tel est l'intérêt immédiat de tous les producteurs, et cet intérêt ne peut être balancé au profit de l'intérêt opposé du consommateur que par deux contrepoids : la concurrence des producteurs ou l'appropriation des consommateurs.
Si la concurrence existe et si elle est suffisamment active» si le consommateur a le choix entre les producteurs, il ne manquera pas de s'adresser à celui qui lui offre la meilleure marchandise au prix le plus bas, et il obtiendra finalement les produits dont il a besoin à un prix correspondant aux frais nécessaires pour les créer et les mettre à sa disposition dans le moment et dans le lieu où il les demande. Si, au contraire, la concurrence n'existe pas ou si elle est insuffisante, le prix s'élèvera jusqu'à la limite extrême des sacrifices que le consommateur peut faire pour apaiser le besoin qui le sollicite; et si ce besoin est de première [295] nécessité, comme la sécurité par exemple, le prix pourra s'élever à un taux excessif. Le producteur s'enrichira tandis que le consommateur se ruinera.
A défaut de la concurrence, le seul préservatif du consommateur, c'est d'être approprié au producteur. Si celuici est propriétaire de sa clientèle, il se trouve intéressé par là même à ne pas épuiser des ressources dont il tire les siennes et à modérer ses profits afin d'en assurer la durée. Telle était la situation du chef héréditaire de la maison royale, propriétaire à perpétuité de la clientèle politique de la nation française. Son intérêt permanent de propriétaire faisait contrepoids à son intérêt immédiat de producteur.
Cependant cet intérêt permanent, le propriétaire-exploitant de l'État était toujours exposé à le perdre de vue et tenté de le sacrifier à son intérêt immédiat, ainsi qu'il arrive au surplus à tous les entrepreneurs d'industrie. Alors, lorsque l'abaissement de la qualité et l'exagération du prix des services de l'État étaient devenues insupportables, que faisaient les consommateurs politiques? Ils recouraient à l'expédient de la coalition. Ils se coalisaient pour refuser ou marchander l'impôt, jusqu'à ce qu'on eût accordé à eux ou à leurs mandataires le droit de débattre contradictoirement le prix des services de l'Etat et d'en contrôler la qualité. Mais cet expédient, qui a donné naissance au régime représentatif, ne pouvait atteindre qu'imparfaitement le résultat désiré. Tout dépendait, comme dans le cas d'une coalition d'ouvriers, des forces des deux parties en présence. Lorsque le gouvernement était le plus fort et le plus habile, il s'appliquait à rendre illusoire le contrôle de ses services aussi bien que le débat du prix, les garanties que les consommateurs croyaient avoir acquises sous ce double rapport ne tardaient pas à perdre leur vertu, les services à s'abaisser et les charges à s'accroître comme auparavant. Lorsque les mandataires des gouvernés, [296] constitués en corporations riches et puissantes, avaient affaire, au contraire, à un gouvernement faible, ils lui marchandaient les ressources dont il avait besoin, contre-carraient «es entreprises les plus nécessaires et mettaient en péril la sécurité commune. Aux époques et dans les pays où les populations étaient exposées aux invasions barbares, ce marchandage devenait une nuisance dont elles ne tardaient pas à ressentir les effets désastreux et on s'explique ainsi que le système représentatif qui avait commencé à s'implanter en Europe après les grandes invasions ait été frappé de discrédit lorsque les conquêtes musulmanes eurent de nouveau mis en péril le monde chrétien. Sauf en Angleterre, où les populations étaient défendues par la mer, elles se laissèrent enlever, presque sans résistance, une garantie trop souvent illusoire ou dangereuse, et elles retombèrent à la merci des producteurs des services politiques.
Tel était le régime qui avait prévalu en France aussi bien que dans les autres grands Etats du continent à l'époque où l'évolution industrielle commençait à nécessiter la transformation et surtout la simplification de la vieille machinery du gouvernement.
§ 4. Causes qui ont empêché la réforme de l'ancien régime. — Cette transformation, le chef héréditaire de la maison royale, propriétaire à perpétuité de l'État, était plus que personne intéressé à l'accomplir. Si la nation venait à s'affaiblir et à s'appauvrir, par le fait de la conservation routinière d'un régime qui avait cessé d'avoir sa raison d'être, l'Etat ne pouvait manquer de subir le contre-coup de son affaiblissement et de sa ruine. L'intérêt particulier de la maison royale était donc lié, d'une manière permanente, à l'intérêt général de la nation. Cela étant, il appartenait au roi de prendre l'initiative de la transformation politique que commençait à nécessiter l'évolution industrielle. Son [297] intérêt bien entendu le lui commandait, et il en avait d'ailleurs le pouvoir. Grâce à la concentration successive de la propriété politique dans la maison royale et à l'accroissement de force que la centralisation avait apporté au mécanisme gouvernemental, il disposait d'une puissance qui lui permettait d'imposer sa volonté aux intérêts les plus récalcitrants et de surmonter toutes les résistances.
Malheureusement, les sciences morales et politiques, par suite du retard qu'elles avaient subi et dont nous avons analysé les causes, ne projetaient que des lueurs incertaines et confuses sur la nature des réformes qu'il s'agissait d'opérer et sur la manière de les opérer. D'un autre côté, aucune nécessité immédiate et impérieuse ne pressait sur le roi pour le déterminer à s'engager dans une voie nouvelle, dont ses traditions, son éducation et les influences de son entourage devaient l'éloigner, et qui a'était pas même clairement tracée.
Il ne faut pas oublier qu'à mesure que l'État s'était agrandi et qu'il avait été moins exposé à la pression et aux risques de la concurrence politique et guerrière, le roi, sa maison et son entourage ne ressentaient plus qu'indirectement, et à la longue, les conséquences d'une gestion inhabile et routinière de ce colossal établissement. Une guerre improductive ou même désastreuse, une calamité quelconque qui appauvrissait les populations, augmentait les dettes ou diminuait les revenus de l'Etat, n'atteignait pas sensiblement dans leur bien-être le roi, sa famille et ses courtisans. Si l'on mangeait du pain bis à la cour de Versailles, aux époques de famine, c'était par pur respect humain et sans y être obligé par une nécessité réelle. C'est pourquoi on se laissait aller, avec une facilité imprévoyante, à s'engager dans des guerres coûteuses, en vue de satisfactions purement morales, augmentation du prestige et de la gloire de la « maison », abaissement de [298] l'orgueil des maisons rivales, et on ne se résignait à y mettre un terme qu'après une longue accumulation de revers. La guerre était demeurée d'ailleurs presque l'unique débouché de la noblesse qui entourait le roi. Cette noblesse, dépouillée de ses domaines politiques et réduite à l'oisiveté, ne trouvait plus que sur les champs de bataille une occasion de déployer son activité, d'acquérir de la réputation et de mériter des récompenses. [46] Elle constituait un parti naturel de la guerre. Elle y poussait constamment le souverain, qui y était porté lui-même par son éducation et ses traditions. Enfin, le développement du crédit, conséquence des progrès de l'industrie, lui donnait à cet égard des facilités nouvelles et croissantes. Les guerres se multiplièrent sans nécessité dans le courant du xviie et du xviiie siècle, d'abord sous des mobiles de rivalité dynastique; ensuite et en dernier lieu, lors de la révolution américaine, sous l'impulsion sentimentale de la philanthropie politique du jour; elles eurent pour résultat de [299] créer une série de déficits qui allèrent s'accumulant et finirent par embarrasser sérieusement les finances. Une autre cause d'embarras s'ajoutait à celle-là. La dépossession de la féodalité seigneuriale avait eu pour résultat de réunir autour du souverain les héritiers des maisons dépossédées. En compensation de la clientèle politique qu'il leur avait enlevée, il leur avait distribué de grands emplois, des charges honorifiques et autres sinécures. La « cour » était devenue de plus en plus nombreuse et fastueuse, et elle constituait 'pour les finances de l'Etat une charge de plus en plus lourde. Le roi distribuait les grâces et les faveurs, et il lui était bien difficile de les refuser à ses favoris et à ses favorites. Que lui coûtaient-elles? Une signature. Cependant, à la longue, les embarras financiers, provenant de ces deux causes, étaient devenus tellement pressants qu'il fallut bien aviser aux moyens d'y rémédier. Ces moyens étaient de deux sortes : 1° on pouvait réduire les dépenses, mais aussitôt qu'on essuyait de recourir à ce procédé, on se trouvait en présence de la coalition de tous ceux qui vivaient, dûment ou indûment, aux dépens de l'Etat; 2° on pouvait augmenter les recettes, en imposant à la nation un supplément de charges. Certes, la nation était assez riche, — l'expérience l'a prouvé plus tard, — pour supporter ce fardeau supplémentaire. Mais les progrès de l'industrie, de la richesse et de l'instruction, — instruction encore fort incomplète et trop mélangée d'ivraie, — avaient créé des foyers de mécontentement et do résistance qui rendaient dangereux un accroissement d'impôts et faisaient hésiter à y recourir, sans le consentement des imposés. Tandis que la noblesse, en possession héréditaire de la plupart des grands emplois, des sinécures et d'un restant de privilèges en matière d'impôts, s'était déconsidérée eu passant à l'état de domesticité de cour et qu'elle avait perdu son influence locale en désertant ses châteaux [300] pour le séjour de Versailles, [47] enfin s'était appauvris, malgré les faveurs et les privilèges dont elle jouissait, [48] par suite de la diminution des profits de la guerre, les progrès de l'industrie avaient fait croître en nombre, en richesse, en influence et aussi en appétits, la classe moyenne. Celle-ci supportait avec impatience la [301] suprématie artificielle de la noblesse, — suprématie que ne justifiaient plus ni la supériorité des services, ni celle de la richesse. Parmi les mécontents, les uns aspiraient simplement à prendre part à l'exploitation de l'État, les autres réclamaient, avec une répartition plus équitable des charges publiques, l'abolition des servitudes politiques et économiques et l'établissement d'un régime de liberté et de paix. La passion des réformes s'était emparée des esprits, et il eût fallu au roi une énergie et une science qui lui faisaient également défaut pour contenir et diriger ce mouvement qu'il n'était point en son pouvoir d'arrêter. En désespoir de cause, il eut recours à la convocation d'une assemblée des délégués de la nation, expédient [302] auquel les esprits les plus éclairés attribuaient volontiers la vertu d'une panacée, mais qui devait simplement hâter l'explosion révolutionnaire.
§ 5. Pourquoi la réunion de f Assemblée nationale devait conduire à la révolution. — Nous avons comparé la situation du roi, propriétaire de l'État, en présence des délégués de la nation, à celle d'un chef d'industrie menacé par une coalition d'ouvriers. Reprenons et développons cette comparaison. Aussi longtemps qu'un chef d'industrie demeure le maître de fixer à son gré le taux des salaires, de régler la durée et les conditions du travail dans ses ateliers, sans que ses ouvriers s'avisent de résister à ses décisions ou de s'y soustraire, sa situation est considérée à bon droit comme fort enviable. S'il n'abuse point de son pouvoir, s'il fournit à ses ouvriers une rétribution proportionnée à leurs efforts, si ses règlements d'atelier sont judicieux et équitables, cette situation pourra se prolonger longtemps. Mais un moment arrive où, à tort ou à raison, les ouvriers trouvent que leur salaire est trop bas, la durée du travail trop longue, le règlement de l'atelier injuste et oppressif. Ils se coalisent alors pour donner plus de poids à leurs réclamations, sachant par expérience qu'elles ne seraient pas écoutées si elles étaient présentées isolément, et ils nomment des délégués pour exposer leurs griefs et leurs prétentions et les faire prévaloir. Si des deux côtés on est animé d'un désir sincère de conciliation, si l'entrepreneur d'industrie n'est point dominé par un esprit d'orgueil et de rapacité, s'il ne considère point les ouvriers comme des bêtes de somme dont il peut user et abuser à sa guise; si les ouvriers à leur tour sont modérés et raisonnables, s'ils tiennent compte des conditions nécessaires d'organisation d'une entreprise et des exigences de la concurrence, on réussira peut-être à s'entendre. L'entrepreneur fera des concessions sur le salaire et la durée du travail et [303] réformera ce qu'il peut y avoir d'abusif dans le règlement de l'atelier; les ouvriers, de leur côté, renonceront à celles de leurs prétentions qui seraient reconnues incompatibles avec le bon fonctionnement de l'entreprise et ruineuses pour l'entrepreneur. Malheureusement, la modération et l'équité ne sont point les caractères dominants de l'esprit humain. Il n'est que trop probable qu'on ne parviendra pas à se mettre d'accord, surtout si de part et d'autre on est également obstiné et ignorant. Le conflit s'envenimera au lieu de s'apaiser et les deux parties lutteront jusqu'à ce que la plus faible soit contrainte à céder. Si l'entrepreneur l'emporte, il obligera ses ouvriers à rentrer à l'atelier aux anciennes conditions ou même à des conditions plus dures; si les ouvriers ont l'avantage, ils l'obligeront à subir les leurs, fussent-elles incompatibles avec la bonne gestion de l'entreprise; ils exigeront, par exemple, le renvoi de certains contre-maîtres et leur remplacement par des hommes de leur choix. Le conflit subsistera alors à l'état latent; on se fera une guerre sourde et implacable : l'entrepreneur rêvant d'asservir les ouvriers, les ouvriers de déposséder l'entrepreneur et d'exploiter eux-mêmes l'usine après l'avoir confisquée.
Telle fut la lutte pleine de péripéties dramatiques qui ne manqua pas de s'engager entre le roi et les délégués de la nation, malgré leur désir réciproque d'entente mutuelle. Mais des deux côtés les prétentions étaient inconciliables, et l'évènement a prouvé qu'elles étaient particulièrement déraisonnables du côté de l'Assemblée et incompatibles avec la bonne gestion de l'Etat. L'entente étant devenue impossible, les deux parties firent appel à la force. La force décida contre le roi. L'usine politique fut confisquée, déclarée propriété nationale et mise en exploitation pour le compte et au profit de la nation. C'était une révolution; était-ce un progrès?
[304]
III. Rétrogression produite par la révolution. — § 1er. Récapitulation des cotises de ce phénomène. A ne se fier qu'aux apparences, la nationalisation de l'État devait être aussi conforme que possible à l'intérêt des consommateurs politiques et constituer un progrès manifeste du gouvernement des sociétés. Désormais, en effet, l'État cesserait d'être exploité au profit d'une « maison »; la nation, devenue propriétaire de l'État, ne manquerait pas de le gérer au mieux de ses intérêts en s'attribuant à elle-même les profits de cette gestion au lieu de les abandonner à la maison exploitante. Ces profits, elle pourrait à son gré les répartir entre ses membres ou diminuer le prix des services publics, de manière à rembourser simplement les frais nécessaires pour les produire. Telles étaient les apparences, mais l'évènement allait prouver combien elles différaient des réalités.
A un souverain individuel dirigeant lui-même d'une manière permanente la gestion de l'État et intéressé au plus haut point à le bien gérer, qui pouvait sans doute être incapable et vicieux, mais qui appartenait à une famille élevée au-dessus de toutes les autres par sa situation, son éducation et ses traditions et dont les facultés et les aptitudes professionnelles se transmettaient et s'accumulaient par l'hérédité et les alliances avec les autres familles politiques, qui avait pour auxiliaire un haut personnel formé dans des conditions analogues; à ce souverain individuel qui avait été, en fait, dans le cours des siècles, et, malgré les défaillances de la transmission héréditaire, au-dessus de la moyenne de ses contemporains, succédait un souverain collectif de 25 millions d'individus dont l'immense majorité était absolument dépourvu des aptitudes et des connaissances nécessaires à la direction d'un État; qui se trouvaient d'ailleurs dans l'impossibilité matérielle de le gérer par eux-mêmes et qui étaient appelés [305] cependant à supporter tout le poids de la responsabilité de cette gestion bonne ou mauvaise. C'était une première cause de rétrogression et elle devait en engendrer un autre, savoir : la constitution et la lutte des partis pour la possession et l'exploitation de l'État.
En présence de l'impossibilité où se trouve une nation de gérer elle-même son État politique, la constitution d'associations politiques pour le gérer à sa place est une nécessité, et nous avons vu qu'à l'époque de l'avènement de la petite industrie, elle a été une application utile du principe de la division du travail et de la spécialisation des fonctions. Groupant et associant dans leurs cadres les hommes que leurs aptitudes et leurs connaissances particulières attirent vers les différentes branches de l'industrie du gouvernement, comme d'autres sont attirés vers l'agriculture, l'industrie manufacturière ou minière, le commerce et les beaux-arts, les partis concentrent les éléments propres à la gestion de l'État et les préparent à cette gestion. Malheureusement, si leur intérêt permanent est conforme à celui de la nation, il n'en est pas de même de leur intérêt immédiat, et ils subissent des nécessités qui les obligent à sacrifier le premier au second.
Sans doute, les partis politiques sont intéressés à la grandeur et à la prospérité de la nation dont ils font partie et à laquelle leur destinée est attachée. Mais cet intérêt est lointain, et il est d'ailleurs plus faible que ne l'était celui du souverain de l'ancien régime, car ce dernier avait la jouissance continue et perpétuelle de l'exploitation de l'État, tandis qu'ils n'ont qu'une éventualité aléatoire et temporaire d'en jouir. Plus cette éventualité est incertaine et courte, moins ils ont de chances de s'emparer de la gestion de l'État ou de la conserver longtemps; moins la considération de l'intérêt général et permanent de la nation agit sur leur conduite, plus ils sont [306] disposés à le sacrifier à leur intérêt immédiat et particulier. Or cet intérêt est naturellement en opposition avec l'intérêt général et permanent de la nation. Cette opposition tient, en premier lieu, à ce que les associations politiques ou les partis constitués en vue de la gestion de l'Etat sont des producteurs, en exercice ou en expectative, de services publics, tandis que la nation se compose de l'ensemble des consommateurs de ces services. Elle tient, en second lieu, aux nécessités qu'ils subissent. Tout parti se recrute principalement dans une classe particulière de la nation, ayant ses passions, ses préjugés et ses intérêts distincts de ceux des autres classes. Ces intérêts, ces préjugés et ces passions, le parti est obligé de les servir, sous peine d'être renié et abandonné par le groupe dont il est issu et avec lequel il doit compter périodiquement, aux époques où le souverain sort de son immobilité passive pour élire ses mandataires. S'ils sont en opposition avec l'intérêt général, c'est tant pis pour l'intérêt général! D'un autre côté, la puissance d'un parti et ses chances de conserver la gestion de l'État ou de l'enlever à ses concurrents dépendent du nombre, de l'influence et de l'activité de ses adhérents. C'est une armée que son intérêt est de grossir, et surtout de maintenir dévouée, fidèle et ardente à la lutte. Or l'expérience démontre que le dévouement, la fidélité et l'ardeur d'un parti sont toujours proportionnés à l'importance des bénéfices que la victoire peut lui procurer. D'où la nécessité de multiplier les places, d'augmenter les appointements, les gratifications et les pensions qui y sont attachés, tout en allégeant ou en laissant s'alléger le poids des services qui ont été le motif ou le prétexte de leur création. N'est-il pas bien naturel d'ailleurs que le fonctionnaire ou l'employé subordonne ses devoirs envers le public à ses obligations envers le parti auquel il est redevable de sa position, et dont la défaite aurait pour résultat de la lui faire perdre? Ajoutons que, dans la [307] lutte pour la possession de l'État, l'ardeur des compétiteurs est d'autant plus excitée et le conflit plus furieux, non seulement que le butin a une valeur plus grande, mais encore que la distance est plus forte entre la situation sociale des compétiteurs, les moyens d'existence qu'ils possèdent ou qu'ils peuvent espérer de posséder en dehors de l'exploitation de l'Etat, et la situation, la fortune et les honneurs que celte exploitation peut leur valoir. Si l'on tient compte enfin des passions violentes que toute lutte engendre et développe, on s'explique qu'aucune considération tirée de l'intérêt général et lointain de la nation n'exerce une influence appréciable sur les compétiteurs.
Si l'on veut bien ne pas perdre de vue ces observations sur la nature du propriétaire collectif que la révolution a substitué à la maison royale, et sur celle des partis qui allaient se disputer la gestion de l'État, on s'expliquera qu'au lieu d'un progrès continu des institutions politiques cette révolution ait engendré une rétrogression non moins continue.
§ 2. Marche rétragressive de la révolution jusqu' à nos jours. On avait transféré à la nation la propriété de l'État, mais il fallait organiser la gestion de cette propriété; il fallait constituer le gouvernement de la nation par elle-même. En attendant l'accomplissement de cette œuvre chimérique, l'association politique qui avait renversé la monarchie et conquis l'État, avec l'auxiliaire du peuple de Paris, et sous l'influence de laquelle la Convention des mandataires constituants avait été élue, cette association victorieuse demeurait maîtresse de_l'État. D'abord unie contre l'ennemi commun, elle ne manqua pas de se diviser après la victoire, chacune de ses fractions ou coteries prétendant à la possession exclusive du gouvernement de la France. De là, la lutte qui s'engagea entre elles, parallèlement à celle qu'elles poursuivaient ensemble contre les partisans de la monarchie [308] dépossédée. On s'étonne, au premier aspect, de la violence furieuse de cette double lutte et des excès abominables qui l'ont souillée, mais cet étonnement se dissipe lorsqu'on considère la valeur énorme de la proie que les fractions concurrentes du parti révolutionnaire se disputaient ou qu'elles défendaient contre les revendications de ses anciens propriétaires et de leurs co-intéressés. Il s'agissait d'une propriété d'une valeur de plusieurs milliards, dont le revenu annuel, malgré les brèches que la révolution y avait faites, dépassait encore 500 millions, qui procurait à ses détenteurs les situations les plus hautes et les plus lucratives, réservées jusqu'alors à une classe réputée supérieure et enveloppée d'une sorte de prestige mystique. Aux politiques de sentiment et aux utopistes, la possession de l'État conférait le pouvoir d'appliquer leurs systèmes de régénération politique et sociale et de faire ainsi à jamais le bonheur de la nation et de l'humanité; pour les ambitieux, les cupides et les vaniteux, elle contenait une source inépuisable de puissance, de profits et d'honneurs; bref, la possession de l'État renfermait de quoi satisfaire tous les désirs de l'âme humaine, depuis les passions les plus nobles jusqu'aux appétits les plus bas. Comment la compétition autour d'une telle proie n'eut-elle pas été poussée à l'extrême quand on songe avec quelle âpreté, quel acharnement et quelle absence de scrupules, les hommes se disputent la moindre parcelle de propriété ou le moindre avantage social? On s'explique donc que, dans cette lutte à outrance, tous les moyens aient été mis en usage :proscriptions, émeutes, massacres avec ou sans les formes de la justice, guerre civile, recours à l'intervention étrangère, coups d'Etat, etc. ; on s'explique aussi que le parti en possession de l'État n'ait pas hésité à puiser à discrétion dans le réservoir des forces et des ressources de la nation, — forces et ressources dont l'immensité était par parenthèse à [309] l'honneur de l'ancien régime, — et à employer les procédés .les plus tyranniques et les plus odieux pour la contraindre à les lui livrer. Mais ne devait-il pas arriver qu'après quelques années de ces luttes et de ces procédés barbares, la nation épuisée et meurtrie prît en horreur une révolution entreprise pour établir la liberté et la paix et qui n'aboutissait qu'à une recrudescence de tyrannie et de guerre, d'oppression et de misère?
C'est à ce moment psychologique qu'eut lieu le coup d'Etat du 18 brumaire, suivi de l'établissement d'une dictature militaire et administrative. Cette dictature répondait à un besoin général en ce qu'elle mettait fin à la lutte violente et ruineuse des partis, tout en garantissant les situations et les propriétés acquises per fas et nefas dans le cours de la révolution. Mais, établie au moyen de l'armée et appuyée sur l'administration, elle ne pouvait se maintenir qu'en donnant à ces deux corporations une prépondérance décisive et en les attachant au dictateur parles liens solides de l'intérêt. D'où la nécessité d'accroître leurs « débouchés » au moyen de guerres et de conquêtes, qui augmentaient leur prestige et leurs profits. Mais la guerre et la conquête sont des industries aléatoires. Les revers succédèrent aux victoires, l'armée fut vaincue et le dictateur mis dans l'impossibilité de recommencer aux dépens de l'Europe son industrie déprédatrice. L'Etat se trouva alors à la disposition de la coalition des vainqueurs. En présence de l'impossibilité de s'accorder sur le partage de ce magnifique domaine politique, [49] ils en restituèrent la nue propriété [310] à la maison de France, mais à la condition d'admettre les mandataires de la nation à participer à sa gestion, s'imaginant ainsi assurer la paix intérieure par la conciliation des intérêts de l'ancien régime avec ceux de la révolution. L'évènement ne devait pas tarder à faire justice de cette illusion. Les partis politiques que la dictature impériale avait dissous ou réduits à l'impuissance se réorganisèrent en vue de s'attribuer la participation à la gestion de l'État que la « Charte » concédait à la nation, représentée par le corps électoral et ses mandataires. Ces partis qui occupèrent la scène politique de la Restauration se recrutaient dans les deux éléments qui composaient presque [311] exclusivement le corps électoral : l'aristocratie terrienne et l'étatmajor bourgeois de la haute industrie et des professions militaires, administratives ou libérales; l'un, le parti conservateur et royaliste, représentait principalement les intérêts de la classe gouvernante de l'ancien régime; l'autre, le parti libéral, était l'expression de ceux de la classe gouvernante issue de la révolution.
Dans la première période de la révolution, la lutte des partis pour la conquête et l'exploitation de l'État s'était pratiquée d'une manière sauvage, au mépris des usages que l'expérience avait conduit à faire adopter ailleurs, comme avantageux aux belligérants, de même qu'elle avait fait mettre en vigueur un ensemble d'usages qui avaient sensiblement diminué les maux de la guerre. Sous la Restauration, on commença à observer régulièrement ces pratiques nouvelles, empruntées à l'Angleterre, en concentrant la lutte sur le terrain électoral et parlementaire; en renonçant, avec plus ou moins de sincérité, aux conspirations, aux émeutes et aux autres coups de force. Comme dans le cas de la guerre ordinaire, l'adoption de ces pratiques constitutionnelles et parlementaires procura aux populations un soulagement manifeste; 1tss intérêts cessèrent d'être perpétuellement sur le qui-vive; ils n'étaient plus affectés que faiblement par des articles de journaux et des discours qui aboutissaient à des votes et non plus à des coups de fusil. Les consommateurs politiques n'en faisaient pas moins les frais de cette lutte civilisée, dont le résultat, quel qu'il fût, ne pouvait amener qu'une augmentation de leurs charges. Le corps électoral étant étroitement limité, les charges budgétaires ne s'accrurent toutefois qu'avec une certaine lenteur; en revanche, les deux partis concurrents, en désaccord sur tout le reste, s'entendirent pour exhausser artificiellement, au moyen des tarifs de douane, les rentes des propriétaires fonciers et les profits des chefs [312] d'industrie, qui constituaient les élémens prépondérants du corps électoral.
Cependant, les deux partis de plus en plus excités par la lutte ne se piquèrent point d'observer scrupuleusement ce qu'on pourrait appeler les lois de la guerre politique. Le parti libéral voulait quelque chose de plus qu'une simple participation à la gestion de l'Etat, il voulait cette gestion tout entière et il conspirait le renversement de ce qui restait du pouvoir royal de l'ancien régime, tout en l'acceptant en apparence; le parti royaliste ou conservateur voulait reconquérir cette gestion, et l'assurer d'une manière permanente à la classe que la révolution en avait dépossédée. Or comme les progrès de l'industrie qui déjà, avant 1789, avaient porté la richesse et l'influence de la classe moyenne presque au niveau de celles de la noblesse et de l'Église établie continuaient plus activement que jamais à les accroître, comme l'élément libéral devenait de jour en jour plus nombreux et plus fort, le parti royaliste aux abois essaya de ressaisir, au moyen d'un coup d'Etat, la direction des affaires qui lui échappait. Le coup d'Etat échoua et le parti libéral y répondit par la révolution de Juillet 1830. La co-propriété de la maison royale dans la gestion de l'État lui fut enlevée, malgré les efforts détournés du nouveau roi pour la retenir, et le corps électoral fut élargi en vue d'assurer la prépondérance politique de la portion supérieure et moyenne de la bourgeoisie et de fixer désormais entre ses mains l'exploitation de l'Etat. La classe exploitante étant devenue plus nombreuse par le fait de l'adjonction d'éléments inférieurs, il fallut augmenter le volume et les profits de l'exploitation, les attributions de l'Etat se développèrent, les emplois se multiplièrent, les dépenses publiques s'accrurent; tandis que le personnel exploitant, recruté dans une couche sociale dont la moyenne était plus basse, deve-. nait inférieur en qualité et rendait de moins bons services. [313] Cependant, le parti vainqueur s'était divisé après la victoire et ses fractions concurrentes se disputaient la proie conquise en commun, tout en se réunissant pour la défendre contre les retours offensifs des vaincus, désormais de moins en moins redoutables. En outre, les profits grossissants d'une exploitation qui allait tous les jours s'étendant et se ramifiant davantage excitaient l'envie des classes exclues du festin; elles demandaient à y prendre part, et elles fournissaient le contingent d'un parti extra-constitutionnel, rattaché par ses origines à la république jacobine. Le gouvernement, s'obstinant à refuser d'admettre au concours légal pour la possession de l'État une portion, si petite qu'elle fût, de ces classes exclues, elles eurent recours aux moyens révolutionnaires dont leur état-major politique, quasi héréditaire, [50] conservait la tradition; à la monarchie constitutionnelle, avec suffrage limité, succédèrent, en 1848, la république et le suffrage universel.
A partir de ce moment, la propriété de l'Etat et le droit de la gérer appartinrent tout entiers à la nation et aucune barrière artificielle ne s'opposa plus à la participation des éléments sociaux inférieurs à l'exploitation de la « chose publique ». De là, un nouveau fractionnement des partis avec un élargissement de leurs cadres. La couche supérieure de la bourgeoisie, réunie à l'aristocratie et au haut clergé dans l'intérêt de la défense commune, fournit le contingent du parti conservateur; le parti républicain modéré se recruta principalement dans la région moyenne de la bourgeoisie; enfin, le parti démocrate et socialiste trouva ses éléments dans la couche inférieure de la bourgeoisie et dans la couche supérieure des masses ouvrières. Entre ces [314] partis reconstitués et accrus, la lutte pour la possession de l'État recommença bientôt plus ardente que jamais, sans aucun souci, cette fois, des lois de la guerre politique. Les agitations populaires et l'insurrection de Juin jetèrent l'épouvante parmi les intérêts conservateurs, épouvante redoublée par l'annonce à grand fracas d'une revanche pour 1852. Alors apparut l'héritier de l'homme qui avait mis fin à l'anarchie de la première période révolutionnaire. Un coup d'État rétablit la dictature impériale par l'intervention de l'armée, les partis furent dispersés et, réduits à l'impuissance sinon dissous. Cette dictature, l'immense majorité de la nation l'avait acceptée comme un moyen d'en finir avec une lutte politique dont elle redoutait peut-être plus que de raison l'issue, car la force réelle de la démocratie socialiste ne répondait point à ses prétentions bruyantes, mais sans prévoir de quel prix elle s'exposait à la payer. Appuyée, comme sa devancière, sur l'armée et l'administration qui pouvaient seules lui fournir la force nécessaire pour dominer les partis, les empêcher de se reconstituer et de prendre leur revanche, la seconde dictature était obligée avant tout de compter avec les intérêts administratifs et militaires. Pour satisfaire l'administration, il fallait étendre ses attributions et augmenter ses appointements. Pour satisfaire l'armée ou du moins son état-major professionnel, il fallait faire la guerre. Quel que fût son goût naturel pour la paix, la guerre s'imposait au dictateur. Aussi longtemps que ses entreprises militaires furent couronnées de succès, sa situation demeura intacte. Néanmoins il comprenait ce que l'appui exclusif de l'armée et de l'administration avait de dangereux et de précaire, et il entreprit de se concilier les partis, en rouvrant l'arène parlementaire et en offrant ainsi, de nouveau, à leurs compétitions, la proie de l'exploitation de l'État, sous la seule condition d'accepter sa reprise de possession dynastique. [315] Les partis demeurant irréconciliables, le dictateur eut recours à une guerre, qui lui aurait rendu, en cas de succès, un ascendant irrésistible mais dont l'issue funeste le laissa sans appui, à la merci des partis coalisés pour le renverser.
Depuis la chute de la dictature impériale et le rétablissement d'un gouvernement constitutionnel et parlementaire sous la forme républicaine, les partis ont subi un nouveau fractionnement, correspondant toujours aux groupes d'intérêts dont ils sont issus et où ils se recrutent. On peut distinguer le parti légitimiste fusionné maintenant avec le parti orléaniste, le parti bonapartiste, le parti républicain opportuniste, le parti républicain radical, le parti communaliste et socialiste, divisé en un certain nombre de groupes : collectivistes, possibilistes, anarchistes ou nihilistes. Chacun de ces partis et même de ces groupes aspire à la possession exclusive de l'État, mais ils ont des affinités naturelles qui les poussent à se coaliser en vue d'un intérêt commun. C'est ainsi que, dans les moments de crise, on voit les partis et les groupes conservateurs recrutés dans les régions supérieure et moyenne de la nation, avec un appoint de transfuges républicains et socialistes, se coaliser contre les partis et les groupes radicaux, communeux, anarchistes, recrutés dans la petite bourgeoisie et la classe ouvrière avec l'appoint des déclassés et des mécontents venus des régions plus élevées. En observant cette composition et ces affinités des partis qui occupent actuellement la scène, on peut se faire une idée approximative de la marche ultérieure de la révolution.
§ 3. Marche ultérieure de la révolution. — En voyant s'abaisser puis disparaître les barrières qui excluaient la masse de la nation de la compétition légale à la gestion de l'Etat, les classes en possession de cette gestion ont d'abord été saisies de crainte. Il semblait, en effet, que les [316] classes inférieures dussent infailliblement, en vertu de la supériorité de leur nombre, l'emporter dans les luttes politiques. Cependant l'expérience n'a pas tardé à démontrer que le nombre n'est qu'un des éléments et non le plus considérable de la puissance. Dans la balance des forces qui procurent la suprématie politique, il faut compter non seulement les valeurs personnelles, mais encore les valeurs mobilières et immobilières et avoir égard, de plus, à l'inégalité naturelle des facultés morales et des connaissances qui entrent, avec les forces purement physiques, dans la composition des valeurs personnelles. En faisant l'addition de ces différentes valeurs, on peut constater aisément que la somme de puissance dont les classes supérieure et moyenne disposent est incompara.blement plus grande que celle qui se trouve investie dans la classe inférieure, et qu'il leur suffit, par conséquent, de demeurer unies pour défier la supériorité du nombre. L'expérience, disons-nous, l'a prouvé depuis le début même de la révolution jusqu'à nos jours : que le système électoral fût plus ou moins étroitement limité par le cens ou sans autre limite que celle de la majorité civile, les classes supérieure et moyenne sont toujours demeurées maîtresses du terrain; jamais les partis recrutés dans les régions inférieures n'ont pu réunir plus du quart des suffrages de la nation souveraine. Aussi, malgré le caractère égalitaire du suffrage universel, quoiqu'il ne tienne aucun compte de l'inégalité des valeurs électorales, — mais sans pouvoir détruire l'inégalité des influences résultant de l'inégalité des valeurs, — les partis radicaux et socialistes ont parfaitement compris qu'il leur serait, pendant bien longtemps encore, impossible de s'emparer de l'État par des moyens constitutionnels et parlementaires. On peut donc prévoir qu'à la première occasion favorable, ils auront recours, comme en juin 1848 et en mars 1871, [317] aux moyens révolutionnaires. Alors les classes supérieure et moyenne sentiront encore une fois la nécessité de faire trêve à leurs divisions en se soumettant à une dictature, au moins jusqu'à ce qu'elles croient n'avoir plus rien à craindre. Mais, dans l'intervalle, sous l'influence sans cesse grandissante de la transformation industrielle, la proportion des valeurs investies dans les différentes couches sociales se modifiera peu à peu à l'avantage des couches inférieures, et un moment viendra où la balance des forces penchera du côté des masses populaires. Aussitôt, et quels que soient les efforts des partis conservateurs ou de la dictature qu'ils auront réinstallée, l'État tombera entre les mains de la démocratie socialiste. L'État ouvrier succédera à l'Etat bourgeois, comme celui-ci a succédé à l'Etat aristocratique et clérical. Le quatrième État, ainsi que le désignent les théoriciens collectivistes, sera exploité au profit des intérêts particuliers et immédiats des masses ouvrières. Selon toute apparence aussi, il sera d'abord géré par une dictature appuyée sur la démocratie armée, en vue de parer aux retours offensifs des classes dépossédées. Car celles-ci, devenues impuissantes à recouvrer la possession de l'État par les voies légales, ne se feront point scrupule de recourir à leur tour aux moyens révolutionnaires jusqu'à ce qu'elles soient définitivement écrasées et annihilées. Ce sera la fin de la révolution, en admettant que la nation ait pu supporter jusque-là le poids de plus en plus alourdi de l'exploitation de l'État, qu'elle n'ait pas péri, affaiblie et exténuée, sous la pression de la concurrence internationale.
Nous avons constaté, en effet, que la lutte engagée entre les partis politiques pour l'exploitation de l'Etat devait avoir pour résultat inévitable d'accroître progressivement le volume et le poids de cette exploitation. Aussi longtemps que le corps électoral a été limité par le cens, [318] le personnel des partis est demeuré peu nombreux, et, pour nous servir d'une expression caractéristique de l'auteur de l' Essai sur le principe de la population, il n'a pressé que modérément sur ses moyens de subsistance. La nécessité d'augmenter le butin qui les lui fournissait était peu sensible, et, d'un autre côté, la qualité de ce personnel recruté dans les régions supérieures ne s'abaissait que lentement, dans la proportion assez faible de l'accroissement du corps électoral. Mais, aussitôt que les barrières ont été renversées, — et pouvaient-elles ne pas l'être en présence des nouvelles couches sociales qui prétendaient avoir leur part de la curée? — les armées politiques se sont soudainement grossies, et il a bien fallu augmenter leurs moyens de subsistance. C'est ainsi que depuis la révolution de Juillet et surtout depuis l'avènement du suffrage universel, le volume et le poids de l'Etat n'ont pas cessé de croître, tandis que la qualité du personnel politique et administratif allait s'abaissant. Ce mouvement de rétrogression ne manquera pas de s'accélérer à mesure que la compétition pour une proie devenue plus riche se fera plus ardente et que des, compétiteurs plus nombreux et besogneux y prendront part. Il y a apparence qu'il arrivera à son maximum d'accélération sous la domination du quatrième Etat. Alors, l'État absorbant toutes les branches de la production, et ses prix de revient dépassant ceux des industries libres des pays concurrents, il faudra de toute nécessité assujettir au travail forcé avec un minimum de subsistance une partie de la nation, probablement la population des campagnes, frappée d'incapacité politique; en un mot, il faudra rétablir l'esclavage. Ce sera le dernier terme du progrès révolutionnaire.
IV. Influence rétrograde de la révolution sur les sciences morales et politiques. — § 1er. Sur la science de lapolitique. — Nous avons constaté que l'acte décisif de la révolution a [319] été la confiscation de l'État au profit prétendu de la nation. L'Etat, avec toutes ses altenanccs et dépendances, a cessé d'être la propriété de la maison royale pour devenir une propriété nationale. Cette confiscation ne pouvait être justifiée que par la théorie de la souveraineté du peuple. La révolution n'était légitime qu'à la condition que le peuple fût souverain. S'il ne l'était point, il n'avait aucunement le droit de mettre la main sur l'Etat; la révolution n'était qu'un attentat criminel, un acte de pur brigandage, dont le propriétaire légitime de l'État avait le droit et même le devoir de punir les auteurs, le jour où il rentrerait en possession de son héritage. Le principe de la souveraineté du peuple était donc la base nécessaire du droit public de la révolution. C'est pourquoi il a été adopté comme un dogme indiscutable par tous les théoriciens du nouveau régime. Ce principe admis, il ne s'agissait plus que de chercher le meilleur mode de gouvernement d'une nation par ellemême. Tels étaient désormais le but que devaient poursuivre, et les limites dans lesquelles devaient se renfermer les recherches et les inventions des hommes qui cultivaient la politique soit comme une science, soit comme un art. Les législateurs de la Convention s'évertuèrent d'abord à résoudre ce problème insoluble. Insoluble, disons-nous, car il consistait à adapter à une nation moderne, au début de l'évolution de la grande industrie, les institutions des petites communautés du premier âge de l'humanité. Ils ne manquèrent pas d'y échouer, et la première constitution sortie de leurs mains fut déclarée par eux-mêmes sinon inapplicable, du moins incompatible avec les « nécessités » de l'état révolutionnaire. Le but assigné aux théoriciens et aux législateurs politiques n'en restait pas moins de découvrir ou d'inventer la constitution et les lois les plus conformes aux intérêts de la nation souveraine.
Cependant la nation souveraine était une simple fiction; [320] la réalité, c'étaient les partis organisés en vue de s'emparer de l'Etat et de l'exploiter à leur profit, en ne laissant à la nation, identifiée dans un corps électoral façonné, délimité et réglementé par eux-mêmes, d'autre droit que de choisir entre eux, dans des conditions et à des intervalles également fixés par eux. Or quel était le premier intérêt de chacun de ces partis concurrents? C'était de trouver et d'établir le système politique le plus propre à lui assurer, aussi longtemps que possible sinon à perpétuité, la possession exclusive de l'État, en annihilant ou tout au moins en affaiblissant les chances de ses compétiteurs. Voilà le problème sur lequel se sont concentrés l'attention et les efforts des théoriciens et des praticiens enrégimentés au service des partis. Sans doute, quelques hommes de bonne volonté ont continué de cultiver la science politique pour elle-même, en se plaçant au point de vue de l'intérêt général, mais leurs conceptions devaient rester à l'état de simples utopies, elles n'avaient aucune chance raisonnable d'être appliquées, car l'intérêt général n'a point de force organisée à son service. Si l'on inventorie les œuvres de la science et de l'art de la politique depuis la Révolution française, que trouve-t-on? Des théories et des systèmes, des constitutions et des lois de parti.
Après avoir essayé en vain de ressusciter l'ancien droit public, les théoriciens de la monarchie, de la noblesse et du clergé dépossédés ont subi sinon accepté le droit révolutionnaire, en s'efforçant de l'adapter aux intérêts aristocratiques et cléricaux. — La nation est souveraine, soit! disentils; mais son intérêt bien entendu, en tenant compte de son tempérament, de son histoire et de sa situation géographique, ne lui commande-t-il pas de confier ses destinées à la monarchie traditionnelle? Elle est souveraine, mais présente-t-elle, dans tous ses éléments, les garanties de conservation, les lumières et la moralité nécessaires pour [321] assurer le bon choix de ses mandataires? N'est-il pas indispensable, dans l'intérêt de l'ordre public, de la stabilité de l'Etat et de la préservation sociale, de concentrer dans les régions supérieures le droit électoral? Ne convient-il pas encore, en vue des mêmes intérêts, de limiter le pouvoir des représentants du corps électoral, en les obligeant à le partager avec un corps aristocratique héréditaire ou à la nomination du roi? — Sur quelques-uns de ces points les théoriciens de la classe moyenne sont d'accord avec les précédents ; sur d'autres, au contraire, ils sont en complète dissidence. S'ils s'accommodent de la monarchie, c'est à la condition d'annuler le pouvoir royal, en faisant prévaloir la maxime que « le roi règne et ne gouverne pas », la monarchie étant par ses origines et ses affinités naturellement portée à s'appuyer de préférence sur la noblesse et le clergé. S'ils considèrent, eux aussi, la limitation du droit électoral comme indispensable, c'est dans la mesure et avec les conditions les plus propres à assurer la prépondérance des partis issus de la classe moyenne. — Les théoriciens de la démocratie repoussent la monarchie, comme naturellement inféodée aux classes supérieures, et ils étaient naguère d'accord pour préconiser le suffrage universel. Toutefois, le suffrage universel ayant trompé leurs prévisions en donnant la majorité aux influences plutôt qu'au nombre, les plus avancés s'accordent aujourd'hui pour concentrer l'exercice du droit politique entre les mains du peuple des grandes villes, investi d'une sorte de dictature révolutionnaire. — Sur ce point, ils ne s'éloignent pas sensiblement des théoriciens de l'impérialisme, qui délèguent le pouvoir souverain à un dictateur héréditaire, imposé et soutenu par l'armée et l'administration, avec la ratification illusoire d'un plébiscite. Toutes ces théories, si diverses et même opposées qu'elles soient, prennent cependant pour point de départ le principe de [322] la souveraineté du peuple, sauf à l'accommoder aux intérêts des partis en concurrence pour la possession de l'État.
On conçoit que ces théories et les institutions qui en dérivent et qui ont pour objet essentiel et invariable d'assurer la prépondérance d'un parti, au détriment de ses concurrents, provoquent des luttes d'une vivacité extraordinaire, et qu'il arrive même, quand un parti entreprend de se protéger, au moyen d'un cens électoral adapté à sa situation particulière ou de toute autre institution, que ses concurrents aient recours aux moyens révolutionnaires pour renverser cette douane qui menace de les exclure du marché politique. Il est permis de se demander cependant si les partis ne se font pas quelque illusion sur l'efficacité des appareils à l'aide desquels ils essayent de fixer entre leurs mains la possession de l'Etat. Cette efficacité est naturellement limitée. En fait, la force d'un parti dépend de la puissance de l'élément social dont il est issu. Lorsque les partis, en compétition, proviennent de classes ayant un poids à peu près égal dans la balance politique, un système bien agencé de protection peut, sans doute, faire pencher cette balance d'un côté ou d'un autre. Mais il n'est aucune combinaison du protectionnisme politique, si savante qu'on la suppose, qui ait la vertu d'empêcher un élément social en voie de croissance, comme l'était la bourgeoisie en 1789, de supplanter un élément social en décadence, comme l'était la noblesse. Et telle a été, depuis la révolution, la supériorité de la puissance de la.classe moyenne, en comparaison des autres éléments sociaux, aristocratie et haut clergé ou masses populaires, qu'elle est demeurée maîtresse de l'Etat ou qu'elle en a promptement recouvré la possession, en dépit des institutions qui lui semblaient le plus contraires : dictature militaire, monarchie avec charte octroyée et suffrage aristocratique, république et suffrage universel. En revanche, le jour où les masses populaires viendront à [323] l'emporter dans la balance des forces sociales, les appareils les plus solides et les plus ingénieusement combinés pour conserver aux classes supérieures l'exploitation de l'Etat seront balayés comme des fétus de paille par l'ouragan.
On doit comprendre maintenant pourquoi la science de la politique est demeurée immobile. En admettant que le dogme de la souveraineté du peuple, tel que les théoriciens de la révolution l'ont formulé, vînt à être appliqué, il ramènerait les sociétés civilisés au régime politique des communautés du premier âge de l'humanité. Seulement, comme il n'est pas plus possible de revenir à ce régime embryonnaire qu'à l'outillage primitif des armes et des instruments en pierre éclatée, la science est demeurée figée dans cette formule hiératique. La production des constitutions et des lois organiques ou autres n'a certainement jamais été aussi active que de nos jours, mais la confection de ces produits législatifs à l'usage des partis ne procède pas plus de la science de la politique que celle des tarifs protectionnistes n'est du ressort de la science économique.
§ 2. — Influence rétrograde de la révolution sur l' économie politique. — Dans le demi-siècle qui a précédé la Révolution française, l'économie politique avait réalisé des progrès considérables. Elle avait analysé les causes qui déterminent la création et la multiplication de la richesse des nations, démontré qu'il suffit de laisser aux hommes la liberté de travailler et d'échanger les produits de leur travail, en se bornant à leur en assurer la propriété, de « laisser faire et de laisser passer», pour que la richesse secrée avec toute l'abondance que comporte le degré d'avancement de l'outillage de la production et se distribue de la manière la plus conforme à l'utilité générale. Le rôle de l'État se bornait ainsi à garantir la liberté et la propriété de chacun, et l'œuvre des réformateurs devait consister simplement à détruire les obstacles que l'ignorance, la cupidité et la [324] barbarie avaient opposés, sous forme de privilèges, de règlements, d'impôts, de douanes, de monopoles, aux manifestations légitimes de l'activité humaine. A la vérité, les économistes n'étaient pas remontés aux causes qui avaient nécessité la création de ces différentes pièces du gouvernement de l'homme et de la société sd-us le régime de l'état de guerre et de la limitation des marchés, et ils n'apercevaient pas, d'une manière beaucoup plus claire, les causes qui agissaient maintenant pour les rendre superflues et nuisibles. Mais, si incomplète qu'elle fût, leur doctrine n'était pas moins assise sur une base inébranlable, savoir que le monde économique a ses lois naturelles comme le monde physique.
A côté de cette école scientifique, il y en avait une autre qui, s'arrêtant à l'apparence des choses, sans procéder par voie d'observation et d'analyse des phénomènes économiques, n'apercevait dans la société, telle qu'elle se trouvait constituée, qu'un conflit anarchique de forces, aboutissant nécessairement à l'asservissement des faibles. Aux yeux des adeptes de cette école, le peuple avait été de tous temps opprimé et exploité, et il ne cesserait de l'être que le jour où, s'emparant de toutes les propriétés et de tous les pouvoirs qui lui avaient été dérobés par la force ou la ruse et les mettant en commun, il organiserait la production et la distribution de la richesse conformément à des règles de justice et d'égalité qu'il établirait lui-même. C'était la doctrine du communisme, corollaire économique du principe de la souveraineté du peuple, ou du communisme politique.
Ce principe, la révolution le fit triompher et il s'imposa désormais comme un dogme nécessaire et indiscutable ; mais avec le communisme politique s'imposait aussi son corollaire, le communisme économique. L'économie politique de la révolution devait se résoudre logiquement ;dans le communisme.
[325]
En vertu du principe de la souveraineté du peuple, les révolutionnaires avaient confisqué l'État politique pour le restituer à son légitime propriétaire, la Nation. Désormais, la communauté nationale allait gérer elle-même, à son profit, l'ensemble des services qui avaient été successivement englobés dans la sphère d'activité de l'Etat et qui étaient exploités au profit de la maison royale et de ses auxiliaires. Il était entendu, et ce point ne pouvait être mis en question sous peine d'infirmer l'utilité, partant la légitimité de la révolution, que la communauté nationale était plus capable de gérer d'une manière conforme à son intérêt les services de l'État que ne l'avait été la « maison de France » ; autrement dit, qu'elle devait trouver plus d'avantage à se gouverner elle-même qu'à être gouvernée. C'était là une vérité universellement considérée comme acquise, un truisme, que l'on pouvait se passer de démontrer. Mais s'il en était ainsi, si la nation ou la « communauté nationale » était plus capable qu'une « maison » ou une association, n'ayant en vue que son intérêt particulier, de gérer les services publics, de pourvoir à la sécurité intérieure et extérieure, à la protection des personnes et des choses, à l'enseignement, au culte, à la construction et à l'entretien des routes, à l'encouragement des arts et des lettres, etc., etc., n'en devait-il pas être de même pour tout le reste, et le progrès économiques ne consistait-il pas à faire rentrer dans le domaine de la communauté nationale toutes les industries et tous les services qui avaient jusqu'alors appartenu, comme l'État lui-même, à des entreprises privées? De deux choses l'une: ou le système des entreprises privées, mues par l'intérêt particulier, individuel ou collectif, et régies par la concurrence, est économiquement supérieur à celui de la communauté nationale, il peut créer des produits et des services en plus grande abondance et les répartir d'une manière plus conforme à l'utilité générale et, dans ce cas, il faut lui [326] confier toutes les industries qui pourvoient à la multitude des besoins de l'homme, sans excepter celles qui appartiennent à l'État, la sécurité, l'enseignement et le reste ; ou le système de la communauté nationale est, au double point de vue de la création et de la distribution des produits et des services, plus économique et plus conforme à l'utilité générale, la communauté nationale peut produire toutes choses à meilleur marché que les entreprises privées et répartir d'une manière plus utile les résultats de la production, et, dans ce cas, ne convient-il pas d'annexer aux industries appartenant au domaine de l'Etat, restitué à la nation, toutes les autres industries? Ne faut-il pas remettre entre les mains de la communauté nationale, avec la production de la sécurité, de l'enseignement, du transport des lettres et petits paquets, etc., etc., la production agricole, minière, manufacturière, littéraire, artistique et commerciale?
Il n'y a pas à sortir de ce dilemme.
C'est pourquoi, dès que l'État eut été restitué révolutionnairement à la communauté nationale, on vitle communisme économique prendre le haut du pavé et marcher de pair avec le communisme politique. Le gouvernement révolutionnaire se mit en devoir de substituer, autant que le permettaient les circonstances, l'État aux entreprises privées, en commençant par les entreprises collectives, qui lui faisaient particulièrement ombrage. Les jacobins les plus logiques et les plus radicaux, Babeuf et ses associés, essayèrent même de pousser d'emblée jusqu'au bout l'application économique du principe communiste qui était devenu la base du droit public de la révolution. Mais, de même que l'application politique de ce principe, telle qu'elle était formulée dans la Constitution de 93, avait dû être ajournée, dans l'intérêt du salut de la révolution, on jugea nécessaire d'ajourner son application économique. On guillotina [327] Babeuf, mais l'absorption de toutes les industries par l'État, l'organisation communautaire de la production et de la distribution, sans oublier la consommation, continua de s'imposer comme l'idéal logique et nécessaire de la révolution.
Cependant, on essaye vainement de lutter avec la nature des choses. Si l'on avait pu enlever l'État à la maison royale pour le transférer à la nation, on n'avait pu donner à celle-ci la capacité de le gérer elle-même. Quel avait donc .été le résultat pratique de la confiscation de l'État à son propriétaire légitime? Tout simplement de déterminer l'éclosion d'une série de « sociétés », en vue de l'exploitation de cette propriété d'un incapable. Désormais une lutte sans trêve allait s'engager entre ces sociétés politiques en participation ou ces partis, soit pour conquérir l'État soit pour le conserver après l'avoir conquis, lutte tantôt poursuivie pacifiquement par des moyens constitutionnels et parlementaires, tantôt violemment, par des moyens révolutionnaires. C'était, en définitive, la guerre civile, plus ou moins régularisée et adaptée à la situation présente des sociétés civilisées. Mais, pour soutenir cette lutte, chaque parti était obligé de donner une satisfaction particulière aux intérêts de l'élément social dans lequel il puisait ses forces et ses ressources. Ces intérêts, bien ou mal entendus, voulaient être protégés et favorisés d'une manière spéciale; ce n'est qu'à cette condition qu'ils accordaient leur concours aux partis politiques. Donnant, donnant: telle était leur devise. Chaque parti s'est donc trouvé dans la nécessité d'adopter et de faire prévaloir le régime économique que ses commettants ou ses commanditaires considéraient comme le plus avantageux à leurs intérêts particuliers. Ce régime, les praticiens politiques se sont chargés de l'établir, mais il fallait bien qu'ils le justifiassent. De là, une « demande » croissante de [328] sophismes et d'utopies économiques, à l'usage des partis politiques.
Or, il en est des sciences comme de tous les autres produits de l'industrie humaine. Elles sont gouvernées par la demande. D'une part, la classe moyenne, entre les mains de laquelle la révolution a fait tomber la puissance politique, a demandé les théories propres à justifier les monopoles et les privilèges ayant pour objet d'élever l'intérêt de ses capitaux, les profits de ses entreprises, la rente de ses terres, qui constituent, avec les émoluments des fonctions publiques, la presque-totalité de ses revenus. Le monopole des banques, le système protecteur, les lois sur les coalitions et les grèves et tant d'autres, dont l'objet était la protection spéciale des intérêts de la classe moyenne, ont trouvé des avocats plus ou moins sincères pour les défendre, au moyen d'arguments empruntés tantôt à la politique, tantôt à l'économie politique, ou, pour mieux dire, à une prétendue « économie nationale », appropriée à leur thèse. Il convient de remarquer, toutefois, que les « politiciens » qui forment l'état-major des partis, et dont l'industrie consiste dans l'exploitation actuelle ou éventuelle de l'Etat, ont naturellement peu de goût pour les théories économiques. La protection, les monopoles ou les subventions exigés par leurs commettants sont des obligations ou des nécessités qu'ils subissent, à moins qu'ils ne soient engagés eux-mêmes dans une industrie quelconque, qu'ils ne soient manufacturiers, négociants, armateurs ou propriétaires fonciers en même temps que politiciens. En général, ils se gardent bien d'avoir en ces matières une opinion préconçue, de se prononcer, par exemple, en faveur du libre échange ou de la protection; ils se mettent du côté des intérêts les plus forts et les plus capables de servir leurs intérêts politiques. D'une autre part, à mesure que le développement de la grande [329] industrie a accru l'importance des classes ouvrières, qu'elles ont pesé davantage dans la balance des pouvoirs et fourni un appoint plus appréciable aux partis politiques, il a bien fallu tenir compte aussi de leurs intérêts bien ou mal entendus, flatter leurs espérances, épouser leurs haines, répondre à leur « demande » d'amélioration de leur condition dure et précaire. Cette demande a provoqué la production et l'offre d'une multitude de systèmes, ayant ceci de commun avec les théories protectionnistes à l'usage des classes supérieures, qu'ils réclament l'intervention de l'État pour protéger ou favoriser particulièrement les intérêts des classes inférieures, ne différant, en somme, de ces théories que par l'application. Parmi tous ces systèmes socialistes, commtmistes, collectivistes, anarchistes, ceuxlà ont surtout obtenu la vogue qui répondaient le mieux à la demande du grand nombre, qui étaient le plus accessibles à la masse des intelligences dépourvues de culture ou à demi cultivées, chez lesquelles le sentiment et l'imagination l'emportent sur la réflexion. Il faut noter enfin que les « politiciens » jacobins ou autres, qui cherchent un contingent ou un appoint de forces dans les classes ouvrières, n'ont pas plus de goût pour les théories économiques que leurs collègues des classes supérieures. Ils considèrent comme un embarras la nécessité de les appliquer au risque de soulever des résistances violentes et peut-être de compromettre leur victoire. Ils se gardent, en tous cas, de prononcer entre les systèmes, en se réservant de faire prévaloir celui qui peut leur apporter le plus de forces et leur causer le moins de soucis, ou même encore en invoquant pour les ajourner la théorie ingénieuse et commode de l'opportunisme.
Comment, en présence de cette concurrence des systèmes protectionnistes et socialistes, répondant les uns à la demande des classes supérieures, les autres à celle des classes [330] ouvrières, l'économie politique n'aurait-elle pas vu diminuer sa clientèle? Elle n'a pu en conserver une partie qu'en sacrifiant dans quelque mesure l'intérêt général, désormais sans organe et sans pouvoir, aux intérêts particuliers servis par les partis politiques, c'est-à-dire en faisant des concessions opportunistes à des systèmes faux et rétrogrades. Une autre cause a contribué à accélérer le mouvement de rétrogression de la science économique. Dans tous les pays où la révolution a triomphé ou qui ont subi son influence, l'enseignement a été de plus en plus accaparé par l'État. Or des professeurs et des savants au service de l'État peuvent-ils être bien convaincus de la supériorité de l'industrie privée et de la nécessité de la concurrence? Les hommes ne subissent-ils pas toujours, quoi qu'ils fassent, l'influence de leur position, de leurs intérêts et du milieu où ils vivent? Comment des principes, non seulement en contradiction manifeste avec la demande générale, mais encore avec la situation particulière de ceux qui les enseignent, ne finiraient-ils point par être délaissés? Faut-il s'étonner si l'école économique des Adam Smith, des Turgot et de leurs disciples, est tombée en discrédit et si nous avons vu apparaître à sa place et grandir rapidement une école mieux avisée qui s'applique à accommoder la science à la demande du jour? Cette science nouvelle est, avons-nous besoin de le dire, une économie politique d'État. [51] C'est à l'État qu'elle confère la gestion ou [331] la direction souveraine des intérêts économiques de la nation. Il n'y a plus de lois naturelles qui régissent la production et la distribution de la richesse. Il n'y a que des règlements qu'il appartient à l'Etat de formuler et de mettre en (vigueur pour diriger la production et opérer la distribution de la manière la plus conforme à l'intérêt de la communauté nationale. Mais l'apparition et les progrès de Cette école, qui réduit l'économie politique à n'être plus qu'une branche de l'administration publique, n'attestet-elle point que la science économique n'a pas rétrogradé moins que la science politique sous l'influence de la révolution?
V. Pertes matérielles et démoralisation causées par la révo lution. — § 1er. Destruction de richesses. — On peut, d'une manière approximative, faire le compte de ce qu'ont coûté à la France, et, par contre-coup, au reste du monde civilisé, les émeutes, les guerres, les crises, le gouvernement alternatif des partis politiques, suscités par la révolution, en déduisant toutefois de ce total énorme de pertes et de dommages ceux qu'eût coûté la conservation de la monarchie en décadence de l'ancien régime et sur lesquels on ne peut faire que de simples conjectures. En se reportant à l'état matériel et moral de la France et aux dispositions des esprits dans le reste de l'Europe, pendant les belles années du règne de Louis XVI, et en supposant qu'au lieu de recourir aux moyens révolutionnaires, les réformateurs du temps eussent demandé uniquement à la méthode évolutionuiste la transformation progressive de l'ancien régime, on est autorisé à croire cependant que les institutions appropriées à l'état de paix et à la grande industrie auraient déjà, en grande partie, remplacé celles de l'ancien régime et que les frais de cette substitution nécessaire eussent été incomparablement moindres. Il ne convient pas moins de tenir compte de ces frais inévitables [332] de la transformation de l'ancienne machinery politique et économique, en faisant l'inventaire .des pertes et dommages causés par la révolution.
Nous ne pouvons, bien entendu, ici, écrire que les sommaires de ce volumineux inventaire. Le premier chapitre qui comprend la période violente et anarchique de la révolution, du 10 août 1792 au 18 brumaire 1799, est rempli par les proscriptions et les confiscations; l'élite intellectuelle et morale de la France périt sur les échafauds ou dans les prisons, et quoique la perte causée de ce chef ne soit pas susceptible d'une évaluation rigoureuse, elle atteint la France aux sources mêmes de sa grandeur et de sa richesse. Quelle brèche le meurtre d'un Lavoisier, d'un André Chénier, d'un Bailly et de tant d'autres illustres représentants de la civilisation française n'a-t-il pas faite dans l'inventaire des valeurs personnelles qui constituent, partout et toujours, la meilleure part de la richesse d'un pays? Les confiscations, grâce auxquelles une portion du domaine territorial est tombée entre les mains peu scrupuleuses des acheteurs de biens nationaux, qui les ont émiettés au détriment des progrès de l'agriculture, [52] ont fait une autre large brèche à la fortune et à la moralité publiques. Joignez-y les réquisitions, les assignats, le maximum, la destruction du commerce intérieur et extérieur, [53] les frais et les ravages de la guerre [333] civile [54] et étrangère, les levées en masse et la conscription, l'incapacité et les dilapidations du nouveau personnel [324] gouvernant et administrant, et vous arriverez à un total tel que, à part les grandes destructions occasionnées par les invasions barbares, — et la révolution a-t-elle été autre chose qu'une irruption de la barbarie intérieure? — on ne saurait citer aucun peuple qui ait subi dans ce court espace de sept années une aussi effroyable déperdition de forces, de richesses et de civilisation.
Dans la période de dictature militaire et administrative qui succède, de 1799 à 1814, à la période anarchique de la révolution, la paix intérieure se rétablit, les partis sont dissous ou réduits à l'impuissance, mais le dictateur appuyé sur l'armée et l'administration se fait, d'une manière inconsciente, l'instrument de leur domination, en croyant établir la sienne. A l'armée, la guerre, redevenue permanente d'intermittente qu'elle était sous l'ancien régime, procure un débouché plus avantageux que jamais : les grades, les dotations, les majorats et les titres héréditaires récompensent largement les chefs, tandis que les réquisitions en pays ennemi et le relâchement des usages de la guerre dédommagent le soldat de l'extension illimitée du servage militaire. A l'administration, le dictateur fournit de même un accroissement de débouchés et de profits, en augmentant les attributions de l'État, dont les conquêtes de l'armée reculent les limites géographiques : la carrière administrative s'élargit, la France exporte des employés de tous grades en Belgique, en Hollande, dans les provinces rhénanes, en Italie, en Espagne ; le monopole de l'Université et le Concordat procurent encore des moyens d'existence assurés à un nombreux personnel de fonctionnaires civils et religieux. Cependant, la coalition de l'Europe, lasse de servir de débouché à l'armée et à l'administration impériales, et l'épuisement de la France mettent fin à la dictature révolutionnaire; la France paye les frais de deux invasions et, avec la Restauration, s'ouvre la troisième période, la [335] période constitutionnelle et parlementaire de la révolution. Les partis se reconstituent et recommencent, cette fois-par des moyens pacifiques, à lutter pour la possession et l'exploitation de l'État. Malgré les exigences de cette lutte, les droits politiques demeurant concentrés dans les classes supérieures, naturellement peu nombreuses, les attributions de l'État ne se développent que d'une manière peu sensible; le pays est gouverné par des politiciens d'élite et administré avec économie. L'industrie progresse, en dépit des entraves du régime prohibitif rétabli au profit des classes investies des droits politiques ; la littérature et les arts, dont la Révolution avait rétréci et abaissé les débouchés, renaissent et prennent un vif essor, sous l'influence de la paix, de la sécurité et de l'accroissement de la richesse. Malheureusement, la guerre civile des partis descend, de nouveau, de l'arène parlementaire dans la rue. Le coup d'État des ordonnances et les journées de Juillet 1830 ouvrent une nouvelle crise révolutionnaire, qui trouble et ralentit, pendant plusieurs années, la marche des affaires. La paix intérieure finit néanmoins par se rétablir, la paix extérieure est conservée. Seulement, le risque de guerre s'est élevé sous l'influence de la crise, les dépenses militaires se sont grossies en conséquence, tandis que l'extension des droits politiques détermine, avec l'abaissement du personnel gouvernant, un accroissement graduel des attributions de l'État et une augmentation correspondante des dépenses civiles. Les budgets deviennent d'année en année plus volumineux sans dépasser encore toutefois des proportions raisonnables.
A cette période de monarchie constitutionnelle et parlementaire qui va de 1814 à 1848, interrompue seulement par le retour de l'île d'Elbe et la courte convulsion révolutionnaire de 1830, succède une période de république parlementaire et de dictature impériale, ouverte par la [336] révolution de février 1848 et marquée par l'établissement du suffrage universel, les journées de Juin, le coup d'État du 2 décembre, les guerres du second Empire, l'invasion allemande, la révolution du 4 septembre et la Commune. Dans cette dernière période, l'accroissement rapide du risque de guerre, provenant des progrès de la révolution sur le continent et de l'établissement en France d'une nouvelle dictature appuyée sur l'armée, a élevé extraordinairement les dépenses militaires et doublé les dettes publiques, tandis que les crises engendrées par les insurrections, les révolutions et les guerres ralentissaient le développement de l'industrie et des affaires, et que la suppression des barrières qui limitaient le corps électoral agissait à la fois pour augmenter les attributions de l'État et abaisser le personnel gouvernant. Non seulement les dépenses de l'État, mais encore celles des départements et des communes, ont crû dans une progression inusitée, et on a vu, comme une conséquence inévitable de l'augmentation des charges publiques, la vie devenir de plus en plus chère. [55]
[337]
Si l'on pouvait faire le compte de ce qu'ont coûté, dans ces différentes périodes et particulièrement dans les deux premières et dans la dernière, les guerres extérieures [338] provoquées par la révolution, la guerre civile des partis, tantôt dans le Parlement et tantôt dans la rue, tantôt faite à coups de discours et de votes, tantôt à coups de fusil, en attendant la dynamite, si l'on pouvait additionner, avec l'accroissement des budgets et des dettes, les pertes matérielles que les crises de la révolution ont causées à l'industrie, les dommages plus considérables encore occasionnés par l'extension des attributions de l'État, le régime prohibitif et les monopoles établis au profit des classes dominantes en matière de crédit, de voies de communication, etc., on atteindrait à un chiffre qui paraîtrait invraisemblable. Nous n'exagérons point en estimant au tiers et peut-être à la moitié de la masse annuelle du travail de l'ensemble de la population valide de la France, la somme nécessaire pour solder les frais et servir les dettes de l'énorme et informe établissement politique que la révolution a institué, dont elle élargit continuellement les dimensions et appesantit le fardeau. A bien considérer les choses, n'estce pas la résurrection du vieux régime de la corvée, perfectionné de telle sorte que la multitude des corvéables, autrement dit des consommateurs politiques, ignorent quelle partie de leur labeur quotidien est employée à satisfaire à leurs besoins et quelle autre partie à l'entretien de cette idole de plus en plus avide de sang et d'argent que l'on nomme l'État.
§ 2. Démoralisation causée par la révolution. — Aux pertes matérielles causées par la révolution, il faut joindre une autre série de dommages qui échappent à tout calcul: nous voulons parler de la démoralisation produite, d'un côté par le spectacle du succès brutal des émeutes et des coups d'État, des proscriptions politiques, de la curée des places, de l'abaissement de ceux qui veulent les garder et de ceux qui veulent les obtenir devant les triomphateurs du jour; d'un autre côté, et surtout, par l'hypocrisie [339] nécessaire des actes et du langage des partis politiques. Le but que s'elforcent d'atteindre les « politiciens » des partis, sans se montrer autrement scrupuleux sur le choix des moyens, c'est la possession du pouvoir, représentant pour eux et leurs commettants une somme plus ou moins considérable de profits et d'honneurs. Mais s'ils avouaient sincèrement et ouvertement qu'ils poursuivent cet objectif matériel, ils soulèveraient contre eux la conscience publique, quelques-uns même , particulièrement délicats, leur propre conscience; et il leur deviendrait impossible d'arriver à leurs fins. Il faut bien qu'ils le dissimulent sous les apparences du désintéressement, de l'amour du peuple et du patriotisme. Écoutez-les. S'ils consentent à subir les déboires et à affronter les orages de la vie politique, c'est uniquement dans l'intérêt du peuple et pour l'amour de la patrie. C'est par pur dévouement qu'ils se résignent à être députés, sénateurs, ministres, ambassadeurs. Ce n'est pas tout. Quand ils sont dans l'opposition, comment pourraient-ils arriver au pouvoir, s'ils ne captaient point les suffrages du souverain? Il leur faut donc flatter ses passions, ses préjugés et ses intérêts; lui promettre, s'il est ignorant et misérable, des réformes qui améliorent sa condition d'une manière instantanée. Mais, qu'ils réussissent à arriver au pouvoir : aussitôt leur langage change, ils oublient leurs promesses et leurs programmes, sauf à les reprendre quand ils en auront été évincés. Ils avaient promis par exemple de diminuer les dépenses publiques, ils les augmentent; ils s'étaient engagés à maintenir la paix, ils font la guerre. A quoi tiennent ces revirements et ces mensonges? Faut-il croire que les hommes politiques soient nés menteurs et hypocrites? Non! mais ils subissent des nécessités inhérentes au régime de la souveraineté du peuple, et à la situation que ce régime a faite aux partis. Quand la religion était le canal qui conduisait à la fortune et aux [340] honneurs, on simulait l'amour de Dieu : depuis que le peuple est devenu souverain et presque Dieu, on simule l'amour du peuple et on se dévoue aux intérêts de la patrie comme autrefois aux intérêts du ciel. De là la phraséologie écœurante des oraisons électorales, et l'hypocrisie politique qui restera le trait caractéristique du siècle de la révolution.
VI. Influence rétrograde de la Révolution française à l'étranger. — Tout en infligeant aux autres nations civilisées d'énormes pertes matérielles, d'hommes et de capitaux, par la recrudescence de l'état de guerre, la révolution a déterminé un mouvement général de recul des institutions, des idées et des sentiments politiques.
A la veille de la Révolution, la réforme de l'ancien régime était à l'ordre du jour chez tous les peuples du continent. Une propagande active, dont la France était le foyer, se faisait en faveur du libre examen des institutions et des actes du gouvernement, de la tolérance religieuse, de la liberté du travail et du commerce. Les philosophes et les économistes français exerçaient à l'étranger une influence extraordinaire et l'on sait avec quel enthousiasme y fut accueillie la convocation de l'Assemblée nationale. Mais aussitôt que l'évolution pacifique et libérale qui semblait s'annoncer eut fait place à la révolution, imposée par la Terreur, et la guerre, une réaction universelle s'opéra non seulement contre les doctrines et les pratiques révolutionnaires, mais encore, dépassant le but comme toutes les réactions, contre les idées les plus saines de progrès politique et économique. Les institutions représentatives dans ce qu'elles avaient d'utile, la liberté dans toutes les manifestations de l'activité humaine, furent considérées comme subversives; et les maisons souveraines, menacées dans leur existence par la révolution, formèrent [341] une Sainte Alliance contre ces nouveautés pernicieuses. [56]
VII. Comment les nations civilisées sortiront de la [342] révolution pour rentrer dans révolution. — Deux causes agissent pour mettre fin à la perversion politique, déterminée [343] par la révolution et le régime de communisme national qu'elle a inauguré : la première réside dans l'augmentation [344] continue des charges que ce régime impose aux nations civilisées, la seconde dans le développement de la grande industrie et la généralisation de la concurrence industrielle.
Nous avons constaté que la recrudescence de l'état de guerre et la multiplication des attributions du [345] gouvernement ont eu pour résultat nécessaire l'augmentation croissante des dépenses publiques. Non seulement les budgets de tous les États civilisés, en y ajoutant ceux des communes, des départements ou des provinces, ont suivi, depuis la révolution, une progression plus rapide que celle du nombre et des ressources des populations qui en [346] font les frais, malgré l'accroissement considérable de la productivité du travail dans la plupart des branches de l'activité humaine, mais encore ces budgets se sont soldés par des déficits, dont l'accumulation a produit une dette de plus de cent milliards. En supposant que le régime politique actuel continue de subsister et de produire le même contingent de guerres et de révolutions, que la compétition des partis continue aussi de provoquer le même développement des attributions de l'État, — et nous avons remarqué qu'à mesure que la classe exploitante de l'Etat devient plus nombreuse, elle exige un butin plus volumineux d'emplois rétribués, — on verra s'élever, suivant une progression correspondante, le chiffre des dépenses et des dettes publiques. 11 est permis d'affirmer que d'ici à un siècle les budgets des États civilisés auront triplé et que le chiffre de leurs dettes aura dépassé 200 milliards. Cette progression de l'augmentation des budgets et des dettes publiques dépassant celle de l'accroissement des revenus particuliers, un moment viendra où le fardeau de l'État excédera les forces qui le supportent. Alors, de deux choses l'une, ou il faudra diminuer ce fardeau, ou les populations qui en seront chargées périront à la peine.
Cependant une autre cause agira dans l'intervalle, avec une puissance croissante, pour nécessiter l'abandon de ce régime rétrograde et l'établissement d'un système de gouvernement, en harmonie avec l'évolution de la grande industrie et de la concurrence. En dépit de tous les obstacles, cette évolution continue de s'opérer, la machinery de la production se transforme, les entreprises se spécialisent et s'agrandissent, en exigeant par là même un débouché de plus en plus étendu. Le progrès des moyens de communication et d'information satisfait à ce besoin de l'industrie grandissante. Aux marchés morcelés et limités par l'obstacle des distances, la difficulté et la cherté des transports, [347] l'insuffisance de la sécurité, succède peu à peu un marché universel où, en dépit des barrières douanières, toutes les nations versent leurs produits et se font concurrence. Mais cette lutte, à laquelle aucune nation ne peut se soustraire, à moins de s'isoler absolument et de se condamner, — en admettant que cet isolement soit possible, —à conserver le matériel inférieur de la petite industrie, on ne peut la soutenir qu'à une condition : c'est de produire et de mettre au marché ses produits à aussi bas prix que ses concurrents. Or il ne faut pas oublier que le point vers lequel gravite incessamment avec une force d'impulsion irrésistible le prix du marché c'est la somme des frais de la production, et que les charges provenant des impôts, des monopoles et des privilèges s'incorporent toujours, d'une manière ou d'une autre, dans ces frais. Il ne faut pas oublier, non plus, que sous l'influence de la facilité croissante des déplacements, tous les autres éléments des frais de la production ou des prix de revient tendent à s'égaliser : les inventions et les méthodes industrielles passent d'un pays à un autre avec les capitaux, l'intelligence technique et la maind'œuvre. Il n'y a que les inégalités provenant des charges publiques, des monopoles et des privilèges qui ne se comblent point. Cela étant, que doit-il arriver? C'est qu'à mesure que la concurrence internationale se généralisera, les industries des pays les plus grevés seront moins en état de lutter avec celles des pays les moins grevés. Un moment viendra donc où il faudra qu'elles renoncent à une lutte inégale, que les entreprises se liquident ou succombent, en entraînant la ruine et la dépopulation du pays, à moins que l'on ne diminue les frais et les charges qui surélèvent les prix de revient. A cet égard, la concurrence industrielle universalisée est destinée à remplir le rôle qui était dévolu, sous le régime de la petite industrie, à la concurrence politique et guerrière. Déjà, malgré les obstacles naturels ou [348] artificiels qui entravent son expansion régulière, on ne peut méconnaître son influence. Celle-ci serait bien plus sensible encore si toutes les nations civilisées n'étaient point entraînées, quoique à des degrés divers, dans le mouvement de rétrogression politique, qui détermine l'augmentation des frais de gouvernement. Cependant quelques-unes, l'Angleterre et les États-Unis en tête, ont pris un avantage qui devient chaque jour plus sensible: l'Angleterre en se débarrassant du régime protecteur, les États-Unis en respectant la liberté de l'industrie et du crédit, enfin et surtout, en exemptant, à l'exemple de l'Angleterre, le travail de la corvée militaire. [57] La concurrence [349] américaine a fait son apparition sur le marché général des produits agricoles, et lorsqu'elle possédera l'auxiliaire de la liberté commerciale, elle ne tardera pas à la faire sur le marché des produits industriels. Il faudra bien que l'agriculture et l'industrie du vieux continent se mettent en mesure de la soutenir. On commencera, on a déjà commencé à demander, pour les protéger contre cette concurrence envahissante, des droits compensateurs, destinés, comme leur nom l'indique, à combler l'inégalité des prix de revient. Mais les droits compensateurs, accordés à l'agriculture, augmentent les frais de production de l'industrie; accordés à l'industrie, les frais de production de l'agriculture; accordés à l'une et à l'autre, ils élèvent tous les prix de revient de manière à rendre plus difficile et finalement impossible à l'ensemble des produits agricoles et industriels l'accès du marché général. Après avoir eu recours à cet expédient et à d'autres, on s'apercevra enfin que le seul moyen de soutenir une lutte à laquelle il est désormais impossible de se soustraire, c'est de diminuer le fardeau des charges qui grèvent la production. Il se créera alors, en dehors des partis politiques, une opinion de plus en plus hostile à la guerre, à l'accaparement des industries et des services par l'État, aux subventions, aux monopoles et aux privilèges. Cette opinion d'intérêt général aura, sans aucun doute, une lutte acharnée à soutenir avec les intérêts particuliers engagés dans le régime actuel. Elle succombera, selon toute apparence, dans les pays où ils ont acquis [350] une position presque inexpugnable et dont la décadence deviendra sans remède; elle l'emportera ailleurs, et elle aboutira, par l'emploi de la méthode évolutionniste, à la constitution du régime politique approprié aux conditions d'existence des sociétés vivant de la grande industrie.
Quel sera ce nouveau régime, voilà ce qu'il nous reste à rechercher.
[351]
CHAPITRE X.
Les gouvernements de l'avenir↩
I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires.— II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées. § 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises, g 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — III. Du régime économique des Etats politiques dans l'ère de la grande industrie. § 1er. Les servitudes et leur raison d'être. § 2. La servitude politique. § 3. Raison d'être de la servitude politique. § 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. § 5. La liberté de gouvernement. — IV. La commune et son avenir. — V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — VI. La nationalité et le patriotisme.
I. Causes de la supériorité des gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires. — Si nous voulons savoir comment les nations civilisées sortiront de la voie rétrograde où la révolution les a engagées, il est nécessaire que nous nous reportions encore pour un moment à l'époque où le régime des entreprises privées, individuelles ou corporatives, a remplacé le communisme politique, et que nous revenions sur les causes qui ont déterminé cette évolution progressive de l'industrie du gouvernement.
Dans les temps primitifs, avant la création du matériel de la petite industrie, lorsque les hommes encore peu nombreux étaient rassemblés en troupeaux ou en tribus, les fonctions du gouvernement et de la défense de ces sociétés à l'état de germe étaient exercées par les différents [352] membres de la communauté, concurremment avec l'industrie rudimentaire qui leur fournissait leurs moyens de subsistance. Cette industrie, chasse, pêche, récolte des.fruits naturels du sol, ne leur procurant que le strict nécessaire, les fonctions gouvernantes ne pouvaient être rétribuées; elles constituaient autant de charges imposées dans l'intérêt commun et auxquelles on ne pouvait se soustraire sans aggraver celles d'autrui. comme il arriverait dans une association dont certains membres se refuseraient à payer leur cotisation, en prétendant cependant recueillir leur part des profits ou des avantages sociaux.
Mais, à la suite des temps, un progrès immense s'accomplit, le matériel de la petite industrie est créé. Aussitôt, par le fait de l'énorme accroissement de la productivité des industries alimentaires et autres, les fonctions gouvernantes deviennent productives d'onéreuses qu'elles étaient. On voit alors ces fonctions se spécialiser et devenir, comme les autres branches d'industrie, l'objet d'une exploitation par voie d'entreprise. Les hommes qui possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de cette sorte d'entreprise constituent des « sociétés » ayant pour but d'exploiter l'industrie du gouvernement et d'en tirer le plus grand profit possible. Ces sociétés s'approprient un marché dont elles s'efforcent d'exclure les entreprises concurrentes et qu'elles s'appliquent à agrandir en vue d'augmenter leurs bénéfices. En cela, leurs pratiques ne diffèrent point de celles des corporations industrielles ou commerciales auxquelles donnent naissance, dans la même période, les progrès du matériel de la production.
Cependant on peut se demander si les nations vivant de la petite industrie n'auraient pas trouvé plus d'avantage à conserver le régime de la communauté politique, tel qu'il existait dans le troupeau ou la tribu, et de continuer, par conséquent, à répartir entre tous leurs membres les [353] fonctions gouvernantes, devenues productives. Chacun aurait eu sa part dans les profits de l'industrie du gouvernement, tandis que ces profits ont été monopolisés par la société politique qui a imposé ses services à la nation réduite à l'état de sujétion. L'humanité n'aurait pas subi l'oppression que les monarchies et les oligarchies politiques et religieuses ont fait peser sur elle pendant une longue suite de siècles; elle eût continué de jouir des bienfaits de la démocratie ou du gouvernement du peuple par lui-même. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi?
Si les choses se sont passées autrement, si nulle part l'ancien régime de la communauté politique n'a pu subsister en concurrence avec le nouveau régime de la concentration du gouvernement dans une corporation particulière, c'est parce que celui-ci était plus efficace et plus économique; plus propre, par conséquent, à donner la victoire, dans la lutte pour l'existence, aux nations qui s'y trouvaient assujetties.
Quelles sont les causes de cette supériorité, démontrée par l'expérience, dos gouvernements d'entreprise sur les gouvernements communautaires? Ces causes résident, d'une part, dans le principe économique de la division du travail et de la spécialisation des fonctions, de l'autre dans les lois naturelles qui régissent la constitution et la mise en œuvre des entreprises.
En premier lieu, il en est des fonctions du gouvernement comme de toutes les autres. Elles exigent, aussi bien que les fonctions industrielles, artistiques, commerciales, des aptitudes et des connaissances spéciales avec une application continue et exclusive. C'est quand elles se trouvent séparées et spécialisées qu'elles sont le plus productives, qu'elles fournissent les produits et les services les plus abondants, les moins chers et les meilleurs. En supposant que les nations, vivant de la petite industrie, eussent [354] continué de se gouverner comme les tribus ou les troupeaux primitifs, que chacun de leurs membres eût coopéré au gouvernement et à la défense de l'Etat en même temps qu'il vaquait aux travaux nécessaires à sa subsistance et à son entretien, les nations eussent été plus mal défendues et gouvernées, défense et gouvernement leur eussent coûté plus cher. C'est exactement ce qui se serait passé si chacun avait continué à pourvoir à tous ses autres besoins, à cultiver son blé, à pétrir son pain, à fabriquer ses habits, à construire et à meubler son habitation, au lieu de s'adonner à une seule industrie et d'en échanger les produits ou les services contre les produits ou les services des autres industries.
En second lieu, un gouvernement est une entreprise comme une autre, et il se trouve à ce titre soumis aux lois naturelles qui régissent la généralité des entreprises. Que ses attributions soient étendues ou limitées, qu'il possède un marché plus ou moins vaste, un gouvernement a besoin d'un matériel et d'un personnel, il exige la concentration d'une quantité plus ou moins considérable de capital, de travail et de connaissances techniques, combinés et mis en œuvre en vue du but à atteindre qui est toujours de produire un maximum d'effet utile en échange d'un minimum de dépense. Or cette constitution et cette organisation économiques des entreprises ont leurs lois que l'expérience a fait découvrir comme elle a révélé celles de la construction des édifices ou de l'architecture, et dont la non-observation entraîne invariablement, au bout d'un temps plus ou moins long selon que les manquements sont plus ou moins graves, la chute des entreprises et l'effondrement des édifices. L'observation et l'expérience démontrent encore que ces lois sont les mêmes pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie, de commerce ou de gouvernement.
[355]
Voyons comment les choses se passent. Un produit ou un service vient à être assez demandé pour qu'on puisse trouver profit à en entreprendre la production. Qu'arrive-t-il alors? Si la demande est peu considérable, si le marché est peu étendu, un homme pourvu de la capacité, des connaissances et des ressources nécessaires entreprend cette production à ses frais et risques. Il fonde une entreprise individuelle. Si le marché est vaste et si le produit ou le service exige, en vertu de sa nature particulière, la mise en œuvre d'une grande agglomération de forces et de ressources, une entreprise individuelle est ordinairement insuffisante, il faut une entreprise collective. Mais, individuelle ou collective, toute entreprise est soumise à des règles invariables. Ces règles, nous devons nous borner ici à les rappeler d'une façon sommaire. H faut : 1° qu'une entreprise ait la propriété ou la libre disponibilité de ses forces et de ses ressources, ainsi que des résultats de sa production; qu'elle puisse les augmenter ou les diminuer, conserver ses produits ou les mettre au marché aux conditions qu'il lui convient de stipuler; 2° il faut que les ressources et les forces dont elle dispose soient proportionnées aux exigences de la production, et, en même temps, qu'elle ne s'étende pas au delà de certaines limites, déterminées par le degré de puissance de son matériel, de capacité et de connaissances techniques de son personnel, de perfectionnement de ses procédés et de ses méthodes; il faut que sa direction soit une, et, à la fois, intéressée au succès de l'entreprise, libre d'agir et effectivement responsable de ses actes; 4° que tous les co-intéressés dans l'entreprise possèdent un droit proportionné à leur intérêt de contrôler sa gestion avec la possibilité matérielle et la capacité d'exercer utilement ce droit de contrôle; 5° qu'elle n'ait autant que possible qu'un seul objet, qu'elle s'applique a une seule branche d'industrie, [356] qu'elle se conforme, en un mot, au principe de la division du travail et de la spécialisation des fonctions productives; 6° enfin et surtout qu'elle soit soumise, dans la mesure nécessaire, à la pression de la concurrence, sinon quelque solides et excellentes qu'aient été, à l'origine, sa constitution et:son organisation, elles finissent par se corrompre et devenir caduques.;
Telles sont, dans toutes les branches de l'activité humaine, les conditions principales et essentielles d'existence et de succès des entreprises. Celles qui s'en écartent le plus ne lardent pas à succomber, et, en général, elles ne durent et prospèrent que dans la mesure où elles les réalisent. Or, si l'on étudie la constitution et l'organisation des gouvernements institués sous forme d'entreprises individuelles ou collectives, dès l'époque où les fonctions gouvernantes sont devenues productives, on s'apercevra que ces conditions naturelles d'existence et de succès s'y trouvaient réunies beaucoup plus complètement qu'elles ne pouvaient l'être dans des communautés, composées désormais de millions d'individus, dont l'immense majorité n'avait ni la possibilité matérielle, ni la capacité d'intervenir utilement dans la gestion gouvernementale, sans .-parler des autres causes d'infériorité d'une entreprise communautaire. Qu'en faut-il conclure? C'est que les nations ont trouvé avantage à ce que le gouvernement devînt l'affaire d'une entreprise particulière au lieu de continuer à être celle de la communauté elle-même. C'est qu'elles ont pu être gouvernées et défendues plus efficacement et à moins de frais.
Il serait impossible d'évaluer l'importance de l'avantage que les nations ont rencontré, au point de vue de l'efficacité des services, dans la substitution des gouvernements, constitués sous forme d'entreprises particulières, aux gouvernements communautaires des temps primitifs. On peut [357] soutenir cependant que cet avantage était illimité, en ce sens que les nations qui auraient conservé le régime de la communauté politique eussent été détruites par celles qui étaient assujetties à un gouvernement d'entreprise. Si lourd et si coûteux que pût être ce gouvernement, toujours valait-il mieux qu'un gouvernement communautaire, en ce qu'il procurait un sécurité extérieure et intérieure que celui-ci était incapable de produire dans la même mesure. Ce point paraîtra décisif si l'on songe que telle est la nature des services d'un gouvernement, que l'insuffisance et l'infériorité de ces services peuvent entraîner la destruction et la ruine de la nation qui les consomme.
Quoique la qualité des services doive passer ici avant le prix dont on les paye, cette dernière considération a cependant bien aussi son importance. Il est bien clair que les consommateurs des services politiques sont intéressés à se les procurer au meilleur marché possible, comme tous les autres. Or il peut arriver qu'une entreprise produisant un article de première nécessité, comme la sécurité ou le pain, en élève le prix non seulement à un taux bien supérieur à celui des frais de la production, mais encore à celui auquel il revenait aux consommateurs lorsqu'ils le produisaient eux-mêmes. Dans ce cas, qu'ont à faire les consommateurs? Avant d'entreprendre de le produire de nouveau eux-mêmes, — ce qui, à première vue, semble la solution naturelle du problème,—ils ont à considérer : 1° s'ils peuvent le produire en qualité aussi bonne et aussi régulière qu'un entrepreneur dont c'est la spécialité, 2° à un prix de revient aussi bas. Dans la négative, —et tel est le cas pour les services d'un gouvernement comme pour tous les autres, — c'est à l'analyse des causes qui permettent au producteur d'exploiter le consommateur et à l'examen des remèdes appropriés à cette nuisance qu'ils doivent s'appliquer d'une manière exclusive.
[358]
Quelles sont les causes qui agissent pour déterminer le prix des produits ou des services? L'observation la plus élémentaire nous apprend que le prix d'un produit ou d'un service quelconque dépend, d'une part, des frais de la production, d'une autre part, de la loi de l'offre et de la demande, et que celle-ci est influencée à son tour par la situation du producteur vis-à-vis du consommateur. Trois cas peuvent se présenter : une entreprise de production peut posséder 1° un monopole illimité, 2° un monopole limité, 3° être soumise à la libre concurrence. Dans le premier cas, les consommateurs sont entièrement à la discrétion du producteur. S'il s'agit d'un article nécessaire à la vie, il peut en élever le prix hors de toute proportion avec les frais de la production, jusqu'à la limite extrême des ressources des consommateurs. Dans le second cas, si le monopole est limité, soit par la coutume (appuyée sur une force suffisante), soit par une charte ou tout autre appareil protecteur, les consommateurs pourront être préservés, en partie du moins, de l'abus de la puissance que le monopole confère au producteur, à la condition cependant, — et cette condition a été rarement remplie, — que l'appareil préservatif possède et conserve une efficacité réelle. Dans le troisième cas, si l'entreprise est soumise à la concurrence, il n'y aura plus lieu de recourir à un appareil quelconque pour modérer le prix des produits ou des services et en maintenir la qualité, la concurrence suffira, pourvu qu'elle soit entièrement libre; le prix de vente ou prix courant couvrira simplement les frais de la production avec adjonction du profit nécessaire.
Les gouvernements de l'ère de la petite industrie appartenaient aux deux premières catégories. Les uns possédaient vis-à-vis des consommateurs politiques un monopole illimité, les autres un monopole limité. Les premiers pouvaient, en conséquence, augmenter selon leur bon plaisir [359] le prix de leurs services et en abaisser la qualité. Toutefois deux circonstances agissaient pour les empêcher d'abuser de ce pouvoir excessif. C'était, d'une part, la propriété perpétuelle ou tout au moins indéfinie de leur marché, qui les intéressait à ne point ruiner leur clientèle; c'était, d'une autre part, la pression continue de la concurrence politique et guerrière qui les obligeait de même à éviter de tarir la source où ils puisaient les moyens de la soutenir. Les seconds, ceux dont le monopole était plus ou moins efficacement limité, se trouvaient obligés de compter avec les consommateurs, mais nous avons vu qu'à mesure que les Etats politiques s'étaient agrandis et unifiés, leurs propriétaires s'étaient débarrassés d'une limitation et d'un contrôle qui leur paraissaient gênants et humiliants, et qu'ils avaient recouvré, pour la plupart, l'intégrité de leur monopole. Comme, dans l'intervalle, la pression de la concurrence politique et guerrière s'était ralentie et affaiblie, la gestion des gouvernements s'était relâchée, la qualité de leurs services avait baissé tandis que le prix s'en était élevé. De là, le mécontentement de plus en plus général et accentué des consommateurs politiques et la nécessité d'un changement de régime.
II. Des gouvernements adaptés à l'état présent et futur des sociétés civilisées.—§ 1er. Position du problème à résoudre. Retour nécessaire aux lois naturelles qui président à la constitution et à la gestion des entreprises. — Qu'il existe des lois naturelles qui régissent les entreprises, que ces lois soient les mêmes pour toutes les entreprises, politiques, agricoles, industrielles ou commerciales; qu'elles continuent aujourd'hui de gouverner leur constitution et leurs opérations comme elles les gouvernaient il y a des milliers d'années, comme elles les gouverneront dans l'avenir le plus reculé; que la méconnaissance de ces lois naturelles et immuables de l'architecture et du gouvernement des entreprises ait [360] pour résultat inévitable de déterminer l'abaissement de la qualité et l'exhaussement du prix de leurs produits ou dé leurs services et finalement de précipiter leur chute, voilà ce que nous apprend l'étude économique de l'histoire du passé et mieux encore celle de l'histoire contemporaine.
Si nous considérons les gouvernements de l'ancien régime, nous constaterons, en effet, que les plus solides, ceux qui ont duré le plus longtemps et rendu les meilleurs services aux populations, étaient, invariablement, ceux-là dont la constitution et la gestion se conformaient de plus près aux lois que nous avons énumérées. Nous serons frappés aussi de la similitude qui existe entre leur constitution et leur gestion et celles des autres entreprises, industrielles ou commerciales. L'intérêt d'une famille ou d'une société limitée en nombre est le mobile qui préside à la fondation de l'établissement politique. Cet établissement est la propriété perpétuelle et héréditaire d'une « société » ou d'une «maison» qui l'exploite de père en fils, à ses frais et risques et qui subsiste des profits de son exploitation, après avoir pourvu à l'entretien et au renouvellement de son matériel et à la rétribution de son personnel. Le roi gouverne souverainement son Etat comme le chef d'industrie gouverne sa fabrique et le négociant son comptoir; il supporte toute la responsabilité de ses opérations et de ses obligations pécuniaires. L'établissement politique n'a que des attributions restreintes; il ne produit que des services essentiels mais peu variés, la sécurité intérieure et extérieure (encore les services de la justice proprement dite ont-ils fini par être confiés à une compagnie presque indépendante) et la monnaie. Toutes les autres productions sont abandonnées à la multitude des entreprises agricoles, industrielles, commerciales, constituées et gérées comme l'établissement politique qui les protège.
Si nous examinons maintenant la structure et le mode [361] de gestion des gouvernements issus de la révolution, nous reconnaîtrons qu'ils s'écartent par des points essentiels des lois qui président à la construction et à l'exploitation des entreprises industrielles ou commerciales. L'Etat a cessé d'être la chose d'une famille ou d'une association limitée, il appartient à une nation, c'est-à-dire à une communauté dont les membres se comptent par millions, dont l'intérêt dans cette entreprise est infinitésimal, et qui n'ont d'ailleurs pour la plupart ni la possibilité ni la capacité d'intervenir d'une manière active et utile dans sa gestion. Par suite de cet émiettement d'intérêts, de cet empêchement matériel et de cette incapacité de l'immense majorité de ses propriétaires, l'exploitation de l'État est livrée à des associations politiques qui tantôt s'en emparent en recourant à la force, tantôt en se la faisant adjuger pour un temps limité par l'assemblée des propriétaires, ou pour mieux dire par un corps électoral composé des propriétaires réputés politiquement capables. Sans parler des fraudes inévitables auxquelles donne lieu cette adjudication d'une entreprise dont les opérations se chiffrent par milliards, quel en est le résultat? C'est de remettre l'exploitation de l'État à une association qui, n'en ayant que la jouissance temporaire, est intéressée à en tirer la plus grande somme possible de bénéfices et d'avantages dans cet intervalle limité, dût-elle sacrifier au présent qui lui appartient l'avenir qui ne lui appartient pas. De là sa tendance irrésistible à augmenter les attributions de l'État, partant les bénéfices et avantages que son exploitation peut conférer, tendance encore développée par les nécessités de la compétition des associations organisées en vue de conquérir ou de se faire adjuger l'exploitation de l'État. Enfin, ces exploitants temporaires, quels que soient les erreurs, les fautes et même les crimes de leur gestion n'ont point à en supporter les conséquences : le seul risque qu'ils courent, c'est, à l'expiration [362] de leur jouissance, de voir l'État adjugé à d'autres; mais c'est la nation propriétaire qui supporte, avec la dépréciation de son domaine, la responsabilité des dettes dont ils l'ont grevé. Faut-il s'étonner si, en présence de ces dérogations aux lois essentielles de la construction et de la gestion des entreprises, les gouvernements n'ont plus qu'une durée éphémère, tout en imposant aux nations des sacrifices de plus en plus disproportionnés avec leurs ressources? On a remarqué avec raison qu'en admettant que les entreprises industrielles et commerciales fussent constituées et gouvernées comme les Etats politiques, elles seraient promptement vouées à la banqueroute. Si les États subsistent, c'est grâce à l'étendue des ressources des nations propriétaires et au développement progressif de leur industrie; mais si ce régime politique devait se perpétuer, il ruinerait à la longue les nations les plus riches et les plus industrieuses. Cela étant, quel est donc le problème à résoudre, problème qui s'imposera d'une manière plus pressante aux nations civilisées à mesure qu'elles subiront davantage les dommages de l'état présent des choses? Ce problème consiste à ramener les gouvernements modernes à l'observation des principes essentiels qui président à la construction et à la gestion des entreprises, en prenant pour modèles les entreprises industrielles et commerciales qui n'ont pas cessé d'être construites et gouvernées conformément à ces principes. Ainsi il faudra : 1° que l'État politique redevienne la chose d'une maison ou d'une association limitée en nombre, et dont tous les membres aient par conséquent un intérêt suffisant à ce qu'il soit bien constitué et géré; 2° que cette maison ou cette association en soit propriétaire à perpétuité, qu'elle le gère librement et souverainement sous sa responsabilité effective, sans pouvoir rejeter cette responsabilité sur les consommateurs politiques; en un mot, que la nation ne soit pas plus obligée de combler [363] les déficits et de payer les dettes de l'entrepreneur exploitant de l'État que ne l'est un consommateur de pain ou de viande de combler les déficits et de payer les dettes de son boulanger ou de son boucher; et telle était en droit, sinon toujours en fait, la situation sous l'ancien régime; enfin, que la maison ou l'association propriétaire exploitante de l'État limite, encore à l'exemple des gouvernements de l'ancien régime, et d'une manière plus rigoureuse, son industrie à la production de la sécurité, en abandonnant tous les autres produits et services, sans excepter la monnaie, aux autres entreprises. Alors, mais seulement alors, les gouvernements pourront de nouveau compter leur existence par siècles; ils cesseront d'être, suivant une expression pittoresque de J.-B. Say, les ulcères des nations.
§ 2. Forme de gouvernement adaptée au régime de la grande industrie. — Est-ce à dire que le progrès politique consiste à revenir purement et simplement aux gouvernements de l'ancien régime? Non, pas plus qu'il ne consisterait à revenir pour la construction de nos maisons et de nos édifices à l'architecture de l'ancienne Egypte, sous le prétexte que les lois de l'architecture n'ont pas changé depuis les Pharaons. La forme des édifices a changé et changera encore, si les lois qui président à leur construction sont demeurées immuables. Il en est de même de la forme des entreprises politiques et autres.
Sous l'ancien régime, la forme des gouvernements était monarchique ou oligarchique, sauf dans quelques petits cantons de la Suisse où elle était demeurée communautaire ou démocratique. Autrement dit, l'État était la propriété d'une maison ou d'une association, et cette propriété se léguait de père en fils, suivant les lois naturelles de l'hérédité, plus ou moins modifiées par des dispositions ou des conventions particulières. Tel était aussi le régime des [364] autres entreprises. Ce régime a continué de prévaloir dans celles-ci : les entreprises industrielles ou commerciales appartiennent soit à des maisons, soit à des associations. Seulement, ces dernières, qui avaient jadis une forme identique à celle des oligarchies politiques, ont été transformées par l'invention des titres transmissibles et nous avons montré les avantages de cette nouvelle forme des entreprises, malgré ce qu'elle a encore d'imparfait et de défectueux. [58] Elle est, avons-nous dit, la forme adaptée au régime de la grande industrie comme l'entreprise patrimoniale a été celle qui s'adaptait le mieux à la petite industrie. On peut donc prévoir que les « maisons politiques » disparaîtront peu à peu, comme disparaissent, dans les exploitations qui exigent de grandes accumulations de capitaux et de forces, telles que les chemins de fer, les mines, etc., les « maisons » pour faire place aux « sociétés ». Déjà il n'est point sans exemple que cette forme progressive des entreprises ait été appliquée à des établissements politiques. La Compagnie des Indes anglaises en a été le spécimen le plus célèbre, et si l'invasion des doctrines communistes en Angleterre n'avait déterminé sa suppression, elle continuerait d'être citée comme un modèle de bonne gestion politique et d'administration économique. [59]
[365]
III. Du régime économique des États politiques dans tare de la grande industrie. — § 1er. Les servitudes et leur raison [366] d'etre. — Nous venons de voir quelle sera la forme probable des États politiques dans l'ère de la grande industrie; il [367] nous reste à rechercher maintenant quel sera leur régime économique. Sera-ce le monopole illimité ou limité vis-à-vis [368] des consommateurs, comme dans l'ère de la petite industrie, ou sera-ce la concurrence? Dans toutes les autres branches [369] d'industrie, ce dernier régime est celui qui a commencé généralement à prévaloir. Les entreprises peuvent se [370] constituer librement, en nombre illimité, tandis que les consommateurs, de leur côté, sont libres de s'adresser à celles qui leur offrent les produits ou les services qu'ils jugent les meilleurs et les moins chers. Sous ce régime, le producteur est libre de constituer son entreprise, de confectionner ses produits ou ses services et d'en fixer le prix à son gré; mais le consommateur, à son tour, est libre d'accepter ou de refuser produits et services. La liberté, tel est donc le régime qui préside aux relations des producteurs et des consommateurs et qui est destiné à y présider de jour en jour davantage, dans les différentes branches de l'activité humaine.
Mais ce régime est-il actuellement applicable aux entreprises politiques? Le sera-t-il jamais?
Pour résoudre cette question, il est nécessaire que nous nous reportions encore au régime qui a prévalu jusqu'à une époque récente dans la production de la généralité des produits ou des services. Ce régime était celui de l'appropriation du marché, ou du monopole de son approvisionnement, monopole tantôt illimité, tantôt limité par la coutume ou un appareil réglementaire, et impliquant pour le consommateur une servitude restrictive de sa liberté naturelle. Les maisons ou les corporations industrielles et commerciales, aussi bien que les maisons ou les corporations politiques et religieuses, possédaient leur marché. Dans les limites de ce marché, elles ne souffraient point qu'aucun autre établissement se fondât pour leur faire concurrence ou que des établissements placés au dehors y importassent leurs produits ou leurs services. Cette propriété de leur [371] marché, elles la défendaient de tout leur pouvoir : en matière politique et religieuse, toute tentative d'empiéter sur ce marché ou de le morceler était recherchée avec un soin particulier et rigoureusement punie. L'inquisition, par exemple, avait été instituée dans le but de défendre les marchés approprié»au culte catholique, et par conséquent de sauvegarder les profits de leur exploitation, contre toute concurrence intérieure ou extérieure. De même les corporations industrielles et commerciales invoquaient le secours de la maison ou de la corporation politique pour empêcher l'importation des produits étrangers, et interdire aux autres corporations placées dans les limites de l'État d'empiéter sur leur domaine particulier. Sous le régime de l'état de guerre, ce régime, au moins dans ses applications aux articles nécessaires à la vie, ne garantissait pas seulement la sécurité des producteurs, mais encore celle des consommateurs. Dans un pays continuellement exposé à la guerre, — et n'oublions pas qu'aux époques où nous nous reportons la paix était l'exception et la guerre la règle, — si les entreprises agricoles et industrielles n'avaient point possédé leur marché, il leur eût été impossible de proportionner leur production aux besoins de la consommation. Dans les intervalles de paix, les produits importés du dehors auraient dérangé toutes les prévisions des producteurs en leur causant des pertes ruineuses et déterminé, dans la production intérieure, une diminution qui, la guerre survenant de nouveau, et avec elle l'interruption des communications extérieures, eût exposé les consommateurs à la privation de produits nécessaires. Les servitudes agricoles et industrielles constituaient donc pour eux aussi bien que pour les producteurs une véritable assurance. Cependant, à mesure que les guerres sont devenues moins fréquentes et les communications internationales plus faciles, l'utilité de cette assurance a diminué, et les gouvernements se [372] sont moins appliqués à la garantir. Ils ont cessé de maintenir dans son intégrité la prohibition des produits étrangers, d'abord en autorisant, moyennant redevance, l'établissement des foires ou marchés temporaires libres; ensuite, en autorisant, en tous temps, l'importation de la plupart des denrées et marchandises, sous payement d'une taxe ou « droit d'entrée » ; ils ont laissé envahir le marché des corporations soit par de nouvelles maîtrises qu'ils autorisaient moyennant finance, soit par des entreprises libres qu'ils assujettissaient simplement au droit de patente; enfin, ils ont établi, comme un fait général, la liberté de l'industrie et du commerce à l'intérieur, substituant ainsi au dedans des frontières de l'État la concurrence au monopole.
La nécessité de cette assurance en cas de guerre était, comme on sait, le plus fort argument des protectionnistes anglais contre le rappel des lois-céréales. L'abrogation de ces lois tutélaires placerait, disaient-ils, l'Angleterre sous la dépendance de l'étranger pour sa subsistance, et ils faisaient ressortir, avec une inquiétude vraie ou simulée, les dangers d'un tel état de choses. L'événement leur a donné raison sur le premier point, car l'Angleterre achète aujourd'hui à l'étranger plus de la moitié de la masse des denrées alimentaires qui entrent dans sa consommation; en revanche, grâce au développement extraordinaire des moyens de communication le risque qu'une guerre peut lui faire courir de ce chef s'est singulièrement atténué. C'est pourquoi la nation anglaise a préféré s'y exposer plutôt que de continuer à payer, pour le couvrir, la prime de renchérissement des lois-céréales. [60]
Quant à la religion, aussi longtemps qu'elle est demeurée un instrument de gouvernement, son marché a été protégé à [373] l'égal de celui de l'Etat; mais à mesure que les liens qui attachaient l'Église à l'État se sont relâchés, la servitude religieuse a. été moins garantie et elle est en train de disparaître.
Au moment où nous sommes, le régime de la liberté de l'industrie, impliquant la concurrence intérieure, a généralement prévalu dans les États civilisés, tant pour les produits de l'agriculture, de l'industre et des arts que pour les services religieux, et les progrès de la liberté commerciale [374] y ajoutent, de plus en plus, la concurrence extérieure. L'ancien régime des marchés appropriés n'existe plus que pour un petit nombre d'industries, les unes réputées en possession d'un monopole naturel et soumises à une réglementation destinée à le limiter, les autres englobées, pour des raisons diverses, dans la régie de l'État.
§ 2. La servitude politique. — Cet ancien régime des marchés appropriés, tous les États se sont appliqués, en revanche, à le conserver pour leurs propres services. Les États issus de la révolution se sont même montrés plus encore que les autres jaloux de le maintenir, et de perpétuer, apparemment dans l'intérêt de la liberté, la servitude politique. En France, le gouvernement révolutionnaire a commencé par proclamer l'indivisibilité de la République, et le gouvernement de l'Union américaine a sacrifié à cette nécessité, réelle ou supposée, un million de vies humaines et quinze ou vingt milliards de francs, engloutis dans la guerre de sécession. Toute tentative de séparation est considérée comme un crime de haute trahison que les républiques démocratiques aussi bien que les monarchies absolues ou constitutionnelles réprouvent avec horreur et châtient avec sévérité. [61] On va même plus loin : en vue de prévenir [375] les tentatives de morcellement du marché politique, on oblige les populations suspectes de tendances sécessionnistes à renoncer à leurs institutions et à leur langue, et on leur impose les institutions et la langue dites « nationales».
Il s'agit de savoir si ces mesures répressives et préventives, sans parler de la réprobation morale, sont justifiées ou non; si, tandis que le progrès a consisté à supprimer les servitudes industrielles, commerciales et religieuses qui assuraient aux corporations de l'ancien régime la propriété de leur marché, à l'exclusion de toute concurrence intérieure ou extérieure, cette servitude doit être maintenue pour le marché politique; s'il est, et s'il sera toujours nécessaire que les consommateurs politiques demeurent assujettis à la maison, à la corporation ou à la nation propriétaire exploitante de l'Etat, et contraints de consommer ses services bons ou mauvais ; s'ils ne pourront jamais posséder la liberté de fonder des entreprises politiques en concurrence avec celle-là, d'accorder leur clientèle à des entreprises concurrentes ou même de ne l'accorder à aucune dans le cas où ils trouveraient plus d'avantage à demeurer les propres assureurs de leur vie et de leur propriété; s'il est, en un mot, dans la nature des choses que la servitude politique se perpétue et que les hommes ne puissent jamais posséder la liberté de gouvernement.
Il est clair que cette servitude, — la plus onéreuse de toutes, car elle s'applique à des services de première [376] nécessité, — ne peut être maintenue, sous un régime où la liberté est de droit commun, qu'à une condition, c'est d'être motivée par l'intérêt général. Si cet intérêt exige que les propriétaires exploitants des établissements politiques demeurent investis de la propriété intégrale de leur marché, aussi longtemps du moins qu'ils ne sont pas obligés de céder une partie de ce marché, à la suite d'une guerre malheureuse, ou qu'ils ne jugent point avantageux de s'en dessaisir par une vente ou un troc, « la liberté de gouvernement » ne saurait être établie utilement comme l'ont été la liberté des cultes, de l'industrie et du commerce. Dans cette hypothèse le droit de sécession devrait être à jamais frappé d'interdit ou, pour mieux dire, il n'y aurait pas de droit de sécession. Il convient de remarquer toutefois que des brèches importantes ont déjà été faites à cette partie du vieux droit public, sous l'influence des changements que les progrès de la sécurité, de l'industrie et des moyens de communication ont introduits dans les relations des peuples civilisés. Si les gouvernements n'admettent aucune concurrence dans les limites de leur marché, ils ont généralement renoncé à empêcher leurs sujets de faire acte de sécession individuelle par voie d'émigration et de naturalisation à l'étranger. En revanche, ils n'admettent aucun acte de sécession collective, qui entame leur domaine territorial. Toutefois encore, si les sécessionnistes sont assez forts pour opérer cette séparation comme l'ont été les colons anglais et espagnols de l'Amérique du Nord et du Sud, les anciens propriétaires exploitants de ces marchés séparés se résignent à accepter le « fait accompli » et ils finissent même par reconnaître la légitimité des gouvernements sécessionnistes. Mais dans ce cas ils ne cèdent qu'à la force, et il est presque sans exemple qu'une sécession ait été accomplie à l'amiable.
Examinons donc quels motifs peuvent être invoqués en [377] faveur du maintien de la servitude politique, —en prenant ce mot dans son acception économique, — tandis que les autres servitudes ont cessé généralement d'être considérées comme nécessaires.
§ 3. Raison d'être de la servitude politique. — Sous l'ancien régime, cette servitude était, comme toutes les autres, motivée par les nécessités de l'état de guerre. En supposant qu'une partie de la nation eût possédé le droit de se séparer de l'État soit pour s'annexer à un État concurrent soit pour fonder un État indépendant, soit enfin pour vivre sans gouvernement, l'exercice de ce droit eût produit une nuisance générale, nuisance d'autant plus grande que la nation eût été exposée à être envahie, détruite ou assujettie par des peuples moins avancés, tels que les barbares qui menaçaient les frontières des Etats de l'antiquité et du moyen âge. La sécession d'une partie de la population, en diminuant ou simplement en divisant les forces de l'Etat eût aggravé le risque de destruction, d'asservissement et en tous cas de recul de civilisation qui pesait sur la nation à laquelle l'Etat servait de rempart. On peut comparer la situation des nations civilisées, dans cette période de l'histoire, à celle des populations des contrées menacées incessamment, comme la Hollande, par les flots de l'océan. Il est nécessaire que tous les habitants, sans exception, contribuent à l'entretien des digues; ceux qui s'y refuseraient profiteraient indûment d'un appareil de défense dont ils ne supporteraient point les frais; ils augmenteraient d'autant les charges des autres, et si les ressources de ceux-ci ne suffisaient point pour élever des digues assez solides et assez hautes, ils s'exposeraient eux-mêmes à être victimes de leur malhonnête égoïsme; ceux qui s'obstineraient à établir des digues particulières sans les rattacher au système commun compromettraient de même l'œuvre nécessaire de la défense contre l'élément destructeur. Aux époques où [378] la civilisation était menacée par la barbarie, la servitude politique s'imposait donc comme une absolue nécessité. En revanche, elle a perdu en grande partie sa raison d'être depuis que la supériorité des forces a passé du côté des peuples civilisés. Cependant elle peut encore être motivée, quoique à un degré moindre, par les inégalités de civilisation qui subsistent de pays à pays.
Dans l'état actuel du monde, bien que la supériorité des forces physiques et morales, des ressources et des connaissances techniques qui sont les matériaux de la puissance militaire, appartienne visiblement aux nations les plus civilisées, on ne saurait affirmer qu'elles soient entièrement à l'abri des invasions des peuples moins avancés. Sans doute, les populations de l'Empire russe, par exemple, n'ont aucun intérêt à envahir l'Europe centrale et occidentale, à la manière des hordes barbares et pillardes qui détruisirent jadis l'Empire romain ; mais dans l'état arriéré où se trouve encore la constitution politique de l'Europe, ce n'est pas l'intérêt général des populations qui décide de la paix et de la guerre. Tantôt, c'est l'intérêt bien ou mal entendu d'une maison souveraine et de l'armée de fonctionnaires militaires et civils sur laquelle elle s'appuie; tantôt c'est l'intérêt d'un parti, dont l'état-major se recrute dans une classe vivant du budget et de ses attenances et à laquelle la guerre fournit un accroissement de débouchés, partant de bénéfices, ou simplement dont elle peut, suivant les circonstances, consolider la domination. Dans cette situation et aussi longtemps qu'elle subsistera, les peuples les plus civilisés demeureront exposés au risque de l'invasion et de la conquête, et la « servitude politique » conservera jusqu'à un certain point sa raison d'être. Mais que cet état de choses vienne à cesser, que l'intérêt général des « consommateurs politiques » acquière assez de puissance pour maîtriser les appétits d'exploitation et de rapine des [379] producteurs, que le risque d'invasion et de conquête s'affaiblisse en même temps que s'effaceront, sous l'influence de la multiplicité des échanges, et du rayonnement des lumières, les inégalités de civilisation, la « servitude politique » perdra toute raison d'être, la « liberté de gouvernement » deviendra possible.
§ 4. Système de gouvernement approprié à la servitude politique. Le régime constitutionnel ou contractuel. — En attendant, les « consommateurs politiques » devront se résigner à supporter les défectuosités naturelles du vieux régime de l'appropriation des marchés, sauf à recourir aux moyens, malheureusement toujours imparfaits et insuffisants, de limiter la puissance du monopole auquel ils se trouvent assujettis. Le système adapté actuellement à cet état de choses est celui du gouvernement constitutionnel ou pour mieux dire contractuel, monarchique ou républicain, se résolvant dans un contrat débattu et conclu librement entre la « maison » ou la « société » productrice des services politiques et la nation qui les consomme.
Seulement, ce système doit être établi de manière à respecter les lois naturelles qui régissent toutes les entreprises, politiques, industrielles ou commerciales, soit qu'elles possèdent un monopole, soit qu'elles se trouvent soumises à la concurrence. Il faut que la mai son ou la société politique possède un capital proportionnné à l'importance et aux exigences de son entreprise, capital immobilier et mobilier, investi sous forme de forteresses, de matériel et de provisions de guerre, de bureaux d'administration et de police, de prisons, de monnaie destinée au paiement de ses employés et de ses ouvriers civils et militaires, etc., etc. ; qu'elle soit maîtresse d'organiser son exploitation et de recruter son personnel, sans qu'aucune condition ou limite lui soit imposée. En revanche, il faut qu'elle subisse la responsabilité pécuniaire de ses actes et de ses entreprises; qu'elle [380] en supporte les pertes sans pouvoir les rejeter sur les consommateurs, sauf dans les cas de force majeure, — une invasion de barbares par exemple, —spécifiés dans le contrat; qu'elle en recueille les bénéfices, sauf encore à partager ceux-ci avec les consommateurs, au-dessus d'un certain taux fixé de même dans le contrat ; il faut enfin que ses pouvoirs et ses attributions soient strictement limités à ce qu'exige le bon accomplissement de ses services, qui consistent à préserver de toute atteinte intérieure et extérieure la vie et la propriété des consommateurs politiques, sans qu'il lui soit permis d'empiéter sur le domaine des autres industries. Telles doivent être, en substance, les conditions du contrat si l'on veut que les maisons ou les sociétés productrices de services politiques puissent, de nouveau, fonctionner d'une manière utile et durable. C'est pour les avoir méconnues, sous l'influence des doctrines et des faits révolutionnaires, c'est pour avoir cessé de tenir compte, dans la constitution et le fonctionnement des entreprises politiques, des lois naturelles qui régissent toutes les entreprises que l'on a essayé en vain de fonder des gouvernements économiques et stables, et que l'on n'a pas réussi davantage à adapter à l'état présent des sociétés ceux que nous a légués l'ancien régime.
Cependant, ces conditions du contrat politique, les nations peuvent-elles les débattre elles-mêmes et en surveiller l'exécution? N'est-il pas indispensable qu'elles choisissent des mandataires, d'abord pour rédiger le contrat après en avoir débattu les clauses avec les délégués de la maison ou de l'association politique, ensuite pour le modifier et le perfectionner s'il y a lieu, enfin pour surveiller et contrôler la fourniture des services politiques, sous le double rapport de la qualité et du prix, régler le compte de participation de la nation aux pertes et aux bénéfices de l'entreprise? Cette nécessité a été considérée jusqu'à [381] présent comme indiscutable. Toutefois, en présence de la corruption à peu près inévitable du régime représentatif, on peut se demander si les garanties qu'on croit y trouver ne sont pas, le plus souvent, illusoires, s'il ne serait pas préférable d'abandonner aux consommateurs eux-mêmes le soin de débattre les conditions du contrat, de le modifier et d'en surveiller l'exécution, sans leur imposer aucune formule de représentation. Sans doute, les consommateurs politiques sont individuellement incapables de se charger de cette tâche, mais des associations librement formées entre eux ne pourraient-elles pas s'en acquitter avec l'auxiliaire de la presse? Dans les pays où la masse de la population ne possède ni la capacité ni les loisirs nécessaires pour s'occuper des choses de la politique, cette représentation libre des consommateurs, recrutée parmi ceux qui possèdent cette capacité et ces loisirs, ne serait-elle pas un instrument de contrôle et de perfectionnement de la gestion do l'État plus efficace et moins sujet à se rouiller ou à se vicier que la représentation officielle d'une multitude ignorante ou d'une classe privilégiée?
§ 5. La liberté de gouvernement. —Un jour viendra toutefois, et ce jour n'est peut-être pas aussi éloigné qu'on serait tenté de le supposer en considérant la marche rétrograde que la révolution a imprimée aux sociétés civilisées; un jour viendra, disons-nous, où la servitude politique perdra toute raison d'être et où la liberté de gouvernement, autrement dit la liberté politique, s'ajoutera au faisceau des autres libertés. Alors, les gouvernements ne seront plus que des sociétés d'assurances libres sur la vie et la propriété, constituées et organisées comme toutes les sociétés d'assurances. De même que la communauté a été la forme de gouvernement adaptée aux troupeaux et aux tribus des temps primitifs, que l'entreprise patrimoniale ou corporative, avec monopole absolu ou limité par des [382] coutumes, des chartes, des constitutions ou des contrats, a été celle des nations de l'ère de la petite industrie; l'entreprise par actions avec marché libre sera, selon toute apparence, celle qui s'adaptera aux sociétés de l'ère de la grande industrie et de la concurrence. [62]
IV. La commune et son avenir. — Dans les temps primitifs, les sociétés embryonnaires, vivant de la chasse, de la pêche et de la récolte des fruits naturels du sol, formaient des communautés politiques, au gouvernement et à la défense desquelles tous leurs membres étaient obligés de contribuer. Dans la période suivante, lorsque la mise en culture régulière des plantes alimentaires et la création de la petite industrie eurent permis aux hommes de se multiplier en proportion de l'énorme accroissement de leurs moyens de subsistance, les fonctions politiques, devenues productives, se séparèrent et se spécialisèrent entre les mains d'une corporation ou d'une maison, fondatrice et exploitante de l'État. Soit qu'il fût partagé entre les membres de la corporation et formât un ensemble de seigneuries rattachées par les liens de la féodalité, soit qu'il se concentrât entre les mains d'un seul maître et propriétaire héréditaire, ce domaine politique dut être subdivisé en raison des nécessités de sa gestion. Cette subdivision s'opéra de deux manières : tantôt elle fut l'œuvre des propriétaires exploitants de l'État, tantôt celle des populations qui leur étaient assujetties.
Dans tous les pays où la population conquise a été réduite en esclavage, la commune, par exemple, ne se constitue ou pour mieux dire ne se reconstitue qu'à l'époque où les esclaves passent à l'état de serfs; dans ceux où les [383] conquérants se bornent à assujettir les habitants au servage, la commune est constituée par la tribu ou le troupeau primitif, fixé au sol, d'abord par les nécessités de l'exploitation de l'agriculture et des métiers, ensuite par l'intérêt du propriétaire du domaine politique qui vit de l'exploitation du cheptel humain de ce domaine, en l'obligeant à en cultiver une partie à son profit, et en lui laissant la jouissance du reste. Mais soit qu'il s'agisse d'une population passée de l'esclavage au servage ou immédiatement réduite à cette forme progressive de la servitude, le propriétaire politique, roi ou seigneur, ne s'impose la peine et les frais nécessaires pour la gouverner qu'autant qu'il y est intéressé et dans la mesure de son intérêt. Il laisse les groupes ou les communautés se former à leur convenance suivant la configuration du sol, la facilité des communications locales, la langue et les affinités de race ou de caractère, sauf à empêcher chaque commune d'empiéter sur les limites des autres ou de franchir celles de son domaine. [63] Il les laisse encore suivre leurs coutumes, parler leur langue ou leur patois, se servir de leurs poids et mesures, pourvoir, à leur guise, à leurs divers besoins individuels ou collectifs, en exceptant seulement les services susceptibles de lui valoir une rétribution ou un profit. Il les oblige par exemple à lui acheter du sel, à se servir de sa monnaie, de son four et de son pressoir; enfin, il les soumet à sa justice, [384] au moins quand il s'agit de crimes ou de délits qui troublent la paix du domaine et surtout d'atteintes à ses droits et de révoltes contre sa domination. Les communes forment d'autres groupements, des cantons, des bailliages pour l'établissement et l'entretien des moyens de communication, la perception des redevances, et plus tard, lorsque les seigneuries sont absorbées dans le domaine royal, elles forment des provinces administrées par un intendant. Certaines communes favorablement situées pour l'industrie et le commerce prennent un développement considérable; elles deviennent des villes; les industries et les métiers se constituent en corporations, dont les chefs ou les notables administrent la cité sous l'autorité du seigneur. Il arrive alors, surtout lorsque le seigneur exige des redevances trop lourdes; lorsque son joug est tyrannique ou bien encore lorsque les magistrats et les meneurs du peuple sont affamés de domination, que les communes veulent s'affranchir de l'autorité seigneuriale et se gouverner elles-mêmes. Quelquefois le seigneur consent à leur vendre la franchise, en capitalisant la somme des redevances ; d'autres fois, elles entreprennent de la conquérir par la force. En France, le roi favorise cette insurrection des communes, en vue d'abaisser la puissance des seigneurs. Mais il arrive rarement que les communes affranchies réussissent à se bien gouverner elles-mêmes. Tantôt la population est exploitée par l'oligarchie des métiers, tantôt la commune est le théâtre de la lutte des partis, recrutés les uns dans la bourgeoisie, les autres dans la populace, qui se disputent l'exploitation du petit État communal. C'est une lutte analogue à celle dont nous sommes aujourd'hui témoins, dans les pays où l'État est devenu la propriété de la nation. Cependant, lorsque les grandes seigneuries eurent absorbé les petites et, plus tard, lorsque la royauté eut absorbé les grandes, on vit disparaître ce que les communes et [385] les provinces avaient acquis ou conservé d'indépendance. Telle était la disproportion entre les forces dont disposait le maître d'un grand État et celles d'une commune ou même d'une province que toute lutte était désormais impossible entre eux. La conséquence fut que communes et provinces ne conservèrent que la portion du gouvernement d'elles-mêmes que le maître de l'État ne trouva aucun profit à leur enlever ou qui aurait été pour lui une charge sans compensation suffisante. Telle était la situation lorsque la Révolution éclata.
Tout en faisant passer entre les mains de leurs intendants et de leurs autres fonctionnaires civils et militaires les attributions et les pouvoirs exercés auparavant par les seigneurs et leurs officiers, en augmentant même ces attributions et ces pouvoirs, aux dépens de ceux des agents du self government communal ou provincial, les rois avaient cependant respecté, dans une certaine mesure, les coutumes locales, et ils ne s'étaient point avisés de toucher aux groupements qui s'étaient formés naturellement, dans le cours des siècles, sous l'influence des besoins et des affinités des populations. Mais cet état de choses ne pouvait trouver grâce devant les novateurs ignorants et furieux qui prétendaient refondre et régénérer d'emblée la société française. Ils découpèrent, suivant leur fantaisie, les circonscriptions provinciales, et remplacèrent les trente-deux provinces du royaume par quatre-vingt-trois départements, en triplant ainsi ou à peu près le haut personnel à appointements de l'administration. En même temps, ils portèrent à son maximum de développement la centralisation qui avait été, sous l'ancien régime, la conséquence naturelle de l'absorption successive des petites souverainetés seigneuriales dans le domaine politique du roi, et à laquelle avait contribué aussi une cause purement économique. En effet, à mesure que la productivité de l'industrie s'augmentait sous [386] l'influence des inventions mécaniques et autres, on voyait s'accroître la rétribuabilité des fonctions gouvernantes de tout ordre; il devenait par conséquent avantageux de faire passer, dès qu'elles devenaient rétribuables, les fonctions du self government local dans le domaine de l'administration centrale. C'étaient autant de situations qui élargissaient le débouché administratif et augmentaient l'importance et l'influence du haut personnel, distributeur des places. L'administration centrale alla ainsi grossissant aux dépens du self government local qui ne conserva plus que des attributions subordonnées, faiblement rétribuées ou gratuites.
Cette centralisation des services avait des avantages et des inconvénients : des avantages, en ce que les fonctionnaires ouïes employés spécialisés et suffisamment rétribués de l'administration générale d'un pays peuvent posséder, à un plus haut degré, les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et s'en acquitter mieux que des fonctionnaires ou des employés à besognes multiples, à appointements insuffisants ou sans appointements d'une administration locale; à quoi il faut ajouter qu'ils sont moins accessibles aux influences et aux passions de clocher; des inconvénients, en ce que les moindres affaires passant par une longue filière administrative ne peuvent être résolues qu'après de nombreux délais, quelle que soit l'urgence d'une solution. Ces avantages et ces inconvénients sont devenus, comme on sait, une source inépuisable de débats entre les partisans de la centralisation et ceux de la décentralisation : les uns voulant augmenter les attributions du gouvernement central aux dépens des sous-gouvernements départementaux et communaux; les autres prétendant, au contraire, réserver au département et à la commune l'examen et la solution définitive de toutes les affaires locales. Mais ni les uns ni les autres ne se sont avisés [387] de rechercher s'il n'y avait pas lieu de diminuer et de simplifier ces attributions, en abandonnant à l'industrie privée une partie des services accaparés par l'État, le département ou la commune. Quelle que fût l'issue de ces débats, elle ne pouvait donc avoir pour résultat de diminuer les charges des consommateurs de services publics.
La décadence de l'ancien régime et la rétrogression vers le communisme politique qui a caractérisé le régime nouveau, en déterminant l'éclosion des partis et leur compétition pour l'exploitation de l'État devaient, au contraire, avoir pour conséquence d'accroître le nombre et le poids des fonctions de tout ordre constituant le butin nécessaire de ces armées politiques.'Sans doute, la portion de ce butin que pouvaient fournir les administrations locales était de moindre valeur que celle qui formait le contingent de l'administration centrale. Un bon nombre de fonctions même, celles de conseillers communaux et départementaux, de maires et d'adjoints étaient demeurées gratuites ou ne procuraient que de faibles indemnités, et ceux qui les briguaient ne manquaient pas de faire sonner bien haut leur désintéressement et leur dévouement patriotique, mais elles étaient investies d'une influence qui se monnayait d'une manière ou d'une autre en avantages matériels; elles étaient d'ailleurs le chemin qui conduisait aux autres. C'est pourquoi nous avons vu, sous l'influence des mêmes causes qui ont agi pour augmenter les attributions et grossir le budget de l'État, croître les attributions et les budgets locaux, particulièrement dans les villes. La tendance des administrations urbaines a été de transformer la commune en un petit État, autant que possible indépendant du grand, ayant entre ses mains non seulement les services de l'édilité et de la voirie, mais encore la police, l'instruction publique, les théâtres, les beaux-arts, taxant à sa guise la population et s'entourant, à l'instar de l'État central, d'une muraille [388] douanière fiscale, et même protectrice de l'industrie municipale. Les dépenses communales, départementales ou provinciales ont crû, en conséquence, dans une progression qui dépasse même, dans certaines communes, celle des dépenses de l'État, et le résultat a été que la vie y est devenue de plus en plus chère. Il semblerait au premier abord que le gouvernement central dût s'opposer à ce débordement des dépenses locales, en vue de sauvegarder ses propres recettes. Il a interdit, en effet, aux communes d'empiéter sur ses attributions et il a veillé à ce qu'elles n'établissent point des impôts qui puissent faire aux siens une concurrence nuisible, mais il n'a rien fait pour les empêcher d'étendre leurs attributions aux dépens de l'industrie privée, et cela se conçoit aisément : les partis politiques en possession du gouvernement ou aspirant à le posséder ne sont-ils pas intéressés à l'accroissement du butin des places et des situations influentes, aussi bien dans la commune, le département ou la province que dans l'État, puisque ce butin constitue le fonds de rétribution de leur personnel?
Cependant un moment viendra où ce fardeau, aujourd'hui si rapidement croissant, ne pourra plus s'accroître, où une évolution analogue à celle dont nous avons montré l'inévitable nécessité dans l'État, devra s'opérer dans la commune, le département ou la province. Cette évolution sera déterminée : 1° par l'impossibilité où se trouveront les administrations locales de couvrir plus longtemps leurs dépenses au moyen de l'impôt ou de l'emprunt; 2° par la concurrence intercommunale et régionale, activée par le développement des moyens de communication et la facilité croissante des déplacements de l'industrie et de la.population. Les localités où les frais de production de l'industrie et le prix de la vie seront surélevés à l'excès par les taxes locales courront le risque d'être abandonnées pour celles [389] où cette cause de renchérissement sévira avec une moindre intensité; elles seront obligées alors, sous peine de ruine, de restreindre leurs attributions et leurs dépenses. En dehors de l'édilité et de la voirie, comprenant les services des égouts, des moyens de communication, du pavage, de l'éclairage et de la salubrité, il n'y a pas un seul service municipal qui ne puisse être abandonné à l'industrie privée. Enfin, si nous considérons ces services mêmes, nous nous apercevrons que la tendance déjà manifeste du progrès consiste à les annexer aux industries immobilières qui pourvoient à l'exploitation des immeubles et du sol, et par conséquent à en incorporer directement les frais dans les prix de revient de ces industries.
Essayons, en recourant à une simple hypothèse, de donner une idée du modus operandi de cette transformation progressive. Supposons qu'une société immobilière se constitue pour construire et exploiter une ville nouvelle (et ne voyons-nous point déjà des sociétés de ce genre construire des rues et même des quartiers?) sous la condition de demeurer pleinement libre de la bâtir, de l'entretenir et de l'exploiter à sa guise, sans qu'aucune administration centrale ou locale s'avise de se mêler de ses affaires ; comment procédera-t-elle? Elle commencera d'abord par acheter l'emplacement nécessaire dans la localité qu'elle jugera la mieux située, la plus aisément accessible et la plus salubre; elle convoquera ensuite des architectes et des ingénieurs pour tracer les plans et faire les devis de la future cité, et, parmi ces plans et devis, elle choisira ceux qui lui paraîtront les plus avantageux. Les entrepreneurs et les ouvriers de l'industrie du bâtiment et de la voirie se mettront aussitôt à l'œuvre. On percera les rues, on construira des maisons d'habitation appropriées aux différentes catégories de locataires, on n'oubliera pas les écoles, les églises, les théâtres, les salles de réunion. Cependant il ne suffit pas, pour [390] attirer les locataires, de mettre à leur disposition des logements, des écoles, des théâtres et même des églises ; il faut que les habitations accèdent à des rues bien pavées et éclairées, que les habitants puissent se procurer chez eux l'eau, le gaz et l'électricité; qu'ils aient à leur service des véhicules variés et à bon marché, enfin que leurs personnes et leurs propriétés soient préservées de toute nuisance dans l'enceinte de la cité. Mieux tous ces services seront remplis, moins cher ils coûteront et plus rapidement se peuplera la nouvelle cité. Que fera donc la compagnie propriétaire? Elle fera paver les rues, établir des trottoirs, creuser des égouts, construire et décorer des squares; elle traitera avec d'autres entreprises, maisons ou compagnies, pour la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la sécurité, des tramways, des chemins de fer aériens ou souterrains, c'est-a-dire pour les services qui ne peuvent, en vertu de leur nature particulière, être individualisés ou faire l'objet d'une concurrence illimitée dans l'enceinte limitée de la cité. Pour les omnibus et les voitures de place, elle se bornera, au contraire, à faire appel à la concurrence, sauf dans le cas où celle-ci ne pourrait se développer par suite de l'insuffisance de la demande; elle stipulera dans ce cas l'établissement d'un tarif maximum, tout en demandant aux entrepreneurs de locomotion aussi bien qu'aux propriétaires de voitures particulières un abonnement au pavage et à l'éclairage. Elle établira des règlements de voirie et de salubrité; interdira ou isolera les entreprises dangereuses, insalubres, incommodes ou immorales. En outre, comme il est possible que le plan de la cité doive être modifié plus tard, qu'il faille élargir certaines rues, en supprimer d'autres, la compagnie se réservera le droit de reprendre la disposition de ses immeubles, moyennant une indemnité proportionnée à la durée des baux restant à courir ; mais il est clair qu'elle n'usera de ce droit qu'en vue d'augmenter les produits de. [391] son exploitation. Cette exploitation, elle l'administrera soit elle-même, soit au moyen d'une agence urbaine, chargée d'une part du bon entretien de la cité et de la surveillance des différents services y attenant, d'une autre part de la perception des loyers, dans lesquels seront compris les services qui ne peuvent être séparés de la jouissance de l'habitation, tels que la police locale, les égouts, le pavage et l'éclairage des rues.
Une compagnie ainsi constituée pour exploiter sur une grande échelle l'industrie du logement sera intéressée à diminuer autant que possible les frais de construction, d'entretien et de gestion de ses immeubles et elle aura pour tendance naturelle d'élever autant que possible le taux de ses loyers. Si elle jouissait d'un monopole, cette tendance ne pourrait être combattue et neutralisée que par une coutume ou une réglementation analogue à celle qui limitait jadis le pouvoir de toutes les industries de monopole; mais, grâce à la multiplicité des moyens de communication et à la facilité des déplacements, ce monopole n'existe plus pour l'industrie du logement. Il n'est besoin d'aucun appareil artificiel pour protéger les consommateurs; la concurrence suffit pour obliger les producteurs de logements, si vastes que soient leurs entreprises, à améliorer leurs services et à abaisser leurs prix au taux nécessaire pour rétribuer leur industrie.
Poursuivons maintenant notre hypothèse. Supposons que la situation favorable de la nouvelle cité, la bonne gestion des services urbains et la modicité du taux des loyers agissent pour attirer la population et qu'il devienne avantageux de construire un supplément d'habitations. N'oublions pas que les entreprises de tous genres ont leurs limites nécessaires, déterminées par la nature et le degré d'avancement de leur industrie, et qu'en deçà comme au delà de ces limites, leurs frais de production vont croissant [392] et leurs bénéfices diminuant. Si la compagnie qui a construit et qui exploite la cité estime que ces limites se trouvent atteintes, elle laissera à d'autres le soin de l'agrandir. On verra donc se former d'autres compagnies immobilières qui construiront et exploiteront des quartiers nouveaux, lesquels feront concurrence aux anciens, mais augmenteront cependant la valeur de l'ensemble, en accroissant le pouvoir d'attraction de la cité agrandie. Entre ces compagnies exploitantes celle-là du noyau de la cité, celles-ci de nouvelles rues ou quartiers, il y aura des rapports nécessaires d'intérêt mutuel pour le raccordement des voies, des égouts, des tuyaux du gaz, l'établissement des tramways etc. ; elles seront, en conséquence, obligées de constituer une union ou un syndicat permanent pour régler ces différentes questions et les autres affaires résultant de la juxtaposition de leurs propriétés, et la même union devra s'étendre, sous l'influence des mêmes nécessités, aux communes rurales du voisinage. Enfin, si des différends surgissent entre elles, elles devront recourir à des arbitres ou aux tribunaux pour les vider.
Ainsi se transformeront, selon toute apparence, les communes en entreprises libres pour l'exploitation de l'industrie du logement et de ses attenances naturelles. En supposant que la propriété et l'exploitation immobilières individuelles continuent de subsister à côté de la propriété et de l'exploitation actionnaires, — malgré la supériorité économique de celles-ci, — les différents propriétaires exploitants de la cité, individus ou sociétés, formeront une union pour régler toutes les questions d'intérêt commun , union dans laquelle ils auront une participation proportionnée à la valeur de leurs propriétés. Cette union, composée des propriétaires, individus ou sociétés, ou de leurs mandataires, réglerait toutes les affaires de voirie, de pavage, d'éclairage, de salubrité, de sécurité par abonnement [393] ou autrement, et elle se mettrait en rapport avec les unions voisines pour le règlement commun de ces mêmes affaires, en tant toutefois que la nécessité de cette entente se ferait sentir. Ces unions seraient toujours libres de se dissoudre ou de s'annexer à d'autres, et elles seraient naturellement intéressées à former les groupements les plus économiques pour pourvoir aux nécessités inhérentes à leur industrie.
Tandis que les doctrines révolutionnaires et socialistes ont pour tendance d'augmenter incessamment les attributions de la commune ou de l'État, transformé en une vaste commune, en faisant entrer dans sa sphère d'activité toutes les industries et tous les services, ainsi rassemblés et confondus dans un monstrueux monopole, l'évolution, suscitée parles progrès de l'industrie et de la concurrence, agit au contraire pour spécialiser toutes les branches de la production, en y comprenant celles qui sont exercées par la commune et l'Etat, et les attribuer à des entreprises librement constituées et soumises à Faction à la fois propulsive et régulatrice de la concurrence. Ces entreprises libres n'en ont pas moins des rapports déterminés par les nécessités de leur industrie, De là une organisation naturelle mais libre qui va se développant et se modifiant avec ces nécessités mêmes.
C'est ainsi qu'au lieu d'absorber l'organisme de la société, suivant la conception révolutionnaire et communiste, la commune et l'Etat se fondent dans cet organisme. Leurs fonctions se divisent et la société est composée d'une multitude d'entreprises formant, sous l'empire de nécessités communes qui dérivent de leur nature particulière, des unions ou des États libres exerçant chacun un'e fonction spéciale. L'avenir n'appartient donc ni à l'absorption de la société par l'État, comme le prétendent les communistes et les collectivistes, ni à la suppression de l'État, comme le [394] rêvent les anarchistes et les nihilistes, mais à la diffusion de l'État dans la société. C'est, pour rappeler une formule célèbre, l'État libre dans la Société libre.
V. La souveraineté individuelle et la souveraineté politique. — L'homme s'approprie l'ensemble des éléments et des forces physiques et morales qui constituent son être. Cette appropriation est le résultat d'un travail de découverte ou de reconnaissance de ces éléments et de ces forces, et de leur application à la satisfaction de ses besoins, autrement dit de leur utilisation. C'est la propriété personnelle. L'homme s'approprie et se possède lui-même. Il s'approprie encore,— par un autre travail de découverte, d'occupation, de transformation et d'adaptation, — le sol, les matériaux et les forces du milieu où il vit, en tant qu'ils sont appropriables. C'est la propriété immobilière et mobilière. Ces éléments et ces agents qu'il s'est appropriés dans sa personne et dans le milieu ambiant, et qui constituent des valeurs, il agit continuellement, sous l'impulsion de son intérêt, pour les conserver et les accroître. Il les façonne, les transforme, les modifie ou les échange à son gré, suivant qu'il le juge utile. C'est la liberté. La propriété et la liberté sont les deux facteurs ou les deux composantes de la souveraineté.
Quel est l'intérêt de l'individu? C'est d'être absolument propriétaire de sa personne et des choses qu'il s'est appropriées en dehors d'elle, et d'en pouvoir disposer à son gré; c'est de pouvoir travailler soit isolément, soit en associant librement ses forces et ses autres propriétés, en tout ou en partie, à celles d'autrui; c'est de pouvoir échanger les produits qu'il tire de l'exploitation de sa propriété personnelle, immobilière ou mobilière, ou bien encore de les consommer ou de les conserver : c'est, en un mot, de posséder dans toute sa plénitude la « souveraineté individuelle ».
Cependant l'individu n'est pas isolé. Il est perpétuellement en contact et en rapport avec d'autres individus. [395] Sa propriété et sa liberté sont limitées par la propriété et la liberté d'autrui. Chaque souveraineté individuelle a ses frontières naturelles dans lesquelles elle s'exerce et qu'elle ne peut franchir sans empiéter sur d'autres souverainetés. Ces limites naturelles, il faut qu'elles soient reconnues et garanties, sinon les faibles se trouvent à la merci des forts et aucune société n'est possible. Tel est l'objet de l'industrie que nous avons nommée « la production de la sécurité » ou, pour nous servir de l'appellation habituelle, tel est l'objet du « gouvernement ».
Comme toutes les autres industries, celle-ci a commencé par être imparfaite et grossière; elle s'est successivement perfectionnée, mais non sans avoir des phases de rétrogression et de décadence. Dans le premier âge de la civilisation, elle est exercée par la communauté des membres du troupeau ou de la tribu. Ne possédant qu'un outillage et un armement rudimentaires, qui suffisent à peine à subvenir aux premières nécessités de la vie, et ne pouvant s'accroître au delà de quelques centaines ou de quelques milliers de têtes, le troupeau primitif ne fournirait point un débouché assez large pour rémunérer une entreprise spéciale de gouvernement. Ses membres sont obligés de produire eux-mêmes la sécurité dont ils ont besoin. Ils en sont à la fois les producteurs et les consommateurs. Ils partagent leur temps et leurs efforts entre la production alimentaire et la production de la sécurité. Seulement, avec cette différence qui tient à la nature particulière de ces deux industries, que l'une peut être, dans la plupart des cas, exercée individuellement, tandis que l'autre ne peut l'être que collectivement. Les membres du troupeau ou de la tribu constituent donc une communauté ou une mutualité d'assurance, dans laquelle, à défaut d'autre capital, chacun apporte une partie de son temps et de ses forces. Des souverainetés individuelles ainsi associées, en vue de [396] pourvoir à une nécessité commune, naît la souveraineté politique. Cette souveraineté appartient collectivement, mais non également, à tous les membres de l'association. Chacun en possède une part proportionnée à son apport.
Telle est l'origine et tels sont les éléments de la souveraineté politique. Comme la souveraineté individuelle, elle a ses limites. Celles-ci sont déterminées par l'objet en vue duquel elle est instituée, et qui consiste à assurer contre toute agression intérieure ou extérieure la vie et la propriété des membres de la mutualité, considérés comme consommateurs de sécurité. Elle ne peut atteindre ce but sans leur imposer des charges, des obligations et des règles qui diminuent d'autant leur propriété et leur liberté. Aussi longtemps que ces charges, ces obligations et ces règles n'excèdent pas le nécessaire, le souverain ne dépasse pas les limites de son droit. Mais où est la garantie qu'il ne les dépassera point? Comment le consommateur individuel de sécurité se trouve-t-il préservé de l'abus du pouvoir du producteur collectif? Cette garantie essentielle réside d'abord dans son droit de renoncer à faire partie de la mutualité, soit pour produire lui-même, isolément, sa sécurité, soit pour s'annexer à une autre mutualité; toutefois, en fait, ce droit demeure à peu près inapplicable; elle réside ensuite, dans la participation de l'individu à l'exercice de la souveraineté politique, et, au sein d'une mutualité peu nombreuse, cette garantie pouvait avoir une efficacité suffisante.
Dans le second âge de la civilisation, le mode de production de la sécurité subit un changement radical. Grâce aux progrès de l'outillage, la productivité du travail s'accroît dans une proportion telle que l'individu peut non seulement pourvoir largement à ses besoins de première nécessité, mais encore à beaucoup d'autres. Alors apparaît le phénomène de la séparation des industries et de la division du travail. Les industries séparées sont exercées [397] par des entreprises spéciales, dont l'importance varie suivant l'étendue et la richesse de leur débouché. La production de la sécurité suit la loi commune. Aux mutualités primitives succèdent, nous avons vu en quelles circonstances et sous l'impulsion de quelles nécessités, des entreprises organisées sous forme de sociétés en participation ou autrement qui fondent un État et établissent un gouvernement. Qu'advient-il de la souveraineté sous ce nouveau régime?
Il y a alors deux sociétés: la société possédante et exploitante de l'État, et la société, ou plutôt la multitude assujettie à sa domination. Les membres de la première possèdent, à l'origine, comme ceux des communautés ou des mutualités primitives, la souveraineté individuelle et la souveraineté politique. Toutefois, les nécessités du maintien et de l'agrandissement de la domination qui leur fournit leurs moyens d'existence ont pour effet ordinaire et presque général de déterminer la concentration de l'exercice de la souveraineté politique entre les mains d'un petit nombre de familles, et finalement même d'une seule. Ceux qui en sont exclus se trouvent alors à la discrétion du souverain, sauf les garanties qu'ils ont pu stipuler pour l'empêcher d'entamer, au delà du nécessaire, leur souveraineté individuelle. Si ces garanties n'existent point, ils subissent le régime du despotisme et du bon plaisir : le souverain peut disposer à sa guise des éléments de la souveraineté individuelle de chacun : la propriété et la liberté. Cependant ils peuvent avoir intérêt à courir ce risque inhérent à la concentration de la souveraineté politique, si cette concentration a pour effet de mieux garantir la domination dont ils sont les coparticipants et bénéficiaires.
La multitude assujettie à la domination de la société maîtresse de l'État ne possède, au début de ce régime, ni [398] la souveraineté individuelle ni la souveraineté politique. Elle est esclave. Les individus qui la composent sont appropriés soit à un membre, soit à la collectivité des membres de la société dominante. Ce n'est qu'à la longue, grâce à une série de progrès, déterminés surtout par la concurrence politique, qu'ils parviennent à s'affranchir, c'est-à-dire à entrer en possession de la souveraineté individuelle. Toutefois elle ne leur est point accordée entière; elle demeure grevée de la sujétion ou de la servitude politique. L'affranchi n'est plus esclave ou serf, mais il est encore « sujet ». Il est propriétaire de sa personne et de ses biens; il est libre d'agir à sa guise, il possède, en d'autres termes, d'une manière plus ou moins complète la souveraineté, sauf l'obligation strictement et universellement réservée de la faire garantir par la société politique de ses anciens maîtres, aux prix et conditions qu'il plaît à celle-ci d'établir, soit qu'elle exerce elle-même la souveraineté politique, soit que l'exercice en soit concentré dans une oligarchie ou dans une « maison ». Le consommateur de sécurité se trouve ainsi à l'entière discrétion du producteur, car il lui est interdit non seulement de la demander à d'autres, mais encore de la produire lui-même. Et sa situation va même s'aggravant de ce côté à mesure que sa souveraineté individuelle devient plus complète: quand il était sous la dépendance d'un maître, appartenant à la société dominante, celui-ci était intéressé à le protéger de son influence contre l'abus du pouvoir du souverain, et il l'était d'autant plus que cette dépendance était plus étroite. Cet intérêt a disparu du moment où l'esclave ou le serf est devenu entièrement propriétaire et maître de lui-même. Il s'est trouvé alors entièrement à la merci de la corporation ou de la maison politique, en possession du monopole de la production de la sécurité. Ce monopole sans contrepoids n'a pas manqué de devenir de plus en [399] plus lourd et oppressif. On a entrepris d'abord de le limiter par l'établissement d'un système analogue à celui qui restreignait le pouvoir des autres corporations, également investies d'un monopole. Les consommateurs de sécurité ont obtenu le droit de débattre le prix et les conditions de ce service. Mais, comme nous l'avons constaté, les deux parties en présence réussissaient rarement à s'accorder et, en dernière analyse, elles avaient recours à la force pour vider leurs différends.
Ce recours n'avait pas été favorable aux consommateurs de sécurité. A la fin du xvm8 siècle, les corporations ou les maisons en possession de la souveraineté politique avaient réussi partout, sauf en Angleterre, à récupérer l'intégrité de leur monopole, et il en était résulté un abaissement général de la qualité et l'exhaussement du prix de la sécurité ou de la garantie de la souveraineté individuelle. La Révolution française survint et eut pour premier résultat de donner la victoire aux consommateurs. L'établissement politique qui produisait la sécurité tomba entre leurs mains et ils eurent à aviser aux moyens de pourvoir à ce service. Ce problème comportait trois solutions différentes : 1° on pouvait laisser subsister l'ancien établissement politique, en revenant au système des garanties et des contrepoids, usité au moyen âge, conservé et amélioré en Angleterre; 2° rétrograder jusqu'au système de la mutualité primitive, ou de la production de la sécurité par les consommateurs eux-mêmes; 3° supprimer purement et simplement la servitude politique, et laisser à la concurrence le soin de pourvoir à la garantie de la souveraineté individuelle.
C'est le second système qui a prévalu, et qui prévaut encore aujourd'hui avec des applications et des tempéraments divers, et l'on peut se rendre aisément compte des causes qui l'ont fait prévaloir. Les consommateurs avaient [400] souffert des abus du monopole; il était naturel qu'ils s'imaginassent que le moyen le plus simple et le plus efficace d'éviter le retour de ces abus consistait à produire eux-mêmes, — collectivement puisqu'il n'était pas possible de la produire autrement, — la sécurité dont ils avaient besoin. C est ainsi que nous voyons les consommateurs de pain, dans les localités où la taxe a été abolie et où la concurrence demeure insuffisante, fonder des boulangeries coopératives, autrement dit des mutualités de production du pain. Mais il est rare que ces mutualités, quoique instituées librement, sans que personne soit contraint à en faire partie, réussissent à atteindre le but en vue duquel elles ont été établies, savoir : de produire du pain, en meilleure qualité et à meilleur marché que les boulangeries de l'ancien système, et elles finissent communément par se liquider ou à revenir au régime économique des entreprises ordinaires, individuelles ou collectives. Encore moins est-on parvenu à fonder des mutualités de production de la sécurité, économiques et durables, et il suffit de jeter un coup d'œil sur leur constitution et leur fonctionnement pour se rendre compte de cet insuccès.
De quels éléments se composent les mutualités politiques, dites nationales? Elles se composent de populations d'origine diverse, meublant un territoire conquis parles sociétés gouvernantes de l'ancien régime, et réunies sans leur consentement ou même malgré elles. Ces populations, on les a déclarées propriétaires (apparemment en vertu du droit de conquête) de l'établissement politique auquel elles étaient naguère assujetties, après avoir confisqué cet établissement à ses légitimes propriétaires, et on leur a commis le soin de le gérer à leurs frais, risques et profits, en attribuant arbitrairement soit à une portion de leurs membres, soit à tous, le droit de participer à sa gestion. Mais d'abord cette souveraineté collective ainsi artificiellement [401] façonnée et rendue obligatoire ne constitue-t-elle pas, aussi bien que celle à laquelle elle succède, une atteinte ou une « servitude » imposée à la souveraineté individuelle? Si je suis souverain (et la révolution n'a-t-elle pas été faite pour m'affranchir de la servitude politique, c'est-à-dire pour me restituer ma souveraineté dans toute sa plénitude?), si je suis souverain, et, comme tel, propriétaire et libre de ma personne et de mes biens, en vertu de quel droit m'imposeriez-vous l'obligation de m'associer à tels individus plutôt qu'à tels autres pour garantir ma personne et mes biens? Serait-ce parce qu'à l'époque où nous subissions en commun la servitude politique, où nous étions obligés, les uns et les autres de demander notre sécurité à la corporation ou à la maison qui en avait le monopole, nous étions placés sous le même joug? A quoi nous servirait d'avoir secoué ce joug, si c'était pour le remplacer par un autre, fût-ce même par celui de la collectivité des serfs, dans laquelle nous avions été englobés sans notre consentement et presque toujours malgré nous? En dépossédant la corporation ou la maison dont nous étions les sujets, vous prétendez nous avoir restitué la part de souveraineté dont elle nous avait dépouillés? Soit! mais, il fallait alors nous permettre d'en user librement pour produire nous-mêmes notre sécurité, individuellement — ou en nous associant à d'autres à notre convenance, en admettant que la production individuelle fût impossible. Ou bien encore, il fallait nous permettre de nous adresser à une société ou à une maison de notre choix, pour obtenir ce service indispensable, et de contracter librement avec elle. Mais nous contraindre à faire partie d'une mutualité composée de tous les anciens sujets de l'Etat confisqué, n'était ce pas comme si, après avoir aboli la corporation investie du monopole de la production du pain, et nous avoir ainsi affranchis de l'obligation onéreuse de nous pourvoir exclusivement [402] à la boulangerie du quartier, on nous avait contraints à exploiter nous-mêmes cet établissement, transformé en une boulangerie coopérative obligatoire, à en supporter les frais, à en combler les déficits, et à nous approvisionner exclusivement chez elle? N'était-ce pas remplacer une servitude par une autre?
Ajoutons que cette servitude transférée à un corps politique nombreux et dont font partie ceux-là mêmes qui la subissent, peut devenir incomparablement plus lourde et plus oppressive que lorsqu'elle était établie au profit d'une corporation ou d'une maison. C'est, en effet, en s'appuyant sur l'intérêt de la généralité de la nation, et non plus seulement en se fondant sur l'intérêt particulier de la corporation ou de la maison souveraine, que l'on attente à la propriété et à la liberté de chacun, Et quelle limite les intérêts particuliers peuvent-ils opposer à une puissance qui agit au nom de l'intérêt général? On peut opposer un frein à la tyrannie d'un seul, ne fût-ce que par le fer ou le poison; on est impuissant contre la tyrannie d'une multitude. Dira-t-on que dans ce système renouvelé des temps primitifs l'individu participe à la souveraineté politique, et que cette participation suffit à le garantir contre l'oppression d'un pouvoir qu'il contribue à former. Elle suffisait peut-être dans les temps primitifs, lorsque les mutualités politiques ne comprenaient que quelques centaines ou quelques milliers de membres, ayant les mêmes moyens d'existence, partant les mêmes intérêts, et surtout n'ayant aucun intérêt à former des ligues ou des sociétés particulières pour exploiter l'industrie encore improductive du gouvernement; elle ne suffit plus, elle est devenue purement illusoire dans des mutualités politiques dont les membres se comptent par millions, exercent les industries les plus diverses, et à une époque où l'industrie du gouvernement possède une productivité croissante, limitée [403] seulement par les facultés contributives que les progrès de l'industrie augmentent sans cesse. Dans ce nouvel état des choses, quand chacun des membres de la mutualité politique ne possède plus qu'une fraction infinitésimale de souveraineté, comment cette part ainsi diluée pourrait-elle être efficace? Comment cette poussière de souveraineté devenue presque impalpable pourrait-elle résister à l'effort des agglutinations compactes d'intérêts qui se forment pour exploiter l'industrie du gouvernement, devenue de plus en plus productive? Nous avons vu où conduit ce système, dont l'expérience se poursuit et dont les conséquences s'aggravent tous les jours sous nos yeux : il conduit à renchérissement et à l'abaissement progressifs des services des gouvernements, constitués et gérés, nominalement du moins, par des mutualités nationales.
Au point où cette expérience est parvenue, elle atteste déjà, avec une évidence suffisante, que le système révolutionnaire et communiste des mutualités nationales ne résout point le problème de la garantie utile de la souveraineté individuelle. Deux solutions restent donc en présence : celle de la limitation par voie de contrat librement débattu du monopole naturel ou artificiel des établissements politiques, et celle de la concurrence. Il y a apparence que l'on reviendra au premier, tout en introduisant dans le fonctionnement des établissements politiques les progrès déjà réalisés dans les autres entreprises collectives, et qu'il subsistera jusqu'à ce que le développement de la grande industrie rende le second possible et finisse par l'imposer comme nécessaire. Mais quels sont, dans l'état présent des choses, les droits des producteurs de sécurité et les droits des consommateurs? En quoi consistent-ils et quelles sont leurs limites? Nous allons voir que ces droits sont les mêmes que ceux des [404] producteurs et des consommateurs des autres industries. Tous dérivent également du principe de la souveraineté individuelle.
Reprenons l'exemple dont nous venons de nous servir. J'ai besoin de pain. Si la localité que j'habite n'est pas assez populeuse et riche pour fournir un débouché à un boulanger, je serai obligé de le fabriquer moi-même, — je serai à la fois producteur et consommateur de pain. Si la population s'enrichit et s'accroît, ce débouché s'ouvrira, une boulangerie pourra s'établir et je trouverai avantage à lui acheter mon pain plutôt qu'à continuer à le fabriquer. Mais qu'advient-il alors de mes droits de producteur et de consommateur? Je cesse d'exercer mon droit de producteur de pain, mais je continue à le posséder, et même il s'est étendu au lieu de décroître : à mon droit, dont je puis continuer à user, de fabriquer du pain pour ma consommation, s'est joint celui d'en produire pour autrui, en fondant une boulangerie ou en contribuant à la fonder et à la mettre en œuvre par mes capitaux et mon travail. Mon droit de consommateur s'est étendu de même; car je puis demander le pain dont j'ai besoin à deux producteurs au lieu d'un : au boulanger et à moi. Si je m'adresse de préférence au boulanger, c'est parce que son pain est meilleur et me revient moins cher que celui que je produisais moi-même. Je bénéficie de la différence, et, en admettant que l'industrie soit libre et la concurrence possible, cette différence de prix représentera celle d'une production isolée et d'une production spécialisée.
Supposons cependant que l'industrie ne soit pas libre. Une boulangerie s'est établie, et celui qui l'exploite m'interdit à la fois de fabriquer mon pain moi-même et de m'adresser à d'autres qu'à lui pour me procurer cet article de première nécessité. Aussi longtemps qu'il me fournira du pain de bonne qualité et à un prix modéré, il y a [405] apparence que je ne réclamerai point; mais que la qualité vienne à baisser et le prix à s'élever, — et il p«ut, dans ces conditions, s'élever bien au-dessus des frais de la production, — je m'efforcerai soit de limiter cette servitude, soit de m'y dérober. Si le monopole auquel j'ai affaire est « naturel », s'il ne peut être supprimé sans compromettre l'alimentation et l'existence de la société dont je fais partie, je ne revendiquerai point, à titre de producteur, mon droit primordial de fabriquer mon pain moi-même ou de fonder quelque boulangerie concurrente, mais je réclamerai en échange le droit d'être admis à participer à l'exercice de l'industrie de la boulangerie, si je possède les aptitudes et les connaissances techniques nécessaires. Je ne revendiquerai pas davantage, à titre de consommateur, le droit de me pourvoir chez moi ou à une autre boulangerie: mais en compensation de ce droit, j'exigerai celui de contrôler la qualité du pain et d'en limiter le prix jusqu'au niveau moyen où l'abaisserait la concurrence, en supposant qu'elle fût possible. Si, des deux parts, nous entendons bien nos intérêts, et si nous sommes animés d'un esprit d'équité, l'accord pourra s'établir sur ces bases. Le boulanger continuera d'exercer son industrie et de gouverner son établissement à sa guise, mais sans exclure de son personnel les membres de sa clientèle, et il acceptetera de bonne grâce la création et la mise en vigueur d'un système plus ou moins exact de contrôle de la qualité et de limitation du prix, sans entreprendre d'intimider ou de corrompre les mandataires que les consommateurs auront chargés de ce contrôle et de cette limitation.
Si l'accord ne s'établit point ou s'il vient à se rompre, soit par la mauvaise foi du producteur ou son impatience à subir un contrôle, soit par les exigences excessives et déraisonnables des consommateurs ou de leurs mandataires, avides de popularité; et si l'on a recours à la force [406] pour vider ce procès, qu'arrivera-t-il? Si le propriétaire exploitant du monopole l'emporte, il ne manquera pas de supprimer le contrôle des consommateurs, et même de les exclure de son personnel. Si les consommateurs ont le dessus, ils confisqueront l'établissement investi d'un monopole pour l'exploiter eux-mêmes ou le faire exploiter à leur profit, en se réservant de plus le droit exclusif de faire partie du personnel exploitant. Mais, dans l'un et l'autre cas, les deux parties auront dépassé les limites de leur droit : le propriétaire exploitant d'un monopole excède le sien et empiète sur celui des consommateurs, en supprimant l'appareil qui tient lieu du régulateur naturel de la concurrence pour maintenir la qualité et modérer le prix de ses produits ou de ses services. Les consommateurs excèdent, de même, leur droit en confisquant la propriété et l'industrie du producteur, et en s'emparant de son établissement pour l'exploiter à leur profit. Les « nuisances » que produisent ces dérogations au droit, ne se font, au surplus, pas attendre. L'absence d'un contrôle efficace engendre l'abus inévitable du monopole, et expose le monopoleur à de nouvelles revendications plus violentes des consommateurs; la confiscation de la propriété de l'établissement politique crée un risque qui met en péril toutes les autres propriétés. [64]
[407]
Remplacez la fabrication du pain par la production de a sécurité et vous aurez l'explication de tous les conflits [408] et de toutes les luttes entre les gouvernants et les gouvernés, depuis l'époque où la concurrence politique et [409] guerrière a commencé à s'affaiblir entre les premiers et où les seconds ont commencé à entrer en possession de la [410] souveraineté individuelle. Vous connaîtrez aussi l'origine et les limites de la souveraineté politique.
Résumons maintenant cette théorie:
La souveraineté réside dans la propriété de l'individu sur sa personne et ses biens et dans la liberté d'en disposer, impliquant le droit de garantir lui-même sa propriété et sa liberté ou de les faire garantir par autrui. Lorsqu'il les garantit lui-même, la souveraineté politique demeure confondue avec la souveraineté individuelle. Lorsque cette garantie devient l'objet d'une industrie spéciale, la souveraineté politique se spécialise de même; mais dans ce nouvel état de choses, comme dans le précédent, elle a ses limites qui sont marquées par la nature et les nécessités de la production de la sécurité et qui ne [411] diffèrent point de celles dans lesquelles s'exercent les autres industries.
Si un individu ou une collection d'individus use de sa souveraineté pour fonder un établissement destiné à pourvoir à la satisfaction d'un besoin quelconque, il a le droit de l'exploiter et de le diriger suivant les impulsions de son intérêt, comme aussi de fixer à son gré le prix de ses produits ou de ses services. C'est le droit souverain du producteur. Mais ce droit est limité naturellement par celui des autres individus non moins souverains, considérés en leur double qualité de producteurs et de consommateurs. Cette délimitation s'opère naturellement sous un régime de concurrence, les autres individus demeurant libres de fonder des établissements analogues et de se [412] pourvoir ailleurs, ce qui oblige le producteur à réduire son prix et ses conditions au nécessaire. Il en est autrement sous un régime de monopole. Le droit du producteur est, en ce cas, plus difficile à mesurer et il ne peut être délimité que par un compromis. En échange de leur droit de fonder et d'exploiter d'autres établissements, le monopoleur doit concéder à ses clients assujettis, à titre de producteurs, un droit éventuel de coopération à son entreprise; en échange de leur droit de se pourvoir ailleurs, il doit leur consentir, à titre de consommateurs, un droit de contrôle de la qualité et de limitation du prix de ses produits ou de ses services. Le droit d'un producteur investi d'un monopole peut être ramené ainsi à ses limites naturelles et se concilier avec les droits des autres membres de la société, considérés comme producteurs et consommateurs. L'expérience atteste malheureusement que cette conciliation n'est pas facile à accomplir dans la pratique. Il en sera ainsi, selon toute apparence, aussi longtemps que la production de la sécurité s'opérera sous le régime du monopole et que subsistera la « servitude politique ». Seule, la concurrence peut établir une exacte délimitation de la souveraineté politique.
De cette analyse, il ressort que la souveraineté politique est une partie intégrante de la souveraineté individuelle. Il en ressort aussi qu'il n'est point nécessaire de faire partie du corps en possession de l'exercice de la souveraineté politique pour obtenir la garantie de sa souveraineté individuelle, pas plus qu'il n'est nécessaire d'être boulanger pour se procurer du pain en belle qualité et à bon marché. Il suffit, dans le cas du monopole, de posséder le droit éventuel de coopération qui appartient au producteur et d'exercer, d'une manière efficace, le droit de contrôle et de limitation qui appartient au consommateur; enfin, dans le cas où le monopôle [413] n'est point nécessaire, de recourir à la concurrence. [65]
VI. Nationalité et patriotisme. — La suppression de la servitude politique, en vertu de laquelle la maison ou l'association exploitante d'un Etat impose ses services à la population du territoire soumis à sa domination, n'entraînera-t-elle pas la destruction de la nationalité et du patriotisme? Voilà ce qu'il s'agit encore d'examiner. Pour résoudre cette question, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les origines et le développement de ces deux phénomènes d'ordre politique et moral.
Dans les temps primitifs, le troupeau ou la tribu, réuni par des affinités de race et une nécessité commune, constituait la nationalité. La défaite et la dispersion de ce troupeau entraînait la destruction à peu près certaine de tous ceux qui en faisaient partie, hommes, femmes et enfants. De là, la formation d'une « opinion » qui exigeait de la part de chacun le sacrifice ou la subordination de [414] ses intérêts particuliers à l'intérêt général de l'association. De là aussi, et par contre-coup, le développement d'un instinct ou d'un sentiment analogue à celui de la famille, qui embrassait dans un même culte le troupeau, ses institutions, ses membres vivants ou morts. Cet instinct ou ce sentiment, c'était l'attachement à la nationalité et, lorsque le troupeau se fut établi en permanence dans les localités où il trouvait sa subsistance, ce même sentiment s'étendit au milieu ou à l'habitat, et il devint l'amour de la patrie ou le patriotisme.
Dans la période suivante, lorsque l'Etat politique se spécialise et appartient exclusivement à une corporation conquérante et gouvernante, la nationalité se spécialise de même. La nationalité dominante est celle des maîtres de l'État; au-dessous d'elle, les populations assujetties forment des nationalités diverses, selon leurs affinités de race, de mœurs et de langage. Le patriotisme subit une évolution analogue. L'existence de chacun des membres de la corporation dominante étant attachée à celle de cette corporation, au maintien de sa hiérarchie et des autres institutions qui sont les facteurs de sa puissance, l'opinion fait passer l'intérêt corporatif avant tout autre et le patriotisme se résout dans la fidélité au chef et la confraternité avec les membres du corps politique unis par la communauté des intérêts. Chez les populations assujetties, le patriotisme ne dépasse guère l'enceinte de la commune ou du canton, il ne réunit les maîtres et les sujets que lorsqu'un danger égal de dépossession et de destruction menace les uns et les autres. Mais cette communauté de patriotisme disparaît à mesure que le risque de dépossession et de destruction provenant de la guerre et de la conquête s'affaiblit et s'inégalise en s'affaiblissant. Lorsque les invasions barbares ont cessé d'être à craindre, la corporation propriétaire et gouvernante ou auxiliaire de la maison souveraine demeure [415] cependant exposée à perdre sa situation prépondérante, à la suite d'une conquête étrangère; tandis que les populations assujetties, protégées par les progrès des usages de la guerre, n'ont plus à redouter qu'un simple changement de domination, et qu'il arrive même parfois qu'elles gagnent à ce changement. On s'explique donc que leur patriotisme soit moins intense que celui de la classe gouvernante et qu'elles soient moins disposées à dépenser leur sang et leur argent pour défendre l'État : pourvu qu'elles ne soient point molestées dans leur existence, leur propriété, leur industrie ou leur commerce, qu'elles conservent leurs institutions locales, l'usage de leur langue et de leurs coutumes traditionnelles, et qu'elles n'aient point à supporter une augmentation de charges, peu leur importe le reste. Telle était la situation dans les derniers temps de l'ancien régime. Cependant la rétrogression déterminée par la Révolution française dans les usages de la guerre et de la conquête est venue modifier cet état des choses et des esprits. Les guerres et les conquêtes de la Révolution et du premier Empire n'ont pas intéressé seulement, comme les précédentes, les dominations politiques; elles ont atteint les propriétés et les institutions particulières des populations et même leur langue. Faute de ressources financières suffisantes, les énormes armées que le gouvernement révolutionnaire recrutait avec une facilité extraordinaire, grâce au rétablissement du servage d'État, vivaient sur les pays envahis; on ne se contentait pas même des réquisitions de subsistances, on dépouillait les églises et les musées, on confisquait sans scrupule les domaines des corporations; enfin, on obligeait, sous prétexte de progrès, les populations à renoncer à leurs vieilles institutions pour adopter celles des conquérants, au premier rang desquelles figurait la conscription. De là une recrudescence et on pourrait dire une unification du [416] patriotisme dans tous les pays envahis ou menacés par la révolution. De nos jours, cette unification tend de nouveau à s'effacer, bien que la pratique des usages de la guerre et de la conquête ne soit pas encore revenue au point d'avancement qu'elle avait atteint avant la révolution, et que les conquérants modernes, à l'imitation de leurs devanciers révolutionnaires continuent à vouloir imposer leurs institutions et leur langue aux populations qu'ils assujettissent. Mais la multitude des consommateurs politiques commence à comprendre, quoique d'une manière encore vague et confuse, que son intérêt à agrandir les frontières de l'État ou à les récupérer quand elles ont été entamées, ou même à conserver l'État, diffère sensiblement de celui des maisons et des associations politiques qui vivent de l'exploitation de l'Etat ou aspirent à en vivre. Cette différence apparaît clairement quand on analyse les effets de la guerre et de la conquête au point de vue des intérêts des producteurs de services politiques, d'une part, des consommateurs de ces services de l'autre. La guerre et la conquête, en cas de succès, augmentent à la fois la puissance, le prestige et les profits du personnel politique et militaire qui gouverne l'Etat; les officiers montent en grade à la suite d'une campagne victorieuse, et les fonctionnaires civils voient s'accroître le débouché administratif par l'annexion d'un nouveau territoire; les consommateurs politiques, en revanche, supportent les charges de la guerre, sans recueillir aucun bénéfice appréciable de la conquête. Ils alimentent la guerre au moyen de l'impôt du sang, qui n'est pas susceptible d'être remboursé, et au moyen d'emprunts dont les intérêts et l'amortissement exigent un accroissement d'impôts, que les plus fortes indemnités de guerre ne parviennent point à balancer, sans parler de la perturbation que toute guerre apporte dans l'industrie et les affaires. S'ils tirent quelque avantage [417] du reculement des lignes de douanes, ce profit est compensé le plus souvent par l'abaissement des services politiques et administratifs résultant de l'agrandissement de l'État au delà de ses limites utiles. Enfin, l'exhaussement du risque de guerre résultant de l'appréhension d'une revanche de l'Etat vaincu et diminué a pour conséquence inévitable d'augmenter, d'une manière permanente, leurs charges militaires. En cas de revers, au contraire, les effets de la guerre et de la conquête affectent dans une proportion plus forte les intérêts des maisons ou des associations exploitantes de l'État, et du personnel qui leur sert d'auxiliaires. La défaite leur enlève une portion notable de leur puissance et de leur prestige, elle diminue leur débouché si elles sont obligées de céder une partie du territoire national, elle le supprime si elles sont entièrement dépossédées, tandis que les consommateurs politiques ne subissent que le dommage résultant de la substitution d'une domination à une autre. De là, des différences notables entre l'opinion de la classe qui vit de l'exploitation de l'Etat et celle de la masse des consommateurs politiques en matière de guerre et de conquête. Autant la première est disposée à engager la nation dans une entreprise de ce genre, pour peu qu'elle ait confiance dans le succès, autant la seconde y répugne. Et, quand au lieu de succès viennent les revers, quand la maison ou l'association gouvernante se voit menacée d'une dépossession partielle ou totale, elle s'efforce de prolonger la lutte sans se faire scrupule d'imposer à la nation des sacrifices illimités; tandis, au contraire, que la multitude gouvernée réclame la paix avec une insistance plus marquée à mesure qu'elle estime que les sacrifices qu'on lui impose dépassent la mesure du dommage que lui infligerait une conquête partielle ou même une conquête entière. Sa voix ne tarde pas, à la vérité, à être étouffée par les clameurs des politiciens qui l'accusent [418] de manquer de patriotisme, et c'est seulement lorsque la nation est entièrement épuisée que la lutte cesse.
A. le bien considérer, le patriotisme, tel que l'entendent les politiciens modernes, et tel qu'ils sont parvenus à l'imposer à l'ignorance de la foule, en flattant ses passions grossières, n'est autre chose qu'une branche, on pourrait dire la branche maîtresse du protectionnisme. Sur quelle base se fonde la doctrine protectionniste? Sur l'appropriation du marché national aux producteurs indigènes; impliquant l'obligation pour les consommateurs de s'approvisionner exclusivement de produits nationaux, quand même ils pourraient se procurer ces articles en meilleure qualité et à meilleur marché à l'étranger. C'est une « servitude » économique qui avait sa raison d'être à l'époque où .les nations civilisées vivaient sous le régime de l'état de siège, mais qui l'a perdue depuis, nous avons vu sous l'influence de quels phénomènes d'évolution.
Dans l'opinion des protectionnistes, cette servitude n'a point cessé d'être nécessaire, et le devoir des consommateurs est de s'y soumettre quand même. Dans l'opinion du consommateur, au contraire, ce devoir n'existe pas, et c'est en vain qu'on a fondé des ligues ou des associations pour en raviver l'a notion, on n'a réussi nulle part à persuader aux consommateurs qu'ils devaient donner la préférence aux produits nationaux et à les détourner d'acheter des similaires étrangers quand ils croyaient y trouver avantage, ces produits similaires eussent-ils l'origine la plus détestée. Alors, qu'a-t-on fait? On a renforcé et étendu de plus en plus l'appareil de prohibitions et de pénalités qui avaient pour objet de contraindre les consommateurs à se soumettre à cette servitude, et quand les économistes ont entrepris de démolir cet appareil suranné, on les a accusés de vouloir ruiner l'industrie nationale au profit de l'industrie étrangère, en un mot, de manquer de patriotisme.
[419]
De même, la nation, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs politiques, dans les limites où s'étend la domination de l'État et de ses détenteurs, appartient ou est assujettie à l'État. Quelles que soient l'infériorité et la cherté des services qu'elle en reçoit, non seulement elle est obligée de s'en contenter, et ce serait un crime de les demander à un État étranger au moyen d'une annexion totale ou partielle; mais encore son devoir envers la patrie lui commande de mettre au besoin sans compter son sang et ses ressources à la discrétion des détenteurs de l'État pour empêcher la concurrence étrangère d'empiéter sur leur marché. Seulement, comme les consommateurs ne comprennent guère mieux ce qu'ils doivent à l'État que ce qu'ils doivent à l'industrie nationale, on les contraint à fournir par voie d'impôt, de réquisition ou de conscription, les capitaux et les hommes nécessaires à la défense des frontières de l'État et au besoin à leur agrandissement. Ceux qui refusent de se soumettre aux sacrifices qu'on leur impose dans l'intérêt de la patrie, ou même qui se contentent de protester contre leur exagération, sont accusés encore de manquer de patriotisme.
II y a toutefois une distinction à établir entre la protection de l'industrie et celle de l'État. En admettant que l'on cesse de protéger l'industrie, les consommateurs, libres de s'adresser aux industries concurrentes dans le pays et ù l'étranger, seront toujours assurés de pouvoir s'approvisionner des produits dont ils ont besoin aux conditions les plus avantageuses. Il en sera autrement pour les services politiques. Ces services, continuant partout d'être grevés d'une servitude au profit de l'État, la conquête expose les consommateurs à être assujettis à un Etat inférieur en civilisation, qui leur impose, à la mode révolutionnaire, ses institutions rétrogrades et son personnel de fonctionnaires aux allures despotiques et, de plus, leur [420] fasse payer à un plus haut prix des services de qualité moindre. Mais encore les sacrifices qu'on leur impose pour la protection de l'Etat devraient-ils être proportionnés à ce risque. Quand ils dépassent le montant de la prime nécessaire pour le couvrir, ils cessent d'être conformes à l'intérêt des consommateurs, c'est-à-dire à l'intérêt général, et la nation subirait un dommage moindre à être exposée à la conquête étrangère qu'à supporter des charges en disproportion avec le dommage auquel la conquête l'expose.
Malheureusement, ce n'est pas la masse des consommateurs politiques qui décide des questions de paix ou de guerre. Cette décision appartient encore, même dans les pays réputés les plus libres, au personnel gouvernant, qui, tirant ses moyens d'existence de l'industrie politique, a un intérêt illimité à imposer ses services aux consommateurs, tandis que ceux-ci n'ont qu'un intérêt limité à les recevoir de préférence à d'autres. On a pu constater fréquemment les différences d'opinion résultant de cette différence d'intérêt, dans les pays qui viennent à être assujettis à une domination étrangère, — ce qui, d'ailleurs, est parfois un avantage et un progrès, quand le gouvernement indigène était oppressif et vicieux. Si le gouvernement nouveau n'est pas plus lourd que l'ancien, s'il respecte les mœurs, les coutumes et la langue des populations, la masse des consommateurs politiques se résigne aisément k ce changement de domination. En revanche, la classe politique ne l'accepté que dans le cas où le conquérant lui conserve la situation prépondérante qu'elle possédait et qu'il est bien rarement en son pouvoir de lui conserver, car il est obligé de compter avec les appétits de son personnel. Cette classe politique dépouillée de son débouché demeure à l'état de conspiration et saisit toutes les occasions favorables de reconquérir l'État qu'elle a perdu. Il [421] arrive alors que les consommateurs politiques sont obligés de payer deux impôts : l'un à l'État étranger, sous la domination duquel la conquête les a fait tomber, l'autre à l'État national, représenté par les conspirateurs. Ils cherchent naturellement à sortir de cette situation critique et finissent d'ordinaire par faire cause commune avec les conspirateurs au milieu desquels ils vivent et qui se croient autorisés, d'ailleurs, à titre de représentants de la « nationalité », à soumettre ceux qui leur refusent obéissance et secours à des pénalités autrement terribles et sommaires que celles auxquelles peut avoir recours un gouvernement régulier. Ce qui ne les empêche pas de regretter plus tard, — quand la conspiration, devenue gouvernement, a augmenté leurs charges, — la domination étrangère.
Lorsque le gouvernement étranger a été expulsé, on ne manque pas de célébrer la délivrance de la patrie, mais ce n'est pas tout. Si quelque morceau du territoire réputé national reste soumis à ce gouvernement ou à un autre, on s'écrie douloureusement que la patrie n'est pas faite, et on soutient qu'aucun sacrifice ne doit lui coûter pour récupérer le morceau qui lui manque, — quand même la population de ce morceau manquant préférerait le statu quo. Au moins, lorsque la patrie est faite, renonce-t-on à l'agrandir? Nullement. Tantôt il lui faut des « frontières naturelles », tantôt elle a besoin de s'annexer des races approximativement de même famille pour faire contrepoids à des races naturellement ennemies, sauf à nationaliser de gré ou de force celles qui ne sont pas suffisamment nationales. Il est bien entendu encore que les hommes, qui s'opposent à cet agrandissement de la patrie ou, en d'autres termes, à l'extension du débouché des industriels politiques qui exploitent l'État, sont dépourvus de patriotisme.
Voilà comment le protectionnisme politique exploite et [422] fausse la notion de la nationalité et le sentiment de la patrie.
Maintenant, supposons que la nécessité, déjà contestable, de la servitude politique vienne à disparaître comme a disparu celle de la servitude économique : qu'adviendra-t-il de la nationalité et du patriotisme? Parce que les consommateurs politiques pourront, individuellement ou collectivement, demander la sécurité de leur vie, de leurs propriétés et de leurs transactions à l'établissement national ou étranger qui leur fournira ce service en meilleure qualité et au meilleur marché, s'ensuivra-t-il que la « nationalité » cessera d'exister? N'est-elle pas déjà mise en péril à un plus haut point par l'importation étrangère des produits agricoles qui s'incorporent au consommateur et font entrer dans sa chair et dans ses os des éléments étrangers? La nationalité dérive à la fois de phénomènes géographiques, physiologiques, économiques et moraux; elle dépend de la situation, des affinités de race, de l'ancienneté des relations, de la communauté du langage; aussi longtemps que ces facteurs de la nationalité subsistent, elle se maintient avec tous ses signes caractéristiques: c'est ainsi qu'il y a une nationalité anglaise, française, russe, allemande, espagnole. La servitude qui oblige une nation à demander les services politiques dont elle a besoin à un établissement indigène, à l'exclusion de tout autre, ne contribue pas plus à sauvegarder sa nationalité que ne le ferait l'obligation qui lui serait imposée de se pourvoir exclusivement de produits agricoles et industriels dans les fermes et les manufactures nationales. Au contraire! Si la servitude politique associe des races antipathiques ou simplement dissemblables, des Anglais et des Irlandais, des Russes et des Polonais, des Allemands et des Français, et si les plus fortes, suivant en cela la tradition révolutionnaire, prétendent imposer leurs institutions et leur [423] langue aux plus faibles, les caractères originaux et utiles de celles-ci finiront par s'effacer, tandis que l'amalgamation forcée d'un élément hétérogène altérera le type national de celles-là. Il en sera autrement si les peuples sont libres dans leurs relations politiques et autres : ces relations déterminées alors uniquement par l'intérêt et la sympathie seront les plus favorables à la conservation et au perfectionnement des types nationaux. Est-il nécessaire d'ajouter que l'amour de la patrie est indépendant de la provenance des services politiques comme de celle des produits agricoles ou industriels? Ce sentiment respectable se compose, comme nous l'avons remarqué, de deux sortes d'éléments: l'amour du sol et du milieu physique où la créature humaine a grandi, et l'attachement particulier à la tribu ou à la nation dont elle fait partie, impliquant le désir de la voir dépasser les autres en richesse, en puissance et en civilisation. Or, si la servitude politique, après avoir été une condition nécessaire de l'existence et de la prospérité des nations perd sa raison d'être et devient au contraire pour elles une cause d'affaiblissement et de retard, ne serace point faire acte de patriotisme que de les en affranchir?
[424]
CHAPITRE XI.
Tutelle et liberté↩
I. Nécessité de la tutelle. — II. La tutelle dans le passé. — III. La tutelle et la révolution. — IV. Résultats de l'abolition de l'ancien régime de la tutelle par voie révolutionnaire et philanthropique. § ler. L'abolition de l'esclavage des nègres. § 2. L'abolition du servage en Russie. § 3. La réforme du régime agraire en Irlande. § 4. Les rapports des peuples civilisés avec les races inférieures ou en retard. Le remplacement des institutions dites barbares par le self government combiné avec la tutelle gouvernementale. — V. De la reconstitution libre de la tutelle par voie d'évolution. — VI. Avenir de la liberté et de la tutelle.
I. Nécessité de la tutelle. — La tâche essentielle de tout gouvernement consiste à assurer la sécurité des personnes et des propriétés contre toute atteinte intérieure ou extérieure. Cependant suffirait-il de la sécurité la plus complète et la plus efficace garantie à chacun pour faire régner la justice dans les rapports économiques et avec elle l'harmonie et la paix, en même temps que pour imprimer à toutes les forces et à toutes les ressources de la société la direction la plus utile? Tous les membres des sociétés civilisées sont-ils également capables de se gouverner sans nuire à autrui et à eux-mêmes? Le plus grand nombre d'entre eux n'ont-ils pas besoin d'être guidés, dans le gouvernement de leurs affaires et de leur vie, par une intelligence et une volonté supérieures? Et en supposant même qu'ils possédassent tous assez d'intelligence, de moralité et d'énergie pour conduire utilement leurs affaires et leur vie, n'auraient-ils pas besoin d'être protégés [425] dans une foule de circonstances où l'action des lois qui régissent le monde économique se trouve entravée ou paralysée, dans le cas d'un monopole naturel par exemple? Si l'on considère l'imperfection de l'homme, sa faiblesse et surtout l'insuffisance manifeste de ses forces morales quand il s'agit de l'accomplissement d'un devoir en opposition avec son intérêt ou sa passion du moment, si l'on tient compte aussi des défectuosités du milieu'économique où il se meut, ne demeurera-t-on pas convaincu de la nécessité d'une tutelle qui contraigne les moins capables du self government à s'acquitter des obligations qu'implique la vie eu société et les préserve de l'oppression que les circonstances ambiantes peuvent faire peser sur eux?
Que les sociétés les plus civilisées contiennent de nombreuses individualités incapables de se gouverner utilement elles-mêmes, c'est un fait qu'on ne saurait contester; mais quelle part convient-il d'y faire à la liberté et quelle part à la tutelle; comment et par qui ces parts doivent-elles être faites? Comment et par qui la tutelle doit-elle être exercée? Voilà le problème qui se pose aux sociétés modernes comme il s'est posé à leurs devancières.
II. La tutelle dans le passé. — Si nous étudions ce problème et sa solution dans le passé, nous trouverons non seulement que la tutelle est la règle et la liberté l'exception, mais encore que le caractère général de la tutelle est d'être imposée. On peut distinguer toutefois deux sortes de tutelle : celle des classes asservies et celle des classes libres ou réputées telles. La première est inhérente à la servitude et elle est absolument imposée. Elle a ses degrés comme la servitude elle-même. Elle est entière dans l'esclavage proprement dit. L'esclave n'a ni liberté ni responsabilité. Toutes les manifestations de son activité sont régies par la volonté de son maître, qui en est responsable [426] comme des siennes propres. Le serf au contraire n'est que partiellement en tutelle. Il gouverne sa vie et celle de sa famille, sauf les restrictions et les obligations que lui imposent à la fois son maître, individuel ou collectif, et la commune dont il fait partie. La tutelle du maître est imposée uniquement dans l'intérêt du tuteur. La seconde espèce de tutelle est imposée ou est censée l'être dans l'intérêt de ceux qui la subissent et de leur consentement, quoiqu'elle soit trop souvent détournée de sa destination et viciée au profit de ceux qui l'établissent et la gèrent. Comme la première, elle a ses degrés. C'est dans l'intérêt de la société ou de la communauté dont il est membre, intérêt dans lequel le sien est compris, et en raison du but qu'elle poursuit et des nécessités qu'elle subit, que l'individu est assujetti à une tutelle, parfois tellement étroite et rigoureuse que la part de self government qui lui est laissée est moindre que celle du serf ou même de l'esclave.
Examinez la condition de toutes les sociétés des temps passés, et vous trouverez que l'individu y était assujetti à une multitude de règles, de lois, de coutumes ou d'obligations établies, les unes dans l'intérêt du maître individuel ou collectif auquel il était approprié, les autres dans l'intérêt de la corporation politique, cléricale ou industrielle, ou bien encore de la communauté locale dont il était membre. A ces tutelles du maître, de la corporation ou de la communauté, venaient se joindre la tutelle religieuse non moins abondante en règles et en prescriptions concernant tous les actes de l'existence et non moins obligatoire, et, finalement, la tutelle de l'opinion de la classe ou du groupe auquel appartenait l'individu, opinion imposant certaines manières d'agir ou même de penser, à l'exclusion de toutes les autres, et aux arrêts de laquelle il était obligé de se soumettre, surtout quand il se trouvait dans l'impossibilité de changer de lieu ou de condition.
[427]
Ainsi nul ne pouvait, à moins d'aller vivre à l'écart de toute société, gouverner librement sa vie.
Comme nous l'avons remarqué, ce vaste appareil de tutelle a été créé, perfectionné et complété par des découvertes et inventions successives, à mesure que le besoin de le créer, de le perfectionner et de le compléter se faisait sentir. Dans les sociétés primitives, troupeaux, clans ou tribus, les individualités les plus intelligentes observaient les manières d'agir utiles ou nuisibles à l'association, elles prescrivaient les unes, interdisaient les autres, établissaient en un mot une « loi » en l'attribuant à une révélation divine. Cette loi se transmettait de génération en génération, d'abord par la tradition orale, ensuite par l'écriture, en se modifiant et se complétant, en raison des changements qui survenaient dans les conditions d'existence de l'association. Celle-ci ne s'y soumettait toutefois qu'à la condition d'en reconnaître l'utilité. Quand elle ne la trouvait point à son gré, elle renonçait au culte des divinités au nom desquelles on prétendait la lui imposer pour adopter un autre culte et une autre loi.
Lorsque les progrès de l'industrie ont rendu possible la création des États politiques, on y constate l'existence de deux lois : celle qui régit la société des fondateurs et des propriétaires de l'État et qui procède de la loi de la tribu dont ils sont issus, et celle de la population assujettie, la première établie dans l'intérêt des propriétaires associés et consentie par eux, la seconde imposée dans le même intérêt aux esclaves et aux sujets. Au premier abord, il semble que celle-ci doive être en opposition avec l'intérêt de la population qui la subit, mais les intérêts opposés des maîtres et des sujets se rapprochent et finissent par s'identifier sous la double influence des phénomènes de la propriété et de la concurrence. Lorsqu'une société politique et guerrière s'est emparée d'un territoire et l'a partagé [428] entre ses membres avec les habitants qui le meublent, les propriétaires sont naturellement intéressés à en développer autant que possible la production et les ressources, et ils le sont d'autant plus que la concurrence extérieure les menace davantage. Or le seul moyen d'atteindre ce but, c'est-à-dire de porter au plus haut point la richesse et la puissance de l'État, c'est d'établir la loi la plus utile à la population assujettie.
La loi de la société propriétaire et exploitante de l'État a pour objet principal d'assurer sa domination, de l'étendre et de la rendre aussi fructueuse que possible : elle soumet, dans ce but, à une tutelle uniforme tous les membres de cette société : elle prévient le morcellement des domaines et pourvoit à leur transmission régulière, elle veille également à la conservation et au développement des forces morales, l'honneur, la valeur militaire, indispensables au succès dans les luttes pour la domination. La loi imposée à la population assujettie varie d'abord d'un domaine à un autre : chaque maître ou seigneur établit celle qui lui paraît la plus conforme à son intérêt; ses sujets réglementent de même, par des coutumes qui diffèrent de seigneurie à seigneurie, la portion de self government qui leur est laissée. A la longue, lorsque l'État s'est unifié comme en France, la loi du royaume remplace celle des seigneuries; mais elle ne consiste guère qu'en un ensemble de règles destinées à assurer en premier lieu, la domination du souverain et la perception de ses revenus; en second lieu, la sécurité des personnes et des propriétés; le reste est réglé par les coutumes communales ou provinciales, les statuts et règlements des corporations et confréries.
A ces lois qui assujettissent à une tutelle politique et économique plus ou moins étroite et compliquée, les différentes classes d'une nation, s'ajoutent celles qu'imposent la religion et l'opinion. Comme les autres, celles-ci ont [429] pour objectif des intérêts : intérêt de la religion, ou pour mieux dire de la corporation productive des services religieux; intérêt de la société particulière ou générale, où se produit l'opinion. Encore faut-il toutefois que les règles de conduite ou les manières d'agir que la religion ou l'opi' nion entreprend d'imposer soient, dans quelque mesure, consenties par ceux qui les subissent. Les articles essentiels de la loi de toute Église comme de tout État ont pour objet d'assurer sa domination; viennent ensuite ceux qui concernent le gouvernement de la vie des fidèles, ou la morale religieuse proprement dite, mais cette loi et ces règles ne sont obéies qu'autant que les « consommateurs religieux » les jugent conformes à leur intérêt, en ce monde et dans l'autre. Sinon, la religion établie, malgré son union ou son alliance avec l'État et la protection dont celui-ci la couvre, finit par être abandonnée pour une religion concurrente. Tel a été le sort du paganisme lorsqu'il a été supplanté par le christianisme, et celui du catholicisme dans les pays où le protestantisme a pris sa place. Autant peut-on en dire de l'opinion : elle a toujours pour objectif principal sinon unique l'Intérêt de ceux qui la produisent et s'efforcent de l'imposer, mais elle n'est acceptée qu'autant que la collectivité la juge conforme au sien. Si l'on vient à soupçonner qu'elle est fausse, autrement dit qu'elle ne répond point à l'intérêt collectif, intérêt de la corporation ou du parti, de la commune ou de la nation, on la bat en brèche, les plus hardis l'attaquent de front, et elle finit toujours par être supplantée par une autre considérée comme plus vraie, ou, ce qui est synonyme, comme plus conforme à l'intérêt de la collectivité.
Dans ses différentes pièces, lois et coutumes politiques, civiles, économiques, prescriptions religieuses et morales, règlements industriels et commerciaux, modes, opinions, etc., cet énorme appareil de tutelle qui s'est [430] construit partout et dans toutes les sociétés, qui a été se développant ou se modifiant, qui s'est tantôt perfectionné et tantôt dégradé, en limitant plus ou moins, et, dans les premiers âges, en supprimant presque la sphère d'activité du self govemment individuel; cet énorme appareil de tutelle, disons-nous, a été le produit de l'observation et de l'expérience, en matière de gouvernement de l'homme et de la société, produit accumulé et capitalisé de génération en génération. Aux impulsions désordonnées et le plus souvent nuisibles des appétits et des passions de la multitude ignorante et imprévoyante, cette tutelle a substitué des règles de conduite utiles, fondées sur des observations recueillies et des expériences répétées pendant des centaines ou des milliers de siècles, et dont la mise en pratique était appuyée tantôt sur la force matérielle, tantôt seulement sur la force morale. Malgré ses imperfections, son insuffisance et les vices de son fonctionnement, elle a dressé les hommes au respect de la vie et de la propriété d'autrui, et rendu parmi eux la paix possible. Elle a transformé des sauvages, gouvernés par les appétits et les passions de la brute, en hommes civilisés, capables quoique à des degrés divers de se gouverner sans nuire à autrui et à eux-mêmes; elle a fait, pour tout dire, l'éducation sociale de l'espèce humaine. Sans doute, cette éducation est loin d'être achevée et parfaite : les hommes les plus civilisés ne gouvernent point, d'une manière irréprochable, leurs affaires et leur vie, en remplissant comme elles devraient l'être leurs obligations envers autrui et envers eux-mêmes; en outre, dans toute société, les inégalités de civilisation sont énormes d'individu à individu, et elles ne le sont guère moins de société à société; d'où il faut conclure que la tutelle sera encore longtemps, sinon toujours, nécessaire, quoique dans une mesure de plus en plus réduite, et qu'elle continuera de [431] comporter une multitude de degrés pour s'adapter aux inégalités naturelles du besoin auquel elle répond; mais si son œuvre d'éducation et de protection sociales est inachevée et imparfaite, elle n'en a pas moins été et elle est encore un des facteurs indispensables de la civilisation.
Maintenant, si nous considérons cet appareil de tutelle dans les derniers siècles de l'ancien régime, à l'époque où l'avènement de la grande industrie commençait a bouleverser les conditions d'existence des sociétés civilisées, nous trouverons qu'il ne répondait plus suffisamment ni à l'état intellectuel et moral des populations ni à la situation du milieu politique et économique. L'éducation sociale avait réalisé dans les sphères supérieure et moyenne des progrès tels qu'ils rendaient inutile partant nuisible, une partie de la tutelle existante, en permettant d'élargir d'autant la sphère du self government de chacun, tandis que, dans les couches inférieures, au contraire, l'abolition de l'esclavage et du servage avait étendu le self government au delà de la capacité nécessaire pour le pratiquer; il fallait donc diminuer la tutelle des uns et augmenter celle des autres. Ajoutons que le changement radical qui s'opérait dans le milieu politique et économique, par suite du progrès extraordinaire de la machinery de la guerre et de la production, enlevait peu à peu sa raison d'être à l'appareil de protection adapté au régime de l'état de guerre, et de l'isolement des marchés. Enfin, les progrès en voie d'accomplissement permettaient de substituer, dans une large mesure, la tutelle libre à la tutelle imposée. C'était une œuvre immense et nécessaire à réaliser, mais qui exigeait une science et une prudence d'autant plus grandes qu'il s'agissait d'une machinery plus compliquée et plus délicate, à laquelle on ne pouvait toucher sans exercer, en bien ou en mal, une influence [432] considérable sur la condition de l'homme et de la société.
III. La tutelle et la révolution. — Que la révolution ait échoué dans l'accomplissement de cette œuvre, qu'elle n'ait détruit l'ancien régime de la tutelle, au moins dans les parties que la force pouvait détruire, que pour le remplacer par un régime plus rétrograde, moins en harmonie avec la condition présente et le développement futur de l'homme et de la société, 'cela devient de plus en plus visible, et cela s'explique d'ailleurs aisément quand on se reporte à l'état des esprits et des connaissances au moment de l'explosion révolutionnaire de 1789. Une réaction provoquée par la décadence et les abus de l'ancien régime et surexcitée parjune philosophie et une science superficielles s'était opérée dans le courant du xvinc siècle contre les institutions politiques, religieuses et économiques. De ces institutions séculaires, on ne voyait plus que les côtés défectueux et surannés; ce qu'elles avaient eu, ce qu'elles avaient encore d'utile et même de nécessaire était méconnu de parti pris ; les esprits qui se croyaient avancés voulaient faire table rase de toute cette machinery qui n'avait servi, selon eux, — et ils étaient sincères dans leur ignorance aussi bien que dans leur infaillibilité, — qu'à opprimer l'humanité et à l'abêtir. Les esprits modérés étaient, au fond, du même avis : seulement la pensée d'un bouleversement effrayait leur timidité; ils demandaient qu'on ménageât la transition entre l'ancien régime et le nouveau, mais quel devait être le nouveau régime? Les uns et les autres n'en avaient qu'une conception vague et confuse. Il y avait cependant un point sur lequel on s'imaginait qu'une pleine lumière s'était faite, c'est qu'il fallait détruire dans le monde entier ce qui subsistait encore de l'antique servitude, esclavage, servage, sujétion politique, religieuse et économique, et mettre à la place un ordre de choses fondé sur la liberté, l'égalité et la [433] fraternité. Mais, dans cet ordre de choses idéal, quel serait le rôle de la tutelle? Faudrait-il la supprimer ou simplement la transformer, dans quelle mesure et de quelle manière? Sur cette question, pourtant essentielle et qu'il eût été bien nécessaire de résoudre avant de renverser l'ancien régime, les esprits étaient complètement divisés : les uns croyaient volontiers qu'il suffirait de rendre les individus libres de gouverner leurs affaires et leur vie, en supprimant toutes les entraves opposées au déploiement de leur activité, en laissant faire et en laissant passer, pour que l'ordre et la justice s'établissent d'eux-mêmes. Les autres, au contraire, — et ceux-ci étaient les plus nombreux, — étaient couvaincus qu'en l'absence de toute tutelle, les forts et les riches ne manqueraient pas d'exploiter les faibles et les pauvres. A leurs yeux, « une tutelle sociale » était indispensable; seulement, elle ne devait rien avoir de commun avec l'ancienne. Celle-ci était diverse, inégale et, le plus souvent, instituée sans le consentement ou même contre la volonté de ceux qui la subissaient. Celle-là devait être une, égalitaire et voulue, c'est-à-dire la même dans toute l'étendue du territoire, également applicable à tous les citoyens et émanée de la volonté de la nation. 11 ne devait plus y avoir de lois et de tutelles particulières, mais une seule loi, une seule tutelle, celle de la nation réglementant et ordonnant, d'une manière uniforme, par l'entremise de son gouvernement, toutes les manifestations de l'activité de ses membres.
Telle a été la conception révolutionnaire de la tutelle. A l'examiner de près, cette conception prétendue progressive repose non sur l'observation des hommes et des choses, mais sur de pures fictions et de simples hypothèses. Elle suppose en premier lieu que tous les individus qui composent une nation, naturellement égaux en intelligence, en moralité et en lumières, — pourquoi pas aussi en force et [434] en beauté? — ont la même insuffisance de capacité à gouverner leurs affaires et leur vie, partant le même besoin de tutelle; ce que l'observation la plus élémentaire suffit pour infirmer. Elle suppose, en second lieu, autre fiction, que l'assemblée de législateurs qui institue cette tutelle uniforme et égalitaire, a la capacité et le désintéressement requis pour l'établir de la manière la plus utile, autrement dit la plus conforme à l'intérêt général. Elle suppose, en troisième lieu, que le gouvernement chargé de la faire fonctionner n'a pas moins que les législateurs la capacité et la volonté de s'acquitter utilement de sa tâche. A la place de ces fictions, mettons les réalités. Là capacité du self government de la multitude des membres d'une nation est essentiellement diverse et inégale, d'où il suit qu'en les soumettant à une loi uniforme et égalitaire, on enlève trop au self government des uns et trop peu à celui des autres, et on diminue par là même l'activité utile de tous. Autre réalité. Une assemblée législative ne représente jamais, en proportion de leur valeur, tous les intérêts particuliers, dont la collection constitue l'intérêt général, et en admettant même que cet idéal de la représentation se trouvât réalisé, la loi serait dictée toujours par les intérêts en majorité; or il n'y a pas de raison pour que ces intérêts s'accordent, plus que ceux qui sont en minorité, avec l'intérêt général. Troisième réalité. Le gouvernement appartient nominalement à la nation; mais, en fait, il est toujours entre les mains d'une association politique ou d'un parti, qui vit de l'exploitation de la tutelle publique, et qui est d'autant plus intéressé à en grossir les frais que sa jouissance est plus précaire. Enfin, une tutelle monopolisée par un gouvernement et composée de toute sorte de branches disparates ne peut, en vertu de la nature des choses, être aussi économique et efficace qu'une tutelle spécialisée et soumise à la concurrence.
[435]
Ce nouveau système de tutelle n'a pas moins prévalu dans tous les pays qui ont subi, de près ou de loin, l'influence de la révolution. Partout on a cru faire œuvre de progrès en abolissant les institutions particulières, diverses et inégales de l'ancien régime pour les remplacer par une loi uniforme, égalitaire, et émanée de la soi-disant volonté nationale. Dans chaque pays, une manufacture législative installée à grands frais produit tous les ans, depuis bientôt un siècle, un énorme fatras de lois ayant pour objet essentiel de régler uniformément et également les manifestations de l'activité individuelle ou collective. Cependant ce nouveau régime, à son tour, soulève des réclamations générales bien que contradictoires, les uns se plaignant que la nation est trop gouvernée, les autres qu'elle ne l'est pas assez. Est-il nécessaire de redire que ces réclamations opposées sont également fondées? Il y a trop de tutelle pour les individualités supérieures et moyennes, il n'y en a pas assez pour la multitude des individualités inférieures. En outre, cette tutelle instituée sous l'influence d'intérêts particuliers par des assemblées médiocrement pourvues de lumières et de moralité, et exercée par des gouvernements de parti intéressés à en grossir les frais, établie enfin contrairement aux principes de la séparation des entreprises et de la concurrence, ne peut être qu'inefficace et coûteuse, et elle est condamnée à une dégradation et à un enchérissement progressifs et inévitables.
IV. Résultats de l'abolition de l'ancien régime de la tutelle par voie révolutionnaire ou philanthropique. — Abolir les anciennes formes de la tutelle, rendre l'individu libre, en lui garantissant tous les droits que la liberté contient et en lui interdisant même, par surcroît de précaution, de les aliéner ou de les engager, sauf à l'assujettir à une loi ou à une tutelle établie par la « nation », loi ou tutelle dont le caractère essentiel est d'être une et égale pour tous; [436] empêcher toute autre tutelle de renaître ou de se créer en concurrence avec celle-là, voilà donc la conception du gouvernement de l'homme et de la société que la révolution a fait prévaloir, après l'avoir elle-même empruntée aux plus vieilles pratiques du despotisme. C'est en vertu de cette conception, adoptée par la généralité des esprits réputés progressifs, que les principaux États civilisés se sont entendus pour supprimer la traite et l'esclavage des nègres, que le servage a été aboli en Russie, une législation protectrice des fermiers introduite en Irlande, et que les peuples civilisés s'empressent, dans toutes les contrées qu'ils assujettissent à leur domination, de remplacer des institutions et des lois séculaires, déclarées par eux, sans examen, barbares et rétrogrades, par leurs codes progressifs et civilisateurs. C'est encore en vertu de la même conception que les socialistes prétendent remédier à tous les maux de la société parla généralisation de la tutelle de l'État. Examinons brièvement les résultats de quelques-unes de ces opérations chirurgicales faites sur l'organisme compliqué et sensitif des sociétés par des praticiens philanthropes, mais qui ne paraissaient pas se douter que la philanthropie la plus pure ne saurait tenir lieu de 1n connaissance des hommes et des choses. [66]
[437]
§ 1". L'abolition de la traite et de l'esclavage des nègres. — La servitude, volontaire ou forcée, a été jusqu'à une [438] époque récente la condition de la grande majorité de l'espèce humaine et elle est encore celle de la masse de la population en Afrique. On connaît les circonstances sous l'influence desquelles la traite des nègres d'Afrique en Amérique s'est créée au commencement du xvi" siècle. On connaît aussi les causes qui ont soulevé les esprits contre ce commerce, un siècle et demi plus tard. Ces causes se résumaient dans la réaction universelle qui se produisait contre les anciennes formes de la tutelle, esclavage, servage, sujétion. Les amis du progrès et de l'humanité voulaient abolir la servitude dans le monde entier, eu affranchissant au besoin par la force et même contre leur propre gré les hommes de tous les pays et de toutes les couleurs. A l'objection que ces affranchis ne seraient peut-être point capables de bien user de leur liberté, on répondait qu'il se pouvait, à la vérité, que la servitude les eût dégradés, mais que cette influence néfaste d'un régime d'oppression et d'avilissement ne tarderait pas à s'effacer, car tous les hommes ont virtuellement la capacité d'être libres comme ils en ont le droit; qu'au surplus, la tutelle bienveillante, éclairée et désintéressée de l'Etat suppléerait à ce qui pourrait leur manquer de ce côté. L'opinion publique, travaillée par les philanthropes en Angleterre et les philosophes en France, [439] sollicita donc les gouvernements d'intervenir pour prohiber un commerce et une institution qui faisaient honte à l'humanité. Les gouvernements s'entendirent d'abord pour interdire la traite, dissoudre les compagnies qui la pratiquaient et établir des croisières à la côte d'Afrique afin d'assurer cette prohibition. Cependant la traite continuait de se faire en contrebande, et la prohibition ne donnait que des résultats négatifs. [67] Tout en exigeant des sacrifices [440] considérables d'argent, de marins et de soldats exposés à uu climat insalubre, et en suscitant entre les États prohibitionnistes [441] par philanthropie la querelle du droit de visite, elle aggravait les souffrances des malheureux objets de ce [442] commerce prohibé, augmentait leur mortalité pendant les traversées, abaissait la valeur de la vie humaine aux lieux de provenance et encourageait la pratique barbare du massacre des prisonniers. Alors on comprit qu'il ne suffisait pas de défendre le commerce des esclaves, mais qu'il fallait supprimer la demande qui le provoquait, et on se mit en devoir d'abolir l'esclavage. Cette entreprise humanitaire, qui se poursuit depuis bientôt un siècle, peut être partagée en trois phases : 1° la menace de l'abolition, 2° l'abolition par voie d'insurrection, de guerre ou de rachat, 3° les résultats de l'abolition. Avant que l'opinion eût été soulevée contre l'esclavage et que des mesures prohibitives eussent été prises contre la traite, négriers et planteurs prenaient grand soin de leurs esclaves, et ils se gardaient de leur infliger des privations et des peines qui les eussent endommagés et dépréciés. Les planteurs, obéissant à leur intérêt bien entendu et imitant les pratiques qui avaient mis fin graduellement à l'esclavage dans l'ancien monde, [443] abandonnaient à leurs esclaves un « pécule » qui leur permettait de se racheter, dès qu'ils sentaient le besoin d'être libres et qu'ils devenaient capables de se gouverner euxmêmes. Mais aussitôt que la traite eût été interdite et que les planteurs se trouvèrent menacés dans leur propriété, les précautions nécessitées par ce nouvel état des choses et des esprits rendirent de plus en plus dure la condition des esclaves. [68] Enfin, l'opération de l'abolition, soit qu'elle ait eu lieu par voie d'insurrection comme à Saint-Domingue, de guerre civile comme aux Etats-Unis ou de rachat comme dans les colonies anglaises et françaises, a occasionné directement et indirectement des frais et des pertes incalculables.
Cependant tous ces maux infligés aux nègres et aux blancs par une prohibition philanthropique n'ont-ils pas été compensés par les résultats? La condition de la race nègre n'a-t-elle pas été améliorée d'une manière sensible? Les contrées qui ont été débarrassées du fléau de l'esclavage n'ont-elles pas vu croître plus rapidement leurs richesses et leur civilisation? L'expérience, on le sait, n'a ratifié sur aucun de ces points les espérances des abolitionnistes. Les pays où l'esclavage a été aboli ont vu décroître leur prospérité, et la race nègre abandonnée à elle-même s'est montrée généralement incapable de pratiquer le self government. Ici, elle a décru en nombre [et elle est en train de disparaître devant la concurrence des autres races; ailleurs, la condition des individualités les plus faibles et, en particulier, des femmes et des enfants, est devenue pire. [69] Ajoutons qu'on a plutôt déplacé l'esclavage, en l'aggravant dans certaines régions, qu'on ne l'a supprimé. Aux esclaves [445] les planteurs ont substitué, dans les Indes occidentales, à Cuba, à l'île Maurice, etc., des engagés à temps, qu'ils exploitent avec une rapacité et une dureté impitoyables parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ménager leurs forces : il leur suffit que la capacité de travail de l'engagé dure aussi longtemps que son engagement. [70]
Que conclure de là? Qu'une tutelle n'a pas cessé d'être nécessaire, au moins à la grande majorité des individus [447] appartenant aux races de couleur, et, qui sait même ? à la race blanche, et qu'en prohibant l'esclavage, forme primitive et barbare de la tutelle, sans le remplacer par une tutelle supérieure, en vouant l'affranchi au self government obligatoire, sans rechercher s'il était capable ou non de le pratiquer, on a fait une œuvre de rétrogression et non une œuvre de progrès.
Ce n'était pas à la prohibition qu'il fallait recourir pour abolir l'esclavage, c'était à la concurrence. Laisser subsister cette forme arriérée mais nécessaire dela tutelle jusqu'à ce que des formes nouvelles et progressives l'eussent supprimée en la remplaçant, voilà ce qu'il y avait et ce qu'il y a encore à faire dans l'intérêt particulier des races inférieures et dans l'intérêt général de la civilisation. [71]
[448]
§ 2. L'abolition du servage en Russie. — Le-servage en Russie date seulement de la fin du xvic siècle, époque où il fut établi par un simple oukase du tsar Boris Godounof, mais ce serait une erreur de croire qu'il ait remplacé, alors, un régime de self government. Le paysan russe ne se [449] gouvernait pas lui-même ; il était gouverné par la communauté agraire dont il faisait partie, et par le propriétaire du domaine sur lequel cette communauté était établie. Ce domaine dont il avait la jouissance à la manière féodale, sous la condition de rendre à l'État les services militaires ou civils que le tsar, chef absolu et héréditaire de la [450] communauté politique jugeait nécessaire de requérir, le seigneur en concédait une partie aux communautés agraires en échange du travail dont il avait besoin pour exploiter l'autre partie. De plus, il protégeait, encore à la manière -féodale, ces petites communautés tout en leur laissant le -soin de se gouverner elles-mêmes, mais en établissant cependant, en ce qui les concernait, les lois qui lui paraissaient les plus propres à assurer le bon ordre et la prospérité de son « Etat ». La communauté ou le mir représenté par ses anciens, formant une sorte de conseil d'administration, partageait les terres qui lui étaient concédées entre les familles, en raison du nombre de bras dont elles disposaient, et il renouvelait ce partage d'intervalle en intervalle, afin de proportionner toujours autant que possible les parts, et avec elles les redevances en travail ou les corvées, aux forces disponibles de chacune de ces unités composantes de la communauté. Les anciens veillaient encore à l'observation des coutumes qui réglaient les obligations et la manière de vivre de chacun, et leur autorité n'était subordonnée qu'à celle du seigneur. L'oukase de Boris Godounof, interdisant aux paysans de se déplacer sans l'autorisation du seigneur, ne changeait rien en apparence à cet état de choses ; c'est pourquoi il ne provoqua aucune résistance parmi les paysans qui n'en prévoyaient point les conséquences. Mais en établissant un monopole où il n'y avait auparavant que des rapports libres, il ne pouvait manquer à la longue d'abaisser la qualité des services de protection et de tutelle que le seigneur rendait à ses paysans et d'en élever le prix. En vain le tsar intervint pour réglementer ce monopole, en limitant le nombre des jours de corvée, la condition des paysans asservis devint de plus en plus mauvaise, et une réaction justement motivée commença à s'opérer contre le servage. Le remède au mal était facile à découvrir e.t simple à appliquer. Il [451] consistait à supprimer le monopole établi par Boris Godounof, en restituant aux paysans la liberté de se déplacer et en rétablissant ainsi la liberté des rapports et des conventions entre eux et les propriétaires. Cette solution si naturelle et si simple d'un problème redoutable était d'autant mieux indiquée que le tsar avait cessé d'obliger les membres de la communauté politique à rendre] à l'État des services militaires et civils, en échange de la jouissance de leurs domaines; d'obligatoires, ces services étaient devenus libres. L'affranchissement du servage seigneurial imposé au paysan apparaissait donc comme la conséquence juste et nécessaire de l'affranchissement du servage d'État imposé au seigneur. Malheureusement, l'influence prépondérante des intérêts engagés dans le monopole fit reculer le gouvernement devant cette conséquence, jusqu'au jour où la solution de la question de l'émancipation des paysans lui apparut comme une nécessité inévitable.
Au lieu de demander cette solution à la liberté, on la demanda, en suivant la mode du jour, à une réglementation mi-partie socialiste, mi-partie protectionniste. On abolit la tutelle seigneuriale, mais pour la partager entre la commune et la bureaucratie administrative. Le paysan n'a été affranchi de la tutelle du seigneur que pour être assujetti davantage à la tutelle du mir et à celle de l'administration. A-t-il gagné au change? Le mir est ignorant et brutal, l'administration est arbitraire et vénale, et d'ailleurs elle n'est point immédiatement intéressée comme l'était le propriétaire au bon gouvernement du domaine. Les progrès de l'ivrognerie, que le gouvernement, auquel la régie de l'eau-de-vie procure le plus clair de ses revenus, n'a point intérêt à décourager, suffiraient pour attester que le pfiysan n'a rien gagné à échanger la tutelle du seigneur, si gâtée qu'elle fût par le monopole, contre un surcroît de tutelle communale et bureaucratique. Cependant, si l [452] tutelle à laquelle il continue à se trouver assujetti a baissé en qualité au lieu de s'améliorer, n'est-elle pas devenue moins onéreuse? L'émancipation, en abolissant le monopole seigneurial, n'a-t-elle pas diminué les charges du paysan? Elle les a, au contraire, augmentées. D'abord, et bien que le seigneur eût été exonéré des obligations qui avaient motivé l'octroi de ce monopole, on a jugé à propos de l'indemniser, en contraignant le paysan à lui acheter une portion arbitrairement fixée du domaine et en calculant le prix d'achat de manière à y comprendre une indemnité compensatrice de ce monopole. De là une charge supplémentaire que les serfs émancipés auront à supporter pendant près d'un demi-siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'entière conclusion de l'opération du rachat. A cette charge viennent s'ajouter les impôts croissants établis en triple expédition au profit du gouvernement communal, provincial et central,qui ont hérité de la tutelle seigneuriale et qui, s'ils ne l'ont pas autrement améliorée, se font concurrence pour en élever le prix.
Les conséquences de cette opération aussi imprudente que philanthropique ne se sont pas fait attendre. En taillant dans le vif d'un organisme affaibli, sans se demander s'ils n'en détruisaient point une partie essentielle, les opérateurs ont aggravé l'état du malade au lieu de le guérir. La gangrène du nihilisme, sans parler de l'antisémitisme, [72] [453] s'est mise dans la plaie, et il n'est déjà que trop visible que les paysans, les proprétaires etle gouvernement russe n'ont pas plus à se louer des résultats de l'émancipation des serfs opérée suivant la méthode philanthropique que les nègres, les propriétaires et les gouvernements abolitionnistes n'ont eu à se féliciter de ceux de la prohibition de la traite et de l'esclavage. [73]
[454]
§ 3. La réforme du régime agraire en Irlande. — Toute l'explication de la décadence économique et sociale de l'Irlande, [455] des maux qui l'ont accablée depuis la conquête anglaise et de la haine irréconciliable que les Irlandais ont vouée à [456] leurs dominateurs se trouve dans le fait de la substitution violente d'un régime de self government obligatoire au [457] régime delà tutelle patriarcale. Avant la conquête,l'Irlande était partagée en domaines appartenant à une tribu ou à un [458] clan, gouverné par un chef héréditaire. Les coutumes que ce chef ou roi était chargé de faire observer réglaient [459] l'allotissement des terres, les mariages, la manière de vivre de ces grandes familles, conformément au tempérament [460] particulier de chacune. [74] Sous ce régime de tutelle patriarcale, l'Irlande arriva à un degré de prospérité extraordinaire et la sécurité y était telle que la belle fille dont il est question dans la ballade de Th. Moore, pouvait la traverser seule, couverte de ses bijoux.
La conquête survint. Les conquérants confisquèrent le sol et y apportèrent avec eux le selfgovernment. Aux anciennes coutumes se substitua une loi qui dépouillait les vaincus de leur droit collectif à la propriété du clan, en leur donnant en échange la liberté individuelle avec la responsabilité qui y est naturellement attachée. Mais cette liberté si précieuse aux Anglo-Saxons était un présent illusoire et funeste pour les Irlandais moins capables du self government et placés dans un milieu économique moins favorable, par suite des prohibitions dont les vainqueurs frappèrent leur industrie. En l'absence de moyens de communication rapides et à bon marché, la terre était alors ce qu'elle commence seulement à cesser d'être aujourd'hui : un monopole naturel. Le propriétaire anglais que la conquête avait substitué, dans les domaines confisqués, au clan ou au chef indigène, soumis à la coutume locale, distribuait les terres et en fixait le loyer à son gré. Le paysan dépossédé et dans l'impossibilité de trouver sur place d'autres moyens d'existence ou d'émigrer, était bien obligé de subir les conditions du propriétaire,si léonines qu'elles pussent être. Son revenu alla ainsi se réduisant graduellement jusqu'à un minimum de subsistance,et ce minimum même s'abaissa encore lorsque l'introduction de la pomme de terre eut permis de remplacer les anciens matériaux de l'alimentation par une substance moins nutritive, mais plus abondante. D'un autre côté, ce revenu abaissé au minimum, l'Irlandais, nature gaie, spirituelle, hospitalière, mais [461] imprévoyante et rétive aux exigences du self govermnent, pouvait-il l'aménager d'une manière utile? Vivant au jour le jour, se multipliant sans prévoyance, depuis qu'il n'avait plus à compter avec la coutume, amateur de plaisirs et de clinquant, facile à entraîner, et, comme le nègre, le plus mauvais des maîtres pour lui-même, il devait fatalement tomber dans une misère noire, et, la pomme de terre venant à manquer par suite de l'épuisement d'un sol morcelé à l'excès, subir les effroyables extrémités de la famine.
Exaspérés par les ressentiments de la. dépossession et par les maux qui étaient la conséquence du régime établi par la conquête, les Irlandais eurent recours, suivant l'habitude ordinaire, à des remèdes violents qui ne pouvaient qu'aggraver ces maux, dont ils ne discernaient point d'ailleurs toutes les causes. Trop faibles pour chasser les conquérants , ils constituèrent des sociétés secrètes, ayant pour but d'empêcher les propriétaires d'user à leur gré du pouvoir excessif que leur conférait le monopole naturel de la terre. Ces associations interdisaient aux propriétaires d'élever le taux de la rente et d'expulser leurs tenanciers; et leurs prohibitions, appuyées sur des mesures terroristes, l'incendie, la mutilation des bestiaux, la mort, avaient pour résultat immédiat d'empêcher le taux de la rente de s'élever au niveau où l'auraient naturellement porté le monopole du propriétaire et la concurrence des preneurs. Mais ce n'était qu'un palliatif temporaire : le tenancier, protégé à la fois contre l'exhaussement possible de la rente et contre l'expulsion de sa ferme, vendait ce qu'il appelait son droit au bail, et son successeur en achetant ce droit payait, sous une autre forme, un supplément de rente. Ce tenancier de seconde main se trouvait ainsi dans une situation pire que celle de son prédécesseur, — car les propriétaires usaient rarement de tout leur pouvoir, tandis que les tenanciers vendaient leur droit au bail aussi cher que possible. [462] En outre, ce terrorisme protectionniste, en provoquant l'absentéisme des propriétaires, diminuait la consommation des produits agricoles et autres, au détriment des producteurs.
La situation continuant de s'aggraver d'une manière alarmante, le gouvernement anglais a entrepris à son tour d'y porter remède. Après avoir épuisé les rigueurs de la conquête, en fermant aux Irlandais l'accès des fonctions publiques et des professions libérales, en les obligeant à supporter les frais d'un culte étranger, en ruinant leurs industries par des mesures prohibitives; [75] il a adopté une politique réparatrice et, malheureusement aussi, philanthropique, à l'égard de l'Irlande. Non seulement il a cessé [463] de l'opprimer, mais encore il s'est évertué à étendre spécialement sur elle les bienfaits de la tutelle et de la protection gouvernementales. Il ne s'est pas contenté d'établir en Irlande le régime de charité publique qui fleurit en Angleterre, il y a mis en vigueur une série de lois et de mesures agraires ayant pour objet de limiter le pouvoir des propriétaires et de faciliter aux tenanciers l'accès de la propriété. Mais ni la charité publique, ni les mesures agraires n'ont atteint et ne pouvaient atteindre le but que se proposaient leurs promoteurs. Les effets naturels et inévitables de la charité publique, en Irlande comme ailleurs, sont d'encourager la multiplication et l'imprévoyance des pauvres : plus elle est facile et abondante, plus elle contribue à accroître la misère et la dégradation auxquelles elle sert de palliatif. Quant aux restrictions aux droits des propriétaires, n'ontelles pas pour résultat unique et invariable d'entraver les progrès de l'industrie agricole? Est-il nécessaire d'ajouter que le rachat des propriétés pour les attribuer aux paysans, — procédé philanthropique emprunté à la Russie, dont certains économistes anglais se sont engoués, — aurait un résultat analogue? Il empêcherait toute application de la science et du capital à l'agriculture, en consolidant, sinon en perpétuant, le morcellement excessif du sol. Ceci, à la vérité, dans l'hypothèse que le tenancier devenu propriétaire se trouvât pourvu des qualités nécessaires pour conserver son petit domaine. Or ces qualités lui font généralement défaut. Selon toutes probabilités, son lopin deterre ne tarderait pas à être grevé d'hypothèques et à être adjugé par voie d'expropriation aux prêteurs écossais ou Israélites, entre les mains desquels la propriété foncière se concentrerait de nouveau. Le résultat final de cette opération philanthropique serait de mettre à la place des maîtres actuels du sol une nouvelle classe de propriétaires plus durs et plus rapaces, comme la chose est arrivée en [464] France à la suite de la confiscation des biens de la noblesse et du clergé. La population agricole de l'Irlande gagnerait-elle au change?
Loin de remédier aux maux de l'Irlande, le terrorisme agraire et la philanthropie gouvernementale ne peuvent que les aggraver. [76] Les causes de ces maux résident dans le monopole naturel de la propriété foncière, et dans le défaut de capacité de la masse de la population pour le self government; les seuls remèdes qui s'y adaptent sont la [465] concurrence et la tutelle. Déjà, la concurrence élargie par le développement des moyens de communication rapides et à bon marché a commencé à agir pour détruire le monopole naturel de la propriété foncière. La possibilité croissante d'émigrer dans les foyers de production agricole et industrielle de l'Angleterre et du Nouveau Monde a permis aux ouvriers irlandais de débattre plus librement le prix de leurs services, et les pauvres tenanciers ont cessé d'être réduits à louer la terre à tout prix sous peine de mourir de faim. De là, une amélioration sensible dans leurs conditions d'existence. On peut douter, en revanche, qu'ils soient plus capables du self government que ne l'étaient leurs ancêtres. Selon toute apparence, cette race intelligente et spirituelle, mais inhabile à refréner ses appétits et ses passions, ne verra la fin des maux qui l'ont accablée depuis la destruction violente de son ancien régime de tutelle que lorsque cette tutelle aura été librement reconstituée sous une forme appropriée à l'état des sociétés vivant de la grande industrie et dans la mesure exigée par son tempérament particulier.
§ 4. Les rapports des peuples civilisés avec les races inférieures ou en retard. Le remplacement des institutions dites barbares par le self government combiné avec la tutelle gouvernementale. — C'est un fait d'observation et qui n'a comporté jusqu'à présent qu'une seule exception : celle des établissements des jésuites au Paraguay, que la domination ou même le simple contact des peuples civilisés est funeste aux races inférieures et arriérées. Partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, dans l'Océanie, soit que les peuples civilisés agissent en ennemis ou en amis, ils détruisent ou dégradent les races moins avancées au lieu de les élever jusqu'à eux. Essayons de nous rendre compte des causes de ce phénomène.
En premier lieu, on peut l'attribuer à la conviction passée [466] à l'état de dogme ou d'axiome indiscutable chez tes peuples civilisés que la religion, les institutions et les coutumes qui diffèrent des leurs ne sont autre chose que des superstitions grossières et des monuments de barbarie; qu'en contraignant par conséquent les races inférieures à adopter leur religion et leurs lois, ils leur rendent un inappréciable service. [77] Telle était par exemple la conviction des Espagnols lorsqu'ils convertissaient, on sait par quels procédés, les Indiens du Pérou et du Mexique, et leur imposaient des institutions empruntées à la mère patrie. Le résultat de ces procédés civilisateurs a été d'anéantir les civilisations naissantes du Pérou et du Mexique, aussi complètement qu'aurait pu le faire une invasion des Indiens sauvages des prairies, et de déterminer le retour des peuples indigènes à un état inférieur. Sans doute, la cruauté et l'avidité des conquérants ont eu leur part dans ce résultat, mais en admettant qu'ils n'eussent été ni cruels ni avides, qu'en imposant leur religion et leurs institutions aux Indiens ils n'eussent obéi qu'à une intention philanthropique et [467] humanitaire, la rétrogression eût été la même. Pourquoi? Parce la religion et les institutions qu'ils détruisaient étaient le fruit d'un travail et d'une expérience séculaires, et qu'elles constituaient un régime de tutelle adapté au tempérament physique et moral des indigènes et à leur degré d'avancement dans l'art de se gouverner soi-même. Ces institutions, on pouvait les perfectionner en élaguant peu à peu ce qu'elles avaient de barbare et de nuisible; mais en les supprimant pour les remplacer par d'autres qui ne convenaient point aux Indiens précisément parce qu'elles appartenaient à un peuple arrivé à un degré supérieur de civilisation, on vouait cette race en retard à une destruction ou tout au moins à une rétrogression inévitable, absolument comme si l'on s'avisait d'appliquer aux enfants le régime des hommes faits. Seuls, les jésuites, excellents observateurs, rompus à la connaissance des hommes et à l'art de les gouverner, comprirent la nature des Indiens, et les soumirent à l'espèce et au degré de tutelle qui leur étaient adaptés; de là, le succès de leurs missions du Paraguay.
En second lieu, alors même que les Européens s'abstiennent de supprimer la religion, les institutions et les coutumes qui constituent la tutelle des peuples moins avancés, ils apportent avec eux des engins de destruction et de corruption, contre lesquels cette tutelle demeure, lé plus souvent, impuissante, les liqueurs fortes par exemple. Et plus la nation colonisatrice ou conquérante est avancée en civilisation, plus le self government est développé chez elle, plus sa domination et le contact de ses membres sont pernicieux pour ces peuples à demi civilisés ou sauvages. Car elle s'imagine volontiers leur rendre service en leur accordant le bienfait prétendu de ce self government dont ils sont incapables, et elle ne les préserve point de l'abus que ses membres font de leur liberté, en exploitant l'ignorance et les passions imprévoyantes de ces peuples enfants. [468] La domination des nations relativement moins avancées leur est moins nuisible; elle les expose moins à l'abus d'une liberté plus limitée, et les soumet à un régime de tutelle qui se rapproche davantage de celui qui leur convient. C'est ainsi que la domination espagnole elle-même, malgré ce qu'elle avait de dur et d'inhumain, a été moins destructive des races indigènes du Nouveau Monde que celle de l'Angleterre et des États-Unis.
Nous n'ignorons pas qu'une école moderne, s'appuyant à faux sur la doctrine de l'évolution, a entrepris de justifier cette destruction des races arriérées et faibles par les peuples supérieurs en civilisation et en force. Ce sophisme sanguinaire a pour point de départ la conception erronée de la liberté qui est aujourd'hui en vogue, et qui se résume dans le self government obligatoire. Tant pis pour ceux qui ne possèdent ni la force physique et morale ni l'intelligence nécessaires pour gouverner eux-mêmes leurs affaires et leur vie, et qui succombent dans la lutte pour l'existence! Cette élimination des faibles et des incapables tourne, affirme-t-on, au profit commun de l'espèce, car leur place est remplie par des individus plus capables et plus forts. Mais les adeptes de cette école soi-disant libérale et progressive sont-ils bien assurés que les races qu'ils vouent d'un cœur léger à la destruction ne possèdent point des facultés et des aptitudes dont la conservation et le développement ultérieur importent à l'avenir de l'espèce? Ignorent-ils que la tutelle et la discipline peuvent combler et au delà les inégalités de forces et d'intelligence, en développant les facultés de l'individu le moins richement doué et en leur imprimant une direction utile? Avec des soldats médiocrement courageux, d'une faible complexion physique et morale, ne constituet-on point une armée capable de vaincre un pareil nombre d'hommes individuellement supérieurs en force, en intelligence et eu courage, mais soumis à une discipline moins [469] exacte et à une direction moins habile? Le progrès ne commande point d'imposer la liberté et le self govemment à toutes les individualités humaines indistinctement, en les obligeant à en subir les conséquences bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles. S'il est utile d'accorder à tout homme qui se sent capable de gouverner ses affaires et sa vie, une liberté entière, un self govemment complet, au lieu de l'astreindre à supporter les restrictions, les directions, les gênes et les frais d'une tutelle dont il n'a pas besoin, il n'est pas moins conforme à l'intérêt général de l'espèce de permettre à ceux qui ont conscience de ne point posséder la capacité nécessaire à la lutte pour l'existence, de se soumettre à la tutelle et à la discipline que réclament l'imperfection et l'insuffisance de leurs facultés gouvernantes.
V. De la reconstitution libre de la tutelle par voie d'évolution.—Les progrès de l'industrie et l'extension de la concurrence ont pour effet d'augmenter à la fois le besoin de liberté et le besoin de tutelle.
Depuis un demi-siècle surtout, le développement de la grande industrie a nécessité la création d'entreprises de plus en plus vastes, exigeant la concentration d'une masse de plus en plus considérable de capital et de travail : entreprises de navigation à vapeur, de chemins de fer, de télégraphie, mines, hauts-fourneaux, manufactures, établissements de crédit, etc. Bien loin de demander la liberté, ces enlreprises ont commencé par réclamer l'intervention de l'Etat pour la limiter à leur profit, et, grâce aux influences politiques dont elles disposaient, elles sont généralement arrivées à leurs fins : en France et dans la plupart des pays du continent, une banque a obtenu le monopole de l'émission de la monnaie fiduciaire, les compagnies de chemins de fer ont été préservées de la concurrence dans leur rayon d'exploitation, les entreprises industrielles et agricoles ont été protégées contre la concurrence [470] étrangère par des tarifs prohibitifs. Aussi longtemps que le marché intérieur a absorbé la plus forte part des produits du travail de la nation, ce régime a pu se maintenir sans difficulté. Sans doute, comme le démontraient les économistes, on ne peut protéger les uns qu'aux dépens des autres : le monopole des banques diminue et renchérit le crédit au détriment de l'universalité des branches de la production, le monopole des chemins de fer renchérit de même la circulation de tous les produits et services, la protection douanière a pour effet d'exhausser d'une manière artificielle les prix des produits des industries protégées; mais ces charges qui s'ajoutent à celles de l'impôt retombent en définitive sur les consommateurs. La multitude est moins bien pourvue de toutes les choses dont elle a besoin et elle est obligée de les payer plus cher, autrement dit de fournir en échange une quantité de travail plus considérable. Mais la multitude est ignorante, et il n'est point malaisé de lui faire croire qu'on la protège en la dépouillant.
Cependant, à mesure que le matériel de la production se perfectionne et acquiert plus de puissance, que les moyens de communication de tout genre se multiplient, que les relations commerciales s'étendent, on voit se créer un « marché général » qui vient s'ajouter au marché intérieur, qui finit par le dépasser en importance, et sur lequel les industries de toutes les nations apportent leurs produits en concurrence. Sur ce marché général, la pression de la concurrence oblige les industries d'exportation à abaisser au minimum leurs prix de vente, et elles ne le peuvent qu'à la condition de diminuer d'autant leurs frais de production. Le système de protection qui élève artificiellement ces frais devient alors une cause d'infériorité, une « nuisance », et à mesure que le marché général acquiert plus de valeur en comparaison du marché national, et que les [471] industries d'exportation croissent en nombre et en importance, ce système perd du terrain. On essaye d'abord de le maintenir en vigueur, en établissant, pour contre-balancer ses effets nuisibles, des primes à l'exportation; mais un moment arrive où cet expédient devient trop ruineux pour continuer à être apppliqué, où il faut produire mieux et à meilleur marché que ses concurrents si l'on ne veut point être exclu du marché général. Alors, — et telle est la situation qui commence à apparaître,—le besoin de liberté s'impose avec une puissance croissante aux nations de grande industrie. En vain elles voudraient s'isoler, le marché intérieur leur suffirait de moins en moins :elles se condamneraient à une décadence et à une ruine inévitables. Sous peine de périr, il faudra bien qu'elles débarrassent leur industrie des entraves, des privilèges et des charges qui élèvent artificiellement ses prix de revient, et le jour n'est peut-être pas éloigné où la pression de plus en plus générale et intense de l'opinion contraindra les gouvernements à renoncer à la machinery surannée de la réglementation et de la protection pour accorder à l'industrie une liberté devenue une condition absolue d'existence.
Mais, tout en augmentant d'un côté le besoin de liberté, les progrès de l'industrie et l'extension de la concurrence augmentent de l'autre le besoin de tutelle. A mesure qu'elles s'agrandissent, les entreprises exigent une concentration plus considérable de capital. L'inégalité de pouvoirs entre l'entrepreneur et l'ouvrier, entre l'acheteur et le vendeur de travail qu'Adam Smith constatait déjà il y a un siècle, devient chaque jour plus marquée. L'entrepreneur est de plus en plus le maître de dicter les conditions et le taux du salaire. En d'autres termes, la puissance du capital s'accroît à mesure qu'il est plus concentré en présence du travail individualisé. Les masses ouvrières pourraient finir ainsi par se trouver complètement à la merci [472] des détenteurs ou des metteurs en opuvre du capital, sans posséder même contre l'abus de leur pouvoir les garanties que l'esclave et jusqu'à un certain point le serf trouvaient dans l'intérêt des maîtres ou des seigneurs auxquels ils étaient appropriés. Et non seulement cette multitude, au sein de laquelle la capacité du self government n'existe généralement qu'à un faible degré et qui depuis l'abolition prématurée des anciennes formes de la tutelle supporte entièrement la responsabilité de son.existence, cette multitude débat les conditions et le prix dei ses services avec des entrepreneurs dont le pouvoir va croissant; mais elle se trouve, par le fait des progrès de la production et de la richesse, en présence de tentations plus nombreuses et plus pernicieuses. La situation de l'ouvrier dans nos sociétés civilisées n'est pas sans analogie avec celle du PeauRouge ou du nègre libéré en contact avec l'homme blanc: son ignorance, son imprévoyance et ses appétits qu'il est encore incapable de refréner et auxquels viennent s'offrir des aliments nouveaux, aussi tentants que funestes, le livrent à la merci de qui veut l'exploiter, sans qu'il puisse trouver auprès de ceux qui lui fournissent en échange de son travail les matériaux ou l'existence, et qu'aucun intérêt de propriété ou de domination ne pousse désormais à veiller à sa conservation, une protection contre les autres et contre lui-même.
Cette protection, la classe ouvrière à son tour l'a demandée au gouvernement. Mais, au début du nouveau régime, elle ne disposait point de l'influence nécessaire pour l'obtenir; à quoi il faut ajouter même que l'appareil de la protection était en partie dirigé contre elle. Telles étaient notamment les lois interdisant les coalitions et, en général, toute association ou combinaison ayant pour objet de remédier à l'inégalité ordinaire de la situation des entrepreneurs et des ouvriers sur le marché du travail. Il a fallu [473] près d'un siècle d'efforts pour obtenir la réforme de la législation qui employait la puissance publique à maintenir et même à aggraver cette situation inégale. En revanche, la charité publique a été organisée et alimentée par l'impôt, des lois tutélaires ont été faites pour limiter la durée du travail des enfants, des femmes et même des ouvriers adultes dans un certain nombre d'industries; d'autres lois, d'un caractère à la fois philanthropique et fiscal, ont protégé les ouvriers contre eux-mêmes, au moyen d'impôts exorbitants sur les liqueurs fortes. Malheureusement, cette tutelle gouvernementale n'a point répondu à l'attente de ses promoteurs; elle s'est montrée partout et dans toutes ses parties impuissante à soulager les maux qu'elle devait guérir, quand elle n'a pas contribué à les empirer. Ces résultats négatifs n'ont pas découragé cependant les gouvernements imbus des doctrines du socialisme d'État, et ils travaillent aujourd'hui plus que jamais à répandre sur les classes ouvrières les bienfaits de leur intervention lutélaire. De leur côté, les socialistes révolutionnaires sont demeurés convaincus que si la tutelle de l'État est demeurée jusqu'à présent inefficace, c'est parce que l'État est entre les mains des classes capitalistes; mais le jour où la révolution l'aura fait tomber entre les mains des ouvriers, sa capacité tutélaire se révélera au monde ; il guérira tous les maux et mettra fin à toutes les misères.
En attendant que l'expérience fasse justice de ces illusions puériles, le besoin de tutelle subsiste, et il devient plus intense à mesure que l'agrandissement des entreprises augmente l'inégalité des pouvoirs du capital concentré et du travail individualisé, pendant que la multiplication de la richesse, et des tentations qu'elle étale sous les formes les plus variées, rend le self government plus difficile dans les classes les moins favorisées de la fortune. Comme tous les autres besoins, celui-ci n'a pas manqué de susciter [474] l'organisme économique destiné à y répondre. En dépit des obstacles que l'intérêt mal entendu et le mauvais vouloir des entrepreneurs d'industrie, les prohibitions des gouvernements sollicités par eux, l'ignorance et la brutalité des ouvriers ont opposés à la création et à la croissance régulière de cet organisme, il s'est créé malgré tout, il s'est créé comme toute machinery à son début, sous des formes imparfaites et grossières : marchandage, agences de placement , trades unions, sociétés de résistance, syndicats professionnels, sociétés de secours mutuels, etc. Mais en étudiant de près ces institutions encore à l'état rudimentaire, on peut déjà se faire une idée de ce que sera l'appareil adapté au besoin de tutelle de la multitude.
De même, en effet, que Leverrier a été conduit, par l'observation de notre système sidéral, à deviner l'existence d'une planète invisible, en étudiant les troubles et les maux qu'a provoqués la destruction hâtive de l'ancien appareil de tutelle imposée, et l'individualisation du travail en présence de la concentration progressive du capital, on peut conclure qu'il manque à notre nouveau régime économique un rouage nécessaire, celui de la tutelle libre. De plus, en se fondant sur la loi naturelle qui régit la production de toutes choses, on peut affirmer que ce rouage finira par se constituer sous les formes et dans les proportions les mieux adaptées à la fonction qu'il est destiné à remplir. Il n'a pu se créer tout d'une pièce et être porté d'emblée au point d'applicabilité désirable, et en cela il ne diffère point des autres mécanismes. Tel qu'il se constitue de préférence aujourd'hui, sous la forme de trades unions et de syndicats professionnels, c'est un mécanisme grossier, d'un emploi incertain et même dangereux. Le défaut principal de ces mutualités ouvrières, c'est d'emprunter une forme d'entreprise arriérée et de subalterniser deux facteurs indispensables de la création de tout produit et de tout service: [475] l'intelligence qui organise et dirige les entreprises, et le capital qui les alimente. En refusant de leur attribuer une situation et une rétribution proportionnées à celles qu'ils trouvent ailleurs, on les écarte, et qu'en résulte-t-il? C'est qu'on ne réussit point, même en recourant à l'intimidation et à la violence, à établir entre les vendeurs et les acheteurs de travail, l'équilibre des forces, qui peut seul déterminer un règlement équitable et utile des salaires; c'est qu'on peut encore moins parvenir à instituer l'organisme savant et délicat d'un gouvernement libre des incapables du self ffovernment. Nous avons esquissé ailleurs les données du problème à résoudre et la solution qu'il nous paraît comporter, nous nous bornerons à résumer brièvement ce que nous en avons dit. [78]
Supposons que les trades unions et autres mutualités ouvrières se transforment en de simples sociétés commerciales, ayant pour objet le placement du travail, c'est-à-dire la fourniture régulière de cet agent indispensable de toute production, aux entreprises agricoles, industrielles et autres; supposons encore que ces sociétés, faisant le commerce du travail, soient solidement constituées, convenablement dirigées et pourvues de capitaux, elles se trouveront placées vis-à-vis des entrepreneurs d'industrie sur le pied d'une complète égalité; d'où il résultera que les prix et conditions auxquels elles fourniront leur marchandise seront uniquement déterminées par l'état du marché, par les quantités de travail demandées d'un côté, disponibles de l'autre. Nous avons fait ressortir les avantages que les entrepreneurs d'industrie trouveraient dans ce système perfectionné d'approvisionnement du travail : garantie [476] d'une fourniture régulière, responsabilité effective pour les malfaçons et la non-exécution des engagements, mode de payement commercial des salaires par des effets à terme et escomptables, etc., etc. D'une autre part, des sociétés faisant le commerce du travail pourraient offrir aux ouvriers, soit isolés, soit réunis en mutualités de garantie, des avantages bien supérieurs à ceux qu'ils peuvent trouver en s'abouchant directement avec les entrepreneurs: 1° parce que des intermédiaires bien pourvus de capitaux ne seraient pas contraints de céder leur marchandise à un prix déprécié par la nécessité de vendre; 2° parce qu'ils seraient en mesure de connaître exactement, au jour le jour, l'état du marché, et qu'ils pourraient faire l'avance des frais nécessaires pour porter le travail dans les parties de ce marché où il serait le plus demandé, partant le plus cher. A ces services essentiels viendraient s'en ajouter d'accessoires que les intermédiaires seraient intéressés à rendre à leur clientèle ouvrière, en vue de s'assurer un approvisionnement régulier de bon travail. Ils veilleraient à la salubrité et au confort des ateliers, et à l'emploi des procédés les plus propres à prévenir les accidents ou à améliorer les conditions du travail dans les industries dangereuses ou insalubres; ils se chargeraient au besoin, moyennant commission, de recueillir et de placer les épargnes de leurs clients, de les assurer contre les maladies et la vieillesse, de leur procurer des logements commodes et sains, de leur rendre, en un mot, tous les services qu'ils n'obtiennent qu'à force de démarches et de pertes de temps, dans leur état actuel d'abandon et d'isolement. Enfin, les intermédiaires, guidés toujours par leur intérêt et obéissant aux nécessités particulières de leur industrie, seraient amenés à établir un régime de tutelle, ayant pour objet la conservation et l'amélioration des forces productives de leur clientèle ouvrière. Sous peine de rupture ou [477] de non-renouvellement des engagements, ou bien encore en recourant à l'appât des récompenses et des primes, ils interdiraient l'abus des liqueurs fortes, exigeraient la bonne tenue des vêtements et des habitations, l'accomplissement des devoirs de famille, etc. Cette tutelle intéressée serait plus ou moins étendue, selon que l'ouvrier aurait plus ou moins d'aptitude à conserver et à améliorer luimême ses forces productives. Elle soumettrait les natures incultes et imprévoyantes à une discipline, embrassant la plupart des actes de l'existence, en laissant aux autres une part de liberté plus large, en se bornant pour tout dire à suppléer au déficit plus ou moins grand de l'aptitude au self (jovernment. La rétribution de ces services d'intermédiaire et de tutelle s'opérerait au moyen d'un prélèvement sur le salaire, et cette rétribution, la concurrence se chargerait de la réduire au taux nécessaire.
Ces prévisions sur le développement progressif d'institutions qui sont encore dans leur période d'enfantement, et qui apparaissent même généralement comme des instruments de guerre, d'oppression et de désordre, ces prévisions ne sont-elles pas entachées d'utopie? Peut-on supposer, par exemple, que des travailleurs émancipés et maître de gouverner à leur guise leurs affaires et leur vie, consentent volontairement à se soumettre à une tutelle disciplinaire? Nous ferons remarquer qu'ils se soumettent déjà passivement, en vue d'une augmentation incertaine de leurs salaires, à la direction despotique des meneurs des coalitions et des (rades unions. Ne voyons-nous pas encore dans les pays où le service militaire est libre, en Angleterre et aux Etats-Unis, les armées de terre et de mer se recruter sans difficulté, malgré le peu d'élévation de la solde en comparaison des salaires industriels et la sévérité draconienne du code et de la discipline militaires? Enfin, les ordres monastiques ne continuent-ils pas à [478] enrôler des recrues des deux sexes, en dépit de la rigueur de leurs règles et de l'interdit qu'elles jettent sur l'un des appétits les plus forts de notre nature? Le jour où une tutelle appropriée au besoin qu'elles en ont sera offerte aux individualités impuissantes à défendre leurs intérêts et à pourvoir à la responsabilité de leur existence, — responsabilité dont la sanction est la misère, la dégradation, la souffrance et la mort, — la demande de cet adjuvant au self government ne demeurera point, selon toute apparence, au-dessous de l'offre, et ceux-là seulement se refuseront à y recourir qui se sentent la capacité nécessaire pour gouverner, sans aucune aide, leurs affaires et leur vie.
VI. Avenir de la liberté et de la tutelle. — La conception révolutionnaire et communiste du gouvernement consistait à soumettre à une « loi » uniforme et égalitairc, impliquant la même dose de réglementation et de tutelle, toutes les individualités composantes de la nation, si inégales que pussent être leurs aptitudes à se gouverner elles-mêmes. Toutes les lois particulières régissant les associations ou corporations territoriales, religieuses, industrielles, commerciales devaient céder la place à cette loi générale et unitaire. Des individus et un gouvernement avec ses subdivisions administratives, départements et communes, voilà la nation « une et indivisible ». Les individus étaient libres et propriétaires, sauf les restrictions et les charges que le peuple souverain jugeait nécessaire d'imposer à leur liberté et à leur propriété ; mais leur sphère d'activité se trouvait naturellement bornée. Tout ce qui la dépassait, toutes les entreprises qui excédaient les forces etles ressources individuelles, et qui appartenaient à des associations ou corporations ayant leurs lois particulières, devaient rentrer dans la sphère d'activité du gouvernement. A la vérité, cette dernière partie de la théorie révolutionnaire ne pût être entièrement appliquée. En présence de [479] l'impuissance actuelle du gouvernement à suffire à une tâche que les progrès de l'industrie allaient singulièrement agrandir, on laissa subsister ou se reconstituer un certain nombre de sociétés particulières; mais en leur imposant une constitution et des règles uniformes, dictées par la sagesse des législateurs, mandataires du peuple souverain. Elles devaient notamment avoir un objet spécial et unique, des attributions limitées et une durée temporaire, l'État seul possédant le double privilège de pouvoir appliquer son activité aux objets les plus divers et d'exister à perpétuité. L'État se réservait au surplus le droit d'absorber, quand il le jugerait opportun, ces restes de l'organisation de l'ancien régime. Il n'y aurait plus alors d'autre loi que la sienne, et celte loi édictée par le peuple souverain, propriétaire de l'État, ne pouvait manquer d'être également conforme à l'intérêt de tous.
Ce que cette conception est devenue dans l'application, on le sait. La nation, théoriquement propriétaire de l'État, mais pratiquement incapable de gérer elle-même cette propriété, a dû en abandonner la gestion, devenue de plus en plus lucrative, à des sociétés d'exploitation, ou à des partis politiques constitués dans ce but et recrutés dans les différentes couches de la population. Qu'est-il advenu de la loi sous ce régime? Ayant pour objectif commun de s'emparer de l'État et de conserver à perpétuité cette riche proie, les partis se sont efforcés d'établir les institutions et les lois qu'ils croyaient les plus propres à assurer leur domination. Le parti « conservateur », constitué avec les débris de la classe gouvernante de l'ancien régime, s'est appliqué à ressusciter autant qu'il pouvait l'être ce régime, et à mettre en attendant la loi au service des intérêts aristocratiques et cléricaux. Le parti « libéral », recruté dans la classe moyenne, s'est fait le promoteur et le soutien de la monarchie constitutionnelle, appuyée sur un corps [480] électoral limité de manière à donner la prépondérance à la bourgeoisie, et il a mis la loi au service des intérêts bourgeois. Le parti républicain ou démocratique, à son tour, s'est attaché à la forme républicaine et au suffrage universel et il a promis aux masses populaires d'employer la loi à les protéger d'une manière spéciale. Seulement, le suffrage universel ayant laissé à peu près intacte, jusqu'à présent, la prépondérance de la classe moyenne, cette promesse n'a pu encore être tenue :la loi a bien été dirigée contre les intérêts aristocratiques et cléricaux, contre lesquels s'accordaient les autres, mais elle a continué à protéger particulièrement les intérêts de la classe moyenne : la république est restée et restera bourgeoise aussi longtemps que les masses populaires ne l'emporteront point dans la balance du pouvoir et de l'influence politiques. Ainsi « la loi », au lieu d'être l'expression de l'intérêt général, est devenue l'instrument de la domination des partis et de l'exploitation de l'intérêt général au profit de ces partis et des classes dans lesquelles ils se recrutent. De plus, les nécessités de la compétition politique, obligeant les partis à augmenter continuellement leurs effectifs, et par conséquent à grossir le butin qui sert à les solder, la « loi», soit qu'elle émanât de tel parti ou de tel autre, a eu pour tendance uniforme d'élargir la sphère d'activité de l'État, d'étendre sa tutelle et d'en augmenter le poids.
Cependant, malgré les obstacles que ce régime lui opposait et les charges croissantes dont il l'accablait, la production a continué à se développer, sous l'impulsion du progrès industriel, stimulé par la concurrence. Les entreprises particulières se sont multipliées et agrandies, et à mesure qu'elles ont crû en nombre et en importance, elles ont ressenti davantage le dommage que leur infligeait la « loi », tantôt en leur imposant des modes de constitution et de gestion surannés, tantôt en augmentant leurs prix de [481] revient et en restreignant leurs débouchés; elles ont commencé à demander à être débarrassées de cette « loi », qui les entravait et les grevait, sous le prétexte de les protéger; elles ont réclamé la liberté de se gouverner elles-mêmes. En même temps, l'insuffisance de plus en plus manifeste de la tutelle de l'Etat a commencé à provoquer dans les couches inférieures de la société une demande croissante de protection et de tutelle libres, et cette demande a déterminé à son tour la création d'organismes destinés à satisfaire à ce besoin, en suivant leur propre « loi ».
Entre les associations politiques qui vivent de l'exploitation de l'État et les intérêts particuliers sur lesquels elles s'appuient, et les intérêts généraux qui supportent le fardeau de plus en plus lourd de cette exploitation, la lutte sera, évidemment, longue et acharnée. Cette lutte demeurera stérile et elle n'aboutira même qu'à rendre ce fardeau plus pesant, aussi longtemps que les défenseurs des intérêts généraux et tous ceux qui ont à cœur l'amélioration du sort des classes souffrantes s'imagineront que le seul moyen efficace d'atteindre le but qu'ils se proposent c'est de remplacer, soit violemment, soit même pacifiquement, un gouvernement par un autre. Car, outre le temps perdu dans la lulte, le résultat de cette substitution n'est et ne peut être qu'une extension et un alourdissement de l'exploitation politique. L'œuvre des hommes de progrès doit consister uniquement à éclairer l'opinion sur les nuisances que le vieux système de gouvernement issu de la décadence de l'ancien régime, consolidé et développé par la Révolution, inflige à la généralité des « consommateurs politiques ». Quand elle sera pleinement édifiée sur l'étendue et la gravité de ces nuisances, elle apportera à la cause de la réforme une puissance morale à laquelle rien ne pourra résister.
Alors l'organisme de gouvernement adapté aux sociétés [482] vivant de la grande industrie entrera en pleine croissance. Ce que sera cet organisme, quand il aura acquis son entier développement, nous pouvons déjà nous en faire une idée, en étudiant les constructions qui s'élèvent sous nos yeux malgré les empêchements d'un régime suranné. Ce qui le caractérise, ce n'est point un gouvernement omnibus et une loi uniforme et égalitaire, comme les rêvent les révolutionnaires et les communistes, ce n'est pas davantage l'absence de tout gouvernement et de toute loi, comme l'imaginent les anarchistes; c'est la diffusion du gouvernement dans la société, la spécialisation et la diversification de la loi.
Sous quel aspect nous apparaît cet organisme naturel du gouvernement libre des sociétés dans l'ère commençante de la grande industrie et de la concurrence universalisée? Quels en sont les traits caractéristiques? Tous les membres de ces sociétés se rattachent à la multitude des entreprises qu'ils alimentent de leurs capitaux et de leur travail, et d'où ils tirent leurs moyens d'existence. Ces entreprises sont libres; elles ont leur gouvernement et leur loi qu'elles instituent elles-mêmes en vue du but à atteindre; elles ont entre elles des rapports qui dérivent de leur nature et des nécessités ou des besoins qui leur sont communs : rapports entre les propriétaires exploitants de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, pour la viabilité, la salubrité et les autres services attenant à leurs exploitations); rapports entre les entreprises de locomotion pour régulariser et faciliter le transport des hommes et des choses; rapports entre les divers groupes ou catégories de producteurs, agriculteurs, industriels, négociants, artistes, tantôt pour remédier à des nuisances communes telles que les maladies contagieuses des végétaux et des animaux, tantôt pour garantir la qualité etla provenance des marchandises, pour établir des poids, mesures et usages adaptés aux besoins [483] des producteurs et aux convenances des consommateurs; rapports entre les sociétés de commerce du travail et de tutelle des travailleurs pour faciliter le placement utile et le bon gouvernement de leur clientèle'; rapports entre les banques pour l'échange de leurs instruments de circulation en papier ou en métal, etc., tous ces rapports avec les coutumes ou les lois qu'ils nécessitent, établis librement, suivant des conventions volontairement acceptées et n'engageant que ceux qui les acceptent. Cependant, dans cet organisme qui va se créant et se développant de lui-même, au fur et à mesure des besoins qui sollicitent sa création et son développement, les établissements politiques continuent à exercer une fonction nécessaire, celle qui consiste à garantir la propriété et la liberté ou la souveraineté individuelle de chacun dans ses limites naturelles. Comme tous les autres établissements, ils sont autonomes et libres; ils se constituent conformément aux lois naturelles qui régissent les entreprises et aux nécessités dérivant de l'objet spécial de leur industrie. Ils instituent les lois et conditions qu'ils jugent indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions d'assureurs de la propriété et de la liberté. Ces lois et conditions, désormais limitées aux seules exigences de la production de la sécurité, ils les proposent à la nation ou à ses mandataires, aussi longtemps que la « servitude politique » conserve sa raison d'être, et elles font l'objet du contrat qui lie les deux parties. En, supposant que la servitude politique cesse d'être nécessaire et disparaisse, ils les proposent aux individus isolés ou librement associés qui éprouvent le besoin de faire assurer leur propriété et leur liberté. Ils ont entre eux des rapports nécessités par la nature particulière de leur industrie, protection collective contre les agressions des peuples barbares, garantie réciproque de la sécurité de leurs clients, poursuite des malfaiteurs. Quoique limitée dans son objet à la production [484] de la sécurité, leur loi, qui est le produit de la science du droit, est infiniment diverse et étendue dans ses applications. Elle sanctionne, sauf à leur refuser cette sanction quand elles sont contraires au droit ou à la morale, les lois particulières de toutes les autres entreprises et les règles de conduite de chacun, en ce qu'elles touchent à la propriété et à la liberté. Elle est, pour tout dire, la clé de voûte de l'organisme naturel du gouvernement des sociétés sous un régime de self govemment et de tutelle libres.
A le bien considérer, cet organisme du gouvernement des sociétés dans l'ère de la grande industrie et de la concurrence universalisée n'est que le développement et le perfectionnement de celui de l'ère précédente de la petite industrie et des marchés limités. Sous l'impulsion des progrès de la machinery de la production, dans ce second âge de l'humanité, les entreprises s'étaient divisées et spécialisées, les corporations s'étaient constituées et avaient établi lès lois requises par la nature et l'objet de leur industrie; seulement, le monopole qui résultait du défaut d'étendue des marchés avait suscité la création d'un appareil destiné à faire contrepoids au pouvoir que ce monopole conférait aux producteurs vis-à-vis des consommateurs; en même temps, la communauté du péril extérieur de la civilisation, encore enveloppée et assiégée par la barbarie, obligeait tous les membres des sociétés civilisées à supporter en commun les charges et les servitudes de l'état de siège. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'un progrès nouveau et décisif de la machinery de la production, les entreprises grandissent, les marchés s'étendent et s'unifient, la concurrence s'universalise, et elle rend inutile le vieil appareil limitatif du monopole, tandis que le refoulement des barbares permet aux sociétés civilisées de se débarrasser des charges et des servitudes de l'état de siège. L'organisme du gouvernement des sociétés peut, en conséquence, se [485] simplifîer et devenir plus léger. Une irruption de la barbarie intérieure a interrompu ce progrès et déterminé même une rétrogression générale de la science et de l'art de la politique. Mais quand le flot révolutionnaire se sera retiré en emportant les formes de gouvernement primitives et inadaptables à l'état économique actuel des sociétés qu'il a apportées avec lui, l'évolution politique reprendra son cours, et le nouveau régime apparaîtra comme le dévelopment naturel de l'ancien, — avec la liberté de plus.
[486]
CHAPITRE XII.
Résumé et conclusion↩
Depuis son apparition sur la terre, l'humanité prise dans son ensemble, a progressé d'une manière continue. Elle a créé et augmenté par un travail ininterrompu de découvertes et d'inventions son capital de civilisation. Elle a successivement découvert le plus grand nombre sinon encore la totalité des matériaux, des forces et des êtres animés que contient le monde minéral, végétal et animal, et elle a inventé un outillage et des procédés de plus en plus puissants et efficaces pour utiliser ces matériaux, ces forces et ces créatures inférieures, en les appropriant à la satisfaction de ses besoins. Elle a créé et perfectionné l'organisme du gouvernement de l'homme et de la société, en l'adaptant à leurs conditions d'existence, perpétuellement modifiées par l'accroissement des matériaux de la production et les progrès de l'outillage. Cette machinery politique a été le produit d'un travail continu de découvertes et d'inventions, comme la machinery industrielle, au développement de laquelle ses progrès se trouvaient organiquement subordonnés.
C'est l'évolution progressive de cet organisme du gouvernement de l'homme et de la société que nous avons entrepris d'esquisser après avoir décrit, dans une première série d'études, [79] l'évolution industrielle et économique dont [487] elle procède. Comme celle-ci, nous l'avons partagée en trois périodes : 1° les temps primitifs; 2° l'ère de la petite industrie; 3° l'ère de la grande industrie. Nous avons montré ce qu'a été et ce qu'a dû être, en raison de l'état des matériaux et de l'outillage de la production, le gouvernement de l'espèce humaine dans les deux premières périodes et, en étudiant les changements que l'avènement de la grande industrie a commencé à apporter dans les conditions d'existence del'homme et de la société, nous avons pu nous faire une idée de ce qu'il sera dans la troisième.
I. La nécessité ou le besoin, voilà quel est le premier moteur de l'activité de l'homme et de tous ses progrès. Les besoins veulent être satisfaits, sous peine d'une déperdition de forées, impliquant une souffrance, et ils ne peuvent l'être qu'au moyen d'une dépense de forces, impliquant une autre souffrance. Si celle-ci est inférieure à celle-là, l'homme est intéressé, — et d'autant plus intéressé que la différence est plus grande, — à créer le produit ou le service adapté à la satisfaction du besoin, et le même intérêt l'excite à découvrir ou à inventer les moyens les plus propres à lui procurer cette satisfaction, en économisant ses forces et sa peine. Cependant ce mobile, malgré toute sa puisrsance, n'aurait pas suffi pour déterminer l'évolution du progrès et créer le phénomène de la civilisation, en agrandissant continuellement la distance qui sépare l'homme, au moins dans ses variétés supérieures, des autres espèces animales. Car celles-ci sont, aussi bien que l'espèce humaine, gouvernées par la nécessité ou le besoin. Il a fallu que l'homme se trouvât pourvu, à l'origine, d'un organisme mental et physique, supérieur, ou qu'il provînt d'un germe.contenant cet organisme en puissance et en devenir; qu'il possédât un cerveau plus complet avec des membres appropriés à l'exécution des conceptions et des ordres de ce maître organe. C'est grâce à sa supériorité organique, de [488] quelque façon qu'elle l'ait acquise, que l'espèce humaine a si prodigieusement devancé toutes les autres et produit la civilisation.
Dans la première période de ce travail, la condition do l'homme et sa manière de vivre ne diffèrent pas sensiblement de celles de la généralité des animaux. Il vit comme eux de la recherche des végétaux alimentaires, do la chasse ou de la pêche; il habite des cavernes et des huttes de terre ou de branchages. La nécessité de se défendre contre des animaux plus forts et naturellement mieux armés l'oblige, comme un grand nombre d'autres espèces, à former des sociétés, troupeaux, clans ou tribus; mais aussitôt que des individualités quelconques, hommes ou animaux, se trouvent rassemblées, apparaît la nécessité d'un gouvernement. Si elles sont réunies pour lutter contre d'autres espèces ou d'autres sociétés de leur propre race, il leur faut une organisation, une hiérarchie et une discipline appropriées à cette lutte, avec un appareil préventif ou répressif des nuisances intérieures que leurs appétits déréglés et leurs passions égoïstes les poussent à commettre, et qui mettent la société en péril en diminuant ses forces et ses ressources. Il leur faut, pour tout dire, un gouvernement. Ce gouvernement prescrit les règles de conduite ou les manières d'agir nécessaires à l'association et par contre-coup à ses membres; il interdit les actes nuisibles; il sanctionne ces prescriptions et ces interdictions au moyen de pénalités, établies de façon à infliger une souffrance supérieure à la jouissance que leur infraction pourrait procurer.
La machinery du gouvernement est plus ou moins compliquée selon le nombre et la nature des nécessités auxquelles elle doit pourvoir; elle est aussi plus ou moins appropriée à sa destination et efficace, selon que ceux qui l'inventent et la mettent en œuvre connaissent mieux l'objet qu'elle doit atteindre et les moyens qui y sont adaptés, eu égard au [489] tempérament particulier des associés, à leur état de civilisation et aux circonstances du milieu ambiant, c'est-à-dire selon qu'ils sont plus ou moins doués du génie politique. Ce génie spécial n'existe point dans toutes les têtes, pas plus que le génie des arts mécaniques, de la peinture, de la musique ou de la poésie. Ceux qui le possèdent, dans quelque mesure, inventent l'appareil du gouvernement et ils utilisent le sentiment ou l'instinct religieux dans la constitution de cet appareil nécessaire.
Dans cette première période de l'existence et du développement des sociétés, le caractère économique du gouvernement, c'est d'être gratuit ou pour mieux dire non rétribuable et, par conséquent, communautaire. Les membres de ces sociétés embryonnaires, sont trop peu nombreux, et — par suite de l'insuffisance et de l'imperfection de leur outillage, —trop pauvres pour payer les services d'un gouvernement. Ces services constituent une obligation et une charge qui incombent à chacun. D'où il suit que le régime naturel et nécessaire du gouvernement des sociétés primitives est la communauté.
II. Grâce à leur supériorité mentale, à l'intérêt qui les pousse à augmenter leurs jouissances, en diminuant leurs efforts et leur peine, grâce enfin à la concurrence vitale qui apparaît et les stimule davantage à mesure qu'ils se multiplient, les hommes découvrent un nombre croissant de matériaux et d'agents productifs; ils créent et perfectionnent la machinery de la production. Ils apprennent à reconnaître les plantes alimentaires, ils inventent le matériel de l'agriculture et il en résulte un énorme accroissement de la productivité de leur travail. Outillé d'une bêche ou d'une charrue, l'homme obtient sur un sol cultivable, en échange de la même dépense de forces, autrement dit de la même quantité de travail, une quantité de subsistance infiniment plus grande que celle qu'il obtenait avec un arc et des [490] flèches sur un terrain de chasse infiniment plus étendu. Au lieu donc d'employer la presque totalité de son temps et de ses forces à la production de ses aliments, il peut n'en employer que la moitié ou moins encore, et consacrer le reste à la satisfaction de ses autres besoins. Alors, la spécialisation ou la division du travail et l'échange deviennent possibles. Ce procédé ingénieux, par lequel, au lieu de produire directement toutes les choses dont on a besoin, on se les procure indirectement au moyen de l'échange d'un produit ou d'un service qu'on s'applique spécialement à créer; ce procédé, facilité par l'invention de la monnaie, a pour effet d'augmenter encore la productivité du travail, en permettant à chacun de se vouer à l'industrie à laquelle il est le plus propre, d'y devenir plus habile et plus capable d'en perfectionner les procédés et l'outillage. La production se divise et se ramifie en branches de plus en plus nombreuses, la population et la richesse s'accroissent dans des proportions extraordinaires. Sur un territoire occupé naguère par un troupeau ou une tribu, dont les membres, absorbés par la recherche de leur subsistance et le soin de leur sécurité, traînaient le plus souvent une existence misérable et précaire, on voit apparaître une société dont les membres se comptent par millions et au sein de laquelle la richesse s'accumule sous les formes les plus variées. Mais ce développement de la population et de la richesse nécessite un progrès correspondant de l'appareil du gouvernement. Il faut que cet appareil devienne à la fois plus ample et plus résistant pour préserver la société des « nuisances » extérieures et intérieures, auxquelles elle est davantage exposée, précisément parce que sa population s'est accrue avec sa richesse. Au dehors, elle est en butte aux agressions continuelles des peuplades moins avancées de chasseurs et de guerriers, pour lesquelles elle est une proie d'autant plus tentante qu'elles sont plus pauvres et qu'elle est plus riche. [491] Au dedans, l'ordre et l'harmonie sont plus difficiles à maintenir au sein d'une population plus nombreuse, dont les intérêts se sont compliqués et diversifiés. La propriété s'est divisée et spécialisée comme la production; elle est devenue individuelle ou collective; il faut en régler et en assurer la jouissance, l'échange et la transmission ; la richesse s'est accumulée et inégalisée en s'accumulant; il faut protéger les'riches contre les convoitises des pauvres, et les pauvres contre l'abus de la puissance des riches. La « loi » doit en conséquence être considérablement étendue dans ses applications; elle doit encore être établie et mise en vigueur par un pouvoir intéressé au bien général et assez fort pour le faire prévaloir sur les intérêts particuliers.
Ce progrès nécessaire de la machinery du gouvernement n'était point compatible avec le régime de la communauté. Des hommes, appliqués, les uns aux travaux agricoles, les autres aux différentes branches de l'industrie et des arts, ne pouvaient résister à des peuplades exclusivement adonnées à la chasse et à la guerre. Les mêmes hommes ne pouvaient posséder les connaissances et l'expérience spéciales, non plus que la situation indépendante des intérêts particuliers, qui étaient nécessaires pour faire régner au sein de la société la justice et l'ordre. Il fallait que le gouvernement, comme les autres industries, se spécialisât pour suffire désormais à cette double tâche, et qu'il concentrât assez de forces, d'intelligence, de connaissances professionnelles et de ressources pour produire un accroissement de sécurité, proportionné à l'accroissement des risques extérieurs et intérieurs qui menaçaient l'existence de la société. Cette spécialisation s'opéra grâce à la rétribuabilité que l'augmentation de la productivité du travail avait conférée aux services du gouvernement. Après avoir été négatifs dans la période précédente, les profits [492] de l'industrie du gouvernement pouvaient maintenant s'élever au point d'absorber le produit net de toutes les autres branches de la production, en ne leur laissant que la part strictement nécessaire pour subvenir à l'entretien et au renouvellement de leur personnel et de leur matériel. Quel fut le résultat de ce progrès? C'est que les hommes intelligents et forts qui dirigeaient déjà, auparavant, les tribus, par l'ascendant naturel de leurs aptitudes gouvernantes et guerrières s'adonnèrent de préférence à une industrie qui, d'improductive qu'elle était, venait de devenir la plus productive de toutes. Ils s'associèrent pour l'entreprendre, s'emparèrent des régions où elle pouvait s'exercer avec le plus de profit, se partagèrent le sol et assujettirent la population à travailler pour eux et à leur livrer tout ou presque tout le produit net de son travail, en échange de la sécurité qu'ils lui fournissaient. [80] Sans [493] doute, les consommateurs obligés de ce service le payaient à un prix excessif, mais auraient-ils pu se le procurer autrement? L'expérience avait dû leur faire reconnaître l'impossibilité de se gouverner et de se défendre, en cumulant les fonctions du gouvernement et de la guerre avec celles de l'agriculture, de l'industrie et des arts; ils n'avaient de choix qu'entre la servitude et la destruction, et l'on s'explique ainsi que l'esclavage ait pu s'établir universellement et se faire accepter par les intelligences les plus hautes de l'antiquité. C'est qu'il était le prix nécessaire de la sécurité. Si élevé que fût ce prix, les consommateurs étaient intéressés à le payer, comme en temps de disette on est intéressé à se procurer du pain à tout prix plutôt qu'à mourir de faim.
Cependant la sécurité est devenue, dans le cours des temps, plus abondante, plus complète et moins chère. Comment s'est réalisé ce progrès? Il s'est réalisé, comme tous les autres progrès, par l'action de la concurrence. C'est la concurrence sut generis des producteurs de sécurité, la concurrence politique et guerrière des corporations [494] ou des maisons en possession du gouvernement des sociétés civilisées qui a déterminé les progrès de la machinery du gouvernement et de la guerre, et l'abaissement du prix de ses services.
Comme tous les autres entrepreneurs d'industrie, les propriétaires exploitants des établissements politiques s'efforçaient d'augmenter leurs profits. Or ils ne pouvaient les accroître que par deux procédés : 1° par la conquête et l'annexion de nouveaux territoires, meublés d'une population assujettie aux travaux de l'agriculture et de l'industrie; 2° par une augmentation, naturellement plus lente, des produits de leur exploitation intérieure. Le premier de ces deux procédés étant le plus lucratif, on y recourait de préférence. A mesure que les États se multiplièrent, on vit en conséquence se développer la concurrence politique et guerrière. Quand les propriétaires exploitants des États civilisés n'étaient pas occupés à se défendre contre les agressions des barbares, ils se faisaient la guerre entre eux, en vue d'accroître leurs domaines politiques partant leurs profits. Le premier résultat de cette concurrence a été de perfectionner le matériel et l'art de la guerre, de préserver ainsi les peuples civilisés des invasions barbares, de leur permettre de déborder sur la barbarie et finalement de devenir les maîtres du monde, en agrandissant successivement le domaine de la sécurité. Le second a été de stimuler le progrès des méthodes d'exploitation des populations assujetties. La guerre exigeant, à mesure que le matériel qu'elle mettait en œuvre devenait plus puissant, des avances de capital plus considérables, les propriétaires d'États durent chercher les moyens de rendre leur exploitation plus productive. De là la transformation de l'esclavage en servage et du servage en simple sujétion; de là encore les progrès dans l'assiette, le mécanisme et la perception de l'impôt, impliquant l'abaissement successif du [495] prix de la sécurité. Telle a été l'œuvre de la concurrence politique et guerrière.
Mais après avoir accompli cette œuvre, la concurrence politique et guerrière s'est affaiblie, les États qu'elle vivifiait sont'tombés en décadence, la machinery du gouvernement de ces États organisés pour la guerre et l'exploitation des populations assujetties est devenue un danger et un obstacle au progrès. Une seconde évolution devenait alors, nécessaire : elle consistait dans l'adaptation du gouvernement des sociétés civilisées aux nouvelles conditions d'existence que leur faisaient l'établissement de leur suprématie sur le globe et l'extension illimitée de la concurrence industrielle et commerciale. Cette évolution a commencé à la fin de l'ère de la petite industrie; elle poursuit maintenant son cours, malheureusement interrompu, troublé et retardé parles révolutions.
III. Ce qui caractérisait les établissements politiques, à l'abri desquels vivaient les nations dans le second âge de la civilisation, c'était leur hostilité naturelle et le régime d'isolement et d'état de siège que cette situation rendait nécessaire. Chaque État était une forteresse et il devait être gouverné comme une forteresse en temps de guerre. Il fallait que le commandement se trouvât concentré d'une manière permanente, sans interruption ni contestation, entre les mains d'un chef investi du pouvoir d'appliquer, au besoin, toutes les forces et toutes les ressources de la population à l'œuvre de la préservation commune; il fallait encore que ce chef souverain pût imposer aux manifestations de l'activité privée toutes les servitudes politiques et économiques, nécessitées par cet état de choses, et tel fut, en"effet, le régime qui prévalut, dans le monde civilisé aussi bien que dans le monde barbare. Un jour vint où, grâce aux progrès de la sécurité, ce lourd et rigoureux régime, avec son arbitraire, ses charges et ses entraves [496] commença à perdre sa raison d'être. Il eût fallu, dans l'intérêt de tous, en alléger successivement le fardeau, en diminuant et en supprimant, à mesure qu'elles devenaient visiblement inutiles, les servitudes qui pesaient sur la propriété et la liberté de chacun. Mais les maîtres de la forteresse et leur état-major avaient une tendance naturelle à conserver les pouvoirs et les avantages extraordinaires que leur conférait le régime de l'état de siège, et cette tendance était justifiée, d'abord, par le fait que le péril extérieur n'avait pas encore entièrement disparu; ensuite, parce qu'ils pouvaient craindre qu'on ne se servît, pour les déposséder et se mettre à leur place, des libertés mêmes qu'ils auraient concédées. Alors s'engagea entre les gouvernants et les gouvernés une lutte qui se poursuivit avec des péripéties diverses jusqu'à la Révolution française, les gouvernés réussissant d'abord à obtenir le droit de contrôler les services des gouvernants, d'en débattre et d'en consentir le prix; ensuite privés, — trop souvent par leur faute, — de ce droit tutélaire, obligés de pourvoir aux frais de guerres désormais inutiles et de subir, au retour de la paix, les charges et les servitudes de l'état de siège, celles-ci d'autant plus insupportables que l'industrie et le commerce, dont elles enrayaient l'essor, avaient réalisé plus de progrès et avaient besoin d'un débouché plus étendu; celles-là d'autant plus injustifiables qu'elles servaient à alimenter l'oisiveté et la corruption d'une classe dont les services, après avoir été indispensables, devenaient de moins en moins utiles. Dans ces circonstances, la réforme de « l'ancien régime » s'imposait avec une puissance irrésistible, et il eût suffi de la pression continue et modérée de l'opinion des gouvernés pour que les gouvernants fussent obligés de l'accomplir dans le temps et dans la mesure nécessaires.
Malheureusement, comme il était déjà arrivé au début du mouvement évolutionniste, cette lutte pour [497] l'affranchissement se transforma en une lutte pour la domination. L'évolution fit place à la révolution. Au lieu de continuer à travailler à la réforme de l'État, en s'aidant de la pression de l'opinion, les progressistes les plus impatients, — et nous voulons bien croire qu'au début ils étaient désintéressés et sincères, — eurent recours à la force pour s'en emparer, sans se douter qu'ils allaient simplement substituer à des maîtres affaiblis et nantis, des maîtres plus nombreux, plus vigoureux et d'autant plus rudes et avides qu'ils étaient partis de plus bas et qu'ils avaient leur fortune à faire. En confisquant l'État, ces révolutionnaires ignorants et naïfs (leurs successeurs ont gardé leur ignorance et perdu leur naïveté) n'avaient point l'idée de le garder pour l'exploiter à leur profit, ils se proposaient de le restituer à la nation qui en était, à leurs yeux, la légitime propriétaire et à laquelle ils se plaisaient à attribuer toute la capacité nécessaire pour le gouverner et même pour en faire l'instrument de la régénération universelle. L'expérience n'allait pas tarder à emporter ces illusions sentimentales. La monarchie renversée, on se trouva en présence d'un État appartenant nominalement à une nation incapable de le gouverner, c'est-à-dire, effectivement, en présence d'un État vacant et à la merci de qui serait assez fort et assez peu scrupuleux pour s'en emparer. Si l'on songe que cette proie avait une valeur presque illimitée, les maîtres de l'État ayant le pouvoir indéfini de taxer et de grever une nation dont les progrès inouïs de l'industrie accroissaient à vue d'œil la richesse, on s'expliquera qu'elle soit aussitôt devenue l'objet de la lutte acharnée des partis engendrés parla révolution. Nous assistons depuis près d'un siècle à cette lutte, poursuivie tantôt par la violence, tantôt parle mensonge et la. corruption, tantôt par les moyens révolutionnaires, assassinats, émeutes, insurrections, conspirations et coups d'État; tantôt parles moyens constitutionnels [498] et parlementaires, promesses illusoires, captation des votes, coalitions effrontées pour augmenter les revenus de quelques-uns aux dépens de tous. Recrutés, ceux-là dans les couches supérieure et moyenne de la nation, ceux-ci dans les couches inférieures, organisés et hiérarchisés comme des armées, les partis ont pour objectif réel et unique, en dépit de l'hypocrisie obligatoire de leur langage, la conquête et l'exploitation de l'État; leur politique se résume, à la fois, dans l'art de capturer cette proie et d'empêcher leurs concurrents de la leur ravir, et dans l'art d'en tirer la plus grande somme possible de profits pour eux-mêmes et pour leurs commanditaires. Or ces profits sont proportionnés au volume de l'exploitation de l'État, à la grosseur du budget, au nombre des emplois civils et militaires qu'il rétribue, aux subventions et aux faveurs qu'il permet de distribuer. La politique des partis, qu'ils soient conservateurs, cléricaux, libéraux, radicaux ou socialistes, et quels que soient leurs programmes et leurs affiches; est donc naturellement hostile à l'établissement de la paix et à la diminution des attributions de l'État; car la paix impliquerait la réduction des effectifs militaires, et la simplification de l'État mettrait sur le pavé la plus grande partie du personnel gouvernant, légiférant, administrant et réglementant. Ajoutons que toute victoire d'un parti sur un autre, tout remplacement d'un parti par un autre dans la possession du pouvoir, soit que ce remplacement s'opère par les moyens révolutionnaires ou par les moyens constitutionnels et parlementaires, n'a et ne peut avoir pour résultat que d'alourdir le fardeau de l'exploitation de l'État. Car l'armée politique qui assiège cette forteresse ne peut s'en emparer qu'à la condition de déployer des forces supérieures à celles de l'armée assiégée, et il faut bien que le butin qui sert à la solder soit proportionné à son effectif. C'est pourquoi, à mesure que ce [499] régime de compétition pour la conquête et l'exploitation de l'État acquiert plus de durée en mettant en mouvement des armées plus nombreuses, il devient plus écrasant pour les populations qui fournissent le butin. [81]
Cependant ce régime est condamné à périr par son excès même. Sa fin peut, à la vérité, être encore longtemps retardée par les progrès qui augmentent continuellement la productivité du travail en créant ainsi une marge croissante à l'exploitation politique. Comment finira-t-il?
Si les consommateurs politiques savaient quelle quantité énorme de travail, de peines et de souffrances inutiles l'exploitation politique leur inflige; si les politiciens [500] eux-mêmes et leur clientèle n'ignoraient pas que, tout en grossissant artificiellement leur part dans le revenu total de la nation, elle empêche ce revenu de croître, de telle façon qu'ils en tirent, en réalité, moins qu'ils n'en pourraient tirer, en échange de la même dépense d'intelligence et de travail, sous un régime de liberté et de paix, l'opinion publique, dont les partis constituent l'élément actif et militant, se soulèverait tout entière contre un système illusoire pour les uns, écrasant pour les autres; elle brûlerait l'idole de l'État qu'elle adore aujourd'hui, et elle reprendrait l'œuvre, interrompue par la révolution, de la réforme et de la simplification de la machinery du gouvernement. Malheureusement, l'opinion publique est profondément ignorante et plus que jamais fourvoyée par le socialisme révolutionnaire ou conservateur, les politiciens des partis et leur clientèle sont absolument convaincus que leur existence et leur fortune sont attachées au maintien et au développement de l'exploitation politique dont ils vivent ou bénéficient et que ce qu'ils appellent « la Société » et « la Patrie » seraient en danger de périr si elle cessait de fonctionner. On ne peut donc s'attendre à ce que les enseignements de la science aient la vertu de ramener les sociétés civilisées dans la voie du progrès évolutionniste. Ce qui mettra fin au système d'exploitation politique aggravé sinon engendré par la révolution, ce sont les conséquences mêmes de ce système, conséquences qui se produisent lentement, sans doute, mais qu'aucune puissance humaine ne pourrait empêcher de se produire. Les nécessités de la compétition des partis engendrant une progression de plus en plus rapide des charges publiques, — on pourrait appliquer ici la célèbre théorie de Malthus, savoir que la tendance des charges publiques est de croître en raison géométrique, tandis que la productivité du travail qui y pourvoit ne peut croître qu'en raison arithmétique, — un moment doit [501] venir où elles excéderont la capacité de la nation à les alimenter et à les supporter. A dater de ce moment, elles deviendront de moins en moins productives et de plus en plus accablantes. Alors ceux qui bénéficient de l'exploitation politique seront moins intéressés à la conserver, et ceux qui en font les frais le seront davantage à s'en exonérer. Alors aussi, les uns et .les autres seront plus disposés à écouter les Cassandre de l'économie politique, et la réforme deviendra possible.
Nous avons vu comment la concurrence industrielle et commerciale, de nation à nation, lui viendra en aide, en obligeant toutes les industries qui versent leurs produits sur les marchés agrandis et en voie d'unification, à diminuer leurs prix de revient. A mesure que cette concurrence agit davantage, — et elle s'est développée d'une manière continue et prodigieuse depuis un demi-siècle malgré les efforts du protectionnisme politique et économique pour la contrecarrer et l'annihiler, — elle contraint les industries rivales à adopter les machines et les procédés de production les plus puissants et les plus économiques. Quand elles seront arrivées, sous ce rapport, au même niveau de progrès; quand le prix du travail et le loyer du capital se seront nivelés de même, grâce à la rapidité et au bon marché des transports ; quand l'inégalité des prix de revient ne sera plus causée que par celle des charges publiques, il faudra, de deux choses l'une, ou que les nations les plus grevées réduisent leurs frais de gouvernement ou qu'elles disparaissent du marché. La concurrence industrielle et commerciale apparaît ainsi comme l'irrésistible moteur de la transformation de la machinery du gouvernement des sociétés dans l'ère actuelle de la civilisation, comme la concurrence politique et guerrière l'a été dans l'ère précédente, en rendant ce progrès nécessaire sous peine de ruine et de mort.
[502]
Mais cette transformation ne saurait s'opérer en un jour, et il est à craindre qu'elle ne tarde longtemps à s'accomplir. Nous ne sommes encore qu'au début de la période de rétrogression révolutionnaire. Le gouvernement, que les classes moyennes ont arraché aux mains de la classe supérieure, commence seulement à être revendiqué par Ja démocratie ouvrière qui finira par s'en emparer à son tour. Cette seconde lutte, dont nous n'avons vu que les escarmouches préliminaires, en juin 1848 et en mars 1871, s'annonce comme incomparablement plus acharnée et plus longue que ne l'a été la première, en raison de l'accroissement continu de l'effectif des armées politiques, de l'augmentation du butin qu'elles se disputent et de la violence contagieuse des passions qui les animent. Des guerres civiles et étrangères, des convulsions et des catastrophes rendues plus formidables par les progrès des agents de destruction marqueront, selon toute apparence, cette nouvelle phase de la révolution et surpasseront en grandeur et en horreur celles qui ont marqué la précédente. Certes, on doit s'affliger des maux que ces luttes sauvages traînent après elles et qui accablent surtout les faibles et les petits. Mais est-il possible de les éviter? Ils sont le produit de l'ignorance et des passions aveugles de ceux qui ont rendu la révolution inévitable : les uns, les conservateurs, en voulant empêcher un progrès devenu nécessaire, les autres, les philanthropes et les sectaires en voulant le hâter et en s'imaginant que la violence peut tenir lieu de la science.
Cependant nous envisagerons peut-être avec plus de philosophie ces convulsions du progrès si nous songeons quelle petite place elles tiennent, après tout, dans la vie de l'humanité. Quoique nous ne possédions encore que des données bien incertaines sur l'époque de la naissance de l'espèce humaine, nous pouvons conjecturer, en nous [503] fondant sur la durée probable de la formation des couches de terrains, où se retrouvent les restes des hommes des époques primitives, les débris de leur outillage, de leur industrie et même de leur cuisine, que si l'âge de l'humanité dépasse singulièrement les 6,000 ans de la période biblique, il n'atteint pas un million d'années. Or, d'après d'autres approximations, l'âge de notre globe serait actuellement de dix millions d'années, et il serait arrivé seulement au tiers ou, tout au plus, à la moitié de sa durée. En supposant qu'il demeure jusqu'à la fin habitable pour notre espèce, et qu'elle conserve, grâce au mélange de ses variétés, la vitalité nécessaire pour se reproduire et subsister sans dégénérer, elle aurait encore environ dix millions d'années d'existence possible. Elle ne serait donc pas sortie, au moment où nous sommes, de sa période d'enfance et de première éducation, ce que d'autres données, empruntées aux sciences morales et politiques viennent d'ailleurs confirmer. En effet, même dans les sociétés les plus avancées, il n'existe qu'une croûte superficielle de civilisation; non seulement la multitude est demeurée dans un état d'ignorance et de demi-barbarie, mais les instincts de la brute n'ont pas cessé de prédominer dans les classes les plus cultivées : sans l'appareil si grossièrement imparfait et si exorbitamment coûteux qui garantit la vie et la propriété de chacun, on verrait les forts se ruer sur les faibles pour les dépouiller, les massacrer ou les asservir. Eh bien, si l'on songe que cette période d'un million d'années écoulées depuis la naissance de l'humanité forme tout au plus la dixième partie de son existence possible, si l'on n'oublie pas que ce million d'années s'est partagé entre deux ères de civilisation, — l'ère des temps primitifs et l'ère de la petite industrie, — et que nous sommes seulement à l'aurore de la troisième, les quelques siècles de crise qui marquent le passage de l'une à l'autre ne nous paraîtront-ils [504] pas bien peu de chose en comparaison de la durée de chacune? Ce sont de simples accidents de la fièvre de croissance de l'humanité, et, malgré ce que leurs symptômes peuvent avoir d'effrayant et de hideux, il ne faut s'en exagérer ni l'importance ni le danger.
IV. Ce qui doit nous rassurer, par-dessus tout, c'est l'indestructibilité et la nécessité providentielle de la civilisation. De quoi se compose la civilisation? Elle se compose d'un capital investi, pour une part, dans l'homme, pour une autre part hors de l'homme : celui-là consistant dans la mas se des notions morales, des règles de conduite, des sciences et des procédés techniques qui ont été découverts, inventés et expérimentés par le travail continu de l'élite de l'humanité, qui se sont emmagasinés, capitalisés dans le cerveau de l'homme et se transmettent par l'hérédité et l'éducation d'une génération à l'autre; celui-ci consistant dans le sol approprié, fertilisé, assaini, dans le sous-sol exploité, dans les édifices, les habitations, les usines, les ateliers, les comptoirs, les routes, les produits de l'agriculture, de l'industrie, des lettres, des arts, etc., etc., l'un et l'autre constituant l'ensemble des valeurs personnelles, immobilières et mobilières qui existent sur notre globe et dont la somme s'augmente à mesure que le travail de l'homme devient plus productif. Ce capital peut-il être détruit? Aux époques où les sociétés civilisées commençaient seulement à émerger du monde animal et barbare, il a couru maintes fois des risques sérieux, mais toujours la civilisation ne disparaissait d'une région que pour reparaître dans une autre.
Maintenant que la suprématie guerrière du monde civilisé est devenue flagrante et incontestable, le capital de la civilisation se trouve à l'abri des incursions et des retours offensifs de la barbarie extérieure; en revanche, ne continue-t-il pas à être exposé aux irruptions de la barbarie intérieure ? Ne peut-il pas être entamé et même anéanti par un [505] soulèvement des couches sociales inférieures, demeurées dans un état de demi-sauvagerie et armées des puissants instruments de destruction que la civilisation crée et multiplie tous les jours, ou bien encore ne peut-il pas être successivement amoindri et épuisé par une exploitation politique que la concurrence des partis travaille, de même, à étendre et à rendre plus productive, aux dépens de la richesse et de l'activité générale? 11 peut arriver, sans doute, qu'une nation civilisée tombe en décadence et finalement disparaisse sous l'influence de l'une ou l'autre de ces deux causes ; mais la civilisation s'est répandue sur tant de points différents des deux hémisphères, sa puissance d'expansion va croissant avec une rapidité telle depuis l'avènement de la grande industrie et de la suprématie guerrière des peuples civilisés, que la disparition d'une nation ne mettrait plus en péril l'existence des autres, et même que le vide qu'elle laisserait ne tarderait pas à être comblé. On peut donc affirmer que la civilisation est indestructible, et qu'elle est destinée à atteindre les couches les plus profondes des sociétés et à couvrir de proche en proche toute la surface du globe.
On peut affirmer aussi que la civilisation était nécessaire, qu'elle ne pouvait pas ne pas se produire, étant donné les puissances intellectuelles et morales investies dans l'homme, les besoins qui provoquaient leur activité, les matériaux et les agents extérieurs dont elles pouvaient disposer pour y pourvoir. A cette provocation continue des besoins est venue se joindre, à mesure que les hommes se sont multipliés, la concurrence pour la vie, concurrence d'abord purement animale, concentrée sur la recherche des substances alimentaires, ensuite politique et guerrière ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation des régions les plus productives, enfin industrielle et commerciale, s'étendant à tous les produits et services nécessaires [506] à la satisfaction des besoins multiples de l'homme civilisé , et, sous ces formes progressives, donnant la victoire aux plus forts, aux plus courageux, aux plus entreprenants, aux plus intelligents et aux plus laborieux. Dans cette lutte, les races et les individualités paresseuses ou vicieuses, qui font un emploi insuffisant ou malfaisant de leurs forces productives, finissent par être vaincues et par disparaître. Grâce à cette élimination et à cette sélection successives qui la débarrassent de ses membres débilités et gâtés pour mettre à la place des rejetons vigoureux et sains, l'humanité conserve et accroît les forces dont elle a besoin pour mener à bien l'œuvre de la civilisation. Mais ce grand travail qu'elle a poursuivi depuis sa naissance et qu'elle poursuivra, selon toute apparence, jusqu'à sa mort, n'a-t-il aucun but, aucune finalité providentielle? Parce que cette finalité nous échappe, sommes-nous autorisés à la nier? Autant vaudrait nier l'existence des mondes que notre vue bornée ne peut atteindre dans les profondeurs infinies du ciel,
FIN
Paris. — Typ. Georges Chamerot, 19, rue des Saints-Pores. — 15717.
Notes↩
[1] Dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité des conditions, Rousseau attribue l'initiative de cette délibération à un « riche », à la recherche des moyens les plus propres à préserver ses propriétés des agressions des pauvres.
« ... Le riche, pressé par la nécessité, conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit entré dans l'esprit humain; ce fut d'employer en sa faveur les forces mêmes de ceux qui l'attaquaient, de faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur inspirer d'autres maximes, et de leur donner d'autres institutions qui lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui était contraire.
« Dans cette vue, après avoir exposé à ses voisins l'horreur d'une situation qui les armait tous les uns contre les autres, qui leur rendait leurs possessions aussi onéreuses que leurs besoins, et où nul ne trouvait sa sûreté ni dans la pauvreté ni dans la richesse, il inventa aisément des raisons spécieuses pour les amener à son but :
« Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l'oppression les faibles, contenir les ambitieux et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient; instituons dcs règlements de justice et de paix auxquels tous seront obligés (le se conformer, qui ne fassent acception de personne et qui réparent eu quelque sorte les caprices de la fortune, en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. Eu un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de sages lois, qui protège et défende tous les membres de l'association, repousse les ennemis communs, et nous maintienne dans une concorde éternelle. »
« II en fallut beaucoup moins que l'équivalent de ce discours pour entraîner des hommes grossiers, faciles à séduire, qui d'ailleurs avaient trop d'affaires à démêler entre eux pour pouvoir se passer d'arbitres, et trop d'avarice et d'ambition pour pouvoir longtemps se passer de maîtres. Tous coururent au-devant de leurs fers, croyant assurer leur liberté; car avec assez de raison pour sentir les avantages d'un établissement politique, ils n'avaient pas assez d'expérience pour en prévoir les dangers; les plus capables de pressentir les abus étaient précisément ceux qui comptaient en profiter, et les sages mêmes virent qu'il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l'autre, comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps.
« Telle fut ou dut être l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une adroite usurpation firent un droit irrévocable et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère. »
[2] « II parait que, dans ces temps reculés, les hommes étaient plus sous le gouvernement de l'opinion qu'ils ne le sont de nos jours. Leur raison était plus soumise à celle d'un individu : dans cette faible aurore des connaissances humaines, un homme savant ou réputé savant était un prodige.
... Qu'il me soit permis d'éclairer ce qui a été dit des pouvoirs des anciens législateurs par un exemple moderne, emprunté d'un sujet frivole et d'un personnage qui ne l'était pas moins. Il ne s'agit que d'un maître des cérémonies. Pendant une longue suite d'années, Nash, surnommé le beau Nash, fut à Bath le régulateur de la nombreuse société qui s'y rassemble dans la saison des eaux : régulateur des bienséances, des'coutumes, des étiquettes, de la succession des bals et des concerts, etc. Quelle est la nature et la force de ces règlements? Qu'on ne fasse pas, dit le législateur, qu'il ne soit pas permis de, etc. Que l'Assemblée ait lieu tel jour, qu'elle commence à telle heure, qu'elle finisse à telle heure, etc., etc. Laissant à part l'extrême disparité de l'objet, la ressemblance est frappante avec ce qui nous reste de plusieurs lois de l'antiquité. Point de peines proprement dites. La société, se fiant à la prudence d'un individu, mettait à sa disposition une certaine quantité du pouvoir de la sanction morale. Le cri public était prêt à s'élever contre les infractions, et les lois les plus faibles en apparence étaient pourtant les mieux obéies. (Jérémie Bentham, Théorie des récompenses et des peines.)
[3] A l'état primitif, les hommes ne subsistent que des produits spontancs de la nature. Leur vie se passe à les chercher. Après avoir consommé tout ce qu'en offre le point du sol qu'ils occupent, ils s'en éloignent pour retrouver ailleurs de nouvelles ressources... A cette époque, les associations sont à l'état embryonnaire; l'insuffisance des moyens de nutrition eu arrête le développement, et rarement se composent-elles de plus d'une centaine de familles. Cependant quelque misérables, quelque peu nombreuses que soient les communautés sauvages, elles ne manquent pas d'affaires qui leur imposent des efforts collectifs. Chacune d'elles a pour ennemies toutes les autres. Des hommes que ne cessent de menacer les atteintes meurtrières de la faim ne souffrent pas que des étrangers tuent le gibier et s'emparent des végétaux dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Toute rencontre entre deux tribus amène un choc sanglant, une bataille, à la suite de laquelle les vainqueurs égorgent impitoyablement ceux des vaincus qui ne parviennent pas à se dérober à leur poursuite. Aussi, des communautés, environnées de périls redoutables, se soumettent-elles à uue direction qui seule peut les préserver de la ruine. Dans les temps même ordinaires, elles laissent aux plus habiles, aux plus expérimentés, le soin de les conduire, et ce qu'ils proposent ou conseillent devient la règle à laquelle chacun obéit. « On ne peut trop s'étonner, dit en parlant des tribus de l'Amérique septentrionale, l'homme qui les a le mieux connues, le Revérend des Hcckewclder, de voir comment une association sans code de lois, sans système de jurisprudence, sans aucune forme établie de gouvernement, et même sans un seul magistrat électif ou héréditaire, peut vivre en paix et pratiquer les vertus morales; comment un peuple peut être bien gouverné sans aucune autorité reconnue, mais seulement par l'ascendant qu'ont les hommes d'un esprit supérieur sur ceux d'une trempe plus ordinaire, et par une soumission tacite, quoique générale, à l'aristocratie naturelle de l'expérience, du talent et de la vertu. Tel est pourtant le spectacle que présentent les races indiennes. C'est ainsi que je les ai vues pendant le long séjour que j'ai fait parmi elles. » Ainsi, en effet, se passent les choses chez les peuplades qui vivent principalement de chasse, de pêche et des fruits spontanés de la terre. Elles ne sentent pas le besoin de pouvoirs stables et régulièrement constitués; les avis, les décisions de ceux qui ont fait preuve de sagesse et d'intrépidité dans les occasions difficiles suffisent pour maintenir le bon ordre au dedans; et ce n'est que dans le cas, du reste assez fréquent, où il leur faut entreprendre une expédition guerrière, qu'elles se rangent momentanément sous le commandement direct de celui d'entre eux qu'elles jugent le plus capable de les diriger avec succès. C'est la forme républicaine dans toute sa plénitude et à son plus haut degré de simplicité. » (Hippolyte Passy. Des formes de gouvernement et des lois qui les régissent, p. 92.)
[4] Voit l'Évolution économique du xix° siècle, p. 411; Giraud-Teulon, les Origines de la famille.
[5] Voir l'Évolution économique, p. 411.
[6] Divisés en classes ou tribus, le régime patriarcal était le seul qu'ils (les Germains) connussent. Chaque tribu vivait sous la suprématie d'une famille réputée d'origine héroïque ou divine. C'était parmi les membres de cette famille qu'était proclamé son chef; mais le chef n'exerçait qu'une autorité restreinte. Du moment où se présentait une question d'intérêt général, il était tenu de convoquer les guerriers qui reconnaissaient son commandement, et c'était en assemblée générale qu'étaient arrêtées les décisions définitives. Tel était le mode de gouvernement que les races du Nord apportèrent avec elles dans les contrées devenues leur partage. Non seulement la puissance législative restait sous le contrôle des principaux membres de l'association, mais en partie aussi la puissance constituante, le droit d'élire le prince n'admettant, selon l'usage recu, d'autre restriction que l'obligation de le tirer des rangs d'une famille privilégiée entre toutes. (H. Passy. Des formes de gouvernement et des lois gui les régissent, ch. viii, p. 199.)
[7] La communauté ne se chargeait point, à l'origine, de réprimer les nuisauces privées; elle ne s'occupait que de celles qui l'atteignaient elle-même directement; en revanche, elle reconnaissait à tout individu offensé ou lésé le droit de tirer vengeance de l'offense ou d'exiger une réparation pour le dommage. Lorsqu'il s'agissait d'un meurtre, le droit de vengeance était exercé par les parents les plus proches de la victime, et ce droit, chez les tribus germaines par exemple, a continué d'être pratiqué pendant plusieurs siècles après leur établissement dans les Gaules.
« Les annales des Franks, dit M. Thonissen, sont remplies de meurtres perpétrés pour venger l'homicide, sans qu'une protestation se fasse entendre, sans que la justice soit appelée à intervenir, sans que les historiens et les hagiographes songent à révoquer en doute la légitimité de ces sanglantes représailles. Aux yeux des hommes les plus pieux et les plus austères du vic siècle, ces meurtres étaient le résultat d'un juste jugement de Dieu. Grégoire de Tours trouve tout simple que l'héritier du mort tue l'assassin et disperse ses membres palpitants le long du chemin. La douce ut pieuse Clotilde, que l'Église a placée a» nombre des saiutes, blâmait ses fils de ce qu'ils tardaient à venger la mort de ses parents. La déconsidération, le mépris public, atteignaient le fils qui ne vengeait pas le sang paternel, soit en exigeant une composition, soit en arrachant la vie a l'assassin, » (J.-J. Thonissen. Le Droit de vengeance dans la législation mérovingienne. Compterendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales politiques. Janvier 1879.)
Cependant, cette pratique naturelle qui est commune aux hommes et aux autres animaux de venger leurs offenses et de chercher à rendre avec usure le mal pour le mal, ne pouvait manquer d'engendrer des guerres privées qui affaiblissaient la communauté. L'expérience de cette nuisance indirecte eut à la longue pour résultat de la déterminer à intervenir dans les différends entre individus et dans la répression des crimes privés. Elle y intervint d'abord par la composition, c'est-à-dire par le rachat de l'offense ou la compensation pour le dommage causé. Il convient de remarquer toutefois que cette pratique transactionnelle remontait beaucoup plus haut, qu'elle avait été découverte et mise en usage par les auteurs des offenses ou par ceux qui avaient été offensés ou lésés. « La coutume » se borna à la faciliter et à la garantir en établissant un tarif de compensation gradué pour chaque sorte d'offenses ou de nuisances privées, et en appelant la vindicte publique sur ceux qui exercaient leur droit de vengeance ou qui continuaient à exercer ce droit après avoir accepté la composition.
« Chez les Bavarois, dit encore M. Thonissen, l'auteur d'un homicide légitime annonçait le meurtre à ses voisins, suivant une formule sacramentelle déterminée par la coutume. Les parents du mort étaient ainsi solennellement sommés de s'expliquer sur le caractère légal de l'homicide. S'ils prétendaient et prouvaient que le meurtrier avait outrepassé son droit, ils pouvaient le faire condamner aux peines fixées par la loi; mais si l'accusé prouvait de sou côté que les coutumes de la nation lui permettaient de faire ce qu'il avait fait, en d'autres termes qu'il avait légitimement tué son ennemi, .il échappait à la justice répressive. Il conservait la « paix » et les parents du mort, en se vengeant à leur tour, tombaient au uivcau des assassins ordinaires.
« ... Le coupable qui payait la composition échappait à la faida (fchde, facdh, inimitié conduisant à la vengeance). Sa personne et ses biens se trouvaient replacés sous la protection du droit commun. Il récupérait « la paix », cette paix intérieure de la cité à laquelle les Germains de toutes les races, malgré leurs passions grossières et leur humeur aventurière, attachaient le plus grand prix. Il avait éteint le ressentiment de la victime du délit. Les lois et les mœurs lui garantissaient désormais une sécurité complète. Chez les Germains du Nord, où les traditions nationales mises à l'abri de l'action absorbante de l'élément romain se sont longtemps conservées dans leur pureté native, une sorte de malédiction à la fois légale et divine tombait sur la tète de l'homme qui osait rompre la paix après avoir recu le payement de la composition. »
« Chez les races inférieures, dit sir John Lubbock, les chefs s'occupent à peine des crimes, à moins qu'ils n'atteignent directement les intérêts de la tribu en général. Quant aux querelles particulières, chacun doit se protéger ou se venger comme il l'entend.
« Le chef ou les magistrats, dit Du Tertre, n'administrent pas la justice chez les Caraïbes ; mais de même que chez les Topinambous, celui qui se croit offensé obtient de sou adversaire la satis« factioa qui lui convient, selon que la passion le conduit, et que sa force le lui permet. Le public ne s'occupe pas du châtiment des criminels, et si, chez ces peuples, ou se soumet à une offense sans chercher à se venger, on est mis au ban de la tribu comme un lâche et un homme sans hon« neur. »
Cependant, l'expérience ne peut manquer de faire sentir les inconvénients du droit individuel et illimité de se venger d'une offense, au point de vue du maintien de l'ordre et de la conservation de la tribu. On essaye donc de limiter et de réglementer ce droit.
« La quotité de la vengeance légale, si l'on peut s'exprimer ainsi, est souvent l'objet de lois sévères, dans les pays mêmes où nous ne nous attendions pas à les trouver. Ainsi, en Australie,
« le criminel peut racheter sou crime en se présentant et en permettant à toute personne offensée de lui donner des coups de lance dans certaines parties du corps, dans la cuisse, dans le mollet ou sous le bras. La partie à percer est indiquée pour chaque crime, et un indigène qui a encouru ce châtiment présente souveut la jambe, par exemple, à la personne qu'il a offensée, pour recevoir le coup de lance. » (Sir G. Grey, Australia}.
Le montant du châtiment est si strictement limité, que si, en infligeant la blessure, un homme, par inattention ou pour quelque autre cause, dépasse les limites prescrites, si par exemple il atteint l'artère, il devient à son tour passible du même châtiment. »
« ... La sévérité des anciens codes, ajoute judicieusement sir John Lubbock, et l'uniformité du châtiment qui les caractérise, proviennent probablement de la même cause. Un individu qui se trouvait offensé ne pesait pas très philosophiquement le châtiment qu'il avait le droit d'infliger; et, sans aucun doute, quand, dans une tribu, un chef, civilisé pour son temps, essaya de substituer la loi à la vengeance particulière, son but dut être de déterminer ceux qui avaient sujet de se plaindre, à demander l'appui de la loi plutôt qu'à se venger eux-mêmes. Or, comment y amener le peuple, si le châtiment infligé par la loi était moindre que celui que la coutume permettait à la victime d'infliger elle-même? (Les origines de la Civilisation. Lois.}
Ce fut seulement beaucoup plus tard que la communauté interdit l'exercice du droit de vengeance en se chargeant de la répression des nuisances privées. Est-il nécessaire d'ajouter que le duel est un reste de ce droit primitif et qu'il subsiste, malgré ce qu'il a de barbare et d'incertain, comme un moyen extrême de venger les offenses que la loi et l'opinion de la communauté sont demeurées impuissantes à réprimer?
[8] Si l'on se reporte au temps où la race humaine était disséminée sur la terre, on trouve que les premiers établissements ont eu lieu sur des hauteurs: c'est de là que les hommes se sont répandus dans les diverses contrées. Les fleuves qui naissent sur ces hauteurs ont été les premiers guides, comme les premières routes de ces migrations qui ne s'avancent jamais dans la direction des montagnes, mais qui suivent constamment le cours des rivières; et c'est par la même raison que les courants d'eau et non les montagnes servent de limites aux peuplades primitives dont les habitations viennent se grouper sur les bords des fleuves. Le Zendavesta renferme des traditions anciennes qui confirment cette assertion. Il y est dit que le premier établissement de la race iranienne fut Cériéné Vièedjio, actuellement Cachemire ou l'ancienne Paropamise; et que ces Iraniens ayant été chassés par Arimane, occupèrent d'abord les régions situées le long de l'Oxus, puis celles qui bordent l'Indus et l'Arius, et plus tard les autres contrées qui ont reçu le nom de cette race émigrante. L'Inde a conservé des traditions semblables : elles se rapportent également au plateau de Cachemire ou de Paropamise qu'on y présente, à l'instar de la Thessalie des Grecs, comme la demeure des dieux, des génies et des premiers hommes. Là s'élève la montagne de Mérou, l'Olympe indien, où repose dans sa majesté la force divine et où veillent quatre animaux : un cheval, une vache, un chameau et un cerf; de leur bouche s'écoulent quatre fleuves :le Bourampoutra (enfant de Brama), le Gange, l'Indus et l'Oxus. Les trois premiers sont le berceau des établissements indiens, et leurs rives ont vu se former les sociétés primitives. Les rivages du Nil ont partagé les destinées de l'Oxus, de l'Indus et du Gange. Les anciens auteurs témoignent que la race éthiopienne est descendue des hauteurs de l'Abyssinie, que la province de Méroé fut la première peuplée, et que les émigrations qui en sortirent se répandirent ensuite dans la haute Egypte, dans l'Egypte centrale et dans la basse Egypte. Ainsi la race éthiopienne, en s'étendant du sud au nord, a suivi une impulsion directement contraire à celle de la race indienne, qui s'est avancée du septentrion au midi. (Essais sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité, par M. Koutorga, traduit du russe par M. Chopin, p. 6.)
[9] A l'origine de la civilisation, avant que les hommes se livrassent à l'agriculture, les émigrations paraissent avoir été nombreuses. Cependant, les historiens, partant de l'idée préconçue de l'unité d'origine de la race humaine, eu ont peut-être exagéré l'importance. On ne remarque point, par exemple, que les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, qui pourvoient encore à leur subsistance au moyen de la chasse, se déplacent fréquemment. Chaque tribu a ses terrains de chasse dont elle dépasse rarement les limites. Cette immobilité de l'existence du sauvage s'explique par sa situation économique. Il ne possède qu'un faible capital, des armes, des filets, quelques avances de subsistance. Ce capital, qui lui fournit à peine les moyens de soutenir son existence dans les localités composant le domaine de sa tribu, n'est-il pas tout à fait insuffisant pour lui permettre d'entreprendre des expéditions lointaines? Sans doute on peut se livrer partout à la chasse ou à la pèche, mais avant de connaître les endroits où le gibier et le poisson abondent, ne faut-il pas pratiquer des explorations souvent chanceuses et difficiles? L'accumulation d'un capital relativement assez considérable n'est-elle pas nécessaire pour rendre ces explorations possibles? Or, comme le sauvage, naturellement imprévoyant, accumule peu, il demeure essentiellement sédentaire, à moins que l'excès de la population ou la guerre ne le chasse de son territoire primitif. Tels du moins nous apparaissent les sauvages du nouveau monde et tels devaient être ceux de l'ancien. (Dictionnaire de l'Économie politique, art. Émigration.)
[10] Voir le Dictionnaire de l'Économie politique, art. Noblesse.
[11] La conquête de l'Angleterre par les Normands nous offre un exemple caractéristique de la constitution d'une entreprise de conquête et de la manière dont se distribuait le butin entre les co-participants de l'entreprise. Comme toutes les autres conquêtes, celle-ci fut une « affaire ». C'est ainsi que nous l'a montrée l'admirable récit qu'en a fait M. Augustin Thierry. On voit d'abord dans ce récit avec quelle habileté Guillaume réussit à réunir le capital nécessaire à son entreprise malgré les résistances des notables auxquels il demandait des subsides; comment il parvint ensuite à y associer, eu usant de procédés qui ne diffèrent pas sensiblement de ceux auxquels ont recours nos sociétés financières, des hommes de tous rangs et de toutes conditions, comment enfin s'opéra le partage des bénéfices entre les co-participants à l'entreprise. On dressa l'inventaire de la conquête et ou attribua à chacun une part aussi exactement proportionnée que possible à son apport et aux services rendus. Ecoutons plutôt l'éloquent historien de la conquête:
« Le duc Guillaume assembla, en conseil de cabinet, ses amis les plus intimes pour leur demander aide et secours. Tous furent d'opinion qu'il fallait descendre en Angleterre et promirent à Guillaume de le servir de corps et de biens jusqu'à vendre ou engager leurs héritages. « Mais ce n'est pas tout, lui dirent-ils; il vous faut demander aide et conseil à la généralité des habitants de ce pays, car il est do droit que qui paye la dépense soit appelé à la consentir. » Guillaume alors fit convoquer, disent les chroniques, une grande assemblée d'hommes de tous états de la Normandie, gens de guerre, d'église et de négoce, les plus considérés et les plus riches. Le duc leur exposa son projet et sollicita leur concours; puis l'assemblée se retira afin de délibérer plus librement hors de toute influence. Dans le débat qui suivit, les opinions parurent fortement divisées; les uns voulaient qu'on aidât le duc de navires, de munitions et de deniers, les autres refusaient toute espèce d'aide, disant qu'ils avaient déjà plus de dettes qu'ils n'en pouvaient payer. Cette discussion n'était pas sans tumulte, et les membres de l'assemblée, hors de leurs sièges et partagés en groupes, parlaient et gesticulaient avec grand bruit. Au milieu de ce désordre, le sénéchal de Normandie, Guillaume fils d'Osbcrn, éleva la voix et dit : « Pourquoi vous disputer de la sorte? Il est votre seigneur; il a besoin de vous; votre devoir serait de lui faire des offres et non d'attendre sa requête. Si vous lui manquez et qu'il arrive à ses fins, de par Dieu, il s'en souviendra; montrez donc que vous l'aimez et agissez de bonne grâce. — Nul doute, s'écrièrent les opposants, qu'il ne soit notre seigneur; mais n'est-ce pas assez pour nous de lui payer ses rentes? Nous ne lui devons point d'aide pour aller outremer; il nous a déjà trop grevés par ses guerres; qu'il manque sa nouvellc entreprisc, et notre pays est ruiné Qu'il ait affaire dans son pays et nous le servirons comme il lui est dû; mais nous ne sommes pas tenus de l'aider à conquérir le pays d'autrui. D'ailleurs, si nous faisions une seule fois double service, et si nous le suivions outre-mer, il s'en ferait un droit et une coutume pour l'avenir; il en grèverait nos enfants; cela ne sera pas, cela ne sera pas! »
Cependant le duc ayant fait appeler séparément auprès de lui les plus récalcitrants, « aucun, dit M. Augustin Thierry, n'eut le courage de prononcer isolément son refus à la face du chef du pays, dans un entretien seul à seul; ce qu'ils accordèrent fut enregistré aussitôt, et l'exemple des premiers décida ceux qui vinrent ensuite. L'un souscrivit pour des vaisseaux, l'autre pour des hommes armés en guerre, d'autres promirent de marcher en personne; les clercs donnèrent leur argent, les marchands leurs étoffes et les paysans leurs denrées.
« Bientôt arrivèrent de Rome la bannière consacrée et la bulle qui autorisait l'agression contre l'Angleterre. A cette nouvelle, l'empressement redoubla; chacun apportait ce qu'il pouvait; les mères envoyaient leurs fils s'enrôler pour le salut de leurs âmes, Guillaume fit publier son ban de guerre dans les contrées voisines; il offrit une forte solde et le pillage de l'Angleterre à tout homme robuste qui voudrait le servir de la lance, de l'épéc ou de l'arbalète. 11 en vint une multitude, par toutes les routes, de loin, de près, du nord et du midi. Il en vint du Maine et de l'Anjou, du Poitou -et de la Bretagne, de la France et de la Flandre, de l'Aquitaine et de la Bourgogne, des Alpes et des bords du Rhin. Tous les aventuriers de profession, tous les enfants perdus de l'Europe occidentale accoururent à grandes journées; les uns étaient chevaliers et chefs, les autres simples piélous et sergents d'armes, comme on s'exprimait alors; les uns offraient de servir pour une solde en argent, les autres ne demandaient que le passage et tout le butin qu'ils pourraient faire, plusieurs voulaient de la terre chez les Anglais, un domaine, un château, une ville; d'autres enfin souhaitaient quelque riche Saxonne en mariage. Tous les vœux, toutes les prétentions de l'avarice humaine se présentèrent. Guillaume ne rebuta personne, dit la chronique normande, et fit plaisir à chacun selon son pouvoir. »
Ces promesses, Guillaume les renouvela au moment d'engager la bataille d'Hastings. « Pensez à bien combattre, dit-il à ses compagnons, et mettez tout à mort; car si nous les vainquons, nous sommes tous riches. Ce que je gagnerai, vous le gagnerez; si je conquiers, vous conquerrez; si je prends la terre, vous l'aurez. »
Ces promesses furent religieusement tenues, et Guillaume n'aurait pu y manquer, d'ailleurs, sans s'exposer à une révolte de ses compagnons. Tout en s'adjugeant en sa qualité de chef la plus grosse part dans les fruits de la conquête (il ne s'adjugea pas moins de i,500 manoirs), il procéda au partage des dépouilles, après avoir fait préalablement un inventaire du butin mobilier et immobilier.
« Des commissaires parcouraient toute l'étendue du pays où l'armée avait laissé des garnisons; ils y faisaient un inventaire exact des propriétés de toute espèce, publiques et particulières; ils les inscrivaient et les enregistraient avec soin et grand détail; car la nation normande, dans ces temps reculés, se montrait déjà, comme on l'a vu depuis, extrêmement prodigue d'écritures, d'actes et de procès-verbaux.
« On s'enquérait des noms de tous les Anglais morts en combattant, ou qui avaient survécu à la défaite, ou que des retards involontaires avaient empêchés de se rendre sous les drapeaux. Tous les liieus de ces trois classes d'hommes, terres, revenus, meubles étaient saisis : les enfants des premiers étaient déclarés déshérités à tout jamais; les seconds étaient également dépossédés sans retour; et eux-mêmes, disent les auteurs normands, sentaient bien qu'en leur laissant la vie, l'ennemi faisait assez pour eux; enfin, les hommes qui n'avaient point pris les armes, furent aussi dépouillés de tout, pour avoir eu l'intention de les prendre; mais, par une grâce spéciale, on leur laissa l'espoir qu'après de longues années d'obéissancc et de dévouement à la puissance étrangère, non pas eux, mais leurs fils pourraient peutêtre obtenir des nouveaux maîtres quelque portion de l'héritage paternel. Telle fut la loi de la conquête, selon le témoignage non suspect d'un homme presque contemporain et issu de la race des conquérants.
« L'immense produit de cette spoliation universelle fut la solde des aventuriers de tous pays qui s'étaient enrôlés sous la bannière du duc de Normandie. Leur chef, le nouveau roi des Anglais, retint premièrement, pour sa propre part, tout le trésor des anciens rois, l'orfèvrerie des églises et ce qu'on trouva de plus précieux et de plus raie dans les magasins des marchands. Guillaume envoya une portion de ces richesses au pape Alexandre, avec l'étendard de Harold, en échange de la bannière qui avait triomphé à Hastings; et toutes les églises d'outre-mer où l'on avait chanté des psaumes et brûlé des cierges pour le succès de l'invasion, reçurent, en récompense, des croix, des vases et des étoffes d'or. Après la part du roi et du clergé, on fit celle des hommes de 'guerre, selon leur grade et les conditions de leur engagement. Ceux qui, au camp sur la Dive, avaient fait hommage pour des terres alors à conquérir, reçurent celles des Anglais dépossédés; les barons et les chevaliers eurent de vastes domaines, des châteaux, des bourgades, des villes entières; les simples vassaux eurent de moindres portions, quelques-uns prirent leur solde en argent; d'autres avaient stipulé d'avance qu'ils auraient une femme saxonne, et Guillaume, dit la chronique normande, leur fit prendre, par mariage, de nobles dames, héritières de grands biens, dont les maris étaient morts dans la bataille. Un seul, parmi les chevaliers venus à la suite du conquérant, ne réclama ni terres, ni or, ni femme, et ne voulut rien accepter de la dépouille des vaincus. On le nommait Guilbert, fils de Richard : il dit qu'il avait accompagné son seigneur eu Angleterre parce que tel était son devoir, mais que le bien volé ne le tentait pas; qu'il retournerait en Normandie pour y jouir de son héritage, héritage modique mais légitime, et que, content de son propre lot. il n'enlèverait rien à autrui D'ignobles valets d'armée, de sales vauriens, disent les vieux annalistes, disposaient, à leur fantaisie, des plus nobles filles et ne leur laissaient qu'à pleurer et à souhaiter la mort. Ces misérables effrénés s'émerveillaient d'eux-mêmes; ils devenaient fous d'orgueil et de surprise de se voir si puissants, d'avoir des serviteurs plus riches que n'avaient jamais été leurs pères. Tout ce qu'ils voulaient, ils se le croyaient permis, ils versaient le sang au hasard, arrachaient le morceau de pain de la bouche des malheureux, et prenaient tout, l'argent, les biens, la terre...
« Les soldats normands partagèrent entre eux les maisons des vaincus. Ailleurs, ce furent les habitants eux-mêmes qu'ils se distribuèrent corps et biens: et, dans le bourg de Lewcs, selon un registre authentique, le roi Guillaume prit soixante bourgeois produisant chacun trente-neuf sous de rente; un certain Asselin eut plusieurs bourgeois payant seulement quatre sous de rente, et Guillaume de Cacn eut deux bourgeois de deux sous (ce sont les propres mots du registre).
« La ville de Douvres, à demi consumée par l'incendie, devint le partage d'Eudes, évéque de Baveux, qui ne put, disent les vieux actes, en calculer au juste la valeur parce qu'elle était trop dévastée. Il en distribua les maisons à ses guerriers et ù ses gens; Raoul de Combespine en reçut trois avec le champ d'une femme pauvre; Guillaume, fils de Geoffroy, eut aussi trois maisons et l'ancien hôtel de ville ou la halle commune des bourgeois. Près de Colchester, dans la province d'Essex, Geoffroy de Mandeville occupa seul quarante manoirs ou habitations entourées de terres en culture; quatorze propriétaires saxons furent dépossédés par Engelry et trente par un certain Guillaume. Unriche Anglais se remit, pour sa sûreté, au pouvoir du Normand Gaultier qui en fit son tributaire; un autre Anglais devint serf de corps sur la glèbe de son propre champ. Le domaine de Stratton, dans la province de Bedford, celui de Burton et la ville de Strafford, furent le partage de Guy de Riencourt. Il posséda toutes ces terres durant sa vie. Mais Richard, son fils et son héritier, en perdit la meilleure partie en jouant aux dés contre le roi Henri, second successeur du conquérant.
« Dans la province de Suffolk, un chef normand s'appropria les terres d'une Saxonne nommée Ëdive la Belle. La cité de Norwick fut réservée tout entière pour le domaine privé du conquérant; elle avait payé au roi saxon trente livres et vingt sous d'impôt, mais Guillaume exigea par au soixantedix livres, un cheval de prix, cent sous au profit de sa femme et en outre vingt livres pour le salaire de l'officier qui y commandait eu son nom; une forte citadelle fut bâtie au sein de cette ville habitée par des hommes d'origine danoise, parce que les vainqueurs craignaient qu'elle n'appelât et ne recut du secours des Danois qui croisaient souvent près de la côte. Dans la ville de Dorchester, au lieu de cent soixante-douze maisons qu'on avait vues du temps du roi Edward, on n'en comptait plus que quatre-vingt-huit; le reste était un monceau de ruines; à Washam, sur cent treize maisons, soixante-deux avaient été détruites; à Bridport, vingt maisons disparurent de même, et la misère des habitants fut telle que, plus de vingt années après, pas une seule n'avait été rebâtie. L'ile de Wight, près de la côte du sud, fut envahie par Guillaume, fils d'Osbern, sénéchal du roi normand, et devint une portion de ses vastes domaines en Angleterre; il la transmit à son fils, puis à son petit neveu Baudouin, appelé eu Normandie Baudoin de Riviers, et qu'en Angleterre on surnomma Baudoin de l'Ile.
« Les bouviers de Normandie et les tisserands de Flandre, avec un peu de courage et de bonheur, devenaient promptement, en Angleterre, de hauts hommes, d'illustres barons, et leurs noms, vils ou obscurs sur l'une des rives du détroit, étaient nobles et glorieux sur l'autre.
« Voulez-vous savoir, dit un vieux rôle en langue française, quels sont les noms des grands venus d'outre-mer avec le conquérant Guillaume, à la grande vigueur? Voici leurs surnoms comme on les trouve écrits, mais sans leurs noms de baptême qui souvent manquent ou sont changés : c'est Mandeville et Dandeville, Omfrevillo et Domfrevillc, Bouteville et Estoutcville, Mohun et Bohun, Biset et Basset, Malin et Malvoisin. »
« ... Un autre catalogue des conquérants de l'Angleterre, longtemps gardé dans le trésor du monastère de la bataille, contenait des noms d'une physionomie singulièrement liasse et bizarre, comme Bonvilain et Boutevilain, Trousselot, Trousscbout, l'Engayne et Longue-Épée, (Eil-de-Bœuf... Enfin, plusieurs actes authentiques désignent comme chevaliers en Angleterre un Guillaume le Charretier, un Hugues le Tailleur, un Guillaume le Tambour; et, parmi les surnoms de cette chevalerie rassemblée de tous les coins de la Gaule, figurent un grand nombre de simples noms de villes et de pays: Saint-Quentin, Saint-Haur, Cahors, etc.
« Les valets de l'homme d'armes normand, son écuycr, son porte-lance, furent gentilshommes en Angleterre; ils devinrent tout à coup nobles à côté du saxon autrefois riche et noble lui-même, maintenant courbé sous l'épée de l'étranger, expulsé de la maison de ses aïeux, n'ayant pas où reposer sa tète.
« ... Pour dernière particularité qu'offre le grand registre de la conquête normande, on y trouve la preuve que le roi Guillaume établit la loi générale que tout titre de propriété antérieur à son invasion, et que tout acte de transmission de biens faits par un homme de race anglaise postérieurement à l'invasion, étaient nuls et non avenus, à moins que lui-même ne les eût formellement ratifiés. »
Les profits extraordinaires que la conquête procurait à Guillaume et à ses heureux compagnons ne pouvaient manquer d'attirer une foule croissante d'aventuriers avides de prendre leur part dans ce riche butin.
« Depuis que la conquête prospérait, dit encore M. Augustin Thierry, ce n'étaient plus seulement de jeunes soldats ou de vieux chefs de guerre, mais des familles entières, hommes, femmes et enfants qui émigraient de presque tous les pays de la Gaule pour chercher fortune en Angleterre; ce pays était devenu, pour les gens d'outre-mer, comme ces terres nouvellement découvertes que l'on va coloniser, et qui appartiennent à tout venant. « Hofcl le Breton, dit un ancien acte, et sa femme Célestinc vinrent tous deux à l'armée de Guillaume le Bâtard, et recurent en don de ce même bâtard le manoir d'Ëlinghall, avec toutes ses dépendances. » Suivant un vieux dicton en rimes, le premier seigneur de Cognisby, nommé Guillaume, était arrivé de Basse-Bretagne, avec son épouse Tifaine, sa servante Maufa et son chien Hardi-Gras. Il se faisait des fraternités d'armes, des Sociétés de gain et do perte, à la vie et à la mort, entre les hommes qui s'aventuraient ensemble aux chances de l'invasion. Robert d'Orcilly et Roger d'Ivry vinrent à la conquête comme frères ligués et fédérés par la foi etle serment; ils portaient des vêtements pareils et des armes pareilles; ils partagèrent par moitié les terres anglaises qu'ils conquirent. Eudes et Picot, Robert Marmion et Gauthier de Somervillc firent de même. Jean de Courcy et Amaury de Saint-Florent jurèrent leur fraternité d'armes dans l'église de Notre-Dame .à Rouen; ils firent vœu de servir ensemble, de vivre et de mourir ensemble, de partager ensemble leur solde, et tout ce qu'ils gagneraient par leur bonne fortune et leur épée. »
Enfin , lorsque la conquête et l'occupation du pays furent achevées, Guillaume fit procéder à un nouvel inventaire, dans un but fiscal. 11 voulait connaître l'importance des parts de chacun afin d'établir l'assiette des redevances en argent ou en services, nécessaires à la défense de la propriété commune.
« ... Afin d'asseoir sur une base fixe ses demandes de contribution ou de services d'argent, pour parler le langage du siècle, Guillaume fit faire une grande enquête territoriale, et dresser un registre universel de toutes les mutations de propriété opérées en Angleterre par la conquête; il voulut savoir en quelles mains, dans toute l'étendue du pays, avaient passé les domaines des Saxons, et combien d'entre eux gardaient encore leurs héritages par suite de traités particuliers conclus avec lui-même ou avec ses barons; combien, dans chaque domaine rural, il y avait d'arpents de terre; quel nombre d'arpents pouvaient suffire à l'entretien d'un homme d'armes; et quel était le nombre de ces derniers dans chaque province ou comté d'Angleterre; à quelle somme montait en gros le produit des cités, des villes, des bourgades, des hameaux; quelle était exactement la propriété de chaque comte, baron, chevalier, sergent d'armes; combien chacun avaient de terre, de gens ayant fiefs sur ses terres, de Saxons, de bétail, de charrues.
« Ce travail, dans lequel des historiens modernes ont cru voir la marque du génie administratif, fut le simple résultat de la position du roi normand comme chef d'une armée conquérante, et de la nécessité d'établir un ordre quelconque dans le chaos de la conquête. Cela est si vrai que, dans d'autres conquêtes dont les détails nous ont été transmis, par exemple dans celle de la Grèce par les croisés latins, au xin° siècle, on trouve la même espèce d'enquête faite sur un plan tout semblable par les chefs de l'invasion.
« En vertu des ordres du roi Guillaume, Henri de Ferrières, Gauthier Giffard, Adam frère d'Eudes le sénéchal, et Remi évéque de Lincoln, ainsi que d'autres personnages pris parmi les gens de justice et les gardiens du trésor royal, se mirent à voyager par tous les comtés d'Angleterre, établissant dans chaque lieu un peu considérable leur conseil d'enquête. Ils faisaient comparaître devant eux le vicomte normand de chaqtic province ou de chaque shire saxonne, personnage auquel les Saxons conservaient dans leur langue l'ancien titre de shire-reve ou sheriff. Ils convoquaient ou faisaient convoquer par le vicomte tous les barons normands de la province qui venaient indiquer les bornes précises de leurs possessions et de leurs juridictions territoriales; puis, quelques-uns des hommes de l'enquête, ou des commissaires délégués par eux, se transportaient sur chaque grand domaine et dans chaque district ou centurie, comme s'exprimaient les Saxons. Là, ils faisaient déclarer sous serment, par les hommes d'armes français de chaque seigneur et par les habitants anglais de la centurie, combien il y avait sur les domaines de possesseurs libres et de fermiers, quelle portion chacun occupait eu propriété ; les noms des détenteurs actuels; les noms de ceux qui avaient possédé [avant la conquête et les diverses mutations do propriété survenues depuis : de façon, disent les récits du temps, qu'on exigeait trois déclarations sur chaque terre, ce qu'elle avait été au temps du roi Edward, ce qu'elle avait été quand le roi Guillaume l'avait donnée, et ce qu'elle était au moment présent. Au-dessous de chaque recensement particulier, on inscrivait cette formule : « Voilà ce qu'ont juré tous les Français et tous les Anglais du canton. »
« Dans chaque bourgade, on s'cnquérait de ce que les habitants avaient payé à l'impôt aux anciens rois et de ce que le bourg produisait aux officiers du conquérant; on recherchait combien de maisons les guerres de lu conquête ou les constructions de forteresses avaient fait disparaître; combien de maisons les vainqueurs avaient prises; combien de familles saxonnes, réduites a l'extrême indigence, étaient hors d'état de rien payer. Dans les cités, on prenait le serment dcs grandes autorités normandes, qui convoquaient les bourgeois saxons au sein de leur ancienne chambre du conseil, devenue la propriété du roi ou de quelque baron étranger; enfin, dans les lieux de moindre importance, on prônait le serment du préposé ou prévùt royal, du prêtre et de six Saxons ou de six villains de chaque ville, comme s'exprimaient les Normands. Cette recherche dura six années, pendant lesquelles les commissaires du roi Guillaume parcoururent toute l'Angleterre, à l'exception des pays montagneux au nord et à l'ouest de la province d'York, c'est-à-dire les cinq comtés modernes de Durham, Northumberland, Cumbcrland, Westmoreland et Lancaster La rédaction du rôle du cadastre, ou le terrier de la conquête normande pour chaque province qu'il mentionnait, fut modelée sur un plan uniforme. Le nom du roi était placé en tète avec la liste de ses terres et de ses re venus dans la province; puis venaient à la suite les noms des chefs et des moindres propriétaires, par ordre de grade militaire et de richesse territoriale. Les Saxons épargnés par grâce spéciale dans les grandes spoliations ne figuraient qu'aux derniers rangs; car le petit nombre d'hommes de cette race qui restèrent propriétaires franchement et librement, ou tenants en chef du roi, comme s'exprimaient les conquérants, ne le furent que pour de minces domaines. Ils furent inscrits à la fin de chaque chapitre sous le titre de thegns du roi, ou avec diverses qualifications d'offices domestiques dans la maison royale. Le reste des noms à physionomie anglo-saxonne, épars eà et là dans le rôle appartiennent à des fermiers de quelques fractions plus ou moins grandes du domaine des comtes, barons, chevaliers, sergents d'armes ou arbalétriers normands.
« Telle est la forme du livre authentique, et conservé jusqu'à nos jours, dans lequel ont été puisés la plupart des faits d'expropriation présentés cà et là dans ce récit. Ce livre précieux, où la conquête fut enregistrée tout entière pour que le souvenir ne pût s'en effacer, fut appelé par les Normands le grand rôle, le rôle royal ou le rôle de Winchester, parce qu'il était conservé dans le trésor de la cathédrale de Winchester. Les Saxons l'appelèrent d'un nom plus solennel, le livre du dernier jugement Doomesdaybok, parce qu'il contenait leur sentence d'expropriation irrévocable. (Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, t. II, p. 237.) »
[12] Le droit d'aînesse tire sou origine de la féodalité qui, au x° siècle, remplaça définitivement la barbarie dans la plus grande partie de l'Occident. Sous la constitution féodale, en elïet, les hommes se divisent en deux castes: les uns tiennent la terre à condition de service militaire, ce sont les vassaux, les nobles; les autres à condition de redevance ou de corvées, ce sont lcs roturiers. Or, deux principes dominent cette organisation : la terre et l'épée. « L'ordre social n'est autre chose qu'une hiérarchie de terres possédées par des guerriers, relevant les unes des autres, à divers degrés et formant une chaîne qui part de la tourelle du simple gentilhomme pour remonter jusqu'au donjon royal. » (H. Martin.) Le vassal perd sou fief, c'est-à-dire la terre concédée, s'il ne remplit pas vis-à-vis du suzerain los devoirs, suite de la concession.
Mais, pour ce faire, il ne faut pas que le fief, devenu héréditaire, soit démembré; il n'y suffirait plus. Dès lors, point de partage entre 1 aîné et le puîné, il n'y a qu'un fief dans la maison; le représentant du père, le plus sage, le plus fort, l'aîné en un mot, gardera la terre et rendra les services attachés au domaine utile. « Les fiefs, dit Montesquieu, étant chargés d'un service, il fallait que le possesseur fût ou état de le remplir. On établit un droit de primogéniture, et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile. » (montesquieu. Esprit des lois, chap. xxxiii, 1. XXXI.)
A sou point de départ, le droit de primogéniture est donc politiquement justifié. 11 est alors une conséquence nécessaire du régime auquel il se rattache. Dictionnaire général de la politique par M. Maurice Block. Art. Droit d'aînesse, par Ch. Mazeau.
[13] Parmi les conquérants, on distingua deux classes d'hommes : 1° les ahrimans ou hommes de guerre germains qui avaient participé à l'invasion, mais qui, après la lutte, se détachèrent du roi ou du chef qu'ils avaient suivi momentanément et qui vécurent sur le pays conquis dans une complète indépendance; 2° les leudes (appelés antrustions parce qu'ils formaient la trust ou compagnie des chet's de guerre), ou fidèles, guerriers attachés à la fortune d'un chef, même pendant la paix, et qui, en retour de certains avantages par lui concédés, demeurèrent sous sa dépendance, astreints envers lui à certains devoirs ou services.
... Des terres enlevées par les Barbares aux vaincus, on fit deux sortes de propriétés, les alleux et les bénéfices. Les alleux étaient les terres distribuées par la voie du sort à tous les ahrimaus après la conquête; ils étaient francs de redevances, entièrement indépendants et on les possédait en toute propriété. La seule condition à laquelle l'ahriman se trouvait soumis, était de concourir à la défense du sol et aux guerres nationales; voilà pourquoi chez les Franks les femmes, incapables de combattre, étaient exclues de tout héritage territorial: On appelait bénéfices les terres que le roi ou le chef de bande prenait sur la part plus large qui lui avait été faite dans la répartition du territoire conquis, pour les donner à ses leudes, à la place des armes et des chevaux qu'il leur distribuait autrefois en Germanie. Ces terres, dont les donataires purent à leur tour détacher des parcelles en faveur d'autres guerriers, n'étaient concédées qu'à la condition du service militaire à toute réquisition, de redevances dans des circonstances déterminées et même de certains devoirs dans la maison du donateur; elle» étaient un don temporaire et révocable.
Quant aux propriétés laissées entre les mains des vaincus, ou les appelait terres censives parce qu'elles étaient frappées d'un cens ou tribut. (Histoire de France, par Th. Bachelet, t. I, pp. 126, 128.)
[14] L'anecdote bien connue du vase de Soissons nous apprend que les parts du butin étaient tirées au sort et que le roi, comme les autres co-participants à l'entreprise, n'avait droit qu'à la part qui lui était assignée par le sort.
« L'archevêque de Reims, saint Remi, avait réclamé un vase d'or enlevé d'une de ses églises après la victoire de Soissons. Clovis était disposé à cette restitution; mais un guerrier, frappant le vase de sa hache d'armes, s'écria: « Tu n'auras du butin que la part qui te sera assignée par le sort. » Clovis, respectant les usages de sa tribu, dissimula sa colère. Quelque temps après. passant une revue, il reprocha au soldat frauk le mauvais état de ses armes, les lui arracha et les jeta à terre. Tandis que le soldat se baissait pour les ramasser, il lui fendit la tête d'un coup de framée, en disant :;« Ainsi, tu as fait au-vase de Soissons..» .(Histoire de France, par Th. Bacheletst, I, p. 64.)
[15] Les propriétaires d'alleux, ne dépendant de personne, n'avaient aucun secours à espérer s'ils étaient menacas. Dans un état de société où la force tenait souvent lieu de loi, ils furent conduits, naturellement, pour échapper aux spoliations et aux violences, à se mettre sous la protection d'hommes plus puissants. On appela recommandation l'acte par lequel ils se reconnurent dépendants et s'astreignirent, pour être défendus, à certaines obligations ou redevances (Histoire de France, pur Th. Bachelet, t. I, p. 230.)
[Notes 23 and 24 are out of order]
[23] Ce fut Hugues Capot qui, dérogeant à l'ancien usage des tribus germaniques, établit une loi de succession royale en vertu de laquelle la couronne devait se transmettre à l'aîné de ses enfants dans la ligne masculine. Plus tard, Philippe le Hardi rendit une ordonnance qui déclarait le domaine roval inaliénable.
[16] La prévôté paraît avoir été la circonscription domaniale la plus ancienne et la plus élémentaire. Le prévôt était un officier inférieur, ayant dcs attributions judiciaires, administratives et financières. Dès 1051, il y avait un prévôt à Orléans : les documents prouvent qu'au milieu du siècle suivant, Bourges et Sens avaient aussi des prévôts. La royauté n'était pas seule à avoir des prévôts pour son domaine : on en trouve à cette époque dans presque toutes les seigneuries. Le chapitre de Paris a douze prévôts pour l'administration de sa mense capitulaire et l'évéque en a également pour s'a mcnse épiscopalc... De même que dans les pays où la grande propriété s'est maintenue, le propriétaire de terres considérables a aujourd'hui des intendants pour régir ses biens, de même aux xie et xiie siècles le seigneur féodal et le roi, qui était un grand seigneur féodal, avaient des prévôts pour exercer leur pouvoir et administrer leurs domaines. Le nombre de ces ofliciers était ordinairement en rapport avec l'importance et l'étendue de la seigneurie dont ils étaient les officiers.
« Les baillis que Philippe-Auguste institua en 1190 furent placés au-dessus iles prévôts, et ils furent comme ceux-ci des officiers judiciaires, administratifs et financiers; ils percurent une partie des revenus et ils en rendirent compte. Mais leur institution ne date que de la lin du xn° siècle et leurs circonscriptions, qu'on appela faillies, furent plus étendues, moins nombreuses et plus variables que les prévôtés. C'est donc par le nombre de celles-ci plutôt que par le nombre des baillies, qu'on peut apprécier, aux xi°, XIIe et xiiiesiècles, l'importance et les progrès du domaine de la couronne. » (Ad. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la révolution de 1789, p. 166.)
[24] Dissertation sur les recettes et les dépenses de saint Louis, préface du t. XXI du Recueil des historiens de France, p. 73.
[17] A l'avènemcnt de Hugues Capet, le domaine politique du roi se composait seulement du duché de France. En dehors de ce domaine, l'autorité du roi était nulle, sauf son droit au commandement suprême eu sa qualité de chef de la hiérarchie féodale dans le cas d'une guerre d'intérêt commun. On ne sait pas même exactement quelles étaient les limites du duché de France. D'après M. Vuitry, les terres dont le duc devenu roi avait la propriété directe se trouvaient vraisemblablement concentrées dans cinq de nos départements actuels : la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, l'Oise et le Loiret. Le Gatinais, le Perche, la Touraine, l'Anjou, le Maine faisaient aussi partie du duché de France; mais c'étaient des fiefs dont le duc était suzerain. Les premiers successeurs de Hugues Capet n'agrandirent que faiblement le domaine royal. — « Depuis 987, jusqu'à 1101, dit M. Mignet, les rois de la dynastie capétienne furent réduits à une impuissance presque complète. Malgré leur titre qui les plaçait à la tête de la hiérarchie féodale, ils n'obtinrent pendant cette période ni l'obéissance des grands vassaux du royaume ni celle des petits barons du duché de France. » Ce fut Philippe-Aujuste qui commença véritablement l'œuvre de l'agrandissement du domaine royal, œuvre que ses successeurs poursuivirent sans interruption, mais sans aucun autre dessein que d'augmenter la puissance et la richesse de l«ur « maison ». Tantôt, en effet, ils s'arrondissaient aux dépens de leurs vassaux de France; tantôt en portant leurs armes ou en faisant valoir des droits de succession en Espagne, en Italie ou eu Allemagne. Il leur était indifférent que leurs sujets appartinssent à une race ou à une autre, de même qu'il importe peu à un industriel que sa clientèle soit française, allemande ou chinoise. Ce qu'il considère, avant tout, c'est le profit qu'il peut en tirer. — Les chefs de maisons politiques n'envisageaient pas autrement les choses. S'ils s'efforcèrent, par exemple, pendant plusieurs siècles ,de s'agrandir eu Italie plutôt qu'en France même, c'est parce que l'Italie étant plus riche rapportait davantage.
M. Mignet explique parfaitement les causes qui favorisèrent l'agrandissement du domaine royal sous la dynastie capétienne:
« Philippe-Auguste, petit-fils de Louis le Gros, rendit conquérante la couronne que son aïeul avait faite souveraine. La dynastie nouvelle était favorablement placée pour réunir le territoire de la France sous sa domination et former un État compact. Ses domaines, situés au centre du pays, lui donnaient une grande facilité géographique de s'agrandir, et son titre dans la société féodale lui en offrait les moyens soit par des mariages, soit par des traités, soit par des confiscations, soit par des conquêtes. Impuissants jusque-là, ou occupés de l'établissement de leur suprématie, les princes Capétiens avaient fait peu d'acquisitions. Ils avaient seulement ajouté à leur domaine le Vexin français, les comtés de Mantes, de Dreux, de Corbeil, le Gâtinais dans le duché de France, et le vicomté de Bourges hors de ce duché. »
Néanmoins, pendant plusieurs siècles, l'agrandissement du domaine royal se trouva encore retardé par la coutume de donner en fiefs à titre d'apanages une partie de ce domaine aux cadets, l'aîné n'ayant droit, d'après la coutume féodale, qu'aux deux tiers du domaine et au manoir. Louis XI reprit la plupart de ces apanages et contribua, plus encore que ne l'avait fait PhilippeAuguste à l'accroissement de l'Etat dont il était propriétaire.
« Doué en politique d'un esprit profond et ayant des desseins étendus, quoique son caractère manquât de grandeur, familier, rusé, hardi, cruel, il acheva par tous les moyens de l'intrigue, de la violence, de la guerre et du droit aussi la réunion du territoire. Encore dauphin il avait, en 1448, acquis par les armes le Viennois, le Valentinois et le Diois dans la vallée du Rhône. Il reprit, en 1460, moyennant 400,000 écus d'or, les villes de Picardie qui avaient été cédées par le traité d'Arras au duc de Bourgogne. (Ces villes avaient été cédées par Charles VII au duc de Bourgogne, sauf faculté de rachat au prix de 400,000 écus d'or.) — Après être resté en possession de la Guyenne, en 1472, par la mort violente de son frère, il confisqua en 1473 sur la maison des Armagnacs qui avait pris part à toutes les confiscations et à toutes les guerres des apanagistes, l'Armagnac, le Pardiac, l'Astarac, le Fezenzac, le Fczenzaguet, le Rouerguc. En 1475, il s'empara de Perpignan, etc. — C'est ainsi que ce prince politique, moitié par l'influence de son caractère, moitié par la faveur des circonstances qui laissèrent à la même époque sans héritiers mâles les puissantes maisons de Bourgogne, d'Anjou, de Provence et de Bretagne, contribua plus que tout autre roi, Philippe-Auguste excepté, à la formation matérielle de la monarchie. Philippe-Auguste avait agrandi le royaume aux dépens des dynasties féodales indépendantes. Louis XI l'étendit en reprenant les provinces occupées par les dynasties apanagées. » (Estai, etc., p. 668.)
Ajoutons que le trait dominant du caractère de Louis XI était une avidité sans scrupule qui ne reculait devant aucune fourberie et aucun crime pour arrondir son domaine et augmenter son revenu. Sa politique, dit un historien, se résumait en cette devise : « Là où est le profit, là est la gloire. » Sous ce rapport, il réalisait le type le plus complet d'un bon entrepreneur d'industrie politique.
Après Philippe-Auguste et Louis XI, c'est Louis XIV qui a le plus contribué à l'extension du domaine politique de la maison de France.
La conquête a joué le premier rôle dans l'agrandissement de ce. domaine; vient ensuite l'héritage, puis en dernier lieu les acquisitions à prix d'argent. Parmi celles-ci nous citerons:
— En 1100 ou 1101, Eudes Arpin, vicomte de Bourges, se disposant à partir pour la Terre sainte avec le duc d'Aquitaine, vendit pour 60,000 sous d'or sa vicomté au roi qui la réunit à la couronne.[Note 1: Études sur le régime financier de la France, par Ad. Vuitry, p. 179.]
— Pierrefonds, dans le Valois, fut acquis en 1193 de Gaucher de Chàtillon, par échange de 80 livres de revenu annuel à prendre à .Clichy, et subsidiairement à Montreuil près Paris. Cette seigneurie relevait de l'évèque de Soissons et le roi lui remit le droit de gîte pour être dispensé de lui rendre hommage comme seigneur de Pierrefouds. [Note 2: Ibid., p. 202.]
— Louis IX réunit à la couronne le comté de Mâcon qu'il acquit du comte et de la comtesse de Mâcon pour le prix de 10,000 livres et une pension viagère de 10,000 livres à la comtesse. [Note 3: Ibid., p. 229.]
— Humbcrt II, dauphin du Viennois, vendit le Dauphiné à Philippe VI et désormais l'héritier présomptif de la couronne de Franco porta le titre de Dauphin (1349). [Note 4: Histoire de France, par Th. Bachelet, t. I, p. 394.]
— L'année précédente (1348), la seigneurie de Montpellier avait été achetée à don Jayrac d'Aragon pour 200,000 écus d'or.
[18] Ou distinguait deux sortes de guerre, et, par suite, deux sortes de service : la guerre générale ou de défense nationale à laquelle tous les guerriers, ahrimans et leudes. étaient appelés au moyen de l'heriban, et la guerre d'intérêt privé à laquelle chaque chef ne pouvait emmener que ses leudes. (Histoire de France, par Th. Bachelet, t. I, p. 133.
[19] Le seigneur n'avait de compte à rendre à personne sur la manière dont il traitait ses sujets; ils étaient gens de poésies (genies potestatis, gens sur qui on a pouvoir) « taillablcs et corvéables à merci ». (Histoire de France, par Th. Bachelet, t. I, p. 244.)
[20] En France, les fois comme les autres seigneurs vendirent, à prix d'argent, la liberté à leurs serfs.
« Philippe le Bel, dit M. Mignet, vendit la liberté aux serfs de la couronne. Il affranchit, en 1298, moyennant douze deniers tournois par sesterée de terre, les serfs du Languedoc; et ses deux fils, Louis le Hutin et Philippe le Long, imitant son exemple en 1316 et 1318, étendirent cette révolution aux serfs de la langue d'oil, ce qui, en moins d'un quart de siècle, donna la liberté personnelle aux paysans des immenses domaines de la couronne qui purent et voulurent l'acheter. (MIGNET. Essai sur la formation territoriale et politique de la France. Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, 2e sér., t. II, p. 596.)
[21] En France, la plupart des villes (le quelque importance avaient fini par se racheter de la domination du seigneur et elles constituaient des républiques indépendantes, sauf l'acquittement de la redevance qui avait été le prix de leur rachat. Mais, quand les rois curent remplacé les seigneurs, ils confisquèrent peu à peu cette indépendance que les cités avaient acquise de leurs deniers, et leur imposèrent une administration nommée par eux. Peut-être les villes auraient-elles pu défendre leurs libertés contre les usurpations de leurs seigneur», elles étaient trop faibles pour résister au roi, qui avait supplanté successivement les seigneurs, en s'emparant de leurs domaines politiques.
« En France, presque toutes les villes qui formaient des républiques lorsqu'elles étaient enclavées dans des souverainetés féodales avaient perdu de leur indépendance au moment où l'agrandissement de la couronne les avait enveloppées dans le territoire royal. Kilos avaient conservé des maires électifs au nord, et des consuls au midi, mais la souveraineté leur avait été enlevée eu ce qui touchait la justice et les armes. Elles avaient reçu dans leur sein des prévôts du roi, dont l'administration souveraine s'était établie à coté de l'administration locale de leurs officiers municipaux. Le bailli avait été chargé de nommer un capitaine général pour le bailliage et un. capitaine particulier pour chaque ville de sou ressort. C'est entre les mains de ce dernier que les armes des bourgeois devaient être déposées pour leur être données en cas de besoin. Jugées par les baillis, surveillées par les prévôts, commandées par les capitaines royaux, elles avaient été soumises depuis le commencement du xive siècle à de nouveaux impôts qu'elles avaient, il est vrai, accordés elles-mêmes par leurs députés dans les États généraux. Elles étaient ainsi rentrées dans l'État par l'administration de la justice, le service militaire, la contribution à l'impôt et par leur dépendance sur tous ces points des officiers royaux. Il n'y avait, à proprement parler, plus de républiques en France, comme il y en avait eu dans le xnc et le xiie siècle. » (MIGNET. Essai sur la formation territoriale et politique de la France, p. 632.)
[22] Telle était notamment l'opinion du cardinal de Richelieu: « Si les peuples étaient trop à l'aise, dit-il dans son testament politique (chap. iv, section 5), il ne serait pas possible de les contenir dans les règles de leur devoir. »
[25] Tel est encore théoriquement du moins, le droit public de la plupart des États monarchiques de l'Europe. « Les traités de Westphalie, dit M. Ott, ne connaissaient, dans les États monarchiques, d'autre souveraineté que celle des maisons royales et princières; le prince et l'État se confondaient et se prêtaient réciproquement la majesté; personne ne songeait au pacte social. Le congrès de Vienne de 1816 n'a pas suivi d'autres principes. »
A. Ott. Notes du droit des gens modernes de l'Europe de Kluber, p. 29. Édition Guillaumin.
[26] La Constitution belge, notamment, garantit la liberté des cultes, de, l'enseignement, de la presse et des associations, mais en passant sous silentv la liberté industrielle et commerciale.
Art. 14. — La liberté des cultes, celui de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf l.-i répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 17. — L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi.
L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi.
Art. 18. — La presse est libre, la censure ne pourra jamais être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs et imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 19. — Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Art. 20. — Les Belges ont le droit de s'associer, ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Est-il nécessaire de remarquer qu'en dépit de l'art. 14 qui garantit la liberté des cultes, il y a eu Belgique des cultes subventionnés, c'est-à-dire des cultes à l'entretien desquels les Belges ne sont pas libres de ne pas contribuer; — en dépit de l'art. 17, un enseignement d'État qui fait concurrence, aux frais des contribuables, à l'enseignement libre; enfin, en dépit de l'art. 20, une législation spéciale qui réglemente, par des mesures préventives, la liberté des sociétés civiles et commerciales. Mais, quoi de plus, facile à « interpréter » qu'une constitution?
La même constitution, citée cependant à bon droit comme une des plus libérales que l'on connaisse, a voulu assurer à jamais la possession du gouvernement à la classe moyenne, en établissant un maximum et un minimum de cens électoral.
Art. 47. — La Chambre des représentants se compose de députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de. 20 florins.
[27] Il est bon de remarquer toutefois que la « crise présidentielle » pourrait être évitée par un autre mode de nomination. Ajoutons encore que les listes civiles des rois ou des empereurs constitutionnels et les parts que s'attribuent dans les résultats de l'exploitation de l'État les souverains absolus, tels que le tsar et le sultan, sont eu disproportion manifeste avec les services rendus.
D'après une statistique publiée par The financial reform Almanack for 1884, le montant total des sommes payées annuellement aux familles souveraines ou gouvernantes des différents États monarchiques de l'Europe ne s'éleverait pas à moins de 341.602.000 francs.
[28] Dans les États européens, pour la plupart nouveaux venus au régime con. stitutionnel, sous la forme monarchique ou républicaine, le système de l'attribution des dépouilles ou du « butin » des places et des faveurs gouvernementales au parti vainqueur n'a pas reçu encore tout le développement qu'il comporte et qu'il est inévitablement destiné à recevoir. On n'est entré que graduellement dans ce système et en se défendant d'y entrer. Il en a été autrement aux États-Unis, où, il y a plus d'un demi-siècle, le général Jackson l'a proclamé comme un principe et fait entrer hardiment et ouvertement dans les mœurs politiques.
« L'avènement à la présidence du général Jackson (1829), dit M. Claudio Jannet, marqua la prédominance définitive du gouvernement populaire sur le gouvernement des classes dirigeantes, qu'avaient pratiqué les hommes de la guerre de l'Indépendance et les générations suivantes. Les employés fédéraux, en petit nombre, étaient généralement conservés dans leurs fonctions, tant qu'ils les remplissaient convenablement. Jackson, arrivant au pouvoir à la suite d'un effort considérable de parti, proclama la maxime qu'aux vainqueurs appartiennent les dépouilles, et il remplaça tous les employés en fonction par des hommes de son parti. A l'époque, cet abus de pouvoir causa une émotion considérable; mais les partis ont chacun pour leur compte retenu cette maxime, et depuis lors chaque renouvellement présidentiel est le signal d'un changement complet de tous les employés, à commencer par le secrétaire d'État, pour finir par le maître de poste de village et le collecteur des douanes.
Avant l'élection présidentielle, les politiciens qui mènent les conventions de parti font soigneusement leurs stipulations avec leur candidat pour la répartition des places. Le président, quand il recherche une réélection, a également par là un puissant moyen d'action; tous les employés fédéraux combattent pour lui avec ardeur et par tous les moyens, car la conservation de leurs positions dépend de son triomphe. On comprend aussi combien l'esprit de parti reçoit de force par la perspective d'un butin si considérable en cas de succès. » (claudio Jannet. Les États-Unis contemporains, chap. VII, § 2.)
« Quand un président est inauguré, dit encore un écrivain anglais, il réclame toutes les places du gouvernement comme les dépouilles des vaincus et les distribue à ses créatures.
« II commence par renvoyer et remplacer, non seulement le ministère, mais même tous les subordonnés, les envoyés près des cours étrangères, les consuls, les employés de la douane, jusqu'aux directeurs des postes dans les villages. Tous sont regardés, non plus comme des serviteurs de la chose publique, mais comme les favoris d'un pouvoir tombé. Le mémo principe qui a amené son élection dirige ses actes : ce n'est plus le pays qu'il faut servir, mais le parti. Tous ceux qui le composent ont compté sur ces places, leurs efforts ont été stimulés par cette perspective, il ne faut pas qu'ils soient désappointés. Cette habitude engendre naturellement deux séries d'hommes à places, ceux qui les possèdent et ceux qui viennent de les perdre. Nombre de ceux qui viennent d'être renvoyés et qui sont ainsi privés de leurs moyens d'existence deviennent des politiques de profession, et, enflammés de tout le zèle que leur position leur impose, ils apportent dans les questions politiques cet excès de passion qui a été souvent relevé par ceux qui ont visité les ÉtatsUnis. Les qualités réelles n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de la plus haute position de la république, on s'en inquiète encore moins pour les positions secondaires; aussi voit-on souvent des hommes occuper des places qu'ils sont absolument incapables de remplir. » [Note 1: James Spence. L'Union américaine. Institutions politiques de l'Union.]
« Le mal, dit à son tour M. Esra Seaman, consiste dans la nomination de gens incapables, impropres ou mauvais, parce qu'ils ont été membres du parti, et comme récompense des services de parti.
«... Avoir deux armées de politiciens, aspirant presque tous aux offices, ou au patronage public, aux contrats, aux agiotages, agissant sur l'esprit public de diverses manières, pendant des semaines et des mois avant une élection disputée, avec l'espoir et l'attente d'être récompensés de leurs services, si leur parti obtient le succès, doit nécessairement produire une influence corruptrice et amener beaucoup de mensonges et de déceptions, d'intrigues et de fraudes pour faire les élections. De là l'influence corruptrice de nommer aux offices des gens comme récompense des services de parti. Les hommes devraient être nommés pour leurs principes politiques, leurs affinités de parti et leur capacité, et non comme récompense de leurs services à un parti. Ils devraient être nommés pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont capables de faire pour le public, et non pour ce qu'ils ont fait pour un parti politique. Mais avec le système électoral actuel et l'organisation des partis, le mal ne peut pas être évité. Il est inhérent au système. » [Note 2: Esra. C. Seaman. Le Système du gouvernement américain. — Chap. II, l'Exercice du pouvoir de nomination et la récompense des services de parti.]
La conséquence logique de ce système, c'est que les places appartenant, en vertu du droit de conquête, au parti vainqueur, ceux auxquels il les distribue demeurent avant tout ses serviteurs, et n'ont à remplir envers le public que des obligations secondaires et subordonnées à leurs devoirs envers le parti. De là aussi le droit que s'attribue le parti de leur imposer une contribution destinée à le maintenir en possession de l'État, contribution qu'ils sont du reste intéressés à payer, car elle constitue une véritable prime d'assurance de leur place et des moyens d'existence qu'elle procure.
« La théorie des exploiteurs du parti, disait à ce propos et fort justement un journal américain, l'Evening Post, est que les places du service public appartiennent en toute propriété au parti régnant pour être employées essentiellement au profit de ce parti, à la condition qu'elles seront employées aussi subsidiairement à rendre certains services publics aussi utilement que la chose est compatible avec les intérêts du parti. C'est sur cette théorie que se fonde le droit d'exiger du fonctionnaire public qu'il restitue une partie du salaire qu'il reçoit, sous forme de contribution pour soutenir le parti de qui il tient sa place. Il est juste qu'il paye pour ainsi dire le loyer de son office. Il reconnaît par là le droit de propriété du parti et l'obligation de le servir. Le tribut qu'on se propose de lever cette année (1882) à raison de 2 p. 100, à supposer qu'on atteigne tous les appointements, ferait entrer environ 400,000 dollars dans le trésor du parti . »
Toutefois, comme nous venons de le dire, cette contribution ou ce tribut a moins le caractère d'un loyer que d'une prime d'assurance.
[29] En droit, remarquions-nous ailleurs (Lettres sur les États-Unis et le Canada), le gouvernement américain est, à tous ses degrés et dans toutes ses branches, la chose des dix millions d'électeurs américains, et jamais souverain plus absolu n'a régné sur les bords de l'Euphrate ou du Gange. En fait, le gouvernement des Etats-Unis, à tous ses degrés et dans toutes ses branches, appartient à une classe de deux à trois cent mille politiciens, divisés en deux camps irréconciliables, et qui trouvent, dans la politique et l'administration de l'Union, des États et des villes, leurs moyens d'existence. Ils font de la politique comme les manufacturiers font des étoffes de laine ou de coton, et comme les cordonniers font des souliers. Ce n'est point un mal, et je dirai même que cette division du travail a été aux Etats-Unis, comme ailleurs, un progrès nécessaire. Au temps où nous sommes, tous les citoyens ne peuvent pas plus s'adonner aux besognes de plus en plus difficiles et compliquées que comportent le gouvernement et l'administration, qu'ils ne peuvent fabriquer eux-mêmes leurs habits et leurs souliers. Mais que diraiton d'une manufacture de draps ou de souliers dont les consommateurs, réunis dans leurs comices, se chargeraient tous les ans, tous les deux ans ou tous les quatre ans, de renouveler le personnel? Il est vraisemblable que la fabrication de ces articles de première nécessité laisserait à désirer, et que les consommateurs courraient même le risque de payer de plus en plus cher des habits et des souliers de plus en plus mauvais. Tel est pourtant le régime politique des Etats-Unis, et je ne puis le considérer comme le dernier mot de la science politique et de la sagesse humaine.
« Les deux partis qui se disputent ici l'exploitation de la « manufacture » sont organisés comme l'était, au moyen âge, la milice féodale. Dans chaque district, dans chaque ville, dans chaque comté, dans chaque Etat, et finalemeat dans l'Union elle-même, il y a une série de comités qui se chargent de convoquer les réunions de cette milice politique toutes les fois que l'intérêt du parti l'exige. Lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle, le ban et l'arrière-ban sont mis en branle ; on nomme, dans toute l'étendue de l'Union, des délégués qui se réunissent en Convention nationale et désignent, à la majorité des suffrages, le candidat du parti. Le candidat désigné, on convoque des meetings, on organise des processions, on répand des journaux et des pamphlets; on ne recule, en un mot, devant aucune démarche et aucune dépense pour assurer son succès. Et, vraiment, la chose en vaut la peine! Le prix de ce concours politique, ce n'est ni plus ni moins que le budget. Le vainqueur s'empare invariablement, par droit de conquête, de toutes les fonctions rétribuées qui dépendent de l'administration. Il y a trente ans, on n'en comptait guère que trois mille; depuis la guerre de la Sécession et le développement énorme des services qu'elle a exigé, soit pour la recette, soit pour la dépense, le nombre en a été porté, assure-t-on, à quatre-vingt mille et même à cent mille.
« Sans doute, la masse électorale conserve le droit imprescriptible de disposer de ses votes comme bon lui semble; mais eu fait chacun, sous peine de perdre sa voix, est obligé de voter pour l'un des deux candidats désignés par la Convention nationale des politiciens républicains ou des politiciens démocrates. Sans doute encore, chacun a le droit de s'enrôler parmi les politiciens; ils ne forment pas une oligarchie fermée, mais c'est un métier que les hommes de loi et les faiseurs d'affaires peuvent seuls combiner, sans dommage, avec leurs occupations habituelles. C'est d'ailleurs un métier qui exige une certaine élasticité de conscience, et dont les profits sont trop aléatoires pour attirer les gens honorablement et solidement établis. Ceux-ci font volontiers profession de. mépriser les politiciens, et ils s'éloignent même de plus en plus de la politique active. Il en résulte que le pouvoir des politiciens va s'accroissant chaque jour, et que le contrôle des classes éclairées sur la direction des affaires devient, chaque jour aussi, moins attentif et moins efficace. »
[30] En France, les partisans de la monarchie constitutionnelle et de l'empire, interprétant de la manière la plus large l'art. 8 de la constitution du 25 février 1875, relatif à la révision des lois constitutionnelles, prétendent que l'Assemblée nationale chargée de procéder à cette révision aurait le droit de remplacer la République par la monarchie ou l'empire. Mais la généralité du parti républicain n'admet point cette interprétation de l'art. 8, et il est évident qu'un changement dans la forme du gouvernement ne pourrait s'accomplir, on France comme ailleurs, que par l'emploi de la force.
[31] Quoique la guerre soit un reste de la barbarie primitive, elle a cependant subi, dans une large mesure, l'influence de la civilisation. Ses coutumes se sont successivement adoucies, on pourrait dire humanisées. Dans les premiers âges du monde, le « droit de la guerre » était illimité. Quand deux peuples en venaient aux mains, la lutte avait pour terme ordinaire la destruction ou l'asservissement du plus faible. Les vaincus étaient massacrés, sans distinction d'âge ni de sexe, à moins que les vainqueurs ne trouvassent profit à les emmener en esclavage, pour s'en servir en guise de bêtes de somme. Vse victis, malheur aux vaincus 1 Telle était la maxime de l'antiquité, et cette maxime fut longtemps suivie dans toute son impitoyable rigueur.
On a fait un mérite au christianisme d'avoir adouci les coutumes de la guerre. Nous ne voudrions pas, certes, diminuer ce mérite. Nous sommes convaincus qu'en vulgarisant les notions d'une morale supérieure à celle de l'antiquité, en jetant l'anathèmc sur les appétits brutaux que le paganisme avait divinisés, et qui trouvaient dans la guerre un aliment approprié à leur nature, le christianisme a contribué, pour sa part, à préparer dans le monde le règne de la paix. Toutefois, c'est bien moins à l'influence du progrès religieux qu'à celle du progrès économique que l'humanité est redevable de l'adoucissement successif des coutumes de la guerre.
Le progrès économique a eu pour résultat de séparer de plus en plus, au sein de chaque nation, le personnel et le matériel de la guerre, du personnel et du matériel de la paix. A l'origine, aucune division du travail n'existe à cet égard. Les mêmes hommes qui cultivent la terre ou qui exercent n'importe quelle autre industrie paisible s'adonnent aussi à la guerre. Ils unissent ces occupations diverses, en s'attachant à les concilier autant que possible. C'est ainsi que la plupart des nations guerrières de l'antiquité ne commencent leurs expéditions militaires qu'après avoir labouré et ensemencé leurs terres, et qu'elles les terminent à l'époque de la moisson. Mais l'expérience leur apprend qu'en séparant ces occupations, en laissant les laboureurs à leurs charrues, les artisans à leurs métiers, les marchands à leurs comptoirs, et en entretenant des hommes spécialement voués au métier des armes, elles deviennent plus fortes à la fois dans les arts de la paix et dans ceux de la guerre. La production finit par avoir son personnel spécial comme la destruction a le sien. Le matériel de la guerre se sépare de même successivement du matériel de la paix. D'abord, toutes les villes, toutes les habitations mêmes sont fortifiées. Chaque propriété comme chaque homme sert, tour à tour, pour la paix et pour la guerre. Mais, peu à peu, la division du travail intervient, et l'on voit s'établir des villes ouvertes, où prédominent les arts de la paix, et des villes fortes qui sont comme les grands ateliers de la guerre. De nos jours, bien peu de villes sont eu même temps des foyers d'industrie et de commerce et des positions militaires. Pourquoi? Parce que l'expérience a démontré que l'industrie et le commerce sont entravés, gênés dans leur développement par un appareil de fortifications et qu'ils entravent, qu'ils gênent à leur tour les opérations militaires ; parce que l'expérience a démontré qu'une ville d'industrie ou de commerce ne peut être une bonne place de guerre et réciproquement.
Le domaine de la guerre s'est ainsi séparé, de plus en plus, de celui de la paix, et le progrès économique a exercé l'influence la plus bienfaisante sur les usages de la guerre.
Lorsque chaque nation a possédé une classe de plus en plus nombreuse, exclusivement vouée à des occupations paisibles, on s'est aperçu qu'il y avait profit, au simple point de vue du succès des opérations militaires, à respecter les personnes et les biens appartenant à cette classe, à la gêner le moins possible dans ses transactions habituelles. Sans doute la population vouée aux travaux de la paix prend toujours une part indirecte à la guerre puisque c'est dans son sein que l'on va puiser les hommes ou les capitaux nécessaires pour la soutenir. Il semblerait donc que l'ennemi dût avoir intérêt à la détruire ou tout au moins à la ruiner. Mais l'expérience atteste qu'il y a toujours plus de dommage que de profit à agir ainsi, car les populations que l'on veut détruire ou ruiner ne manquent pas (le résister; elles opposent à l'ennemi, non plus seulement la portion de forces et de ressources que leur gouvernement réclame d'elles pour soutenir la guerre, mais toutes les forces, toutes les ressources dont elles disposent; au lieu de contribuer d'une manière indirecte à la lutte, elles y prennent une part directe.
C'est donc dans l'intérêt même du succès de leurs opérations de guerre et non, comme on pourrait le croire, sous l'impulsion d'un sentiment philanthropique et humanitaire que les belligérants se sont accoutumés peu à peu à respecter les personnes et les propriétés des classes vouées aux paisibles travaux de la production. Les lois de la guerre qui ne sont autre chose que la conservation de pratiques dont l'expérience a démontré l'utilité se sont modifiées dans ce sens.
(Questions d'économie et de droit public. Les progrès réalisés dans les usages de la guerre. T. II, p. 277.)
A quoi il faut ajouter qu'à mesure que les nations sont devenues plus riches, elles ont pu mieux approvisionner leurs armées et les mettre ainsi en mesure de pourvoir régulièrement à leur subsistance. Ce progrès dans le système des approvisionnements a été particulièrement avantageux au point de vue militaire, en assurant aux armées la liberté de leurs mouvements. Nous verrons plus loin que le recul déterminé par la Révolution française dans lès usagés de la guerre a eu en grande partie pour cause l'insuffisance des ressources dont les gouvernements révolutionnaires disposaient pour faire subsister leurs armées; ce qui obligeait celles-ci à vivre sur le pays ennemi au moyen des réquisitions et du pillage.
[32] On trouve, dans les Économies royales de Sully l'exposé d'un plan attribué à Henri IV pour l'établissement d'une fédération destinée à maintenir la paix au sein du monde chrétien. Il s'agissait de partager l'Europe en quatre États à peu près d'égale étendue et d'égale force, d'instituer un tribunal européen pour juger leurs procès et de mettre au service de ce tribunal une force commune. Cette même force devait encore être employée à faire la guerre aux nations infidèles. Tel était le plan que Sully attribuait à Henri IV. L'honneur de l'avoir conçu appartient-il, en réalité, à ce monarque? Quelques historiens le nient. Nous citerons en particulier M. Bazin, l'auteur d'une Histoire de Louis XIII, qui attribue cette rêverie, comme il la nommait, au vieux ministre. Mais est-ce bien là une rêverie de vieillard? Et ne s'accordet-elle pas mieux avec le tempérament aventureux et chevaleresque de Henri IV qu'avec l'esprit plus froid et plus rassis de son ministre? Ajoutons encore que les Mémoires de Sully sont très explicites sur ce point, que le ministre et le confident de Henri IV affirme que des négociations ont été onpagées avec plusieurs souverains, notamment avec la reine Elisabeth, pour établir la fédération européenne.
Quoi qu'il en soit, l'idée d'établir une fédération, un' concert entre les principaux États, pour rendre la paix permanente, cette idée était née, et, eu attendant qu'elle portât ses fruits, elle devait engendrer dc nombreux projets. En 1623 paraît un livre intitulé le Nouveau Cynee, attribué à Ëmeric de Lacroix, et qui renferme un plan destiné :i assurer une paix perpétuelle entre les nations chrétiennes. Selon toute apparence, ce plan n'est autre que celui de Henri IV, dont Émcric de Lacroix a écrit ailleurs le panégyrique. Un peu plus tard, Leibniz rêve aussi l'établissement d'une fédération européenne, à laquelle il donne pour chefs, à la fois, le pape et l'empereur. A la même époque, les moralistes commencent à stigmatiser les horreurs de la guerre, et l'on trouve dans La Bruyère une page admirable sur la folie malfaisante des hommes qui s'entre-tueut eu bel ordre et en bonne discipline.
« Petits hommes hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui vous enfermez aux foires comme géants, et comme des pièces rares dont il faut acheter la vue, dès que vous allez jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautessc et de l'éminence, qui est tout ce que l'on pourrait accorder i'i ces montagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-dessous d'elles; espèce d'animaux glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne faites pas même comparaison avec l'éléphant et la baleine, approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite. \e dites-vous pas en commun proverbe, « des loups ravissants, des lions furieux, malicieux « comme un singe »? Et vous autres, qui êtes-vous? J'entends corner sans cesse à mes oreilles : « L'homme est un animal raisonnable; qui vous a passé cette définition? sont-ce les loups, les siuges et les lions; ou si vous vous l'êtes accordée à vous-mêmes? C'est déjà une chose plaisante, que vous donniez aux animaux, vos confrères, ce qu'il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu'il y a de meilleur : laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme ils s'oublieront, et comme vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue qui vont sagement leur petit train, et qui suivent sans varier l'instinct de leur nature; mais écoutez-moi un moment. Vous dites d'un tiercelet de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la perdrix : Voilà un bon oiseau; et d'un lévrier qui prend un lièvre corps à corps : C'est un bon lévrier ; je consens aussi que vous disiez d'un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l'atteint et qui le perce : Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, qui se mordent et se déchirent : Voilà de sots animaux, et vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l'on vous disait que tous les chats d'un grand pays se sont assemblés par milliers. dans une plaine, et qu'après avoir miaulé tout leur saoul ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe; que de cette mêlée il est demeuré de part et d'autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l'air à dix lieues de là par leur puanteur; ne diriezvous pas : Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais oui parler? Et si les loups en faisaient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si les uns ou les autres Tous disaient qu'ils aiment la gloire, conclueriez-vous de ce discours qu'ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce! Ou, après l'avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l'ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raisonnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement, car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la tète ! Au lieu que vous voilà munis d'instruments commodes, qui vous servent à vous faire réciproquement de larges plaies d'où peut couler votre sang jusqu'à la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre d'eu échapper. Mais comme vous devenez d'année à autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette manière de vous exterminer : vous avez de petits globes qui vous tuent tout d'un coup, s'ils peuvent seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine : vous en avez d'autres plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits, enfoncent les planchers , vont du grenier à la cave, en enlèvent les voûtes, et font sauter en l'air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche, l'enfant et la nourrice : et c'est là encore où gît la gloire. »
Au commencement du xviiie siècle, l'abbé de Saint-Pierre écrit son Projet de paix perpétuelle, dans lequel il reprend en sous-ceuvre le plan deHenri IV en l'accommodant aux circonstances du temps... La propagande de l'abbé de Saint-Pierre, en faveur de la cause de la paix, ne demeura pas stérile. On en retrouve la trace chez un grand nombre d'écrivains du XVIIIe siècle. M. Necker, par exemple, consacre l'avant-dernier chapitre de son ouvrage sur « l'administration des finances de la France » à des réflexions sur la guerre qui semblent inspirées par la lec'ure du Projet de paix perpétuelle. (L'ABBÉ De Saint-pjerre, Sa vie et ses oeuvres, chap. i et H.)
Citons enfin, comme un témoignage des tendances pacifiques des esprits, au moment où la Révolution vint raviver pour longtemps le fléau de la guerre, ces vues de Condorcet sur l'avenir de l'humanité:
« Les peuples plus éclairés, se ressaisissant du droit de disposer eux-mêmes de leur sang et de leurs richesses, apprendront peu à peu à regarder la guerre comme le fléau le plus funeste, comme le plus grand des crimes. Ou verra d'abord disparaître celles où les usurpateurs de la souveraineté des nations les entraînaient pour de prétendus droits héréditaires.
« Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur liberté; que des confédérations perpétuelles sont le seul moyen de tna.into.nir leur indépendance; qu'ils doivent chercher la sûreté et non la puissance. Peu à peu, les préjugés commerciaux se dissiperont; un faux intérêt mercantile perdra l'affreux pouvoir d'ensanglanter la terre et de ruiner les nations sous prétexte de les enrichir. Comme les peuples se rapprocheront enfin dans les principes de la politique et de la morale; comme chacun d'eux, pour son propre avantage, appellera les étrangers à un partage plus égal des biens qu'il doit à la nature ou à son industrie, toutes ces causes qui produisent, enveniment, perpétuent les haines nationales, s'évanouiront peu à peu, elles ne fourniront plus à la fureur belliqueuse, ni aliment ni prétexte.
« Des institutions, mieux combinées que ces projets de paix perpétuelle qui ont occupé le loisir et consolé l'âme de quelques philosophes accéléreront les progrès de cette fraternité des nations, et les guerres entre les peuples, comme les assassinats, seront au nombre de ces atrocités extraordinaires qui humilient et révoltent la nature, qui impriment un long opprobre sur le pays, sur le siècle dont les annales en ont été souillées. »
Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.
[33] « L'imperfection des formes de gouvernement a été et est encore très souvent une cause de guerre. Le despotisme qui permet à un seul homme, au souverain, de décider la jruerre doit rendre celle-ci bien plus fréquente. En effet, un souverain absolu n'a que peu à souffrir d'une guerre, même malheureuse. Ses revenus n'en sont point diminués ni son bien-être atteint. Vient-il à perdre une province, il n'y a que son orgueil qui en souffre. Au contraire, la guerre la plus heureuse impose toujours de cruelles souffrances même aux vainqueurs. Le commerce suspendu, l'industrie arrêtée, les impôts accrus, des morts, des blessés et des malades sans nombre, les familles décimées, des douleurs de toute sorte pour les âmes et pour les corps, voilà (les maux que les victoires les plus décisives ne préviennent point. Quant au pays vaincu et envahi, qui dira tout ce qui l'accable et le désole? Si les peuples étaient assez éclairés pour discerner leur véritable intérêt, il n'y aurait plus de guerre, car aucun d'eux, n'ayant d'avantage à attaquer ni à vaincre, aucun n'aurait à se défendre; mais une souverain peut trouver dans la guerre un plaisir et un profit... Dans une république, l'élection d'un président peut aussi pousser à la guerre. Ainsi, aux Etats-Unis, pendant la campagne électorale de 1872, on a vu les partis exciter tour à tour î'animosité de la foule contre l'Angleterre à propos des Alabama Claims et faire de cette passion surexcitée un détestable moyen de popularité. Le régime constitutionnel, avec un roi impuissant comme en Angleterre ou un président comme en Suisse, est une meilleure garantie de paix; mais pour que ce régime soit un obstacle à la guerre, il ne suffit pas qu'il y ait une Chambre élective qui délibère et décide. Il faut que cette Chambre soit composée d'hommes assez indépendants et assez raisonnables pour résister aux excitations du pouvoir exécutif. Or, c'est ce qu'on ne rencontre encore nulle part, sur notre continent au moins. Dans tous nos litats, le gouvernement, en provoquant les susceptibilités du patriotisme ou en faisant naître une situation qui compromet, dit-il, l'honneur du pays, obtiendra toujours un vote de guerre. On l'a bien vu en 1870. C'est même en vain qu'on inscrirait dans la Constitution que le droit de décider la guerre appartient exclusivement au Parlement. Si la raison publique n'est pas mûre et l'opinion publique agissante et toute-puissante, le Parlement votera la guerre quand le ministère le voudra... Je ne connais pas d'exemple d'une Chambre qui ait voté la paix, quand le gouvernement voulait la guerre. »
Emile De Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe, pp. 59-61.
[34] Cette periode de vingt ans au maximum est celle que recommandent les professeurs des sciences militaires.
« Si la guerre est une loi de l'humanite, lisons-nous dans le cours d'histoire militaire profossé en 1882 à l'Ecole supérieure de la guerre, loi de progrès moral et de progrès matériel, il importe que toutes les générations en sentent l'influence fortifiante et que la tradition s'en transmette des pères aux enfants. On est ainsi conduit à désirer qu'il y ait au moins une guerre par génération... L'intérêt de l'armée, d'accord avec celui de la nation, exige donc que la paix ne dure jamais plus de vingt ans de suite. Non seulement cette limite de vingt ans ne doit pas être dépassée, mais il est avantageux de ne pas l'atteindre. »
Mais quels motifs invoquer pour ne point dépasser cette période utile? C'est l'affaire du souverain et de ses ministres.
« ... Les souverains qui veulent en venir à une rupture s'inquiètent fort peu de la justice et du droit. Ils déclarent la guerre et laissent à un ministre éloquent le soin de la justifier. La guerre ne se justifie que par l'intérêt des peuples. Elle n'est ni juste ni injuste; elle est politique ou impolitique. »
(1er conférence, pp. 31-32.)
[35] « On a cherché à évaluer, disions-nous (Dictionnaire de l'Économie politique, art. Paix), les pertes que les guerres de la Révolution et de l'Empire ont causées à l'Europe. D'après les estimations les plus dignes de foi, la somme ne s'élèverait pas à moins de 26 milliards pour l'Angleterre seulement, en dépenses directes, et la perte totale eu hommes pour l'Europe serait de 2,100,000 individus. Les pertes en hommes ont été souvent évaluées beaucoup plus haut. Sir Francis d'Ivernois, par exemple, ne les porte pas à moins de 1,500,000 individus pour la France seulement, jusqu'en 1799. On trouvera dans son Tableau des pertes que la Révolution et les guerres ont causées au peuple français, les bases sur lesquelles il établit son évaluation. En même temps, cet écrivain remarque avec raison que les réquisitions et la conscription amenèrent à l'abattoir des champs de bataille des hommes qui avaient bien une autre valeur que ceux donl les recruteurs de l'ancien rcgime remplissaient les armées. « II ne faut pas perdre de vue, dit-il, que jusqu'ici, dans les guerres modernes, les hommes qui se vouaient à l'état de soldat étaient, pour la plupart, tirés de la classe la plus vagabonde, la plus paresseuse et la plus dissipée de la société, et déjà tellement appauvrie que le célibat lui est en quelque sorte imposé par sa pauvreté même. Mais la population guerrière que les Français ont sacrifiée depuis sept ans sur les champs de bataille a été tirée indistinctement de toutes les classes, sans égard pour ]a classe aisée qui avait .le plus de penchant vers l'état du mariage, et le plus de moyen pour subvenir aux frais et à l'éducation d'une nombreuse famille. Les aveugles réquisitions ont traîné de force aux armées cette classe précieuse qui y a péri par milliers, et le plus souvent dans les rangs des simples soldats. C'était à elle surtout à réparer les brèches que la guerre faisait à la population, et elle a été fauchée dans sa fleur, dans l'âge de force et de vigueur, entre 18 et 35 ans, ù l'époque de la vie la plus propre à la propagation. » Sans parler du vide que cette effroyable consommation d'hommes utiles a laissé dans les industries particulières, la race en a été tellement affaiblie que la proportion des réformes pour défaut de taille et infirmités s'est élevée en un demi-siècle, selon M. Putigny, de 29 1/2 à 54 pour 100. D'autres causes ont pu, sans doute, concourir à ce même résultat; mais n'est-il pas évident que les réquisitions et la conscription, en moissonnant pendant 2'i ans l'élite de la jeunesse, ont dû y contribuer pour une large part?
« ... On peut se faire une idée du nombre prodigieux de personnes plongées dans la misère par les guerres de Bonaparte, dit J.-B. Say (Traité d'économie politique) d'après le tableau des secours donnés par les bureaux de bienfaisance de Paris : de 1804 à 1810, le nombre des femmes secourues à Paris seulement s'est graduellement élevé de 21,000 à 38,000. En 1810, le nombre des enfants qui recevaient à Paris des secours de la charité publique n'était pas de moins de 53.000. »
Empruntons maintenant aux Recherches économiques, historiques et statistiques de M. Paul Leroy-Beaulieu sur les guerres contemporaines, ce résumé des pertes matérielles, directement causées par la guerre dans une courte période de 14 années (1853-1866).
« 1° Pertes d'hommes. Hommes tués sur les champs de bataille ou morts soit de leurs blessures, soit de maladies:
| Crimée | 784,991 |
| Italie | 45,000 |
| Sleswig-Holstein | 3,500 |
| Amérique Nord | 281,000 |
| Amérique Sud | 519,000 |
| Guerre de 1866 | 45,000 |
| Expéditions lointaines et guerres diverses: Mexique, Cochinchine, Maroc, Saint-Domingue, guerres de Paraguay, etc. | 65,000 |
| Total | 1,743,491 tués par les guerres |
« C'est un total do 1,750,000 hommes environ, enlevcs par les guerres aux peuples civilisés, de 1853 à 1866, c'est-à-dire dans l'espace de 14 ans; c'est un chiffre égal à celui de la population masculine de la Hollande; c'est encore un chiffre égal à celui des individus occupés eu France comme iMivriers par les professions industrielles et commerciales.
2° Pertes financières.
| Guerre de Crimée | 8 milliards 500 million |
| Guerre d'Amérique. Nord | 23 — 500 — |
| Guerre d'Amérique. Sud | 11 — 500 — |
| Guerre d'Italie | 1 — 500 — |
| Guerre de Holstein | 180 — |
| Guerre de 1866 | 1 — 650 — |
| Guerre lointaines | 1 — |
| Total | 47 milliards 830 millions. |
« Ce ne sont là que des dépenses immédiates et positives des guerres; encore ne sont-elles pas complètes; et cependant nous sommes parvenus au chiffre effroyable de 48 milliards. 48 milliards, mais c'est le montant de l'épargne francaise pendant plus d'un demi-siècle... Et cependant cette somme immense de 48 milliards qui, employée aux œuvres de la paix, eût transformé les conditions matérielles de la vie des peuples civilisés, le mauvais génie de la guerre l'a dévorée en quatorze années pour faire disparaître de la face du monde près de 1,800,000 hommes. » Paul Leroy-Beaulieu, les Guerres contemporaines, p. 180.
Enfin, nous trouvons, dans un rapport de M. de La Porte sur le règlement définitif du budget de 1871, les renseignements suivants sur ce qu'a coûté directement à la France la guerre de 1870:
« Du 1er août 1870 au 1" avril 1871, les pertes subies ont été : 3,864 déserteurs, 310,449 prisonniers, 4,756 réformés, 21,430 hommes tués à l'ennemi, 14.398 morts de suites de blessures, 223,410 causes diverses.
« La France a payé à l'Allemagne pour indemnité de guerre, entretien de ses troupes, frais d'escomptes, etc., 5,627,963,853 francs.
« En outre, le vainqueur a exigé de Paris, et d'autres villes françaises, 251 millions de contributions de guerre; enfin, autant qu'on peut évaluer en pareille matière, la lutte contre l'Allemagne et la paix désastreuse qui l'a suivie ont coûté à la France 12,667,000,000 francs de dépenses et dommages directs. »
Les dommages indirects causés par la crise de la guerre, remarquions-nous à ce propos (Journal des économistes, décembre 1883,i, l'interruption des communications, le chômage des ateliers auxquels la guerre enlevait la' portion la plus vigoureuse de leur personnel en France et en Allemagne, etc., ont certainement atteint un chiffre égal à celui des dommages directs. C'est (loue une somme de 25 milliards au moins qu'a coûtée aux deux nations, entraînées dans cette guerre néfaste, sans parler des dommages qu'elle a infligés par contre-coup aux neutres, la candidature du prince de Hohenzollern au trône d'Espagne et la querelle dont elle a été l'occasion ou le prétexte.
[36] « Cinquante millions d'hectolitres de blé détruits par l'eau ou le feu, 50,000 hommes enlevés par l'épidémie, établissait M.'Frédéric Passy eu 1865, ne seraient pas pour l'Europe une perte comparable à celle que lui inflige annuellement le régime de dépenses militaires et d'armements exagérés auxquels elle est soumise. »
« Le manque de bras pour les travaux agricoles est peut-être le résultat le plus frappant de ce régime. Mais il y a d'autres conséquences plus désastreuses encore : c'est le rachitisme, sinon même la décroissance numérique des populations. La nature nous a appris que le meilleur moyen d'améliorer une race, c'est de réserver pour la reproduction les individus les plus beaux et les plus forts. Pourquoi donc, employant le procédé contraire, nous étonnerions-nous d'aboutir à des résultats opposés? Aucune espèce, même la nôtre, no s'aurait s'accommoder d'une sélection à rebours qui condamne à un célibat de plusieurs années les éléments les plus capables de produire des générations saines et robustes. »
Goblet d'Alviella, Désarmer ou déchoir, p. 130.
[37] Voici, d'après le Financial Reform Almanac pour 1884, le relevé des charges que supporte actuellement l'Europe, principalement du chef des guerres passées et de la préparation des guerres futures.
| Poulation de l'Europe d'après le dernier recensement | 346,625,747 habitants. |
| Dettes nationales | 100 milliards 380 millions. |
| Dépense nationales | 15 milliard 464 millions |
| Intérêts des dettes nationales | 5 milliard 71 millions |
| Dépenses militaires et navales | 4 milliard 2 millions |
| Armées sur pied | 3,860,045 hommes |
| Total des forces militaires en y comprenant l'armée sur pied et les réserves | 12,454,867 |
| Navires de guerre cuirassées | 280 |
| Navires de guerre non cuirassées | 1,396 |
| Officiers et marins | 280,534 |
[38] Voir l'Évolution économique, ch. vii, p. 225.
[39] Parmi les étrangers qui ont pris du service dans l'armée française sous l'ancien régime et qui figurent sur la liste des maréchaux, on peut citer: Jacques Trivulzio, 1500-1518; Teodoro Trivulzio, neveu de Jacques, 1526-1531; Robert Steuart, 1515-1543; Robert III de la Marck, 1526-1537; Robert IV, 1347-1556; Pierre Strozzi, 1554-1558; Honorât de Savoie, 1572-1586; d'Ornano dit Corso, 1596-1610; Concino, marquis d'Ancre, 1614-1617; Turenne (comte de Sedan, le comté de Sedan ne fut réuni à la France qu'en 1641); Josias, comte de Rantzau, 1645-1650; Schulemberg, 1658-1671; marquis d'Asfeldt, 1734-1743; Cereste Brancas, 1743; d'Iscnghien, 1741; Maurice de Saxe, 17471755; Thomas Ch. O'Brien, vicomte de Clare, 17o7-1761; de Croy Solre, 1783-1788 ; Luckner, 1791-1793.
Dans les emplois civils, nous nous bornerons à citer, pour ne pas allonger cette note, les noms célèbres de Mazarin, Law et Necker.
D'après le dénombrement de 1772, l'armée française possédait sur un effectif de 210,000 hommes (pied de paix) 27,348 hommes d'infanterie étrangère sans compter la cavalerie.
| Infanterie suisse | 11 régiments | 12,232 hommes |
| Gardes suisses | 2,348 hommes | |
| Infanterie allemande | 8 régiments | 8,512 hommes |
| Infanterie irlandaise, itlienne, etdc. | 8 régiments | 4,256 hommes |
Le Père Daniel. Abrégé de l'histoire de la milice française.
[40] Voir notre Cours d'économie politique, t. I, 3e leçon : la Valeur et le prix.
[41] M. le docteur Armand Després, chirurgien à l'hôpital de la Charité de Paris, affirme que, avec leurs immeubles, biens-fonds et capitaux placés, les hôpitaux de France possèdent encore aujourd'hui plus de 2 milliards 1/2.
Cette fortune colossale, qui représente 123 millions de revenus, sert à soigner en moyenne 410,000 malades par année. De ce chiffre il convient de retrancher le budget des enfants et des vieillards assistés, qui s'élève actuellement à 40 millions environ. Restent 83 millions pour 410,000 malades, c'est-à-dire que chaque maladie traitée revient à plus de 200 francs. A ce compte, les 220,000 malades des Sociétés de secours mutuels dépenseraient 44 millions, tandis qu'ils en coûtent 16 (année 1879). Et encore cette somme comporte des indemnités payées aux malades pour un total de 5,246,000 fr. et des secours aux veuves et aux orphelins pour 525,000 fr., allocations que ne fait pas l'hôpital. De sorte que les 220,000 malades des Sociétés de secours mutuels coûtent réellement 10 millions en soins de médecin et de pharmacien, c'est-à-dire qu'à ce taux, les 85 millions de l'administration hospitalière pourraient, sans un centime de subvention, servir à soulager 1,870,000 malades au lieu des 410,000 qu'elle secourt.
[42] Comme la plupart des hommes politiques, même les plus libéraux M. Thiers n'avait qu'un goût médiocre pour la liberté de la presse. Quant à la liberté des associations, elle constituait à ses yeux un empiétement dangereux sur la souveraineté.
« Savez-vous bien, disait-il avec sa vivacité pittoresque, ce que c'est que d'accorder à une réunion d'hommes la faculté de s'associer politiquement, — et certes, ceux-là s'associent bien politiquement qui marchent à l'assaut de tout ce qui constitue les bases de la société, — c'est leur déléguer toute la puissance de la société; c'est leur accorder une portion de la souveraineté. Et je vais vous le démontrer eu quelques mots. Examinez ce que c'est que le gouvernement, en quoi consiste-t-il? Voyez le nombre de ceux qui le composent et voyez où est sa force? Cent mille fonctionnaires peut-être, quelque cent mille soldats. Que sont ces cinq cent mille individus en présence d'un peuple composé de plus de trente millions d'habitants?
« Ce n'est rien comme force numérique, comme force matérielle.
« Qu'est-ce qui fait donc la force du gouvernement? C'est son organisation, c'est le concert avec lequel il agit, c'est la faculté de donner des ordres et d'être obéi, c'est la puissance de réunir à Lyon, à un instant, dix mille soldats, un préfet, des généraux, de faire la même chose s'il le faut à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, taudis que, en même temps, le gouvernement agit à Paris avec le même ensemble, avec la même vigueur. Sa force est dans son organisation, dans son concert, dans cette vigueur d'ensemble, résultat de l'association. Et cette faculté, qui renferme toute la puissance sociale, vous la délégueriez à quelques individus sans mission, sans caractère, qui veulent renverser l'État?... C'est livrer la puissance sociale au premier venu qui voudra s'en emparer.
« Remarquez, Messieurs, quel a toujours été le travail des comploteurs, de tous ceux qui par des conspirations, ou publiques ou secrètes, ont voulu renverser l'État? Leur but a été d'arriver à cette organisation, à ce concert du gouvernement lui-même, de s'associer pour correspondre d'un bout de la France à l'autre, pour qu'au même signal, au même instant, le désordre éclatât à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris. C'est donc la force sociale, celle qu'ils ont mis tous leurs soins à usurper, que vous leur livreriez vousmêmes, de votre propre volonté. Eh! Messieurs, c'est la doctrine la plus antisociale, la plus subversive... »
Le malheur, c'est qu'en cette matière comme en bien d'autres, le pouvoir des gouvernements est limité. Ils peuvent interdire les associations publiques, mais les sociétés secrètes bravent leurs défenses, et elles sont bien autrement attrayantes et dangereuses, précisément parce qu'elles sont défendues.
[43] Il y aurait encore à reviser un bon nombre d'articles de cet actif. Eu même temps qu'elle abolissait les maîtrises et les jurandes, la révolution supprimait violemment les associations industrielles et commerciales, en interdisant aux industriels, aux artisans et aux ouvriers de se réunir pour délibérer sur « leurs prétendus intérêts communs ». La suppression des douanes intérieures avait été déjà en grande partie accomplie par Colbert.
Il ne restait, en dehors de l'union douanière à laquelle était appliqué le tarif protectionniste de Colbert, qu'un petit nombre de provinces et de ports, jouissant les unes d'un tarif libéral, les autres d'une liberté commerciale entière. La révolution unifia le régime douanier de la France, mais pour le rendre prohibitif.
« La révolution a été funeste à la liberté des transactions comme à bien d'autres libertés, car elle a sinon engendré, du moins renforcé et universalisé le régime prohibitif.
« Avant la révolution, l'école de Qucsnay et de Turgot, en France, celle d'Adam Smith, en Angleterre, avaient plaidé avec succès la cause de la liberté commerciale, et un traité, basé sur la nouvelle doctrine économique, avait été conclu, en 1786, entre la France et l'Angleterre. Mais la révolution survint, et aussitôt on vit succéder au traité libéral de 1786 des mesures prohibitives d'une rigueur jusqu'alors sans exemple. Dans un de ses décrets fiévreux, la Convention avait enjoint à ses armées de ne plus faire de prisonniers anglais; ce qui était revenir tout simplement aux coutumes de la barbarie primitive. Eh bien, ce système de destruction impitoyable, la Convention ne se borna pas à l'appliquer aux soldats de l'Angleterre, elle l'appliqua encore à ses marchandises. Les marchandises anglaises furent prohibées et, lorsqu'on parvenait à les saisir, on les brûlait sur les places publiques. Napoléon continua ce système barbare, il lui donna même des proportions colossales et il l'imposa à toutes les nations alliées à la France. Sous le régime du blocus continental, la plus grande partie du continent fut interdite aux marchandises anglaises, et les autodafés de ces denrées proscrites se multiplièrent sur les places publiques. Enfin, après la chute de l'Empire, l'industrie anglaise, qui avait été préservée des confiscations, des réquisitions, des assignats, du pillage et de l'incendie ; l'industrie anglaise était si supérieure à celle des contrées de l'Europe occidentale, où la révolution avait étendu ses ravages, que les gouvernements furent partout obligés, par les clameurs des propriétaires et des industriels, de maintenir le régime prohibitif, tel que la révolution l'avait inauguré. La Révolution française a retardé d'un siècle au moins l'avènement de la liberté commerciale et ce n'est point là un des moindres griefs qu'on puisse élever contre elle au nom de la civilisation. » [Note: Les Révolutions et le Despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels, p. 105. Bruxelles, 1852.]
Le remplacement des coutumes provinciales par un code uniforme n'a pas cessé d'être célébré comme un des bienfaits les plus notoires de la révolution; mais quand on examine de près les parties essentielles de cette compilation à laquelle Napoléon a donné son nom, malgré son ignorance absolue en matière de législation et l'absence si manifeste che/ le meurtrier du duc d'Enghien de la notion de la justice, on s'aperçoit qu'à bien des égards les anciennes coutumes, adaptées depuis des siècles aux populations qu'elles régissaient et successivement perfectionnées par voie expérimentale laissaient une part bien plus grande à la liberté individuelle et établissaient avec plus d'équité la responsabilité attachée à la liberté. Elles respectaient notamment davantage le droit de tester, supprimé d'abord par la révolution et réglementé ensuite étroitement par le code Napoléon.
« Par une loi du 7 mars 1793, la Convention avait complètement supprimé le droit de tester. Cette loi était ainsi conçue : « Disposition unique : La faculté de disposer de ses biens soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie; en conséquence, tous les desccndans auront un droit égal à partager les biens de leurs ascendans.
« Les auteurs du Code civil furent unanimes à reconnaître que cette loi avait porté une grave atteinte à l'autorité paternelle. Malheureusement, ils n'osèrent la réformer qu'à demi. » [Note: Les Soirées de la, rue Saint-Lazare. Entretien sur les lois économiques. Le Droit de tester. Paris, Guillaumin, nov, 1849.]
La recherche de la paternité qui partage équitablemcnt la responsabilité de l'élève et de l'entretien de l'enfant entre ceux qui lui ont donné le jour était autorisée par la législation de l'ancien régime. Le Code Napoléon l'a interdite en chargeant ainsi entièrement du soin d'élever et d'entretenir l'enfant celui de ses deux auteurs qui est le moins capable de supporter ce fardeau. La même rétrogression pourrait être signalée dans la plupart des autres articles du Code. N'est-il pas singulier qu'à une époque où il se public tant de livres inutiles ou nuisibles, aucun légiste ne se soit avisé de faire justice de ce prétendu monument de législation en comparant article par article l'ancienne législation avec la nouvelle? Au sujet du système des poids et mesures, inventé par des professeurs de mathématiques, au mépris de l'expérience et des besoins des échangistes et imposé par la Révolution, en même temps que son calendrier fantaisiste, voir notre Cours d'économie politique, t. II, 1re leçon, les Poids et mesures.
Enfin on ne manque jamais de placer en première ligne, parmi les bienfaits de la révolution, la division de la propriété et la multiplication des propriétaires. 11 semblerait que la petite propriété date de la révolution. C'est une pure légende à mettre à la réforme avec celle des volontaires de 92.
« On se persuade, dit M. A. de Galonne, que la division de la propriété est née (le la révolution. Rien n'est moins vrai, M. de Tocqueville prouve que, vingt ans auparavant, toutes les Sociétés d'agriculture déplorent le morcellement exagéré des terres. Young le mentionne parmi les nouveautés qui le frappent quand il visite notre pays, et nulle part il ne le trouve au même degré qu'en France.
« Déjà Forbonnais signale, vers 1750, beaucoup de nobles et d'anoblis « réduits à une pauvreté extrême avec des titres de propriété immense et vendant leurs biens au petit cultivateur à bas prix... souvent pour le montant de la taille », de manière que près d'un quart du sol passe entre les mains des travailleurs agricoles.
« Le nombre des petites propriétés rurales va toujours croissant. Necker déclare qu'il y en a une immensité. La plupart ont leur origine dans l'antique censive qui s'est peu à peu transformée entre les mains de ses possesseurs et qui, grevée jadis d'une rente fixe, en argent ou en nature, a fini par s'amoindrir au point de devenir dérisoire.
« Jetons les yeux sur les anciens plans. Ils sont autant et plus divisés que de nos jours, excepté aux environs des grands domaines monastiques. La loi de 1790, qui a établi l'impôt foncier, exigea de chaque paroisse un état des propriétés alors existantes. Beaucoup de ces états ont disparu; néanmoins ou en retrouve un certain nombre; en les comparant avec les rôles d'aujourd'hui, on constate que, dans les villages, le nombre des propriétaires fonciers s'élève à la moitié, souvent aux deux tiers du nombre des propriétaires actuels, ce qui paraîtra bien extraordinaire, étant donné que la population totale de la France s'est accrue de plus d'un quart depuis lors.
« Déjà l'amour des paysans pour la propriété foncière est extrême. « Les terres se vendent toujours au delà de leur valeur, dit Arthur Young, ce quitient à la passion qu'ont les paysans de devenir propriétaires Toutes les épargnes de la basse classe en France sont destinées à l'achat des terres. »
« Si la propriété se divise, le fermage en subit le contre-coup : tout ménager propriétaire de quelques arpents s'empresse d'augmenter son occupation aux dépens de la grande ou de la moyenne culture. Il n'est pas d'ouvrier laborieux qui ne rêve de louer « à n'importe quel prix, des terres qu'il n'a souvent ny l'aisance ny la force de bien tenir » (Archives de l'Aisne). Il en résulte que la main d'œuvre renchérit (Note 1: A. De Calonne, la Vie agricole sous t ancien régime en Picardie et en Artois : Propriétaires et fermiers.).
« Ce qui soutient les paysans, dit M. Albert Babeau, c'est qu'ils sont propriétaires pour la plupart; c'est qu'ils s'attachent à la terre qui leur appartient, et qu'ils cultivent avec plus de soin que celle qu'ils tiennent à loyer. Mais leur petite culture est souvent un obstacle à l'aisance qu'ils poursuivent; si elle suffit à leur alimentation annuelle, elle les laisse sans ressource lorsque la récolte fait défaut. Dès la fin du moyen âge, le morcellement de la propriété était extrême. En Bretagne, au xve siècle, la propriété était morcelée «n parcelles en quelque sorte infinitésimales. (Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France.) Guy Coquille disait : « Les partages sont la ruine des maisons de village. Dans la Brie, sous Henri IV, un seigneur veut se créer un parc d'une superficie de trente hectares; il sera obligé d'acheter deux cents parcelles de terre. Il faut lire, au xvm" siècle, ce qu'écrit Quesnay fils (Encyclopédie} sur l'excès du morcellement; il faut entendre Arthur Young déplorer le trop grand nombre des petites terres cultivées par leurs propriétaires et qui formaient le tiers du royaume. La petite propriété était, suivant lui, la source de maux effroyables, et le voyageur anglais n'hésitait pas à lui attribuer plutôt qu'aux institutions la détresse dont souffraient les campagnes. Il voyait dans la division excessive des terres une grande déperdition de force et de peine. « Un propriétaire qui n'a rien à faire ôtera une pierre d'un endroit pour la remettre dans un autre, disait-il, il fera dix milles à piedpour vendre un œuf. » La passion de l'égalité dans les partages avait multiplié la subdivision des héritages. Chaque enfant voulait avoir son lot dans chaque pièce de terre laissée par les parents, et les biens d'un cultivateur se composaient de dix, de cinquante ou de cent parcelles de terre, dont la plus grande .n'avait pas un arpent et dont les plus petites étaient insignifiantes. Un laboureur d'Isle-au-Mont dont l'héritage est évalué 3,020 1. en 1701, possède 60 pièces de terre; la maison et son verger valant 1,500 1.; le prix des pièces de terre varie entre 75 liv. et 4 liv. 10 sous. Ce n'est que par exception que l'on trouve dans le Nivernais et le Berry des familles conservant par indivis le domaine patrimonial; c'est seulement dans certaines régions du Midi que les coutumes ou l'usage attribuent à l'aîné des fils la majeure partie ou la totalité du domaine du paysan... Tous les modes de succession étaient admis en France par les différentes coutumes. Le droit d'aînesse s'appliquait aux familles rurales de certaines provinces. Dans les profondes vallées des Alpes et des Pyrénées, où les anciennes traditions se conservaient intactes, on comptait un grand nombre de familles de toutes classes dont l'existence remontait à quatre ou cinq siècles. Dans le Béarn, pays remarquable par son aisance et où les terres étaient très divisées l'aîné héritait de tous les biens, et quand la révolution supprima le droit d'aînesse, les puînés refusèrent le plus souvent de se prévaloir des avantages que leur assuraient les nouvelles lois. (Général Servier, Description des Basses-Pyrénées.) L'attribution du do. maine paternel à l'aîné ou au plus méritant des fils avait l'incontestable avantage de garantir la continuité de la propriété et par conséquent de l'aisance dans la famille; la liberté de rester renforçait l'autorité paternelle; mais dans les pays où la coutume et les mœurs favorisaient les partages égaux, les familles plus instables, mais stimulées par la nécessité, pouvaient se ramifier en branches plus prospères que la souche dont elles étaient sorties La tendance générale, qui s'affirmera davantage à l'époque de la révolution, est en faveur de la propriété individuelle et subdivisée. Elle va même jusqu'à provoquer le partage des biens communaux, sorte de réservoir permanent, où la petite propriété puise des forces sans que la grande en souffre.
« Ces transformations économiques influent sur le sort des paysans. Un des résultats de l'excès des partages fut de réduire à tel point les biens de quelques petits propriétaires qu'ils se virent forcés de reprendre le métier de serviteurs à gages ou de colons qu'avaient exercé leurs pères. Il en fut ainsi dans le Berry, où un certain nombre de paysans avaient dû vendre jusqu'à leurs maisons. Cependant, les salaires qui leur furent donnés s'élevèrent en proportion de la diminution de la valeur de l'argent, surtout au xvi° siècle et à la fin du xvme... La rareté des travailleurs, sur certains points, faisait accroître leurs gages en même temps que leurs exigences : « Ils veulent gagner en un jour, disait-on dans le Berry, de quoi vivre sans rien faire durant plusieurs jours. Les cultivateurs, ajoutait-on, sont les esclaves de leurs valets et ils reçoivent comme un bienfait le peu de travail qu'ils en obtiennent.» Cependant, les gages de ces hommes qui deviennent de plus en plus mauvais, renchérissent d'année en année. On remarquait aussi qu'à mesure que le salaire s'élevait, la quantité du travail journalier diminuait. François 1e' était resté populaire, sous le nom de roi au grand nez, parmi les vignerons de la même province, parce qu'il avait réduit le nombre de leurs heures de travail. Il n'avait pas été besoin d'ordonnances royales pour en diminuer le nombre ailleurs, et l'on demandait plutôt des règlements pour assurer la régularité du travail que pour en réprimer l'excès.
« Si la rareté et les exigences des ouvriers agricoles attestaient une amélioration dans leur condition, elles rendaient pour les propriétaires et leurs fermiers l'exploitation des terres plus difficile. Les terres n'étaient pas seulement pour les bourgeois un placement sûr; elles pouvaient leur conférer un titre honorifique. Cependant, à la fin du xvn» siècle, les biens-fonds étaient dépréciés et l'on appelait « terres à gendre » certaines métairies que l'on donnait en dôt pour une valeur supérieure à jla réalité. Depuis la banque de Law, les rentes constituées ou viagères, les tontines, les contrats particuliers vinrent aussi détourner des campagnes l'argent qui les aurait vivifiées. Mais tandis que le noble et le bourgeois se montraient moins disposés à acquérir des terres, le paysan s'efforçait d'en acheter quelques parcelles, et comme il vendait souvent son blé à un prix rémunérateur, on le voyait petit à petit augmenter son domaine en même temps que son aisance.
Les crises trop nombreuses que l'agriculture eut à subir, particulièrement à la fin du règne de Louis XIV, n'empêchèrent point des progrès réels de s'accomplir dans les campagnes. C'est ainsi que le Médoc, solitaire et sauvage au xvi' siècle, s'était assaini, défriché, cultivé dans les deux siècles suivants; il s'était couvert de vignes et peuplé de vignerons. C'est ainsi que Voltaire dira en parlant de la France entière : « On a planté plus de vignes et on les a mieux cultivées; on a t'ait de nouveaux vins qu'on ne connaissait pas auparavant, tels que ceux de Champagne; cette augmentation des vins a produit celle des eaux-de-vie: la culture des jardins, des légumes, des fruits, a recu de prodigieux accroissements. Les plaintes qu'on a de tout temps fait éclater sur la misère des campagnes ont cessé d'être fondées. » Et Voltaire ajoute: « Il n'y a guère de royaume dans l'univers, où le cultivateur, le fermier soit plus à l'aise que dans quelques provinces de France, et l'Angleterre seule peut lui disputer cet avantage. » Il écrit ailleurs : « Comment peut-on dire que les plus belles provinces de France sont incultes? Il suffit d'avoir des yeux pour être persuadé du contraire. « Ces provinces, le marquis de Mirabeau les énumère : ce sont « celles du Nord, la vallée de la Loire près de Tours, la vallée de la Garonrie près d'Agen, les environs d'Orléans, de Lyon et de Marseille, qui présentent l'image de la prospérité et de la fécondité ». Dans ces contrées, les maisons particulières ne sont presque séparées que par leurs vignes et leurs vergers, et le manouvrier revenant de journée bêche son champ au clair de lune. La petite propriété a souvent produit des effets excellents. La culture maraîchère des environs de Paris est admirable. Les régions moins fertiles ne sont pas tout à fait déshéritées. En Bretagne, si la majeure partie de la province est mal cultivée, il y a des cantons qui le sont avec beaucoup d'intelligence et de succès. En tous cas, la France que Shakspeare appelait le « meilleur jardin du monde », la France est loin de présenter au xvine siècle l'aspect inculte que lui attribuent certains publicistes contemporains.
II est des époques où l'on aime à se plaindre comme il en est d'autres où il paraît naturel de se vanter. A la veille de la révolution, il semble qu'on se soit plu à exagérer ses maux afin de mieux les guérir. Les progrès réels qu'on avait obtenus faisaient supposer qu'on pouvait en réaliser de plus grands... Mais ces plaintes qui avaient l'inconvénient de peindre sous des couleurs trop sombres une situation qui laissait à coup sûr à désirer, ces plaintes avaient l'avantage de stimuler le zèle et les améliorations. A partir de 1760, les améliorations s'accentuèrent sous l'impulsion des administrations, des Sociétés d'agriculture et de l'esprit public. Des provinces entières se transforment, comme le Languedoc. L'intendant d'Étigny, dit-on, y a vivifié l'agriculture. En dix ans, les paysans y auraient décuplé, avec leur population, la quantité et le prix de leurs denrées. De 1762 à 1789, la valeur des propriétés y a doublé... Le docteur Rigby, qui traversa la France de Calais à Antibcs, en juillet 1789, ne tarit pas sur la culture et la fécondité des contrées qu'il parcourt. Il eu exprime à plusieurs reprises son étounement. Ce n'est pas seulement la Flandre qui le comble de surprise par la beauté de ses froments bien supérieurs à ceux que produit l'Angleterre ; c'est la Picardie, c'est l'Ile-de-France. « La culture de ce pays, dit-il en Picardie, est réellement incroyable, et nous n'avons pas vu un pouce de terre qui ne fût pas cultivée et fertile. Et quand il sera en Bourgogne, il dira : « Nous avons maintenant voyagé pendant 5 ou 600 milles en France et nous avons vu à peine un arpent inculte, si ce n'est dans les forêts de Chantilly et de Fontainebleau. Partout ailleurs, à peu près chaque pouce de terrain a été labouré ou bêché, et semble en ce moment écrasé sous le poids de ses moissons. » En allant de Dijon à Lyon, l'enthousiasme du Dr Rigby augmente. Les collines sont couvertes de vignes jusqu'au sommet, tandis que des maisons, des villages et des villes sans nombre apparaissent à leurs pieds. « Quel pays! s'écrie notre Anglais. Quel sol fertile! Quel peuple industrieux! Quel charmant climat! » II descend la vallée du Rhône, et il est frappé de voir que l'on cultive jusqu'aux fissures des rochers où le temps a déposé un peu de terre végétale ; il fait la même remarque aux environs de Toulon... Le docteur anglais parle aussi de l'étonnante population de la France. Cette population avait en etfet singulièrement progressé depuis la diminution sans précédents qu'elle avait subie au commencement du siècle et qui avait frappé les villes plus encore que les campagnes. Mais à partir du ministère de Fleury, la progression avait repris; elle s'était accentuée surtout après 1768. A défaut de recensements généraux, les relevés faits par les États de Bourgogne et de Languedoc attestent l'augmentation incessante des naissances et des mariages. L'augmentation des naissances était souvent compensée par la mortalité des enfants en bas âge; mais des effets salutaires n'étaient pas moins signalés de toutes parts. La liberté du commerce des grains y contribua. Un curé de Bourgogne publia à ce sujet des chiffres qui ont lieu de surprendre: de 1764 à 1770, le nombre des naissances avait quintuplé dans sa paroisse; le prix des bestiaux doublé et les friches réduites des neuf dixièmes. Vers la même époque, on dit sur différents points : « La population est infinie dans les campagnes. — II est vrai qu'il y a une multitude d'enfants. — La population qui s'est accrue d'une manière étonnante laisse à peine à nos champs le temps nécessaire pour se reposer. » Si le service militaire enlevait quelqucs campagnards à leurs champs, si beaucoup d'entre eux allaient se placer comme domestiques au château et à la ville, les paysans restaient eu très grande majorité dans le village où ils étaient nés, s'efforcant d'améliorer leur situation par leur travail et leur industrie.
« Les anciennes institutions ne se sont pas opposées à ces efforts légitimes et n'ont jamais interdit au paysan de chercher à s'élever au-dessus de la condition de son père. Les derniers mainmortables que l'on ait vus en France pouvaient s'instruire, quitter la profession de leurs ancêtres et devenir médecins ou prêtres... Dans certaines régions, les anciennes familles de cultivateurs avaient leurs traditions et tenaient à garder leur rang... Laborieuses et économes, elles finissaient parfois par acquérir les fermes que, pendant de longues années, elles avaient tenues à loyer. On a pu suivre, en Normandie, pour l'une de ces familles, la progression de l'aisance depuis le xvi" siècle. A chaque génération, le trousseau et la dot des enfants augmentent. En 1688, un des chefs de la famille louait 78 ares de terre moyennant 630 livres; un de ses descendants, à la veille de la révolution, étaitposscsscur de 259 acres et se refusait à en augmenter le nombre, quelques années plus tard, en achetant à vil prix des domaines nationaux. [Note: Albert Babeau, la Vie rurale dans l'ancienne France, chap. vi.]
« ... En guenilles, pieds nus, ne mangeant que du pain noir, dit à son tour M. Taine, [Note : Les Origines de la France contemporaine, 1.1er, l'Ancien Régime.] mais couvant dans son coin le petit trésor sur lequel il fondait tant d'espérances, il guettait l'occasion et l'occasion ne manquait pas. « Malgré tous ses privilèges, écrit un gentilhomme en 1755, la noblesse se ruine et s'anéantit tous les jours, le Tiers État s'empare des fortunes. » Nombre de domaines passent ainsi, par vente forcée ou volontaire, entre les mains des financiers, des gens de plume, des négociants, des gros bourgeois. Mais il est sûr qu'avant de subir la déposscssion totale, le seigneur obéré s'est résigné aux aliénations partielles... Déjà vers 1750, Forbonnais note que beaucoup de nobles et d'anoblis, « réduits à une pauvreté extrême avec des titres de propriété immense », ont vendu au petit cultivateur à bas prix, souvent pour le montant de la taille... En 1772, à propos du vingtième qui se perçoit sur le revenu net des immeubles, l'intendant de Caen, ayant fait le relevé des cotes, estime que sur cent cinquante mille « il y en a peut-être cinquante mille dont l'objet n'excède pas cinq sous, et peut-être encore autant qui n'excèdent pas vingt sous ». ...Arthur Young, en 1789, s'étonne de la prodigieuse multitude des petites propriétés rurales et « penche à croire qu'elles forment le tiers du royaume ». Ce serait déjà notre chiffre actuel, et l'on trouve encore, à peu de chose près, le chiffre actuel, si l'on cherche le nombre des propriétaires comparé au nombre des habitants... La vente des biens nationaux (COCHUT, Revue des Deux Mondes, septembre 1848, cité par M. Taine) ne paraît pas avoir augmenté sensiblement le nombre des petites propriétés ni diminué sensiblement le nombre des grandes; ce gue la révolution a développé, c'est la propriété moyenne. Eu 1848, on compte 183,000 grandes propriétés (23,000 familles payant 500 fr. de contributions et au-dessus et possédant 260 hectares en moyenne, 160,000 familles payant de 250 à 500 fr. de contributions et possédant 75 hectares eu moyenne). Ces 183,000 familles possèdent 18 millions d'hectares. — En outre, 700,000 propriétés moyennes (payant de 50 à 250 francs d'impôt), et comprenant 15 millions d'hectares. — Enfin, 3900000 petites, comprenant 15 millions d'hectares (900000 payant de 25 à 50 fr. d'impôt, moyenne 5 hectares 1/2; 3 millions payant moins de 25 fr., moyenne 3 hectares 1/9) ».
Comme le remarque avec raison M. Cochut, ce que la révolution a développé c'est la propriété moyenne, et cela s'explique aisément. Malgré l'avilissement du prix des propriétés de la noblesse et du clergé, que la révolution mettait, en masse, sur le marché, il fallait cependant encore des capitaux pour les acheter. Or les capitaux étaient principalement entre les mains de la classe moyenne. Dans la tourmente révolutionnaire, les paysans et les autres gens du peuple gardaient le peu d'argent qu'ils possédaient, et ne s'avisaient point de s'en dessaisir pour acheter des propriétés, qui pouvaient d'ailleurs être revendiquées plus tard. Les biens nationaux passèrent, pou? la plus grande part, entre les mains des usuriers de village, des intendants et des hommes d'affaires plus ou moins aventureux et véreux, qui formèrent le gros des associés des bandes noires et ils s'ajoutèrent au domaine de la classe moyenne, dont le personnel d'enrichis s'accrut ainsi « révolutionnairement » en nombre, sinon en qualité. Sans doute, plus tard, quand les paysans purent recommencer à faire des économies, ils rachetèrent à haut pris les terres morcelées par les bandes noires, mais les bénéfices de l'opération restèrent entre les mains de ceux qui avaient payé en assignats les terres" confisquées et qui les revendaient contre de l'or.
Ou peut affirmer, en dernière analyse, avec M. Taine, que la part de la petite propriété, c'est-à-dire des terres possédées par ceux qui les cultivent, est demeurée à peu près ce qu'elle était avant la révolution; il n'y a de changement sensible que dans la distribution de la propriété des terres cultivées par des fermiers. Une portion considérable de ces terres a passé des mains de la noblesse et des corporations religieuses entre celles des acquéreurs de biens nationaux, mais elle a continué à être affermée. Les fermiers et autres tenanciers ont-ils gagné à échanger leurs anciens propriétaires contre les nouveaux, fraîchement enrichis et fort au courant de la valeur de» terres et de l'argent? Il est permis d'en douter.
Est-il besoin d'ajouter que si la valeur des terres s'est accrue et si les cultures se sont améliorées depuis quatre-vingts ans, la révolution n'y a été pour rien? Ces progrès datent d'avant la révolution; elle les a interrompus et retardés au lieu de les accélérer. Les progrès de l'agriculture n'ont-ils pas été d'ailleurs dans cette période bien autrement rapides et considérables en Angleterre qu'en France?
[44] « La réforme des impôts de l'ancien régime a été une simple mascarade. D'abord, les anciens impôts ont été abolis, en effet; mais comme le gouvernement révolutionnaire ne s'était point avisé de réduire les dépenses publiques, il fallut bien combler le vide causé par l'abolition des anciens impôts. Ce vide, on essaya de le remplir au moyen du papier-monnaie, des confiscations et des réquisitions; mais ces ressources révolutionnaires eurent une fin et, un beau jour, le trésor public se trouva complètement à sec. Alors, que fit-on? On rétablit purement et simplement les impôts que la révolution avait abolis. Seulement on eut soin de leur donner d'autres noms, afin de ne pas trop effaroucher les contribuables. Ainsi la taille et les vingtièmes prirent le nom de contribution foncière; la taxe des maîtrises et jurandes, le droit du marc d'or que l'on payait pour être admis à faire le commerce ou à exercer une profession industrielle, furent remplacés par les patentes; le droit de contrôle fut désormais connu sous le nom de droit du timbre; les aides se nommèrent contributions indirectes, droits réunis; la gabelle, si odieuse, recut la dénomination anodine d'impôt du sel; les octrois furent d'abord abolis, mais on ne tarda pas à les rétablir sous la philanthropique désignation A'octrois de bienfaisance; les corvées demeurèrent supprimées, niais les paysans furent assujettis aux prestations en nature. Bref, tout le vieux système d'impôts reparut; on prit seulement la peine de le débaptiser. »
Les Révolutions et le Despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels. Bruxelles, 1852.
Un des principaux griefs contre l'ancien régime consistait dans l'inégalité des charges publiques et en particulier dans l'exemption de la taille dont jouissaient les terres nobles. La taille produisait 91 millions à la veille de la révolution et on évaluait à un sixième de ce produit, soit à 15 millions, l'exemption accordée à la noblesse. Ce privilège a été supprimé; mais la contribution foncière qui a remplacé la taille a été à peu près triplée. « Le total de la taxe foncière sur les propriétés rurales et les constructions atteint la somme de 341 millions, dit M. Paul Leroy-Beaulieu (Traité de la science des finances); mais comme sur les 168 millions et demi de francs produits par les centimes additionnels, il y a environ 48 millions et demi qui représentent la part de la propriété bâtie, il en résulte que l'impôt foncier véritable, celui qui frappe les propriétés agricoles, ne monte qu'à 242 millions et demi de francs dont 122 millions et demi eu principal et 120 millions en centimes additionnels. »
On se plaignait encore des vices de la perception des impôts directs, mais Turgot y avait déjà remédié dans son intendance de Limoges et les améliorations qu'il avait introduites dans cette perception n'auraient pas tardé à se généraliser. En revanche, la mise eu régie des impôts indirects a entraîné pour les contribuables une aggravation considérable de vexations et de charges, et l'on sait à quel point les droits réunis étaient devenus odieux sous le premier Empire.
[45] Sous les deux premières races, les armées étaient composées de corvéables, les terres étant concédées avec obligation du service militaire. Les seigneurs, et plus tard les communes, fournissaient à la requête du roi et selon ses besoins leurs contingents de milices. Sous Clovis, les armées étaient exclusivement composées de Franks; sous Clotaire, les Gaulois y furent admis:
« Clotaire, lisons-nous dans l'Histoire de la milice française, du P. Daniel, ordonna que chaque province, sans distinction de Français, de Gaulois, de Bourguignons, fournirait, dans les occasions de guerre, un certain nombre de troupes et les troupes prirent le nom des provinces qui les fournissaient: voilà pourquoi les historiens, en parlant de guerre, disent les troupes du Berri, Biturici, les troupes du Maine, Cœnomanici, etc. Bien plus, nous voyons, par Grégoire de Tours, que dès lors des seigneurs gaulois commandaient des armées françaises.
« A l'égard de la manière dont les troupes se levaient, il parait que les seigneurs, tant français que gaulois, étaient obligés de fournir leur contingent de troupes dans les expéditions militaires : car lors du partage des terres entre les Français après la conquête des Gaules, quoiqu'ils reçussent les terres franches de toutes charges, ils s'obligeaient néanmoins au service pour le roi en temps de guerre, et, quand ces terres passaient à des gens d'église, c'était toujours à la même condition. De là vint qu'un évèque, dont l'église avait été mise en possession d'une terre de cette nature, ne pouvant pas par lui-même s'acquitter du service militaire, il mettait une personne en sa place pour aller à la guerre et y représenter le seigneur. C'est là une des origines de la qualité de vidame, en latin vice-dominus.
« ...On appelait banus la proclamation par laquelle on ordonnait de lever des troupes. De là vinrent les noms de ban et d'arrière-ban, qui signifient les troupes mêmes de la noblesse qu'on assemble dans les nécessités pressantes de l'État.
« ...Chaque province fournissait la milice de vivres, dans le pays, pour trois mois et d'armes et d'habits pour six; mais les trois mois étant passés, c'était au roi à la fournir de vivres pour les trois derniers mois du service.
« ...On voit, par l'ordonnance de Philippe le Hardi (1271), que les barons, les chevaliers et même les baronnets, les écuyers, etc., recevaient, au moins pour la plupart, une solde du roi. C'était un changement introduit dans la police militaire; car il est certain que quand Clovis se saisit de la plus grande partie des Gaules, il ne soudoyait point ses troupes : toute leur solde était le butin qu'elles faisaient dans leurs courses et dans leurs conquêtes et surtout les prisonniers qu'elles amenaient et qui, devenant leurs serfs, leur produisaient un grand profit. Il n'est point fait mention de solde dans l'histoire de la première race; et les capitulaires faits pour la guerre sous la seconde semblent supposer partout le même usage. Telle était la coutume de toutes les nations venues de Germanie pour s'établir dans les Gaules et telle fut celle du peuple romain pendant 350 ans (Tite-Live, Hist., 1. IV, ch. Lix); ce ne fut qu'après la paix d'Anxur, appelée depuis Terracine, que la république établit la solde d'abord pour les piétons, et trois ans après pour les cavaliers. »
A la suite de leur affranchissement, les communes furent obligées, comme les seigneuries, à fournir leur contingent de milices. Mais ces milices n'étaient obligées de marcher à leurs frais que jusqu'à une certaine distauce4 si on les menait plus loin, le roi était obligé de pourvoir à leur entretien.
« Outre les troupes de gentilshommes fieffés et celles des communes, dit le P. Daniel, il y avait d'autres troupes soudoyées qui ne servaient que pour la solde; on les appelait soldats ou soudoyés. On croit que Philippe-Auguste fut le premier qui forma un corps de cette espèce pour être moins dépendant de ses vassaux et avoir dans le besoin des troupes extraordinaires. Il suivit en cela l'exemple de Henri II, roi d'Angleterre, qui, voyant ses enfants et la plupart de ses sujets révoltés contre lui, leva une armée qu'il forma d'aventuriers ou bandits, qui couraient par bandes les provinces et les ravageaient. Ces troupes étaient méléas de diverses nations. Les historiens les appellent tantôt cottereaux, coterelli, parce qu'ils se servaient de grands couteaux, tantôt routiers ou les compagnies ruptarii, parce qu'ils ruinaient tout, d'où est venu le proverbe vieux routier; tantôt brabançons, parce que les plus redoutables étaient du Brabant.
«... Le corps des Brabançons était considérable et le roi donnait à leur chef une paie très forte.
«... Outre ces compagnies, nos rois prirent à leur solde d'autres troupes, mais plus disciplinées que les précédentes. C'étaient des compagnies de gendarmes de cent hommes chacune, commandés par des gentilshommes, ayant la qualité de capitaines d'hommes d'armes. Dès le temps de Philippe le Long, on voit les plus grands seigneurs à la tête, les uns de cent hommes d'armes, les autres de soixante, les autres de cinquante pour lesquels ils recevaient une solde particulière du roi. On les appelait compagnies d'ordonnance parce qu'elles avaient été créées par ordonnance du prince, et encore pour les distinguer de celles qui étaient amenées au service par les gentilshommes fieffés. »
Les enrôlés volontaires remplaçaient ainsi peu à peu les corvéables. D'abord on ne fit point d'enrôlements hors du royaume.
« Nos premiers rois de la troisième race ne se servaient point de troupes étrangères : 1° parce qu'il eût fallu les soudoyer et qu'ils ne pouvaient subvenir à une dépense aussi considérable; 2° parce qu'ils ne pensaient pas alors à faire des conquêtes hors de la France, mais seulement à affermir leur trône. Philippe le Bel fut le premier de nos rois qui traita avec les étrangers pour avoir de leurs troupes à son service, comme avec Albert d'Autriche, avec Humbert, dauphin de Vienne, et aux conditions d'une forte pension qu'il leur faisait. Mais ce fut principalement sous Philippe de Valois que les étrangers commencèrent à servir dans les armées de France en grand nombre tant sur terre que sur mer.
«... A la bataille de Crécy, en 1346, Philippe de Valois avait à son service quinze mille arbalétriers génois. Les Espagnols lui fournissaient pareillement des vaisseaux et des troupes. Louis XI traita avec les Suisses et en prit six mille à son service. Dans les guerres civiles sous Charles IX et Henri III, on vit grand nombre d'Allemands servir dans les armées des deux partis, sous le nom de retires qui étaient de la cavalerie et de lansquenets qui etaient de l'infanterie. Enfin, sous les derniers règnes, nous avons eu toutes sortes de nations dans nos armées. »
Jusqu'au règne de Louis XI, les armées demeurèrent cependant en majorité composées de corvéables. Tout en augmentant le nombre des compagnies d'ordonnance composées d'enrôlés volontaires, Charles VII obligea en 1848 chaque paroisse à lui fournir un fantassin pour aller en campagne avec l'arc et les flèches; il affranchit de tous subsides ceux qui étaient choisis; de là leur nom de francs archers. On leur donnait une solde de 4 francs par mois. Cette milice subsista jusqu'à Louis XI, qui supprima la corvée militaire et que cette mesure libérale rendit populaire. Ce roi bon économe, noua pourrions dire économiste, ne se contenta pas d'enrôler des nationaux pour remplacer les corvéables; il alla chercher des soldats de préférence dans les pays où ils étaient les meilleurs et au meilleur marché; il enrôla notamment des Suisses et des Écossais. Charles VIII y ajouta de l'infanterie allemande. Louis XII prit des stradiots à son service; on appelait cette troupe recrutée en Grèce : cavalerie albanaise.
A partir de Louis XI jusqu'à Louis XIV, l'armée française se composa presque exclusivement d'enrôlés volontaires recrutés pour les deux tiers environ en France, et pour un tiers à l'étranger, principalement en Suisse, en Allemagne, en Ecosse et en Irlande. Le recrutement s'opérait par des intermédiaires auxquels il était alloué une prime.
« Les hommes de recrue, lisons-nous dans l'Histoire du p. Daniel, doivent être enrôlés sans séduction, violences ni supercheries, à S pieds 2 pouces depuis 17 ans jusqu'à 40 en paix, et à 5 pieds 1 pouce en guerre depuis 18 ans jusqu'à 48. Le terme des engagements est de 8 ans, au bout desquels le soldat doit avoir son congé quand même il serait parvenu aux hautes payes. Les engagements doivent être faits sur des imprimés que l'enrôlé doit signer et, s'il ne sait pas écrire, il y met ses marques en présence de deux témoins qui signent l'engagement, au bas duquel sera le signalement et renseignements sur la profession de l'homme enrôlé et l'argent qu'il aura reçu. Si ces noms et renseignements vérifiés se trouvent faux, l'enrôlé est condamné aux galères. Comme l'engagement ne peut être annulé que par l'intendant qui en rend compte au ministre, l'accommodement fait par le préposé à l'effet d'enrôler est réputé nul et le préposé est puni. Un père de famille qui se repentira de s'être engagé, peut présenter à ses frais un homme en sa place.
« Le prix de l'engagement est de 30 livres, dont un tiers est donné sur-lechamp, un tiers au quartier du régiment de recrue et le reste lors de l'arrivée au régiment pour lequel l'enrôlé est destiné. Ces paiements ne peuvent être différés ni anticipés sous aucun prétexte : le pourboire est de 5 livres pour les hommes de 5 pieds 1 pouce, de 10 livres pour ceux de S pieds 2 pouces, 15 livres pour 5 pieds 3 pouces, 20 pour 5 pieds 4 pouces, et 25 pour ceux au delà. La gratification des préposés est de 3 livres pour chacun des cinq et six premiers hommes, 4 livres pour chacun des sept et huit, 5 livres pour chacun des neuf et dix, 6 livres pour chacun des dix et onze et ainsi en proportion, mais ils sont chargés des frais de voyage et autres menus frais et responsables des avances faites aux hommes qui ne se rendraient point au quartier du régiment de recrue ou qui seraient réformés pour cause d'incommodité.
« On donne aux nouveaux enrôlés deux chemises de toile, un col noir, une paire de souliers, une paire de guêtres noires, des culottes, une veste, un chapeau, un habit, un havresac, un fusil, une bayonnette, une giberne et nn ceinturon.
« L'ordonnance de Louis XIV, du 9 février 1692, et celle de Louis XV, du 2 juillet 1716, défendent expressément à tous capitaines et autres officiers de ne faire aucun enrôlement de cavaliers, dragons et soldats qui ne soient volontaires, et s'il arrive qu'un capitaine ou autre officier ait fait prendre ou enlever dans leurs maisons et sur des chemins, à la campagne ou ailleurs, des gens pour les faire entrer contre leur gré dans sa compagnie, il sera mis en prison par ordre des gouverneurs ou commandants dans les provinces jusqu'à ce que S. M., informée des circonstances de la violence, puisse lui imposer le châtiment qu'il aura mérité. »
Malheureusement, sous Louis XIV, la pénurie des finances et la nécessité d'augmenter dans une proportion extraordinaire l'effectif militaire, déterminèrent le roi à revenir au système moins onéreux et plus expéditif de la corvée. La puissance royale s'était tellement accrue depuis Richelieu, que ce lourd et cruel impôt pût être rétabli sans soulever de résistances sérieuses. A la vérité, Louis XIV se contenta d'abord d'une levée de 25,000 hommes et il alloua aux miliciens en sus de la solde fixée à S s. 6 d. des avantages particuliers. Le contingent de chaque province était réparti entre les paroisses. On procédait par voie de tirage au sort entre les garçons et au besoin les hommes mariés de 16 à 40 ans. La durée du service était de 5 ans, la moitié du contingent était congédiée après 3 ans. les hommes mariés étaient compris dans cette moitié. Voici, au surplus, quelques détails sur la solde et les avantages faits à cette milice, d'après les ordonnances royales:
« Lorsque lesdits bataillons de milice seront assemblés, il sera payé 2 liv. 10 s. par jour au capitaine de chaque compagnie, 13 s. 4 d. à chaque lieutenant, 10 s. à chacun des onze sergens, 1 s. 6 d. à chacun des trois caporaux, 5 s. 6 d. à chacun des trois anspessades, 5 s. 6 d. à chacun des quarante-huit fusiliers, et 7 s. 6 d. au tambour.
« II doit être fourni par les paroisses, lorsque S. M. fera assembler lesdites milices pour marcher sur les frontières, à chaque milicien un bon chapeau, une veste et une camisole d'une étoffe ordinaire du pays, une paire de souliers, une paire de guêtres, deux chemises de toile et un havresac. En outre, 8 [livres en argent dont 3 livres seront délivrées au milicien et les 5 livres restantes appliquées aux commissaires employés à la levée, lesquelles fournitures seront renouvelées en cas de besoin d'année en année.
« Quant à l'armement et au surplus de l'habillement, S. M. leur fait fournir un j ustaucorps de bon drap doublé de serge, une culotte, une cartouche, un fourniment avec son porte-fourniment, un ceinturon de buffle piqué avec son porte-bayonnette et porte-épée, une épée et un fusil.
« ...Tout milicien qui aura servi pour sa paroisse le temps de quatre années ne pourra être imposé à la taille personnelle ou industrielle que deux ans après l'expiration de son service, pour son bien propre et pour ceux qui lui viendront du chef de sa femme, s'il se marie dans le cours desdits deux ans: et dans le cas où ledit milicien prendra, pendant ledit temps, des fermes ou exploitations étrangères, il sera, pour raison d'icelles, taxé d'office modérément par l'intendant de la province. Veut S. M. que le milicien qui se trouvera marié, lorsqu'il marchera pour sa paroisse, soit diminué de 10 livres sur sa cote personnelle, pour chacune de ses années de service. En outre, que les pères desdits miliciens soient exempts de collecte, pendant que leurs enfans serviront à ladite milice, que pendant ledit temps, leurs cotes de taille ne puissent être augmentées par les collecteurs. »
Rétablie seulement à titre de nécessité temporaire, la corvée militaire devait se perpétuer en s'alourdissant graduellement. Cependant, les soldats de milice n'entrèrent pas pour plus d'un cinquième environ dans la composition de l'armée française jusqu'à la révolution. En 1762, sur un pied de guerre de 430,731 hommes, on comptait 105 bataillons de milice avec un effectif de 77,040 hommes; en 1772, sur un pied de paix de 219,165 hommes, les milices figuraient pour 43,888 hommes seulement.
La révolution allait généraliser le servage militaire, aboli trois ou quatre siècles auparavant et auquel l'ancien régime n'était revenu que timidement et partiellement depuis Louis XIV. Cependant, les cahiers du tiers état étaient unanimes pour réclamer la suppression de cette pire variété de la corvée.
« A la fin de l'ancien régime, la milice est attaquée de toutes parts ; quelques écrivains militaires y voient une dépense inutile; les soldats des troupes réglées,une concurrence maladroite; l'économiste, un fléau pour la richesse publique; le philosophe, une atteinte à la liberté humaine; le peuple, un impôt écrasant et une iniquité.
« Parmi les adversaires du service obligatoire, il faut compter en premier lieu presque tous les économistes. Écrivant au marquis de Monteynard, ministre de la guerre, Turgot, alors intendant de Limoges, considère la doctrine du service militaire dû par tous comme une formule de rhétorique... Condorcet déclare « inapplicable aux nations modernes la maxime des « anciens peuples qui appelait tous les citoyens à la défense de la patrie »; pour lui, l'enrôlement forcé est un système barbare et routinier, condamné à disparaître. Le soldat qui sert par force n'est jamais qu'un mauvais soldat: cette maxime d'alors rallie de nombreux adhérents. Une phrase de Condorcet résume les arguments émis en faveur de l'enrôlement volontaire: « Cette méthode d'avoir des soldats est en même temps la plus juste, la plus noble, la plus économique, la plus sûre, la plus propre à former de bonnes troupes... »
Au moment où les États généraux s'ouvrirent, la milice était à peu près universellement condamnée. Elle tomba avec l'ancien régime; abolie de fait depuis la nuit du 4 août, elle fut officiellement supprimée le 4 août 1791.
« Durant le cours de la discussion (séances des 12, 15, 16 décembre 1789), Dubois de Crancé, au nom de la minorité du comité militaire, et le baron Menou se prononcèrent pour le service obligatoire et l'établissement d'une conscription. Le duc de Liancourt, le vicomte de Mirabeau, Bureaux de Pusy, soutinrent l'enrôlement volontaire; le comité militaire, par l'organe de son rapporteur, le marquis de Bouthillier, s'était déjà déclaré favorable à ce dernier système... Image de l'opinion, la grande majorité de l'Assemblée constituante était hostile au service forcé. Les discours prononcés dans cette assembléc sont des indices curieux de la répugnance qu'excitait alors chez les esprits libéraux l'idée de ce service. « 11 vaudrait cent fois mieux, s'écriait le duc de Liancourt, vivre à Constantinople ou au Maroc que dans un pays où de pareilles lois seraient en vigueur. » La discussion fut close par le vote suivant, en date du 16 décembre 1789 : « Les troupes françaises, de quelque arme qu'elles soient, autres que les milices et gardes nationales, seront recrutées par enrôlement volontaire. «
« L'imminence d'une guerre avec l'Autriche fit décider, le 28 janvier 1791, la levée d'une armée auxiliaire de 100,000 hommes recrutés par enrôlement volontaire. Les forces militaires devaient se trouver composées ainsi qu'il suit : armée active, 150,000 hommes; armée auxiliaire, 100,000 hommes; garde nationale, formée de tous les citoyens actifs de 18 ans à 50. » [Note: Jacques Gibelin, Histoire des milices provinciales.]
Cependant le système de la corvée militaire, aboli avec tant d'enthousiasme, ne devait pas tarder à reparaître, et l'Assemblée nationale, dont les décisions ne brillaient point d'ailleurs du côté de la logique, le rendit à peu près inévitable, en prohibant le recrutement des soldats étrangers. En 1791, on s'était contenté de faire appel aux volontaires de la garde nationale; en 1792, on les exigea, et bientôt après, en 1793, on recourut simplement au système des réquisitions, qui demeura en vigueur jusqu'en 1798. Alors une loi du 19 fructidor an VI donna une organisation régulière à l'enrôlement obligatoire, en établissant la conscription.
On pourra s'étonner que la corvée militaire, si impopulaire en 1789, ait pu être rétablie et généralisée en 1793; mais il ne faut pas oublier que la centralisation donnait à la Convention une puissance d'autant plus irrésistible qu'elle avait pour instrument la guillotine. Non seulement les réfractaires étaient punis de mort, mais cette pénalité terrible et sommaire était infligée aux « complices de l'étranger » accusés « de détourner « les jeunes gens du service militaire. Plus tard, la peine de mort fut remplacée par des condamnations solidaires infligées aux conscrits et à leurs parents. Dans les Notices sur l'intérieur de la France, écrites en 1806 par M. Faber, on trouve une esquisse curieuse et émouvante des mesures qui étaient prises pour assurer l'acquittement de la corvée militaire.
« La France, dit M. Faber, ressemble à une grande maison de détention où l'un surveille l'autre et où l'un évite l'autre. On ne peut ajler à une portée de fusil de son endroit sans être toisé et questionné. Partout, des gardiens, des surveillans, des espions; on doit toujours être muni de nombre de certificats et papiers. Souvent on voit un jeune homme qui a les gendarmes à ses trousses; souvent, quand on y regarde de près, le jeune homme a les pouces liés; quelquefois il porte les menottes. Les mesures de surveillance augmentent à mesure qu'on approche des frontières; il y a là sextuple, peut-être décuple rang de gardiens. La ligne des douanes y fait la visite des fronts et des physionomies comme celle des poches.
« Vous êtes en voyage. Tout à coup vous ne pouvez passer outre. Une foule nombreuse obstrue la grande route. Fracas de chaînes. Voix plaintives. Escorte à cheval. Sabres nus. Des hommes à figure pâle et défaite, tête rasée, à costume hideux, traînant des chaînes et des boulets, forment une effrayante procession sur le grand chemin. De quel crime atroce, grand Dieu! sont-ils coupables ces malheureux, pour présenter un tel aspect d'abjection et de misère?... Ce sont des conscrits réfractaires et déserteurs qui, rassemblés en dépôts dans un département, sont transportés à une forteresse de l'intérieur.
« II existe plusieurs lois, décrets, arrêtés, qui statuent des punitions pour les déserteurs et réfractaires, lorsqu'on les prend. Pendant que, provisoirement, leurs parents ou répondants sont condamnés à l'amende, qu'on saisit et vend chez eux tout ce qu'ils possèdent, pour faire face à la somme prescrite et aux dépens de la procédure, les jeunes gens pris doivent satisfaire de leur personne à la vindicte de la loi. Aussitôt arrêtés, ils sont conduits sous bonne et sûre escorte aux prisons de la commune la plus voisine. Ils y souffrent faim et misère, parce que la commune qui doit les faire subsister n'a pas de quoi satisfaire à leurs besoins. La commune doit fournir un habillement hideux pour ses formes et sa couleur, semblable à celui des galériens, de bure ou de gros drap gris brun, veste pantalon et bonnet. Un jour de parade, le conscrit arrêté est conduit devant la troupe qui peut se trouver dans l'endroit, mise sous les armes. Lecture lui est donnée de la loi et de son jugement; il est déclaré indigne de servir. Il est dépouillé de ses vêtements; on lui tond ras la tête; on l'affuble du costume mi-pénitent, migalérien; il reçoit des sabots pour chaussure et une chaîne terminée par un poids lourd que le condamné traîne après lui est rivée à sa jambe. C'est dans ce costume et réunis en convois que les conscrits condamnés sont conduits à travers la France, vers les forteresses où ils doivent être employés aux travaux publics. »
L'horreur et l'effroi de la conscription étaient devenus tels qu'ils agissaient d'une manière préventive sur le développement de la population. Dans un rapport d'une facture originale, le préfet du Gers constatait le fait, en l'attribuant aux secousses révolutionnaires.
« Au milieu de tant de larmes, de tant de secousses révolutionnaires, écrivait ce digne administrateur, chacun redoute sa propre fécondité, chacun craint de se marier s'il était célibataire, ou de se reproduire s'il était époux. Les femmes, à cet égard, se sont montrées d'accord avec les hommes. Ainsi, ou l'on a suspendu les jouissances de la vie, ou l'on s'est appliqué à les rendre infructueuses et les mœurs en ont rougi. »
La Restauration abolit en 1814 cet impôt odieux, mais, cédant aux influences militaires, elle le rétablit en 1818. Les classes moyennes et supérieures en ressentaient à peine le poids, grâce à la faculté du remplacement, et, d'un autre côté, leurs enfants en passant par les écoles militaires trouvaient dans l'armée un débouché avantageux et d'autant plus large que le nombre des corvéables était plus grand. On en est arrivé ainsi au service général et obligatoire, rendu supportable pour les mêmes classes par l'institution du privilège du volontariat d'un an.
Quoique les pénalités qui assurent l'acquittement de la corvée militaire aient été adoucies, elles dépassent cependant encore en rigueur celles qui garantissent le recouvrement des autres impôts.
Code de justice militaire, art. 230. Est considéré comme insoumis et puni d'un emprisonnement de six jours à un an, tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplacant qui, hors les cas de force majeure, n'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route.
En temps de guerre, la peine est d'un mois à deux ans d'emprisonnement.
Art. 231. Est considéré comme déserteur à l'intérieur: 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation; néanmoins, si le soldat n'a pas six mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence;
2° Tout sous-officier, caporal, brigadier |ou soldat voyageant isolément d'un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps de garde ne s'y est pas présenté.
Art. 232. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de deux à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou d'un territoire en état de guerre ou de siège. C'est ainsi, pour nous servir de l'euphémisme officiel, que le gouvernement est parvenu à faire entrer la conscription dans nos moeurs. Néanmoins on s'efforce, aujourd'hui comme autrefois, d'y échapper en simulant des infirmités ou même par des mutilations volontaires. Le cas le plus curieux est celui de ce soldat du 7e régiment d'artillerie,le nommé Chevrier, condamné à mort en décembre 1883 par le conseil de guerre de Châlons-sur-Marne pour avoir tenté d'assassiner son père. Les débats ont établi que Chovrier n'avait eu qu'un but : devenir fils aîné de veuve pour être exempté du service militaire.
Le rétablissement et la généralisation du servage militaire permirent à la France révolutionnaire de mettre sur pied des armées énormes. Il en résulta ,un changement qui n'avait rien de progressif dans la tactique et les habitudes de la guerre. Auparavant, lorsqu'on ne pouvait se procurer des soldats qu'au moyen des enrôlements libres, on ménageait leur vie et l'on calculait ce qu'une bataille pouvait coûter d'hommes. Lorsque la conscription eut permis de puiser à même dans le grand réservoir de forces et de vie de la nation, on ne calcula plus, on prodigua la vie du soldat qui ne coûtait plus rien. Bonaparte dut une grande partie de ses succès à ce qu'il n'hcsitait jamais devant aucune « dépense d'hommes » pour enlever une position ou obtenir tout autre avantage. Aussi le général Moreau avait-il coutume de le nommer un vainqueur à raison de dix mille hommes par heure.
« Ce nouveau système, dit l'auteur du Tableau des pertes que la Révolution a causées à la France, sir Francis d'Ivernois, ce nouveau système entraînait un grand sacrifice d'hommes; mais les généraux français sentaient que la vie était la denrée dont la République était le plus prodigue, et que, tandis que la France, dans son enceinte, offrait à la mort un aussi abondant festin, il ne fallait pas se montrer avare envers elle sur le champ de bataille.
« Ces mêmes motifs firent introduire dans la tactique une innovation qui contribua beaucoup à multiplier les pertes. Les armées ennemies, déconcertées par la gi ande supériorité numérique des Français, et privées de renseignements par l'infatigable activité des troupes légères de ces derniers, se décidèrent souvent pour la défensive : prenant une position avantageuse et fortifiée, elles attendaient que cette fougueuse jeunesse française vînt se jeter par milliers sous leurs batteries. C'était alors que les généraux français attaquaient en colonnes successives, faisant marcher les brigades les unes après les autres, sans égard pour le nombre d'homme tués. Les assiégés, se voyant forcés sur un point quelconque, par l'impossibilité de repousser sur tous une attaque aussi soutenue et aussi désespérée, regardaient la bataille comme perdue et finissaient par céder un terrain dont les assaillants achetaient la possession par d'immenses sacrifices.
« C'est de cette manière que les généraux français employaient des colonnes entières de conscrits, appelés chair à canon, avant que les infirmités eussent diminué leur activité, ou que l'expérience leur eût appris les dangers d'une profession à laquelle ils se livraient avec l'imprudente vivacité de l'enfance.» I1 convient de remarquer toutefois que les armées de corvéables de la République et de l'Empire ne demeurèrent victorieuses qu'autant qu'elles eurent affaire à d'autres armées de corvéables. Tandis qu'une armée française, recrutée au moyen d'enrôlements volontaires, à l'intérieur et à l'étranger, avait battu les Anglais à Fontenoy, les meilleures armées du premier Empire eurent constamment le dessous dans leurs rencontres avec l'armée anglaise, constituée par le recrutement libre.
[46] Cette comparaison des appointements et do la solde de l'infanterie française en temps de paix et en temps de guerre, sans parler de la différence entre les chances d'avancement, suffirait au besoin pour expliquer la préférence que le corps des officiers, recruté principalement parmi la noblesse, donnait à la guerre sur la paix.
| En paix. | En guerre. | |
| Captaine de grenadiers | 2,000 l. | 3,000 l. |
| Captaine de fusiliers | 1,500 l. | 2,400 l. |
| Lieutenant de grenadiers | 900 l. | 1,200 l. |
| Lieutenant de fusiliers | 600 l. | 1,000 l. |
| Sous-lieutenant de grenadiers | 600 l. | 900 l. |
| Sous-lieutenant de fusiliers | 540 l. | 800 l. |
| Par jour | ||
| s.d. | s.d. | |
| Sergent | 11 4 | 11 8 |
| Fourrier | 9 0 | 9 4 |
| Caporal | 7 8 | 8 0 |
| Appointé | 6 8 | 7 0 |
| Fusilier de tambour | 5 8 | 6 0 |
(Histoire de la milice française, par le P. Daniel.)
[47] « La noblesse militaire, dit un écrivain qui aie premier étudié la révolution en économiste, sans se laisser influencer par les théories et les passions politiques, M. Raudot, la noblesse militaire était exposée pendant la paix à une vie d'oisiveté et de dissipation. Ne participant en aucune manière, comme corps"politique, au gouvernement de l'État, ni mémo à son administration, excepté dans les pays d'État, elle ne conservait pas son influence sur les esprits par ses actions et son utilité, elle ne se mêlait pas aux populations pour faire taire, par ses services journaliers, leurs préventions et leurs jalousies. La noblesse avait des prétentions et point de puissance. Presque dans toute la France, elle n'avait point d'assemblées et de délibérations, de vie politique; chacun était dans la faiblesse de l'isolement. L'attrait d'un vain éclat et du plaisir remplacait les idées d'indépendance et d'ambition politique. La noblesse abandonnait ses terres pour la cour et les plaisirs des villes, et perdait ainsi son influence sur les populations et souvent sa fortune. N'étant pas obligée de s'occuper du peuple pour parvenir à de hautes positions, elle ne trouvait pas dans la nécessité de l'élection de ses concitoyens un stimulant énergique, une occasion d'augmenter ses connaissances, sa considération, son influence; elle n'avait pas la vigueur des pensées, l'activité, l'intelligence des hommes et des affaires indispensables aux classes appelées à diriger une nation; la noblesse n'était pas gouvernementale. A la tète de la nation par les lois, elle ne conservait pas réellement sa supériorité. Les nobles étaient de plus en plus des officiers sans soldats. La bourgeoisie se demandait déjà à quoi servait une noblesse tombée dans la frivolité et la débauche, et pouvait croire qu'elle-même saurait aussi bien et même beaucoup mieux conduire les destinées de la nation.
« Un autre vice de l'organisation de la noblesse et de ses idées dominantes, c'est qu'elle n'avait et ne voulait avoir nul moyen de s'assimiler complètement les grands talents qui pouvaient surgir dans les autres classes de la société, de les absorber ainsi pour son plus grand avantage. Ces grands talents n'avaient pas eux-mêmes l'occasion légitime de se développer entièrement; ils restaient en dehors des plus hautes classes dont ils auraient pu augmenter la force et que souvent, au contraire, par dépit et par orgueil, ils travaillaient à détruire .» [Note: Raudot, la France avant la Révolution, p. 117.]
Voir encore, sur les causes de la décadence de la noblesse et l'impatience croissante avec laquelle les autres classes supportaient sa suprématie et ses privilèges, Tocquevlle, l'Ancien Régime et la Révolution, t. II, chap. Ier: Pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux en France que partout ailleurs.
[48] Le préjugé nobiliaire interdisait aux nobles pauvres les emplois de l'industrie et du commerce. Ce fut seulement au xvmc siècle qu'une réaction commença à s'opérer contre ce prcjuge, — lequel était à l'origine, comme la plupart des préjugés, une opinion fondée sur les nécessités de l'état de choses existant, mais qui avait subsisté après que cet état de choses eut changé. Un écrivain qui jouissait alors de quelque notoriété, l'abbé Coyer, écrivit un ouvrage intitulé la Noblesse commerçante, dans lequel il engageait les nobles à recourir aux utiles et fructueuses occupations de l'industrie et du commerce pour refaire leurs patrimoines que l'abus du luxe avait considérablement ébréchés. L'ouvrage de M. Coyer fut bien accueilli par la jeune noblesse, qui commençait à s'imprégner des idées du temps; mais il excita au plus haut degré l'indignation des partisans des vieilles idées. Un écrivain aristocratique, le chevalier d'Arcq, se chargea de réfuter les opinions malséantes et incongrues qui s'y trouvaient avancées. Les arguments de ce défenseur du préjugé nobiliaire ne manquent pas d'une certaine originalité. Le chevalier d'Arcq constatait avec un douloureux effroi que la noblesse n'était que trop disposée à suivre les conseils dégradants de l'abbé Coyer, et il la conjurait, au nom de son honneur et du salut de tous, de s'arrêter sur une pente si funeste.
« II faudrait, au contraire, s'écriait-il, mettre de nouvelles barrières entre la noblesse et la route qu'on se propose d'ouvrir. Sans quoi, au lieu de ne voir qu'un gentilhomme dans une famille suivre cette route, il est à craindre que toute, ou du moins presque toute la famille no s'y précipite, et qu'on ne voie une foule de nobles sur nos vaisseaux marchands, sans autres armes que la plume et le tablier, au lieu de les voir sur nos vaisseaux de guerre l'épée et la foudre à la main pour défendre le commerçant timide. »
L'abbé Coyer riposta avec deux volumes intitulés : Développement et défense du système de la no/jlesse commerçante, et Grimm, en rendant compte de la querelle dans sa Correspondance (année 1757), écrivit à son tour un plaidoyer en faveur de la noblesse militaire..
Mais la révolution n'a-t-clle pas contribué à raviver, avec le préjugé nobiliaire, la manie des titres auxquels la noblesse progressiste de 1789 renoncait dans un moment de généreux enthousiasme?
[49] On trouve dans l'Histoire des deux Restaurations, de M. Achille de Vaulabelle, des renseignements intéressants sur le plan de démembrement de la France en 1815; ce plan échoua, grâce à l'opposition de l'Angleterre et de la Russie qui n'avaient aucun intérêt à y participer.
« L'Angleterre, dit M. de Vaulabelle, n'avait que sa voix dans le conseil commun, voix équivoque, car elle laissait ses alliés discuter, sans opposition, des plans de démembrement qui n'allaient à rien moins qu'à nous enlever un cinquième de notre territoire. Les petits États placés sur nos frontières se montraient les plus avides : les Pays-Bas, ce royaume de la veille, création exclusivement anglaise, réclamaient comme annexes de la Belgique les départements formés par l'ancien Hainaut, par la Flandre et par l'Artois; les différents États de la Confédération demandaient que tous les États ressortissant autrefois au vieil empire d'Allemagne, ceux de l'Alsace et de la Franche-Comté entre autres, fussent réunis au corps germanique; la Prusse ne voulait rien moins que porter ses frontières eu Champagne; la Sardaigne réclamait la Savoie, ainsi que plusieurs districts français limitrophes; l'Autriche, enfin, exigeait la Lorraine, et c'était son représentant, M. de Metternich, qui, dans les conférences, se chargeait le plus habituellement d'indiquer et de motiver les sacrifices que la coalition victorieuse devait nous imposer... M. de Metternich, dans des pourparlers préliminaires, résumait en ces termes les bases du nouveau traité : 1° confirmation du traité de paix du 30 mai 181 i dans celles de ses dispositions qui ne seraient pas modifiées par le nouveau traité; 2° cession au roi des Pays-Bas des districts ayant fait autrefois partie de la Belgique; au roi de la Sardaigne, de la Savoie; à la Prusse, à l'Autriche et au corps germanique, d'un certain nombre do places et de plusieurs départements de l'Est; démolition des fortifications de Huningue, avec l'engagement de no jamais les rétablir, etc., etc.
« Wellington se récria contre la dureté de ces conditions, mais la conférence ne voulut d'abord tenir aucun compte de l'opinion du représentant de la Grande-Bretagne. Bientôt il sortit de son travail une carte, où figuraient comme retranchés de la France, l'Alsace, la Lorraine, le Hainaut, la Flandre et de notables parties de la Champagne, de la Franche-Comté et du Berry. On parvint à s'en procurer une copie qui fut mise sous les yeux de Louis XVIII, en même temps qu'une série de journaux allemands où tous les faits relatifs à la Lorraine et à l'Alsace se trouvaient déjà réunis sous le titre : Allemagne. Louis XVIII demanda alors une entrevue à Wellington et à Alexandre et il parvint à toucher l'âme généreuse de ce monarque. A la fin de la conférence, Alexandre, ému, s'écria : « Non, Votre Majesté ne perdra point ses provinces' « je ne le souffrirai pas! »
[50] Cette hérédité dans la composition des partis est à signaler. Les politiciens lèguent leur situation à leurs descendants, absolument comme les industriels et les négociants conservent leurs maisons de père en fils, et l'on retrouve aujourd'hui dans les différents partis la plupart des noms qui y figuraient à l'époque de leur formation.
[51] Nous ne mettons pas en doute la sincérité des convictions des économistes d'État, désignés en Allemagne sous le nom de Katheder socialists (socialistes de la chaire). Nous croyons seulement qu'ils subissent, d'une manière inconsciente, l'influence de leur position et celle de la « demande », Nous ne parlons pas de ceux qui se servent de la science au lieu de la servir, qui accommodent sans scrupule ses principes au goût et aux fantaisies de quelque ministre tout puissant,
Et qui sont des savants moins que des domestiques,
Ceux-ci forment heureusement l'exception, et s'ils font leurs affaires, Us ne font pas école.
[52] Voir, au sujet de la situation et des progrès comparés de l'agriculture en France et en Angleterre, l'ouvrage de Mounier et Rubichon : De l'agriculture et de la condition des agriculteurs en Irlande et dans la GrandeBretagne, et le compte rendu que nous en avons fait dans le Journal des Économistes, en janvier 1847.
[53] Voici quelle avait été la progression du commerce extérieur de la France pendant le xviiie siècle: [Note: Voyages en France, par Arthur Young, avec des notes et observations par M. Decazaux, t. III, p. 298.]
| Importations. | Exportations. | |
| Depuis 1716 jusqu'un 1720, en paix, taus moyen par an | 65,079,000 liv. | 106,216,000 liv. |
| 1721 jusqu'un 1732, paix | 80,198,000 liv. | 116,765,000 liv. |
| 1733 jusqu'un 1735, guerre | 76,600,000 liv. | 124,465,000 liv. |
| 1736 jusqu'un 1739, paix | 102,035,000 liv. | 143,441,000 liv. |
| 1749 jusqu'un 1748, guerre | 112,805,000 liv. | 192,334,000 liv. |
| 1740 jusqu'un 1755, paix | 155,555,000 liv. | 257,205,000 liv. |
| 1756 jusqu'un 1763, guerre | 133,778,000 liv. | 210,899,000 liv. |
| 1764 jusqu'un 1776, paix | 165,154,000 liv. | 309,245,000 liv. |
| 1777 jusqu'un 1783, guerre | 207,536,000 liv. | 259,782,000 liv. |
| 1784 jusqu'un 1788, paix | 301,727,000 liv. | 354,423,000 liv. |
Dans les années 1787, 1788 et 1789, le commerce extérieur s'éleva, sous l'influence du traité de commerce avec l'Angleterre, importations et exportations réunies, à 991, 983 et 1018 millions.
Dans les années qui suivirent l'explosion révolutionnaire, ce commerce fut presque entièrement détruit et il ne se releva qu'avec une extrême lenteur.
« Pendant les quinze premières années de ce siècle, dit M. Maurice Block (Statistique de la France), les relations commerciales furent à peu près stationnaires; elles oscillèrent entre un chift're minimum de 621 millions en 1809 (2S8,5 à l'importation et 332,5 à l'exportation) et un maximum de 933 millions et demi en 1806 '477 millions à l'importation et 456 millions à l'exportation). De 1815 à 1826, les résultats furent à peu près les mêmes. Le mouvement commercial en 1815 descendit à 611 millions (199 millions à l'importation et 412 à l'exportation). En 1825, année la plus florissante de la période, il remonta à 954 millions (410 millions à l'importation et 544 à l'exportation). »
Ce ne fut donc qu'au bout de 36 ans que le commerce extérieur de la France se retrouva à peu près au niveau qu'il avait atteint avant la Révolution.
[54] Après deux années de guerre civile, la Vendée ne présentait plus qu'un effroyable monceau de ruines. Environ 900,000 individus, hommes, femmes, enfants, vieillards avaient péri, elle petit nombre de ceux qui avaient survécu au massacre trouvaient à peine de quoi s'alimenter et s'abriter. Les champs étaient dévastés, les enclos détruits, les maisons incendiées. Un ancien administrateur des armées républicaines, qui a laissé des mémoires curieux sur cette guerre d'extermination, décrivait ainsi le spectacle qui s'était offert à lui dans une de ses tournées:
« Je n'ai pas vu, disait-il, un seul homme dans les paroisses de Saint-Harmand, Chantonnay et les Herbiers. Quelques femmes seulement avaient échappé au glaive. Maisons de campagne, chaumières, habitations quelconques, tout était brûlé. Les troupeaux erraient comme frappés de terreur autour de leurs habitations fumantes. Je fus surpris par la nuit; mais les flammes de l'incendie éclairaient tout le pays. Aux beuglements et aux bêlements des troupeaux se joignaient les cris rauques des oiseaux de proie et des animaux carnassiers qui, du fond des bois, se précipitaient sur les cadavres. Enfin, une colonne de feu que je voyais augmenter à mesure que j'approchais, me servit de fanal. C'était l'incendie de la ville de Mortagne. Quand j'y arrivai, je n'y trouvai d'autres êtres vivants que de malheureuses femmes qui cherchaient à sauver quelques effets .de l'embrasement général... »
Les Révolutions et le Despotisme, p. 101.
[55] D'après le compte rendu de M. Necker, le budget des dépenses s'élevait, diins les dernières années de l'ancien régime, à environ 600 millions (585 millions en 1783) pour une population évaluée communément à 25 millions d'habitants (24,800,000 en 1784), mais que M. Raudot porte, avec raison selon nous, à 29 millions. Les intérêts de la dette publique s'élevaient à 207 millions. La banqueroute, déguisée sous les euphémismes de consolidation et d'unification de la dette, les réduisit à 42 millions. Néanmoins, après dix ans de révolution, le budget rétabli régulièrement est monté au chiffre de 835 millions pour une population de 27,349,000 habitants. Il serait impossible de faire le compte, même approximatif, des dépenses publiques et des charges qu'elles infligeaient aux contribuables dans ces dix années de despotisme et d'anarchie, pendant lesquelles les réquisitions et le maximum étant les principales ressources des gouvernements issus de la révolution. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que cette taxation barbare coûtait aux contribuables au moins le double de ce qu'elle rapportait à l'État. On peut évaluer à 4 ou 5 milliards [Note: Voir notre Cours d'économie politique, t. II, 7e leçon. Le papier-monnaie.] le produit net de l'émission des 45 miliards d'assignats, et estimer, sans s'éloigner beaucoup de la vérité, la dépense annuelle des gouvernements révolutionnaires à un milliard, et la charge des contribuables à deux milliards.
Voici maintenant, d'après M. Ch. Nicolas (les Budgets de la France) quelle a été, depuis cette époque, la progression des dépenses publiques de la France:
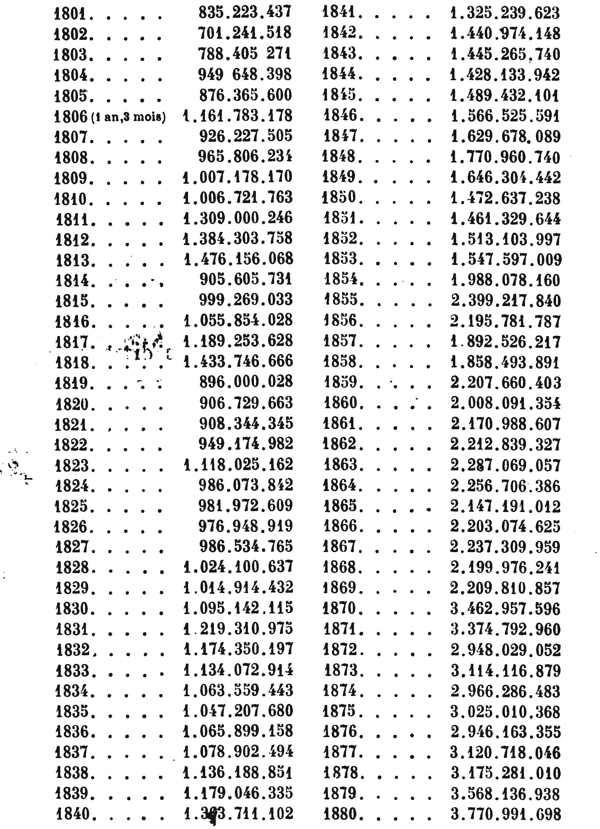
Tandis que la population ne s'élevait, dans cet intervalle, que de 27 millions d'habitants à 37 millions, les dépenses de l'État montaient de 835,223,000 fr. à 3,770,000,000 fr., c'est-à-dire qu'elles étaient plus que quadruplées.
[56] Cette réaction, qui a isole politiquement la France en Europe, n'a pas été seulement l'œuvre des gouvernements; elle a gagné les peuples. Au moment où la révolution éclata, tous ceux qui souffraient des abus de l'ancien régime, la saluèrent avec enthousiasme. En Belgique, en Allemagne, en Italie, les soldats français furent d'abord accueillis comme des libérateurs. Malheureusement, en Belgique par exemple, ils furent suivis de la tourbe des clubs parisiens, dont le gouvernement voulait se débarrasser, comme le fit plus tard M. Ledru-Rollin, lors de la fameuse expédition de Risquonstont. « Le ministère français, dit l'auteur de l'Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle, M. Borgnet, prit dans la populace des clubs ce qu'il y avait d'êtres les plus vicieux ou les plus atroces pour leur donner ses pouvoirs et les lancer sur la Belgique. Enflés de leur fortune subite,[Note: Leur traitement annuel s'élevait à 10,000 livres, indépendamment de leurs frais de voyage et de leurs voleries, dit Dumouriez. (Mémoires, vol. II, p. 32.)] ces misérables donnèrent carrière à leurs passions et se crurent tout permis. Il fallut un arrêté des commissaires de la Convention pour leur défendre de se faire rendre des honneurs que jusqu'alors les rois seuls avaient reçus; plus tard, après l'évacuation de la Belgique, alors que leur mission était devenue sans objet, il en fallut un autre encore pour leur interdire de continuer une partie de leurs fonctions... Leur rapacité n'avait pas de bornes : « Ils demandaient contre la loi française, en vertu de l'usage ancien belgique, et en même temps ils demandaient contre l'usage ancien lielgique en vertu de la loi française [Note: Procès-verbal des séances du Corps administratif de Tournay, p. 674.] ...» Cette nuée d'oiseaux de proie fondit sur la Belgique à la fin de janvier 1793; notre malheureuse patrie fut alors livrée à un tel brigandage que Marat lui-même s'en scandalisa. Trente tyrans ignobles ne suffisaient pas : le ministère français leur adjoignit encore, sous différents noms, une foule de satellites avides de prendre part aux friponneries de leurs chefs. Ceux-ci en augmentèrent encore le nombre par leurs délégations : on les vit prendre leurs mandataires dans les dernières classes du peuple et même parmi les commensaux de Bicétre.
« L'armée française ayant éprouvé des revers, les commissaires de la Convention chargèrent les agents du conseil exécutif de faire transporter à Lille « pour la mettre à l'abri des événements » l'argenterie trouvée dans les communautés soumises au séquestre. Aussitôt les couvents et les églises furent envahis par des bandes avides qui profanèrent jusqu'à la cendre des morts, sous le prétexte d'exécuter l'ordre des commissaires de la Convention. Un acte dressé par le notaire Jean Cans, et qui contient les dépositions de trois serruriers et de deux maçons qui avaient été contraints de prêter leur ministère pour forcer les portes de l'église Samte-Gudule, présente un exposé curieux des profanations commises dans cette magnifique cathédrale.
« Joseph Van den Branden déclara que le 6 mars, le quart avant deux heures de l'après-midi, il fut arraché de vive force de sa boutique par une troupe de Français; que, conduit à la porte de l'église des SS. Michel et Gudule, il avait été contraint de l'ouvrir en brisant la serrure... que les troupes volèrent, dans la sacristie, les ornements, en ôtèrent les galons et brûlèrent les étoffes; que les officiers prenaient les hosties et se les jetaient l'un à l'autre; que plusieurs étant tombées près du feu allumé devant le baptistère, on les poussa du pied et que d'autres furent mangées... que les officiers et les soldats se promenèrent par dérision, revêtus des habits de chœur des chanoines et en portant les saints vases dont ils mirent quelquesuns dans leurs poches; qu'ils firent même leurs ordures dans l'église... que dans une chambre à côté de la sacristie, les officiers avaient forcé un secrétaire dans lequel se trouvait une cassette remplie de liards qu'ils distribuèrent aux soldats et une caisse avec des couronnes parmi lesquelles il y avait trois croix d'or; qu'ils emportèrent la caisse en disant qu'il fallait rendre compte de cet argent à la Monnaie... Les cadavres, malgré leur fétidité, ne purent échapper, dans leur enveloppe funèbre, aux recherches et à la main déprédatrice des satellites impies du jacobinisme... Ces sacrilèges multipliés inspirèrent une indicible horreur. Le Courrier de l'Égalité nous apprend « qu'ils indisposèrent tellement les esprits qu'un soulèvement général aurait pu éclater ». [Note: Les Patriotes et les Jacobins, par Ad. Levak, I, p. 339.]
Le mal provenait surtout de ce que les gouvernements révolutionnaires manquaient des capitaux nécessaires pour subvenir à l'entretien des armées dans les pays qu'ils allaient « délivrer de leurs tyrans ». Il fallait bien que les soldats se chargeassent eux-mêmes de pourvoir à leur subsistance. « Lorsque Bonaparte arriva au quartier général de l'armée d'Italie, dit M. Thiers (Histoire de la Révolution française, liv. XXXIII), les troupes étaient réduites à la dernière misère. Sans habits, sans souliers, sans paye, quelquefois sans vivres, elles supportaient leurs privations avec un rare courage. Grâce à cet esprit industrieux qui caractérise le soldat français, elles avaient organisé la maraude et descendaient alternativement et par bandes dans les campagnes du Piémont pour s'y procurer des vivres. » Bonaparte lança à son arrivée une proclamation que ses historiens citent volontiers comme un modèle de style héroïque, mais qui conviendrait plutôt à un chef de brigands qu'à un libérateur de peuples. « Soldats, disait-il, vous êtes mal nourris et presque nus. Le gouvernement vous doit beaucoup, mais ne peut rien pour vous. Votre patience, votre courage vous honorent, mais ne vous procurent ni avantage ni gloire. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde; vous y trouverez de grandes villes, de riches provinces, vous y trouverez honneur, gloire et richesses. »
L'Italie fut, en effet, largement mise à contribution : la seule ville de Milan fut soumise à une contribution de guerre de vingt millions, et tout en libérant les peuples du joug des tyrans, l'armée de la révolution délivra les musées italiens de leurs chefs-d'œuvre.
Plus tard, Napoléon continua, sur de plus vastes et plus désastreuses proportions, le même système qui consistait à faire vivre ses armées sur les pays envahis. On trouve dans l'Histoire de l'ambassade dans le grand-duche de Varsovie, de l'abbé de Pradt, un tableau instructif des conséquences de ce système, aussi nuisible aux armées qu'aux populations elles-mêmes.
« La campagne (de Russie) avait été ouverte sans aucun approvisionnement : c'est la méthode de Napoléon. Quelques-uns de ses imbéciles admirâteurs prétendent qu'il lui a dû ses succès. Aujourd'hui, il est bien plus certain qu'il lui doit ses revers.
« C'était surtout la nourriture des chevaux qui manquait. On précipita quatre cent mille hommes et plus de cent mille chevaux sur la Lithuanie. Aussitôt les feux s'allument, une ligne d'incendie et de dévastation marque la route de l'armée depuis le Niémen jusqu'à Wilna. Le royaume de Prusse, quoique ami, avait été aussi très maltraité.
« Pour suppléer au défaut des fourrages, on avait fauché les blés et mis les chevaux au vert. On ne leur en fit pas faire un pas de plus : un orage affreux survint et voilà dix mille de ces malheureux animaux morts : leurs cadavres ont pendant six mois empesté la route de Kowno à Wilna, d'où ils détournaient les voyageurs... La seule chose que j'ose me permettre de dire, c'est que pendant sept mois que j'ai siégé au conseil de Varsovie, il s'est écoulé bien peu de jours dans lesquels les récits les plus affligeants ne soient venus jeter la consternation parmi nous. Je me souviens que le ministre des finances m'annonça un jour deux de ses proches parents, échappés de la dévastation de leurs biens situés en Lithuanie, à quelque chose de pire que le massacre de leurs familles; qui, dépouillés et laissés nus sur un tronc d'arbre, devant leurs habitations en cendres, étaient devenus le but des coups de soldats enivrés de désordres et de boissons fortes; et qu'en définitive, l'ébranlement que tant de secousses avaient donné à leur raison, mit dans un état qui leur interdisait de se montrer. Un autre jour, c'était des enfants brûlés... Toutes ces horreurs provenaient du système aussi absurde qu'inhumain de faire la guerre sans magasins. On a créé ce genre, qui est devenu le fléau des armées comme celui des peuples, qui a tué l'art de la guerre et qui a relégué presque tous ceux qui suivent cette profession, jadis si noble, dans le nombre des animaux féroces. Celui qui a ainsi dépravé le cœur si généreux des guerriers, qui par là a centuplé les calamités inséparables de la guerre, a mérité les malédictions du genre humain... Qu'on me permette de m'arrêter et de demander qui a pu inspirer aux militaires français cet esprit de rapacité inconnu à leurs devanciers; cette soif du butin, ce mépris de toutes les lois de la société, qui font que, du jour qu'un homme revêt l'habit militaire, il a trop souvent le malheur d'abjurer tous les sentiments d'humanité, de justice, dont il se montrait pénétré auparavant, ce qui rend le choix fort embarrassant entre celui qui se dit le défenseur et celui qui se déclare ennemi? Le besoin, l'exemple et l'impunité de ces horribles mœurs créées par la révolution et perfectionnées par la méthode de guerre de Napoléon.
« Du jour que des milliers d'hommes sont aux prises avec le besoin, qu'on les pousse sur un pays qu'on leur montre comme leur magasin, qu'ils ont les moyens de la force, ils appellent de tout à la force, ils deviennent des brigands féroces, parce qu'ils ont été des soldats négligés dans leur administration : or, qu'on mesure la masse de maux et de corruption qui doit suivre de l'application de cette pratique à un peuple de soldats. C'est bien évidemment à ceux qui ont créé le besoin de ce désordre qu'il faut demander compte des excès qu'il entraîne à sa suite. Cette méthode est aussi insensée qu'elle est barbare. Parce qu'elle a réussi en Lombardie, dans la grasse Autriche, on la porte en Russie, en Pologne, à Dresde; on l'applique à 400,000 hommes comme à 50,000 hommes; on la maintient en son propre terrain; on ruine ceux qu'il faudrait protéger : qu'arrive-t-il? Deux superbes armées périssent; la troisième expire de besoin au milieu des contrées les plus fertiles de France. Avec ces armées croulent la gloire, la puissance; l'existence même tient à un fil; et tandis qu'on aspirait aux hommages de l'univers, on recoit sur des monceaux de cadavres et de ruines la plus effrayante punition de la plus détestable dépravation d'esprit et de cœur qui fut jamais...
« Ce défaut d'administration a coûté, à l'armée française de Russie et de Dresde, trois fois plus de monde que les combats. Dès le début de la campagne, l'armée entière fut attaquée de la dyssenterie : elle manquait de pain; le soldat, croyant y suppléer par l'abondance des viandes, périssait par milliers. Il n'y avait aucun approvisionnement de rien; ce n'est qu'à la fin de la campagne qu'il en est arrivé par Tricste. Le corps d'armée bavarois, fort de 25,000 grands et bcavix hommes à l'ouverture de la campagne, était réduit, à la fin d'octobre, à 2,000 hommes présents sous les armes; le reste avait péri ou encombrait les plus misérables hôpitaux qui furent jamais... »
A ces mœurs barbares des armées « sans magasins » de la République et de l'Empire, l'auteur d'une biographie impartiale du duc de Wellington, M. Jules Maurel, oppose la manière d'agir du « duc de fer » à son entrée en France. « Quand il eut passé la Bidassoa et la Nivelle, les Espagnols commirent des excès déplorables dans les villages de la frontière. Voici de quel ton il avait signifié tout d'abord son mécontentement aux généraux espagnols : « Je n'ai pas perdu vingt mille hommes depuis le début de la campagne et je n'ai pas conduit mon armée en France pour que les soldats aient le droit de piller et de vexer les paysans français. Mettez-vous dans la tête que j'aime mieux commander une petite armée si elle se conduit bien qu'une grande armée si elle se conduit mal... » II ne change pas de ton quand il fait ses doléances aux ministres anglais : « Si j'avais vingt mille bons soldats espagnols sous mes ordres, je prendrais Bayonnc; si j'en avais quarante mille, je ne sais pas où nous irions. Je les ai, ces vingt mille et ces quarante mille bons soldats espagnols, mais ils ne sont ni nourris ni payés ni vêtus par le gouvernement; si je les fais marcher, ils pilleront, et s'ils pillent, tout est perdu. » Voyant que ni les menaces, ni la potence, ni la fusillade, ne suffisaient pour rétablir l'ordre, Wellington s'était décidé à mettre à la queue de l'armée et à renvoyer en Espagne toutes les armées espagnoles qui étaient sous ses ordres et qui ne comptaient pas moins de quarante mille hommes, d'ailleurs excellents soldats. Il était en pays ennemi; il jouait le rôle de conquérant et il aimait mieux couper son armée en deux que de souffrir le désordre et le pillage. C'est ainsi que, pendant le mois de décembre 1813 et le mois de janvier 1814, il avait campé sur le territoire francais avec la seule armée anglo-portugaise. Les batailles sanglantes qu'il livra sous les murs de Bayonne étaient demeurées sans résultats, parce qu'il n'avait plus assez de monde pour faire une guerre d'invasion. Mais il avait pris un ascendant irrésistible sur les Basques et sur toutes les populations de la frontière. Et peu de temps après , le maréchal Soult déclarait aux ministres de Napoléon qu'il ne fallait pas songer à une levée en masse, attendu que les paysans emportaient leur argent et emmenaient leurs troupeaux, pour aÛer chercher protection dans les lignes de l'armée anglaise. »
Wellington se bornait, au surplus, à suivre les usages qui avaient commencé à prévaloir dans les guerres des peuples civilisés depuis le xvnc siècle. « Le pillage et l'incendie du Palatinat, qui eussent été considérés, un siècle auparavant, comme un fait ordinaire de guerre, soulevèrent alors l'opinion de l'Europe contre Louis XIV. Les chefs d'armée se contentent désormais de lever des contributions en pays ennemi, et ils s'entendent même pour ne point les rendre trop onéreuses aux populations. » (vattel, le Droit des gens, t. I, liv. III, chap. ix.) Au xvm° siècle, on fait un progrès de plus. On s'abstient de toucher aux propriétés publiques quand elles ne font point partie de l'appareil militaire. C'est ainsi que le grand Frédéric, s'étant emparé de Dresde, respecta le magnifique musée de cette ville. Enfin, en 1785, les États-Unis et la Prusse concluent un traité d'alliance par lequel elles stipulent que les garanties les plus complètes seront accordées à la propriété privée, en cas de guerre. » [Note: Questions d'économie politique et de droit publie. Les progrès réalisés dans les usages de la guerre, t. II, p. 277.]
Mais la révolution devait faire rétrograder les usages de la guerre comme tout le reste. Aux déprédations des armées obligées de vivre sur le pays ennemi, ajoutez les décrets odieux de la Convention,[Note: Décret du 7 prairial an II, rendu sur le rapport de Barrère et voté avec une adresse aux armées. Art. 1er. Il ne sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien. Art. 2. L'adresse et le décret seront imprimés dans le Bulletin et envoyés à toutes les armées.] la tyrannie et les eiactions des délégués des Jacobins, plus tard le 'despotisme des fonctionnaires impériaux et la cruauté des répressions,[Note: Tentative d'assassinat sur Napoléon à Schœnbrunn. « Cet homme, dont j'ai oublié le nom, fut conduit dans les prisons de Vienne, où on le garda au secret pendant quelques jours, lui faisant éprouver la privation du sommeil, lui donnant des fruits pour nourriture afin d'affaiblir sa constitution et de le forcer à révéler le nom de ses complices. Il persista à ne rien avouer et à se vanter de son projet. Il fut jugé par une commission militaire et fut fusillé. Voilà le fait tel qu'il s'est passé. » De Bausset, Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais, etc.] et vous aurez l'explication des sentiments de malveillance et d'hostilité qui ont succédé, depuis la révolution, aux sympathies des peuples pour la France.
[57] « Si la civilisation était encore un monopole exclusif des anciens Etats européens ou si toutes les nations qui représentent aujourd'hui la société chrétienne sur les divers points du globe s'abandonnaient avec un égal acharnement à la ruineuse émulation des armements exagérés, nous croyons que la vieille Europe, se plaçant à un point de vue purement égoïste, pourrait ne pas désespérer de son avenir. Alors, en effet, cette antique citadelle de la civilisation, qui a su résister aux invasions des barbares, à l'anarchie de la féodalité et à l'oppression des grandes monarchies absolutistes, saurait peutêtre traverser l'âge transitoire de la paix armée, et dans le malaise commun, garder son rang à la tête des peuples. Mais tandis qu'elle s'affaisse sous le poids des dépenses militaires, d'autres nations plus heureuses ou plus habiles s'élancent à la conquête du progrès, sans l'encombrant bagage de nos préjugés, de nos abus et de nos misères.
« Songeons à ces États-Unis, grandissant avec une rapidité à donner le vertige... Songeons ensuite à l'Australie, autre témoignage de ce génie colonisateur qui semble faire des Anglo-Saxons la pépinière des sociétés futures. Pourrons-nous lutter, avec nos dettes, notre bureaucratie, contre ces nations plus jeunes et plus nombreuses, qui alors nos égales en lumières et en civilisation n'auront pas à combattre comme nous l'héritage d'un passé onéreux.
« Sans doute, ces États qui devront leur supériorité à la paix ne viendront pas nous asservir par la force. Mais la violence leur sera-t-elle nécessaire? On voit souvent dans les forêts des insectes destructeurs s'attaquer aux arbustes d'apparence les plus sains et les plus vivaccs. La plante s'affaiblit et se dessèche, son feuillage tombe, son développement s'arrête. Cependant elle n'en meurt pas et, quand enfin le parasite succombe ou disparaît, il semble qu'elle va reprendre, avec sa vigueur passée, le mouvement interrompu de sa croissance. Mais, pendant qu'elle languissait, d'autres plantes ont grandi aux alentours et bien que ces nouvelles venues dominent à peine de quelques pouces l'arbuste retardataire, elles vont le faire périr sans même l'effleurer de leurs rameaux, par ce seul fait qu'elles lui enlèvent une part d'air et de soleil pour s'en abreuver à ses dépens. Telle est la destinée qui menace l'Europe, si celle-ci s'obstine à accumuler sur nos têtes les charges qui entravent déjà notre essor. Il sera trop tard quand elle verra des nations' déjà supérieures en ressources, sinon en nombre et en consistance, lui circonscrire peu à peu la place qu'elle occupe encore au soleil de la civilisation. »
Goulet D'alviella, Désarmer ou déchoir, p. 135.
Dès 1835, Cobden avait déjà prévu la concurrence américaine et ses effets. Voir son admirable brochure :England, Ireland and America by a Manchester manufactures.
[58] Voir L'Évolution économique.
[59] La conquête et l'occupation de l'Inde offrent cette particularité digne de remarque qu'elles ont été exécutées commercialement en vue des bénéfices qu'elles pouvaient procurer à une compagnie d'actionnaires. Fondée en l'an 1600, au capital assez modeste de 80,000 livres sterling, la « Compagnie des marchands de Londres faisant le trafic des Indes Orientales » obtint de la reine Elisabeth le monopole du commerce dans toutes les mers situées au delà du cap de Bonne-Espérance et du détroit de Magellan. Elle s'occupa d'abord uniquement d'opérations commerciales, et elle réalisa des bénéfices considérables : de 1603 à 1613, huit expéditions successives rapportèrent, en moyenne, aux actionnaires des dividendes de 171 p. 100. Ces bénéfices excitèrent naturellement la Compagnie à étendre la sphère de ses opérations et à multiplier ses comptoirs. Mais ceux-ci n'étaient pas toujours respectés par les princes indigènes. La Compagnie fut obligée d'enrôler des troupes pour les défendre. En 1686, Jacques II l'autorisa à attaquer les Mongols, dont elle avait à se plaindre, et peu de temps après elle fut investie des pouvoirs nécessaires pour faire la guerre et la paix « avec les princes et les peuples pourvu qu'ils ne fussent pas chrétiens ». La Compagnie des marchands de Londres cessa dès lors d'être purement commerciale ou pour mieux dire, elle fit entrer au nombre des opérations de son commerce le gouvernement des contrées où elle avait fondé ses établissements. « L'accroissement du revenu par l'impôt, écrivaient les directeurs à leurs agents, vers la fin du xvnc siècle, doit être désormais le but de nos efforts aussi bien que le développement de notre commerce. » Les agents de la Compagnie suivirent fidèlement ces nouvelles instructions et ils finirent, à force d'audace et de persévérance, par substituer dans l'Inde le pouvoir d'une simple compagnie dc marchands à celui du Grand Mogol. Les acquisitions territoriales, qui n'avaient d'abord été pour elle qu'un accessoire, devinrent peu à peu le principal. Elle conservait cependant encore le monopole du commerce avec l'Inde et la Chine ; mais sur les plaintes des négociants de la métropole, le Parlement lui enleva, en 1814,1e privilège exclusif du commerce de l'Inde et, en 1834, celui du commerce de la Chine. A dater de cette époque jusqu'en 1858, où le gouvernement l'a abolie pour se mettre à sa place, la Compagnie (les Indes a cessé entièrement d'être une compagnie de commerce pour n'être plus qu'une « compagnie de gouvernement ».
Au 30 avril 1856, la Compagnie des Indes exercait sa domination sur une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés et sur .une population de 131,990,000 habitants. En outre, son influence ou son patronage s'exerçait sur une série d'États indigènes comprenant ensemble une population de 48.376,000 habitants. 180 millions d'hommes se trouvaient ainsi soumis à sa domination ou à son influence.
Malheureusement, si l'Inde était -soumise à la Compagnie, la Compagnie était soumise à son tour à la couronne, et depuis 1784, époque de la fondation du Board ofcontrol, cette sujétion était devenue de plus en plus étroite. La Compagnie avait joui jusqu'alors d'une certaine indépendance, quoiqu'elle fût obligée de faire renouveler son privilège tous les vingt ans. Elle se gouvernait elle-même, et la couronne n'exerçait sur elle qu'un faible controle. Mais, à la fin du xviiie siècle, les conquêtes de Clive ayant rendu la Compagnie maîtresse de la plus grande partie de l'Inde, sa puissance croissante ne manqua point d'exciter la jalousie du gouvernement. Les déprédations de Warren Hastings et le procès scandaleux auquel elles donnèrent lieu, fournirent bientôt au Parlement un motif plausible pour intervenir dans l'administration de la Compagnie. Le Bureau de contrôle fut institué avec des pouvoirs qui lui attribuaient la prépondérance réelle dans la direction des affaires de l'Inde. A partir de ce moment, la Compagnie fut obligée de subir la politique qu'il plut au gouvernement de lui imposer. Cette politique n'était, il faut bien le dire, ni intelligente ni élevée. Le gouvernement anglais ne se préoccupait ni des intérêts de la compagnie ni de ceux des populations qu'elle gouvernait : il ne songeait qu'à étendre la domination britannique et, avec elle, le patronage lucratif de l'aristocratie gouvernante.
En conséquence, il imposait à la Compagnie l'obligation de maintenir sur pied une armée formidable, et il la poussait incessamment à faire de nouvelles conquêtes. Si la Compagnie objectait l'insuffisance de ses ressourceg,<m l'autorisait à contracter des emprunts; si elle objectait encore la nécessité de distribuer des dividendes à ses actionnaires, on lui permettait de leur allouer, en tout temps, un dividende ou un intérêt de 10 1/2 p. 100.
L'organisation de la Compagnie des Indes ne différait pas essentiellement de celle d'une compagnie ordinaire. Son capital, qui était de 6 millions sterling à l'époque où elle a été abolie, se trouvait réparti entre environ 4,000 actionnaires ; mais ceux-ci n'étaient admis à participer à la gestion de la Compagnie qu'à la condition de posséder des actions jusqu'àconcurrencc de 1,000 livres sterling. Une part de 1,000 livres dans le capital donnait droit à une voix ; une part de 3,000 livres, à deux voix ; une part de 6,000 livres, à trois voix; enfin une part de 10,000 livres et plus, à quatre voix. Le nombre des actionnaires admis à voter était, en dernier lieu, de 1,780. Les actionnaires étaient admis à exercer leur droit sans distinction de nationalité ni de sexe et, parmi les 1,780 votants, on ne comptait pas moins de 400 femmes. Ces 1,780 actionnaires actifs, qui possédaient une part de capital de 1.000 livres et au-dessus se réunissaient quatre fois par an en assemblée générale (cour des propriétaires). Ils nommaient le conseil d'administration (cour des directeurs), qui a été composé tantôt de 24 et tantôt de 18 membres ; ils contrôlaient les dépenses, votaient les budgets, etc., etc. Le conseil d'administration, ou la cour des directeurs, était chargé de la gestion de l'entreprise. Il'se divisait pour l'expédition des affaires en trois comités: finances et intérieur, politique et guerre, revenus et justice. Tous les ans, les 6 directeurs le plus anciennement élus étaient remplacés. Un directeur ne pouvait être réélu qu'un an après sa sortie de fonctions. La cour des directeurs se choisissait un 'président, lequel était chargé de présider aussi les assemblées générales des actionnaires.
La cour des directeurs constituait donc le pouvoir exécutif de la Compagnie. Seulement, depuis 1784, époque à laquelle le gouvernement avait constitué le Board of control, la cour des directeurs était obligée de soumettre toutes ses décisions et toutes ses mesures de quelque importance à l'approbation de ce bureau de contrôle ou de surveillance, dont les membres étaient nommés par le souverain dans son conseil privé. Le Board of control avait fini même par empiéter sur les pouvoirs du conseil d'administration de la Compagnie, de facon à s'attribuer la direction réelle du gouvernement de l'Inde et à entraîner la Compagnie dans la voie coûteuse de la politique d'annexions. La Compagnie était constituée pour une période illimitée ; pliais sou privilège avait été limité à vingt années. Au bout de cette période, il était soumis au Parlement qui le renouvelait, en en modifiant plus ou moins les conditions. Il expirait en 1854, mais à cette époque l'opinion favorable au gouvernement direct de l'Inde ayant commencé à prévaloir, on ne l'a renouvelé que d'une manière provisoire jusqu'à la dissolution de la Compagnie en 1858.
De l'aveu de tous les voyageurs, les régions soumises à la Compagnie étaient incomparablement mieux administrées que celles qui étaient demeurées assujetties à la domination des princes indigènes. La police y était mieux faite, le pauvre y pouvait obtenir justice contrôle riche, et la presse jouissait dans l'Inde d'une liberté entière. Au bienfait d'une sécurité et d'une liberté inconnues dans le reste de l'Asie et même dans une bonne partie de l'Europe, il faut ajouter encore une énergique impulsion donnée aux travaux publics.
La Compagnie avait fait exécuter d'immenses travaux d'irrigation, construit les canaux de la Jumma et du Gange, le barrage du Godavery, etc. Enfin c'est à l'époque de sa domination qu'ont été commencés les travaux des chemins de fer et des télégraphes. En 1858, un réseau télégraphique de 5,000 kilomètres reliait les principaux foyers de population de l'Inde et près de 4,000 kilomètres de chemins de fer étaient en construction. [Note: La Domination anglaise dans l'Inde. Economiste belge. (Avril-juin 1858.)]
Dans une remarquable brochure intitulée :Suggestions fur a future government of India, miss Harriet Martincau faisait ressortir la supériorité du gouvernement de la Compagnie sur le gouvernement colonial de la métropole et elle signalait les causes de cette supériorité, qu'elle qualifiait de « manifeste et indiscutable ».
« Pendant des siècles de changements continuels et de fréquentes perturbations que les Anglais pouvaient contrôler chez eux, mais qui ne pouvaient manquer d'être terriblement nuisibles aux intérêts des colonies, le gouvernement de l'Inde a été stable, consistant et aussi immuable aux yeux de ses sujets indiens que celui d'un Dieu assis sur un trône inébranlable. Dans ce ras particulier, cette stabilité du gouvernement a été un inestimable bienfait. Sou caractère corporatif, la succession de ses chefs d'origine diverse, l'ont préservé des maux du despotisme, tandis que son indépendance de la politique du jour l'a protégé contre la multitude des inconvénients des changements de partis, — inconvénients que nous reconnaissons être des maux chez nous, quoique nous les préférions à ceux de tout autre système. Dans l'Indoustan, le caractère non politique de la Compagnie a été absolument une question vitale. Notre domination n'aurait pu y être maintenue si les autorités d'lndia House avaient été changées avec chaque ministère...D'un autre côté, le public n'ignore pas que partout où l'on a pu établir une comparaison entre les fonctionnaires du gouvernement et ceux de la Compagnie, la supériorité de ces derniers a été manifeste et indiscutable. Les chefs militaires de la Compagnie ou les officiers de la reine à la solde de la Compagnie et accoutumés de la guerre indienne, ont remporté des succès aussi brillants que les déconvenues des autres ont été lamentables. Le public a eu moins souvent l'occasion de constater à quel point le même contraste existe dans le service civil, mais il n'est pas moins sensible pour tous ceux qui sont au courant des affaires des deux gouvernements. »
Miss Harriet Martineau terminait par cette prédiction:
« Si nous nous hâtons de décider que l'Inde sera une colonie de la couronne, gouvernée directement et entièrement par l'Angleterre, d'après les notions et les habitudes existantes de notre régime colonial, nous perdrons l'Inde promptement, honteusement et d'une manière si désastreuse que ce sera uue des calamités les plus mémorables de l'histoire des nations. »
La prédiction de miss Martineau ne s'est pas encore réalisée, mais le rapide accroissement du budget et de la dette de l'Inde, sous le régime du gouvernement direct, confirme amplement ce qu'elle disait de la supériorité économique du gouvernement de la Compagnie.
Dans' l'exercice finissant le 30 avril 1856, les dépenses de la Compagnie étaient de liv. 29,154,490; elles se sont élevées à liv. 71,113,079 dans l'exercice 1881-1882. La dette a monté de liv. 34,684,997 en 1840 à liv. 157,388,879 en 1881.
Il est permis de croire, avec miss Martincau, que l'Angleterre aura quelque our à se repentir d'avoir assumé la lourde tâche du gouvernement direct de l'Inde. A l'époque où a eu lieu cette annexion rétrograde et anti-économique du domaine de la Compagnie à la régie de la couronne, voici comment nous proposions de résoudre la question indienne. Si nous reproduisons celte solution, c'est parce que le gouvernement de la Compagnie des Indes est, à nos yeux, le type des gouvernements de l'avenir.
Eu définitive, disions-nous (La Domination anglaise dans l'Inde), l'Angleterre, tout en s'attribuant la possession politique de l'Inde, ou si l'on veut, le droit de la gouverner, délègue ce droit à une compagnie organisée commercialement, mais en intervenant d'une manière plus ou moins active dans la gestion de celte compagnie concessionnaire du service gouvernemental de l'Inde et en se réservant la faculté de rompre le contrat au bout de vingt années ou d'en modifier les conditions. C'est pour tout dire le système de Va/fermage, transporté dans le domaine gouvernemental et substitué à celui du gouvernement direct ou de la régie.
Le système de l'affermage constitue évidemment un progrès économique sur celui de la régie, et ce serait faire un pas rétrograde que de l'abandonner pour revenir à ce dernier. Mais il ne s'ensuit pas qu'il soit nécessaire de conserver intact le mode actuel de concession ou d'affermage du gouvernement de l'Inde. Il ne s'ensuit pas non plus qu'il faille s'en tenir toujours aux conditions stipulées avec les premiers concessionnaires.
Ainsi l'expérience a démontré que l'Inde est maintenant trop vaste pour être bien gouvernée par une seule compagnie. Pourquoi ne diviserait-on pas la concession primitive? pourquoi ne fractionnerait-on pas l'Inde entre trois ou quatre compagnies, ayant chacune 40 à KO millions d'âmes à gouverner, au lieu de 130? N'est-il pas évident que le fractionnement d'un service trop vaste permettrait de le mieux remplir, et quo l'Inde serait beaucoup mieux gouvernée par trois ou quatre compagnies qu'elle ne peut l'être par une seule?
Dans l'état actuel des choses, avec l'intervention continue et tracassière du gouvcr.icmcnt dans les affaires de l'Inde, avec son système militaire et annexionniste qui a été si ruineux pour les finances de la Compagnie actuelle, ou trouverait sans doute assez difficilement des capitalistes disposés à aventurer leurs fonds dans de semblables entreprises. Mais on pourrait accorder aux compagnies concessionnaires plus de liberté dans leurs allures, ainsi que des concessions à plus longs termes. D'un autre côlé,lc gouvernement stipulerait différentes garanties en faveur des populations dont il affermerait ou concéderait ainsi l'administration ; il stipulerait, par exemple, que les impôts ne pourraient dépasser un certain chiffre, que les libertés les plus essentielles, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté d'association, etc., devraient être respectées; enfin que la non-exécution de ces clauses rendrait le contrat nul de plein droit.
Ces compagnies ainsi maîtresses de leur gestion, à la seule condition d'exécuter les clauses de leur contrat, recruteraient leur personnel d'employés civils et militaires où ils seraient les meilleurs et au meilleur marché, sans faire aucune acception de nationalité. Le principe du fret trade serait appliqué à l'Inde pour les services aussi bien que pour les produits, et l'on verrait, en conséquence, s'y accroître rapidement l'élément européen qui s'y trouve aujourd'hui dans des proportions tout à fait insuffisantes.
Sans doute, l'Angleterre fournirait le plus grand nombre des actionnaires et du personnel des nouvelles compagnies, comme elle fournit encore les trois quarts des produits européens consommés dans l'Inde; mais enfin elle n'aurait plus, à aucun degré, le « monopole de l'Inde »; elle admettrait toutes les nations à concourir au gouvernement de ce vaste empire, au moyen de leurs capitaux ou de leurs services ; elle ne se réserverait qu'un simple patronage qui ne conférerait à ses nationaux aucun bénéfice, aucun avantage exclusif. Or, du moment où l'Inde ne procurerait plus aux Anglais aucun avantage particulier, du moment où tous les Européens seraient admis à y remplir toutes les fonctions publiques sur le même pied que les Anglais, nous ne voyons pas qui pourrait songer encore à déposséder l'Angleterre de ce patronage qu'elle exercerait pour l'avantage commun des peuples civilisés. Toutes les nations ne seraient-elles pas intéressées, au contraire, à le lui conserver, afin d'éviter le retour d'une domination exclusive qui substituerait, de nouveau, en matière de gouvernement, le principe du monopole à celui du Free trade?
Ce système ne serait, remarquons-le bien, qu'un perfectionnement du système actuel. Le principe demeurerait le même. Ce serait toujours la concession ou l'affermage substitué à la régie. Il n'y aurait de changé que le mode et les conditions de l'application. Au lieu d'une seule compagnie concessionnaire, devenue insuffisante pour gouverner un empire que des annexions successives ont rendu de plus en plus vaste, il y aurait autant de compagnies que cela serait nécessaire pour que l'Inde fût économiquement gouvernée. D'un autre côté, au lieu [de limiter la durée des concessions et d'assujettir les concessionnaires à l'intervention gênante et tracassière du Board of contrat, on leur assurerait une possession illimitée, à la seule condition d'exécuter fidèlement un cahier des charges dont les articles concerneraient surtout les garanties à accorder aux peuples gouvernés. Les compagnies réuniraient ainsi ces deux conditions essentielles à .toute bonne exploitation : la sécurité et la liberté. Elles seraient intéressées du reste à bien gouverner les peuples soumis à leur domination, afin de rendre plus productives les sources d'où elles tireraient leurs revenus; et l'Angleterre, de son côté, n'aurait pas moins d'intérêt à les empêcher de vexer et de pressurer leurs sujets. Car plus la situation des peuples de l'Inde deviendrait prospère, plus le commerce que font avec eux les nations européennes et l'Angleterre en particulier pourrait prendre d'extension, plus abondantes et plus fructueuses deviendraient les relations de l'Europe avec l'Inde. Les intérêts les plus élevés de la civilisation ne seraient pas moins bien servis par l'adoption de ce système qui détruirait les dernières barrières que l'esprit de monopole a élevées entre l'Inde ot le reste du monde; qui permettrait aux capitaux et aux intelligences, sans distinction d'origine, de contribuer à faire pénétrer dans ce foyer presque éteint de l'antique civilisation les idées, les inventions et les méthodes vivifiantes et progressives de la civilisation moderne.
[60] Voici, d'après le Financial reform Almanack pour 1884, le relevé des denrées alimentaires de toute espèce importées en Angleterre en 1840 sous le régime de la protection et en 1882, sous le régime du free trade:
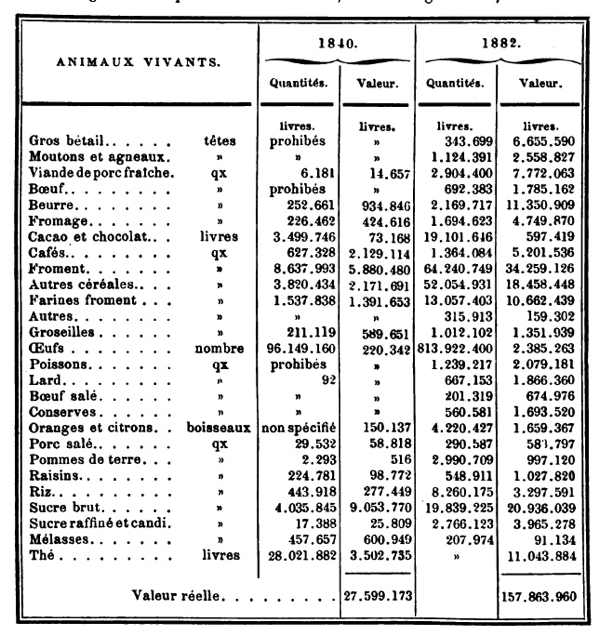
Tous ces articles entrent maintenant en franchise, à l'exception du cacao, du café, des groseilles, des raisins et du thé.
Ne suffit-il pas de jeter un simple coup d'œil sur ce relevé pour se convaincre que la paix s'impose aujourd'hui comme une nécessité aux peuples civilisés?
[61] Les pénalités contre les manœuvres séparatistes ont été renouvelées en France par la loi de 1871 contre l'Association internationale des travailleurs et le séparatisme.
« L'idée même de patrie, lisons-nous dans l'exposé des motifs du projet de loi, disparaîtrait s'il était loisible de proposer la rupture du lien national, sans que la loi pût réprimer de pareilles provocations.
« Les lois qui répriment les crimes et délits contre l'ordre public sont muettes cependant sur ce point et ne contiennent aucune peine contre ce genre de délit nouveau dans notre pays. L'article 77 du Code pénal punit de la peine capitale les intelligences entretenues et les manœuvres pratiquées avec les ennemis de l'Etat pour leur livrer une partie du territoire. La provocation par la voie de la presse à des crimes de cette nature est punie par les lois sur la presse, et notamment par les articles 1 et 2 de la loi du 17 mai 1819, qui punissent la provocation publique aux crimes et délits. Mais ces dispositions ne seraient pas facilement appliquées aux manœuvres ou aux manifestations publiques des séparatistes, ni à l'appel fait au suffrage universel pour le provoquer à se prononcer contre le maintien national.
« C'est cette lacune que le projet de loi soumis à l'Assemblée aurait pour objet de combler. Nous ne proposons que des peines modérées et prises dans la nature même du délit : le condamné sera privé de la qualité de citoyen français après en avoir méconnu et la dignité et les devoirs les plus essentiels. Soumis en France à la condition des étrangers, privé de cette nationalité qu'il aurait, en quelque sorte, abjurée par avance, il ne pourrait reconquérir la qualité de Français qu'en accomplissant les conditions prescrites à l'étranger qui aspire à devenir citoyen.
« La loi préserverait ainsi le principe de la souveraineté nationale d'attaques dont le danger n'est sans doute pas grand au milieu de populations françaises de cœur, mais qui ne sauraient rester impunies. »
[62] Voir les Soirées de la rue Saint-Lazare, 11e soirée, p. 303. — Les Questions d'économie politique et de droit public, la liberté de gouvernement, t. II, p. 24S. — Cours d'économie politique, les consommations publiques, 126 leçon, p. 480.
[63] La nécessité de ces groupements se fit sentir aussi pour l'administration des services religieux. C'est ainsi qu'on voit, à l'époque de l'établissement et de la propagation du christianisme, se former des communes religieuses ou paroisses, dans un rayon plus ou moins étendu selon la configuration du sol, la densité rtc la population, la facilité plus ou moins grande des communications. Lorsque la hiérarchie se constitue, ces paroisses se groupent ou sont groupées selon leur situation topographiquc et leurs affinités de race et de langue, et elles forment un évéché ; les évéchés à leur tour sont groupés en archevêchés toujours en tenant compte des circonstances naturelles parmi lesquelles il ne faut pas oublier l'appartenance politique; enfin, les archevêchés ressortent directement du pape, sous la réserve de leurs obligations envers le propriétaire politique de l'État.
[64] En confisquant l'État politique et en faisant suivre cette confiscation de celle des biens du clergé et d'une partie de la noblesse, la révolution a créé un « risque » qui menace tous les propriétaires et qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste se chargera de faire échoir. Quel langage tiennent, en effet, aujourd'hui les collectivistes et les anarchistes? Ils disent: La révolution bourgeoise de 1789 a donné la puissance politique au tiers état, et elle a fait passer entre ses mains, par voie de confiscation, les biens de la noblesse et du clergé! Eh bien, ce qui a été fait alors au profit du tiers état, c'est-à-dire de la bourgeoisie, il s'agit de le refaire au profit du quatrième état, c'est-à-dire du peuple. Notre tâche à nous, c'est d'achever l'œuvre de la révolution en transformant en « biens nationaux » les exploitations agricoles, minières, industrielles et autres appartenant à la bourgeoisie capitaliste, comme nos pères ont transformé en « biens nationaux u les propriétés de la maison souveraine, de la noblesse et du clergé.
« La révolution qu'il s'agit de faire aujourd'hui contre la bourgeoisie, dit un écrivain notable du collectivisme, M. Jules Guesde (Collectivisme et Révolution), la bourgeoisie, lorsqu'elle n'était encore que le tiers état, l'a faite elle-même contre la noblesse et le clergé! Il n'est personne qui ne se souvienne comment elle s'est approprié en 89 les « biens » de ces deux ordres après les avoir déclarés « nationaux ». Et ce n'est pas parce qu'au lieu de s'emparer comme elle l'a fait à son profit exclusif de plus des deux tiers de la France, les prolétaires entendent approprier collectivement la France entière au bénéfice de tous, — les bourgeois y compris (?), —• que leur révolution pourrait être moins justifiée que l'autre. Bien au contraire.
« Car, — on ne saurait trop insister sur ce point, — ce qui caractérise la révolution poursuivie par la B'rance ouvrière ou le quatrième état, c'est qu'elle ne tend pas à substituer une classe à une autre classe dans la possession du sol et des autres capitaux, mais à fondre toutes les classes en une seule, celle des travailleurs, au service desquels devra être mis l'ensemble des capitaux de production. »
A ce langage, nous ne voyons pas ce que pourraient répondre les écrivains qui se plaisent à justifier la légitimité des confiscations révolutionnaires en France, la « reprise » des biens du clergé et des couvents dans les autres pays. Si le tiers état a eu le droit de confisquer les biens de la noblesse et du clergé avec l'État lui-même, le quatrième état n'a pas un droit moins évident de confisquer les biens de la bourgeoisie capitaliste pour les mettre au service de la « classe des travailleurs ».
Il n'y a, quoi qu'en disent les sophistes prétendus libéraux et conservateurs, aucune différence substantielle entre ces deux sortes de propriétés. Les unes et les autres ont été également'le fruit du travail et des services rendus. Si la noblesse n'a pas défriché, avec la houe et la charrue, le sol de ses domaines, elle l'a défendu pendant des siècles et il n'est pas xm sillon qui n'ait été arrosé de son sang; elle a produit la sécurité sans laquelle aucune terre n'eût été cultivée, et ce service, comme nous l'avons démontré ailleurs (Cours d'économie politique, 13e leçon, la Part de la terre), s'est incorporé dans le sol, il a été l'un des premiers éléments de la râleur de la terre. Les biens du clergé n'ont pas eu une origine moins légitime; ils ont été la récompense de services non moins nécessaires : ceux du gouvernement politique et moral de multitudes encore à l'état demi-sauvage, et c'est aux monastères que l'on doit le défrichement de la plus grande partie du sol et la renaissance de l'industrie et des lettres après les grandes invasions barbares. Dira-t-on que ces propriétés ont été accrues et viciées par les privilèges et les monopoles? Mais n'en peut-on pas dire autant de celles de la bourgeoisie? Qncl a été l'objet des monopoles conférés aux banques, aux Compagnies de chemins de fer et, finalement, à tous les entrepreneurs d'industrie que protègent les tarifs douaniers, sinon d'augmenter leurs revenus, partant leurs propriétés, aux dépens de la masse des consommateurs de leurs produits ou de leurs services? Dira-t-on encore que la noblesse s'était amollie, que les moines s'étaient corrompus et que les couvents étaient devenus des repaires du vice et de la fainéantise, que noblesse et clergé avaient fini par soulever contre eux la haine de toutes les autres classes de la nation? Mais si l'on compare les mœurs de la bourgeoisie gouvernée du xvnc et du xvin" siècle à celles de la bourgeoisie politicienne du xixe siècle, est-ce bien un progrès que l'on pourra constater? Si la corruption et la fainéantise étaient des motifs suffisants pour légitimer la confiscation, l'État ne serait-il pas autorisé à reprendre les biens de tous ces beaux fils d'industriels, de négociants, de financiers, [qui dissipent dans l'oisiveté et la débauche la fortune que des pères entreprenants, laborieux et économes leur ont léguée? Enfin, si l'impopularité d'une classe devait justifier sa dépossession, les entrepreneurs d'industrie, les propriétaires de mines et autres ne seraient-ils pas exposés aujourd'hui à être expropriés au même titre que l'ont été les nobles, les prêtres et les moines? Ne pourrait-on pas prétendre même, en lisant les journaux socialistes, en écoutant les discours des meetings populaires et les conversations d'atelier que la domination de la classe moyenne a soulevé plus de haines et de rancunes en cinquante ans que celle de la noblesse et du clergé n'en avait accumulé en dix siècles?
On insiste et on essaye tout au moins d'établir une distinction entre la propriété patrimoniale qui se lègue de père en fils, et la propriété des associations religieuses qui se perpétuent comme personnes civiles et constituent une « mainmorte. » C'est l'État qui crée, dit-on, les personnes civiles; il a, par conséquent, le droit de les supprimer, quand leur existence est devenue nuisible à la société. S'il ne possédait pas ce droit, s'il lui était interdit de toucher à la propriété d'institutions qui ont cessé, pour une cause ou pour une autre, de répondre à un besoin social, voyez à quelles conséquences absurdes et monstrueuses aboutirait le fétichisme de la propriété! Lorsque le christianisme a pris la place du paganisme, u'aurait-il pas fallu respecter la propriété des prêtres de Jupiter et de Vénus, et laisser subsister indéfiniment leurs temples? On les a confisqués avec justice dans l'intérêt général de la société. N'cst-il pas juste et raisonnable de confisquer de même la propriété des moines, devenus non moins inutiles sinon nuisibles que les prêtres de Jupiter et de Vénus? — A cet argument spécieux, la réponse est facile. L'État ne crée point les personnes civiles, — pas plus qu'il ne crée les personnes de chair et d'os. Elles se créent par l'accord des volontés et l'apport des capitaux de ceux qui fondent une association quelconque, civile ou commerciale; l'État se borne à garantir leur vie et leurs propriétés, absolument comme pour les personnes de chair et d'os. Il n'a pas plus le droit de tuer et de dépouiller les unes que les autres. Cependant, si des institutions se perpétuent quand elles ont perdu leur raison d'être, quand elles sont devenues une « nuisance », peut-on lui refuser le droit de les supprimer comme toute autre nuisance? Non! mais encore faudrait-il que cette nuisance fût manifeste et qu'elle se traduisît par dos actes criminels. Est-il nécessaire d'ajouter que les personnes civiles sont, comme les autres, sujettes à mourir de leur belle mort et qu'elles meurent dès qu'elles ont cessé d'être utiles quand on ne prolonge point artificiellement leur existence par des protections, des subventions et des privilèges. Prenons le cas d'une religion à son déclin. Comme toutes les autres entreprises, les établissements religieux en décadence sont abandonnés successivement par leur clientèle: d'où il suit que leurs profits vont diminuant et finissent par faire place à des pertes et à des déficits. On comble d'abord ces déficits par des emprunts. Mais si la clientèle continue à déserter, si les déficits subsistent et vont croissant, les emprunts finissent par absorber la valeur de la propriété et les propriétaires sont obligés de liquider l'établissement. Telle eût été la destinée finale et inévitable des établissements religieux du paganisme, et tel est, aux États-Unis, le sort des religions ou des sectes qui ne réussissent point à recruter une clientèle suffisante pour couvrir leurs frais. Il suffit que l'État s'abstienne de les subventionner pour qu'elles ne traînent point une existence inutile; la concurrence se charge d'en faire justice.
En revanche, aussi longtemps qu'un établissement religieux ou autre répond à un besoin, il résiste aux réglementations les plus étroites et même aux prohibitions les plus rigoureuses. Tel est actuellement le cas pour les ordres monastiques et les couvents. On a beau les dissoudre, disperser leurs membres et confisquer leurs biens au nom de la « liberté », on n'a point réussi et on ne réussira point à les extirper. Pourquoi? Parce qu'ils répondent encore à un besoin religieux et surtout, plus que jamais, à un besoin de tutelle dans nos sociétés de self govermnent obligatoire. C'est une forme arriérée et surannée, si l'on veut, de la tutelle, mais qui est encore préférée par beaucoup d'individualités des deux sexes à la responsabilité et l'isolement de leur existence. En vain on la prohibera, elle subsistera quand même. Il n'y a qu'un moyen efficace de la supprimer, c'est la concurrence. Le jour où des institutions de tutelle, mieux adaptées à l'état actuel des hommes et des choses, seront offertes aux individualités qui se sentent incapables de supporter la responsabilité du self government, les ordres monastiques auront vécu et les couvents entreront en liquidation; mais jusque-là iU résisteront victorieusement aux interdictions et aux confiscations du prohibitionnisme libéral et conservateur-révolutionnaire.
On voit par là comment devrait être résolue la question actuellement pendante de la séparation de l'Église et de l'État. En échange des biens que la révolution lui a enlevés, l'Église a accepté une subvention annuelle qui constitue la dotation du culte catholique. Le capital de cette subvention devrait lui être remis avec les édifices affectés au culte. L'atteinte portée par la révolution à la propriété religieuse serait ainsi réparée autant qu'elle peut l'être, et le risque auquel elle a exposé toutes les autres propriétés diminué. Ce qui n'empêcherait pas le catholicisme de disparaître et ses établissements de se liquider le jour où, comme autrefois le paganisme, il aurait cessé do répondre aux besoins religieux de la société et où quelque autre croyance mieux adaptée à ces besoins viendrait lui faire concurrence.
Une dernière question soulevée par les héritiers du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple reste à résoudre. C'est la question de savoir si la confiscation de l'État et la dépossession de la noblesse et du clergé ont été avantageuses à la bourgeoisie; si, par conséquent, la dépossession de la bourgeoisie et la socialisation de l'État seraient avantageuses à la « classe des travailleurs ». Pour les collectivistes du quatrième état, l'affirmative n'est pas douteuse. Ils sont absolument convaincus que la bourgeoisie doit sa fortune à la dépossession de la noblesse et du clergé, à l'acquisition du monopole de l'exploitation de l'État, aux emplois, aux privilèges et aux faveurs que ce monopole lui a valus, et bon nombre de bourgeois, même éclairés, sont, au fond, du même avis. Cependant rien n'est plus contestable; disons mieux, rien n'est plus, contraire à la vérité.
Nous ferons remarquer d'abord que la classe moyenne de la GrandeBretagne s'est enrichie beaucoup plus encore que la nôtre, quoique la puissance politique soit restée jusqu'au Reform bill entre les mains de l'aristocratie. Nous ferons remarquer ensuite que la bourgeoisie française est, de toutes les classes de la nation, la noblesse et le clergé y compris, celle dont la fortune et l'influence se sont le plus augmentées dans les derniers siècles de l'ancien régime. En supposant que la révolution n'eût pas éclaté, et même que la bourgeoisie n'eût pas acquis jusqu'à présent la puissance politique, le développement prodigieux de l'industrie n'aurait pas manqué d'accroître sa fortune et son influence dans une mesure plus considérable encore qu'au siècle précédent. Elle n'aurait pas disposé peut-être d'une manière aussi complète du débouché des fonctions et des emplois politiques et administratifs, elle aurait moins émargé au budget, son industrie eût été moins protégée, le régime prohibitif n'eût point succédé au régime libéral inauguré par le traité de 1786, le monopole de la banque de France n'eût pas été institué, les ouvriers n'eussent pas été_mis à la discrétion des patrons par la suppression du droit d'association et les lois sur les coalitions; mais est-il bien avéré que l'émargement au budget, les monopoles et la protection ont contribué à augmenter la richesse, la vitalité et la puissance réelle de la bourgeoisie? Les emplois publics, en exigeant, avec un travail moins assidu, moins d'efforts d'intelligence et de volonté que les emplois de l'industrie privée, n'ont-ils pas pour effet d'affaiblir, à la longue, physiquement et intellectuellement ceux qui les exercent, et cet affaiblissement ne devient-il pas héréditaire? Si les monopoles et la protection enrichissent un petit nombre d'actionnaires d'établissements privilégiés, de propriétaires et d'entrepreneurs d'industrie, n'est-ce pas aux dépens du grand nombre des capitalistes et des hommes industrieux dont ils augmentent les charges et rétrécissent les débouchés? En laissant même de côté la démoralisation dont l'exploitation de l'État et les compétitions qu'elle provoque ont été la source pour la classe moyenne, on peut affirmer qu'elle serait aujourd'hui plus riche, plus influente, plus saine et aussi moins menacée si la révolution n'avait pas fait tomber entre ses mains la puissance politique. Maintenant supposons qu'une révolution complémentaire fasse descendre cette puissance dans le quatrième état, supposons même que ce quatrième état confisque les biens de la bourgeoisie capitaliste au profit de la « classe des travailleurs » et établisse en faveur de celle-ci un régime de monopole et de protection analogue à celui dont la première révolution a doté la classe moyenne, est-il bien certain que les travailleurs en deviendront plus riches? Il ne faut pas être bien fort en économie politique pour prévoir que la production de la richesse diminuera de la moitié ou des trois quarts sous ce nouveau régime ; que les biens et les capitaux confisqués aux bourgeois seront promptement gaspillés et détruits, et que le quatrième état ne régnera que sur des ruines et des cadavres. N'en déplaise aux collectivistes et aux anarchistes, ce n'est pas la possession de l'État qui a fait la fortune de la bourgeoisie; elle ferait encore moins celle du peuple.
Sans doute, la domination exclusive d'une classe est nuisible à toutes les autres. Mais s'ensuit-il que le monopole de la puissance politique soit avantageux, malgré ses bénéfices apparents, à la classe qui le possède? La noblesse et le clergé sont tombés en décadence pour l'avoir accaparé sous l'ancien régime. Il no se passera pas longtemps avant que les bourgeoisies politiciennes qui gouvernent actuellement la plupart des États modernes subissent le même sort. Tout ce que peuvent souhaiter les sincères amis du peuple; dans l'intérêt de son bien-être et de ses progrès matériels et moraux, c'est qu'une nouvelle révolution collectiviste ou anarchiste ne lui ïasse point ce présent décevant et funeste.
[65] La souveraineté individuelle contient la souveraineté politique, et celleci a ses limites déterminées par la nature même du besoin auquel pourvoit la production de la sécurité ou le gouvernement. Est-il nécessaire de remarquer que cotte théorie est en opposition absolue avec la théorie monarchique et la théorie révolutionnaire de la souveraineté? Celles-ci, à les bien considérer, sont identiques, ou du moins elles se ressemblent eu ce point capital qu'elles ne comportent pas de limites. Le roi ou l'empereur, dans la théorie monarchique, tient sa souveraineté de Dieu lui-même; il ne doit compte qu'à Dieu de l'usage qu'il en fait; clic est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au souverain de lui imposer. Dans la théorie révolutionnaire, le peuple rentre en possession de la souveraineté qu'avait usurpée le roi ou l'empereur, et il n'en doit compte qu'à lui-même; elle est absolue et sans autres limites que celles qu'il plaît au peuple ou à ses mandataires de lui marquer; encore est-ce une question de savoir si les mandataires peuvent, sans se rendre coupables d'usurpation, limiter le droit du souverain. Avons-nous besoin de remarquer encore que ces deux théories ou plutôt cette théorie place la souveraineté individuelle, c'cst-ù-dirc la propriété et la liberté de l'individu, entièrement à la merci de l'homme ou du parti qui exerce la souveraineté politique? C'est en vertu de cette théorie que les despotes asiatiques confisquent les biens et font tomber les tètes de leurs sujets; c'est en vertu de la mémo théorie que le « peuple souverain i/ a confisqué, en France, les biens de la noblesse et du clergé, — non sans couper le cou aux nobles et aux prêtres récalcitrants, — et qu'il confisquera, quelque jour, ceux de la bourgeoisie propriétaire et capitaliste; c'est, pour tout dire, la théorie du despotisme.
[66] La philanthropie est le produit des sentiments de la justice et de la charité ou de l'amour et de la compassion pour les opprimés, les souffrants et les faibles, — ce qui la rend particulièrement respectable, — mais associés à l'ignorance de la nature des hommes et des choses et à la conscience de l'infaillibilité du philanthrope, — ce qui la rend particulièrement redoutable. Un philanthrope religieux qui a une foi absolue dans les dogmes de son Eglise (et peut-on avoir une foi absolue sans se croire soi-même infaillible?), qui est convaincu que, hors de cette tàglise, il n'y a point de salut, que les hérétiques et les schismatiqucs sont voués au feu éternel, s'émeut de ce péril affreux; il s'efforce de le conjurer, d'abord en employant la persuasion, ensuite, si la persuasion demeure inefficace, en recourant à des moyens plus sûrs, à la torture et au bûcher. Ce n'est point, cependant, en vue de sauver leurs âmes, comme l'a supposé un poète illustre, qu'il torture et brûle les hérétiques. Non ! en refusant d'écouter sa parole, ils ont montré visiblement que le démon s'était déjà emparé d'eux, et le philanthrope religieux ne se berce point du vain espoir de les dérober au feu eternel. Mais, du moins, il préservera d'une infection mille fois pire que la peste, la multitude des ignorants et des simples, et il sera d'autant moins accessible à la pitié que sa foi sera plus profonde et sou amour rdu prochain plus intense. Tels étaient les saint Dominique et les Torquemada. — Un philanthrope politique qui a foi dans la vertu souveraine d'une certaine forme de gouvernement pour faire le bonheur du peuple ne reculera de même devant aucune violence pour l'établir. Il aura beau être un homme sensible et caresser des tourterelles comme Couthon, ou avoir écrit un plaidoyer contre la peine de mort comme Robespierre, il cédera à la nécessité de dresser des échafauds et d'y faire,monter des femmes, des enfants et des vieillards. A plus forte raison, s'il s'agit de « chasser l'étranger » et de faire une nation « une ». Alors le philanthrope politique n'éprouvera aucun scrupule à recourir au poignard et à organiser l'assassinat; il sera Mazzini. A plus forte raison encore, s'il s'agit d'arracher l'humanité entière à l'oppression et à la misère, en mettant fin à la domination de ceux qui l'ont, de tout temps, opprimée et exploitée. Comment le philanthrope socialiste, communiste, collectiviste ou nihiliste, qui possède une panacée sociale, reculerait-il devant le devoir impérieux de supprimer, par les moyens les plus cxpéditifs et les plus sûrs, les tyrans et les exploiteurs qui se refusent obstinément à appliquer cette panacée de salut? Enfin, le philanthrope libéral qui a foi dans la vertu universelle du self government n'a-t-il pas le droit de l'imposer à toutes les variétés de l'espèce humaine? S'il joint à sa foi en la liberté un amour spécial pour la race de Cham, il n'hésitera pas à réclamer l'emploi de la force pour supprimer la traite, et il lui paraîtra juste et raisonnable de contraindre les contribuables blancs à payer les frais de l'abolition de l'esclavage des noirs. Il encouragera au besoin l'incendie des habitations et le massacre des propriétaires, comme à Saint-Domingue; ou bien il contribuera, comme aux États-Unis, à fomenter une guerre civile, dans laquelle des centaines de milliers de vies seront offertes en holocauste à la liberté nègre. Il en gémira peut-être, mais il ne persistera pas moins à se considérer sincèrement comme un bienfaiteur de l'humanité.
Si l'on pouvait faire le compte des maux causés par la philanthropie religieuse, politique, socialiste, libérale et négrophile, on trouverait certainement qu'ils dépassent ceux que la perversité des méchants a infligés à notre malheureuse espèce, depuis sa naissance. La puissance malfaisante des méchants est limitée, car ils sont l'objet d'une juste méfiance et généralement antipathiques, tandis que le philanthrope, l'ami des hommes, est entouré d'une confiance et d'une considération qui lui procurent un pouvoir et une influence extraordinaires.
Ce philanthrope qui, fort de son amour pour le peuple blanc ou noir, de l'infaillibilité de sa science et de la vertu de sa panacée, ne se laisse arrêter par aucune considération de morale vulgaire, s'expose cependant, si sa science est fausse, ou, ce qui revient au même, incomplète, si sa panacée est vicieuse, à commettre une double « nuisance ». Il court non seulement le risque de sacrifier en pure perte des hommes et des capitaux, mais encore de jeter le discrédit sur la cause qu'il prétend servir. Les philanthropes religieux qui élevaient des autodafés ont rendu la religion odieuse; les philanthropes politiques, libérateurs et unificateurs de nations, nous ont fait prendre en grippe les peuples opprimés; les philanthropes socialistes, communistes et nihilistes ont endurci les cœurs les plus disposés à s'apitoyer sur les maux des classes ouvrières, et les philanthropes négrophiles nous ont dégoûtés des nègres.
Est-ce à dire qu'il faille se désintéresser des misères humaines et attendre passivement leur guérison de l'opération assurée mais lente de la machinery du progrès? Non. sans doute. C'est le devoir de tout homme de venir en aide à ses semblables et de contribuer ù soulager leurs maux ; mais ce devoir ne confère aucun droit sur les personnes et les biens d'autrui. On a le droit de mettre sa propre vie et ses propres biens au service d'une cause que l'on croit juste, rien de plus! Encore faut-il que le philanthrope qui se dévoue, lui-même, à une idée, n'ait pas à remplir d'autres obligations plus positives et plus formelles. Sinon, ses intentions ont beau être pures, il est un simple malfaiteur. Dieu nous garde de la philanthropie et des philanthropes!
[67] Depuis 1807, époque de l'abolition de la traite en Angleterre jusqu'en 1819, époque de l'établissement des croisières, 2,290,000 nègres ont été enlevés à la côte d'Afrique. Sur ce nombre, 680,000 ont été expédiés au Brésil, 615,000 dans les colonies espagnoles, et 562,000 dans les autres pays. Le déchet, pendant la traversée, a été de 433.000. Depuis 1819 jusqu'en 1847, le nombre des nègres exportés a été de 2,758,!506 ainsi répartis: Brésil, 1,121,800; colonies espagnoles, 831,027; déchet, 688,299; capturés 117,380. Totaux pendant les quarante années : esclaves importés au Brésil, 1,801,800; dans les colonies espagnoles, 1,446,027; dans les autres contrées, 562,000; déchet pendant la traversée, 1,121,299; capturés depuis 1819, 117,380. Ce qui donne en totalité, depuis la prohibition, 5,048,S06 victimes de la traite. Ces chiffres attestent combien peu les mesures prises pour empêcher le transport des esclaves de la côte d'Afrique ont atteint leur but.
Ce n'est pas tout. Non seulement la prohibition de la traite et les mesures prises pour l'assurer n'ont point arrêté cet odieux trafic, mais elles ont eu pour résultat d'aggraver les souffrances de ses victimes. Avant la prohibition, les nègres transportés étaient généralement bien traités pendant le voyage, car les négriers avaient intérêt à ce que leur marchandise arrivât en bon état à sa destination. Mais à peine les lois répressives de la traite furent-elles mises en vigueur, que toutes les précautions prises pour procurer quelque bien-être aux transportés disparurent. Les négriers n'eurent plus alors qu'un souci : échapper aux croisières. Dans ce but, ils réduisirent au minimum la place réservée à leurs cargaisons, et ils n'embarquèrent plus que les quantités d'eau et de vivres qui leur étaient rigoureusement nécessaires. Le résultat fut que le déchet des cargaisons s'éleva de 14 à 25 p. 000. Cette augmentation du déchet s'explique par les horribles souffrances que la prohibition de la traite infligeait aux victimes de la cupidité des négriers. Les rapports de la Société pour l'abolition de l'esclavage sont remplis des récits de leurs tortures; on n'a que le choix des documents. Nous nous bornerons à rapporter quelques passages d'une déposition du docteur Cliffe. Américain, qui a participé aux opérations de la traite et qui a été en position d'en observer toutes les horreurs.
« Les esclaves, dit le docteur Cliffe, sont entassés pêle-mêle et couchés sur le flanc, dans un mélange confus de bras, de têtes, de jambes, grouillant les uns dans les autres, de sorte qu'il est difficile à l'un d'eux de remuer sans que la masse entière remue en même temps. Sur le même bâtiment, on forme parfois deux ou trois ponts encombrés d'esclaves et dont la hauteur ne dépasse pas un pied et demi ou même un pied. Ils ont ainsi la place nécessaire pour se tenir couchés, aplatis comme l'insecte visqueux; mais un enfant lui-même ne pourrait s'asseoir dans ces longs cercueils à compartiments. On peut dire qu'ils sont arrimés comme des boucauts ou comme des livres sur le.s rayons d'une bibliothèque. Ils sont nourris par un homme qui leur descend une calebasse d'eau et une parcelle d'aliment. Uu petit nombre d'entre eux, ceux qui semblent plus accablés, sont hissés sur le pont au grand air. Avant le redoublement de sévérité de nos lois, on leur distribuait leur nourriture sur le pont, par escouades successives; mais aujourd'hui ce faible adoucissement ne leur est même plus donné. Jadis les négriers amenaient avec eux un chirurgien; aujourd'hui il n'est pas de praticien de quelque valeur qui voulût les suivre. Les bâtiments perdent quelquefois plus de la moitié de leur cargaison, et l'on cite même l'exemple d'un chargement de 160 nègres sur lesquels 16 seulement survécurent au voyage. Rien ne saurait donner une idée des souffrances auxquelles ces malheureux sont soumis, principalement à cause du manque d'eau : comme la présence à bord d'une grande quantité d'eau et de tonneaux expose les négriers à la confiscation, ils sont arrivés, après des calculs d'une odieuse précision, à reconnaître qu'en distribuant une fois tous les trois jours à un individu l'eau contenue dans une tasse de thé, cela suffisait pour lui conserver la vie. Ils limitent en conséquence leurs approvisionnements d'eau fraîche à ce qu'il faut pour empêcher les esclaves de mourir de soif. Rien ne saurait non plus donner une idée exacte de la saleté horrible d'un navire chargé de nègres. Amoncelés et en quelque sorte cncaqués comme le sont les nègres, dit le docteur Cliffe, il devient à peu près impossible de nettoyer le navire, lequel est fort souvent abandonné faute d'un Hercule assez téméraire pour nettoyer ces nouvelles étables d'Augias. Les bâtiments que l'on a purifiés conservent une odeur particulièrement acre et fétide, qui trahit leur destination première. Je reconnus qu'un vaisseau naviguant sur la ente d'Afrique avait servi à la traite par les effluves caractéristiques qui s'en exhalaient. Il est bien certain que si un blanc était plongé dans l'atmosphère où vivent ces malheureux, il serait immédiatement asphyxié. »
Le docteur Cliffc décrit ensuite l'aspect d'une cargaison de nègres au moment du débarquement.
« Les rotules de ces malheureux, dit-il, présentent l'aspect d'un crâne dénudé. Le bi'as se trouve dégarni de toutes les parties musculaires; c'est un os recouvert de peau. Le ventre est protubérant et comme gonflé d'une manièrj maladive. Il faut qu'un homme prenne ces misérables dans ses bras pour les porter hors du bâtiment, car ils ne sont pas capables de marcher. Comme ils ne se sont pas tenus debout pendant un ou deux mois, leurs muscles sont affaiblis au point de ne pouvoir plus les soutenir. Ils ont un air hébété, hagard, et l'on peut dire qu'ils sont descendus jusqu'au dernier degré de l'abaissement au delà duquel il n'y a plus que la brute. Un grand nombre sont tout meurtris, couverts de larges ulcères, de maladies cutanées profondément repoussantes, et la chique se creuse, à travers l'épiderme et jusque dans les chairs, ses horribles refuges. » D'après le docteur Cliffe, pour faire parvenir 65,000 nègres au Brésil, il faut en enlever 100,000 à la côte d'Afrique, et sur les 65,000, il en meurt communément 3, 4 ou 5,000 dans les deux mois qui suivent leur arrivée.
D'autres témoignages recueillis dans les rapports de la Société pour l'aliolition de l'esclavage attestent que la déposition du docteur Cliffe n'est nullement empreinte d'exagération.
Comment donc se fait-il que les mesures prises pour la répression de la traite n'aient pas eu la vertu d'y mettre fin? Ce fait s'explique par les bénéfices considérables du commerce des nègres, bénéfices que la prohibition de la traite a eu pour résultat d'augmenter dans une proportion énorme.
Avant que la traite ne fût défendue, les opérations des négriers donnaient de 20 à 30 p. 000 de profit, tout au plus. Depuis que la traite est devenue un commerce de contrebande, les bénéfices qu'elle rapporte s'élèvent fréquemment jusqu'à 2 ou 300 p. 000. Cette augmentation provient, en premier lieu, de la réduction survenue dans la concurrence des capitaux et des bras qui s'offraient pour faire la traite : les entrepreneurs et les capitalistes honnêtes se sont retirés successivement de ce commerce lorsqu'il a été flétri par la conscience publique et poursuivi par les lois. Les entrepreneurs et les capitalistes les moins scrupuleux seuls ont continué de s'y livrer, et le retrait de leurs concurrents honnêtes a eu pour résultat naturel d'augmenter leurs profits. En second lieu, la demande sans cesse croissante des denrées tropicales qui a eu lieu en Europe depuis soixante ans, du sucre, du café, du tabac, du coton, a occasionné un accroissement correspondant de la demande de bras dans les colonies. Les négriers ont ainsi profité à la fois des découvertes de Watt et d'Arkwright eu Angleterre et de l'affranchissement du travail en France. Ils ont profité même des lois rendues contre leur trafic, sous la généreuse inspiration des apôtres de l'abolition de l'esclavage, absolument comme les usuriers ont profité des lois rendues contre l'usure.
La traita a donc résisté à tous les efforts tentés pour l'abolir, et, dans un de ses rapports, la Société pour l'abolition de l'esclavage était obligée de convenir que « l'étendue et l'activité du commerce des esclaves, bien qu'affectées dans une certaine mesure par la prohibition de la traite, n'avaient pas cessé cependant d'être gouvernées par la demande des produits du travail esc/ave sur les marchés d'Europe. » [Note: Dictionnaire de l'Économie politique. Art. Esclavage.]
« Dans la longue histoire des faits chevaleresques, des actes dictés par les sentiments les plus purs de la bienfaisance, disait The Economist à propos de ce lamentable échec de la prohibition mise au service de la philanthropie, on ne trouve rien qui dépasse en noblesse la croisade que nous avons entreprise contre la traite. Rien n'a été épargné : hommes, choses, argent, menaces, châtiments, tout a été prodigué pour y parvenir. Eh bien, le résultat le plus net de cette campagne philanthropique, que n'eût pas désavouée l'hidalgo de Cervantes, a été que non seulement on brave nos croisières sur toute la côte d'Afrique, mais encore que les souffrances des victimes se sont accrues démesurément. Et ce qui est suprêmement douloureux dans ce triste épisode, c'est que l'approbation générale ne vient pas même nous consoler de notre insuccès. Non seulement on ne nous est pas sympathique, mais on a même pensé et dit tout haut que si nous maintenions ce système répressif, aujourd'hui que toutes ces horreurs se sont révélées et se révèlent à nu, c'est qu'apparemment nous sommes mus, non par un sentiment d'humanité, mais par le désir de faire prospérer nos colonies des Indes Occidentales, — lesquelles sont précisément en pleine décadence depuis la venue de ce système.
« Ceux qui ont concu et proposé ce plan de répression peuvent en rejeter tout l'insuccès sur la perversité de la nature humaine. Mais, quant à nous, nous croirons toujours qu'il faut bien se garder de lutter contre les lois générales qui font agir la majorité des hommes. Ce ne sont pas les jouissances seules et les supcrfluités de la société que compromet leur refoulement : c'est son bien-être, sa vie elle-même dans les conditions les plus humbles.
« L'avenir des races humaines, la route qu'elles ont à parcourir, le but qu'elles atteindront est couvert d'un profond mystère que nous n'essayerons pas de pénétrer. Mais le déchirant et déplorable avortement de notre politique sur la côte d'Afrique prouve, une fois de plus, que ce n'est pas à force de prohibitions et de restrictions, — toutes généreuses qu'elles soient en principe, — que s'élève la condition matérielle ou morale de l'homme, et que tous les efforts arbitrairement appliqués même au triomphe d'une vertu, d'une idée élevée, aboutissent nécessairement à retarder le développement général de l'humanité. »
[68] De même que les mesures prises contre la traite ont aggravé au delà de toute expression le sort des nègres transportés en Amérique, l'émancipation des esclaves d'un certain nombre de colonies et les tentatives abolitionnistes qui se sont produites aux États-Unis ont rendu plus dure la condition des travailleurs encore soumis au régime de l'esclavage. Aux anciennes rigueurs de la discipline des ateliers sont venues s'en joindre de nouvelles, destinées à empêcher des évasions rendues plus faciles et une propagande devenue plus dangereuse.
[69] C'est par milliards que se comptent les pertes et les dommages directs ou indirects causés par l'abolition de l'esclavage accomplie par voie d'insurrection on de prohibition à Saint-Domingue, dans les autres colonies et aux États-Unis. Dans les États du Sud de l'Union, l'émancipation décrétée comme une mesure de guerre a déprécié les propriétés dans une proportion énorme, tandis que les dépenses du gouvernement de ces malheureux États, livrés à la rapacité pans scrupule des politiciens du Nord se sont accrues d'une manière fantastique.
« En 1860, écrivait un propriétaire de la Caroline du Sud, M. Rhett, au New-York Herald, la propriété soumise aux taxes dans la Caroline du Sud était évaluée à 607,818,288 dollars. La taxe annuelle de l'État était de 500,000 dollars. La législature siégeait pendant trois semaines, et chacun de ses membres était payé à raison de 3 dollars par jour, plus les frais de route. Les impressions officielles revenaient à environ 16,000 dollars. Les fonctionnaires publics recevaient des appointements analogues à ceux qu'on leur paye actuellement dans les petits Etats de la Nouvelle-Angleterre, et ils remplissaient eux-mêmes les devoirs de leurs emplois respectifs.
« Aujourd'hui, la propriété taxable de l'État n'est plus évaluée qu'à 140 millions de dollars, — encore cette évaluation est-elle exagérée de la manière la plus manifeste, — et la taxe annuelle de l'État a monté à 1,500,000 dollars. La législature siège pendant des mois et chaque membre reçoit 600 dollars plus les frais de déplacement; en sorte qu'elle coûte 103,000 dollars au lieu de 15,000. Les impressions officielles figurent au budget pour 50,000 dollars, et pendant plusieurs années elles ont coûté jusqu'à 150,000 dollars. Les fonctionnaires de l'État se considèrent maintenant comme des « chefs de département « et ils emploient un commis pour faire leur besogne. Les emplois se sont multipliés, et les salaires ont été largement augmentés au profit de la foule des charlatans politiques. Le gouvernement coûte maintenant, en sus des dépenses de la législature, environ 800,000 dollars annuellement. »
Au moins, la condition des nègres des États du Sud s'est-elle améliorée à la suite de l'émancipation, et de l'amendement à la Constitution qui leur a conféré les « droits politiques »? La décadence de la race nègre dans les anciens États à esclaves aussi bien que dans la plupart des colonies n'est, au contraire, que trop visible et nous avons pu la constater nous-méme. (Voir nos Lettres sur les États-Unis et le Canada.) Tous les témoignages s'accordent malheureusement sur ce point. « Consultez, nous disait-on, les relevés de l'état civil dans le Sud, et vous verrez que la mortalité des enfants de la race nègre est, proportion gardée, double ou triple de celle des enfants de la race blanche. Ceux qui survivent, abandonnés à leurs instincts, sans surveillance et sans discipline, forment une pépinière de vagabonds et de voleurs. La nouvelle génération vaut moins que l'ancienne, élevée sous l'esclavage; la prochaine vaudra moins encore. Les nègres ne soignent ni leurs enfants, ni leurs parents, ni eux-mêmes ; ils sont incapables d'observer les lois les plus nécessaires de l'économie et de l'hygiène domestiques, faute d'une force morale suffisante pour résister aux appétits brutaux et désordonnés dont la nature les a richement pourvus. Voilà pourquoi, le whisky aidant, avant un siècle ils auront disparu de la terre américaine sans y laisser plus de traces que l'Indien Peau-Konge. » CeWe disparition serait plus rapide encore s'ils n'étaient pas protégés par le climat contre la concurrence de la race blanche, et par l'intolérance américaine contre la concurrence de la race jaune. En attendant, malgré les dépenses énormes que les États se sont imposées pour l'instruction du coloured people, le relèvement par l'école a complètement échoué, et le nombre des nègres sachant lire et écrire va même diminuant d'année en année.
« A la distance de deux décades depuis la proclamation de l'émancipation dit le journal The American de Philadelphie, l'examen du progrès réalisé fait découvrir quoi? Qu'il n'y a pas eu de progrès, que les efforts de la philanthropie privée, de l'organisation des États et de la nation ont échoué dans l'accomplissement de la tâche de l'éducation des hommes de couleur. Les chiffres du recensement nous apprennent que de 1870 à 1880, dans tous les États du Sud ayant une grande population de couleur, la Virginie exceptée, le nombre de ceux qui ne savent ni lire ni écrire s'est accru d'une manière absolue et dans beaucoup de cas d'une manière relative. Le tableau ci-dessous montre les nombres respectifs des individus au-dessus de dix ans on 1870 et 1880 qui ne savaient ni lire ni écrire, et la proportion des illettrés dans chaque État en 1880.
| Ne sachant pas lire. | Ne sachant pas écrire. | |||||
| ÉTATS | 1870 | 1880 | 1870 | 1880 | ||
| P. 100. | P. 100 | |||||
| Alabama | 349,771 | 370,279 | 43.5 | 383,012 | 433,447 | 50.9 |
| Arkansas | 111,799 | 153,229 | 28.8 | 133,339 | 202,015 | 38.0 |
| Florida | 66,238 | 70,219 | 38.0 | 71,803 | 80,183 | 43.4 |
| Georgie | 418,553 | 446,683 | 42.8 | 468,593 | 520,416 | 49.9 |
| Kentucky | 249,567 | 258,186 | 22.2 | 332,176 | 348,392 | 29.9 |
| Louisiana | 257,184 | 297,312 | 45.8 | 276,158 | 318,380 | 49.1 |
| Mississippi | 291,718 | 315,612 | 41.9 | 313,310 | 373,201 | 49.5 |
| North Carolina | 339,79 | 367,890 | 38.3 | 397,690 | 463,975 | 48.3 |
| South Carolina | 265,892 | 321,780 | 48.2 | 290,379 | 369,848 | 55.4 |
| Tennessee | 290,549 | 294,385 | 27.7 | 364,697 | 410,722 | 38.7 |
| Texas | 189,423 | 256,223 | 24.1 | 221,703 | 316,432 | 29.7 |
| Virginia | 390,913 | 360,495 | 34.0 | 445,893 | 430,352 | 40.6 |
[70] Voici, par exemple, d'après une correspondance adressée de Nouméa au journal le National (19 janvier 1879), comment s'opèrent les engagements des naturels des Nouvelles-Hébrides pour la Nouvelle-Calédonie.
La traite des nègres, — ce mot sonne mal aux oreilles européennes, — poursuivie jusque dans ses derniers retranchements en Afrique, ne peut exister encora dans une colonie française que sous uns forme adoucie et dissimulée. Voici ce qui a lieu : La population indigène de la Nouvelle-Calédonie a toujours été assez restreinte; l'occupation a eu pour résultat de l'amoindrir encore, tout en la refoulant dans l'intérieur du pays; dès aujourd'hui, on peut prévoir l'époque où la race des Canaques aura disparu. Pour obvier au manque de bras auxiliaires, quelques commerçants de Nouméa ont eu l'idée, peu humanitaire, mais productive, de fréter des bateaux qui vont mensuellement aux Nouvelles-Hébrides dans le but d'y raccoler des naturels.
Avec l'aide de quelques-uns de leurs chefs, qui sont dans le complot, les indigènes sontfalléchés par des cadeaux, tels que des verroteries sans valeur, des cotonnades aux couleurs voyantes et d'autres menus objets; d'abondantes distributions'de'rhum et de tafia leur sont faites; et Nouméa leur apparaît, à travers la fumée de l'alcool, comme une sorte de terre promise.
A ce moment psychologique a lieu l'entrée eu scène d'un agent investi des fonctions de commissaire, nommé par l'armateur du bateau, et simplement agréé par la direction de l'intérieur. Son rôle consiste à demander à ces pauvres sauvages, — dont il ne parle pas la langue et qui, eux, ne comprennent pas le français, — s'ils veulent venir à la Nouvelle-Calédonie de leur plein gré et en connaissance de cause. La réponse est toujours affirmative: on comprend trop pourquoi; et le bateau lève l'ancre. Quelques jours après des Néo-Hébridais sont débarqués à Nouméa.
Hommes et femmes, à peu près nus, sont exposés pèlc-mèle près des magasins de l'importateur. C'est un spectacle singulièrement pénible : dans cette complète promiscuité, cette marchandise humaine, — on ne saurait employer d'autre terme, — grouille en plein air, sans souci des regards qui s'attachent sur elle. Les amateurs sont nombreux. Ils examinent les noirs, les tournent et les retournent, car le prix varie suivant l'âge et suivant la force. Un NéoHébridais, de l'un ou l'autre sexe, bien constitué et sans défaut apparent, coûte 250 francs pour cinq ans, plus la nourriture,[le gîte et une somme mensuelle de quelques francs.
On le voit, ce n'est pas l'esclavage à vie; mais c'est l'esclavage à temps. Il y a deux sortes d'esclavage, de même qu'il y a deux sortes de travaux forcés.
Les Néo-Hébridais supportent difficilement le climat de la Nouvelle-Calédonie et le genre de vie qu'ils y mènent. Ils meurent dans une proportion effrayante. En consultant au hasard la collection du Moniteur de la NouvelleCalédonie au chapitre des décès, on trouve, par exemple, que, du 1er janvier au 31 mars 1875 — eu trois mois, — 76 Néo-Hébridais sont morts à Nouméa seulement, la plupart âgés de 14 à 18 ans, quelques-uns n'ayant que 8 ans, tous étant censés avoir compris, avant de l'accepter, le contrat qui les lie.
Ému par les articles de quelques journaux anglais, par l'évidence des abus qui se produisaient dans l'opération du recrutement, poussé sans doute aussi par un sentiment d'humanité, le gouverneur actuel a rendu, en date du 8 mai 1878, un arrêté portant que les commissaires du gouvernement, à bord des navires autorisés à effectuer le transport des immigrants néo-hébridais, seraient dorénavant choisis par la direction de l'intérieur. Cet arrêté faisait, pour ainsi dire, l'aveu des faits déplorables qui l'avaient précédé. Il commençait ainsi : « Considérant que les commissaires du gouvernement à bord des bâtiments autorisés à faire le recrutement néo-hébridais ne jouissent pas de toute l'indépendance due aux délicates fonctions dont ils sont investis, etc., etc. »
Déjà, en janvier 1877, l'amiral de Pritzbuer, qui fut pendant trois ans gouverneur, avait dû recommander aux commissaires de s'assurer que les engagements étaient librement contractés, et il avait prescrit, dans ce but, à l'armateur du bateau, de mettre à leur disposition un interprète néo-hébridais. Antérieurement encore, un arrêté réglant les conditions de l'introduction des travailleurs asiatiques, africains et océaniens, et le régime de leur protection dans la colonie, avait été pris par M. de La Richerie le 26 mars 1874; mais cet arrêté visait surtout l'introduction a Nouméa d'hommes relativement éclairés sur leurs droits et sur leurs devoirs. Il est demeuré lettre morte par la force des choses, en ce qui concerne les indigènes des Hébrides, et ne saurait leur être appliqué.
[71] Les philanthropes abolitionnistes ont commis une première et capitale erreur en s'imaginant que l'Afrique était généralement peuplée d'hommes libres, pratiquant le self governement à la manière anglaise, et que l'on réduisait criminellement en esclavage en vue de la traite. La vérité est qu'en Afrique l'esclavage est, au contraire, le fait général, comme il l'était jadis en Europe, et qu'il a, du moins au Congo, le caractère d'une tutelle patriarcale.
« Les nègres au Congo,dit M. Charles Jeaunest (Quatre années au Congo), se divisent en deux parties : les hommes libres et les esclaves. Un esclave peut avoir lui-même des muleks (inférieurs)... Chez les propriétaires, la condition d'esclave diffère, sur bien des points, de ce que ce mot semblerait indiquer. Les maîtres sont très doux avec leurs muleks. Ceux-ci forment une grande famille, et le chef vit avec elle comme les anciens patriarches. Un mulek, à charge d'une certaine redevance, fait du commerce à son compte, se marie, achète des esclaves s'il en a les moyens. C'est alors non plus un esclave, mais bien plutôt un client, dans le sens que les Romains donnaient à ce mot. Si au contraire le mulek ne peut se suffire, il trouve toujours, auprès de son maître, les secours dont il a besoin ; il le respecte, l'aime autant qu'il peut aimer et ne le nomme que son père. Celui-ci, en revanche, le couvre de sa protection et le défend en toute occasion.
« II est une coutume qui, au besoin, protège l'esclave contre la brutalité de son maître. Il peut se réfugier chez un chef quelconque (s'il a des motifs valables) et implorer sa protection en brisant à ses pieds une baguette en bois, dont il lui remet les deux morceaux. Celui-ci doit les rejeter au loin. Cette formule accomplie, l'esclave appartient au nouveau maître qu'il a choisi. Cette coutume serait une cause continuelle de guerre, si la loi ne stipulait que le chef ne peut refuser d'adopter le noir qui se présente ainsi devant lui. »
Il arrive aussi que des nègres se vendent même aux biancs pour obtenir les avantages de la tutelle et de la proteciion attachées à l'esclavage.
« II y a de cela quatre ou cinq ans, dit M. Charles Jeannest, mon ami C... était à Landana. Un jour, un jeune Cabynde, d'une douzaine d'années environ se présente deva ;t lui. « Veux-tu m'acheter? » lui dit-il. G...croit aune plaisanterie et le congédie en riant. Mais le petit bonhomme insiste et fait tant et si bien que, renseignements pris, le marché fut conclu moyennant 12 pans, soit 30 fr. environ. »
Naguère encore, avant que les abolitionnistes eussent réussi à faire interdire ce trafic, les blanc? établis sur la côte achetaient les esclaves à leur maître, et, au témoignage impartial de M. Jeannest, les esclaves trouvaient avantage à ce changement de propriétaires.
« Les blancs ont besoin de travailleurs, souvent les naturels leur refusent leur concours ou cherchent à exploiter le besoin que nous avons d'eux. Poi:r pallier ces inconvénients voici ce que font les blancs, ou plutôt ce qu'ils faisaient, car cette habitude a été abandonnée. Ils achetaient aux riches les esclaves dont, pour une raison ou une autre, ils voulaient se débarrasser. Les blancs les faisaient travailler sans rétribution. Eu échange, ils les nourrissaient, les entretenaient et les couvraient de leur protection. Le plus grand nombre s'attachait à la maison, aux blancs qui les employaient, et les traitaient de pères; ils étaient fiers d'être fils de blancs comme ils disaient, méprisaient leurs compatriotes, et si quelques-uns s'enfuyaient, ce n'était guère que les paresseux pour lesquels tout travail est un supplice... Ce système, j'en suis convaincu, rend un grand service à ces pauvres noirs. Ceux qu'on nous abandonne sont misérables chez eux, maltraités par tous et mourant presque de faim. Chez les blancs, ils ont tout à profusion et sont convenablement traités s'ils se conduisent bien. Enfin, ces captivas apprennent à travailler, à parler le langage des blancs. Au contact de notre civilisation, leur intelligence se développe et ils ne pensent plus à retourner chez eux. J'ai dit que la grande raison de principe s'était tellement répandue qu'on n'achetait plus de captivas. Je ne le regrette pas. mais je trouvais des avantages à ce système. »
En dépit de la « grande raison de principe », M. Jeannest arrive néanmoins à cette conclusion qu'impose à son esprit observateur et judicieux une expérience de quatre années passées au milieu des nègres de la côte : « Pour moi, e l'avoue, il n'existe guère qu'un moyen de les civiliser : ce serait de les éloigner de leur pays. C'est ainsi qu'agissent avec les Krouboys les grandes maisons de la côte et particulièrement les Anglais, et cela au grand avantage des blancs et des noirs. »
La traite ne faisait donc pas descendre des hommes libres à l'état d'esclaves; elle faisait simplement passer des esclaves d'un milieu sauvage dans un milieu civilisé. Si les philanthropes prohibitionnistes ne s'étaient pas mis en travers, ce transport aurait continué de s'opérer dans les conditions hygiéniques et humaines que commandait l'intérêt des trafiquants et qui allaient s'améliorant d'année en année, avant la prohibition de la traite et l'établissement des croisières à la côte d'Afrique. Il est permis d'affirmer de même que les nègres ainsi importés d'Afrique en Amérique n'auraient point tardé, sous l'influence du progrès de la machinery de la production combiné avec l'action de la concurrence, à passer du régime de l'esclavage à celui de la liberté ou de la tutelle libre, le seul qui convienne au plus grand nombre d'entre eux. On peut se faire aisément une idée de la manière dont ce progrès se serait accompli.
Les esclaves achetés par les négriers à la côte d'Afrique étaient revendus par eux aux planteurs qui se trouvaient obligés de pourvoir à leur entretien, de les surveiller et de les gouverner. A ce mode primitif d'exploitation on aurait vu se substituer, selon toute apparence, par un progrès de la division du travail et des entreprises, un système de culture à forfait par des compagnies possédant et exploitant des ateliers de travailleurs importés d'Afrique. En admettant que la coutume qui autorisait l'esclave africain à changer de maître eût été maintenue en vigueur en Amérique, cette coutume l'eût protégé dans une certaine mesure contre l'abus de l'exploitation de son travail, mais il eût été mieux sauvegardé encore par l'intérêt des exploitants. Déjïi l'expérience avait démontré aux planteurs qu'il était de leur intérêt d'abandonner un pécule à l'esclave et de lui laisser la faculté de se racheter afin de le stimuler au travail. Ce stimulant n'aurait pas manqué de devenir de plus en plus nécessaire à mesure que l'outillage des plantations, en se perfectionnant, eût exigé plus de soins, et la concurrence aurait fait justice des exploitants routiniers qui se seraient refusés à y recourir. Les nègres qui se seraient sentis capables de supporter la responsabilité de leur existence auraient acquis peu à peu la liberté; les autres, et c'eût été le plus grand nombre, auraient fait choix de la compagnie exploitante qui leur eût offert les conditions les plus avantageuses de travail et de tutelle. Ils auraient passé ainsi graduellement de l'esclavage au régime supérieur de la tutelle libre, au lieu de passer de l'esclavage à un régime inférieur : celui du self government obligatoire, imposé à des hommes-enfants incapables du self government.
[72] C'est en étudiant les effets de la destruction révolutionnaire, philanthropique ou socialiste des vieilles formes de la tutelle dans l'Orient de l'Europe et en Amérique qu'on se rend compte des causes du mouvement antisémitiquc, qui menace la race juive de persécutions analogues à celles qu'elle a subies au moyen âge, dans des circonstances analogues. Aussi longtemps que le paysan de race slave demeurait soumis à la tutelle du seigneur et le nègre à celle du planteur, l'un et l'autre se trouvaient, dans une certaine mesure, sauvegardés de leur imprévoyance native. Ils ne pouvaient rien hypothéquer et par conséquent rien emprunter. Ils ne pouvaient, de même, que par exception et en cachette, dissiper leur gain et s'abrutir au cabaret, car les seigneurs etles planteurs sévissaient contre les ivrognes et ne souffraient point, pour la plupart, qu'on ouvrît des cabarets dans leurs domaines. L'émancicipation est venue, et aussitôt les émancipés, désormais maîtres de dépenser leur revenu à leur guise et mis en possession des moyens de contracter des dettes, ont été assaillis par une nuée de tentateurs qui offraientà ces hommesenfants des jouissances actuelles contre un paiement futur. Les fils d'Israël étaient les plus habiles et les plus retors de ces tentateurs; paysans et nègres n'ont pas manqué de tomber dans leurs filets et de devenir leurs débiteurs. De là une explosion de haines contre ces créanciers experts à exploiter les vices, l'incurie et l'imprévoyance de leurs clients, des massacres et des expulsions analogues à ceux qui suivirent l'abolition du servage en Occident et produits par la même cause. Est-il nécessaire d'ajouter que ces massacres et ces expulsions ne sauraient remédier au mal? Les usuriers chrétiens prendront la place des juifs pour exploiter les incapables du self government: voilà tout! Le remède, c'est l'établissement d'un nouveau régime de tutelle adapté aux conditions d'existence présentes de l'homme et de la société. Mais, au lieu d'abolir l'ancien régime pour livrer ceux qui y étaient assujettis à un self government qu'ils étaient incapables de supporter, avec le correctif onéreux et impuissant sinon malfaisant de la tutelle gouvernementale, n'eût-il pas été sage de laisser subsister ce régime, en se bornant à écarter les obstacles qui s'opposaient à sa transformation progressive, c'est-à-dire à la substitution de la tutelle libre à la tutelle imposée?
[73] II se peut, disions-nous dans une étude sur la Russie et le Nihilisme (Journal des Économistes, avril 1881),que le serf seigneurial en passant à l'état de serf communal ait éprouvé une vive satisfaction morale ; en revanche, tous les témoignages s'accordent à attester que sa condition matérielle est généralement devenue plus mauvaise. Elle s'est aggravée d'abord parce que le serf émancipé a dû payer en argent, quelles que fussent les circonstances locales, l'annuité substituée à sa redevance en travail. Elle s'est aggravée ensuite parce que, dans certains gouvernements, en dépit des lumières et de l'impartialité infuses de la commission d'émancipation et de ses agents, l'annuité de rachat a été calculée à un taux excessif. « Dans telle région, dit M. Anatole Leroy-Beaulieu (la Russie et les Russes), dans le pays de Smolensk, par exemple, le prix du rachat a été estimé 50 p. 100 au-dessus de la valeur vénale et .le rendement de la terre suffit à peine à en couvrir les charges annuelles. Parfois, dans le gouvernement de Novgorod entre autres, les lots de terre sont offerts pour rien à qui se chargera de l'impôt et il ne se rencontre pas toujours d'amateurs. Dans d'autres régions et parfois dans les mêmes, les paysans n'ont eu que des allocations exiguës, deux, trois ou quatre fois moins de terre qu'ils n'en avaient en jouissance au temps du servage. » Enfin, la condition du paysan s'est aggravée parce qu'à la charge d'une annuité calculée trop haut, s'ajoutant à celle de la capitation, est venue s'adjoindre successivement une variété croissante de fardeaux supplémentaires provenant des « réformes » qui ont été entreprises surtout dans l'intention louable d'améliorer son sort. Il plie littéralement sous le faix. Écoutons à ce sujet un ancien membre du comité d'émancipation, M. Alexandre Kochelew:
« La situation du paysan s'est-elle améliorée à partir de 1861 ? Ou pose souvent cette question, mais elle n'est pas aisée à résoudre. Les abus et les âpretés du régime du servage se sont en effet évanouis. Mais, d'autre part, il dispose maintenant de moins de terre, de moins de bois, il a même moins de crédit qu'autrefois, tandis que ses charges ont augmenté. La situation est aggravée encore par le pouvoir discrétionnaire de la police et par la multiplicité" des autorités que le paysan doit subir bon gré mal gré. L'ancien du village, le maire, le percepteur des impôts, l'ispravnick, le stanovoi, l'ouriadnik, le centenier, le tribunal pour les paysans avec son membre permanent, le maréchal de noblesse, la délégation du zemstvo, etc., etc., chacun commande dans le village. Le paysan pâtit aussi de la variété des tribunaux; le tribunal communal et sa cour de cassation, le tribunal pour les affaires des paysans, le juge de paix. En somme, malgré son self government, le paysan jouit à l'heure qu'il est de bien moins de garanties qu'autrefois.
« Les frais d'entretien de l'administration rurale ont augmenté, les émoluments des maires et des écrivains communaux sont devenus doubles et même triples selon les localités. Le poste « d'ancien » occupe maintenant toute l'activité d'un homme : aussi les meilleurs paysans refusent-ils de s'en charger. Ceux qui l'acceptent deviennent des espèces de fonctionnaires bureaucrates entachés de tous les vices des anciens tchinovniks. Les lenteurs, les négligences, les exactions, les pots-de-vin fleurissent de jour en jour davantage dans nos communes de paysans. Les assemblées communales se distinguaient autrefois par une grande '.dignité, et la voix des pères de famille y était écoutée. Ceux-ci évitent maintenant d'y paraître, et ce sont les fonctionnaires de la commune qui y ont la haute main. Aussi, chez le peuple, toutes ces institutions sont-elles en plein discrédit... Cette désorganisation des institutions communales exerce une influence funeste sur la situation des paysans. Ils perdent toute énergie, tout espoir. Ils vendent leur bétail et cherchent l'oubli au cabaret. L'immoralité va de pair avec cet appauvrissement et les statistiques criminelles des dernières années le prouvent de reste. »
... Les maux résultant du faux système adopté pour l'abolition du servage ont été encore aggravés par cette foule de réformes incohérentes et indigestes, qui ont été empruntées, pour la plupart, sans discernement et avec un aveugle esprit d'imitation à l'Europe... On raconte qu'un amateur de chinoiseries eut un jour la fantaisie de se faire confectionner un service de porcelaine par un habile fabricant de Canton ou de Nankin. Il lui envoya une tasse pour modèle en lui recommandant de l'imiter avec soin. La tasse avait une fêlure. Au bout de quelques mois notre amateur reçoit un service à thé qui était une vraie merveille. Seulement, toutes les tasses étaient fêlées. En imitant les institutions libérales ouréputées telles de l'Occident, les novateurs russes n'ont pas oublié les fêlures; on pourrait même prétendre qu'ils les ont quelque peu élargies. Ils se sont procuré eu France, en Belgique, en Angleterre, en Prusse, un assortiment de porcelaines qu'ils ont copiées avec une fidélité chinoise, tout en accouplant ici un sucrier anglais avec une théière francaise, là une tasse belge avec une soucoupe allemande et en se nattant volontiers d'avoir perfectionné les services à thé... Cette pacotille bigarrée a médiocrement plu aux consommateurs russes, elle leur a paru assez mal adaptée à leurs besoins et terriblement lourde. De quoi souffrait particulièrement la Russie? Elle souffrait avant tout d'un excès d'administration et de l'absence d'un contrôle administratif. Qu'ont fait les novateurs? Au lieu de simplifier l'administration,ils l'ont compliquée davantage et rendue d'autant plus chère. A l'ancien mécanisme administratif des provinces, ils ont ajouté deux autres machines à réglementer et à taxer, savoir : le zemstvo de district et le zemstvo de gouvernement, en y adjoignant des « commissions de permanence » zemskaia ouprava, dont les membres reçoivent des appointements de 1,500 à 2,000 roubles pour faire une partie de la besogne des anciens tchinovniks. Comme il fallait s'y attendre, le zemstvo et la zemskaia ouprava se sont appliqués aussitôt à augmenter leurs attributions et leur importance, et, comme la chose ne pouvait se faire sans accroître en même temps les dépenses, il a fallu aussi élever d'autant les charges. « Vers 1865, au début de l'institution, les recettes réunies des vingt-neuf ou trente gouvernements alors en possession d'assemblées territoriales atteignaient à peine 5 millions de roubles ; en 1868 elles montaient, déjà à 14 millions 1/2, ayant triplé en trois ans. En 1872, le total de ces budgets provinciaux montait pour trente-deux gouvernements, à 19 millions de roubles, en 1873 il dépassait 21 millions, en 1874 il approchait de 23 millions de roubles, et cette constante progression s'est, croyons-nous, maintenue dans les années suivantes. » (A. Leroy-Beaulieu, la Russie et les Russes.) La plus grande partie, sinon la presque totalité de ces charges supplémentaires retombe sur les paysans et elles s'ajoutent à celles qui proviennent du rachat et de « l'organisation » des communes émancipées. D'après les évaluations de la commission chargée de faire une enquête sur les résultats de l'émancipation, les taxes communales s'élevaient en 1876 au total véritablement énorme de 30 millions de roubles et elles varient selon les communes de 31 copecks à 2 roubles 93 copecks par tête, sans compter, bien entendu, ce que les exactions et les malversations des slarostas, des starchinas, des petits ou des grands tchinovniks (employés) peuvent y ajouter. Les taxes provinciales ont suivi une progression analogue les impôts de l'État proprement dit n'ont pas diminué, et les uns comme les autres continuent de peser presque exclusivement sur les paysans. La commission d'enquête, évaluant en effet à une somme totale de 208 millions de roubles la somme des impôts, charges et redevances de toute nature, y compris les payements du rachat que supporte l'agriculture, fait la remarque que sur cette somme il n'y a que 13 millions environ qui 'grèvent les terres des propriétaires, tandis que 195 millions sont à la charge des paysans... Au moins les contribuables en ont-ils pour leur argent? La gestion des zemstvos, par exemple, est-elle supérieure à celle des anciens tchinovniks ? Les membres de la zemskaia ouprava qui en sont chargés se recrutent, poiir la plupart, parmi les petits propriétaires qui ont mal fait leurs affaires, et qui ont réussi, on manipulant convenablement la pâte électorale, à émarger 1,500 ou 2,000 roubles par an au budget provincial sans se donner trop de peine et sans avoir à redouter un contrôle trop rigide. Leurs collègues non rétribués des zemstvos no se piquent pas, en effet, d'une assiduité exemplaire et le plus grand nombre de ces assemblées provinciales à la mode belge réussissent rarement à réunir plus du tiers de leurs membres. [Note 1: see below]
A la vérité, par une interversion singulière de leur rôle naturel, elles sont placées sous le controle du gouverneur qu'elles devraient avoir pour mission spéciale, sinon unique, de contrôler; il a le droit de s'opposer à toutes les résolutions et mesures qui lui paraissent contraires aux vrais intérêts de l'Empire, et, par surcroit de précaution, le compte rendu des délibérations des zemstvos est soumis à sa censure. Voilà comment ont été comprises la décentralisation et la réforme de l'administration des provinces. On peut eu dire autant de celle de l'administration des villes qui a été accomplie sur le même plan et qui n'a eu jusqu'à présent d'autres résultats qu'une augmentation effrénée de leurs dépenses et de leurs dettes [Note 2: see below] ... La réforme judiciaire n'a pas été moins lourde. C'était sans contredit une réforme nécessaire et mémo la plus nécessaire de toutes; mais comment s'y est-on pris pour la faire? Les esprits sont, comme on sait, fort divisés sur la question du recrutement du personnel judiciaire. Les juges doivent-ils être nommés ou élus? Les réformateurs russes ont résolu cette question difficile en adoptant les deux systèmes, le système anglais ou américain pour la justice de paix, le système français pour la justice ordinaire, en rendant ces deux séries de tribunaux complètement indépendantes l'une de l'autre et en les organisant chacune de toutes pièces. Cette organisation en double coûte naturellement fort cher, et il ne parait pas malheureusement qu'elle ait eu la vertu d'abréger la durée des procès... Enfin, les réformateurs russes ont emprunté à la Prusse ses institutions militaires. Ce système a eu pour résultat, eu Russie comme ailleurs, d'alourdir sensiblement le fardeau des charges militaires. Autrefois la durée du service était de vingt-cinq ans, et le sort des malheureuses recrues enlevées à la rie civile était sans doute peu enviable; mais les seigneurs et les communautés se débarrassaient ainsi des mauvais sujets, voleurs, escrocs, faussaires, vagabonds que la discipline militaire se chargeait de mater; on choisissait encore de préférence les recrues dans les familles trop nombreuses; en sorte que les forces productives de l'empire n'étaient que faiblement atteintes par l'impôt du sang. Il en est autrement aujourd'hui. Tout le monde est assujetti au servage militaire. La durée de ce servage d'État est de six ans dans l'armée active, et il enlève ainsi aux travaux productifs la fleur de la jeunesse, en leur laissant le rebut physique et moral de chaque génération. La jeunesse des classes supérieures échappe, à la vérité, en partie aux rigueurs de ce système, grâce à un privilège de clergie, un abus de l'ancien régime devenu un progrès dans le nouveau! Eu revanche, elle n'a pas échappé à l'alourdissement progressif des programmes d'études... D'un côté, on a rendu plus facile l'accès des universités et des autres établissements d'instruction, que l'on s'est efforcé de nraltiplier, toujours naturellement aux frais des contribuables, et d'un autre côté on a rendu les examens de plus en plus difficiles. Les programmes sont surchargés et les étudiants n'y peuvent suffire. La proportion des élèves des gymnases qui parviennent à terminer leurs études et à franchir le terrible défilé des examens ne dépasse pas 4 p. 100. Qu'en résulte-t-il? C'est qu'une multitude de jeunes gens attirés par les facilités décevantes de l'entrée dans les gymnases et les universités, et ne pouvant, à la sortie, obtenir les diplômes nécessaires pour exercer une profession libérale, dégoûtés, en outre, par ce commencement d'instruction supérieure, des carrières plus modestes auxquelles d'ailleurs cette instruction basée sur l'étude des langues mortes ne les a point préparés, ont formé une classe de plus en plus nombreuse de déclassés et de mécontents qui est devenue la pépinière du nihilisme.
Toutes ces pseudo-réformes n'ont pas manqué de coûter fort cher. Avant qu'elles ne commençassent à sévir, en 1857, le budget des dépenses de l'Empire russe était de 3i7 millions de roubles ; en 1881, il a atteint 67 i millions de roubles, le double, sans compter les dépenses extraordinaires de la dernière guerre, évaluées par un financier russe, M. H. Raffalovich, à environ 1 milliard de roubles. La dette publique qui ne dépassait pas, en y comprenant la circulation fiduciaire (les assignats), 450 ou 500 millions de roubles à la mort de l'empereur Nicolas, atteignait au l»r janvier 1878 2 milliards 50i millions de roubles (le papier-monnaie était compris dans ce chiffre pour 1,106 millions). Elle s'est donc grossie de 2 milliards de roubles et elle a quintuplé en vingt-cinq ans. Le budget de la guerre, qui n'exigeait que 91 millions de roubles en 18S5, en absorbe actuellement 193. A ces charges croissantes du budget de l'État, il faut ajouter celles non moins croissantes des budgets des provinces, des villes et des communes, sans oublier celles du rachat obligatoire des terres par les paysans émancipés. Il faut ajouter enfin le tribut, progressivement alourdi depuis la dernière guerre, que le système protecteur prélève sur la masse des consommateurs. C'est encore à l'émancipation faite par des procédés socialistes et révolutionnaires qu'il faut attribuer l'aggravation continue de ce système, qui ajoute aux impôts perçus au profit de l'État un autre impôt non moins lourd, perçu au profit de coteries influentes de monopoleurs peu scrupuleux sur le choix des moyens de s'enrichir. Les propriétaires dont la fortune était compromise par l'émancipation et par la brusque liquidation des établissements de crédit de la couronne, ont demandé à la protection les moyens de la refaire. Le procédé était simple. En exhaussant le tarif des douanes, on créait, instantanément, [un vide sur le marché; les prix s'élevaient aussitôt et l'on réalisait ainsi, en sus des profits ordinaires, une prime de 25, 30 et même 50 p. 100. Comment l'esprit d'entreprise et les capitaux n'auraient-ils pas été attirés dans les industries primées ? Seulement, ces agents et ces éléments de la production, le système protecteur était impuissant à les créer, il ne pouvait que les déplacer et les détourner d'autres destinations productives. Il les a détournés de la grande industrie naturelle de la Russie, l'agriculture, déjà si cruellement éprouvée par l'émancipation et accablée sous le fardeau croissant des impôts et des charges de tous genres. Le résultat a été qu'en dépit du développement des moyens de communication et de l'augmentation énorme de la demande des produits alimentaires à l'étranger, la production agricole de la Russie a cessé de se développer. En 1870, la quantité de tchetverts de blé de tchetvert équivaut à 2,91 hectol.) ensemencés et récoltés dans la Russie d'Europe était de 69,988,000 et de 301,744,000; en 1878, elle ne s'élevait encore qu'à 71,182,000 et à 300,350,000. La production animale est dans une situation analogue. La quantité du bétail est demeurée stationnaire en proportion des terrains défrichés et elle a diminué relativement à la population. La Russie d'Europe possédait, en 1851, 20,962,000 bêtes à cornes, 27,527,000 moutons et 16,154,000 chevaux ; en 1876, elle n'avait encore que 21,857,000 bêtes à cornes, 44,92^,000 moutons et 16,151,000 chevaux, tandis que sa population a monté de 60,255,000 en 1846 à 71,872,000 en 1879. Une augmentation de charges et une diminution de ressources, voilà le résumé du bilan de la situation de l'immense majorité de la population de la Russie depuis l'inauguration de la politique dite des réformes. Faut-il s'étonner si cette politique, dictée cependant par les intentions les plus philanthropiques n a abouti qu'à susciter un mécontentement universel et à engendrer le monstrueux succube du nihilisme?
A cette situation critique, les hommes de progrès à la mode occidentale ne voient qu'un remède : une constitution qui établisse le régime représentatif et parlementaire, c'est-à-dire le gouvernement alternatif des partis, impliquant la création d'un double ou d'un triple personnel politique à rétribuer aux frais des contribuables. L'invasion terrifiante du" nihilisme a eu du moins le bon résultat de faire ajourner cette panacée et de retarder ainsi la marche de la révolution. Mais ce n'est qu'un ajournement, et la Russie est fatalement entraînée aujourd'hui dans la voie rétrograde et semée de précipices où s'est jetée la France en 1789, sans avoir comme elle l'excuse d'ignorer où elle va. A la vérité, les Russes des classes supérieures s'imaginent que l'amour du paysan pour le tsar suffira pour conjurer le péril des révolutions. Mais ils oublient que l'émancipation et les autres « réformes » ont changé du tout au tout la situation du tsar vis-à-vis des paysans. Il était autrefois leur protecteur naturel contre les abus du monopole seigneurial. Il limitait la durée des corvées et si sa volonté n'était pas toujours obéie, le paysan n'en avait pas moins confiance en son bon vouloir paternel et en sa justice. Aujourd'hui le monopole seigneurial n'existe plus, le paysan a cessé d'être assujetti à la corvée ; en revanche, il paye au gouvernement du tsar des impôts qui sont bien près d'excéder ses forces. Ce n'est plus à l'intendant du seigneur qu'il a affaire, c'est au bureaucrate du tsar, et, en cas de retard dans l'acquittement de ses impôts et redevances,c'est au nom du tsar qu'on fait vendre sa dernière vache. Aussi sa douleur et son indignation à la nouvelle de l'odieux assassinat du tsar libérateur ont-elles été beaucoup moins expansives qu'on ne s'y serait attendu. Encore quelques années du nouveau régime, et l'amour du paysan pour le tsar n'existera plus qu'à l'état de légende. On s'apercevra alors que ce n'est point avec des légendes qu'on arrête la marche des révolutions.
---
Notes in Footnotes
Note 1. « Il arrive souvent, disait le journal le Golos (la Voix) quelque temps avant d'être supprimé, que faute d'un nombre suffisant de membres du zemstvo présents à l'ouverture de l'assemblée générale, la session ne peut avoir lieu. Or il ne faut qu'un tiers du nombre complet des membres pour que les décisions soient valables. La Voix cite un cas semblable survenu au zemstvo provincial de Kischinew. Or la convocation des membres en session extraordinaire avait eu lieu dans le but de venir en aide aux habitants du district d'Àkkerman éprouvé par la disette, et il s'agissait de voter immédiatement un crédit de 300,000 roubles pour l'achat de blé, dont le manque se faisait déjà sentir.
Des cas semblables sont fréquents dans la pratique du zemstvo, et la Voix attribue le mal à la situation anormale de cette institution. Aussi le zemstvo a-t-il cessé d'attirer dans son sein l'élite de la société provinciale, qui s'abstient de plus en plus de l'exercice de fonctions électives. Les personnes qui briguent encore l'honneur d'être élues n'ont en général qu'un but, celui d'obtenir une place rétribuée dans les bureaux de la délégation. Ce contingent de membres du zemstvo unis par le même intérêt personnel forme souvent une masse compacte contre laquelle les membres indépendants se voient impuissants à lutter, d'autant plus que l'assemblée générale ne se trouve que trop souvent en présence de faits accomplis par la délégation et qu'il ne lui reste qu'à sanctionner.
---
Note 2. La moyenne du budget quinquennal de la ville de Saint-Pétersbourg, qui n'était que de 1,976,000 roubles de 1851 à 1855 s'est élevée rapidement depuis l'introduction du nouveau régime municipal, emprunté à l'Occident. De 1871 à 1876 elle a été de 3,974,000 roubles et dans cette dernière année de plus de 5 millions de roubles. Un compte rendu de M. Stassulévitch résumé par le Journal de Saint-Pétersbourg, sur les résultats du nouveau régime de 1872 à 1882, renferme des renseignements édifiants sur le matins operandi de ce régime.
En 1873 il y avait à Saint-Pétersbourg 12,590 électeurs, dont 1,411 seulement avaient usé de leurs droits; en 1877, sur 20,522 électeurs, 2,220 prirent part aux élections. Eu 18811e nombre des électeurs tomba à 17,741, mais celui des votants monta à 2,730. On sait que dans ce laps de temps la population de la capitale s'est accrue de 660,000 à 860,000 habitants, chiffre constaté par le recensement de 1881.
Pour ce qui concerne les travaux du conseil municipal, M. Stassulévitch relève l'extrême lenteur de la conduite des affaires par l'organe de l'assemblée générale. En 1880 il y avait 90 dossiers non entamés; en 1883 — cent onze. Une des principales causes de cette lenteur serait la négligence des délégués à venir assister aux séances du conseil. De 1873 à 1876 il y a eu 288 séances (douze n'ont pu avoir lieu), et de 1877 à 1880 — 263 (neuf n'ont pas eu lieu). Vingt délégués seulement ont assisté à deux cents séances, dans le cours de quatre ans; 133 délégués ont paru do cent à deux cents fois; enfin 109 autres ne sont pas même venus cent fois à l'Hôtel de Ville. En 1880, trente délégués n'y ont pas assisté du tout, et il y en a même quatre qui, depuis quatre ans, n'ont mis le pied à aucune séance de l'assemblée! Cette inexactitude des délégués agit d'une manière néfaste sur la solution des affaires importantes, qui exigent, pour être tranchées, la présence de la moitié des membres et une majorité des deux tiers des voix. Telle affaire importante est revenue à la charge 22 l'ois, et il y en a une, — le projet de conversion des prestations en nature en impôts pécuniaires pour le pavage des rues, — qui revient depuis douze ans sans pouvoir être résolue.
Ce qui nuit en outre beaucoup à la marche régulière des affaires, c'est le désordre qui règne dans les délibérations. Les mêmes délégués parlent constamment — il y eu a un, par exemple, qui en 1874 a pris 222 fois la parole; — en 1875, 266 fois en 1876, 286 fois. 11 y a eu des cas où le même délégué parlait jusqu'à dix fois dans une seule séance.
...Ce qui est digne de mention, dit un autre écrivain russe, M. Stchepkine, c'est que dans plusieurs villes l'entretien de l'administration municipale absorbe la plus grande partie des ressources annuelles : ainsi à Mojaïsk, sur un revenu de 4,000 roubles, — 1.696 r. seulement sont consacrés aux besoins des habitants, le reste de la somme étant mangée par ces messieurs de la municipalité. La proportion est autre dans les villes plus grandes; mais les sommes consacrées à l'administration sont cependant excessives: à Kolomna 9,640 r. sur 38,400 de recettes, et à Serpoukhow 12,600 r. sur 68,500!
[74] Voir le recueil des anciennes lois de l'Irlande et notamment le Code des Bréhons.
[75] La plupart des branches de l'industrie manufacturière étaient frappées par des prohibitions à la sortie; ainsi, par exemple, il était défendu d'exporter du verre d'Irlande, et l'Angleterre s'attribuait, en outre, le monopole de l'importation de cet article; la même prohibition fut imposée aux étoffes de laine, dont la production avait pris un développement considérable ; le roi Guillaume déclarait en plein Parlement « qu'il ferait tout ce qui était eu son pouvoir pour décourager les manufactures de laine de l'Irlande. » -La sortie des laines brutes et des bestiaux vivants fut également prohibée. Ces deux dernières prohibitions existaient déjà au xvn° siècle, et telle était la crainte que la concurrence irlandaise inspirait aux landlords anglais, qu'à l'époque de l'incendie de Londres, les propriétaires de l'Irlande s'étant réunis pour envoyer aux indigents de la métropole un secours de 30,000 têtes de bétail, cet acte de charité, loin d'exciter en Angleterre le moindre sentiment de reconnaissance, y fut considéré comme une tentative insidieuse dirigée contre la prohibition; peu s'en fallut même qu'on n'en repoussât le bienfait.
Le commerce n'était pas moins entravé que l'industrie. Non seulement l'intercourse de l'Irlande avec les différents ports de l'Europe se trouvait arrêté par des restrictions sur tous les produits qui pouvaient faire concurrence aux produits similaires de la Grande-Bretagne; non seulement toutes relations avec l'Asie étaient interdites aux Irlandais, en vertu des chartes accordées aux Compagnies de Londres, mais encore les ports de l'Irlande étaient fermés au commerce des colonies d'Amérique. Quoique l'Irlande offrît aux navires de l'Amérique du Nord les ports les plus spacieux et les plus sûrs de l'Europe, ses habitants étaient privés de tout le bénéfice de cette situation privilégiée; des lois interdisaient l'importation directe en Irlande des produits des colonies américaines; il fallait que ces produits eussent touché préalablement quelque port de l'Angleterre ou du pays de Galles; de plus, l'exportation des produits irlandais pour les colonies était défendue, excepté par certains ports d'Angleterre. Que penser après cela des gens qui attribuent à la liberté commerciale les maux de l'Irlande? (Journal des Économistes. L'Irlande. Mai 1847.)
[76] On peut eu dire autant du Home rule. En admettant même que l'Irlande réussit, grâce à je no sais quel cataclysme politique, à recouvrer son indépendance , sa situation en deviendrait-elle meilleure? Elle ne contribue aujourd'hui à la dépense commune que pour la modique somme de liv. 6,781,000, tandis que l'Angleterre et l'Ecosse fournissent pour leur part liv. 62,893,000; autrement dit, elle est une charge pour ses deux associés. Si elle devenait indépendante, elle serait obligée de subvenir elle-même à tous ses frais de gouvernement intérieur et extérieur; sa dépense serait au moins doublée et il faudrait, par conséquent, doubler aussi ses charges. Serait-elle mieux gouvernée et administrée ? La gestion des services locaux laisse visiblement à désirer : j'ai été frappé de la mauvaise apparence du workhouse de Galway, et les journaux sont remplis de révélations peu édifiantes sur l'administration du workhouse de Belfast; les villes sont mal pavées et malpropres, quoique les budgets municipaux aillent grossissant à vue d'œil, tandis que les prisons et la constabulary qui dépendent du gouvernement central, sont des modèles de bonne organisation et de bonne tenue... Les consommateurs des services publics qui forment la masse de la population n'auraient donc rien à gagner à l'acquisition d'un gouvernement national. J'en dirai autant de cette élite intellectuelle qui a sa part dans le vaste débouché que l'empire britannique offre aux capacités de tous genres. En admettant que ces politiciens, journalistes, etc., gens éveillés mais terriblement remuants, vinssent à refluer sur le marché étroit de l'Irlande nationalisée, pourraient-ils y trouver, avec toute la facilité souhaitable, des positions à la hauteur de leur mérite, et leurs compétitions contribueraient-elles à consolider la paix publique? « L'Irlande indépendante, me disait un Irlandais qui n'était pas un home ruler, serait bientôt déchirée par les partis. Avant dix ans nous aurions la guerre civile. Le Nord, où sont concentrés les capitaux et l'industrie, finirait certainement par battre le Midi, comme la chose s'est passée aux Etats-Unis; les catholiques retomberaient sous le joug des protestants, et qui sait s'ils n'imploreraient pas le secours de l'Angleterre et le rétablissement de l'Union pour se soustraire à ce joug détesté? » Est-il nécessaire d'ajouter que cette agitation, organisée pour réaliser la plus chimérique des utopies politiques, détourne les esprits du progrès possible, effraye les capitaux et oblige l'Angleterre à renforcer ses garnisons? Voilà les bienfaits du Home rule!
Lettres sur l'Irlande adressées au Journal des Débats. L'Irlande, le Canada, Jersey, p. 136.
[77] « Là où la civilisation européenne rencontre des peuples de même race, de même tempérament, doués d'une civilisation moins avancée, mais cependant dirigée dans le même sens, fondée sur les mêmes bases, l'action de cette civilisation peut être féconde et produire de bons résultats. Mais lorsqu'elle se trouve en présence d'une civilisation toute différente, entraînée par un courant d'idées tout différent, fondée sur des principes qui n'ont rien de commun avec ceux sur lesquels elle s'appuie, alors, au lieu de féconder, elle ruine. Dans son action révolutionnaire, elle commence par détruire sans savoir si elle pourra réédifier, et pour mener plus rapidement son œuvre de destruction c'est à la base qu'elle s'attaque d'abord et contre laquelle elle porte ses premiers coups; entre elle et sa rivale il ne peut y avoir de compromis, car elle est absolue et intolérante dans son essence; eue a adopté à son profit la vieille formule ecclésiastique : « En dehors de moi point de salut! » Et, comme elle veut sauver ou dominer à tout prix, elle engage la lutte, lutte ardente, lutte dévastatrice où tous les coups portent, lutte sans quartier ni merci, d'où ne peuvent sortir que l'affaiblissement et la ruine, jusqu'au jour où son adversaire épuisé et meurtri succombe définitivement et la laisse seule maîtresse du champ de bataille. Combien d'exemples n'en avons-nous pas eus déjà? Que sont devenus les Incas, les Peaux-Rouges, les Hindous et les Turcs? »
(Léon Rousset, A travers la Chine.)
[78] Voir notre Cours d'économie politique : La part du travail. —Le mouvement socialiste, suivi de la Pacification des rapports du capital et du travail. — Projet d'une société de placement des ouvriers (publié dans la Revue du mouvement social de M. Ch. Limouzin).
[79] L Évolution économique du xixe siècle. Théorie du progrès. 1 vol. Paris, Reinwald, 1880.
[80] Est-il nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'antagonisme naturel des créatures vivantes, et en particulier de la concurrence des animaux carnassiers, la sécurité faisait, à l'origine, complètement défaut à la race humaine? On a donc été obligé de la « produire. » On l'a produite d'abord individuellement, puis par voie d'association, en la combinant avec l'exercice de l'industrie alimentaire. Les entreprises ainsi organisées étaient grossières et i mparfaitcs; elles ne pouvaient résister à celles qui, fondées sur le principe do la division du travail, s'adonnaient exclusivement à la production de la sécurité. Nous avons vu dans quelles circonstances et à quel moment de l'évolution économique celles-ci ont pu apparaître. Dès que les plantes alimentaires ont été découvertes et que le matériel agricole a été inventé, dès que le travail appliqué à l'agriculture est devenu assez productif pour fournir régulièrement quelque chose de plus que la quantité de subsistances nécessaires au travailleur, d'autres industries ont pu naître et se développer, en constituant des entreprises séparées et spécialisées, et, en première ligne, par ordre de nécessité, la production de la sécurité. Les sociétés d'hommes du proie qui subsistaient de la chasse aux animaux et aux hommes ont trouvé profit alors à transformer leur industrie et à fonder des établissements politiques ayant pour objet d'asservir et d'exploiter les populations adonnées à-la pratique de l'agriculture et de l'industrie. Or qu'étaient ces établissements sinon des ateliers de production de la sécurité? Sans doute, le but que se proposaient ceux qui les fondaient et les exploitaient n'était point de rendre service aux populations asservies, en leur procurant la sécurité nécessaire pour subsister, se multiplier et se civiliser. Leur but était uniquement de les exploiter, comme nous faisons de notre bétail, en tirant de cette exploitation le profit le plus élevé possible, et c'est parce que la production de la sécurité était plus profitable qu'aucune autre qu'ils s'y livraient de préférence. Mais il faut bien remarquer que les choses ne se passent pas différemment dans les autres industries. Le fabricant de drap et le tailleur ne se proposent pas de préserver leurs clients des atteintes du froid, le boulanger d'épargner aux siens les tortures de la faim. Non ! ils se proposent seulement de réaliser un profit, et s'ils ont choisi leur industrie plutôt qu'une autre, ce n'est point parce qu'ils estiment qu'elle peut être plus utile à autrui, mais parce qu'ils la jugent plus avantageuse à eux-mêmes. Ils n'ont pas du tout l'intention de rendre service à leurs semblables, en fabriquant et en faconnant du drap ou du pain, et même leur préoccupation dominante c'est d'en fournir la moindre quantité et la plus basse qualité, au plus haut prix. Celui-là mêle du coton à sa laine, sans ignorer que son étoffe sera d'un moins bon usage, celui-ci emploie de la farine avariée et blanchie au sulfate de cuivre, sans s'inquiéter de savoir si elle ne donnera point la colique au consommateur. S'ils produisent de bonne marchandise et s'ils vendent à bas prix, c'est en vue de conserver leur clientèle ou de l'accroître et parce qu'ils y sont forcés par la concurrence, ce n'est nullement sous l'influence d'un sentiment philanthropique ou humanitaire. Voilà pourquoi aussi les prix de tous les produits et services haussent et leur qualité s'abaisse dès que la pression de la concurrence cesse de se faire sentir.
[81] On objectera peut-être que la concurrence étant, en toute chose, le véhicule du progrès, la concurrence des partis doit engendrer aussi un progrès. Sans doute, elle engendre un progrès dans l'exploitation politique des nations. Supposons que la piraterie ait continué d'être en honneur, il est certain que la concurrence entre pirates aurait eu pour résultat de les rendre plus habiles dans leur art; mais ce progrès eut-il été avantageux pour la navigation et le commerce? Si l'on compare les procédés de rapine et d'exploitation aux époques et dans les pays où la vacance de l'État laisse les populations à la merci des « sociétés » organisées en vue de les piller ou de les exploiter, ou sera frappé certainement des progrès qui ont été accomplis dans cette industrie. Les bandes de barbares qui infestaient les Gaules après la chute de la domination romaine, et, plus tard, les « grandes compagnies », employaient des procédés de rapine et d'exploitation grossiers, brutaux et, par la même, médiocrement productifs. Ces procédés primitifs ne diminuaient pas seulement la richesse des populations, ils en empêchaient la reproduction. L'exploitation politique des partis est beaucoup plus savante, partant plus productive, quoique à la longue elle doive finir par être tout aussi ruineuse. Grâce aux perfectionnements de la machinery de la fiscalité, de la protection, des monopoles et subventions, elle soustrait une part croissante des revenus de la nation sans que celle-ci s'en aperçoive. On peut lui appliquer ce que Cobden disait du monopole : « Le monopole ! oh! c'est un personnage mystérieux qui s'assoit avec votre famille autour de la table à thé, et quand vous mettez un morceau de sucre dans votre tasse, il en prend vitement un autre dans le sucrier; et lorsque votre femme et vos enfants réclament ce morceau de sucre qu'ils ont bien gagné et qu'ils croient leur appartenir, le mystérieux filou, le monopole, leur dit : Je le prends pour votre protection. »
Mais quel est le résultat final de cette opération mystérieuse? C'est d'obliger ceux qui en sont victimes à payer leur sucre plus cher ou, ce qui revient au même, à travailler à la fois pour remplir leur sucrier et celui du « filou ». En dernière analyse, est-ce autre chose qu'une transformation progressive du régime de la corvée?