
GUSTAE DE MOLINARI,
Cours d’économie politique (1863)
Two volumes in One
 |
 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
[Created: 10 Aug. 2022]
[Updated: December 14, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Cours d’économie politique, professé au Musée royal de l’industrie belge, 2 vols. 2nd revised and enlarged edition (Bruxelles et Leipzig: A Lacroix, Ver Broeckoven; Paris: Guillaumin, 1863).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Books/1863_CoursEconomiePolitique/Cours-2-in-1.html
- Tome I. La Production et la Distribution des Richesses.
- Tome II. La Circulation et la Consommation des Richesses.
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
- Vol. 1 in facs. PDF and eBooks: HTML, PDF, and ePub.
- Vol. 2 in facs. PDF and eBooks: HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).
[I-475]
TABLE DES MATIÈRES - Volume I
- Préface de la seconde édition .............. v
- Dédicace .................... ix
- Introduction. — Étymologie du mot économie politique. — Définition de la science économique. — De l’intérêt spéculatif qu’elle présente. — De son utilité. — Réfutation des reproches qui lui ont été adressés. — Qu’elle peut servir d’auxiliaire à la religion, — à la morale, — à la politique de conservation. — Qu’elle est un puissant instrument de progrès .................... 17
- PREMIÈRE PARTIE de la production des richesses
- Première lEçon. — Les besoins et les moyens de production. — L’homme considéré au point de vue économique. — Ses besoins. — Analyse des principaux besoins. — Éléments dônt l’homme dispose pour les satisfaire. — Définition de la production; — du produit; — de la richesse; — des agents productifs; — du travail; — des capitaux fixes et circulants; — des agents naturels appropriés; — non appropriés. — Que le concours de ces agents est nécessaire dans toutes les opérations de la production. — Formule. — Des résultats de la production. — Du produit brut et du produit net. — De l’épargne et de son rôle dans la production .............. 37
- Deuxième leçon. — La spécialisation des industries et l’échange. — Causes naturelles qui déterminent la spécialisation des industries et des fonctions productives; — diversité et inégalité de la répartition [476] des facultés productives parmi les hommes; — diversité et inégalité de la distribution des agents naturels de la production: — nécessité de l’intervention des machines et des connaissances professionnelles. — Développement historique du phénomène de la division du travail. — Point où elle est parvenue dans quelques-unes des branches de l’activité humaine, l’industrie cotonnière, l’imprimerie, l’horlogerie, etc. — Analyse de ses avantages d’après Adam Smith, Babbage et Ch. Lehardy de Beaulieu. — Que la spécialisation des fonctions est le caractère de tout organisme supérieur. — Qu’elle implique l’Échange. — Qu’elle s’opère en raison de l’étendue de la sphère de l’échange. — Extension progressive de la sphère de l’échange et ses conséquences .................... 55
- Troisième leçon. — La valeur et le prix. — Que l’échange des choses s’opère en raison de leur valeur. — Éléments constitutifs de la valeur. — L’utilité. — La rareté. — Que ces deux éléments se combinent à des degrés divers pour constituer la valeur. — Que la valeur existe dans l’état d’isolement, mais seulement comme une notion confuse. — Qu’elle se manifeste et se détermine dans l’échange. — En quoi consiste le prix. — Comment il se fixe. — Loi des quantités et des prix. — Du prix courant et du prix naturel. — Que le prix courant tend incessamment à se confondre avec le prix naturel. — Résumé de la double loi qui préside à la formation des prix ........ 80
- Quatrième leçon. — La valeur et la propriété. — Définition de la propriété. — Qu’elle est un rapport de justice entre la valeur et ceux qui l’ont produite, reçue ou acquise. — Que toute altération de ce rapport engendre une nuisance économique. — Raison de ce phénomène. — Analyse de la propriété. — La propriété considérée dans son objet, la valeur. — Des formes sous lesquelles la valeur s’incarne; — des valeurs personnelles, immobilières et mobilières. — Comment les valeurs périssent. — Comment des valeurs périssables peuvent constituer des capitaux impérissables. — Des chances de plus value et des risques de moins value. — La propriété considérée dans son sujet, le propriétaire. — En quoi consiste le droit de propriété. — Libertés dans lesquelles ce droit se ramifie. — De la capacité nécessaire pour l’exercer. — De la tutelle nécessitée par le défaut de capacité des propriétaires. — De l’effet des restrictions opposées à l’exercice du droit de propriété. — Des risques auxquels ce droit est assujetti et des servitudes qu’ils nécessitent. — Des formes du droit de propriété; — de la propriété commune, individuelle et collective. — Du monopole et de la concurrence ........... 107
- Cinquième leçon. — L’assiette de la production. — Comment l’assiette de la production s’établit, lorsque le producteur est isolé; — que cette assiette n’a rien d’arbitraire; — qu’elle est essentiellement mobile. — Comment elle s’établit sous le régime de la division du travail et de l’échange; — que la loi de la formation des prix apparaît, [477] sous ce régime. comme le grand régulateur de la production; — qu’elle agit incessamment pour faire naître les différentes branches de la production, dans le temps le plus opportun, pour les établir dans les lieux, sous les formes et dans les limites les plus utiles. — Des obstacles qui s’opposent à ce que les différentes branches de la production se localisent de la manière la plus conforme aux ressources du sol et au génie particulier des habitants. — Comment ces obstacles s’aplanissent. — Vice des discussions entamées sur les formes et les limites de la production ........... 132
- Sixième leçon. — L’équilibre de la production et de la consommation. — Importance du problème de l’équilibre de la production et de la consommation. — Comment il se résout sous le régime de la production isolée. — Que M. de Sismondi le croyait insoluble, sous le régime de la production divisée, aussi longtemps qu’elle demeurerait abandonnée à elle-même. — Apologue de M. de Sismondi. — Comment ce problème se résout par l’action de la loi qui préside à la formation des prix. — Causes perturbatrices cui font obstacle à l’équilibre de la production et de la consommation. — L’inconstance des saisons; — le défaut ou l’insuffisance de la connaissance du marché; — le monopole. — Que ces causes perturbatrices s’atténuent et disparaissent peu à peu sous l’influence de la loi de la formation des prix. — Que l’anarchie est un fait exceptionnel dans la production; — que c’est l’ordre qui est la règle .............. 158
- Septième leçon. — La classification et les formes de la production. — De la classification généralement adoptée pour la production. — Ses défauts. — Observations de M. Dunoyer à cet égard. — Que la classification de la production concerne la statistique plutôt que l’économie politique. — Quelles industries il convient de considérer comme productives. — Que les industries qui concernent le personnel de la production ont éminemment ce caractère, que leurs produits soient matériels ou immatériels. — Démonstration de M. Dunoyer. — Quelles industries il convient de considérer comme improductives, — Des formes de la production. — Du revenu et des formes sous lesquelles il est perçu ................. 177
- SECONDE PARTIE de la distribution des richesses
- Huitième leçon. — La part du travail. — En quoi consistent les frais de production du travail. — Que ces frais sont essentiellement inégaux, selon les industries et les fonctions industrielles. — D’où provient cette inégalité? — Que des facultés diverses et inégales employées à la production exigent des frais d’entretien divers et inégaux. — [478] Exemples. — Des frais de renouvellement des travailleurs et des causes qui les diversifient. — De l’influence des inconvéments et des avantages particuliers de chaque industrie sur la rémunération du travail. — Le salaire du bourreau, — de l’artiste, — de l’homme de lettres, — du savant. — Que le progrès industriel élève incessamment la rémunération nécessaire du travail. — Absurdité démontrée du système de l’égalité des salaires. ........... 201
- Neuvième leçon. — La part du travail (suite). — Comment se fixe le prix courant du travail. — Effets de la loi des quantités et des prix sur la rémunération du travail. — Que cette rémunération tend toujours à se confondre avec son taux naturel et nécessaire. — Circonstances perturbatrices, — absence de la liberté du marché, — esclavage. — Éléments constitutifs de l’esclavage. — le monopole d’exploitation et la tutelle. — Comment s’est établi le monopole de l’exploitation. — Raison de l’extrême multiplication des esclaves dans les sociétés primitives. — Raison d’être de la tutelle. — Inégalité naturelle des races et des individualités humaines. — Opinion de M. James Spence sur l’infériorité de la race nègre. — Que la nécessité de la tutelle pour les individualités inférieures est la même que pour les enfants et les femmes. — En quoi consiste, sous le rapport économique, le gouvernement de soi-même. — Que l’homme ne peut utilement être libre qu’à la condition de posséder la capacité nécessaire pour supporter la responsabilité attachée à la liberté. — Que la tutelle peut être libre ou imposée. et dans quels càs. — Que l’esclavage et le servage ont été les formes primitives de la tutelle. — Que l’abolition de l’esclavage et du servage n’impliquent pas celle de la tutelle. — Erreur des abolitionnistes à cet égard. — Maux causés par cette erreur. — Nécessité de substituer la tutelle libre à la tutelle monopolisée au lieu de supprimer à la fois le monopole et la tutelle. — Conséquences bienfaisantes du développement de la tutelle libre. — Formule du prix courant du travail engagé ......... 224
- Dixième leçon. — La part du travail (fin). — De la part éventuelle ou profit. — De quoi se compose le profit. — Son taux naturel et son taux courant. — De la part fixe ou salaire. — Raison d’être de cette forme de la rémunération du travail. — Pourquoi l’Association intégrale n’est pas possible. — Que le travailleur n’a aucun avantage à recevoir sa rémunération sous forme d’une part éventuelle plutôt que sous forme d’une part fixe. — Causes perturbatrices qui font descendre le salaire au dessous de son taux naturel et nécessaire. — De l’insuffisance du développement du commerce de travail ou du marchandage. — Maux qui en résultent pour l’ouvrier. — Infériorité de sa situation vis-à-vis de l’entrepreneur. — Conséquences: avilissement du salaire, abaissement de la qualité du travail. — Que cette situation ne présente à l’entrepreneur d’industrie que des avantages illusoires. — Comparaison avec le commerce des grains. — Bienfaits [479] qui résulteraient pour l’ouvrier et pour l’entrepreneur d’industrie du développement normal de ce commerce. — Causes qui ont jusqu’à présent entravé ce développement. — Progrès que le marchandage rendrait possibles. ................. 249
- Onzième leçon. — La part du capital. — En quoi consiste le matériel de la production. — Des capitaux fixes et circulants. — Caractères auxquels ils se reconnaissent. — Éléments du prix naturel du service des capitaux. — Des risques de la production. — Qu’ils sont essentiellement divers et variables. — Qu’ils doivent être couverts. — Comment ils peuvent être abaissés. — De la privation. — En quoi elle consiste. — Qu’elle doit être compensée. — Que la prime nécessaire pour la compenser est plus ou moins élevée selon que le capital peut être plus ou moins aisément dégagé ou réalisé. — Exemple. — Autres éléments du prix naturel du service des capitaux. — Les inconvénients ou les avantages particuliers de chaque industrie. — Que le progrès agit incessamment pour abaisser les frais de production du service des capitaux. — De la part proportionnelle de produit net qui s’ajoute aux frais de production de ce service pour composer son prix naturel. — Sa raison d’être. — Qu’on ne peut la supprimer et mettre le capital à la portion congrue. .......... 281
- Douzième leçon. — La part du capital (suite). — Du prix courant du service productif du capital. — Comment il gravite autour du prix naturel de ce service. — Des formes sous lesquelles il est perçu. — En quoi consistent le profit, — le dividende, — le loyer, — l’intérêt. — Qu’il y a toujours entre ces différentes formes de la rémunération du capital proportionnalité ou équivalence. — Que l’on a cependant attaqué l’intérêt d’une manière spéciale. — Historique du préjugé contre le prêt à intérêt. — Arguments employés pour justifier ce préjugé. — Circonstances qui ont pu lui donner naissance et le faire subsister jusqu’à nos jours. — D’où est venue la réaction contre ce préjugé. — Comment et par qui il a été battu en brêche. — Atténuations que l’Église catholique a apportées à sa doctrine prohibitive du prêt à intérêt. — Du dommage naissant et du lucre cessant. — État actuel de la question. — Aperçu des inconvénients de la limitation du taux de l’intérêt. — Résumé. — A quoi aboutissent les déclamations contre le capital .................. 306
- Treizième leçon. — La part de la terre. — Comment se règle la part des agents naturels appropriés ou de la terre. — Analyse des opérations nécessaires pour approprier la terre à la production. — La découverte, — l’occupation, — le défrichement. — Que ces opérations ne procurent pas des profits supérieurs à ceux des autres industries. — Du prix naturel du service productif du sol. — Éléments qui le composent. — Les frais nécessaires d’entretien des fonds de terre, — la privation, — le risque. — La chance heureuse ou l’avantage futur provenant de la plus value que les progrès de la population et de la [480] richesse attribuent au sol. — Comment se distribue cette plus value, selon la situation et la qualité des terres. — Comme elle se déplace. — Autres avantages particuliers qui s’attachent à la propriété territoriale. — Causes de l’infériorité relative du taux du revenu foncier. — De la part proportionnelle de produit net afférente au sol. — Résumé des éléments du prix naturel du service productif des agents naturels appropriés ou de la terre ............ 338
- Quatorzième leçon. — La part de la terre (suite). — Que le prix naturel du service productif du sol n’est qu’un point idéal vers lequel gravite le prix courant de ce service. — Comment s’établit le prix courant. — Difficulté de reconnaitre quand il se confond avec le prix naturel. — De la manière dont il convient de calculer celui-ci. — Dans quel cas le prix courant du service productif de la terre peut demeurer au dessous de son prix naturel. — Que cette situation se présente dans les pays d’esclavage et de servage. — Citations relatives à la Russie. — Dans quel cas le prix courant du service productif peut s’élever au dessus de son prix naturel. — Des obstacles qui empêchent l’éuilibre de s’établir, et de leurs effets. — Théorie de Ricardo, — son application à ce cas particulier. — Réfutation des attaques dirigées contre cette théorie. — Causes qui agissent pour rétablir l’équilibre rompu en faveur de la terre dans l’Europe occidentale; — les progrès de l’agriculture et de la locomotion, — la liberté commerciale, — l’émigration. — Point vers lequel le prix courant des terres tend de plus en plus à se fixer sur le marché général. — Résumé. — Impropriété du mot rente pour signifier la part de la terre ...... 362
- Quinzième leçon. — Théorie de la population. — Que la loi qui régit le renouvellement de la population est la même que celle qui gouverne les différentes branches de la production. — Analyse du phénomène du renouvellement de la population. — Que la population est naturellement limitée dans son nombre et dans sa durée. — Des agents productifs dont la coopération est nécessaire pour renouveler la population: la force reproductive, le travail, le capital. — De quoi se compose le prix naturel d’une génération nouvelle. — Du prix courant. — En quoi consistent la demande et l’offre de la population. — Limites du débouché ou de la demande de la population. — De la connaissance de ce débouché sous le régime des marchés limités, — du marché général. — De l’offre de la population. — Ce qui la détermine, — dans le cas d’une population esclave, — dans le cas d’une population libre. — Imperfection du self-government de la population. — Comment il est pratiqué dans les classes supérieures, — moyennes; — inférieures. — Que l’offre de la population n’en a pas moins une tendance irrésistible à se mettre en équilibre avec la demande au niveau du prix naturel ou nécessaire. — Raison de cette tendance. — Comment agit la loi des quantités et des prix pour déterminer l’équilibre de la population avec ses moyens d’existence et de reproduction. 391
- [481] Seizième leçon. — Théorie de la population (suite). — Causes perturbatrices de la loi de la population. — Des institutions et des lois qui suppléent à l’insuffisance du self-government de l’homme en matière de reproduction. — De l’esclavage et de son action utile sur la multiplication des races inférieures. — Du servage. — Des lois qui restreignent la liberté de la reproduction, et, en particulier, de celles qui empêchent les mariages hâtifs. — La liberté de la reproduction doit-elle être laissée entière? — Maux du régime actuel — Nécessité d’une législation et d’une opinion publique suffisamment répressives des nuisances causées par l’abus de la liberté de la reproduction. — Théorie de Malthus. — Exposé et examen critique de cette théorie. — En quoi elle est erronée. — Qu’il n’est pas vrai que la population ait une tendance organique et virtuelle à dépasser ses moyens d’existence. — Qu’elle tend, au contraire, toujours, irrésistiblement, à s’y proportionner. — Autre erreur de Malthus. —Que la population ne tend à se multiplier en raison géométrique qu’autant que ses moyens d’existence se multiplient dans la même proportion. — De l’influence perturbatrice de l’incontinence sur le mouvement de la population. — Qu’elle a toujours pour résultat de diminuer le nombre des hommes et non de l’accroître. — Comment elle peut être combattue. — Que le vice et le malheur aggravent les maux qu’elle cause. — Que la contrainte morale seule peut lui être imposée d’une manière efficace et utile. — Que la contrainte morale samement appliquée a pour résultat de permettre à la population de recevoir son maximum de développement. — De l’application de la contrainte morale, — sous l’ancien régime, — sous le régime actuel. — Que la contrainte libre doit se substituer à la contrainte imposée. — Rélutation de diverses objections relatives a l’exercice de la contrainte morale et à l’application d’une législation répressive des abus de la liberté de la reproduction. — Que la contrainte morale n’est contraire ni à la morale ni à la religion ...................... 420
- Appendice ..................... 461
- Notes
[II-535]
TABLE DES MATIÈRES - Volume II
- TROISIÈME PARTIE. de la circulation
- Première leçon. — Les poids et mesures. — Récapitulation de quelques notions élémentaires. — Les besoins des hommes, la production, l’association des agents productifs, la division du travail. — Multiplication des échanges résultant du développement croissant de ces deux derniers phénomènes. — Nécessité de l'intervention des mesures de quantité et de valeur dans les échanges. — Comment se constituent les étalons de mesures ou de poids. — L'unité économique et l'unité physique. — Les anciens systèmes de poids et mesures. — Leurs inconvénients. — Le système métrique. — Vices de ce système artificiel et arbitraire. — A quoi doit se borner l'intervention gouvernementale en matière de poids et mesures. — Par quelle voie pourra s'opérer utilement l'uniformisation des poids et mesures. — Note sur le système métrique .............. 7
- Deuxième leçon. — La mesure de la valeur. — De la valeur et de ses éléments. — Nécessité de mesurer la valeur. — Impossibilité de trouver une mesure fixe de la valeur. — Qualités que doit réunir une mesure ou un étalon de la valeur. — Qualités que réunissent les métaux précieux pour remplir cette fonction économique; — l'uniformité de la qualité; — la transportabilité; — la durabilité. — Perturbations que causent les variations de l'étalon. — Lequel de l'or ou de l'argent est le moins sujet à varier. — De l'étalon simple et de l'étalon double. — Étalons réels et étalons nominaux ......... 39 [536]
- Troisième leçon. — La monnaie. — Nécessité de décomposer l'échange en deux parties, la vente et l'achat. — Avantages de cette décomposition économique de l'échange. — De l'instrument nécessaire pour l'opérer. — Ce que doit être cet instrument intermédiaire des échanges. — Qualités qu'il doit réunir. — Des matières premières dont on se sert pour le fabriquer. — Pourquoi l'or, l'argent et le cuivre ont été affectés de préférence à cet usage. — De la façon qui doit leur être donnée pour en faire un bon instrument des échanges. — De l'étalonnage des monnaies. — Des lois qui gouvernent la valeur de la monnaie. — Que ces lois sont les mêmes pour la monnaie que pour les autres marchandises. — Comment elles agissent. — Du monopole du monnayage et de l'influence de ce régime sur les lois qui gouvernent la valeur des monnaies. — De l'étalonnage de la monnaie en Angleterre. — De la quantité de monnaie nécessaire pour effectuer les échanges d'un pays ................. 58
- Quatrième leçon. — La monnaie sous l'ancien régime. — Le monopole du monnayage. — Influence du monopole sur la formation des prix. — Comparaison avec le monopole du sel. — Pourquoi les seigneurs attachaient une importance particulière au monopole du monnayage. — Comment les rois le leur enlevèrent. — Des étalons de poids et de qualité dont on se servait pour la monnaie. — De l'étalon originaire de la valeur. — Ce qu'était la livre monétaire. — Pourquoi la valeur de la monnaie différait de celle du métal dont elle était faite. — De la traite, du brassage et du seigneuriage. — De la dégradation de l'étalon monétaire. — Comment elle se manifestait. — Dans quelle mesure elle s'est opérée sous l'ancien régime. ............. 94
- Cinquième leçon. — La monnaie sous ancien régime (suite). — Comment la valeur de la monnaie pouvait différer de celle du métal. — Exemple de la monnaie de billon. — Que cette différence, sans engendrer nécessairement la dépréciation de l'étalon, le rendait possible. — Des causes de la limitation naturelle des profits du monnayage. — Limitation du débouché. — Longévité des monnaies. — Des opérations sur les monnaies. — Que ces opérations se résumaient dans la levée d'un impôt extraordinaire sur la circulation. — Procédés employés pour la levée de cet impôt. — Décri des anciennes monnaies; monnayage forcé des nouvelles. — Réquisition des métaux précieux, de la vaisselle, etc. — Défense de billonner les anciennes espèces; prohibition à la sortie des métaux précieux, lois somptuaires. — Pourquoi la levée d'un impôt sur la circulation avait pour conséquence ordinaire l'affaiblissement de l'étalon. — Conséquences de cet affaiblissement. — Comment les populations essayaient de s'y soustraire. — Refus d'accepter la nouvelle monnaie. — Adoption de l'étalon métal. — Concession d'un autre impôt, le fouage ou les aides. — Comment on rétablissait l'étalon monétaire après une période d'affaiblissement. — Époques des grandes perturbations monétaires, occasionnées [537] par la levée de l'impôt extraordinaire sur la circulation. — Comment le monopole du monnayage était géré dans les temps ordinaires. — L'affermage. — La régie. — Causes perturbatrices qui agissaient alors pour affaiblir l'étalon. — La contrefaçon des monnaies et le faux monnayage. — Les espèces étrangères. — La mauvaise proportion établie entre l'or et l'argent. — L'excès de la monnaie de billon. — Les pièces usées ou rognées. — Progrès de la pratique du monnayage. — Supériorité de la monnaie française au xviiie siècle, d'après Jacques Steuart. — Montant de l'affaiblissement de l'étalon depuis la domination romaine. — Résumé .......... 127
- Sixième leçon. — Le nouveau régime monétaire. — Esquisse du nouveau régime monétaire français. — Ressemblance de ce régime avec l'ancien. — Le billon. — Défectuosité de l'étalonnage de la monnaie d'or. — Conséquences de cette défectuosité. — Retrait et affluence de l'or. — Inconvénients de la substitution de l'or à l'argent. — Moyens de la prévenir. — La refonte, la tarification et le billonnage de l'or. — Ce qu'il faut penser du système dit du double étalon. — Anachronisme de ce système. — L'opinion des économistes sur le choix de l'étalon engage-t-il la science? — Rôle de la science économique dans le règlement des questions monétaires. — Nécessité actuelle d'un progrès de l'instrument des échanges .............. 201
- Septième leçon. — Le papier-monnaie. — Perfectionnement apporté à l'altération des monnaies par l'introduction du papier-monnaie. — Caractère du papier-monnaie. — En quoi il diffère de la monnaie métallique. — Comment il peut acquérir une valeur et remplir les fonctions de monnaie. — Analyse de la valeur du papier-monnaie. — Effet de la limitation des émissions. — Origine du papier-monnaie. — Causes qui ont retardé son introduction sous l'ancien régime. — Complément de la théorie du papier-monnaie. — Histoire des assignats en France. — Causes de leur dépréciation. — Moyens employés pour l'arrêter. — Maux occasionnés par la dépréciation. — Le maximum, moyen de péréquation de l'impôt monétaire. — Ce que les assignats ont rapporté au gouvernement révolutionnaire et ce qu'ils ont coῦté à la France. — Que l'expédient du papier-monnaie a remplacé partout celui des affaiblissements des monnaies métalliques au grand profit des gouvernements, au grand dommage des peuples ................. 230
- Huitième leçon. — Le crédit. — Notions générales. — Introduction. — Définition du crédit. — Comment se forment les capitaux. — Formes sous lesquelles les capitaux peuvent être investis; destinations auxquelles on peut les affecter. — En quoi consiste l'offre des capitaux. — De la privation et du risque qu'implique tout engagement de capitaux. — De la demande des capitaux. — Ce qui la limite. — De la tendance de l'offre et de la demande des capitaux à s'équilibrer au niveau du prix naturel de l'intérêt. — Des instruments du crédit. — Des obligations commerciales. — Analyse de la vente à crédit. — Comment [538] se paye le crédit en nature. — Cause de l’extréme multiplication des marchands de détail. — Caractère somptuarie du maximum imposé aux prix des choses nécessaires à la vie. — De la transmissibilité des obligations commercials et de son influence sur le développement du crédit. — Des obligations auxquelles donnent naissauce le prèts en argent. — Des titres de propriété et des effets de leur transmissibilité. — La mobilisation des valeurs a-t-elle pour résultat de multiplier les capitaux? — Des garanties du crédit. — Des garanties réelles, personnelles, mobilières et immobilières. — Des garanties morales et légales. — Des assurauces. . . . . . . . . . . 275
- Neuvième leçon. — Les intermédiaires du crédit. — Des banques de prêt et des banques d'escompte et de circulation. — Mécanisme et opérations des banques de prêt sur gage. — Monts-de-piété. — Banques de prêt sur marchandises entreposées. — Récépissés et warrants. — Services que rendent les banques de prêt sur marchandises entreposées. — Mécanisme et opérations des banques de crédit foncier. — Formes et intermédiaires primitifs de prêt hypothécaire. — Progrès résultant de l'établissement des banques de crédit foncier. — Banques agricoles — Banques industrielles. — Crédits mobiliers. — Du crédit personnel et de son développement possible. — Les banques d'escompte. — Nature de leurs opérations. — Division naturelle du travail entre les intermédiaires du crédit. — Hiérarchie et fonctions diverses des intermédiaires. — Comment les banques d'escompte sont issues des banques de dépót. — Opérations des banques de dépôt. — Virements de comptes. — Assurance de la monnaie. — Ce qu'était la monnaie de banque. — Comment la monnaie de banque a donné naissance au billet de banque. — De l'étalonnage des billets de banque. — Économie résultant de la substitution partielle des obligations commerciales et autres au numéraire et aux métaux précieux dans la monétisation des billets de banque. . . . . . . . 319
- Dixième leçon. — Les intermédiaires du crédit (suite et fin). — Cause du retard de développement des banques d'escompte et de circulation. — Avantages qui résulteraient de la spécialisation de l'escompte et de l'émission, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage. — Élargissement du marché de l'escompte, abaissement du prix de la monnaie. — Comment fonctionneraient des banques libres et spéciales d'escompte et de circulation. — Des instruments monétaires dont pourrait se servir une banque de circulation spéciale, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage. — Des frais de production d'une circulation purement métallique; — d'une circulation mixte en métal et en papier; — d'une circulation en papier. — Des différents modes de production de la monnaie de papier. — Du papier monnaie, — vices de cet instrument monétaire. — Du billet de banque. — Comment il est produit et étalonné sous un régime de privilége et de réglementation. — Qu'il n'est autre chose qu'un billon de papier. [539] — Avantages que procure aux banques privilégiées le monopole de l'émission de cet instrument monétaire. — Maux qui en résultent pour le public consommateur; — cherté de la monnaie; crises monétaires causées par la réglementation vicieuse de l'étalonnage. — Que cette réglementation ne garantit point la conversibilité des billets. — D'un système de circulation en papier-monnaie inconversible. — Possibilité démontrée de l'établissement de ce système, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage. — De ses avantages, au double point de vue de l'économie et de la sécurité. — Comment pourrait être étalonnée une monnaie de papier inconversible. — Ce qu'étaient les anciens étalons de banque. — Supériorité de l'étalon composé sur l'étalon simple. — Que l'avenir appartient au papier-monnaie inconversible, à étalon composé . . . . . . . . . . . . 392
- QUATRIÈME PARTIE. de la consommation
- Onzième leçon. — Le revenu. — La consommation utile et la consommation nuisible. — Comment se forment les revenus. — Sources et formes diverses des revenus. — Des causes naturelles de l'inégalité des revenus. — Inégalité des aptitudes productives et des milieux où elles s'exercent. — Inégalité des aptitudes conservatrices ou accumulatives. — Que l'égalité des revenus, partant, des conditions est contraire à la nature des hommes et des choses. — Que les revenus sont naturellement mobiles comme ils sont naturellement inégaux. — Des causes artificielles de l'inégalité des revenus. — Que ces causes se résument dans la spoliation. — Raison d'être économique de la spoliation. — Des formes progressives de la spoliation, vol, brigandage, piraterie, conquête, esclavage, monopoles, priviléges. — De la spoliation contenue dans l'ancien régime des corporations; — dans le régime moderne de la protection; — son mode d'action et ses résultats. — Des autres forteresses de la spoliation, le monopole gouvernemental, les priviléges en matière de crédit, d'association, etc. — De la spoliation sous forme de communisme, en matière de production intellectuelle. — Des procédés employés pour immobiliser l'inégalité artificielle des revenus. — De la déperdition de forces et de richesses que la spoliation occasionne. — Ce qu'il faut penser d'une liquidation sociale des résultats de la spoliation. — Que les révolutions ne suppriment pas la spoliation; qu'elles la transforment en l'aggravant. — Qu'il importe d'atteindre les inégalités artificielles non dans leurs résultats mais dans leurs causes. — Que ces causes ayant disparu, les inégalités artificielles feront place non à une égalité chimérique mais à l'inégalité naturelle. [540] — Des emplois du revenu. — Des classes dont le revenu est insuffisant pour couvrir leurs frais d'existence et de renouvellement, — dont le revenu est suffisant, et au delà. — De la consommation utile. — Des éléments et des conditions d'un bon gouvernement de la consommation. — Des facultés intellectuelles et morales qu'il exige. — De la consommation nuisible. — Ce qu'il faut entendre par consommations absolument et relativement nuisibles. — Causes de la consommation nuisible. — Analyse des effets de la prodigalité et de l'avarice. — Qn'elles sont également contraires à une bonne économie privée. — De l'influence de la consommation utile et de la consommation nuisible sur la conservation et le progrès des sociétés. — Des coutumes, des institutions ou des lois qui ont pour objet de déterminer et d'assurer la consommation utile, d'empêcher la consommation nuisible. — De l'esclavage et du servage envisagés au point de vue de la consommation. — Des lois somptuaires. Leur raison d'être. Pourquoi elles sont devenues surannées. — Qu'en cessant d'être réglementée, la consommation ne doit pas cesser cependant d'être réglée. — Que la règle volontaire doit succéder à la règle imposéc. — Tous les hommes sont-ils capables de gouverner utilement leur consommation? — Opinion affirmative des individualistes, négative des socialistes. — Que ces opinions opposées contiennent chacune une portion de la vérité. Que le self government en matière de consommation ne peut être ni utilement imposé à ceux qui en sont incapables, mutilement refusé à ceux qui possèdent l'intelligence et la force morale nécessaires pour l'exercer . . . . . 427
- Douzième leçon. — Les consommations publiques. — Du partage du revenu entre les consommations publiques et les consommations privées. — Proportion dans laquelle se fait ce partage. — En quoi consistent les services publics. — Que l'ensemble de ces services constitue la tutelle sociale excreée par les gouvernements. — Des attributions et de la constitution naturelles ou utiles des gouvernements dans les trois phases du développement économique des sociétés, — sous les régimes de la communauté, du monopole et de la [541] concurrence. — Que les gouvernements débutent par la communauté et que leurs fonctions se spécialisent avec celles de l'industrie privée. — Que toute fonction ou toute industrie spécialisée existe d'abord à l'état de monopole naturel. — Exemples. — Comment les monopoles naturels se transforment en monopoles artificiels. — Que tout monopole est productif de nuisances. — Que les gouvernements doivent réprimer les nuisances causées par le monopole. — Raison d'être du régime réglementaire dans la seconde phase du développement économique de la société. — Que les gouvernements eux-mémes sont constitués dans cette seconde phase sous la forme de monopoles plus ou moins limités. — Pourquoi le régime communautaire est alors populaire. — — Comment la société passe de la phase du monopole à celle de la concurrence. — Des attributions utiles des gouvernements dans la phase de la concurrence. — Que la production de la sécurité doit se développer et se perfectionner dans cette phase, —que l'intervention du gouvernement dans la production et dans la distribution de la richesse cesse, en revanche, d'avoir une raison d'être. — Des nuisances de la consommation et de la mesure dans laquelle le gouvernement doit intervenir pour les empécher. — Que la constitution du gouvernement se modifiant avec celle des autres entreprises, l'unité économique s'établit dans chaque phase du développement des sociétés. — Que cette unité a maintenant cessé d'exister. — Que le gouvernement est demeuré à l'état de monopole tandis que les autres entreprises entraient dans la phase de la concurrence. — Maux qui découlent de cette dissonnance entre la constitution du gouvernement et celle de la société. — Pourquoi un gouvernement de monopole devient de plus en plus anti-économique au sein d'une société régie par la concurrence. — Comparaison. — Pourquoi les gouvernements sont demeurés des monopoles, tandis que les entreprises privées étaient soumises à la loi de la concurrence. — Comment la question de la constitution des gouvernements était envisagée à l'époque de la révolution française. — Que, dans l'opinion générale, cette question se trouvait en dehors du domaine de l'économie politique. — Solutions qu'on lui a données. — Du régime constitutionnel et de son insuffisance. — Autres solutions, le socialisme, le principe des nationalités. — Inanité de ces utopies. — Que la constitution des gouvernements est du ressort de l'économie politique aussi bien que celle des autres entreprises. — Critique de la constitution des gouvernements modernes au point de vue économique. — Qu'ils pèchent contre les lois de l'unité des opérations, de la division du travail, des limites naturelles, de la concurrence, de la spécialité et de la liberté des échanges. — Nuisances qui résultent pour la société de ces vices de constitution des gouvernements. — Mauvaise qualité et cherté croissante des services publics, inégalité de leur distribution. — Que les gouvernements sont les ulcères des sociétés. — Remède économique que ce mal comporte. — Qu'il faut simplifier les gouvernements et les soumettre à la loi de la concurrence comme toutes les autres entreprises. — Que l'unité économique se trouvera ainsi rétablie. — Possibilité et résultats de la concurrence politique. . . . 480
- Notes
Gustave de Molinari, Cours d’économie politique (1863).
Tome I. La Production et la Distribution des Richesses
[I-v]
PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION.↩
L’un des maîtres respectés de la science économique, M. Charles Dunoyer, a eu l’obligeance de rendre compte de la première édition de ce livre, à l’Académie des sciences morales et politiques [1] . Il l’a fait non seulement avec la bienveillance qui lui est habituelle mais encore en donnant à l’auteur des marques particulières d’intérêt et de sympathie. Je n’ai pas besoin de dire combien ces témoignages d’affectueuse estime d’un des hommes qui honorent le plus la science ont de prix à mes yeux, et je suis heureux de pouvoir en exprimer toute ma reconnaissance au savant auteur de La liberté du travail.
Cependant, M. Charles Dunoyer n’a point dissimulé les défauts du livre dont il avait à rendre compte, et sa critique pour être bienveillante n’a pas manqué d’une [I-vi] certaine sévérité. Il m’a reproché surtout d’avoir mêlé à l’exposition des vérités reconnues de la science celle d’une loi nouvelle, loi dont il ne conteste pas l’existence, d’une manière absolue, mais dont la démonstration lui paraît insuffisante, et à laquelle il n’attribue point la portée que ce livre lui assigne, je veux parler de la loi d’équilibre qui agit incessamment pour faire régner l’ordre dans la production et la justice dans la distribution de la richesse.
Que la démonstration de cette loi soit insuffisante, je l’accorde volontiers. J’aurais dῦ certainement la rendre plus complète et plus claire, puisqu’elle n’a pas réussi à porter la conviction dans l’esprit de mon bienveillant critique; mais j’ai fait ce que j’ai pu, et si le résultat n’a pas entièrement répondu à mes efforts, je crois cependant avoir appuyé mes propositions sur des faits assez patents et sur des observations assez concluantes pour qu’on ne puisse les reléguer au rang des simples hypothèses. Ces faits et ces observations qui portent, comme on sait, sur la progression géométrique des prix engendrée par la progression arithmétique des quantités et sur les conséquences extrêmement importantes de ce phénomène, au double point de vue de la production et de la distribution des richesses, n’ont point été contestés ou infirmés, et je ne crois point qu’ils puissent l’être; en sorte que si ma démonstration a le défaut d’être insuffisante, on ne saurait lui reprocher, je pense, d’être fausse.
[I-vii]
Maintenant, cette démonstration pouvais-je la faire d’une manière isolée, dans un traité particulier, sans la mêler à un exposé général de la science, comme l’aurait souhaité M. Charles Dunoyer? Je ne le crois pas. De quoi s’agissait-il en effet? Il s’agissait de démontrer, d’une part, que l’ordre tend à s’établir naturellement, sous une impulsion irrésistible, dans la production; d’une autre part, que la même loi qui fait régner l’ordre dans la production, engendre aussi la justice dans la répartition. Ne devais-je pas, en conséquence, exposer comment la richesse se produit et comment elle se répartit, autrement dit, écrire un traité général d’économie politique, en essayant de déterminer la place qu’occupe et le rôle que joue dans l’ensemble des faits économiques la loi que je me proposais de mettre en lumière? Déjà au surplus, j’avais, à diverses reprises, fait cette démonstration isolée et spéciale, à laquelle j’aurais dῦ me borner selon mon savant critique, et c’est précisément parce qu’elle n’était point et ne pouvait guère être bien saisie, en dehors de l’ensemble des vérités auxquelles elle venait s’ajouter, que je me suis décidé à écrire ce Cours d’économie politique.
Il ne me reste plus qu’une simple observation à faire sur le compte rendu d’ailleurs si bienveillant de l’illustre et savant auteur de La liberté du travail. M. Charles Dunoyer me reproche d’avoir soutenu “que le niveau vers lequel gravite le prix des services de toute espèce est le même...” et encore “que la liberté [I-viii] tend à niveler le prix des services et à rendre égale la condition des travailleurs.” Il se peut que je me sois servi mal à propos du mot égalité, mais l’ensemble de mon livre atteste suffisamment que ce mot doit être pris dans le sens de proportionnalité, et je regrette que mon respectable critique ait pu me prendre, un seul instant, pour un partisan de l’égalité des salaires.
J’ai à m’excuser enfin de n’avoir pas publié jusqu’à présent les parties complémentaires de ce Cours, ainsi que j’en avais fait la promesse dans ma première édition. Mais je crois pouvoir invoquer à cet égard le bénéfice des circonstances atténuantes. Engagé dans des travaux qui me laissent trop peu de loisirs pour me permettre d’apporter aux recherches et aux spéculations purement scientifiques l’attention suivie qu’elles réclament, je me suis trouvé dans l’impossibilité de m’acquitter convenablement de ma promesse. Plus d’une fois même, j’ai regretté de l’avoir faite, et si je m’occupe maintenant de la remplir, c’est, avant tout, pour que les acheteurs de mon premier volume cessent de m’accuser de manquer à mes engagements envers eux. Puissent-ils ne pas me reprocher plus tard d’avoir cédé à ce scrupule de probité commerciale?
[I-ix]
A Mousieur CHARLES DE BROUCKERE,
bourgmestre de bruxelles,
ancien prÉsident de l’ASSOCIATION Belge pour la libertÉ des Échanges
ancien ministre [2] .
Permettez-moi de vous dédier, à vous qui avez été le promoteur le plus actif et le plus dévoué de l’enseignement de l’économie politique en Belgique, le résumé d’un Cours entrepris [I-x] sous vos auspices. Commencé à l’Athénée royal de Paris, en 1847, ce Cours avait été brusquement interrompu par la révolution de février. Grâce à votre appui bienveillant, j’ai pu le recommencer au Musée de l’industrie belge, où j’espère, — et mon espoir se fonde sur l’attachement sincère et profond que les gouvernants aussi bien que les gouvernés professent chez nous pour les libertés constitutionnelles, — où j’espère, dis-je, qu’aucune révolution ne m’empêchera de le poursuivre et de le mener à bonne fin.
A quoi bon, me dira-t-on peut-être, un nouveau Cours d’économie politique? Ne possédons-nous pas déjà bien assez de traités généraux de cette science? N’avons-nous pas le magnifique ouvrage d’Adam Smith sur la richesse des nations, le Traité et le Cours complet de J.-B. Say, les Traités de MM. Charles Dunoyer, Mac Culloch, John Stuart Mill, les Cours de Rossi et de M. Michel Chevalier, les Harmonies économiques de Frédéric Bastiat, le Traité élémentaire, tout à la fois si concis et si complet, de M. Joseph Garnier, sans parler d’un grand nombre d’Abrégés, parmi lesquels les Principes généraux d’économie politique, de M. Charles de Brouckere, méritent d’être cités en première ligne? Pourquoi refaire ce qui a été fait si souvent et bien fait?
Si mon Cours ne contenait rien de plus que les Traités existants; s’il n’en était que la reproduction pure et simple, je m’abstiendrais bien certainement de le publier, car une compilation de ce genre, venant après le magnifique Dictionnaire [I-xi] de l’économie politique de M. Guillaumin, demeurerait sans utilité.
Mais il m’a semblé que tous les ouvrages d’économie politique publiés jusqu’aujourd’hui présentaient une lacune importante, je veux parler de l’absence d’une démonstration suffisamment claire de la loi générale qui, en établissant un juste et nécessaire équilibre entre les différentes branches de la production comme aussi entre les rémunérations des agents productifs, fait régner l’ordre dans le monde économique.
Cette lacune, il serait injuste de la reprocher aux maîtres de la science. A l’époque où l’économie politique a pris naissance, ils avaient à faire prévaloir, avant tout, la liberté de l’industrie, alors à son berceau, sur les vieux errements du régime réglementaire. Ils avaient à démontrer combien les priviléges des corporations et des castes, l’abus des monopoles et des restrictions ralentissaient l’essor de la production; combien les masses laborieuses avaient à souffrir, dans leur dignité et dans leur bien-être, des entraves opposées au libre développement de leur activité. Cette tâche, les fondateurs de la science économique et leurs successeurs l’ont admirablement remplie. Sans doute, ils n’ont pu rénssir à briser complétement les liens qui enchaînaient jadis l’industrie. Nos sociétés renferment encore de trop nombreux vestiges de régime réglementaire. Nulle part, la liberté du travail et des échanges n’a conquis pleinement sa place au soleil. Cependant, grâce aux efforts persévérants de ses promoteurs, grâce à la diffusion de plus en plus abondante [I-xii] des lumières économiques, elle fait chaque jour un pas en avant, et le moment n’est pas éloigné peut-être où la liberté deviendra la loi universelle des transactions humaines.
Malheureusement, cette liberté industrielle, que les économistes ont tant contribué à faire prévaloir, malgré les efforts désespérés des détenteurs des vieux priviléges, elle a rencontré, de nos jours, des adversaires au sein même des classes dont l’intérêt avait été invoqué pour l’établir. Une réaction antilibérale et néo-réglementaire, à laquelle on a appliqué la dénomination générique de “socialisme,” s’est opérée parmi les masses laborieuses.
Cette réaction a imposé une nouvelle tâche aux économistes. Tandis que les fondateurs de la science n’avaient à combattre que les bénéficiaires des abus de l’ancien régime, réclamant, dans des vues égoïstes, le maintien de leurs priviléges, nous avons à lutter aujourd’hui non seulement contre les successeurs beaucoup trop nombreux de ces privilégiés, mais encore contre les socialistes qui jettent l’anathème sur la liberté industrielle, en invoquant l’intérêt des masses et en demandant “l’organisation du travail.”
Il suffisait aux premiers économistes de démontrer combien étaient nuisibles à l’intérêt général les monopoles et les restrictions de l’ancien régime; combien étaient absurdes les préjugés et les sophismes sur lesquels on se fondait pour les maintenir. Il leur suffisait, en un mot, de “démolir” le vieux régime réglementaire. Cela ne suffit plus aujourd’hui, puisqu’on affirme [I-xiii] que l’expérience de la liberté industrielle a décidément échoué, et que la société n’a été débarrassée de la servitude que pour tomber dans l’anarchie. Il faut justifier la liberté des accusations auxquelles elle est en butte. Les socialistes l’accusent d’être anarchique; ils prétendent qu’aucun principe régulateur n’existe dans la production abandonnée à elle-même. Il faut démontrer que ce principe régulateur existe, et que l’anarchie, dont les fauteurs du socialisme ont fait un tableau si assombri, provient de l’inobservation des conditions naturelles de l’ordre.
Telle est la nouvelle tâche que les circonstances ont imposée aux économistes, et que j’ai essayé de remplir dans la mesure de mes forces. J’ai essayéde démontrer que ce monde économique, où le socialisme n’aperçoit aucun principe régulateur, est gouverné par une loi d’équilibre qui agit incessamment et avec une irrésistible puissance pour maintenir une proportion nécessaire entre les différentes branches et les différents agents de la production. J’ai essayé de démontrer que, sous l’impulsion de cette loi, l’ordre s’établit de lui-même dans le monde économique, comme il s’établit dans le monde physique, en vertu de la loi de la gravitation.
Cette démonstration est l’objet principal de l’ouvrage que je publie aujourd’hui. J’avais déjà entrepris de la faire dans deux publications antérieures [3] , mais sans parvenir à lui donner [I-xiv] toute la clarté nécessaire. J’ignore si j’ai mieux réussi dans le présent ouvrage; mais, en tous cas, je croirai avoir atteint mon but si j’ai indiqué la voie aux amis de la science.
Combien ne serait-il pas souhaitable, en effet, que l’on pῦt démontrer, de manière à se faire comprendre de tous, que la production, abandonnée à elle-même, n’est pas fatalement vouée à l’anarchie; qu’elle contient en elle un principe régulateur d’une efficacité souveraine? Cela étant bien établi, bien rendu évident à toutes les intelligences, qui donc oserait encore proposer d’emprisonner la société dans une organisation artificielle? Le socialisme ne se trouverait-il pas frappé à mort? Les esprits distingués et les cœurs généreux qu’il a égarés à la poursuite de la vaine utopie d’une reconstruction sociale, ne se hâteraient-ils point de regagner le terrain solide de la réalité? Ces dissidents de l’économie politique ne se joindraient-ils pas à nous pour rechercher à quelles conditions la Providence maintient l’ordre dans le monde économique, à quelles conditions aussi elle y distribue le bien-être? Les causes réelles des maux qui affligent la société seraient alors mieux étudiées et elles disparaîtraient plus tôt grâce à l’entente commune des amis du progrès.
[I-xv]
Ce cours sera divisé en quatre parties:
La première et la seconde, que je publie aujourd’hui, concernent la production et la distribution des richesses.
La troisième et la quatrième traiteront de la circulation et de la consommation.
Telle est, Monsieur, la tâche que je me suis proposée. Peutêtre ai-je trop présumé de mes forces, en l’entreprenant; mais je compte sur l’indulgence du public et sur l’appui bienveillant des amis de la science, parmi lesquels vous occupez une place si distinguée.
[I-none]
[I-17]
INTRODUCTION.↩
Étymologie du mot économie politique. — Définition de la science économique. — De l’intérêt spéculatif qu’elle présente. — De son utilité. — Réfutation des reproches qui lui ont été adressés. — Qu’elle pent servir d’auxiliaire à la religion, — à la morale, — à la politique de conservation. — Qu’elle est un puissant instrument de progrès.
Économie politique vient du grec et signifie arrangement intérieur de la cité ou de l’État [4] . Montchrestien de Watteville, écrivain du xviie siècle, paraît avoir employé, le premier, cette dénomination sans y attacher toutefois un sens bien précis. [I-18] D’autres dénominations ont été successivement proposées, parmi lesquelles nous citerons économie sociale, chrématistique, etc., mais économie politique a décidément prévalu.
Les économistes ne sont pas encore complétement d’accord sur la définition de la science, non plus que sur les limites qu’il convient de lui assigner.
Selon Adam Smith, “l’économie politique, considérée comme une branche de la science d’un homme d’État ou d’un législateur, se propose deux objets distincts: 1° de procurer au peuple un bon revenu ou une subsistance abondante, ou, pour mieux dire, de le mettre en état de se les procurer lui-même; et 2° de pourvoir à ce que l’État ou la communauté ait an revenu suffisant pour les charges publiques. Elle se propose d’enrichir en même temps le peuple et le souverain.”
Selon J.-B. Say, l’économie politique est la science qui s’occupe “de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses.”
Selon M. de Sismondi, “le bien-être physique de l’homme, autant qu’il peut être l’ouvrage de son gouvernement, est l’objet de l’économie politique.”
[I-19]
Selon M. Storch, “l’économie politique est la science des lois naturelles qui déterminent la prospérité des nations, c’est à dire, leur richesse et leur civilisation.”
Sans vouloir discuter le mérite de ces définitions et de beaucoup d’autres qui ont été successivement proposées, je me bornerai à paraphraser la dénomination même de la science économique, et je dirai:
L’économie politique est la science qui décrit l’organisation de la société. Comment la société se constitue, fonctionne, prospère ou dépérit, par quel mécanisme la subsistance arrive à chacun de ses membres, dans quelles conditions et avec l’auxiliaire de quels agents se produit cette subsistance qui se compose d’éléments si divers et qui est destinée à pourvoir à tant de besoins différents, quelles lois naturelles président à sa distribution entre tous ceux qui concourent à la produire, tel est l’objet de l’économie politique. C’est la description du mécanisme de la société, en deux mots, une anatomie et une physiologie sociales.
Alors même que cette science du mécanisme de la société demeurerait à l’état purement spéculatif, alors même qu’elle ne serait susceptible d’aucune application, elle offrirait encore une étude des plus intéressantes. Si nous n’accordons pas toujours une attention suffisante aux phénomènes qu’elle décrit, cela vient, selon toute apparence, de ce qu’on n’observe guère les choses qu’on a constamment sons les yeux; mais ces phénomènes, qui nous paraissent si simples et, comme on dit, si naturels, nous sembleraient véritablement merveilleux si nous n’y étions point accoutumés. Supposons, par exemple, qu’au sein de l’immensité se trouve un globe où chacun pourvoie isolément à ses besoins, et qu’un des habitants de ce monde inconnu [I-20] vienne nous visiter. Quel ne serait point l’étonnement de ce nouveau Micromégas à l’aspect de la division du travail qui caractérise nos sociétés civilisées? Il verrait des hommes passer leur vie, celui-ci à poser des têtes des à des épingles, celui-là à surveiller l’étirage d’un fil de laine ou de coton, un troisième à appliquer des couleurs sur des étoffes, un quatrième à griffonner des caractères sur des chiffons de papier, etc., etc. Ces hommes qui ne font rien ou presque rien de ce qui est nécessaire à la satisfaction de leurs propres besoins, il les verrait, en même temps, plus ou moins bien nourris, vêtus, logés, entretenus. Il se demanderait avec étonnement comment ces êtres singuliers s’y prennent pour se procurer les choses nécessaires à leur subsistance et à leur entretien. Son étonnement ne ferait probablement que s’accroître lorsqu’il les verrait échanger qui des aliments, qui des habits, qui une maison, contre de petites pièces de métal, jaunes ou blanches, ou même contre de simples morceaux de papier maculé. Comment, se dirait-il, des êtres pourvus de raison, peuvent-ils consentir à donner des aliments, des vêtements, une maison en échange de ces petites pièces de métal ou de ces morceaux de papier? Comment se fait-il qu’ils aient généralement l’air satisfait en concluant ces marchés bizarres et incompréhensibles? Quels avantages peuvent-ils en retirer? Après qu’on lui aurait donné quelques notions élémentaires sur la nature des échanges et sur les instruments à l’aide desquels ils s’opèrent, il se demanderait encore quelle règle préside à ces transactions dont la division du travail est la source: pour peu que cet habitant d’un autre monde eῦt la notion de la justice, il se préoccuperait vivement de savoir si l’équité règne dans l’économie des sociétés humaines; si chacun des hommes qui contribuent à la production [I-21] reçoit, en récompense de son concours, une part équitable de produits; s’il y a des lois naturelles qui déterminent la répartition de la richesse ou si cette répartition est abandonnée au hasard. Questions pleines d’intérêt, auxquelles nous n’accordons pas toujours, nous autres, l’attention qu’elles méritent, parce que nous sommes accoutumés à la division du travail, aux échanges, à la monnaie, aux fluctuations de l’offre et de la demande, mais qui ne pourraient manquer d’intéresser au plus haut point des êtres qui n’auraient jamais eu sous les yeux le spectacle de ces phénomènes économiques.
L’étude de l’économie politique présenterait donc un vif intérê, quand même cette science demeurerait pour nous à l’état purement spéculatif; quand même nous n’en pourrions faire aucune application utile; quand même la société, dirigée par une volonté supérieure, échapperait complétement à l’action de l’homme et roulerait, comme le globe qui lui sert de support, dans une orbite immuable. Mais il n’en est pas ainsi. S’il est hors du pouvoir de l’homme de changer les conditions naturelles d’existence de la société; — et l’économie politique démontre, en effet, que cela n’est pas en son pouvoir; — il peut, en revanche, exercer sur son développement une influence considérable; il peut, en observant ou en méconnaissant les lois auxquelles son existence est soumise, la rendre prospère ou misérable, augmenter son bien-être ou la plonger dans un abîme de maux. L’économie politique est, en conséquence, susceptible de recevoir des applications nombreuses et fécondes. On peut s’en servir pour rechercher quelles sont les conditions les plus favorables au développement de la société; on peut s’en servir aussi pour découvrir les moyens de la préserver des maux auxquels elle est sujette, ou, quand ces maux l’ont [I-22] atteinte, de l’en débarrasser. C’est ainsi que l’anatomie et la physiologie, sciences dont l’objet est de décrire l’organisation naturelle du corps humain, servent de bases à l’hygiène et à la médecine, l’une destinée à prévenir les maladies du corps, l’autre à les guérir.
L’économie politique pourrait, de même, servir de base à une hygiène sociale ayant pour objet de prévenir, par des règles volontaires ou imposées, toute infraction aux conditions nécessaires d’existence ou de développement de la société. Elle pourrait encore servir de base à un autre art, analogue à l’art médical, qui aurait pour objet de guérir ou de soulager les maux que la société endure soit par la faute de ses membres, soit par le fait de circonstances indépendantes de leur volonté. Comme l’hygiène et la médecine, ces deux arts politiques existent, du reste, depuis l’origine même des sociétés; seulement, comme l’hygiène et la médecine encore, ils sont demeurés jusqu’à nos jours réunis, confondus et réduits à un pur empirisme. La politique ou l’art de gouverner les nations n’est pas autre chose, et elle a pour agents des hommes d’État et des administrateurs dont la pratique, pour être salutaire, doit s’appuyer exclusivement sur les vérités que l’économie politique enseigne.
Malheureusement, de même que l’ignorance de l’anatomie et de la physiologie a donné naissance à de nombreures et funestes erreurs sur les moyens de prévenir ou de guérir les maladies auxquelles le corps humain est sujet, l’ignorance ou la connaissance imparfaite de l’économie politique a laissé s’introduire dans le gouvernement des sociétés les errements les plus vicieux et les plus nuisibles. Comme le corps humain, le corps social souffre non seulement des maladies et des accidents auxquels il est naturellement exposé, mais encore de la mauvaise [I-23] hygiène et des drogues malfaisantes qu’on lui prescrit en vue de le maintenir en santé ou de le guérir.
D’après ce que je viens de dire, on pent apprécier aisément toute l’utilité de l’étude de l’économie politique. Cependant, chose qui fait assurément peu d’honneur au siècle où nous vivons, cette utilité a été contestée. On a nié les services que l’économie politique a déjà rendus à la société, depuis l’époque, encore si rapprochée, de sa naissance, et l’on a soulevé contre elle, particulièrement au nom de la religion et de la morale, les accusations les plus graves. Je répondrai d’abord à ces accusations plus ou moins sincères, et je tâcherai de démontrer qu’à tous les points de vue les hommes ne peuvent que gagner à connaître le mécanisme de la société.
Je me placerai premièrement au point de vue élevé de la religion, parce que c’est en invoquant les croyances religieuses qu’on a porté à l’économie politique les coups les plus redoutables. Il y a quelques années, un orateur célèbre, M. Donoso Cortès, lançait, du haut de la tribune espagnole, un fougueux réquisitoire contre l’économie politique qu’il accusait de détourner les âmes vers des objets indignes de leur sublime essence et de troubler la société en présentant aux hommes un idéal de bonheur qui ne saurait être réalisé sur la terre. M. Donoso Cortès considérait l’économie politique comme une science essentiellement hostile à la religion aussi bien qu’à la morale, et j’ai le regret de dire que beaucoup d’esprits religieux partagent encore à cet égard les préjugés de l’orateur espagnol.
Cependant, pour peu que l’on se donne la peine d’étudier l’économie politique, on ne tarde pas à s’apercevoir que rien n’est fondé dans les accusations de M. Donoso Cortès. L’économie politique apparaît, au contraire, comme une science [I-24] essentiellement religieuse en ce qu’elle donne, plus qu’aucune autre peut-être, une idée sublime du suprême ordonnateur des choses. Permettez-moi de faire, à ce sujet, un simple rapprochement. Il y a deux ou trois siècles, on se méfiait de l’astronomie, on nevoulait pas entendre parler du système de Copernic et l’on condamnait Galilée, comme ayant porté atteinte aux vérités religie uses, parce qu’il soutenait “l’hérésie” de la rotation de la terre. Or, je le demande, l’astronomie, au point où l’ont portée les travaux des Kepler, des Copernic, des Galilée, des Newton, ne nous donne-t-elle pas de la puissance divine une idée plus vaste et plus haute que celle qui ressortait des croyances erronées et des hypothèses plus ou moins saugrenues des astronomes de l’antiquité? Les anciens n’avaient, vous le savez, aucune idée précise de l’éloignement ni de la dimension des étoiles, ils croyaient que la voῦte du ciel était solide, et les plus hardis supposaient que le soleil était une masse de fer chaud, grande comme le Péloponèse. Leur hardiesse scientifique n’allait pas au delà. Eh bien! quand les astronomes modernes ont reculé les limites du ciel, quand ils ont découvert, dans ses profondeurs jusqu’alors inexplorées, des millions de mondes inconnus; quand ils ont reconnu les lois en vertu desquelles ces mondes se meuvent dans un ordre éternel, n’ontils pas contribué à donner une idée plus sublime ’de l’intelligence qui préside à l’arrangement de l’univers? N’ont-ils pas agrandi l’idée de Dieu? N’ont-ils pas, du même coup, rabaissé l’orgueil humain, en réduisant à de plus humbles proportions la place que l’homme occupe dans la création? La terre a cessé d’apparaître comme le centre de l’univers; elle n’a plus figuré qu’à un rang inférieur dans l’échelle des mondes, et l’homme a dù renoncer à l’orgueilleuse satisfaction de se croire l’un des [I-25] personnages les plus importants de la création. Dieu est devenu plus grand et l’homme plus petit. Au point de vue religieux, était-ce un mal?
Si l’astronomie a mis sous les yeux de l’homme, un tableau plus grandiose de la puissance divine, l’économie politique, à son tour, me semble destinée à lui donner une idée meilleure de la justice et de la bonté de la Providence. Avant que les doctrines économiques se fussent répandues dans le monde, comment l’organisation sociale était-elle comprise? De quelle manière pensait-on que chacun pouvait prospérer, s’enrichir? On était généralement convaincu que l’antagonisme présidait aux relations des hommes. Dans l’antiquité, on avait coutume de dire: homo homini lupus, l’homme est le loup de l’homme. Plus tard, Montaigne répétait avec ses contemporains: le proufict de l’un fait le dommage de l’autre; et cette maxime apparaissait comme un axiome emprunté à la sagesse expérimentale des nations. On ne croyait pas que l’auteur des choses se fῦt mêlé de l’organisation de la société. On croyait qu’il l’avait abandonnée à je ne sais quel hasard malfaisant, et l’on considérait le monde comme une espèce de bagne où la force et la ruse dominaient nécessairement, fatalement, quand le bâton du garde-chiourme n’y venait point mettre le holà. On pensait que les jouissances des uns étaient inévitablement achetées au prix des souffrances des autres, et l’on ne voyait parmi les hommes que des spoliateurs et des spoliés, des fripons et des dupes, des bourreaux et des victimes. Voilà ce qu’on pensait de la société quand les économistes ont commencé à en étudier le mécanisme. Eh bien! qu’ont-ils fait ces économistes, dont quelques esprits prévenus repoussent les doctrines au nom de la religion? Ils se sont efforcés de démontrer que la Providence n’a pas [I-26] abandonné l’humanité aux impulsions aveugles du hasard. Ils se sont efforcés de démontrer que la société a ses lois providentielles, lois harmonieuses qui y font régner la justice comme les lois de la gravitation font régner l’ordre dans l’univers physique. Ils se sont efforcés de démontrer que l’antagonisme n’est point la loi suprême des relations sociales; mais que le monde est soumis, au contraire, à une inévitable loi de solidarité; qu’aucun homme ne peut souffrir sans que sa souffrance rejaillisse, se répercute parmi ses semblables, comme aussi que nul ne peut prospérer, sans que sa prospérité profite à d’autres hommes. Telle est la loi que les économistes ont entrepris de substituer au vieil antagonisme de l’antiquité paienne. N’est-ce pas, je le demande, une loi plus morale, plus religieuse, plus chrétienne? Ne nous donne-t-elle pas une idée meilleure de la Providence? Ne doit-elle pas contribuer à nous la faire aimer davantage? Si, en étudiant les œuvres des Kepler et des Newton, on voit s’agrandir la puissance divine, en observant, dans les livres des Smith, des Malthus, des Ricardo, des J.-B. Say, ou mieux encore, dans la société même, les lois harmonieuses de l’économie sociale, ne doit-on pas se faire une idée plus sublime de la justice et de la bonté de l’éternel ordonnateur des choses?
Voilà quels sont, au point de vue religieux, les résultats de l’étude de l’économie politique. Voilà comment l’économie politique conduit à l’irréligion.
Le reproche que l’on adresse aux économistes, de flatter les appétits matériels de l’homme, est-il mieux fondé?
Ce reproche peut être adressé, non sans raison, à certaines écoles socialistes, mais il ne saurait s’appliquer à l’économie politique. Car si les économistes constatent que les hommes ont à satisfaire des appétits matériels, ce qu’on ne saurait nier, je [I-27] pense, aucun d’eux n’a jamais enseigné que la prédominance dῦt appartenir à ces besoins inférieurs de notre nature. Aucun d’eux n’a engagé les hommes à s’occuper uniquement du soin de se nourrir, de se vètir et de se loger. Aucun d’eux ne leur a conseillé de se faire un dieu de leur ventre. Tous ont tenu soigneusement compte des besoins moraux, et ils ont rangé au nombre des richesses, les choses qui pourvoient à la satisfaction de ce genre de besoins. Les produits immatériels, tels que l’enseignement et le culte, ont été considérés par eux comme des richesses, au même titre que les produits composés de matière. Seulement, les économistes n’ont pas pensé qu’il fῦt raisonnable de jeter l’anathème sur ceux-ci, non plus que sur les besoins auxquels ils pourvoient. Tout en reconnaissant que l’homme est pourvu d’une âme ils se sont dit qu’il possède un corps aussi, un corps qu’il est tenu de conserver en bon état, dans l’intérêt même de l’âme à laquelle ce corps sert d’étui.
L’économie politique est si peu en désaccord avec la saine morale qu’une de ses plus belles démonstrations, celle qui concerne la formation des capitaux, repose précisément sur l’intervention des facultés morales de l’homme. En effet, les capitaux sont les fruits du travail et de l’épargne, et qu’est-ce que l’épargne, sinon un sacrifice qu’impose l’esprit de prévoyance et qui ne peut être accompli qu’avec l’auxiliaire d’une force morale assez grande pour résister aux sollicitations pressantes des appétits purement matériels? Lorsque cette force morale fait défaut ou qu’elle n’est point suffisamment développée, les capitaux ne se forment point, et la production, dont ils sont les agents indispensables, demeure stationnaire. Les travaux qui ont pour objet de cultiver et de perfectionner le moral de l’homme n’ont donc pas moins d’importance aux yeux de l’économiste, [I-28] que ceux qui le rendent aptes à exercer une profession ou un métier. Le prêtre, l’instituteur, et avant eux, la mère et le père de famille qui comprennent et remplissent leurs devoirs envers les êtres dont ils sont les tuteurs naturels, contribuent à former, en développant le moral des jeunes générations, le plus puissant des véhicules de la multiplication des richesses. C’est ainsi que l’économie politique est en désaccord avec la morale.
L’économie politique peut être encore considérée comme un instrument efficace de conservation sociale. Je viens de dire qu’avant que les notions économiques eussent commencé à se répandre, la croyance à l’antagonisme des intérêts était universelle. On était convaincu que ce que l’un gagnait, l’autre devait inévitablement le perdre; d’où l’on était amené à conclure que le riche n’avait pu faire fortune qu’au dépens du pauvre, et que la richesse accumulée dans certaines mains était un vol fait au reste de la communauté. Cette fausse notion du mécanisme de la société ne conduisait-elle pas droit au socialisme?
S’il était vrai, en effet, que la société se trouvât abandonnée aux impulsions aveugles du hasard; s’il était vrai que la force et la ruse fussent dans le monde les souveraines dispensatrices du bien-être, il y aurait lieu, assurément, “d’organiser” une société ainsi livrée à l’anarchie. Il y aurait lieu de faire régner l’ordre à la place de ce désordre, la justice à la place de cette iniquité. Si la Providence avait omis d’organiser la société, il faudrait bien qu’un homme se chargeât d’accomplir une œuvre si nécessaire. Il faudrait qu’un homme se fit Providence.
Or il n’y a pas au monde, remarquons-le bien, d’œuvre plus attrayante que celle-là; il n’y en a pas qui puisse davantage séduire notre amour-propre et flatter notre orgueil. On parle souvent de la satisfaction orgueilleuse qu’éprouve le maître d’un [I-29] grand empire en voyant tant de créatures humaines obéir à ses lois et se courber sur son passage. Mais cette satisfaction, si étendue qu’on la suppose, peut-elle se comparer à celle d’un homme qui rebâtit à sa guise, sur un modèle tiré de sa propre imagination, la société toute entière? d’un homme qui peut se tenir à lui-même ce langage superbe: “La société est un foyer d’anarchie. La Providence n’a pas voulu l’organiser ou peutêtre même ne l’a-t-elle pas pu! et depuis l’origine du monde ce grand problème de l’organisation du travail est demeuré l’énigme du sphinx qu’aucun législateur n’a su deviner. Eh bien! ce problème, moi je l’ai résolu; cette énigme, moi je l’ai devinée. J’ai donné à la société une base nouvelle. Je l’ai organisée de telle sorte qu’elle ne peut manquer désormais de goῦter une félicité parfaite. J’ai réussi par la seule force de mon génie à mener à bonne fin cette œuvre gigantesque. Il ne reste plus qu’à appliquer mon plan pour transformer notre vallée de misère en un Eldorado ou un pays de Cocagne.”
L’homme qui croit avoir accompli une telle œuvre, doit se regarder assurément comme un génie extraordinaire. Il doit s’estimer bien supérieur à tous les hommes qui ont paru avant lui sur la terre et presque l’égal de Dieu lui-même. N’a-t-il pas, en effet, complété, perfectionné l’œuvre de Dieu? Aussi, tous les utopistes sont-ils possédés d’un orgueil incommensurable. Fourier, par exemple, n’hésitait pas à affirmer que tous les philosophes et tous les législateurs, sans parler des économistes, que l’humanité avait commis la folie de prendre pour guides, l’avaient misérablement égarée; que l’on n’avait rien de mieux à faire que d’oublier au plus vite leurs lois ou leurs préceptes, et de jeter au feu les 400,000 volumes remplis d’erreurs et de mensonges dont ils avaient meublé les bibliothèques; en [I-30] remplaçant, bien entendu, ces livres inutiles ou malfaisants par ses propres livres. Fourier déclarait encore, naïvement, qu’il se considérait comme supérieur à Christophe Colomb, et il avait pris pour emblème une couronne impériale, convaincu que l’humanité reconnaissante le proclamerait un jour empereur des génies.
Voilà jusqu’où a été poussé le délire des réorganisateurs de la société. L’orgueil s’est gonflé comme une verrue monstrueuse sur ces intelligences quelquefois si remarquables, et il les a rendues difformes et repoussantes. On me dira: ces hommes sont fous! Je le veux bien; mais d’où provient leur folie, et comment se fait-il que cette folie soit contagieuse? Leur folie provient de ce qu’ils pensent que la société étant naturellement “anarchique,” il y a lieu de l’organiser. Cette folie est contagieuse, parce que la foule partage leur erreur; parce que la foule est imbue de la croyance que la société se trouve livrée à un aveugle antagonisme; parce que la foule croit, comme Montaigne, que le profit de l’un fait le dommage de l’autre, et que les riches n’ont pu s’enrichir qu’aux dépens des pauvres.
Mais cette ignorance de l’organisation naturelle de la société, cette ignorance présente un danger sérieux. Supposons que les masses fanatisées par l’utopie réussissent à faire tomber un jour entre leurs mains le gouvernement des nations; supposons qu’elles usent de leur puissance pour mettre en vigueur des systèmes qui blessent les conditions essentielles d’existence de la société. Qu’en résultera-t-il? C’est que la société se trouvera profondément atteinte dans sa prospérité, dans son bien-être. C’est qu’elle courra les mêmes risques, c’est qu’elle endurera les mêmes souffrances qu’un malade qui aurait confié le soin de sa santé à un marchand de vulnéraire. Je sais bien que la société possède une vitalité assez énergique pour résister aux [I-31] drogues les plus malfaisantes; je sais bien que la société ne saurait périr, mais elle peut cruellement souffrir et demeurer longtemps comme si elle était atteinte d’une langueur mortelle.
Remarquons encore ce qui arrive au sein d’une société que menacent les désastreuses expérimentations de l’utopie appuyée sur l’ignorance. Il arrive que les sources de la prospérité publique se tarissent par avance. Il arrive que la peur du mal devient presque aussi ruineuse que le mal même. Alors, les intérêts qui se savent menacés s’exaspèrent après s’être alarmés, et on les voit se résoudre parfois aux sacrifices les plus durs pour se débarrasser du fantôme qui les obsède. Pour se préserver du socialisme, on subit le despotisme.
Voilà pourquoi il est bon d’enseigner l’économie politique. C’est le seul moyen d’écarter ces terreurs qui servent de prétexte au despotisme, et peut-être, — disons-tout, — qui le justifient. Lorsque les masses connaîtront mieux les conditions d’existence de la société, on cessera de craindre qu’elles n’usent de leur puissance pour y porter atteinte. Elles en deviendront, au contraire, les meilleures gardiennes. On pourra confier alors à leurs lumières ce dépôt sacré des intérêts généraux de la société dont leur ignorance et leur crédulité compromettraient aujourd’hui l’existence. On pourra leur accorder des droits dont il serait imprudent de les gratifier au moment où nous sommes. Alors aussi la société deviendra véritablement inexpugnable, car elle disposera, pour se défendre, de toutes les forces qu’elle recèle dans son sein.
Ainsi donc, l’économie politique est une science essentiellement religieuse, en ce qu’elle manifeste plus qu’aucune autre l’intelligence et la bonté de la Providence dans le gouvernement supérieur des affaires humaines; l’économie politique est une [I-32] science essentiellement morale, en ce qu’elle démontre que ce qui est utile s’accorde toujours, en définitive, avec ce qui est juste; l’économie politique est une science essentiellement conservatrice, en ce qu’elle dévoile l’inanité et la folie des théories qui tendent à bouleverser l’organisation sociale, en vue de réaliser un type imaginaire. Mais l’influence bienfaisante de l’économie politique ne s’arrête pas là. L’économie politique ne vient pas seulement en aide à la religion, à la morale et à la politique conservatrice des sociétés, elle agit encore directement pour améliorer la situation de l’espèce humaine. Voici de quelle manière:
Quand on considère la société, on demeure frappé des inégalités qu’elle recèle dans son sein, des richesses et des misères qui s’y trouvent juxtaposées, des alternatives de prospérité et de décadence qui s’y présentent: tantôt le corps social apparaît florissant de santé et de bien-être; tantôt il semble près de succomber sous le faix des maux qui l’accablent. Eh bien, que fait l’économie politique? Elle remonte, par ses patientes analyses, aux sources du bien-être et du mal-être du corps social; elle divulgue les causes de la prospérité et de la décadence des nations. Elle examine l’influence des institutions et des lois sur la condition des masses et elle étudie, au même point de vue, les passions humaines. Elle signale aux nations les réformes qu’elles peuvent introduire utilement dans leurs institutions et elle encourage les hommes à refréner leurs passions, à corriger leurs vices, en mettant en lumière les répercussions funestes mais trop souvent inaperçues des passions et des vices de chacun sur la condition de tous.
Ainsi, pour citer quelques exemples, l’étude des lois de la production et la distribution des richesses démontre que les [I-33] barrières artificielles dont l’ignorance et la cupidité se sont servies pour séparer les peuples, les monopoles, les priviléges, les gros impôts sont nuisibles aux intérêts du plus grand nombre; qu’ils retardent la diffusion du bien-être et les progrès de la civilisation. Que les notions économiques se vulgarisent davantage; que toutes les intelligences viennent à être pleinement édifiées sur les effets des barrières douanières, des monopoles, des priviléges et des gros impôts, et l’opinion aura bientôt fait justice de ces obstacles qui se dressent sur la route du progrès.
Ainsi encore, l’étude des lois économiques démontre que les intérêts des peuples sont solidaires; que chacun est intéressé à la prospérité de tous. Que cette vérité vienne à être universellement répandue, que chaque nation acquière la conviction qu’en faisant tort aux autres elle se fait tort à elle-même, et la guerre, cette destruction systématique des hommes et des capitaux, ne deviendra-t-elle pas, pour ainsi dire, impossible? N’aura-t-elle point pour adversaire la formidable coalition des intérêts auxquels elle porte atteinte et qui sauront désormais à quel point elle leur est funeste?
Ainsi, enfin, l’économie politique fait voir quelle influence néfaste la satisfaction désordonnée de certains appétits exerce sur la condition de l’espèce humaine. Elle enseigne, par exemple, qu’en se multipliant sans prévoyance, en s’abandonnant à l’instinct qui les pousse à se reproduire, sans avoir égard à l’étendue de l’arène ouverte à leur activité, les hommes se précipitent dans un abîme de maux. Elle enseigne qu’aucun progrès ne saurait améliorer efficacement le sort d’un peuple qui n’apporte aucune règle, aucun frein à sa reproduction, et que l’imprévoyance est un crime que la Providence punit de mort. Que cette connaissance des suites fatales de la satisfaction [I-34] immodérée d’une de nos passions les plus véhémentes vienne à se vulgariser, et les masses, désormais instruites des calamités auxquelles elles s’exposent en obéissant aveuglément à un appétit brutal, ne se montreront-elles pas plus disposées à écouter les conseils de la prévoyance en matière de population? Les gouvernements, à leur tour, oseront-ils encore accorder des primes à l’imprévoyance, en multipliant sans mesure les secours de la charité publique?
L’économie politique peut donc exercer une influence considérable sur l’amélioration progressive du sort du plus grand nombre, en engageant les hommes à conformer leurs institutions et leurs actes aux lois immuables auxquelles leur existence est soumise, lois dont l’essence même est l’utilité et la justice. Que ses vérités deviennent pour tous les peuples des articles de foi, et les obstacles dont l’ignorance, la cupidité, la fausse gloire, les passions inférieures de l’âme humaine ont semé la route du progrès, s’aplaniront peu à peu, la condition des masses s’améliorera chaque jour d’une manière plus sensible, enfin l’humanité marchera d’un pas plus rapide et plus assuré vers l’idéal de progrès, vers le summum de civilisation qu’il est dans sa destinée d’atteindre.
[I-35]
PREMIÈRE PARTIE de la production des richesses
[I-36]
[I-37]
PREMIÈRE LEÇON.↩
les besoins et les moyens de production.
L’homme considéré au point de vue économique. — Ses besoins. — Analyse des principaux besoins. — Éléments dont l’homme dispose pour les satisfaire. — Définition de la production; — du produit; — de la richesse; — des agents productifs; — du travail; — des capitaux fixes et circulants; — des agents naturels appropriés; — non appropriés. — Que le concours de ces agents est nécessaire dans toutes les opérations de la production. — Formule. — Des résultats de la production. — Du produit brut et du produit net. — De l’épargne et de son rôle dans la production.
Avant d’étudier l’organisation de la société, il est essentiel de jeter un coup d’œil sur l’homme. L’homme c’est la matière vivante dont se compose la société; c’est, pour ainsi dire, la molécule sociale. Analysons donc l’homme, considéré à ce point de vue; recherchons quelle est sa nature et quels sont les mobiles de son activité.
L’homme nous apparaît comme un composé de matière, d’intelligence et de sentiment. Ce sont les trois éléments constitutifs de son être. Or, ces éléments qui se trouvent associés, combinés dans la créature humaine, en vertu de lois qui nous [I-38] sont inconnues, doivent être incessamment entretenus et renouvelés, sinon l’homme souffre et périt.
De là, la notion du besoin. L’homme a des besoins qui répondent aux trois éléments constitutifs de son être. Il a des besoins physiques, intellectuels, et moraux.
La vie, soit physique, soit intellectuelle, soit morale s’entretient en nous par la satisfaction de nos besoins. Les aliments que nous leur donnons sont l’huile de notre lampe. Nous sommes tenus de nous procurer ces aliments essentiels à la vie, sous peine de périr ou de vivre seulement d’une manière incomplète.
On peut soumettre à une analyse détaillée les divers besoins de l’homme. Mais un travail de ce genre serait sans utilité pour nous. Il n’est pas nécessaire que nous examinions avec détail chacun des appétits qui sollicitent l’homme et auxquels il est obligé de pourvoir, sous peine de souffrir et de périr. Un simple coup d’œil jeté sur l’ensemble de ces appétits inhérents à la nature humaine nous suffira.
Les besoins physiques concernent l’existence matérielle de l’homme. Le besoin d’alimentation est le plus urgent de tous. Notre corps est ainsi fait que nous sommes obligés de lui fournir une alimentation quotidienne; chaque individu, selon sa complexion, selon le milieu où il se trouve placé, a besoin d’absorber régulièrement une quantité plus ou moins considérable de substances alimentaires. Après le besoin de s’alimenter vient celui de se préserver d’une multitude de causes de destruction qui menacent incessamment la frêle machine humaine. Nous avons d’abord à nous protéger contre les intempéries des saisons, contre l’excès du froid, de la chaleur, de l’humidité. Nous sommes obligés, en conséquence, de nous vêtir et de nous [I-39] loger. Nous avons encore à nous défendre contre une multitude d’êtres nuisibles, depuis le scorpion jusqu’à l’homme lui-même. Je ne veux pas dire certes que l’homme soit naturellement l’ennemi de l’homme. Non! je veux dire seulement que les hommes, dans leur ignorance, se sont considérés comme des ennemis, et qu’ils se sont traités comme ces fils de Cadmus dont parle Ovide: à peine nés, ils se sont entretués.
Se nourrir, se vêtir, s’abriter, se défendre, voilà donc quels sont les premiers besoins auxquels l’homme doit pourvoir.
Après les besoins physiques, viennent les besoins intellectuels et moraux.
Quoique ceux-ci occupent une place considérable dans l’existence humaine, ils ne sont pas revêtus d’un caractère d’urgence aussi marqué que les besoins physiques. A la rigueur, on peut vivre sans leur donner satisfaction. On peut se borner à satisfaire ses besoins physiques, à boire, à manger, à se préserver des éléments et des animaux destructeurs, etc., mais il ne faut pas s’y tromper: quand on se borne à cela, on n’a qu’une vie incomplète, tronquée. On ne vit ni par l’intelligence ni par le sentiment. On n’est pas un homme, on est une simple brute.
L’intelligence a ses besoins comme le corps; elle a son activité, sa vie propre, et cette activité, cette vie ne se maintiennent qu’à l’aide d’une assimilation continue d’aliments conformes à sa nature. L’intelligence a soil de connaissances: elle a besoin de recevoir incessamment des impressions nouvelles, de les accumuler, de les associer ou de les combiner. Et de même que chaque palais a ses aliments préférés, chaque intelligence a ses affinités propres. Mais de quelque façon que se manifestent les appétits intellectuels, ils exigent impérieusement satisfaction. C’est une vérité d’observation que l’intelligence [I-40] veut être alimentée, sinon elle dépérit, elle s’atrophie et l’homme n’a plus alors qu’une vie imparfaite.
Les besoins moraux sont, avec ceux de l’intelligence, les signes qui distinguent l’homme de la brute. Ils sont plus ou moins développés selon les peuples et selon les individus, mais aucune créature humaine n’en est complétement dépourvue. Or, ces besoins de l’âme exigent une satisfaction, un apaisement comme les autres. L’homme éprouve, par exemple, le besoin de fonder une famille; je ne parle pas du besoin purement physique de la reproduction qui lui est commun avec les espèces inférieures de l’animalité, mais le besoin d’aimer des êtres issus de son sang. L’amour de la famille est un de ces besoins moraux, et c’est peut-être le plus impérieux de tous. Ce besoin, l’homme le satisfait en mettant au monde des enfants qu’il élève et soutient jusqu’à ce qu’ils soient en état de s’entretenir eux-mêmes. Après le sentiment de la famille, il y en a un autre qui nous porte à aimer non seulement les êtres semblables à nous, mais encore les créatures inférieures et jusqu’aux choses inanimées. Quand ce sentiment s’applique indistinctement à nos semblables, nous l’appelons bienveillance, amour de l’humanité, je dirais encore fraternité, si l’on n’avait pas tant abusé du mot. Quand il s’applique à des êtres dont la nature est particulièrement sympathique à la nôtre, il prend le nom d’amitié. L’amour de la patrie est une manifestation sui generis du sentiment dont je parle. Nous aimons notre patrie parce que, grâce à la communauté du langage, aux affinités du caractère, au rapprochement des intérêts, nous éprouvons pour nos compatriotes une sympathie particulière. Nous aimons encore notre patrie, parce que nous avons des affinités mystérieuses avec le sol, avec le climat, avec les circonstances [I-41] naturelles qui caractérisent les lieux qui nous ont vus naître. Et ces affinités diverses agissent avec tant d’énergie sur certains hommes, qu’ils éprouvent, loin de leur pays, un malaise étrange, une tristesse profonde, à ce point qu’ils finissent quelquefois par en mourir. Ils meurent de la nostalgie.
L’homme est encore doué du sentiment du beau, possédé de l’amour de l’idéal. Il est affamé d’ordre, d’harmonie, et pour satisfaire ce goῦt sublime, il embellit sa demeure, il se pare lui-même, il s’efforce d’imprimer à toutes ses œuvres un cachet d’élégance et de grandeur. Il emploie l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie à satisfaire ce noble appétit qui lui procure de si vives et de si pures jouissances.
Enfin, l’homme est naturellement religieux. Il éprouve le besoin d’aimer, de vénérer un être supérieur. Il éprouve le besoin d’aimer Dieu. Et ce besoin moral est presque aussi général et aussi intense que le plus général et le plus intense de ses besoins physiques. Le sentiment religieux se retrouve à toutes les époques de l’histoire et dans toutes les régions du globe. Partout aussi il a reçu une satisfaction plus ou moins élevée et épurée, selon l’élévation de la nature morale et le degré de civilisation des peuples. Partout, même chez les peuples réduits à la condition la plus abjecte, on a élevé des autels à la Divinité.
En résumé donc, nous avons des besoins physiques, intellectuels et moraux, inhérents à notre nature et dépendants du milieu où nous vivons. Lorsque nous ne donnons point satisfaction à ces besoins qui nous sollicitent; lorsque nous ne leur fournissons point les aliments qui leur sont nécessaires, — aliments matériels, intellectuels et moraux, — nous souffrons [I-42] et nous finissons par périr. Lorsque nous les apaisons, nous éprouvons, au contraire, une jouissance.
Maintenant, il s’agit de savoir de quels éléments nous pouvons disposer pour satisfaire à nos besoins.
Le globe que nous habitons, l’immensité dont nous avons la perspective, la société au sein de laquelle nous vivons, renferment tous les éléments nécessaires à la satisfaction de nos appétits matériels, intellectuels et moraux.
S’agit-il de nos besoins physiques? Des variétés infinies de quadrupèdes, d’oiseaux, de poissons et d’insectes; des végétaux non moins nombreux et divers peuvent nous servir d’aliments. Des substances minérales de toute sorte, des plantes textiles et tinctoriales, des animaux couverts de fourrures, nous fournissent tous les éléments nécessaires pour nous préserver des atteintes des forces brutes de la nature ou pour nous défendre contre les agressions des animaux nuisibles. S’agit-il de nos besoins intellectuels? Le spectacle du monde où nous vivons, les phénomènes qui s’y produisent, notre nature si diverse et si compliquée, nos relations avec nos semblables et avec le reste de la création, les procédés nécessaires pour nous faire subsister et pour améliorer notre sort, voilà de quoi satisfaire amplement tous les appétits de notre intelligence. S’agit-il de nos besoins moraux? Depuis le lieu même de notre naissance, depuis la plaine, le coteau ou la vallée dont l’aspect a frappé nos premiers regards, jusqu’à l’auteur inconnu des choses, nous voyons se dérouler sous nos yeux une immense série de créations brutes ou animées sur lesquelles nous pouvons assouvir ce besoin d’aimer qui est l’essence morale de notre être.
Mais le plus grand nombre de ces éléments de satisfaction qu’une Providence bienveillante nous a prodigués, doivent être [I-43] appropriés à notre usage et mis à notre portée. Ainsi la terre nous offre dans son sein ou à sa surface toutes les substances végétales et animales nécessaires à notre alimentation, mais il faut que nous sachions nous en emparer et, au besoin, les multiplier. Il faut atteindre la bête fauve dans les forêts, le poisson dans les eaux, l’oiseau dans les airs; soumettre les plantes à une culture régulière; préparer la peau et le poil des animaux; tisser et colorer les étoffes, puis les transformer en vêtements; il faut abattre les arbres, extraire les pierres et les métaux des carrières et des mines pour construire des habitations où l’on soit à l’abri des intempéries et où les affections de la famille trouvent un point de réunion, un foyer. Il faut encore détruire les animaux et les plantes nuisibles; opposer une digue au fleuve qui déborde, dessécher et assainir les terres marécageuses; établir des voies de communication, à l’aide desquelles nous puissions nouer et entretenir des relations avec nos semblables, ou, au besoin, nous défendre contre eux, etc., etc.
L’ensemble des opérations ayant pour objet d’approprier à la satisfaction de nos besoins les choses qui nous sont nécessaires, se nomme la production.
Le résultat de la production, c’est le produit; l’ensemble des produits, c’est la richesse.
Toute production, quelle que soit sa nature, exige le concours d’un certain nombre d’agents productifs.
Ces agents productifs ont été partagés en quatre catégories.
I. Les forces on facultés physiques, intellectuelles et morales de l’homme. C’est le travail.
II. Les éléments ou les instruments de production que l’homme a accumulés soit sur le sol, soit en lui-même, tels que les bâtiments d’exploitation, les machines, les matières pre mières, [I-44] les avances nécessaires à l’entretien des travailleurs, les connaissances et les procédés techniques nécessaires à la production. C’est le capital.
On divise encore le capital, en capital fixe et en capital circulant. Le premier se compose d’agents qui concourent successivement à un certain nombre d’opérations de la production. Le second se compose d’agents qu’il faut renouveler entièrement à chaque opération.
III. Les fonds de terre, les gisements minéraux, les courants d’eau et les autres agents naturels que l’homme a découverts et préparés pour la production. Ce sont les agents naturels appropriÉs.
IV. Enfin les éléments et les forces que la nature met au service de la production, sans qu’il soit nécessaire de leur faire subir aucune préparation, tels que l’air, la lumière du soleil, l’eau de l’océan, etc. Ce sont les agents naturels non appropriÉs.
De ces quatre catégories d’agents productifs, les trois premières seules doivent occuper l’attention de l’économiste, la quatrième étant mise gratuitement au service de la production.
Si l’on observe la multitude des ramifications de la production, on s’aperçoit qu’elles exigent toutes, indistinctement, le concours des agents productifs qui viennent d’être énumérés; mais, en même temps, que les proportions dans lesquelles elles exigent ce concours varient d’une manière presque infinie: tantôt il leur faut plus de travail, tantôt plus de capital fixe ou circulant, tantôt plus d’agents naturels appropriés ou non appropriés.
Considérons, par exemple, à ce point de vue, l’industrie qui pourvoit au besoin de l’alimentation, l’industrie agricole, ou, [I-45] pour simplifier, l’une de ses branches, celle qui s’occupe de la production du blé.
Que faut-il pour produire du blé?
Il faut:
- 1° Des hommes pourvus de la vigueur et des aptitudes nécessaires pour défricher et labourer la terre, recueillir le grain, etc., c’est à dire du travail;
- 2° Une surface plus ou moins étendue de terre propre à la production du blé, c’est à dire un agent naturel approprié;
- 3° Des avances et des approvisionnements de toute sorte pour entretenir le personnel appliqué à la production du blé, et lui permettre de se renouveler; des bâtiments d’exploitation, du bétail, des outils et des machines, des connaissances et des procédés techniques, des engrais, des semences, etc., en un mot, une certaine quantité de capital fixe et de capital circulant;
- 4° Des agents naturels non appropriés, tels que l’air, l’eau du ciel, la lumière du soleil, etc.
Tels sont les agents dont le concours est nécessaire à la production du blé. Que l’un ou l’autre fasse défaut, et cette production ne pourra s’opérer.
Or, —et c’est là une observation d’une importance capitale, — ces agents productifs sont exigés, requis dans une certaine proportion déterminée par la nature même de la production.
Supposons qu’il s’agisse de produire un million d’hectolitres de blé, il faudra un certain nombre de travailleurs, de bêtes de trait, d’instruments aratoires, une certaine quantité d’engrais et de semences, une certaine étendue de terre, une certaine quantité de chaleur et de pluie. Si la proportion nécessaire de ces agents productifs n’est point observée, si certains agents [I-46] surabondent relativement aux autres, le surplus demeurera inutile, s’il n’est pas nuisible. S’il y a, par exemple, plus de bras que cela n’est nécessaire, un certain nombre de ces bras demeureront sans emploi; s’il y a plus de terres, de charrues ou de bêtes de trait, l’excédant ne pourra, de même, être utilisé.
Il y a, comme on voit, une proportion naturelle et nécessaire entre les agents dont la production exige le concours. Cette proportion est-elle la même dans toutes les branches de la production? Non. Loin de là, elle diffère dans chacune. Vous retrouverez, dans chacune des branches de la production, des agents productifs, appartenant aux quatre catégories mentionnées plus haut, mais ils y seront dans des proportions différentes. Choisissons un second exemple pour rendre cette démonstration plus claire. Examinons quels agents productifs sont nécessaires pour faire fonctionner l’industrie de la locomotion à la vapeur. Il faut des travailleurs pourvus d’aptitudes et de connaissances spéciales; il faut des bâtiments, des machines, des locomotives, des waggons, etc.; il faut une bande de terre nivelée et revêtue de rails; il faut encore des avances et des matières premières de diverses sortes pour entretenir et faire fonctionner le personnel et le matériel d’exploitation. Vous reconnaîtrez au premier coup d’œil que ces agents productifs ont entre eux une proportion naturelle et nécessaire; vous reconnaîtrez aussi que cette proportion diffère essentiellement de celle qui est exigée dans la production agricole ou dans toute autre. Il faut proportionnellement plus de capital et moins de terre dans l’industrie de la locomotion qu’il n’en faut dans l’industrie agricole.
Examinez, au même point de vue, les différentes branches [I-47] de la production, et vous vous convaincrez, d’une part, que chacune exige, dans des proportions déterminées, la coopération du travail, des capitaux fixes et circulants, des agents naturels appropriés et non appropriés; d’une autre part, que ces proportions naturelles et nécessaires se diversifient à l’infini selon la nature de la production.
Au moins demeurent-elles toujours les mêmes dans chaque branche de la production?
Non. Elles se modifient incessamment sous l’influence du progrès industriel.
Dans les premiers âges des sociétés, la production n’emploie qu’une faible proportion de capitaux fixes ou circulants, mais elle exige, en revanche, beaucoup de travailleurs et beaucoup de terres. Plus tard, on voit la proportion des capitaux fixes et circulants empiéter successivement sur celle du travail et des agents naturels appropriés. Considérez, par exemple, l’industrie alimentaire, dans ses différentes périodes de développement, et vous serez frappé des modifications qui se sont opérées dans la proportion de ses agents productifs. Lorsque l’homme vit en recueillant des fruits, des racines ou des mollusques, l’industrie alimentaire n’exige le concours d’aucun capital fixe. A la rigueur même, le sauvage, qui subsiste au moyen de cette industrie grossière, peut se passer d’un capital circulant. Mais qu’il se livre à la chasse ou à la pêche, et aussitôt il lui faudra un capital fixe, consistant en armes de chasse ou en engins de pêche, plus un capital circulant, consistant dans les approvisionnements nécessaires à sa subsistance jusqu’à ce qu’il ait atteint le gibier ou le poisson. Qu’à la chasse ou à la pêche il substitue l’agriculture, et il lui faudra une proportion bien plus considérable encore de capitaux fixes et circulants. Il aura [I-48] besoin d’instruments aratoires et de bêtes de somme pour défricher le sol, de magasins pour conserver le grain, de clôtures et de fossés pour défendre sa terre et la dessécher, d’engrais pour la fertiliser, capital fixe; il aura besoin encore d’une certaine quantité de semences et d’une forte avance de subsistances pour lui et ses coopérateurs, jusqu’à ce que le blé qu’il a semé puisse être recueilli et utilisé, capital circulant. Il lui faudra, en dernière analyse, plus d’instruments et de provisions que lorsqu’il vivait de la cueillette des fruits, de la chasse ou de la pêche; en revanche, il n’aura plus besoin de consacrer, à la production de ses aliments, une proportion aussi considérable de travail et de terre. A mesure que l’agriculture se perfectionnera, elle exigera moins de travail et de terre, plus de capitaux fixes et circulants. L’agriculture britannique, la plus avancée que l’on connaisse, emploie beaucoup moins de travail et de terre que l’agriculture française, mais la proportion relative de ses capitaux fixes et circulants est infiniment plus forte. Considérez enfin les industries qui s’occupent de la production de vos vêtements, et vous ne serez pas moins frappé des changements successifs qui se sont opérés dans la proportion de leurs agents productifs. Avant l’introduction de la machine à filer, par exemple, les industries qui façonnent le coton, la laine et le lin, exigeaient beaucoup de travail et peu de capital fixe; aujourd’hui, au contraire, elles exigent proportionnellement plus de capital et moins de travail. Ainsi des autres.
En résumé:
Il y a une proportion naturelle et nécessaire entre les agents dont la production exige le concours; cette proportion n’est pas la même dans les différentes branches de la production, et elle varie encore dans chacune sous l’influence du progrès.
[I-49]
Nous venons de voir que la production s’accomplit à l’aide d’agents productifs de diverses sortes, associés, combinés dans des proportions déterminées. Jetons maintenant un coup d’œil sur ses opérations.
Toute production implique la destruction ou la consommation totale de certains agents productifs, partielle de certains autres. Voyez ce qui se passe à cet égard dans la production agricole. Lorsqu’une certaine quantité de blé est produite et recueillie, les hommes, les instruments aratoires, les bêtes de somme et la terre qui ont servi à la produire, sont plus ou moins usés, détériorés; en outre, leurs frais d’entretien, plus la semence, sont entièrement consommés. Il en est de même dans l’industrie de la locomotion. Lorsqu’un certain nombre de voyageurs et une certaine quantité de marchandises ont été transportés, le personnel et le matériel qui ont servi à effectuer ce transport, ont subi une détérioration, une usure plus on moins considérable; d’un autre côté, les approvisionnements divers qui ont servi à alimenter et à entretenir les hommes, les matières premières qui ont servi à faire mouvoir les machines et à les maintenir en bon état, ont été entièrement consommés. Que l’on analyse les opérations de toutes les autres entreprises de la production et l’on observera le même phénomène. On trouvera que toute production implique la destruction totale de certains agents productifs, la destruction partielle de certains autres.
Cela posé, la production peut donner trois résultats différents.
- I. Le résultat de la production où le produit peut ne point suffire pour remplacer la portion des agents productifs qui a été détruite ou consommée en totalité, pour réparer et renouveler [I-50] à la longue celle qui a été détruite en partie. Alors on dit de la production qu’elle ne couvre pas ses frais, qu’elle est en perte. Si cette situation se prolonge, que doit-il arriver? Inévitablement que la production finira par s’arrêter, en conséquence de l’anéantissement successif des agents productifs.
- II. Le résultat de la production peut suffire exactement pour entretenir et renouveler les agents productifs, ou ce qui revient au même, pour couvrir les frais de production. Dans ce cas, la production peut se poursuivre, mais elle ne peut s’accroître.
- III. Le résultat de la production peut dépasser ce qui est nécessaire pour entretenir et renouveler les agents productifs. Dans ce cas, on dit des producteurs qu’ils réalisent un profit ou un bénéfice, et la production peut, non seulement se poursuivre, mais encore s’accroître.
Le résultat général de la production, soit que celle-ci donne une perte ou un bénéfice, soit encore qu’elle ne donne ni perte ni bénéfice, porte le nom de produit brut.
Lorsque la production donne un excédant, cet excédant c’est à dire la portion du produit brut qui dépasse les frais de production et qui est communément désignée sous le nom de profit ou de bénéfice, porte encore le nom de produit net.
C’est seulement lorsque la production donne un produit net qu’elle peut s’accroître. Voyons de quelle manière elle s’accroît.
Supposons qu’une entreprise de production ne donne u’un produit brut exactement suffisant pour entretenir et renouveler son personnel et son matériel, que se passera-t-il? S’il s’agit, par exemple, d’une entreprise agricole, une partie du produit brut devra être consacrée à l’entretion et au renouvellement des travailleurs, une autre partie à l’entretien et au renouvellement [I-51] des forces productives du sol, une troisième partie à l’entretien et au renouvellement du capital fixe et circulant, outils, bétail, semences, bâtiments d’exploitation. Comme il n’y aura rien en sus de ces frais de production, comme le produit brut ne suffira que juste pour maintenir la production en état, les producteurs ne pourront rien mettre en réserve, et si toutes les industries se trouvent dans la même situation, la société demeurera stationnaire.
Supposons, au contraire, qu’il y ait un produit net, que se passera-t-il? Quel emploi pourra-t-on donner à ce produit net? Les producteurs, ou, ce qui est synonyme, les détenteurs des agents productifs, entre lesquels il se partagera, pourront l’employer de deux manières. Ils pourront:
- 1° L’employer à se procurer un supplément de jouissances, le consacrer à des dépenses de luxe, ou, ce qui revient au même, à une consommation improductive;
- 2° L’employer à augmenter la production, en lui donnant la forme d’un supplément d’agents productifs, ou, ce qui revient encore au même, le consacrer à une consommation reproductive.
La production ne peut se développer à moins qu’une partie du produit net ne soit régulièrement appliquée à une consommation reproductive. Rappelons-nous, en effet, que la production exige le concours d’agents productifs divers, dans des proportions déterminées. Si l’on veut donc l’augmenter, que faut-il faire préalablement? Il faut créer les agents productifs nécessaires au supplément que l’on veut y ajouter. Si l’on veut produire, par exemple, un supplément de subsistances et de vêtements, il faut préalablement se procurer un certain nombre de travailleurs, d’outils, de machines, de bâtiments, une certaine [I-52] quantité de matières premières, une certaine étendue de terre, le tout dans des proportions déterminées par la nature des industries dont il s’agit d’augmenter la production. Il faut consacrer le produit net ou une portion du produit net à cet usage, sinon le supplément de production ne pourra être créé faute des instruments nécessaires.
C’est donc une accumulation d’agents productifs qu’il faut faire, si l’on veut augmenter la production. Il faut former et réunir pour chaque entreprise nouvelle qu’on veut créer ou pour les entreprises existantes qu’on veut développer, une certaine quantité d’instruments et de matériaux, en même temps qu’un certain nombre de travailleurs. Or, cette accumulation d’agents productifs ne peut être opérée que par l’intervention de l’épargne.
Ordinairement, on n’entend par épargner que l’action de mettre sous la forme de capitaux fixes et circulants, une portion du produit net annuel de la société. Il est bien évident cependant que mettre un supplément de travailleurs et de terres au service de la production, dans la proportion nécessaire, c’est encore épargner. Épargner doit se dire de toute accumulation d’agents productifs, formée en vue d’une augmentation de la production.
S’il n’y avait point d’épargne, si l’on n’accumulait point de nouveaux agents productifs, dans la proportion nécessaire, la production ne pourrait s’accroître. Cela est de toute évidence. Pourtant la nécessité d’épargner pour augmenter la production, a été niée. On a prétendu qu’il suffisait d’augmenter la consommation pour développer par là même la production, et l’on a dressé des autels aux prodigues qui gaspillent la richesse, comme s’ils contribuaient à l’accroître. On n’a pas vu que les [I-53] prodigues, c’est à dire les hommes qui emploient une partie du produit net de la société à satisfaire leurs besoins immédiats ne pourraient obtenir cette satisfaction, si une autre portion du produit net n’était épargnée pour produire les choses qu’ils consomment. On n’a pas vu, et la méprise est singulière, que tout supplément de consommation doit être nécessairement précédé d’un supplément d’épargne.
Maintenant, il ne suffit pas d’épargner pour augmenter la production, il faut encore bien employer son épargne.
Bien employer son épargne, c’est s’en servir pour former des agents productifs dans la proportion nécessaire. Quand cette proportion n’est pas observée, l’épargne devient inutile, parfois même nuisible. Si l’on consacre, par exemple, une portion trop considérable du produit net à augmenter le nombre des travailleurs par rapport à la quantité des matières premières, au nombre des terres, des bâtiments, des machines, etc., nécessaires à la production, il est évident que l’excédant du matériel humain ainsi accumulé ne pourra être utilisé. De même, si l’on construit trop de bâtiments ou trop de machines, si l’on approprie trop de terres à la production, par rapport à la quantité de travail dont on peut disposer, l’excédant demeurera encore sans emploi.
Ainsi donc la production ne peut s’accroître qu’autant qu’elle donne un produit brut qui dépasse la somme nécessaire pour entretenir et renouveler ses agents productifs, que l’excédant ou produit net est épargné en partie, et que l’épargne est mise sous la forme d’agents productifs, dans la proportion voulue.
Que si l’on considère l’espèce humaine depuis son origine, on trouvera qu’elle s’est progressivement développée et enrichie; que le nombre des hommes s’est multiplié, que la somme [I-54] des capitaux fixes et circulants s’est accrue, et qu’une surface de plus en plus étendue du globe terrestre a été appliquée à la production. Que prouve ce fait? Que, depuis son origine, l’humanité, prise dans son ensemble, a obtenu au delà de ce qui lui était rigoureusement nécessaire pour entretenir et renouveler les agents et les éléments de la production; qu’elle a réalisé incessamment, malgré des désastres sans nombre, un surplus ou produit net, que ce surplus ou produit net elle l’a épargné en partie; qu’elle a employé son épargne à mettre au service de la production un supplément de subsistances et de matières premières, à élever et à former un supplément de travailleurs, à construire un supplément de bâtiments, de machines, d’outils, à défricher un supplément de terres, le tout dans la proportion nécessaire.
C’est ainsi que s’est accumulé, de siècle en siècle, l’immense matériel dont l’humanité se sert actuellement pour produire.
[I-55]
DEUXIÈME LEÇON↩
la spÉcialisation des industries eT l’Échange
Causes naturelles qui déterminent la spécialisation des industries et des fonctions productives; — diversité et inégalité de la répartition des facultés productives parmi les hommes; — diversité et inégalité de la distribution des agents naturels de la production; — nécessité de l’intervention des machines et des connaissances professionnelles. — Développement historique du phénomène de la division du travail. — Point où elle est parvenue dans quelques-unes des branches de l’activité humaine, l’industrie cotonnière, l’imprimerie, l’horlogerie, etc. — Analyse de ses avantages d’après Adam Smith, Babbage et Ch. Lehardy de Beaulieu. — Que la spécialisation des fonctions est le caractère de tout organisme supérieur. — Qu’elle implique l’Échange. — Qu’elle s’opère en raison de l’étendue de la sphère de l’échange. — Extension progressive de la sphère de l’échange et ses conséquences.
La réunion ou la combinaison, dans certaines proportions déterminées, des agents productifs que nous avons désignés sous les dénominations de travail, de capital et d’agents naturels appropriés, tel est le premier caractère essentiel de la production.
[I-56]
Le second consiste dans la spécialisation des industries et des fonctions productives, ou, pour nous servir de l’expression qu’Adam Smith a fait prévaloir, dans la division du travail.
Comme l’association des agents productifs, la spécialisation des industries et des fonctions productives est commandée par la nature même des choses.
Si nous jetons, en effet, un coup d’œil sur l’homme et sur le milieu où il se trouve placé, nous serons frappés du phénomène que voici. Nous remarquerons que les facultés ou les aptitudes des hommes sont essentiellement diverses et inégales; d’où il résulte que chaque individu est plus propre à exécuter certaines opérations de la production, moins propre à exécuter certaines autres. Nous remarquerons encore que chacune des régions du globe ne renferme point tous les éléments nécessaires à tous les genres de production; que quelques-uns de ces éléments abondent dans certains endroits et manquent complétement dans d’autres: d’où il résulte encore que certains produits peuvent être obtenus, ici facilement, là difficilement, ou même qu’il y a impossibilité de les obtenir [5]
[I-57]
En présence de cette inégalité et de cette diversité de la distribution des éléments naturels de la production, qu’arriverait-il si chacun s’efforçait de produire isolément, dans le coin de terre où la Providence l’a placé, les choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins? Il arriverait que nous ne pourrions obtenir que le plus petit nombre de ces choses; que nous ne pourrions nous procurer qu’un minimum de jouissances.
Cela arriverait d’abord parce que chaque homme n’est pas pourvu de toutes les facultés nécessaires pour produire toutes choses, et que chaque coin de terre ne contient pas tous les éléments minéraux, végétaux et animaux, sans parler des fluides, dont la coopération est requise dans l’ensemble des branches de la production.
[I-58]
Cela arriverait ensuite parce que la production, ainsi isolée, morcelée, ne comporterait point le développement d’une puissance productive suffisante pour surmonter les obstacles que la nature oppose à la satisfaction des besoins de l’homme; parce qu’un homme obligé d’appliquer successivement ses facultés à la production de la multitude de choses nécessaires à l’apaisement de ses besoins si nombreux et si divers ne pourrait acquérir assez de connaissances et d’habileté, enfin parce qu’il ne pourrait mettre en œuvre des machines assez puissantes pour exécuter aussi économiquement que possible chacune des opérations de la production.
On trouve en Afrique, en Australie et dans les archipels de la mer du Sud, des peuplades sauvages, au sein desquelles la division du travail existe à peine; mais leur puissance productive se trouvant par là même extrêmement limitée, ces peuplades demeurent plongées dans la misère la plus profonde.
Aussi, dès les premiers âges de l’humanité, voit-on apparaître avec le phénomène de l’association ou de la combinaison des agents productifs, celui de la spécialisation des industries et de la division du travail. Des hommes réunissent, associent, combinent leurs forces physiques, intellectuelles et morales, en même temps que les capitaux qu’ils ont accumulés, et les agents naturels qu’ils ont découverts et préparés pour la production. Ils se constituent par groupes plus ou moins nombreux et disposant d’un matériel de production plus ou moins considérable. Chacun de ces groupes n’exerce qu’un petit nombre d’industries. A la longue même, on ne retrouve plus qu’une seule industrie et parfois une simple fraction d’industrie par groupe. Que si l’on considère encore isolément chacune de ces industries spécialisées, on y observe comme une particularité [I-59] essentielle le phénomène de la séparation des fonctions productives.
Essayons de nous faire une idée du développement historique de ces phénomènes.
Des hommes ont été jetés par la Providence sur un point de notre globe. S’ils veulent vivre isolés, ils pourront, sans doute, recueillir quelques aliments grossiers, se couvrir de la peau des bêtes qu’ils auront tuées et se construire un abri imparfait; mais s’ils veulent varier leur alimentation et l’assurer davantage; s’ils veulent se procurer des vêtements plus commodes et plus beaux, s’ils veulent encore se loger d’une manière plus confortable, ils seront obligés de réunir les éléments de production dont chacun d’eux dispose. En outre, il est certains besoins physiques et moraux, l’amour, l’amitié, le besoin de communiquer sa pensée, etc., etc., que l’homme ne peut satisfaire dans l’isolement. Enfin, la nécessité de se défendre contre les bêtes féroces, et souvent, hélas! aussi contre ses semblables, le pousse, d’une manière irrésistible, à se rapprocher des autres hommes et à vivre en communauté avec eux. Sous l’influence de ces nécessités diverses, on voit se former des familles, des tribus, des nations, en un mot, des associations plus ou moins étendues.
La spécialisation des occupations nait d’une manière naturelle et spontanée de ce rapprochement des créatures humaines. Dans la famille d’abord: plus robuste et plus courageux que sa compagne, l’homme se charge d’aller poursuivre, dans les bois ou sur les eaux, la proie nécessaire à l’alimentation commune. La femme prépare les aliments et vaque aux autres travaux intérieurs de l’habitation. Parmi les enfants, les plus faibles assistent la mère, les plus forts accompagnent le père. Voilà la division du travail à l’état rudimentaire.
[I-60]
Cependant, les familles éparses sur d’immenses territoires éprouvent bientôt le besoin de se rapprocher et de s’entr’aider. Les chasseurs ont remarqué, par exemple, qu’en se réunissant en troupes pour poursuivre certains animaux, ils peuvent en atteindre un plus grand nombre, toute proportion gardée, qu’en chassant isolément. Ils ont ressenti en même temps la nécessité de constituer des communautés pour se protéger contre des individus plus forts qu’eux et qui abusent de cet avantage. Les voilà donc groupés, associés, non plus seulement en familles, mais encore en penplades, en tribus, en nations. Ils font, en commun, des expéditions de chasse ou de guerre. Qu’on les observe à ce point de développement, et l’on verra que la division du travail a fait parmi eux un pas de plus. On rencontre, au sein de la tribu ou de la peuplade, des hommes peu propres à supporter les fatigues de la chasse ou de la guerre, mais qui possèdent une certaine habileté de main ou une certaine supériorité d’intelligence. Ceux-ci n’assistent point aux expéditions; ils demeurent dans les habitations avec les femmes; les uns fabriquent des armes ou des outils; les autres sont médecins, prêtres, juges. Une certaine division du travail s’établit aussi parmi les hommes qui vont à la chasse ou à la guerre. L’un d’entre eux a le coup d’œil plus sῦr, l’esprit plus délié, l’intelligence plus vaste que le commun de ses compagnons. Il sait mieux suivre le gibier à la piste et déjouer ses ruses, ou bien encore découvrir l’ennemi, lui tendre des embῦches et échapper aux siennes. On le charge, en conséquence, de diriger les expéditions. Il soumet la troupe, dont le gouvernement lui a été confié dans l’intérêt commun, à une certaine organisation, à une discipline. Il répartit entre ses compagnons le travail à exécuter, selon les exigences du moment et selon [I-61] les aptitudes particulières qu’il reconnaît à chacun. Il charge celui-ci, qui a la vue perçante, qui est prudent et rusé, d’aller reconnaître la piste du gibier, ou bien d’observer les meuvements de l’ennemi; celui-là, qui est remarquable par son adresse, il l’emploie spécialement comme archer; cet autre, qui se distingue par sa force herculéenne, il le réserve pour les combats corps à corps. La troupe se soumet docilement aux ordres du chef, parce qu’elle a compris la nécessité de cette combinaison des efforts et de cette division du travail; parce que l’expérience a appris aux chasseurs et aux guerriers qu’en chassant et en faisant la guerre sans combinaison, sans ordre, sans division du travail, le résultat obtenu était moindre pour chacun.
C’est ainsi qu’obéissant à leur intérêt bien entendu, les hommes associent leurs forces et répartissent entre eux le travail à exécuter. Cette association des forces productives et cette division du travail qui rendent la production plus abondante et plus facile, apparaissent dès l’origine de l’humanité et elles vont se développant sans cesse. Si nous portons nos regards sur la société actuelle, nous trouverons qu’elles s’y sont étendues et diversifiées presque à l’infini. Nous observerons que la production s’opère de nos jours dans des milliers d’ateliers spéciaux établis à l’aide de l’association des forces productives, organisés et dirigés conformément au principe de la division du travail.
Voici d’abord l’atelier agricole. Quelques hommes rassemblés sur un morceau de terre, s’occupent de produire du blé. Ils préparent le sol pour la production, à l’aide de la pioche, de la houe, de la bêche ou de la charrue, puis ils l’ensemencent. Grâce à la force productive de la terre, le blé semé devient plante, et cette plante porte un épi chargé de grains de blé. [I-62] Des batteurs en grange séparent ces grains de la paille, des meuniers les réduisent en farine, et des boulangers transforment la farine en pain. Ce sont autant d’industries séparées, auxquelles il conviendrait d’en joindre encore plusieurs autres, l’industrie des transports, par exemple, qui s’occupent de la production et de la préparation d’un de nos aliments. Dans chacune de ces industries, il y a association des forces productives d’un certain nombre d’hommes, et, généralement aussi, division du travail. Quand l’atelier agricole n’est point établi sur une échelle trop réduite, le propriétaire ou le fermier s’occupe seulement de la surveillance des opérations de la culture, des achats et des ventes, de la comptabilité, en un mot, de la direction de l’entreprise. Dans les ateliers agricoles quelque peu étendus, ces fonctions mêmes sont séparées et spécialisées.
Examinez comment sont produits et mis à la portée des consommateurs la plupart des autres aliments qui composent la nourriture de l’homme, la viande, le poisson, le café, le vin, et vous verrez que chacune de ces substances alimentaires se trouve communément produite dans un atelier spécial, où les éléments nécessaires à sa production sont associés, combinés, où le travail est plus ou moins divisé.
Dans la plupart des industries qui s’occupent de la production de nos vêtements, l’association des forces productives et la division du travail sont plus étendues encore. Prenons pour exemple l’industrie du coton. Le coton est produit dans des plantations où l’on s’occupe uniquement de sa culture. Mis en ballots, il est transporté dans des manufactures où on le transforme en fil et en étoffes. Dans ces manufactures, l’association des forces productives et la division du travail apparaissent, pour ainsi dire, à leur maximum de développement. La manufacture [I-63] reçoit son mouvement d’une machine à vapeur, et ce mouvement se communique à toute la série des mécanismes qui servent à travailler le coton: d’abord, le coton est battu et dépouillé de ses impuretés; ensuite il est transformé en un long ruban, puis tordu en un gros boudin. Le gros boudin est étiré en un boudin plus mince et celui-ci est placé sur la mule jenny ou sur le self acting où il est filé. Chacune de ces opérations est exécutée au moyen d’une machine particulière, et chacune de ces machines est dirigée ou surveillée par un ou plusieurs travailleurs qui ne font pas autre chose. Après avoir été filé, le coton est placé le plus souvent sur un métier à tisser et transformé en étoffe: tantôt l’étoffe est livrée en écru aux marchands qui se chargent de la mettre à la portée des consommateurs, tantôt elle est blanchie ou teinte. Nouvelles opérations auxquelles président encore l’association des forces productives et la division du travail.
Les industries qui s’occupent de l’habitation de l’homme présentent un spectacle analogue. Le carrier, le maçon, le charpentier, le serrurier, le fabricant de meubles, le tapissier, etc., exercent des industries bien distinctes, mais qui concourent, chacune dans sa spécialité, à préparer aux différents membres de la société, des logements plus ou moins commodes et élégants.
Viennent enfin les industries qui s’occupent des besoins intellectuels et moraux de l’homme, ainsi que celles qui pourvoient à sa sécurité. Dans cette catégorie, se rangent l’enseignement, la littérature et les beaux-arts, le culte, le gouvernement ou la police. La division du travail apparaît dans ces industries aussi bien que les autres. Ainsi, par exemple, les hommes ont besoin d’accumuler leurs connaissances, de les [I-64] conserver et de les communiquer. Des inventions ingénieuses ont successivement pourvu, d’une manière de plus en plus complète, à la satisfaction de ce besoin. On a inventé d’abord l’écriture, ensuite l’imprimerie, et l’on a accumulé les connaissances ou les simples nouvelles dans des livres ou dans des journaux. Ces derniers, qui renferment les nouvelles du jour accompagnées de commentaires, ont pris, depuis un demisiècle, une extension considérable. Les établissements de la presse quotidienne sont maintenant de vastes manufactures qui présentent au plus haut degré le spectacle de la division du travail. Dans un journal de quelque importance, apparaît d’abord un nombreux personnel de rédacteurs, ayant chacun sa spécialité. Celui-ci s’occupe des événements politiques; celuilà rapporte et commente les faits économiques; cet autre rassemble les faits divers; un quatrième rend compte des séances de la législature ou des tribunaux. Le journal a encore un directeur dont l’occupation principale consiste à rassembler, à revoir et à coordonner les travaux des rédacteurs. Voilà pour la rédaction seulement. Mais la rédaction ne fournit que les manuscrits nécessaires à la composition du journal. Ces manuscrits doivent être réunis et imprimés sur des feuilles que l’on puisse lire aisément et se passer de main en main. Ceci est l’œuvre d’une deuxième classe de travailleurs. Le travail de l’imprimerie n’est pas moins divisé que celui de la rédaction. Il y a dans l’imprimerie, des compositeurs, des correcteurs, des metteurs en pages, des pressiers, etc. La feuille imprimée est remise entre les mains des plieuses, d’où elle passe dans celles des porteurs de journaux ou des facteurs de l’administration des postes, qui la transportent au domicile de l’abonné. Le journal possède encore une administration dans laquelle figurent [I-65] un directeur, des commis chargés ceux-là de tenir les comptes, ceux-ci les registres des abonnements ou de recevoir les annonces, un caissier, des garçons de bureau, etc., etc., chacun remplissant une fonction spéciale et concourant, dans une mesure plus ou moins étendue, à l’accomplissement de l’œuvre commune.
Dans l’industrie élevée qui pourvoit à la satisfaction des besoins religieux de l’âme humaine, même division du travail. L’église qui est l’atelier où s’opère ce genre de production, l’église est desservie par des prêtres officiants, des prédicateurs, des confesseurs, des chantres, des bedeaux, des enfants de chœur. Quelques-uns de ces ouvriers du culte remplissent, à la vérité, plusieurs fonctions à la fois. Le même prêtre dit la messe, prêche et confesse. Cependant, dans les établissements religieux de quelque importance, la division du travail est poussée aussi loin que possible: certains prêtres sont, par exemple, spécialement confesseurs, d’autres spécialement prédicateurs.
Enfin, dans l’industrie qui pourvoit à la sécurité publique, dans l’industrie du gouvernement, les forces productives se trouvent ordinairement rassemblées par masses considérables et les travaux divisés à l’infini. Il y a des administrateurs, des juges, des agents de police, des soldats, qui contribuent, chacun dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces, à la production de la sécurité.
Le monde offne ainsi le spectacle d’une multitude d’industries appliquées à satisfaire les besoins physiques, intellectuels et moraux de l’homme. Chacune de ces industries s’exerce, communément du moins, dans des ateliers spéciaux où se trouvent groupés des travailleurs plus ou moins nombreux qui [I-66] combinent, en vue de l’œuvre commune, les forces productives dont ils disposent et qui exécutent chacun une opération particulière. Ce n’est que dans les industries les moins avancées que l’on voit le même travailleur remplir plusieurs fonctions ou exécuter les diverses parties d’une opération un peu compliquée.
C’est dans l’industrie proprement dite que la division du travail a été poussée au plus haut degré. Dans l’horlogerie, par exemple, elle paraît avoir atteint sa limite extrème.
Un comité de la chambre des communes a constaté à la suite d’une enquête, dit M. Ch. Babbage, que l’on compte dans l’horlogerie cent deux opérations distinctes, dont chacune exige un apprentissage spécial; que l’apprenti n’apprend rien au delà de ce qui forme l’attribution particulière de son maître, et qu’à l’expiration de son engagement il serait parfaitement incapable, à moins d’une étude ultérieure, de travailler dans une autre branche du même art. L’horloger proprement dit, dont la besogne consiste à réunir les pièces séparées de l’ouvrage, serait peut-être le seul qui pῦt s’utiliser dans un autre département que le sien; et il n’est pas compris dans le nombre des cent deux personnes susmentionnées [6] .
Il serait impossible d’évaluer les avantages que l’humanité retire de la spécialisation des industries et des fonctions productives; mais ces avantages sont évidemment des plus considérables. Adam Smith, qui a aperçu le premier toute la portée du phénomène de la division du travail, estime que, dans la fabrication des épingles, la différence de productivité entre le [I-67] travail isolé et le travail divisé peut s’élever d’un à quatremille [7] . Cette estimation n’a rien d’exagéré. Si chacun se mettait à produire [I-68] isolément toutes les choses qui lui sont nécessaires, la production générale baisserait assurément au moins dans la [I-69] proportion d’un à quatre mille. Que de choses dont la production deviendrait impossible! Combien de temps ne faudrait-il [I-70] point, par exemple, à un producteur isolé pour se fabriquer une montre? Il serait obligé d’abord d’extraire du sol et de préparer [I-71] les matières premières qui entrent dans la composition des produits de l’horlogerie, de l’or ou de l’argent, du cuivre, du fer, etc. Il serait obligé ensuite de façonner ces matières premières qu’il aurait extraites du sol et préparées à grand’peine; ce qui le mettrait dans la nécessité de faire l’apprentissage des métiers de fondeur, de fabricant de ressorts, de verrier et d’une vingtaine d’autres; après quoi, il aurait encore à exécuter les cent deux opérations comprises dans l’art de l’horlogerie. La vie d’un homme suffirait à peine pour la fabrication d’une seule montre, et Dieu sait comment elle marcherait cette montre dont toutes les pièces auraient été façonnées par le même ouvrier!
Ainsi donc, sollicités par des besoins de toute sorte, besoin [I-72] de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de protéger leur vie et leurs propriétés contre toute agression, besoin d’alimenter leur esprit et leur âme, les hommes se rapprochent. Ils réunissent et combinent, dans les proportions requises, les agents productifs dont ils disposent. En même temps que l’association ou la combinaison des agents productifs apparaît le phénomène de la division du travail. Dès leur naissance, les industries se séparent et se spécialisent. pourvoyant chacune ou concourant à pourvoir à une portion des nombreux besoins de l’homme, celle-ci à l’alimentation, celle-là au vêtement, cette autre à la sécurité, etc. Les hommes se casent, chacun selon ses aptitudes, dans ces industries séparées, divisées, où chacun remplit une fonction particulière. Celui-ci laboure la terre et y enfouit [I-73] la semence; celui-là transporte le grain; un troisième le moud; un quatrième le pétrit et en fait du pain. Un autre cultive du coton que des mains étrangères façonnent. Un autre encore veille à ce que ces divers coopérateurs de la production ne soient point troublés dans leur travail, ni dans la légitime possession des fruits qu’ils en ont retirés. Ainsi rapprochés, réunis, et se distribuant, selon leurs aptitudes, les fonctions nécessaires à la satisfaction des besoins de chacun, les hommes produisent infiniment plus de choses utiles, en échange de la même quantité de travail, que s’ils demeuraient dans l’isolement [8] .
[I-74]
La spécialisation des industries et des fonctions productives implique L’échange. Si un homme passe sa vie à fabriquer des têtes d’épingles, un autre à filer ou à tisser du coton, un troisième à cultiver du blé, ils devront se procurer par l’échange de ces produits tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, car on ne se nourrit pas avec des têtes d’épingles ou des fils de coton et l’on ne s’habille pas avec des grains de blé. L’échange est le complément naturel de la spécialisation des industries, et plus le travail est divisé au sein d’une société, plus les échanges doivent y être multipliés.
On a dit de l’homme qu’il est de tous les êtres le senl qui [I-75] fasse des échanges et l’on en a conclu qu’il a, de plus que les autres, un certain penchant à “troquer” ou à “brocanter.” L’intervention de ce penchant particulier ne nous semble point indispensable pour expliquer le phénomène de l’échange. Pourquoi les animaux ne concluent-ils pas d’échanges? Parce que leurs besoins sont extrêmement limités. Parce qu’ils ne se trouvent guère sollicités, pour la plupart, que par les besoins physiques de l’alimentation et de la reproduction, et que les aliments qui conviennent spécialement à chaque espèce sont en fort petit nombre. Supposons que les hommes fussent dans le même cas; supposons qu’ils fussent sollicités seulement par les besoins de l’alimentation et de la reproduction, supposons encore que leur nourriture habituelle se composât simplement de blé, les verrait-on conclure des échanges? Qu’échangeraient-ils? Du blé contre du blé? Mais à quoi pourrait leur servir un troc de cette espèce? C’est la diversité de leurs besoins et l’impossibilité de les satisfaire au moyen de la production isolée, qui, dès l’origine, leur a suggéré l’idée de recourir à l’échange. Il n’est pas nécessaire de faire intervenir pour cela, un penchant particulier, sous le nom de penchant à troquer ou à brocanter.
Chez les animaux qui vivent en communauté, tels que les fourmis, les abeilles, les castors, etc., on voit apparaître avec une association de forces et une division du travail rudimentaires, un commencement d’échanges. Parmi les abeilles, quelques-unes ont spécialement pour fonction de reproduire l’espèce, et les abeilles ouvrières se chargent de pourvoir à l’alimentation de ces abeilles-mères. Un phénomène analogue peut être observé chez les fourmis; un certain nombre de ces laborieuses ouvrières s’occupent des travaux de construction, [I-76] d’aménagement ou de réparation de l’habitation commune, tandis que d’autres vont chercher la subsistance au dehors. N’est-ce point la division du travail et l’échange à l’état rudimentaire, tels, par exemple, qu’ils pourraient se pratiquer entre le chasseur et le maçon, si l’homme n’avait d’autres besoins que ceux de l’alimentation et du logement?
Quoi qu’il en soit, le phénomène de la division du travail et celui de l’échange ont entre eux la corrélation la plus intime. Si le travail n’est point divisé, il n’y aura pas d’échanges. D’un autre côté, si les échanges ne sont point possibles, ou si quelque obstacle naturel ou artificiel vient les restreindre, il n’y aura point de division du travail, ou il y en aura moins.
C’est l’étendue de la sphère de l’échange qui détermine l’extension que peut prendre la division du travail. Complétons à cet égard les observations d’Adam Smith par celles de J.-B. Say:
“Dix ouvriers peuvent fabriquer quarante-huit mille épingles dans un jour; mais ce ne peut être que là où il se consomme chaque jour un pareil nombre d’épingles; car, pour que la division s’étende jusque-là, il faut qu’un seul ouvrier ne s’occupe absolument que du soin d’en aiguiser les pointes, pendant que chacun des autres ouvriers s’occupe d’une autre partie de la fabrication. Si l’on n’avait besoin dans le pays que de vingt-quatre mille épingles par jour, il faudrait donc qu’il perdît une partie de sa journée, ou qu’il changeât d’occupation; dès lors la division du travail ne serait plus aussi grande.
“Par cette raison, elle ne peut être poussée à son dernier terme que lorsque les produits sont susceptibles d’être transportés au loin, pour étendre le nombre de leurs consommateurs, ou lorsqu’elle s’exerce dans une grande ville qui offre, par elle-même, une grande consommation. C’est par la même raison que plusieurs sortes de travaux, qui doivent [I-77] être consommés en même temps que produits, sont exécutés par une même main dans les lieux où la population est bornée.
“Dans une petite ville, dans un village, c’est souvent le même homme qui fait l’office de barbier, de chirurgien, de médecin et d’apothicaire; tandis que dans une grande ville, non seulement ces occupations sont exercées par des mains différentes, mais l’une d’entre elles, celle de chirurgien, par exemple, se subdivise en plusieurs autres, et c’est là seulement qu’on trouve des dentistes, des oculistes, des accoucheurs, lesquels, n’exerçant qu’une seule partie d’un art étendu, y deviennent beaucoup plus habiles qu’ils ne pourraient jamais l’être sans cette circonstance.
“Il en est de même relativement à l’industrie commerciale. Voyez un épicier de village: la consommation bornée de ses denrées l’oblige à être en même temps marchand de merceries, marchand de papier, cabaretier, que sais-je? écrivain public peut-être, tandis que, dans les grandes villes, la vente, non pas des seules épiceries, mais même d’une seule drogue, suffit pour faire un commerce. A Amsterdam, à Londres, à Paris, il y a des boutiques où l’on ne vend autre chose que du thé ou des huiles ou des vinaigres; aussi chacune de ces boutiques est bien mieux assortie dans ces diverses denrées que les boutiques où l’on vend en même temps un grand nombre d’objets différents.
“C’est ainsi que, dans un pays riche et populeux, le voiturier, le marchand en gros, en demi-gros, en détail, exercent différentes parties de l’industrie commerciale, et qu’ils y portent et plus de perfection et plus d’économie. Plus d’économie, bien qu’ils gagnent tous; et si les explications qui en ont été données ne suffisaient pas, l’expérience nous fournirait son témoignage irrécusable; car c’est dans les lieux où toutes les branches de l’industrie commerciale sont divisées entre plus de mains, que le consommateur achète à meilleur marché. A quantités égales, on n’obtient pas dans un village une denrée venant de la même distance à un aussi bon prix que dans une grande ville ou dans une foire.
[I-78]
“Le peu de consommation des bourgs et villages, non seulement oblige les marchands à y cumuler plusieurs occupations, mais elle est même insuffisante pour que la vente de certaines denrées y soit constamment ouverte. Il y en a qu’on n’y trouve que les jours de marché ou de foire; il s’en achète ce jour-là seul tout ce qui s’en consomme dans la semaine ou même dans l’année. Les autres jours, le marchand va faire ailleurs son commerce, ou bien s’occupe d’autre chose. Dans un pays très riche et très populeux, les consommations sont assez fortes pour que le débit d’un genre de marchandise occupe une profession pendant tous les jours de la semaine. Les foires et les marchés appartiennent à un état encore peu avancé des relations commerciales; mais ce genre de relations vaut encore mieux que rien [9] .”
A l’origine des sociétés, la sphère des échanges est extrêmement limitée, soit à cause de l’obstacle des distances, obstacle qui n’a pu encore être surmonté d’une manière économique, soit à cause de l’état de guerre dans lequel vivent les peuples. Les denrées qui renferment beaucoup de valeur sous un petit volume seules peuvent être transportées à distance. Aussi sontelles les premières dont la production se perfectionne. La production agricole, au contraire, est demeurée partout en arrière, quoiqu’elle fournisse les denrées les plus nécessaires à la vie. Cela tient à ce que la sphère où s’échangent ses produits est naturellement fort limitée. L’agriculture ne progresse guère que dans les endroits où elle possède à sa portée immédiate de vastes foyers de consommation, dans le voisinage des grandes villes par exemple.
Mais les progrès de la locomotion, en entamant peu à peu [I-79] l’obstacle des distances, agrandissent la sphère des échanges même pour les denrées les plus lourdes et les plus encombrantes. De nos jours, les substances alimentaires les plus communes, les matériaux les plus grossiers sont transportés beaucoup plus loin que ne pouvaient l’être jadis les métaux précieux, les parfums et les étoffes de luxe. Le résultat de cette extension successive de la sphère des échanges est facile à apprécier. Si, comme l’observation l’atteste, les différents peuples de la terre sont pourvus d’aptitudes particulières, si chaque région du globe a ses productions spéciales, à mesure que s’étendra la sphère des échanges, on verra chaque peuple s’adonner de préférence aux industries qui conviennent le mieux à ses aptitudes, ainsi qu’à la nature de son sol et de son climat; on verra la division du travail s’étendre de plus en plus parmi les nations. Chaque industrie se placera dans les meilleures conditions de production, et le résultat final sera que toutes les choses nécessaires à la satisfaction des besoins de l’homme pourront être obtenues avec un maximum d’abondance et en échange d’un minimum de peine.
[I-80]
TROISIÈME LEÇON↩
la valeur et le prix
Que l’échange des choses s’opère en raison de leur valeur. — Éléments constitutifs de la valeur. — L’utilité. — La rareté. — Que ces deux éléments se combinent à des degrés divers pour constituer la valeur. — Que la valeur existe dans l’état d’isolement, mais seulement comme une notion confuse. — Qu’elle se manifeste et se détermine dans l’échange. — En quoi consiste le prix. — Comment il se fixe. — Loi des quantités et des prix. — Du prix courant et du prix naturel. — Que le prix courant tend incessamment à se confondre avec le prix naturel. — Résumé de la double loi qui préside à la formation des prix.
A quelle qualité des choses a-t-on égard lorsqu’on les échange?
Est-ce à leur volume? Non à coup sῦr. Un diamant de moyenne dimension est un objet bien peu volumineux, et pourtant on ne l’échangerait point contre une meule de foin. Un paysan qui venait d’acheter pour une trentaine de francs une grosse montre d’argent voulait avoir par-dessus le marché une toute petite montre d’or..L’horloger l’éconduisit en éclatant [I-81] de rire. Pourquoi? Parce que les choses ne s’échangent point en raison de leur volume.
Est-ce à la matérialité des choses que l’on a égard dans l’échange? Est-il nécessaire qu’une chose soit composée de matière pour être échangée? Pas davantage. Quand vous allez au spectacle, par exemple, vous donnez de la monnaie, une chose matérielle, en échange de l’audition purement immatérielle d’une comédie, d’un drame, d’un opéra, d’un vaudeville. Vous n’avez donc pas égard à la matérialité des choses en concluant un échange.
A quoi avez-vous égard? Vous avez égard à la valeur des choses. Vous échangez les choses en raison de leur valeur, quelles que soient, du reste, leur forme, leur apparence et la substance dont elles sont composées.
Qu’est-ce donc que la valeur?
Pour bien définir la valeur, il faut l’analyser, la décomposer. Car la valeur n’est pas un corps simple, comme on dirait en chimie, la valeur est un corps composé. La valeur se compose de deux éléments bien distincts, l’utilité et la rareté.
L’utilité, c’est la propriété qu’ont les choses de satisfaire nos besoins ou de contribuer à les satisfaire. Quand les éléments que nous fournit la nature ne sont pas entièrement pourvus de cette propriété; quand il faut les découvrir; modifier leur composition et leur forme, les transporter d’un lieu à un autre, pour les rendre propres à notre consommation, on crée de l’utilité. La production n’est autre chose qu’une création d’utilité et la consommation une destruction d’utilité.
Toute consommation d’utilité implique une satisfaction donnée à nos besoins, partant une jouissance.
La rareté n’a pas besoin d’être définie. Bornous-nous à dire [I-82] seulement qu’elle implique toujours des difficultés à vaincre, des obstacles à surmonter. Plus une chose est rare, et plus il est difficile de se la procurer, plus il faut surmonter d’obstacles pour la mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin. Ces difficultés, ces obstacles que nous oppose la nature, lorsque nous puisons dans son sein les choses qui nous sont nécessaires, nous les combattons en mettant en œuvre les agents productifs dont nous disposons. De même que toute production implique une utilité créée, elle implique aussi une difficulté vaincue.
Or, à son tour, toute difficulté vaincue implique une peine.
Seule, l’utilité ne suffit pas pour constituer la valeur, car il y a des choses pourvues d’une grande utilité, qui n’ont aucune valeur; mais il n’y a pas dans le monde une seule chose pourvue de valeur, qui n’ait de l’utilité.
Seule, la rareté ne suffit pas pour constituer la valeur. Car une chose peut être infiniment rare et n’avoir aucune valeur, si elle n’est propre à satisfaire aucun besoin, si elle n’unit point, dans une certaine mesure, l’utilité à la rareté; mais il n’y a pas non plus dans le monde une seule chose pourvue de valeur qui ne soit plus ou moins rare, qui n’implique en conséquence une difficulté vaincue, une production effectuée.
C’est donc la réunion de deux éléments d’une nature fort différente, l’utilité et la rareté, qui constitue la valeur.
Reprenons avec un peu plus de détail l’examen de ces deux éléments constitutifs de la valeur.
Je viens de dire que l’utilité ne suffit pas seule pour constituer la valeur. L’air, par exemple, a une immense utilité; il est pour nous le plus indispensable des aliments; cependant il n’a aucune valeur. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous en [I-83] procurer, sans avoir à surmonter aucune difficulté, toute la quantité dont nous avons besoin. Il en est de même de la lumière du soleil pendant que cet astre éclaire notre hémisphère. Mais que le soleil vienne à se coucher, que cette fontaine de lumière, comme l’appellent les Orientaux, cesse de couler pour nous, et la lumière n’aura plus seulement de l’utilité, elle aura encore de la valeur. Pourquoi? Parce qu’on ne pourra plus s’en procurer, sans difficulté, une quantité suffisante. Sans doute, on pourra encore obtenir gratis
Ces obscures clartés qui tombent des étoiles,
pour nous servir du langage du vieux Corneille; on pourra encore disposer de la lumière de la lune et des étoiles; mais celle-ci est insuffisante pour notre usage. Il nous faut dans nos rues, dans nos maisons, dans nos salles de bal et de spectacle plus de lumière que la lune et les étoiles ne peuvent nous en fournir. Nous sommes, en conséquence, obligés d’en produire d’une manière artificielle, et la lumière qui n’a que de l’utilité pendant le jour acquiert ainsi de la valeur pendant la nuit.
Si nous n’avions aucun obstacle à vaincre, aucune difficulté à surmonter pour nous procurer les choses nécessaires à notre consommation, nous n’aurions point la notion de la valeur, nous n’aurions que celle de l’utilité. Dans les régions enchantées de la féerie, la valeur n’existe pas, car il suffit d’un simple coup de baguette pour créer et mettre à la portée des habitants de ces régions fortunées toutes les choses qu’ils peuvent souhaiter.
Mais nous ne vivons pas dans le pays des fées. Nous vivons sur une terre où la plupart des choses nécessaires à la satisfaction [I-84] de nos besoins n’existent point en quantité illimitée, au moins sous une forme qui les rende propres à notre consommation; où il faut les produire en surmontant des obstacles plus ou moins considérables; où elles sont plus ou moins rares, ce qui leur donne plus ou moins de valeur.
La rareté seule ne suffit cependant pas plus que l’utilité pour constituer la valeur. Une chose aura beau être rare, si elle n’est pas utile à un degré quelconque, c’est à dire si elle ne peut contribuer directement ou indirectement à la satisfaction d’un de nos besoins, elle n’aura aucune valeur. Pendant longtemps, le ver à soie et la cochenille n’ont pas eu plus de valeur que les chenilles et les punaises ordinaires, quoiqu’ils fussent, en comparaison, beaucoup plus rares. Pourquoi? Parce qu’on n’avait pas encore trouvé les moyens d’utiliser la soie de l’un, la substance colorante de l’autre; parce qu’ils ne joignaient point encore l’utilité à la rareté. Mais des hommes ingénieux parviennent à tirer parti de ces deux substances; ils transforment la soie qui garnit le cocon du bombyx en une étoffe souple et moelleuse, la matière colorante de la cochenille en une teinture solide et brillante. Aussitôt, le ver à soie et la cochenille, qui étaient simplement rares, deviennent utiles, et ils acquièrent de la valeur.
Complétons cette analyse des éléments de la valeur par une observation essentielle, savoir qu’il y a des degrés dans l’utilité qu’ont les choses aussi bien que dans leur rareté.
A chacun de nos besoins répond toute une série de choses utiles. Il y a autant de séries d’utilités dans le monde qu’il y a de besoins dans l’homme. Mais nos besoins n’ont pas tous un égal caractère de nécessité ou d’urgence. Il y en a auxquels nous sommes obligés de pourvoir régulièrement, sous peine de [I-85] périr; tel est notamment le besoin de l’alimentation. Il y en a d’autres, en revanche, que nous pouvons nous abstenir de satisfaire, sans compromettre notre existence; tel est le goῦt de la parure. Quoique très impérieux chez certains individus, ce goῦt auquel répond toute une immense série de choses utiles, les étoffes précieuses, les ameublements somptueux, les bijoux, les diamants, etc., ne saurait être rangé parmi les besoins de première nécessité, car on peut, à la rigueur, se passer d’y pourvoir. Il y a enfin des besoins qui ne sont que des perversions ou des maladies de notre nature et que l’on doit, autant que possible, s’abtenir de satisfaire. Ces besoins vicieux n’existent pas chez certains individus; chez d’autres, au contraire, ils se manifestent avec une extrême intensité. Telle est la passion des liqueurs fortes.
On pourrait établir une échelle des besoins d’après leur caractère de nécessité, avec les séries correspondantes d’utilités. Mais cette échelle n’aurait rien d’uniforme ni de fixe. Seuls, les besoins qu’il faut satisfaire pour entretenir la vie animale apparaissent chez tous les hommes avec un caractère d’intensité à peu près égal, et ils figurent au même rang, relativement aux autres. Ainsi, tous les hommes éprouvent le besoin de manger et de boire, et, malgré l’inégalité des appétits, ce besoin a pour tous le même caractère de nécessité. En revanche, les besoins dits de luxe, besoins qui se reconnaissent à ce qu’on peut se dispenser de les satisfaire sans compromettre son existence, s’échelonnent différemment, selon les individus, et ils sont soumis à des fluctuations nombreuses, fluctuations qui se répercutent dans les utilités correspondantes.
La rareté a ses degrés aussi bien que l’utilité, et elle dépend, [I-86] d’une part, de la grandeur de l’obstacle qu’il faut vaincre pour se procurer les choses; d’une autre part, de l’étendue des ressources et de la puissance des instruments dont on dispose pour surmonter cet obstacle. Comme l’utilité encore, elle est essentiellement diverse et variable. Tout progrès qui développe les ressources et augmente la puissance des instruments de la production, diminue la rareté des choses. Tout accroissement naturel ou artificiel des difficultés de la production contribue, au contraire, à l’augmenter.
D’après l’analyse qui vient d’être faite des éléments de la valeur, on peut se convaincre qu’elle existe indépendamment de l’échange. Un homme isolé peut posséder des choses pourvues de valeur, aussi bien qu’un homme plongé dans le milieu social. Prenons pour exemple Robinson dans son ile. Robinson accumule des provisions, fabrique des vêtements, construit une tente et un canot pour son usage. Ces divers objets sont évidemment pourvus de valeur. Car ils ne sont pas seulement utiles à Robinson comme l’air, la lumière du soleil ou l’eau de l’Océan, ils sont encore rares, et il a dῦ surmonter, pour les produire, des difficultés plus ou moins considérables. Robinson peut les envisager au double point de vue de leur utilité, de la propriété qu’ils ont de satisfaire ses besoins et des difficultés qu’il éprouverait à les produire, s’il ne les possédait point ou s’il venait à les perdre. Il peut les comparer à ce double point de vue et dire, par exemple: Mon canot vaut deux fois ma hutte; ma hutte vaut trois fois mes habits; mes habits valent deux sacs de bananes. Quels sont les éléments de cette comparaison? C’est, d’une part, l’utilité qu’ont ces choses; c’est, d’une autre part, leur rareté, impliquant des difficultés plus ou moins considérables à surmonter pour les remplacer.
[I-87]
C’est l’utilité. Robinson doit se demander d’abord quelles jouissances lui procure chacun de ces objets, — la hutte, — le canot, — les habits, — les bananes. Il doit se consulter pour savoir lesquels lui sont le plus utiles, ceux dont la privation lui causerait le plus de souffrances. Remarquons bien que la réponse qu’il pourra se donner à lui-même sur ce point n’aura rien d’absolu; qu’elle dépendra tout à fait des circonstances. Ainsi, pendant l’été, sa hutte et ses habits auront, en comparaison de son canot, moins d’utilité que pendant l’hiver. Pourquoi? Parce qu’il peut à la rigueur se passer d’habits et coucher à la belle étoile en été, tandis qu’il ne le peut en hiver. Parce que, d’un autre côté, il peut aller à la pêche dans la bonne saison, tandis qu’il ne le peut dans la mauvaise. La privation de sa hutte et de ses habits lui serait donc plus sensible en hiver; celle de son canot lui serait plus sensible en été. En tous cas, si Robinson veut avoir une idée de la valeur de sa hutte, de son canot, de ses habits, de ses bananes, il faut, en premier lieu, qu’il examine et compare ces objets, au point de vue de leur utilité.
C’est la rareté. Il faut, en second lieu, que Robinson examine et compare sa hutte, son canot, ses habits, ses bananes, au point de vue de leur rareté, ou, ce qui revient au même, de la difficulté qu’il éprouverait à les remplacer. Comme il a dῦ interroger tout à l’heure ses besoins pour apprécier les jouissances que chacun de ces objets lui procure, ainsi que les souffrances qu’il ressentirait s’il en était privé, il doit maintenant examiner les éléments de production dont il dispose afin de se rendre compte des difficultés qu’il devrait surmonter, des peines qu’il devrait se donner pour en produire d’autres. Ces difficultés et ces peines seront plus ou moins étendues selon les objets et [I-88] elles varieront encore selon les circonstances. Les provisions, par exemple, pourront être renouvelées plus aisément en été qu’elles ne le seraient en hiver.
C’est ainsi que Robinson devra procéder s’il veut évaluer sa hutte, son canot, ses habits, ses bananes. Après avoir bien examiné ces divers objets au double point de vue de leur utilité et de leur rareté, il pourra se faire une idée de leur valeur en usage et de leur valeur en échange, c’est à dire, de leur valeur par rapport à lui et de leur valeur par rapport les uns avec les autres. Mais des évaluations de ce genre seront évidemment des opérations fort difficiles. Elles exigeront, en effet, une appréciation, aussi exacte que possible, des jouissances que Robinson retire de chaque objet, des souffrances qu’il ressentirait s’il venait à en être privé, des difficultés qu’il devrait surmonter, des peines et des sacrifices qu’il devrait s’imposer pour le remplacer. Aussi Robinson ne s’avisera-t-il point, selon toute apparence, d’évaluer les objets qu’il possède. A quoi lui servirait de connaître la valeur en usage de son canot, ou bien encore de savoir ce que vaut son canot en comparaison de sa hutte, sa hutte en comparaison de ses habits, etc., si ce n’est peut-être pour proportionner à la valeur de ces différents objets les soins de leur conservation. Or, le sentiment confus de la valeur suffit pour cela. Si donc la notion de la valeur existe chez l’homme isolé aussi bien que chez l’homme plongé dans le milieu social, cette notion demeure obscure, elle manque de précision, car l’homme isolé n’a aucun intérêt à l’éclaircir ni à la préciser.
Mais aussitôt que les hommes se rapprochent, que les industries et les fonctions productives se spécialisent, aussitôt qu’apparaît en conséquence la nécessité de l’échange, la situation [I-89] ne demeure plus la même. La notion de la valeur doit alors se manifester clairement, puisque les choses s’échangent en raison de leur valeur. Tout échange implique une évaluation, c’est à dire, une comparaison entre la valeur des choses, produits ou services, qu’il s’agit d’échanger. Cette comparaison a pour objet de déterminer le rapport de valeur existant entre ces choses, et, par conséquent, les quantités de chacune qui se balanceront ou s’équivaudront dans l’échange. Supposons, par exemple, que deux hommes possédant l’un de l’or et l’autre de l’argent veulent en échanger une certaine quantité, comment procéderont-ils? Ils feront une évaluation, autrement dit, une comparaison entre la valeur de l’or et celle de l’argent. Supposons que le résultat de cette opération, faite d’une manière contradictoire, soit que la valeur d’une quantité déterminée d’or, d’un kil., par exemple, est 15 fois plus grande que celle de la même quantité d’argent, l’échange se fera sur le pied d’un kil. d’or pour 15 kil. d’argent et le rapport entre la valeur des deux métaux sera de 1 à 15.
L’échange fait, celui qui a obtenu les 15 kil. d’argent au moyen d’un kil. d’or dira que ces 15 kil. d’argent lui ont coῦté 1 kil. d’or, ou bien encore valent 1 kil. d’or, ou bien enfin qu’un kil. d’or est le prix de 15 kil. d’argent, et vice versâ.
Le prix est donc la valeur d’un produit ou d’un service échangé, exprimée au moyen de son équivalent. Il énonce des valeurs égales, dans des quantités ordinairement fort inégales. Quand je dis, par exemple, qu’un kil. d’or est le prix de 15 kil. d’argent, qu’est-ce que cela signifie? Que, dans l’endroit et dans le moment où l’échange a eu lieu, un kil. d’or contenait exactement la même somme de valeur que 15 kil. d’argent, autrement dit, que ces quantités inégales des deux métaux étaient égales en valeur.
[I-90]
Par le fait de l’intervention de la monnaie, intervention que la division du travail a, comme nous le verrons, rendue indispensable, les échanges se sont décomposés en deux parties. On a cessé de troquer directement ses produits ou ses services contre ceux d’autrui, pour les échanger d’abord contre de la monnaie, ce qui s’appelle vendre, et pour échanger ensuite cette monnaie contre les produits ou les services dont on a besoin, ce qui s’appelle acheter. La valeur de cet instrument intermédiaire des échanges constitue une mesure que l’on suppose invariable et à laquelle on compare la valeur de tous les produits ou services, quand on les échange. En France, où l’unité monétaire est le franc, c’est à dire un poids d’argent monnayé de 5 grammes à 9/10es de fin, la valeur de toutes choses est exprimée en francs. Quand je dis: un hectolitre de blé vaut 20 francs, ou: le prix d’un hectolitre de blé est de 20 fr., cela signifie que la valeur contenue dans un hectolitre de blé est précisément égale à celle qui est contenue dans 20 pièces de 1 franc, et cela indique, du même coup, le rapport existant entre la valeur du blé et celle de la monnaie.
Ces observations faites, — et nous aurons à les développer quand nous traiterons de la monnaie, — recherchons comment la valeur d’une chose, produit ou service, s’établit dans l’échange; ce qui en détermine le niveau.
C’est une vérité d’observation que la valeur de toute chose se fixe dans l’échange, en raison inverse de la quantité offerte. Plus considérable est la quantité offerte, moindre est le prix, et vice versâ. Ce n’est pas tout. Le prix s’élève ou s’abaisse dans une progression beaucoup plus rapide que celle de la diminution ou de l’augmentation des quantités offertes. Dans un travail sur la formation des prix, publié par [I-91] le Journal des Économistes [10] , j’ai donné à cet égard la formule suivante:
“Lorsque le rapport des quantités de deux denrées offertes en échange varie en progression arithmétique, le rapport des valeurs de ces deux denrées varie en progression géométrique.”
“Les fluctuations du prix du blé, ajoutais-je, fournissent sur cette loi les indications les plus concluantes. Tout le monde a pu remarquer qu’il suffit d’un faible déficit dans la récolte, c’est à dire dans la quantité de blé mise au marché, pour occasionner une hausse considérable dans le prix. En 1847, année où le déficit n’atteignit pas le quart d’une récolte ordinaire, le prix monta successivement de 20 francs à 40 et 50. Tandis que la quantité offerte décroissait en progression arithmétique, le prix croissait en progression géométrique.”
“De même, il suffit d’une faible augmentation dans la récolte pour faire baisser considérablement le prix. De 1847 à 1849, le prix du blé est descendu de 50 francs à 10 ou 12 fr., bien que l’excédant de la récolte de 1848 ne dépassât point le déficit de l’année précédente.”
“Cependant le développement de la progression géométrique se trouve communément ralenti par la circonstance suivante:”
“Lorsqu’un déficit survient dans la production d’une denrée et que le prix s’élève en conséquence, la demande de cette denrée diminue. Supposons, par exemple, que l’on consomme dans une ville 100,000 hectolitres de blé au prix de 20 francs. — 10,000 hectolitres viennent à être retirés du marché. Aussitôt, [I-92] le prix monte à 24 francs. Mais à 24 francs, on consomme moins de blé qu’à 20 francs. La demande baissera probablement de 5 à 6,000 hectolitres. L’écart entre les quantités de blé et de monnaie offertes en échange diminuant, le prix tombera pour se fixer aux environs de 22 francs. Si la provision de blé est régulièrement renouvelée, il n’y aura pas d’autres variations. Mais si elle ne l’est point, et si, par la consommation, l’approvisionnement vient à tomber à 80,000, à 60,000 hectolitres et ainsi de suite, le prix haussera avec rapidité. D’un autre côté, la demande continuera de baisser. Elle baissera, en premier lieu, parce qu’on consommera d’autres aliments devenus relativement moins chers; en second lieu, parce que le prix, en s’élevant, cessera d’être à la portée de la portion la plus misérable de la population. Mais comme, avant de se laisser mourir de faim, chacun se résigne aux plus grands sacrifices, la concurrence des consommateurs de blé demeurera néanmoins très vive, et l’écart entre les quantités de blé et de monnaie offertes en échange deviendra de plus en plus sensible. Le dernier millier d’hectolitres se vendra probablement à un prix excessif.”
“Le blé, et, en général, les objets indispensables à la vie, sont ceux dont les prix peuvent monter le plus haut par le fait d’un déficit dans l’approvisionnement. S’il s’agit d’une denrée moins nécessaire, d’oranges, par exemple, la hausse du prix, suscitée par le déficit de la récolte, occasionne immédiatement une baisse considérable dans la demande; l’écart entre les quantités d’oranges et de monnaie offertes en échange diminue, et le prix baisse. La loi de progression demeure la même, mais ses effets diffèrent, eu égard à la différence de nature des deux denrées et des besoins auxquels elles pourvoient.”
[I-93]
“La demande hausse ou baisse en raison inverse du prix, mais tantôt plus, tantôt moins, selon la nature des denrées. A cet égard, il n’y a rien de fixe. Si la récolte des oranges vient à doubler et si le prix baisse en conséquence, la consommation des oranges augmentera sensiblement. En revanche, si l’on fabrique dix mille tuyaux de poêle dans un pays où il n’y a que cinq mille cheminées, on n’en vendra probablement pas un de plus. On sera obligé de se défaire de l’excédant au prix du vieux fer, à moins que l’on n’ait la patience d’attendre que les tuyaux existants soient usés. Mais qu’il s’agisse de blé, d’oranges ou de tuyaux de poêle, la loi en vertu de laquelle les prix montent ou baissent, selon les variations du rapport des quantités offertes en échange, cette loi demeure la même.”
“Elle demeure aussi la même lorsqu’il s’agit du travail et des capitaux.”
En ce qui concerne le travail, rien de plus décisif que le phénomène de la crue subite des salaires dans les Antilles anglaises, à l’époque de l’abolition de l’esclavage. Le prix de revient de la journée de travail d’un esclave ne dépassait pas fr. 1 à fr. 1–25 environ. A peine l’émancipation fut-elle prononcée, que les salaires se fixèrent à un taux véritablement excessif. Pour exécuter le même travail qui se paye en Europe fr. 1 ou fr. 1–50, les esclaves demandèrent et obtinrent 2, 3, 4, 5, 6 francs, et, dans la saison des récoltes, jusqu’à 15 et 16 francs. Cependant le plus grand nombre des nègres émancipés continuaient à travailler dans les plantations. Un petit nombre d’entre eux seulement s’en étaient retirés pour s’appliquer au commerce de détail ou à la culture des denrées alimentaires.”
“Dans les pays où les travailleurs surabondent, le phénomène [I-94] opposé se manifeste. Le taux du salaire y tombe presque à rien. Au Bengale et à la Chine, on obtient une journée de travail pour la valeur d’une poignée de riz. Cependant l’excédant du travail, dans ces contrées, n’est pas considérable, et il ne saurait l’être, car il a sa limite naturelle dans les moyens de subsistance. Mais il suffit qu’une faible quantité de travail s’ajoute à la quantité susceptible d’être régulièrement employée, pour que le salaire baisse dans une proportion notable.”
“La même observation s’applique à l’intérêt du capital. Le retrait ou l’apport d’une faible quantité de capitaux sur un marché suffit pour déterminer immédiatement une hausse ou une baisse sensible dans le taux de l’intérêt. Aux époques de crise, par exemple, on voit le taux de l’intérêt tripler ou quadrupler d’une manière presque instantanée. Cependant, même dans les crises les plus intenses, les capitaux perdus ou retirés de la circulation ne forment jamais plus du tiers ou de la moitié de la quantité qui figure communément au marché; mais ici encore la progression arithmétique dans le rapport des quantités engendre la progression géométrique dans les prix.”
“Le prix des denrées, le taux des salaires et de l’intérêt, se trouvent donc indistinctement soumis à la loi que nous avons ainsi formulée:”
Lorsque le rapport des quantités de deux denrées offertes en échange varie en progression arithmétique, le rapport des valeurs de ces denrées varie en progression géométrique” [11] .
[I-95]
Essayons maintenant de découvrir la raison de cette loi. Essayons de déterminer pourquoi la valeur d’une chose ne [I-96] s’abaisse ou ne s’élève pas simplement, d’une manière proportionnelle à l’augmentation ou à la diminution de la quantité [I-97] de cette chose; pourquoi les fluctuations des valeurs obéissent à une impulsion incomparablement plus forte et plus rapide que celles des quantités.
Pour s’expliquer ce phénomène, il faut reporter ses regards sur la nature complexe de la valeur; il faut se souvenir que la valeur se compose à la fois d’utilité et de rareté. Or, qu’arrivet-il lorsque la quantité d’une chose vient à s’augmenter? Il arrive qu’elle devient à la fois moins rare et moins utile. Moins [I-98] rare, cela va de soi-même et ne requiert aucune explication. Moins utile, cela s’explique aisément. Supposons qu’une population ait faim et soif. Elle aura besoin, par exemple, d’une certaine quantité de pain et de viande pour apaiser sa faim, d’une certaine quantité de bière et de vin pour étancher sa soif. Les premières quantités qui lui seront offertes de ces substances alimentaires auront évidemment pour elle un maximum d’utilité, car elles répondront à un besoin des plus [I-99] intenses. Celles qui lui seront offertes ensuite auront, au contraire, de moins en moins d’utilité, parce que le besoin auquel elles seront appliquées se trouvera de plus en plus amplement satisfait. Lorsqu’il le sera pleinement, lorsque la population qu’il s’agit de nourrir et d’abreuver n’aura plus faim ni soif, les aliments et les boissons qu’on pourra lui offrir demeureront sans utilité pour elle, et en perdant leur utilité ils perdront leur valeur, à moins qu’ils ne puissent se conserver pour apaiser la faim et étancher la soif à venir.
Ainsi donc, à mesure que la quantité d’une chose augmente, la rareté et l’utilité qui sont les parties constituantes de la valeur de cette chose, diminuent à la fois. En d’autres termes: quand la quantité d’une chose augmente en raison simple, la valeur de cette chose diminue en raison composée; quand la quantité augmente d’un, la valeur diminue de deux et ainsi de suite.
Au reste, que la formule que nous avons donnée plus haut soit ou non d’une exactitude mathématique, cela importe assez peu. Ce qui importe, comme nous le verrons, c’est qu’une variation quelconque dans le rapport des quantités de deux choses offertes en échange engendre une variation beaucoup plus forte dans le rapport existant entre leurs valeurs, et nous croyons que ce fait ne saurait être contesté.
Le prix est essentiellement variable puisqu’il dépend des quantités qui se présentent au marché. Cependant il y a un niveau vers lequel il gravite incessamment, en vertu de la loi même qui le détermine. Ce niveau d’équilibre se trouve indiqué dans la formule suivante:
Le prix de toute denrée tend incessamment à se mettre au niveau de ses frais de production, représentant la somme des [I-100] difficultés qu’il a fallu surmonter pour la produire et la mettre au marché, augmentés d’une part proportionnelle de produit net.
Pour se bien rendre compte de cette formule, il faut se rappeler les définitions que nous avons déjà données des termes frais de production et produit net.
Produire c’est, ainsi que nous l’avons remarqué, surmonter les difficultés qui nous empêchent de nous procurer les choses nécessaires à notre consommation. Nous produisons à l’aide d’éléments et de forces de différentes sortes. La quantité de ces agents productifs que nous sommes obligés de dépenser pour surmonter les difficultés que présente la production d’une chose constitue ses Frais de production.
Ainsi, les frais d’entretien et de renouvellement nécessaires des travailleurs, des matières premières, des outils, des machines, des bâtiments, des terrains, etc., employés à la production d’une denrée quelconque, constituent par leur réunion, les frais de production de cette denrée.
Or, nous avons remarqué encore que trois cas peuvent se présenter: c’est que la valeur échangée de la denrée ou son prix courant peut demeurer au dessous du niveau de ses frais de production; c’est qu’elle peut être précisément à ce niveau; c’est enfin qu’elle peut s’élever au dessus.
Dans premier cas, la production décline et elle finit même par cesser, en conséqnence de la destruction progressive de ses agents productifs; dans le second cas, elle peut se maintenir mais sans s’accroître; dans le troisième cas seulement, elle donne un excédant ou produit net, à l’aide duquel elle peut se développer.
Cela étant, il est bien évident, que tout détenteur d’agents productifs choisira de préférence, s’il en est le maître, la [I-101] branche d’industrie dans laquelle il pourra réaliser la portion la plus considérable de produit net. Lorsqu’une industrie vient à donner plus ou moins de produit net qu’une autre, les agents productifs s’y portent ou s’en éloignent jusqu’à ce que l’équilibre se rétablisse, c’est à dire jusqu’à ce que sa part de produit net soit exactement proportionnée à celles de toutes les autres branches de la production.
La somme des frais de production augmentée d’une part proportionnelle de produit net prend indifféremment les dénominations de prix rémunérateur et de prix naturel. Tantôt le prix auquel les choses s’échangent sur le marché, ou le prix courant se confond avec le prix rémunérateur ou le prix naturel, tantôt il s’élève au dessus ou il demeure au dessous; mais toujours il gravite autour de ce point comme vers un centre d’équilibre [12] .
[I-102]
En résumé, le prix courant des choses dépend immédiatement des quantités offertes en échange, ou, pour nous servir de l’expression usitée, de l’offre et de la demande. Que le rapport des quantités de deux choses offertes en échange se [I-103] modifie et l’on verra aussitôt le rapport existant entre leurs valeurs se modifier. Sera-ce dans une proportion équivalente? Non, ce sera dans une proportion plus forte. Si la quantité offerte d’une chose augmente en progression arithmétique, la [I-104] demande demeurant la même, son prix baissera en progression géométrique et vice versâ. Telle est la loi des quantités et des prix.
Le mouvement des quantités offertes et l’action qu’il exerce [I-105] sur les valeurs apparaissent donc comme le premier élément de la formation des prix.
Mais cet élément n’est pas seul. Il y en a un second dont l’influence sur la formation des prix n’est pas moindre que [I-106] celle de l’offre et de la demande, quoiqu’il agisse d’une manière moins immédiate et moins visible, nous voulons parler des frais de reproduction et du produit net. Tout produit exige la coopération de certains agents que nous avons désignés sous les noms de travail, de capital et d’agents naturels appropriés. Ces agents sont consommés en totalité ou en partie pendant l’œuvre de la production. Il faut les rétablir sous peine d’être successivement dépourvu des moyens de produire. On n’entreprend, en conséquence, la production d’une denrée que si l’on a l’espoir plus ou moins fondé d’en retirer un prix suffisant pour reconstituer les éléments qui la composent, ou, ce qui revient au même, pour couvrir ses frais de production. En outre, on choisit de préférence l’industrie, dans laquelle on peut se procurer le produit net le plus élevé, et comme cette tendance est générale, il en résulte qu’aucune industrie ne peut demeurer longtemps plus productive qu’une autre, à moins que des obstacles n’empêchent le niveau de s’établir. Les quantités offertes se trouvent donc, en définitive, déterminées par les frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net, et ceux-ci apparaissent ainsi comme l’élément essentiel, nous pourrions presque dire pivotal de la détermination des valeurs ou de la formation des prix.
[I-107]
QUATRIÈME LEÇON↩
la valeur et la propriÉtÉ
Définition de la propriété. — Qu’elle est un rapport de justice entre la valeur et ceux qui l’ont produite, reçue ou acquise. — Que toute altération de ce rapport engendre une nuisance économique. — Raison de ce phénomène. — Analyse de la propriété. — La propriété considérée dans son objet, la valeur. — Des formes sous lesquelles la valeur s’incarne; — des valeurs personnelles, immobilières et mobilières. —Comment les valeurs périssent. —C>omment des valeurs périssables peuvent constituer des capitaux impérissables. — Des chances de plus value et des risques de moins value. —La propriété considérée dans son sujet, le propriétaire. —En quoi consiste le droit de propriété. — Libertés dans lesquelles ce droit se ramifie. —De la capacité nécessaire pour l’exercer. — De la tutelle nécessitée par le défaut de capacité des propriétaires. —De l’effet des restrictions opposées à l’exercice du droit de propriété. —Des risques auxquels ce droit est assujetti et des servitudes qu’ils nécessitent. —Des formes du droit de propriété; — de la propriété commune, individuelle et collective. — Du monopole et de la concurrence.
Le phénomène de la valeur engendre celui de la propriété. La propriété c’est le rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l’ont créée, reçue ou acquise. L’étude de ce rapport [I-108] fait l’objet de la science du droit. Nous n’aurions donc pas à nous en occuper dans un cours d’économie politique si le droit, tel que les hommes le conçoivent et l’appliquent, autrement dit le droit positif, était, partout et toujours, l’incarnation du droit naturel, c’est à dire de la justice; si, d’autre part, jamais aucune atteinte n’y était portée; si, en conséquence, la production et la distribution des valeurs n’étaient point influencées tant par les déviations du droit positif que par les infractions que les hommes régis par ce droit imparfait commettent à la justice.
Malheureusement, le droit positif n’a encore été dans aucune société la pure incarnation de la justice, et celle-ci, à moins de supposer que les hommes arrivent un jour à la perfection morale, ne sera jamais une règle de conduite universellement et constamment obéie. Si le droit positif tend, sous l’influence du progrès, à se rapprocher du droit naturel, il est loin encore d’être arrivé à s’y confondre; et quoique les hommes soient doués d’un sens particulier qui leur donne l’intuition même du droit et qui porte les noms de conscience, de sens moral ou de sentiment de la justice, ce sens particulier demeure, faute de vigueur native, et, plus souvent, faute de culture, fort obtus chez le plus grand nombre. D’ailleurs, il a rarement pour auxiliaires des forces morales suffisantes pour assujettir et dominer les appétits inférieurs et les passions excessives de l’âme humaine. De là les innombrables et incessantes infractions commises à la justice, soit par le manque d’une vue assez claire pour la discerner, soit par le défaut d’une énergie morale assez puissante pour la faire observer. De là aussi l’indispensable nécessité d’un appareil destiné à assurer le règne du droit positif, si imparfait qu’il soit.
[I-109]
Maintenant, voici un phénomène que l’expérience nous révèle: c’est qu e toute atteinte portée à la justice soit en vertu du droit positif, soit au mépris et en violation de ce droit, engendre une nuisance économique, laquelle arrête ou ralentit la production des valeurs ou, ce qui revient au même, la multiplication des richesses. Partout et toujours, le développement de la production est en raison de la somme de justice incarnée dans la loi et dans les mœurs; partout et toujours, la diminution de la justice entraîne une diminution proportionnelle dans la production.
Que si nous voulons avoir la raison de ce phénomène, que si nous, voulons savoir pourquoi toute atteinte portée à la propriété, c’est à dire au rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l’ont créée, reçue ou acquise, a pour effet de ralentir ou de diminuer la production, nous devons achever d’étudier la valeur, non seulement dans les éléments qui la constituent, mais encore dans les formes sous lesquelles elle s’incarne et dans les destinations qu’elle reçoit.
Récapitulons d’abord les notions que nous a fournies l’analyse des éléments constitutifs de la valeur.
Le premier, c’est l’utilité, c’est à dire la qualité qu’ont naturellement les choses ou qui leur est donnée artificiellement de satisfaire à nos besoins.
Lorsque les choses sont naturellement utiles, c’est à dire lorsqu’elles peuvent servir, sans aucun changement de forme, de temps ou de lieu, à la satisfaction de nos besoins, lorsqu’elles existent, de plus, en quantité illimitée, lorsqu’elles ne sont rares à aucun degré, lorsque nous pouvons, en conséquence, les consommer sans avoir été préalablement obligés de les produire, elles ne constituent point des valeurs. Ce sont de simples utilités gratuites.
[I-110]
Mais les choses naturellement utiles et d’une abondance illimitée, autrement dit les utilités gratuites, sont l’exception. Généralement, l’utilité doit être créée, produite, et elle ne peut l’être que par une mise en œuvre des forces et des matériaux dont l’homme dispose. L’immense majorité des choses utiles servant à réparer et à augmenter nos forces physiques, intellectuelles et morales n’existent que par le fait de la production; elles demeurent, en conséquence, plus ou moins rares, et elles constituent des valeurs.
Il entre donc deux éléments, non seulement distincts, mais contraires, dans la composition de la valeur: l’un, l’utilité, se résume en un pouvoir de réparation et d’augmentation des forces dont l’homme dispose et qu’il applique à la satisfaction de ses besoins; l’autre, la rareté, implique au contraire, nécessairement, une dépense de ces mêmes forces. Cette dépense constitue les frais d’acquisition de l’utilité; elle se proportionne aux difficultés qu’il faut vaincre pour la créer ou l’obtenir.
Or, si l’utilité se résume, en dernière analyse, en une certaine quantité de forces assimilables, et si l’assimilation ou la consommation de ces forces procure une jouissance; si, d’une autre part, la rareté, impliquant une certaine somme de difficultés à vaincre, nécessite une dépense de forces et cause une peine, qu’en doit-il résulter? C’est que la valeur, qui est composée d’utilité et de rareté, ne peut être produite qu’à la condition que les forces acquises que contient l’utilité soient attribuées, au moins en partie, à celurqui a surmonté les difficultés et dépensé les forces nécessaires pour les acquérir, ou bien encore qu’à la condition que la jouissance impliquée dans l’utilité soit attribuée à celui qui s’est donné la peine, qu’implique à son tour la rareté.
[I-111]
Si cette condition n’était point observée, si celui qui a dépensé de la force ou du pouvoir ne recevait en échange aucune portion de la force ou du pouvoir qu’il a créé, la production des valeurs deviendrait impossible, car nul ne peut dépenser des forces sans en récupérer, nul ne peut produire sans consommer. Enfin, si aucune partie de la jouissance ne revenait à qui s’est donné la peine, il n’existerait aucun motif pour produire.
Ce motif, ou, pour nous servir de l’expression consacrée, cet intérêt réside tout entier dans la possession de l’utilité produite ou d’une utilité équivalente. Lorsque le producteur peut s’attribuer toute cette utilité, l’intérêt qu’il a à la créer est à son maximum. Cet intérêt diminue, au contraire, à mesure que la part d’utilité qui lui est attribuée devient plus faible; il tombe à zéro lorsque cette part devient nulle.
Comment peut-on attribuer au producteur l’utilité contenue dans la valeur? En lui attribuant cette valeur même, c’est à dire en lui en garantissant la propriété. Maître de la valeur, il pourra user à sa guise de l’utilité qui s’y trouve contenue.
Que si maintenant l’on veut savoir jusqu’où doit aller cette garantie, il faut savoir jusqu’où va la valeur. Il faut rechercher dans quelles choses elle s’incarne, quelle est la nature, la forme, l’étendue et la durée de ces choses. Il faut, puisque la valeur est l’objet de la propriété, connaître exactement la valeur si l’on veut correctement garantir la propriété.
D’abord, on peut écarter du domaine de la propriété, toutes les choses qui ne sont ni pourvues de valeur ni susceptibles d’en acquérir. En revanche, il faut y comprendre toutes les valeurs, quelles que soient les formes sous lesquelles elles se trouvent incarnées.
[I-112]
Ces formes de la valeur, et, par conséquent, de la propriété, peuvent être ramenées à trois grandes catégories. On distingue: les valeurs personnelles, immobilières et mobilières, faisant l’objet d’autant de catégories correspondantes de propriétés.
La valeur incarnée dans les personnes fait l’objet de la propriété personnelle. Cette valeur réside, d’une part, dans l’utilité que l’on peut tirer des personnes, considérées comme agents productifs, en employant leurs forces ou leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles; d’une autre part, dans leur rareté, ou, ce qui revient au même, dans la limitation de leur nombre, ce quî implique la nécessité de les produire et de les entretenir, moyennant une dépense plus ou moins considérable. Tous les hommes constituent des valeurs, — valeurs essentiellement inégales comme leurs forces ou leurs aptitudes naturelles et acquises, — et, par conséquent aussi, des propriétés. Seulement, tandis que les uns s’appartiennent à euxmêmes et sont qualifiés de libres, les autres sont appropriés en tout ou en partie à des maîtres, et sont qualifiés d’esclaves, de serfs ou de sujets. Les hommes libres, aussi bien que les esclaves, ont une valeur; mais comme ils ne se vendent point, cette valeur n’est pas aussi facile à constater. On peut toutefois la reconnaître et l’exprimer, en calculant le taux et la durée des profits ou des salaires que tout individu maître de lui-même retire de l’exploitation ou de la location de ses facultés personnelles, et se rendre compte ainsi de la valeur d’une population libre aussi bien que d’une population esclave.
Les valeurs incarnées dans les personnes et faisant l’objet des propriétés personnelles sont susceptibles comme les autres d’augmentation et de diminution. Elles peuvent être augmentées, [I-113] d’un côté,par l’accroissement de l’utilité qui les constitue, par une éducation et un apprentissage qui développent les forces et les aptitudes productives de l’individu, d’un autre côté, par une augmentation de la rareté qui forme leur second élément constitutif, c’est à dire par une diminution du nombre des individualités productives relativement aux emplois qui leur sont ouverts, ou, ce qui revient au même, par une augmentation des emplois qui leur sont ouverts relativement à leur nombre.
Les valeurs incarnées, ou, pour nous servir de l’expression anglaise, investies dans toutes les choses qui ne sont point susceptibles d’être déplacées, telles que les fonds de terre, les bâtiments, etc., font l’objet de la propriété immobilière. Cette propriété ne réside point, comme on est trop généralement disposé à le croire, dans la matière des immeubles, mais dans la valeur qui s’y trouve incarnée. Ainsi la propriété d’un fonds de terre ne réside point dans le sol, auquel cas il serait impossible d’en déterminer les limites; mais dans la valeur du sol, appliqué à telle ou telle destination productive. Une valeur minière, par exemple, peut se créer sous le sol indépendamment de la valeur agricole qui se crée à la surface. Ces deux valeurs peuvent coexister et coexistent en formant des propriétés différentes, et leurs confins sont à la limite des éléments utiles à chacune des entreprises de production qui leur donnent naissance.
Enfin, la valeur investie dans toutes les choses susceptibles d’être mobilisées fait l’objet de la propriété mobilière.
On a voulu, dans ces derniers temps, créer une quatrième catégorie de propriété, nous voulons parler de la propriété intellectuelle, appliquée aux produits de l’invention, de la [I-114] science, de la littérature et de l’art. Mais les valeurs créées par la production dite intellectuelle peuvent être rattachées aux catégories précédentes. Dans le cas d’une mine, par exemple, la valeur créée par le découvreur s’incarne dans un immeuble. Dans le cas d’une machine, d’un livre ou d’une œuvre d’art, la valeur créée par l’inventeur, l’homme de lettres ou l’artiste s’incarne dans un objet mobilier. Dans le cas d’un procédé, la valeur créée s’incarne dans une capacité productive et constitue une valeur personnelle. Toutefois, ces valeurs ont, dans leur mode d’existence et de transmission, des caractères particuliers qui pourraient motiver l’établissement d’une catégorie à part.
Née avec la valeur, la propriété périt avec elle. Nous savons comment les valeurs naissent et sous quelles formes elles s’incarnent; voyons maintenant comment elles périssent.
Elles périssent par la destruction de l’utilité ou de la rareté des choses dans lesquelles elles sont contenues. Si une chose pourvue de valeur perd son utilité soit par voie de consommation, soit, au contraire, parce qu’elle cesse de répondre à un besoin, sa valeur périt. De même, si cette chose après avoir existé seulement en quantité limitée vient à se produire en quantité illimitée, si elle cesse d’être rare à quelque degré, sa valeur périt encore. On pourrait dresser un tableau de la longévité des valeurs, depuis celle de la leçon du professeur, qui périt au moment même où elle est produite, jusqu’à celle de l’or dont la durée est presque illimitée. Entre ces limites extrèmes de longévité, viennent se placer toutes les valeurs que crée et multiplie incessamment l’industrie humaine prise dans son acception la plus large, les valeurs incarnées dans les hommes, — libres ou esclaves, — dans les bêtes de somme, [I-115] dans les terres, les bâtiments, les machines, les outils, les marchandises de toute sorte, les livres, les objets d’art. La longévité moyenne des valeurs est, en définitive, assez courte; et s’il est des produits ou des œuvres dont la valeur traverse les siècles, le plus grand nombre n’a qu’une valeur limitée à quelques années, quelques mois ou même quelques jours.
Cependant, au moyen de ces valeurs essentiellement périssables, on constitue des capitaux qui ne périssent point, ou, du moins, qui subsistent bien longtemps après que les valeurs qui ont servi à les constituer ont été anéanties. Cette propriété qu’ont les valeurs, si éphémères qu’elles soient, d’engendrer des capitaux durables tient à ce qu’elles sont échangeables.
Comment un capital formé de valeurs éphémères mais échangeables peut subsister d’une manière indéfinie, voilà ce dont il importe de se rendre bien compte.
On crée des valeurs en vue de jouir de l’utilité qu’elles contiennent ou qu’elles peuvent procurer. Mais cette jouissance, on peut la recueillir de différentes manières: directement ou indirectement, immédiatement ou médiatement. Ainsi, on crée une valeur sous forme de blé. On consomme ce blé, on en détruit l’utilité, partant la valeur. Voilà une jouissance obtenue directement par la consommation de l’utilité, entraînant la destruction de la valeur que l’on a créée.
Cependant, au lieu de consommer directement le blé, on peut l’échanger contre d’autres produits, en se servant ainsi de la valeur du blé pour se procurer d’autres utilités que celles que le blé contient. Supposons qu’on l’échange contre de la monnaie. On peut conserver cette monnaie à titre de capital ou l’échanger contre d’autres choses, produits ou services. Lorsque ce second échange est accompli, on obtient indirectement [I-116] la satisfaction en vue de laquelle on a créé la valeur.
Tantôt aussi, la consommation est immédiate, et tantôt elle s’effectue au bout d’un espace de temps plus ou moins long. Si la leçon du professeur, par exemple, est consommée dès qu’elle est produite, la plupart des produits se conservent plus ou moins longtemps avant d’être consommés ou usés, et ils constituent des accumulations de valeurs ou des capitaux. Que ces capitaux ne se détruisent point, aussi longtemps que les valeurs, dont ils sont formés, demeurent échangeables, cela se conçoit aisément. Si mon capital est investi dans un chargement d’oranges, il périra ou sera diminué promptement, en admettant que je ne réussisse point à échanger la valeur de ce chargement contre une valeur égale ou plus considérable. En revanche, si cet échange est possible, si j’échange mon chargement d’oranges contre une certaine somme de monnaie, celle-ci contre d’autres marchandises, etc., etc., mon capital pourra acquérir une durée indéfinie.
Aussi longtemps donc que la valeur peut être échangée; aussi longtemps qu’on peut substituer ainsi à des valeurs investies sous une forme éphémère d’autres valeurs investies sous une forme durable, les capitaux composés de la réunion de ces valeurs échangeables peuvent non seulement se conserver, mais encore s’accroître et former, par là même, des propriétés essentiellement durables, quoique toute propriété périsse avec la valeur qui en fait l’objet.
Nous avons vu plus haut que les valeurs ont une longévité naturelle, dont la durée moyenne est assez bornée. Dans le cours de leur existence, elles sont soumises par le fait des circonstances ambiantes à des chances de plus value d’une part, à [I-117] des risques de moins value et de destruction accidentelle d’une autre part.
Ces chances et ces risques varient selon la nature des choses dans lesquelles ces valeurs sont incarnées, selon qu’il s’agit de valeurs personnelles, mobilières ou immobilières. Tantôt, ils ne peuvent être prévus, et, s’il s’agit de risques, évités; tantôt, et le plus souvent, au contraire, ils peuvent être prévus et approximativement calculés. Dans ce cas, les chances de plus value s’escomptent et les risques de moins value ou de destruction de la valeur, s’assurent.
On peut les partager d’abord en deux grandes catégories: ceux qui sont produits par l’action des forces déréglées de la nature, tremblements de terre, inondations, intempéries, etc., et ceux qui proviennent du fait de l’homme. Cette dernière catégorie comporte encore deux divisions: ceux qui sont conformes au droit et ceux qui sont contraires au droit.
L’homme ayant pouvoir de créer et de détruire des valeurs, c’est à dire d’augmenter ou de diminuer la quantité des valeurs existantes, doit exercer par là même une action inévitable sur les valeurs ambiantes. Ainsi, tout homme qui fonde une entreprise industrielle augmente la demande, partant la valeur des bâtiments, des ustensiles, des matériaux et du travail nécessaires à son industrie, tandis qu’en accroissant l’offre des produits de cette industrie, il en diminue la valeur. Tout homme, — et cet exemple est plus saisissant encore, — qui invente ou applique un nouveau procédé, une nouvelle machine, etc., occasionne une révolution dans les valeurs ambiantes, personnelles, mobilières et immobilières, en fournissant aux unes une plus value parfois énorme, en faisant en revanche subir aux autres une moins value qui peut aller jusqu’à [I-118] la destruction totale de la valeur. Qu’un chemin de fer, par exemple, vienne à être établi dans un pays qui avait été jusqu’alors sillonné seulement par des routes ordinaires, on verra ces deux phénomènes de la moins value d’une part, de la plus value de l’autre se manifester d’une manière simultanée. Les routes concurrentes et tous les établissements qui subsistaient de leur exploitation, tels qu’auberges, relais de postes, etc., subiront une moins value par le fait du déplacement de la circulation des voyageurs et des marchandises. En revanche, tous les capitaux personnels, mobiliers on immobiliers, placés dans la sphère d’activité du chemin de fer, recevront une plus value grâce à l’augmentation de débouché qui en résultera pour les produits agricoles ou industriels, pour les services personnels, etc. Il en est ainsi de tous les progrès accomplis dans n’importe quelle branche d’industrie. Quand les métiers à filer et à tisser à la mécanique ont été substitués aux métiers à filer et à tisser à la main, la valeur investie dans les anciens métiers a été presque anéantie et celle du personnel qui les faisait mouvoir a été fortement diminuée. En revanche, les industries, les instruments et les matériaux propres à la fabrication des nouveaux métiers, les matériaux des industries dans lesquelles ils ont été introduits et dont ils ont provoqué le développement, le personnel de ces industries, enfin les consommateurs des produits économiquement fabriqués au moyen de ces engins perfectionnés en ont reçu une plus value. La différence entre la moins value infligée aux uns et la plus value ajoutée aux autres constitue le bénéfice du progrès, et elle demeure acquise, d’une manière permanente, à l’humanité.
On a été plus loin et l’on a affirmé que les ouvriers employés aux anciennes machines n’éprouvaient aucun dommage par le [I-119] fait de l’introduction des nouvelles. C’était commettre une exagération analogue à celle qui aurait consisté à dire que les anciennes machines elles-mêmes ne subissaient aucune moins value, sous l’influence du même fait. Car les ouvriers fileurs ou tisserands à la main, par exemple, perdaient tout au moins la valeur de l’apprentissage qui leur avait été nécessaire pour faire fonctionner les métiers désormais mis au rebut. Pourrait-on affirmer cependant que ces ouvriers eussent quelque droit d’empêcher l’adoption des machines qui leur causaient ce dommage? ou bien encore de réclamer de ceux qui faisaient usage des nouveaux métiers une compensation pour la moins value infligée à leurs facultés productives? Non, à coup sῦr. S’il est dans la nature du progrès d’engendrer d’un côté une moins value dont quelques-uns souffrent, il engendre d’un autre côté une plus value toujours supérieure à la moins value. Qu’en résulte-t-il? C’est que dans une société en voie de progrès, chacun reçoit incessamment, et, le plus souvent, sans s’en apercevoir, sous la forme d’un accroissement de sa valeur personnelle ou de ses valeurs immobilières et mobilières, une part de la plus value qu’engendre tout progrès accompli. Cette plus value, à la vérité, il ne la reçoit point gratis, il l’achète au prix du risque de moins value que contient également tout progrès. Mais comme le risque de perte est toujours et nécessairement inférieur à la chance de gain, il bénéficie de la différence. Dédommager de la perte causée par un progrès particulier ceux qui bénéficient des avantages résultant du progrès général, cela reviendrait à augmenter artificiellement la part des uns, en leur procurant, aux dépens des autres, les avantages du progrès sans en déduire les risques. Sans doute, le risque de perte s’agglomère, tandis que la chance de gain se [I-120] dissémine, et un seul progrès, dont ils ont eu à subir la moins value, a pu causer aux fileurs et aux tisserands à la main un dommage supérieur au bénéfice qu’ils avaient retiré de cent autres progrès; mais rien n’empêche de recourir à l’assurance pour disséminer aussi les risques. En admettant donc que l’assurance vint à se généraliser en cette matière, tous les membres de la société recevraient, en échange de la prime qu’ils auraient payée pour s’assurer contre le risque d’un progrès spécial, une plus value toujours supérieure, constituant leur part de dividende dans le progrès général. L’excédant de cette part de gain sur la prime du risque, formerait le bénéfice net que chacun retirerait de l’ensemble des progrès accomplis.
Mais il existe une seconde catégorie de risques de moins value ou de destruction de la valeur, provenant du fait de l’homme: ce sont ceux qu’il inflige aux valeurs ambiantes, personnelles, mobilières et immobilières, en sortant des limites de son droit. Ces risques se traduisent en des nuisances spéciales auxquelles ne correspond et que ne rachète aucun profit général. Il existe des industries absolument nuisibles, telles que le brigandage et le vol, qui détruisent les valeurs ambiantes on les empêchent de se multiplier, et qu’il importe en conséquence d’extirper; il en existe aussi, et en bien plus grand nombre, qui, tout en ayant un caractère d’incontestable utilité, contiennent cependant des nuisances: telles sont les industries qualifiées de dangereuses, insalubres ou incommodes; celles-ci doivent ou se placer et se comporter de façon que la nuisance qu’il est dans leur nature de causer n’inflige point de dommage à autrui, ou fournir pour ce dommage une compensation suffisante.
Les industries nuisibles donnent lieu à une branche particulière [I-121] des assurances, la plus ancienne de toutes, et qui a pour objet la production de la sécurité ou, ce qui revient au même, la destruction ou la police des nuisances [13]
En résumé, la valeur, objet de la propriété, s’incarne dans les personnes et dans les choses. Elle périt avec elles, mais, grâce à la qualité qu’elle a d’être échangeable, elle sert d’étoffe à des capitaux dont la durée est indéfinie. Dans le cours de son existence, elle est soumise, soit par le fait de la nature, soit par le fait de l’homme, à des risques de moins value et de destruction accidentelle, mais elle possède, en revanche, des chances de plus value. Certains d’entre ces risques naissent de l’exercice légitime et nécessaire de l’activité humaine, et ils ne peuvent donner lieu qu’à de simples assurances; certains autres, au contraire, impliquent une atteinte portée au droit d’antrui, et il est juste et nécessaire de les supprimer ou de les écarter, en fournissant une compensation à ceux qui en souffrent aux frais de ceux qui les infligent.
Telle est la propriété considérée dans son objet, la valeur. Comme elle n’est, d’après la définition que nous en avons donné, qu’un rapport, — rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l’ont créée, reçue ou acquise, — nous avons à la considérer aussi dans son sujet, celui qui possède.
L’homme qui possède des valeurs est investi du droit naturel d’en user et d’en disposer selon sa volonté. Les valcurs possédées peuvent être détruites ou conservées, transmises à titre d’échange, de don ou de legs. A chacun de ces modes d’usage, [I-122] d’emploi ou de disposition de la propriété correspond une liberté.
Énumérons ces libertés dans lesquelles se ramifie le droit de propriété.
Liberté d’appliquer directement les valeurs créées ou acquises à la satisfaction des besoins de celui qui les possède, ou liberté de consommation.
Liberté de les employer à produire d’autres valeurs, ou liberté de l’industrie et des professions.
Liberté de les joindre à des valeurs appartenant à autrui pour en faire un instrument de production plus efficace, ou liberté d’association.
Liberté de les échanger dans l’espace et dans le temps, c’est à dire dans le lieu et dans le moment où l’on estime que cet échange sera le plus utile, ou liberté des échanges.
Liberté de les prêter, c’est à dire de transmettre à des conditions librement débattues la jouissance d’un capital ou liberté du crédit.
Liberté de les donner ou de les léguer, c’est à dire de transmettre à titre gratuit les valeurs que l’on possède, ou liberté des dons et legs.
Telles sont les libertés spéciales ou, ce qui revient au même, tels sont les droits particuliers dans lesquels se ramifie le droit général de propriété.
Maintenant, si nous considérons ce droit dans son usage, nous trouverons qu’il existe deux catégories de propriétaires:
- 1° Ceux qui sont pourvus d’une capacité morale et intellectuelle suffisante pour user utilement des valeurs qu’ils ont créées, reçues ou acquises.
- 2° Ceux qui ne possèdent point cette capacité; ceux qui sont [I-123] incapables d’user et de disposer utilement de la propriété, et qui n’en pourraient faire, en conséquence, qu’un usage dommageable à eux-mêmes et aux autres.
Il convient de remarquer toutefois que la capacité d’user et de disposer utilement de la propriété n’existe point d’une manière absolue. Quelles que soient la moralité et l’intelligence d’un propriétaire, il est toujours exposé à faire un mauvais usage de sa propriété. Mais, selon qu’il en use bien ou mal, sa richesse augmente ou diminue; selon qu’il existe dans une société plus ou moins de capacité à bien user de la propriété, elle s’enrichit ou demeure misérable.
Lorsque cette capacité n’existe point, on met le propriétaire en tutelle. Le tuteur use et dispose de la propriété, sauf à rendre compte à qui de droit de l’usage qu’il en a fait. Tantôt la tutelle est complète, lorsqu’il s’agit des enfants et des aliénés par exemple; tantôt elle est partielle, lorsqu’il s’agit des femmes. Tantôt encore elle est volontaire, tantôt, et plus souvent, elle est imposée. L’esclavage est la forme primitive et grossière de la tutelle imposée à des classes ou à des races incapables de bien user de la propriété. Que cette forme de la tutelle soit vicieuse et surannée, la réaction qui s’est universellement produite contre l’esclavage l’atteste suffisamment, mais que la tutelle elle-même ait cessé d’être nécessaire, pour les individualités inférieures de certaines races ou même de toutes les races, voilà ce que nul n’oserait affirmer. La suppression de la tutelle, sous sa forme barbare et primitive de l’esclavage, n’implique pas nécessairement la suppression de toute tutelle, et aussi longtemps qu’il existera des hommes enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, il y aura lieu de leur donner et, au besoin, de leur imposer des tuteurs.
[I-124]
En admettant que cette question préalable soit résolue, c’est à dire que les seules individualités capables d’user et de disposer de la propriété (que cette propriété se trouve sous la forme de valeurs personnelles, mobilières ou immobilières), soient investies du droit d’en user et d’en disposer, il s’agit de savoir si les différentes libertés que contient ce droit, liberté de la consommation, liberté de l’industrie, liberté d’association, liberté de l’échange, liberté du prêt, des donations et des legs, doivent être restreintes ou laissées en tières.
Pour résoudre cette question, nous n’avons qu’à nous reporter aux conditions de la création des valeurs. Si, comme nous l’avons démontré, la création de toute valeur occasionne une dépense de forces et une peine, nul ne crée volontairement des valeurs qu’à la condition de récupérer une force supérieure à celle qu’il a dépensée, une jouissance plus grande que la peine qu’il s’est donné. Mais si l’on ne peut user et disposer librement des valeurs que l’on possède, si cette liberté d’user ou de disposer de la valeur est supprimée ou diminuée, l’utilité contenue dans la valeur et en vue de laquelle elle a été acquise, se trouve supprimée ou diminuée et la valeur avec elle. Tout retranchement à la liberté d’user ou de disposer des valeurs, de les consommer, de les employer, de les échanger, de les donner, de les léguer, en un mot, toute servitude imposée aux propriétaires, en ce qui concerne l’usage et la disposition de leurs propriétés, se traduit en une moins value, et diminue d’autant leur intérêt à créer, à conserver et à multiplier les valeurs.
Cependant, le propriétaire peut être intéressé, soit pour conserver son droit sur la valeur qui lui appartient, soit pour préserver cette valeur d’un risque de destruction quelconque, à [I-125] sacrifier une partie de la valeur possédée ou même une partie du droit de propriété pour assurer la conservation du restant. Lorsqu’il s’agit simplement de préserver d’un risque de destruction la valeur possédée, il suffit ordinairement d’abandonner, sous la forme d’une prime, une partie de cette valeur à un assureur quelconque, sans se dessaisir d’aucune partie du droit d’user ou de disposer du restant. Mais il en est autrement, lorsqu’il s’agit de sauvegarder le droit de propriété même contre les atteintes de la violence ou de la fraude. Presque toujours, en ce cas, un retranchement du droit est nécessaire, une servitude doit être jointe à la prime d’assurance. Supposons, par exemple, qu’il s’agisse de préserver un pays du risque d’une invasion étrangère, il pourra être nécessaire d’établir sur certains points du territoire des places fortes ou des camps retranchés. Autour de ces lieux de défense, l’expérience technique de l’art militaire a démontré encore la nécessité d’établir un rayon de servitudes, dans lequel il est interdit de planter et de bâtir, afin que les abords de la place ne soient point obstrués par des plantations et des constructions, propres à servir d’abris à l’ennemi. Ces servitudes, en restreignant la liberté de l’emploi des valeurs appropriées, leur infligent une moins value. Elles peuvent néanmoins être très légitimement établies, s’il est reconnu qu’elles sont nécessaires à la défense commune. Seulement, dans ce cas, il est juste que la communauté des assurés, dans l’intérêt de laquelle elles sont établies, en paye les frais, en fournissant aux propriétaires dont les biens sont frappés de servitudes, une indemnité égale à la moins value que subissent ces biens. Supposons encore qu’il s’agisse de combattre et d’écarter, à l’intérieur, les risques de spoliation et de destruction qui menacent les propriétés, risques d’assassinat, [I-126] de vol, d’escroquerie, etc.; il pourra être nécessaire que chacun se soumette à certaines servitudes spéciales, requises pour rendre efficace la répression de ces sévices: telle est, par exemple, la servitude de l’incarcération, c’est à dire la privation de la liberté personnelle pendant la durée d’une instruction judiciaire, etc., etc. Mais ces servitudes qui diminuent le droit de propriété aussi bien que les primes d’assurances qui diminuent les valeurs possédées, doivent être réduites au minimum indispensable pour garantir la propriété. Il en est ainsi lorsque les assurances sont libres, c’est à dire lorsque le propriétaire, grevé d’un risque, est le maître ou de s’assurer contre le risque ou de le supporter lui-même, ou bien encore de choisir entre les assureurs. Mais les assurances libres sont d’une date récente; l’assurance obligatoire et monopolisée n’a pas cessé d’être la règle, au moins pour les risques provenant du fait de l’homme; en conséquence, les primes et les servitudes qu’elle exige sont demeurées partout excessives.
Après avoir examiné en quoi consiste le droit de propriété, dans quels droits ou dans quelles libertés il se ramifie, les conditions nécessaires à son exercice et les servitudes qu’il comporte, nous avons à jeter un coup d’œil sur les formes qu’il affecte. On peut ramener ces formes à trois grandes catégories. La propriété peut être commune, individuelle ou collective.
Ces formes de la propriété n’ont rien d’arbitraire; elles sont déterminées partout et toujours par la nature et l’état d’avancement de la production. La propriété commune apparaît la première au moins pour les valeurs immobilières. Les domaines de chasse, les pêcheries sont possédés en commun par les tribus qui vivent de leur exploitation. En revanche, les produits provenant de cette exploitation, le poisson et le gibier sont [I-127] partagés entre les chasseurs et les pêcheurs, en proportion de la valeur du concours de chacun, et ils deviennent alors des propriétés individuelles. Lorsque l’agriculture prit naissance, les exploitations se morcelèrent, et la propriété individuelle devint alors la forme prédominante. Cette forme domine encore de nos jours, quoique les progrès des instruments et des méthodes de la production nous conduisent rapidement à une période où la propriété collective prévaudra à son tour. Comme il faut, de plus en plus, pour produire, la réunion et la coopération d’immenses capitaux, sous forme de valeurs personnelles, mobilières et immobilières, la propriété des valeurs appliquées à la production ou, ce qui revient au même, des capitaux doit devenir, de plus en plus aussi, collective ou actionnaire. La propriété collective n’est, à la bien considérer, qu’une transformation progressive de la propriété commune, avec laquelle elle conserve de notables analogies. C’est ainsi qu’un chemin de fer, par exemple, est la propriété commune d’une “tribu” plus ou moins nombreuse d’actionnaires, qui n’en peuvent disposer que collectivement. Chacun reçoit dans le produit de l’exploitation une part proportionnée à la valeur de son apport, et cette part seule devient sa propriété individuelle. En résumé, on peut dire que la propriété collective, qui répond à un état avancé de l’industrie humaine, n’est autre chose que la communauté librement spécialisée, conformément aux besoins de la production divisée.
La communauté primitive qui se retrouve encore dans les propriétés dites nationales, provinciales ou communales, tend ainsi à disparaître pour faire place à la communauté spécialisée, — ceci en vertu de la loi même qui détermine la spécialisation progressive des industries ou la division du travail.
[I-128]
Si les formes de la propriété dépendent de la nature et de l’état d’avancement de la production, si tel état de la production comporte la propriété commune, tel autre la propriété individuelle, tel autre enfin la propriété collective ou communauté spécialisée, on comprend qu’aucune forme de la propriété ne puisse être arbitrairement imposée, sans occasionner un dommage, une nuisance à la société. Vouloir restaurer, dans l’état présent de la production, la communauté primitive aux dépens de la propriété individuelle, ce serait, en admettant que la chose fῦt praticable, faire rétrograder la production jusqu’à l’époque où les hommes vivaient des produits de la chasse, de la pêche, de la cueillette des fruits ou de la vaine pâture. Vouloir, au contraire, perpétuer la propriété individuelle, en la protégeant au moyen d’obstacles artificiels opposés à la formation de la propriété collective, ce serait enrayer le développement progressif de la production et ralentir ainsi la multiplication des richesses. Il importe, en définitive, de laisser la propriété s’établir toujours sous sa forme naturelle, c’est à dire sous la forme que commandent la nature et l’état d’avancement de la production, en se bornant à la garantir aussi complétement que possible sous cette forme.
Enfin, il nous reste à examiner les rapports économiques de la propriété de chacun avec la propriété d’autrui. Ces rapports se résument dans l’échange et dans le prêt, lequel n’est, en dernière analyse, qu’un échange accompli dans le temps. Sous un régime de production spécialisée, toutes les valeurs appropriées sont incessamment échangées par ceux qui les possèdent ou qui en ont loué l’usage. Ces échanges s’opèrent sous l’empirede deux sortes de circonstances ou de deux états différents de la propriété: sous l’empire du monopole ou de la concurrence.
[I-129]
Le monopole apparaît lorsque des valeurs personnelles, mobilières ou immobilières sont possédées par un seul individu ou par un petit nombre d’individus, tandis que les valeurs contre lesquelles elles s’échangent sont possédées par un grand nombre. Alors il peut arriver et il arrive fréquemment que les monopoleurs restreignent leur offre de manière à élever le prix courant d’un produit bien au dessus de son prix naturel et à s’attribuer ainsi un bénéfice de surcroît, autrement dit une rente.
Le monopole peut être de deux sortes: naturel ou artificiel.
Le monopole est naturel lorsque, d’une part, la quantité existante des valeurs monopolisées est inférieure à la demande; lorsque, d’une autre part, aucun obstacle artificiel n’empêche les consommateurs de se les procurer où bon leur semble. Ainsi, un artiste pourvu d’un talent extraordinaire possède un monopole naturel. De même, les propriétaires de certaines terres particulièrement fertiles ou propres à la production de denrées rares jouissent encore d’un monopole naturel. Mais le monopole naturel procurant des bénéfices extraordinaires, ces bénéfices agissent comme une prime d’encouragement pour la découverte ou la formation de fonds analogues. Plus cette prime est élevée, plus l’encouragement qu’elle offre à la concurrence est considérable et moins, en conséquence, le monopole est durable. Tel est encore le cas pour les inventions et les œuvres de la littérature ou de l’art. Lorsque ceux qui les ont créées ou acquises profitent de leur monopole naturel pour en surélever le prix, la production des œuvres similaires est stimulée de tout le montant de la rente qu’ils s’attribuent. Non seulement le monopole attire ainsi la concurrence, mais encore il arrive fréquemment, dans le cas des inventions, par [I-130] exemple, que l’invention nouvelle, hâtée par l’abus du monopole naturel de l’ancienne, anéantisse complétement la valeur de celle-ci.
Le monopole est artificiel lorsqu’un individu ou une collection d’individus ont seuls le droit d’offrir sur un certain marché une catégorie quelconque de produits ou de services, ou, ce qui revient au même, lorsque les autres propriétaires sont soumis, au profit des monopoleurs, à une diminution de leur droit de disposer de leurs produits ou de leurs services, lorsque le droit des uns est étendu aux dépens du droit des autres, de manière à constituer, d’un côté, un privilége auquel correspond, d’un autre côté, une servitude. Dans ce cas, les monopoleurs peuvent réaliser des bénéfices d’autant plus considérables que le produit ou le service monopolisé peut être, d’une part, plus aisément raréfié, et qu’il a, d’une autre part, un caractère d’utilité plus prononcé. Lorsque c’est une denrée nécessaire à la vie, le prix en peut être porté, par la diminution des quantités offertes, à un taux meurtrier. Aussi, dans ce cas, le gouvernement qui concède ou garantit le monopole prend-il soin, le plus souvent, de le limiter, en établissant un maximum, c’est à dire un niveau au dessus duquel le prix du produit ou du service monopolisé ne peut être porté. Mais ce maximum est ordinairement éludé, et, quand même il ne l’est point, il permet aux monopoleurs de vendre ou de prêter leurs produits ou leurs services à usure, c’est à dire en s’attribuant, aux dépens des consommateurs, une rente en sus du profit naturel et nécessaire de leur industrie.
La concurrence existe, au contraire, lorsque le nombre des propriétaires de produits ou de services échangeables n’est point limité, et lorsque ces produits ou ces services eux-mêmes [I-131] peuvent être produits d’une manière illimitée. Dans ce cas, qu’arrive-t-il? C’est que ces produits ou ces services sont toujours offerts sur le marché ou tendent toujours à l’être dans la proportion la plus utile. En effet, lorsqu’ils sont offerts en quantité insuffisante, la loi des quantités et des prix agit promptement pour attribuer à ceux qui les offrent une rente en sus du profit nécessaire, et cette rente agit comme une prime pour attirer la concurrence; lorsqu’ils sont, au contraire, offerts avec excès, le phénomène opposé se manifeste, et c’est ainsi, comme nous le verrons plus loin, que l’ordre et la justice tendent incessamment et d’eux-mêmes à s’établir sous le régime de la concurrence.
[I-132]
CINQUIÈME LEÇON↩
l’assiette de la production
Comment l’assiette de la production s’établit, lorsque le producteur est isolé; — que cette assiette n’a rien d’arbitraire; — qu’elle est essentiellement mobile. — Comment elle s’établit sous le régime de la division du travail et de l’échange; — que la loi de la formation des prix apparaît, sous ce régime, comme le grand régulateur de la production; — qu’elle agit incessamment pour faire naître les différentes branches de la production, dans le temps le plus opportun, pour les établir dans les lieux, sous les formes et dans les limites les plus utiles. — Des obstacles qui s’opposent à ce que les différentes branches de la production se localisent de la manière la plus conforme aux ressources du sol et au génie particulier des habitants; — Comment ces obstacles s’aplanissent. — Vice des discussions entamées sur les formes et les limites de la production.
C’est seulement après s’être bien rendu compte du phénomène de la constitution des valeurs ou de la formation des prix, qu’on peut concevoir, d’une manière un peu nette, comment, sous le régime de la division du travail et de l’échange, la production s’assied et s’organise, comment aussi elle se [I-133] proportionne avec la consommation; comment, pour tout dire, l’ordre s’établit et se maintient de lui-même dans le monde économique.
Sous le régime de la production isolée, ce problème de l’établissement de l’ordre économique se résout d’une manière fort simple. L’homme isolé consulte, d’une part, ses besoins, d’une autre part, les moyens de production dont il dispose, et il organise sa production en conséquence. Comme ses ressources sont d’abord fort limitées, il se contente de produire les choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins les plus urgents et dans la proportion marquée par le caractère de nécessité de ces choses. A mesure que ses ressources se développent, il accroît sa production. Dans quel ordre? Dans l’ordre indiqué par la nature et l’étendue de ses besoins, la nature et l’étendue de ses ressources. Après avoir pourvu à ses besoins de première nécessité, il commence à satisfaire ceux de seconde nécessité, puis ses goῦts de luxe. C’est l’intensité plus ou moins grande de ses besoins et, par conséquent, des jouissances qu’il peut retirer de leur satisfaction, qui le dirigera, avant tout, dans l’organisation de sa production. Sera-t-elle cependant son seul guide? L’homme isolé s’attachera-t-il toujours à pourvoir à ses besoins en proportion de leur intensité? Oui, s’ils ne sont pas plus difficiles à satisfaire les uns que les autres. Non, si, comme c’est le cas ordinaire, la nature de ses ressources est telle qu’il puisse satisfaire facilement certains besoins, difficilement certains autres, et qu’il s’en trouve même qu’il ne puisse satisfaire. Les difficultés de la production des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, et par conséquent l’intensité de la peine ou la grandeur du sacrifice que chacune de ces choses lui coútera, entreront comme un second élément dans son appréciation. [I-134] Il organisera sa production des différentes choses dont il a besoin et qu’il a les moyens de produire, en raison directe de la jouissance que lui procurera la consommation de ces choses, en raison inverse de la peine que leur production lui coῦtera. L’assiette de sa production sera le résultat de cette double appréciation.
L’assiette de la production de l’homme isolé n’aura, comme on voit, rien d’arbitraire. L’homme isolé produira d’abord les choses dont la consommation lui procurera le plus de jouissances on, ce qui revient au même, dont la privation lui causerait le plus de souffrances, et dont la production lui coῦtera le moins de peine. Successivement, à mesure que ses premiers besoins seront apaisés, il produira d’autres choses, toujours en raison directe de la jouissance qu’elles lui procurent, et en raison inverse de la peine qu’elles lui coῦtent. Tel sera l’ordre chronologique naturel de l’établissement des branches plus ou moins nombreuses de sa production.
Cet établissement s’opérera aussi dans les conditions les plus économiques. Car l’homme isolé ayant beaucoup de besoins et peu de moyens de les satisfaire, s’efforcera de ne consacrer à chacune des branches de sa production que la moindre quantité possible des forces et des ressources dont il dispose. Dans ce but, il s’attachera à les établir dans la situation la plus favorable et à les exploiter de la manière la plus économique, afin d’obtenir un maximum de produit, partant de jouissances, moyennant un minimum de dépense, partant de peine.
Enfin, l’homme isolé ayant établi sa production conformément à la nature et à l’étendue de ses besoins, conformément aussi à la nature et à l’étendue de ses ressources, cherchera [I-135] naturellement à maintenir entre les différentes branches de son travail, la proportion la plus utile: ses ressources étant limitées, il n’exagérera point sa production d’un côté, afin de n’être point obligé de l’amoindrir d’un autre. Il maintiendra parmi ses produits la proportion indiquée par l’état de ses besoins et de ses ressources, c’est à dire la proportion qui lui sera la plus utile ou qui lui semblera telle.
Tel est l’ordre que l’homme isolé s’attachera à établir dans sa production. Cet ordre sera-t-il immuable? Non, il sera fréquemment troublé et changé. Il le sera par le fait de causes indépendantes de l’homme et par le fait de sa volonté.
L’homme vit dans un milieu essentiellement mobile et il est exposé à des risques de toute sorte. Sa demeure pent être consumée par l’incendie, ses moissons peuvent être ravagées par la grêle, ou dévorées par les sauterelles. Les accidents de la température exercent une influence considérable sur la branche la plus importante de son travail, sur la production de ses aliments. Quand il entreprend une culture, il ne peut jamais savoir au juste quelle quantité de produits elle lui rendra. Il ne peut le savoir que d’une manière approximative, et souvent le résultat s’éloigne beaucoup de son approximation. En tous cas, la proportion des produits qu’il obtient diffère toujours plus ou moins de celle qu’il avait cherché à obtenir.
L’ordre de sa production se trouve ainsi troublé par des accidents qui échappent à son influence. Cet ordre se trouve encore incessamment modifié, bouleversé par le fait de sa volonté.
Doué d’une intelligence progressive, l’homme se modifie et il modifie le milieu où il vit ainsi que les agents dont il se sert. Ses besoins et ses goῦts changent, au moins dans une certaine [I-136] mesure. Les uns deviennent plus intenses, les autres le deviennent moins. De jour en jour, il raisonne davantage ce qui lui parait utile. Il avait, par exemple, la passion des liqueurs fortes. Il s’aperçoit que cette passion lui est nuisible et il s’en corrige. Aussitôt, il consomme moins de spiritueux et, en conséquence, il en produit moins. La portion de son temps et de ses ressources qu’il économise de ce côté, il l’applique à produire un supplément de choses destinées à satisfaire d’autres besoins. L’assiette de sa production se modifie, dans ce cas, parce que l’assiette de sa consommation s’est modifiée. L’inverse se produit aussi. L’homme perfectionne certaines branches de sa production, et il obtient facilement, en se donnant peu de peine, ce qu’il obtenait naguère difficilement, en se donnant beaucoup de peine. Alors l’assiette de sa consommation se modifie parce que l’assiette de sa production s’est modifiée. Trois cas différents peuvent, du reste, se présenter ici: 1° que l’homme augmente sa consommation de la denrée dont il a perfectionné la production, exactement en proportion de la diminution de sa dépense ou de sa peine; 2° qu’il augmente sa consommation dans une proportion plus faible; 3° qu’il l’augment dans une proportion plus forte. Dans le premier cas, l’assiette de sa consommation se trouvera changée, mais non celle de sa production. Dans les deux autres, l’assiette de sa production sera modifiée comme celle de sa consommation. En tous cas, quelles que soient les modifications qu’elles subissent, la production et la consommation de l’homme isolé tendent toujours à se mettre en équilibre. Cet équilibre peut toujours aussi s’établir aisément, sauf, bien entendu, les perturbations indépendantes de la volonté humaine, puisque chacun connaît, d’une part, ses besoins et les choses qui lui sont nécessaires [I-137] pour les satisfaire, d’une autre part, les ressources dont il dispose pour produire ces choses.
En d’autres termes, l’homme isolé connaît ou peut connaître aisément l’étendue du débouché qu’il s’offre à lui-même; il peut apprécier aisément la demande qu’il fera de chacune des choses qui lui sont nécessaires, et régler sa production de manière à proportionner son offre à sa demande, sauf toujours les perturbations indépendantes de sa volonté.
C’est l’intérêt bien ou mal entendu de l’homme isolé qui détermine la nature de sa consommation, et c’est la nature de sa consommation qui détermine l’assiette de sa production.
Sous le régime de la division du travail et de l’échange, le même principe gouverne l’organisation de la production. Comme dans le cas de l’isolement, chaque homme est sollicité par un certain nombre de besoins et il dispose pour les satisfaire d’une certaine quantité de moyens de production, avec cette différence que les moyens de production de l’homme en société sont infiniment plus considérables que ceux de l’homme isolé, nous avons vu pour quelle raison [14] . L’homme en société peut, en conséquence, pourvoir à ses besoins d’une manière plus complète que l’homme isolé. Mais, dans les deux cas, l’assiette de la consommation, partant celle de la production, s’établit de la même manière. Ainsi que l’homme isolé, l’homme en société échelonne sa consommation en raison directe de la jouissance que les choses lui procurent, ou, ce qui revient au même, de la souffrance qu’elles lui épargnent, en raison inverse de la [I-138] peine ou des sacrifices qu’elles lui coῦtent. C’est son intérêt bien ou mal entendu qui gouverne sa consommation.
Seulement, dans le cas de l’isolement, on conçoit aisément que la production s’opère toujours dans le temps, dans le lieu, sous la forme et dans la proportion qui paraissent le plus utiles au consommateur, sauf bien entendu les perturbations indépendantes de la volonté humaine, puisque l’homme isolé consomme lui-même toutes les choses qu’il produit, puisque le producteur s’identifie en lui avec le consommateur.
Dans le cas de la division du travail et de l’échange, la production étant séparée de la consommation, en ce sens que chacun produit des choses qu’il livre à la consommation générale pour recevoir en échange les choses qui entrent dans sa consommation particulière, le problème de l’organisation utile de la production semble infiniment plus difficile à résoudre. On ne s’explique pas d’emblée comment, sous ce régime, la production puisse s’opérer toujours dans le temps, dans le lieu, sous la forme et dans les conditions les plus utiles, comme aussi dans la proportion requise par la consommation.
Nous allons voir que la loi qui fait graviter avec une puissance irrésistible le prix des choses vers un point central marqué par leurs frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net; nous allons voir, disons-nous, que cette loi donne, sauf l’action des causes perturbatrices, la solution du problème que nous venons de poser; qu’elle agit incessamment pour faire naître les différentes branches de la production dans le temps le plus opportun, pour les établir et les organiser dans les lieux, sous les formes et dans les conditions les plus utiles, enfin pour les développer dans les proportions requises par la consommation, absolument comme si le producteur continuait [I-139] à ne faire qu’un avec le consommateur; qu’elle est, en un mot. le grand régulateur de la production.
1. Chacune des branches de la production naît-elle toujours dans le temps le plus opportun?
C’est seulement lorsqu’une denrée est assez demandée pour que son prix s’élève au niveau de ses frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net, qu’elle commence à être produite. On dit alors qu’elle possède un débouché. Nous venons de voir qu’à l’origine, chaque producteur se sert de débouché à lui-même. Mais lorsque le travail vient à se diviser, le débouché s’agrandit: chaque catégorie de producteurs sert de débouché aux autres. Ainsi, les agriculteurs produisent des substances alimentaires non seulement pour eux-mêmes, mais encore pour les maçons, les cordonniers, les fabricants d’étoffes, etc. Les cordonniers fournissent des souliers aux agriculteurs, aux maçons et aux autres catégories de production. Ainsi de suite.
Cependant, dans la production divisée aussi bien que dans la production isolée, ces différentes branches de l’industrie humaine ne naissent point d’une manière simultanée. Elles ont un ordre de développement naturel, ordre déterminé par la formation et le développement de chaque débouché.
Le besoin de nourriture étant celui que nous pouvons le moins nous dispenser de satisfaire, l’industrie alimentaire a été évidemment la première à se constituer. Viennent ensuite le besoin de se préserver des intempéries des saisons, et celui de se défendre contre les hommes et les animaux nuisibles, qui ont donné naissance à plusieurs autres branches de la production. Les industries qui pourvoient à ces besoins de première nécessité sont les seules que l’on observe chez les peuples [I-140] demeurés à l’échelon inférieur de la civilisation. Pourquoi? parce que le travail de l’homme, chez ces peuples arriérés, suffit à peine pour lui procurer une alimentation, des vêtements et un abri grossiers. Tout son temps et toutes ses ressources doivent y être consacrés.
Mais que l’industrie se perfectionne, que les moyens de production dont l’homme dispose viennent à s’accroître de telle façon qu’après avoir pourvu à ses besoins de première nécessité, il puisse encore en satisfaire d’autres, on verra aussitôt un débouché naître pour les denrées de seconde nécessité et même pour les objets de luxe. Ces moyens de production supplémentaires que le progrès aura mis au service de l’homme, il les emploiera à créer un supplément de choses utiles et à apaiser des besoins qui étaient demeurés jusqu’alors non satisfaits.
C’est ainsi que les différentes branches de la production naissent et se développent, successivement, à mesure que l’industrie se perfectionne. Il y a dans leur croissance un ordre chronologique naturel. Chaque branche de la production naît aussitôt qu’elle trouve un débouché, et la formation du débouché dépend, à son tour, du nombre et de la perfection des agents productifs dont l’homme dispose. Tout progrès, en développant les moyens de production, crée par là même un nouveau débouché et permet à l’homme de satisfaire un nouveau besoin ou, pour mieux dire, un besoin demeuré jusqu’alors inassouvi. Grâce aux progrès successifs que l’humanité a accomplis depuis l’origine de la civilisation, l’homme peut satisfaire aujourd’hui un bien plus grand nombre de besoins et d’une manière bien plus complète qu’il ne le pouvait jadis, et la production qui n’avait alors que quelques rameaux en possède aujourd’hui des milliers.
[I-141]
Examinons maintenant comment il se fait que chacune des nombreuses ramifications de l’industrie humaine naisse d’ellemême, dans le plus opportun, sauf toujours bien entendu l’action des causes perturbatrices de l’ordre économique.
Nous venons de dire qu’une industrie ne peut naître qu’à la condition de posséder un débouché, c’est à dire à la condition que ses produits soient assez demandés pour que leur prix courant s’élève au niveau de leurs frais de production augmentés d’une part proportionnelle de produit net. C’est seulement alors, en effet, qu’on peut en entreprendre la production avec avantage pour soi, avec utilité pour autrui. Si on l’entreprend plus tôt, qu’arrivera-t-il? Que l’on n’obtiendra pas de cette denrée un prix suffisant pour couvrir ses frais de production augmentés d’une part proportionnelle de produit net, c’est à dire qu’il y aura perte à la produire. Qu’est-ce que cela signifiera? Cela signifiera que cette denrée est moins utile que les autres, puisque les consommateurs ne consentent pas à s’imposer pour l’obtenir des sacrifices proportionnés à ceux qu’ils s’imposent pour se procurer celles-ci. Moins elle sera utile, moins haut s’élèvera son prix, en sorte que plus on devancera l’époque où il deviendra opportun de la produire, plus considérable sera la perte que l’on éprouvera en la produisant.
Cette époque ne pourra non plus être dépassée, au moins d’une manière sensible. Supposons, en effet, qu’une denrée non encore produite vienne à obtenir un débouché, supposons qu’elle vienne à être assez demandée pour que son prix dépasse ses frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net, qu’arrivera-t-il? Que la production de cette denrée devenant plus avantageuse que celle de tout autre, on la [I-142] produira de préférence, et que l’excitation sera d’autant plus vive que l’époque où l’on pouvait commencer à la produire utilement s’éloignera davantage, car son prix s’élèvera progressivement à mesure qu’elle sera plus demandée sans être encore offerte.
Si l’on se rend bien compte de ce phénomène économique, on se convaincra, comme nous l’avons remarqué ailleurs [15] , qu’il n’est nullement nécessaire que le gouvernement inter vienne pour provoquer l’établissement de n’importe quelle branche de la production. S’il intervient pour produire une denrée, [I-143] avant que cette denrée soit assez demandée pour que son prix s’élève au niveau de ses frais de production augmentés d’une part proportionnelle de produit net, il causera une perte à la société et son intervention sera nuisible. S’il intervient pour la produire, après que la production en est devenue suffisamment avantageuse, son intervention sera au moins inutile.
Quelques-uns affirment cependant qu’il peut être utile de hâter ou de reculer, voire même d’ajourner indéfiniment l’époque où une industrie prendrait naissance, soit en la subventionnant [I-144] de manière à couvrir tout ou partie du montant de ses frais de production et en créant ainsi à ses produits un débouché artificiel, aux dépens des débouchés de tous les autres produits; soit, au contraire, en renchérissant ou même en interdisant la production nouvelle, de manière à retarder autant que possible l’époque de son éclosion naturelle. Ce genre d’intervention, dont nous aurons à discuter le mérite lorsque nous nous occuperons de la consommation, s’appuie sur une proposition dont la vérité devient de jour en jour plus contestable, [I-145] savoir que les gouvernés sont moins aptes que le gouvernement à discerner ce qui leur est utile.
Mais en laissant à part la question de la légitimité ou de l’utilité des divers besoins qui se manifestent dans l’homme, nous pouvons affirmer que la production tend toujours, d’elle-même, à se mettre en harmonie avec eux; nous pouvons affirmer qu’aussitôt qu’une chose non encore produite acquiert une utilité proportionnée à celle des choses déjà produites, elle ne tarde pas à être offerte aux consommateurs, car les agents productifs sont attirés dans cette nouvelle direction, avec d’autant plus de force que le produit est plus demandé, c’est à dire qu’il a acquis plus d’utilité.
Sous le régime de la production divisée comme sous le régime de la production isolée, l’éclosion des différentes branches de l’industrie humaine tend donc à s’opérer toujours conformément aux besoins du consommateur et aux ressources dont il dispose pour les satisfaire, c’est à dire dans le temps le plus utile.
II. Chacune des branches de la production s’établit-elle toujours dans le lieu, sous la forme et dans les conditions les plus utiles?
Quand vous portez vos regards sur la carte économique du monde, vous vous a percevez au premier coup d’œil que chaque contrée ne produit pas indifféremment toutes choses; vous vous apercevez que la production a sa distribution topographique comme elle a son développement chronologique. Ainsi, le blé ne croît guère que dans les régions tempérées, le riz exige un climat plus chaud, le café, le coton, les épices ne peuvent être produits que sous les latitudes les plus basses. Il en est de même pour les minéraux. Chaque région du globe a ses gisements particuliers de minéraux comme elle a ses gisements [I-146] d’animaux et de plantes. Enfin, si l’on étudie la race humaine dans les différentes contrées du globe, on se convaincra que les facultés dont elle est pourvue peuvent être assujetties aussi à un classement topographique. Il y a certainement une relation qui nous échappe entre la formation du règne minéral et celle des deux autres règnes; il y a des rapports mystérieux qui unissent les minéraux, les plantes et les animaux et qui déterminent leur distribution. En tous cas, le coup d’œil le plus superficiel jeté sur notre globe suffit pour démontrer que tous les genres de production ne peuvent s’établir en tous lieux.
Ces conditions de lieu ne se manifestent pas seulement de contrée à contrée; elles s’observent encore dans le choix des localités où chaque industrie établit ses principaux foyers. Ainsi la plupart des industries de luxe se sont concentrées à Paris, sauf l’industrie de la soie dont le foyer est à Lyon. En Belgique, la production du drap s’est concentrée à Verviers et celle du coton à Gand. Cette localisation industrielle ne s’est pas opérée d’une manière arbitraire. Des causes naturelles, résidant dans le climat, dans le gisement des matières premières et des facultés industrielles des populations, déterminent chacune des branches de la production à se caser dans telle localité plutôt que dans telle autre. Des causes artifielles interviennent aussi pour déterminer la localisation des industries parfois à contresens de la nature.
On peut affirmer, d’une manière générale, que toutes les industries tendent à se localiser dans les endroits où les difficultés de la production sont les moins considérables, où la production est la plus économique. Il en est ainsi, soit qu’elle se trouve placée sous le régime du monopole, soit qu’elle se développe sous la loi de la concurrence.
[I-147]
Dans le premier cas, les producteurs peuvent s’attribuer, en grande partie, les bénéfices des progrès qu’ils réalisent. Or, se placer dans une localité où la production est plus facile qu’ailleurs, n’est-ce pas réaliser un progrès? Les producteurs se trouvent ainsi excités, même sous le régime du monopole, à se placer dans les endroits les plus favorables à l’exercice de leur industrie.
Dans le second cas, savoir sous le régime de la concurrence, le prix des choses tend irrésistiblement à se mettre au niveau des difficultés de la production, dans les endroits où elle est la plus économique. Il en résulte que les producteurs placés dans des localités peu favorables ne peuvent obtenir un prix suffisant pour couvrir leurs frais. Cela étant, ils finissent par être dépouillés peu à peu des éléments de production dont ils disposent et par cesser de produire. Sous ce régime, les producteurs se trouvent dont excités, bien plus énergiquement encore que sous le régime du monopole, à se fixer dans les localités les plus favorables à l’exercice de leur industrie. En effet, dans le cas du monopole, c’est uniquement l’appât d’un supplément de bénéfice qui les y provoque; dans le cas de la concurrence, ils y sont tenus sous peine de mort industrielle.
Si aucun obstacle ne s’était opposé depuis l’origine des sociétés à la bonne distribution topographique de la production, il est présumable qu’après une foule de tâtonnements et d’écoles, ses différentes branches auraient fini par se localiser de la manière la plus conforme à la distribution des ressources particulières du sol et du climat, comme aussi au génie particulier des populations.
Malheureusement cette distribution économique de la production a rencontré des obstacles de tous genres. Elle en a [I-148] rencontré dans la nature, elle en a rencontré aussi dans les hommes.
La difficulté naturelle des communications a été jusqu’à présent le principal obstacle à une bonne distribution topographique de la production. Cette difficulté inhérente à l’imperfection ou à l’insuffisance originaire des moyens de transport, a permis à certaines industries de s’établir dans des localités naturellement peu favorables et de subsister, ainsi placées, sous la protection de l’obstacle des distances.
D’autres causes, provenant des passions ou des mauvais calculs de l’homme, telles que la guerre et la prohibition, ont agi encore pour entraver la distribution économique de la production. Voici une comparaison qui pourra vous montrer, je pense, avec une certaine clarté, de quelle manière elles ont agi.
Il y a un fait qui doit vous avoir frappés, car vous pouvez l’observer à Bruxèlles mieux que partout ailleurs, c’est la manière incommode et anti-économique dont la plupart des anciennes villes sont bâties; c’est la mauvaise situation dans laquelle elles sont placées. Bruxelles, par exemple, est bâti sur le versant d’une colline. La partie supérieure de la ville est sur un plateau, la partie inférieure est dans un marais. Les habitants de Bruxelles passent leur vie à monter et à descendre. Si l’on évaluait la force et le temps qui sont perdus, les matériaux qui sont usés dans ces montées et dans ces descentes continuelles, en d’autres termes, si l’on supputait ce que Bruxelles a perdu, depuis son origine, à n’être pas bâti sur un terrain plat, on arriverait certainement à un total énorme. Une autre particularité caractérise encore les anciennes villes, c’est l’étroitesse incommode et insalubre des rues. Cependant, si l’on examine [I-149] les environs de ces villes bâties sur le flanc des montagnes et resserrées dans une étroite enceinte, on apercevra, le plus souvent, des plaines magnifiques, offrant un choix d’emplacements vastes et commodes pour l’établissement d’une cité. Enfin, si l’on visite un pays neuf, les États-Unis par exemple, on remarquera que les habitants choisissent de préférence pour bâtir leurs villes non les montagnes, mais les plaines; on remarquera aussi que l’espace n’est pas épargné dans les villes d’Amérique que les places et les squares y abondent et que les rues y ont toute la largeur désirable.
D’où proviennent ces différences dans le choix de l’emplacement des villes et dans la manière de les bâtir? Devons-nous croire que nos ancêtres préféraient les montagnes aux plaines et les rues étroites aux rues larges? Devons-nous croire qu’ils préféraient ce qui est incommode et malsain à ce qui est commode et sain? Nullement. Ce n’était point par goῦt qu’ils se logeaient sur le flanc des montagnes et dans des rues étroites et malsaines; c’était par nécessité. Ils y étaient contraints par la guerre.
A l’époque où le plus grand nombre de nos anciennes villes ont été bâties, on ne trouvait de sécurité nulle part. Partout, le citoyen paisible courait incessamment le risque d’être volé ou assassiné. Au moyen âge, par exemple, l’insécurité était universelle. Les conquérants barbares s’étaient établis dans les endroits les plus inaccessibles; ils y avaient bâti des châteaux forts, et ils s’élançaient de ces nids de vautours sur les contrées avoisinantes pour les piller ou les rançonner. Trop faibles pour leur résister, les victimes de leurs déprédations songèrent alors à composer régulièrement avec eux comme on compose avec les bandits, dans les pays où le gouvernement est sans force. [I-150] Ils s’assurèrent contre leurs incursions et leurs pillages en leur payant un tribut. Mais comme les bandes qui ravageaient le pays étaient nombreuses, ce procédé serait devenu fort dispendieux s’il avait fallu payer un tribut à chacune. On s’adressait donc à la bande la plus forte pour obtenir sa protection contre les autres bandes. Cette protection, on l’obtenait moyennant un tribut plus ou moins élevé, selon les circonstances. Enfin, pour que la garantie fῦt plus sῦre, la protection plus efficace, les protégés se logeaient aussi près que possible de leurs protecteurs. D’ordinaire, ils s’établissaient immédiatement au dessous des châteaux forts, afin de pouvoir s’y réfugier en cas d’alerte. Ce fut ainsi que se bâtirent le plus grand nombre des villes, dont l’origine remonte au moyen âge. Les premières maisons s’élevèrent au dessous des fossés du château, et les autres s’échelonnèrent, comme en amphithéâtre, sur les gradins inférieurs. Aussitôt que les habitants se trouvèrent réunis en nombre suffisant, ils environnèrent leur cité de murailles pour compléter leur système de défense.
Quand on se rend compte des nécessités du temps, on comprend aussi pourquoi les rues étaient si étroites. C’est que les murailles avaient été bâties à une époque où les habitants, encore en petit nombre, resserraient, autant que possible, leurs lignes de défense. Mais, à mesure que la population s’accroissait, il fallait plus de place pour la loger. Que faisait-on pour résoudre ce problème? On augmentait la hauteur des maisons et l’on diminuait la largeur des rues. On parvenait ainsi à loger un maximum de population dans l’intervalle compris entre les lignes de défense. On aurait pu, à la vérité, reculer les murs d’enceinte de la cité, mais cette opération, exigeant une dépense considérable, on la retardait autant que possible. [I-151] Une partie de la population aurait pu se loger aussi en dehors des portes, mais, dans les premiers siècles qui suivirent les grandes invasions des barbares, elle ne s’y serait pas trouvée suffisamment en sῦreté. Voilà pourquoi les populations s’entassaient sur le flanc des montagnes au lieu de se loger commodément dans les plaines. Ce n’était point par goῦt, c’était par nécessité.
Cependant, la sécurité s’est progressivement accrue. La féodalité a disparu et la guerre avec elle, du moins dans l’intérieur de chaque pays. Alors, qu’est-il arrivé? C’est que la popution urbaine a tendu à se déplacer, c’est qu’elle a choisi des emplacements plus commodes et plus sains que ceux où le soin de sa sécurité l’obligeait d’abord à se confiner. La population des villes hautes est généralement descendue dans les plaines avoisinantes et elle y a bâti les villes basses. Les faubourgs doivent leur origine à ce progrès de la sécurité, qui permettait aux hommes industrieux et paisibles de vivre désormais en dehors d’une enceinte fortifiée [16] .
Ce mouvement de déplacement de la population des anciennes [I-152] villes s’est, du reste, opéré lentement, car les maisons sont des capitaux durables que leurs propriétaires ne se résignent pas aisément à abandonner, et qu’ils louent à vil prix plutôt que de les démolir; mais c’est un mouvement universel. Nos villes tendent de plus en plus à quitter les versants des montagnes ou des collines pour s’épandre largement dans les plaines, et ce mouvement s’opère, le plus souvent, en dépit des résistances des administrations municipales qui s’efforcent de “protéger” les vieux quartiers aux dépens des nouveaux.
Vous voyez quelle influence considérable la gnerre a exercée sur “l’assiette” des anciennes villes. Elle n’en a pas exercé une moindre sur l’assiette de la production.
Lorsque la guerre était l’état normal des sociétés, les producteurs, en choisissant un emplacement pour leur industrie, avaient égard, avant tout, au degré de sécurité qu’il pouvait leur offrir. C’était la condition principale. La difficulté naturelle des communications,—difficulté que la guerre augmentait encore, — rendait d’ailleurs toute concurrence fort difficile sinon impossible.
Mais, à la longue, la guerre a cessé d’être l’état normal de la société, et l’industrie de la locomotion, dont elle enrayait les progrès, s’est rapidement développée et perfectionnée. Alors l’assiette de la production a été menacée d’une révolution analogue à celle qui vient d’être signalée dans l’emplacement des cités. Des établissements que la guerre et la difficulté naturelle des communications avaient jusqu’alors préservés de la concurrence, ont vu leur clientèle passer à d’autres établissements situés dans des conditions plus favorables, et leur ruine aurait été certaine si l’on n’avait imaginé de remplacer, à leur profit, les entraves de la guerre par celles des barrières de douanes, les [I-153] soldats par des douaniers. Le système prohibitif eut primitivement pour objet de neutraliser les effets de la paix et du développement progressif des communications internationales, au profit des établissements qui s’étaient constitués sous le régime antérieur. Il fut établi en vue d’empêcher les industries mal placées de succomber sous l’effort des concurrences que cette nouvelle situation de la société faisait surgir.
A coup sῦr, ce système était peu intelligent, car il perpétuait pour les peuples la plus grosse part des maux de la guerre. Il empêchait la production de s’établir dans la situation la plus favorable, et il faisait ainsi obstacle à l’abaissement naturel des prix. Mais s’il lésait les intérêts des masses, il favorisait, en revanche, ceux des propriétaires des fonds immobiliers servant à la production, et ces propriétaires, qui jouissaient d’une influence prépondérante dans la plupart des États civilisés, ne se firent point scrupule de faire prévaloir leurs intérêts sur ceux du reste de la nation.
De même, si les propriétaires des habitations situées sur le flanc des montagnes avaient eu le pouvoir d’empêcher les populations urbaines d’aller se loger dans les plaines, ils ne se seraient vraisemblablement point fait scrupule d’user de ce pouvoir. Ils auraient établi des douanes pour empêcher ces populations de s’épandre en dehors de l’enceinte des anciennes cités. Les habitants des villes auraient continué alors, indéfiniment, de supporter une partie des maux auxquels les soumettait l’anarchie féodale. Ils auraient continué de vivre dans des maisons bâties et entretenues à grands frais sur le flanc des montagnes, chères, incommodes et malsaines.
Telle a été l’influence du système prohibitif sur la plupart des branches de l’industrie humaine. Ç’a été de maintenir sous [I-154] un régime de paix les conditions de production et les prix d’un régime de guerre.
Mais la guerre et le système prohibitif qui la continue finiront certainement par disparaître. Lorsque la guerre aura cessé d’exister d’une manière normale, lorsqu’elle ne sera plus qu’un accident dans la vie de l’humanité, lorsque le système prohibitif aura été abandonné, la production se localisera d’ellemême de la manière la plus conforme à la nature.
Restera encore, à la vérité, la difficulté naturelle des communications qui continuera de protéger, dans une certaine mesure, les industries mal situées. Mais il ne faut pas oublier que l’application de la vapeur et de l’électricité à la locomotion est en train de révolutionner l’industrie des transports; il ne faut pas oublier que les distances s’annulent, pour ainsi dire, devant ces deux agents formidables. La protection résultant de l’obstacle des distances s’annule avec elles, et chacune des branches de la production se trouve ainsi, de plus en plus, mise en demeure de se placer dans la situation la plus économique.
Ce qui est vrai pour le temps et le lieu où se développent les différentes branches de la production ne l’est pas moins pour le mode de leur établissement, pour la forme sous laquelle elles se constituent. Ici encore rien n’est arbitraire, rien n’est “anarchique.” Les entreprises de production tendent à se constituer toujours sous la forme et dans les limites les plus utiles, eu égard aux circonstances. On conçoit encore qu’il en soit ainsi. S’il y a concurrence, les producteurs seront obligés d’adopter pour leurs entreprises les formes et les limites qui leur permettront de réduire leurs frais de production au minimum, c’est à dire les formes et les limites les plus économiques. Dans ce [I-155] cas, les consommateurs profiteront de l’abaissement de prix qui en résultera. S’il y a monopole, l’excitation à choisir les formes et les limites les plus utiles sera moindre, et il arrivera fréquemment sous ce régime que les entreprises de production seront mal constituées et limitées d’une manière peu économique. Toutefois, les producteurs auront encore intérêt à choisir les formes et les limites les plus utiles, sinon par l’appréhension d’une perte, au moins par l’appât d’un bénéfice, car ils tireront profit de l’économie résultant de toute modification progressive de la constitution et des limites de leur entreprise.
Cela posé, la forme et les limites des entreprises de production sont essentiellement diverses et mobiles. Telles formes et telles limites peuvent convenir à un certain genre d’entreprises et ne pas convenir à un autre; telles formes et telles limites, qui peuvent encore se trouver appropriées à certaines circonstances de temps ou de lieu, doivent être abandonnées ou modifiées lorsque ces circonstances changent ou se modifient.
Cette partie de la science économique est encore peu avancée, et nous en avons la preuve dans les discussions qu’elle suscite journellement. Ainsi, nous avons vu, à une époque récente, certaines écoles condamner, d’une manière absolue, la constitution actuelle de la production, et demander qu’on substituât aux entrepreneurs d’industrie des associations de travailleurs. L’essai de cette nouvelle forme de la production a été fait, mais il n’a réussi que d’une manière partielle et insuffisante. Est-ce à dire que le régime des “associations ouvrières” doive être condamné d’une manière irrévocable? Non, à coup sῦr, car telle forme de la production qui vaut aujourd’hui moins que telle autre, peut valoir davantage demain. Il en est de même pour les limites des entreprises de production. On [I-156] discute beaucoup, par exemple, sur la grande et sur la petite culture. L’une et l’autre ont des partisans exclusifs et fanatiques. Qu’est-il résulté cependant des débats auxquels cette question intéressante a donné lieu? C’est que dans certains pays, à certaines époques et pour certains produits agricoles, la grande culture est plus avantageuse que la petite, tandis qu’elle l’est moins dans d’autres pays, à d’autres époques et pour d’autres produits. L’essentiel, c’est de laisser pleine liberté aux producteurs de choisir les formes et les limites qui leur paraissent préférables, car ils sont irrésistiblement poussés à adopter celles qui présentent un maximum d’utilité ou d’économie, eu égard aux circonstances.
Quand on examine les formes et les limites des entreprises de production, il faut avoir égard avant tout à la situation des milieux où elles s’établissent. Cela n’empêche pas que les unes ne puissent être plus parfaites que les autres. De mème que la production acquiert chaque jour un matériel plus puissant, un personnel plus instruit et plus habile, elle s’établit aussi sous des formes et dans des limites de plus en plus économiques. Mais c’est là un progrès qui a ses conditions naturelles, et qu’on essayerait en vain d’accélérer en implantant, par exemple, de nouveaux modes d’organisation de la production dans un pays et dans un temps qui ne les comportent pas encore. C’est comme si l’on voulait remplacer la force des chevaux ou même celle des hommes par celle de la vapeur, dans un pays où les chevaux et les hommes seraient en abondance, ainsi que les aliments nécessaires pour les faire subsister, tandis que les matériaux qui entrent dans la construction des machines, le combustible qui sert à les alimenter, les connaissances indispensables pour les diriger, seraient rares. Malgré sa supériorité [I-157] intrinsèque, la machine à vapeur ne pourrait, dans de telles circonstances, soutenir la concurrence de la bête de somme ou de l’homme de peine. La même observation s’applique aux formes et aux limites de la production. C’est pour n’y avoir pas pris garde que certains socialistes ont réclamé d’une manière si peu opportune la substitution immédiate et générale des associations ouvrières aux entrepreneurs d’industrie, et que certains économistes ont commis la faute de se faire les avocats exclusifs de la grande ou de la petite culture.
En résumé, soit qu’on observe les entreprises de production, au point de vue du temps et du lieu où elles s’établissent, de la forme sous laquelle elles se constituent, des limites dans lesquelles elles se développent, on demeure frappé du même phénomène, savoir, qu’elles ont une irrésistible tendance à s’organiser toujours de la manière la plus utile. Cette tendance existe dans la production divisée au même degré que dans la production isolée. Dans l’une comme dans l’autre, c’est l’intérêt du producteur qui agit pour la faire naître; seulement, dans la production isolée, cet intérêt agit sans aucun intermédiaire, tandis que, dans la production divisée, il agit à l’aide du mécanisme naturel de la formation des prix.
Nous verrons dans la prochaine leçon que ce même mécanisme détermine, sous le régime de la spécialisation des industries et de l’échange, la proportion utile des différentes industries et des différents produits, en d’autres termes, l’équilibre de la production avec la consommation.
[I-158]
SIXIÈME LEÇON↩
l’Équilibre de la production et de la consommation
Importance du problème de l’équilibre de la production et de la consommation. — Comment il se résout sous le régime de la production isolée. — Que M. de Sismondi le croyait insoluble, sous le régime de la production divisée, aussi longtemps qu’elle demeurerait abandonnée à elle-même. — Apologue de M. de Sismondi. — Comment ce problème se résout par l’action de la loi qui préside à la formation des prix. — Causes perturbatrices qui font obstacle à l’équilibre de la production et de la consommation. — L’inconstance des saisons; — le défaut ou l’insuffisance de la connaissance du marché; — le monopole. — Que ces causes perturbatrices s’atténuent et disparaissent peu à peu sous l’influence de la loi de la formation des prix. — Que l’anarchie est un fait exceptionnel dans la production; que c’est l’ordre qui est la règle.
Il nous reste à examiner un point des plus importants, savoir si chacune des branches de la production se développe toujours dans la proportion la plus utile, c’est à dire de manière à pourvoir, ni plus ni moins, au genre de consommation en vue duquel elle est établie.
[I-159]
Je dis que ce point est des plus importants. Il ne suffit pas, en effet, de savoir de combien la spécialisation des industries et des fonctions productives a augmenté la masse des richesses produites; il ne suffit pas non plus de savoir que c’est au moyen de l’échange que des hommes qui passent leur vie, celui-là à labourer la terre et à semer du grain, celui-ci à façonner du fil ou des étoffes de coton, cet autre à fabriquer des têtes d’épingles, se procurent les choses nécessaires au maintien de leur existence; il importe encore et, par dessus tout, de savoir comment est régularisée la production ainsi spécialisée, divisée; comment il se fait que l’on ne produise point incessamment trop d’une denrée et trop peu d’une autre; qu’il n’y ait point ici surabondance, là disette des choses nécessaires à la consommation.
Si le mécanisme de la spécialisation des industries et des fonctions productives, de la division du travail et de l’échange n’existait point, si chaque homme produisait lui-même isolément les choses qui lui sont nécessaires, le problème du développement utile de la production ou de l’équilibre de la production et de la consommation ne se poserait point. Nous avons vu plus haut, en effet, que chacun emploierait dans ce cas les éléments de production dont il disposerait, à créer les choses qui lui seraient le plus utiles. En d’autres termes, comme producteur, chacun s’appliquerait à créer et à offrir les choses qu’il demanderait le plus comme consommateur. Ainsi, l’homme isolé produirait d’abord des aliments pour son usage, il se fabriquerait ensuite des vêtements, se construirait un abri, etc., toutes ces choses dans l’ordre marqué parleur degré d’utilité, ou, ce qui revient au même, par l’intensité du besoin auquel elles seraient destinées à pourvoir. Chacun proportionnerait exactement, [I-160] sauf toutefois les erreurs de calcul et les écarts provenant de l’inconstance des saisons, sa production à sa consommation. Seulement, comme les moyens de production dont chacun pourrait disposer seraient fort limités, comme la puissance productive de chacun serait très faible, l’homme ne pourrait satisfaire, même dans les régions les plus favorisées du ciel, qu’une faible portion de ses besoins et encore d’une manière bien incomplète.
Dans le régime économique qui s’est successivement substitué à celui de la production isolée, régime fondé sur la division du travail et l’échange, la puissance productive de chacun se trouvant accrue dans une proportion énorme, l’homme peut donner à ses besoins une satisfaction beaucoup plus ample. Mais comment le problème de l’équilibre de la production et de la consommation est-il résolu sous ce nouveau régime? Comment se fait-il que les milliers d’objets différents qui entrent dans la consommation d’un seul individu, et qu’une multitude d’hommes placés souvent à des distances considérables des lieux de consommation ont concouru à produire, comment se fait-il que ces objets puissent être produits dans la proportion utile? Comment se fait-il que l’on ne produise pas journellement des quantités trop fortes ou trop faibles des nombreuses denrées qui entrent dans la consommation de l’homme?
Parmi les économistes qui ont principalement tourné leur attention vers cet intéressant problème, M. de Sismondi doit être cité en première ligne. M. de Sismondi ne pensait pas que l’équilibre pῦt s’établir de lui-même, par une impulsion naturelle, entre la production et la consommation. Effrayé du développement extraordinaire et d’ailleurs un peu artificiel qui avait été donné, de son temps, à la production manufacturière, [I-161] il se demanda si l’on ne produisait pas trop, et il exprima ses appréhensions sous la forme d’un apologue des plus ingénieux:
Nous nous souvenons d’avoir entendu conter dans notre enfance, qu’au temps des enchantements, Gandalin, qui logeait un sorcier dans sa maison, remarqua qu’il prenait chaque matin un manche à balai, et que disant sur lui quelques paroles magiques il en faisait un porteur d’eau qui allait aussitôt chercher pour lui autant de seaux d’eau à la rivière qu’il en désirait. Gandalin, le matin suivant, se cacha derrière une porte, et, en prêtant toute son attention, il surprit toutes les paroles magiques que le sorcier avait prononcées pour faire son enchantement; il ne put entendre cependant celles qu’il dit ensuite pour le défaire. Aussitôt que le sorcier fut sorti, Gandalin répéta l’expérience; il prit le manche à balai, il prononça les mots mystérieux, et le manche à balai porteur d’eau partit pour la rivière et revint avec sa charge, il retourna et revint encore, une seconde, une troisième fois; déjà le réservoir de Gandalin était plein d’eau et inondait son appartement. C’est assez, criaitil, arrêtez; mais l’homme-machine ne voyait et n’entendait rien; insensible et infatigable, il aurait porté dans la maison toute l’eau de la rivière. Gandalin, au désespoir, s’arma d’une hache, il en frappa à coups redoublés son porteur d’eau insensible, il voyait alors tomber sur le sol les fragments du manche à balai, mais aussitôt ils se relevaient, ils revêtaient leur forme magique et couraient à la rivière. Au lieu d’un porteur d’eau, il en eut quatre, il en eut huit, il en eut seize; plus il combattait, plus il renversait d’hommes-machines, et plus d’hommes-machines se relevaient pour faire, malgré lui, son travail. La rivière tout entière aurait passé chez lui, si heureusement le sorcier n’était revenu et n’avait détruit le charme.
L’eau cependant est une bonne chose, l’eau, non moins que le travail, non moins que le capital, est nécessaire à la vie. Mais on peut avoir trop, même des meilleures choses. Des paroles magiques prononcées par [I-162] des philosophes, il y a bientôt soixante ans, ont remis le travail en honneur. Des causes politiques, plus puissantes encore que ces paroles magiques, ont changé tous les hommes en industriels; ils entassent les productions sur les marchés bien plus rapidement que les manches à balai ne transportaient l’eau, sans se soucier si le réservoir est plein. Chaque nouvelle application de la science aux arts utiles, comme la hache de Gandalin, abat l’homme-machine que des paroles magiques avaient fait mouvoir, mais pour en faire relever aussitôt deux, quatre, huit, seize, à sa place; la production continue à s’accroître avec une rapidité sans mesure. Le moment n’est-il pas venu, le moment du moins ne peut-il pas venir, où il faudra dire: c’est trop [17]
Les socialistes ont, comme chacun sait, largement exploité cet apologue. Ils ont prétendu que la société, abandonnée à elle-même, ignorait les paroles qu’il fallait dire pour équilibrer la production avec la consommation, et qu’à mesure que le progrès industriel rendait la production plus facile et plus abondante, la société se trouvait plus exposée à une “ondation de produits.” Cette appréhension est-elle fondée? N’y a-t-il aucune loi régulatrice qui serve à proportionner la production aux besoins de la consommation, comme faisaient les paroles du sorcier pour arrêter la course du manche à balai? Nous allons voir que cette loi régulatrice n’est autre que la loi d’équilibre qui préside à la formation des prix.
Chaque homme engagé dans le mécanisme de la production divisée demande les choses dont il a besoin, à commencer par celles qui lui sont le plus nécessaires. Voilà donc une multitude de choses demandées. Mais comme on ne peut demander [I-163] une chose sans en offrir une autre en échange, voilà, du même coup, une multitude de choses offertes, ou, si l’on veut, une multitude de demandes et d’offres. Or quel est l’intérèt de chacun des individus engagés dans le mécanisme de la production divisée? C’est d’obtenir en échange de la chose qu’il offre, la plus grande quantité possible des choses qu’il demande; c’est, en conséquence, d’offrir les denrées à la fois les plus utiles et les plus rares, parce que le pouvoir d’échange de ces denrées ou leur valeur comparée à celle des autres est à son maximum.
Cela posé, nous avons vu qu’il suffit d’apporter au marché ou d’en retirer une faible quantité d’une denrée pour en abaisser ou en élever considérablement la valeur. Que résulte-t-il de là? C’est que chaque producteur se trouve intéressé au maximum à produire et à mettre au marché les choses les plus utiles et les plus rares comparativement aux autres, parce que ce sont celles-là qui ont le plus de valeur, et qui peuvent, en conséquence, lui procurer la plus forte quantité possible des autres choses. Chacun est donc intéressé toujours à appliquer les éléments de production dont il dispose, à l’industrie la plus utile à la société, c’est à dire à celle dont les produits sont à la fois le plus demandés et le moins offerts. Chacun est intéressé aussi à ne jamais mettre au marché une quantité trop considérable de ces produits, sous peine d’en voir diminuer, de la manière la plus dommageable pour lui, le pouvoir d’échange.
Tous les produits nécessaires à la consommation sont ainsi apportés au marché dans la proportion la plus utile, ou, s’ils ne le sont point, ils tendent continuellement à l’être. En effet, que l’un de ces produits ne soit point apporté en quantité suffisante, [I-164] eu égard au besoin qu’on en a, et l’on verra aussitôt sa valeur hausser en raison composée de son utilité et de sa rareté. Chacun sera, en conséquence, intéressé à produire cette chose de préférence à toute autre, jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli. Que l’on mette, en revanche, au marché, une quantité trop considérable d’un produit, et l’on verra la valeur de ce produit baisser également en raison composée, en sorte qu’on sera intéressé de plus en plus à en diminuer la production. C’est ainsi que se résout de lui-même, par l’action de la loi de la formation des prix, le problème de l’équilibre de la production et de la consommation.
Différentes causes agissent cependant pour empêcher cet ordre naturel de s’établir ou pour le troubler lorsqu’il est établi. Citons-en quelques-unes.
I. L’inconstance des saisons qui rend incertains et inégaux les résultats de la production agricole.
Cette cause, dont l’importance est si considérable, agit, comme nous l’avons vu, sur la production isolée aussi bien que sur la production divisée. Vous vivez seul et vous consacrez avant tout une portion des forces et des éléments dont vous disposez à produire les substances nécessaires à votre consommation. Guidé par votre intérêt, vous vous efforcez de proportionner cet emploi de vos forces productives à votre besoin de nourriture. Vous vous efforcez de n’y consacrer que juste le nécessaire, ni trop ni trop peu: ni trop, afin de consacrer le restant de vos forces et de votre temps à la satisfaction de vos autres besoins: ni trop peu, afin de ne pas vous exposer à manquer d’aliments. Mais l’instabilité des saisons vient déranger toutes vos prévisions. Si la saison est favorable, il se pourra que votre récolte dépasse du tiers ou de la moitié la quantité [I-165] sur laquelle vous aviez compté. Si la saison est mauvaise, votre récolte pourra demeurer, au contraire, du tiers ou de la moitié au dessous de vos prévisions. Dans le premier cas, vous aurez fait, sans le vouloir à la vérité, un mauvais emploi d’une portion de vos forces productives, puisqu’en consacrant une moindre portion de ces forces à votre production alimentaire, vous auriez obtenu toute la quantité d’aliments qui vous est nécessaire. Dans ce cas, il y aura déperdition d’aliments, à moins que vous ne puissiez conserver jusqu’à l’année suivante le surplus de votre récolte, ce qui vous permettra de réduire alors d’autant votre production alimentaire, au profit de la satisfaction de vos autres besoins. Si la saison est mauvaise, le mal aura plus de gravité encore, car vous manquerez des denrées nécessaires à la conservation de votre existence, et vous serez condamné à subir toutes les horreurs de la faim.
Voyons maintenant comment agit cette cause perturbatrice dans la production divisée. Si la saison est favorable, si la récolte est surabondante, si la quantité des substances alimentaires produites dépasse la proportion utile, leur valeur baisse. Elle baisse, et chose assez curieuse, mais qui n’est qu’un effet de la loi des quantités et des prix, les producteurs des denrées agricoles en mettant au marché plus d’aliments n’obtiennent pas en échange autant des autres denrées que si la proportion utile n’avait point été dépassée. Ils subissent, en conséquence, une perte, un dommage, et l’économie entière de la société s’en trouve plus ou moins troublée.
Si la saison est mauvaise, au contraire, si la quantité des denrées alimentaires produites n’atteint pas la proportion utile, leur valeur hausse. Elle hausse, à moins que le déficit ne puisse être comblé par l’excédant des récoltes des années précédentes [I-166] on des autres contrées, et les producteurs de denrées agricoles obtiennent en échange une proportion plus forte de toutes les autres denrées que s’il n’y avait pas eu déficit. Le dommage retombe, en ce cas, sur les consommateurs des produits agricoles qui sont obligés de s’imposer plus de sacrifices pour se procurer une quantité insuffisante d’aliments qu’ils ne faisaient auparavant pour s’en procurer une quantité suffisante. Le mal s’étend et se ramifie alors à l’infini, et parfois des classes nombreuses en sont victimes.
Le problème à résoudre consisterait à déterminer, au moins d’une manière approximative, la loi de variation des récoltes, afin de pouvoir connaître, en moyenne, la surface à mettre en culture pour obtenir des aliments dans la proportion utile. Que si cette loi ne pouvait être déterminée, au moins faudrait-il pouvoir toujours reporter aisément les excédants de récoltes des pays et des années où il y a surabondance vers les pays et les années où il y a disette. Jusqu’à nos jours, l’imperfection des procédés employés pour la conservation des blés et des autres substances alimentaires, la difficulté des communications, les lois-céréales et les préjugés hostiles au commerce des blés ont rendu difficiles et précaires les opérations que nous venons de signaler. Mais des progrès notables ont été réalisés sous ces divers rapports, et il y a apparence que les denrées alimentaires pourront être de plus en plus aisément mises au marché dans la proportion utile.
II. Le défaut ou l’insuffisance de la connaissance du marché.
Cette deuxième cause perturbatrice de l’ordre économique ne se manifeste que sous le régime de la production divisée. Lorsque les hommes produisent isolément les choses qui leur sont nécessaires, rien n’est plus facile à chacun que de connaître [I-167] son marché et d’organiser sa production en conséquence. Il lui suffit pour cela de passer ses besoins en revue, de rechercher quels produits sont nécessaires pour les satisfaire et en quelles quantités. Ayant acquis ainsi la connaissance de son marché, il organise sa production de manière à satisfaire aussi complétement que possible les besoins qui le sollicitent, à commencer par les plus urgents. Aussi longtemps que ses besoins et ses moyens de production demeurent les mêmes, l’assiette de sa production ne change point. L’inconstance des saisons ou l’intervention de quelque fléau, d’une maladie des plantes alimentaires, d’une inondation, etc., seule peut mettre l’approvisionnement de l’homme isolé en désaccord avec sa demande. soit que la production de certaines denrées vienne à dépasser ses prévisions, soit qu’elle demeure en deçà.
Nous disons que l’assiette de la production demeure la même, aussi longtemps que les besoins de l’homme isolé et les moyens dont il dispose pour produire ne changent point. Mais elle se modifie dès que l’un ou l’autre de ces deux éléments vient à changer. Si les besoins se modifient, les moyens de production demeurant les mêmes, il faut que le producteur réduise un genre de production pour en créer ou en augmenter un autre. Dans ce cas, la masse de la production demeurera la même, la distribution ou l’assiette seule en sera changée. Si les moyens de production s’accroissent par suite d’un progrès quelconque, si l’acquisition d’une force nouvelle, l’emploi plus habile et plus économique d’une force existante permettent au producteur de créer une quantité plus considérable de certaines denrées sans y consacrer plus de temps, la production s’en trouvera à la fois accrue et modifiée. Elle se trouvera accrue de toute la quantité supplémentaire que l’acquisition de la nouvelle force permettra [I-168] de produire. Elle se trouvera modifiée parce que la force acquise ne sera pas, selon toute apparence, consacrée à augmenter la quantité d’un seul produit. Éclaircissons ceci par un exemple. Un producteur que nous supposons isolé a besoin de chaussures et il en fabrique chaque année deux paires pour son usage, moyennant une certaine dépense de temps et de forces productives. Il découvre un procédé qui lui permet d’économiser la moitié du temps et des forces qu’il employait à ce genre de production, ou, ce qui revient au même, qui met à sa disposition un supplément de temps et de forces. Qu’en va-t-il faire? En profitera-t-il pour fabriquer quatre paires de chaussures au lieu de deux? Cela n’est pas probable, en admettant même qu’il puisse user ces quatre paires de chaussures en une année. Pourquoi? Parce qu’il n’éprouve pas seulement le besoin de se chausser; parce qu’il est sollicité encore par une foule d’autres besoins qui ne peuvent ètre satisfaits qu’imparfaitement, à cause de l’insuffisance des moyens de production dont il dispose. Qu’il vienne à acquérir un supplément de forces productives, et il l’emploiera à donner une satisfaction plus complète à l’ensemble des besoins qui le sollicitent, en commençant par les plus intenses. Il se peut que le besoin de se chausser soit du nombre de ceux-ci. Dans ce cas, le producteur isolé en fabriquera probablement une paire de plus, puis il consacrera à la satisfaction de ses autres besoins, le restant de la force supplémentaire qu’il aura acquise. Sa production se sera donc accrue, et, du même coup, la proportion existante entre les éléments qui la composent se sera modifiée.
Mais soit que les besoins et les moyens de production de l’homme isolé demeurent les mêmes, soit qu’ils se modifient, il peut toujours aisément connaître sa consommation, c’est à dire [I-169] la nature et l’étendue du débouché qu’il s’offre à lui-même et organiser sa production en conséquence.
Dans la production divisée, le marché est beaucoup plus difficile à connaître, et les modifications qu’il subit amènent des complications inconnues dans la production isolée.
Que le marché soit plus difficile à connaître, cela se conçoit sans peine. Au premier abord, il semblerait même impossible d’apprécier d’avance ce qu’une population consommera d’une certaine denrée, et de déterminer, en conséquence, le débouché qu’elle offrira aux producteurs de cette denrée. L’expérience atteste cependant que cela se peut, au moins d’une manière approximative. Mais à mesure que la production s’est développée, la “connaissance du marché” n’en est pas moins devenue de plus en plus difficile.
Aux époques où l’industrie était encore dans l’enfance, la connaissance du marché pouvait être assez aisément obtenue. Alors, en effet, le monde se trouvait morcelé en une multitude de petits marchés, séparés complétement les uns des autres, soit par l’obstacle des distances, soit par d’autres obstacles naturels ou artificiels. Ces obstacles empêchaient la plupart des denrées d’être transportées au delà d’un rayon de consommation fort limité. Dans l’antiquité et dans le moyen âge, par exemple, les marchandises précieuses, celles qui renferment une valeur considérable sous un petit volume, l’or, l’argent, les pierreries, les parfums, les étoffes de luxe, etc., seules sont transportées à de longues distances. La guerre s’ajoute encore à l’obstacle naturel des distances pour limiter le rayon des échanges. En outre, dans chaque marché, la production est limitée par voie réglementaire. Que résulte-t-il de là? C’est, que, d’une part, le marché se trouvant naturellement resserré, [I-170] il est facile d’en apprécier l’étendue et de proportionner toujours la production à la consommation; c’est que, d’une autre part, le nombre des producteurs qui approvisionnent le marché étant limité, ces producteurs peuvent aisément s’arranger de manière à ne jamais offrir des quantités trop considérables de leurs denrées. Souvent même, ils se coalisent pour en mettre au marché moins que la proportion nécessaire, et les consommateurs sontalors victimes des disettes artificielles occasionnées par le monopole.
Mais peu à peu les barrières naturelles ou artificielles qui séparaient les différents marchés et qui obstruaient l’entrée de la plupart des professions ont été renversées. Des inventions merveilleuses ont aplani, en grande partie, l’obstacle des distances, et les progrès de la civilisation, en affaiblissant les passions guerrières, ont augmenté et consolidé les relations internationales. Les marchés de consommation sont devenus de plus en plus vastes et ils ont cessé, en même temps, d’être le domaine exclusif d’un petit nombre de producteurs privilégiés.
Que cette grande transformation économique ait eu des résultats bienfaisants, cela ne saurait être sérieusement contesté. Sous le régime de la production morcelée et réglementée, chaque homme se trouvait réduit à consommer les denrées produites aux environs de sa demeure. Quelques-unes seulement, et en bien petite quantité, lui parvenaient des contrées éloignées. Chacun ne pouvait donc profiter que dans une faible mesure des bienfaits de la division du travail. Sous le régime nouveau, au contraire, chacun peut faire entrer dans sa consommation des denrées produites sur tous les points du globe et augmenter ainsi, d’une manière presque indéfinie, la somme de ses jouissances.
[I-171]
En revanche, sous ce nouveau régime, le problème de l’équilibre de la production et de la consommation est devenu bien plus difficile à résoudre, et il semble même, au premier abord, que la solution en soit impossible. Il semble que sous un régime de libre concurrence universelle, l’anarchie doive régner en permanence dans l’arène de la production. Comment, en effet, parvenir à connaître l’étendue d’un marché désormais illimité? Et quand même on y parviendrait, comment empêcher l’approvisionnement de déborder la demande, puisque l’industrie est libre, puisque chacun peut employer désormais, comme bon lui semble, les forces productives dont il dispose? Ne doit-il pas arriver, à chaque instant, sous ce régime, que l’on produise trop d’une denrée, trop peu d’une autre; qu’il y ait ici pléthore, là disette, et que l’arène de la production soit, en conséquence, incessamment bouleversée par les crises les plus désastreuses?
Il ne faut point se le dissimuler, les plaintes que formulait à cet égard M. de Sismondi n’étaient point dénuées de fondement. Des convulsions redoutables ont accompagné l’avènement du régime de la libre concurrence. On a vu les hommes industrieux encombrer certaines branches de la production et porter des masses de produits dans des marchés déjà surchargés. On a vu, chose plus funeste encore! les travailleurs affranchis des entraves de la servitude se multiplier à l’excès, sans s’enquérir de l’étendue du débonché ouvert à leur activité. On a vu des classes nombreuses, victimes de ce grand désordre de la production, tomber dans une condition plus misérable, plus abjecte que celle dont elles venaient de sortir.
Seulement, en dénonçant ces maux, d’une voix éloquente, M. de Sismondi eut le tort de les croire irrémédiablement [I-172] attachés au régime de la concurrence. Parce que le nouveau monde industriel s’enfantait au sein du chaos, il eut le tort de croire que ce nouveau monde ne serait autre chose que le chaos. Il n’aperçut point la force régulatrice qui agissait avec une puissance irrésistible pour établir l’ordre au sein de ce désordre.
A l’époque où écrivait M. de Sismondi, le marché, récemment agrandi, était rempli de confusion et de trouble. On s’y heurtait dans l’obscurité la plus profonde. L’arène de la production n’était pas éclairée ou elle l’était à peine. La publicité industrielle et commerciale venait seulement de naître.
Cette publicité, qui est devenue aussi nécessaire à notre monde industriel, depuis l’avénement de la libre concurrence, que l’éclairage au gaz peut l’être à nos villes, depuis que l’entrée de chaque rue n’est plus fermée par des chaînes, cette publicité ne pouvait se développer sous l’ancien régime. A quoi aurait-elle servi en effet? Chaque marché isolé, morcelé, était bien connu du petit nombre de producteurs qui avaient le privilége de l’approvisionner. Quant aux autres, à quoi leur aurait servi de le connaître, puisqu’il n’y pouvaient pénétrer? Des renseignements sur l’état des marchés auraient donc été alors tout à fait sans objet. Certains marchés se trouvaient, à la vérité, déjà ouverts à la concurrence, mais ils étaient peu nombreux et l’on n’y apportait point une grande variété de produits. Les industriels et les négociants pouvaient aisément se tenir au courant de la situation de ces marchés libres, au moyen de leurs correspondances particulières.
Mais lorsque les marchés sont devenus plus accessibles, grâce à la suppression ou à l’abaissement des obstacles qui les isolaient, les correspondances particulières n’ont plus suffi. Il [I-173] est devenu indispensable aux producteurs d’avoir des renseignements détaillés et précis sur la situation de tous les marchés qui leur étaient ouverts, afin de savoir dans quels endroits ils pouvaient porter leurs denrées avec le plus d’avantage. C’est alors, et pour répondre à ce besoin nouveau, que la publicité industrielle et commerciale a pris naissance. C’était d’abord une faible lumière qui éclairait à peine la foule pressée qui se précipitait dans l’arène obscure et immense de la production; mais, peu à peu, cette faible lumière a grandi, la lampe est devenue un phare, et déjà, quoiqu’elle soit encore bien insuffisante, on peut prédire le jour où, grâce au merveilleux agent que la science vient de mettre à son service, nous voulons parler de la télégraphie électrique, elle éclairera a giorno tout le vaste champ de la consommation. Ce n’est nullement une utopie de supposer que la situation des marchés agrandis et accessibles de l’industrie moderne, puisse être promptement et aisément connue de tous ceux qui sont intéressés à la connaitre, aussi promptement et aussi aisément que pouvait l’être jadis celle des marchés morcelés et privilégiés de l’industrie du moyen âge. Chaque industrie a maintement sa publicité organisée. Sans doute, cette publicité laisse encore beaucoup à désirer, surtout en ce qui concerne la plus importante des denrées, le travail; mais combien de progrès n’a-t-elle pas réalisés depuis l’époque où écrivait M. de Sismondi? Combien n’en pourra-t-elle pas réaliser encore?
Or, si la connaissance du marché peut être obtenue, dans la nouvelle phase où la production est entrée, comme elle pouvait l’être dans l’ancienne; si les producteurs peuvent apprécier, sur toute la surface du monde industriel, l’étendue des débouchés qui leur sont ouverts, l’ordre ne doit-il pas s’établir de [I-174] lui-même dans la production? Le marché de chaque denrée étant bien connu, la quantité qui est demandée de cette denrée durant un certain espace de temps pouvant être déterminée, n’arrivera-t-il pas infailliblement que cette denrée finira par être mise au marché dans la proportion utile, ni plus ni moins? Ni plus, car, par l’opération de la loi des quantités et des prix, un faible excédant amenant une dépression considérable du prix, les producteurs sont intéressés au plus haut degré à ne jamais mettre d’excédant au marché. Ni moins, car, en vertu de la même loi, un faible déficit amenant une hausse proportionnellement plus forte dans le prix, les hommes qui ont des capitaux disponibles sont intéressés à les appliquer à ce genre de production, plutôt qu’à tout autre, jusqu’à ce que l’équilibre se trouve rétabli.
III. Le monopole.
Cependant, il peut arriver, nonobstant l’action de la loi des quantités et des prix, qu’un déficit acquière un certain caractère de durée; c’est lorsqu’il y a monopole.
Les monopoles agissent invariablement pour restreindre la production en deçà de sa limite utile. Ils sont, comme nous l’avons remarqué, naturels ou artificiels. Ils sont naturels, lorsque les éléments nécessaires à un genre de production n’existent que dans une proportion trop faible pour satisfaire aux besoins de la consommation. Ils sont artificiels, lorsque certains producteurs obtiennent seuls le droit d’approvisionner un marché. Dans l’un et l’autre cas, les monopoleurs ne mettent au marché qu’une quantité insuffisante de leur denrée, et ils réalisent ainsi des bénéfices extraordinaires. Mais l’appât de ces bénéfices ne tarde pas à attirer la concurrence. S’il s’agit d’un monopole naturel, de toutes parts on s’ingénie à découvrir de [I-175] nouveaux éléments de production, qui puissent faire concurrence à ceux qui jouissent de ce monopole. S’il s’agit d’un monopole artificiel, ceux à qui ce monopole est nuisible ne manquent pas de s’agiter pour obtenir la suppression des priviléges qui le constituent. Dans les deux cas, le monopole aura d’autant moins de chances de durée qu’il occasionnera dans la consommation un déficit plus dommageable, et qu’il procurera, en conséquence, de plus gros bénéfices aux monopoleurs. Le monopole détruit, la production ne manquera pas de se remettre en harmonie avec les besoins de la consommation.
On voit, en résumé, que la loi qui préside à la formation des prix est le régulateur naturel de la production. C’est grâce à elle que la production tend à se mettre toujours en harmonie avec la consommation. Sans doute, cette harmonie est parfois troublée. Différentes causes agissent incessamment pour la rompre. Tantôt, c’est l’inconstance des saisons qui rend la production agricole insuffisante ou surabondante. Tantôt, c’est l’ignorance de la situation du marché qui rétrécit ou qui exagère, d’une manière nuisible, l’approvisionnement. Tantôt enfin ce sont des monopoles naturels ou artificiels qui occasionnent un déficit de certaines denrées. Mais ces causes perturbatrices sont énergiquement combattues par la loi des quantités et des prix. Sous l’empire de cette loi, tel est l’intérét des producteurs à ce qu’il n’y ait jamais surabondance d’une denrée, et tel est l’intérêt des consommateurs à ce qu’il n’y ait jamais déficit de cette même denrée, que la production et la consommation tendent constamment à se mettre en équilibre.
C’est ainsi que se résout de lui-même, par une impulsion naturelle, le problème de l’équilibre de la production et de la [I-176] consommation que M. de Sismondi et les socialistes après lui ont regardé à tort comme insoluble sous le régime du laisser faire. Cette solution si simple d’un problème qui paraît si compliqué n’est-elle pas véritablement admirable? Les produits les plus divers entrent dans la consommation de chacun des membres de la grande famille humaine, et ces produits sont créés sur tous les points du globe. Des nègres, des Indous, des Chinois produisent des denrées qui sont consommées par les Anglais, les Français et les Belges, et en échange desquelles ceux-ci leur fournissent d’autres denrées. Au premier abord, ne semblerait-il pas que ces échanges, qui s’opèrent à de si longues distances et parfois à de si longs intervalles, devraient être impossibles à ajuster; qu’il devrait y avoir tantôt surabondance, tantôt déficit des denrées offertes en échange? Pourtant, il n’en est rien, ou du moins les perturbations de ce genre sont l’exception, même dans les échanges à distance; c’est l’ordre qui est la règle, et cet ordre est dῦ à l’action régulatrice de la grande loi d’équilibre qui préside à la constitution des valeurs, à la formation des prix.
[I-177]
SEPTIÈME LEÇON↩
la classification et les formes de la production
De la classification généralement adoptée pour la production. — Ses défauts. — Observations de M. Dunoyer à cet égard. — Que la classification de la production concerne la statistique plutôt que l’économie politique. — Quelles industries il convient de considérer comme productives. — Que les industries qui concernent le personnel de la production ont éminemment ce caractère, que leurs produits soient matériels ou immatériels. — Démonstration de M. Dunoyer. — Quelles industries il convient de considérer comme improductives. — Des formes de la production. — Du revenu et des formes sous lesquelles il est perçu.
Sous l’impulsion de la loi générale d’équilibre qui détermine la constitution des valeurs ou la formation des prix, les différentes branches de la production ont une tendance irrésistible à naître toujours dans le temps le plus opportun, à se localiser de la manière la plus avantageuse, à s’organiser sous la forme et dans les limites les plus économiques, enfin à se développer dans les proportions requises par la consommation. C’est ainsi que la production se constitue d’elle-même, selon un ordre naturel.
[I-178]
Il ne nous reste plus maintenant, pour compléter cet aperçu général de la production des richesses, qu’à jeter un coup d’œil sur ses différentes ramifications, ainsi que sur ses divers modes d’organisation. Il ne nous reste plus, en deux mots, qu’à rechercher quelle est la classification et quelles sont les formes de la production.
La production a été généralement partagée en quatre grandes catégories: 1° l’agriculture; 2° l’industrie; 5° le commerce; 4° les professions libérales. A ces quatre catégories on peut rattacher la multitude des ramifications de l’industrie humaine.
Indiquons sommairement à quels besoins elles répondent.
L’agriculture, dans ses différentes branches, répond principalement au besoin de l’alimentation.
L’industrie répond d’une manière plus spéciale aux besoins du vêtement et du logement. Elle fournit, en outre, les matériaux et les instruments nécessaires à la plupart des branches de la production.
Les professions libÉrales ont pour objet principal de pourvoir aux besoins moraux et intellectuels de l’homme. Elles fournissent encore les procédés nécessaires à l’exercice des différentes branches de la production.
Le commerce a pour objet de mettre à la portée des consom mateurs, dans l’espace et dans le temps, les produits ou les instruments de production fournis par l’agriculture, l’industrie et certaines professions libérales.
Cette classification est toutefois fort imparfaite. Dans quelle catégorie convient-il, par exemple, de ranger l’industrie qui pourvoit à la sécurité des membres de la société? Ce n’est évidemment ni dans l’industrie proprement dite, ni dans le commerce. [I-179] C’est donc dans les professions libérales. Or n’est-il pas au moins singulier de voir l’agent de police, le gendarme et le soldat classés au nombre des individus qui exercent des arts libéraux? N’est-il pas plus choquant encore d’y voir figurer la prostituée à côté du prêtre?
M. Dunoyer a fort bien signalé les vices de la classification communément adoptée pour les différentes branches de la production. Citons quelques-unes de ses observations à cet égard.
Il y a, en premier lieu, dit-il, toute une classe de travaux, celle des industries extractives, qui est devenue beaucoup trop considérable pour qu’il soit possible de n’en pas tenir compte, et qui, en même temps, diffère trop de toutes les autres pour qu’il soit permis de la confondre avec quelque industrie que ce soit. Comment comprendre qu’on puisse omettre de parler d’une classe d’industries capables de jeter sur le marché des masses de produits comparables à celles que donnent la chasse, la pêche, l’industrie du bῦcheron, celle du carrier, celle du mineur surtout? Et, d’un autre côté, comment admettre qu’on puisse les confondre, ainsi qu’on le fait quelquefois, avec l’industrie agricole? Qu’y a-t-il de commun entre des arts qui, se bornant à extraire du sein des eaux, des bois, de la terre, les matériaux d’une multitude d’industries, n’emploient pour cela que des forces mécaniques, et un art qui s’occupe, comme le fait l’agriculture, de la multiplication et du perfectionnement des végétaux et des animaux utiles, et qui fait usage pour cela d’une force aussi spéciale, aussi peu connue, aussi délicate à manier que la vie? Peut-être vaudrait-il mieux les confondre, ainsi qu’on le fait encore, avec l’industrie des transports; car, à l’exemple de cette industrie, les arts extracteurs déplacent, en effet, les choses qu’ils livrent à la consommation. Mais ils ne se bornent pas, comme elle, à opérer des déplacements: leur artifice consiste surtout dans le fait même de l’extraction, fait industrieux d’une pratique souvent très difficile, fort différent en tous [I-180] cas de celui des transports; et il est devenu impossible de n’en pas faire, sous le nom d’arts extracteurs ou d’industries extractives, une classe de travaux tout à fait séparée.
Une autre grave incorrection à signaler dans la nomenclature des arts qui agissent sur le monde matériel, c’est le nom de commerce qui a été donné à l’industrie des transports. Le commerce a pu mettre sur la voie de cette industrie, apprendre à la discerner, conduire à reconnaître comment le déplacement intelligent des choses, l’action de les mettre à la portée de quiconque en a besoin, pouvait contribuer à la production; mais il n’a pu devenir pour cela l’art des transports, l’industrie du voiturage. L’industrie voiturière est un art immense, qui se distingue nettement de tous les autres, et qui doit avoir son nom séparé. On ne peut lui donner le nom de commerce sans torturer violemment la langue, sans l’estropier misérablement, et il est d’autant plus impossible d’appeler commerce l’industrie des transports, que ce nom de commerce s’applique à un ordre de faits tout différent et qui doit avoir aussi son appellation propre. Commercer, c’est acheter pour vendre: ce n’est pas un fait particulier à un ordre de travailleurs; c’est un fait commun absolument à tous; et, à vrai dire, il n’est pas une profession, depuis les plus humbles jusqu’aux plus élevées, dans laquelle on ne commence par des achats et on ne finisse par des ventes: si l’armateur, le voiturier, achètent les choses dans un lieu pour les revendre dans un autre, le fabricant les achète sous une forme pour les revendre sous une forme différente; quiconque exerce une industrie, un art, une fonction, a commencé par acquérir des aptitudes, des talents, des facultés, qu’il vend ensuite continuellement sous forme de services. Tout le monde donc achète et vend, et achète pour revendre. Seulcment, entre les achats et les ventes que chacun fait, il se place un travail, un art dont l’exercice intelligent constitue la profession; et pour en revenir aux gens qui font profession de répandre les choses dans le monde, de les mettre à la portée de quiconque en a besoin, il y a, entre les achats et les ventes qu’ils font, un art, qui gît moins dans l’action d’acheter, de vendre, de commercer, [I-181] que font, comme eux, tous les travailleurs possibles, que dans le déplacement judicieux des choses, dans le travail merveilleux et particulier qu’ils exécutent, et dont il est raisonnable que leur industrie reçoivent son nom [18]
En même temps, M. Dunoyer a proposé une nouvelle classification, qui est, à beaucoup d’égards, supérieure à l’ancienne. Il convient néanmoins de faire remarquer que la classification de la production concerne la statistique, science qui a pour fonction spéciale de dresser l’inventaire des différentes branches de l’industrie humaine, bien plutôt que l’économie politique, dont l’objet consiste à exposer comment la richesse se produit, se distribue et se consomme.
En effet, que la production soit agricole, industrielle, commerciale, artistique ou littéraire, elle s’opère en vertu des mêmes lois. Ses opérations peuvent être en outre ramenées à un petit nombre de catégories. Tout producteur ne fait, en définitive, autre chose que de découvrir, transformer ou transporter les éléments dont l’espèce humaine dispose pour la satisfaction de ses besoins. Quelquefois ces opérations sont accomplies par le même producteur; mais le plus souvent elles occupent des producteurs différents et elles constituent des industries distinctes que le statisticien doit inventorier et classer [19] .
[I-182]
Si l’inventaire et la classification de la production sont du ressort de la statistique, il appartient cependant à l’économie politique d’examiner quels éléments doivent entrer dans cet inventaire et dans cette classification. Or les économistes ne sont pas encore parfaitement d’accord sur ce point. C’est ainsi qu’un grand nombre d’entre eux se bornent à considérer comme industries productives celles dont les résultats se présentent sous une forme matérielle. D’autres, au contraire, et en première ligne il faut encore citer M. Dunoyer, plaçent dans le cadre de la production toutes les industries qui concourent à [I-183] la satisfaction des besoins des hommes, sans se préoccuper si leurs produits sont matériels ou immatériels.
Laquelle de ces deux opinions est la mieux fondée? Pour bien éclaircir cette question, jetons un coup d’œil sur l’ensemble des industries qui contribuent à la formation des richesses. Ces industries peuvent être partagées en deux grandes catégories, celles qui servent à façonner et à entretenir les agents dont l’homme se sert pour produire, celles qui servent à façonner et à entretenir l’homme lui-même.
Certaines industries ont, par exemple, pour objet spécial [I-184] d’approprier la terre à la production, d’entretenir et de développer sa fécondité. D’autres ont pour objet de créer des outils et des machines et de les entretenir en bon état. Ces industries qui s’occupent du matériel de la production appartiennent à la première catégorie. Viennent ensuite les industries qui agissent directement sur l’homme, qui contribuent à façonner et à entretenir ses facultés physiques, intellectuelles et morales, c’est à dire les industries qui s’occupent du personnel de la production. Celles-ci appartiennent à la seconde catégorie.
Parmi ces industries qui concernent soit le matériel, soit le personnel de la production, les unes fournissent des produits matériels, les autres des produits immatériels. Pourquoi les premières seraient-elles plutôt considérées comme productives que les secondes? En quoi, par exemple, l’industrie qui fournit des engrais à la terre, qui contribue ainsi à entretenir et à développer, à l’aide d’un produit matériel, la fécondité de cet agent, est-elle plus productive que celle du professeur d’agronomie, qui procure aux agriculteurs les connaissances nécessaires pour tirer un meilleur parti de la fécondité du sol? Où est la différence? La leçon du professeur est-elle moins une richesse que le guano? Tandis que celui-ci s’incorpore à la terre et augmente sa puissance créatrice, celle-là s’incorpore à l’homme et développe, d’une manière analogue ses facultés productives. S’il y a une différence entre les deux produits, n’est-elle pas à l’avantage de la leçon du professeur, qui peut se transmettre d’âge en âge, et contribuer encore après des centaines d’années, à l’amélioration des cultures, tandis que le résultat de l’application du guano est, de sa nature, beaucoup plus fugitif? Pourquoi donc accorder à l’un la qualification de richesse et la refuser à l’autre?
[I-185]
L’erreur que l’on commet à cet égard provient, croyonsnous, de ce que les industries qui agissent sur le matériel de la production lui donnent une valeur immédiatement réalisable, partant visible, tandis qu’il n’en est pas tout à fait ainsi pour celles qui agissent sur le personnel, du moins dans les sociétés où l’esclavage n’existe point. Défrichez une terre, par exemple, et vous y ajouterez une plus value que vous pourrez immédiatement réaliser en vendant la terre; élevez du bétail, construisez des machines, et vous pourrez de même en réaliser la valeur. Mais si vous élevez un homme, et si vous développez ses facultés de manière à en faire un instrument de production de plus en plus parfait, vous ne pourrez pas apprécier aussi bien la plus value que vous lui aurez donnée. Pourquoi? Parce que, dans nos sociétés civilisées, l’homme est un agent productif qui ne se vend point. Sans doute la plus value qu’une éducation appropriée à la nature de ses facultés lui aura donnée finira par se manifester dans le prix de ses services, mais ce dernier phénomène sera lent à se produire et l’on ne s’y arrêtera point.
Dans les sociétés où l’esclavage a continué de subsister, l’erreur que nous signalons n’est pas possible, et l’on y considère à bon droit le travailleur esclave comme un agent productif ayant sa valeur propre, valeur susceptible d’augmentation aussi bien que de diminution. En conséquence, les industries qui contribuent à former, à entretenir et à développer cette portion du personnel de la production, sont considérées comme aussi productives que celles qui s’appliquent au matériel. La valeur des esclaves peut. en effet, être réalisée, comme celle des terres, des bâtiments, des outils, des machines. Aussi est-elle comptée dans l’inventaire de la richesse nationale. Pourquoi donc omettrait-on de tenir compte de celle des [I-186] travailleurs libres? Serait-ce parce qu’ils exploitent à leur profit leurs facultés productives au lieu de les laisser exploiter au profit d’autrui?
La richesse incorporée dans les hommes doit évidemment être comprise dans l’inventaire d’une nation, aussi bien que celle qui existe sous forme de terres, de bâtiments, d’outils, de machines, d’approvisionnements, etc., et les industries qui servent à la créer et à la développer ne sont pas moins productives que celles qui servent à créer et à développer les richesses dites immobilières et mobilières. C’est une troisième sorte de richesse, non moins réelle que les deux autres, et qui peut être qualifiée de richesse personnelle.
En résumé, on peut considérer comme productives toutes les industries qui contribuent, directement ou indirectement, à créer des richesses immobilières, mobilières et personnelles; qui contribuent à mettre au service de la production des agents naturels appropriés, des capitaux fixes et circulants et des travailleurs, quelle que soit d’ailleurs la forme sous laquelle se présentent les produits dont la réunion constitue ces richesses, que cette forme soit matérielle ou immatérielle.
Voilà ce que M. Dunoyer a démontré mieux que personne, et nous croyons que sa démonstration est inattaquable [20] .
[I-187]
Cependant, il y a aussi des industries improductives ou même destructives. Ce sont celles qui contribuent directement ou indirectement à diminuer la quantité des richesses immobilières, mobilières et personnelles dont la société dispose.
Ces industries improductives ou destructives sont heureusement en fort petit nombre. Nous ne connaissons guère que les professions de voleur, de mendiant ou de parasite qui aient ce caractère d’une manière absolue. La première est essentiellement destructive en ce que le voleur ne déplace pas seulement à son profit une portion de richesse, mais en ce qu’il entrave encore la production, en menaçant la sécurité des producteurs. La seconde est improductive, en ce qu’elle occasionne un déplacement stérile de la richesse; elle est aussi, dans une certaine mesure, destructive, en ce qu’elle ralentit la formation des capitaux, car l’aumône donnée au mendiant, qui l’emploie à sa consommation du jour, aurait pu être appliquée à la constitution d’un supplément d’agents productifs.
Ces deux industries sont donc naturellement improductives et destructives. D’autres le sont accidentellement.
Toute entreprise de production qui ne couvre pas ses frais, ou qui ne les couvre qu’au moyen d’une subvention prélevée sur les résultats des autres entreprises, doit être considérée [I-188] comme accidentellement improductive. Éclaircissons ceci par un exemple. Supposons que vingt manufactures de drap existent dans un pays, et que leur production suffise pour alimenter la [I-189] consommation. Un entrepreneur qui n’apprécie pas bien la situation du marché en élève une vingt et unième. Aussitôt les quantités de drap que la nouvelle manufacture verse sur le [I-190] marché font baisser le prix courant de cette marchandise au dessous de son prix naturel, et les producteurs de drap subissent une perte, jusqu’à ce qu’ils aient resserré leur production de [I-191] manière à la remettre en harmonie avec la consommation. Dans l’intervalle, la production du drap n’ayant pu reconstituer intégralement ses agents productifs, aura diminué la masse [I-192] des richesses existantes, au lieu de l’augmenter. Elle aura été accidentellement improductive.
Le même résultat se produit chaque fois que l’on augmente une industrie au delà de la proportion requise par les besoins de la consommation. La production de la sécurité est l’une de celles où l’on peut observer, le plus fréquemment, ce développement parasite, où il présente, en même temps, le caractère le plus anti-économique. C’est là probablement ce qui a porté un grand nombre d’économistes à considérer les travailleurs employés dans cette branche d’industrie comme des improductifs. Sans doute, ils ne le sont que trop souvent, car partout aujourd’hui l’effectif militaire dépasse la proportion utile; mais quand cette proportion est observée, le soldat, qui sert à garantir aux autres producteurs la sécurité dont ils ont besoin, contribue, autant qu’eux-mêmes, quoique peut-être d’une manière moins immédiate et moins visible, au développement de la richesse.
Les industries qui ne subsistent que grâce à des subventions prélevées sur les autres branches de la production doivent être considérées aussi comme accidentellement improductives. Elles sont improductives, puisqu’elles ne couvrent pas leurs frais, ou, ce qui revient absolument au même, puisqu’elles ne les couvrent qu’en taxant à leur profit les autres branches de travail. Telles sont, par exemple, les industries qui sont nées et qui se maintiennent grâce au régime prohibitif. Un pays qui a le malheur d’en être affligé se trouve atteint dans les sources mêmes de sa prospérité, et les individus qui exploitent ces industries mendiantes et spoliatrices jouent, dans son économie intérieure, à peu près le même rôle que les mendiants et les voleurs de grands chemins.
[I-193]
Ainsi donc, il y a des industries ou des entreprises de production qui sont naturellement improductives, et d’autres qui le sont accidentellement. Les unes et les autres contribuent à diminuer la somme des richesses immobilières, mobilières et personnelles qui existent dans la société, ou bien elles l’empêchent de s’accroître autant qu’elle pourrait le faire si ces industries parasites n’existaient pas.
Ce point éclairci, examinons quelles sont les Formes de la production.
Chacune des branches de la production se trouve partagée entre un nombre plus ou moins considérable d’entreprises. Ces entreprises affectent les formes les plus variées. Cependant les formes de la production peuvent être ramenées à deux grandes catégories. On distingue:
- 1°La production par des entrepreneurs d’industrie;
- 2°La production par des associations de capitalistes ou de travailleurs capitalistes.
Examinons brièvement en quoi consistent et en quoi se différencient ces deux formes générales de la production.
La production par des entrepreneurs d’industrie a été, jusqu’à présent, la plus usitée. Voici en quoi elle consiste.
Un homme possède les aptitudes nécessaires pour produire une denrée quelconque. Il possède aussi ou il est en mesure de se procurer les autres éléments indispensables à la production de cette denrée. S’il juge que ce genre de production est de nature à lui fournir un produit brut suffisant pour couvrir ses frais et lui permettre de recueillir un bénéfice en harmonie avec les bénéfices des autres branches de la production, il l’entreprend. Il porte alors le nom d’entrepreneur d’industrie.
Couvrir ses frais de production et recueillir un bénéfice aussi [I-194] considérable que possible, tel est le but que se propose tout entrepreneur d’industrie.
En quoi consistent ses frais de production? Sous quelle forme perçoit-il son bénéfice?
Ses frais de production consistent dans la rétribution ou dans les frais d’entretien nécessaires des agents et des éléments qu’il applique à la production. Toujours ou presque toujours il fait l’avance de ces frais. Lorsqu’ils sont couverts, le surplus qui lui demeure constitue son bénéfice ou son profit. Ce bénéfice ou ce profit est purement éventuel. Il dépend de deux choses: 1° du montant des frais de production, lequel s’élève ou s’abaisse souvent d’une manière instantanée, selon les circonstances; 2° du prix auquel se vendent les produits, et ce prix est encore essentiellement variable.
Ordinairement, l’entrepreneur d’industrie ne possède pas toute la quantité de travail, de capital et d’agents naturels appropriés qu’il applique à la production. Souvent même il n’en possède que la plus faible partie. Dans ce cas, que fait-il? Il achète le concours du travail, du capital et des agents naturels appropriés qui lui sont nécessaires et qu’il ne possède pas. Il l’achète, soit en allouant aux détenteurs de ces agents une rémunération fixe, soit en leur accordant une part dans les bénéfices de son entreprise; parfois aussi en adoptant une combinaison mixte.
S’il s’agit du travail, l’entrepreneur d’industrie peut s’assurer le concours des travailleurs dont il a besoin, en leur fournissant une rémunération fixe, laquelle porte le nom de salaire. Ceci est le cas le plus fréquent. Quelquefois l’entrepreneur d’industrie ne fournit à ses coopérateurs qu’une partie de leur rétribution sous forme de salaire; il leur en distribue une autre partie [I-195] sous la forme d’une prime éventuelle, laquelle est plus on moins forte selon que les résultats de la production sont plus ou moins considérables. Cette prime éventuelle qui s’ajoute à la rémunération fixe, prend le nom de part dans les bénéfices.
S’il s’agit du capital, l’entrepreneur d’industrie s’en assure le concours en payant aux capitalistes une rémunération soit fixe, soit en partie fixe et en partie éventuelle, pour l’usage de leurs instruments de production. S’il s’agit d’un capital circulant, la rémunération fixe qui est allouée au capitaliste porte le nom d’intérêt; s’il s’agit d’un capital fixe, elle est désignée sous le nom de loyer; s’il s’agit d’agents naturels appropriés, elle s’appelle fermage ou rente.
Le bénéfice ou le profit de l’entrepreneur comprend la rémunération éventuelle des différents agents qu’il a appliqués à la production, savoir son travail, son capital fixe ou circulant et ses agents naturels appropriés.
La production s’opère encore aux frais et risques d’associations de capitalistes ou de travailleurs capitalistes. Quand il arrive, par exemple, que les opérations productives exigent un déploiement de forces et de ressources trop considérables pour qu’un seul homme puisse y pourvoir, on voit des individus plus ou moins nombreux s’associer en vue d’organiser et d’exploiter cette entreprise qui dépasse les facultés d’un seul entrepreneur; s’associer, c’est à dire mettre en commun leurs aptitudes, leurs connaissances et les autres instruments de production dont ils disposent. Ces associations se constituent sous les formes les plus diverses, mais presque toujours elles ne s’appliquent qu’à une partie des agents et des instruments employés dans l’entreprise. Les détenteurs de ces agents ou de ces instruments, les associés ou les actionnaires reçoivent, comme l’entrepreneur [I-196] d’industrie, leur part sous une forme éventuelle, et cette part prend communément le nom de dividende.
Telles sont les formes de la production. Ces formes n’ont rien d’arbitraire. Elles s’adaptent toujours à l’état économique de la société, et telle forme qui est impossible ou mauvaise aujourd’hui devient possible et avantageuse demain.
Quelle que soit du reste la forme d’une entreprise de production, les résultats de cette entreprise se partagent entre les différents agents productifs qui y sont employés, entre le travail, les capitaux fixes et circulants et les agents naturels approprié. Ils constituent Le revenu des détenteurs de ces agents productifs, des travailleurs, des capitalistes et des propriétaires fonciers, et la réunion des revenus de ces trois classes d’hommes constitue le revenu général de la société.
Le revenu porte différents noms selon la nature des agents qui le procurent, selon encore la forme des entreprises dans lesquelles ces agents sont utilisés. C’est ainsi que:
| La part du travail, constituant le revenu des travailleurs, porte les noms de: |  |
Profit Salaire ou appointements Part dans les bénéfices ou dividende du travail. |
| La part du capital… |  |
Profit Loyer Intérêt. Dividende. |
| La part des agents naturels appropriés. |  |
Profit foncier. Fermage ou rente. |
Nous aurons à examiner comment, en vertu de quelle loi, s’opère ce partage ou cette distribution du produit entre les détenteurs des agents qui ont servi à le former, comment se [I-197] déterminent les parts du travail, du capital et des agents naturels appropriés, ou, ce qui revient au même, comment la richesse se distribue entre les travailleurs, les capitalistes et les propriétaires fonciers.
Nous verrons que la même loi qui fait régner l’ordre dans la production règle du même coup la distribution de la richesse. Nous verrons, en analysant successivement les éléments de la rémunération des divers agents productifs, travail, capital et agents naturels appropriés, que le revenu des travailleurs, des capitalistes et des propriétaires fonciers, est réglé par cette loi de la manière la plus utile, c’est à dire la plus conforme à la justice.
[I-198]
[I-199]
SECONDE PARTIE de la distribution des riches ses
[I-200] [I-201]
HUITIÈME LEÇON↩
la part du travail
En quoi consistent les frais de production du travail. — Que ces frais sont essentiellement inégaux, selon les industries et les fonctions industrielles. — D’où provient cette inégalité. — Que des facultés diverses et inégales employées à la production exigent des frais d’entretien divers et inégaux. — Exemples. — Des frais de renouvellement des travailleurs et des causes qui les diversifient. — De l’influence des inconvénients et des avantages particuliers de chaque industrie sur la rémunération du travail. — Le salaire du bourreau, — de l’artiste, — de l’homme de lettres, — du savant. — Que le progrès industriel élève incessamment la rémunération nécessaire du travail. — Absurdité démontrée du système de l’égalité des salaires.
Nous sommes arrivé maintenant à la seconde partie de notre tâche. Après avoir examiné comment s’opère la production, nous allons rechercher de quelle manière se répartissent ses résultats, en un mot, nous allons nous occuper de La distribution des richesses.
Cette grande loi d’équilibre qui détermine la constitution des valeurs ou la formation des prix, et qui sert de régulateur à [I-202] la production,joue le même rôle dans la distribution des richesses.
Nous avons vu qu’en vertu de cette loi, le prix des produits gravite incessamment vers un certain niveau marqué par leurs frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net, niveau qui porte le nom de prix naturel ou nécessaire.
Nous constaterons successivement que le prix des services productifs des facultés humaines, des capitaux fixes ou circulants, et des agents naturels appropriés, gravite de même vers un certain niveau, marqué par les frais de production de ces services, avec l’adjonction d’une part proportionnelle de produit net. Ce niveau constitue le prix naturel ou nécessaire des services des agents productifs.
Nous commencerons par rechercher quels sont les éléments du prix naturel ou nécessaire du travail, et l’analyse de ces éléments nous fera voir comment se détermine la part que les travailleurs obtiennent dans la distribution des richesses.
Quand on considère l’ensemble des agents de la production, on s’aperçoit qu’ils ont besoin d’être incessamment entretenus et renouvelés, sinon ils se détruisent et ils disparaissent au bout d’un laps de temps plus ou moins long. Dans une entreprise de chemins de fer, par exemple, il faut que les locomotives et les waggons, composant le matériel de l’exploitation, les coussinets et les rails placés sur la voie, la voie elle-même, avec ses déblais et ses remblais, ses ponts, ses viaducs et ses tunnels, soient continuellement maintenus en état; il faut encore que le charbon ou le coke qui sert à réduire en vapeur l’eau contenue dans la chaudière, et cette eau même, soient, à chaque instant, remplacés par de nouvelles quantités de charbon [I-203] ou de coke à brῦler et d’eau à vaporiser. Si ces instruments nécessaires de l’industrie des transports ne sont point soigneusement entretenus et renouvelés, la locomotion ne pourra s’effectuer, ou bien elle sera promptement interrompue. Il en sera de même dans une entreprise agricole. Si l’on n’entretient point les charrues, les chevaux de labour et les autres véhicules animés ou inanimés de l’exploitation; si l’on ne répare point les bâtiments et les clôtures, si l’on ne renouvelle point les forces productives du sol au moyen d’engrais appropriés à leur nature, etc., la production s’arrêtera infailliblement au bout d’un laps de temps plus ou moins long.
Or, ce qui est vrai pour les éléments de production placés en dehors de l’homme ne l’est pas moins pour l’homme luimême, envisagé comme un agent productif; en d’autres termes, ce qui est vrai pour le matériel de la production ne l’est pas moins pour le personnel. Reprenons, pour nous en assurer, les deux exemples que nous venons de citer. Si les employés composant le personnel d’un chemin de fer, les directeurs, les mécaniciens, les chauffeurs, les cantoniers, les commis, etc., ne reçoivent pas une rémunération suffisante pour pouvoir non seulement se maintenir en vie et en santé, mais encore se reproduire, se renouveler, l’entreprise dont ils sont les agents nécessaires cessera évidemment bientôt de pouvoir fonctionner. De même, si les laboureurs, les faucheurs, les batteurs en grange, composant le personnel d’une ferme, ne reçoivent pas une rémunération qui leur permette de subsister et de se reproduire, de telle façon que ce personnel agricole demeure constamment en état, la production devra encore cesser.
Au point de vue économique, les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines. Ce sont des machines [I-204] qui fournissent une certaine quantité de forces productives et qui exigent, en retour, certains frais d’entretien et de renouvellement pour pouvoir fonctionner d’une manière régulière et continue. Ces frais d’entretien et de renouvellement, que le travailleur exige, constituent les frais de production du travail, ou, pour nous servir d’une expression fréquemment employée par les économistes, le minimum de subsistances du travailleur.
Ces frais de production du travail, ce minimum de subsistances du travailleur, sont-ils les mêmes dans tous les emplois de la production?
Non; l’observation atteste qu’ils sont, en premier lieu, essentiellement divers et inégaux, en second lieu, essentiellement mobiles.
Examinons avec détail, — car la question est des plus importantes, — les causes qui diversifient et font varier ces frais de production du travail ou ce minimum de subsistances, faute duquel le travailleur ne peut mettre, d’une manière régulière et continue, ses facultés au service de la production.
Chaque fonction productive exige le concours de facultés particulières. Ainsi, l’ouvrier laboureur ne met point en œuvre les mêmes facultés que l’ouvrier mécanicien. L’un déploie principalement de la force physique; l’autre déploie plutôt certaines facultés intellectuelles. Le marchand ne met pas non plus en œuvre les mêmes facultés que le mécanicien, et selon la nature des opérations auxquelles un marchand se livre, il déploie des facultés différentes. Le grand commerce, le commerce de spéculation par exemple, exige à un plus haut degré que le commerce de détail, le concours de l’esprit de combinaison. L’instituteur, le prêtre,le médecin,l’avocat,le peintre,le [I-205] musicien, l’homme de lettres mettent en œuvre chacun une association sui generis de facultés productives.
Les facultés requises pour la production ne diffèrent pas seulement selon les industries; elles diffèrent encore selon les fonctions entre lesquelles se partage l’exercice de chaque industrie. Dans une maison de commerce, par exemple, le copiste expéditionnaire n’a pas à déployer les mêmes facultés que le chef ou que le commis chargé de la correspondance. Dans une armée, le soldat n’a pas à mettre en œuvre les mêmes facultés que le général, etc., etc.
On voit ainsi s’établir, en vertu de la nature même des choses, une hiérarchie du travail. Les fonctions s’échelonnent, se hiérarchisent en raison du nombre, de l’espèce et de l’étendue des facultés dont elles exigent le concours.
Il serait intéressant de savoir quelles facultés sont particulièrement requises dans chacun des emplois de la production, depuis la fonction du monarque qui gouverne un grand empire jusqu’à celle du simple manœuvre. Ce classement industriel des facultés de l’homme ne serait pas sans utilité. Bornous-nous toutefois à constater qu’il existe une hiérarchie naturelle du travail, c’est à dire que les différentes fonctions de la production exigent le concours de facultés diverses et inégales. Qu’en résulte-t-il?
Il en résulte que les frais de production du travail sont essentiellement divers et inégaux, car ils varient selon le nombre, l’espèce et l’étendue des facultés dont chaque fonction exige le concours.
Si l’on considère à ce point de vue le simple ouvrier terrassier qui ne fait guère usage que de sa force musculaire, et qui, en vertu de la nature même de sa fonction industrielle, n’a [I-206] point à déployer des facultés plus relevées, on trouvera que les frais de production de son travail sont placés à l’échelon le plus bas. Un ouvrier terrassier peut, sans nuire à sa santé, faire œuvre de sa force musculaire pendant douze heures sur vingtquatre, et son entretien nécessaire peut à la rigueur se réduire à une nourriture, à des vêtements et à un abri grossiers. Sa rémunération doit encore, à la vérité, lui fournir les moyens de se reproduire, mais ses frais de reproduction sont aussi faibles que possible. Il lui suffit d’avancer au travailleur destiné à le remplacer l’entretien nécessaire au développement de sa force musculaire, rien de plus. La rémunération des hommes qui mettent uniquement en œuvre de la force musculaire et qui n’ont pas besoin d’en déployer d’autre, occupe en conséquence le degré le plus bas de l’échelle des salaires.
Mais aussitôt que le travailleur exerce une fonction qui exige le concours des facultés de l’intelligence, son entretien nécessaire s’élève. Voici pourquoi:
- 1° L’homme qui fait œuvre de son intelligence ne peut travailler aussi longtemps que celui qui se borne à utiliser la force de ses muscles; il a besoin d’accorder à ses facultés des intervalles de repos plus longs pour les maintenir en bon état;
- 2° Il est obligé de consommer des aliments matériels plus raffinés, comme aussi de s’assimiler des aliments intellectuels dont le manœuvre peut se passer.
Le travailleur voué à une œuvre intellectuelle ne peut se contenter de la nourriture grossière qui suffit au manœuvre. Il ne le peut, sous peine de voir s’émousser et s’affaiblir son intelligence, et de devenir à la longue incapable de remplir la fonction qui lui est dévolue. Cette influence de l’alimentation sur [I-207] les facultés de l’intelligence a été constatée par un grand nombre de physiologistes, notamment par Cabanis:
Dans certains pays, dit cet illustre physiologiste, où la classe indigente vit presque uniquement de chataignes, de blé sarrasin ou d’autres aliments grossiers, on remarque chez cette classe tout entière un défaut d’intelligence presque absolu, une lenteur singulière dans les déterminations et les mouvements. Les hommes y sont d’autant plus stupides et plus inertes qu’ils vivent plus exclusivement de ces aliments: et les ministres du culte avaient souvent, dans l’ancien régime, observé que leurs efforts pour donner des idées de religion et de morale à ces hommes abrutis, étaient encore plus infructueux dans le temps où l’on mange la chataigne verte. Le mélange de la viande, et surtout l’usage d’une quantité modérée de vins non acides, paraissent être les vrais moyens de diminuer ces effets: car la différence est plus grande encore entre les habitants des pays de bois de chataigniers et ceux des pays de vignobles, qu’entre les premiers et ceux des terres à blé les plus fertiles. En traversant les bois, plus on se rapproche des vignobles, plus aussi l’on voit diminuer cette différence, qui distingue leurs habitants respectifs [21] .
Quand on exerce un métier où la force musculaire seule est requise, quand on bêche la terre, quand on porte des fardeaux, on peut, à la rigueur, se contenter de chataignes et de blé sarrasin, puisque cette nourriture grossière suffit pour entretenir et renouveler les muscles. Mais il en est autrement quand on exerce une fonction où le concours de l’intelligence est indispensable. Mettez M. Alexandre Dumas et M. Scribe au régime du blé sarrasin et de la chataigne verte, puis demandez-leur [I-208] d’écrire un roman ou une comédie et vous verrez de quelle œuvre indigeste ils ne manqueront pas de vous régaler à leur tour.
L’intelligence exige encore, pour se maintenir en force et en santé, des aliments purement immatériels. Il faut d’abord que l’esprit perçoive et s’assimile, d’une manière continue, des impressions en harmonie avec la nature de l’œuvre à laquelle il est voué. Il faut ensuite que l’esprit se délasse, et qu’on lui procure en conséquence des distractions en harmonie avec ses occupations. Qu’un poète, un romancier, un artiste ou même un avocat soit assujetti à l’existence de l’ouvrier terrassier; qu’on l’oblige à travailler douze heures par jour, puis à passer les douze heures restantes à boire, à manger, à fumer et à dormir, il finira certainement par devenir incapable de remplir la fonction intellectuelle qui lui est assignée: pour me servir d’une expression énergiquement pittoresque, il finira par s’abrutir.
On peut donc affirmer que l’entretien de l’homme qui fait œuvre de ses facultés intellectuelles doit être plus complet et plus raffiné que celui du manœuvre, sinon le mécanisme délicat et subtil de l’intelligence s’altère, se détériore et finit par ne pouvoir plus fonctionner.
Les anciens avaient parfaitement aperçu cette nécessité et ils y avaient égard dans la manière dont ils traitaient leurs esclaves. Ils avaient, vous le savez, des esclaves qui remplissaient les fonctions les plus diverses. Ils en avaient dont l’unique fonction consistait à tourner la meule; d’autres qui labouraient la terre; d’autres encore qui étaient appliqués à des fonctions industrielles; d’autres enfin qui exerçaient des professions libérales, qui étaient médecins, grammairiens, philosophes [I-209] même. Eh bien! ils traitaient ceux-ci infiniment mieux que les autres; ils les nourrissaient, les habillaient et les logeaient mieux; ils leur imposaient des tâches moins lourdes, quoique les lois, les mœurs et l’opinion n’établissent aucune distinction entre les différentes catégories d’esclaves. Pourquoi donc cette inégalité de traitement? Parce que les maîtres en avaient reconnu la nécessité; parce que l’expérience leur avait appris qu’un esclave ne pouvait faire œuvre de son intelligence, d’une manière régulière et continue, à moins d’être plus complétement entretenu, mieux traité et plus ménagé que s’il avait eu à déployer seulement de la force musculaire.
Les frais de production du travail comprennent donc, en premier lieu, l’entretien nécessaire du travailleur, et cet entretien varie selon le nombre, l’espèce et l’étendue des facultés requises pour remplir chaque fonction productive.
Les frais de production du travail comprennent, en second lieu, la somme nécessaire pour couvrir les frais de renouvellement du personnel de la production. Ceux-ci sont plus ou moins élevés selon deux circonstances: 1° selon que le travail à exécuter exige un apprentissage plus ou moins long et coῦteux; 2° selon qu’il use plus ou moins vite le travailleur.
Ainsi que je l’ai fait remarquer plus haut à propos des ouvriers terrassiers, le renouvellement des travailleurs est peu coῦteux dans les rangs inférieurs de la production. Que faut-il, en effet, pour renouveler les portefaix, les valets de charrue, les ouvriers terrassiers, et, en général, les ouvriers dont la force musculaire seule est utilisée? Il faut simplement la somme nécessaire pour entretenir un enfant et développer sa force physique jusqu’à ce qu’il soit en état de faire œuvre de ses muscles, ni plus ni moins. D’apprentissage spécial, il n’en est, [I-210] pour ainsi dire, pas besoin. Les frais de renouvellement de ce genre de travailleurs sont donc aussi faibles que possible. Il n’en est pas ainsi lorsque l’exercice de la fonction industrielle exige le concours des facultés intellectuelles ou même simplement d’une certaine habileté de main. A la nourriture et à l’entretien de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en état de travailler, vient s’ajouter, en ce cas, un apprentissage spécial plus ou moins coῦteux.
Remarquons encore que les frais nécessaires d’alimentation et d’entretien des enfants varient selon les professions qu’ils sont destinés à exercer. On peut nourrir avec du blé noir et des chataignes vertes un enfant destiné au labeur matériel, car ce genre d’alimentation peut suffire, à la rigueur, pour développer la force de ses muscles. On est obligé de fournir une alimentation plus raffinée à un enfant destiné à faire œuvre de son intelligence, sous peine d’entraver le développement de ses facultés intellectuelles.
Mais l’inégalité la plus importante est celle des frais d’apprentissage selon les professions. Ces frais qui sont à peu près nuls pour les travailleurs voués au labeur purement matériel, s’élèvent en revanche fort haut pour les travailleurs intellectuels, les avocats, les médecins, les prètres, les administrateurs, les juges, les hommes de lettres, etc. La profession d’avocat, par exemple, exige un apprentissage long et coῦteux. On a beau être pourvu d’une dose convenable d’éloquence naturelle et des autres facultés nécessaires pour réussir au barreau, cela ne suffit point. Ces dispositions naturelles, il faut d’abord les développer d’une manière générale; il faut ensuite s’assimiler les connaissances et les pratiques du métier; il faut étudier la jurisprudence et la manière de s’en servir. Sans doute, le [I-211] programme de ces études préliminaires a été chargé outre mesure: on oblige l’étudiant en droit à encombrer son intelligence d’une foule de notions inutiles, parmi lesquelles je citerai en première ligne la connaissance des langues mortes. Mais en admettant même que les frais d’apprentissage de l’avocat fussent ramenés aux proportions du strict nécessaire, ils n’en demeureraient pas moins plus élevés que ceux du tailleur ou du maçon, et, à plus forte raison, que ceux du portefaix ou du valet de charrue.
Si l’homme était immortel, ces frais d’élève et d’apprentissage des travailleurs n’exerceraient évidemment qu’une influence inappréciable sur la rémunération du travail, répartis comme ils le seraient sur une période d’une étendue illimitée. Mais il n’en est point ainsi: le personnel de la production doit être régulièrement renouvelé et la période de son renouvellement varie selon les industries et selon les pays.
Selon les industries. Il y a, comme on sait, des inégalités considérables dans la durée du personnel des différentes branches de la production. Dans les professions dites insalubres, par exemple, l’outillage humain doit être renouvelé beaucoup plus fréquemment que dans les autres. La fabrication du blanc de céruse, pour ne citer que celle-là, consomme en un siècle deux ou trois générations de plus que les industries ordinaires; d’où il résulte que la rémunération de ses travailleurs doit comprendre les frais d’élève et d’apprentissage de ces générations supplémentaires.
Selon les pays. Dans certains pays, la durée moyenne de la vie humaine est plus longue; dans certains autres, elle l’est moins, et cette différence de longévité a une importance économique qu’il est facile d’apprécier. Supposons qu’une contrée [I-212] soit continuellement exposée aux ravages des maladies contagieuses, en sorte que le personnel de la production doive y être renouvelé six fois par siècle, tandis que dans une contrée voisine, où les conditions de salubrité sont meilleures, le personnel ne doive être renouvelé que cinq fois; n’est-il pas évident que les frais de production du travail seront plus élevés dans la première que dans la seconde? A égalité de rémunération, les ouvriers de la contrée malsaine ne seraient-ils pas bien plus misérables que ceux de la contrée placée dans de bonnes conditions hygiéniques?
On voit, par ce qui précède, dans quelle mauvaise situation économique se trouvent les pays où les maladies contagieuses, la peste et la fièvre jaune, la malaria étendent habituellement leurs ravages. Non seulement le personnel de la production doit y être plus fréquemment renouvelé qu’ailleurs, mais encore ce personnel se trouve journellement entamé, décomplété dans ses parties essentielles, sans qu’il soit possible de combler immédiatement les vides causés par la contagion, un travailleur étant une espèce d’outil que l’on ne saurait fabriquer en un jour.
Une dernière remarque à faire sur ce sujet, c’est que les frais de production du travail s’augmentent en raison composée de la fréquence du renouvellement des travailleurs et de l’importance des frais d’élève et d’apprentissage. Il en résulte que la rémunération des travailleurs attachés aux professions qui exigent un apprentissage long et coῦteux doit atteindre une élévation extraordinaire dans les régions insalubres ou dangereuses.
Au point de vue économique, deux pays qui se trouvent placés dans des conditions de salubrité inégales peuvent être [I-213] comparés à deux fabricants de céruse, dont l’un aurait réussi à assainir sa fabrication, tandis que l’autre continuerait à travailler d’après les anciens errements. Comme celui-ci serait obligé de payer le travail nécessaire à son industrie plus cher que son concurrent, il finirait indubitablement par succomber dans la lutte.
Les progrès qui améliorent les condition hygiéniques de la production, qui préviennent les maladies et les accidents de toute sorte auxquels les travailleurs sont exposés, etc., ont, en conséquence, une grande importance économique. On attache avec raison beaucoup de prix aux procédés qui augmentent la durée des outils, des machines, des bâtiments, qui préservent de l’action des maladies contagieuses et des autres causes accidentelles de destruction, les animaux et les végétaux utiles; mais ceux qui augmentent la durée de l’homme, considéré comme agent de la production, en permettant ainsi aux générations existantes d’économiser une partie des frais d’élève et d’apprentissage des générations qui doivent les remplacer, ceux-là ne méritent point certes, à un degré moindre, l’attention de l’économiste.
Ainsi donc les frais de production du travail se différencient, premièrement, en raison de la diversité et de l’inégalité des forces ou facultés requises dans les différentes opérations de l’industrie et des réparations qu’elles exigent; secondement, en raison de la diversité et de l’inégalité des frais de renouvellement des travailleurs.
D’autres éléments contribuent encore à diversifier le prix naturel du travail. Ce sont, par exemple, les chômages et les crises industrielles; ce sont encore les inconvénients ou les avantages particuliers qui sont attachés à l’exercice de certaines industries.
[I-214]
Les chômages réguliers ou mortes saisons et les crises irrégulières qui interrompent l’exercice d’un grand nombre de professions et d’industries doivent inévitablement influer sur les frais de production du travail. Supposons que deux industries exigent la mise en œuvre de facultés équivalentes, et que la période d’activité des travailleurs soit la même dans chacune, — mais que la morte saison soit de trois mois dans l’une et d’un mois seulement dans l’autre; que la première soit, en outre, exposée, beaucoup plus que la seconde, aux interruptions fortuites de travail provenant des crises industrielles, le salaire de neuf mois de travail dans celle-là devra équivaloir au salaire de onze mois dans celle-ci, et contenir en sus une prime destinée aux interruptions occasionnées par les crises irrégulières.
Tout progrès qui abrége la durée des chômages et qui diminue le nombre ou l’intensité des crises industrielles abaisse par là même les frais de production du travail.
Un résultat équivalent est obtenu lorsque le travailleur parvient à utiliser régulièrement ses mortes saisons, ou bien encore à ajouter aux ressources que lui fournit sa principale industrie, celles d’une industrie auxiliaire.
Les avantages ou les inconvénients spécialement attachés à l’exercice de chaque industrie constituent enfin une prime qui diminue ou qui élève le prix naturel du travail. C’est ainsi que le niveau de la rémunération du travail dans l’industrie des mines, par exemple, dépasse communément celui des autres branches de la production, à cause des inconvénients et des dangers matériels qui accompagnent le travail du mineur.
La privation de certains avantages purement moraux donne naissance à une prime de même nature. Nous citerons comme [I-215] exemple la profession de bourreau ou, si l’on aime mieux, d’exécuteur des hautes œuvres. Cette profession est, de nos jours, fort peu difficile à remplir. Il n’en était pas tout à fait ainsi, comme on sait, aux époques où les supplices étaient fréquents et compliqués, où encore la torture jouait un rôle considérable dans la procédure. Alors le bourreau était souvent le travailleur le plus occupé d’un royaume. Heureusement, sa besogne a été beaucoup abrégée et simplifiée tant par les progrès de la civilisation que par ceux mêmes de l’art de détruire les hommes. La besogne du bourreau se réduit, de nos jours, à fort peu de chose. L’instrument de supplice dont on se sert en France et en Belgique par exemple, la guillotine, substitue l’impulsion d’une force mécanique, celle de la pesanteur terrestre, à l’action de la force physique. Le bourreau ne tranche plus la tête, il ne roue plus, il n’écartèle plus, il ne torture plus, toutes besognes qui exigeaient la mise en œuvre d’une certaine force et d’une certaine adresse; il se borne à présider à la toilette du condamné, à diriger le montage de la funèbre machine qui fonctionne à sa place et à tourner un simple bouton. Enfin, ce travail essentiellement simple, c’est tout au plus s’il l’exécute huit ou dix fois par an, dans les endroits où il est le plus occupé.
Eh bien! ce travailleur, dont la fonction est si simple et si peu fatigante, reçoit cependant des appointements énormes en comparaison de ceux des travailleurs des autres professions. Pourquoi? Parce que le métier de bourreau prive l’individu qui l’exerce de certains avantages moraux ou sociaux auxquels les hommes tiennent beaucoup; parce qu’une mère ne se soucie pas de donner sa fille à un bourreau; parce qu’on ne reçoit pas volontiers un bourreau chez soi. A quoi il faut ajouter que la [I-216] fonction de l’exécuteur n’a pas cessé encore d’être répugnante, tant par le fait même de l’exécution que par les circonstances qui l’accompagnent. Si ces circonstances venaient à se modifier; si, par exemple, on exécutait les condamnés dans l’enceinte des prisons au lieu de les exécuter en public; si encore la répulsion qu’excite la personne du bourreau venait à s’affaiblir, le niveau de la rémunération de ce genre de travail baisserait, selon toute apparence, dans une proportion considérable.
Choisissons maintenant un exemple opposé. Certaines industries ne procurent qu’une rémunération extrêmement faible, eu égard au nombre et à l’importance des facultés dont elles exigent le concours, comme aussi aux risques qui s’y trouvent attachés. Telles sont les professions artistiques, littéraires et scientifiques. A quoi cela tient-il? Cela tient à ce que les avantages moraux attachés à l’exercice de ces professions sont supérieurs à ceux que peuvent procurer la plupart des autres branches de l’industrie humaine. On peut se faire une réputation brillante dans les arts et dans les lettres; on peut exercer, en cultivant les sciences, une influence considérable sur le bien-être de ses semblables. La vanité, l’orgueil ou, ce qui vaut mieux, l’amour de la justice et de l’humanité obtiennent, dans l’exercice de ces professions d’élite, une satisfaction exceptionnelle. Ces avantages particuliers, d’un ordre purement moral, remplacent dans la rémunération de l’homme de lettres, du savant et de l’artiste, une portion plus ou moins forte du salaire matériel, en ce sens que l’homme de lettres, le savant ou l’artiste se contente pour les acquérir d’un salaire matériel inférieur à celui qu’il pourrait obtenir dans le commun des industries.
Remarquons toutefois que la prime qui résulte des inconvénients [I-217] particuliers à chaque industrie s’ajoute non aux frais de production du travail, mais à la part proportionnelle de produit net qui complète le prix naturel du travail. Cette prime n’a pas, en effet, un caractère de nécessité. Ainsi, par exemple, il n’est pas nécessaire de payer un bourreau plus cher qu’un ouvrier terrassier pour le mettre en état d’exercer sa profession. Sous un régime d’esclavage, on pourrait n’établir aucune différence entre ces deux professions, car les frais de production du travail ne diffèrent pas essentiellement dans l’une et dans l’autre. Mais comme une certaine défaveur s’attache à la profession de bourreau, on ne l’adopte, sous un régime de liberté, qu’à la condition d’obtenir une prime qui compense cet inconvénient particulier. Cette prime élève non les frais de production du travail du bourreau, mais la part proportionnelle de produit net que ce travail procure. Elle s’ajoute, en tous cas, au prix naturel, lequel se compose des frais de production augmentés de la part proportionnelle de produit net.
Dans le cas de l’homme de lettres, du savant ou de l’artiste, la prime comprenant les avantages particuliers à ce genre de travail, se déduit de la part proportionnelle de produit net, et non des frais de production du travail, puisque ces frais doivent être couverts par une rémunération matérielle, suffisante pour permettre au travailleur d’exercer son industrie d’une manière régulière et continue. En tous cas, elle se déduit encore du prix naturel, dont la part proportionnelle de produit net est une portion intégrante.
Par les analyses qui précèdent, on a pu voir que le prix naturel du travail a des niveaux essentiellement divers; que ces niveaux diffèrent selon les circonstances qui caractérisent chaque industrie; selon le nombre, l’espèce et l’étendue des [I-218] facultés dont chaque fonction exige le concours; selon la durée plus on moins longue de la période d’activité du travailleur; selon le coῦt de son renouvellement; selon la durée des chômages et la fréquence des crises auxquelles il est exposé; selon les avantages ou les inconvénients spéciaux que comporte son industrie. Telles sont les causes qui établissent l’inégalité entre les niveaux du prix naturel du travail.
Enfin ces niveaux divers ne sont pas fixes; ils sont au contraire essentiellement mobiles. Tantôt on les voit s’abaisser, tantôt on les voit s’élever.
C’est ainsi, par exemple, que le progrès industriel, en élevant le niveau des facultés requises pour la production, élève par là même, incessamment, le niveau du prix naturel du travail.
Ceci étant une observation de la plus haute importance au point de vue de l’avenir des classes ouvrières, voyons de quelle façon agit le progrès industriel pour modifier la nature du travail.
Le progrès industriel substitue communément à l’emploi de la force physique du travailleur celui d’une force mécanique moins coῦteuse et plus puissante. Dans les industries que le progrès tranforme, on voit, en conséquence, le travail humain changer successivement de nature: de purement physique à l’origine, du moins dans les fonctions inférieures, il devient de plus en plus intellectuel. Si nous examinons, par exemple, l’industrie de la locomotion à ses différentes périodes de développement, nous serons surpris de l’étendue et de la portée des transformations que le travail dont elle exige le concours a subies sous l’influence du progrès. A l’origine, c’est l’homme lui-même qui transporte les fardeaux en mettant en œuvre sa force musculaire. Il en est encore ainsi dans certaines parties [I-219] de l’Inde, où les bras et les épaules des coulis sont les seuls véhicules en usage pour transporter les voyageurs aussi bien que les marchandises. Mais l’industrie de la locomotion vient à progresser. L’homme dompte le cheval, l’âne, le chameau, l’éléphant, et il les assujettit à porter des fardeaux; il invente encore la charrette, la voiture et le navire. Aussitôt la nature du travail requis pour le transport des hommes et des marchandises se modifie. La force musculaire ne suffit plus, elle ne joue même plus qu’un rôle secondaire dans l’industrie des transports; le premier rôle appartient désormais à l’adresse et à l’intelligence. Il faut plus d’adresse et d’intelligence que de force musculaire pour guider un cheval, un âne, un chameau, un éléphant, pour conduire une voiture ou une charrette, pour diriger un navire. Survient enfin un dernier progrès. La vapeur est appliquée à la locomotion. La locomotive avec ses longues files de waggons se substitue au cheval, à la charrette, à la diligence; le bateau à vapeur prend la place du navire à voiles. La fonction du travailleur dans l’industrie des transports acquiert, par suite de cette nouvelle transformation, un caractère intellectuel plus prononcé. Les employés des chemins de fer ont à déployer plus d’intelligence et moins de force physique que les voituriers, messagers, etc., qu’ils ont remplacés. Dans l’industrie des transports par eau, l’intervention de la vapeur supprime l’outillage humain qui était employé à manœuvrer l’appareil moteur des navires, les mâts, les voiles, les cordages, etc. A cet appareil qui nécessitait encore l’application d’une certaine quantité de force musculaire, la vapeur substitue une machine dont les servants, chauffeurs ou mécaniciens, n’ont guère à faire œuvre que de leur intelligence.
En examinant donc l’industrie de la locomotion à son point [I-220] de départ et à son dernier point d’arrivée, on s’aperçoit que la proportion dans laquelle elle réclame le concours de la force musculaire et de la force intellectuelle de l’homme s’est progressivement modifiée, et que la dernière a fini par s’y substituer presque entièrement à la première. On obtient le même résultat en étudiant l’action du progrès industriel sur les autres branches de la production, et l’on arrive ainsi à cette conclusion importante, que l’industrie moderne exige dans une proportion moindre que celle des premiers âges du monde l’intervention de la force musculaire de l’homme, mais qu’elle réclame, en revanche, à un bien plus haut degré, le concours de ses facultés intellectuelles et morales.
Cette modification progressive dans la nature des forces requises pour la production ne manque pas de se répercuter dans les frais de production du travail. A mesure que l’intelligence se substitue à la force musculaire dans l’industrie, on voit s’élever le niveau de la rémunération des travailleurs. Ainsi les salaires des voituriers, des cochers, des conducteurs d’omnibus sont plus élevés que n’étaient ceux des porteurs de chaises; mais ils se trouvent à leur tour dépassés par ceux des employés des chemins de fer. De même, il y a apparence que les travailleurs employés dans la navigation à voiles sont mieux rémunérés que ne l’étaient jadis les rameurs, tandis qu’ils le sont plus mal que le personnel employé dans la navigation à la vapeur. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l’intelligence nécessaire à l’exercice d’une industrie perfectionnée exige des frais d’entretien et de renouvellement plus considérables que la force musculaire requise par une industrie encore dans l’enfance; parce que les frais de production du travail intellectuel sont plus élevés que ceux du travail physique.
[I-221]
En examinant les modifications que subit la nature du travail sous l’influence du progrès industriel, on arrive, en définitive, à une conclusion qui peut être formulée ainsi:
Que le progrès industriel contribue dans toutes les branches de l’activité humaine à élever le niveau des frais de production du travail.
Le prix naturel du travail se modifie donc sous l’influence du progrès industriel qui transforme la nature du travail, qui rend l’œuvre de l’homme dans la production de plus en plus intellectuelle, et nécessite en conséquence des frais d’entretien et de renouvellement de plus en plus considérables pour le personnel de la production.
Le prix naturel du travail se modifie encore lorsque le prix des choses nécessaires à l’entretien et au renouvellement des travailleurs vient à se modifier. Tout progrès qui diminue d’une manière permanente le prix des choses diminue par là même le prix naturel du travail. Toute circonstance qui élève le prix de ces choses élève le prix naturel du travail.
Cette analyse que nous venons de faire des circonstances qui déterminent le niveau du prix naturel du travail dans chacune des branches de la production montre toute l’absurdité des systèmes fondés sur l’égalité des salaires. Cette égalité ne serait possible qu’aux conditions suivantes: 1° si toutes les opérations de la production exigeaient l’application de forces de même nature et parfaitement égales; 2° si les matériaux nécessaires à l’entretien et au renouvellement de ces forces se trouvaient partout en égale abondance; 3° si l’outillage humain de la production avait toujours et partout la même durée. Alors on concevrait que les travailleurs pussent être soumis au régime de l’égalité des salaires, de même que l’on conçoit que [I-222] des machines de tout point semblables et placées dans des conditions égales, soient soumises à celui de l’égalité des frais d’entretien. Mais si, comme l’observation l’atteste, les fonctions de la production sont essentiellement diverses et inégales; si les unes peuvent être accomplies à l’aide d’un outil humain simple et grossier, tandis que les autres exigent l’emploi d’un outil humain compliqué et perfectionné, l’égalité des salaires n’estelle pas en opposition avec la nature même des choses? Vouloir donner à un portefaix et à un directeur de chemin de fer, par exemple, une rémunération égale, ne serait-il pas aussi absurde, aussi contraire à la nature des choses, que de vouloir consacrer la même somme aux frais d’entretien et de renouvellement de la locomotive et à ceux du cheval de trait? Les différents emplois de la production exigent l’application de facultés diverses et inégales; ils sont accompagnés aussi d’inconvénients et d’avantages divers et inégaux. Comment donc pourrait-on établir une égalité artificielle, où l’auteur des choses a institué une inégalité naturelle?
A la vérité, il y a dans le progrès industriel une certaine tendance à l’égalité. Le progrès industriel élève, ainsi que nous l’avons remarqué, le niveau général des fonctions de la production, et par conséquent diminue la distance qui existe entre les plus hautes et les plus basses; mais la hiérarchie des fonctions ne s’efface point pour cela. Il y a toujours, dans les industries les plus perfectionnées, certaines fonctions qui exigent des facultés supérieures, certaines autres où des facultés d’un ordre inférieur peuvent suffire; il y en a toujours qui usent plus promptement que les autres les travailleurs aussi bien que les machines, le personnel aussi bien que le matériel, et ces inégalités, qui tiennent à la nature des choses, doivent nécessairement [I-223] se reproduire dans les salaires. Il n’en est pas moins consolant de penser que tout progrès industriel implique une modification progressive dans la nature des forces humaines dont le concours est exigé pour la production, et que cette modification amène un exhaussement, progressif aussi, du niveau de la rémunération nécessaire du travail.
[I-224]
NEUVIÈME LEÇON↩
la part du travail (suite)
Comment se fixe le prix courant du travail. — Effets de la loi des quantités et des prix sur la rémunération du travail. — Que cette rémunération tend toujours à se confondre avec son taux naturel et nécessaire. — Circonstances perturbatrices, — absence de la liberté du marché, — esclavage. — Éléments constitutifs de l’esclavage, — le monopole d’exploitation et la tutelle. — Comment s’est établi le monopole d’exploitation. — Raison de l’extrême multiplication des esclaves dans les sociétés primitives. — Raison d’être de la tutelle. — Inégalité naturelle des races et des individualités humaines. — Opinion de M. James Spence sur l’infériorité de la race nègre. — Que la nécessité de la tutelle pour les individualités inférieures est la même que pour les enfants et les femmes. — En quoi consiste, sous le rapport économique, le gouvernement de soi-même. — Que l’homme ne peut utilement être libre qu’à la condition de posséder la capacité nécessaire pour supporter la responsabilité attachée à la liberté. — Que la tutelle peut être libre ou imposée, et dans quels cas. — Que l’esclavage et le servage ont été les formes primitives de la tutelle. — Que l’abolition de l’esclavage et du servage n’impliquent pas celle de la tutelle. — Erreur des abolitionnistes à cet égard. — Maux causés par cette erreur. — Nécessité de substituer la tutelle libre à la tutelle monopolisée au lieu de supprimer à la fois [I-225] le monopole et la tutelle. — Conséquences bienfaisantes du développement de la tutelle libre. — Formule du prix courant du travail engagé.
Nous avons examiné dans la leçon précédente quelles sont les parties constituantes de la rémunération du travail. Nous avons vu qu’elles consistent en premier lieu dans la somme nécessaire pour entretenir et renouveler le personnel de la production; en second lieu, dans une part de produit net proportionnée à celle qui est afférente aux autres agents productifs, laquelle part de produit net permet à ceux qui la reçoivent d’augmenter, dans la proportion utile, le personnel de la production.
Telles sont les parties constituantes du prix naturel ou nécessaire du travail.
Mais le prix naturel ou nécessaire n’étant qu’un point idéal vers lequel gravite le prix réel ou le prix courant, ce dernier nous reste encore à étudier pour compléter l’analyse de la part du travail.
Comment se fixe le prix courant du travail? Il se fixe, comme celui de toute autre marchandise, en vertu de la loi de l’offre et de la demande. Quand la demande est supérieure à l’offre le prix hausse et vice versâ.
Ces oscillations en hausse ou en baisse de la valeur du travail dans l’échange ayant lieu, comme celles de toutes les autres valeurs, en raison géométrique, lorsque les quantités offertes ou demandées varient simplement en raison arithmétique (voir la IVe leçon), il en résulte: 1° une extrême sensibilité du prix courant du travail; 2° une tendance incessante du prix courant du travail à se rapprocher du prix naturel ou nécessaire. Cette tendance qui agit avec une intensité progressive à mesure que [I-226] ces deux prix s’écartent davantage sous l’influence des variations des quantités offertes, doit avoir pour résultat final de déterminer le retrait des quantités surabondantes ou l’apport des quantités déficientes, et d’amener ainsi l’identification des deux prix.
Examinons, en effet, ce qui se passe, d’une part, quand il y a surabondance de l’offre, d’une autre part, quand il y a déficit.
Lorsque l’offre du travail dépasse la demande, et que, par suite de cette circonstance, le prix courant vient à tomber progressivement au dessous du prix naturel comprenant les frais de production et une part proportionnelle de produit net, la quantité excédante de l’offre doit finir par disparaître du marché, soit qu’elle se détruise ou se déplace. Cela arrive nécessairement si les frais de production du travail cessent d’être couverts, puisque, en ce cas, le personnel de la production ne peut plus s’entretenir et se renouveler d’une manière suffisante. Cela arrive encore, mais d’une manière moins prompte et moins certaine, si les travailleurs sont privés simplement de leur part proportionnelle de produit net. Dans ce cas, ils peuvent, en effet, continuer de subsister, seulement ils sont moins encouragés à renouveler leur personnel et plus excités, au contraire, à mettre la portion de revenu qu’ils consacraient à ce renouvellement, sous la forme d’autres agents productifs, dont la part s’est accrue aux dépens de la leur, et à déterminer ainsi, par la diminution des quantités offertes, le relèvement du prix courant au niveau du prix naturel.
Lorsque, au contraire, la demande du travail est supérieure à l’offre dans une branche quelconque de la production, — et on pourrait supposer également qu’il en fut ainsi dans toutes [I-227] les branches, — lorsque le prix courant s’élève, en conséquence, au dessus du prix naturel ou nécessaire, qu’arrive-t-il? C’est que les travailleurs appartenant à cette catégorie obtiennent une part de produit net supérieure à celle dont jouissent les travailleurs des autres catégories ainsi que les détenteurs des autres agents productifs; c’estt qu’ils obtiennent en sus de leur part naturelle ou nécessaire une véritable prime ou rente. Or, l’appât de cette prime ou de cette rente ne peut manquer d’attirer dans la branche favorisée un supplément de travail, et l’attraction est d’autant plus vive que la prime est plus forte, c’est à dire que le prix courant s’élève davantage au dessus du prix naturel. La quantité offerte s’augmente ainsi d’une manière progressive, et le prix s’abaisse jusqu’à ce qu’il se confonde de nouveau avec le prix naturel.
Cependant si, comme nous venons de le voir, le prix courant du travail gravite vers le prix naturel, sous une impulsion analogue à celle qui détermine la chute des corps (et l’on peut dire que cette loi des forces économiques n’est qu’une division de la loi générale des forces), si, en conséquence, la part du travailleur dans la production tend à prendre toujours son niveau juste et utile, il n’en est pas moins vrai que, dans la pratique, cette impulsion et cette tendance, si énergiques qu’elles soient, se trouvent communément en lutte avec des causes perturbatrices qui les contrarient et les neutralisent presque toujours au détriment du travailleur.
Ces causes de désordre n’agissent pas seulement, à la vérité, pour troubler l’action régulatrice de la loi des quantités et des prix dans l’échange du travail, mais encore dans tous les autres échanges. Seulement elles apparaissent ici avec plus de fréquence et d’intensité qu’ailleurs.
[I-228]
Nous allons voir en quoi elles consistent, comment elles agissent et de quelle manière elles peuvent être éliminées.
En montrant plus haut comment agit la loi des quantités et des prix pour ajuster le prix courant du travail avec son prix naturel, nous avons supposé que cette loi ne rencontrait aucun obstacle, qu’elle agissait librement dans un milieu libre.
Nous nous sommes placé, en d’autres termes, dans l’hypothèse de l’entière liberté du marché du travail. Nous avons supposé que le travailleur est le maître d’offrir ses services dans la quantité, dans le temps, dans le lieu et dans le mode d’emploi et d’échange le plus utiles, et qu’il possède, en même temps, la capacité nécessaire pour gouverner convenablement cette offre, de telle façon qu’aucun obstacle extérieur ou intérieur n’en vienne contrarier ou troubler l’impulsion naturelle. Nous avons supposé encore que la demande du travail, ou, ce qui revient au même, l’offre de l’argent, des denrées ou des services à échanger contre du travail, s’effectue dans des conditions analogues.
Si ces conditions de liberté n’existent point ou n’existent que d’une manière partielle, — et tel est malheureusement le cas ordinaire pour le travail, — s’il y a des circonstances naturelles ou artificielles qui mettent l’une des parties en présence à la merci de l’autre; si, par exemple, l’une se trouve obligée de livrer quand même, à un certain moment, dans un certain lieu et dans un certain mode d’emploi et d’échange, toute la quantité de travail dont elle dispose, tandis que l’autre demeure maîtresse de réduire ou d’augmenter à son gré son offre d’argent, de denrées ou de services, comme aussi de mobiliser cette offre dans l’espace et dans le temps, de choisir le mode d’emploi et d’échange qui lui convient le mieux, la liberté du marché [I-229] cessera évidemment d’exister, le jeu de la loi régulatrice des valeurs se trouvera obstrué ou faussé, et le prix courant du travail pourra demeurer, sous l’influence de cette cause perturbatrice, fort au dessous du prix naturel.
C’est ainsi que les choses se passent sous l’influence de l’esclavage et du servage, c’est à dire de l’assujettissement à des degrés divers du producteur de travail à l’acheteur. Quel est l’effet de cet assujettissement? C’est de détruire au profit de l’acheteur toute liberté du marché, c’est d’obliger l’esclave et, à un certain degré, le serf de livrer son travail dans la quantité, dans le temps, dans le lieu et dans le mode qui conviennent au maître, tandis que celui-ci ne fournit en échange, en denrées, en services fonciers ou en argent que la quantité qu’il lui convient de fournir quand, où et comme il le juge bon.
Entre l’esclave et le serf d’une part, le maître de l’autre, il n’existe donc pas de marché libre. Le maître use ou abuse de la supériorité de sa force pour contraindre l’esclave ou le serf à lui offrir une quantité maximum de travail, tout en n’offrant, de son côté, qu’un minimum d’entretien, de services fonciers ou de monnaie.
Est-ce à dire cependant que la servitude ait reposé uniquement depuis les premiers âges du monde jusqu’à nos jours sur un abus de la force? Et faut-il, en conséquence, considérer ce phénomène comme ayant été et étant encore absolument injuste et nuisible? Nous ne le pensons pas. Le phénomène de la servitude est, en effet, complexe. On y trouve en l’analysant: 1° un monopole d’exploitation, lequel a pu être et a été même trop souvent abusif; 2° une tutelle, laquelle est, au contraire, le plus souvent juste et nécessaire.
Examinons successivement, dans ces deux éléments de nature [I-230] diverse qui le composent, monopole d’exploitation et tutelle, le phénomène de la servitude.
I. Le Monopole D’exploitation. La servitude apparait d’abord sous l’aspect d’une prise de possession de certains hommes par d’autres, en vue de l’exploitation et de la mise en valeur de leurs facultés productives. L’homme dompte l’homme et l’assujettit, grâce à la supériorité de ses forces physiques, intellectuelles et morales, absolument comme il dompte et assujettit le cheval, l’éléphant, le chameau et les autres animaux qu’il fait passer de l’état sauvage à l’état domestique. A l’origine, on ne faisait même, à cet égard, aucune différence. On assujettisait l’homme sauvage et on le rédnisait à l’état de domesticité comme tout autre animal. On l’élevait, on le dressait pour l’usage auquel ses aptitudes semblaient le rendre le plus propre ou qui constituait pour le maître l’emploi le plus avantageux, et on s’efforçait d’en extraire, comme de tout autre animal encore, un maximum de services en échange d’un minimum de frais d’entretien. Ainsi que l’attestent les écrits du vieux Caton, les Romains, par exemple, étaient particulièrement experts dans cette branche de l’économie rurale. Quant au mode d’exploitation des esclaves, il ne différait pas non plus de celui des autres bêtes de somme. On les élevait ou pour les exploiter soi-même, ou pour les vendre, ou pour les louer, et on les multipliait plus ou moins, comme on fait pour le bétail, selon qu’ils constituaient un emploi des capitaux plus ou moins profitable. Le produit qu’on en tirait, en les employant soi-même, en les vendant ou en les louant, devait rembourser leurs frais d’élève et d’entretien, compenser les risques de maladie, de fuite, de vieillesse et de mort auxquels ils étaient sujets, de telle sorte que le capital investi sous cette forme pῦt toujours se trouver [I-231] rétabli comme s’il avait été investi sous forme d’immeubles, de denrées, de métaux précieux, etc., en donnant en sus les profits ordinaires de l’emploi des capitaux [22]
On dut particulièrement multiplier les esclaves dans les sociétés primitives, et la raison en est simple. L’outillage agricole et industriel étant alors dans l’enfance, on était obligé d’appliquer la force physique de l’homme à la plupart des travaux que nous exécutons aujourd’hui au moyen de la force [I-232] mécanique. Dans l’Inde, en Assyrie et en Égypte, les esclaves, soit qu’ils formassent des propriétés individuelles, soit qu’ils fussent agglomérés en propriétés collectives, paraissent avoir été innombrables. La prodigieuse fécondité du sol et la douceur du climat permettaient, en effet, de les entretenir au moyen du produit d’une faible partie de leur travail. Le restant constituant le produit net de leur exploitation fournissait un large revenu à leurs propriétaires qu’il stimulait par là même à les multiplier. Lorsqu’ils étaient, comme dans l’Inde et en Égypte, possédés par de puissantes corporations mi-partie religieuses mi-partie militaires, on appliquait une forte proportion de l’excédant de leur travail à la construction d’œuvres monumentales, temples, pyramides, etc., luxe colossal qui ne se retrouve point dans les pays où l’homme asservi apparaît sculement à l’état de propriété individuelle ou patrimoniale.
Mais, soit que l’esclave fῦt possédé par des corporations ou par des familles, il constitua pendant des siècles la plus forte part du capital productif de la société. Car il tenait lieu des machines dont nous nous servons aujourd’hui pour cultiver le blé et le transformer en pain, transporter les hommes et les choses, filer, tisser et façonner nos vêtements. Il était, pour tout dire, le moteur universel de la production matérielle.
II. La Tutelle. Si la servitude ne contenait rien de plus qu’un monopole d’exploitation de l’homme par son semblable, elle ne se justifierait ni sous le rapport économique ni sous le rapport moral, et l’on s’expliquerait difficilement que l’immense majorité de l’espèce humaine s’y fῦt pendant tant de siècles docilement soumise. Mais elle contient autre chose qu’une exploitation de travail à prix non débattu, et, le plus souvent, abusive, elle contient encore une tutelle, le plus souvent utile.
[I-233]
Toutes les races d’hommes comme toutes les individualités humaines n’ont pas été créées égales. Il existe entre elles des différences que l’observation la plus superficielle suffit pour révéler. Non seulement, les hommes sont inégaux sous le rapport de la force physique, chose aisée à constater, mais ils ne le sont pas moins sous le rapport des forces morales et intellectuelles. Prenons pour exemple le nègre. Quoiqu’il y ait parmi les nègres un bon nombre d’individualités supérieures au commun de la race blanche, la masse considérée dans son ensemble apparaît comme sensiblement inférieure. Au point de vue moral et intellectuel, on peut assimiler le nègre à un enfant de race civilisée, qui, arrivé à l’âge de sept ans, aurait acquis les proportions physiques et la virilité d’un homme [23] . Cet enfant [I-234] serait-il capable de se gouverner lui-même? Non, à coup sῦr. Car ce n’est point avec de la force physique que l’homme se gouverne, c’est au moyen de ses forces morales et intellectuelles. Un enfant de sept ans, grand et fort comme un homme, n’en serait pas moins un enfant, et il lui faudrait un tuteur.
Cette nécessité de la tutelle pour les enfants et même, jusqu’à un certain point, pour les femmes n’est point niée par les plus ardents amis de la liberté. Pourquoi? Parce que l’expérience démontre que les enfants, sans parler des femmes, ne possèdent point les forces intellectuelles et morales requises pour un bon gouvernement de soi-même. Qu’arriverait-il si on [I-235] ne les soumettait point à une tutelle? si les enfants étaient abandonnés à leur propre gouvernement avant d’avoir acquis la capacité de se gouverner? Il arriverait que leurs actes ne seraient qu’une série de nuisances pour eux-mêmes et pour les autres, que les jeunes générations se dépraveraient et finalement se détruiraient. Eh bien! il en serait de même pour les hommes-enfants, qui se rencontrent, ajoutons-le, au sein de toutes les races, mais en majorité parmi les unes, en minorité seulement parmi les autres. Nous achèverons de nous en convaincre en recherchant en quoi consiste, sous le rapport économique, le gouvernement de soi-même.
[I-236]
Il concerne: 1° la production; 2° la consommation.
I. La production. L’homme est obligé de produire toutes les choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. Or sa production ne doit pas se proportionner seulement aux besoins du présent, mais elle doit pourvoir encore aux éventualités de l’avenir. L’homme, en effet, n’est pas apte à produire pendant toute la durée de son existence, et, même pendant son âge de travail, il est sujet à des maladies et à des accidents qui le contraignent à chômer. Ce n’est pas tout. Communément, il n’est pas responsable seulement de son existence. Il est poussé à s’associer un être plus faible et à fonder une famille. Envers cette famille, et, d’une manière générale, envers les êtres auxquels il a donné le jour, il contracte des obligations naturelles, dont l’importance varie, mais qui ont le caractère de dettes positives et dont le non-acquittement occasionne des nuisances [24] . Il est tenu de pourvoir à l’entretien de sa femme, de nourrir et d’élever ses enfants, en leur faisant l’avance des frais d’éducation et d’apprentissage. S’il manque à ces obligations envers lui-même et envers les siens, qu’arrive-t-il? C’est d’abord qu’il impose à autrui le fardeau de son entretien lorsque les maladies et la vieillesse le rendent incapable de travailler; c’est ensuite qu’il est obligé de condamner sa femme à des travaux incompatibles avec les fonctions de la maternité et ses enfants, dont il est le tuteur naturel, à un labeur hâtif et destructeur, à moins encore qu’il n’impose à autrui les frais de leur entretien. Il faut donc qu’il sache proportionner librement, sans qu’on l’y [I-237] contraigne, la durée et l’intensité de son travail à l’étendue et au poids de ses obligations, ou qu’il proportionne ses obligations à la productivité de son travail.
II. La consommation. Il ne lui suffit pas de proportionner sa production aux nécessités qui pèsent sur lui, et dont il n’a aucun droit de reporter le poids sur autrui, il faut encore qu’il sache gouverner sa consommation de manière à subvenir aux besoins et aux obligations de l’avenir comme à ceux du présent. S’il manque de prévoyance, s’il s’adonne à l’intempérance, à l’incontinence et aux autres vices, il sera réduit, tôt ou tard, si productif que puisse être son travail, à faire banqueroute à lui et aux siens, en rejettant indῦment sur la société un fardeau qu’il n’a pas su porter.
De cette analyse, il résulte visiblement que l’homme ne peut être justement et utilement laissé libre, autrement dit, maître de gouverner sa production et sa consommation, qu’à la condition de posséder la capacité nécessaire pour supporter la responsabilité attachée à la liberté.
S’il ne la possède point, l’intérêt commun, dans lequel est compris le sien propre, exige ou qu’il soit mis en tutelle ou qu’il soit exclu de la communauté pour laquelle il est une nuisance.
La tutelle peut être libre ou imposée.
Elle peut être libre, si l’incapable se reconnaît lui-même impropre à supporter le fardeau de la responsabilité attachée à la liberté, s’il refuse en conséquence une liberté qui serait pour lui comme pour les autres un présent funeste, et s’il se soumet volontairement à la tutelle dont il a besoin.
Elle doit être imposée, si l’incapable est ou trop peu intelligent ou trop dépravé pour demander volontairement cette tutelle nécessaire. Mais comment reconnaître et constater son [I-238] incapacité, sans s’exposer à commettre des erreurs funestes? Évidemment, en laissant d’abord agir l’incapable et en le jugeant d’après ses actes. S’il agit d’une manière nuisible à lui et aux autres, on sera autorisé, soit à lui infliger une tutelle pénale, soit à l’expulser d’une société pour laquelle il est une nuisance.
L’esclavage a été la forme rude et primitive de la tutelle. Les vices de cette forme sont faciles à reconnaître. D’abord, l’esclavage ayant eu généralement le caractère d’une tutelle imposée, on y a assujetti à la fois des individualités qui avaient besoin d’ une tutelle et des individualités qui n’en avaient pas besoin, en sorte que s’il était utile aux unes il était nuisible aux autres.
Ensuite, par cela même que l’esclavage était une tutelle imposée. sans que l’esclave fῦt admis à en débattre les conditions et sans qu’aucun pouvoir supérieur stipulât en sa faveur, il se trouvait à l’entière discrétion de son tuteur. Qu’en résultait-il? C’est que le tuteur, considérant le plus souvent ses pupilles non comme des hommes-enfants, mais comme une variété supérieure de bêtes de somme, s’attachait uniquement à extraire d’eux un maximum de travail en échange d’un minimun de frais d’entretien; ce qui revient à dire qu’il se faisait payer son service de tuteur à un taux usuraire. Grâce au monopole qu’il possédait vis-à-vis de l’esclave, il pouvait, en effet, n’imposer aucun frein à ses exigences. Cependant son intérêt bien entendu l’obligeait toujours à ménager jusqu’à un certain point les forces de ses esclaves et à leur fournir la rétribution nécessaire pour s’entretenir en vigueur et en santé comme aussi pour se reproduire dans les proportions réquises par l’état du marché de travail. Quelquefois même, il leur abandonnait un [I-239] pécule, c’est à dire une portion de produit net pour les stimuler au travail, en ouvrant à ceux qui, devenus peu à peu capables d’être libres, en ressentaient le désir, la perspective de l’affranchissement.
En résumé, le maître fournissait à ses esclaves, d’une manière permanente et assurée, les choses indispensables à leur entretien et à leur reproduction en échange du travail qu’il tirait d’eux. Mais il s’attribuait communément toute la part propornelle de produit net afférente à ce travail. Cette part leur serait revenue s’ils avaient été libres, dans l’hypothèse où ils auraient été aussi capables que l’étaient les maîtres d’exploiter utilement leurs facultés productives, dans l’hypothèse aussi où ils auraient su régler économiquement leur consommation. En revanche, si, comme c’était le cas ordinaire, cette double capacité leur avait fait défaut, ils n’auraient pu, quoique libres, obtenir une rétribution équivalant à celle qui leur était laissée comme esclaves, si durs et si rapaces que pussent être leurs maîtres. Selon toute apparence, elle ne leur aurait point suffi pour se multiplier ni même pour se conserver. Ils étaient donc intéressés, dans leur incapacité de se servir à eux-mêmes de tuteurs, à acheter une tutelle, si cher qu’on la leur fit payer. La preuve c’est que dans les pays, tels que la Nouvelle Hollande, la Nouvelle Guinée et la Terre Van Diemen, où il ne s’est point rencontré de race supérieure capable de se charger de la tutelle des classes inférieures, celles-ci sont demeurées dans la plus abjecte barbarie. Cela n’empêchait point toutefois que l’industrie de la tutelle ne s’exerçât à des conditions usuraires, ceux qui fournissaient ce service indispensable ne permettant à ceux qui le recevaient ni de le refuser ni d’en débattre le prix.
[I-240]
L’esclavage était donc parfois une nuisance,—lorsqu’il s’imposait à des individu alités capables de liberté, — et presque toujours une usure, en ce qu’il faisait surpayer la tutelle qui s’y trouvait contenue.
Les résultats de cette tutelle varient naturellement selon la manière dont on l’exerce. Lorsqu’elle est de qualité supérieure et point trop chère, elle fait croître et mῦrir rapidement les facultés morales et intellectuelles de ceux qui la reçoivent, et elle finit, en conséquence, au bout d’un nombre plus ou moins considérable de générations, selon que leur point de départ est plus ou moins bas, par les rendre capables de se gouverner eux-mêmes. La croissance des facultés morales et intellectuelles qui sont les matériaux à l’aide desquels l’homme se gouverne lui-même, s’accomplit, en effet, l’expérience l’atteste, non seulement dans l’individu, mais encore dans la génération. L’éducation modifie le moral de l’homme aussi bien que son physique, et cette modification est transmissible. Les générations peuvent ainsi se perfectionner comme elles peuvent se dégrader, selon qu’elles conservent, accroissent ou diminuent leur capital de forces physiques, morales et intellectuelles. On ne peut donc pas plus se hasarder à dire, comme le font les esclavagistes ultras, qu’il existe des races naturellement vouées à une servitude perpétuelle qu’on ne peut affirmer que les races actuellement libres s’en trouvent affranchies à jamais. Il est possible, par exemple, si étrange et exorbitante que la chose paraisse à notre orgueil, que la race blanche en se dégradant, finisse par tomber sous la tutelle des races de couleur relevées et améliorées, comme les anciens maîtres du monde sont tombés sous le joug des races barbares au sein desquelles se recrutaient leurs légions d’esclaves.
[I-241]
A mesure que les classes asservies deviennent plus capables de se gouverner elles-mêmes, on voit l’esclavage se modifier et, le plus souvent, faire place au servage, c’est à dire à un état de demi-tutelle. Tandis que le maître gouverne entièrement l’esclave, en se chargeant d’assurer son existence au prix de la totalité de son travail, le serf se gouverne en partie luimême. Le maître se borne communément à lui fournir: 1° la portion de terre nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; 2° la justice et la sécurité dont il a besoin; 3° des secours en cas d’accidents, de maladies, de vieillesse, etc., sauf à lui interdire, par exemple, les mariages hâtifs, à réprimer son intempérance, etc. Le prix de cette demi-tutelle se règle comme celui de la tutelle entière sous le régime du monopole, puisque le serf est attaché à la glèbe, autrement dit à la terre seigneuriale et qu’il n’existe point, en conséquence, entre son seigneur et lui, de libre débat pour les conditions de la tutelle.
Ces deux formes primitives de la tutelle, viciées par le monopole, sont par là même destinées à disparaître comme tout ce qui est fondé sur le monopole, mais est-ce à dire que la tutelle doive disparaître avec elles? Que tous les hommes, quels que soient leur race, leur état de civilisation, le milieu social où ils vivent, possèdent dès à présent la capacité nécessaire pour se gouverner eux-mêmes? Qu’il faille, en conséquence, non seulement leur accorder la liberté de se gouverner mais encore la leur imposer? Nous ne le pensons pas, et, comme preuve à l’appui, nous pourrions signaler ce fait caractéristique que jamais, dans le monde civilisé, la tutelle n’a été plus demandée. A quoi nous pourrions ajouter que tout en prohibant ou en entravant l’offre de la tutelle [I-242] libre, on développe de plus en plus celle de la tutelle de l’État, c’est à dire d’une autre forme de la tutelle monopolisée. Cette demande générale de tutelle, chez les races civilisées (exception faite peut-être de la seule race anglo-saxonne) n’atteste-t-elle pas combien, à plus forte raison, la tutelle doit être encore nécessaire chez les races à demi ou tout à fait barbares? Or si ce besoin existe pourquoi empêcher qu’il se satisfasse? Au double point de vue du juste et de l’utile, peut-on imposer le gouvernement de soi-même à des êtres qui sont incapables de l’exercer? Au point de vue du juste d’abord. Si l’homme est propriétaire de son fonds de valeurs personnelles n’a-t-il pas le droit non seulement d’en user mais encore d’en disposer à sa guise, par voie de don, d’échange, de prêt et à telles conditions qu’il peut lui convenir de stipuler? Lui en interdire ou en limiter la disposition, en prohibant par exemple les engagements à vie, n’est-ce pas, sous le prétexte d’assurer sa liberté, la détruire? Au point de vue de l’utile. Si un homme se reconnaît incapable de se gouverner lui-même ou si son incapacité est attestée par ses actes, n’est-ce pas lui causer un dommage positif que de l’empêcher d’échanger une liberté qui lui est nuisible contre une tutelle qui lui est utile? En d’autres termes, s’il ne peut parvenir à couvrir les frais de production de sa liberté et en retirer un bénéfice, si son selfgovernment se solde en déficit, si son capital de valeurs personnelles diminue et se détruit au lieu de s’accroître, n’est-ce pas le vouer à la misère et à la ruine que de le contraindre à conserver une liberté dont il est incapable d’user utilement? N’est-ce pas encore, si les incapables auxquels on impose ainsi une liberté nuisible sont nombreux, préparer l’affaiblissement et la ruine de la société elle-même?
[I-243]
Remarquons à ce propos qu’à mesure que la société se développe et que la civilisation progresse, que la sphère d’action de la liberté humaine s’étend en conséquence, la sphère de la responsabilité s’étend aussi. C’est donc une erreur de croire, comme on le fait généralement, que la tutelle n’ait été nécessaire aux individualités inférieures que dans les premiers âges de l’humanité. Elle ne l’est peut-être pas moins de nos jours, car l’incapacité à se gouverner soi-même peut engendrer des désordres plus graves dans une société dont l’organisme s’est développé et perfectionné que dans une société d’une contexture primitive: et si elle ne peut plus avoir comme autrefois pour résultat final de livrer la civilisation affaiblie et corrompue aux barbares du dehors, elle peut encore la livrer aux barbares du dedans, et amener sa ruine par des révolutions, c’est à dire par des débordements de la barbarie intérieure non moins destructifs que ceux de la barbarie extérieure.
Soit donc que l’on se place au point de vue du juste ou de l’utile, de l’intérêt individuel ou de l’intérêt social, la prohibition ou la limitation du droit de disposer de la liberté aussi bien que d’en user, autrement dit la prohibition ou la limitation de la tutelle apparaissent comme également nuisibles. Quoi qu’en dise une certaine école égalitaire (singulièrement inconséquente du reste, car tout en fulminant l’anathème contre la servitude, elle la rétablit sous la forme de la tutelle monopolisée de l’État), le progrès ne consiste point à abolir la tutelle, en imposant indistinctement la liberté à toutes les individualités humaines, qu’elles soient ou non capables d’en user [25] , [I-244] mais simplement à transformer la tutelle et à la perfectionner en la faisant passer du régime du monopole à celui de la libre concurrence.
Voilà malheureusement ce que n’ont pas compris les philanthropes honnêtes et bienveillants, mais trop peu économistes, quiont pris entre leurs mains la cause de l’abolition de l’esclavage des nègres. C’est pourquoi, comme nous l’avons constaté ailleurs [26] , leurs efforts égarés dans une fausse voie ont été jusqu’à présent plus nuisibles qu’utiles.
Les abolitionnistes n’ont aperçu en effet que le côté vicieux du phénomène de l’esclavage, savoir l’exploitation usuraire du travail, engendrée par le monopole; ils n’en ont pas voulu considérer le côté utile, savoir la tutelle, et ils ont entrepris, en conséquence, de supprimer la tutelle avec le monopole, en imposant la liberté aux nègres, soit par voie de prohibition du commerce des esclaves, soit encore par voie d’expropriation des ateliers coloniaux. Les résultats sont loin d’avoir répondu à leur attente, et l’on commence à s’apercevoir aujourd’hui qu’en cette affaire comme en bien d’autres, les procédés de la liberté eussent été préférables à ceux de la prohibition. L’interdiction de la traite, par exemple, n’a eu pour résultat que d’aggraver le sort des victimes de ce commerce, devenu interlope, et [I-245] l’expropriation des ateliers d’esclaves pour cause de philanthropie en livrant les nègres à eux-mêmes, c’est à dire, le plus souvent, à des maîtres pires encore que ne l’étaient les planteurs, n’a point amélioré la condition morale et matérielle du plus grand nombre, tout en imposant d’énormes sacrifices à la métropole et aux colonies. Supposons qu’au lieu de recourir à ces procédés anti-économiques, les abolitionnistes se fussent bornés à demander que le commerce de travail engagé soit à temps soit à vie cessât d’être monopolisé par des compagnies privilégiées, comme il l’était sous l’ancien régime; qu’il fῦt abandonné désormais, sans entrave aucune, à la libre concurrence, et placé, comme tout autre, sous la protection et la surveillance des lois, que serait-il arrivé? Que le développement naturel du commerce libre de travail engagé aurait inévitablement agi pour améliorer les conditions morales et matérielles de l’engagement, tandis que l’intervention des pouvoirs publics aurait as suré l’exécution loyale des contrats. Peu à peu, soit par la nomination de tuteurs d’office chargés de suppléer au défaut de capacité des engagés et de stipuler pour eux, soit par d’autres moyens, les pratiques de violence et de fraude qui déshonoraient ce commerce auraient disparu, et la traite aurait cessé d’être un trafic usuraire de travail esclave pour devenir un commerce légitime de travail engagé à temps ou à vie. Tandis encore que la prohibition pure et simple, en rendant ce commerce interlope sans le détruire, l’a fait tomber entre les mains d’individus sans moralité et généralement dépourvus de ressources suffisantes, il aurait continué, selon toute apparence, de s’exercer, sous un régime de liberté, comme auparavant sous le régime du privilége, au moyen de puissantes associations. En se multipliant sous l’impulsion de la demande croissante du [I-246] travail engagé, ces associations se seraient, selon toute apparence aussi, divisées, ce qui aurait amené un nouveau progrès dont les engagés auraient particulièrement profité, savoir: la spécialisation de la tutelle.
Comme on l’a fait remarquer souvent, le planteur de sucre, de coton, etc., n’est pas intéressé comme planteur à posséder des esclaves. Son intérêt est de se procurer du travail, aussi abondamment et à aussi bon marché que possible, que ce travail soit libre, engagé ou esclave.
Sans doute, à titre de propriétaire exploitant d’un atelier d’esclaves, il réalise un bénéfice spécial, parfaitement distinct de son bénéfice de producteur de sucre, de coton, etc. Mais il est clair que ce second bénéfice nuit au premier; que si le producteur de sucre, de coton, etc., au lieu d’être à la fois planteur et propriétaire exploitant d’un atelier d’esclaves, n’était que planteur; s’il recouvrait, par conséquent, la disponibilité du capital engagé dans son atelier d’esclaves, ainsi que celle de la portion d’activité industrieuse qu’il consacre à la gestion de cet atelier, et s’il appliquait cette portion de capital et d’activité au développement de ses plantations, il retirerait désormais de son industrie, ainsi unifiée et spécialisée, un revenu supérieur à celui que lui fournissent les deux industries, essentiellement diverses, auxquelles il est obligé de se livrer. De même, l’exploitation du travail engagé ne manquerait pas de se perfectionner en se spécialisant.
Or ce progrès de la division du travail n’aurait certainement pas manqué de se réaliser à mesure que le commerce et l’exploitation du travail engagé se seraient librement développés. Aux compagnies ayant pour fonction d’acheter cette marchandise aux lieux de provenance seraient venues s’en joindre d’autres [I-247] qui se seraient spécialement chargées de la revendre aux consommateurs. Grâce à ces nouveaux intermédiaires, les planteurs n’auraient plus eu à s’occuper de la gestion détaillée des ateliers d’esclaves. Ils auraient acheté en bloc comme tout autre matière première, le travail nécessaire à leurs cultures, en se bornant à en surveiller la livraison, sans avoir, du reste, à s’occuper des moyens à employer pour l’obtenir. Enfin, ils auraient pu payer aussi, comme toute autre matière première, cette marchandise indispensable, soit au comptant, soit au moyen de traites à échéances correspondant à celles du paiement de leurs produits.
C’est ainsi seulement, on peut l’affirmer, c’est à dire par le développement du commerce et de l’exploitation libres du travail engagé, que l’esclavage pourra être aboli, absolument comme le prêt usuraire qui est, pour ainsi dire, le pendant de l’exploitation du travail esclave, après avoir résisté à toutes les prohibitions, disparaît peu à peu aujourd’hui sous l’influence du développement du commerce et de l’exploitation libres des capitaux. Déjà, du reste, le commerce de travail engagé quoique encore entravé et limité (les engagements à vie, par exemple, les plus avantageux de tous aux travailleurs, sont demeurés prohibés), s’accroît rapidement, en dépit des anathèmes des abolitionnistes de la vieille école, et il a permis aux colonies anglaises et françaises de se relever en partie de la situation désastreuse où les avaient plongées la suppression de la traite et l’abolition de l’esclavage.
Lorsque ce commerce s’exercera sous un régime de pleine liberté, on peut affirmer que:
Le prix courant du travail engagé finira, comme celui de toute autre marchandise, par se confondre avec ses frais de production [I-248] augmentés d’une part proportionnelle de produit net, sous déduction du prix courant de la tutelle, réduit au taux nécessaire pour rémunérer et développer dans la proportion utile, ce genre de commerce ou d’industrie.
[I-249]
DIXIÈME LEÇON↩
la part du travail (fin)
De la part éventuelle ou profit. — De quoi se compose le profit. — Son taux naturel et son taux courant. — De la part fixe ou salaire. — Raison d’être de cette forme de la rémunération du travail. — Pourquoi l’Association intégrale n’est pas possible. — Que le travailleur n’a aucun avantage à recevoir sa rémunération sous forme d’une part éventuelle plutôt que sous forme d’une part fixe. — Causes perturbatrices qui font descendre le salaire au dessous de son taux naturel et nécessaire. — De l’insuffisance du développement du commerce de travail ou marchandage. — Maux qul en résultent pour l’ouvrier. — Infériorité de sa situation vis-àvis de l’entrepreneur. — Conséquences: avilissement du salaire, abaissement de la qualité du travail. — Que cette situation ne présente à l’entrepreneur d’industrie que des avantages illusoires. — Comparaison avec le commerce des grains. — Bienfaits qui résulteraient pour l’ouvrier et pour l’entrepreneur d’industrie du développement normal de ce commerce. — Causes qui ont jusqu’à présent entravé ce développement. — Progrès que le marchandage rendrait possibles.
Jetons maintenant un coup d’œil sur les circonstances perturbatrices qui empêchent trop souvent le prix courant du travail libre de se confondre avec son prix naturel.
[I-250]
Quel usage le travailleur libre peut-il faire de son fonds de facultés productives, autrement dit de son capital de valeurs personnelles?
I. Il peut l’employer pour son propre compte, isolément ou par association, en entreprenant une industrie avec l’auxiliaire d’un capital de valeurs mobilières et immobilières. Dans ce cas, la rémunération de son travail se compose de la portion de produit qui excède les frais de sa production, en comprenant dans ces frais la rémunération du travail et du capital qui lui servent d’auxiliaires. Ordinairement, les travailleurs qui fondent une entreprise, individuellement ou par association, y engagent et y exposent non seulement leur capital de valeurs personnelles, mais encore un capital de valeurs immobilières et mobilières; en sorte que l’excédant de la production, les frais étant couverts, ou le profit, se partage entre leur travail (valeurs personnelles) et leur capital (valeurs mobilières et immobilières). Les écrivains anglais ne distinguent pas d’habitude ce qui, dans le profit, revient à l’un de ce qui revient à l’autre, quoiqu’il y ait lieu évidemment de différencier ces deux parts. En tous cas, le profit, soit qu’il représente seulement la rémunération du travail de l’entrepreneur, soit qu’il représente la rémunération du travail et du capital que l’entrepreneur engage et expose dans la production, le profit est gouverné par les lois générales de l’offre et de la demande et des frais de production. Il a son taux naturel et son taux courant. Son taux naturel, c’est la rétribution nécessaire à l’entrepreneur pour conserver et augmenter dans la proportion utile son capital de valeurs personnelles et, communément aussi, de valeurs mobilières et immobilières. Son taux courant est déterminé: 1° par le montant des frais de production, en [I-251] y comprenant le loyer du travail et du capital auxiliaires; 2° par le prix auquel se réalisent les produits. La différence, c’est le profit. Or qu’arrive-t-il lorsque le taux des profits d’une industrie vient à s’élever au dessus ou à demeurer au dessous de celui des autres industries? C’est que le travail et le capital d’entreprises y affluent ou s’en éloignent; en sorte que, comme nous l’avons remarqué déjà, l’équilibre tend toujours à s’établir (sauf les différences naturelles des risques, etc.) entre les profits des différentes branches de la production. Qu’arrive-t-il encore, lorsque le taux courant des profits s’élève dans une industrie au dessus ou tombe au dessous de son taux naturel ou nécessaire? C’est que le travail et le capital d’entreprises y affluent ou s’en éloignent jusqu’à ce que le niveau se trouve encore rétabli. Sans doute, les variations des profits sont incessantes, car les éléments dont ils dépendent, frais de production d’une part, prix des produits de l’autre sont essentiellement variables. Mais à travers toutes ces variations surgit un taux moyen courant des profits qui gravite perpétuellement dans toutes les branches de la production autour du taux naturel et nécessaire de la rémunération de l’entrepreneur d’industrie.
Sous un régime de liberté industrielle, tous les travailleurs ont le droit d’entreprendre une industrie; mais une faible minorité seulement en a la possibilité. D’abord parce que le travail de l’entrepreneur exige généralement certaines qualités intellectuelles et morales assez rares; ensuite parce que bien peu possèdent le capital dont la coopération est indispensable au travail d’entreprise ou peuvent se le procurer à des conditions utiles; enfin, parce que le nombre des entreprises possibles est toujours fort limité relativement an nombre des travailleurs. Remarquons à ce propos qu’à mesure que l’industrie [I-252] se développe sous l’influence du progrès des machines et des procédés de production, les grandes entreprises tendent davantage à se substituer aux petites. Or les grandes entreprises, exigeant la mise en œuvre de fonds productifs considérables, s’établissent par voie d’association ou de jonction des capitaux. Dans ce nouvel état de la production, les profits des entreprises vont uniquement aux capitalistes qui courent seuls désormais les risques de la production, et ils prennent, comme on sait, le nom de dividendes. Quant aux travailleurs, à tous les degrés, ils reçoivent leur rémunération sous la forme d’une part fixe et assurée, et ils retombent ainsi dans la seconde catégorie que nous allons examiner, à l’exception toutefois des directeurs et des administrateurs qui joignent communément à leur part fixe une part éventuelle dans les bénéfices.
En résumé, c’est seulement la minorité des travailleurs, exerçant la fonction spéciale d’entrepreneurs d’industrie qui reçoivent leur rémunération sous la forme d’une part éventuelle ou profit. Cette classe d’hommes, déjà relativement peu nombreuse, tend à diminuer à mesure que les entreprises s’agrandissent; et il y a apparence qu’elle finira en grande partie par disparaître dans l’évolution actuelle de l’industrie. Mais, en attendant, à moins que les entrepreneurs d’industrie ne possèdent un monopole naturel de certaines facultés réquises pour leur spécialité d’entreprises, ou, chose malheureusement plus fréquente, un monopole artificiel résultant de priviléges ou de restrictions qui limitent le développement de l’industrie, du commerce ou du crédit, ils ne peuvent obtenir pour l’emploi de leurs facultés productives, une rémunération supérieure à celle qui est nécessaire au maintien et au développement utile de leurs entreprises.
[I-253]
II. Le travailleur, et c’est le cas le plus fréquent, peut mettre ses facultés productives autrement dit son capital de valeurs personnelles au service d’autrui, et recevoir en échange une rémunération fixe ou salaire; absolument comme font les capitalistes qui mettent leurs valeurs mobilières ou immobilières au service d’autrui en recevant en échange un intérêt ou un loyer. Ces rémunérations ont entre elles une complète analogie: l’intérêt ou le loyer est le salaire des capitaux formés de valeurs mobilières ou immobilières, comme le salaire du travail est l’intérêt ou le loyer du capital formé de la valeur personnelle de l’ouvrier.
Les socialistes se sont accordés, comme on sait, à jeter l’anathème sur cette forme de la rémunération du travail. Cette phrase plus sonore que juste de M. de Chateaubriand: le salaire est la dernière transformation de la servitude, ils l’ont répétée et amplifiée à outrance. Ils ont affirmé que le salarié est inévitablement exploité par l’entrepreneur d’industrie et ils en ont conclu qu’aucune amélioration sérieuse ne pourrait être apportée au sort des classes laborieuses aussi longtemps que l’Association ne serait pas substituée au salariat, c’est à dire aussi longtemps que l’ouvrier ne recevrait point sa rémunération sous la forme d’une part éventuelle, dividende ou profit, au lieu de la recevoir sous la forme d’une part fixe ou salaire.
Recherchons donc quelle est la raison d’être de cette forme de la rémunération du travail, comment se détermine et se règle le salaire, et quelles circonstances ont pu motiver la réprobation dont il a été l’objet de la part des socialistes.
Supposons qu’il s’agisse de fonder une entreprise, une manufacture de coton, par exemple. Il faudra y engager et par là [I-254] même y exposer une certaine quantité de capital (valeurs mobilières et immobilières) et une certaine quantité de travail (valeurs personnelles). Il est évident qu’en suivant le cours naturel des choses, capital et travail ne pourront recevoir leur rétribution qu’après que le produit aura été réalisé. Ils pourront alors se partager le produit au prorata des valeurs engagées et exposées, sous la forme d’un dividende que recevront travailleurs et capitalistes.
Tel est, comme on sait, l’idéal de l’Association intégrale rêvé par les socialistes. Pourquoi cet idéal n’est-il réalisé nulle part? Pourquoi la grande majorité des travailleurs, comme aussi des capitalistes, au lieu d’être associés à part éventuelle dans les entreprises de production, n’en sont-ils que les auxiliaires à part fixe? A l’aide de quelles combinaisons reçoiventils par anticipation une part fixe et assurée dans un produit non réalisé et qui ne le sera peut-être point? Comment enfin se règle cette part?
Voilà quelques-unes des questions importantes que soulève le phénomène du salariat. La première de ces questions, savoir pourquoi les travailleurs sont pour la plupart salariés au lieu d’être associés aux entreprises de production, est facile à résoudre. Il suffit, pour en trouver la solution, de jeter un coup d’œil, d’une part, sur les conditions naturelles de la production, d’une autre part, sur la situation de l’immense majorité des travailleurs.
Dans toute industrie, les produits ne peuvent être achevés et réalisés qu’après un délai plus ou moins long. Dans la production agricole, il faut attendre que le grain ait mῦri pour le moissonner, et la récolte ne peut toujours être immédiatement réalisée avec avantage. Dans l’industrie cotonnière, il faut [I-255] attendre encore que le coton brut entré dans la manufacture en soit sorti sous forme de fils ou de tissus, et que ces fils ou ces tissus aient été vendus et payés. Il en est de mème dans toutes les autres branches de la production.
D’un autre côté, toute entreprise de production est assujettie à des risques plus ou moins nombreux et intenses. Quoiqu’on n’entreprenne une industrie qu’en vue d’en retirer un bénéfice, il peut arriver non seulement qu’on ne réalise point ce bénéfice, mais encore qu’on ne couvre pas même les frais nécessaires pour entretenir et renouveler les agents productifs.
Or, les travailleurs n’ont point généralement des ressources suffisantes pour attendre que les produits soient réalisés, non plus que pour supporter les risques de la production. D’ailleurs, alors même qu’ils posséderaient ces ressources, ils pourraient préférer le rôle d’auxiliaires de la production à part fixe à celui d’associés à part éventuelle. C’est ainsi qu’une nombreuse classe de capitalistes, quoique possédant les moyens nécessaires pour attendre la réalisation des produits à la formation desquels leurs capitaux contribuent, préfèrent recevoir leur rétribution sous la forme d’un intérêt fixe plutôt que sous la forme d’une part éventuelle, d’un profit ou d’un dividende.
Cela étant, l’Association intégrale, quoiqu’elle paraisse au premier abord la forme la plus naturelle des entreprises, était impossible. Il fallait trouver une combinaison qui permit d’obtenir le concours des travailleurs en leur fournissant la part anticipative et assurée qu’ils demandaient, au lieu de la part éventuelle que les entreprises de production pouvaient seulement leur offrir.
Cette combinaison a consisté à placer les travailleurs, comme aussi les capitalistes auxiliaires, dans la même catégorie que [I-256] les fournisseurs de matériaux et instruments divers qui servent à l’alimentation et au fonctionnement des entreprises. Ces matériaux et ces instruments, l’entrepreneur les achète au comptant ou à terme, en établissant le prix qu’il en peut offrir d’après le prix estimatif auquel il vend ses produits, la différence constituant son bénéfice. Tantôt il les achète à bon marché, tantôt il les achète cher, et il règle ses achats et sa production en conséquence. Comme les prix de toutes choses, qu’il s’agisse des matériaux et des instruments de production ou des articles de consommation, sont gouvernés par les lois de l’offre et de la demande et des frais de production, les entrepreneurs, considérés dans leur ensemble, paient le prix naturel et nécessaire de tous les éléments de leur production, et ils font, de même, payer leurs produits à leur prix naturel et nécessaire. En sorte que chacun ne reçoit, sauf les cas de monopole, que la rétribution indispensable pour maintenir et développer son industrie dans la proportion utile.
On pourrait admettre qu’il existât entre les entrepreneurs d’industrie et les différents coopérateurs industriels, capitalistes et travailleurs, une association universelle, en ce sens que chacun, au lieu de payer à un prix fixe les produits et les services dont il a besoin pour produire, les paierait au moyen d’une part éventuelle dans les résultats de sa production. Mais cela compliquerait les choses plutôt que de les simplifier, sans rien changer au surplus à l’action des lois qui gouvernent les prix de tous les produits ou services. Si le coton employé dans une manufacture, par exemple, se payait au moyen d’une assignation sur le produit brut, le montant de cette assignation s’élèverait plus ou moins selon l’état du marché des cotons, comme aujourd’hui la quantité de monnaie ou de valeurs monétaires que l’on [I-257] fournit en échange, et il n’en résulterait aucune amélioration dans l’économie de la société. Au contraire! Il en résulterait une agglomération anti-économique de trois opérations distinctes, le commerce, la spéculation industrielle et le crédit. Le négociant en cotons, en recevant, au lieu d’une somme fixe en valeurs monétaires, une assignation sur un produit éventuel, deviendrait par là même spéculateur industriel et prêteur de capitaux, et l’obligation où il se trouverait de cumuler des fonctions essentiellement diverses, au lieu de s’en tenir à sa spécialité, serait pour lui comme pour les autres une cause de retard et non de progrès. Ce que nous disons des producteurs et des marchands qui fournissent les matériaux et les instruments de la production, s’applique aussi bien aux capitalistes et aux travailleurs qui fournissent le capital et le travail auxiliaires des entreprises. On ne pourrait considérer comme un progrès une combinaison qui les rendrait participants quand même aux chances et risques des entreprises auxquelles ils fournissent le concours de leurs forces productives, que si, dans l’état actuel des choses, leur rétribution ne pouvait se régler d’une manière équitable et utile. Mais en est-il bien ainsi? En ce qui concerne le capital auxiliaire que les entrepreneurs d’industrie empruntent, il est clair que ce capital peut recevoir et reçoit sa rémunération sur un pied équitable et utile, soit qu’on le rétribue au moyen d’une part éventuelle ou au moyen d’une part fixe, et que l’une de ces deux formes de rémunération ne peut jamais être, au moins d’une manière constante, plus avantageuse que l’autre. Prenons pour exemple le capital d’une compagnie de chemins de fer. Ce capital est divisé en actions qui donnent droit à une part éventuelle ou dividende dans le produit de l’entreprise, et en [I-258] obligations qui donnent droit à une part fixe ou intérêt. Il est évident que si l’une de ces deux formes de rémunération devenait plus avantageuse que l’autre, les capitaux s’offriraient de préférence sous cette forme jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli. Il en est de même pour le travail. Comme le capital, le travail nécessaire à une entreprise peut recevoir sa rétribution sous la forme d’une part fixe ou d’une part éventuelle. En d’autres termes, les entrepreneurs qui demandent du travail peuvent offrir en échange soit une rétribution fixe en valeurs monétaires, soit une rétribution éventuelle en une assignation sur le produit variable et incertain de leurs entreprises. Supposons que cette dernière forme de rémunération fῦt plus avantageuse aux ouvriers que la première, ne la demanderaient-ils pas, de préférence, jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli? Mais la généralisation de la rétribution du travail, sous forme de part éventuelle dans les entreprises, constituerait-elle bien un progrès? L’ouvrier, devenant ainsi à la fois producteur de travail, spéculateur industriel et prêteur, pourrait-il remplir cette triple fonction utilement pour lui-même et pour les autres? Son manque habituel de ressources serait un premier obstacle à ce qu’il la remplît; toutefois cet obstacle ne serait pas insurmontable, car il pourrait faire escompter les assignations qui lui seraient fournies en paiement; mais lui conviendrait-il toujours de courir les risques de dépréciation qu’elles pourraient subir, aux époques de crises industrielles, par exemple? Une rétribution, sous forme de part fixe ou de salaire ne serait-elle pas, dans la plupart des cas, mieux appropriée à sa situation et ne lui paraîtrait-elle pas préférable? Croire que l’on améliorerait son sort en arrangeant les choses de telle façon qu’il fῦt obligé de recevoir quand même la rétribution de son travail sous la [I-259] forme d’une part éventuelle dans le produit des entreprises, serait aussi peu rationnel que de croire que l’on améliorerait le sort des capitalistes en les obligeant désormais à placer leurs capitaux exclusivement sous forme d’actions, au lieu de leur laisser le choix entre les actions et les obligations.
On voit donc que le salariat ne mérite point l’anathème dont l’ont frappé les socialistes. Cette forme de rémunération a sa raison d’être à la fois dans les conditions naturelles de la production, qui ne permettent point de réaliser le produit d’une manière immédiate et certaine, et dans la situation des travailleurs qui ne leur permet ni de spéculer sur un produit ni d’attendre qu’il soit réalisé. La supprimer, pour la remplacer par une rémunération éventuelle, sous la forme d’une assignation sur le produit brut des entreprises serait aggraver certainement la situation des ouvriers au lieu de l’améliorer. Car, sous ce nouveau régime comme sous le régime actuel du salariat, le prix des services de l’ouvrier continuerait de dépendre de la situation du marché de travail. Quand le travail serait abondant, on diminuerait la part proportionnelle de l’ouvrier dans le produit brut de l’entreprise, comme aujourd’hui on diminue son salaire; en sorte qu’il n’aurait gagné à ce changement que l’obligation de participer à des spéculations industrielles auxquelles il n’est point propre et de s’exposer à des risques que l’exiguité habituelle de ses ressources ne lui permet pas de subir.
Le taux courant de la rémunération du travail auxiliaire descend cependant trop souvent au dessous de son taux naturel et nécessaire; mais ce n’est pas sous l’influence de la forme de cette rémunération, c’est par l’action de toutes autres causes. La principale réside dans l’insuffisance du développement du marchandage ou commerce intermédiaire de travail.
[I-260]
Tandis que le commerce de la plupart des produits est développé et divisé autant que la production elle-même; qu’il existe entre les producteurs et les consommateurs de toutes les marchandises régulièrement demandées des marchands en gros, demi-gros et détail, il n’en est pas de même pour le travail. L’entrepreneur qui a besoin de travail en gros est obligé, presque toujours, de s’aboucher directement avec l’ouvrier qui le lui vend en détail, et, — n’en déplaise aux socialistes, grands ennemis des intermédiaires comme on sait, — il en résulte une situation désavantageuse, à la fois, à l’ouvrier et à l’entrepreneur lui-même.
A l’ouvrier d’abord. Cette absence d’intermédiaires, en contraignant l’ouvrier à cumuler les deux fonctions naturellement distinctes de producteur et de marchand de travail ne lui permet point de s’acquitter également bien de l’une et de l’autre. S’il n’avait point à se préoccuper du placement de son travail, il pourrait s’appliquer uniquement à sa spécialité professionnelle, et développer au maximum ses services productifs sous le double rapport de la quantité et de la qualité. D’un autre côté, il ne peut, faute de connaissances spéciales, de temps et de ressources, exercer convenablement le métier de marchand de travail. Il lui est à peu près impossible d’acquérir une connaissance régulière du marché de travail au delà du milieu borné où il vit. Il ne possède pas non plus les ressources nécessaires soit pour se transporter sur un marché éloigné, soit pour attendre le moment le plus favorable au placement de sa marchandise. Qu’en résulte-t-il? C’est que, ne disposant ni de l’espace ni du temps, il est obligé d’accumuler son offre dans le lieu et dans le moment où il se trouve, et où il est, communément du moins, en présence d’une demande beaucoup moins intense. [I-261] Sans doute, les entrepreneurs d’industrie ont besoin d’acheter du travail comme les ouvriers ont besoin d’en vendre. Car si, d’un côté, il y a un capital de valeurs personnelles que le chômage laisse improductif et qu’il peut finalement détruire, d’un autre côté, il y a un capital de valeurs mobilières, immobilières et personnelles pour lequel le chômage n’est pas moins dommageable. Mais, en premier lieu, les entrepreneurs peuvent, en cas d’extrême nécessité, se procurer des ouvriers au dehors beaucoup plus facilement que les ouvriers ne peuvent s’y procurer des emplois; en second lieu, comme ils disposent d’une accumulation plus grande de capitaux, sans parler des ressources du crédit, ils peuvent supporter plus longtemps le chômage; ils disposent, en un mot, à un plus haut degré, de l’espace et du temps [27] . Cela étant, il est rare que le louage du fonds productif de l’ouvrier, ou, ce qui revient au même, la vente de son travail s’effectue dans des conditions d’égalité. L’offre est presque toujours plus intense que la demande et il en résulte pour l’entrepreneur la possibilité de réduire sa demande beaucoup plus que l’ouvrier ne réduit son offre. Sous l’influence de cette situation inégale, l’ouvrier porte successivement au maximum la quantité de travail offert, tandis que l’entrepreneur abaisse, successivement aussi, la quantité de salaire en monnaie [I-262] ou en denrées qu’il offre en échange. Bientôt ce salaire descend au point de ne plus suffire à l’entretien de l’ouvrier et de sa famille. Alors l’ouvrier ajoute à l’offre devenue insuffisante de son propre travail, celle du travail de sa femme et de ses enfants. Mais s’il améliore ainsi immédiatement sa situation, c’est pour l’aggraver ultérieurement. A mesure, en effet, que ces quantités supplémentaires de travail arrivent sur le marché en progression arithmétique, le prix courant du travail baisse en progression géométrique. Le salaire doit finir par tomber ainsi à son minimum extrême, c’est à dire à la somme indispensable pour maintenir l’ouvrier en état de travailler non point pendant le cours de son existence comme dans le cas de l’esclavage, mais seulement pendant le moment même où il livre son travail. Il descendrait plus bas encore si en s’abaissant davantage, c’est à dire au dessous du taux nécessaire à la réparation immédiate des forces de l’ouvrier, il ne provoquait point une diminution de l’offre du travail, et par conséquent une hausse de la rémunération du travailleur.
Cependant, lorsque le salaire est descendu à ce minimum extrême où il ne suffit plus qu’à la satisfaction des besoins actuels de l’ouvrier, celui-ci est condamné à périr dès que le travail vient à lui faire défaut ou bien encore dès qu’il se trouve hors d’état de travailler. La charité publique ou privée supplée alors à l’insuffisance du salaire; mais à mesure que les secours fournis par la charité augmentent et surtout à mesure qu’ils sont affectés davantage aux besoins des individus capables de travailler, l’inégalité de situation des vendeurs de travail vis à vis des acheteurs continue à agir pour réduire encore le salaire. C’est ainsi que le prix courant du travail finit par tomber fort au dessous non seulement du prix naturel (comprenant une part [I-263] proportionnelle du produit net) mais encore même des frais indispensables à l’entretien et au renouvellement des ouvriers. Sous l’influence de cet avilissement du salaire, on voit, successivement baisser la qualité du travail, puis, si des forces ouvrières fraîches ne sont pas importées du dehors, on en voit diminuer la quantité même, par suite de l’épuisement des forces et de la vitalité d’une race surmenée hâtivement, de génération en génération. Cette situation est pour la classe ouvrière pire que celle de l’esclavage, car le propriétaire d’esclaves a intérêt d’une part à ménager économiquement les forces d’un personnel qui lui coῦte cher, d’une autre part à lui fournir toujours le minimum d’entretien nécessaire, tandis que cet intérêt n’existe point ou n’existe que d’une manière lointaine pour l’entrepreneur qui emploie des ouvriers libres.
Cet état de choses si désastreux pour les ouvriers est-il, en revanche, avantageux aux entrepreneurs?
Ils le croient volontiers, et c’est pourquoi ils emploient leur influence à le maintenir au moyen de tout un arsenal de lois spéciales, lois sur les coalitions, sur les livrets des ouvriers, etc., destinées à mettre les ouvriers à leur entière discrétion, mais en agissant ainsi ils n’offensent pas seulement la justice, ils travaillent encore à la ruine future de la classe à laquelle ils appartiennent. Ce qui les abuse, c’est la conséquence immédiate du phénomène de l’abaissement des salaires, conséquence qui leur paraît essentiellement avantageuse car elle engendre une hausse immédiate de leurs profits. Mais les profits venant à hausser, qu’arrive-t-il? C’est que les capitaux et le travail d’entreprise sont irrésistiblement attirés dans les localités et dans les industries dont les profits se trouvent surelevés, c’est à dire augmentés d’une rente en sus de leur taux naturel, aux dépens des [I-264] salaires. De nouvelles entreprises se créent, le salaire se relève par l’augmentation de la demande de travail, tandis que les prix des produits s’abaissent par l’accroissement des quantités offertes, et, en conséquence, les profits diminuent.
L’avilissement des salaires ne peut donc, comme on voit, occasionner une hausse permanente des profits, ceux-ci se trouvant toujours ramenés par la concurrence à leur taux naturel et nécessaire. De plus, il peut placer à la longue les entrepreneurs dans une situation d’infériorité dommageable et devenir pour la société entière une cause de ruine. Lorsqu’il va, en effet, jusqu’à ne plus permettre aux travailleurs de réparer et de rétablir entièrement leurs forces productives, en amenant ainsi l’abaissement de la qualité du travail, c’est à dire du moteur essentiel de la production, les entrepreneurs, obligés de se contenter de ce travail de qualité inférieure, ne peuvent plus produire les articles qui exigent une force et une habileté supérieures et leur industrie dépérit, alors même qu’elle ne serait point supplantée par la concurrence étrangère. On parle souvent de localités ou de contrées ruinées par l’épuisement des forces productives du sol; mais, en étudiant les causes qui ont ruiné une foule d’industries, on s’aperçoit que l’épuisement des forces productives des travailleurs, quoique bien rarement mentionnée, doit être placé au premier rang de ces causes de décadence.
On doit donc souhaiter, non seulement dans l’intérêt de l’ouvrier, mais encore dans l’intérèt de l’entrepreneur et, par extension, de la société entière, que la rémunération du travail ne descende point, autrement que d’une manière accidentelle et temporaire, au dessous de son taux naturel et nécessaire. Mais ce souhait peut-il être réalisé en présence de l’inégalité de situation [I-265] qui existe communément entre l’entrepreneur et l’ouvrier, entre l’acheteur de travail et le vendeur? Celui-ci n’est-il pas irrémédiablement condamné à être exploité par celui-là? N’en déplaise aux écrivains socialistes, nous ne le pensons pas.
D’où provient cette inégalité de situation qui amène trop souvent avec l’avilissement des salaires l’abaissement de la qualité du travail? Elle provient, comme nous l’avons vu, de ce que l’ouvrier vendeur de travail ne dispose pas, ordinairement du moins, au même degré que l’acheteur, de l’espace et du temps, de ce qu’il ne peut, faute d’informations et de ressources, porter son travail dans les lieux où on le paye le plus cher, de ce qu’il ne peut non plus attendre pour le vendre le moment le plus favorable. La spécialisation et le développement du commerce de travail auraient pour résultat inévitable d’effacer cette inégalité en plaçant sur le marché, agrandi à la fois dans l’espace et dans le temps, l’ouvrier le plus pauvre au niveau de l’entrepreneur le plus riche. Le marchandage, à tort impopulaire auprès des ouvriers, est le germe de ce progrès. Le marchandeur achète le travail en détail aux ouvriers et il le revend en bloc aux entrepreneurs. Faisant ainsi commerce de travail, il est intéressé à agrandir autant que possible le débouché de sa marchandise. D’abord, il profite seul de ce progrès commercial. Ensuite, l’élévation de ses profits, en attirant la concurrence, l’oblige à y faire participer producteurs et consommateurs.
C’est exactement l’histoire du marchand de grains que poursuit encore le préjugé populaire, et dont l’interposition est cependant si avantageuse à l’agriculteur aussi bien qu’au consommateur. Dans les commencements, à la vérité, la spécialisation du commerce des grains occasionne un dommage à certains intérêts particuliers, absolument comme fait l’introduction [I-266] d’une machine nouvelle, car le commerce des grains n’est autre chose qu’une nouvelle machine ou, si l’on veut, un nouveau rouage de l’immense appareil de la production. Que cette machine ne s’introduise point sans causer un dommage aux détenteurs de l’outillage grossier qu’elle supplante; qu’ils s’ameutent, en conséquence, contre elle et qu’ils veuillent la briser, cela se conçoit parfaitement. Ainsi, des marchands de grains apparaissent sur un marché local où des cultivateurs se rencontraient seuls jusque-là avec les consommateurs. S’ils achètent pour revendre soit ailleurs, soit plus tard, ils feront hausser le prix, au grand dommage actuel des acheteurs. S’ils vendent, ils le feront baisser au grand dommage des cultivateurs. Ce n’est pas tout. En présence de cette concurrence du commerce spécialisé, les cultivateurs qui remplissaient l’office de marchands seront obligés d’y renoncer pour se renfermer dans leur spécialité. Comme agriculteurs, ils y gagneront certainement, à la longue, car ils pourront mieux produire, et le commerce des grains spécialisé leur procurera des débouchés plus vastes et plus sῦrs; mais, comme marchands, ils y perdront d’abord, et le matériel et le personnel qu’ils employaient à cette annexe de leur industrie agricole seront frappés d’une moins value. D’un autre côté, les acheteurs qui font aussi en partie ce commerce, en ce qu’ils s’approvisionnent pour un terme plus ou moins long dans les moments où les prix sont les plus bas, ne pourront plus se livrer avec le même avantage à ce genre de spéculation, et le capital qu’ils y employaient sera frappé d’une moins value jusqu’à ce qu’ils aient trouvé à le placer autrement. Sans doute, ils regagneront plus tard comme acheteurs, par la régularité et la sῦreté des approvisionnements, ce qu’ils auront perdu d’abord comme spéculateurs. Mais, en attendant, l’introduction [I-267] de cette nouvelle machine commerciale n’en froisse pas moins les intérêts engagés dans les petits rouages imparfaits et grossiers auxquels elle se substitue; et, comme un bien futur et général ne console jamais d’un mal actuel et particulier, on conçoit que la machine nouvelle du commerce des grains ait été tout d’abord impopulaire. Cette impopularité dont elle était frappée, en l’empêchant de se développer autant qu’elle aurait pu le faire, a aggravé les maux de la transition en restreignant l’emploi de cette machine perfectionnée à un petit nombre d’individus, ainsi investis d’un monopole naturel et parfois aussi artificiel quand ils étaient organisés en corporations fermées, et en mettant à leur merci producteurs et consommateurs. Ils ont pu réaliser alors des bénéfices exceptionnels, et, comme leur petit nombre rendait entre eux les coalitions faciles, des bénéfices peu légitimes. Mais quand la suppression des corporations a rendu accessibles à tous les différentes branches de la production et du commerce, l’élévation de ces bénéfices n’a pas manqué d’attirer la concurrence. Le commerce des grains s’est développé, et ceux qui l’exerçaient se sont efforcés d’augmenter leurs débouchés pour maintenir leurs bénéfices. Le perfectionnement et la multiplication des voies de communication par l’application de la vapeur à la locomotion, l’abaissement graduel des barrières douanières et finalement la suppression des lois céréales ont singulièrement secondé leurs efforts, et aucune branche de commerce ne s’est plus développée dans ces vingt dernières années. Les résultats de ce développement frappent déjà tous les yeux. Lorsque le commerce des grains était une annexe locale de la production et de la consommation, le consommateur était à la merci du producteur dans les mauvaises années et vice versâ. Les prix étaient déterminés par l’intensité [I-268] des besoins respectifs des parties en présence sur le marché local, besoin d’acheter d’un côté, besoin de vendre de l’autre. Dans les années d’abondance, les cultivateurs pressés de vendre pour payer leurs fermages, leurs impôts, etc., étaient obligés de céder à vil prix leurs denrées sur le seul marché où ils eussent accès. Dans les années de disette, — et le plus souvent la disette avait pour cause l’excessif avilissement des prix qui avait fait réduire l’étendue des cultures, — les consommateurs, sous l’aiguillon du besoin qui peut le moins attendre, se faisaient à leur tour une concurrence à outrance, et ils subissaient la loi des producteurs. Depuis que le commerce des grains s’est interposé entre eux et à mesure qu’il s’est généralisé, la situation a changé. La multitude des marchés locaux ont été mis en communication, les quantités demandées d’un côté, offertes de l’autre se sont totalisées, et il en est résulté un prix courant général déterminé par la proportion de la totalité de l’offre avec la totalité de la demande, au niveau duquel les prix locaux ont tendu à se placer. Désormais l’exploitation partielle des producteurs par les consommateurs ou des consommateurs par les producteurs est devenue impossible. Car le plus petit cultivateur aussi bien que le plus humble consommateur connaissent la situation du marché général. Nul ne peut plus donc spéculer sur leur ignorance. Nul ne peut non plus spéculer, si ce n’est par accident et d’une manière temporaire, sur l’intensité de leurs besoins. En effet, dès que dans une localité le prix du marché descend au dessous ou s’élève au dessus du prix courant du marché général, la concurrence des acheteurs on des vendeurs y est invinciblement attirée jusqu’à ce que le niveau soit rétabli, en sorte que les différences de prix ne peuvent plus dépasser la différence des frais de transport et des frais commerciaux. [I-269] Producteurs et consommateurs y gagnent. Les premiers parce qu’ils ne sont plus exposés à des dépréciations ruineuses de leurs denrées, les seconds parce qu’ils n’ont plus à redouter les calamités de la disette ou de la famine.
Eh bien! si l’on étudie le commerce, encore malheureusement à l’état embryonnaire, du marchandage, on lui trouvera, sauf les différences provenant de la diversité de nature des deux denrées, la plus complète ressemblance avec le commerce des grains, et l’on s’expliquera, de même, qu’il ait pu être et qu’il soit encore presque également impopulaire parmi les entrepreneurs d’industrie, consommateurs et acheteurs de travail, et parmi les ouvriers, producteurs et vendeurs de cette marchandise. Actuellement, les uns et les autres participent plus ou moins à ce commerce, qui est une annexe de leur industrie principale. L’entrepreneur d’industrie y emploie une portion plus ou moins considérable de son capital et de son temps. Grâce à la supériorité de sa situation vis-à-vis des ouvriers agglomérés dans le marché local, et avec lesquels il traite individuellement, il retire d’abord un profit extraordinaire de cet emploi de son capital et de son temps, mais l’élévation de ce profit, en attirant la concurrence, rend sa situation de moins en moins avantageuse. Ses bénéfices, comme marchand de travail, diminuent, tandis qu’il ressent, comme industriel, les inconvénients de l’insuffisance du développement de ce commerce. S’il tient communément la masse des travailleurs à sa merci, il est obligé, en revanche, de subir leurs exigences lorsqu’il a des commandes pressées à exécuter, ou lorsqu’il a besoin d’une espèce de travail qui manque sur le marché local. Cela n’empêche pas que le marchandeur ne soit d’abord, comme le marchand de grains, reçu en ennemi par les deux parties en présence. S’il fait des [I-270] achats de travail, ou, pour nous servir de l’expression usitée, s’il embauche des ouvriers, il en résultera une hausse du salaire qui ne manquera pas de faire jeter les haut cris aux entrepreneurs. S’il fait, au contraire, des ventes de travail, s’il porte un supplément de main d’œuvre dans les endroits où elle est rare, il la fera baisser, et les ouvriers se plaindront à leur tour. Mais que le commerce de travail vienne à se développer comme les autres branches de commerce, et il en résultera, pour le producteur aussi bien que pour le consommateur, des avantages tels que l’impopularité originaire du marchandeur s’effacera, comme s’efface déjà peu à peu celle du commerce des grains. De même que le grand fermier n’est pas fâché aujourd’hui de pouvoir vendre ses récoltes au marchand de grains au lieu de les porter lui-même au marché; de même encore que le consommateur s’adresse volontiers à des intermédiaires qui le dispensent de faire des provisions, exposées à se détériorer, etc., l’entrepreneur et l’ouvrier trouveront avantage à n’être plus, l’un qu’industriel, l’autre que travailleur.
Dans l’état actuel des choses, les entrepreneurs, achetant le travail en détail aux ouvriers au lieu de l’acheter en bloc à un intermédiaire, sont obligés d’établir une comptabilité compliquée et de surveiller eux-mêmes chaque livraison partielle, sans pouvoir rendre l’ouvrier suffisamment responsable de la matière première qu’il gâte ou de l’outillage qu’il détériore par sa négligence ou son incapacité. D’un autre côté, ne pouvant traiter avec les ouvriers qu’au comptant, ils sont obligés d’augmenter d’autant leur capital circulant. Supposons que le commerce de travail fῦt spécialisé et développé comme tout autre, et qu’il possédât de même l’auxiliaire du crédit, les entrepreneurs qui achèteraient du travail en gros se trouveraient d’abord [I-271] débarrassés des détails de la comptabilité et de la surveillance; ensuite ils pourraient payer cet élément de leur production comme toutes les autres matières premières, au moyen d’effets à terme, dont les échéances coïncideraient avec la réalisation de leurs produits, et que les vendeurs, à leur tour, pourraient faire escompter au besoin. Ce serait une simplification économique de l’organisation des entreprises, qui tournerait, comme tout progrès de la spécialisation des industries et de la division du travail, à l’avantage de tous.
Quant à l’ouvrier, presque toujours isolé aujourd’hui dans un marché resserré, sans informations sur l’état des autres marchés, sans ressources soit pour se déplacer, soit pour attendre une amélioration des prix, il pourrait, grâce au puissant véhicule commercial qui serait mis à son service, disposer de l’espace et du temps, au même degré que l’entrepreneur lui-même. Son salaire se relèverait et s’assurerait, il n’aurait pas plus à redouter désormais les avilissements de salaire et les chômages que nous n’avons à redouter l’élévation exorbitante des mercuriales et les disettes depuis que le commerce des grains s’est développé et généralisé. Supposons, en effet, que le marchandage vint à se développer et à se généraliser à l’instar du commerce des grains, qu’en résulterait-il? C’est que les marchés locaux s’effaceraient devant le marché général; c’est que le prix courant de chaque espèce de travail s’établirait d’après la proportion de l’offre et de la demande sur ce marché général, dont la situation serait désormais généralement et constamment connue. Si, sur un marché local, le salaire venait à tomber fort au dessous ou à s’élever fort au dessus du prix courant du marché général, la concurrence des acheteurs ou des vendeurs y serait invinciblement attirée, et [I-272] l’équilibre ne tarderait pas à se rétablir. Il n’y aurait donc plus ni disettes ni surabondances locales de travail, et, par conséquent, ni exploitation usuraire des ouvriers par les entrepreneurs ou des entrepreneurs par les ouvriers. Que s’il y avait disette ou surabondance générale, l’intérêt des intermédiaires seconderait, dans le premier cas, celui des acheteurs en stimulant la production et l’offre d’une quantité supplémentaire; dans le second cas, au contraire, il seconderait celui des producteurs, en les aidant à retirer l’excédant du marché. Assurer les approvisionnements et régulariser les prix, à l’avantage mutuel de l’ouvrier et de l’entrepreneur, du producteur et du consommateur, tel serait donc le résultat inévitable de la spécialisation et du développement du commerce de travail comme de tout autre.
Sans doute, le marchandage venant à se développer d’une manière normale, le prix courant du travail se trouverait grevé des frais de ce rouage intermédiaire; mais en premier lieu, si ces frais excédaient la valeur du service rendu, les ouvriers pourraient toujours, comme ils le font aujourd’hui, s’aboucher directement avec les entrepreneurs. En second lieu, la concurrence des intermédiaires aurait pour résultat nécessaire et final d’abaisser le prix courant de leur service au niveau de son prix naturel.
D’où ces formules:
I. Sous un régime de pleine liberté et de développement normal du marchandage, le prix courant de toute espéce de travail tendrait toujours, dans chaque localité, à se niveler avec celui du marché général.
II. Le prix courant du travail sur le marché général tendrait, à son tour, à se mettre au niveau de son prix naturel, c’est à dire de ses frais de production augmentés d’une part proportionnelle [I-273] du produit net, déduction faite de la rémunération nécessaire des intermédiaires.
Comment donc se fait-il que ce commerce, dont l’utilité est plus grande encore peut-être que celle du commerce des grains, soit encore dans l’enfance? Quelles sont les causes particulières qui ont retardé sa spécialisation et son développement? Ces causes, dont nous avons déjà dit quelques mots, sont de deux sortes: naturelles et artificielles. Les premières se résument dans la difficulté du transport des ouvriers, surtout à de longues distances, et dans l’absence d’informations sur la situation des différents marchés de travail. Mais, d’une part, la multiplication des chemins de fer et des autres voies de communication à bon marché rend de plus en plus facile le déplacement des hommes, — lesquels étaient, il n’y a pas bien longtemps encore, pour nous servir de l’expression d’Adam Smith, de toutes les espèces de bagages la plus difficile à transporter; d’une autre part, le commerce de travail, en se développant, saura bien se procurer les renseignements dont il a besoin sur la situation du marché. On verra, en conséquence, à mesure que ce commerce étendra la sphère de ses opérations, se créer à son usage une publicité spéciale, et probablement aussi se constituer des Bourses analogues à celles des fonds publics, des valeurs industrielles et des principales marchandises; d’où il résultera que la situation des différents marchés de travail, les transactions qui s’y effectuent, les cours des salaires, etc., seront connus, jour par jour, comme le sont déjà ceux des autres valeurs ou marchandises [28] — Les causes artificielles, [I-274] qui font obstacle au développement du marchandage, résident surtout dans la limitation et la réglementation des engagements [I-275] de travail comme dans la difficulté d’en assurer l’exécution. Les lois et règlements qui interdisent l’embauchage ou qui font [I-276] directement ou indirectement obstacle au déplacement des ouvriers, qui limitent, dans l’intérêt prétendu des travailleurs, [I-277] la durée des engagements de travail; qui empêchent, toujours dans les mêmes intentions philanthropiques, les capitalistes [I-278] qui prêtent sur hypothèque de la valeur personnelle de l’ouvrier, de se saisir de leur gage, et, par dessus tout, les préjugés [I-279] auxquels le marchandage est en butte, ont contribué jusqu’à présent à empêcher cette branche de commerce de prendre son développement naturel et nécessaire. Mais à mesure que ces obstacles s’aplaniront, on verra certainement le marchandage prendre un essor analogue à celui que nous avons vu prendre au commerce des grains dans les pays où il a cessé d’être entravé par la difficulté des communications, les lois restrictives et les préjugés populaires. Les travailleurs se trouveront alors, pour le placement de leurs services, dans la même situation que les producteurs pour le placement de leurs produits et les capitalistes pour le placement de leurs capitaux. L’usure sur le travail disparaîtra comme disparaît l’usure sur le capital à mesure que les institutions de crédit se multiplient.
Ce développement libre d’un commerce nécessaire rendrait possibles bien des combinaisons avantageuses, qui, dans l’état présent des choses, sembleraient à bon droit chimériques. Tantôt les intermédiaires achèteraient le travail au comptant et en détail, par semaine, par jour ou même par heure, ou bien encore à la pièce, en raison de la quantité effectivement fournie. Tantôt ils l’achèteraient pour une longue période, pendant laquelle les ouvriers jouiraient d’un revenu assuré, soit que leur travail ainsi engagé trouvât ou non des acheteurs. De même, tantôt ils le revendraient au comptant et tantôt à terme. Peut-être encore, au lieu de le revendre toujours pour une somme fixe, trouveraient-ils quelquefois plus d’avantage à l’échanger contre une part éventuelle dans le produit des entreprises auxquelles ils le fourniraient. On arriverait ainsi à cette Association Intégrale qui a été le rêve des socialistes, mais dont ils connaissaient si mal le chemin.
Sans doute, le commerce de travail continuerait d’être, [I-280] comme tous les autres commerces, soumis à d’incessantes fluctuations. Tantôt, l’accroissement local et temporaire de l’offre ferait baisser les salaires; tantôt, au contraire, l’accroissement de la demande les ferait hausser. Mais ces écarts seraient promptement corrigés, grâce à la mobilité d’une marchandise, devenue l’objet d’un commerce organisé sur une vaste échelle et disposant de grands capitaux. Comme on pourrait désormais la transporter aisément dans l’espace et dans le temps, les engorgements d’une part, les disettes de l’autre cesseraient de se produire, les différences locales s’effaceraient devant le prix courant du marché général, lequel, à son tour, tendrait incessamment à se confondre avec le prix naturel et nécessaire. Que si des accidents perturbateurs, tels que les guerres, les révolutions, les épidémies, les mauvaises récoltes, les accroissements d’impôts, etc., venaient altérer cet équilibre général, il ne manquerait pas de se rétablir bientôt sous l’influence de la loi régulatrice qui gouverne les prix du travail comme ceux des autres marchandises.
[I-281]
ONZIÈME LEÇON↩
la part du capital
En quoi consiste le matériel de la production. — Des capitaux fixes et circulants. — Caractères auxquels ils se reconnaissent. — Éléments du prix naturel du service des capitaux. — Des risques de la production. — Qu’ils sont essentiellement divers et variables. — Qu’ils doivent être couverts. — Comment ils peuvent être abaissés. — De la privation. — En quoi elle consiste. — Qu’elle doit être compensée. — Que la prime nécessaire pour la compenser est plus ou moins élevée selon que le capital peut être plus ou moins aisément dégagé ou réalisé. — Exemple. — Autres éléments du prix naturel du service des capitaux. — Les inconvénients ou les avantages particuliers de chaque industrie. — Que le progrès agit incessamment pour abaisser les frais de production du service des capitaux. — De la part proportionnelle de produit net qui s’ajoute aux frais de production de ce service pour composer son prix naturel. — Sa raison d’être. — Qu’on ne peut la supprimer et mettre le capital à la portion congrue.
Nous venon de voir de quels éléments se compose la rémunération du personnel de la production et en vertu de quelle loi elle se règle. La rémunération du matériel de la production se compose d’éléments analogues, et elle est réglée par la [I-282] même loi. Elle se compose des frais d’entretien et de renouvellement nécessaires pour maintenir le matériel au service de la production, comme aussi d’une part proportionuelle de produit net, qui permette à ses détenteurs de l’accroître dans la proportion utile.
Ces frais d’entretien et de renouvellement nécessaires, et cette part proportionnelle de produit net constituent le prix naturel du service du matériel, autour duquel gravite encore le prix courant, en vertu de la loi d’équilibre qui régit le monde économique.
Le matériel de la production comprend les trois catégories d’agents productifs, que les économistes se sont accordés à désigner sous les dénominations suivantes:
Capitaux fixes.
Id. circulants.
Agents naturels appropriÉS.
Nous nous occuperons d’abord des deux premières catégories dont la réunion constitue le capital proprement dit.
Les capitaux fixes se reconnaissent à ce caractère qu’ils ne se détruisent ou ne se consomment point intégralement dans la formation d’un produit. Tels sont, par exemple, dans une entreprise agricole, les bâtiments d’exploitation, les charrues et les autres instruments aratoires, les chevaux ou les bœufs de labour, tels sont encore les amendements durables apportés aux terres, le drainage, les clôtures, etc. Les semences, l’argent ou les provisions qu’il faut fournir aux travailleurs sous forme de salaires, les provisions et les matériaux nécessaires pour maintenir en état les différentes parties du capital fixe, etc., constituent le capital circulant. Dans une manufacture de coton, les bâtiments et les machines forment le capital fixe; le [I-283] coton brut, le charbon, l’huile et les autres matières premières, l’argent que l’on consacre au paiement des travailleurs, les matériaux que l’on applique à l’entretien des bâtiments et des machines, composent le capital circulant. Dans le commerce, le capital fixe comprend le magasin et le mobilier du négociant; le capital circulant consiste principalement dans l’approvisionnement des marchandises qu’il met à la disposition du public et dans les fonds nécessaires pour les renouveler.
Il ne faut accorder toutefois qu’une importance secondaire à ces divisions et à ces subdivisions qui ont été établies entre les agents productifs, car ces agents, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux mêmes lois, quant à leur formation, à leur entretien et à leur multiplication.
Les capitaux fixes et circulants concourent à la production, dans des porportions déterminées par la nature de l’industrie à laquelle ils s’appliquent. Certaines industries réclament plus de capital fixe, d’autres plus de capital circulant. Une filature de coton exige une proportion considérable de capital fixe. Un commerce d’épiceries, au contraire, exige une proportion plus forte de capital circulant. Le capital fixe prédomine dans l’industrie, et surtout dans la grande industrie, le capital circulant prédomine dans le commerce.
Le service productif des capitaux fixes et circulants a son prix naturel, faute duquel ces capitaux ne peuvent être engagés et maintenus dans la production, faute duquel aussi ils ne peuvent être multipliés dans la proportion utile. Examinons quels sont les éléments de ce prix naturel.
Le premier consiste dans la somme nécessaire pour maintenir en état le capital appliqué à la production.
Ainsi, par exemple, quand j’applique à la filature ou au [I-284] tissage du coton, un capital consistant dans les bâtiments de la manufacture, dans l’outillage nécessaire pour travailler le coton, dans les matières premières, coton brut, huile, charbon, etc., dans les fonds et les matériaux indispensables à l’entretien du personnel et du matériel de l’entreprise, que faut-il pour que ce capital puisse demeurer indéfiniment au service de la production? Il faut que le produit suffise pour renouveler la portion du capital qui a été détruite ou consommée dans l’opération, le coton brut, l’huile, le charbon, ainsi que les fonds et les matériaux qui ont été employés à entretenir et à renouveler le personnel et le matériel de la production, faute de quoi, le capital circulant d’abord, le capital fixe ensuite, se détruisent, disparaissent, et la production, privée d’une portion de ses agents, cesse d’avoir lieu.
Il faut donc que le capital engagé dans la production soit reconstitué, recomposé intégralement au bout de chaque opération. Voilà un premier point à observer.
En voici un second. C’est que l’on n’a, dans aucune industrie, la certitude entière que la production renouvellera intégralement le capital engagé; c’est que l’on court dans toute industrie certains risques de ne point récupérer intégralement son capital. Ces risques sont plus ou moins considérables selon les temps et les lieux où s’accomplit la production, selon aussi la nature particulière de l’industrie.
En tous cas, les risques de la production doivent être couverts, sinon ils finissent, au bout d’un délai plus ou moins long, selon leur nombre et leur intensité, par dévorer le capital.
Il y a des risques généraux qui dépendent des temps, des lieux et des circonstances, et qui pèsent également sur toutes [I-285] les branches de la production; il y a des risques particuliers qui grèvent spécialement certaines branches d’industrie.
Je dis que les risques généraux varient suivant les temps, les lieux et les circonstances. Il y a des époques où la sécurité est tellement insuffisante et précaire, qu’un homme qui applique un capital à n’importe quelle branche de la production doit calculer qu’au bout de cinq opérations, par exemple, son capital sera emporté, détruit. Chaque opération se trouvera, en conséquence, grevée d’un risque de 20 p. c. Si ce risque n’est point couvert, si les résultats de la production ne suffisent point pour constituer, au bout de cinq opérations, un capital de rechange, le risque venant à échoir, la production cessera. Dans une situation semblable, il ne suffit donc pas que le capital soit reproduit intégralement au bout de chaque opération, il faut qu’il le soit avec 20 p. c. en sus. Mais que les risques généraux qui pèsent sur la production viennent à baisser de 10 p. c. que le capital qui naguère était emporté, détruit au bout de cinq opérations, ne le soit plus qu’au bout de dix, alors, il suffira que le capital soit reconstitué avec 10 p. c. en sus, à la fin de chacune. Toute diminution des risques généraux de la production comportera une baisse équivalente dans la rémunération des agents productifs.
C’est ainsi qu’aux époques de guerre et d’anarchie, la rémunération nécessaire du capital s’élève plus haut qu’aux époques de paix et de tranquillité intérieure; c’est ainsi que dans deux pays où la sécurité dont jouit la production est inégale, les niveaux de la rémunération nécessaire du capital diffèrent de tout le montant de la différence des risques.
Ceci est un point d’une extrême importance. Qu’on me permette donc de m’y arrêter un peu. La sécurité de la production [I-286] tient à des causes diverses, elle dépend du degré de perfectionnement des institutions gouvernementales, elle dépend encore et surtout du degré d’honnêteté et d’intelligence des populations.
Supposons qu’une nation ait un gouvernement trop faible pour la protéger efficacement contre les prétentions abusives des autres gouvernements, trop faible aussi et trop mal organisé pour garantir contre les agressions intérieures la sécurité des capitaux engagés dans la production. Supposons, en outre, que ce gouvernement dispose, d’une manière arbitraire, de la vie et de la propriété des citoyens, qu’en résultera-t-il? Qu’une nation ainsi gouvernée se trouvera dans les plus mauvaises conditions possibles pour produire, car les risques généraux de la production seront chez elle à leur maximum. Les producteurs de cette nation auront, en effet, à craindre 1° d’être dépouillés soudainement de leurs capitaux par le fait d’une invasion étrangère et des déprédations ou des crises qu’elle occasionne; 2° ils auront plus à craindre encore peut-être de la part de leur gouvernement: au moment où ils s’y attendront le moins, une banqueroute, un impôt extraordinaire, un emprunt forcé, une altération de la monnaie métallique ou une émission de papier-monnaie atteindront leur industrie, et détruiront, en tout ou en partie, le capital qui s’y trouve engagé. En outre, si le gouvernement est trop faible pour mettre les producteurs à l’abri du brigandage et du vol, si l’agriculteur, l’industriel, le marchand, peuvent être rançonnés par le seigneur, pillés par le voleur de grand chemin, dépouillés par le banqueroutier, sans que ces sévices soient punis; si, pour tout dire, le gouvernement ne protége suffisamment le producteur ni au dehors ni au dedans, s’il n’est lui-même qu’un exacteur [I-287] public, les risques de la production seront énormes. Ils seront tels peut-être que, dans les entreprises ordinaires, les capitaux fixes et circulants disparaitront, en moyenne, au bout de quatre ou cinq opérations.
Les risques généraux de la production s’accroîtront encore, si la nation manque d’honnêteté. Alors, en effet, les risques provenant soit des faillites et des banqueroutes, soit des altérations et des fraudes qui détériorent la qualité des produits, ces risques seront considérables, et il faudra encore les couvrir, sous peine de voir disparaître peu à peu le capital.
Dans une nation ainsi gouvernée et composée, la rémunération nécessaire du capital sera à son maximum.
Maintenant, supposons que dans le voisinage de cette nation il y en ait une autre qui possède un gouvernement assez fort pour la faire respecter au dehors, assez bien organisé pour faire régner au dedans l’ordre et la sécurité. Supposons que ce gouvernement ne s’engage dans des guerres extérieures qu’en cas de nécessité absolue; supposons aussi qu’il soit constitué de manière à ne pouvoir jamais lever d’impôt ou contracter d’emprunt sans le consentement des citoyens; supposons qu’il s’occupe uniquement d’empêcher les producteurs d’être victimes des exactions et des sévices qui atteignent ailleurs le capital; supposons, d’un autre côté, que la population ainsi gouvernée soit essentiellement honnête; que la fraude et le vol sous leurs formes multiples lui paraissent odieux et méprisables; supposons, enfin, que cette population soit pourvue d’un assez bon jugement pour ne point aventurer ses capitaux dans des entreprises qui ne présentent point de suffisantes garanties de succès, qu’en résultera-t-il?
Qu’au sein d’une nation ainsi gouvernée et composée, les [I-288] risques généraux de la production seront à leur minimum, partant aussi les primes nécessaires pour les couvrir.
Ce sont là deux situations extrêmes; mais si l’on considère les différentes nations du globe au point de vue de la sécurité qu’elles présentent à l’emploi des capitaux, on s’apercevra qu’elles se placent, à des degrés divers, entre ces deux extrémités. Le haut de l’échelle est occupé par la Hollande, l’Angleterre, la Suisse et quelques autres pays remarquables par la bonté comparative de leur gouvernement, par la moralité et l’intelligence de leurs populations. Le bas est occupé par les contrées dont les populations clair-semées et encore à l’état sauvage sont impuissantes à se protéger soit contre les agressions du dehors, soit contre l’anarchie du dedans, où le gouvernement, au lieu de s’attacher à protéger les populations, n à en vue que de les exploiter, où enfin les rapines et les déprédations publiques et privées sont passées à l’état d’habitude. Sur les échelons intermédiaires se placent les pays où les institutions et les mœurs sont à l’état moyen.
De là des différences énormes dans le développement de la production de ces divers pays.
Arrivons maintenant aux risques particuliers de la production. Certaines branches de la production comportent plus de risques, en vertu de leur nature particulière; certaines autres en comportent moins. Les industries de luxe, par exemple, qui se trouvent pour la plupart exposées aux caprices de la mode, subissent, de ce chef, un risque spécial. En effet, que la mode vienne à changer pendant que l’on produit des étoffes d’un certain dessin, ou des meubles d’un certain modèle que tout le monde demandait hier, que personne ne demandera plus demain, et les producteurs subiront infailliblement une [I-289] perte. Voilà donc un risque particulier, un risque qui ne se présente point dans les industries placées en dehors de l’influence de la mode.
Ces inégalités des risques de la production se répercutent inévitablement, et d’une manière toute spontanée, dans la rémunération du capital; car, à rémunération égale, on choisit de préférence les industries qui offrent aux capitaux la sécurité la plus grande. Si une industrie, à laquelle incombe un risque de 5 p. c., ne me donne point pour mon capital une rémunération plus élevée que telle autre dont les risques sont de 2 p. c. seulement, je préférerai assurément la seconde à la première, et tout capitaliste en fera autant. J’exigerai de même une rémunération plus forte pour mon capital dans les pays où les risques généraux de la production sont élevés que dans ceux où ils sont bas.
Voilà pour ce qui concerne les risques.
Un second élément entre dans la rémunération nécessaire des capitaux engagés dans la production, c’est la privation.
Pour nous rendre bien compte de l’importance de ce second élément de la rémunération nécessaire du capital, jetons un coup d’œil sur les mobiles qui poussent l’homme à former des capitaux et à les engager dans la production.
Nous avons vu précédemment que les agents productifs qui composent le personnel et le matériel de la production se multiplient grâce au produit net et à l’épargne. Supposons qu’aucune entreprise ne fournisse un produit net; supposons que les résultals de la production n’excèdent point la somme nécessaire pour entretenir et renouveler les agents productifs, le capital ne pourra s’augmenter et la production demeurera stationnaire. Supposons encore que la production [I-290] donne régulièrement un produit net, mais qu’aucune portion de ce produit net ne soit épargnée, pour être, sous forme d’un supplément de travailleurs, de bâtiments d’exploitation, de machines, de matières premières, de terres défrichées, consacrée à une augmentation du personnel et du matériel de la production, celle-ci demeurera encore stationnaire.
Heurcusement, il y a des mobiles nombreux et divers qui poussent les producteurs à ne pas appliquer à la satisfaction de leurs besoins immédiats tout leur produit net, à en réserver une partie soit pour la consommation future, soit pour l’augmentation de la production.
L’homme est soumis, dans le cours de son existence, à des éventualités qui l’obligent à réserver pour l’avenir une partie de son gain de chaque jour. Telles sont les maladies et la vieillesse. Si, dans les jours de prospérité, aux époques où il gagne amplement de quoi subvenir à ses besoins, il n’a pas assez de prévoyance pour réserver et accumuler une partie de son gain, un jour viendra où il se trouvera sans ressources en présence des maux et des accidents inévitables dont est parsemée l’existence humaine. La nécessité de pourvoir aux mauvaises éventualités de l’avenir, voilà donc le premier mobile qui excite l’homme à épargner. Alors même qu’il ne pourrait employer son épargne à augmenter son revenu, en la mettant sous la forme d’un supplément d’agents productifs et en la consacrant à la production, il n’accumulerait pas moins chaque année une portion de son produit net. C’est ainsi que, dans les pays et aux époques où la sécurité n’est pas suffisante pour déterminer l’application d’un supplément de capital à la production, ou même le capital engagé diminue faute d’être convenablement entretenu et renouvelé, on accumule cependant de la [I-291] richesse. On épargnait aux époques les plus troublées du moyen âge; on épargne dans les contrées où la propriété est encore aujourd’hui le moins sῦrement garantie. Seulement on a soin, en ce cas, de mettre son épargne, sa richesse accumulée, sous forme de matières que l’on puisse à la fois conserver longtemps et dérober aisément à la spoliation. Chacun consacre l’excédant disponible de sa production à acheter des métaux précieux, des pierreries ou d’autres matières que l’action du temps n’altère point et qui puissent être facilement mises en lieu sῦr. Cette épargne, on a soin de la réserver et de l’enfouir pour les mauvais jours. Elle ne sert point à augmenter la production, mais elle n’en est pas moins utile. Elle donne, en premier lieu, aux populations, les moyens de pourvoir aux éventualités ordinaires de la maladie, du chômage et de la vieillesse. Elle leur donne, en second lieu, les moyens de se soustraire en partie aux conséquences funestes de l’anarchie et de la guerre. Dans les deux cas, elle concourt au maintien sinon au développement de la production. En effet, si les travailleurs n’accumulaient pas une réserve pour les jours de maladie ou de chômage, ils courraient risque d’être emportés par ces éventualités funestes, et le personnel de la production, dont ils font partie, se trouverait ainsi diminué. S’ils n’accumulaient pas pour échapper aux conséquences de l’anarchie et de la guerre, dans les pays et aux époques où ces fléaux les menacent, s’ils ne possédaient point des ressources cachées lorsque leurs maisons ont été incendiées, leurs champs ravagés, leurs moissons foulées aux pieds des chevaux, ils seraient hors d’état de réparer ces pertes; ils périraient de misère et le pays qu’ils habitent serait bientôt inculte et désert.
Alors même qu’on n’aurait point en vue d’augmenter son [I-292] revenu, en mettant un supplément de capital au service de la production, on épargne. Mais ne perdons pas de vue que l’épargne suppose deux choses: 1° un produit net disponible; 2° une dose de prévoyance suffisante pour soustraire une portion de ce produit net à la consommation immédiate. Quelquefois le produit net n’existe pas, soit à cause des difficultés naturelles de la production, soit à cause des risques que l’anarchie et la guerre font peser sur elle. Alors toute épargne est impossible, et l’homme demeure voué aux angoisses et aux tortures du dénῦment, aussitôt qu’il devient impropre à produire. La même situation l’attend, lorsqu’il n’a pas assez de prévoyance ni de force morale pour s’abstenir d’appliquer à la satisfaction immédiate de ses besoins tout le résultat de sa production.
Moins les éventualités auxquelles les réserves doivent pourvoir sont pressantes, moins l’esprit d’économie se développe. On remarque, par exemple, que les marins et les militaires sont beaucoup moins disposés à l’épargne que les travailleurs des autres professions, surtout en temps de guerre. Cela tient d’abord à ce qu’ils sont, pour la plupart, sans famille; cela tient ensuite à ce que les chances du métier leur permettent moins de songer à la vieillesse. Ils accordent d’autant plus aux jouissances actuelles qu’ils peuvent moins compter sur l’avenir. Leur penchant à la dépense est encore encouragé par les pensions que les gouvernements ont coutume de leur garantir.
On épargne donc en vue de pourvoir à la consommation future.
On épargne aussi en vue d’augmenter son revenu, en appliquant à la production un supplément de capital. C’est ainsi que l’agriculteur épargne soit pour défricher un supplément de [I-293] terre, soit pour cultiver mieux, à l’aide d’instruments perfectionnés, le domaine qu’il exploite, et en tirer un supplément de revenu. C’est ainsi que l’industriel épargne pour augmenter l’importance de sa manufacture, le négociant pour développer son commerce.
L’homme qui épargne établit une balance entre les jouissances qu’il peut retirer de l’application de ses ressources à la satisfaction des besoins qui le sollicitent actuellement, c’est à dire à sa consommation présente, et les jouissances que pourra lui procurer une réserve destinée soit à pourvoir aux éventualités de l’avenir, soit à augmenter sa puissance productive, partant son revenu, et, dans les deux cas, sa consommation future. Les prodigues sacrifient volontiers la consommation future à la consommation présente, et ils font un mauvais calcul en ce que les privations futures auxquelles ils s’exposent leur causeront plus de mal que la consommation présente ne leur procure de jouissances. Les avares, qui sacrifient au contraire la consommation présente à la consommation future, font encore un mauvais calcul, en ce qu’ils se privent d’une portion de jouissances actuelles qu’ils pourraient se procurer sans rien exposer. Les uns dépouillent l’avenir au profit du présent, les autres dépouillent le présent au profit de l’avenir. La sagesse réside dans un esprit de judicieuse économie qui tient le milieu entre la prodigalité et l’avarice.
Mais, dès que l’on épargne, on tient à conserver autant que possible la libre disposition de son capital accumulé; on tient soit à l’avoir sous la main, soit à pouvoir le réaliser d’une manière immédiate et sans perte, comme si on l’avait sous la main. Cela se conçoit aisément. Si l’on a accumulé, par exemple, un capital en vue de pourvoir à certaines éventualités de [I-294] maladie, de vieillesse ou de mort, et que l’on perde la libre disposition de ce capital, en l’appliquant à la production, on pourra souffrir une privation plus ou moins intense, lorsque les éventualités en vue desquelles on l’a accumulé viendront à échoir. On conservera donc son capital disponible à moins que la production à laquelle on l’applique ne fournisse une prime suffisante pour compenser cette privation. La prime sera plus ou moins forte selon deux circonstances: 1° selon que les éventualités qui pèsent sur le capitaliste sont plus ou moins nombreuses et urgentes; 2e selon que le capital engagé dans la production peut en être retiré plus ou moins promptement et avec plus ou moins de perte.
Si les éventualités qui pèsent sur le capitaliste sont nombreuses et urgentes, s’il n’a pour y faire face que de faibles ressources, si encore la production est ainsi organisée que les capitaux qui y sont engagés ne puissent en être retirés promptement et avec une faible perte, ou, ce qui revient au même, que l’on ne puisse se procurer à peu de frais des capitaux disponibles sous la garantie de ceux-là, la prime nécessaire pour couvrir la privation sera considérable.
Elle sera faible, au contraire, si les détenteurs du capital ne sont exposés qu’à des éventualités peu nombreuses et dont l’échéance puisse être aisément prévue; si encore les capitalistes ont des ressources étendues pour y subvenir; s’ils sont dans l’opulence; si, d’un autre côté, la production est ainsi organisée qu’on puisse en retirer promptement et à peu de frais les capitaux qu’on y a appliqués.
A cet égard, les différences de situation sont presque infinies. Il en résulte que les primes nécessaires pour couvrir la privation provenant de l’engagement du capital sont infiniment [I-295] inégales aussi. Elles varient selon les époques, les lieux et les industries. Elles sont faibles dans les pays riches, élevées dans les pays pauvres; elles sont faibles encore dans les industries d’où le capital peut être aisément retiré, élevées dans celles où ce retrait est difficile et grevé d’impôts, comme aussi où les emprunts sur des capitaux engagés sont onéreux.
Les difficultés que la législation oppose dans un grand nombre de pays à la réalisation des capitaux engagés, les frais que cette réalisation implique; les obstacles que l’on rencontre lorsqu’on veut emprunter sur des capitaux engagés, les impôts et les frais extraordinaires dont ces emprunts sont grevés, le peu de garanties que l’on a quant à leur recouvrement, sont pour beaucoup dans l’élévation de la rémunération nécessaire des capitaux. En France, par exemple, les vices de la législation hypothécaire, les priviléges accordés à certains officiers ministériels, les impôts qui grèvent la vente des immeubles et les emprunts sur hypothèques (enregistrement, timbre, etc.), élèvent singulièrement le taux du loyer des capitaux, car on n’en peut recouvrer la libre disposition qu’avec une lenteur extrême et moyennant des frais exorbitants: à quoi il faut ajouter que la France étant essentiellement un pays de petites fortunes, les gens qui ont des capitaux engagés sont fréquemment obligés de retirer de la production tout ou partie de leurs fonds, pour subvenir à des nécessités fortuites. La prime inhérente à la privation se trouve ainsi portée à un taux considérable.
En revanche, elle est presque nulle, dans certains emplois où le capital peut être réalisé d’une manière instantanée et presque sans frais. Tels sont les emprunts publics et les entreprises par actions. Vous avez, par exemple, accumulé un [I-296] capital soit pour parer aux éventualités de la maladie, du chômage ou de la vieillesse, soit pour augmenter votre revenu, en profitant des bonnes chances de gain qui peuvent s’offrir. Vous avez donc un intérêt évident à conserver la libre et pleine disposition de votre capital. Or vous cesserez de pouvoir en disposer, si vous l’employez à hâtir une maison, à défricher un champ ou à fonder un nouvel atelier. A la vérité, si l’éventualité en vue de laquelle vous avez accumulé votre capital vient à échoir, vous pourrez vendre votre maison, votre champ, votre atelier, ou bien encore emprunter sur cette garantie le capital dont vous avez besoin. Mais les institutions barbares qui régissent encore la propriété immobilière dans la plupart des pays civilisés, les impôts excessifs qui la grèvent, rendent la réalisation du capital engagé dans la maison, le champ ou l’atelier extrêmement lente et onéreuse. Quant aux emprunts, l’impossibilité de donner de sῦres garanties aux prêteurs, par suite des obscurités et des complications de la législation hypothécaire, les frais qui résultent de l’obligation imposée à l’emprunteur de passer par les mains d’officiers privilégiés, les rendent fort coῦteux. Vous ne vous dessaisirez donc pas de votre épargne pour bâtir une maison, pour défricher un champ, pour fonder un atelier, à moins que cet emploi de votre capital ne vous procure une rémunération suffisante pour vous dédommager de la privation qui vous est imposée. Il en sera autrement si, au lieu de bâtir isolément une maison, de défricher un champ ou de fonder un atelier, vous vous associez avec d’autres capitalistes pour construire un chemin de fer, exploiter une mine, entreprendre une industrie ou un commerce quelconque. Il en sera encore autrement si vous prêtez votre capital au gouvernement. Dans les deux cas, vous pourrez recouvrer d’une manière [I-297] presque instantanée et à peu de frais, la disposition de votre capital, aussitôt que vous en aurez besoin. Ce sera comme si vous l’aviez conservé sous votre main, libre, non engagé. Voici, en effet, comment les choses se passeront. Si vous avez placé votre capital dans une entreprise de chemins de fer, de mines, etc., on vous donnera en échange un certain nombre d’actions, lesquelles vous conféreront le droit de toucher un dividende; si vous l’avez prêté au gouvernement, on vous donnera un titre ou coupon de rente, auquel sera attaché un intérêt. Or ces actions industrielles et ces coupons de rente, vous n’aurez pas besoin de remplir une longue série de formalités coῦtenses, lorsqu’il vous conviendra de les vendre; vous n’aurez qu’à les porter sur un marché public installé à cet effet, vous n’aurez qu’à les offrir ou les faire offrir à la Bourse. Là vous pourrez vous en défaire immédiatement et à peu de frais. Que si vous ne voulez pas les vendre, que si vous préférez emprunter la somme dont vous avez besoin, en les donnant en garantie, vous le pourrez encore aisément. Il y a des institutions qui prêtent sur dépôt d’actions ou de coupons de rente, sans vous imposer aucune formalité gênante, et moyennant un faible intérêt, car elles n’ont pas à craindre que le titre déposé se trouve grevé d’une hypothèque occulte.
A la vérité, vous risquerez toujours, en vous dessaisissant de votre capital, soit pour fonder de grandes entreprises industrielles, soit pour le prêter au gouvernement, de ne pouvoir le recouvrer intégralement en vendant votre titre, ou bien encore de ne pouvoir emprunter aisément sur ce titre, au moment où vous en aurez besoin. Mais ce risque n’a qu’une faible importance. Car il pourra arriver aussi qu’en vendant vos actions ou vos titres de rentes, vous réalisiez une somme supérieure à [I-298] celle que vous aurez déboursée pour vous les procurer. D’ailleurs, même en conservant votre capital disponible sous forme de métaux précieux, de pierreries, de blé ou de toute autre matière facilement et à peu de frais réalisable, vous pourrez subir aussi une dépréciation, au moment où vous aurez besoin de l’employer. Il se pourra que l’argent, les pierreries, le blé ne valent plus alors ce qu’ils valaient au moment où vous avez accumulé votre capital.
La prime nécessaire pour couvrir la privation du capital engagé, — cette prime qui est très élevée lorsque le capitaliste engage isolément ses fonds sous forme de maisons, de terres, d’ateliers, — devient très faible lorsque l’engagement a lieu dans des entreprises collectives où le capital est représenté soit par des actions, soit par des titres de rentes, immédiatement et à peu de frais réalisables. Cela étant, on conçoit que les entreprises constituées par actions négociables doivent avoir sur les autres un avantage marqué, puisque la rémunération nécessaire de leur capital est moins élevée. Cette cause, et plusieurs autres, agissent activement de nos jours pour substituer aux entreprises isolées des entreprises collectives.
Dans les entreprises isolées, le retrait des capitaux engagés est plus ou moins facile selon la nature de la production. Si vous avez un commerce d’épiceries, par exemple, vous pourrez réaliser votre capital plus promptement et avec une perte moindre que si vous possédiez une manufacture de coton. Vos épiceries sont des marchandises pour lesquelles on trouve toujours des acheteurs. Il en est autrement pour le matériel d’une manufacture. On peut malaisément se défaire d’un matériel de ce genre, sans subir une forte perte, surtout lorsqu’on est pressé de réaliser son capital. La rémunération nécessaire d’un capital [I-299] engagé dans un commerce d’épiceries est, en conséquence, moins élevée que celle d’un capital engagé dans une manufacture, la prime requise pour couvrir les éventualités de la privation étant moins forte.
D’autres éléments entrent encore dans la rémunération nécessaire des capitaux fixes et circulants engagés dans la production et contribuent à la diversifier.
Ce sont d’abord les avantages ou les inconvénients particuliers qui se rattachent plus ou moins directement à l’exploitation de certaines industries. Ainsi, la rémunération nécessaire d’un capital employé à mettre en activité une entreprise de prostitution sera plus élevée que celle d’un capital employé dans une industrie honnête. Pourquoi? Parce qu’on risque de se déconsidérer en commanditant des entreprises de prostitution. Ce risque doit, en conséquence, être compensé par une prime.
Au contraire, lorsque l’emploi d’un capital est de nature à procurer au capitaliste certains avantages particuliers, matériels ou moraux, la rémunération nécessaire du capital s’abaisse. On remarque, par exemple, que la rémunération des capitaux employés dans les entreprises de journaux et de théâtres est, proportion gardée, moins élevée que celle des capitaux employés dans les autres branches de la production. Pourquoi? Parce que les journaux procurent une certaine influence politique. Parce que les théâtres offrent à leurs commanditaires des avantages particuliers d’un autre genre. Il arrive fréquemment que les capitaux engagés dans les entreprises de journaux ou de théâtres n’obtiennent pas leur rémunération nécessaire, qu’ils soient détruits au bout d’un laps de temps plus ou moins long, sans que les entreprises mêmes disparaissent. Cela tient [I-300] à ce que de nouveaux capitalistes viennent prendre la place des anciens, en vue d’acquérir les avantages particuliers à ce genre d’entreprises.
La même observation s’applique aux capitaux engagés dans des fondations scientifiques, charitables ou religieuses.
En résumé, le minimum indispensable pour qu’un capital soit appliqué et maintenu, d’une manière régulière et permanente, au service de la production, se compose:
- 1°Si c’est un capital circulant, de la somme nécessaire pour le rétablir au bout de chaque opération; si c’est un capital fixe, de la somme nécessaire pour l’entretenir et le renouveler à mesure qu’il se détruit;
- 2°D’une prime suffisante pour couvrir les risques attachés à toute entreprise de production;
- 3°D’une prime suffisante pour compenser le dommage éventuel résultant de la privation du capital engagé;
- 4°D’une autre prime destinée à balancer les avantages ou les inconvénients particuliers à certaines industries. Cette prime s’ajoute à la rémunération du capital, lorsqu’il s’agit d’un inconvénient; elle s’en déduit lorsqu’il s’agit d’un avantage.
Nous venons de voir que les risques et les éventualités attachés à l’exercice des différentes branches de la production varient suivant les temps, les lieux, les circonstances générales et les conditions particulières dans lesquelles se trouve chaque industrie; nous venons de voir que les capitaux engagés dans la production courent plus ou moins de risques selon les époques, les pays et les industries; nous venons de voir encore que les éventualités résultant de la privation du capital engagé sont plus ou moins nombreuses et urgentes selon la situation des capitalistes et la facilité plus ou moins grande avec laquelle [I-301] ils peuvent réaliser leurs fonds. On conçoit donc que la rémunération nécessaire du capital soit essentiellement diverse et mobile; qu’elle ne le soit pas moins que celle du travail.
Le progrès agit, du reste, sur celle-là tout autrement que sur celle-ci. Tandis qu’il élève incessamment les frais de production du service productif de l’homme, ainsi que cela a été démontré (voir la IXe leçon), il abaisse ceux du service du capital. Il les abaisse en rendant les gouvernements meilleurs, sinon moins coῦteux, les législations plus équitables et moins compliquées, la police plus efficace, en développant davantage les facultés intellectuelles et morales des peuples, notamment la faculté de raisonner et de prévoir, et celle de discerner ce qui est juste et utile de ce qui est injuste et nuisible. C’est ainsi qu’il diminue les risques industriels, partant la prime nécessaire pour les couvrir. Il abaisse encore les frais de production du service du capital, en augmentant peu à peu la richesse générale, et en mettant par là même les préteurs en état de se passer de plus en plus aisément de la portion engagée de leurs capitaux, comme aussi en perfectionnant l’organisation industrielle, de telle sorte qu’un capital engagé devienne de plus en plus aisément réalisable dans toutes les branches de la production. C’est ainsi qu’il diminue la prime nécessaire pour couvrir la privation du capital engagé.
La rémunération des capitaux fixes ou circulants qui composent le matériel de la production ne saurait tomber, d’une manière régulière et permanente, au dessous de la somme indispensable pour les entretenir et les renouveler, ainsi que pour couvrir la privation et les risques dont leur emploi est accompagné. Lorsqu’elle tombe au dessous de ce minimum, ou les capitaux engagés se détruisent et disparaissent peu à peu, ou [I-302] leurs détenteurs les retirent de la production afin de parer à des éventualités et à des chances qui maintenant ne sont plus couvertes. Alors cette catégorie d’agents productifs devenant moins abondante, sa rémunération hausse.
Ce minimum, au dessous duquel la rémunération du capital ne peut tomber d’une manière régulière et permanente, constitue les frais de production du service du capital. Si l’on joint à ces frais une part proportionnelle de produit net, on aura le prix naturel du service productif des capitaux, autour duquel gravite incessamment le prix courant de ce service, absolument comme autour du prix naturel du service productif des facultés humaines gravite le prix courant du travail.
Qu’un produit net vienne nécessairement s’adjoindre aux frais de production du service du capital, c’est ce que nous allons essayer de démontrer encore.
Certains écrivains se sont élevés avec beaucoup de véhé mence, comme chacun sait, contre la rémunération du capital. Ils ont déclaré que le capital était le tyran de la production, qu’il ne laissait au travail qu’une part chétive et insuffisante, pour s’attribuer la part du lion; qu’il était temps d’en finir avec cette exploitation du travailleur par le capitaliste, et de mettre le capital à la portion congrue. Sans revenir sur les causes qui ont pu déprimer, d’une manière anormale, la rémunération de la masse des travailleurs, nous allons examiner s’il est possible de retrancher quelque chose de la rémunération du capital, telle que nous l’avons analysée.
Veut-on qu’aucune part ne soit désormais accordée au capital dans les résultats de la production? Mais cela n’est évidemment pas possible. Il faut que le capital circulant soit intégralement renouvelé au bout de chaque opération; il faut que le capital [I-303] fixe soit entretenu et qu’il soit renouvelé au bout d’un certain nombre d’opérations, sinon l’un et l’autre se détruisent, disparaissent et la production s’arrête. Il faut encore que les risques de la production soient couverts, sinon ces risques finissent par dévorer le capital. Il faut enfin que la privation du capital investi, engagé, soit compensée, sinon le capital sera retiré de la production ou n’y sera point appliqué. Il ne peut donc être question de toucher aux frais de production du service du capital.
Peut-on du moins refuser aux capitalistes une part dans le produit net? Est-il possible d’attribuer aux travailleurs tout ce produit net, sur lequel repose le développement futur de la production? Examinons.
Admettons un instant que le produit net, c’est à dire tout le surplus restant après que la somme nécessaire pour maintenir en état le personnel et le matériel de la production a été prélevée; admettons, dis-je, que le produit net aille tout entier aux travailleurs, qu’en résultera-t-il? C’est que les travailleurs, investis de la totalité du produit net, ne trouveront aucun avantage à en mettre une portion sous forme de bâtiments, de machines, de matières premières, ou, ce qui revient au même, sous forme de capitaux fixes ou circulants; c’est qu’ils le consacreront à la satisfaction de leurs besoins sans en appliquer aucune part à l’accroissement de la production. La production demeurera alors à l’état stationnaire, aucun supplément de capital fixe ou circulant n’étant plus formé. Mais il faudra, en même temps, que les détenteurs du produit net se gardent d’en consacrer la moindre part à former un supplément de travailleurs, sinon la balance cessera de pencher de leur côté. L’offre des bras et des intelligences venant, en effet, à s’accroître, [I-304] tandis que celle des autres agents productifs demeurerait stationnaire, la rémunération du travail baisserait, et les travailleurs perdraient ainsi une portion de leur produit net qui irait aux mains des détenteurs des autres agents productifs.
Que si maintenant l’on songe que les hommes sont à la fois détenteurs des facultés et des connaissances nécessaires à la production, des capitaux fixes et circulants, et des agents naturels appropriés, on se convaincra aisément que l’équilibre ne saurait demeurer rompu d’une manière permanente en faveur d’aucune de ces catégories d’agents productifs. Supposons, en effet, que le travail emporte tout le produit net, les capitalistes qui consacraient annuellement une partie de leur revenu à constituer de nouveaux capitaux fixes et circulants, à bâtir de nouvelles maisons, à construire de nouvelles machines, etc., ne trouveront-ils pas plus d’avantage à créer un supplément de travailleurs? N’en sera-t-il pas de même pour les propriétaires fonciers qui consacraient chaque année une portion de leur produit net à augmenter leurs exploitations rurales? On multipliera donc le personnel de la production, sans augmenter le matériel, et l’équilibre, en admettant qu’il ait pu être rompu, ne manquera pas de se rétablir. D’un autre côté, si l’équilibre vient à être rompu en faveur du matériel, on ne manquera pas de ralentir la multiplication du personnel. Les travailleurs, par exemple, ne trouveront-ils pas avantage à consacrer une partie de leur produit net ou même de leurs fonds de renouvellement à former des capitaux fixes et circulants ou des agents naturels appropriés, plutôt que des hommes, du matériel plutôt que du personnel? Le produit net doit donc évidemment se partager, sauf l’influence des causes perturbatrices, entre les agents productifs, personnel et matériel, en proportion du concours qu’ils [I-305] apportent à la production. Aucun de ces agents ne peut, en vertu de la nature même des choses, emporter d’une manière permanente, la balance de son côté, et l’équilibre doit nécessairement s’établir vers le point marqué par le niveau des frais de production du service de chacun, augmentés d’une part proportionnelle de produit net.
On ne saurait donc mettre le capital à la portion congrue. Ce serait une entreprise chimérique! Mais on peut fort bien, par des progrès successifs, en diminuant les risques de la production, en facilitant la réalisation des capitaux engagés, etc., réduire les frais de production du service du capital, partant aussi sa part proportionnelle de produit net.
Nous connaissons maintenant les éléments du prix naturel du service des capitaux; il nous reste à examiner comment s’établit le prix courant de ce service, et sous quelles formes il se perçoit.
[I-306]
DOUZIÈME LEÇON↩
la part du capital (suite)
Du prix courant du service productif du capital. — Comment il gravite autour du prix naturel de ce service. — Des formes sons lesquelles il est perçu. — En quoi consistent le profit, — le dividende, — le loyer, — l’intérêt. — Qu’il y a toujours entre ces différentes formes de la rémunération du capital proportionnalité ou équivalence. — Que l’on a cependant attaqué l’intérêt d’une manière spéciale. — Historique du préjugé contre le prêt à intérét. — Arguments employés pour justifier ce préjugé. — Circonstances qui ont pu lui donner naissance et le faire subsister jusqu’à nos jours. — D’où est venue la réaction contre ce préjugé. — Comment et par qui il a été battu en brêche. — Atténuations que l’Eglise catholique a apportées à sa doctrine prohibitive du prêt à intérêt. — Du dommage naissant et du lucre cessant. — État actuel de la question. — Aperçu des inconvénients de la limitation du taux de l’intérêt. — Résumé. — A quoi aboutissent les déclamations contre le capital.
Le prix courant du service productif des capitaux tend incessamment, comme celui des services productifs des facultés humaines, à se confondre avec son prix naturel, c’est à dire avec la somme nécessaire pour maintenir le capital au service [I-307] de la production et l’augmenter dans la proportion utile. Quand l’offre du capital dépasse la demande, le prix courant de son service productif petit tomber au dessous du prix naturel de ce service; mais aussitôt, les risques de l’emploi du capital n’étant plus suffisamment couverts ni la privation suffisamment compensée, une partie du capital se dissipe ou se retire, l’offre diminue et le prix courant s’élève. Quand, au contraire, le prix courant vient à dépasser le prix naturel, par suite de l’excès de la demande relativement à l’offre, la rémunération du capital s’augmente d’une prime qui encourage la formation des capitaux et leur application à la production. Alors l’offre des capitaux s’accroît et le prix courant s’abaisse.
Des circonstances diverses peuvent toutefois, comme dans le cas de la rémunération du travail, entraver l’action de cette loi régulatrice. Quand les détenteurs de capitaux possèdent un monopole, par exemple, ils peuvent diminuer artificiellement leur offre et maintenir ainsi, pendant une période plus ou moins longue, le prix courant du service productif de leurs capitaux au dessus de son prix naturel. Mais, comme dans le cas du travail encore, la prime extraordinaire dont jouissent les détenteurs du monopole, agit activement pour le détruire, qu’il soit naturel ou artificiel.
Examinons maintenant sous quelles formes se perçoit la rémunération du service productif des capitaux.
Comme la rémunération du travail, elle se présente tantôt sous la forme d’une part éventuelle, tantôt sous la forme d’une part assurée. Dans le premier cas, elle se nomme profit on dividende; dans le second cas, intérêt ou loyer.
Lorsque vous engagez un capital dans la production, c’est en vue d’obtenir une part de produit qui couvre votre privation [I-308] ainsi que vos risques et vous procure un bénéfice. Mais cette part de produit, vous pouvez ne point la recevoir si les risques de la production viennent à échoir; elle est, de sa nature, purement éventuelle.
S’il s’agit d’une entreprise formée à l’aide des fonds d’un seul capitaliste ou d’un petit nombre de capitalistes, cette part éventuelle prend le nom de profit.
S’il s’agit d’une entreprise formée au moyen de la réunion d’un grand nombre de fractions de capital, cette part éventuelle se nomme dividende.
N’oublions pas toutefois que le profit comprend ordinairement avec une part afférente au capital, une part afférente au travail. L’entrepreneur d’industrie est, en effet, un travailleurcapitaliste qui consacre à la production son fonds de facultés productives ainsi que les capitaux fixes et circulants dont il dispose. Il doit donc être rémunéré à ce double titre. Il doit recevoir une part comme travailleur et une part comme capitaliste.
Les choses se passent autrement dans les entreprises fondées au moyen de capitaux collectifs. Dans cette forme de la production incontestablement plus parfaite que la précédente, la séparation des fonctions productives, la division du travail, a fait un pas de plus. L’entreprise est dirigée et mise en activité par un personnel de travailleurs qui reçoivent séparément, et le plus souvent sous la forme d’une part fixe et assurée, la rémunération de leurs services productifs. Les actionnaires qui fournissent le capital ne participent que dans une faible mesure à la gestion de l’entreprise et leur rémunération ne comprend, en conséquence, que la part éventuelle, afférente à leur capital. Cette part éventuelle, c’est le dividende.
[I-309]
Le profit et le dividende n’en sont pas moins des termes synonymes, lorsqu’on a soin de séparer du profit la part qui revient au travail.
Au lieu d’être purement éventuelle, partant mobile, variable, selon les résultats de l’opération productive, la part du capital peut être indépendante des résultats de cette opération, elle peut être assurée, partant fixe. Dans ce cas, elle se nomme intérêt, lorsqu’il s’agit d’un capital circulant, loyer lorsqu’il s’agit d’un capital fixe.
Je dis que la part du capital dans la production peut être assurée, an lieu d’être simplement éventuelle. Ceci a lieu chaque fois qu’on prête ou qu’on loue un capital au lieu de l’employer pour son propre compte, soit isolément, soit par association. Ainsi, par exemple, nu homme a besoin d’un capital pour entreprendre une industrie. Ce capital, il ne le possède point, mais vous le possédez. Vous pouvez vous associer avec lui et percevoir votre part dans le produit de l’entreprise sous la forme d’un profit ou d’un dividende, mais vous n’aurez dans ce cas qu’un revenu purement éventuel. Si l’entreprise tourne mal, non seulement vous ne percevrez aucun revenu, mais encore vous courrez le risque de perdre votre capital. Vous préférez, en conséquence, recevoir un revenu fixe et assuré, dùt-il être moins élevé. Que fait alors l’individu qui a besoin de votre capital? Après avoir évalué le bénéfice probable de l’entreprise, il s’engage: 1° à vous restituer intact votre capital à une époque convenue; 2° à vous fournir dans l’intervalle un revenu fixe. C’est une double assurance qu’il vous procure, une double responsabilité dont il se charge, car il n’a point et ne peut avoir la certitude que l’entreprise lui donnera un produit suffisant pour vous fournir une part fixe, ou même pour recomposer [I-310] intégralement le capital que vous lui avez prêté. Tout emprunteur est donc, en même temps, un assureur. Mais on conçoit que cette assurance ne soit pas, ne puisse pas être entière, qu’elle ne vaille que ce que vaut l’assureur lui-même. Si c’est un homme habile, prudent et honnête; s’il possède un capital assez considérable pour servir de garantie au vôtre, les risques que vous subirez seront très faibles. L’assurance, en ce cas, sera presque complète. Mais si votre emprunteur est un homme d’une habileté médiocre et d’une probité douteuse, s’il ne possède qu’un faible capital, enfin s’il se trouve engagé dans une entreprise chanceuse, les risques que vous subirez, vous prêteur assuré, pourront s’élever fort haut.
Une portion plus ou moins importante des risques afférents à la production se retrouve clone dans la part assurée comme dans la part éventuelle. Un risque particulier s’y ajoute même, lorsque l’emprunteur ne présente point de suffisantes garanties de moralité. La privation s’y retrouve aussi. Quand vous prêtez un capital circulant, quand vous louez un capital fixe, vous en perdez la libre disposition pour une période plus ou moins longue. Quelquefois cette période est limitée, quelquefois elle ne l’est point. S’il vous arrivait d’avoir besoin de votre capital, dans l’intervalle, vous ne pourriez en disposer, vous en demeureriez privé, en supportant tout le dommage ou le manque à gagner résultant de cette privation, à moins que vous n’eussiez la possibilité de vendre votre créance, ou d’emprunter sur le dépôt du titre. Selon le mode d’emploi du capital, la vente des créances, ou l’emprunt sur le dépôt des titres est plus ou moins facile, et la prime nécessaire pour compenser la privation plus ou moins élevée.
Mais que le capital soit employé aux frais et risques du capitaliste; [I-311] que la part qui revient à celui-ci soit, en conséquence, variable et éventuelle; ou bien que le capital soit employé aux frais et risques d’un emprunteur qui s’engage à fournir au prêteur une part de produit fixe et assurée, sa rémunération demeurera la même, compensation faite de la différence de la privation et des risques. En d’autres termes, il y aura toujours équivalence entre le loyer et l’intérêt d’une part, le profit et le dividende de l’autre, ou si cette équivalence n’existe pas, elle tendra irrésistiblement à s’établir.
Supposons, en effet, qu’elle n’existe point; supposons que la rémunération des capitaux employés aux frais et risques des capitalistes, vienne, toutes choses étant égales, à dépasser celle des capitaux loués ou prêtés; supposons que le taux des profits et des dividendes s’élève au dessus de celui des intérêts et des loyers, qu’en résultera-t-il? Que les capitalistes préféreront employer leurs capitaux eux-mêmes, pour leur propre compte, plutôt que de les prêter ou de les louer. Moins de capitaux s’offriront donc pour être prêtés ou loués et le taux de l’intérêt ou du loyer haussera jusqu’à ce que l’équilibre se trouve rétabli. Le contraire aura lieu si le taux de l’intérêt et du loyer vient à s’élever proportionnellement au dessus du taux des profits et des dividendes. En ce cas, les individus qui ont des capitaux engagés pour leur propre compte ou qui sont en train d’en accumuler, s’empresseront de les prêter ou de les louer et l’équilibre se rétablira encore.
L’assurance qui se trouve comprise dans le prêt et le loyer, ne saurait, comme on voit, procurer un profit supérieur à celui de toute autre opération. La prime payée de ce chef ne saurait excéder le taux rémunérateur, sinon le prêteur préférerait subir lui-même le risque attaché à l’emploi de son capital; elle ne [I-312] saurait non plus demeurer longtemps au dessous, sinon l’emprunteur cesserait de trouver avantage à conclure ce genre d’opération; il trouverait plus de profit, par exemple, à s’associer un capitaliste à qui il fournirait une part éventvelle dans ses bénéfices.
Donc, on peut affirmer qu’il y a, sauf l’action des causes perturbatrices, équivalence entre les profits et les dividendes d’une part, les intérêts et les loyers de l’autre.
Nous allons voir qu’il y a, de même, équivalence entre les intérêts et les loyers.
Les expressions d’intérêt et de loyer sont fréquemment confondues, et on comprend qu’elles le soient, car l’opération qui donne naissance à l’intérêt est absolument de la même nature que celle qui. donne naissance au loyer. Entre le prêt et la location il n’y a aucune différence essentielle, Seulement, le prêt auquel correspond l’intérêt se dit communément des capitaux circulants, tandis que la location à laquelle correspond le loyer s’applique aux capitaux fixes.
Voyous sur quoi repose la distinction que l’on a établie cependant entre le prêt et la location, l’intérêt et le loyer.
Les capitaux circulants sont, comme nous l’avons vu, ceux qui disparaissent entièrement dans chaque opération productive. De là encore le nom de capitaux fongibles qui leur a été donné. Ils consistent, par exemple, dans les matières premières qui entrent dans la composition du produit et dans les moyens de subsistance que l’on fournit aux travailleurs, ou bien encore dans le numéraire à l’aide duquel on se procure matières premières et subsistances. Chaque opération doit reproduire entièrement cette portion du matériel de la production, ces capitaux circulants ou fongibles.
[I-313]
Il n’en est pas de même pour les capitaux fixes, consistant dans les bâtiments, les machines, les outils, etc., nécessaires à la production. Ceux-ci ne se consomment qu’en partie et ils ne doivent, en conséquence, être rétablis qu’au bout d’un certain nombre d’opérations.
De cette différence naturelle qui existe entre les capitaux circulants ou fongibles et les capitaux fixes ou durables, voici ce qui résulte:
C’est que l’homme qui a prêté un capital circulant ou fongible ne peut pas recouvrer les mêmes matières qu’il a prêtées; c’est qu’il en recouvre d’autres, égales en valeur.
C’est, au contraire, que l’homme qui a loué un capital fixe ou durable, un bâtiment, une machine, une bête de somme, un outil, recouvre le même agent productif qu’il a loué, le même bâtiment, la même machine, la même bête de somme, le même outil. Seulement, il le recouvre plus ou moins détérioré, endommagé, usé. D’où la nécessité qui incombe au locataire, de payer outre le prix du service de l’agent productif, une somme suffisante pour l’entretenir et le renouveler.
Ainsi donc, l’intérêt comprend seulement le prix de l’usage d’un capital; le loyer comprend, outre le prix de l’usage ou du service productif, la somme nécessaire pour maintenir en bon état et renouveler à la longue l’instrument loué.
Il semblerait, d’après cela, que le loyer dῦt toujours être supérieur à l’intérêt. Cependant il n’en est rien. Souvent même, c’est le contraire qui arrive. Voici pourquoi: c’est que la plus grande partie du matériel que l’on désigne sous le nom de capital fixe, s’use, se détériore avec une extrême lenteur, en sorte que l’annuité nécessaire pour entretenir et renouveler cette portion du matériel de la production demeure très faible; [I-314] c’est qu’elle ne dépasse pas un pour cent ou un demi pour cent, par exemple. Or, en vertu de la nature même de l’instrument loué, les risques de la location d’un capital fixe sont généralement moindres que ceux du prêt d’un capital circulant ou fongible. Si l’opération à laquelle concourent ces deux espèces de capitaux ne réussit point, le capital fongible peut être entièrement détruit, fondu; le capital fixe subsiste au contraire, ou du moins l’on n’en perd que la portion qui a été usée, consommée dans l’opération. Le prêteur est donc exposé à perdre, outre l’intérêt auquel il a droit, la totalité ou la plus grande partie de son capital, tandis que le loueur n’est exposé, lui, qu’à la perte de son loyer et de la partie de son instrument qui a été usée, consommée dans l’opération. L’homme qui loue un capital fixe subit donc, en vertu de la nature même de son instrument, un moindre risque que l’homme qui prête un capital circulant. Si la différence qui existe entre ces deux risques s’élève à un p. c., tandis que l’annuité nécessaire pour entretenir et renouveler le capital fixe n’est que d’un demi p. c., le loyer sera d’un demi p. c. plus bas que l’intérêt. Si, au contraire, l’annuité est supérieure à la différence des risques, le loyer sera plus élevé que l’intérêt. Ces inégalités dépendent à la fois ’de la nature de l’emploi du capital et de la nature du capital employé.
Mais, en tous cas, le taux du loyer ne saurait dépasser, au moins d’une manière régulière et permanente, le taux de l’intérêt, ni demeurer au dessous. Chacun peut, en effet, donner à la portion de produit net qu’il capitalise, la destination qu’il trouve la plus avantageuse; il peut la mettre sous la forme d’un capital fixe, d’une maison, d’une terre, d’une machine, ou sous la forme d’un capital circulant, d’une provision de blé, de vin, [I-315] d’huile, ou bien encore d’une somme d’argent. Si la location des capitaux fixes rapporte, toutes choses étant supposées égales, plus que le prêt des capitaux circulants, il la choisira de préférence. Il échangera la portion de produit net qu’il veut capitaliser contre une terre, une maison ou une machine qu’il louera. Dans le cas contraire, il l’échangera contre une provision de blé, d’huile, de vin, ou contre une somme d’argent qu’il prêtera. L’équilibre s’établit ainsi nécessairement entre le taux de l’intérêt et le taux du loyer, c’est à dire entre le prix de l’usage de cette portion du matériel de la production que l’on désigne sous le nom de capital circulant, et le prix de l’usage de cette autre portion du matériel de la production que l’on désigne sous le nom de capital fixe.
Ainsi donc, d’un côté l’intérêt et le loyer tendent incessamment à se mettre en équilibre avec le profit et le dividende, la part assurée avec la part éventuelle; d’un autre côté, l’intérêt tend, en vertu de la même impulsion, à se mettre en équilibre avec le loyer.
Chose curieuse cependant. Rarement on a attaqué la légitimité des profits ou des dividendes provenant de l’exploitation des capitaux fixes ou des capitaux circulants mis an service de la production. Rarement aussi, on s’est élevé contre le loyer des capitaux fixes. En revanche, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, on a contesté la légitimité de l’intérêt des capitaux circulants ou fongibles. La religion a proscrit le prêt à intérêt, bien avant que le socialisme songeât à réclamer la gratuité du crédit. Et tandis que les législateurs n’ont réglementé que d’une manière accidentelle le taux des profits, des dividendes et des loyers, ils ont presque universellement limité le taux de l’intérêt.
[I-316]
L’Église catholique s’est particulièrement signalée, dès son origine, par la guerre à mort qu’elle a faite an prêt à intérêt. Elle l’a prohibé de la manière la plus formelle, en s’appuyant sur un passage de l’Évangile selon saint Lue où Jésus-Christ s’exprime ainsi:
“Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque service, quel gré vous en saura-t-on, puisque les pécheurs mêmes se prêtent les uns aux autres pour recevoir un pareil avantage?.... Prêtez sans rien espérer (mutuum date, nihil indè sperantes), et alors votre récompense sera très grande, et vous serez les enfants du Très-Haut.” Selon tonte apparence, ce n’était là qu’un simple précepte de charité; mais dès l’origine, il fut interprété d’une manière beaucoup plus rigoureuse. L’Église interdit d’une manière formelle le prêt à intérêt, même à un très bas intérêt. Selon ses pères et ses docteurs, notamment selon saint Thomas, celui-là est un usurier, et, comme tel, passible de toutes les censures de l’Église, qui exige quelque chose en sus du sort principal, c’est à dire de la somme prêtée. Saint Ambroise, Tertullien, saint Basile, saint Jérôme, saint Chrysostôme, toutes les grandes autorités de la primitive Église avaient exprimé à cet égard la même opinion que saint Thomas. Les conciles défendirent en outre à diverses reprises le prêt à intérêt en le flétrissant du nom d’usure.
Cette opinion contraire au prêt à intérêt remonte, du reste, bien plus haut que le christianisme. Ainsi, Moise défendit aux Juifs de tirer aucun intérêt de l’argent qu’ils prêtaient à leurs concitoyens pauvres; il permit toutefois de tirer un intérêt des prêts faits aux riches et aux étrangers. Le roi David et les prophètes, particulièrement Ézéchiel, fulminèrent l’anathème contre les usuriers. Les mêmes répulsions contre le prêt à intérêt [I-317] se retrouvent chez la plupart des législateurs et des philosophes de l’antiquité païenne. Aristote, par exemple, pose en principe que l’intérêt est une chose contre nature. Caton, Cicéron, Senèque, Plutarque sont du même avis. Quelqu’un ayant demandé à Caton ce qu’il pensait du prêt à intérêt, il répondit qu’à ses yeux c’était à peu près le même crime de prêter à intérêt et de tuer un homme: quid fœnerari? quid hominem occidere?
Le sentiment universel s’élevait dans l’antiquité contre le prêt à intérêt, et les apôtres du christianisme n’ont fait autre chose que d’adopter à cet égard l’opinion commune. Cependant les mêmes philosophes et les mêmes docteurs qui réprouvaient l’intérét provenant des capitaux circulants, ne songeaient à s’élever ni contre le loyer des capitaux fixes, ni contre le profit des capitaux fixes ou circulants.
Il est assez curieux de rechercher la cause de cette anomalie. Examinons donc sommairement de quelle manière on s’y prenait pour justifier le préjugé contraire au prêt à intérêt.
Qu’il soit répréhensible de retirer un intérêt de l’argent ou des marchandises que l’on a prêtées, tandis qu’il ne l’est point de retirer un loyer de la maison que l’on a louée, une rente de la terre que l’on a affermée, ou bien encore un profit de l’argent ou des marchandises que l’on a fait valoir soi-même; que l’on commette un délit et un péché dans le premier cas, tandis qu’on use d’un pouvoir légitime dans les deux autres, voilà ce qui semble difficile à démontrer. Cette difficulté n’a pas arrêté cependant les adversaires du prêt à intérêt. Ils ont entassé volumes sur volumes pour la surmonter, et, grâce à l’ignorance universelle, ils ont pu avoir raison pendant des siècles contre le sens commun. Je me bornerai à reproduire quelques-uns des sophismes dont ils ont fait le plus fréquent usage.
[I-318]
Voici d’abord comment ils justifiaient la différence qu’ils établissaient entre l’intérêt et le loyer. “Quand je loue une maison, une terre, un outil, un cheval on un âne, disaient-ils, je puis séparer de la chose même l’usage que j’en fais, et il est juste que je vous fasse payer cet usage. Car lorsque vous me restituez ma maison, ma terre, mon outil, mon cheval, mon âne, vous me les avez plus ou moins usés, détériorés. Or n’estil pas équitable que vous me fournissiez une compensation, une indemnité pour la dépréciation que vous avez fait subir à ma chose en vous en servant? Cette compensation, cette indemnité, c’est le loyer.
“Il y a, en revanche, une autre catégorie d’objets dont l’usage ne saurait être séparé de la chose même, car on ne peut s’en servir sans qu’ils se consomment ou disparaissent des mains de celui qui s’en sert. Ce sont les objets fongibles. Tels sont l’argent, le blé, le vin, l’huile, les matières premières nécessaires à l’industrie, etc. Quand je vous prête une somme d’argent, un sac de blé, un tonneau de vin, un baril d’huile, vous ne pouvez me restituer ces choses après vous en être servi comme vous me restituez ma maison, ma terre, mon outil, mon cheval, mon âne. Vous ne le pouvez, parce qu’il est dans la nature de ces choses de se consommer par l’usage. Vous me restituez donc d’autre argent, d’autre blé, d’autre vin, d’autre huile. Mais serait-il juste que vous m’en rendissiez plus que vous n’en avez reçu? On conçoit qu’en restituant la maison, la terre, l’outil, le cheval ou l’âne, vous y ajoutiez une indemnité pour compenser la détérioration, l’usure. Mais si vous remplacez intégralement le capital fongible que je vous ai prêté, puis-je rien exiger de plus? Ne reçois-je pas sinon la chose prêtée ellemême, du moins une chose équivalente? Le prêt des objets [I-319] fongibles ne doit-il pas être gratuit en vertu de la nature même des choses?”
S’agissait-il de justifier la différence qu’ils établissaient entre le profit résultant de l’emploi d’un capital fongible et l’intérêt provenant du prêt de ce même capital, les adversaires de l’usure prétendaient que, dans le premier cas, l’on courait des risques, tandis que dans le second on n’en courait point. “En faisant valoir soi-même son capital, disaient-ils, on court risque de faire de mauvaises opérations et de perdre son capital en tout ou en partie, tandis qu’en le prêtant, soit que l’emprunteur fasse de bonnes ou de mauvaises affaires, on reçoit toujours le même intérêt.”
Rien de plus faible, de plus puéril même que ces arguments des adversaires de l’usure. N’était-il pas visible, en effet, que le loyer des maisons, des terres, etc., comprenait autre chose que l’indemnité nécessaire pour les maintenir en bon état? Que le profit provenant de l’emploi des capitaux fongibles dépassait de beaucoup l’indemnité nécessaire pour couvrir les risques de cet emploi? Enfin, qu’en prêtant un capital on n’était pas toujours “sῦr de recevoir le même intérêt;” qu’on n’avait aucune certitude de recevoir un intérêt quelconque ou même de récupérer son capital? On aurait pu aisément démontrer aux adversaires de l’usure qu’ils devaient, sous peine de se montrer illogiques, condamner comme usure tout ce qui, dans le loyer d’une maison, d’une terre, d’un outil, d’un cheval, d’un âne, dépassait l’indemnité nécessaire pour compenser la détérioration de la chose louée; tout ce qui, dans le profit d’un capital employé par son propriétaire, excédait la prime du risque. Ils auraient été conduits ainsi à cette conséquence d’une absurdité palpable qu’un fermier, par exemple, qui restituait une terre [I-320] après l’avoir améliorée, non seulement ne devait aucun fermage au propriétaire, mais encore qu’il pouvait, en bonne justice, exiger de lui une indemnité.
Un troisième argument, qui surpassait encore ceux-là en puérilité, était tiré de la prétendue stérilité de l’argent et des autres métaux servant de monnaie. C’est une chose contre nature, disait Aristote, ou lui faisaient dire ses interprètes, que l’argent produise de l’argent. Saint Basile, qui avait adopté pleinement l’opinion attribuée au philosophe grec, rappelait aux fidèles que le cuivre, l’or et les métaux ne produisent rien; qu’ils ne portent aucun fruit en vertu de leur nature même. Un autre père de l’Église, saint Grégoire de Nysse, faisait remarquer que le créateur n’a dit qu’aux créatures animées: Croissez et multipliez; qu’il n’a rien dit de semblable aux créatures inanimées, telles que l’argent. Jérémie Bentham réfute d’une manière originale cet argument attribué à Aristote et répété par la plupart des pères et des docteurs de l’Église ainsi que par un bon nombre de jurisconsultes [29]
Il arriva, dit-il, que ce grand philosophe, avec tout son talent et [I-321] toute sa pénétration, et malgré le nombre de pièces d’argent qui avaient passé par ses mains (nombre plus grand peut-être que celui qui ait jamais passé avant ou depuis dans les mains d’aucun philosophe), et malgré les peines toutes particulières qu’il s’était données pour éclaircir la question de la génération, ne pῦt jamais parvenir à découvrir dans aucune pièce de monnaie quelque organe qui la rendît propre à en engendrer une autre. Enhardi par une preuve négative de cette force, il s’aventura à donner au monde le résultat de ses observations sous la forme de cette proposition universelle, que, de sa nature, tout argent est stérile. Vous, mon ami, sur qui la saine raison a beaucoup plus d’empire que l’ancienne philosophie, vous aurez déjà remarqué, sans doute, que ce qu’on aurait dῦ conclure de cette observation spécieuse, s’il y avait lieu d’en conclure quelque chose, c’est qu’on essayerait en vain de tirer 5 p. c. de son argent, et non pas qu’on ferait mal si on parvenait à en tirer ce profit. Mais ce fut autrement que les sages de l’époque en jugèrent.
Une autre considération qui ne s’est point présentée à l’esprit de ce grand philosophe, et qui, si elle s’y fῦt présentée, n’aurait point été tout à fait indigne de son attention, c’est que, bien qu’une darique (monnaie persane) fῦt aussi incapable d’engendrer une autre darique que d’engendrer un bélier ou une brebis, un homme cependant, avec [I-322] une darique empruntée, pouvait acheter un bélier et deux brebis qui, laissés ensemble, devaient probablement, au bout de l’année, produire deux ou trois agneaux; en sorte que cet homme, venant, à l’expiration de ce terme, à vendre son bélier et ses deux brebis pour rembourser la darique, et en donnant en outre un de ses agneaux pour l’usage de cette somme, devait encore se trouver de deux agneaux, ou d’un au moins, plus riche que s’il n’avait point fait ce marché [30]
Avant Bentham, Calvin avait réfuté, en employant des arguments analogues, le sophisme d’Aristote:
L’argent, dit-on, n’enfante pas l’argent. Et la mer le produit-elle? Est-il le fruit d’une maison, pour l’usage de laquelle pourtant je reçois un loyer? L’argent naît-il, à proprement parler, du toit et des murailles? Non, mais la terre produit, la mer porte des navires qui servent à un commerce productif, et avec une somme d’argent on peut se procurer une habitation commode. Si donc il arrive que l’on retire d’un négoce plus que de la culture d’un champ, pourquoi ne permettrait-on pas au possesseur d’une somme d’argent d’en retirer une somme quelconque, quand on permet au propriétaire d’un champ stérile de le donner à bail moyennant un fermage? Et lorsqu’on acquiert à prix d’argent un fonds de terre, est-ce que ce capital ne produit pas un revenu annuel? Quelle est cependant la source des profits que fait un marchand? Son industrie, direz-vous, et son activité intelligente. Qui doute que l’argent, que l’on n’emploie pas, soit une richesse inutile? Celui qui demande à un emprunteur un capital veut apparemment s’en servir comme d’un instrument de production. Ce n’est donc pas de l’argent même que provient le bénéfice, mais de l’emploi qu’on en fait [31]
[I-323]
L’erreur d’Aristote et de ses disciples provenait, comme on voit, de ce qu’ils se méprenaient sur la signification économique des mots stérilité, productivité. L’argent est stérile en ce sens que deux pièces d’argent juxtaposées n’en engendreront jamais une troisième; mais les maisons, les navires, les machines et les outils de toute sorte ne sont-ils pas affectés du même genre de stérilité? Leur productivité réside dans le concours qu’ils apportent à la production, dans l’emploi qu’on en fait, pour nous servir de l’expression de Calvin, et telle est aussi la source de la productivité de l’argent.
C’est donc à grands renforts de sophismes que l’opinion contraire au prêt à intérêt a été soutenue. Il n’en est que plus intéressant de rechercher quelles circonstances l’ont suscitée et lui ont permis de subsister jusqu’à nos jours, malgré la faiblesse vraiment puérile des arguments employés pour la soutenir. Comme dans le cas du salaire, mais en sens inverse, ces circonstances peuvent se résumer en un seul mot: le monopole.
Dans l’antiquité, le monopole agissait à la fois pour surélever le taux du profit et celui de l’intérêt.
La rareté du travail et du capital d’entreprises, au sein de sociétés dont la guerre était la principale occupation, l’espèce de réprobation qui était attachée aux arts industriels, les règlements qui limitaient les professions, enfin l’esclavage qui mettait les travailleurs à la discrétion des entrepreneurs d’industrie, contribuaient, dans l’antiquité, à surélever le taux courant des profits. Or, le taux de l’intérêt devait correspondre exactement au taux des profits, sinon les capitalistes auraient préféré employer leurs fonds pour leur propre compte, plutôt que de les prêter.
[I-324]
La seconde cause de l’élévation du taux de l’intérêt résidait dans le peu de garanties que présentait aux prêteurs la classe nombreuse qui recourait habituellement aux emprunts dans les sociétés anciennes. La guerre était, à Rome et dans la plupart des autres sociétés de l’antiquité, la grande nécessité qui obligeait cette classe à emprunter, et qui, en même temps, l’empêchait de donner des garanties valables aux prêteurs. Le système des armées permanentes était, comme chacun sait, inconnu dans l’antiquité. Lorsqu’une guerre survenait, tous les citoyens valides étaient tenus d’y prendre part. Le petit propriétaire, par exemple, qui cultivait lui-même son champ avec un ou deux esclaves, était obligé de partir pour l’armée. Pendant son absence, sa propriété demeurait à l’abandon. A son retour, il trouvait son petit capital entamé, ses réserves détruites. Il était obligé d’emprunter la somme nécessaire pour subsister jusqu’à la récolte suivante, et il allait frapper à la porte du riche patricien qui se trouvait, lui, dans une situation bien différente; car, le patricien avait de nombreux esclaves, disciplinés comme une armée et dirigés par des contre-maîtres dont il stimulait le zèle en leur offrant la perspective de l’affranchissement. Quand il allait à la guerre, sa terre continuait d’être cultivée, ses ateliers ne chômaient point; en outre, la guerre était bien plus profitable pour les patriciens, qui occupaient les principaux grades de l’armée, qu’elle ne l’était pour les plébéiens. Les chefs ne manquaient point de s’adjuger la grosse part des dépouilles des vaincus; souvent même ils ne laissaient rien aux simples soldats, leurs compagnons de périls et de gloire.
De retour à Rome, la campagne finie, le patricien se retrouvait riche, — riche des dépouilles qu’il avait ravies à l’ennemi, [I-325] riche aussi des profits que lui avaient rapportés ses terres ou ses ateliers pendant son absence. Le malheureux plébéien, au contraire, ne retrouvait chez lui que la misère. Il empruntait pour se refaire; il empruntait au riche patricien, sous la condition de rembourser son emprunt à une échéance plus ou moins prochaine. Mais souvent, aux approches de l’échéance, une nouvelle guerre éclatait. Obligé encore une fois d’abandonner son champ ou son atelier, le plébéien ne pouvait acquitter sa dette. Alors il était impitoyablement saisi à la requête de son créancier, et ce vétéran glorieux, ce vainqueur des nations, était vendu à l’encan et attaché à la même chaîne que les ennemis qu’il avait vaincus. On conçoit combien une destinée si cruelle devait émouvoir les masses au sein desquelles se rencontraient tant de débiteurs menacés d’un sort semblable. Les plébéiens, victimes de la rigueur des créanciers, rappelaient bien haut les services qu’ils avaient rendus à la république; ils énuméraient leurs actions d’éclat; ils montraient les cicatrices dont ils étaient couverts, et parfois le peuple indigné brisait leurs chaînes. De là des troubles continuels et des plaintes véhémentes dont les échos ont traversé les siècles; de là aussi ce sentiment de commisération pour le débiteur et de répulsion pour le créancier qui remplissait les âmes et qui n’est pas encore complétement effacé; de là enfin le préjugé des masses contre le prêt à intérêt et leur haine contre les usuriers. Car les masses remontent rarement jusqu’à la source du mal qu’elles endurent. Elles s’en tiennent commumunément à la cause apparente. La guerre et l’esclavage, voilà quelles étaient, dans l’antiquité, les causes premières des maux qui accablaient les classes plébéiennes. Mais l’opinion populaire était favorable à la guerre, et l’esclavage était, malgré [I-326] ses vices, une institution indispensable. On s’en prenait donc à l’usure, et le peuple en tumulte exigeait que l’avidité des prêteurs fῦt réprimée et punie. Tantôt il réclamait l’abolition des anciennes dettes, tantôt la limitation du taux de l’intérêt. Quand, après de longs débats, on satisfaisait à ces exigences de la démocratie du temps, les emprunteurs s’abandonnaient à la joie; ils se croyaient pour jamais à l’abri des atteintes de l’usure. Cependant, bien loin d’en être améliorée, leur situation en devenait, presque toujours, plus mauvaise. En effet, lorsqu’on touchait aux anciennes dettes, on augmentait les risques du prêt, partant le taux de la prime nécessaire pour les couvrir. Lorsqu’on limitait le taux de l’intérêt, on contribuait de même à l’élever: d’abord en diminuant le nombre des prêteurs, car les plus honnêtes préféraient retirer leurs capitaux du marché et les employer pour leur propre compte, plutôt que de les prèter au dessus du taux légal. On l’élevait ensuite en augmentant les risques de ceux que ne retenait point ce scrupule et qui s’exposaient du même coup à la réprobation publique et à la vindicte de la loi, en prêtant à un taux prohibé. Les emprunteurs devenaient ainsi victimes des mesures mêmes qui étaient prises pour les protéger.
Ces circonstances réunies expliquent l’élévation excessive du taux de l’intérêt dans l’antiquité. A Rome, le taux légal de l’intérêt fut de 12 p. c. jusqu’au temps de Justinien; mais le taux auquel on prêtait communément était beaucoup plus élevé. On voit, par exemple, dans les lettres de Cicéron, que Brutus prêta de l’argent dans l’île de Chypre à 48 p. c.
Au moyen âge, la situation n’avait guère changé. Les capitaux étaient tout aussi rares que dans l’antiquité, sinon davantage, et les marchés aussi resserrés. Le prêt des capitaux continuait [I-327] d’être à peu près partout le monopole d’un petit nombre d’individus. Une circonstance particulière contribuait même à rendre ce monopole plus oppressif et plus odieux que jamais. A cette époque, les juifs, dispersés sur toute la surface du monde civilisé, étaient considérés comme une race maudite. Partout on leur interdisait la possession des capitaux immobiliers, afin de les empêcher, autant que possible, de s’établir à demeure fixe. Ils ne pouvaient acquérir que des richesses mobilières. La situation que les préjugés du temps faisaient à cette race intelligente et économe ne lui laissait guère d’autre ressource que de prêter à intérêt pour subsister. D’un autre côté, l’interdiction canonique de l’usure rendait le métier de prêteur particulièrement avantageux. Retenus par la menace de la damnation éternelle qui était fulminée contre les usuriers, les chrétiens s’abstenaient, pour la plupart, de prêter. Le marché des capitaux demeurait, en conséquence, à la merci des juifs et des autres mécréants. C’était un monopole que l’Église leur conférait sans le savoir et, à coup sῦr, sans le vouloir. Ils ne manquèrent point d’en tirer un bon profit: sur toute la surface du monde chrétien, on vit ces proscrits, ces maudits s’enrichir aux dépens des fidèles.
On essaya de limiter leurs bénéfices, d’abord par la violence, ensuite par des mesures légales. On les dépouilla, on les bannit après avoir confisqué leurs biens, etc.; mais ces mesures violentes, en aggravant les risques du prêt, n’avaient d’autre résultat que d’augmenter encore le taux de l’intérêt. On rétablit un maximum légal du taux de l’intérêt, à l’instar de ce qui s’était pratiqué dans l’antiquité, mais les prescriptions de la loi furent éludées. Ainsi, par exemple, les prêteurs ne livraient qu’une partie de la somme stipulée dans le contrat, ou bien, au [I-328] lieu de la fournir tout entière en argent, ils n’en fournissaient qu’une partie. Le complément se composait de marchandises invendables. On trouve, dans l’Avare de Molière, une esquisse d’un prêt de cette espèce. La loi était constamment éludée, et d’ailleurs les risques qu’elle faisait courir au prêteur retombaient toujours en définitive sur les emprunteurs, dont la condition devenait de plus en plus mauvaise.
En résumé, l’opinion contraire au prêt à intérêt provenait de ce que les circonstances et les institutions se joignaient communément pour conférer aux capitalistes un monopole qui leur permettait de prêter à un taux excessif. Et comme les moyens que l’on employait pour combattre ce monopole demeuraient le plus souvent inefficaces, comme ils aggravaient même parfois le mal qu’on voulait détruire, on se persuadait que le prêt à intérêt était entaché d’un vice irrémédiable. On lui imputait les maux provenant de l’usure, au lieu de les ramener à leur véritable source, qui était le monopole, et on le frappait d’anathème; puis, faute de bonnes raisons pour motiver cet anathème, on avait recours à des sophismes.
Cependant, la situation économique de l’Europe s’était peu à peu modifiée. L’anarchie qui avait régné pendant le moyen âge dans l’intérieur de chaque État commençait à faire place à l’ordre, les guerres devenaient moins fréquentes, les relations de cité à cité et de pays à pays se développaient. L’industrie et le commerce prenaient un essor rapide. Or, ces deux branches de la production, la dernière surtout, exigent une proportion considérable de capitaux circulants. Les négociants qui pouvaient réaliser de grands profits en employant des capitaux, en demandèrent des quantités de plus en plus fortes. Les capitalistes chrétiens auraient bien voulu leur en fournir; mais ils [I-329] étaient intimidés par la menace de la damnation éternelle que l’Église fulminait contre les usuriers. La prohibition canonique de l’intérêt fut alors soumise à un nouvel examen et vigoureusement battue en brêche par les intérêts de plus en plus nombreux qu’elle lésait. Deux camps se formèrent dans l’Église et dans la magistrature: les esprits routiniers et infatués du principe d’autorité soutinrent la vieille doctrine; les esprits avancés, les partisans du libre examen adoptèrent la nouvelle. Les promoteurs de la réformation se prononcèrent, pour la plupart, en faveur de la légitimité de l’intérêt, et ce fait, comme le remarque avec raison M.Léon Faucher, donne en partie l’explication de la supériorité industrielle et commerciale des nations protestantes [32] .
Ainsi Calvin déclarait:
1° Que, s’il y a de l’usure et une espèce de cruauté d’exiger des intérêts lorsqu’on prête aux pauvres, il n’y en a pas lorsqu’on prête aux riches; 2° que l’usure n’est mauvaise et condamnable entre les riches que quand on tire du prêt des intérêts excessifs.
Des théologiens catholiques, parmi lesquels nous citerons Major, Navarro, Launoy, des jurisconsultes, tels que Charles Dumoulin et Grotius, soutinrent hardiment la légitimité du prêt à intérêt; mais leur opinion fut condamnée par la plupart des assemblées générales du clergé. Bossuet écrivit pour la réfuter un Traité de l’usure. Cependant la réaction en faveur de l’intérêt ne s’en poursuivit pas moins. Au xviiie siècle, Turgot et les économistes démontrèrent avec une clarté irrésistible la [I-330] légitimité du prêt à intérêt. Jérémie Bentham leur vint en aide dans son admirable Défense de l’usure. L’Église catholique sentit alors la nécessité de mettre sa doctrine un peu plus en harmonie avec les exigences du temps. Elle continua de prohiber d’une manière générale le prêt à intérêt, en invoquant le précepte de l’Évangile: “Mutuum date, nihil inde sperantes, “prêtez sans rien espérer;” mais elle admit deux circonstances dans lesquelles le prêteur pouvait recevoir, à titre de dédommagement, une indemnité de l’emprunteur: ces deux circonstances étaient celles du dommage naissant et du lucre cessant. Par dommage naissant, on entendait le préjudice que le prêteur pouvait éprouver en se dessaisissant de son capital. Ainsi, par exemple, disait-on: “Celui qui, ayant de l’argent pour faire les réparations nécessaires dans sa maison, est assez obligeant pour le prêter à une personne qui le lui demande, ne peut faire de réparations à sa maison et ne peut la louer à cause qu’elle menace ruine: il est juste qu’il reçoive quelque chose au dessus du principal, pour le dédommager de la perte qu’il fait, faute de louer sa maison [33] “Voilà ce que l’Église, suivant en cela la définition des jurisconsultes, entendait par dommage naissant. Le lucre cessant consistait dans la privation d’un gain. Si, par exemple, disaient les casuistes, un négociant prête une somme d’argent dont il aurait retiré un bénéfice assuré en l’employant dans son commerce, il peut légitimement réclamer, à titre de lucre cessant, un dédommagement pour le gain qu’il a manqué de réaliser. Toutefois, [I-331] l’Église mettait au dédommagement pour cause de lucre cessant des conditions assez rigoureuses: “Ce n’est pas assez que le lucre cessant soit possible, disaient les théologiens orthodoxes, ce n’est pas assez, parce qu’il n’y aurait plus d’usure de prêter à intérêt. Tout le monde pourrait alléguer qu’il pouvait faire profiter l’argent qu’il a prêté, et ce serait s’abuser; ainsi il est absolument nécessaire que le lucre cessant soit prochain, probable, et comme dit le droit, moralement certain et assuré. Tel est le lucre cessant des marchands qui, ayant résolu de mettre leur argent dans le commerce, se privent d’un gain prochain, probable et moralement certain, quand ils prêtent à un ami qui les en sollicite [34] ”
Malgré ces restrictions, l’Église, en admettant les circonstances du dommage naissant et du lucre cessant, allait droit à la réhabilitation du prêt à intérêt. Aussi, à l’époque où le bénéfice de ces deux circonstances fut accordé aux prêteurs, c’est à dire, en France, vers la fin du xviie siècle, vit-on une partie du clergé protester contre une innovation si pernicieuse. C’étaient les docteurs de Sorbonne qui avaient admis le dommage naissant et le lucre cessant [35] Les docteurs de province, qui demeuraient plus en dehors du mouvement du siècle, repoussèrent avec indignation une doctrine qu’ils n’hésitèrent pas à qualifier d’infidèle à la tradition de l’Église. Le lucre cessant fut surtout en butte à leurs attaques. Ils prétendirent qu’en légitimant cette circonstance, les docteurs de Sorbonne avaient suivis les errements des casuistes relâchés: “Ni Moïse, [I-332] écrivaient-ils dans un mémoire, ni David, ni Ézéchiel, ni les autres prophètes, ni même Jésus-Christ dans l’Écriture, ni les saints Pères, ni le droit canon ou civil n’ont jamais parlé du lucre cessant: il faut donc le rejeter.” En même temps, ils invoquaient l’autorité de plusieurs grands docteurs, tels que saint Thomas, saint Raymond, saint Antonin, qui s’étaient prononcés d’une manière formelle contre le lucre cessant. Les docteurs de Sorbonne ne manquèrent pas de répliquer; ils s’efforcèrent de démontrer que rien dans les Écritures ni dans les Pères de l’Église ne s’opposait à l’adoption du lucre cessant; qu’il était inexact de prétendre que saint Thomas l’eῦt condamné, et, de plus, que ce grand docteur avait admis le dommage naissant [36] Mieux en harmonie avec les besoins du siècle, la doctrine soutenue par les docteurs de Sorbonne a prévalu dans l’Église. Cette doctrine ne légitime toutefois l’intérêt qu’en partie, et elle laisse une ample carrière ouverte au péché d’usure. Sous les titres de dommage naissant et de lucre cessant, l’Église admet une compensation pour la privation du capital; en revanche, elle se refuse à considérer comme légitime la prime destinée à couvrir le risque du prêt. Ceci est d’autant plus bizarre que l’Église ne fait aucune difficulté à reconnaître la légitimité des bénéfices, souvent énormes, que l’on réalise en prêtant à la grosse aventure, c’est à dire en fournissant une partie de la cargaison d’un navire, en vue de participer aux chances de l’entreprise.
Au moment où nous sommes, la question n’est pas encore résolue canoniquement. Il y a encore au sein de l’Église catholique [I-333] des adversaires du prêt à intérêt. Le 18 aoῦt 1830, la cour de Rome rendit un arrêt portant que les confesseurs ne devaient pas inquiéter les prêteurs, mais laissant la question pendante quant au fond. Cet arrêt souleva un nouvel orage au sein du clergé. On vit se reproduire en France la vieille querelle des docteurs de province et des docteurs de Sorbonne. Plusieurs membres du clergé, parmi lesquels nous citerons l’abbé Laborde, vicaire de la métropole d’Auch, et l’abbé Denavit, professeur de théologie à Lyon, protestèrent contre l’arrêt de la Pénitencerie romaine. “Je refuse l’absolution, écrivait notamment l’abbé Denavit, à ceux qui prennent des intérêts, et aux prêtres qui prétendent que la loi civile est un titre suffisant.” La majorité du clergé finit toutefois par accepter cet arrêt, et l’Église se borne aujourd’hui généralement à condamner comme usuriers les prêteurs qui exigent un intérêt supérieur au taux légal.
Malheureusement, il faut le dire, les erreurs des légistes en cette matière continuent à venir en aide à celles des théologiens. La plupart des pays civilisés ont conservé leurs vieilles lois limitatives du taux de l’intérêt. En France, ces lois, après avoir été abolies pendant la révolution, furent rétablies en 1807. Le taux de l’intérêt fut limité à 5 p. c. en matière civile, et à 6 p. c. en matière commerciale. Et, chose fâcheuse! cette législation surannée a encore été renforcée en 1850 par l’assemblée législative. Cependant, la limitation légale du taux de l’intérét devient de moins en moins justifiable. Les capitaux se disséminent de plus en plus et les communications deviennent de plus en plus faciles. On ne saurait plus citer un seul endroit où quelques individus exercent le monopole du prêt sans qu’il soit possible de le leur enlever. Or, la limitation légale du taux [I-334] de l’intérêt qui pouvait, dans une certaine mesure, se justifier à des époques où le prêt formait à peu près partout l’objet d’un monopole, cette limitation n’est-elle pas un non sens économique, lorsque rien ne s’oppose plus à l’action de la concurrence? N’est-elle pas un obstacle qui entrave la distribution utile des capitaux dans les diverses parties de l’arène de la production? Ainsi, par exemple, il y a des industries qui ne peuvent emprunter à 5 où 6 p. c., qui doivent payer un intérêt plus élevé, à cause des risques particuliers auxquels les capitaux s’y trouvent exposés. Ces industries n’offrent un intérêt rémunérateur au capitaliste qu’en lui payant 8 ou 10 p. c. et davantage. Que fait la loi en proscrivant ce taux comme usuraire? Elle empêche les capitalistes scrupuleux d’alimenter ces industries; elle les livre aux capitalistes les moins honnêtes, qu’elle oblige à prélever une prime destinée à couvrir les risques supplémentaires qu’elle leur fait courir. Elle empêche encore le capital de se distribuer partout, selon le besoin qu’on en a. Si elle n’existait point, l’élévation extraordinaire, anormale, du taux de l’intérêt dans certaines localités, causée soit par le manque de capitaux, soit par leur concentration excessive, attirerait bientôt dans ces localités les capitaux du dehors. Les premiers arrivés se prêteraient à un taux élevé, mais l’élévation, l’exagération même de ce taux en attirerait de nouveaux, jusqu’à ce que les bénéfices du monopole eussent disparu, jusqu’à ce que le niveau se fῦt rétabli entre la rémunération des capitaux dans cette localité et dans les autres. La limitation légale du taux de l’intérêt contribue à perpétuer les monopoles, elle les protége au lieu de les détruire. Effet ordinaire des lois qui survivent aux circonstances qui les ont provoquées!
[I-335]
Résumons-nous. Comme le service productif du personnel de la production, le service productif du matériel ou de cette portion du matériel qui a été comprise sous les dénominations de capital fixe et de capital circulant, a un prix naturel et un prix courant.
Le prix naturel du service des capitaux se compose d’abord de la somme nécessaire pour les entretenir et les renouveler, de manière à maintenir intact le matériel de la production. Cette somme comprend, comme nous l’avons vu, outre la portion de produit nécessaire pour rétablir le capital au bout de chaque opération, une prime destinée à compenser la privation de ce capital et une autre prime destinée à couvrir les risques afférents à son emploi. A ces frais de production, il faut ajouter une part proportionnelle de produit net, qui permette d’accroître le matériel de la production, comme la part proportionnelle de produit net afférente au travail permet d’en augmenter le personnel. Tels sont les éléments du prix naturel du service productif des capitaux.
Le prix courant de ce service, le prix auquel il se paye sur le marché tend incessamment à se confondre avec le prix naturel. En effet, quand il demeure au dessous, une portion du capital se détruit ou se dégage de la production, ou bien encore cesse de s’y engager, l’offre du capital diminue relativement à la demande, et le prix se relève. Quand le prix courant s’élève au dessus du prix naturel, une prime extraordinaire est aussitôt offerte soit à la formation des capitaux, soit à leur apport dans les branches de la production où cette rémunération extraordinaire est perçue, l’offre s’augmente et le prix s’abaisse.
Telle est la loi qui régle la rémunération du capital comme celle du travail.
[I-336]
Comme la rémunération du travail encore, celle du capital se perçoit sous différentes formes, lesquelles peuvent cependant être ramenées à deux formes générales: la part éventuelle et la part fixe ou assurée. La part éventuelle porte tantôt le nom de profit, tantôt le nom de dividende; la part assurée, le nom de loyer quand il s’agit de capitaux fixes, le nom d’intérêt quand il s’agit de capitaux circulants. Nous avons vu qu’il y a toujours équivalence, sauf l’action des causes perturbatrices, entre les rémunérations perçues sous ces différentes formes; que le profit et le dividende doivent nécessairement se mettre en équilibre avec le loyer et l’intérêt; que le taux du loyer ne peut de même excéder, d’une manière régulière et permanente, le taux de l’intérêt ni demeurer en dessous, en un mot que la loi qui détermine le taux de la rémunération du capital agit indépendamment de la forme sous laquelle cette rémunération est perçue.
Nous avons vu enfin combien il serait absurde et impossible de vouloir toucher à la rémunération du capital, soit qu’il s’agisse de ses frais de production ou de sa part proportionnelle de produit net; que néanmoins cette rémunération a été de tous temps attaquée, principalement lorsqu’elle a été perçue sous forme d’intérêt; nous avons recherché d’où provenait le préjugé contre le prêt à intérêt, et nous avons vu qu’il avait sa source dans les circonstances au sein desquelles se concluait habituellement le prêt; nous avons vu que le prix naturel de l’intérêt était très élevé autrefois, et que le monopole contribuait, en outre, à rendre le prix courant supérieur au prix naturel. De là les anathèmes fulminés contre l’usure, c’est à dire contre le prix de monopole de l’intérêt, de là encore les lois limitatives du taux de l’intérêt. Nous avons essayé de démontrer que [I-337] ces lois, qui avaient pu avoir une certaine utilité à l’époque où le monopole du prêt était un produit des circonstances sociales, ont complétement perdu leur raison d’être à l’époque actuelle; qu’elles sont devenues nuisibles au lieu d’être utiles.
Ajoutons quelques mots sur les effets de la guerre que le socialisme moderne a déclarée à la rémunération du capital. Que voulaient, en 1848, les adversaires de la “tyrannie du capital?” Ils voulaient surtout abaisser le taux de l’intérêt et augmenter le taux des salaires. Quels ont été les résultats de l’agitation révolutionnaire dont ils ont été les promoteurs? Ç’a été d’élever le taux de l’intérêt et d’abaisser le taux des salaires. Ces résultats que le socialisme ne prévoyait guère étaient cependant inévitables. Que faisaient les socialistes? Ils menaçaient le capital. Or, menacer le capital, n’est-ce pas augmenter ses risques, et tout supplément de risques ne doit-il pas être couvert par un supplément de rémunération? On aurait, certes, étonné beaucoup les socialistes, si on leur avait dit que chacune de leurs philippiques contre le capital contribuait à augmenter la part de ce “tyran,” et pourtant c’eῦt été l’exacte vérité. Puisse au moins cet exemple servir de leçon aux agitateurs à venir! Puissent les hommes qui ont à cœur d’améliorer la situation des classes laborieuses, s’abstenir désormais de toucher à l’organisation sociale avant de l’avoir suffisamment étudiée!
[I-338]
TREIZIÈME LEÇON↩
la part de la terre
Comment se règle la part des agents naturels appropriés ou de la terre. — Analyse des opérations nécessaires pour approprier la terre à la production. — La découverte, — l’occupation, — le défrichement. — Que ces opérations ne procurent pas des profits supérieurs à ceux des autres industries. — Du prix naturel du service productif du sol. — Éléments qui le composent. — Les frais nécessaires d’entretien des fonds de terre, — la privation, — le risque. — La chance heureuse ou l’avantage futur provenant de la plus value que les progrès de la population et de la richesse attribuent au sol. — Comment se distribue cette plus value, selon la situation et la qualité des terres. — Comme elle se déplace. — Autres avantages particuliers qui s’attachent à la propriété territoriale. — Causes de l’infériorité relative du taux du revenu foncier. — De la part proportionnelle de produit net afférente au sol. — Résumé des éléments du prix naturel du service productif des agents naturels appropriés ou de la terre.
Outre les capitaux fixes et circulants, le matériel de la production comprend les agents naturels appropriés ou, pour nous servir du terme générique, “la terre.” Les agents naturels appropriés ont des caractères qui leur sont propres et qui exercent [I-339] une certaine influence sur les conditions auxquelles ils concourent à la production, mais leur part est réglée, en définitive, par la même loi qui détermine celle des autres agents productifs.
Comme le service productif des facultés humaines et des capitaux fixes et circulants, celui des agents naturels appropriés ou de la terre a son prix naturel ou nécessaire et son prix courant.
Nous nous occuperons, en premier lieu, du prix naturel, ainsi que nous l’avons fait pour les autres agents productifs; mais avant d’examiner quels sont les éléments du prix du service ou de l’usage du sol, il faut que nous recherchions de quoi se compose la valeur du sol même. Il faut, en conséquence, que nous considérions la terre comme un produit avant de la considérer comme un agent productif.
Comme tous les autres produits, comme les bâtiments, les outils, les machines, les substances alimentaires, etc., la terre a son prix naturel et son prix courant. Son prix naturel se compose de ses frais de production augmentés d’un profit ou d’un produit net.
Quels sont les frais de production de la terre? Voilà donc ce qu’il s’agit de rechercher d’abord.
Dans son célèbre mémoire sur la propriété, M. Proudhon a lancé aux propriétaires fonciers cette apostrophe véhémente:
“A qui est dῦ le fermage de la terre? Au producteur de la terre, sans doute. Qui a fait la terre? Dieu. En ce cas, propriétaire, retiretoi.”
En énonçant cette proposition, M. Proudhon s’est borné, comme chacun sait, à mettre sous une forme saisissante, le [I-340] grand argument que les partisans de la communauté des biens ont, de tous temps, opposé à la propriété foncière. D’après ces rêveurs, le propriétaire foncier serait un privilégié qui s’attribuerait la meilleure part des dons du créateur au détriment du reste du genre humain. Tout propriétaire foncier serait un voleur qui ravirait, pour les attribuer à son usage exclusif, des biens que Dieu a créés pour tous [37]
Le fondement de cette erreur si répandue réside dans une autre erreur non moins générale, savoir que l’appropriation des terres à la production s’opère sans difficulté aucune, et que le propriétaire foncier recueille, en conséquence, un revenu qui ne lui a coῦté aucune peine. Or, rien n’est plus faux que cette opinion vulgaire. Les fonds de terre n’ont pas plus été donnés gratis à ceux qui les possèdent que les bâtiments, les charrues, les bêtes de somme et les autres parties du matériel [I-341] de la production. Chaque parcelle de terre employée à la production peut être considérée comme une machine dont les éléments ont été fournis par la nature comme ceux de toutes les machines et de l’homme lui-même, mais dont la formation et l’appropriation au service de la production appartiennent à l’industrie humaine.
La formation de l’instrument-terre est l’objet d’une série d’industries, comme la construction des bâtiments, des machines et des autres agents qui concourent à la production. Seulement nous ne pouvons plus guère observer ces industries en Europe, au moins dans leur ensemble, car celles qui donnent à la terre ses premières façons ont cessé d’exister depuis longtemps. C’est dans le Nouveau Monde qu’il nous faut aller les étudier. Nous pourrons observer là que la production de l’instrument-terre, en d’autres termes, l’appropriation de la terre, [I-342] se compose de trois opérations bien distinctes et qui font l’objet d’autant d’industries différentes, savoir: 1° la découverte, 2° l’occupation, 3° le défrichement.
A la vérité, l’Amérique était déjà en partie découverte, occupée et défrichée, lorsque les Européens la découvrirent; mais ceux-ci n’ayant point respecté les titres de propriété des anciens habitants, qu’ils chassèrent et détruisirent comme des bêtes fauves, on peut considérer la seconde occupation de cette terre nouvelle comme une occupation primitive.
La découverte est la première opération que nécessite la production de l’instrument-terre. Au XVe et au XVIe siècles, cette opération fait l’objet d’une industrie spéciale. On voit alors des milliers d’aventuriers, suivant les traces de Christophe Colomb, équiper des navires pour aller découvrir de nouvelles terres. Un certain nombre de ces aventuriers réussissent dans leurs entreprises, mais combien périssent misérablement! Aucune industrie n’était alors plus chanceuse, et si l’on avait pu comparer ses profits à ceux des autres branches de la production on n’aurait eu aucune peine à se convaincre qu’ils ne les dépassaient point.
Les aventuriers qui avaient signalé de nouvelles terres tiraient ordinairement parti de leur découverte, en la cédant à la nation dont ils étaient membres. On leur accordait, en échange, des honneurs, des dignités, des gratifications et des pensions. Quelquefois aussi, ces découvreurs étaient de simples agents salariés du gouvernement, lequel recueillait alors les profits de ce genre d’entreprises comme il en supportait les pertes.
Les nouveaux territoires du continent américain se trouvèrent donc grevés, en premier lieu, des frais de découverte. Ils furent grevés, en second lieu, des frais d’occupation.
[I-343]
La découverte peut être considérée comme la première façon que l’homme est obligé de donner à la terre pour l’approprier à son usage. L’occupation est la seconde.
Il ne suffit pas, en effet, de découvrir un nouveau territoire et d’en reconnaître la configuration, il faut y établir des moyens de défense, soit contre les animaux et les éléments, soit contre les hommes; il faut y percer des voies de communication, y construire des forteresses, etc. Ces divers travaux, qui constituent une seconde façon nécessaire à l’instrument-terre, furent accomplis en Amérique par les gouvernements d’Europe. Comme ceux de la découverte, les travaux de l’occupation devinrent l’objet d’une industrie spéciale. Si cette industrie avait été abandonnée à de simples particuliers, si les gouvernement ne s’en étaient point mêlés, ses profits n’auraient pu évidemment dépasser ceux des autres branches de la production ni demeurer en dessous. Mais, à cette époque, la possession des territoires du Nouveau Monde était regardée comme une source inépuisable de richesses, en sorte que les gouvernements de l’Europe s’empressèrent de mettre la main sur ceux que leurs sujets avaient découverts. Ainsi que toute propriété, celle-ci donna lieu à de nombreux procès, et comme les gouvernements ne reconnaissaient point de tribunal souverain pour juger leurs différends, chacun de ces procès engendra une guerre plus ou moins longue et coῦteuse. L’occupation des terres du Nouveau Monde devint en conséquence la moins profitable des industries. Bien peu de gouvernements retirèrent de leurs établissements en Amérique, une rémunération suffisante pour couvrir les frais de découverte qu’ils avaient remboursés et les frais d’occupation qu’ils avaient supportés, avec un profit en harmonie avec ceux des autres industries.
[I-344]
Cette deuxième façon étant donnée à la terre, il fallait encore la défricher pour l’approprier à la production. Le défrichement devint l’objet d’une troisième industrie, distincte des deux premières.
Les gouvernements qui occupaient les territoires du Nouveau Monde ne possédaient pas, en effet, les ressources nécessaires pour les défricher et les exploiter eux-mêmes. Cependant ils voulaient en tirer parti. Qu’en firent-ils? Ils les cédèrent, sous des conditions diverses, à des hommes disposés à les défricher et à les exploiter. Après avoir occupé un territoire en bloc, ils le vendirent ou le concédèrent en détail.
En quoi consiste l’industrie des défricheurs? Ces pionniers de la civilisation pénètrent dans les solitudes du Nouveau Monde, où ils choisissent un lot de terre. Les uns choisissent bien, les autres choisissent mal; c’est leur affaire. Ce lot, sur lequel ils ont jeté leur dévolu, ils l’achètent aux prochaines enchères, en remboursant ainsi les frais de découverte et d’occupation de la terre. Ils se mettent ensuite à l’œuvre. La terre vierge est couverte d’arbres et encombrée des détritus de la végétation primitive; souvent aussi elle est envahie par les eaux et exposée aux agressions des animaux sauvages. Le défricheur déblaye le sol, le dessèche et l’enclôt. Il y construit, en outre, les bâtiments les plus nécessaires à l’exploitation. C’est ainsi que la terre reçoit la troisième et dernière façon indispensable pour la mettre au service de la production.
Après que la terre a reçu cette troisième façon, elle peut être considérée comme un produit achevé. C’est un bâtiment dont on a couronné le faite; c’est une machine que l’on a fini d’ajuster et à laquelle on a donné le dernier coup de lime ou de marteau. On peut maintenant l’employer à la production.
[I-345]
Cet instrument, auquel le défricheur a donné la dernière façon, il l’emploie rarement lui-même. Voici pourquoi. C’est que le défricheur possède les aptitudes, les connaissances et les instruments nécessaires pour défricher une terre vierge, mais qu’il ne possède pas ceux qui sont requis pour l’exploitation régulière du sol; c’est qu’il ne possède, communément du moins, ni les instruments aratoires, ni les semences, ni les avances de subsistance dont il aurait besoin pour cultiver la terre qu’il a défrichée. Quand donc il a achevé son œuvre, quand il a défriché son lot de terre, il le vend; après quoi, il va en défricher un autre, et ainsi de suite.
Le prix auquel le défricheur vend son produit-terre doit naturellement rembourser les frais de la découverte, de l’occupation et du défrichement, avec adjonction des profits ordinaires. C’est le prix naturel de la terre, autour duquel le prix courant gravite, en vertu de la même loi qui gouverne le prix de tous les autres produits.
Maintenant, l’homme qui entre en possession de cet instrument nouveau, après en avoir payé le prix courant, le propriétaire de cette machine à fabriquer du blé, de la viande, du lin, du chanvre, du coton, ou bien encore de l’or, de l’argent, du fer, du plomb, de la houille, cet homme est-il donc un privilégié? Mérite-t-il bien l’apostrophe véhémente que lui adresse M. Proudhon:
“A qui est dῦ le fermage de la terre? Au producteur de la terre, sans doute. Qui a fait la terre? Dieu. En ce cas, propriétaire, retire-toi.”
Non, à coup sῦr. Outre le travail de Dieu, qui est toujours gratuit, soit qu’il s’agisse des agents naturels appropriés, soit qu’il s’agisse des capitaux fixes et circulants, des bâtiments, des [I-346] machines, des outils, des approvisionnements, soit qu’il s’agisse enfin de l’homme lui-même, dont Dieu a été également le premier ouvrier, la production de l’instrument-terre a exigé l’intervention de l’industrie humaine. Or, cette intervention n’a pas été gratuite, et le propriétaire foncier n’a acquis la terre qu’à la charge d’en faire ou d’en rembourser les frais. La valeur de sa terre représente des frais de production et des profits, absolument comme celle des bâtiments, des machines, des outils, etc. Pourquoi donc le propriétaire foncier qui a créé cette valeur ou qui l’a remboursée à ceux qui l’ont créée, se retirerait-il pour faire place à Dieu [38] ?
La terre doit donc être considérée d’abord comme un simple [I-347] produit que l’industrie humaine façonne, et dont la création et la mise au marché ne peuvent conférer aucun bénéfice exceptionnel.
Que si l’on objecte que j’ai envisagé l’industrie de l’appropriation des terres seulement dans le Nouveau Monde, où les difficultés de l’appropriation ont été considérables pour les Européens, où, d’un autre côté, les hommes disposés à surmonter ces difficultés ou à en rembourser les frais sont peu nombreux, je répondrai que la situation était absolument la même dans l’ancien monde, aux époques où les terres y ont été appropriées à la production. La seule différence qu’on puisse signaler, — et cette différence ne touche pas au fond des choses, — c’est que l’industrie de l’appropriation des terres était alors moins divisée dans l’ancien monde qu’elle ne l’a été depuis dans le nouveau; c’est que les mêmes hommes qui découvraient de nouvelles terres se chargeaient aussi de les occuper et de les exploiter. A ces époques, qui se perdent maintenant dans la nuit des temps, l’agriculture n’était pas encore inventée. L’homme vivait de la cueillette des fruits, de la chasse ou de la pêche. Mais pour exercer l’une ou l’autre de ces industries, il avait besoin du concours de l’instrument-terre ou de l’instrument-mer, lac, étang, rivière. Pour se procurer des fruits, des racines, du gibier ou du poisson, il fallait découvrir, occuper et exploiter des terres ou des eaux qui en continssent. Ces opérations diverses étaient accomplies ordinairement par le même individu ou par la même troupe; mais en admettant qu’elles eussent été séparées, auraient-elles pu donner des profits inégaux? Si le travail de découverte et d’occupation des pêcheries et des terrains de chasse avait rapporté plus que la pêche et la chasse même, les anciennes pêcheries et les anciens terrains de chasse [I-348] n’auraient-ils pas été continuellement abandonnés pour les nouveaux? Tout autre travail n’aurait-il pas été délaissé pour celui de la découverte et de l’occupation des terres et des eaux? Combien de siècles se sont écoulés cependant avant que la surface de l’ancien monde ait été découverte et occupée! Combien d’industries diverses se sont élevées et ont fleuri dans l’intervalle! Or, l’existence de ces industries, en concurrence avec l’appropriation des terres, n’est-elle pas une preuve manifeste que celle-ci n’était pourvue d’aucun privilége naturel, qu’elle ne rapportait pas plus, à l’origine, que les autres branches de la production?
Ainsi donc, on peut affirmer que la propriété foncière n’a pas plus été investie d’un privilége dans l’ancien monde que dans le nouveau, aux époques où elle a été formée.
Mais, objectent les adversaires de la propriété foncière, c’est à la longue que la possession de la terre acquiert les caractères d’un monopole, en conférant des bénéfices ou des avantages supérieurs à ceux qui résultent de la possession des autres agents productifs. Il se peut qu’à l’époque où l’ancien monde commençait à être découvert, occupé et défriché, l’appropriation des terres ne présentât pas plus d’avantages que les autres branches de la production; il se peut encore qu’en Amérique les pionniers qui donnent la dernière façon à l’instrumentterre, et les cultivateurs qui leur achètent cet instrument pour l’employer à la production des denrées alimentaires, ne réalisent pas de plus gros bénéfices que les manufacturiers, les négociants ou les hommes qui exercent des professions libérales; mais franchissons un certain laps de temps, et quel spectacle s’offrira à nos regards? Nous verrons des terres qui, après avoir été vendues à vil prix à l’époque où on les a mises [I-349] au service de la production, ont acquis une valeur énorme par le fait du développement de la population et des progrès de la richesse; nous verrons leurs propriétaires, fruges consumere nati, percevoir, sans se donner aucune peine, la meilleure part des résultats de la production, et ne laisser aux détenteurs des autres agents productifs que la portion congrue. Un tel privilége n’est-il pas exorbitant? Puisque la valeur de la propriété foncière s’accroît par suite du développement de la population et des progrès de la richesse générale, ne serait-il pas juste d’en restituer la plus value à ceux qui l’ont créée? Ne serait-il pas juste de faire rentrer, à la longue, la propriété foneière dans le domaine public?
Une simple observation suffira, je pense, pour faire tomber cette objection, si formidable en apparence. Que dit-on? Qu’il est dans la nature de la propriété foncière de procurer à ceux qui la créent des avantages futurs d’une importance considérable. Que telle terre, dont le prix de vente suffit à peine aujourd’hui pour couvrir ses frais de production augmentés des profits ordinaires, aura, dans dix ans, dans vingt ans, dans un siècle, dans dix siècles, une valeur dix fois, vingt fois, cent fois, mille fois plus forte. Cela est possible. Il est possible que les terres qui sont actuellement défrichées en Californie, par exemple, acquièrent dans l’avenir une valeur décuple ou centuple de leur valeur présente; mais cette chance heureuse, que courent les hommes qui approprient des terres à la production, constitue-t-elle bien un privilége? N’est-elle pas successivement escomptée? L’espérance d’un avantage futur n’entre-t-elle pas toujours, soit qu’il s’agisse de l’appropriation des terres ou de toute autre industrie, en déduction du bénéfice actuel? Où donc est le privilége?
[I-350]
Ceci deviendra plus clair encore si, après avoir considéré l’appropriation des terres comme une industrie et la terre comme un produit, nous examinons les conditions auxquelles le produit-terre transformé en agent productif concourt à la production. Nous verrons alors se dissiper les derniers nuages qui planent sur la propriété foncière et sur le revenu dont elle est la source.
Voici qu’une terre est produite, c’ést à dire découverte, occupée et défrichée. Qu’en va-t-on faire? Celui qui la possède peut en jouir ou l’exploiter pour son propre compte, soit isolément, soit par association, il peut encore l’affermer ou la vendre. S’il l’exploite pour son propre compte, il en retirera un profit foncier; s’il l’afferme, il en retirera un fermage ou une rente; s’il la vend, il en retirera simplement un prix de vente. Il s’agit de savoir quels sont les éléments de la part de la terre, lorsqu’elle est perçue sous l’une ou l’autre de ces trois formes? En d’autres termes, quel est le prix naturel ou nécessaire de l’usage ou du service de la terre lorsqu’elle est appliquée à la production?
Le prix naturel de vente de la terre se compose des frais de production de ce genre de produit, augmentés des profits des industries qui ont concouru à l’appropriation du sol.
Le prix naturel d’exploitation ou de location de la terre se compose des frais nécessaires pour engager les détenteurs de cet agent productif à le mettre au service de la production et à l’y maintenir; ’c’est à dire, comme dans le cas du travail et des capitaux fixes et circulants, d’une certaine somme de frais de production et d’une part proportionnelle de produit net.
Avant d’analyser ces éléments du prix naturel du service ou [I-351] de l’usage de l’instrument-terre, ou pour employer une expression plus usitée, du capital foncier, faisons deux remarques essentielles.
La première, c’est que la forme sous laquelle est perçue la rémunération du capital foncier n’influe en rien sur le fond même de cette rémunération; c’est que le taux du fermage, par exemple, doit nécessairement se proportionner au taux du profit foncier et au prix de vente, sinon celui de ces modes d’emploi de la terre qui présenterait plus ou moins d’avantage que les autres, serait aussitôt recherché ou abandonné, et l’équilibre ne manquerait pas de se rétablir. Ajoutons que le profit foncier est une part éventuelle, tandis que le fermage est une part fixe et plus ou moins assurée. L’un correspond au profit du travail ou du capital; l’autre au salaire, à l’intérêt ou au loyer.
La seconde remarque à faire, c’est que le profit foncier et le fermage contiennent, le premier toujours, le second communément, une part pour les capitaux fixes et circulants qui sont joints à la terre dans l’œuvre de la production; dans certains cas même, lorsque la terre est cultivée par des esclaves ou des serfs, le profit foncier et le fermage contiennent une part afférente au travail. On s’est, en conséquence, accordé pour désigner sous le nom de rente la part qui est simplement afférente à la terre; mais cette expression peut malheureusement do nner lieu à des confusions; nous verrons pourquoi, dans la leçon prochaine.
En attendant, recherchons quels sont les éléments du prix naturel ou nécessaire du service productif de la terre.
En premier lieu, apparaissent les frais d’entretien et de renouvellement des facultés productives du sol, s’il s’agit d’un [I-352] terrain appliqué à la production agricole, et les frais d’amortissement ou de recomposition de ces mêmes facultés productives, s’il s’agit d’une mine. Si ces frais ne sont pas couverts, comme la fécondité d’un terrain ou d’une mine n’est pas inépuisable, la production ne pourra évidemment s’opérer d’une manière continue.
En second lieu, apparaît la privation. Lorsqu’un homme qui a défriché une terre ou acheté une terre défrichée, la consacre à la production, c’est un capital dont il demeure privé jusqu’à ce qu’il puisse le dégager. La privation provenant de ce chef est considérable dans les pays où la vente des terres est difficile, où, d’un autre côté, les emprunts hypothéqués sur la terre sont environnés de formalités coῦteuses. Dans ces pays, le taux de la prime nécessaire pour compenser la privation du capital foncier est élevé; il est bas, au contraire, dans les pays où la vente des terres et les emprunts hypothéqués sur le sol s’opèrent aisément et à peu de frais.
En troisi[ww]me lieu apparaît le risque. Lorsqu’un homme consacre une terre à la production en l’exploitant lui-même ou en la louant à quelqu’un qui l’exploite, il court le risque soit de n’en point tirer de revenu ou de n’en tirer qu’un revenu inférieur à celui sur lequel il avait compté, si les circonstances sont mauvaises, soit même d’en perdre successivement la valeur. En revanche, il court la chance de voir s’accroître, parfois même d’une manière démesurée, et la valeur de son capital foncier et le revenu qu’il en tire (ces deux choses sont, bien entendu, inséparables). Ce risque et cette chance donnent naissance à des primes, dont l’une s’ajoute au prix naturel du service productif de la terre, et dont l’autre s’en déduit.
Dans le cours ordinaire des choses, et par le fait de la nature [I-353] particulière de l’instrument-terre, la chance de voir s’accroitre la valeur du capital foncier engagé dans la production dépasse le risque de la voir diminuer ou se perdre. Qu’en résulte-t-il? C’est, comme nous l’avons remarqué plus haut, que cette chance heureuse ou cet avantage futur attaché à la possession du sol s’escompte; c’est que le prix naturel du service productif de l’instrument-terre demeure communément au dessous de celui du service des autres agents qui composent le matériel de la production.
Je dis que, dans le cours ordinaire des choses, l’instrumentterre, bien loin de perdre de sa valeur par l’usage, acquiert annuellement une plus value. En cela, il diffère de la plupart des autres instruments qui composent le matériel de la production. Mettez, en effet, des bâtiments, des machines, des outils au service d’une industrie quelconque, et vous les verrez perdre successivement de leur valeur, d’abord parce que l’usage les détériorera plus ou moins, ensuite parce qu’on en construira d’autres plus parfaits que l’on substituera graduellement aux anciens. De là, une moins value qui doit être couverte ou compensée par un supplément de rémunération, sinon on renoncerait à mettre les agents qu’elle atteint, au service de la production.
En vertu de sa nature particulière, l’instrument-terre se trouve communément dans une situation différente. D’abord, il est essentiellement durable. Il faut renouveler, au bout d’une période plus ou moins longue, les bâtiments et les machines; il n’est jamais nécessaire de renouveler la terre. Sans doute, lorsqu’une terre est employée à l’agriculture, il faut entretenir ses forces productives; mais celles-ci s’accroissent à la longue au lieu de se perdre, quand elles sont convenablement alimentées. [I-354] Seuls les gisements minéraux s’épuisent, et ils doivent, en conséquence, être amortis. Ensuite, l’instrument-terre joint l’immobilité, la non-transportabilité à la durée, et c’est là une nouvelle particularité dont il importe d’apprécier l’influence.
Quand la population et la richesse s’accroissent dans un pays, on voit s’élever graduellement la valeur de la terre. D’où cela vient-il? Cela vient de ce que la demande de la terre et de ses produits s’augmente, tandis que l’offre ne peut pas toujours s’augmenter dans la même proportion. Prenons pour exemple une ville qui est en train de se développer. Les terrains qui forment sa surface et ceux qui environnent son enceinte augmenteront progressivement de valeur. Pourquoi? parce qu’ils seront plus demandés, les uns pour servir d’emplacement aux habitations, les autres pour fournir des substances alimentaires à une population croissante, sans que, en vertu de la nature même des choses, l’offre puisse se proportionner à la demande. Seulement cette plus value ne sera pas uniforme. Elle sera plus ou moins élevée selon la situation et la qualité des terres.
Selon la situation des terres. Le développement de la population et de la richesse dans une ville ne s’opère jamais d’une manière uniforme. Le mouvement de la circulation se porte de préférence dans certains quartiers et dans certaines rues. La valeur des terrains qui forment la surface de ces quartiers ou de ces rues s’accroît en conséquence beaucoup plus que celle des terrains des autres parties de la cité. A Paris, par exemple, la circulation s’est principalement développée dans les rues Saint-Denis, Saint-Honoré, Vivienne, Richelieu, sur une partie des boulevards, etc.; à Bruxelles, c’est dans la rue de la Madeleine et aux environs. Dans ces localités favorisées, une certaine étendue de terre rapporte cent fois, mille fois plus qu’une [I-355] étendue égale située à quelque distance. Pourquoi? Parce que les propriétaires des localités bien situées jouissent d’un monopole naturel; parce que la terre n’étant point un instrument transportable, on n’en saurait augmenter l’offre dans les endroits où la population et la richesse vont se concentrer. On ne peut transporter dans la rue Richelieu ou sur le boulevard des Italiens, un supplément de terrain à bâtir provenant de la plaine Saint-Denis. On ne peut transporter, dans la rue de la Madeleine à Bruxelles, des terrains situés dans le bois de la Cambre ou dans la forêt de Soignes. La terre ne se déplace point. Il n’en est pas de même, comme on sait, de la part des autres agents productifs. Qu’une machine, une somme d’argent, un tonneau d’huile, une balle de coton, etc., se trouvent dans une localité où l’on n’en ait pas l’emploi, on pourra les transporter ailleurs. Sans doute, les circonstances pourront encore investir les détenteurs de ces agents productifs, d’un monopole naturel ou artificiel, mais ce monopole sera beaucoup moins durable que celui dont jouissent les détenteurs des terrains bien situés, — ceci toujours en vertu de la nature même des choses.
L’observation qui vient d’être faite au sujet des terrains à bâtir s’applique encore au sol arable. Les terres qui se trouvent à proximité des grands foyers de consommation des denrées alimentaires acquièrent toujours une valeur supérieure à celle des autres. Cette différence s’explique par l’économie que l’on réalise sur les frais de transport des produits cultivés dans les endroits les plus rapprochés des centres de consommation. De là, la valeur extraordinaire qu’ont acquise les terres de la banlieue de Paris, et, en général, de toutes les grandes villes.
La plus value s’élève encore plus ou moins selon la qualité des terres. Quand une population croît en nombre et en richesse, [I-356] elle demande certaines denrées dans une proportion de plus en plus forte. Les terres qui sont les plus propres à la production de ces denrées acquièrent naturellement une valeur supérieure à celle des terres qui le sont moins. Quand une terre arable unit à l’avantage de la situation, la supériorité de la qualité, sa plus value peut s’élever au maximum.
Ainsi donc la terre est susceptible d’acquérir une plus value à mesure que la population et la richesse se développent, mais cette-plus value n’a rien d’uniforme. Elle varie selon la situation et la qualité des terres.
Elle n’est pas non plus fixe. Des causes diverses agissent incessamment, soit pour la déplacer, soit même pour la détruire. Citons-en quelques exemples.
Depuis le moyen âge, les progrès de la sécurité ont opéré toute une révolution dans la valeur des terrains servant d’emplacements aux villes. Nous avons vu (Ve leçon) que les populations, après s’être agglomérées sur les hauteurs, sont descendues successivement dans les plaines. Qu’est-il résulté de ce déplacement? Que le monopole naturel dont jouissaient les propriétaires du sol des villes situées sur les hauteurs, a été transféré aux propriétaires fonciers des plaines où les nouvelles villes ont été fondées. Alors la non-transportabilité du sol qui naguère était si avantageuse aux premiers a tourné à leur détriment. La valeur de leur capital foncier, après s’être élevée parfois d’une manière démesurée, est tombée, parfois aussi, presque à rien. Sans doute, les bâtiments et les autres capitaux immobiliers se trouvent exposés à peu près au même risque. On ne peut faire descendre une maison de la montagne dans la plaine. Mais au moins peut-on tirer un certain parti de ses matériaux, tandis qu’un fonds de terre n’est pas susceptible d’être démoli comme [I-357] une maison, et vendu pour la valeur de ses matériaux. Les bruyères et les autres plantes sauvages finissent donc par envahir les emplacements escarpés des anciennes villes et le sol n’y conserve, le plus souvent, d’autre valeur que celle des monceaux de débris encore épars à sa surface.
Les progrès de la sécurité ont principalement contribué à déplacer les monopoles naturels des terrains servant d’emplacements aux habitations; par là même, ils ont agi aussi pour déplacer ceux des terres employées à la production des denrées alimentaires. Mais d’autres causes ont contribué encore, soit à déplacer ceux-ci, soit même à les détruire. Ces causes résident principalement dans les progrès de l’agriculture et de la locomotion, comme aussi dans la destruction des obstacles artificiels qui entravaient la liberté des échanges.
A l’époque où l’homme était encore réduit à subsister de la cueillette des fruits ou de la chasse, les terres les plus abondantes en fruits et en gibier furent les premières à croître en valeur. A mesure que la population s’augmenta, que les fruits et le gibier furent, en conséquence, plus demandés, leur valeur s’accrut, tandis que d’autres terres demeuraient sans valeur parcé qu’elles ne pouvaient être utilisées. Mais les premières méthodes et les premiers instruments agricoles sont inventés. Aussitôt la situation change. La cueillette des fruits et la chasse sont, en grande partie, abandonnées pour l’agriculture. Alors les terres propres à la culture des denrées alimentaires, des plantes textiles et tinctoriales, etc., acquièrent une valeur, tandis que les terres précédemment employées perdent une partie de la leur, à moins toutefois qu’elles ne soient susceptibles de culture. Mais, dans la suite des temps, de nouveaux progrès s’accomplissent: d’une part l’agriculture se développe et se [I-358] transforme, de nouvelles plantes, de nouveaux engrais, de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes d’exploitation sont découverts; d’une autre part, l’industrie des transports se perfectionne sous le double rapport de la célérité et du bon marché. Enfin, la sécurité devenant plus générale, le domaine de la civilisation s’étend de plus en plus, et la surface cultivable s’accroît par là même. Que résulte-t-il de ces progrès?
Les progrès de l’industrie agricole permettent à la fois d’appliquer de nouvelles terres à la production et de tirer un meilleur parti des anciennes. C’est ainsi que les terres lourdes, qui naguère ne pouvaient être cultivées avec avantage, font maintenant concurrence aux terres légères, grâce aux perfectionnements du matériel et des méthodes d’exploitation. C’est ainsi encore que des terres longtemps regardées comme stériles sont devenues cultivables par suite de la découverte de nouveaux engrais. C’est ainsi, enfin, que l’acquisition de nouvelles plantes a permis de tirer un bon parti de terrains qui étaient auparavant délaissés et sans valeur. Grâce à ces divers progrès, la sphère de la concurrence s’agrandit successivement aux dépens du monopole des terres anciennement cultivées, et de la plus value qui s’y était attachée.
Quant aux progrès de la locomotion, ils étendent la sphère de la concurrence et pour les emplacements des habitations et pour la production agricole. Ainsi, par exemple, les industriels, les négociants, les employés étaient obligés autrefois de se loger auprès de leurs bureaux ou de leurs comptoirs. A mesure que la locomotion s’est perfectionnée, ils ont pu aller demeurer plus loin du foyer de leurs affaires. Les anciens terrains d’habitation ont perdu ainsi une partie de leur valeur, laquelle est allée se fixer sur les nouveaux. Le même changement s’opère sous l’influence [I-359] de la même cause dans la valeur des terres employées à la production agricole. Les terres situées aux environs des villes avaient autrefois le monopole de la plupart des denrées alimentaires qui entraient dans la consommation journalière des populations urbaines. La difficulté des communications, jointe à l’insuffisance de la sécurité, à l’obstacle artificiel des péages et des droits de traite, empêchaient les habitants des villes de recevoir les denrées alimentaires produites à distance. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui. Depuis l’établissement des chemins de fer, la production des légumes, des fruits, du lait, etc., n’est plus le monopole des banlieues; elle s’opère dans un rayon qui s’étend chaque jour davantage, et la valeur des terres baisse en conséquence, relativement du moins, aux environs des villes, tandis qu’elle hausse plus loin. Ce que nous disons des villes et de leurs environs peut s’appliquer aussi à des contrées entières. Depuis l’invention de la navigation à la vapeur et l’avénement de la liberté du commerce, l’Angleterre retire du dehors des masses de subsistances qu’elle demandait auparavant à son agriculture et que celle-ci lui fournissait moins abondamment et à plus haut prix. Les terres qui ont profité de ce nouveau débouché ont augmenté de valeur, tandis que celles qui possédaient jadis le monopole de l’approvisionnement du marché britannique ont subi une dépréciation, ou si elles ont conservé leur valeur intacte, c’est grâce à l’application d’un supplément de capital sous forme d’améliorations de toute sorte.
La plus value que les progrès de la population et de la richesse donnent aux agents naturels appropriés en augmentant à la fois leur rareté (en comparaison des autres agents productifs) et leur utilité, cette plus value n’a donc rien d’uniforme ni de fixe. Elle augmente plus ou moins selon la situation [I-360] et la qualité des terres; mais comme ces deux circonstances se modifient d’une manière incessante, sous l’influence des progrès généraux de la société, comme telle situation qui peut être aujourd’hui plus avantageuse que telle autre peut l’être moins demain, comme telle espèce de terre qui est actuellement classée au premier rang peut être reléguée plus tard à un rang inférieur, la plus value que le sol acquiert, grâce aux progrès de la population et de la richesse, se déplace continuellement, parfois même elle se perd. Mais son existence et son accroissement continu dans une société en voie de prospérité n’en sont pas moins incontestables.
La possession du sol confère encore, dans un grand nombre de pays, des avantages particuliers dont il faut tenir compte. Des droits et des priviléges de différentes sortes y sont attachés, surtout dans les pays où le régime féodal a été en vigueur. La classe des propriétaires fonciers jouit dans ces pays d’une considération supérieure à celle des autres classes. Enfin, soit par l’influence de cette cause, soit par l’attrait particulier que beaucoup de personnes paraissent éprouver pour la propriété foncière, la terre procure à ses possesseurs des avantages et des jouissances dont on se montre généralement avide.
Qu’en résulte-t-il? C’est que ces avantages et ces jouissances donnent naissance à une prime, laquelle se joint à celle qui résulte de l’expectative d’une augmentation graduelle de la valeur du sol, par suite de l’accroissement de la population et de richesse, et que cette double prime se déduit de la rémunération nécessaire ou du prix naturel du service productif du sol. C’est là ce qui explique pourquoi le taux de la rémunération des agents naturels appropriés, le taux du profit foncier ou du fermage est généralement inférieur à celui de la rémunération [I-361] des autres agents productifs, au taux de l’intérêt ou du loyer par exemple.
Enfin, si aux frais nécessaires d’entretien du sol, à la privation et au risque, déduction faite des avantages particuliers résultant de la nature de l’instrument-terre, nous ajoutons une part proportionnelle de produit net, faute de laquelle nul ne voudrait approprier des terres ni les consacrer à la production, nous aurons tous les éléments du prix naturel du service productif des agents naturels appropriés ou de la terre.
[I-362]
QUATORZIÈME LEÇON↩
la part de la terre (suite)
Que le prix naturel du service productif du sol n’est qu’un point idéal vers lequel gravite le prix courant de ce service. — Comment s’établit le prix courant. — Difficulté de reconnaître quand il se confond avec le prix naturel. — De la manière dont il convient de calculer celui-ci. — Dans quel cas le prix courant du service productif de la terre peut demeurer au dessous de son prix naturel. — Que cette situation se présente dans les pays d’esclavage et de servage. — Citations relatives à la Russie. — Dans quel cas le prix courant du service productif peut s’élever au dessus de son prix naturel. — Des obstacles qui empêchent l’équilibre de s’établir, et de leurs effets. — Théorie de Ricardo, — son application à ce cas particulier. — Réfutation des attaques dirigées contre cette théorie. — Causes qui agissent pour rétablir l’équilibre rompu en faveur de la terre dans l’Europe occidentale: — les progrès de l’agriculture et de la locomotion, — la liberté commerciale, — l’émigration. — Point vers lequel le prix courant des terres tend de plus en plus à se fixer sur le marché général. — Résumé. — Impropriété du mot rente pour signifier la part de la terre.
Nous venons d’étudier le prix naturel de la terre et du service qu’on en tire lorsqu’elle est employée à la production. Ce prix naturel représente la somme des frais nécessaires pour mettre [I-363] la terre au service de la production, l’y maintenir, comme aussi pour en augmenter successivement, dans la proportion utile, la surface exploitable.
Mais il ne faut jamais perdre de vue que le prix naturel est purement idéal; que c’est simplement un point vers lequel gravite le prix réel ou le prix courant, et que si ces deux prix tendent incessamment à se confondre, ils ne sont pas cependant toujours confondus; que le prix courant peut être tantôt au dessus, tantôt au dessous du prix naturel. Cette observation s’applique au service productif de la terre, aussi bien qu’à celui des facultés humaines ou des capitaux fixes et circulants.
Si donc nous voulons avoir une idée exacte et complète du revenu que l’on tire de l’application de la terre à la production, il nous faut examiner encore comment s’établit le prix courant de cet agent productif.
C’est le mouvement de l’offre et de la demande qui détermine le prix courant des terres, soit qu’il s’agisse de les vendre ou simplement d’en louer l’usage. Comme toute autre marchandise, la terre hausse de prix lorsqu’elle est beaucoup demandée et peu offerte; elle baisse lorsque l’inverse a lieu.
Mais il n’est pas facile de savoir quand le prix courant de la terre se confond avec son prix naturel, et cette difficulté, qui tient à la nature des choses, a donné lieu aux appréciations les plus erronées sur la légitimité de certaines portions du revenu foncier.
Les erreurs que l’on commet à cet égard proviennent de ce qu’on ne se forme pas une idée bien nette des frais généraux d’appropriation de la terre, non plus que de la manière dont ces frais doivent être répartis sur chacune des parties du sol approprié.
[I-364]
Nous savons de quoi se composent les frais d’appropriation de la terre; étudions maintenant comment ils doivent être distribués pour constituer le prix naturel de chacun des fragments du sol.
Nous avons remarqué dans la leçon précédente que les diverses industries qui concourent à l’appropriation du sol ne peuvent être ni plus ni moins profitables que les autres branches de la production; mais qu’en vertu de la nature même de l’objet auxquelles elles s’appliquent, ces industries ont un caractère essentiellement aléatoire. Nous allons voir pourquoi.
Il existe une extrême inégalité entre les terres. Les unes sont plus propres à servir de siége à la population et à l’industrie soit agricole, soit industrielle ou minérale, les autres le sont moins. Cette inégalité a été niée, je ne l’ignore pas. Quelques novateurs ont proclamé “l’égalité des terres,” comme feu Jacotot avait proclamé “l’égalité des intelligences.” Au dire de ces Jacotots de l’économie politique, toutes les terres contiendraient la même quantité de forces productives, et les différences qui se manifestent entre elles proviendraient seulement du plus ou moins d’intelligence et d’habileté avec lesquelles elles sont exploitées. Je ne m’arrêterai pas à discuter cette opinion qui place sur la même ligne la Normandie et les Landes, les prairies des polders et les sables de la Campine, l’île de Cuba et le Spitzberg. Je crois, pour ma part, que les mêmes inégalités qui existent parmi les intelligences se reproduisent parmi les terres. Seulement, je crois aussi que ces inégalités naturelles, dont on essayerait en vain de nier l’existence, n’ont rien de fixe, rien de permanent, soit qu’il s’agisse des hommes ou des terres. Ainsi, dans l’enfance des sociétés, les facultés purement physiques ayant un rôle considérable dans la production, sont particulièrement [I-365] estimées, tandis que d’autres facultés d’un ordre plus relevé, mais qui ne trouvent pas encore leur emploi, telles que les facultés artistiques ou littéraires, n’ont aucune valeur. C’est dans cette première période de la civilisation qu’Hercule est mis au rang des demi-dieux, tandis qu’Homère est réduit à mendier son pain. Mais que l’on franchisse un intervalle de quelques milliers d’années, et la situation aura bien changé. Des hercules plus robustes que leur fabuleux devancier seront réduits à travailler dans les théâtres forains, moyennant un salaire de trente sous par jour, tandis que des poètes qui ne vaudront pas Homère deviendront millionnaires. L’inégalité continuera de subsister dans cette nouvelle phase de la Civilisation; mais l’ordre dans lequel elle se manifestait jadis se sera modifié. Ce qui est vrai pour les facultés productives de l’homme ne l’est pas moins pour celles de la terre. Lorsque l’industrie humaine était peu avancée, les terres qui fournissaient avec le plus d’abondance les éléments de la subsistance du nombreux personnel requis pour la production étaient généralement préférées, et elles devenaient le siége de la civilisation. C’étaient l’Égypte, la Mésopotamie, l’Inde. Mais plus tard l’industrie humaine s’étant perfectionnée, et la force mécanique ayant peu à peu été substituée à la force physique, les terres qui renfermaient le plus d’éléments propres à la construction et à l’entretien des outils et des machines ont été préférées à leur tour. L’Angleterre, la Belgique, le nord de la France et de l’Allemagne, jadis incultes et presque déserts, sont devenus d’admirables foyers de civilisation, tandis que la barbarie a envahi les vieux berceaux de l’humanité. L’inégalité subsiste toujours, mais c’est en sens inverse.
Cette inégalité naturelle des facultés productives de la terre [I-366] n’a donc rien de fixe ni de permanent, mais son existence n’en est pas moins incontestable. Qu’en résulte-t-il? C’est que les industries qui concourent à mettre la terre au service de la production ont un caractère essentiellement chanceux, aléatoire; c’est qu’on peut faire des frais considérables pour découvrir et occuper des terres, dont on ne tirera aucun profit, tandis que d’autres terres dont la découverte et l’occupation auront été bien moins coῦteuses rapporteront de gros bénéfices.
Je ne saurais mieux comparer, sous ce rapport, les industries qui concourent à l’appropriation du sol, qu’à la pêche des perles. Parmi les hommes qui se livrent à cette industrie, les uns y trouvent à peine de quoi subsister, sans parler de ceux qui périssent sous la dent des requins; les autres, et c’est le plus grand nombre, en retirent un profit modéré; quelques-uns enfin, qui ont “la main heureuse” rencontrent des perles d’une dimension extraordinaire et ils font fortune. On dit de ceux-ci qu’ils ont une bonne chance; de ceux-là qu’ils en ont une mauvaise. Mais, somme toute, ces deux chances se compensent. Si la mauvaise l’emportait sur la bonne, si, en conséquence, l’industrie des pêcheurs de perles ne procurait point des bénéfices équivalents à ceux des autres branches de la production, elle ne tarderait pas à être abandonnée; si elle donnait des bénéfices supérieurs, la concurrence y serait attirée jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli. On peut donc dire du pêcheur qui a trouvé une perle d’une dimension extraordinaire, qu’il a été favorisé par la fortune, mais on ne peut pas dire qu’il soit un privilégié. Il a mis à la loterie et il a gagné tandis que d’autres ont perdu. Voilà tout. Eh bien! il en est de même dans les industries qui concourent à l’appropriation du sol. Certaines terres ne rapportent pas ce qu’elles ont coῦté, d’autres [I-367] couvrent leurs frais ni plus ni moins, quelques-unes enfin procurent des profits extraordinaires. Ici, c’est la Terre de Feu ou le Groenland, là c’est Cuba, la perle des Antilles. Mais considérez dans son ensemble l’industrie de l’appropriation des terres, et vous vous convaincrez que ses bonnes chances ne dépassent pas les mauvaises. Examinez, par exemple, ce qu’ont coῦté la découverte et l’occupation du Nouveau Monde depuis la Terre de Feu jusqu’au Groenland, examinez encore quels ont été les frais de défrichement des parties du sol américain qui se trouvent maintenant en cours d’exploitation, et vous pourrez vous assurer que c’est tout au plus si le produit, en y comprenant la plus value escomptable que l’avenir réserve à ce vaste continent, a couvert la dépense. Comptez le nombre des navigateurs et des soldats, ainsi que la masse des capitaux qui ont été sacrifiés avant que la découverte et l’occupation fussent achevées; comptez les tentatives de colonisation qui ont ćchoué, les établissements qui ont dῦ être abandonnés avant d’avoir donné un produit, et vous vous trouverez en présence d’un passif énorme. Or, ce passif doit être couvert, et comme dans le cas de la pêche des perles, il ne peut l’être que par les bénéfices extraordinaires que procurent certaines entreprises, et qui balancent les pertes que l’on a éprouvées sur d’autres.
Telles sont les circonstances auxquelles il faut avoir égard quand on calcule le prix naturel des terres. C’est l’ensemble des terres appropriées qu’il faut considérer, et non tel ou tel fragment du sol. De même qu’il serait absurde de considérer isolément la perle d’une dimension extraordinaire, que le plongeur a trouvée sans se donner plus de peine que s’il s’agissait de la perle la plus commune, et qu’il vend cependant mille fois plus cher, de même qu’il serait absurde de dire que le prix courant [I-368] de cette perle est supérieur à son prix naturel, sans avoir examiné quelle part doit lui incomber dans les frais généraux de la pêcherie, il serait absurde de dénoncer comme inique, comme entaché de privilége, le prix élevé de vente ou de location qu’obtiennent certaines terres, sans avoir préalablement examiné quelle part doit leur être attribuée dans les frais généraux de l’industrie de l’appropriation du sol.
Il n’en est pas moins vrai que dans certaines circonstances le prix courant de vente ou de location de la terre, en tenant compte des inégalités qui viennent d’être signalées, peut tomber au dessous de son prix naturel ou s’élever au dessus.
Premier Cas. Que le prix courant de vente ou de location de la terre peut tomber au dessous de son prix naturel.
Dans la plupart des pays neufs, la valeur des terres demeure communément bien au dessous de la somme des frais qu’il a fallu faire pour les approprier à la production. C’est à ce point que les gouvernements qui possèdent la plus grande partie du sol de ces pays, non seulement le concèdent gratis à ceux qui veulent le mettre en valeur, mais encore qu’ils accordent aux colons des subventions et des priviléges de diverses sortes. Qu’est-ce que cela prouve? Évidemment que la terre n’a dans ces pays aucune valeur actuelle, puisque ses possesseurs consentent à la donner pour rien, voire même à subventionner ceux qui sont disposés à la mettre en culture. Elle n’a que la chance d’acquérir une valeur, à mesure que la population et la richesse viendront s’y concentrer, mais cette chance peut tarder longtemps à se réaliser. En attendant, la terre coῦte souvent beaucoup plus qu’elle ne rapporte, et c’est peut-être alors un bon calcul de la concéder gratuitement ou même avec une subvention, afin de hâter le moment où elle acquerra une [I-369] valeur, où elle pourra, en conséquence, fournir sa quote-part à l’impôt.
Dans les pays où la terre est exploitée au moyen de l’esclavage ou du servage, elle n’a généralement aucune valeur propre. Cela tient à ce que la quantité en est illimitée par rapport à celle des autres agents productifs et, en particulier, du travail, ou ce qui revient au même, à ce que cette quantité dépasse la proportion utile. Comment donc se fait-il qu’on trouve avantage à la posséder? D’où provient le bénéfice qu’on en retire?
Ce bénéfice provient du capital et du travail qu’on y applique, et c’est la servitude qui en est la source. Les propriétaires d’esclaves ou de serfs ne retirent aucun revenu des terres qu’ils occupent, ou ils n’en retirent qu’un revenu insignifiant; en revanche, ils bénéficient de l’exploitation du travail de leurs esclaves ou de leurs serfs, et c’est grâce à ce bénéfice qu’ils trouvent avantage à posséder la terre. Que l’esclavage ou le servage vienne à être aboli, et les anciens propriétaires cesseront d’occuper le sol, ou ils n’en occuperont plus qu’une faible portion, faute de pouvoir en tirer parti. Tel a été le cas, par exemple, aux Antilles anglaises, et surtout à la Guyane, lors de l’émancipation des nègres. La même situation existait en Russie, où la terre s’évaluait naguère, comme le remarque un économiste russe, M. Alexandre Boutowski, non d’après son étendue, mais d’après le nombre des âmes qui y étaient attachées par les liens du servage. [39]
[I-370]
Mais nous avons remarqué déjà, à propos des autres agents productifs, qu’une telle situation ne saurait se perpétuer. Quand un agent productif ne retire pas de la production une part suffisante [I-371] pour couvrir son prix naturel; quand, en conséquence, les autres agents obtiennent, à ses dépens, une prime ou rente, ceux-ci sont invinciblement attirés dans la contrée où ce [I-372] phénomène se produit, et l’équilibre se rétablit à la longue. Mais, en attendant, la possession de l’agent qui demeure privé d’une portion de sa part nécessaire constitue une charge au lieu d’être un avantage. C’est ainsi que, dans les pays à esclaves, la possession de la terre ne procure le plus souvent aucun bénéfice, qu’elle est même onéreuse quand elle n’est pas accompagnée de celle d’un atelier d’esclaves. C’est le gain que l’on réalise sur les esclaves qui couvre, en ce cas, la perte que l’on subit sur la terre; c’est la rente que l’on retire du travail qui couvre la non-rente que coῦte la terre. Si la première ne dépasse [I-373] pas la seconde, — et ce cas peut se présenter par exemple lorsque le prix d’achat et d’entretien des esclaves est élévé, et le produit de leur travail à bas prix, — il n’y aura aucun profit à exploiter la terre, même au moyen de l’esclavage. Il vaudra mieux l’abandonner, à moins que le montant annuel de ses frais d’occupation ne demeure au dessous de la valeur future et escomptable que l’état politique et économique du monde, la direction que prennent la population et la richesse, pourront lui donner, à une époque plus ou moins prochaine.
Second cas. Que le prix courant de vente ou de location de la terre peut s’élever au dessus de son prix naturel.
Supposons que les progrès de l’industrie accumulent une masse croissante de travail et de capital, dans un pays dont la surface exploitable est limitée, et que des obstacles de différente sorte, obstacle naturel des distances, obstacle artificiel des barrières douanières, empêchent la population de ce pays de tirer du dehors une portion de sa subsistance, qu’arrivera-t-il? Il arrivera que les terres propres à la production des substances alimentaires y seront de plus en plus demandées, sans que l’offre puisse se maintenir au niveau de la demande. Si les grains sont le principal aliment de la population, les terres les plus propres à la production des céréales seront demandées et mises en culture les premières. La population continuant à s’accroître, on appliquera à la même culture des terrains qui y sont moins propres. Ainsi de suite. Mais à mesure que l’on consacrera à la production des substances alimentaires des terrains de moins en moins propres à ce genre de production, on verra se manifester les phénomènes que voici: on verra, en admettant toutefois que l’agriculture demeure stationnaire, [I-374] hausser le prix des substances alimentaires et la valeur des terres employées à les produire.
Aussi longtemps que les terres spécialement propres à la production des denrées alimentaires seront seules utilisées, le prix de ces denrées ne haussera point. Mais aussitôt que ces instruments supérieurs ne pourront plus suffire, aussitôt qu’on sera obligé de recourir à des instruments inférieurs, le prix des subsistances ne manquera pas de s’élever. Ou pour mieux dire, ce sera l’insuffisance des subsistances produites à l’aide des premiers, insuffisance dont la conséquence inévitable sera une hausse du prix, qui permettra d’utiliser les seconds. Ceux-ci cessant à leur tour de suffire aux besoins d’une population croissante, une nouvelle hausse se produira, laquelle permettra d’utiliser des terrains encore plus mauvais, puis d’autres, jusqu’à ce que toute la surface exploitable se trouve utilisée. Pendant toute cette période de hausse du prix des subsistances, occasionnée en premier lieu par l’augmentation de la demande, en second lieu par la nécessité de recourir à des terrains de plus en plus mauvais, eu égard à l’état des ressources et des connaissances agricoles, la terre ne manquera pas de hausser d’une manière parallèle; mais cette hausse ne se distribuera pas également sur toute la surface du territoire. Elle sera proportionnée à l’aptitude des terres à produire des substances alimentaires. Les terres les plus propres à ce genre de production hausseront davantage, les autres hausseront moins. En d’autres termes, la prime ou rente dont les détenteurs du sol jouiront dans cet état de la société, par suite de l’insuffisance relative de l’agent productif dont ils disposent, cette prime ou rente sera plus ou moins élevée selon que la terre sera plus ou moins propre à produire les denrées alimentaires dont la demande se sera augmentée.
[I-375]
Les phénomènes économiques dont je viens de donner un aperçu ont été décrits et formulés avec une netteté et une précision remarquables par Ricardo, qui a fondé, sur l’observation de ces phénomènes, sa célèbre théorie de la rente de la terre, théorie incomplète à divers égards, mais qui s’applique parfaitement au cas particulier dont nous nous occupons [40] .
[I-376]
Cette théorie de la rente de la terre, qui est un des plus [I-377] beaux fleurons de la couronne scientifique de Ricardo, quoiqu’elle [I-378] eῦt déjà été indiquée par Anderson1, et reproduite [I-379] par West et Malthus, a été vivement attaquée à une époque récente. [I-380] On a nié que les phénomènes décrits par Ricardo pussent [I-381] se produire. On a affirmé que toutes les terres étaient “égales” et, selon toute apparence aussi, également propres à la production du blé et des autres substances alimentaires, ou que si elles étaient inégales, bien loin de mettre les meilleures en culture les premières, on commençait par les plus mauvaises; en sorte que le prix des subsistances devait inévitablement baisser partout et toujours à mesure que l’on mettait de nouvelles terres en culture [41] ; que cette dernière assertion se trouvait d’ailleurs confirmée par les faits, le prix des subsistances [I-382] n’ayant cessé de baisser, particulièrement en Europe [42] ; enfin qu’il n’était pas possible que la terre se trouvât, en aucun temps et sur aucun point du globe, en déficit relativement aux autres agents productifs; qu’elle ne pouvait, en conséquence, jamais rapporter au delà de la somme nécessaire pour la mettre au service de la production et l’y maintenir; qu’elle ne pouvait, en un mot, jamais donner une rente.
Il est bien vrai que l’inégalité des terres n’a nullement un caractère fixe, permanent; nous avons remarqué déjà qu’elle se modifie d’une manière incessante sous l’influence de progrès; máis il n’en faut pas moins être singulièrement aveuglé par l’esprit de système pour nier son existence. Il est bien vrai aussi que le soin de leur sécurité oblige fréquemment les hommes, dans les premières périodes de la civilisation, à cultiver les terres les plus faciles à défendre, alors même qu’elles ne sont pas les plus fertiles; il est bien vrai enfin, et à cet égard les assertions de M. Carey joignent au mérite d’être neuves celui d’être exactes, que les progrès de l’agriculture et de l’industrie permettent, à certaines époques, d’utiliser avec grand profit des terres dont on ne pouvait auparavant tirer aucun parti; mais il n’en est pas moins avéré qu’eu égard à l’état [I-383] actuel de l’agriculture et de l’industrie, on va généralement des meilleures terres aux plus mauvaises; en outre, qu’il peut arriver que les terres spécialement propres à la production des subsistances ne suffisent pas dans un pays pour subvenir aux besoins de la consommation. Quant à l’assertion de M. de Fontenay, qui sert de preuve aux précédentes, savoir que le prix des subsistances n’a cessé de baisser, sous l’influence de la mise en culture successive de terrains meilleurs à l’aide de méthodes et d’instruments agricoles plus parfaits, elle me paraît être tout juste à l’opposé de la vérité.
C’est un fait malheureusement avéré que le prix des subsistances a été continuellement en hausse depuis un siècle, du moins dans la partie du monde où nous vivons. Cependant, dans cette période, les progrès des instruments et des méthodes agricoles ont été incessants et considérables. Eh bien! tandis que le progrès industriel abaissait dans la proportion de la moitié ou des deux tiers, les prix de la plupart des objets manufacturés, tout ce que le progrès agricole a pu faire, ç’a été de neutraliser en partie la tendance des substances alimentaires à hausser de prix, tendance qui était visiblement un résultat de la nécessité où se trouvait une population croissante d’appliquer à la production agricole des instruments-terres de moins en moins efficaces. Si les adversaires de la théorie Ricardo étaient dans le vrai, si la population croissante de l’Europe occidentale avait, comme ils l’affirment, appliqué successivement à la production agricole des instruments-terres de plus en plus puissants, n’est-il pas évident que le progrès réalisé dans les méthodes et dans l’outillage de l’agriculture venant s’ajouter à celui-là, les prix des subsistances auraient baissé comme ceux des objets manufacturés, dans la proportion de la moitié ou [I-384] des deux tiers? Or, qui donc, à part les adversaires systématiques de la théorie de la rente, oserait affirmer que le prix du blé ou de la viande ait baissé de la moitié ou des deux tiers depuis un siècle, et qu’il continue, au moment où nous sommes, à baisser progressivement?
Cependant, ressort-il des phénomènes observés par Ricardo qu’il doive y avoir enchérissement progressif et continu des substances alimentaires, hausse progressive et continue du revenu territorial, au détriment de la part des autres agents productifs? En aucune façon. Si l’on a bien étudié la loi qui détermine l’équilibre du monde économique, on se convaincra que cette situation ne saurait être que purement temporaire; que si le prix courant de vente ou de location de la terre peut s’élever au dessus de son prix naturel, l’équilibre tend néanmoins toujours à se rétablir. Tout nous annonce, par exemple, qu’il ne saurait plus demeurer longtemps rompu, à l’avantage des détenteurs du sol, dans les pays que nous avons cités.
Nous voyons, en effet, s’opérer depuis un quart de siècle un double mouvement des plus remarquables, parmi les populations de l’Europe occidentale.
D’une part, ces populations s’efforcent d’abattre les obstacles naturels ou artificiels qui confèrent à certaines terres le monopole de la production des denrées nécessaires à la consommation. C’est ainsi que les progrès de l’agriculture et de la locomotion ont permis d’exploiter des terres qui n’auraient pu être cultivées auparavant avec avantage, et que le monopole des terres, considérées autrefois comme les plus fertiles et les mieux situées, a été par là même entamé, en attendant qu’il soit détruit. C’est ainsi encore que l’abaissement ou la suppression des barrières douanières qui protégeaient dans chaque pays les [I-385] terres à blé de l’intérieur contre celles du dehors, a concouru au même résultat.
D’une autre part, les masses agglomérées sur le territoire limité de l’Europe occidentale ont commencé à renverser les obstacles naturels ou artificiels qui s’opposaient jadis à leur déplacement, et elles débordent à flots pressés sur le Nouveau Monde. Cinq cent mille individus passent maintenant, chaque année, d’Europe en Amérique et en Australie, et ce mouvement d’émigration, qui existait à peine il y a un demi-siècle, ira sans cesse croissant avec la facilité et le bon marché des communications.
Que doit-il résulter de ce double mouvement, qui met une quantité croissante de nouvelles terres à la disposition du travail et du capital de l’Europe, soit que les subsistances produites sur ces terres nouvelles émigrent vers les populations qui doivent les consommer, soit que les populations émigrent vers les subsistances? Évidemment que la valeur des anciennes terres doit s’abaisser et celle des nouvelles s’élever, jusqu’à ce qu’il y ait équilibre, jusqu’à ce que les anciens instruments-terres, maintenant dépouillés du monopole dont les circonstances les avaient investis, ne puissent plus se vendre ou se louer plus cher que les nouveaux. Déjà, on le sait, ce phénomène commence à se produire. En Angleterre, par exemple, où la valeur du sol n’avait cessé de croître depuis un siècle, ce mouvement ascensionnel s’est arrêté depuis la suppression des lois-céréales et le développement prodigieux de l’émigration. Beaucoup de propriétaires ont été obligés soit de consentir à une réduction de la rente du sol, soit, ce qui revient au même, d’appliquer au sol un supplément de capital, sans exiger une augmentation de fermage. A mesure que les effets de la liberté commerciale, [I-386] des progrès de la locomotion et de l’émigration se feront sentir davantage, la dépréciation des anciennes terres deviendra plus considérable.
Jusques à quand cette dépréciation inévitable pourra-t-elle continuer? Jusqu’à ce que le prix de vente ou de location des anciennes terres de l’Europe occidentale se trouve en équilibre avec celui des nouvelles terres de l’Amérique ou de l’Australie. Et celui-ci vers quel niveau tend-il à se placer? Vers le niveau marqué par le prix naturel du sol, c’est à dire par la somme des frais qu’il a fallu faire pour le découvrir, l’occuper et le défricher, avec l’adjonction des profits ordinaires.
Au moment où nous sommes, le prix courant de vente ou de location des terres de la plus grande partie de l’Amérique et de l’Australie ne représente pas encore leur prix naturel. Dans plusieurs parties de l’Amérique, au Brésil, au Pérou, etc., la plupart des concessions de terres sont encore gratuites, ce qui signifie que les gouvernements de ces pays n’exigent rien, quant à présent du moins, pour se rembourser des frais de découverte et d’occupation de leurs domaines. Aux États-Unis, c’est tout au plus si ces frais sont couverts par le prix de 1 1/2 dollar l’acre, auquel les terres publiques sont mises en vente. Mais il est vraisemblable qu’à mesure que l’émigration prendra des proportions plus vastes, que les terres seront plus demandées dans le Nouveau Monde, leur prix courant haussera. Seulement, la surface exploitable est tellement vaste, que les émigrants auront pendant longtemps encore le choix des emplacements, et que les gouvernements possesseurs des terres disponibles se feront concurrence pour attirer les acheteurs. Or, chacun sait que dans une situation semblable le prix courant d’une denrée ou d’un agent productif ne peut s’élever, au [I-387] moins d’une manière régulière et permanente, au dessus de son prix naturel.
Le prix naturel des terres de l’Amérique et de l’Australie semble ainsi destiné à devenir le point central vers lequel gravitera de plus en plus le prix courant des terres soit de l’ancien monde, soit du nouveau.
Ceci nous amène à une conclusion du plus haut intérêt, savoir que le prix courant du service productif du sol, partant la part de la terre doivent à la longue s’abaisser d’une manière continue. En effet, les frais d’appropriation des terres sont en vertu de la nature même des choses, de moins en moins élevés. Ainsi, il y a apparence que les terres du Nouveau Monde ont moins coῦté à découvrir, à occuper et à défendre que celles de l’ancien; il y apparence aussi que le défrichement, accompli à l’aide de procédés et d’instruments de plus en plus perfectionnés, coῦte de moins en moins cher. On peut donc affirmer que le prix naturel des terres du Nouveau Monde est inférieur à celui des terres de l’ancien, et qu’il le sera chaque jour davantage. Mais nous venons de remarquer que ce prix devient de plus en plus le régulateur du marché des instruments-terres, le point vers lequel le prix courant doit graviter sur le marché général. Qu’en résultera-t-il? C’est que le prix courant des terres de l’ancien continent finira par ne plus couvrir entièrement leur prix naturel; c’est qu’à une époque plus ou moins éloignée dans l’avenir, la propriété foncière de l’Europe occidentale, par exemple, après avoir obtenu au delà de sa rémunération nécessaire, n’obtiendra plus une rémunération suffisante pour couvrir les frais qu’il a fallu faire pour la constituer et la maintenir au service de la production; c’est que le prix courant de terres tendra de plus en plus à se mettre au niveau du prix [I-388] naturel de celles dont les frais de production auront été le moins élevés; d’où la conclusion que le progrès a pour résultat final d’abaisser la part de la terre, aussi bien que celle du capital, tandis qu’il élève celle du travail.
A la vérité, il est possible que la population et la richesse finissent par s’accumuler de telle façon sur notre globe que la terre vienne à manquer à ses habitants; en d’autres termes, que la proportion des agents naturels appropriés finisse par tomber au dessous de celle du travail et du capital. Que se passera-t-il alors? Évidemment que les agents naturels appropriés obtiendront une prime ou rente aux dépens des autres agents productifs; que ce phénomène qui s’est manifesté en Europe, d’une manière partielle et temporaire, deviendra universel et permanent. Mais, en premier lieu, des siècles se passeront avant qu’une semblable situation puisse se produire, car, au moment où nous sommes, une faible portion de notre globe seulement est assujettie à une exploitation régulière; encore est-elle fort imparfaitement exploitée. En second lieu, cette situation venant à se produire, l’accroissement de la population et du capital se trouverait découragé jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli.
Résumons-nous. La terre est un des agents nécessaires de la production. Cet agent n’est point gratuit, car on ne peut le mettre au service de la production et l’y maintenir, sans avoir à supporter et à couvrir des frais d’appropriation et d’entretien plus ou moins élevés. Ces frais augmentés d’une part de produit net, proportionnée à celle qui est afférente aux autres agents de la production, constituent le prix naturel du service productif de la terre. Il faut que ce prix naturel soit couvert par le prix courant, ou qu’on ait l’espoir suffisamment fondé qu’il le [I-389] sera un jour, de manière à compenser les frais supportés dans l’intervalle, pour que la terre soit appropriée. Communément, le prix courant n’atteint qu’à la longue le niveau du prix naturel. Il se passe quelquefois fort longtemps avant qu’une terre appropriée soit assez demandée, pour que son prix courant atteigne le niveau des frais qu’il a fallu faire pour la découvrir, l’occuper et la défricher, comme aussi pour utiliser toutes les facultés productives qu’elle recèle. La terre acquiert, en conséquence, une plus value, ce qui signifie qu’une partie de sa valeur réside dans l’avenir, mais s’escompte dans le présent pour couvrir ses frais d’appropriation et d’entretien ou son prix naturel. Cette plus value n’est pas uniforme; elle n’est pas non plus fixe. De là, le caractère aléatoire attaché à l’appropriation et à la possession des terres.
Quelquefois le prix courant de la terre ne suffit point pour couvrir son prix naturel, même en tenant compte de sa plus value future. Alors la terre ne peut être appropriée et exploitée, que dans le cas où ses possesseurs peuvent s’attribuer la rente du monopole d’un autre agent productif. C’est le cas de l’esclavage. Quelquefois le prix courant de la terre dépasse son prix naturel, et la plus value qu’elle acquiert comprend alors une rente qui est prise sur la part de l’agent productif qui surabonde relativement à elle. C’est ainsi que dans l’Europe occidentale, la part de la terre a visiblement empiété depuis un siècle sur la part du travail. Mais ces deux situations opposées ne peuvent se perpétuer, et, en dépit de l’influence des causes perturbatrices, l’équilibre, soit qu’il se trouve rompu en faveur de la terre ou à son détriment, finit toujours par se rétablir.
D’après ce qui vient d’être dit, on comprendra que le mot rente soit tout à fait impropre à signifier la part afférente aux [I-390] agents naturels appropriés ou à la terre. On bien il faut se servir du mot rente uniquement pour signifier la part qui revient à la terre dans la production et le restreindre à cet usage, ou bien il faut employer un autre terme, profit foucier, fermage ou loyer, par exemple, pour exprimer la part de la terre, et réserver, comme j’ai eu soin de le faire, le mot rente pour exprimer la part supplémentaire ou la prime qui s’ajoute au prix naturel de tout agent productif en déficit relativement aux autres. Cette part supplémentaire ou cette prime est, ainsi que j’ai cherché à le démontrer, toujours un résultat de la rupture de l’équilibre économique, mais, toujours aussi, elle détermine le rétablissement de cet équilibre juste et nécessaire, en provoquant une augmentation de la quantité, partant de l’offre des agents productifs, auxquels elle se trouve attachée.
[I-391]
QUINZIÈME LEÇON↩
thÉorie de la population
Que la loi qui régit le renouvellement de la population est la même que celle qui gouverne les différentes branches de la production. — Analyse du phénomène du renouvellement de la population. — Que la population est naturellement limitée dans son nombre et dans sa durée. — Des agents productifs dont la coopération est nécessaire pour renouveler la population: la force reproductive, le travail, le capital. — De quoi se compose le prix naturel d’une génération nouvelle. — Du prix courant. — En quoi consistent la demande et l’offre de la population. — Limites du débouché ou de la demande de la population. — De la connaissance de ce débouché sous le régime des marchés limités, — du marché général. — De l’offre de la population. — Ce qui la détermine, — dans le cas d’une population esclave, — dans le cas d’une population libre. — Imperfection du selfgovernment de la population. — Comment il est pratiqué dans les classes supérieures, — moyennes, — inférieures. — Que l’offre de la population n’en a pas moins une tendance irrésistible à se mettre en équilibre avec la demande au niveau du prix naturel ou nécessaire. — Raison de cette tendance. — Comment agit la loi des quantités et des prix pour déterminer l’équilibre de la population avec ses moyens d’existence et de reproduction.
La même loi qui maintient l’équilibre entre les différentes branches et les différents agents de la production, en attribuant [I-392] à chacun de ceux-ci, sauf l’action des causes perturbatrices, sa part juste et nécessaire dans la richesse produite, gouverne aussi le renouvellement de la population. Comme dans toutes les autres branches de l’activité humaine, on retrouve dans la reproduction de la population les deux phénomènes des frais de production et de l’offre et la demande, régis par la loi des quantités et des prix, de telle sorte que les générations qui naissent tendent incessamment à remplacer, dans la proportion nécessaire, ni plus ni moins, les générations qui périssent, en reconstituant et en accroissant, dans la proportion nécessaire aussi, les éléments qui ont été employés à les produire.
On peut dire de chaque génération qu’elle a son prix naturel représentant la somme des frais qu’il a fallu dépenser pour la produire, avec adjonction des profits ordinaires (part proportionnelle de produit net) pour les agents divers qui ont concouru à sa production.
On peut dire de même de chaque génération qu’elle a son prix courant déterminé, d’un côté, par la demande de la population nécessaire pour remplir les emplois disponibles au sein d’une société, dont le personnel va sans cesse s’usant et se détruisant par la vieillesse et la mort; d’un autre côté, par l’offre du personnel nouveau qui se présente incessamment aussi pour remplir les emplois anciens à mesure qu’ils deviennent vacants, et les emplois nouveaux à mesure qu’ils se créent.
On peut dire enfin que l’offre de la population tend incessamment, par l’action de la loi des quantités et des prix, à se mettre en équilibre avec la demande au niveau du prix naturel de chaque génération, c’est à dire à un prix qui non seulement couvre les frais d’entretien de cette génération, ou, ce qui revient au même, qui lui procure les moyens de subsistance nécessaires, [I-393] mais encore qui lui permette de renouveler intégralement les agents productifs employés à sa formation et de les accroitre au besoin dans la proportion utile pour former, à son tour, la génération suivante.
Pour établir la vérité de ces propositions, analysons le phénomène du renouvellement de la population.
Ce qui caractérise toute population, c’est qu’elle est limitée à la fois en nombre et en durée, ou, ce qui revient au même, dans l’espace et dans le temps.
Le nombre des hommes n’est point illimité. Comme nous l’avons constaté au début de ce cours, le nombre utile de la population est déterminé par la proportion naturelle des agents dont la production exige le concours, c’est à dire du personnel et du matériel nécessaires à l’ensemble des entreprises de production.
La durée de l’homme est, de même, naturellement limitée. Chaque génération n’a qu’une durée moyenne d’un certain nombre d’années, tantôt plus tantôt moins, selon les conditions d’aisance, de salubrité, de sécurité où elle se trouve placée. En moyenne, la durée de la population dans les pays civilisés et à notre époque varie entre trente et quarante ans environ.
Que résulte-t-il de là? C’est que la population doit être incessamment reproduite, renouvelée, dans son nombre utile et en raison de sa durée, dans l’espace et dans le temps.
Cela étant, il s’agit de savoir par le concours de quels agents se reproduit ou se renouvelle la population.
La reproduction ou le renouvellement de la population exige le concours de trois agents productifs, associés dans des proportions déterminées, quoique variables selon le degré de civilisation, et par conséquent selon la nature des occupations de la [I-394] population qu’il s’agit de reproduire. Savoir: 1° un agent naturel approprié, la force reproductive de l’homme; 2° du travail; 3° du capital.
Examinons successivement ces trois agents dont la coopération est nécessaire au renouvellement de la population.
I. La force reproductive de l’homme.
La force reproductive ou le pouvoir de reproduction existe au sein de la race humaine comme dans toutes les races vivantes, végétales ou animales, sinon en quantité illimitée du moins en quantité surabondante. Toutes les espèces possèdent des moyens de reproduction bien supérieurs à leur reproduction effective. La nature a prodigué les germes. Ainsi, par exemple, un seul pied de maïs fournit deux mille grains, un pavot trente-deux mille, un orme cent mille; une carpe fait trois cent quarante-deux mille œufs; deux harengs rempliraient la mer en dix ans, si tous leurs œufs étaient fécondés et si aucune cause de destruction n’arrêtait leur multiplication. Cette exubérance de fécondité n’est pas la même, à la vérité, dans toutes les espèces. Les baleines ne peuvent se multiplier avec la même rapidité que les harengs, les éléphants ne peuvent pulluler autant que les lapins. Il serait intéressant d’établir l’échelle de la fécondité des espèces végétales et animales; mais, dès à présent, en se fondant sur les notions acquies dans cette branche de l’histoire naturelle, on peut conjecturer que les espèces sont d’autant plus fécondes qu’elles sont soumises à des causes de destruction plus nombreuses, et qu’elles sont moins pourvues des moyens nécessaires pour y résister.
La fécondité varie selon les espèces; mais la règle générale c’est qu’elle est exubérante; c’est que l’homme, aussi bien que les animaux inférieurs, pourrait se multiplier avec une rapidité [I-395] extrême, en admettant que son pouvoir de reproduction fῦt le seul agent nécessaire à sa multiplication. Si la reproduction de l’espèce humaine n’était pas autrement limitée, la population du globe doublerait tous les vingt-cinq ans, en moins de temps encore, et elle croîtrait en progression géométrique.
C’est ainsi qu’aux États-Unis, par exemple, la population qui n’était que de 3,929,827 individus en 1790, s’est élevée à 22,806,000 en 1850. Si l’on déduit de ces chiffres les quantités qui proviennent des immigrations, on trouvera que la population des États-Unis a quintuplé en soixante ans, qu’elle a plus que doublé en vingt-cinq ans [43] . Eh bien! en supposant qu’elle continuât à se développer en suivant la même progression, elle serait de quarante-quatre millions dans vingt-cinq ans; de quatre-vingt-huit millions dans cinquante ans, de cent soixante-seize dans soixante-quinze ans, de trois cent cinquante-deux dans un siècle, de cinq milliards six cent trentedeux millions dans trois siècles; de 1,441,792 millions dans quatre siècles, et ainsi de suite, selon le cours de la progression géométrique. Cependant, les États-Unis ne posséderont pas, à coup sῦr, 1,441,792 millions d’habitants dans quatre siècles. Cela est évident, car les animaux et les plantes nécessaires pour alimenter et vêtir une population si formidable ne pourraient subsister sur notre globe, car la place même manquerait pour la loger, non seulement aux États-Unis, mais encore dans le reste du monde. Il nous est impossible de prédire [I-396] combien d’habitants les États-Unis posséderont dans quatre siècles, mais nous pouvons affirmer qu’ils n’en auront pas 1,441,792 millions. S’ils en ont trois ou quatre cent millions, ce sera beaucoup. Or, pour que ce dernier chiffre ne soit pas dépassé, il faudra:
Ou que la puissance spécifique de reproduction de la population américaine vienne à diminuer;
Ou que la population américaine utilise moins sa puissance de reproduction;
Ou, en supposant qu’elle continue à l’utiliser autant, qu’une portion plus considérable de son accroissement annuel soit détruite, avant de pouvoir concourir, à son tour, à la reproduction.
Selon toute apparence, ces deux dernières éventualités seules se réaliseront. Ne les voyons-nous pas, en effet, se réaliser dans la plupart des autres contrées du globe, particulièrement en Europe? Le développement de la population suit, comme on sait, en Europe, une progression infiniment plus lente qu’aux États-Unis [44] . Quelle conclusion faut-il tirer de ce fait? [I-397] Que la puissance spécifique de reproduction de la population des États-Unis est supérieure à celle des populations de l’Europe? Rien n’est moins probable, car la race qui se multiplie avec une rapidité si grande aux États-Unis provient d’une souche européenne; elle appartient, en majorité,. à la souche anglo-saxonne. Cette fécondité si active n’est donc pas particulière à la race qui occupe aujourd’hui le territoire des États-Unis. Est-on mieux fondé à prétendre qu’elle est due au sol ou au climat. Non; car les races autochtones dépérissent aux États-Unis, au lieu de s’accroître, et la race anglo-saxonne elle-même s’y développait bien moins rapidement dans le siècle dernier, quoique le sol et le climat de l’Amérique du Nord fussent alors à peu près les mêmes qu’aujourd’hui. Si donc la population de l’Europe s’accroît plus lentement que celle des États-Unis, à quoi cela tient-il? Cela tient évidemment, d’une part, à ce que les Européens utilisent à un moindre degré que les Américains du nord leur puissance reproductive; cela tient, d’une autre part, à ce qu’une portion plus considérable de la génération nouvelle périt avant d’avoir pu servir à la reproduction.
On peut donc affirmer que l’espèce humaine est pourvue d’une puissance reproductive plus que suffisante pour la maintenir et la développer dans la proportion utile. Une partie de ce pouvoir de reproduction demeure sans emploi; une autre partie est anéantie dans ses résultats après avoir été employée. On conçoit fort bien, au surplus, que la puissance reproductrice de l’espèce humaine dépasse les nécessités auxquelles elle doit pourvoir, car l’homme étant soumis à l’influence d’une multitude de causes de destruction, son espèce aurait depuis longtemps disparu, si la Providence [I-398] n’avait pris soin de la munir d’une force reproductrice surabondante [45] .
[I-399]
II. Le travail. La force reproduction ou le pouvoir de reproduction, si essentiel qu’il soit à l’œuvre du renouvellement de la [I-400] population, n’en est cependant qu’un des éléments. Cette force n’agit, en effet, que pour la formation d’un embryon qui n’est que le germe d’un homme. Pour transformer cet embryon en un homme utile, il faut mettre en œuvre une quantité notable de travail: travail naturel de gestation au sein de la mère, travail du médecin ou de la sage-femme qui préside à l’accouchement, travail de l’allaitement, de l’élève, de l’éducation et de l’apprentissage d’un métier ou d’une profession. Ces différents travaux pour la plupart si pénibles et si difficiles occupent la grande majorité de la population féminine et un fort contingent de la population masculine, soit que les pères et les mères de famille élèvent eux-mêmes leurs enfants, soit qu’ils se fassent assister par des nourrices, des bonnes d’enfants, des gouvernantes, des instituteurs, des professeurs, etc. Il n’est certainement aucune branche de la production, sans excepter même l’agriculture, qui exige l’application d’une quantité plus considérable de travail physique, intellectuel et moral que celle qui a pour objet de mettre au monde, d’élever et d’instruire la nouvelle génération nécessaire pour remplacer, en la continuant, la génération existante.
III. Le capital. Il n’en est point non plus qui exige l’application d’une quantité plus considérable de capital, surtout dans une société parvenue à un certain degré de civilisation, où l’homme ne peut remplir une fonction utile et se procurer ainsi des moyens d’existence qu’à la condition d’être pourvu de connaissances plus ou moins nombreuses et variées, les unes générales, les autres spéciales. Même dans les couches les plus basses de la population, et dans les pays où les obligations naturelles de la paternité sont le plus imparfaitement remplies, les enfants ont exigé, au moment où ils commencent par leur travail hâtif à [I-401] subvenir eux-mêmes à leur entretien, l’application d’un capital composé de l’ensemble des frais de nourriture, d’habillement, de chauffage, de logement, d’instruction et d’apprentissage, que les parents, et, à leur défaut, la charité publique ou privée, ont dῦ avancer dans une période de sept à huit ans au minimum. Dans les classes supérieures, les frais d’élève de la génération nouvelle sont infiniment plus considérables, d’abord parce que les éléments constitutifs de l’élève, nourriture, entretien, surveillance, etc., sont plus nombreux et plus raffinés, ensuite parce que la génération nouvelle, issue des classes supérieures, ne commence à occuper des fonctions utiles et rémunératoires que vers l’âge de 18 ou de 20 ans, souvent même plus tard encore. Enfin, aux frais d’élève proprement dits viennent s’ajouter ceux d’une instruction développée et d’autant plus coῦteuse qu’elle est trop souvent surchargée de branches parasites. Il en résulte que les rejetons des classes supérieures ont exigé communément, avant de pouvoir subvenir euxmêmes à leur entretien, soit par la mise en œuvre de leur travail, soit par l’exploitation de leurs capitaux mobiliers et immobiliers, une avance de capital qui s’élève de 15,000 fr. à 30,000 fr. et davantage. Que si on joint par la pensée tous les capitaux qu’a exigés la formation de la génération nouvelle jusqu’au moment où les individualités qui la composent prennent la place de celles qui composaient la génération précédente, en y ajoutant les capitaux absorbés par l’élève et l’éducation des enfants de la même génération morts avant l’âge, on arrivera à un capital véritablement énorme. On trouvera, comme pour le travail, que cette branche particulière de la production, qui a pour objet le renouvellement nécessaire de la génération existante, exige peut-être, en comparaison des [I-402] autres branches, l’application de la plus forte part du capital de la société.
En résumé donc, la reproduction ou le renouvellement de la génération existante exige la coopération de trois agents également indispensables, savoir: la force reproductive de l’homme (composée du pouvoir fécondant d’un sexe, de la fécondité de l’autre); le travail nécessaire pour former la génération nouvelle, en la rendant propre à remplir, à son tour, les fonctions productives qui fournissent à la génération présente ses moyens d’existence; le capital, consistant dans l’ensemble des frais qu’il a fallu avancer pour faire subsister la génération nouvelle et lui donner l’éducation et l’apprentissage requis pour les fonctions que doivent occuper ses différents membres, jusqu’au jour où, prenant leur place dans le grand appareil de la production, ils parviennent à subsister par eux-mêmes.
Ces trois agents sont, disons-nous, également nécessaires au renouvellement de la population. Ainsi, par exemple, que la force reproductive soit utilisée, sans l’auxiliaire d’une quantité suffisante de travail et de capital, les enfants périront avant d’arriver à l’âge d’homme; que le travail et le capital existent, mais que la force reproductive fasse défaut, les unions formées en vue de la reproduction demeureront stériles; que le travail soit insuffisant, les enfants périront encore, faute d’être convenablement soignés, surtout dans la première enfance, alors même que la force reproductive et le capital seraient employés dans la proportion requise.
Mais de ces trois agents, dont la coopération est nécessaire pour renouveler la population, le premiér, savoir: la force reproductive, peut être considéré comme existant et pouvant être employé en quantité illimitée, ou, si l’on veut, surabondante, [I-403] tandis que les deux autres, le travail et le capital, et particulièrement le capital, sont essentiellement limités.
D’où cette conclusion:
Que la multiplication de l’espèce humaine s’opère toujours en proportion non seulement de son pouvoir de reproduction, mais encore et surtout des quantités de travail et de capital dont chaque génération dispose et qu’elle consent à appliquer à son renouvellement.
Et cette formule:
Que la génération nouvelle a exigé, pour être formée, des frais de production consistant dans la somme des agents productifs, pouvoir reproducteur, travail et capital, qu’il a fallu dépenser pour la produire; que la totalité de ces frais de production, avec adjonction des profits ordinaires, constitue son prix naturel ou nécessaire.
Mais qu’il s’agisse de l’homme comme de tout autre produit, les frais de production ou le prix naturel ne sont qu’un point idéal vers lequel gravite incessamment le prix réel ou le prix courant. Celui-ci est déterminé par le mouvement de l’offre et de la demande.
Recherchons donc en quoi consistent la demande et l’offre d’une population.
I. La demande. Comme nous l’avons remarqué déjà, le débouché ouvert à la population n’est pas illimité. Il faut pour produire toutes les choses nécessaires à la consommation de l’homme non seulement un personnel de travailleurs, mais encore d’autres éléments de production, savoir des capitaux mobiliers et immobiliers (parmi lesquels on peut comprendre les agents naturels appropriés). Chaque entreprise exige le concours de ces divers agents productifs, dans une proportion [I-404] déterminée par sa nature. D’où il résulte qu’en examinant l’ensemble des entreprises dans un moment donné, on trouve qu’elles exigent une certaine proportion de personnel et une certaine proportion de matériel. Si le personnel qu’on leur offre dépasse la quantité qu’elles demandent, l’excédant demeurera évidemment sans emploi, et la présence de cet excédant agira pour comprimer la rémunération du personnel employé. Objectera-t-on que le nombre des entreprises n’est pas limité? Sans doute. Mais pour créer de nouvelles entreprises dans lesquelles on demande la portion excédante du personnel, il faut aussi du matériel, c’est à dire des capitaux mobiliers et immobiliers. Si ces capitaux manquent, les nouvelles entreprises ne pourront être fondées, et, quoi qu’on fasse, l’excédant du personnel demeurera sans emploi. Objectera-t-on encore que la demande de population ne comprend pas seulement les travailleurs dont le concours est nécessaire, dans une proportion déterminée, à chaque entreprise, mais qu’elle comprend aussi les détenteurs du matériel de la production, c’est à dire les capitalistes et les propriétaires fonciers? Sans doute encore, mais le nombre des hommes qui peuvent subsister du produit des capitaux mobiliers et immobiliers (déduction faite des frais nécessaires pour les maintenir intacts au service de la production) est limité comme ce produit même; en sorte que, si ce nombre venait à s’accroître sans mesure, il ne tarderait pas à déborder la demande de la population des capitalistes et des propriétaires fonciers. En admettant donc qu’il existât, en même temps, un nombre suffisant de simples travailleurs, il en résulterait encore un excédant de population.
Le débouché ou la demande de la population a donc ses limites naturelles, et il importe d’y ajuster la production et l’offre, [I-405] absolument comme lorsqu’il s’agit de bâtiments, de machines, de matières premières ou de tout autre agent productif.
Cela étant, il s’agit de connaître l’étendue et la nature de ce débouché, en d’autres termes, de connaître l’étendue et la nature du marché de la population. Nous nous trouvons à cet égard, sous le régime actuel, en présence de difficultés beaucoup plus grandes que celles qui se présentaient sous l’ancien régime. Alors, en effet, la limitation et la séparation soit naturelles soit artificielles des marchés étaient partout et pour toutes choses la loi prédominante. Chacun possédait une industrie ou une fraction d’industrie avec un débouché auquel nul concurrent ne pouvait toucher. Les membres des classes aristocratiques monopolisaient les terres, ainsi que les emplois civils et militaires, qu’ils se transmettaient de génération en génération et qui constituaient pour leur population un débouché facile à apprécier. Quand ils se reproduisaient de manière à excéder ce débouché, les corporations religieuses leur servaient communément de déversoirs, les préjugés nobiliaires (préjugés qui avaient leur raison d’être dans cet état de la société) s’opposant à ce qu’ils offrissent leur excédant aux autres branches de la production, où l’affluence de la population surabondante des classes supérieures aurait été une cause de perturbation. Les industriels, les artisans et les commerçants avaient de même un débouché assuré et à peu près invariable dans le marché de la cité, où leur nombre était limité par les statuts de leurs corporations, et où la difficulté des communications d’abord, les règlements ensuite empêchaient qu’on ne vînt leur faire concurrence. Enfin, les classes agricoles attachées à la glèbe possédaient de même un marché d’une étendue bien déterminée, et lorsqu’elles se reproduisaient de [I-406] manière à le déborder, le seigneur intervenait pour modérer le mouvement de leur population, en limitant le nombre des mariages, tandis que la religion et les mœurs agissaient pour prohiber les unions illicites. Dans une société ainsi constituée, chacun connaissait donc le débouché ouvert à sa population, et tandis que les uns y proportionnaient librement leur offre, les autres étaient contraints par les lois, les règlements, les coutumes ou la volonté de ceux dont ils dépendaient à titre de compagnons ou de serfs à l’y proportionner.
Mais, de nos jours, cet état de choses a disparu sans retour. Ce qui tend à s’établir partout et de plus en plus, c’est le régime de la communauté illimitée des marchés. Non seulement, dans chaque pays, les clôtures qui séparaient les différents emplois et les différentes industries ont été rompues, l’agriculteur peut placer ses enfants dans l’industrie, dans le commerce et dans les professions libérales, l’industriel, le commerçant, etc., peuvent placer les leurs dans l’agriculture; mais encore les clôtures qui séparent les différents pays, tant pour les hommes que pour les choses, s’abaissent et tendent à disparaître, à la fois par le progrès inouï des voies de communication et par la suppression graduelle des entraves du régime prohibitif. Qu’en résulte-t-il? C’est qu’à une multitude de marchés de population partiels et clos, partant faciles à connaître et à approvisionner régulièrement, se substitue de plus en plus un marché général et ouvert, dont la situation paraît au premier abord impossible à apprécier. Ce marché n’est point sans doute accessible à tous dans toutes ses parties: des différences de mœurs, de langues, de climats viennent encore faire obstacle à son universalisation; mais cet obstacle n’est point infranchissable. Des millions d’Européens, par exemple, se sont répandus depuis cinquante [I-407] ans dans les autres parties du globe pour y offrir leurs services; un plus grand nombre d’autres y ont trouvé un débouché croissant pour leurs produits, ce qui a agrandi d’autant le marché de leur population en Europe même. Des millions d’Asiatiques et d’Africains ont, de même, été transportés, soit de gré, soit de force, dans d’autres régions du globe, devenues ainsi des annexes aux marchés primitifs de leur population. Que cette pénétrabilité réciproque et cette communalisation progressive des marchés de population soient essentiellement bienfaisantes, il est superflu de le démontrer. D’ailleurs, c’est en vain que le nationalisme, le nativisme, le prohibitionnisme et les autres utopies rétrogrades de l’esprit de routine voudraient y faire obstacle, la force irrésistible des choses nous y pousse. A moins de supprimer toutes les grandes inventions qui, depuis un siècle surtout, sont en train de changer la face du monde, la machine à vapeur, les machines à filer et à tisser, le matériel perfectionné de l’agriculture, la locomotive, le bateau à vapeur, le télégraphe électrique, etc., etc., on n’en peut plus revenir au régime des marchés séparés. Il faut accepter, pour la population comme pour toutes choses, le régime du marché général.
Cependant, il ne faut pas se le dissimuler, le problème de l’équilibre de l’offre et de la demande de la population, sur l’axe du prix naturel, est plus difficile à résoudre dans ce nouvel état économique de la société qu’il ne l’était dans l’ancien. Car, pour nous en tenir au premier terme de ce problème, la demande sur un marché général et ouvert à tous n’est-elle pas moins facile à connaître qu’elle ne l’était sur les marchés limités et fermés de l’ancien régime? Est-ce à dire toutefois qu’elle ne puisse l’être au moins d’une manière approximative et suffisante? Non, sans doute, et ce qui se passe à cet égard pour [I-408] les autres marchés est de nature à nous rassurer. Il y a quarante ans, M. de Sismondi considérait comme impossible l’établissement d’un équilibre de la production et de la consommation des produits de l’industrie sous un régime de concurrence universelle. Il était convaincu que, sous ce régime, un désordre inévitable et funeste régnerait incessamment dans l’arène agrandie de la production; que tantôt on produirait trop, et tantôt trop peu. L’expérience a pu nous éclairer déjà sur la vanité de ces craintes. A mesure que les débouchés se sont élargis, soit pour les produits agricoles, soit pour les produits industriels, nous avons vu s’accroître aussi les moyens d’arriver à la connaissance du marché, et de proportionner de plus en plus exactement la production à la consommation. Or, pourquoi ce qui a lieu pour les produits n’aurait-il pas lieu aussi pour les hommes? Si le marché ouvert à la population s’est étendu et s’il s’étend chaque jour davantage, pourquoi les moyens de le connaître ne s’accroîtraient-ils pas en proportion?
La connaissance de toute espèce de marchés est un besoin. Or, ne savons-nous pas qu’aussitôt qu’un besoin existe et à mesure qu’il devient plus général et plus intense, à mesure, en conséquence, qu’on en demande davantage la satisfaction, et qu’on est disposé à la mieux payer, une offre se crée et se développe pour le satisfaire, jusqu’à ce qu’il obtienne un apaisement régulier, en payant pour être apaisé le prix nécessaire, ni plus ni moins. Du moment donc où la connaissance du marché agrandi de la population deviendra un besoin assez général et assez intense pour provoquer la naissance et le développement d’une industrie spéciale qui y pourvoie, cette industrie naîtra et se développera dans la proportion requise.
[I-409]
En résumé, le débouché ouvert à la population n’est pas illimité, il est déterminé par le nombre des emplois à remplir dans l’ensemble des entreprises de production. Ces emplois constituent le marché de la population. L’état de ce marché ou la demande de la population est plus facile à connaître sous un régime de marché restreint et fermé que sous un régime de marché général et ouvert, mais dans le dernier cas comme dans le premier, on peut arriver à le connaître, et, par conséquent, à proportionner utilement, sans perturbations, sans crises, l’offre de la population à la demande.
II. L’offre. Si la demande de la population dépend de l’étendue du marché qui lui est ouvert, l’offre dépend, comme nous l’avons vu, de la quantité des agents reproductifs qu’une population peut et veut consacrer à son renouvellement. Ces agents existent, l’un, en quantité ordinairement surabondante, les deux autres, le travail et surtout le capital, en quantité limitée. Il s’agit, en définitive, de savoir sous l’influence de quels mobiles une population applique à son renouvellement les agents reproductifs dont elle dispose, et comment il se fait que l’offre de la population reproduite, tende incessamment, comme lorsqu’il s’agit de tout autre produit, à s’équilibrer avec la demande au niveau du prix naturel.
Si la production des hommes était une industrie ordinaire, la solution de ces questions ne présenterait aucune difficulté: il est évident, en effet, qu’en admettant que l’état du marché fῦt bien connu, et qu’il y eῦt entre les entrepreneurs de population concurrence libre, ils proportionneraient toujours aussi exactement que possible, sauf l’action des causes perturbatrices, l’offre à la demande. En ce cas, la production des hommes ne différerait en rien de celle de bêtes de somme, des [I-410] machines, etc. Le travail et le capital d’entreprises y afflueraient ou s’en détourneraient selon qu’elle serait plus ou moins avantageuse que les autres branches de la production; d’où il résulterait que l’offre de la population reproduite tendrait perpétuellement à se mettre en équilibre avec la demande, au niveau du prix naturel, c’est à dire des frais de production augmentés d’une part de produit net proportionnelle à celle que l’on retirerait en appliquant le travail et le capital d’entreprises à d’autres branches de la production. C’est ainsi que les choses se passent lorsqu’il s’agit de la reproduction des travailleurs esclaves. Aux États-Unis, par exemple, où cette branche de l’activité humaine a subi comme les autres l’influence de la division du travail, où l’élève des esclaves est une industrie spéciale comme ailleurs celle de certaines variétés de bétail [46] elle suit exactement dans son développement le mouvement de la demande. Les esclaves servant principalement de machines à l’usage de la production cotonnière, à mesure que la demande du coton s’est accrue en Europe, et que la production s’en est développée en Amérique, la demande des machines humaines nécessaires pour le produire s’est accrue dans la même proportion. Les prix des esclaves ont haussé, les profits de l’élève se sont augmentés de manière à attirer des quantités supplémentaires de travail et de capital d’entreprises, et l’accroissement graduel de l’offre a suivi ainsi celui de la demande. Que la demande vienne à diminuer sous l’influence de la concurrence du coton des autres provenances ou par toute autre cause, les prix des esclaves baisseront, les profits de l’élève diminueront [I-411] et les capitaux se retireront ou se détourneront de cette branche d’industrie pour se porter vers d’autres branches plus avantageuses. Alors la production des esclaves diminuera, jusqu’à ce que l’offre se soit remise en équilibre avec la demande au niveau du prix naturel ou nécessaire.
Mais, tandis que le mobile qui pousse les éleveurs d’esclaves à investir leur travail et leur capital d’entreprises dans la production des hommes réside uniquement dans le profit que procure cette branche particulière d’industrie, le mobile qui pousse les hommes libres à mettre au monde, à élever et à former des êtres libres comme eux, en consacrant à cette destination une portion de travail et de capital dont ils ne retirent aucun profit industriel, ce mobile est d’une nature fort différente: il consiste dans le penchant physique de la reproduction allié au sentiment moral de l’amour de la famille. Cet instinct et ce sentiment ont une énergie telle qu’ils suppléent, chez les populations libres, au mobile intéressé qui détermine la reproduction des populations esclaves. Ils n’existent point toutefois et surtout ils ne s’associent point au même degré chez tous les hommes et au sein de toutes les races. Ils ne sont pas toujours non plus soumis à un self-government suffisamment capable de les diriger et de les contenir. Pour qu’ils agissent aussi sῦrement et aussi régulièrement pour déterminer la reproduction utile de la population libre, que le mobile industriel auquel obéit l’éleveur d’esclaves agit pour déterminer la reproduction utile de la population asservie, que faudrait-il? Il faudrait que l’homme qui appelle à la vie un supplément de créatures humaines envisageât, avec maturité, les conséquences de cet acte: c’est à dire qu’il se rendît compte d’abord de la situation du marché de la population; qu’il calculât ensuite la quantité [I-412] de travail et de capital que sa situation et ses ressources lui permettront d’appliquer à l’élève et à l’éducation de ses enfants; et qu’il ne contractât point comme père de famille plus d’obligations naturelles qu’il n’est capable d’en remplir, absolument comme s’il s’agissait d’obligations commerciales. En d’autres termes, il faudrait que l’homme qui se dispose à fonder une famille se mît à la place de ses enfants à naître et qu’il agît dans leur intérêt comme il le ferait dans le sien propre: en conséquence qu’il ne les appelât à la vie qu’autant qu’il serait en mesure de les pourvoir de toutes les forces et de toutes les aptitudes physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour en faire des hommes utiles, comme aussi de les placer dans un milieu où ces forces et ces aptitudes pourraient trouver un débouché.
Mais avons-nous besoin d’ajouter que ce self-government de la population demeure ordinairement fort imparfait; que bien peu d’hommes ont la notion claire de la nature et de l’étendue des obligations naturelles qu’ils contractent envers les êtres qu’ils appellent à l’existence; que les plus honnêtes établissent toujours à cet égard une distinction immorale et nuisible entre leurs enfants légitimes et leurs enfants naturels; et qu’alors même qu’ils connaissentles obligations que la paternité impose, ils n’ont pas toujours la force morale nécessaire pour les remplir avec une exactitude égale à celle dont ils font preuve, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’obligations au non acquittement desquelles est attachée une répression pénale. Examinons, pour nous en convaincre, comment est pratiqué dans les différentes classes de la société, le self-government en matière de population.
Dans la classe supérieure, l’intervention de la prévoyance en matière de population se manifeste d’une manière sensible. [I-413] Avant de céder au penchant qui pousse les créatures humaines à fonder une famille, l’homme de la classe supérieure calcule, et, en tous cas, ses parents calculent pour lui. On ne se marie gère dans cette classe avant d’avoir réuni un capital ou de s’être assuré une position qui suffise pour subvenir, en premier lieu, aux besoins de l’association conjugale, en second lieu, à l’élève, à l’éducation et à l’avenir des enfants. Sous ce double rapport même, on exagère trop souvent la prévoyance. La constitution du capital de l’association conjugale est la préoccupation dominante, la sympathie naturelle des futurs associés ne vient qu’après; d’où résulte l’affaiblissement de la race sous l’influence d’une mauvaise sélection, etc. Ensuite, ce capital constitué, les unions sont rendues trop souvent, en partie, artificiellement stériles, soit que les époux ne veulent point s’imposer le labeur qu’exigent l’élève et la direction d’une famille nombreuse, et la dépense considérable qu’elle implique dans une classe où l’orgueil et l’ostentation sont les principaux mobiles de la conduite de l’homme, soit que les préjugés de noblesse ou de fortune poussent les parents à vouloir maintenir, quand même, leurs enfants dans une condition sociale supérieure.
Dans les classes moyennes, la prévoyance agit, en général, d’une manière plus rationnelle ; on y a mieux égard aux sympathies naturelles nécessaires au maintien et au progrès de la race, sans oublier cependant les conditions requises pour mettre les futurs associés en état de remplir les obligations auxquelles ils auront à pourvoir. Ces conditions étant suffisamment remplies, l’accroissement des familles agit comme un stimulant qui pousse les pères à augmenter leurs ressources en proportion de leurs charges. C’est donc, communément, dans [I-414] les classes moyennes, que le self-government en matière de population est le mieux compris et le plus judicieusement exercé. Qu’en résulte-t-il? C’est que les familles des classes moyennes (au moins dans les pays où elles n’ont pas, en acquérant la prépondérance politique, contracté les vices de la classe supérieure) deviennent de plus en plus fortes et nombreuses, tandis que les familles de la classe supérieure s’éteignent par l’excès de la prévoyance, et que celles de la classe inférieure se dégradent et s’affaiblissent par l’excès de l’imprévoyance.
Dans cette dernière classe, le self-government en matière de population est, naturellement, beaucoup plus imparfait que dans les autres. L’homme du peuple n’a généralement aucune notion de l’étendue du débouché qui est ouvert à sa population; il ne se rend pas compte davantage des quantités de travail et de capital qu’il devra appliquer à l’élève et à l’éducation de ses enfants pour en faire des hommes. Il n’a enfin qu’une notion extrêmement confuse de ses obligations naturelles envers eux. Il s’unit hâtivement à un être aussi dépourvu de ressources qu’il l’est lui-même, et il n’impose aucune limite à son pouvoir de reproduction. Les familles des classes inférieures sont donc communément nombreuses: mais une partie des enfants meurent avant l’âge faute des soins et d’un entretien suffisants, les autres sont appliqués hâtivement à un travail qui ruine leurs forces physiques, intellectuelles et morales. Tandis que, dans la classe supérieure, on emploie un capital surabondant à la formation d’un trop petit nombre d’hommes, dans la classe inférieure on emploie un capital insuffisant à la formation d’un trop grand nombre. Les secours que la charité publique ou privée accorde de préférence aux familles nombreuses et, progressivement, en raison de leur nombre, encouragent encore [I-415] cette imprévoyance endémique des classes inférieures, comme, en général, toutes les mesures qui ont pour effet de diminuer le poids des obligations naturelles des pères de famille envers les êtres auxquels ils donnent le jour.
Mais, si imparfait que soit le self-government en cette matière, l’offre de la population, qu’il s’agisse d’hommes libres ou d’esclaves, n’en a pas moins une tendance irrésistible à se mettre en équilibre avec la demande, au niveau du prix naturel ou nécessaire: c’est à dire à un niveau tel que la génération nouvelle puisse non seulement subvenir à son entretien, mais encore reconstituer le capital employé à sa formation pour l’appliquer, à son tour, à la formation de la génération suivante. Car, à mesure que l’offre de la population dépasse la demande ou tombe au dessous, elle est ramenée vers ce centre d’équilibre par une impulsion qui agit en raison geométrique, pendant que l’écart se produit seulement en raison arithmétique. Ainsi, un excédant ou un déficit de population qui se produit comme 1, 2, 3, 4, etc., engendre une baisse ou une hausse de la valeur de cette population, qui se produit comme 1, 2, 4, 8, 16. Quand il s’agit d’une population asservie, cette hausse ou cette baisse se manifeste dans le prix de vente ou de loyer des esclaves; quand il s’agit d’une population libre, elle se manifeste dans le taux des salaires. Mais, dans l’un et dans l’autre cas, l’équilibre tend irrésistiblement à s’établir entre l’offre et la demande de la population au niveau du prix naturel ou nécessaire.
Trois cas peuvent se présenter, soit qu’il s’agisse de la production des choses nécessaires à l’homme ou de la production de l’homme même: ou cet équilibre existe, ou l’offre de la population dépasse la demande, ou la demande dépasse l’offre.
Examinons ce qui arrive dans ces deux derniers cas.
[I-416]
Lorsque l’offre dépasse la demande, c’est à dire lorsque la génération précédente a mis au service de la production un personnel surabondant, les salaires baissent, tandis, au contraire, que les profits des capitaux mobiliers et immobiliers s’élèvent, chose aisée à expliquer, puisque le matériel de la production est rare, tandis que le personnel abonde. Cela étant, quel est l’effet de cet abaissement de la rémunération du personnel d’une part, de cette augmentation de la rémunération du matériel de l’autre? C’est que la génération existante est plus intéressée à employer ses capitaux à l’accroissement du matériel qu’à celui du personnel de la production ; c’est que le fonds consacré au renouvellement de la population tend à diminuer, tandis que le fonds consacré au renouvellement des capitaux mobiliers et immobiliers tend à s’augmenter. Cette double tendance se manifeste avec d’autant plus d’intensité que l’excédant de population est plus considérable. S’il devenait tel que la rémunération du personnel de la production ne comprît plus qu’une partie de la somme strictement nécessaire à son renouvellement, l’excédant ne tarderait pas à disparaître, à moins que la société n’affectât un fonds spécial à sa reproduction et à son entretien. Dans ce cas, ces frais de reproduction et d’entretien seraient seulement avancés par les classes capitalistes: ils seraient, en dernière analyse, prélevés sur la rémunération du personnel, dont les salaires se trouveraient déprimés par la présence de cet excédant de population. Que s’il venait à s’accroître encore, comme le fonds qui pourrait être appliqué à son entretien serait limité par le produit net de la production, un moment arriverait toujours où le surplus devrait périr. Sur quoi, en effet, les frais d’entretien de ce surplus seraient-ils prélevés? Sur la rémunération nécessaire des agents productifs? [I-417] Sur les aliments et les matériaux indispensables pour entretenir et renouveler les ouvriers, les outils, les machines, les bâtiments, etc., consacrés à la production? Non, évidemment. Car les agents productifs, personnel et matériel, qui façonnent la masse des produits destinés à l’alimentation et à l’entretien de la communauté, ces agents seraient alors entamés et la production diminuerait. Sur quoi donc la subsistance de l’excédant inutile peut-elle être prélevée? Uniquement sur le produit net.
Chaque nation peut disposer de son produit net comme bon lui semble. Elle peut l’employer à se procurer un supplément de jouissances actuelles; elle peut s’en servir pour constituer un supplément d’agents productifs, — travailleurs, outils, machines, matières premières, agents naturels appropriés, — en vue d’augmenter sa production, partant ses jouissances futures; elle peut encore le jeter dans le gouffre des révolutions et des guerres, ou l’employer à nourrir dans l’abjection et la souffrance un excédant de population.
Les nations européennes nourrissent, pour la plupart, un excédant de population ; mais elles ne consacrent à cet usage qu’une portion probablement assez faible de leur produit net. La preuve en est qu’elles croissent en richesse, ce qui n’aurait point lieu si tout le montant de leur produit net se trouvait absorbé par l’entretien d’un excédant de population. Selon toute apparence, la portion de produit net qui est consacrée à cette destination ne dépasse jamais celle qui est attachée à la part du travail, d’où il résulte que c’est toujours uniquement sur la classe ouvrière que retombe le fardeau de l’entretien d’une population surabondante.
En tous cas, lorsqu’une population se reproduit avec excès, [I-418] son accroissement, à mesure qu’il a lieu en raison arithmétique, engendrant d’une part une baisse de la rémunération du personnel de la production, d’une autre part, une hausse de la rémunération du matériel, qui se développent l’une et l’autre en raison géométrique, il en résulte une tendance des plus énergiques pour rétablir l’équilibre de l’offre et de la demande de la population au niveau du prix naturel ou nécessaire.
L’effet contraire se produit lorsque la demande vient à dépasser l’offre. Dans ce cas, la rémunération du personnel de la production s’élève, tandis que celle du matériel (capitaux mobiliers et immobiliers) s’abaisse. Il devient alors profitable d’appliquer au renouvellement du personnel une portion du capital qui était consacrée à celui du matériel. Cette opération est d’autant plus avantageuse que le déficit du personnel est plus considérable, et elle se pratique jusqu’à ce que l’équilibre de l’offre et de la demande de la population se trouve rétabli au niveau du prix naturel ou nécessaire.
L’équilibre de la population avec les emplois qui lui fournissent ses moyens d’existence et de reproduction s’établit, comme on voit, par l’action de la même loi qui détermine l’équilibre de la production et de la consommation, c’est à dire par l’action de la loi des quantités et des prix.
[I-419]
SEIZIÈME LEÇON↩
thÉorie de la population (suite)
Causes perturbatrices de la loi de la population. — Des institutions et des lois qui suppléent à l’insuffisance du self-government de l’homme en matière de reproduction. — De l’esclavage et de son action utile sur la multiplication des races inférieures. — Du servage. — Des lois qui restreignent la liberté de la reproduction, et, en particulier, de celles qui empêchent les mariages hâtifs. — La liberté de la reproduction doit-elle être laissée entière? — Maux du régime actuel. — Nécessité d’une législation et d’une opinion publique suffisamment répressives des nuisances causées par l’abus de la liberté de la reproduction. — Théorie de Malthus. — Exposé et examen critique de cette théorie. — En quoi elle est erronée. — Qu’il n’est pas vrai que la population ait une tendance organique et virtuelle à dépasser ses moyens d’existence. — Qu’elle tend, au contraire, toujours, irrésistiblement, à s’y proportionner. — Autre erreur de Malthus. — Que la population ne tend à se multiplier en raison géométrique qu’autant que ses moyens d’existence se multiplient dans la même proportion. — De l’influence perturbatrice de l’incontinence sur le mouvement de la population. — Qu’elle a toujours pour résultat de diminuer le nombre des hommes et non de l’accroitre. — Comment elle peut être combattue. — Que le vice et le malheur aggravent les maux qu’elle cause. — Que la contrainte morale seule peut lui être opposée d’une manière efficace et utile. — Que la [I-420] contrainte morale sainement appliquée a pour résultat de permettre à la population de recevoir son maximum de développement. — De l’application de la contrainte morale, — sous l’ancien régime, sous le régime actuel. — Que la contrainte libre doit se substituer à la contrainte imposée. — Réfutation de diverses objections relatives à l’exercice de la contrainte morale et à l’application d’une législation répressive des abus de la liberté de la reproduction. — Que la contrainte morale n’est contraire ni à la morale ni à la religion.
Nous avons constaté que la même loi d’équilibre qui gouverne la production de toutes choses gouverne aussi celle de l’homme; qu’en vertu de cette loi, l’offre des générations nouvelles tend incessamment à se mettre en équilibre avec la demande, au niveau des frais de production, augmentés des profits ordinaires, c’est à dire à un niveau tel que la nouvelle génération mise au marché de la population puisse non seulement couvrir ses frais d’existence, mais encore reconstituer le capital employé à sa formation, pour l’appliquer à celle de la génération suivante, dans la proportion requise. Est-ce à dire cependant que le jeu de cette loi régulatrice ne puisse être troublé et qu’aucune part ne soit laissée, en cette matière, à l’action de la liberté humaine? Non, sans doute.
S’il ne dépend pas de l’homme d’augmenter au delà de certaines limites sa population; si, lorsqu’elle demeure insuffisante, il est irrésistiblement poussé à l’accroître, il n’en peut pas moins exercer une influence considérable sur le nombre, la composition et par conséquent sur les destinées des générations qui doivent succéder à la sienne, et cette influence qu’il exerce sur la condition des générations futures réagit, en bien ou en mal, selon qu’elle est bonne ou mauvaise, sur la sienne propre.
S’il ne tient point compte de l’état du débouché qui est [I-421] ouvert à sa population, s’il obéit aveuglément à l’instinct physique et même aux sentiments moraux qui le poussent à se multiplier au delà du nécessaire; s’il applique à sa reproduction une portion trop considérable de sa force reproductive, de son travail et de ses capitaux; s’il produit en conséquence une génération trop nombreuse eu égard au débouché dont elle dispose, il en résulte, comme nous l’avons démontré, une baisse désastreuse de la rémunération du personnel de la production, la misère et la dégradation des masses, et finalement la destruction, soit rapide, soit lente, de l’excédant. Ou bien encore, en admettant que cet excédant soit entretenu oisif sur la part de produit net qui serait revenue à la classe des travailleurs dans l’hypothèse d’une population normale, il en résulte une consommation improductive des capitaux ainsi absorbés par l’entretien d’une population inutile. Dans cette hypothèse, la production ne peut se développer autant qu’elle le ferait si l’entretien de l’excédant de population ne prélevait point une dîme sur les capitaux en voie de formation, et par conséquent elle ne peut offrir un aussi grand nombre d’emplois à la population future. De même, — et ce cas est plus fréquent encore, — lorsque la force reproductive, le travail et le capital ne sont point convenablement et dans la proportion requise appliqués au renouvellement de la population, lorsque la force reproductive est employée, par exemple, sans l’auxiliaire d’une quantité suffisante de travail et de capital, les générations nouvelles contiennent un grand nombre de non valeurs ou de demi-valeurs, c’est à dire d’individus, ou qui périssent hâtivement, sans avoir couvert leurs frais d’existence et reconstitué le capital employé à les former, ou qui demeurent jusqu’à la vieillesse, entièrement ou en partie, à la charge de leurs semblables: dans ce cas encore, [I-422] disons-nous, une partie du capital de la société étant absorbée par l’entretien de ces non valeurs ou de ces demi-valeurs, la production ne peut s’augmenter, les emplois disponibles se multiplier et la population croître autant que si le renouvellement de la génération existante s’opérait d’une manière saine et utile.
Enfin, si l’homme, cédant non à l’imprévoyance, mais à des penchants égoïstes et dépravés, se refuse à fonder une famille et à remplir les obligations de la paternité, afin de réserver ses ressources à la satisfaction de ses besoins personnels, si les femmes redoutent les labeurs de la maternité et s’y soustraient, s’il en résulte, en conséquence, un renouvellement insuffisant de la population, qu’arrive-t-il? C’est qu’une partie des capitaux mobiliers et immobiliers constituant le matériel de la production deviennent inactifs et, finalement, se détruisent faute d’un personnel assez nombreux pour les mettre en œuvre, et que la société s’appauvrit d’autant, à moins qu’elle ne réussisse à combler au moyen d’une immigration le déficit de sa population. Si l’immigration n’est point possible, et si les vices préventifs de la multiplication de l’espèce continuent à agir, en dépit de l’encouragement que la rareté des bras et des intelligences donne à la formation d’un personnel nombreux, la société tombera en décadence et elle finira par s’éteindre.
L’homme doit done agir pour se conformer à la loi qui gouverne la production de l’espèce humaine comme celle de toutes choses. De même que, industriel ou commerçant, il doit éviter de mettre au marché une quantité de produits qui dépasse la quantité demandée au niveau du prix rémunérateur, s’il ne veut s’exposer à des pertes et à une banqueroute, de même encore qu’il doit s’efforcer de produire toujours et de mettre au [I-423] marché des marchandises en qualité et en quantité suffisantes, s’il ne veut point s’exposer à être supplanté tôt ou tard par des concurrents plus intelligents et plus actifs, tandis que son stock de marchandises invendables ira grossissant, père de famille, il doit éviter, à la fois, d’encombrer le marché d’un personnel surabondant, et de n’y mettre qu’un personnel insuffisant en nombre ou en qualité, c’est à dire impropre à satisfaire à la demande. Dans le premier cas, il voue à la misère l’immense majorité de la génération qui succède à la sienne; dans le second, il prépare et rend inévitable la substitution à sa descendance affaiblie de races ou de classes concurrentes, dont la reproduction aura été mieux gouvernée.
Si nous nous rendons bien compte des conditions naturelles du renouvellement utile de la population, et des obstacles que l’ignorance et les penchants vicieux de l’immense majorité des hommes ont de tous temps opposés à leur accomplissement, nous ne nous étonnerons pas que cette espèce particulière d’industrie ait, de tous temps aussi, attiré l’attention des législateurs, et provoqué l’établissement d’une réglementation destinée soit à assurer la bonne formation de ses produits, par l’application de quantités suffisantes de travail et de capital, soit à en proportionner le nombre aux besoins du marché de la population. Cette réglementation, incarnée dans une multitude d’institutions, de lois, de coutumes, de prescriptions civiles ou religieuses dont le sens nous échappe trop souvent aujourd’hui, avait, en général, sa raison d’être, quoiqu’elle ne fῦt toujours ni pleinement intelligente ni pleinement efficace. Elle constituait une mise en tutelle des individus incapables de gouverner eux-mêmes utilement leur reproduction ou considérés comme tels. Cette tutelle, tantôt supprimait complétement la [I-424] liberté d’initiative de l’individu en matière de reproduction, tantôt se bornait à la restreindre, en lui imposant des règles dont l’expérience avait démontré l’utilité, soit pour la conclusion des associations nécessaires à la formation des familles, soit pour la consécration des obligations des associés, etc., etc. Il nous faudrait des volumes pour esquisser l’histoire de ce gouvernement de la reproduction de l’espèce humaine [47] Bornonsnous à quelques indications essentielles.
On trouve, par exemple, dans les nécessités du gouvernement de la reproduction de l’espèce humaine, la principale raison d’être de l’esclavage. Moins l’homme se différencie des espèces animales inférieures, et moins il est capable d’accumuler et de bien appliquer le capital nécessaire à sa reproduction. Quand donc les races inférieures demeurent abandonnées à elles-mêmes, quand des hommes appartenant à des races plus intelligentes ou parvenues à un degré plus élevé de civilisation, ne se chargent point de les gouverner, qu’arrive-t-il? C’est que les races inférieures ne maîtrisent pas plus que ne le font les animaux eux-mêmes le penchant qui les pousse à se multiplier; mais, comme elles ne possèdent point les ressources nécessaires pour élever tous les êtres auxquels elles donnent le jour, ou elles les laissent périr ou elles les détruisent par l’avortement, l’infanticide et d’autres pratiques odieuses [48] . Dans cet état de [I-425] choses, l’esclavage est un progrès, non seulement en ce qu’il améliore la condition des enfants et des femmes, mais encore en ce qu’il permet aux races asservies de se multiplier davantage, en augmentant les ressources nécessaires d’abord pour renouveler et accroître leur population, ensuite pour l’utiliser. L’éleveur d’esclaves ne tolère ni l’avortement ni l’infanticide, il s’abstient même d’assujettir les enfants à un labeur hâtif et meurtrier (non point, il est vrai, sous l’impulsion de sentiments particuliers de moralité et d’humanité, mais simplement pour empêcher la détérioration de son personnel, comme fait l’éleveur de bétail). Il n’autorise la reproduction de ses esclaves que dans la proportion utile, et il veille à ce qu’elle s’opère dans de bonnes conditions; enfin, il applique à la formation de ses “produits” le capital nécessaire pour leur donner la plus grande valeur possible. L’esclave ne gouverne donc, en aucune manière, sa reproduction. Son maître se charge de la gouverner pour lui.
Lorsque le servage succède à l’esclavage, le gouvernement de la reproduction de la classe asservie se partage entre le serf et le seigneur. Celui-ci n’autorise les mariages qu’autant qu’il le juge utile; mais, cette autorisation accordée, le serf en use comme bon lui semble, et il forme à sa guise la génération qui doit remplacer la sienne. Enfin lorsque le servage disparait, lorsque l’homme des classes inférieures est affranchi de la tutelle du seigneur, il acquiert, du même coup, la liberté de gouverner sa reproduction à ses risques et périls. Cependant cette liberté n’est point partout entière: dans beaucoup de pays, la tutelle de l’autorité communale ou gouvernementale remplace à cet égard celle du seigneur. Témoin ce relevé des lois préventives [I-426] des mariages hâtifs et imprévoyants, que reproduit M. John Stuart Mill:
On ne sait pas généralement, dit M. Stuart Mill, dans combien de pays européens des obstacles légaux directs s’opposent aux mariages imprévoyants. Les communications faites à la première commission pour la loi des pauvres par nos consuls et ministres dans les divers pays de l’Europe fournissent des renseignements abondants sur cette matière. M. Senior, dans la préface dont il a fait précéder le recueil de ces renseignements, affirme que dans les pays où le droit à l’assistance est légalement reconnu, le mariage est interdit aux personnes qui reçoivent cette assistance, et qu’on laisse marier seulement un petit nombre de celles qui ne semblent pas posséder les moyens de vivre par elles-mêmes. Ainsi, on nous dit qu’en Norvége nul ne peut se marier s’il ne constate, au jugement du prêtre, qu’il est établi de manière à faire penser que très probablement il aura le moyen d’élever sa famille.
Dans le Mecklembourg, les mariages sont retardés par la conscription jusqu’à la vingt-deuxième année et par le service militaire pendant six ans de plus; en outre, les futurs époux doivent avoir un domicile, faute de quoi le prêtre n’a pas le droit de les marier. Les hommes se marient de 25 à 30 ans, et les femmes presqu’au même âge, parce que les uns et les autres doivent gagner d’abord de quoi s’établir.
En Saxe, l’homme ne peut se marier avant 21 ans, s’il est propre au service militaire. A Dresde, les professionnistes (expression qui désigne sans doute les artisans) ne peuvent se marier qu’après être passés maîtres.
Dans le Wurtemberg, l’homme assujetti au service militaire ne peut se marier avant 25 ans que par une permission spéciale obtenue ou achetée: à cet âge même il est tenu de se procurer une permission qu’il obtient en prouvant que lui et sa future possèdent ensemble de quoi s’établir et élever une famille. Dans les grandes villes, il faut posséder de 800 à 1,000 florins; dans les petites, de 400 à 500 florins, et 200 florins dans les villages.
[I-427]
Le ministre d’Angleterre à Munich dit: “La grande cause qui maintient à un chiffre si bas le nombre des pauvres en ce pays est la loi qui empêche les mariages, dans le cas où il est prouvé que les futurs n’ont pas des moyens suffisants d’existence; cette loi est observée strictement dans toutes les localités et en tout temps. L’observation constante de cette règle a eu pour effet d’empêcher l’accroissement de la population de la Bavière, population qui, en effet, est peu nombreuse par rapport à l’étendue du territoire, mais elle a eu pour effet heureux d’éloigner l’extrême pauvreté et, par suite, le paupérisme.”
A Lubeck, les mariages entre pauvres sont retardés, premièrement par l’obligation imposée à l’homme de prouver qu’il a un emploi, un métier ou une profession régulière qui le met en état de soutenir un ménage; secondement, par l’obligation où il est de se faire recevoir bourgeois et d’acquérir l’uniforme de la garde bourgeoise qui coῦte environ 4 liv. A Francfort, le gouvernement ne fixe point d’âge avant lequel on ne puisse se marier, mais on n’accorde la permission de se marier qu’à celui qui prouve qu’il a de quoi vivre.
Lorsque ces documents parlent des devoirs militaires, ils indiquent un obstacle indirect opposé aux mariages par les lois particulières de certains pays où l’on n’a point établi de restrictions directes. En Prusse, par exemple, les lois qui obligent tout homme qui n’est pas physiquement impropre au service militaire à passer plusieurs années dans les rangs de l’armée à l’âge où les mariages imprudents sont le plus souvent contractés, exercent probablement sur le mouvement de la population la même influence que les restrictions légales des petits États de l’Allemagne.
Les Suisses, dit M. Ray, savent si bien par expérience qu’il est convenable de retarder l’époque du mariage de leurs fils et de leurs filles, que les conseils de gouvernement des quatre ou cinq cantons les plus démocratiques, élus, il ne faut pas l’oublier, par le suffrage universel, ont fait des lois par lesquelles tous les jeunes gens qui se marient sans avoir prouvé au magistrat du district qu’ils sont en état d’entretenir [I-428] une famille sont passibles d’une grave amende. A Lucerne, à Argovie, dans l’Unterwald, et, je crois, à Saint-Gall, Schwytz et Uri, des lois semblables sont en vigueur depuis longues années [49]
Un bon nombre d’institutions ou de coutumes contribuent, de même, directement ou indirectement, à restreindre dans les pays où l’esclavage et le servage ont cessé d’exister, la liberté de la reproduction. En général, on peut opposer à la réglementation ou aux institutions préventives du renouvellement libre de la population, les mêmes arguments que l’on dirige contre le régime préventif dans ses applications aux autres branches de l’industrie humaine. Cependant, peut-on affirmer qu’il existe parmi les hommes de toutes les classes de la société une capacité suffisante pour pratiquer utilement le self-government en cette matière? L’expérience qui s’est faite à cet égard dans les pays où les obstacles préventifs de la multiplication de l’espèce humaine ont disparu n’a pas été, il faut le dire, des plus satisfaisantes. Les classes inférieures surtout se sont montrées fort peu propres à gouverner utilement leur reproduction. En cette matière plus qu’en aucune autre, elles ont cru que la liberté signifiait absence de frein et de règle. Elles n’ont pas paru et elles ne paraissent pas encore se douter (qui donc, à la vérité, le leur aurait appris?) que ce frein et cette règle que le maître ou le seigneur ou finalement la loi leur imposaient naguère, elles doivent se les imposer à elles-mêmes, sous peine de tomber dans une condition pire que celle dont elles sont sorties. [I-429] Elles ne paraissent pas croire qu’en s’abandonnant sans prévoyance au penchant physique qui les pousse à se reproduire, elles travaillent à leur ruine absolument comme feraient les éleveurs d’esclaves, s’ils ne réglaient point la multiplication de leurs “produits,” conformément à l’état du marché. Que résulte-t-il de cette ignorance des conditions naturelles de la reproduction et de cette absence, trop générale aussi, d’une force morale suffisante pour les observer? C’est que les classes inférieures gouvernent fort mal leur reproduction ; c’est que, d’une part, elles se multiplient sans s’enquérir de l’état du débouché ouvert à leur population, d’une autre part, sans s’assurer préalablement les quantités de travail et de capital nécessaires à la formation de la génération nouvelle. Le plus souvent, ces quantités de travail et de capital sont insuffisantes: aussi plus de la moitié des enfants des classes inférieures meurent-ils avant l’âge, et les survivants sont-ils appliqués à un travail hâtif et meurtrier qui dévore en germe leurs forces physiques et leurs facultés intellectuelles. La race dégénère ainsi et s’affaiblit de plus en plus. Il y a apparence même que si cet état de choses ne se modifiait point, les classes inférieures proprement dites disparaîtraient à la longue, devant la concurrence des classes moyennes qui gouvernent mieux leur reproduction, comme s’éteignent les peuples sauvages abandonnés au gouvernement d’eux-mêmes, en présence de la concurrence des peuples civilisés. Que faire donc? Faudrait-il en revenir à l’esclavage, au servage ou, tout au moins, au régime des lois préventives en matière de population? Non, sans doute. Mais il faudrait, d’un côté, — et la chose est plus urgente qu’on ne suppose, — réformer le régime soi-disant protecteur des classes pauvres qui encourage artificiellement leur multiplication, en [I-430] affaiblissant le poids des obligations de la paternité; d’un autre côté, il faudrait compléter et renforcer la législation répressive des “nuisances” provenant de l’usage abusif de la liberté, en matière de reproduction. Cette législation repressive existe déjà à la vérité; mais elle présente de nombreuses lacunes, et elle n’est qu’imparfaitement appliquée. Elle punit l’avortement et l’infanticide; mais, dans la pratique, elle ne réprime point assez sῦrement ces crimes, qui affaiblissent l’espèce en la dépravant; elle impose aux parents l’obligation de nourrir et d’élever leurs enfants, mais elle ne spécifie point suffisamment les limites de cette obligation, et elle leur permet trop aisément de l’éluder ou de s’y soustraire. Complétée et fortifiée, la législation répressive agirait certainement, surtout si l’opinion publique lui venait en aide, pour réduire le nombre et la gravité des nuisances que cause aujourd’hui l’usage abusif de la liberté en matière de reproduction. Enfin, la tutelle volontaire ou pénale apparaîtrait comme une ressource dernière contre ceux-là qui se montreraient décidément incapables de porter le poids de la responsabilité attachée à l’exercice de cette branche de la liberté humaine [50] .
En résumé, si l’incapacité originaire de l’immense majorité des hommes à gouverner utilement leur reproduction a pu donner une raison d’être à des institutions et à des réglementations préventives, en matière de population, on peut aujourd’hui abandonner à la liberté le soin de la multiplication de [I-431] l’espèce humaine, mais avec l’auxiliaire d’une législation et d’une opinion publique suffisamment répressives des “nuisances” que peut engendrer en cette matière un mauvais self-government.
La théorie que nous venons d’exposer n’est qu’une application à la production de l’homme lui-même de la loi générale d’équilibre qui gouverne la production de toutes choses. Nous ne devons pas dissimuler qu’elle diffère par un point fondamental de la théorie de Malthus qui fait actuellement autorité dans la science. Il nous reste donc à montrer en quoi consiste cette différence et à la justifier.
Voici les deux propositions essentielles dans lesquelles se résume la théorie de Malthus:
“Première proposition. Nous pouvons tenir pour certain que, lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doublant tous les vingt-cinq ans, et croit de période en période suivant une progression géométrique.
Seconde proposition. Nous sommes en état de prononcer, en partant de l’état actuel de la terre habitée, que les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à l’industrie, ne peuvent jamais augmenter que selon une progression arithmétique.
La conséquence inévitable de ces deux lois d’accroissement comparées, ajoute Malthus, est assez frappante. Portons à onze millions la population de la Grande-Bretagne, et accordons que le produit actuel de son sol suffit pour maintenir une telle population. Au bout de vingtcinq ans, la population serait de vingt-deux millions; et la nourriture étant aussi doublée, suffirait encore à son entretien. Après une seconde période de vingt-cinq ans, la population serait portée à quarante-quatre millions et les moyens de subsistance n’en pourraient plus soutenir que trente-trois. Dans la période suivante, la population, arrivée à quatrevingt-huit [I-432] millions, ne trouverait des moyens de subsistance que pour la moitié de ce nombre. A la fin du premier siècle, la population serait de cent soixante-seize millions, et les moyens de subsistance ne pourraient suffire à plus de cinquante-cinq millions; en sorte qu’une population de cent vingt et un millions d’hommes serait réduite à mourir de faim.
Substituons à cette île qui nous a servi d’exemple, la surface entière de la terre; et d’abord on remarquera qu’il ne sera plus possible, pour éviter la famine, de recourir à l’émigration. Portons à mille millions le nombre des habitants actuels de la terre; la race humaine croîtrait comme les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; tandis que les subsistances croîtraient comme ceux-ci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de deux siècles, la population serait aux moyens de subsistance comme 256 est à 9; au bout de trois siècles, comme 4,096 est à 13, et après deux mille ans, la différence serait immense et comme incalculable.
On voit que, dans nos suppositions, nous n’avons assigné aucune limite aux produits de la terre. Nous les avons conçus comme susceptibles d’une augmentation indéfinie, comme pouvant surpasser toute grandeur qu’on voudrait assigner. Dans cette supposition même, le principe de population, de période en période, l’emporte tellement sur le principe productif des subsistances, que, pour maintenir le niveau, pour que la population existante trouve des aliments qui lui soient proportionnés, il faut qu’à chaque instant une loi supérieure fasse obstacle à ses progrès; que la dure nécessité la soumette à son empire; que celui, en un mot, de ces deux principes contraires, dont l’action est si prépondérante, soit contenu dans certaines limites.”
Cette loi supérieure se résume dans l’action d’obstacles, de nature diverse, qui se mettent en travers de la tendance de la population à dépasser ses moyens de subsistance, et qui ont pour effet de l’y proportionner.
“Ces obstacles à la population, qui agissent constamment, avec plus [I-433] ou moins de force, dans toutes les sociétés humaines, et qui y maintiennent le nombre des individus au niveau de leurs moyens de subsistance, peuvent être rangés sous deux chefs. Les uns agissent en prévenant l’accroissement de la population, et les autres en la détruisant à mesure qu’elle se forme. La somme des premiers compose ce qu’on peut appeler l’obstacle privatif; celle des seconds, l’obstacle destructif.
....Les obstacles privatifs et destructifs peuvent se réduire aux trois suivants: la contrainte morale, le vice et le malheur.
Parmi les obstacles privatifs, l’abstinence du mariage, jointe à la chasteté, est ce que j’appelle contrainte morale (moral restraint). J’emploie ici le mot moral dans un sens limité. J’entends par contrainte morale celle qu’un homme s’impose à l’égard du mariage par un motif de prudence, lorsque sa conduite pendant ce temps est strictement morale.
Le libertinage, les passions contraires aux vœux de la nature, la violation du lit nuptial, en y joignant tous les artifices employés pour cacher les suites des liaisons criminelles ou irrégulières, sont des obstacles privatifs qui appartiennent manifestement à la classe des vices.
Parmi les obstacles destructifs, ceux qui paraissent une suite inévitable des lois de la nature composent exclusivement cette classe que je désigne par le mot de malheur (misery). Ceux au contraire que nous faisons évidemment naître nous-mêmes, comme les guerres, les excès de tous genres et plusieurs autres maux inévitables, sont d’une nature mixte. C’est le vice qui les suscite, et ils amènent à leur suite le malheur.
La somme de tous les obstacles privatifs et destructifs forme ce que j’appelle l’obstacle immédiat à la population. Dans un pays où la population ne peut pas croître indéfiniment, l’obstacle privatif et l’obstacle destructif doivent être en raison inverse l’un de l’autre, c’est à dire que dans les pays malsains ou sujets à une grande mortalité, quelle qu’en soit d’ailleurs la cause, l’obstacle privatif aura peu d’influence. Dans ceux au contraire qui jouissent d’une grande salubrité et où l’obstacle [I-434] privatif agit avec force, l’obstacle destructif agira faiblement, et la mortalité sera très petite.
En tous pays, quelques-uns des obstacles que nous avons énumérés agissent avec plus ou moins de force, mais d’une manière constante, et malgré l’influence de cette action permanente, il y a très peu de pays où l’on n’observe pas un constant effort de la population pour croître an delà des moyens de subsistance. Cet effort, constant dans son action, tend non moins constamment à plonger dans la détresse les classes inférieures de la société, et s’oppose à toute espèce d’amélioration de leur état [51] .”
En définitive, Malthus affirme que “la population tend à s’accroître en raison géométrique, tandis que les subsistances ne peuvent s’augmenter qu’en raison arithmétique,” ou, pour nous servir d’une formule de son savant commentateur et abréviateur M. Joseph Garnier, que “la population a une tendance organique et virtuelle à s’accroître plus rapidement que les moyens d’existence [52] , “tendance que combattent incessamment les [I-435] obstacles privatifs et destructifs, mais qu’ils combattent rarement, remarque Malthus, avec une efficacité suffisante.
Il ressort, au contraire, de nos démonstrations que “la population a une tendance organique et virtuelle à se proportionner toujours à ses moyens d’existence, ou, ce qui revient au même, à son débouché. Car, à mesure qu’elle s’en écarte en raison arithmétique, soit en plus soit en moins, elle y est ramenée sous l’impulsion d’une force qui se développe en raison géométrique.” D’où il résulte que l’intervention des obstacles privatifs ou destructifs n’est point nécessaire pour proportionner la population à ses moyens d’existence ou à son débouché.
[I-436]
L’erreur de Malthus provient, comme nous allons nous en convaincre, d’une analyse insuffisante des éléments de la production de l’homme. Son attention s’est portée d’une manière trop exclusive sur l’un de ces éléments, savoir la force reproductive, et il a négligé les deux autres, savoir le travail et le capital, qui concourent avec elle à la formation d’une génération nouvelle. La force reproductive existant et devant exister en quantité surabondante, si elle suffisait seule pour former des hommes, la population tendrait incessamment et virtuellement à dépasser ses moyens d’existence. Mais il n’en est pas ainsi: la force reproductive ne peut former qu’un embryon, et il faut pour faire de cet embryon un homme utile, c’est à dire un homme capable de trouver un débouché, une quantité plus ou moins considérable de travail et de capital, selon que l’emploi auquel on le destine est plus ou moins relevé. Or la quantité de travail et de capital que l’on peut appliquer à la formation d’une génération nouvelle n’est point, comme celle de la force reproductive, naturellement surabondante ou illimitée; elle est, au contraire, naturellement rare ou limitée. Elle ne peut, en aucun cas, dépasser une certaine portion de la quantité totale, — naturellement limitée aussi, — du travail et du capital dont la société dispose. En effet, la plus grande partie de ce travail et de ce capital est nécessairement absorbée par l’entretien de la génération existante, et c’est l’excédant seulement qui peut être appliqué à la formation d’une génération nouvelle.
Cela étant, peut-on dire qu’il existe au sein de la population une tendance organique et virtuelle à consacrer à la formation d’une génération nouvelle, non seulement au delà de la proportion utile de la force reproductive mais encore au delà de la proportion utile du travail et du capital, qui sont aussi indispensables [I-437] à cette œuvre que la force reproductive elle-méme? Sans doute, l’espèce humaine est affligée du vice de l’incontinence, comme elle est sujette à l’ivrognerie, à la gourmandise, à l’orgueil, à la paresse, à la prodigalité et à l’avarice. Mais ce vice, débordement ou déviation maladive d’un penchant nécessaire, a-t-il et peut-il avoir le pouvoir de déterminer ceux qui en sont atteints à mettre au service de la reproduction, les quantités de travail et de capital requises pour produire autant d’hommes qu’il les pousse à former d’embryons? Non, à coup sῦr. D’abord, le plus souvent, ceux qui s’abandonnent à leur incontinence ne disposent ni du travail ni du capital nécessaires pour former autant d’hommes qu’ils risquent d’en mettre au monde. Ensuite, alors même qu’ils possèdent ce travail et ce capital, ils sont généralement peu disposés à les détourner des emplois auxquels ils les affectent pour les appliquer à cette destination, et ils le sont d’autant moins que l’homme coῦte plus cher à former. Admettons toutefois, par hypothèse, que l’incontinence ait le pouvoir de déterminer une génération à appliquer à sa reproduction non seulement une quantité excessive de force reproductive, mais encore une quantité excessive de travail et de capital, et qu’elle mette, en conséquence, sur le marché de la population, une nouvelle génération surabondante. Qu’en résultera-t-il? C’est que l’excédant pèsera sur la rémunération du personnel nouveau, de manière à diminuer la portion de cette rémunération, applicable au renouvellement de la population. A quoi il faut ajouter que le capital en voie de formation sera énergiquement sollicité par l’appât de la rente, qui, dans cette situation, s’attachera aux capitaux immobiliers, à augmenter le matériel plutôt que le personnel de la production. Le capital reproductif diminuant sous cette double influence, [I-438] la reproduction devra inévitablement se ralentir. Sans doute, ce ralentissement peut être arrêté temporairement si l’on alloue un fonds spécial comme celui de la taxe des pauvres, par exemple, à la reproduction de la classe inférieure, ou ne se produire que d’une manière insensible si, comme en Irlande, l’homme coῦte peu de chose à former, mais un moment arrive toujours, où, sous l’influence de ces deux causes, diminution de la rémunération du personnel, augmentation de celle du matériel, le ralentissement a lieu. Ceci se remarque notamment chaque fois que, par le fait d’une crise ou d’une calamité quelconque, le débouché de la population diminue. On voit alors diminuer le nombre des mariages et des naissances, tandis que le phénomène opposé se manifeste chaque fois que la production se développe et, par conséquent, que le débouché de la population s’accroit. Dans le premier cas, la baisse de la rémunération du personnel amenée par le retrécissement du débouché, diminue la quantité de capital disponible pour la reproduction, tandis que dans le second cas, cette quantité se trouve augmentée. L’équilibre tend ainsi continuellement et de lui-même à s’établir par l’accroissement ou la diminution, l’apport ou le retrait du capital nécessaire à la reproduction. En tous cas, les perturbations que l’incontinence, c’est à dire l’exercice immodéré et déréglé de la force reproductive peut causer, en déterminant l’application d’une quantité surabondante de travail et de capital au renouvellement de la population, ces perturbations sont de moins en moins à redouter à mesure que la civilisation progresse: d’une part, les sacrifices que l’homme est obligé de s’imposer pour former une créature semblable à lui s’augmentant, il est plus excité à résister à l’excitation qui le pousse à commettre un acte dont les conséquences se trouvent [I-439] pour lui aggravées; d’une autre part aussi, il devient plus capable de gouverner utilement ses appétits, et peut-être enfin est-il sollicité avec moins de véhémence par ses penchants matériels, en se spiritualisant davantage.
La population n’a donc point, comme l’affirme Malthus, une tendance organique et virtuelle à se multiplier plus rapidement que ses moyens de subsistance, ou ce qui revient au même, à déborder le débouché qui lui est ouvert, au niveau de la rémunération nécessaire pour l’entretenir et la renouveler. Si cette tendance existait, remarquons le bien, et si elle se manifestait d’une manière constante, l’accroissement de la population serait impossible, car l’entretien de l’excédant en entamant progressivement le capital disponible pour la reproduction ne permettrait même point à celle-ci de s’opérer dans la proportion utile. Sans doute, l’incontinence pousse à une multiplication excessive de la population, mais son pouvoir ne va point jusqu’à neutraliser l’action de la loi économique qui sert de régulateur à la production des hommes comme à celle de toutes choses. Dès que la population se multiplie avec excès, en proportion de son débouché, le capital spécial de la reproduction compris dans la rémunération du personnel diminue, et le capital général est attiré, par l’appât d’une prime croissante, vers la formation du matériel; dès que la multiplication de la population devient insuffisante, au contraire, le capital spécial de la reproduction compris dans la rémunération du personnel augmente, et le capital général est attiré comme vers l’emploi le plus avantageux, du côté de la formation du personnel. Sous cette double impulsion qui agit en raison géométrique, alors que les écarts en plus ou en moins se produisent simplement en raison arithmétique, l’équilibre tend perpétuellement à s’établir [I-440] entre la population et ses moyens de subsistance, ou ce qui revient au même, entre la population et les emplois qui lui fournissent les moyens de subsister comme aussi de reconstituer le capital nécessaire pour se renouveler.
Cette inexactitude de son analyse des éléments constitutifs de la production de l’homme a conduit Malthus à formuler l’hypothèse peu scientifique de la multiplication de l’espèce humaine en progression géométrique et sans limites assignables. Cette hypothèse est aussi oiseuse que pourrait l’être celle de la multiplication des grains en admettant que la production des céréales n’exigeât l’application d’aucun capital. La multiplication des grains n’aurait, dans ce cas, selon toute apparence, d’autres limites que celles de la force productive du sol et peut-être de la place nécessaire pour faire pousser le blé. Mais quelles lumières une telle hypothèse apporterait-elle sur le développement possible de la production du blé, dans les conditions réelles où elle peut s’opérer, c’est à dire avec l’auxiliaire indispensable d’un capital. Quand Malthus assure que la population peut s’accroïtre en raison géométrique, il avance une proposition applicable aussi bien à tout autre genre de produits, — bien qu’il affirme à tort que les subsistances, par exemple, ne peuvent croître qu’en raison arithmétique. En effet, on peut admettre telle situation où, le capital croissant en raison géométrique, la production croîtrait dans la même proportion, soit qu’il s’agît d’hommes, de bêtes de somme, de machines, de tissus ou de subsistances. C’est ainsi que les choses se sont passées depuis soixante ans dans les États-Unis. Grâce à l’augmentation progressive du capital américain, le débouché ouvert à la population s’est accru de même. La demande du personnel des entreprises allant ainsi croissant, les salaires étaient élevés et ils [I-441] contenaient un fort tantième applicable à la reproduction, en sus de la somme nécessaire à l’entretien des travailleurs. Mais que le capital cesse de croître avec la même rapidité aux États-Unis,—et il y a apparence que cela ne tardera guère,—que le débouché ouvert à la population se rétrécisse, que la rémunération du personnel baisse, que le capital reproducteur diminue en conséquence, et l’accroissement de la population deviendra plus lent. Le phénomène de la multiplication si rapide de l’espèce humaine aux États-Unis prouve sans aucun doute que l’homme possède une force reproductive extrêmement intense et élastique; mais comme cette force illimitée ne suffit pas seule pour produire une population, comme il lui faut l’auxiliaire d’un capital, qui est essentiellement limité et dont l’accroissement échappe à toute formule mathématique, on ne peut inférer de ce que la multiplication de la population américaine s’est opérée depuis soixante ans en raison géométrique que la population ait une tendance générale et permanente à s’accroître en raison géométrique; pas plus que l’on ne pourrait inférer du phénomène du développement de la production de la laine, en raison géométrique aussi, dans les immenses solitudes de l’Australie, qu’il existe une tendance générale et permanente à multiplier les moutons en raison géométrique et sans limites assignables.
Cependant, si l’incontinence n’exerce point l’influence prépondérante que Malthus lui attribue, s’il est hors de son pouvoir de déterminer, d’une manière générale et constante, l’application d’une quantité excessive de capital à la reproduction de l’espèce humaine, et, par conséquent, de provoquer une surabondance continue de population, elle n’en exerce pas moins une action perturbatrice et nuisible qu’il importe [I-442] de combattre. Quelle est cette action? Elle consiste principalement dans la consommation improductive d’une partie du capital employé à la reproduction.
Ou l’incontinence détermine l’application à la reproduction d’une quantité surabondante de travail et de capital: dans ce cas, qui est le plus rare et qui se présente de moins en moins, à mesure que la quantité de travail et de capital nécessaire à la production d’un homme vient à s’accroître, il se forme une génération nouvelle trop nombreuse. De deux choses l’une, ou l’excédant inutile de cette génération périt ou il subsiste. S’il périt, il y perte du capital reproducteur employé à le former; s’il subsiste, il y a perte non seulement du capital employé à le former, mais encore du capital employé à l’entretenir à l’état oisif. Dans les deux cas, il y a consommation improductive, destruction d’une partie du capital de la société.
Ou,comme c’est le cas le plus ordinaire, l’incontinence contribue seulement à mettre au monde plus d’êtres vivants qu’il n’y a de travail et de capital disponibles pour en faire des hommes utiles. Dans ce cas, qu’arrive-t-il encore? De deux choses l’une, ou l’excédant meurt avant l’âge faute de soins et d’entretien, et dans ce cas, le travail et le capital dépensés à le former jusqu’au moment où il périt est encore consommé d’une manière improductive, ou cet excédant ne peut être qu’imparfaitement formé, et il constitue une population incapable de subvenir, entièrement du moins, à ses frais d’existence, et qu’il faut, en conséquence, soutenir au moyen de ressources spécialement affectées à cet usage stérile: dans ce cas encore, il y a consommation improductive, destruction d’une partie du capital de la société.
Or que faut-il à une société pour croître et se développer au [I-443] maximum? Il lui faut une quantité croissante, au maximum aussi, d’agents productifs, travail, capital et agents naturels appropriés, ou, en d’autres termes, une quantité croissante du matériel et du personnel nécessaires pour établir, mettre en activité et développer les entreprises de production, qui fournissent des moyens d’existence à la population. Que fait donc l’incontinence en détruisant du capital? Elle ralentit la formation et le développement des entreprises, et elle diminue ainsi le nombre des emplois qui pourraient fournir des moyens d’existence à la génération nouvelle. Elle diminue le débouché de la population, et, par une conséquence inévitable, la population elle-même.
Maintenant, de quelle manière l’incontinence peut-elle être combattue? Selon Malthus, elle peut l’être d’une manière préventive et d’une manière répressive, par des obstacles qu’il nomme privatifs et destructifs, et qui se résument dans “la contrainte morale, le vice et le malheur,” en comprenant, sous ces deux derniers chefs, tous les fléaux, la guerre, les épidémies, les famines, etc., que le vice et le malheur engendrent.
Tout d’abord, on est choqué comme d’une dissonnance dans les lois de la nature de cette association hétérogène de la contrainte morale, du vice et du malheur pour l’accomplissement d’une œuvre nécessaire, savoir l’établissement de l’équilibre entre le population et les subsistances. Que les voies de la Providence soient impénétrables, nous ne l’ignorons point. Mais que le vice soit employé par elle aux mêmes fins que la vertu, dans le gouvernement économique du monde, voilà ce qui renverse toutes nos notions sur l’harmonie du juste et de l’utile, en impliquant un désaccord profond et irrémédiable [I-444] entre la morale et l’économie politique, puisque le vice que la morale condamne quand même et toujours, peut, dans certains cas, à défaut de la contrainte morale, par exemple, remplir dans l’économie de la société une fonction nécessaire.
Mais, hâtons-nous de le dire, cette dissonnance n’existe pas. La contrainte morale que Malthus recommande avec raison, et c’est là son grand mérite, exerce sur la multiplication de l’espèce humaine une action précisément opposée à celle du vice et du malheur. Elle contribue toujours, du moins quand elle est sainement appliquée, à perfectionner et à augmenter la population, tandis que le vice et le malheur contribuent toujours, au contraire, à la dégrader et à la diminuer. Elle exerce toujours une action utile, tandis que le vice et le malheur (en y comprenant tous les fléaux qu’ils engendrent) exercent toujours une action nuisible.
Que le vice et le malheur aggravent les maux causés par l’incontinence au lien de les faire disparaitre, rien n’est plus facile à démontrer. En e ffet, les fléaux, les calamités et les infections dont ils sont la source ont pour résultat uniforme de détruire du capital, soit que le capital se trouve investi dans le matériel ou dans le personnel de la production. La guerre, par exemple, détruit du personnel et du matériel. La peste et toutes les infections analogues atteignent spécialement le personnel, mais sans remédier davantage aux effets nuisibles de l’incontinence. Comme ces fléaux n’atteignent pas le vice dans sa racine, il subsiste et repousse plus dru que jamais: une population luxurieuse et imprévoyante ne tarde guère, après une épidémie, à mettre au monde plus d’êtres vivants qu’elle n’en peut former utilement, eu égard à la quantité existante de capital. En attendant, une portion supplémentaire de ce capital [I-445] a dῦ être consacrée à réparer les brêches que l’épidémie a faites dans le personnel employé ou en voie de formation: d’où une diminution du capital applicable aux entreprises productives de moyens d’existence, un rétrécissement du débouché de la population et, par conséquent une aggravation du mal causé par l’incontinence et non point un remède à ce mal. Si les fléaux engendrés par “le vice et le malheur” n’étaient point intervenus pour détruire une partie de la population déjà produite, et dont la production a occasionné une dépense de capital plus ou moins considérable, que serait-il arrivé? C’est que la pression de l’excédant provenant d’une reproduction surabondante aurait agi pour diminuer la quantité du capital reproducteur, qu’il y aurait eu moins de mariages et moins de naissances, et que la population se serait remise en équilibre avec ses moyens d’existence, sans perdre le capital investi dans le personnel que l’épidémie a fauché.
Ceci nous amène à ce passage fameux de la première édition de l’Essai sur le principe de population, retranché dans les éditions suivantes, quoiqu’il résume parfaitement l’esprit de la doctrine de Malthus, mais qui n’en a pas moins largement contribué à rendre l’économie politique impopulaire:
“Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille n’a pas le moyen de le nourrir, ou si la société n’a pas besoin de son travail, cet homme, dis-je, n’a pas le moindre droit à réclamer une portion quel-conque de nourriture: il est réellement de trop sur la terre. Au grand banquet de la nature, il n’y a point de couvert mis pour lui. La nature lui commande de s’en aller, et elle ne tarde pas à mettre elle-même cet ordre à exécution.”
Il en serait ainsi assurément si, comme l’affirme Malthus, la [I-446] population pressait incessamment sur ses moyens d’existence, avec une force d’impulsion qui se développe en raison géométrique, tandis que la force de résistance que lui opposent les moyens d’existence ne peut se développer qu’en raison arithmétique; s’il fallait en conséquence, incessamment aussi, faire obstacle à l’empiètement de la population sur les subsistances, soit en empêchant de naître la folle végétation humaine, soit en la fauchant, d’une main impitoyable, quand elle est née. Mais cette pression formidable, — si formidable que Malthus lui-même, tout en recommandant l’exercice de la contrainte morale pour la combattre, semble désespérer de la victoire; car, déclare-t-il, cet effort, constant dans son action, tend non moins constamment à plonger dans la détresse les classes inférieures de la société et s’oppose à toute espèce d’amélioration de leur état, — cette pression formidable qui livrerait fatalement l’humanité à la faux tranchante du vice et du malheur, n’existe point. Sans doute, il peut se glisser dans la salle du banquet plus de convives qu’il n’y a de couverts préparés: et si les derniers venus sont repoussés de la table par un égoïsme étroit et sans pitié, ils ne feront que traverser tristement la salle en glaçant la joie sur les lèvres des conviés. Mais la table est immense, le nombre des couverts n’est point limité, et, à chaque instant, les places occupées se vident. Pendant que les uns arrivent, les autres s’en vont. Quand les invitations ont été lancées en trop grand nombre, il n’est donc pas nécessaire d’expulser brutalement l’excédant des invités, il suffit de se serrer un peu, en attendant que ceux qui sont rassasiés laissent des places vacantes. Et le grand ordonnateur du banquet ayant ainsi arrangé les choses, que les convives sont obligés non seulement de pourvoir à leur dépense, mais encore de faire à ceux qu’ils [I-447] invitent à les remplacer l’avance des frais de route, ils ne peuvent, si hospitaliers qu’ils soient, multiplier indéfiniment les invitations. Trop souvent, à la vérité, ils négligent de remplir cette obligation ou ils ne la remplissent qu’à demi. Alors, une partie des invités périssent soit dès le point de départ, soit en chemin, quelques-uns même aux abords de la salle. Ils ont beau partir en grand nombre, ils n’arrivent que clairsemés, et comme la dépense faite pour les conviés qui n’arrivent point est perdue, la somme à l’aide de laquelle il est pourvu aux frais du transport et à ceux du banquet se trouve diminuée d’autant. On se ruine en faux frais d’invitations, et la longue avenue qui conduit au banquet est assombrie par une multitude de petites croix, pendant que la salle demeure à moitié vide.
Il faut donc réprimer le penchant hospitalier qui pousse les convives à lancer sans cesse de nouvelles invitations, mais en omettant trop souvent d’y joindre le viatique nécessaire. C’est à quoi sert la contrainte morale. A-t-elle, comme le suppose Malthus, pour résultat de diminuer le nombre des convives? Non! elle agit, au contraire, pour l’accroître. Lorsque les hôtes attablés s’appliquent à proportionner leurs invitations au nombre des places disponibles, comme aussi à joindre scrupuleusement à chacune la somme requise pour amener l’invité, frais et dispos, jusqu’à la porte de la salle, quel est le résultat? C’est que la somme à l’aide de laquelle il est pourvu à cette double dépense n’étant point grevée de faux frais, peut servir à convoyer et à nourrir un nombre maximum de convives, jusqu’au moment où la nature, après les avoir laissés se réconforter à leur aise, leur commandera de continuer leur voyage vers une destination inconnue.
Mais peut-on espérer de voir jamais la contrainte morale [I-448] triompher de l’incontinence qui nous pousse à multiplier nos invitations au banquet de la vie, sans y joindre le viatique nécessaire? Non! pas plus qu’on ne peut espérer de la voir triompher jamais de nos autres penchants et de nos autres appétits, dans ce qu’ils ont d’excessif et de nuisible aux autres et à nousmêmes; pas plus qu’on ne peut espérer de la voir empêcher jamais le besoin et le goῦt de l’alimentation d’engendrer l’intempérance, et le besoin de repos, la paresse. Quelque parfait que puisse devenir le gouvernement de l’homme sur lui-même, quelles que soient les lumières et la force morale qu’il y déploie, ce serait une utopie de croire qu’il réussisse un jour à maîtriser et à diriger ses penchants, de façon à n’en faire qu’un usage sain et utile. L’incontinence continuera donc de subsister, comme l’intempérance et la paresse, en dépit de la contrainte morale, et de contribuer comme elles à appauvrir et à avilir les créatures faites à l’image de Dieu. Mais elle n’agira point et elle n’a jamais agi pour accélérer la multiplication de l’espèce humaine, elle agira et elle a toujours agi pour la ralentir. D’où il résulte qu’en recommandant l’exercice judicieux de la contrainte morale pour refréner l’incontinence, on ne contribue point à diminuer le nombre des hommes, on contribue, au contraire, à l’accroître.
En résumé, nous croyons avoir établi:
- 1°Que la même loi d’équilibre qui gouverne la production de toutes choses, gouverne aussi celle de la population; qu’en vertu de cette loi, l’offre de la population tend incessamment à se mettre en équilibre avec la demande, au niveau du prix remunérateur, c’est à dire à un niveau tel que la génération nouvelle puisse non seulement subsister, mais encore reconstituer au profit de la génération suivante le capital employé à sa formation, et [I-449] l’accroître dans la proportion utile; en d’autres termes, que la population a une tendance organique et virtuelle à se proportionner toujours avec ses moyens d’existence et de renouvellement;
- 2°Que l’incontinence agit comme une cause perturbatrice de cette tendance, en déterminant la multiplication imprévoyante de l’espèce humaine;
- 3°Qu’en poussant les hommes à mettre au monde plus d’enfants qu’ils n’en peuvent élever et placer utilement, l’incontinence provoque, entre autres maux, une consommation improductive d’une portion du capital à l’aide duquel la société s’entretient et se multiplie;
- 4°Qu’elle a ainsi pour résultant final de ralentir les progrès de la population, en diminuant ses moyens d’existence et de renouvellement;
- 5°Qu’il importe, en conséquence, de la combattre comme tout autre penchant excessif et nuisible; qu’elle a été, au surplus, de tous temps combattue, au moyen d’une contrainte morale incarnée dans les institutions, dans les coutumes et dans les lois;
- 6°Que ces institutions, ces coutumes et ces lois qui constituaient un régime préventif des abus de la reproduction de l’espèce humaine ayant disparu ou étant en train de disparaître, il importe de substituer à la contrainte morale, générale et imposée, qu’elles établissaient, une contrainte morale, individuelle et volontaire, et, à son défaut, une législation et une opinion suffisamment répressives des nuisances occasionnées par l’usage imprévoyant et abusif de la liberté de la reproduction [53]
[I-459]
Il ne nous appartient point de porter un jugement sur la théorie de M. Pouchet; mais il est évident que les propositions émises par le savant défenseur du principe des générations spontanées mériteraient un examen sérieux. En tous cas, et quoi qu’il en soit de la théorie de M. Pouchet, il demeure bien entendu qu’en recommandant la contrainte morale nous ne voulons point préconiser la débauche stérile, comme nous en avons été accusé par l’Univers, le Journal de Bruxelles et quelques autres feuilles plus zélées qu’intelligentes, lors de la publication de la première édition de ce cours. Nous recommandons la contrainte morale comme l’instrument nécessaire d’un bon self-government en matière de population, mais nous n’avons jamais songé certes, pas plus que ne l’a fait Malthus lui-même, à recommander la “contrainte immorale.”
La théorie que nous venons d’exposer n’a, croyons-nous, rien de contraire à la morale la plus sévère. Est-elle davantage en désaccord avec la religion? [I-460] Si la contrainte morale a pu effaroucher les âmes religieuses, lorsqu’on lui assignait un but opposé au précepte de l’Écriture: Crescite et multiplicabimini, en devra-t-il encore être de même lorsqu’il sera clairement démontré, — et cette démonstration nous croyons l’avoir faite d’une manière suffisante, — que la contrainte morale est au contraire indispensable à l’accomplissement du précepte que l’Église opposait, non sans quelque raison, à la théorie de Malthus? De tous temps, remarquons-le bien, l’Église a sanctionné et fortifié par ses institutions et ses préceptes la contrainte morale, codifiée dans le régime préventif en matière de population. Aujourd’hui que le régime préventif s’écroule; que la reproduction de l’espèce humaine n’est plus gouvernée par un État, un maître ou un seigneur; qu’elle est abandonnée au self-government de chacun, l’Église doit-elle se comporter comme si le régime préventif était encore debout? Ne doit-elle pas fortifier de sa sanction et de ses préceptes les règles volontaires que chacun est tenu de suivre pour la bonne solution du problème de la population, comme elle fortifiait autrefois de sa sanction et de ses préceptes les règles qui étaient, dans le même but, imposées à chacun? Pourquoi, après avoir prêté son appui à la contrainte morale imposée, le refuserait-elle à la contrainte morale volontaire? Ne se montrerait-elle pas, en agissant ainsi, singulièrement illogique et, chose plus grave, ne ferait-elle pas positivement obstacle à l’accomplissement du précepte: Crescite et multiplicabimini?
[I-461]
APPENDICE↩
rapport fait par m. charles dunoyer a l’acadÉmie des sciences morales et politiques (sÉance du 16 fÉv. 1856) sur le cours d’Économie politique de m. g. de molinari [54]
Je m’étais chargé, au commencement de l’année qui vient de finir, de faire hommage à l’Académie du premier volume du Cours d’économie politique que professe M. de Molinari au Musée royal de l’industrie belge. Un dérangement grave survenu alors dans ma santé, et depuis des préoccupations de famille de la nature la plus cruelle, m’ont successivement fait perdre de vue l’engagement que j’avais pris, et ce n’est que fortuitement, en quelque sorte, que l’ouvrage que je devais vous offrir a été replacé sous mes yeux et est venu me rappeler la promesse que j’avais faite. Je regrette véritablement, malgré les circonstances qui m’ont si tristement servi d’excuse, d’avoir autant différé de la remplir; car l’auteur a droit à beaucoup d’égards et d’estime. M. de Molinari n’est pas seulement un écrivain de talent, un économiste éclairé c’est un homme recommandable par les sentiments non moins que par les lumières, et dont le caractère mérite tout à fait d’être honoré. C’est [I-462] notamment un ami par excellence des idées d’ordre, d’autant plus dévoué à ces idées qu’il ne les sépare pas des idées de liberté qui n’estime pas, et il a raison, qu’en dehors de la liberté il puisse exister d’ordre véritable; qui croit la liberté nécessaire surtout au bon enseignement des sciences, en particulier des sciences morales et sociales; et c’est même sa manière de sentir à cet égard, et la sorte d’impossibilité où il craignait d’ètre, dans la situation où nous venions de nous placer, de s’expliquer sur ces sciences avec un degré suffisant de sincérité, qui l’ont déterminé, à la suite de nos derniers revirements politiques, à aller s’établir plus loin et à porter ses pénates en Belgique. Je signale cette circonstance parce qu’elle se lie naturellement à mon sujet, et parce que c’est l’espèce d’expatriation [55] à laquelle s’est volontairement condamné M. de Molinari, qui est devenuel’occasion du cours qu’il fait à Bruxelles, et de la publication dont il m’a prié de vous offrir la première partie.
Ce n’est pas sans une certaine hésitation que M. de Molinari s’est décidé à faire imprimer son ouvrage. Il s’est démandé si, après Adam Smith, J.-B. Say, Ricardo, Malthus et nombre d’autres, il y avait encore lieu de publier des traités d’économie politique; et il répond qu’il se fῦt abstenu de composer et de mettre au jour le sien, s’il n’avait été entraîné par la réaction anti-libérale et néo-réglementaire de l’école socialiste à envisager la science sous un point de vue spécial; s’il n’avait voulu rechercher ce qu’au fond il y avait sujet de penser du régime de librté que les maîtres de la science économique avaient uniformément présenté comme la loi naturelle du travail, et s’il était vrai, comme l’affirmait le socialisme, que, sous l’empire de cette loi, la production dῦt être fatalement vouéeà l’anarchie, que la liberté du travail nefῦt bonne qu’à enfanter le désordre et à écraser les faibles au profit des forts.
“Il me semble, observe M. de Molinari, que les ouvrages d’économie politique publiés jusqu’à ce jour présentent une lacune importante. Je veux parler de l’absence qui s’y fait remarquer d’une démonstration suffisamment [I-463] claire de la loi générale qui, en établissant un juste et nécessaire équilibre entre les différentes branches de la production, comme aussi entre les rémunérations des divers agents productifs, fait régner l’ordre dans le monde économique. “Or, l’objet qu’il s’est proposé, c’est précisément de remplir cette lacune. “J’ai essayé de démontrer, dit-il, que ce monde économique, où le socialisme n’aperçoit aucun principe régulateur, est gouverné par une loi d’équilibre qui agit incessamment et avec une irrésistible puissance pour maintenir une proportion nécessaire entre les différentes branches et les différents agents de la production. J’ai essayé de montrer que, sous l’impulsion de cette loi, l’ordre s’établit de lui-même dans le monde économique, comme il s’établit dans le monde physique en vertu de la loi de la gravitation. “
Si donc M. de Molinari a publié un nouveau cours d’économie politique après tous ceux qui avaient déjà paru, ce n’est pas, semble-t-il, et l’auteur a même soin de l’observer, “dans la pensée de refaire ce que les maîtres de la science avaient déjà fait et bien fait,” mais c’est dans le dessein de vérifier un point de doctrine particulier et considérable, c’est à dire dans la vue d’examiner si l’un des principes les plus fondamentaux qu’ils ont assignés à la science a eu ou serait susceptible d’avoir les effets que le socialisme lui attribue. Ami de la liberté, mais ami assez éclairé pour bien comprendre à quelles conditions elle est possible, il sait fort bien qu’elle ne peut exister qu’à la condition qu’on réprimera du mieux qu’on pourra tout ce qu’il pourrait s’y mêler de faits nuisibles et naturellement réprimables. Mais, ce point admis, et il n’est pas douteux qu’il ne l’admette, que le premier besoin de la communauté est de définir, de défendre, de punir, dans tous les travaux, tout ce qu’il pourrait se commettre de mauvaises actions, il est d’avis, avec les principaux maîtres de la science, que la liberté est la vraie loi de tous les travaux, que l’initiative en doit être laissée à tout le monde; et non seulement, en se renfermant dans ces limites, il n’admet pas que la producduction, abandonnée à elle-même, soit, comme le disent les socialistes, fatalement vouée à l’anarchie, qu’elle doive avoir pour résultat inévitable [I-464] d’écraser les pauvres et les faibles au profit des riches et des forts; mais il soutient, tout au contraire, qu’au milieu de son activité la plus spontanée, elle contient en elle-même un principe régulateur d’une efficacité souveraine, et que loin d’être particulièrement et partialement favorable à certaines de ses branches et à certains de ses agents, elle tend à maintenir l’équilibre entre toutes ses branches et tous ses agents avec une continuité et une énergie qui ont la force et la durée des lois physiques les plus constantes. Telle est la donnée du livre de M. de Molinari, à en juger du moins par la dédicace qui sert de préface à l’ouvrage; et, par la manière dont l’auteur s’exprime, on serait porté à croire qu’elle est spécialement et pour ainsi dire exclusivement celle qu’il s’est proposé de développer.
Or, si cette donnée peut, sous quelques rapports, être critiquée, elle est, à d’autres égards, foncièrement irréprochable et de nature à fournir matière à d’heureux et utiles développements. Seulement, et pour dire toute ma pensée à M. de Molinari, dont la parfaite sincérité est si bien faite pour encourager la mienne, j’ai, après avoir lu attentivement son ouvrage, quelques doutes à lui proposer:
Le premier, c’est que la donnée même qu’il a eu le dessein de développer fasse suffisamment l’objet de son livre. — Le second, c’est qu’lle y soit suffisamment expliquée. — La troisième enfin, c’est que, l’eῦt-il assez expliquée, elle fῦt la meilleure réponse qu’il y eῦt à faire aux reproches qu’adresse à la liberté le socialisme.
Au vrai, l’ouvrage de M. de Molinari est un traité général beaucoup plutôt que spécial d’économie politique. C’est un exposé plus ou moins complet de la science, telle que les derniers maîtres l’ont enseignée, et qui, pour le fond des idées, offre de grandes analogies avec ceux entre autres de J.-B. Say et surtout de Rossi. L’auteur, avec le talent d’écrire qui lui est naturel, et dans un langage heureux et lucide, expose successivement ce qu’il faut entendre par les mots production, produits, richesse; quels sont les instruments généraux de la production; quelle force elle puise dans le travail, dans les capitaux, dans les agents naturels; [I-465] sous quelles formes diverses elle s’exerce, etc. Seulement, dès ses premières remarques sur la production et ses agents, et beaucoup trop tôt à mon avis, quoiqu’il ne fasse en cela qu’imiter les maîtres, il se laisse conduire par ce qu’il dit du travail et de la division du travail à traiter aussitôt des échanges et de tout ce qui s’y rapporte, des marchés, des débouchés, de la valeur, de la demande, de l’offre, du prix, de la manière dont les prix se forment, de celle par suite dont la production s’asseoit; et il arrive ainsi, d’une façon tout incidente, à s’occuper de l’objet fondamental de son livre, c’est à dire de l’équilibre que la loi de la formation des prix tend à établir entre la production et la consommation, observant que cet équilibre s’établit d’autant mieux que le travail et les échanges sont plus laissés à leur propre impulsion; et il revient plus loin à son objet, considéré sous un autre aspect, dans une série de chapitres, où il traite tour à tour de la part qu’obtiennent dans la production le travail, la terre, le capital, et où il est conduit à observer que, sous l’empire de la liberté, la richesse tend à se répartir toujours plus également entre les diverses classes de producteurs comme entre les diverses classes d’agents productifs, bien qu’ici même et dans cette partie de son travail il s’occupe moins de développer la proposition spéciale qu’il avait entrepris de prouver, que de traiter les questions ordinaires qui se rattachent au sujet de la distribution des richesses.
Il n’est donc pas contestable, je crois, que l’ouvrage de M. de Molinari ne soit devenu, contre son intention, un traité général d’économie politique, plutôt qu’il n’est resté une œuvre spéciale destinée, comme la préface l’avait annoncé, à établir une proposition dont l’auteur jugeait la démonstration d’une importance majeure pour la science.
Ma seconde remarque, c’est qu’au tort de se trouver mêlée dans l’ouvrage à un grand nombre de sujets qui lui sont plus ou moins étrangers, la proposition capitale a, je crains, celui de ne pas y être établie d’une manière suffisante.
A dire vrai, l’auteur parle de la loi d’équilibre qu’il voulait démontrer plus qu’en réalité il ne l’expose et ne la démontre, et c’est surtout dans [I-466] les détails, c’est à dire dans le développement de la proposition, que l’insuffisance dont je parle se fait sentir. Il ne manque pas de clarté, en effet, dans ce qu’il dit en termes généraux de l’assiette de la production et de la manière dont la production et la consommation se mettent en équilibre. Il énonce cette proposition naturellement juste que, sous l’empire de la liberté, il n’y a foncièrement rien d’arbitraire ni d’anarchique dans la manière dont se passent à cet égard les choses; que l’assiette de la production se détermine par la loi qui préside à la formation des prix, par la loi de l’offre et de la demande, et que c’est par l’effet des mêmes lois que la production tend sans cesse à se mettre en harmonie avec les besoins de la consommation.
“Sans doute, observe-t-il, cette harmonie est parfois troublée. Différentes causes agissent incessamment pour la rompre. Tantôt, c’est l’inconstance des saisons qui rend la production agricole insuffisante ou surabondante. Tantôt, c’est l’ignorance de la situation du marché qui rétrécit on qui exagère d’une manière nuisible l’approvisionnement. Tantôt enfin, ce sont des monopoles naturels ou artificiels qui occasionnent un déficit de certaines denrées. Mais ces causes perturbatrices sont énergiquement combattues par la loi des quantités et des prix. Sous l’empire de cette loi, tel est l’intérêt des producteurs à ce qu’il n’y ait jamais surabondance d’une denrée, et tel est l’intérêt des consommateurs à ce qu’il n’y ait jamais déficit de cette même denrée, que la production et la consommation tendent constamment à se mettre en équilibre. C’est ainsi que se résout de lui-même, par une impulsion naturelle, le problème de l’équilibre de la production et de la consommation, que M. de Sismondi, et les socialistes après lui, ont regardé comme insoluble sous le régime du laisser faire. Cette solution si simple d’un problème qui paraît si compliqué n’est-elle pas véritablement admirable? Les produits les plus divers entrent dans la consommation de chacun des membres de la grande famille humaine, et ces produits sont créés sur tous les points du globe. Des nègres, des Indous, des Chinois, produisent des denrées qui sont consommées par les Anglais, les Franç, les Belges, [I-467] et en échange desquelles ceux-ci leur fournissent d’autres denrées. Au premier abord, ne semblerait-il pas que ces échanges, qui s’opèrent à de si longues distances et parfois à de si longs intervalles, devraient être impossibles à ajuster; qu’il devrait y avoir tantôt surabondance, tantôt déficit des denrées offertes en échange. Pourtant il n’en est rien, ou du moins les perturbations de ce genre sont l’exception, et même, dans les échanges à distance, c’est l’ordre qui est la règle.”
L’auteur va peut-être bien loin dans ces dernières lignes, et je ne sais si l’on peut affirmer que c’est effectivement l’ordre qui est ici la règle. Ce qui est indubitablement la règle, j’en conviens, c’est la tendance de la production à se mettre en équilibre avec la consommation. Mais ne serait-il pas difficile de soutenir que le fait ici est habituellement d’accord avec la tendance? En fait, non seulement il arrive sans cesse que l’ordre soit troublé dans la production par l’action de causes naturelles, sur lesquelles l’homme ne peut rien ; mais il l’est aussi par l’action de causes dont il lui est moins impossible de tenir compte, et, par exemple, par l’ignorance presque insurmontable où il est si souvent du véritable état du marché, de la véritable étendue des besoins, de celle des moyens qui sont employés à les satisfaire, du moment où il conviendrait d’agir, de celui où il serait à propos de se ralentir ou de s’arrêter; ignorance dont le résultat est, si fréquemment et sur tant de points, d’amener des embarras commerciaux, du vide ou du trop plein, de l’encombrement ou de la disette. Et néanmoins il ne faut pas croire, à cet égard même, que l’activité des populations se conduise absolument au hasard, qu’elle ne tienne aucun compte de l’étendue des débouchés, de l’état de l’offre et de la demande. Il est indubitable, loin de là, que sa tendance instinctive,énergique, persévérante, est de régler l’étendue de ses efforts sur celle des besoins éprouvés, et que le résultat de cette tendance est, dans une certaine mesure, de maintenir entre la production et la consommation cet équilibre dont parle M. de Molinari, et qu’il présente, sous l’empire de la liberté surtout, comme une loi du monde économique. Il n’y a, je crois, rien que de foncièrement juste dans l’affirmation de [I-468] l’existence de cette loi. Seulement il est permis de ne pas trouver l’exposition qu’il en fait suffisamment explicite, et de trouver, au contraire, la conclusion à laquelle il arrive un peu absolue.
L’auteur est moins explicite encore, et, je le crois aussi, moins exact dans ce qu’il dit à propos de la distribution des richesses, d’un autre équilibre qui, suivant lui, se ferait naturellement, sous l’empire de la liberté surtout, et les choses étant laissées à elles-mêmes, entre les parts afférentes aux diverses classes de travailleurs comme entre les diverses classes d’agents productifs. J’ai de la peine, je l’avoue, à me rendre bien compte de la manière dont l’auteur entend que cet équilibre s’établit. Il développe successivement et d’une manière en général satisfaisante les causes diverses qui font varier le prix du travail, les profits des capitaux, les revenus des fonds de terre. Mais de cette diversité, qui est précisément la chose sensible partout, comment arriver à la conclusion qu’il y a partout égalité, balance, équilibre, entre les parts faites à ceux qui concourent à la production? M. de Molinari semble quelquefois vouloir réduire sa pensée sur l’équilibre qu’il signale ici à affirmer que le niveau vers lequel gravite le prix des services productifs de toute espèce est le même, quelle que soit la forme sous laquelle ce prix est perçu, et, par exemple, que l’ouvrier reçoive le prix de son travail sous forme de profit, de dividende ou de salaire, que le capitaliste reçoive le prix du service de son capital sous forme d’intérêt ou de loyer. Ceci est possible, et je ne le conteste pas. Mais la pensée de l’auteur, qui n’offre rien d’inexact, ainsi restreinte, ne répond plus, sous cette forme amoindrie, à ce qu’il dit d’une manière générale, à savoir que la loi d’équilibre dont il poursuit la démonstration joue dans la distribution des richesses le méme r∘le que dans leur production, et que, de même que cette loi maintient une sorte de balance entre la production et la consommation, de même elle fait graviter vers un certain niveau le prix de tous les services; qu’elle tend sans cesse, par exemple, à faire que la rémunération du salarié se proportionne à celle de l’entrepreneur, etc, Or, c’est ici surtout que des justifications seraient nécessaires, et ici surtout qu’elles me semblent [I-469] faire défaut. Il est certain que l’équilibre entre les parts afférentes aux diverses classes de producteurs, affé par l’auteur à maintes reprises, n’est nulle part, dans cette partie de son ouvrage, véritablement démontré. Bien plus, il ne semble pas qu’il soit susceptible de l’être, et, loin de là, s’il est une chose qui paraisse évidente dans la manière dont les richesses se doivent distribuer entre ceux qui les produisent, c’est la diversité des parts à faire à chacun, selon l’importance du concours que chacun apporte à la production. De sorte qu’à vrai dire, la loi qui doit dominer ici c’est une loi, non pas d’équilibre, non pas d’égalité, mais de proportionnalité.
M. de Molinari observe, il est vrai, et la justesse de l’observation n’est pas contestable, qu’à mesure que la société fait des progrès, la position de tout le monde s’améliore. Mais en tenant pour juste cette observation, qui est en effet très exacte, comment ne pas voir que toutes les positions peuvent s’améliorer sans cesser pour cela d’être inégales, et qu’en réalité c’est l’inégalité, c’est l’absence de niveau, à prendre ces mots dans leur acception rigoureuse, qui est ici la vraie loi du monde laborieux?
Aussi l’équilibre que M. de Molinari croit apercevoir dans la manière dont les richesses se distribuent fùt-il exposé dans son travail plus explicitement qu’il ne l’a été, et démontré vrai dans la mesure et sous les aspects où à la rigueur il pouvait l’être, resterait-il encore à dire, et c’est là ma dernière observation, que la démonstration de cet équilibre nétait pas la meilleure réponse qu’il y eῦt à faire ici aux reproches que le socialisme adresse à la liberté.
Il est en effet très essentiel de bien reconnaître que la liberté n’est pas et qu’elle ne peut pas être, surtout d’une manière absolue, un obstacle à l’inégalité. Elle peut faire, nous l’avons dit, que toutes les conditions deviennent meilleures; elle ne peut pas faire qu’elles deviennent toutes égales. L’inégalité, dans une mesure très étendue, est la plus essentielle, la plus générale, la plus constante des lois qui président au développement de l’humanité. A quelque époque de son histoire que l’on considère [I-470] la société, on y voit les hommes, pour arriver à certaines fins que tous veulent plus ou moins atteindre, au bien-être, à la fortune, à la considération, à l’importance, partir des points les plus différents, se trouver placés dans les conditions les plus diverses, agir avec les moyens les plus inégaux. Il est donc impossible, non pas, j’espère, qu’ils avancent tous plus ou moins vers les biens qui sont l’objet de leur commune poursuite, mais qu’ils en approchent d’un pas égal, qu’ils les atteignent avec un succès semblable; et la seule chose qu’ils puissent justement et sensément demander à la communauté, c’est de les protéger assez, dans le légitime usage de leurs facultés naturelles et de leurs ressources légitimement amassées, pour qu’ils en puissent tirer le meilleur parti possible. Il ne résultera pas de là sans doute qu’ils aient rigoureusement la même destinée: cela ne peut pas être et, en plus d’un sens, il n’est pas même désirable que cela soit; mais il en devra résulter, et que peut-on exiger davantage? qu’ils aient le degré de bonheur auquel leur donnera droit l’usage plus ou moins intelligent et bien réglé qu’ils sauront faire de leurs facultés.
Encore une fois donc, ce qu’avait à soutenir ici M. de Molinari pour défendre victorieusement la liberté contre les agressions du socialisme, ce n’est pas qu’elle tend à niveler le prix des services et à rendre égale la condition des travailleurs. Non, ce n’est pas cela, ce n’est pas là l’effet essentiel qu’elle produit; elle ne tend pas précisément à rendre la condition des travailleurs égale; elle se contente de les placer tous dans une situation où il leur devienne plus aisé de la rendre meilleure, où tous l’aient aussi bonne, en tenant compte de leur point de départ et des moyens d’action dont ils disposent, que le comporte l’emploi fait par eux de leurs moyens. Les inégalités naturelles et trop souvent indestructibles qu’elle laisse subsister entre eux ne sont un obstacle à l’avancement proportionnel de personne. Ce n’est pas, il s’en faut, un mal pour les faibles et pour les moins bien doués qu’il existe, en plus ou moins grand nombre, dans la société, des natures d’élite, des esprits éminents qui découvrent d’utiles vérités, d’habiles chefs d’industrie qui, sans nuire [I-471] à qui que ce soit, parviennent à accumuler de grandes ressources; c’est, au contraire, un notable avantage pour tous, en particulier pour les impuissants et les pauvres, et il ne serait certes pas plus heureux pour ceux-ci qu’il n’y eῦt dans la société que des gens faibles et dénués comme eux. En général, “les supériorités qui ne sont dues qu’à un usage plus intelligent et mieux réglé de nos facultés naturelles, loin d’être un mal, sont un véritable bien; elles sont la source de tout ce qui se fait de grand et d’utile. C’est dans la plus grande prospérité qui accompagne un plus grand ou plus heureux effort qu’est le principe de tout développement. Rendez les conditions pareilles, et nul ne sera intéressé à mieux faire qu’un autre. Réduisez tout à l’égalité, et vous aurez tout réduit à l’inaction, vous aurez détruit tout principe d’activité, d’honnêteté, de vertu parmi les hommes [56] .”
C’est plutôt, je le crois très sérieusement, en se livrant à des considérations de cet ordre que la liberté peut être solidement et heureusement défendue, qu’en essayant d’établir qu’elle tend à mettre un certain niveau entre les existences, d’autant que ceci n’est vrai qu’à un point de vue très général, très incomplétement exact, et qu’en réalité la loi qu’elle a introduit et qu’elle devra introduire de plus en plus dans la distribution des richesses est une loi de proportion et non une loi de parité.
Je crains donc beaucoup que ma dernière observation sur le travail de M. de Molinari, et la plus essentielle, ne soit aussi la mieux fondée, et que la donnée particulière qu’il s’est proposé de développer ne joigne, comme je l’ai dit, au tort de ne pas faire assez essentiellement l’ objet de son livre, et de n’y avoir pas été suffisamment expliquée, celui peut-être de n’avoir pas été heureusement choisie, au moins pour ce qui tient à la distribution des richesses. Considéré comme œuvre spéciale, l’ouvrage, malgré son incontestable mérite, laisserait donc plus ou moins à désirer.
[I-472]
Il est, comme traité général, plus complétement irréprochable, au moins à prendre la science dans l’état où l’ont laissée Smith et ses principaux successeurs. C’est en effet en la formulant comme eux et en la renfermant à peu près dans le même cadre qu’il en a fait une nouvelle exposition. Il s’est contenté, pour le fond essentiel des idées et pour l’arrangement général des matières, de suivre les errements des anciens maîtres. Il me fait, il est vrai, dans sa classification des formes de la production, l’honneur d’approuver la nouvelle division que j’en ai faite, et il comprend expressément, avec moi, dans la nomenclature des revenus productifs, ceux qui épuisent leur activité sur l’homme aussi bien que ceux qui agissent uniquement sur la matière. Mais cette adoption, en principe, d’idées qu’il ne s’est pas, je crains, suffisamment appropriées, ne tire pas précisément à conséquence dans son travail, et il ne fait pas plus figurer dans son exposition des phénomènes de la production les arts qui s’occupent de l’éducation de l’homme, que ne l’avaient fait avant lui la plupart de ses prédécesseurs; il ne prend, comme eux, ses exemples et ses preuves que dans des faits empruntes aux arts qui agissent sur le monde matériel, et l’idée qu’il donne de l’économie de la société laborieuse ne rappelle dans son ouvrage, comme dans ceux de ses anciens devanciers, que des idées de richesse matérielle. Son exposition d’ailleurs, pour qui veut considérer la science ainsi que je l’ai fait, n’a pas seulement le tort de ne rouler que sur des travaux et des produits de l’ordre le moins élevé; elle a plus sensiblement encore celui de ne: faire des agents de la production qu’une analyse à la fois inexacte et incomplète, qui continue à tout rapporter à l’action originaire des trois forces désignées par les appellations banales de travail, terre et capital, et de réduire à ces trois forces tous les moyens d’action du genre humain. J’aurais donc, sans parler d’autres lacunes et d’autres incorrections, essentielles que présentent les traités ordinaires d’économie politique, et que je retrouve dans celui de M. de Molinari, plusieurs sérieuses observations à faire sur son ouvrage considéré comme traité général. Mais ce procès, qui ne s’adresserait pas plus à lui qu’à beaucoup d’autres économistes, [I-473] me mènerait infiniment plus loin que je ne peux avoir ici la pensée d’aller, et je me borne à redire, en prenant la science dans l’état où l’ont laissée les maîtres, que l’exposition qu’il en a faite, et dont il a puisé les idées principales dans leurs meilleurs traités, est un travail recommandable qui semble ne laisser à désirer, comme exposition des idées reçues, que des corrections peu nombreuses.
Je souhaiterais, par exemple, que pour l’établissement de certaines de ses propositions, M. de Molinari ne partît pas, comme il l’a fait à maintes reprises, de l’hypothèse de l’homme isolé; hypothèse gratuite, essentiellement contraire à la vérité des faits, et qui, en donnant un caractère peu scientifique à ses démonstrations, doit naturellement les affaiblir un peu.
Je souhaiterais aussi que, pour l’illustration de ses idées, il ne lui arrivât pas d’emprunter des exemples, ainsi qu’il le fait quelquefois, à des professions naturellement odieuses ou immorales, telles que la profession de bourreau ou l’industrie des courtisanes, dont on ne conçoit pas même que le nom ait pu arriver à la pensée d’un homme de goῦt comme M. de Molinari.
J’aurais voulu quelquefois, en parcourant son livre, trouver l’auteur plus au courant de l’ensemble des faits commerciaux, plus complétement familier avec les procédés de la société laborieuse. Mais il vit dans un pays où il acquerra rapidement ce qui pourrait, sous ce rapport, manquer à son expérience, et l’on ne peut que féliciter nos voisins, non seulement de l’avoir accueilli, mais de lui avoir confié l’enseignement important dont il est chargé à Bruxelles.
Je ne doute pas qu’il ne soit destiné à honorer également l’hospitalité qu’il reçoit et la chaire qu’on l’a appelé à remplir, et que, dans un avenir prochain, il ne compte au nombre des meilleurs instituteurs de la science économique. C’est en effet un esprit essentiellement ouvert à cet ordre d’idées, qui en a naturellement l’intelligence, qui apporte à l’étude qu’il en fait un esprit dégagé de toute préoccupation intéressée, et à qui notamment ne font jamais défaut la sincérité, la droiture et l’honnête [I-474] amour de la liberté qu’un tel enseignement réclame. Ce sont des témoignages que je suis heureux d’avoir l’occasion de lui rendre ici, et qui justifient d’une façon toute spéciale l’hommage que je me suis chargé de faire de sa part à l’Académie.
fin du tome premier.
Notes - Volume I↩
[1] Voir à l’Appendice.
[2] L’homme éminent à qui cette dédicace était adressée, a été enlevé à la science le 20 avril 1860. M. Charles de Brouckere avait mis une activité et un dévouement rares au service de la propagande des vérités économiques, et il s’était montré un des premiers et des plus énergiques promoteurs des réformes douanières en Belgique.
[3] Études économiques. De l’organisation de la liberté industrielle, 1846.— Les soirées de la rue Saint-Lazare. Entretiens sur les lois économiques, 1849. — Observations sur la formation des prix. Journal des Économistes, n° de juin 1851. Reproduites dans les Questions d’Économie politique et de droit public, t. Ier, p. 35.
[4] Bien que le terme d’économie politique soit tout à fait moderne, dit M. Joseph Garnier, les deux mots qui le composent sont très anciens. Les Grecs disaient Oiconomia et les Latins Æconomia, de oicos, maison, nomos, loi, ou de nemo, j’administre, pour signifier la loi et l’administration de la maison. Les plus illustres disciples de Socrate ont traité ce sujet dans leurs œuvres. On a attribué à Aristote, qui vivait trois siècles avant notre ère, un écrit intitulé: Oiconomicos, l’Économique, contenant des réflexions sur l’économie domestique, en deux livres, dont le second cependant paraît apocryphe.
“Ce philosophe entendait par l’Oiconomia, l’administration de la famille sous le rapport moral comme sous le rapport matériel, c’est à dire l’économie domestique comme nous la définissons aujourd’hui, plus la direction intellectuelle et morale de la famille. Xénophon, qui écrivait avant lui, a également laissé des Économiques.”
“Le mot politique est encore plus ancien. Les Greos disaient: Politikos, politike, politikon, de polis, ville, cité, ensemble de citoyens, et les Romains: Politicus, politica, politicum, dans le sens de civique, de politique, de relatif à la chose publique.” (Joseph Garnier. De l’origine et de la filiation du mot écanomis politique.)
[5] Pour subvenir aux nécessités de son existence, écrivions-nous ailleurs, l’homme dispose d’une portion de la création, et il est armé de facultés à l’aide desquelles il peut extraire du milieu où il vit tous les éléments de sa subsistance matérielle et morale. La terre avec ses innombrables variétés de minéraux, de végétaux et d’animaux, ses océans, ses montagnes, son humus fertile, l’atmosphère qui l’environne, les effluves de chaleur et de lumière qui alimentent la vie à sa surface, voilà le fonds abondant que la Providence a mis au service de l’humanité. Mais ni les éléments divers qui composent ce fonds naturel de subsistance, ni les facultés dont l’homme dispose pour los utiliser, n’ont été distribués d’une manière égale et uniforme. Chacune des, régions du globe a sa constitution géologique particulière: ici a’étendent, d’immenses couches de charbon, de fer, de plomb, de cuivre; là gisent l’or, l’argent, le platine et les pierres précieuses. Même diversité dans la distribution des espèces végétales et animales: le soleil qui échauffe et qui éclaire inégalement la terre, qui prodigue dans certaines zones la chaleur et la lumière, tandis qu’il abandonne les autres à la frigidité et à l’ombre, marque à chaque espèce les limites qu’elle ne peut franchir. Même diversité encore dans la répartition des facultés humaines. Un court examen suffit pour démontrer que tous les peuples n’ont pas été pourvus des mêmes aptitudes; que les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Russes, les Chinois, les Indous, les nègres, etc., ont leur génie particulier, provenant, soit de la race, soit des circonstances naturelles du sol ou du climat; que les forces physiques, intellectuelles et morales de l’homme varient selon les races, les peuples et les familles; qu’il n’y a pas dans le monde deux individus dont les capacités soient égales et les aptitudes semblables. Diversité et inégalité des éléments de la production dans les differentes régions du globe; diversité et inégalité non moins prononcées des aptitudes parmi les hommes; tel est donc le spectacle que nous présente la création. (Dictionnaire de l’économie politique, art. Liberté du commerce.).
[6] Charles Babbage, Science économique des manufactures, traduction d’Isoard.
[7] On sait que le chapitre de la division du travail ouvre l’admirable livre de la Richesse des nations. En se divisant davantage, remarque Adam Smith, le travail devient plus productif, c’est à dire qu’une quantité donnée de forces productives et d’éléments de production peut créer, dans un intervalle déterminé, une plus grande quantité de choses utiles. La raison en est, ajoute-t-il, que la division du travail occasionne 1° un accroissement d’habileté dans chaque individu; 2° l’épargne du temps qu’on perd communément en passant d’une occupation à une autre; 3° elle facilite l’invention de machines qui abrégent le travail et qui mettent un seul homme en état de faire l’ouvrage de plusieurs.
“La division du travail réduisant la besogne de chaque homme à une seule opération, et dont il fait son unique occupation pendant toute sa vie, il faut nécessairement qu’il acquière beaucoup d’adresse, et ce surcroît d’adresse et d’habileté ne peut manquer de produire une augmentation proportionnelle dans la quantité du travail qu’il peut expédier. Qu’un forgeron, accoutumé à manier le marteau et non à fabriquer des clous, soit obligé, dans une occasion particulière, de faire l’office d’un cloutier, je suis assuré qu’à peine en pourra-t-il expédier deux ou trois cents dans un jour, et encore seront-ils mauvais. S’il a l’habitude d’en faire, mais que ce ne soit pas son unique ou sa principale occupation, quelque diligence qu’il y apporte, il n’en fera pas plus de huit cents ou mille par jour. Or, j’ai vu de jeunes garçons au dessous de vingt ans, qui n’avaient jamais exercé d’autres métiers, faire chacun plus de deux mille trois cents clous en un jour. Cependant l’opération n’est pas des plus simples. La même personne fait mouvoir les soufflets, attise ou raccommode le feu quand il en est besoin, chauffe le fer et forge chaque partie du clou. Les opérations dans lesquelles se subdivise la fabrication d’une épingle ou d’un bouton de métal sont toutes beaucoup plus simples, et la dextérité de la personne dont toute la vie s’y consume est ordinairement beaucoup plus grande. Elles se font avec une rapidité dont on ne croirait pas que la main de l’homme soit capable si on ne l’avait vu.
“Le second avantage qui résulte de la division du travail est l’épargne du temps qu’on perd communément en passant d’une espèce d’ouvrage à une autre. Cet avantage est beaucoup plus grand qu’on ne le croirait dabord. La perte du temps est moindre quand on n’est pas obligé de changer de lieu; mais elle ne laisse pas d’être encore considérable. Quand un homme quitte un ouvrage pour en prendre un autre, il n’est pas communément fort ardent et fort zélé. Il n’est point à ce qu’il fait, il s’y prend mollement et, pendant quelque temps, il tâtonne plutôt qu’il ne travaille. De là vient que les ouvriers de la campagne qui sont obligés de changer d’ouvrage et d’outils à toutes les demi-heures, et qui passent à vingt opérations manuelles différentes presque tous les jours de leur vie, contractent nécessairement une habitude d’indolence et de paresse qui les rend incapables de toute application vigoureuse, même dans les occasions les plus pressantes. On voit quelle réduction il y a dans la quantité d’ouvrage par cette seule cause, indépendamment du manque d’adresse et de dextérité.
“Troisièmement, il n’est personne qui ne sente combien l’usage des machines abrége et facilite le travail. Il est inutile d’en donner des exemples. J’observerai seulement que leur invention semble être originairement due à la division du travail. L’attention entièrement tournée vers un seul objet découvre plus tôt des moyens courts et faciles d’y parvenir que si elle était partagée. Or, une suite de la division du travail est de fixer naturellement l’attention de chaque individu sur un seul objet fort simple. On doit s’attendre naturellement que parmi ceux qui sont employés à une branche particulière de travail il s’en trouvera qui chercheront quelques expédients pour faire leur ouvrage avec plus de facilité et en même temps avec plus de célérité. Aussi les machines employées dans les manufactures où le travail se subdivise le plus sont en grande partie de l’invention de simples ouvriers, qui, bornés à une seule opération nullement compliquée, se sont avisés de chercher des méthodes pour en venir plus promptement à bout. Quiconque a fréquenté ces sortes de manufactures doit y avoir vu souvent de fort jolies machines dont la découverte a été faite par des artisans dans la vue de faciliter et de hâter l’exécution de leur ouvrage. Lors des premières pompes à feu, il y avait un petit garçon constamment occupé à ouvrir et à fermer alternativement la communication entre le fourneau et le cylindre, selon que le piston montait ou descendait. Un de ces petits garçons, qui était bien aise de jouer avec ses camarades, observa qu’en attachant une corde à l’anse de la soupape qui ouvrait cette communication et à une autre partie de la machine, la soupape ouvrirait et fermerait sans qu’il s’en mêlât et lui laisserait par conséquent tout le temps de se divertir. Une des choses qui ont le plus perfectionné cette machine fut ainsi la découverte d’un petit polisson qui voulait s’épargner de la peine.
“Cependant tout ce que les machines ont acquis de perfection ne vient pas de ceux qui avaient besoin d’elles. Plusieurs tiennent la leur du génie des inventeurs et quelques-unes la tiennent de ceux qu’on appelle philosophes ou théoriciens, gens qui n’ont rien à faire, mais qui observent tout, et qui, par cette raison, sont souvent capables de combiner ensemble les forces ou puissances des objets les plus éloignés et les plus dissemblables. Il en est de la philosophie ou spéculation comme de tous les autres arts. Les progrès de la société en font l’occupation ou l’emploi d’une classe particulière de citoyens. Elle se subdivise de même en plusieurs branches, dont chacune a ses philosophes qui la cultivent, et cette subdivision y occasionne, comme ailleurs, le double avantage d’une plus grande habileté et de l’épargne du temps. Chaque individu acquiert plus de connaissances dans la branche à laquelle il s’attache; en total, il se fait plus de travail et la masse ou quantité de science augmente merveilleusement.” (Adam Smith, la Richesse des nations, liv. Ier, chap. Ier.)
La division du travail présente un quatrième avantage que M. Ch. Babbage a particulièrement fait ressortir, c’est la possibilité d’employer les ouvriers selon leurs aptitudes et selon leurs forces.
“Si chaque homme était obligé de produire lui-même toutes les choses nécessaires à sa consommation, il exécuterait bien certaines opérations conformes à ses aptitudes naturelles, mais il en est un bien plus grand nombre qu’il exécuterait mal ou même qu’il ne saurait pas exécuter. La division du travail permet à chacun de s’occuper spécialement de la branche d’industrie qui convient le mieux à ses aptitudes. Elle permet encore de proportionner les forces employées à l’effort à accomplir. Dans une manufacture où le travail est très divisé, on peut utiliser pour les emplois inférieurs des femmes et des enfants, et réserver les ouvriers habiles pour les besognes qui présentent le plus de difficultés. Ainsi, pour citer un exemple qu’Adam Smith a rendu populaire, dans la fabrication des épingles, il y a certaines opérations, telles que l’étirage du fils et l’épointage, qui exigent une certaine force ou une certaine habileté. Ces opérations sont confiées à des hommes qui gagnent de bons salaires. D’autres, telles que le posage des têtes et la mise en papier, exigent moins de force ou de dextérité. On les abandonne à des femmes ou à des enfants. Si ces diverses opérations étaient exécutées par le même individu, celui-ci devrait savoir exécuter les plus difficiles comme les plus faciles, en sorte que les unes reviendraient, toute proportion gardée, aussi cher que les autres.” (Ch. Babbage, Science économique des manufactures, traduction d’Isoard.)
Un cinquième avantage de la division du travail, c’est de rendre possible l’emploi constant du même outillage, autrement dit, du même capital.
“Que l’on se figure, dit M. Ch. Lehardy de Beaulieu, un artisan qui fasse à la fois les métiers de charron, de charpentier, de menuisier, d’ébéniste et de tourneur, quoique ces métiers se ressemblent en quelques points, il ne lui en faudra pas moins cinq ateliers, cinq approvisionnements de matériaux, cinq séries d’instruments et d’outils, dont quatre chômeront pendant qu’il se servira de la cinquième. Ce sont donc quatre capitaux sur cinq qui resteront toujours inactifs, tandis que, s’il ne faisait qu’un seul métier, son capital entier serait toujours occupé(∗).”
(∗) Ch. Lehardy de Beaulieu, Traité élémentaire d’économic politique, chap. III, p. 32.
Le même écrivain a ajouté quelques exemples saisissants à ceux dont on se sert ordinairement pour illustrer les avantages de la division du travail.
“Supposons, dit-il, un mathématicien robuste d’esprit, mais faible de corps; si le travail n’est pas divisé, il sera souvent obligé d’abandonner son calcul pour travailler à son entretien matériel, à la culture de la terre, par exemple, travail auquel son défant de forces le rend impropre; et, pendant ce temps, ses meilleures facultés seront mal utilisées. Supposons, d’autre part, un vigoureux campagnard, obligé de quitter le labour ou la récolte pour se livrer à des combinaisons mathématiques auxquelles son éducation ne l’a pas initié; il ne produira pas non plus toute l’utilité dont il est susceptible. Mais que le mathématicien et le paysan s’entendent pour se partager ces deux genres de travail, suivant leurs aptitudes respectives, et aussitôt le résultat de leurs efforts sera doublé, puisque chacun d’eux aura accompli le travail pour lequel il était le plus fort et le plus habile.
“En même temps, le mathématicien, toujours occupé de combinaisons et de calculs et le laboureur toujours attaché au travail des champs, se perfectionnent par l’usage incessant de leur faculté de prédilection, et lui font atteindre son plus haut degré de puissance.
“... Un grand nombre d’exemples, ajoute M. Ch. Lehardy de Beaulieu, peuvent servir à montrer combien on peut acquérir d’adresse, de promptitude et de précision dans un travail souvent répété. Nous nous bornerons à en citer deux.
“Un homme sachant calculer, mais peu habitué à faire des additions, mettra un temps fort long à faire la somme d’une colonne de chiffres, même peu étendue, et il devra recommencer au moins trois fois pour avoir la certitude de ne pas s’être trompé; tandis qu’un agent comptable habitué à cet exercice ajoute ensemble plusieurs chiffres d’un seul coup d’œil et achève son addition en un instant, sans se tromper et sans devoir la recommencer pour la vérifier.
“Un batteur d’acier étire facilement une barre de ce métal, parfaitement droite et carrée, sous un marteau mῦ par la vapeur et qui bat 400 coups par minute, tandis qu’un forgeron adroit, mais qui n’est pas habitué à ce genre de travail, ne pourra ni retourner, ni avancer, ni reculer la barre d’acier sur l’enclume pendant les intervalles très courts qui séparent deux coups consécutifs du marteau; alors celui-ci frappera toujours la barre à la même place et l’écrasera.” (Ch. Lehardy de Beaulieu, Traité élémentaire d’économic politique, p. 27 et 31.)
[8] Que l’on puisse mesurer l’état de civilisation, c’est à dire de développement moral et intellectuel, d’une part, de puissance et de richesse matérielle, de l’autre, auquel une société est parvenue, en constatant simplement le point jusqu’où la spécialisation des industries et la division du travail y ont été poussées, dans les différentes branches de l’activité sociale, c’est une vérité sur laquelle il est devenu aujourd’hui superflu d’appuyer; un fait moins remarqué, et que signale M. Frédéric Passy dans ses élégantes Leçons d’économie politique, c’est que la spécialisation des fonctions et la division du travail fonctionnel ne caractérisent pas seulement le progrès de l’organisme social, mais encore celui de tout organisme.
“Écoutez ce que dit un savant naturaliste, étudiant non plus l’homme, mais les animaux. Partout dans la création, il va vous signaler la loi que nous signalons dans l’humanité, partout il va vous montrer que la division du travail est le cachet de la perfection et la condition du développement.
“Tant que l’industrie humaine est à l’état de première enfance, dit M. de Quatrefages (Souvenirs d’un naturaliste), le même homme ensemence son champ avec la bêche qu’il s’est forgée; il récolte et fait rouir le chanvre, le tille et le file. Puis il construit un métier informe, se fabrique une navette grossière et tisse tant bien que mal la toile qui devra le vêtir. Plus tard, il trouve à se pourvoir d’instruments plus parfaits chez un voisin qui passe sa vie à ne faire que des instruments aratoires ou des navettes. Plus tard encore, il vend son fil au tisserand, qui n’a jamais manié ni le marteau du forgeron, ni la pioche du cultivateur, ni la scie du mennisier. A mesure que chaque phase du travail est confiée à des mains uniquement consacrées à elle seule, à mesure que le travail se divise, le produit final devient de plus en plus parfait. Eh bien! il en est de même chez les animaux. Pour assurer la nutrition et la reproduction, c’est à dire la conservation de l’individu et de l’espèce, bien des fonctions secondaires sont nécessairement mises en jeu Pour que leur accomplissement soit à la fois facile et entier, il faut que chacune d’elles dispose d’un organe ou instrument physiologique spécial. En d’autres termes, il faut que le travail fonctionnel soit divisé autant que possible. Tel est le caractère général des types les plus élevés, par exemple de la plupart des mammifères. Au contraire, dans les types inférieurs, deux ou plusieurs fonctions sont attribuées au même organe, et enfin dans les éponges, les amèbes, ces derniers représentants du règne animal, toutes les fonctions sont confondues dans une masse organisée, vivante, où l’on ne distingne plus qu’une pulpe homogene résultant de la fusion complète de tous les élements organiques. Il suit de là qu’un animal, qu’une organisation se dégrade toutes les fois que la division du travail fonctionnel tend à diminuer.”
Ce qui est vrai des animaux, conclut M. Frédéric Passy, est vrai des sociétés. Une société se dégrade toutes les fois que la division du travail fonctionnel tend à diminuer dans son sein.
Elle s’élève et s’accroit, au contraire, quand cette division augmente; et c’est, en effet, en divisant et ramifiant les voies déjà ouvertes qu’on avance dans toutes les carrières. Les sciences se partagent sans cesse sans se renier; l’industrie fait de même, et chaque division nouvelle est un organe nouveau, un sens nouveau, une fonction nouvelle acquis à l’humanité. FrÉdÉric Passy, Leçons d’économie politique, t. Ier, p. 243 (2e édition).
[9] J.-B. Say, Traité d’économic politique, liv. Ier, chap. VIII.
[10] Numéro du 15 juin 1851, t. XXIX, p. 117. — Reproduit dans les Questions d’économie politique et de droit public, t. Ier, p. 35.
[11] Dans son Histoire des prix, M. Tooke constate que les prix varient dans une proportion beaucoup plus considérable que les quantités.
“Il n’est pas rare de rencontrer, dit-il, des personnes qui, en raisonnant sur le prix du blé et des autres denrées, tiennent pour démontré que les variations dans les prix doivent être proportionnées ou à peu près aux variations des quantités qui se trouvent offertes au marché. Si les choses se passent autrement, elles ne manquent pas d’attribuer la cause de cette anomalie prétendue à quelque perturbation extraordinaire survenue dans la circulation ou à tout autre accident.... Mais l’histoire de notre agriculture prouve clairement qu’à toutes les époques d’abondance ou de rareté des récoltes, les variations des prix se sont manifestées dans une proportion supérieure, au delà de toute comparaison, à la différence des quantités. Cette histoire atteste encore qu’à toutes les époques de transition de la disette à l’abondance, l’agriculture a fait entendre des cris de détresse.”
“Le fait qu’un faible déficit dans la production du blé, relativement au taux moyen de la consommation, occasionne une hausse hors de proportion avec la grandeur du déficit, ce fait est démontré par l’histoire des prix, à des époques où rien dans la situation politique et commerciale du pays ne pouvait exercer une influence perturbatrice.”
Quelques écrivains, ajoute M. Tooke, ont essayé d’en déduire une règle exacte de proportion entre un déficit donné de la récolte et la hausse probable du prix. M. Tooke cite notamment Gregory King, qui a établi la règle de proportion suivante pour le prix du blé:
| Un déficit de: | Audessus du prix ordinaire. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 dixième élève le prix de. | 0.3 | dixièmes. | ||
| 2 | id. | id. | 0.8 | id. |
| 3 | id. | id. | 1.6 | id. |
| 4 | id. | id. | 2.8 | id. |
| 5 | id. | id. | 4.5 | id. |
“Mais M. Tooke ne croit pas qu’une règle semblable puisse être établie, et il se fonde sur ce que les déficits constatés des récoltes ont amené des variations fort irrégulières dans les prix.”
“Tout ce qu’on peut affirmer, en termes généraux, dit-il, c’est qu’un déficit dans l’approvisionnement du blé, bien plus que dans celui d’un grand nombre d’autres articles, provoque une augmentation de prix qui dépasse beaucoup la proportion du déficit. Et, après un peu de réflexion, la raison de ce fait devient aussi sensible que le fait même après l’observation la plus superficielle.”
“La hausse, au delà de la proportion du déficit, est occasionnée par la concurrence de ceux qui vont acheter leurs approvisionnements ordinaires de subsistances, et qui n’en trouvent pas assez ou du moins pas autant que de contume. Un déficit étant donné, la proportion dans laquelle le prix haussera dépendra des moyens pécuniaires des plus basses classes de la société. Dans les pays où les moyens pécuniaires des classes inférieures sont limités au pouvoir d’obtenir une subsistance grossière, comme en Irlande et dans beaucoup de parties du continent, et où ni le gouvernement, comme en France, ni les lois des pauvres et les contributions volontaires des riches, comme en Angleterre, ne suppléent à ces ressources devenues insuffisantes aux époques de disette, une portion de la population, plus ou moins considérable, selon la rigueur de la disette, doit périr ou du moins souffrir tous les maux qui accompagnent l’insuffisance des approvisionnements et le remplacement de l’alimentation ordinaire par une alimentation inférieure et malsaine. La concurrence croissante des acheteurs étant ainsi bornée aux classes qui se trouvent au dessus des plus misérables, la hausse ne saurait s’élever beaucoup au dessus du déficit de la quantité. Mais, en France, où le gouvernement a coutume de pourvoir, dans les temps de disette, à la subsistance des classes inférieures, particulièrement à Paris; et, en Angleterre, où les lois des pauvres fournissent un fonds pour l’entretien des classes inférieures, et où les contributions volontaires des particuliers contribuent encore à grossir ce fonds, il est évident que la concurrence des acheteurs doit s’accroître bien davantage et le prix s’élever bien au dessus de la proportion du déficit.”
“... C’est au moyen d’une semblable augmentation de prix que les fermiers réalisent de grands profits pendant la durée de léurs baux, et que les propriétaires obtiennent des rentes élevées au renouvellement de ces baux.”
“Supposons que les prix s’élèvent seulement en proportion du déficit de la récolte; supposons qu’un acre de blé produise, dans une bonne année ordinaire, 33 boisseaux qui, vendus à raison de 6 sh. par boisseau, donnent liv. 9–18, et que, dans une mauvaise année, le même acre produise les deux tiers seulement de cette quantité ou 22 boisseaux. Si ceux-ci sont vendus à raison de 9 sh., le total sera encore de liv. 9–18, en admettant que les frais de culture demeurent les mêmes dans les deux cas. Le fermier ne perdra ni ne gagnera par le fait du déficit de la récolte (en supposant, bien entendu, que le déficit soit général). Ce sera une calamité générale dans laquelle fermiers et landlords auront leur part, à titre de consommateurs.”
“Mais, en vertu du principe qui vient d’être établi, la situation sera bien différente. Si le déficit est d’un tiers d’une récolte ordinaire, le boisseau de blé pourra s’élever à 18 sch. et au dessus. Or, 22 boisseaux à 18 sh. donneront liv. 19–10, alors que 33 boisseaux à 6 sh. ne donnaient que liv. 9–18; ce qui fait un bénéfice net de 100 pour 100 pour le producteur. A vrai dire, ceci est une situation extrême, laquelle ne pourrait se prolonger longtemps; elle suppose qu’il ne reste qu’un faible approvisionnement des années précédentes, et qu’on n’attend aucun secours immédiat de l’importation. Toutefois, si le déficit existe, en réalité ou seulement en appréhension, le résultat doit être celui-là; quelquefois même la hausse est beaucoup plus forte.”
“Pour mieux démontrer comment et à quel degré un déficit dans la récolte, comparativement à un produit moyen, affecte les intérêts de l’agriculture, faisons une nouvelle hypothèse. Supposons que la récolte soit de 32 millions de quarters de grains de toute sorte, dans une année ordinaire, et que cette quantité se vende en bloc à un prix rémunérateur de 40 sh. par quarter. Le produit sera de 64,000,000 de livres, à distribuer en salaires, profits et rentes, en y comprenant les dîmes. Mais arrive une mauvaise récolte, qui amène un déficit d’un huitième, non compensé par un excédant des années précédentes. Si le prix s’élève, comme la chose sera probable, jusqu’à 60 sh., 28 millions de quarters à 60 sh. produiront 84,000,000 de livres; ce qui fera 20,000,000 de livres de plus que dans le premier cas, à distribuer aux fermiers, au propriétaires et aux titulaires de la dîme....Si le déficit est d’un quart, et si le prix s’élève, — comme il le fera infailliblement, — au moins au double, le gain, pour ces classes de la population, sera le suivant:
32,000,000 de quarters à 40 sh. liv. st. 64,000,000 24,000,000 id à 80 id. 96,000,000 — Différence au profit des fermiers, des propriétaires, etc. 32,000,000 “’Il est certain que, dans cette éventualité, l’intérêt agricole jouirait non seulement de l’apparence, mais encore de la réalité des bénéfices de la propriété.... Mais il est certain aussi que le surcroît du revenu qui se trouverait distribué aux parties prenantes de l’intérêt agricole, déduction faite de l’augmentation de dépense qui incomberait aux propriétaires et aux fermiers en leur qualité de consommateurs, il est certain que ce surcroît de revenu leur serait acquis aux dépens des a utres membres de la communauté.” (Th. Tooke, A history of prices, vol. Ier, chap. II; Effects of quantity on prices, p. 10–17.)
[12] Adam Smith a parfaitement indiqué comment s’opère ce mouvement de gravitation, sans toutefois chercher à déterminer la force impulsive qui le provoque. Nous croyons utile, pour éclaircir cette matière si importante, de reproduire quelques-unes de ses lumineuses explications:
“Lorsque le prix d’une marchandise n’est ni plus ni moins que ce qu’il faut pour payer, selon leurs taux naturels, la rente de la terre, le salaire du travail et les profits des fonds employés à sa production, sa préparation et son transport au marché, la marchandise se vend alors ce qu’on peut appeler son prix naturel.”
“Elle se vend précisément ce qu’elle vaut ou ce qu’elle coῦte à la personne qui la met en vente. Car, quoique dans le langage ordinaire, ce qu’on nomme le premier coῦt d’une marchandise ne renferme pas le profit de celui qui doit la vendre ensuite, cependant, s’il la vend un prix qui ne lui rapporte pas le profit qu’on y fait ordinairement dans son voisinage, il perd évidemment à ce commerce, puisqu’en employant ses fonds dans un autre il aurait pu faire ce profit. D’ailleurs, son profit est son revenu et le fonds de sa subsistance. Comme il a avancé à ses ouvriers leur salaire et leur subsistance, il s’est avancé aussi la sienne, qui est généralement proportionnée au profit qu’il peut attendre de la vente de ses marchandises. A moins donc qu’il n’en retire ce profit, on peut dire proprement qu’elles ne lui rapportent pas ce qu’elles lui coῦtent réellement.”
“Ainsi, quoique le prix qui lui laisse ce profit ne soit pas toujours le plus bas auquel un marchand peut vendre quelquefois ses marchandises, il est le plus bas auquel il puisse les vendre habituellement et un long temps de suite, au moins s’il habite un pays où règne une pleine liberté et où il puisse changer de commerce quand il voudra.”
“Le prix actuel auquel se vend une marchandise est appelé le prix du marché; il peut être plus fort ou plus faible ou exactement le même que son prix naturel.”
“Le prix du marché, pour chaque marchandise particulière, est réglé par la proportion entre la quantité qu’on en apporte au marché et celle qu’en demandent les gens qui veulent en payer le prix naturel, c’est à dire toute la valeur de la rente, du travail et du profit qui doivent être payés pour qu’elle vienne au marché. On peut appeler ceux qui veulent en donner ce prix des demandeurs effectifs, et leur demande une demande effective, puisqu’elle suffit pour que la marchandise soit mise en vente. La demande absolue est différente. Un homme pauvre aura beau demander un carrosse à six chevaux et désirer d’en avoir un, jamais on ne mettra de carrosse et de chevaux en vente pour le contenter. Sa demande n’est done pas une demande effective.”
“Lorsque la quantité d’une marchandise qu’on apporte au marché est au dessous de la demande effective, il n’y en aura point assez pour fournir aux besoins de tous ceux qui sont résolus de payer toute la valeur de la rente, du salaire et du profit qui doivent être payés pour qu’elle y vienne. Plutôt que de s’en passer entièrement, quelques-uns des demandeurs en offriront davantage. Dès ce moment, il s’établira parmi eux une concurrence, et le prix du marché s’élèvera plus ou moins, selon que la grandeur du déficit augmentera plus ou moins l’ardeur des compétiteurs. Ce même déficit occasionnera généralement plus ou moins de chaleur dans la concurrence, selon que l’acquisition de la marchandise sera plus ou moins importante pour les compétiteurs. De là le prix exorbitant des choses nécessaires à la vie durant le blocus d’une ville ou dans une famine.”
“Lorsque la quantité qu’on apporte au marché est au dessus de la demande effective, on ne peut vendre le tout à ceux qui sont disposés à en payer le prix naturel, ou toute la valeur de la rente, etc. Il faut en vendre une partie à ceux qui en offrent moins et le bas prix qu’ils en donnent fait nécessairement une réduction sur le prix du tout. Le prix du marché baissera plus ou moins au dessous du prix naturel, selon que la grandeur du surabondant augmentera plus ou moins la concurrence des vendeurs, ou selon qu’il sera plus ou moins important pour eux de se défaire de la marchandise. La même surabondance dans l’importation des marchandises, qui peuvent se gâter et se perdre, comme les oranges, occasionnera une concurrence bien plus animée que ne le feront celles qui sont durables comme la ferraille.”
“Si la quantité portée au marché suffit juste pour fournir à la demande effective et rien de plus, le prix du marché sera exactement le même que le prix naturel ou il s’en approchera le plus près possible, autant qu’on en peut juger. Toute la quantité qu’il y en a peut être vendue à ce prix et pas plus cher. La concurrence des vendeurs les oblige à les donner pour cela et non pour moins.”
“La quantité de chaque marchandise apportée au marché se met naturellement de niveau avec la demande effective. Tous ceux qui emploient leur temps, leur travail et leurs fonds, sont intéressés à ce qu’elle n’excède pas cette proportion; et tous les autres sont intéressés à ce qu’elle y arrive toujours.”
“Si, en un certain temps, elle excède la demande effective, quelques-unes des parties constituantes de son prix seront nécessairement payées au dessous de leur taux naturel. Si c’est la rente, l’intérêt des propriétaires leur fera faire aussitôt un autre emploi d’une partie de leurs terres; et si c’est le salaire ou le profit, les ouvriers et ceux qui les mettent en œuvre feront un autre emploi d’une partie de leur travail et de leurs fonds. La quantité qu’on en apportera au marché ne sera bientôt plus que suffisante pour satisfaire à la demande effective; toutes les différentes parties de son prix remonteront à leur taux naturel et le prix total à son prix naturel.”
“Si, au contraire, la quantité portée au marché se trouve moindre que la demande effective, quelques parties constituantes de son prix s’élèveront au dessus de leur taux naturel. Si c’est la rente, l’intérêt de tous les autres propriétaires leur fera consacrer plus de terre à la culture de cette production; si c’est le salaire ou le profit, on y mettra plus de travail et plus de fonds. La quantité qu’on en portera au marché suffira bientôt pour satisfaire à la demande effective. Toutes les différentes parties du prix de la marchandise descendront bientôt à leur taux naturel et tout le prix reviendra à son taux naturel.”
“Ainsi le prix naturel est pour ainsi dire le prix central vers lequel gravitent continuellement les prix de toutes les marchandises. Divers accidents peuvent les tenir quelquefois suspendus assez haut au dessus de ce prix, et les faire descendre même quelquefois un peu plus bas. Mais, quels que soient les obstacles qui les empêchent de s’établir dans ce centre de repos et de stabilité, ils tendent constamment à s’y mettre.” (Adam Smith, la Richesse des nations, liv. Ier, chap. VII.)
Complétons ces observations par une description résumée de ce phénomène de gravitation économique, signalé par Adam Smith, et que nous avons cherché à déterminer d’une manière plus précise:”
‘“Le prix auquel les produits et les agents productifs se vendent ou se louent sur le marché, le prix courant dépend de la situation de l’offre et de la demande, ou, ce qui revient au même, du rapport des quantités offertes en échange. Or, comme il suffit que ce rapport soit légèrement modifié pour que le prix hausse ou baisse dans une progression rapide, voici ce qui se passe:”
“Lorsque le rapport des quantités de deux denrées offertes en échange est tel que le prix courant de l’une d’elles se trouve au dessous de la limite de ses frais de production, ceux qui offrent cette denrée ont intérêt à en retirer une portion du marché ou à en apporter moins, car le prix qu’ils obtiennent ne rémunère pas alors suffisamment les efforts que la production a coῦtés.”
“Lorsque, au contraire, le rapport des quantités est tel que le prix courant de l’une des denrées offertes en échange se trouve au dessus des frais de production, de nouveaux producteurs ont intérêt à offrir cette denrée. Car le prix courant renferme alors une véritable prime ou rente, en sus de la rémunération nécessaire des efforts que la production a coῦtés.”
“Dans l’un et l’autre cas, l’excitation à réduire ou à augmenter l’offre est d’autant plus vive et elle opère avec d’autant plus de promptitude qu’une modification du rapport des quantités agit plus efficacement sur les prix. Or, s’il suffit que ce rapport varie en raison arithmétique pour que les prix haussent ou baissent en raison géométrique, l’excitation à réduire ou à augmenter l’offre se trouve naturellement portée à un degré d’intensité considérable.”
“En conséquence, la production subit un mouvement irrésistible d’expansion ou de contraction, jusqu’à ce que le rapport des quantités soit tel que le prix courant des denrées réponde exactement à leurs frais de production, augmentés d’une part proportionnelle de produit net.” (Observations sur la formation des prix. Journal des économistes, tom. XXIX, p. 127.)
[13] Voir au sujet de cette industrie, les Soirées de la rue Saint-Lazare, chapitre XI, et les Questions d’économie politique et de droit public. De la production de la sécurité, t. II, p. 245.
[14] Voir le chapitre de la Spècialisation des industries et de l’échange.
[15] Dans les Soirées de la rue Saint-Lazare ou Entretiens sur les lois économiques, etc. Voici le passage auquel il est fait allusion ici:
“le socialiste.
“... Si le gouvernement, les départements et les communes cessaient complétement d’intervenir dans l’industrie des transports, dans la construction des routes, des canaux, des ponts, des rues, s’ils cessaient d’établir des communications entre les diverses parties du pays et de veiller à ce que les communications établies fussent maintenues, les particuliers se chargeraient-ils de cette tâche indispensable?
“l’Économiste.
“Croyez-vous que la pierre lancée dans les airs finira par tomber?
“le socialiste.
“C’est une loi physique!
“l’Économiste.
“Eh bien! c’est en vertu de la même loi physique que toutes les choses utiles, routes, ponts, canaux, pain, viande, etc., se produisent aussitôt que la société en a besoin. Lorsqu’une chose utile est demandée, la production de cette chose tend naturellement à s’opérer avec une intensité de mouvement égale à celle de la pierre quit tombe.
“Lorsqu’une chose utile est demandée sans être produite encore, le prix idéal, le prix qu’on y mettrait, si elle était produite, croît en progression géométrique à mesure que la demande croît en progression arithmétique. Un moment arrive où ce prix s’élève assez haut pour surmonter toutes les résistances ambiantes et où la production s’opère.
“Cela étant, le gouvernement ne saurait se mêler d’aucune affaire de production sans causer un dommage à la société.
“S’il produit une chose utile après que les particuliers l’eussent produite, il nuit à la societé, en la privant de cette chose dans l’intervalle.
“S’il la produit au moment même où les particuliers l’eussent produite, son intervention est encore nuisible, car il produit à plus haut prix que les particuliers.
“Si, enfin, il la produit plus tôt, la société n’est pas moins lésée......;vous vous récriez. Je vais vous le prouver.
“Avec quoi produit-on? Avec du travail et du capital. Comment une particulier qui entreprend une industrie nouvelle se procure-t-il du travail et du capital? En allant chercher des travailleurs et des capitaux dans les endroits où les services de ces agents de la production sont le moins utiles, où, en conséquence, on les paye le moins cher.
“Lorsqu’un produit nouveau est plus faiblement demandé que les produits anciens, lorsqu’on ne couvrirait pas encore ses frais en le créant, les particuliers s’abstiennent soigneusement de le créer. Ils n’en commencent la production qu’au moment où ils sont assurés de couvrir leurs frais.
“Où le gouvernement qui les devance va-t-il puiser le travail et le capital dont il a besoin? Il les puise où les particuliers les auraient puisés euxmêmes, dans la société. Mais en commençant une production avant que les frais en puissent encore être couverts, ou bien avant que les profits naturels de cette entreprise nouvelle soient au niveau de ceux des industries existantes, le gouvernement ne détourne-t-il pas les capitaux et les bras d’un emploi plus utile que celui qu’il leur donne? N’appauvrit-il pas la société au lieu de l’enrichir?
“Le gouvernement a entrepris trop tôt, par exemple, certaines lignes de canaux qui traversent des déserts. Le travail et le capital qu’il a consacrés à la construction de ces canaux, encore inachevés après un quart de siècle, étaient certainement mieux employés où il les a pris. En revanche, il a commencé trop tard et trop peu multiplié les télégraphes dont il s’est réservé le monopole ou la concession. Nous ne possédons que deux ou trois lignes de télégraphes électriques; encore sont-elles à l’usage exclusif du gouvernement et des compagnies de chemins de fer. Aux États-Unis, où cette industrie est libre, les télégraphes électriques se sont multipliés à l’infini et ils servent à tout le monde......” (Les Soirées de la ruè Saint-Lazare, huitième soirée, p. 219.)
[16] Dans certains pays où la sécurité n’a pas fait de progrès, dans la Calabre par exemple, l’enceinte des villes seule est habitée. C’est ainsi du moins que Paul Louis Courier peint la Calabre dans sa correspondance:
“Dans la Calabre actuelle, dit-il, ce sont des bois d’orangers, des forêts d’oliviers, des haies de citronniers. Tout cela sur la côte et seulement près des villes. Pas un village, pas une maison dans la campagne; elle est inhabitable, faute de police et de lois. Mais comment cultive-t-on? direz-vous? Le paysan loge en ville et laboure la banlieue; partant tard le matin, il rentre avant le soir. Comment oserait-on coucher dans une maison des champs? On y serait égorgé dès la première nuit.” (Paul Louis Courier, Correspondance. Lettre à M. de Sainte-Croix, datée de Mileto, 12 septembre 1806.)
[17] Simonde de Sismondi, Études sur l’économie politique, tom. Ier, p. 60.
[18] Dictionnaire de l’économie politique, art. Production.
[19] Jusqu’à une époque encore récente, la ligne de démarcation entre l’économie politique et la statistique est demeurée vague, indécise. Chacune de ces deux sciences empiétait fréquemment sur le domaine de l’autre et elles vivaient en assez mauvaise intelligence. Les économistes, et notamment J.B. Say, reprochaient aux statisticiens l’imperfection notoire des procédés dont ils se servaient pour recueillir les faits et l’assurance avec laquelle ils tiraient des conclusions positives de ces faits contestables. Les statisticiens, à leur tour, accusaient les économistes de vouloir imposer leurs théories sans tenir compte des faits. Dans le congrès général statistique, qui a eu lieu à Bruxelles en 1853, des représentants des deux sciences ont fait justice de ces vieux griefs, en déclarant avec raison que l’économie politique et la statistique s’éclairent et se complètent l’une par l’autre.
“En jetant les yeux sur cette réunion imposante, a dit l’illustre président du congrès, M. Quetelet, un fait bien significatif se révèle d’abord, et nous sommes heureux de pouvoir le constater, c’est la présence d’un grand nombre d’économistes du talent le plus distingué, présence qui proteste contre le prétendu divorce que quelques esprits chagrins ou superficiels voudraient voir prononcer entre la statistique et l’économie politique, entre l’observation et la science qui se doivent un appui mutuel et qui s’éclairent l’une l’autre. Sans doute, il est des écarts dont la statistique s’est rendue coupable, des abus auxquels elle s’est prêtée en voulant étayer de faux systèmes ou faire prévaloir des idées préconçues; sans doute, elle est sortie parfois des limites dans lesquelles elle doit se renfermer; mais les bons esprits n’ont jamais songé à proscrire une science, surtout une science naissante, pour s’être écartée parfois de la véritable direction. Combien de temps l’astrologie n’a-t-elle pas usurpé la place de la véritable science des astres; l’alchimie le rang de la science des Lavoisier et des Berzelius! Chaque science a débuté par des méprises, souvent méme par de déplorables abus. Ce qui peut nous étonner, ce n’est pas que la statistique ait erré; mais que, si près de sa naissance, elle ait déjà compris sa mission et senti le besoin de régulariser sa marche.”
Le regrettable M. Horace Say, qui s’est occupé avec succès de cette science si maltraitée par son illustre père, a insisté sur la même pensée et démontré spirituellement que les deux sciences sont intéressées à vivre en paix dans l’intérêt de leurs progrès respectifs.
“Pour rechercher les principes de la vie sociale, la production des richesses, leur répartition entre les individus, la consommation des produits, l’économiste est obligé de s’appuyer sur l’examen complet et exact des faits. La recherche de toutes ces données est confiée à la statistique. Pour que les déductions à tirer des faits soient possibles, il faut que la statistique soit bien faite. Un économiste ne peut être bon économiste sans consulter la statistique. De même, le statisticien ne peut observer les faits sans des connaissances économiques complètes. Comme l’a fait entendre notre honorable président, les deux sciences sont sœurs. Si, dans leur enfance, comme dans beaucoup de familles, elles se sont un peu chamaillées, elles comprennent cependant qu’elles doivent se prêter, dans le cours de leur carrière, un mutuel appui.” (Compte rendu du congrès général de statistique de 1853, p. 23 à 77.)
[20] Cette démonstration, M. Dunoyer l’a faite dans son beau traité De la liberté du travail, et reproduite avec plus de concision et de clarté encore dans l’article Production du Dictionnaire de l’économie politique. Nous croyons utile d’en citer un extrait, en engageant toutefois le lecteur à lire en entier ce morceau remarquable:
“On nie encore à l’heure qu’il est que les arts qui agissent directement sur les hommes ajoutent à la masse des richesses créées. La plupart des livres d’économie politique, jusqu’aux derniers, et y compris les meilleurs, ont été écrits dans la supposition qu’il n’y avait de richesses réelles ni de valeurs susceptibles d’être qualifiées de richesses que celles que le travail parvenait à fixer dans des objets matériels. Smith ne voit guère de richesse que dans les choses palpables. Say débute en désignant par le nom de richesses des terres, des métaux, des monnaies, des grains, des étoffes, etc., sans ajouter à cette énumération aucune classe de valeurs non réalisées dans la matière. Toutes les fois, selon Malthus, qu’il est question de richesses, notre attention se fixe à peu près exclusivement sur des objets matériels. Les seuls travaux, suivant Rossi, dont ait à s’occuper la science de la richesse sont ceux qui entrent en lutte avec la matière pour l’adapter à nos besoins. Sismondi ne reconnaît pas pour de la richesse les produits que l’industrie n’a pas revétus d’une forme matérielle. Les richesses, suivant Droz, sont tous les biens matériels qui servent à la satisfaction de nos besoins. L’opinion la plus vraie, ajoute-t-il, est qu’il faut la voir dans tous les biens matériels qui servent aux hommes. Enfin, l’auteur de ces lignes ne peut pas oublier qu’il a eu à soutenir, il y a à peine quelques mois, un long débat avec plusieurs économistes, ses collègues à l’Académie des sciences morales, sans réussir à leur persuader qu’il y a d’autres richesses que celles que l’on a si improprement appelées matérielles.”
“Non seulement on ne reconnait comme richesses que les valeurs réalisées dans des objets matériels, mais on déclare improductifs les arts qui n’exercent pas leur activité sur la matière, et nominativement ceux qui agissent directement sur l’homme. Smith, après en avoir fait l’énumération, les présente tous, depuis les plus nobles jusqu’aux plus vils, comme ne laissant après eux rien avec quoi l’on puisse acheter une quantité de travail pareille. Leur travail, ajoute-t-il, s’évanouit au moment méme où il est produit. Nous avons cité ailleurs les opinions d’une série d’économistes connus, qui disent tous la même chose. Tracy, Malthus, Sismondi, James Mill, parlaut du travail des magistrats, des instituteurs, des prêtres, des savants, des artistes, etc., disent de leurs services qu’ils ne sont fructueux qu’au moment méme où ils sont rendus, et qu’il n’en reste rien, ou qu’il n’en reste que des fruits intellectuels ou moraux, et qu’on ne thésaurise pus de ce qui n’appartient qu’à l’áme. Droz, que nous n’avions pas cité, après avoir présenté les arts qui agissent sur la matière, comme les seuls qui produisent la richesse, considère ailleurs ceux qui travaillent sur l’esprit comme ne la créant pas. J. B. Say, qui essaye d’innover sur ce point, présente comme productive toute la grande catégorie des travaux exécutés directement sur l’homme; mais, par une méprise qui l’empêche d’arriver à la vérité, il voit les produits de ces travaux dans les travaux mêmes, au lieu de les voir où ils sont, c’est à dire dans les résultats utiles et durables qu’ils laissent après eux; et, tout en les qualifiant de productifs, il est conduit à en dire tout ce que les autres disent pour établir qu’ils ne le sont pas, à savoir que leurs produits ne s’attachent à rien, qu’ils s’évanouissent à mesure qu’ils naissent, qu’il est impossible de les accumuler, qu’ils n’ajouten rien à la richesse sociale, qu’il y a même du désavantage à les multiplier, et que la dépense qu’on fait pour les obtenir est improductive.”
“Une grande singularité, c’est qu’au milieu de ce concert, pour déclarer improductifs les arts qui agissent directement sur le genre humain, ces économistes sont unanimes pour les trouver productifs quand ils les considèrent dans leurs conséquences, c’est à dire dans les utilités, les facultés, les valeurs qu’ils parviennent à réaliser dans les hommes. C’est ainsi qu’Adam Smith, après avoir dit, dans certains passages de son livre, que les gens de lettres, les savants et autres travailleurs de cette catégorie sont des ouvriers dont le travail ne produit rien, dit expressément ailleurs que les talents utiles, acquis par les membres de la société (talents qui n’ont pu être acquis qu’à l’aide de ces hommes qu’il appelle des travailleurs improductifs), sont un produit fixe et réalisé, pour ainsi dire, dans les personnes qui les possèdent et forment une partie essentielle du fonds général de la société, une partie de son capital fixe. C’est ainsi que J. B. Say, qui dit des mêmes classes de travailleurs que leurs produits ne sont pas susceptibles de s’accumuler, et qu’ils n’ajoutent rien à la richesse sociale, prononce formellement, d’un autre côté, que le talent d’un fonctionnaire public, que l’industrie d’un ouvrier (créations évidentes de ces hommes dont on ne peut accumuler les produits), forment un capital accumulé. C’est ainsi que M. de Sismondi, qui, d’une part, déclare improductifs les travaux des instituteurs, etc., affirme positivement, d’un autre côté, que les lettrés et les artistes (ouvrage incontestable de ces instituteurs) font partie de la richesse nationale. C’est ainsi que M. Droz, qui fait observer quelque part qu’il serait absurde de considérer la vertu comme une richesse proprement dite, termine son livre en disant qu’on tomberait dans une honteuse erreur si l’on considérait comme ne produisant rien la magistrature qui fait régner la justice, le savant qui répand les lumières, etc.”
“Cependant il tombe sous le sens que les mêmes travaux ne peuvent pas être simultanément productifs et non productifs, donner des produits qui tout à la fois s’évaporent et se fixent, qui s’évanouissent en naissant, et qui s’accumulent à mesure qu’ils naissent; et, en voyant à quelles contradictions arrivent sur ce point capital les fondateurs de la science, il est aisé de reconnaître que la question a besoin d’une explication plus satisfaisante que celle qu’ils en ont donnée. Cette explication, nous l’avons produite ailleurs, et nous croyons qu’elle a été péremptoire. Elle ressort, avec évidence, de la distinction toute naturelle qu’il y avait à faire entre le travail et ses résultats.”
“C’est, avons-nous dit, faute d’avoir distingué le travail de ses résultats que Smith et ses principaux successeurs sont tombés dans les contradictions qui viennent d’être signalées, et qu’ils ont si mal résolu la question de savoir s’il faut, oui ou non, considérer comme producteurs les arts dont l’activité s’exerce directement sur l’homme. Toutes les professions utiles, quelles qu’elles soient, celles qui travaillent sur les choses comme celles qui opèrent sur les hommes, font un travail qui s’évanouit à mesure qu’on l’exécute, et tous créent de l’utilité qui s’accumule à mesure qu’elle s’obtient. Il ne faut pas dire avec Smith que la richesse est du travail accumulé, il faut dire qu’elle est de l’utilité accumulée. Ce n’est pas le travail qu’on accumule, c’est l’utilité que le travail produit; le travail se dissipe à mesure qu’il se fait, l’utilité qu’il produit demeure.”
“Très assurément, la leçon que débite un professeur est consommée en même temps que produite, de même que la main-d’œuvre répandue par le potier sur l’argile qu’il tient dans ses mains; mais les idées inculquées par le professeur dans l’esprit des hommes qui l’écoutent, la façon donnée à leur intelligence, l’impression salutaire opérée sur leurs facultés affectives, sont des produits qui restent, tout aussi bien que la forme imprimée à l’argile par le potier. Un médecin donne un conseil, un juge rend une sentence, un orateur débite un discours, un artiste chante un air ou déclame une tirade: c’est là leur travail; il se consomme à mesure qu’il s’effectue, comme tous les travaux possibles; mais ce n’est pas leur produit, ainsi que le prétend à tort J. B. Say: leur produit, comme celui des producteurs de toute espèce, est dans le résultat de leur travail, dans les modifications utiles et durables que les uns et les autres ont fait subir aux hommes sur lesquels ils ont agi, dans la santé que le médecin a rendue au malade, dans la moralité, l’instruction, le goῦt qu’ont répandus le juge, l’artiste, le professeur. Or, ces produits restent, ils sont susceptibles de se conserver, de s’accroître, de s’accumuler, et nous pouvons acquérir plus ou moins de vertus et de connaissances, de même que nous pouvons imprimer à des portions quelconques de matière quelqu’une de ces utilités qui sont de nature à se fixer dans les choses, et qui leur donnent plus ou moins de valeur.”
“Il est vrai que l’instruction, le goῦt, les talents, sont des produits immatériels; mais en créons-nous jamais d’autres? Et n’est-il pas étonnant de voir J. B. Say en distinguer de matériels et d’immatériels, lui qui a si judicieusement remarqué que nous ne pouvons créer, pas plus qu’anéantir la matière, et qu’en toutes choses nous ne faisons jamais que produire des utilités, des valeurs? La forme, la figure, la couleur qu’un artisan donne à des corps bruts, sont des choses tout aussi immatérielles que la science qu’un professeur communique à des êtres intelligents; ils ne font que produire des utilités l’un et l’autre, et la seule différence réelle qu’on puisse remarquer entre leurs industries, c’est que l’une tend à modifier les choses, et l’autre à modifier les hommes.” (Charles Dunoyer, Dictionnaire de l’économie politique, art. Production.)
[21] Cabanis, Des rapports du physique et du moral de l’homme. Influence du régime sur les habitudes morales, t. II, p. 58.
[22] Les frais de l’entretien, c’est à dire le coῦt du travail de l’esclave, sont les mêmes, soit que le propriétaire l’emploie, soit qu’il le loue; la seule différence est que, dans le premier cas, c’est le propriétaire qui fait l’avance de ces frais, et que, dans le second, c’est celui qui prend l’esclave à loyer qui les avance.
Le prix que le propriétaire doit exiger pour le loyer nécessaire de l’esclave, s’il veut éviter des pertes, se réglera d’après les cinq évaluations suivantes:
- 1°D’après l’intérêt du capital que lui ont coῦté l’esclave et l’instruction qu’il lui a donnée pour améliorer ses facultés productives, c’est à dire pour lui faire apprendre un métier, et le mettre en état de travailler à une industrie quelconque;
- 2°D’après le remboursement de ce capital dans un intervalle de temps fixé d’après la probabilité de la durée de la vie de l’esclave, ordinairement plus courte que celle de l’ouvrier libre, à raison de ses plus grandes fatigues;
- 3°D’après les frais de son entretlen;
- 4°D’après le remboursement, avec intérêt, de la somme affectée à l’assurance de la vie de l’esclave, s’il y en a eu;
- 5°D’après les frais d’administration qu’exigent l’entretien de l’esclave et la surveillance de ses travaux, administration qui réclame plus de soins que celle de toute autre espèce de propriété, et qui par cette raison doit être plus dispendieuse. (FlorÈs Estrada. Cours éclectique d’économie politique. T. II, p. 115.).
[23]
“Sans pouvoir approfondir les desseins de la nature, dit à ce sujet l’auteur d’un remarquable ouvrage sur l’Union américaine, M. James Spence, nous savons qu’en fait il existe, dans la puissance intellectuelle des diverses races humaines, des différences aussi marquées et aussi irrémédiables que le sont celles de leurs types respectifs. En théorie, nous donnons à tout homme le titre de frère; mais prenons l’Esquimau ou l’Australien, et essayons de mettre la théorie en pratique: l’Australien est de tous les êtres humains le plus exempt d’entraves de tout genre. La liberté la plus parfaite est son partage. L’esclavage ne l’a jamais avili, il en ignore jusqu’au nom. Et cependant quelle est la somme d’intelligence du sauvage de l’Australie? Toute la culture d’une éducation européenne l’élèverait-elle à notre niveau? Que d’efforts n’a-t-on pas faits sous ce rapport et quel en a été le résultat? Le Nouveau Zélandais, bien moins libre, ayant même l’esclavage au nombre de ses institutions domestiques, aussi sauvage que son voisin, cannibale, il y a une génération à peine, lui est cependant bien supérieur en intelligence. L’un est plein de sentiments nobles et généreux, d’un esprit ouvert et loyal; l’autre aussi incapable de comprendre et d’éprouver ces sentiments-là que si ce n’était qu’une pauvre machine grossièrement façonnée à l’image d’un homme.”
“Et ces deux races, si radicalement différentes sous le rapport de l’intelligence, vivent sous la même latitude et sont proches voisines. S’il y a entre elles une différence aussi sensible, combien n’est-il pas plus facile encore de comprendre celle qui existe entre deux races dont l’une sort des sables brῦlants de l’Afrique et l’autre des régions tempérées de l’Europe? Si le nègre avait eu la même puissance intellectuelle que l’Européen, il n’eῦt pas laissé l’Afrique sans un monument, même de la forme la plus primitive. Qu’est-ce qui a empêché le nègre de s’élever au niveau de l’Arabe, par exemple? En résumé, nous ne voyons pas pourquoi on chercherait à dénaturer le fait ou pourquoi on le constaterait avec dépit. Mais ce qu’il y a de bien certain, c’est que si l’esprit du nègre peut être cultivé, amélioré, on ne peut pas l’élever au niveau de celui des Européens. Quand on voit dans la nature une loi générale de variété en toutes choses, dans l’instinct des animaux comme dans l’intelligence des individus, pourquoi vouloir présumer qu’il doit y avoir uniformité dans la puissance intellectuelle des différentes races humaines? L’esprit du nègre ne se prête ni aux réflexions sur passé ni à la prévision de l’avenir; il n’améliore rien, n’invente rien, ne découvre rien. Nous ne parlons, bien entendu, que de la race pure et sans mélange avec un autre sang; quelque part qu’on la prenne, en Afrique ou en Amérique, tels sont ses signes caractéristiques. Si cela était une fois bien compris, que de sympathies et de bienveillance ne feraient plus fausse route! Nous nous représentons toujours l’esclave animé de sentiments qui seraient les nôtres, si nous en étions réduits à sa condition, tandis qu’en réalité et la plupart du temps ces sentiments lui sont inconnus. Il lui est aussi naturel d’être esclave que ce serait monstrueux pour nous. La grande majorité des nègres, si on leur offrait la liberté, croiraient tout simplement qu’on veut les abandonner à eux-mêmes et les laisser mourir de faim. Ils sont nés comme cela, ils ont été élevés dans ces idées; leur passé ne leur rappelle pas une condition meilleure dont le souvenir les afflige; l’esclavage est pour eux l’état de vie ordinaire; ils n’ont jamais rien vu d’autre. Quand le nègre commande à ses compagnons d’esclavage, il leur fait accomplir leur tàche avec une sévérité toute particulière. Il fait peu de cas du blanc qui n’a pas d’esclaves. Il en aurait beaucoup et de sa race s’il en avait les moyens. Il n’a pas plus l’idée de s’enquérir de la justice ou de l’injustice de l’esclavage qu’il ne s’inquiète de la raison qui fait que la nuit succède au jour. Nous nous créons des sentiments imaginaires dont il n’éprouve rien, et nous déplorons des chagrins qui ne sont pas les siens, mais les nôtres.” (L’union AmÉricaine, ses effets sur le caractère national et politique, causes de sa dissolution, etc., par James Spence, p. 152.”
[24] Voir à ce sujet l’Enseignement obligatoire, discussion entre M. G. de Molinari et M. Frédéric Passy.
[25] Sous le prétexte de protéger la liberté personnelle, la plupart des législations ne permettent d’en disposer que dans les limites fort étroites, et elles rendent ainsi impossible la création d’une industrie spéciale de la tutelle de même que le développement du crédit hypothéqué sur les valeurs personnelles. Les engagements de travail mêmes sont limités à un an pour les simples ouvriers, du moins en France et en Belgique, en vertu de la loi du 22 germinal an II.
[26] Dictionnaire de l’Économie politique, art. Esclavage. Questions d’Économie politique et de droit public. L’abolition de l’esclavage aux colonies et aux États-Unis. T. Ier, p. 110.
[27] Un propriétaire, un fermier, un maître manufacturier, un marchand, peuvent généralement vivre une année ou deux des fonds qu’ils ont par devers eux, sans employer un seul ouvrier. La plupart des ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, fort peu l’espace d’un mois et presque aucun l’espace d’un an sans travailler. A la longue, le maître ne peut pas plus se passer de l’ouvrier que l’ouvrier du maître. Mais le besoin qu’il en a n’est pas si urgent. (Adam Smith. La richesse des nations. Liv. I, chap. VIII.)
[28] Dès l’époque où nous avons commencé à étudier la science économique, nous avons été particulièrement frappé de cette lacune de la publicité industrielle, et nous avons même, à diverses reprises, essayé de la combler. (Voir les Soirées de la rue Saint-Lazare, p. 172, et les Questions d’économie politique et du droit public, t. Ier, p. 183.) Mais nous avons pu nous convaincre, à nos dépens, que nos tentatives étaient prématurées; que la spécialisation et l’extension progressives du commerce de travail seules peuvent donner naissance à une publicité ad hoc, analogue à celle qui s’est créée à l’usage des autres branches de commerce, à mesure qu’elles se sont spécialisées et développées.
Nous croyons néanmoins utile de reproduire les considérations suivantes dans lesquelles se trouvent résumés les avantages que la publicité peut présenter aux travailleurs, avec cette seule réserve qui nous a été suggérée, depuis, par notre expérience personnelle, qu’en cette matière, comme en toute autre, le progrès ne peut s’improviser d’une manière artificielle.
“On a cru longtemps, on croit encore assez généralement que le taux des salaires dépend de la volonté des entrepreneurs; que les chefs d’industrie sont les maîtres de fixer à leur guise la rémunération de leur s ouvriers. Rien n’est plus inexact cependant. Il ne dépend pas plus des entreprencurs d’industrie de fixer le prix du travail que leurs ouvriers leur fournissent qu’il ne dépend d’eux de fixer le prix de la laine, du coton, de la soie, du fer, des machines, du combustible, des matières premières et des outils qu’ils emploient dans leur fabrication. Le travail est une marchandise, comme le coton, la laine, la soie, la houille, et son prix s’établit de la même manière que celui de ces autres matières premières indispensables à la production. C’est le mouvement de l’offre et de la demande qui en décide. Quand le travail est beaucoup demandé et peu offert, le salaire hausse, et vice versá. Cette loi est mathématique, elle régit le monde économique, comme la loi de la gravitation régit le monde physique.
“Les industriels et les négociants sont fort au courant de la loi de l’offre et de la demande, et ils agissent en conséquence. Quelle est, en effet, leur incessante préoccupation? C’est de bien connaître la situation des marchés où ils peuvent placer leurs marchandises, c’est d’être continuellement informés de la situation de leurs débouchés. Dans ce but ils entretiennent des correspondances suivies avec les principaux marchés. En outre, depuis quinze ou vingt ans, la presse, répondant à ce besoin général d’informations, s’est mise à publier régulièrement, non plus seulement le cours des fonds publics, mais encore celui des marchés les plus importants. En ouvrant son journal, l’industriel ou le négociant est informé du prix des fers, des huiles, du coton, de la laine, etc., dans les principaux marchés d’approvisionnement; on lui apprend même quelles ont été les quantités vendues, quel est l’état de la demande, et le stock restant disponible sur le marché. Enfin, le gouvernement se croit encoré obligé d’ajouter aux informations que le commerce reçoit de ses correspondances particulières et des bulletins de la presse quotidienne ou hebdomadaire, en entretenant des consuls, qui ont pour mission de tenir le commerce au courant de la situation des marchés étrangers, comme aussi de lui en faciliter l’accès.
“Que résulte-t-il de ce développement salutaire de la publicité industrielle et commerciale? C’est que les producteurs ne sont plus réduits, comme ils l’étaient trop souvent autrefois, à fournir leurs denrées à un petit nombre d’intermédiaires coalisés, qui les leur achetaient à un vil prix, en profitant de leur ignorance de l’état des marchés; c’est encore qu’ils ne sont plus exposés à fabriquer des masses de marchandises en vue d’un débouché qui se trouve déjà approvisionné d’une manière surabondante; c’est, pour tout dire, que la production a pu se régler, de plus en plus, conformément aux besoins de la consommation.
“Combien la situation des ouvriers, “marchands de travail,” est différente! Au lieu de leur faciliter le placement de leur denrée, on s’attache, au contraire, à ajouter des obstacles artificiels aux obstacles naturels qui les empêchent d’en tirer un bon parti. Veulent-ils, par exemple, s’associer, s’entendre pour aviser aux moyens d’obtenir une plus juste rémunération de leurs efforts? Aussitôt, on met à leurs trousses gendarmes et sergents de ville, et l’on condamne leurs “meneurs,” à des pénalités qui s’élèvent jusqu’à cinq années de prison, sous prétexte de coalition. Or, à la même époque et dans le même pays, où les associations d’ouvriers sont poursuivies avec cette rigueur impitoyable, on permet aux maîtres de forges de se réunir tous les trois mois pour fixer de commun accord le prix des fers. Et cette coalition des gros bénéficiaires du régime prohibitif paraît si assurée de l’impunité, qu’elle a l’impudence de faire annoncer dans les journaux les prix qu’il lui a plu d’imposer aux consommateurs. Il y a pis encore. Tandis qu’on entretient des agents consulaires à l’étranger pour faciliter le placement des produits de nos entrepreneurs d’industrie, tandis qu’on s’efforce d’attirer dans notre pays les commissionnaires étrangers, tandis qu’on récompense les industriels et les négociants qui réussissent à augmenter le débouché “du travail national,” on poursuit comme des malfaiteurs, les intermédiaires qui s’efforcent de procurer à nos travailleurs une situation plus favorable. Nous avons cité un arrêt qui a condamné à un an de prison un employé de la manufacture d’Oignies, coupable d’avoir procuré une situation meilleure, un salaire plus avantageux, à quelques-uns de ses compagnons de travail. (Le nommé Florent Goumans, ci-devant employé à la manufacture de glaces de Sainte-Marie d’Oignies, condamné par la cour d’appel de Bruxelles, à un an de prison et à 150 fr. d’amende, du chef d’avoir, en 1853 et 1854, dans la vue de nuire à l’industrie belge, fait passer en Prusse plusieurs ouvriers de ladite manufacture). Nous pourrions citer encore à Liége, une manufacture dont les chefs font métier de signaler à la police les étrangers qui viennent “embaucher” leurs ouvriers, c’est à dire leur offrir un salaire plus élevé, une existence moins misérable. Grâce à la complicité de la loi, les entrepreneurs d’industrie acheteurs de travail parviennent ainsi, dans la plupart des foyers de la production, à demeurer les maîtres absolus du marché, à dicter aux ouvriers les conditions du salaire. C’est un véritable monopole, dont ils sont investis, et le plus oppressif de tous! plus oppressif peut-être que l’esclavage même, car, au moins le maître est obligé de subvenir à l’entretien de son esclave, tandis que le monopoleur, qui se sert d’une loi inique pour empêcher le travailleur de tirer librement parti de ses facultés productives, n’a aucune obligation à remplir envers lui. C’est l’esclavage avec la responsabilité de moins et l’hypocrisie de plus! Aussi quel est le résultat de ce régime! C’est que le salaire, comprimé par le monopole de connivence avec la loi, est tombé au niveau du minimum de subsistances nécessaires au travailleur, pendant que le taux des rentes et des profits allait croissant; c’est que le prix des choses nécessaires à la vie venant soudainement à s’élever, tandis que le salaire comprimé dans son essor demeurait stationnaire, l’ouvrier n’a plus même obtenu le minimum qui lui était indispensable; c’est que les classes ouvrières ont vu décliner leurs forces, que ne réparait plus une alimentation suffisante; c’est qu’à Gand, par exemple, les fabricants eux-mêmes commencent à se plaindre de la difficulté d’obtenir des ouvriers valides, au sein d’une classe dont l’excès du travail, joint à l’insuffisance du salaire, a ruiné peu à peu la force physique et l’intelligence même.
“Eh bien! supposons qu’au lieu de s’attacher à mettre l’ouvrier à la merci des entrepreneurs de sa localité, on s’attache au contraire à écarter les obstables qui l’empêchent de tirer de ses facultés le meilleur parti possible; supposons qu’au lieu de le parquer dans un coin du marché du travail, sous la surveillance des agents de police et des gendarmes, comme un esclave dans une plantation, ou un malfaiteur dans une maison de force, on s’ingénie à lui faire connaître les différentes parties du marché général du travail, et à les lui rendre de plus en plus accessibles, supposons qu’au lieu d’empêcher les ouvriers de se réunir en vue du placement de leur travail, on les y encourage, supposons qu’on mette à leur service la publicité industrielle et commerciale, supposons que les journaux ajoutent aux cours des céréales, des cotons, des huiles, des fers, qui remplissent leurs dernières pages, les cours des principales sortes de travail, dans les foyers les plus importants de la production, supposons qu’ils tiennent désormais leurs lecteurs parfaitement au courant de l’état de l’offre et de la demande de cette espèce de marchandise, qu’ils indiquent et le nombre des engagements effectués, et l’état de la demande et le stock restant sur le marché, qu’arrivera-t-il?
“Ne verra-t-on pas s’opérer aussitôt dans la situation des classes ouvrières qui vivent du produit de leur travail, un changement analogue à celui qui s’est accompli dans la situation des entrepreneurs d’industrie, lorsque la publicité a mis ses fanaux à leur service? Au lieu de se faire unc concurrence à outrance dans les localités, où leur salaire est tombé au dessous du minimum de subsistances, ils porteront leurs facultés productives dans les endroits où elles sont le plus demandées, partant où elles sont le mieux payées. On ne verra plus, en conséquence, le travail arriver ici à l’état d’excédant et le salaire tomber à un niveau où la vie même du travailleur se trouve atteinte, tandis que là, le travail manque et le salaire monte à un taux exagéré. Il n’y aura plus dans un même pays une foule de petits marchés sans communication entre eux, et où les vendeurs de travail se trouvent à la merci de la coalition des acheteurs; il n’y aura plus qu’un marché général, dont le cours sera réglé d’après l’état de l’offre et de la demande.
“Que si ce marché général est encombré de bras ; que si un excédant de travail y pèse sur le taux du salaire, la publicité permettra encore aux travailleurs surabondants de se diriger vers les marchés étrangers où ils seront le plus assurés de trouver un débouché avantageux. L’émigration, qui n’est autre chose qu’une exportation de travail, n’aura plus lieu à l’aventure. Elle sera guidée par des renseignements positifs, et les hommes disposés à émigrer cesseront d’être retenus par l’appréhension des désastres qui atteignent trop souvent les émigrants, dans des contrées où ils croyaient trouver un bon placement, mais où l’affluence des bras a déjà encombré le marché. L’émigration prendra un cours à la fois plus régulier et plus abondant, elle emportera de plus en plus les excédants de bras qui pèsent sur nos marchés, et les salaires de l’Europe tendront à s’élever au niveau de ceux du nouveau monde, où l’abondance des agents naturels et la rareté du travail se combinent pour les maintenir au taux le plus avantageux possible.” (Économiste belge, 20 septembre 1855.)
[29] Sans parler des poètes. Dans le Marchand de Venise de Shakespeare, la question de la légitimité de l’intérêt donne lieu à une discussion des plus curieuses entre le juif Shylock et le marchand chrétien Antonio. Le juif Shylock, qui plaide pro domo sua en défendant l’usure, cite à l’appui de sa thèse les profits que Jacob faisait sur ses brebis. Son adversaire lui demande ironiquement si l’or et l’argent sont des brebis? Le juif ne trouve rien à répondre à un argument si péremptoire. Cela ne l’empêche pas de prêter ensuite au marchand de Venise une somme de 3 mille sequins, en stipulant que, si cette somme ne lui est pas restituée à l’échéance, il aura le droit de couper une livre de chair dans telle portion du corps de son débiteur qu’il lui plaira de choisir. Antonio qui a consenti à se soumettre à cette usure de cannibale, n’est pas en mesure de rembourser à l’échéance la somme empruntée. Shylock réclame impitoyablement son dῦ en invoquant la justice et la bonne foi. Le marchand de Venise est sur le point de devenir sa victime, lorsque la jeune et belle héroïne Porcia, déguisée en homme de loi, le tire d’affaire en remarquant que “le sang n’est pas entré daus le marché.” Shylock peut donc prendre sa livre de chair, à titre d’intérêt ou d’usure, mais sans une goutte de sang, — ceci sous peine de mort. Le marchand de Venise est sauvé. Cette fable, dont le génie de Shakespeare a tiré un parti si merveilleux, n’est-elle pas un spécimen curieux de l’ignorance du temps?
[30] Défense de l’usure, par JÉrÉmie Bentham, lettre X.
[31] Lettres de Calvin, citées par M. LÉon Faucher, article Intérét du Dictionnaire de l’économie politique.
[32] LÉon Faucher. Art. Intérét du Dictionnaire de l’économie politique.
[33] Conférences ecclésiastiques de Paris sur l’usure et la restitution, établies et imprimées par ordre de Mgr le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, 1756, t. I, p. 261.
[34] Conférences, t. I, p. 271.
[35] Assemblées des docteurs de Sorbonne, du 4 octobre 1665 et du 17 février 1666.
[36] Réplique des douze docteurs de Sorbonne, du 7 mai 1672.
[37] M. Proudhon n’appartient point, comme on sait, à l’école communiste, et, dans ses célèbres mémoires sur la propriété, ce grand agitateur d’idées a voulu seulement faire ressortir l’imperfection des théories reçues en démontrant que la propriété, telle que l’ont comprise de malhabiles défenseurs, n’est qu’une des formes de la spoliation. Mais il est à regretter qu’après avoir critiqué avec une impitoyable rudesse des théories imparfaites, l’illustre démolisseur n’ait pas su mettre à la place une théorie supérieure. Il n’en a pas moins rendu service à la science, en travaillant à la faire sortir de son ornière officielle.
Remarquons, à ce propos, que l’intervention du gouvernement dans l’enseignement et dans les associations scientifiques agit de nos jours à peu près comme agissaient autrefois le monopole des corporations enseignantes et l’intolérance religieuse pour empêcher la libre recherche de la vérité, en refrénant cette hardiesse aventureuse et sans souci du qu’en dira-t-on, qui peut seule amener le progrès des sciences. Nos jeunes professeurs craignent de se compromettre vis-à-vis du corps officiel auquel ils appartiennent et de devenir impossibles dans une académie, en hasardant des théories contraires à celles qui sont professées par les notabilités influentes, dont ils recherchent l’appui ou la voix. Quant aux savants qui ont une position acquise, ils marchent moins encore que ceux qui ont une position à acquérir. Marcher, en effet, c’est risquer de faire des faux pas, et les faux pas sont incompatibles avec le decorum académique. On préfère donc s’en tenir aux vérités acceptées ou convenues plutôt que d’en chercher de neuves au risque de se tromper, et cependant personne n’ignore qu’il faut bien oser risquer vingt erreurs pour mettre au jour une vérité. Il y a quelque apparence que cette extrême retenue des savants plus ou moins officiels a engendré par contre-coup l’extrême licence des socialistes, en la rendant même dans une certaine mesure nécessaire. Le socialisme a sans doute causé de grands maux. Mais la science, engravée dans l’ornière du patronage de l’État, aurait-elle marché si le socialisme ne l’avait poussée en avant?
[38] Quelques économistes, qui ne s’étaient point rendu compte des frais de production de la terre, ont cru que le travail de Dieu ou de la nature attribuait aux agents naturels appropriés une valeur particulière, dont le propriétaire foucier ne manquait pas de s’attribuer le bénéfice. C’était, comme on l’a fort bien remarqué, donner gain de cause aux partisans de la communauté des biens. Ricardo a parfaitement réfuté une opinion si erronée et si dangereuse, en démontrant que la collaboration de Dieu ou de la nature se retrouve dans tous les agents productifs et qu’elle est toujours gratuite.
“La nature, dit-il, ne fait-elle donc rien pour l’homme dans les manufactures? N’est-ce rien que la puissance du vent et de l’eau qui font aller nos machines et qui aident à la navigation? La pression de l’atmosphère et l’élasticité de la vapeur de l’eau, au moyen desquelles nous donnons le mouvement aux machines les plus étonnantes, ne sont-elles pas des dons de la nature? Pour ne rien dire des effets du calorique qui ramollit et fond les métaux, ni de la décomposition de l’air dans les procédés de la teinture et de la fermentation, il n’existe pas une seule espèce de manufacture dans laquelle la nature ne prête son aide à l’homme, et elle le fait toujours avec libéralité et gratuitement.” (Ricardo, Principes de l’économie politique et de l’impôt. — De la rente de la terre.)
[39]
“Chez nous, dit M. Boutowski, on évalue ordinairement les terres d’après le nombre des âmes. Il serait bien plus juste de les apprécier d’après la qualité de ces âmes. A l’état de libre culture, la fertilité du sol, la situation de la terre et le prix courant des produits seront toujours les régulateurs uniques de la rente foncière: dans la Russie d’Europe, à ces conditions vient s’en joindre une autre infiniment plus importante, et dont l’absence paralyse les avantages inhérents aux premières. Nous voulons parler des qualités morales et physiques des serfs que le propriétaire emploie pour la culture de sa terre. Il n’y a pas à douter qu’à l’aide d’un nombre égal de serfs, sur une égale étendue de terrain, avec le me∘me capital et dans des conditions équivalentes de fertilité, de situation et de prix courant, de deux seigneurs celui-là obtiendra un revenu plus considérable qui aura en partage des serfs plus aptes au travail et d’une conduite meilleure.
“Le revenu d’un bien auquel se trouvent attachés des serfs se décompose en deux parties diverses: en revenu provenant de l’exploitation seigneuriale proprement dite (ousadjba), et en revenu provenant de la redevance que les serfs payent pour eux et pour la terre qu’ils occupent.
“...Peut-on comparer cette redevance du serf au fermage payé par un libre contractant? Sans aucun doute, une partie de cette redevance présente toutes les propriétés du fermage, mais il y entre un tribut personnel, auquel ne se trouve jamais assujetti le fermier libre. Ce tribut frappe le travail du paysan, même lorsqu’il ne jouit pas de la terre. La domesticité et l’obroc (redevance en argent) payé par les serfs autorisés à se rendre dans les villes pour y exercer certaines industries, sont des modes de paiement de ce tribut, que les serfs jouissent ou non de la terre. Cette contribution personnelle, espèce de capitation, constitue toujours au profit du seigneur un revenu net; mais la source de ce revenu n’est pas, comme celle de la rente foncière, dans les avantages naturels de la terre occupée par les paysans; elle est dans le travail de ces derniers. La partie de la redevance du serf, constituant la rente foncière proprement dite, ne peut exister que sous certaines conditions spéciales.
“Si le prix courant des produits est si bas, qu’il couvre à peine les frais de production sur les terres les plus fertiles, le seigneur ne pent exiger du paysan aucune rente, et même le tribut personnel doit être très modéré, pour ne pas écraser le paysan sous un fardeau trop lourd. Dans une pareille situation, ce tribut est généralement acquitté en corvées; le paysan n’est pas en état de payer le moindre obroc en argent, par suite du bas prix des produits, aussi bien que par suite de l’incapacité ou de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de les vendre aux marchés les plus rapprochés. Dans de telles conditions, une corvée trop lourde, qui enlèverait trop de travail aux paysans, pourrait les ruiner complétement. Vous entendrez souvent dire aux seigneurs de quelques districts qu’ils ne peuvent supporter la dépense d’un travail loué; cela se conçoit, car le prix courant de la localité ne leur permet de tirer de la terre que les moyens de subsister, et tout leur revenu net ne consiste qu’en un tribut personnel des serfs, lequel serait complétement, et même au delà, absorbé par le salaire.
“Dans les districts où le prix courant des produits est plus élevé, la corvée fournit aux seigneurs, non seulement un tribut personnel, mais encore une rente foncière.” Alexandre Boutowski, Essai sur la richesse nationale et sur les principes de l’économie politique.
L’auteur des Études sur les forces productives de la Russie, M. de Tegoborski, donne sur la situation économique de ce pays, avant l’abolition du servage, des renseignements qui concordent de tous points avec ceux-là
“Par suite de la disproportion qui existe, dit-il, dans une grande partie de l’empire, entre la population et l’étendue du sol, nous nous trouvons, en ce qui concerne la valeur des terrains productifs et la valeur du travail, dans une situation tout à fait différente de celle de tous les autres pays. Ailleurs le terrain a ordinairement plus de valeur que le travail; chez nous c’est l’inverse. Dans les estimations des biens-fonds, c’est ordinairement le nombre des paysans, et non l’étendue du sol productif, qui sert de base. La fécondité du sol entre bien pour quelque chose dans cette estimation, et c’est de là que dérive la différence de la valeur du paysan d’un gouvernement à l’autre, mais ce n’est toujours qu’un élément secondaire du prix estimatif. Par une suite naturelle de cet état de choses, on s’attache bien moins à tirer du sol le plus grand parti possible, à en maintenir la fertilité ou à l’augmenter qu’à utiliser le plus avantageusement les bras dont on peut disposer. Ce rapport entre la valeur du sol et celle du travail commence déjà à se modifier dans quelques contrées, car il y a telle province où les terrains, sans paysans attachés à la glèbe, n’avaient presque pas de valeur et se vendaient, il y a vingt ou trente ans, à cinq roubles la dessiatine, qui se payent aujourd’hui au quintuple et même au décuple de ce prix. C’est surtout dans la Nouvelle-Russie que ce changement favorable dans la valeur des biens-fonds s’est opéré avec le plus de rapidité. Ainsi, par exemple, dans le gouvernement de Kherson, une dessiatine de bonne terre se vendait, en 1810, un double assignat et même au dessous. Vers 1815 on la payait déjà cinq ou six roubles assignats. Maintenant le prix est de dix roubles argent, et il n’y a que quelques contrées où l’on puisse en acheter encore à moins de quatre roubles argent la dessiatine.
“Ce progrès s’étendra sans doute de plus en plus avec l’accroissement de la population; mais il n’en est pas moins vrai que l’état anormal que nous venons de signaler est pour le moment et sera, probablement encore longtemps, dans la plus grande partie de la Russie, le trait caractéristique de notre situation agricole.” L. de Tegoborski, Études sur les forces productives de la Russie, t. Ier, p. 314.
[40] Je crois utile de reproduire ici cette théorie, telle que l’illustre économiste anglais l’a formulée lui-même. Il serait impossible d’exposer, dans un langage plus net et plus scientifique, le phénomène de l’accroissement successif du prix courant de vente ou de location du sol, soit que ce prix se borne à atteindre le niveau du prix naturel, soit qu’il vienne à le dépasser.
“La rente est cette portion du praoduit de la terre que l’on paye au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. Cependant on confond souvent la rente avec l’intéret et le profit du capital, et dans le langage vulgaire on donne le nom de rente à tout ce que le fermier paye annuellement au propriétaire.
“Supposons deux fermes contiguës, ayant une même étendue et un sol d’une égale fertilité, mais dont l’une, pourvue de tous les bâtiments et instruments utiles à l’agriculture, est de plus bien entretenue, bien fumée et convenablement entourée de haies, de clôtures et de murs, tandis que tout cela manque à l’autre. Il est clair que l’une s’affermera plus cher que l’autre; mais dans les deux cas on appellera rente la rémunération payée au propriétaire. Il est cependant évident qu’une portion seulement de l’argent serait payée pour exploiter les propriétés naturelles et indestructibles du sol, le reste représenterait l’intérêt du capital consacré à amender le terrain et à ériger les constructions nécessaires pour assurer et conserver le produit. Adam Smith donne parfois au mot rente le sens rigoureux dans lequel je cherche à le restreindre, mais le plus souvent il l’emploie dans le sens vulgairement usité.... Quand je parlerai de la rente, je ne désignerai sous ce mot que ce que le fermier paye au propriétaire pour le droit d’exploiter les facultés primitives et indestructibles du sol.
“Lorsque des hommes font un premier établissement dans une contrée riche et fertile, dont il suffit de cultiver une très petite étendue pour nourrir la population, ou dont la culture n’exige pas plus de capital que n’en possèdent les colons, il n’y a point de rente; car qui songerait à acheter le droit de cultiver un terrain, alors que tant de terres restent sans maître et sont par conséquent à la disposition de quiconque voudrait les cultiver?
“Par les principes ordinaires de l’offre et de la demande, il ne pourrait être payé de rente pour la terre, par la même raison qu’on n’achète point le droit de jouir de l’air, de l’eau, ou de tous les autres biens qui existent dans la nature en quantités illimitées. Moyennant quelques matériaux, et à l’aide de la pression de l’atmosphère et de l’élasticité de la vapeur, on peut mettre en mouvement des machines qui abrégent considérablement le travail de l’homme; mais personne n’achète le droit de jouir de ces agents naturels, qui sont inépuisables et que tout le monde peut employer. De même le brasseur, le distillateur, le teinturier emploient continuellement l’air et l’eau dans la fabrication de leurs produits; mais comme la source de ces agents est inépuisable, ils n’ont point de prix. Si la terre jouissait partout des mêmes propriétés, si son étendue était sans bornes, et sa qualité uniforme, on ne pourrait rien exiger pour le droit de la cultiver, à moins que ce ne fῦt là où elle devrait à sa situation quelques avantages particuliers. C’est donc uniquement parce que la terre varie dans sa force productive, et parce que, dans le progrès de la population, les terrains d’une qualité inférieure, ou moins bien situés, sont défrichés, qu’on en vient à payer une rente pour avoir la faculté de les exploiter. Dès que par suite des progrès de la société on se livre à la culture des terrains de fertilité secondaire, la rente commence pour ceux des premiers, et le taux de cette rente dépend de la différence dans la qualité respective des deux espèces de terre.
“Dès que l’on commence à cultiver des terrains de troisième qualité, la rente s’établit aussitôt pour ceux de la seconde, et est réglée de même par la différence dans leurs facultés productives. La rente des terrains de première qualité hausse en même temps, car elle doit se maintenir toujours au dessus de celle de la seconde qualité, et cela en raison de la différence de produits que rendent ces terrains avec une quantité donnée de travail et de capital. A chaque accroissement de population qui force un peuple à cultiver des terrains d’une qualité inférieure pour en tirer des subsistances, le loyer des terrains supérieurs haussera.
“Supposons que les terrains n°s 1, 2, 3, rendent, moyennant l’emploi d’un même capital, un produit net de 100, 90 et 80 quarters (∗) de blé. Dans un pays neuf où il y a quantité de terrains fertiles, par rapport à la population, et où par conséquent il suffit de cultiver le n° 1, tout le produit net restera au cultivateur, et sera le profit du capital qu’il a avancé. Aussitôt que l’augmentation de population sera devenue telle qu’on soit obligé de cultiver le n° 2, qui ne rend que 90 quarters, les salaires des laboureurs déduits, la rente commencera pour les terres n° 1; car il faut, ou qu’il y ait deux taux de profits du capital agricole, ou que l’on enlève dix quarters de blé ou leur équivalent, du produit n° 1 pour les consacrer à un autre emploi. Que ce soit le propriétaire ou une autre personne qui cultive le terrain n° 1, ces dix quarters en constitueront toujours la rente, puisque le cultivateur du n° 2 obtiendrait le même résultat avec son capital, soit qu’il cultivât le n° 1, en payant dix quarters de blé de rente, soit qu’il continuât à cultiver le n° 2 sans payer de loyer. De même, il est clair que lorsqu’on aura commencé à défricher les terrains n° 2, la rente du n° 2 devra être de dix quarters de blé ou de leur valeur, tandis que la rente du n° 1 devra atteindre vingt quarters; le cultivateur du n° 3 ayant le même profit, soit qu’il cultive le terrain n° 1 en payant vingt quarters de rente, soit qu’il cultive le n° 2 en en payant dix, soit enfin qu’il cultive le n° 3 sans payer de rente.
(∗) Un quarter équivant à 2 hectolitres 90, 784.
“Il arrive assez souvent qu’avant de défricher les n°s 2, 3, 4, ou les terrains de qualité inférieure, on peut employer les capitaux d’une manière plus productive dans les terres déjà cultivées. Il peut arriver qu’en doublant le capital primitif employé dans le n° 1, le produit, quoiqu’il ne soit pas doublé ou augmenté de cent quarters, augmente cependant de quatre-vingt-cinq quarters, quantité qui surpasse ce que pourrait rendre ce capital additionnel, si on le consacrait à la culture du terrain n° 3.
“Dans ce cas, le capital sera employé de préférence sur le vieux terrain, et constituera également une rente: la rente étant toujours la différence entre les produits obtenus par l’emploi de deux quantités égales de capital et de travail. Si avec un capital de 1,000 l. st. un fermier retirait de sa terre cent quarters de blé, et que par l’emploi d’un second capital de 1,000 l. st., il eῦt un surcroît de produits de quatre-vingt-cinq quarters, son propriétaire serait en droit, à l’expiration du bail, d’exiger de lui quinze quarters ou une valeur équivalente, à titre d’augmentation de rente; car il ne peut y avoir deux taux différents pour les profits. Si le fermier consent à payer quinze quarters de blé en raison de l’augmentation de produits obtenue par l’addition de 1,000 l. st. de capital, c’est parce qu’il ne saurait en faire un emploi plus profitable. Ce serait là le taux courant proportionuel des profits; et si l’ancien fermier n’acceptait pas la condition, un autre se présenterait bientôt, prêt à payer au propriétaire un excédant de rente proportionné au profit additionnel qu’il pourrait retirer de sa terre.
“Dans ce cas, comme dans le précédent, le dernier capital employé ne donne pas de rente. Le fermier paye, à la vérité, quinze quarters de rente, eu égard à l’augmentation du pouvoir productif des premières 1,000 l. st.; mais pour l’emploi des secondes 1,000 l. st., il ne paye pas de rente. S’il venait à employer sur la même terre un troisième capital de 1,000 l. st., produisant en retour soixante quinze quarters de plus, il payerait alors pour le second capital de 1,000 l. st., une rente qui serait égale à la différence entre le produit des deux capitaux, c’est à dire à deux quarters; la rente des premières 1,000 l. st. hausserait de quinze à vingt-cinq quarters; et les dernières 1,000 l. st. ne payeraient point de rente.
“S’il y avait donc beaucoup plus de terres fertiles qu’il n’en faut pour fournir les subsistances nécessaires à une population croissante, ou s’il était possible d’augmenter le capital employé à la culture des vieux terrains, sans qu’il y eῦt aucune diminution de produits, la hausse des rentes deviendrait impossible, la rente étant l’effet constant de l’emploi d’une plus grande quantité de travail donnant moins de produits.
“Les terres les plus fertiles et les mieux situées seraient les premières cultivées, et la valeur échangeable de leurs produits serait réglée, comme celle des autres denrées, par la somme de travail nécessaire à leur production et à leur transport jusqu’au lieu de la vente.
“La valeur échangeable d’une denrée quelconque, qu’elle soit le produit d’une manufacture, d’une usine, ou de la terre, n’est jamais réglée par la plus petite somme de travail nécessaire pour sa production dans des circonstances extrêmement favorables, et qui constituent une sorte de privilége. Cette valeur dépend au contraire de la plus grande quantité de travail industriel que sont forcés d’employer ceux qui n’ont point de pareilles facilités, et ceux qui, pour produire, ont à lutter contre les circonstances les plus défavorables. Nous entendons par circonstances les plus défavorables celles sous l’influence desquelles il est plus difficile d’obtenir la quantité nécessaire de produits.
“C’est ainsi que dans un établissement de bienfaisance où l’on fait travailler les pauvres au moyen de dotations, le prix des objets qui y sont fabriqués sera, en général, réglé, non d’après les avantages particuliers accordés à cette sorte d’ouvriers, mais d’après les difficultés ordinaires et naturelles que tout autre ouvrier aura à surmonter. Le fabricant qui ne jouirait d’aucun de ces avantages pourrait, à la vérité, n’être plus en état de soutenir la concurrence, si ces ouvriers favorisés pouvaient suppléer à tous les besoins de la société; mais s’il se décidait à continuer son industrie, ce ne serait qu’autant qu’il retirerait toujours de son capital les profits ordinaires, ce qui ne pourrait arriver s’il ne vendait ses articles à un prix proportionné à la quantité de travail industriel consacré à leur production.
“...Ce qui fait donc hausser la valeur comparative des produits naturels, c’est l’excédant de travail consacré aux dernières cultures, et non la rente qu’on paye au propriétaire. La valeur du blé se règle d’après la quantité de travail employée à le produire sur les dernières qualités de terrains ou d’après cette portion de capital qui ne paye pas de rente. Le blé ne renchérit pas, parce qu’on paye une rente; et l’on a remarqué, avec raison, que le blé ne baisserait pas lors même que les propriétaires feraient l’entier abandon de leurs rentes. Cela n’aurait d’autre effet que de mettre quelques fermiers dans le cas de vivre en seigneurs, mais ne diminuerait nullement la quantité de travail nécessaire pour faire venir des produits bruts sur les terrains cultivés les moins productifs.
“Rien n’est plus commun que d’entendre parler des avantages que possède a terre sur toute autre source de production utile, et cela en raison du surplus qu’on en retire sous la forme de rente. Et cependant à l’époque où les terrains sont le plus fertiles, le plus abondants, le plus productifs, ils ne donnent point de rente; et ce n’est qu’au moment où ils s’appauvrissent, — le même travail donnant moins de profit, — qu’on détache une partie du produit primitif des terrains de premier ordre, pour le paiement de la rente. Il est assez singulier que cette qualité de la terre, qui aurait dῦ être regardée comme un désavantage, si on la compare aux agents naturels qui secondent le manufacturier, ait été considérée au contraire comme ce qui lui donnait une prééminence marquée. Si l’eau, l’air, l’élasticité de la vapeur et la pression de l’atmosphère pouvaient avoir des qualités variables et limitées; si l’on pouvait, de plus, se les approprier, tous ces agents donneraient une rente, qui se développerait à mesure que l’on utiliserait leurs différentes qualités. Plus on descendrait dans l’échelle des qualités, et plus hausserait la valeur des produits fabriqués avec ces agents, parce que des quantités égales de travail industriel donneraient moins de produits. L’homme travaillerait plus de son corps, la nature ferait moins, et la terre ne jouirait plus d’une prééminence fondée sur la limitation de ses forces.
“Si l’excédant de produit qui forme la rente des terres est réellement un avantage, il est à désirer alors que, tous les ans, les machines récemment construites deviennent moins productives que les anciennes. Cela donnerait, en effet, plus de valeur aux marchandises fabriquées, non seulement avec ces machines, mais avec toutes celles du pays; et l’on payerait alors une rente à tous ceux qui posséderaient les machines les plus productives.
“La hausse des rentes est toujours l’effet de l’accroissement de la richesse nationale et de la difficulté de se procurer des subsistances pour le surcroît de population: c’est un signe, mais ce n’est jamais une cause de la richesse; car la richesse s’accroît souvent très rapidement pendant que la rente reste stationnaire, ou même pendant qu’elle baisse. La rente hausse d’autant plus rapidement que les terrains disponibles diminuent de facultés productives. Là où la richesse augmente avec le plus de vitesse, c’est dans les pays où les terres disponibles sont le plus fertiles, où il y a le moins de restrictions à l’importation, où, par des améliorations dans l’agriculture, on peut multiplier les produits, sans aucune augmentation proportionnelle dans la quantité de travail, et où, par conséquent, l’accroissement des rentes est lent (∗).”
(∗) Ricardo, Principes de l’économie politique, chap. II. — De la rente de la terre.
Ricardo remarque ensuite que les améliorations en agriculture, et particulièrement celles qui développent les facultés productives du sol, ont pour résultat de diminuer la rente, en permettant d’abandonner la culture des terrains de qualité inférieure. Si ces améliorations étaient considérables, il pourrait arriver, ajoute-t-il, que la rente de la terre baisserait quand même la population croîtrait en nombre et en richesse.
(Note de la page 378) Dans un ouvrage intitulé: An inquiry into the nature of the cornlaws, etc. — Recherches sur la nature des lois relatives aux céréales, etc. Édimbourg, 1777, in-8°.
[41] Assertion de M. Carey.
[42] Assertion de M. Fontenay. — Du revenu foncier.
Dans cet ouvrage, où se manifestent d’ailleurs les plus rares qualités de style et de pensée, M. de Fontenay prétend encore que le salaire des ouvriers a triplé depuis un siècle. Or, comme il y a un siècle, les ouvriers ne pouvaient recevoir moins que la somme nécessaire pour s’entretenir et se renouveler, il s’ensuivrait qu’ils recevraient de nos jours trois fois plus qu’il ne leur faut pour subvenir à leur entretien et à celui de leur famille. Je laisse à juger si les faits s’accordent avec la théorie de M. de Fontenay.
[43] Voir à ce sujet une savante note de M. Joseph Garnier, dans l’appendice de l’Essai sur le principe de la population de Malthus. — Collection complète des principaux économistes. T. VII, p. 654, 2e édition.
[44] La période moyenne de doublement de la population des seize États les plus importants de l’Europe, d’après la proportion d’accroissement constatée pendant des périodes diverses, est, en chiffres ronds, de 109 ans. Ce terme varie entre 49 ans pour l’Angleterre et 185 ans pour la Bavière. Après l’Angleterre, les États pour lesquels la période de doublement est le plus rapide sont: la Norwége (54 ans); la Saxe (59); la Prusse (69); le Danemark (72); la Suède (78); la Belgique (82); la Suisse (101); le Hanovre (107); le Wurtemberg (120); le Portugal (123); les États Sardes (124); la France (128); l’Autriche (172); la Bavière (185). (Alf. Legoyt, Dictionnaire de l’économie politique, art. Population.)
[45]
Bien que quelques espèces soient actuellement en voie de s’accroître en nombre plus ou moins rapidement, il n’en saurait être de même pour la généralité, car le monde ne les contiendrait pas. Cependant c’est une règle sans exception que chaque être organisé s’accroisse selon une progression si rapide, que la terre serait bientôt couverte par la postérité d’un seul couple, si des causes de destruction n’intervenaient pas. Même l’espèce humaine, dont la reproduction est si lente, peut doubler en nombre dans l’espace de vingt-cinq ans; et, d’après cette progression, il suffirait de quelques mille ans pour qu’il ne restât plus la moindre place pour sa multiplication ultérieure. Linnée a calculé que si une plante annuelle produit seulement deux graines, et il n’est point de plante qui soit si peu féconde, que si ces deux graines, venant à germer et à croître, en produisent chacune deux autres l’année suivante, et ainsi de suite, en vingt années seulement l’espèce possédera un million d’individus. On sait que l’éléphant est le plus lent à se reproduire de tous les animaux connus, et j’ai essayé d’évaluer au minimum la progression probable de son accroissement. C’est rester au dessous du vrai que d’assurer qu’il se reproduit dès l’âge de trente ans et continue jusqu’à quatre-vingt-dix ans, après avoir donné trois couples de petits dans cet intervalle. Or, d’après cette supposition, au bout de cinq cents ans il y aurait quinze millions d’éléphants descendus d’une première paire.
Mais nous avons d’autres preuves de cette loi que des calculs purement théoriques: ce sont les cas nombreux de multiplication étonnamment rapide des divers animaux à l’état sauvage, lorsque les circonstances ont été favorables pendant deux ou trois saisons successives seulement. L’exemple de plusieurs d’entre nos races domestiques redevenues sauvages en diverses parties du monde est encore plus frappant. Si les faits constatés dans l’Amérique du sud et dernièrement en Australie, sur la multiplication des bœufs et des chevaux, n’étaient parfaitement authentiques, ils seraient incroyables.
Il en est de même des plantes: on peut eiter des espèces végétales nouvellement introduites en certaines îles où elles sont devenues très communes en moins de dix années. Plusieurs plantes, telles que le cardon culinaire et un grand chardon, qui sont maintenant extrêmement communs dans les vastes plaines de la Plata, où elles recouvrent des lieues carrées de surface presqu’à l’exclusion de toute autre plante, ont été apportées d’Europe; et je tiens du docteur Falconer que, dans l’Inde, certaines plantes qui s’étendent aujour-d’hui depuis le cap Comorin jusqu’à l’Himalaya, ont été importées d’Amérique depuis sa découverte.
En ces divers cas, et en chacun des exemples sans fin qu’on pourrait donner, nul n’a jamais supposé que la fécondité de ces plantes ou de ces animaux se fῦt soudainement et temporairement accrue d’une manière sensible. La seule explication satisfaisante de ce fait, c’est d’admettre que les conditions de vie leur ont été extrêmement favorables, qu’il y a eu conséquemment une moindre destruction des individus vieux ou jeunes, et que presque tous ces derniers ont pu se reproduire à leur tour. En pareille occurrence, la raison géométrique d’accroissement, dont le résultat ne manque jamais d’être surprenant, rend compte de la multiplication extraordinaire et de la grande diffusion de ces espèces naturalisées dans leur nouvelle patrie.
A l’état de nature, presque chaque plante produit des graines, et parmi les animaux il en est peu qui ne s’accouplent pas annuellement. On peut en toute sécurité en inférer que toutes les plantes et toutes les espèces d’animaux tendent à se multiplier en raison géométrique, que chacune d’entre elles suffirait à peupler rapidement toute contrée où il leur est possible de vivre et que leur tendance à s’accroître selon une progression mathématique doit être contrebalancée par des causes de destruction à une période quelconque de leur existence.
La seule différence entre les organismes qui produisent annuellement des œufs ou des graines par milliers, et ceux qui n’en produisent qu’un petit nombre, c’est que les plus lents producteurs auraient besoin de quelques années de plus pour peupler une contrée entière, si étendue qu’elle fῦt, les circonstances étant favorables. (Ch. Darwin, De l’origine des espèces, trad. de Mlle Royer, chap. III; Concurrence vitale, p. 94.)
[46] Dictionnaire de l’économie politique, art. Esclacage.
[47] On trouvera dans les Principes d’économie politique de M. Guillaume Roscher, si élégamment traduits par M. L. Wolowski, une profusion de renseignements sur ce sujet, que M. Roscher a traité en déployant toutes les ressources de l’érudition germanique. T. II. Histoire et politique de la population.
[48] Les Jaggas de Guinée dévorent leurs propres enfants. Burdach, Traité de physiologie, t. V, p. 85.
[49] John Stuart Mill. Principes d’économie politique, traduit par H. Dussard et Courcelle Seneuil, t. Ier, p. 402.
[50] Voir au sujet des lacunes de la législation répressive, en matière d’obligations paternelles, la Discussion sur l’enseignement obligatoire entre MM. G. de Molinari et Frédéric Passy. Dernières observations de M. G. de Molinari, pag. 149.
[51] Malthus, Essai sur le principe de population, traduit par MM. P. et G. Prévost, liv. I, chap. I et II.
[52]
“Les propositions de Malthus sont vraies, dit M. Joseph Garnier dans son excellent abrégé encyclopédique Du Principe de la population, si ce n’est dans la lettre au moins dans l’esprit. Et ici encore nous pouvons nous débarrasser tout d’abord de quelques objections moins solides qu’on ne pense, en faisant observer que Malthus, lorsqu’il s’est servi d’une progression géométrique pour formuler l’accroissement de la population, et d’une progression arithmétique pour formuler l’accroissement des subsistances, n’a pas voulu faire autre chose qu’exprimer une tendance. Il y a des personnes qui ne l’ont pas compris ainsi, mais leurs dissertations à cet égard portent scientifiquement à faux.
Malthus n’attachait aucune importance à cette formule mathématique, inutile à son raisonnement. C’est ce dont peut se convaincre tout lecteur de bonne foi.
On a également critiqué l’expression de subsistances comme trop restreinte; mais il est évident que Malthus a entendu tout ce qui est indispensable à l’homme pour vivre: la nourriture, le vêtement, l’habitation, cibaria et vestitus et habitatio du jurisconsulte romain. Mais il est plus clair de dire avec Destutt de Tracy: moyens d’existence.
En d’autres termes donc nous pouvons formuler le principe de population ainsi:
- I. La population, si aucun obstacle physique ou moral ne s’y opposait, se développerait incessamment suivant une progression géométrique et sans limites assignables.
- II. Les moyens de subsistance, au contraire, ne se développent en général que suivant une progression bien moins rapide.
- III. En d’autres termes, la population a une tendance organique et virtuelle à s’accroître plus rapidement que les moyens d’existence.
- IV. De là résulte l’obligation de limiter préventivement le développement de la population, pour éviter la destruction brutale de l’espèce par suite des privations qu’impose la nature.” (Joseph Garnier, Du principe de population, p. 11–15.)
[53] La contrainte morale en matière de population n’est point, comme l’ont prétendu certains socialistes, une “invention malthusienne.” Elle est [450] aussi ancienne que la société elle-même. Seulement, l’introduction toute moderne du principe du self-government a dῦ changer son mode d’application. Autrefois, elle se trouvait incarnée dans des institutions, dans des coutumes, dans des lois civiles ou religieuses, ayant pour objet de suppléer au défaut d’aptitude des individus, — considérés, bien qu’à des degrés divers, comme mincurs et placés sous la tutelle d’un État, d’une Église, d’un maître ou d’un seigneur, — à bien gouverner leur reproduction. En obéissant strictement aux prescriptions qui imposaient la contrainte morale par voie préventive et dont nous sommes trop portés, dans notre ignorance de l’économie de l’histoire, à méconnaître la sagesse, les “sujets” de l’État, les “fidèles” de l’Église, les esclaves ou les serfs pouvaient se multiplier sans se préoccuper des destinées de la génération qu’ils mettaient au monde. Leurs tuteurs y avaient pourvu pour eux. En s’immisçant dans une affaire que l’autorité compétente avait réglée, ils auraient troublé, d’une manière nuisible, l’action des règles établies, absolument comme il arriverait si des pupilles s’avisaient de modifier à leur convenance les décisions de leurs tuteurs. Mais dans les pays où l’ancien régime de tutelle a cessé d’exister, où les unions sont dégagées de toute entrave préventive, sinon de toute réglementation autoritaire, — car le régime de la liberté des contrats est encore loin de prévaloir en cette matière, — la contrainte morale devient l’affaire de chacun et la branche la plus essentielle peut-être du self-government. Puisqu’il n’existe plus de tuteur qui se charge de pourvoir au bon gouvernement de la reproduction, chacun est tenu de se faire à cet égard son propre tuteur et de remplacer, par sa contrainte libre et particulière, la contrainte obligatoire et générale qu’imposait l’ancien régime. S’il manque à ce devoir envers les autres et envers lui-même, qu’en résulte-t-il? C’est que les maux que la contrainte imposée avait pour objet de prévenir et qu’elle prévenait avec plus ou moins d’efficacité ne peuvent manquer de renaître, au grand dommage et peut-être au grand péril de la société. Ils n’y manquent pas, en effet. A moins de fermer de parti pris les yeux à la lumière, il est impossible de n’être pas frappé de l’affaiblissement physique et de la dégradation morale des couches inférieures de la population dans les pays où la contrainte imposée a cessé d’exister, sans que la contrainte volontaire ait suffisamment pris sa place. Ces maux appellent un remède prompt et énergique si l’on ne veut point que l’homme aille se détériorant de [451] plus en plus, pendant que ses bêtes de somme et ses machines se perfectionnent. Mais quel peut être ce remède? Est-ce le retour an système préventif? Non, il n’y faut point songer. Le système préventif a fait son temps, et l’on ne peut pas plus rétrograder vers les étapes du passé qu’on ne peut franchir d’un bond celles de l’avenir. Que faire done? S’appliquer à instruire les hommes devenus libres des obligations particuhères que la liberté leur impose en matière de population comme en toute autre, et tâcher de développer en eux la force morale nécessaire pour les remplir. Mais, en attendant, comme l’éducation et la force morale ne s’improvisent pas, réprimer les nuisances qu’ils commettent en abusant de leur liberté, substituer, en matière de population, à la législation préventice une législation répressive.
Cette législation existe, au surplus, déjà en partie il suffirait de la compléter et de la revêtir d’une sanction pénale proportionnée à la gravité des nuisances qu’elle a pour objet de réprimer. Dans tous les pays civilisés, la loi punit l’avortement, l’infanticide et l’abandon des enfants, quoique, dans la pratique, on apporte à la répression de ces crimes, d’autant plus vils et plus odieux qu’ils atteignent des êtres impuissants à se défendre, une mollesse et une indulgence peu excusables. Mais, du moment où il ne s’agit point d’un attentat brutal à la vie des enfants, la loi s’abstient presque toujours. Elle ne réprime que dans un petit nombre de pays, encore est-ce d’une manière fort imparfaite, l’exploitation hâtive et meurtrière du travail des enfants; elle ne spécifie même point, d’une manière précise, en quoi consiste l’obligation paternelle et elle la laisse dépourvue de sanction pénale. Elle fait pis encore. Au lieu d’assurer le strict accomplissement des obligations paternelles, elle en encourage trop souvent la désertion, d’abord en interdisant la recherche de la paternité et en concentrant ainsi le fardeau de la dette de l’élève et de l’éducation sur l’être le moins capable de la payer (∗); ensuite, en permettant [452] trop aisément à ceux qui ont contracté de semblables dettes d’en confier l’acquittement à la charité publique, ou, ce qui revient au même, d’obliger les contribuables à les solder à leur place.
(∗) Les lois interdisent la recherche de la paternité précisément dans les pays où l’abandon de la législation préventive en matière de population et le relàchement des mœurs la rendraient le plus nécessaire Cette interdiction a principalement pour objet de diminuer le nombre des enfants naturels, en augmentant l’intérêt qu’ont les femmes à se défendre contre la séduction. Mais n’atteindrait-on pas mieux encore le mème but en créant pour les hommes un intérêt à ne point les séduire?
Le célèbre Zachariæ n’est point, à la vérité, de cet avis et voici quels agréables arguments ce grand jurisconsulte, — en admettant qu’on puisse être un grand jurisconsulte sans avoir la notion de la justice, — faisait valoir en faveur de l’interdiction de la recherche de la paternité:
“Pour contribuer à la diminution des enfants naturels, est-il préférable d’affaiblir les attaques contre la pudeur des femmes ou de fortifier les femmes contre la séduction? Je me permettrai une comparaison pour mieux faire saisir la question ainsi posée. (Qu’on me passe la légereté de cette comparaison, elle reud l’idée et epargne les mots.) Par rapport à notre question, on peut comparer toute femme nubile et non mariée à une forteresse; celui qui a le dessein de la séduire, qui la séduit à la fin, ou même tout homme non marié, peut être considéré comme l’armée par laquelle la forteresse est assiégée (Il arrive même quelquefois qu’un homme marié forme l’armée de siége.) Les femmes, ces citadelles supposées, tombent, comme les véritables citadelles, quand l’attaque est bien dirigée, ou quand elles sont mal défendues. Il s’agit de savoir si, en terme moyen, ces forteresses se rendent le plus souvent par suite de la vigueur de l’attaque ou de la faiblesse de la défense.
“On a toutes les raisons de croire cette dernière supposition fondée, et de se prononcer en faveur d’une législation qui imposerait à la femme seule l’obligation d’entretenir son enfant naturel, afin de l’encourager au combat par la crainte des conséquences d’une faiblesse. Car, où le séducteur prend-il ses armes les plus redoutables? Dans cette même faiblesse de caractère qui abandonne sans défense aux impressions du moment le cœur d’une femme savourant avec délices le poison de la flatterie, et se confiant aveuglément aux serments d’un amour éternel. Le succès de l’homme est encore favorisé autant et plus peut-être par le désir physique, qui a plus de force chez la femme que chez l’homme. Mais je laisserai parler Ovide qui, de ce côté au moins, a peut-être mieux connu les femmes que tout autre. Dans le passage que je vais transerire (Métamorph, L. III, v. 318 et suiv.), le poète ne porte pas de jugement; il raconte seulement un événement de l’Olympe. Mais je pourrais démontrer par une foule d’autres passages que ce conte était l’expression de sa propre conviction.
Un jour, Jupiter, égayé par le nectar, déposa, dit-on, les soueis de son empire pour s’abandonner avec Junon, qui alors n’avait pas d’occupation, à des amusements depuis longtemps oubliés. Sans doute, lui dit-il, la volupte a pour vous plus d’attraits que pour les hommes? Junon ne vent pas l’avouer. On convient de s’en rapporter â la sentence de Tiresias qui pouvait en juger par expérience. Un jour il avait, de son bâton, frappé deux serpents accouplés au fond d’un bois touffu; tout à coup, quel prodige! d’homme il fut changé en femme, puis il resta femme pendant sept années. La huitième, il revit des serpents, et s’écria: Si vous avez le pouvoir de changer le sexe de celui qui ose vous frapper, je vais vous frapper de nouveau. A peine les eῦt-il touchés de son bâton, qu’il reprit sa forme première, et de femme redevint homme. Choisi pour arbitre dans cette joyeuse dispute, il se rangea de l’avis de Jupiter. La fille de Saturne en éprouva, dit-on, une douleur bien vive, trop vive peut-être, pour si peu de chose; elle condamna les yeux de son juge â une éternelle cécité.”
La rigueur de cette punition prouve mieux que toute autre chose que Tiresias avait dit la vérité (a).”
(a) Archives de Droit et de Législation. — Le droit commun en Allemagne sur les enfants naturels, comparé au droit français et anglais, en ce qui concerne la recherche de la paternité, par Zachariæ. T. 1”, p. 292. Bruxelles, 1837.
Mais que résulte-t-il de l’absence de répression et, le plus souvent aussi, de l’encouragement des nuisances qu’engendre l’usage abusif de la liberté de la reproduction? C’est, en premier lieu, que la possibilité de s’exonérer en tout ou en partie du fardeau de la responsabilité qui s’y trouve attachée encourage la classe la moins éclairée et la moins morale de la population à en user d’une manière excessive, en contractant plus d’obligations paternelles qu’elle n’a les moyens d’en acquitter; c’est, en second lieu, que le non-acquittement ou l’acquittement imparfait de ces obligations, en entraînant soit la mort hâtive des enfants, soit la débilitation physique, intellectuelle et morale d’une portion plus ou moins considérable de la génération nouvelle, occasionne directement à la société une double perte: perte du capital consacré improductivement à l’entretien de la multitude des enfants qui meurent avant l’âge, [453] perte du capital employé à soutenir une population imparfaitement formée, qui ne peut subvenir entièrement à ses frais d’existence. C’est enfin qu’à ces pertes directes vient se joindre une perte indirecte, infiniment plus considérable encore, résultant de l’affaiblissement et de la détérioration du personnel de la production. Le tout constituant la nuisance qu’inflige à la société l’inobservation ou la méconnaissance des conditions de responsabilité naturellement attachées à l’exercice de la liberté de la reproduction. — Nous ne saurions mieux comparer la situation que nous créent en cette matière l’insuffisance et les vices de notre législation qu’à celle qui se produirait si les industries dangereuses ou insalubres, encore soumises chez nous au régime préventif, venaient à en être affranchies sans que des mesures suffisantes fussent prises pour réprimer et par là même prévenir les nuisances qu’il est dans leur nature de causer. Dans cette éventualité, la liberté de l’industrie, si féconde et bienfaisante qu’elle soit d’ailleurs, ne manquerait pas de devenir une source intarissable de désordres et de dommages. A quoi on peut ajouter que le mal [454] s’accroîtrait singulièrement si la multiplication des établissements dangereux ou insalubres était encouragée d’une manière spéciale par des subventions que seraient obligées de fournir les communes mêmes au sein desquelles ils apporteraient leurs périls et leur infection.
Objectera-t-on qu’en achevant de substituer, en matière de population, le régime répressif au régime préventif, on porterait atteinte à “la liberté des pères de famille?” Nous avons déjà répondu à cette objection dans la discussion que nous avons soutenue contre notre honorable et savant confrère, M. Frédéric Passy, à propos de l’Enseignement obligatoire: “Si le père a, disions-nous, des obligations formelles et positives à remplir envers ses enfants, des obligations qu’il ne peut répudier sans commettre une nuisance, est-ce done porter atteinte à sa liberté que de le contraindre à s’en acquitter complétement et sans fraude? Est-ce porter atteinte à la liberté des débiteurs que de les contraindre à payer leurs dettes (∗)?” Objectera-t-on encore, — et cette objection nous a été posée dans toute sa force par M. Fréd. Passy, — l’impossibilité de déterminer exactement les limites des obligations naturelles de la paternité, comme on peut déterminer celles des obligations conventionnelles? Mais cette impossibilité est plus apparente que réelle. Du moment, en effet, où l’obligation n’est pas intégralement remplie, il y a dommage causé, nuisance. Or, toute nuisance, tout dommage peut être constaté et délimité. Remarquons à ce propos que l’obligation paternelle peut varier en étendue selon l’état de la société. Il se peut, par exemple, que la condition économique de la société soit telle que les enfants des classes inférieures n’aient point besoin de savoir lire, écrire et calculer pour devenir des hommes utiles et trouver un débouché, et que la privation d’une instruction élémentaire ne leur cause, en conséquence, aucun dommage; mais il se peut aussi qu’ils ne puissent s’en passer sans subir une moins value. Dans le premier cas, l’instruction élémentaire peut n’être pas comprise dans l’obligation paternelle; elle doit l’être dans le second. Objectera-t-on enfin la pauvreté du plus grand nombre des débiteurs et l’impossibilité matérielle où ils se trouvent d’acquitter intégralement cette sorte de dettes? Mais si la pauvreté du débiteur peut être une circonstance atténuante, quand il s’agit du recouvrement d’une créance, [455] est-elle un argument qu’on puisse invoquer pour laisser impunies les banqueroutes (∗)?
(∗) De l’enseignement obligatoire, deuxième partie. Dernières observations de M. G. de Molinari, p. 168.
(∗) Voir encore pour la réfutation de cette objection l’Enseignement obligatoire, pages 57 et 62.
Supposons maintenant que les lacunes et les défectuosités de la législation répressive en cette matière fussent comblées, supposons que les obligations naturelles de la paternité fussent mises sur le même pied que les obligations conventionnelles, qu’en résulterait-il? C’est évidemment que le régime répressif agirait comme autrefois le régime préventif, mais en laissant à la liberté son action féconde, pour opposer un frein à la multiplication imprévoyante de la population, — frein qui, pour le dire en passant, serait d’autant plus énergique que l’opinion prêterait davantage son concours à la loi, — c’est qu’on éviterait, sous la double influence de la crainte de la loi et de l’opinion, de créer plus d’obligations qu’on n’en pourrait intégralement acquitter, et que l’on verrait diminuer la somme des non valeurs ou des demi-valeurs qui encombrent aujourd’hui le marché de la population en absorbant improductivement une bonne part des ressources de la société, en ralentissant par conséquent avec le développement des capitaux la multiplication des hommes.
Le jurisconsulte allemand qui invoque ainsi gravement l’autorité d’un poête érotique, à l’appui de ses conclusions contre la recherche de la paternité, ne se demande pas, bien entendu, s’il est équitable de faire supporter à la femme seule les conséquences d’un acte qu’elle n’a pas été seule à commettre; il ne se demande pas, non plus, si l’intérêt du tiers innocent qui est ainsi appelé à la vie, ne mérite point d’être pris en considération. (Et peut-il bien être rendu passible de l’irrégularité légale de sa naissance?) Or, imposer à la mère seule le fardeau de l’entretien de ce fruit d’une union provoquée le plus souvent par un abus moral de sa faiblesse, n’est-ce pas, en exagérant injustement sa part de responsabilité et de sacrifices, l’exciter à s’en décharger soit par l’avortement, l’infanticide ou l’abandon? On l’a si bien compris qu’en Belgique, le nouveau Code pénal établit une excuse en faveur de la femme qui tue son enfant illégitime, et que partout les hospices d’enfants trouvés offrent aux filles-mères un moyen facile de s’exonérer d’une obligation que la loi fait peser exclusivement sur elles et qu’elles sont presque toujours incapables de remplir seules.
Cependant, une dernière objection se présente ici, et ce n’est pas la moins grave. — Si vous atteignez rigoureusement, nous dit-on, dans ses conséquences, l’abus d’un des appétits les plus véhéments de la nature humaine; si non seulement vous punissez les parents qui se débarrassent des obligations paternelles par l’avortement ou l’infanticide, mais encore ceux qui ne s’en acquittent point loyalement et intégralement, qui négligent de fournir à leurs enfants la somme d’instruction nécessaire, qui les vouent à un travail hâtif, etc., qu’en résultera-t-il? C’est qu’en rendant plus rigoureux l’accomplissement [456] des obligations de la paternité, en augmentant par là même le poids de ces obligations, sans diminuer cependant l’intensité du penchant qui pousse à les créer, ce qui est hors du pouvoir de la loi, vous exciterez ce penchant à se satisfaire sans résultats; en d’autres termes, vous encouragerez la débauche stérile, et vous aboutirez ainsi simplement à substituer une immoralité à une autre.
Cette législation barbare qui exonère le père de toute obligation au détriment de la femme et de l’enfant, en protégeant ainsi le fort aux dépens des faibles, encourage au plus haut point les fredaines des fils de famille, à qui elle livre, moyennant un minimum de frais, les filles du peuple, en l’absence d’une surveillance rendue trop souvent impossible par les exigences du travail d’atelier et les tentations de la misère. Que penser donc d’un jurisconsulte qui va chercher jusque dans les polissonneries d’Ovide des arguments pour mettre la loi au service de la luxure associée à l’avarice des classes dominantes?
Cette objection touche, comme on voit, au point le plus délicat de la question. — Sans doute, répondrons-nous, il est possible que tel soit, en partie du moins, l’effet d’une législation qui assure davantage et mieux l’accomplissement des obligations de la paternité: ce qui semblerait l’attester, c’est que les classes aisées, au sein desquelles on acquitte généralement cette sorte de dettes, sont particulièrement adonnées à la débauche stérile. Mais cette pratique vicieuse n’est, remarquons-le bien, une nuisance que pour ceux qui s’y adonnent; tandis que la fécondation imprévoyante nuit à un tiers qu’elle condamne soit à une mort hâtive, soit à une existence misérable, sans parler du dommage qu’elle cause à la société entière. Si condamnable que soit la débauche stérile, elle l’est donc moins que la fécondation imprévoyante.
Cette opinion a été, nous ne l’ignorons pas, taxée d’immorale, et elle est devenue le thème des plus virulentes attaques contre les économistes partisans de la contrainte morale. On a été jusqu’à les accuser de préconiser la débauche stérile, et de demander la solution du problème de la population à “la violence faite à l’action de la nature (∗). C’est absolument comme si l’on reprochait aux jurisconsultes d’établir une échelle dans la criminalité et de condamner le vol moins sévèrement que l’assassinat. C’est, en particulier, comme si l’on avait accusé les jurisconsultes progressistes du XVIIIe siècle, qui réclamaient l’adoucissement des pénalités barbares qui frappaient les voleurs, de recommander la substitution du vol à l’assassinat. Peut-être, à la vérité, quelques partisans de la contrainte morale ont-ils montré trop d’indulgence pour cette forme de la débauche stérile que l’Ancien Testament condamnait ainsi, à propos d’Onam: Semen fundebat in terram, ne liberi nascerentur, et idcircò percussit eum (Onam) Dominus, quod rem detestabilem faceret, et contre laquelle le révérend père Boone, de la Compagnie de Jésus, s’élevait naguère en ces termes qui ne valent pas ceux de l’Ancien Testament:
(∗)C’est une chimère aussi monstrueuse qu’immorale que de demander à la violence faite à l’action de la nature une sauvegarde contre les dangers d’un excédant de la population.
(Journal de Bruxelles, 7 février 1855)
“Hélas! pour combien d’époux le mariage est-il aujourd’hui le voile de désordres honteux qui provoquent la colère divine et corrompent la société dans sa source? Privant à la fois l’État de citoyens, l’Église d’enfants et le Ciel d’élus, ils péchent contre la société, contre la terre et contre le Ciel, attaquant Dieu directement et lui disputant les créatures que sa puissance se préparait à produire et les âmes que sa miséricorde voulait sauver (∗∗).”
(∗∗)Des devoirs de la femme chrétienne, conférences de P. J. B. Boone de la Compagnie de Jésus. Bruxelles, 1855, p. 23.
[457]
Nous ne trouverions rien à redire, pour notre part, aux anathèmes du rév. P. Boone s’ils étaient moins ornés de fleurs de rhétorique et si l’orateur catholique avait eu soin, du même coup, de prémunir “la femme chrétienne” contre le mal plus funeste encore de la multiplication imprévoyante. Nous ne condamnons pas moins formellement que le rév. P. Boone lui-même l’espèce de vol fait à la nature qu’il dénonçait en des termes si touchants à son auditoire féminin, et nous ne partageons pas l’opinion de ceux qui considèrent cet acte plutôt comme vain que comme nuisible. Nous y voyons une cause de dégradation physique et morale qui diminue d’une manière positive la valeur de la population. A l’appui de notre opinion nous pourrions citer plus d’une autorité médicale. Nous nous bornerons à renvoyer nos lecteurs à l’excellent livre de M. Alex. Mayer sur les rapports conjugaux. Ils y verront que les “artifices préventifs de la fécondation” engendrent des désordres pathologiques souvent fort graves, céphalalgie, affaissement d’intelligence, etc., chez l’homme, névroses, dégénérescences de la matrice, polypes et squirrhes chez la femme, sans parler de leurs fâcheuses conséquences morales (∗).
(∗) Des rapports conjugaux, considérés sous le triple point de vue de la population, de la santé et de la morale publique, par le docteur Alex. Mayer, médecin de l’inspection générale de la salubrité et de l’hospice impérial des Quinze-Vingts. — Des artifices préventifs de la fécondation. Paris, 1860, 4° édition.
Mais objectera-t-on enfin, si la multiplication imprévoyante et la débauche stérile doivent être condamnées, quoiqu’à des degrés différents, il ne reste donc que l’abstinence, et l’abstinence est-elle possible? Qu’elle soit difficile nous ne le contestons point; mais l’accomplissement d’aucun de nos devoirs envers les autres ou envers nous-mêmes n’est précisément chose facile. La vie est une lutte: lutte contre les puissances de la nature et contre les puissances animales de notre être que nous devons les unes et les autres maîtriser et utiliser après en avoir fait nos esclaves, sous peine de traîner une existence misérable et précaire sous la domination brutale et stupide de ces agents inférieurs. Du reste, si la Providence nous a imposé des devoirs difficiles, elle a cependant en toutes choses mesuré à nos forces le fardeau qu’elle nous impose, et si les observations de certains physiologistes sont exactes, en matière de fécondation, les rigueurs de la contrainte morale pourraient être beaucoup atténuées.
[458]
Il résulte, dit encore le docteur Mayer, des recherches de plusieurs physiologistes, et entre autres d’un travail de M. le professeur Pouchet de Roueu, couronné par l’Académie des sciences en 1845:
1° Que la fécondation offre un rapport constant avec la menstruation;
2° Que, sur l’espèce humaine, il est facile de préciser rigoureusement l’époque inter menstruelle ou la conception est physiquement impossible, et celle où elle peut offrir quelque probabilité (∗).
(∗) Théorie positive de l’ovulation spontanée et de la fécondation des mammifères et de l’espèce humaine, basée sur l’observation de toute la série animale. Paris, 1847, p. 270.
Pour établir cette loi, l’auteur s’appuie sur les données expérimentales que nous allons rapporter.
Il est généralement admis que les ovules des mammifêres sont émis à des époques déterminées, en rapport avec la surexcitation de l’appareil sexuel, et que cette surexcitation correspond à la menstruation chez la femme: par conséquent, il faut reconnaître aussi que l’ovulation dans l’espèce humaine est subordonnée à la fonction cataméniale, et qu’il est possible d’en assigner rigoureusement l’époque.
D’autre part, il est hors de conteste: 1° que les vésicules de Graaf, chez la femme, n’émettent leurs œufs qu’à l’issue de la menstruation, soit immédiatement après, soit, un, deux, trois ou même quatre jours plus tard, et 2° que les trompes emploient de deux à six jours pour transmettre l’œuf à l’uterus. Si cet œuf a rencontré dans son trajet quelques parcelles de fluide séminal, s’il est fécondé par conséquent, il reste dans la matrice et s’y développe. Dans le cas contraire, après avoir séjourné dans cet organe pendant un certain temps, il en est expulsé avec la decidua (produit de l’exsudation qui se dépose sous forme d’une membrane éphémère, à la surface interne de l’uterus, vers le déclin de l’irritation qui suit l’époque cataméniale). Celle-ci l’entraîne dans sa chute qui s’opère dix à douze jours après la cessation de l’écoulement mensuel.
Or, comme il ne se produit point d’œufs à d’autre époque, la conception ne peut évidemment avoir lieu que dans les premiers jours qui suivent la menstruation et avant la chute de la decidua; après celle-ci, la fecondation est matériellement impossible. L’œuf a disparu.
Déjà ce phénomène avait été pressenti dès les temps les plus reculés, et les physiologistes aussi bien que les accoucheurs, s’accordaient à considérer comme particulièrement favorables à la conception, les premiers jours qui suivent l’époque menstruelle; le père de la médecine avait érigé en précepte, pour les femmes stériles, de rechercher les rapprochements conjugaux, aux époques qui suivent immédiatement la cessation des règles; mais il était réservé à notre siècle de préciser un fait vaguement soupçonné et de l’étayer sur des preuves respectables.
....De ce qui précède, il résulte donc incontestablement que la conception ne peut avoir lieu après le douxième jour qui suit la cessation des règles et jusqu’à l’apparition de la période menstruelle suivante. On peut ajouter encore qu’elle est tout aussi improbable pendant la durée de l’écoulement sanguin, parce que l’ovule ne parvient habituellement dans l’uterus que plusieurs jours après la cessation du flux cataménial. Il reste donc environ huit jours par mois, — du quatrième au douzième — après la période menstruelle, pendant lesquels les rapprochements sexuels ont chance d’être féconds.
C’est à la connaissance ou plutôt à la prescience de ce fait que l’histoire attribue Ie conseil donné par Fernel à Henri Il qui, après onze ans de mariage demeuré stérile, vit, en se conformant aux recommandations de son mêdecin, sa femme, Catherine de Médicis, lui donner plusieurs héritiers.
Boèrhave avait dit déjà: Feminœ semper concipiunt post ultima menstrua et vix ullo alio tempore.
Haller, Burdach et plusieurs autres avaient émis la même opinion.
Enfin, les expériences les plus récentes, entreprises pour la solution de ce problème éminemment digne d’intérêt, s’accordent à sanctionner la découverte de la période intermenstruelle comme propice à la fécondation chez les femmes et chez la plupart des femelles des mammifères.
Il en découle naturellement que la contrainte morale peut être bornée à ce laps de temps, ce qui la rendra certes bien plus facile à observer.
....Ajoutons toutefois que la théorie de M. le professeur Pouchet, si précise et si séduisante à l’esprit, n’est pas admise dans toute sa rigueur par la généralité des physiologistes actuels, et que M. Coste, entre autres, lui oppose certaines objections fondées sur son expérience personnelle. Ce savant prétend, en effet, que la régularité du phénomène de l’ovulation peut être troublée chez maintes espèces animales, et chez la femme en particulier, par des circonstances nombreuses, telles que certaines conditions d’abri, de température, d’alimentation, et, par dessus tout, par le rapprochement sexuel. Notons cette restriction d’un investigateur habile en ces sortes de matières; mais gardons-nous, jusqu’à plus ample informé, de nous prononcer sur cette grave question autrement qu’en disant: Si la doctrine de M. Pouchet n’est pas absolument vraie, elle l’est du moins dans l’immense majorité des cas (∗).”
(∗) Des rapports conjugaux, etc. Des obstacles à l’extension excessive de la population, p. 133. — Des rapports conjugaux pendant l’époque menstruelle, p. 365.
[54] La première édition, sur laquelle ce rapport a été fait, présente quelques différences notables avec celle que nous publions aujourd’hui. Nous y avons ajouté une leçon sur la propriété et refait, en les développant, les leçons sur la part du travail et la population.
[55] L’honorable rapporteur commet ici une erreur involontaire. L’auteur de cours est Belge.
[56] V. le Traité de la liberté du travail, liv. IX, ch. IX, p. 394. V. aussi le chapitre V du même livre, Sur les effets attribués à la concurrence.
Gustave de Molinari, Cours d’économie politique (1863)
Tome II. La Circulation et la Consommation des Richesses
TROISIÈME PARTIE de la circulation
[II-7]
PREMIÈRE LEÇON↩
les poids et mesures
Récapitulation de quelques notions élémentaires. — Les besoins des hommes, la production, l’association des agents productifs, la division du travail. — Multiplication des échanges résultant du développement croissant de ces deux derniers phénomènes. — Nécessité de l’intervention des mesures de quantité et de valeur dans les échanges. — Comment se constituent les étalons de mesure ou de poids. — L’unité économique et l’unité physique. — Les anciens systèmes de poids et mesures. — Leurs inconvénients. — Le système métrique. — Vices de ce système artificiel et arbitraire. — A quoi doit se borner l’intervention gouvernementale en matière de poids et mesures. — Par quelle voie pourra s’opérer utilement l’uniformisation des poids et mesures. — Note sur le système métrique.
Les richesses se produisent et se distribuent dans la société sous l’impulsion des besoins des hommes. Ces besoins, dont nous ressentons l’aiguillon à des degrés divers, on les a rangés, conformément à leurs caractères particuliers, en trois catégories: les besoins physiques, intellectuels et moraux. Ils exigent pour être satisfaits, apaisés, l’assimilation ou la consommation d’une certaine quantité de produits ou de services [II-8] en harmonie avec leur nature. Tel est le premier phénomène qui appelle l’attention de l’économiste.
Mais ces produits ou ces services ne naissent pas spontanément à l’appel de nos besoins. Il faut les créer. Le milieu où nous vivons nous en offre, à la vérité, tous les éléments matériels et immatériels; mais ces éléments sont épars et bruts. Il faut les découvrir, les rassembler et les façonner, de manière à les approprier aux besoins qu’il est dans leur nature de satisfaire. Il faut ensuite les mettre à la portée des individus ou des agglomérations d’individus qui éprouvent ces besoins, autrement dit des consommateurs. Ces diverses opérations constituent la production et elles forment le second phénomène que doit étudier l’économiste.
Si l’on examine comment s’opère la production, on s’aperçoit qu’elle a ses conditions et ses exigences naturelles; qu’elle implique, avant tout, la réunion sur un point donné de l’espace et du temps, d’une certaine quantité d’agents productifs. S’agit-il par exemple de produire du blé, c’est à dire une denrée de nature à satisfaire le besoin physique de l’alimentation? Il faut une certaine étendue de terre propre à la production de cette céréale, un certain nombre d’hommes, pourvus de la force, des aptitudes et des connaissances requises pour accomplir les différentes opérations de la production agricole, un certain nombre d’animaux, d’outils et de machines, des engrais et de la semence, des bâtiments pour abriter les travailleurs, les instruments et les matériaux, des approvisionnements de diverses sortes pour entretenir et renouveler le personnel et le matériel de la production. S’agit-il de produire du drap, il faut de même un personnel et un matériel ad hoc, réunis dans les proportions voulues, des travailleurs, des bâtiments, des outils, [II-9] des machines, des matières premières. S’agit-il enfin d’un produit immatériel, de la sécurité par exemple, nous retrouvons une réunion analogue d’agents productifs, savoir un personnel composé d’administrateurs, de magistrats, d’hommes de police, de militaires; un matériel consistant en bureaux d’administration, en palais de justice, en prisons, en casernes et en forteresses, avec leur mobilier et leur outillage, enfin les matériaux et les provisions nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de ce personnel et de ce matériel.
Si nurons les ateliers de toute sorte où l’on s’occupe de produire les innombrables objets matériels ou immatériels nécessaires à la satisfaction de nos besoins physiques, intellectuels ou moraux, nous serons partout frappés du même spectacle. Partout, nous constaterons la réunion, dans des proportions déterminées par la nature de l’œuvre à accomplir, d’une certaine somme d’agents productifs, travail, capital, agents naturels appropriés, constituant le personnel et le matériel de la production.
Un autre phénomène nous frappera encore: c’est la division du travail, c’est à dire le fractionnement de la production en une multitude de foyers ou d’ateliers spéciaux, où l’on s’occupe de la confection d’une seule espèce de produits, afin d’obtenir un résultat plus considérable en échange d’une dépense moindre.
Ces deux phénomènes essentiels qui caractérisent la production se développent d’une manière progressive à mesure que l’industrie humaine se perfectionne: l’association des agents productifs s’opère sur une échelle plus vaste et la division du travail s’étend davantage.
Lorsque la production encore dans l’enfance s’opère dans le [II-10] cercle resserré de la famille ou de la tribu, l’association des agents productifs et la division du travail n’existent qu’à l’état rudimentaire. Les industries peu nombreuses qui sont alors exercées pour satisfaire aux besoins de première nécessité, n’exigent qu’une faible agglomération d’agents productifs: des agents naturels imparfaitement appropriés, quelques travailleurs pourvus de connaissances élémentaires, un petit nombre d’outils grossiers, enfin les matériaux et les approvisionnements indispensables pour faire fonctionner, entretenir et renouveler cette primitive agglomération d’agents productifs, jusqu’à ce que la pêche, la chasse, l’élève des bestiaux, souvent encore le brigandage aient fourni aux producteurs leurs moyens d’existence accoutumés. En même temps, la division du travail existe à peine. Chaque famille produit elle-même la plus grande partie des choses qui servent à nourrir, à vêtir, à loger et à défendre ses membres. L’échange n’apparaît, en conséquence, que comme un fait exceptionnel.
Dans nos sociétés civilisées, au contraire, quel spectacle frappe nos regards? Nous voyons dans la plupart des branches de l’activité humaine les agents productifs groupés, associés, combinés par masses, et la division du travail étendue à l’infini. Prenons pour exemple la production d’un vêtement de laine. Tandis que dans la première phase du développement de l’industrie, un chef de famille, éleveur de moutons, remettait les toisons qu’il avait tondues et lavées lui-même à sa femme et à ses filles, pour les filer, les tisser et en façonner, à l’aide d’un outillage simple et grossier, les vêtements à l’usage de la famille, de nos jours, la production des mêmes vêtements exige l’application d’une masse énorme de capital et de travail divisés. La laine provient, par exemple, des immenses bergeries de [II-11] l’Australie. De ce premier foyer de production, la matière première est transportée dans un magasin à Sydney, puis chargée à bord d’un navire qui l’apporte en Angleterre où elle commence par être déposée dans un entrepôt. De là, elle passe dans une manufacture où elle est préparée et filée. Souvent, elle est tissée dans un autre établissement, teinte dans un troisième, apprêtée dans un quatrième. L’étoffe achevée passe dans les mains des marchands de gros, de demi-gros et de détail, enfin, dans celles du tailleur ou du confectionneur qui en fait des vêtements. Parfois encore elle est livrée au commerce sous cette dernière forme, transportée par terre et par mer, et on la voit revenir, après un immense circuit, au lieu de provenance de la matière première. Les transformations et les transports dont la laine a été l’objet, avant de passer à l’état de vêtement et d’être mis sous cette forme à la portée des consommateurs, se sont multipliés à l’infini, et chacune de ces transformations, chacun de ces transports a été opéré dans un foyer de production spécial, où se trouvent agglomérés et associés par masses des agents productifs de nature et de provenance diverses.
Or, ces deux phénomènes progressifs, l’association des agents productifs et la division du travail, exigent, d’une manière de plus en plus fréquente et précise, l’application des mesures de quantité et de valeur, soit aux agents et aux éléments de la production, soit aux produits.
Dans l’enfance de la production, lorsque chaque famille produit elle-même, à l’aide des agents et des éléments dont elle dispose, les choses qui servent à la satisfaction des besoins de ses membres, la nécessité de mesurer les quantités et les valeurs se fait peu sentir. Il suffit alors d’apprécier d’une manière [II-12] approximative l’étendue des pâturages nécessaires à l’alimentation du bétail, la quantité de subsistances qu’il faut mettre en réserve pour la mauvaise saison, etc. Il est encore moins nécessaire de mesurer la valeur des produits que la famille crée pour sa subsistance et son entretien puisqu’elle consomme ellemême ces produits, sans en échanger aucune portion. Cependant, dès qu’une séparation survient dans la famille, dès que certains membres demandent à se retirer de la communauté en réclamant leur part dans le capital et dans les produits communs, il faut bien mesurer cette part. Il faut compter les troupeaux, faire l’inventaire des provisions et tâcher aussi de se former une idée de la valeur comparative de ces capitaux ou de ces produits à partager. Cette nécessité de mesurer et d’évaluer les choses devient plus prononcée, d’une part, lorsque des individus appartenant à des familles différentes réunissent leurs forces et leurs capitaux pour produire, d’une autre part, lorsque la division du travail intervenant, chaque individu ou chaque famille ne produit plus directement tous ses objets de consommation, mais s’en procure une partie par l’échange. Dans ce nouvel état de choses, il est indispensable que chacun mesure aussi exactement que possible la quantité et la valeur des agents et des matériaux qu’il associe à ceux d’autrui pour produire, afin de pouvoir apprécier la quote-part qui doit lui revenir dans les résultats de la production; il n’est pas moins indispensable encore que chacun mesure la quantité et la valeur des produits qu’il échange.
La nécessité de mesurer les quantités et les valeurs dans cette phase nouvelle et progressive de la production étant bien établie, il s’agit de savoir ce que doivent être les mesures.
[II-13]
Les mesures doivent remplir plusieurs conditions essentielles. Elles doivent:
- 1°Être en harmonie avec la nature des choses qu’il s’agit de mesurer, et offrir aux détenteurs de ces choses un point d’appréciation ou de comparaison d’une perception claire et facile;
- 2°° Être autant que possible fixes ou stables.
Que la mesure doive être appropriée à la nature des choses qu’il s’agit de mesurer, cela se conçoit aisément. S’agit-il, par exemple, de terre? Ce qu’il faut, c’est une mesure de superficie. S’agit-il d’un produit mobilier solide, liquide ou gazéiforme? C’est une mesure de poids, de longueur ou de capacité. S’agit-il de travail? C’est une mesure de force ou de temps. L’étendue, la pesanteur, la force, le temps, voilà les éléments des mesures de quantité. La valeur, voilà, de même, l’élément des mesures de valeur.
Occupons-nous d’abord des mesures de quantité et des conditions essentielles qu’elles doivent remplir.
L’élément constitutif d’une mesure de quantité, étendue, pesanteur, force ou temps, doit être, comme nous venons de le voir, en harmonie avec la nature de la chose qu’il s’agit de mesurer. C’est un poids pour une chose pesante, une surface pour une chose étendue, etc. Mais ce n’est là que l’élément brut, on pourrait dire la matière première de la mesure. Il faut façonner cet élément brut, cette matière première. Il faut en tirer une unité ou, pour nous servir de l’expression consacrée, un étalon auquel on puisse rapporter les quantités qu’il s’agit de mesurer. Il faut encore diviser et multiplier cette unité ou cet étalon, afin de mesurer les quantités qui y sont contenues ou qui la contiennent. Est-ce le hasard qui a présidé au choix des [II-14] unités ou des étalons de mesure, de leurs divisions et de leurs multiples, ou bien ce choix a-t-il été déterminé, comme celui de l’élément constitutif dans lequel on les a pris et façonnés, par la nature des choses?
Une étude attentive démontre qu’on a dῦ chercher dès l’origine, pour la constitution des étalons, la réunion de certaines qualités, les unes économiques, les autres physiques.
Les quantités le plus souvent demandées des différents produits ou services ont dῦ, selon toute apparence, déterminer partout le choix des étalons de mesure ou de poids. Il était, en effet, naturel de choisir pour unité la quantité qui se présentait le plus communément dans les transactions, partant qui était la mieux et la plus généralement connue, comme aussi la plus facile à vérifier, au moins d’une manière suffisante pour l’usage. Cette conjecture est confirmée par l’histoire, à la vérité assez obscure et mal étudiée, des poids et mesures. C’est ainsi que les divers peuples de l’Europe ont depuis un temps immémorial adopté des étalons de poids qui ne présentent que des différences peu sensibles, bien qu’il n’y ait eu pour cet objet, entre eux, aucune entente, aucun accord préalable. Cette quasi uniformité des étalons de poids dans des contrées fort éloignées les unes des autres trouve son explication la plus naturelle dans ce fait que les besoins de l’alimentation qui provoquent partout la demande la plus usuelle des choses pesantes sont, partout aussi, à peu près les mêmes. Les quantités de subsistances le plus souvent demandées ne différant que d’une manière peu sensible sous l’influence des circonstances particulières de race et de climat, il a dῦ en résulter une certaine uniformité dans les unités économiques de poids.
Quant aux divisions et aux multiples de l’unité, on n’a pas [II-15] manqué de choisir partout ceux qui présentaient le plus de commodité dans l’usage. C’est ainsi que la division par moitié, quart, demi-quart, once, qui est de beaucoup la plus commode et la plus facile à concevoir au moins pour les mesures de poids et de capacité, a généralement prévalu.
Cependant, cette unité dont les besoins économiques de la société avaient déterminé le choix, il fallait la concréter dans un objet matériel qui s’y adaptât et qui demeurât le même en tous temps. Selon la plupart des historiens, on choisit pour type de la mesure de poids le grain d’orge ou de blé. On compta le nombre de grains qui étaient nécessaires pour former une livre et ce nombre devint l’étalon de poids. Pour mesures de longueur, on choisit certaines parties ou certains mouvements du corps humain [1]. Tels furent le pied, le pas, la coudée, la brasse. Mais ce choix demeurait toujours subordonné à la nature des choses à mesurer, et l’unité physique devait répondre à l’unité économique appropriée aux besoins des échanges, qu’elle servait à faciliter. Il semblerait naturel, par exemple, que l’on eῦt pris la taille moyenne de l’homme pour unité de longueur. [II-16] On n’en fit rien cependant. Pourquoi? Parce que cette unité était trop grande pour l’usage habituel. Parce que l’on demandait plus souvent une longueur répondant à celle du pied ou de la coudée qu’à celle du corps.
Pour mesurer le travail, on a choisi généralement une unité de temps, la journée, que l’on a divisée par moitié et par quarts. Cette unité a été choisie parce que la quantité de travail le plus souvent demandée est celle qui peut être livrée dans l’espace d’une journée. Cependant elle avait le défaut de manquer essentiellement de précision, car la durée de la journée de travail ne représente nullement, comme on sait, la durée du jour astronomique. A l’origine, on se contentait même de certaines indications assez vagues pour la spécifier. C’était, par exemple, l’intervalle compris entre le lever et le coucher du soleil, déduction faite du temps nécessaire pour les repas. Plus tard, à mesure qu’un plus grand nombre d’ouvriers ont été employés à une même œuvre, on a senti le besoin d’une précision plus grande, et l’on a spécifié l’heure à laquelle la journée devait commencer et celle à laquelle elle devait finir, ainsi que la durée des intervalles consacrés aux repas. Mais la journée n’en est pas moins demeurée l’unité générale de mesure pour le travail. Ce n’est pas une unité physique, puisque la journée de travail n’a rien de commun avec la journée astronomique. C’est une unité économique.
Certains travaux se mesurent toutefois à l’aide d’une unité plus longue, en vertu de leur nature particulière. S’agit-il, par exemple, des services d’un contre-maître, d’un commis ou d’un directeur d’exploitation; on ne peut évidemment les demander pour une journée comme lorsqu’il s’agit de ceux d’un simple ouvrier, car il faut déjà plusieurs jours à un contre-maître ou à [II-17] un commis pour se mettre au courant de sa besogne. Selon que le travail exige une mise en train plus ou moins longue, selon encore qu’il comporte une responsabilité plus ou moins grande, on demande les services du travailleur pour un mois, pour un trimestre ou pour un an. L’unité de mesure des travaux de cette catégorie, c’est alors le mois, le trimestre ou l’année.
Certains travaux comportent enfin une unité plus courte que la journée. Les artistes dramatiques sont fréquemment payés par représentation, les professeurs par leçon. La durée de la représentation ou de la leçon est rarement spécifiée. C’est l’usage qui en décide, — et l’usage à son tour est fondé sur la nature du travail demandé. Les leçons se demandent plus ou moins longues selon que la science ou l’art qu’il s’agit d’étudier exige une application plus ou moins forte et suivie des facultés de l’étudiant, et, par conséquent, cause plus tôt de la fatigue. De là, une certaine diversité, fondée comme toujours sur la nature des choses, dans la leçon considérée comme unité de mesure d’une catégorie particulière de travaux.
Le choix de l’étalon de mesure ou de poids est donc déterminé d’abord par la nature des choses à mesurer ou à peser, ensuite par la quantité de ces choses qui est le plus communément demandée. Cette unité économique est concrétée ensuite dans une unité physique qui s’y ajuste, et qui puisse être aisément reconnue et vérifiée, comme le grain de blé, d’orge ou de riz pour le poids, les dimensions ou les mouvements du corps humain pour la longueur, les divisions naturelles du temps pour les services mesurables par la durée.
Il ne suffit pas toutefois que l’étalon ainsi façonné offre un point de comparaison facile à apprécier et à vérifier, il faut encore qu’il demeure fixe ou stable. Ceci ne comporte point [II-18] une longue démonstration. Supposons que les mesures en usage soient sujettes à varier, sans qu’on puisse prévoir et calculer à l’avance leurs variations, il deviendra impossible de conclure un marché sur une base certaine. On recevra une quantité supérieure ou inférieure à celle dont la livraison aura été stipulée, selon que la mesure sera devenue plus lourde ou plus légère, qu’elle se sera allongée ou rétrécie dans l’intervalle, et cette instabilité de la mesure, en rendant toutes les transactions incertaines, opposera un obstacle sérieux à leur multiplication.
Il importe de même que l’étalon choisi présente un type uniforme, car sa diversité peut donner naissance à d’incessantes contestations. A cet égard, il semble que certains types primitivement adoptés, tels par exemple que les dimensions et les mouvements du corps humain aient laissé beaucoup à désirer.
Cependant l’inconvénient qui en résultait, était moindre qu’on ne serait tenté de le supposer au premier abord. Les dimensions et les mouvements de la grande majorité des hommes d’une même race forment, en effet, une moyenne, dont l’approximation est facile. Or, cette approximation pouvait suffire aux époques où les échanges étaient encore peu fréquents et les contrats à longs termes presque inconnus. L’extrême précision et l’extrême stabilité de la mesure n’auraient eu alors qu’une faible utilité pratique. Lorsque ce besoin de précision et de stabilité commença à se faire sentir, on ne manqua pas d’y pourvoir. On façonna, en employant des matériaux aussi peu altérables que possible, du bois dur ou des métaux, des étalons-types qui reproduisaient en les fixant, les mesures en usage. On se servit de ces étalons-types pour vérifier les poids et mesures, et, au besoin, pour les redresser ou [II-19] les rectifier quand ils venaient à s’altérer. Dans l’antiquité, on les conservait dans les temples sous la responsabilité des prêtres et sous la protection des dieux. Plus tard, lorsque les fonctions religieuses ont commencé à se séparer des fonctions judiciaires et administratives avec lesquelles elles étaient primitivement confondues, les gouvernements se sont chargés de la conservation des étalons de poids et de mesures.
Malheureusement, les gouvernements ne s’en sont pas tenus là. Ils ne se sont pas bornés à conserver intacts les types en usage, et à s’en servir pour réprimer les fraudes et les tromperies sur les poids et mesures. Ils ont eu la prétention d’en créer de nouveaux, et de les imposer aux populations, sans rechercher si ces nouveaux étalons répondaient mieux que les anciens aux besoins ou aux convenances des consommateurs. C’est ainsi que le système métrique a été imposé à la France et aux pays qui suivent d’habitude son exemple, bon ou mauvais, pour remplacer les poids et mesures de l’ancien régime.
Ce système, inventé et combiné par un “comité” de physiciens et de mathématiciens, peut être une fort agréable conception physico-mathématique, mais il a le défaut capital de ne tenir aucun compte de l’élément essentiel en matière de poids et mesures, savoir de l’unité économique. Ses inventeurs ont commis, en effet, la faute grave de prendre, en matière de poids par exemple, une unité beaucoup plus forte que celle que comportent les besoins des populations; on a dῦ, en conséquence, la partager par moitié dans l’usage; ce qui a engendré une complication au lieu d’amener une simplification. Les nouvelles divisions décimales de l’étalon de poids avaient encore l’inconvénient d’être difficiles à reconnaître, et de compliquer les calculs beaucoup plus que les anciennes divisions, [II-20] par demi, par quart, etc., et la mauvaise foi des marchands de détail n’a pas manqué d’exploiter largement cette imperfection du nouveau système, aux dépens de la masse des consommateurs pauvres et ignorants. Quant au nouvel étalon de longueur, le mètre, il avait le défaut non moins grave de ne pouvoir être aisément approximé comme l’étaient les étalons tirés des dimensions du corps humain, le pieds, la palme, la coudée, la brasse. Quelques autres parties du système, celles qui concernaient la division du temps et la mesure des angles, par exemple, étaient encore beaucoup moins acceptables [2] . Aussi, ce système artificiel a eu beau être présenté au monde comme le plus merveilleux et le plus enviable des progrès: nulle part on a pu le faire accepter de plein gré, nulle part même on n’a pu l’imposer dans toutes ses parties, malgré la prohibition rigoureuse dont on a frappé les anciens systèmes déclarés “routiniers” ou “rétrogrades.”
Sans doute, la diversité, le manque d’uniformité et de fixité [II-21] de ces systèmes, dans certains cas aussi, la complication de leurs divisions présentaient des inconvénients. Cependant, ces inconvénients étaient moindres que ne se plaisent à le supposer les admirateurs fanatiques du système métrique, et d’ailleurs on pouvait aisément les corriger, sans créer de toutes pièces un système arbitraire aussi mal adapté que possible aux besoins des populations.
S’agit-il, par exemple, de la fixité des poids et mesures. Sous ce rapport, il serait impossible, assure-t-on, de concevoir quelque chose de plus parfait qu’un système basé sur la mesure de notre globe et sur le poids spécifique de l’eau distillée. Soit! mais en admettant même que cette perfection existe (ce qui n’est point, car on a reconnu trop tard qu’une erreur a été commise dans la détermination de la longueur du mètre), elle n’aurait aucune importance dans la pratique, et elle serait, en tous cas, fort loin de compenser les inconvénients et les embarras quotidiens qui résultent de l’établissement d’un étalon arbitraire, en désaccord avec l’étalon économique qui ressort de la nature des choses à peser ou à mesurer. Les anciens étalons que l’on conservait dans les temples et plus tard dans les administrations publiques présentaient une fixité bien suffisante dans la pratique, et ils avaient cet avantage que l’homme le plus ignorant pouvait, sans aucun effort, se les représenter, en les rapportant à la dimension ou au poids généralement connu qu’ils servaient à fixer [3] . Enfin, en [II-22] admettant qu’il y eῦt nécessité d’assurer mieux la fixité des étalons, ne suffisait-il pas de calculer le rapport existant entre l’étalon de mesure et la longueur du pendule ou bien encore [II-23] celle des méridiens (quoique l’opération de la mesure des méridiens fῦt, l’expérience l’a prouvé, coῦteuse, difficile et incertaine). Ce rapport, une fois connu, ne pouvait-on pas [II-24] toujours rétablir les étalons-types, en supposant, chose peu probable, qu’ils vinssent à s’altérer d’une manière appréciable? A la vérité, ce rapport n’aurait pas été exprimé par une quantité régulièrement décimale, mais la régularité mathématique n’était ici nullement nécessaire, et la preuve c’est qu’après avoir tout sacrifié à ce besoin prétendu d’une régularité mathématique, on a fini par ne point l’obtenir, car, par suite de l’erreur mentionnée plus haut, le mètre ne représente pas exactement la dix millionième partie du quart du méridien.
S’agit-il de l’uniformité des poids et mesures? Il ne faudrait pas, non plus, s’en exagérer les avantages. La plus forte proportion des échanges s’effectue partout dans la même ville, dans le même canton ou dans la même province. Les échanges à distance, de pays à pays, par exemple, sont peu nombreux en comparaison de ceux-là. La diversité des systèmes présente, en conséquence, des inconvénients moindres que l’uniformité d’un système incommode.
Cette diversité était certainement poussée l’excès sous l’ancien régime. Par suite du morcellement politique qui caractérisa le moyen âge, chaque seigneurie ou chaque commune, constituée comme un État à part, eῦt ses mesures particulières. Mais il n’en résultait qu’un faible inconvénient, à cause de la rareté des échanges à distance. Ce fut seulement lorsque la sphère des échanges commença à s’agrandir, grâce aux progrès de la sécurité intérieure et au développement des moyens de communication que cet inconvénient se fit sentir. Alors aussi, on ne manqua pas d’y porter remède en adoptant des mesures communes et spéciales pour les marchandises qui s’échangeaient à distance, le last pour les grains, le marc pour les métaux précieux, le carat pour les diamants et les autres [II-25] pierres fines, sans tenir aucun compte de la “nationalité” des choses à peser ou à mesurer. L’uniformisation des poids et mesures se serait ainsi, selon toute apparence, opérée d’ellemême, dès qu’elle serait devenue nécessaire, si les gouvernements n’y avaient point mis obstacle en imposant, dans les limites de leur juridiction, un système qualifié de “national.” L’Unité, adoptée d’un commun accord, aurait été, selon toute apparence aussi, la mieux appropriée aux convenances du plus grand nombre; elle aurait été, sur le marché général ce qu’elle avait été d’abord sur les marchés particuliers, savoir: la quantité la plus demandée.
Cette prétention, d’ailleurs assez moderne, des gouvernements d’imposer un certain système de poids et mesures dans les limites de leur juridiction, à l’exclusion de tout autre système indigène ou étranger, est peut-être ce qui a le plus contribué à retarder l’uniformisation des poids et mesures. Si l’on veut que ce progrès s’accomplisse, il faudra, avant tout, que les gouvernements cessent d’imposer aux échangistes un système arbitraire à l’exclusion de tout autre; comme s’ils étaient plus capables que les intéressés eux-mêmes de choisir les étalons les mieux appropriés à chaque espèce d’échange! Il faudra pour tout dire que les gouvernements reconnaissent la liberté du mesurage, en se bornant désormais à vérifier les poids et mesures en usage, et à réprimer les fraudes auxquelles le mesurage peut donner lieu. Alors, mais alors seulement, on verra s’établir dans toute l’étendue du monde civilisé un système uniforme de poids et mesures. Ce système se constituera, non par l’adoption en bloc du système en vigueur dans tel ou tel pays, mais par la généralisation successive des poids et mesures déjà existants dans les différents systèmes ou encore à trouver, [II-26] qui conviennent le mieux à chaque catégorie de produits et de services à peser ou à mesurer [4]
[II-27] [II-28] [II-29] [II-30] [II-31] [II-32] [II-33] [II-34] [II-35] [II-36] [II-37] [II-38]
[II-39]
DEUXIÈME LEÇON↩
la mesure de la valeur
De la valeur et de ses éléments. — Nécessité de mesurer la valeur. — Impossibilité de trouver une mesure fixe de la valeur. — Qualités que doit réunir une mesure ou un étalon de la valeur. — Qualités que réunissent les métaux précieux pour remplir cette fonction économique; — l’uniformité de la qualité; — la transportabilité; — la durabilité. — Perturbations que causent les variations de l’étalon. — Lequel de l’or ou de l’argent est le moins sujet à varier. — De l’étalon simple et de l’étalon double. — Étalons réels et étalons nominaux.
Dans la première partie de ce cours, j’ai analysé les éléments constitutifs de la valeur. J’ai montré que la valeur est un composé d’utilité et de rareté; que l’union de ces deux éléments opposés est nécessaire pour la constituer; qu’une chose peut être utile, indispensable même, sans avoir aucune valeur, si l’on n’éprouve à se la procurer aucune difficulté, si elle n’est pas rare à quelque degré; qu’il en est de même si cette chose est rare, difficile à obtenir sans être utile. J’ai essayé de démontrer, en même temps, contrairement à une opinion accréditée, [II-40] que la valeur existe indépendamment de l’échange, que l’échange la manifeste sans la créer.
La valeur constitue une puissance économique. Toute chose s’échange en raison de la proportion de cette puissance qui est contenue en elle et qui constitue son pouvoir d’échange. Comment ce pouvoir d’échange augmente et diminue, c’est ce que j’ai cherché à déterminer encore. On a vu qu’il s’établit et se fixe, dans l’échange, en raison inverse des quantités offertes, et qu’il varie en progression géométrique lorsque les quantités varient simplement en progression arithmétique; d’où l’extrême mobilité qui caractérise toutes les valeurs, mobilité qui a pour résultat admirable l’équilibre du monde économique. (Voir la première partie. Loi des quantités et des prix.)
Mais ce pouvoir en raison duquel les choses s’échangent, comment peut-on en apprécier l’étendue si ce n’est en les mesurant? Comment pourrai-je me faire une idée de ce que valent le blé, le vin, le coton, le thé, les habits, les outils, etc., si je ne rapporte point la valeur de chacune de ces choses à une unité commune, de manière à pouvoir constituer une échelle des valeurs comme je constitue au moyen de l’unité de grandeur une échelle des grandeurs? Supposons qu’il n’existe point de mesure de grandeur, comment me ferai-je une idée de la hauteur comparative d’un arbre, d’une maison, d’une montagne? J’en serai réduit à dire: l’arbre a deux fois la hauteur de la maison, la montagne a cent fois la hauteur de l’arbre. Si le nombre des objets, dont j’ai besoin de connaître la hauteur est petit, ce mode de mesurage pourra me suffire à la rigueur. Mais si ces objets se multiplient, il faudra bien que j’en choisisse un auquel je compare la grandeur de tous les autres. Il en est de même pour les valeurs. Supposons qu’il n’existe point d’étalon [II-41] commun auquel on puisse rapporter la valeur de chacune des choses qui sont présentées à l’échange, j’en serai réduit à évaluer successivement et isolément ces choses. Je dirai tant de blé vaut tant de café, c’est à dire telle quantité de blé a un pouvoir d’échange égal à celui de telle quantité de café, et ainsi pour l’infinie variété des produits ou des services qui font l’objet des échanges; mais il me sera impossible de me faire une idée des rapports de valeur existant entre l’ensemble de ces choses, à moins que je ne possède une unité commune échelonnée par degrés où je puisse marquer le niveau de chacune de ces valeurs: absolument comme je ne pourrai me faire une idée précise des hauteurs comparatives de l’arbre, de la maison, de la montagne, etc., qu’à la condition de posséder une unité à laquelle je rapporte ces différentes hauteurs. Cette mesure commune me serait nécessaire alors même que la valeur de chacune des choses qui se présentent à l’échange ou qui doivent être additionnées ou partagées ne serait point sujette à varier; à plus forte raison l’est-elle lorsque ces choses sont soumîses à des variations incessantes de valeur [6] .
[II-42]
Maintenant, quelle peut être cette mesure commune des valeurs? Evidemment une chose pourvue de valeur, de même que la mesure commune des grandeurs ne peut être qu’une grandeur. Comme on a pris le pied, la coudée, la brasse et finalement le mètre pour y rapporter les longueurs dont on veut connaître la mesure, il faut prendre une valeur pour y rapporter les valeurs qu’il s’agit de mesurer. Ce sera, par exemple, la valeur d’une quantité déterminée de blé, d’argent, d’or, de cuivre, etc. Cependant nous nous heurtons ici à une difficulté que nous n’avons point rencontrée lorsqu’il s’est agi des quantités physiques. C’est que si l’on peut trouver une chose dont les [II-43] dimensions ne varient point ou ne varient que d’une manière insensible, on ne trouve point de valeur invariable; c’est que la valeur ne se manifestant que par l’échange et se trouvant soumise dans l’échange à des fluctuations qui se produisent, avec une excessive sensibilité, à chaque changement dans la proportion des quantités offertes, il est impossible d’obtenir une mesure fixe de la valeur, à raison de l’extrême mobilité de l’élément qui la compose. Cet inconvénient a une gravité facile à apprécier. C’est comme si le mètre était incessamment exposé à s’allonger ou à se raccourcir. Mais c’est un inconvénient qui tient à la nature des choses et auquel on ne peut espérer de remédier d’une [II-44] manière absolue. La recherche d’une mesure fixe de la valeur est, en effet, considérée à bon droit comme le problème de la quadrature du cercle de l’économie politique.
Quoi qu’il en soit, l’étalon des valeurs ne peut être qu’une chose ou bien encore un ensemble de choses pourvues de valeur. Recherchons maintenant les qualités qu’il doit réunir, et qui doivent faire préférer telle chose à telle autre dans le choix de l’étalon.
Cet étalon doit consister dans une valeur qui soit: 1° la plus généralement connue ou la plus aisée à connaître; 2° la plus fixe ou la moins variable.
Cette valeur n’est pas la même chez tous les peuples et elle change à mesure que les transactions se multiplient et s’étendent à une plus grande diversité d’objets. Chez un peuple pasteur la valeur dont chacun possédera la notion la plus claire et la plus précise, sera celle du bœuf ou du mouton; chez un peuple ictyophage, ce sera celle de l’espèce de poisson ou de coquillage dont on se nourrit d’habitude; chez un peuple agriculteur ce sera celle de la quantité la plus souvent demandée du grain qui sert de base à l’alimentation. Naturellement les populations compareront à ces valeurs qu’elles connaissent bien, dont elles ont la notion claire et positive, toutes les autres valeurs, comme elles comparent à la grandeur bien connue du pied ou de la coudée toutes les autres grandeurs. Un bœuf, un mouton, un poisson ou une mesure de blé, voilà donc quels ont dῦ être et quels ont été, partout, les premiers étalons de la valeur. Ces étalons primitifs réalisaient la première condition de toute mesure, savoir d’être faciles à connaître, de présenter une notion qui entre, en quelque sorte instinctivement, dans les esprits les plus bruts, s’y fixe et s’y conserve. En revanche, ils étaient, sous le rapport de [II-45] la fixité ou de la stabilité, essentiellement imparfaits. Car le bétail, le poisson, le blé sont sujets à des fluctuations de valeur brusques et considérables. Telle évaluation faite en têtes de bétail après une épizootie ou en mesures de blé dans une année de disette différera singulièrement de celle qui sera faite dans une année d’abondance de blé ou de bétail.
Cependant, ce défaut de fixité ou de stabilité de l’étalon ne présente pas à l’origine les inconvénients que l’on pourrait supposer, si l’on jugeait, comme on n’y est que trop disposé, du passé par le présent; il ne devient sensible, et l’on n’éprouve, en conséquence, le besoin d’y porter remède, que dans un état plus avancé du développement économique de la société, savoir lorsqu’aux échanges immédiats ou au comptant commençent à se joindre les contrats ou les échanges à terme.
Rendons-nous d’abord bien compte de ces deux sortes d’opérations.
Vente ou achat au comptant, marché au comptant, sont des expressions synonymes, signifiant que les choses qui font l’objet de l’échange ou du marché sont réciproquement livrables immédiatement après la conclusion de l’échange ou du marché.
Vente ou achat à terme, marché à terme signifie au contraire que les choses échangées ou l’une de ces choses seront livrées plus tard, en totalité ou d’une manière successive.
Quant il s’agit d’un marché au comptant, il suffit que les deux parties contractantes connaissent bien la valeur actuelle de la chose servant d’étalon; il n’est pas nécessaire que cet étalon soit ce qu’il était la veille, ce qu’il sera le lendemain.
Mais il en est autrement quand il s’agit d’une opération à terme. La fixité de l’étalon devient alors une nécessité. Supposons, par exemple, que je loue une maison ou une terre pour [II-46] un terme de neuf ans, il sera indispensable que la somme stipulée pour la location conserve une certaine fixité. Si l’étalon des valeurs est une mesure de blé, et que je contracte à raison de 100 mesures de blé par année, le blé étant sujet à des fluctuations de valeur considérables, je serai exposé à ce que la redevance qui me sera fournie varie, d’année en année, du simple au double ou même au triple. Ainsi, en admettant que j’aie contracté dans une année de rareté, et qu’il y ait, l’année suivante, une récolte abondante, les 100 mesures de blé que je recevrai alors constitueront un loyer deux ou trois fois moindre que dans la première et vice versâ. Il en sera de même si le loyer est stipulé en têtes de bétail ou en poissons. Ces étalons étant, de leur nature, instables, les contractants qui en feront usage auront à subir le risque d’un allongement ou d’un raccourcissement de l’étalon pendant la durée du contrat ou du marché à terme. Si ce risque ne peut être évalué d’avance, il en résultera un obstacle sérieux à la conclusion des marchés à terme, et l’on éprouvera le besoin d’écarter cet obstacle, en adoptant un étalon plus stable.
Cet étalon plus stable, on l’a obtenu en substituant aux étalons primitifs certains métaux, dont les plus notables sont l’or et l’argent. Grâce à une réunion particulière de qualités physiques, l’or et l’argent possèdent une uniformité et une stabilité de valeur plus grandes que celles d’aucun autre produit. Sous ce double rapport, ils l’emportent beaucoup sur les étalons primitifs, bétail, blé, etc. Ainsi, un certain poids d’or ou d’argent affiné est le même partout, tandis qu’un bœuf, un mouton ou une mesure de blé peuvent différer sensiblement d’un autre bœuf, d’un autre mouton ou d’une autre mesure de blé. L’or et l’argent possèdent, en un mot, au plus haut [II-47] degré l’uniformité de la qualité, laquelle est un élément essentiel de l’uniformité de la valeur. Cet élément ne suffit cependant pas encore. Car un même bœuf, un même mouton, une même mesure de blé peuvent avoir des valeurs fort diverses à des distances assez courtes, et l’immense majorité des produits ou des services se trouvent dans le même cas. L’or et l’argent sont sujets à la même diversité de valeur, mais à un degré infiniment moindre, grâce à leur extrême transportabilité. Sans doute, on ne les produit pas partout, et, dans les endroits où on les produit, leurs frais de production sont fort divers. Il en coùte beaucoup plus, par exemple, pour extraire un kilog. d’or des sables du Rhin que de ceux du Sacramento. Mais comme l’or est particulièrement facile à transporter, parce qu’il renferme une grande valeur sous un petit volume, on ne manque pas de le porter toujours dans les endroits où il vaut plus qu’ailleurs. Ainsi, en Californie et en Australie où on le produit en abondance et avec une facilité relative, sa valeur, ou, en d’autres termes, son pouvoir d’échange par rapport aux autres marchandises est moindre qu’en Angleterre ou en France. Qu’en résulte-t-il? C’est que ceux qui le produisent trouvent profit à le faire transporter en Angleterre ou en France, où il peut leur procurer une plus grande quantité d’autres marchandises, qu’il ne le pourrait en Californie et en Australie. On l’exporte donc jusqu’à ce que sa valeur soit nivelée sur les deux marchés, sauf la différence des frais de déplacement. La même observation s’applique à l’argent, quoique dans une mesure moindre, car l’argent ayant de 15 à 16 fois moins de valeur sous un même volume est proportionnellement plus coῦteux à transporter; il possède à un degré moindre la qualité de la transportabilité.
L’uniformité ou la quasi uniformité de la valeur de l’or et de [II-48] l’argent dans l’espace reposent donc sur deux qualités physiques qu’ils possèdent à un plus haut degré que la plupart des autres produits, savoir l’uniformité de la qualité et la transportabilité. Certains produits, les pierres précieuses, par exemple, possèdent à un plus haut degré encore la qualité de la transportabilité, mais sans y joindre au même degré celle de l’uniformité de la qualité.
L’uniformité ou la stabilité de la valeur des métaux précieux dans le temps se fonde sur une autre de leurs qualités physiques, savoir la durabilité. Grâce à cette qualité qu’ils possèdent, l’or surtout, à un haut point, il en existe dans le monde un approvisionnement qui s’est accumulé de siècle en siècle et sur lequel l’augmentation ou la diminution de la production d’une année ou même de plusieurs années ne peut exercer qu’une faible influence. Tandis que les inégalités de la récolte du blé peuvent faire varier du simple au double le prix de cette denrée alimentaire, parce que le stock des années antérieures est relativement insignifiant, les variations de la récolte annuelle de l’or et de l’argent ne peuvent exercer qu’une action insensible sur la valeur de ces métaux, parce qu’il en existe dans le monde un stock infiniment supérieur au montant de la récolte d’une année. A quoi il faut ajouter que le blé étant un article de première nécessité, la demande en demeure à peu près la même soit que l’approvisionnement abonde ou qu’il soit insuffisant, tandis que les métaux précieux n’ayant pas ce caractère de nécessité dans l’usage, une diminution de leur approvisionnement qui aurait pour effet naturel de susciter, si la demande demeurait la même, une hausse extrême de leur valeur, provoque un ralentissement de la demande qui retarde l’exhaussement de leur valeur s’il ne l’arrête point.
[II-49]
Telles sont les qualités qui rendent les métaux précieux propres à servir d’étalons ou de mesures des valeurs. Peut-on dire cependant qu’ils constituent des étalons parfaits? En aucune façon. Ils réunissent à un plus haut degré que les autres marchandises l’ensemble des qualités nécessaires pour constituer une mesure des valeurs; mais ces qualités, ils sont loin d’en être pourvus d’une manière absolue. Ils possèdent même quelques-unes de ces qualités à un moindre degré que d’autres produits, s’ils en possèdent l’ensemble à un plus haut degré.
Ainsi l’uniformité de leur valeur dans l’espace est loin d’être absolue; elle est même moindre que ne le serait celle des diamants par exemple si ceux-ci servaient d’étalons, car les diamants sont à un plus haut point transportables. Il en est de même pour l’uniformité de leur valeur dans le temps. S’ils l’emportent, à cet égard, sur la plupart des autres marchandises, dans un court intervalle, il en est autrement lorsqu’il s’agit d’un long espace de temps. C’est ainsi que, dans une période de plusieurs siècles, la valeur du blé présente une moyenne plus uniforme que celle des métaux précieux. Enfin, il y a des produits dont la valeur est plus accessible à l’intelligence des masses que celle de l’or et de l’argent. Telles sont les denrées alimentaires qui servent à la consommation générale.
Nous venons de dire que la valeur du blé, prise dans une période de plusieurs siècles, présente un niveau moyen plus uniforme que celle des métaux précieux, — un niveau moyen, c’est à dire compensation faite des inégalités provenant des différences annuelles des récoltes. En effet, les frais de production du blé, au niveau desquels sa valeur s’établit à travers les fluctuations des récoltes, n’ont pas changé sensiblement depuis l’invention de la charrue, tandis qu’il en a été autrement pour [II-50] ceux des métaux précieux. Dans l’antiquité d’abord, l’approvisionnement d’or et d’argent, provenant des récoltes antérieures étant beaucoup moindre qu’il ne l’est devenu depuis, toute augmentation extraordinaire de la production, provenant de la découverte de nouvelles mines devait influer d’une manière sensible et rapide sur la valeur des métaux précieux. Plus tard, au moyen àge, lorsque la production en avait presque entièrement cessé, et que toutes relations commerciales se trouvaient à peu près interrompues entre les différentes parties de l’Europe, leur valeur dut encore subir des fluctuations considérables. Enfin, après la découverte de l’Amérique, l’abaissement de leurs frais de production finit par amener une diminution correspondante de leur valeur. On ne saurait donc dire que les métaux précieux soient des étalons parfaits, c’est à dire des mesures de la valeur partout et toujours uniformes, comme sont les unités de longueur, de capacité ou de poids. Ils fournissent les mesures de valeur les moins imparfaites que l’on connaisse, eu égard à l’ensemble des qualités que doivent réunir les mesures de cette espèce, voilà tout!
Est-ce à dire que l’on n’en puisse trouver d’autres? que l’on ne puisse arriver même à en découvrir qui possèdent d’une manière absolue les qualités nécessaires à la mesure des valeurs, qualités qui peuvent se résumer par un seul mot: l’invariabilité, autrement dit la fixité ou l’uniformité absolue dans l’espace et dans le temps? Que l’on ne puisse trouver d’étalons de la valeur moins variables que les étalons actuels, ce serait une témérité pédantesque de l’affirmer. Que l’on puisse découvrir une mesure de la valeur absolument invariable, c’est au contraire une véritable utopie, et le problème de l’invariabilité de la mesure de la valeur est considéré, à bon droit, comme la quadrature du [II-51] cercle de l’économie politique. Il n’existe point, en effet, de chose dont la valeur demeure toujours uniforme dans l’espace et dans le temps, et l’on ne peut se figurer même qu’il en existe une. Mais de même que la quadrature du cercle n’aurait aucune utilité appréciable, car une approximation infinitésimale suffit dans l’usage, il n’est point nécessaire de posséder une mesure invariable de la valeur. Une fixité approximative est suffisante. Seulement on peut se demander s’il n’y aurait pas moyen d’obtenir mieux que l’approximation déjà acquise; si, à une époque comme la nôtre, en particulier, ou l’on peut prévoir un nouvel abaissement de la valeur des métaux précieux, il n’y aurait pas lieu de chercher une mesure des valeurs qui approche davantage de la fixité.
Si l’on veut se faire une idée de l’utilité que pourrait avoir un tel progrès, il est nécessaire de se rendre bien compte de l’influence qu’exercent sur les transactions et sur l’économie générale de la société, les variations de l’étalon des valeurs, surtout à une époque comme la nôtre où les contrats et les opérations à terme de toute sorte se sont si considérablement multipliés. Supposons que la valeur du métal servant d’étalon, la valeur de l’or par exemple, vienne à baisser d’un dixième, qu’en résultera-t-il? C’est que toutes les personnes qui auront fait des opérations à terme subiront, comme créanciers, une perte d’un dixième sur les sommes stipulées. Ainsi, tel qui aura loué pour une somme de fr. 1,000 une maison ou une terre ne recevra plus, après la baisse, qu’une valeur de fr. 1,000 — 1/10e, soit fr. 900, et cette perte, il la subira jusqu’à l’expiration de son contrat de location. Alors seulement il pourra, en renouvelant son bail, exiger une augmentation de prix, servant à compenser la diminution de la valeur du métal-étalon. [II-52] Il le portera par exemple à fr. 1,110, ce qui le mettra dans la même situation qu’auparavant, 1,110 fr. n’ayant plus qu’une valeur ou, ce qui revient au même, une puissance d’achat à peu près égale à celle que possédaient les 1,000 fr. avant la baisse. La position des créanciers sera, comme on voit, d’autant plus mauvaise qu’ils auront contracté pour un terme plus long. Elle le sera tout à fait s’ils ont contracté pour un terme illimité, s’il s’agit d’une rente perpétuelle; s’ils ont prêté, par exemple, à un gouvernement fr. 1,000 à 5 p. c., sans stipuler aucune époque de remboursement. En ce cas, les 50 fr. qu’ils recevront n’équivaudront plus, après la baisse, qu’à 45 fr.; ce sera, en un mot, comme s’ils avaient subi, à perpétuité, une réduction d’intérêt d’un demi p. c. On objectera, à la vérité, que si cette baisse de l’étalon est dommageable aux créanciers, en revanche elle est profitable aux débiteurs, et particulièrement aux États, gros emprunteurs, comme chacun sait. Nous l’accordons, mais le gain des uns peut-il être, en bonne justice et en bonne économie, invoqué comme une compensation du dommage infligé aux autres? D’ailleurs, un autre mal résulte encore de cette perturbation. Comme nous l’avons remarqué, la dépréciation du métal précieux servant d’étalon n’a pas lieu d’emblée. Elle s’opère toujours avec une certaine lenteur. C’est ainsi qu’après la découverte de l’Amérique, il a fallu environ trois quarts de siècle avant que les métaux précieux ne fussent descendus au niveau où ils devaient ensuite se maintenir d’une manière à peu près fixe. Lorsqu’une dépréciation survient, nul ne peut prédire non plus quand et à quel point elle s’arrêtera. Dans l’intervalle et même encore quelque temps plus tard, toutes les transactions sont entravées par le risque de dépréciation de l’étalon. Ce risque, les gens qui prêtent des capitaux sous [II-53] forme de monnaie ou qui en louent sous forme de terres ou de maisons, ne manquent pas de s’en couvrir au moyen d’une prime, ajoutée au taux ordinaire de l’intérêt et des loyers. Cette prime dépasse même toujours le risque qu’elle sert à couvrir à cause de l’impossibilité de calculer exactement ce risque. Toutes les opérations à terme, prêts, loyers, etc., sont ainsi rendues plus difficiles et plus onéreuses pour les emprunteurs et les locataires; en sorte que si la classe des débiteurs gagne sur le passé quelque chose à la dépréciation, en revanche elle perd sur le présent et sur l’avenir. A quoi il faut ajouter que la société prise dans son ensemble perd naturellement aussi au ralentissement des transactions, provenant de cette cause.
Enfin, il y aurait bien quelque chose à dire sur la perturbation que la baisse de l’étalon amène dans les opérations au comptant, vente des marchandises, loyer du travail, etc. Si les fermiers, les industriels et les marchands peuvent communément augmenter d’emblée les prix de leurs produits de manière à compenser la baisse actuelle et même à se couvrir du risque éventuel de baisse de l’étalon, en revanche la masse qui vit au jour le jour du produit de son travail le peut rarement, et elle subit de ce chef un dommage d’autant plus grand, et des privations d’autant plus rudes que sa position est plus dépendante et son salaire plus rapproché du minimum des subsistances.
On voit donc, par ce court aperçu, que nous compléterons dans les leçons suivantes, combien il importe, au double point de vue de la justice et de l’utilité générale, que l’étalon ou la mesure des valeurs soit aussi peu variable que possible. D’où il suit que si l’or et l’argent, qui sont devenus les étalons universels, [II-54] devaient subir une nouvelle baisse analogue à celle qu’ils ont éprouvée lors de la découverte de l’Amérique, il y aurait lieu certainement de les remplacer par un étalon se rapprochant davantage de l’invariabilité.
Mais cet heureux phénix est encore à trouver.
En attendant, on se demande lequel des deux métaux employés généralement comme étalon, l’or ou l’argent, possède au plus haut degré la qualité essentielle de la stabilité de la valeur, lequel des deux est le moins exposé à une dépréciation ou à une hausse, lequel des deux il convient, en conséquence, d’adopter de préférence comme étalon? Les esprits sont fort partagés sur ce point. L’argent a ses partisans déterminés, au nombre desquels il faut placer en première ligne M. Michel Chevalier, dont on connaît les beaux travaux sur la monnaie. Mais l’or a aussi ses défenseurs ardents et convaincus, et ceux-ci paraissent même devoir l’emporter sur leurs adversaires. La question est certainement fort difficile à résoudre. Nous inclinons à croire, pour notre part, que l’or est actuellement plus exposé que l’argent au risque d’une dépréciation, et cette opinion s’appuie sur l’énorme accroissement de la production de l’or depuis une vingtaine d’années. On nous objecte, à la vérité, d’une part, que si la production de l’or s’est accrue depuis vingt ans, en revanche la demande s’en est accrue aussi; d’une autre part, que cette dépréciation si souvent prédite n’a pas encore eu lieu. La première de ces deux objections a une valeur incontestable, quoique, en admettant que la production de l’or se poursuive sur le pied actuel, c’est à dire sur le pied d’un milliard environ par an au lieu d’une centaine de millions de francs seulement, comme il y a vingt ans, on conçoive difficilement [II-55] que la demande puisse continuer indéfiniment à faire équilibre à l’offre, au niveau de la valeur actuelle. La seconde objection nous parait avoir moins de poids. Si l’augmentation considérable qu’à subie la production de l’or n’a pas exercé une influence immédiate sur la valeur de ce métal, cela tient, comme l’a fort bien observé M. de Humboldt, à ce que l’or étant un produit essentiellement durable, il en existe dans le monde un approvisionnement vingt ou trente fois supérieur au montant de la récolte annuelle la plus abondante. Sous l’influence de cette qualité particulière, la valeur des métaux précieux n’est descendue que fort lentement après la découverte de l’Amérique; elle devra descendre plus lentement encore après la découverte des gisements aurifères de la Sibérie, de la Californie et de l’Australie, car le stock d’or existant au XIXe siècle dépasse de beaucoup le stock existant au XVIe; d’où il suit que le rapport entre l’augmentation d’une année et la masse de l’approvisionnement des années antérieures est actuellement plus faible qu’il ne l’était après la découverte de l’Amérique. Mais de ce que la dépréciation doit, sous l’influence de ces causes, être lente, plus lente même qu’elle ne l’a été il y a trois siècles, il ne s’ensuit pas qu’elle ne doive point avoir lieu.
Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas, à proprement parler, du ressort de l’économie politique, pas plus que ne l’est l’appréciation des causes diverses qui peuvent faire hausser ou baisser dans un délai plus ou moins rapproché, le fer, le cuivre, l’étain ou tout autre métal. C’est une question qui appartient plutôt à la technologie et au commerce qu’à l’économie politique.
On s’est demandé encore s’il faut choisir un seul étalon pour mesurer les valeurs, l’or ou l’argent, par exemple, ou s’il convient d’en adopter deux. C’est à peu près comme si l’on se [II-56] demandait si l’on doit se servir de l’aune ou du mètre pour mesurer la longueur des étoffes ou si l’on peut se servir à la fois de l’aune et du mètre. En admettant même que ces deux mesures fussent parfaitement invariables, il serait évidemment plus simple et plus commode de s’en tenir à une seule que d’employer l’une et l’autre. Mais si elles étaient sujettes à varier, si, pendant que le mètre, par exemple, ne change pas ou ne change que d’une quantité insensible, l’aune venait à perdre une quantité sensible de sa longueur, le régime du double étalon de longueur pourrait engendrer des complications et des embarras sérieux. Ces embarras croîtraient encore si, en prescrivant l’usage d’un double étalon de longueur, des législateurs avaient décrété qu’il existe un rapport légal invariable entre l’aune et le mètre, tandis que le rapport réel serait sujet à varier. En effet, supposons que l’aune fῦt légalement estimée à 70 centimètres, et qu’il fῦt en conséquence permis à tout marchand ayant à livrer 1,000 mètres d’étoffes, de mesurer ces 1,000 mètres avec une aune sur le pied de 70 centimètres, alors qu’elle n’en contiendrait plus en réalité que 69, qu’en résulterait-il? Que tous ceux qui auraient des marchés à exécuter en mètres, s’empresseraient de fournir des aunes sur le pied du rapport légal, et que les acheteurs perdraient la différence, jusqu’à ce que chacun s’avisât de contracter dans la mesure qui lui inspirerait le plus de confiance, sans avoir égard au rapport légal. Que chacun soit libre de choisir la mesure qu’il préfère, aune ou mètre, or ou argent, voilà le principe. Qu’il se serve même, tour à tour, à sa convenance, de l’un ou de l’autre étalon, rien de mieux. Mais si ces étalons ne sont pas invariables, c’est commettre une aberration déplorable que d’en prescrire l’usage comme s’ils l’étaient; c’est autoriser et légaliser sinon légitimer, [II-57] dans une foule de cas, la fraude sur les mesures de longueur ou de valeur, en permettant à qui a stipulé en mètres de fournir des aunes rétrécies, à qui a stipulé en argent de payer en or déprécié; c’est en un mot, quand le choix existe entre deux étalons, faire prévaloir d’autorité l’étalon affaibli sur celui qui a conservé relativement l’invariabilité de son type.
Enfin, une dernière question beaucoup plus importante encore nous reste à examiner. Il s’agit des variations artificielles des étalons de la valeur. Si nous jetons en effet nos regards en arrière, nous serons frappés d’un fait remarquable, et jusqu’à présent fort mal expliqué, savoir que les variations de l’étalon de la valeur ont été partout et de tous temps, beaucoup plus nombreuses et plus intenses que celles des métaux dont ils étaient formés; autrement dit que les peuples n’ont pas seulement souffert des variations naturelles de la valeur des métaux servant d’étalons, mais encore de variations artificielles complétement indépendantes des premières.
D’où provenaient ces variations artificielles de l’étalon dont est remplie l’histoire de la monnaie, et qui n’ont point cessé entièrement de nos jours? Elles provenaient de ce que l’on a fréquemment substitué aux étalons réels consistant dans la valeur d’un certain poids déterminé de métal, or, argent ou cuivre, des étalons nominaux consistant soit dans une certaine quantité de métal monnayé, dont la valeur n’était point déterminée par celle du métal non monnayé, soit même encore dans une certaine valeur investie dans du papier monnaie.
Mais l’explication de ces phénomènes, demeurés jusqu’à présent fort obscurs, ne peut sortir que d’une connaissance approfondie de la monnaie de circulation et des fondements de sa valeur.
[II-58]
TROISIÈME LEÇON↩
la monnaie
Nécessité de décomposer l’échange en deux parties, la vente et l’achat. — Avantages de cette décomposition économique de l’échange. — De l’instrument nécessaire pour l’opérer. — Ce que doit être cet instrument intermédiaire des échanges. — Qualités qu’il doit réunir. — Des matières premières dont on se sert pour le fabriquer. — Pourquoi l’or, l’argent et le cuivre ont été affectés de préférence à cet usage. — De la façon qui doit leur être donnée pour en faire un bon instrument des échanges. — De l’étalonnage des monnaies. — Des lois qui gouvernent la valeur de la monnaie. — Que ces lois sont les mêmes pour la monnaie que pour les autres marchandises. — Comment elles agissent. — Du monopole du monnayage et de l’influence de ce régime sur les lois qui gouvernent la valeur des monnaies. — De l’étalonnage de la monnaie en Angleterre. — De la quantité de monnaie nécessaire pour effectuer les échanges d’un pays.
La nécessité de mesurer les valeurs se présente chaque fois que l’on a besoin de se rendre exactement compte de la valeur d’une ou de plusieurs choses. Ce cas se présente dans un inventaire, dans un partage, dans un prêt, dans un échange, etc. [II-59] S’il s’agit, par exemple, d’un héritage, comme le partage devra s’effectuer en raison de la valeur des choses à partager, il faudra bien les évaluer, c’est à dire déterminer la quantité précise de valeur qu’elles contiennent. Pour faire cette opération, il faut, ainsi que nous l’avons vu, choisir comme étalon une valeur bien connue des parties, et comparer à cette valeur celle de chacune des choses qu’il s’agit d’évaluer. Cette valeur-étalon sera chez un peuple pasteur, celle d’un bœuf ou d’un mouton; chez un peuple chasseur, celle d’une peau de bête; chez un peuple agriculteur, d’une quantité usuelle de blé. Ce sera enfin, dans un état de société plus avancé, la valeur d’un certain poids d’or ou d’argent. L’évaluation faite, on exprimera la valeur de chaque chose, au moyen de l’étalon, de ses fractions ou de ses multiples, comme on exprime la grandeur de ces mêmes choses, au moyen du mètre, du centimètre, du kilomètre, ou toute autre mesure appropriée à leur nature.
Cependant, s’il suffit de posséder une mesure commune de la valeur pour opérer un partage ou un troc, un autre agent devient bientôt nécessaire pour faciliter les échanges dans l’espace et dans le temps. Dès que les occupations commencent à se spécialiser et les échanges à se multiplier, on éprouve le besoin de décomposer l’échange en deux parties, la vente et l’achat, et cette décomposition ne peut s’opérer qu’au moyen d’une valeur intermédiaire servant d’équivalent universel.
Qu’il soit nécessaire de décomposer l’échange en deux opérations, pour le faciliter, cela n’a pas besoin d’une longue démonstration.
L’échange simple ou le troc direct de produit contre produit peut suffire à des peuplades barbares, au sein desquelles [II-60] chaque famille produit elle-même toutes les choses qu’elle consomme, à l’exception de deux ou trois articles qu’elle retire du dehors, et contre lesquels elle fournit, à son tour, un ou deux articles qu’elle produit en vue de les échanger. Telle est encore, de nos jours, la situation de la plupart des peuplades de l’intérieur de l’Afrique. Mais dès que la production a réalisé quelques progrès, dès que les produits à échanger se multiplient et se diversifient, le troc simple cesse de suffire; peu à peu même il cesse d’être possible.
Dans notre société, par exemple, il est devenu complétement impossible de troquer, c’est à dire d’échanger directement les choses que l’on produit contre toutes celles dont on a besoin. Prenons un exemple. Je suis tailleur, je produis des habits. J’ai besoin de souliers, je vais offrir un habit à un cordonnier. Mais le cordonnier n’a pas besoin de cet habit, et quant même il en aurait besoin, comme la valeur du vêtement que je lui offre dépasse celle de la paire de souliers que je lui demande, l’échange ne pourrait s’ajuster. Il est, en conséquence, nécessaire de le décomposer, de manière à me permettre de fournir des habits à qui en a besoin, et de me procurer avec la marchandise qui me sera donnée en échange, des souliers ou tout autre objet dont j’ai besoin à mon tour.
Cette marchandise intermédiaire servant d’équivalent universel et permanent dans les échanges a pris le nom de monnaie.
Cet équivalent trouvé, comment les choses se passent-elles?
Tous ceux qui possèdent des produits échangeables, en d’autres termes, des marchandises dont ils veulent se défaire, offrent ces marchandises en demandant de la monnaie en échange. Ceux qui en ont besoin les demandent, en offrant, en échange, de la monnaie.
[II-61]
Si les deux parties s’accordent sur le prix, c’est à dire sur la quantité de marchandise, d’une part, sur la quantité de monnaie, de l’autre, dont les valeurs doivent se mettre en équilibre pour que l’échange ait lieu, le marché se conclut, et l’on dit du détenteur de la marchandise qu’il l’a vendue, du détenteur de la monnaie, qu’il a acheté la marchandise. Pour celui-là, c’est une vente, pour celui-ci un achat.
Poursuivons l’examen de l’opération. L’homme qui a échangé contre de la monnaie ses produits ou ses services, n’a fait, en réalité, qu’une demi-opération. Que veut-il, en effet? Il veut obtenir, en échange de ses produits ou de ses services, d’autres produits ou d’autres services propres à la satisfaction présente ou future de ses besoins. Or, la monnaie ne peut ipso facto satisfaire aucun besoin matériel ou immatériel, elle ne le peut qu’en s’échangeant contre des choses qui ont cette propriété. On ne vend donc que pour acheter. On n’échange ses marchandises contre de la monnaie qu’en vue d’échanger, tôt ou tard, dans tel lieu ou dans tel autre, sa monnaie contre des marchandises. Lorsque cette éventualité se réalise, on fait un achat et l’échange est alors complet. On n’a plus sa marchandise, on n’a plus sa monnaie, mais on a la marchandise dont on avait besoin et en vue de laquelle on avait produit la sienne.
Quand donc on envisage séparément chaque partie contractante, on s’aperçoit qu’elle fait un échange incomplet, un demiéchange. Le vendeur en fait la première moitié, l’acheteur la seconde. La monnaie facilite l’échange en permettant d’en combiner indéfiniment les deux facteurs, tandis que le troc n’admet qu’une combinaison simple. En d’autres termes encore, la monnaie permet de disjoindre la vente de la marchandise que l’on produit de l’achat de la marchandise dont on a besoin, tandis [II-62] que ces deux opérations se trouvent connexes dans le troc ou l’échange simple.
Essayons de formuler d’une manière plus précise encore les avantages résultant de cette décomposition des échanges, au moyen de l’instrument monétaire.
Soit:
A, la marchandise produite en vue de l’échange.
B, la monnaie.
C, D, E, F, G, H, etc., les marchandises dont a besoin le détenteur de A.
Que B fasse défaut, et l’échange devient aussitôt extrêmement difficile sinon impossible à opérer. A demande C par exemple, mais il se peut que C n’ait pas besoin de A, qu’il ait besoin de D. Si A veut se procurer C, il devra donc s’échanger préalablement contre D. Mais D à son tour demande E et non pas A. En conséquence A devra demander E, et si E n’a pas besoin de A, il sera obligé de poursuivre ce circuit en F, G, H, etc. Supposons toutefois qu’E ait besoin de A, l’échange pourra avoir lieu, à la condition cependant que la valeur de A et la valeur de E puissent s’équilibrer; mais A sera obligé ensuite d’échanger E contre D, et D contre C, pour se procurer la marchandise dont il a besoin. C’est un circuit qu’il est obligé de faire et qui rend l’échange impraticable souvent, laborieux et coúteux toujours.
Mais B intervient, B, c’est à dire la monnaie. A commence par s’échanger contre B, et avec B, il peut se procurer à volonté C, D, E, F, G, H, car s’il échange B contre C avec B, C peut se procurer D, et ainsi de suite.
D’où il résulte que:
L’intervention de la monnaie épargne aux échangistes tout le [II-63] montant des frais et des difficultés de la série des échanges qu’ils devraient effectuer jusqu’à ce qu’ils fussent parvenus à se procurer à l’aide de la marchandise qu’ils produisent, celle dont ils ont besoin.
Ces frais et ces difficultés seraient tels dans la plupart des cas qu’ils dépasseraient beaucoup l’économie résultant de la division du travail, qu’ils opposeraient en conséquence un obstacle insurmontable à tout progrès en empêchant les industries de se spécialiser.
Il ya toutefois, sous ce rapport, une distinction à établir entre les échanges. Les échanges qui s’effectuent dans le même lieu et dans le même moment demeureraient, à la rigueur, possibles sans l’intermédiaire de la monnaie, tandis que ceux qui s’effectuent à distance et à un intervalle de temps considérable deviendraient impossibles. Pour les premiers, le crédit pourrait en effet suppléer à la monnaie. Je suppose qu’un tailleur ait besoin d’une paire de souliers. Il l’achète, mais l’équivalent qu’il peut offrir, en l’absence de monnaie, ne convenant pas au cordonnier, celui-ci lui fait crédit pour le montant de la paire de souliers, sauf à demander crédit au tailleur pour les habits dont il aura besoin, en mesurant ces deux crédits de telle façon qu’ils finissent par se balancer. Mais pour que le crédit supplée ainsi à la monnaie, il faut que les contractants se connaissent bien, qu’ils aient confiance l’un dans l’autre, et cette condition ne pourra, sauf de rares exceptions, être remplie lorsqu’il s’agira d’échanges à distance. Les échanges à temps seraient plus difficiles encore à effectuer sans l’intermédiaire de la monnaie. Je fabrique des souliers, et je les échange contre toutes les choses dont j’ai besoin. Mais, parmi ces choses, il en est qui sont destinées à ma consommation immédiate, d’autres qui sont destinées [II-64] à ma consommation future ou même à celle de mes enfants. Il est possible que l’échange direct ou le troc avec ou sans l’auxiliaire du crédit suffise pour me procurer les premières. Mais il n’en sera pas de même pour les dernières. Si je veux me procurer, à l’aide de la vente de mes souliers, les denrées nécessaires pour me nourrir aujourd’hui, demain, pendant une semaine, l’échange direct de mes souliers contre du pain, de la viande, etc., suffira pour y pourvoir. Mais il en sera autrement si, en vendant mes souliers, je veux me procurer les aliments qui me seront nécessaires dans vingt ou trente ans. Si je veux éloigner ainsi les deux termes de la vente et de l’achat, il me faudra recourir de toute nécessité à un intermédiaire. Il me faudra, à l’aide de mes souliers, me procurer un produit dont je puisse toujours et en tous temps me défaire sans perte pour obtenir, en échange, toutes les choses nécessaires à ma consommation future en quelque lieu que je la fasse, c’est à dire une chose qui ait le caractère d’un équivalent universel et permanent. Dira-t-on que je puis retarder l’échange de mes produits, et par conséquent les accumuler jusqu’à ce que le moment de ma consommation future soit venu? Mais, s’il s’agit de souliers, puis-je les accumuler indéfiniment sans m’exposer à des pertes de toutes sortes? Il faut évidemment que je les échange contre une marchandise plus propre à être conservée, accumulée et échangée dans le temps. Cette nécessité sera plus sensible encore si je produis des choses qui ne soient point susceptibles de conservation et d’accumulation; si je suis boulanger, boucher ou bien encore musicien, professeur, etc.
On doit maintenant se rendre compte suffisamment de la nécessité d’un instrument intermédiaire, d’un medium circulans, qui, en séparant les échanges en deux parties, indépendantes [II-65] l’une de l’autre, leur permette de se multiplier à travers l’espace et le temps; c’est à dire un instrument qui remplisse autant que possible les fonctions d’un équivalent universel et permanent.
Cela posé, il s’agit de savoir quel ensemble de qualités doit posséder un bon intermédiaire des échanges. Il doit d’abord réunir, au moins à un certain degré, l’uniformité et la stabilité de la valeur. Si j’échange mes produits ou mes services contre un medium circulans que je me propose d’échanger, à son tour, dans l’espace et dans le temps, contre d’autres produits ou d’autres services, je serai intéressé, avant tout, à ce que cet instrument demeure intact aussi longtemps qu’il sera entre mes mains, qu’il ne subisse aucune diminution de valeur, soit par le fait d’une détérioration physique ou autrement. Qu’il possède une valeur aussi uniforme et aussi stable que possible, que je puisse l’échanger sans perte, dans quelque lieu que j’aille ou à quelque époque que je juge à propos de m’en défaire, voilà mon principal desideratum. Est-ce tout? Non! il faudra encore que l’instrument des échanges soit facile à manier et à transporter, au besoin même à cacher; qu’il se compose de parties aussi appropriées que possible à la dimension des échanges qu’il s’agit d’accomplir, que les unes soient grandes, les autres moyennes, les autres encore petites; que la valeur de chaque pièce soit mesurée sur l’étalon et ne varie qu’avec l’étalon luimême, afin d’épargner aux échangistes la difficulté ou l’embarras d’une double évaluation: celle de la marchandise et celle de la monnaie; et non seulement il faudra que chaque pièce constitue une valeur étalonnée, mais encore que cette valeur soit reconnaissable à la première vue, qu’elle soit en conséquence exprimée sur la pièce; il faudra enfin que la valeur de chaque pièce s’exprime autant que possible par un chiffre rond formant avec [II-66] les autres pièces un rapport régulier facile à reconnaître et à calculer. Telles seront les principales qualités que devra réunir une bonne monnaie.
Ces qualités, toutes les monnaies sont loin de les posséder à un degré égal, aucune même ne les réunit d’une manière complète; le progrès consiste à en approcher le plus possible.
Comme tous les instruments, celui-ci a commencé par être grossier et imparfait; on a tâtonné longtemps avant de trouver les matières premières les plus propres à sa confection, et, après les avoir trouvées, on les a rarement mises en œuvre d’une manière pleinement satisfaisante. Si nous considérons l’état actuel de l’ensemble des branches de l’industrie humaine, nous trouverons que celle qui concerne la production de l’instrument des échanges est l’une des plus arriérées; ce qui tient certainement à ce qu’elle est demeurée jusqu’à présent un monopole gouvernemental au lieu d’être une industrie libre.
Quoi qu’il en soit, après avoir reconnu à quel besoin pourvoit le véhicule intermédiaire des échanges, après nous être rendu compte d’une manière sommaire et générale de ce qu’il doit être et des qualités essentielles qu’il doit réunir pour remplir son office, analysons-le; examinons d’abord de quels matériaux il est composé et quelle façon est donnée à ces matériaux.
Dans la plupart des pays civilisés, l’instrument monétaire est composé: 1° de trois métaux, or, argent, cuivre ou bien encore bronze ou nickel; 2° de papier.
Laissant de côté pour le moment la monnaie de papier, à laquelle nous consacrerons un chapitre à part, nous avons donc à constater ce fait important: qu’ayant à choisir entre une multitude de substances pour servir de matières premières à la [II-67] monnaie, on a fini par adopter généralement trois métaux, l’or, l’argent et le cuivre. Pourquoi? Évidemment parce que l’expérience a démontré qu’ils réunissent à un plus haut degré que les autres matériaux les qualités requises pour la confection de l’instrument monétaire; parce qu’ils sont essentiellement propres à constituer l’étoffe de la monnaie, comme l’acier est essentiellement propre à constituer l’étoffe des couteaux, des socs de charrue, etc.
Ces qualités qui ont valu, surtout à l’or et à l’argent, la préférence comme étoffes monétaires, sont la transportabilité, la durabilité, l’uniformité de la qualité et la divisibilité. L’or et l’argent peuvent se transporter à peu de frais, car ils renferment une grande valeur sous un petit volume; ils se manient avec facilité; ils peuvent se conserver indéfiniment; ils peuvent encore, qualité essentielle pour un équivalent, se diviser en fractions très petites sans rien perdre de leur valeur.
Telles sont les qualités principales qui rendent l’or et l’argent et, à un moindre degré, le cuivre, plus propres qu’aucun autre produit à servir d’étoffes monétaires.
Mais ces étoffes doivent être fabriquées; elles doivent recevoir une certaine façon appropriée à leur destination. A l’état de lingots, les métaux monétaires ne constitueraient qu’une monnaie fort imparfaite. Supposons, par exemple, que nous soyons obligés, chaque fois que nous faisons un échange, de détacher un morceau d’or, d’argent ou de cuivre d’un lingot, de le peser, d’en constater le degré de pureté, d’en mesurer la valeur, ne sera-t-il pas à peu près aussi difficile d’opérer des échanges au moyen de cette matière première non façonnée que de labourer la terre avec une barre d’acier ou de naviguer sur un tronc d’arbre? Il faut donc donner aux métaux monétaires une [II-68] certaine façon spéciale pour les rendre propres à servir d’instruments des échanges comme il faut donner au fer une façon spéciale pour le transformer en un instrument de labour, au bois une autre façon spéciale pour en faire un véhicule de transport maritime.
Quelle façon donne-t-on aux matières premières monétaires pour les transformer en monnaie? En quoi consiste, en d’autres termes, le monnayage?
Le monnayage implique deux sortes d’opérations: celles qui concernent la fabrication proprement dite, c’est à dire le degré de pureté, le poids, la forme et la marque des effigies des pièces; celles qui concernent la fixation de la valeur de ces mêmes pièces.
Les premières sont du domaine de la technologie monétaire, et nous ne nous y arrêterons point. Les matières premières monétaires sont d’abord affinées, c’est à dire amenées à un degré de pureté uniforme, et l’on y ajoute une certaine proportion d’alliage afin d’augmenter la solidité du produit; elles sont ensuite coupées ou taillées en différentes pièces, dont chaque catégorie est également d’un poids uniforme, sauf une certaine tolérance de fabrication; on donne à ces pièces la forme que l’expérience a démontrée être la plus résistante et la plus commode; on les frappe à l’effigie de l’entrepreneur du monnayage (savoir du souverain investi du monopole de cette fabrication), avec l’indication de l’année de la fabrication, et, ordinairement aussi, de la valeur de la pièce, mesurée sur l’étalon en usage.
Les opérations qui concernent la fixation de la valeur des pièces ou l’étalonnage ont, au contraire, un caractère purement économique.
[II-69]
Si l’on veut s’en rendre exactement compte, il faut d’abord savoir quelles lois gouvernent la valeur de la monnaie.
Ces lois sont les mêmes que celles qui gouvernent la valeur de tous les autres produits ou services. Ce sont: la loi de l’offre et de la demande et celle des frais de production.
La valeur de la monnaie, comme celle de toute autre marchandise, est déterminée immédiatement par la loi de l’offre et de la demande.
Comme celle de toute autre marchandise encore, la valeur de la monnaie tend incessamment à s’établir au niveau de ses frais de production.
De quoi se composent les frais de production d’une monnaie? D’abord, et pour la plus forte part, de la somme nécessaire pour se procurer la matière première dont elle se compose, autrement dit de la valeur de la matière première; ensuite, des frais de fabrication, en y comprenant le bénéfice nécessaire pour rémunérer l’entreprise du monnayage.
De cette double loi il résulte que la valeur de la monnaie est déterminée immédiatement, d’un côté, par son émission, c’est à dire par la quantité qui en est offerte ou mise au marché; d’un autre côté, par la quantité qui en est demandée.
Lorsqu’une monnaie est émise en quantité croissante, la valeur de cette monnaie doit baisser, et de plus, cette baisse doit s’opérer en progression géométrique, — à moins, toutefois, que la demande ne croisse dans la même proportion.
Lorsqu’une monnaie, au contraire, est émise en quantité décroissante, elle doit hausser, — et la hausse doit s’opérer de même en progression géométrique, — à moins que la quantité demandée ne décroisse dans la même proportion.
Tels sont les effets immédiats de la loi de l’offre et de la [II-70] demande sur la monnaie comme sur toute autre marchandise.
Voyons maintenant comment agit la loi des frais de production sur cette espèce particulière de marchandise.
Lorsqu’une monnaie est émise en quantité croissante, le moment arrive promptement où sa valeur ne couvre plus les frais de sa fabrication qui sont peu considérables; et où elle tend à descendre au dessous même de la valeur de la matière première. A ce moment, on trouve avantage soit à la fondre, soit à la retirer de la circulation, à mesure qu’elle est produite, l’offre diminue et la baisse s’arrête.
La valeur de l’étoffe métallique dont elle est faite apparaît ainsi comme le point au dessous duquel la valeur de la monnaie ne peut descendre, au moins d’une manière régulière et permanente.
Lorsque la monnaie est émise en quantité décroissante, la demande demeurant la même, sa valeur hausse de manière à dépasser bientôt le montant de ses frais de production. Alors, en supposant qu’aucun obstacle, aucune prohibition, par exemple, ne s’y oppose, on trouve avantage à en faire frapper un supplément, dont la mise au marché arrête la hausse, en ramenant toujours, comme à un niveau supérieur, la valeur de la monnaie à la limite de ses frais de production.
Telles sont les lois qui gouvernent la valeur de la monnaie, en admettant qu’elle soit soumise à un régime de pleine concurrence. Mais elle n’est point soumise à ce régime et ne paraît l’avoir été en aucun temps. Tandis que la production et la vente des objets en or, en argent ou en cuivre sont libres, la fabrication et l’émission de l’outil monétaire font l’objet d’un monopole gouvernemental. Le gouvernement fabrique ou fait fabriquer [II-71] seul la monnaie, et il peut empêcher toute autre monnaie que la sienne de circuler dans les pays soumis à sa domination. Qu’en résulte-t-il? C’est que le gouvernement investi de ce monopole devient le maître de l’un des deux éléments constitutifs de la valeur de la monnaie, savoir de l’offre, et que l’influence régulatrice de la loi des frais de production se trouve par là même paralysée.
Ce n’est pas à dire, toutefois, que le monopole ait le pouvoir de modifier ou d’altérer, d’une façon quelconque, les lois qui régissent la valeur des choses. Non! Sous un régime de monopole comme sous un régime de concurrence, la valeur des choses ne cesse point d’être déterminée immédiatement par les quantités offertes, d’une part, demandées, d’une autre. Mais quand on est le maître de l’un de ces deux éléments de la valeur, quand on peut augmenter à sa guise la quantité offerte, il est évident que le prix de la chose monopolisée n’a plus d’autre régulateur que la volonté arbitraire du monopoleur, ou, ce qui revient au même, son intérêt bien ou mal entendu. Tandis que sous un régime de libre concurrence, ce régulateur se trouve dans la somme des frais de production ou dans le prix naturel autour duquel gravite le prix courant, sous un régime de monopole ce régulateur disparaît. Le prix peut s’élever comme il peut descendre d’une manière indéfinie. Il peut descendre jusqu’à la gratuité complète, au moins en apparence, si le monopoleur est un gouvernement et s’il lui plaît de faire supporter par les contribuables, les frais de production d’un article dont il monopolise la fabrication et le débit. Le prix peut s’élever de même d’une manière indéfinie jusqu’à ce qu’il ait atteint un niveau tel, qu’aucun consommateur n’y puisse plus arriver. Qu’un gouvernement monopolise la production et la vente des subsistances, [II-72] par exemple, il pourra évidemment fixer à 1,000 francs ou 10,000 francs le prix d’un pain; mais les monopoleurs usent rarement de tout leur pouvoir à cet égard. Guidés par leur intérêt, ils s’attachent à fixer le prix de la chose monopolisée au taux qui leur procure la plus grande somme possible de bénéfices. Ce taux n’est pas le même pour toutes les marchandises. Il peut être, proportion gardée, plus élevé pour les articles de première nécessité, tels que les grains, le sel, la sécurité, etc., que pour ceux dont on peut se passer à la rigueur. Supposons, en effet, que le prix de ces derniers fῦt surélevé d’une manière excessive, comme la chose arriva pour les épices à l’époque où les Hollandais en avaient monopolisé la vente, la demande diminuerait dans une proportion telle, que l’exhaussement artificiel du prix réduirait les bénéfices du monopole au lieu de les accroître.
La production de la monnaie a donc été de tous temps un monopole, mais ce monopole a subi, surtout depuis un siècle, de profondes modifications. Tandis qu’il était jadis organisé de manière à former une branche importante du revenu des souverains, il a perdu aujourd’hui presque toute importance au point de vue fiscal. Pour le dire en passant, on peut trouver dans ce changement l’explication de la divergence d’opinions qui existe entre les anciens écrivains qui se sont occupés de la monnaie et les nouveaux. Les uns affirment que le souverain est le maître de fixer à sa guise la valeur de la monnaie, et leur affirmation s’accorde assez bien avec les faits dont ils étaient témoins. Les autres, au contraire, prétendent que la valeur de la monnaie est réglée par celle de la matière dont les espèces sont fabriquées, et leur affirmation est de même assez conforme, — quoiqu’elle ne le soit point entièrement, — aux faits qu’ils ont sous les yeux.
[II-73]
Ces observations préliminaires faites, voyons de quelle façon s’opère aujourd’hui l’étalonnage de la monnaie.
Le problème à résoudre consiste à fixer aussi complétement que possible la valeur de la monnaie sur celle de l’étalon. De telle sorte que les pièces de monnaie étalonnées possèdent toujours exactement la même valeur que l’étalon, ou, si l’étalon est trop fort ou trop faible pour servir de monnaie, la même valeur qu’une de ses fractions ou l’un de ses multiples. En supposant que l’étalon soit invariable, une monnaie bien étalonnée aura donc une valeur invariable; en supposant, au contraire, que l’étalon soit variable, la monnaie subira exactement les mêmes variations que l’étalon sur lequel elle se trouve fixée.
La nécessité de fixer la monnaie sur l’étalon est facile à comprendre. Qu’est-ce que l’étalon? C’est la chose la plus propre à servir de mesure, c’est à dire la chose dont la valeur est reconnue la plus stable. Supposons que la monnaie ne fῦt pas dans toutes ses parties la reproduction exacte de l’étalon, qu’arriverait-il? C’est qu’à chaque échange, il faudrait se livrer à une double évaluation: il faudrait d’abord évaluer la monnaie, en rapportant la valeur de chaque pièce à celle de l’étalon; il faudrait ensuite évaluer la marchandise. Lorsque la monnaie est étalonnée, c’est à dire exactement fixée dans toutes ses parties, pièces d’or, d’argent, de cuivre ou morceaux de papier, sur l’étalon quel qu’il soit, bétail, grain, métal précieux, on économise la première de ces deux opérations, souvent la plus difficile, et l’on simplifie ainsi considérablement l’échange.
Supposons que l’étalon de la valeur consiste dans une tête de bétail ou dans une mesure de blé, et tel était le cas dans les temps primitifs, comment pourra s’opérer l’étalonnage de la monnaie? Et d’abord que sera la monnaie lorsque le bétail ou le [II-74] blé, c’est à dire un produit impropre à servir de monnaie, sera l’étalon de la valeur? La monnaie devra se composer de parties ayant chacune une valeur exactement égale à une tête de bétail ou à une mesure de blé, à ses fractions ou à ses multiples. Comment cette équivalence pourra-t-elle être obtenue? Rappelons-nous qu’il n’existe pas au monde une seule chose ayant une valeur absolument stable; rappelons-nous aussi que la valeur de chaque chose a ses variations propres. Cela étant, on ne pourra établir une monnaie qui soit toujours équivalente à l’étalon, à ses fractions ou à ses multiples, que moyennant l’une de ces deux conditions: 1° que la monnaie soit composée de la même substance que l’étalon; qu’elle soit l’étalon même façonné en monnaie; 2° si, par sa nature, l’étalon est impropre à servir de monnaie, qu’elle soit composée de choses toujours échangeables contre lui. Ainsi, une tête de bétail sert d’étalon de la valeur. En quoi peut consister la monnaie? En têtes de bétail semblables à celle-là, ou en choses qui s’échangent toujours contre une tête de bétail, ni plus ni moins. Mais peut-on trouver de ces choses? Existe-t-il des choses qui soient toujours exactement de la même valeur qu’une tête de bétail? Non, il n’en existe point. Prenons pour exemple une certaine quantité d’or ou d’argent. Aujourd’hui, la valeur de cette quantité répond exactement à celle d’une tête de bétail; demain, elle sera plus grande ou plus petite: la valeur du bétail ou celle de l’or ou de l’argent, toutes deux peut-être, auront changé.
Cependant, s’il n’existe point d’équivalents naturels de l’étalon, on peut en créer d’artificiels. On peut faire en sorte qu’une pièce d’or ou d’argent ou même un simple morceau de papier ait toujours la même valeur qu’une tête de bétail ou une mesure de blé. Il suffit pour cela de se souvenir que la valeur des [II-75] choses est déterminée par la loi de l’offre et de la demande, et de régler l’offre de ces pièces d’or ou d’argent ou de ces morceaux de papier, de telle sorte qu’ils s’échangent toujours contre une tête de bétail, ni plus ni moins. Le moyen le plus assuré d’obtenir cette équivalence, c’est d’échanger toujours soi-même, sur demande, chaque pièce d’or, d’argent ou de papier contre une tête de bétail. L’expérience démontre toutefois que cela n’est point indispensable. Il suffit, dès que la monnaie d’or, d’argent ou de papier émise pour la valeur d’une tête de bétail commence à dépasser cette valeur, d’en émettre, autrement dit, d’en offrir un supplément jusqu’à ce que l’équivalence soit rétablie; et, dans le cas contraire, d’en retirer de la circulation ou d’en diminuer l’offre jusqu’à ce que l’équivalence soit de nouveau obtenue.
Telles sont les conditions auxquelles l’équivalence peut s’établir et se maintenir entre la monnaie et l’étalon, lorsque celle-là est autre que celui-ci. Ajoutons que ces conditions, tirées des lois constitutives de la valeur, sont toujours rigoureuses, absolues comme ces lois mêmes. Supposons, par exemple, qu’après avoir émis le nombre de pièces d’or, d’argent ou de papier nécessaire pour que ces pièces soient l’équivalent d’une tête de bétail, vous en émettiez davantage, leur valeur tombera au dessous de celle de la tête de bétail, et cette chute de valeur ou cette dépréciation sera d’autant plus forte que la surémission aura été plus considérable. Si vous persistez néanmoins à affirmer que votre monnaie continue à valoir une tête de bétail, ni plus ni moins, et si vous possédez le pouvoir nécessaire pour autoriser les débiteurs à acquitter sur ce pied les dettes qu’ils ont contractées en têtes de bétail, qu’en résulterat-il? C’est que l’étalon de la valeur sera changé; c’est qu’il ne [II-76] consistera plus en têtes de bétail réelles, mais en pièces de monnaie qui ne posséderont plus qu’une partie de la valeur de la tête de bétail; c’est que l’étalon ne sera plus qu’une valeur arbitraire, sans base fixe, dépendant de la quantité des émissions monétaires qu’il vous conviendra de faire, si vous pouvez régler à votre guise l’offre de la monnaie.
Il y a apparence que les choses se sont passées ainsi à l’origine. Les peuples pasteurs avaient pour étalon de la valeur le bétail. Mais le bétail ne possédait qu’imparfaitement les qualités requises pour servir de monnaie [7] . Lorsque les métaux qui possédaient ces qualités vinrent à être découverts, que fit-on? On fabriqua des pièces ayant la valeur d’une tête de bétail et portant même cette effigie, d’où le nom de pecunia donné à la [II-77] monnaie. Comme il n’était pas nécessaire que ces pièces continssent en métal une valeur égale à celle du bétail, tant que leur émission demeurait limitée, la fabrication de la monnaie dut rapporter de gros bénéfices. Mais les émissions venant à s’accroître en raison même des bénéfices qu’elles procuraient, la valeur de monnaie ne pouvait manquer tomber au dessous celle l’étalon. Autrement dit, les têtes bétail monnayées devinrent plus petites que réelles, et comme on’était accoutumé évaluer toutes choses monnayées,’étalon primitif se trouva perdu, mesure devint purement arbitraire.
Mais l’incertitude de l’étalon de la valeur engendre, comme nous l’avons vu, des perturbations telles, qu’aucune société ne pourrait les supporter longtemps. On dut donc chercher un remède au mal dont on souffrait, soit en rétablissant l’ancien étalon, soit en en adoptant un nouveau. Or, dans l’intervalle, le monde avait marché, le travail s’était divisé, les industries s’étaient multipliées et perfectionnées: dans ce nouvel état de la société, la tête de bétail avait cessé d’être à la fois la valeur la plus généralement connue et la plus stable. Les métaux précieux qui, à l’origine, ne possédaient ni l’une ni l’autre de ces qualités, les avaient peu à peu acquises. A mesure, par exemple, que le stock provenant de la production des années antérieures s’accumula et se grossit, les fluctuations résultant de la découverte des nouvelles mines, etc., devinrent moins sensibles. On fut amené, en conséquence, à choisir pour étalon la valeur d’un certain poids d’or, d’argent ou de cuivre, soit la valeur d’un talent, d’un sicle ou d’une livre pesant de l’un ou de l’autre de ces métaux. L’adoption de ce nouvel étalon n’empêcha point toutefois le retour des perturbations occasionnées [II-78] par les surémissions, et la livre monétaire comme la tête de bétail monnayée devint de plus en plus petite, au point de ne plus équivaloir à la longue qu’à une fraction très faible de la livre métal.
Nous examinerons dans les leçons suivantes comment ces perturbations et cette dégradation de l’étalon se sont accomplies. Nous devons nous borner pour le moment à rechercher quels procédés on a employés pour en empêcher le retour. D’une part, on en est revenu partout aux étalons métalliques, soit que l’on ait adopté pour étalon un certain poids d’or ou un certain poids d’argent fin. D’un autre part, on s’est appliqué à faire de la monnaie, dans toutes ses parties, or, argent, cuivre ou papier, “un étalon circulant,” en ajustant exactement sa valeur sur celle du métal choisi pour étalon. C’est en Angleterre que ce résultat a été atteint de la manière la plus complète. Voyons donc comment on s’y est pris pour l’atteindre; comment s’opère actuellement en Angleterre l’étalonnage de la monnaie.
C’est l’or qui sert aujourd’hui en Angleterre d’étalon ou de mesure commune des valeurs. Toutes choses, y compris la monnaie elle-même, ont pour mesure commune la valeur d’une certaine quantité d’or exprimée par la livre sterling. Cette quantité qui était autrefois une livre pesant d’argent, n’est aujourd’hui qu’un peu plus du quart d’une once d’or. Car avec une once d’or on fabrique 3 liv. 17 shill. 10 ½ d., ce qui donne pour la valeur de la livre sterling:  ou les
ou les  d’une once d’or. Comment la livre sterling est descendue de la valeur d’une livre pesant d’argent à celle d’un peu plus d’un quart d’once d’or, c’est ce que l’exemple analogue de la dépréciation de la livre française nous servira à expliquer [II-79] plus loin [8] . Contentons-nous de constater, en attendant, de quelle manière on la maintient à ce dernier niveau depuis qu’elle y est descendue, comment on empéche qu’elle ne descende plus bas ou qu’elle ne remonte plus haut. Le gouvernement est tenu de fournir toujours, sur demande, à qui lui apporte de l’or en lingot, poids pour poids d’or monnayé, sans rien garder pour ses frais de monnayage. D’où il résulte qu’il ne peut exister aucune différence sensible entre la valeur de l’or en lingot et [II-80] celle de l’or monnayé. Supposons, en effet, qu’une telle différence vint à se produire, qu’une once d’or monnayé vînt à valoir plus d’une once d’or en lingot, on s’empresserait d’apporter un supplément de lingots à la monnaie; supposons qu’elle valῦt moins, on s’empresserait ou de fondre une partie de la monnaie ou de la réserver pour l’usage auquel sont affectés les lingots jusqu’à ce que l’équivalence fῦt rétablie [9] .
d’une once d’or. Comment la livre sterling est descendue de la valeur d’une livre pesant d’argent à celle d’un peu plus d’un quart d’once d’or, c’est ce que l’exemple analogue de la dépréciation de la livre française nous servira à expliquer [II-79] plus loin [8] . Contentons-nous de constater, en attendant, de quelle manière on la maintient à ce dernier niveau depuis qu’elle y est descendue, comment on empéche qu’elle ne descende plus bas ou qu’elle ne remonte plus haut. Le gouvernement est tenu de fournir toujours, sur demande, à qui lui apporte de l’or en lingot, poids pour poids d’or monnayé, sans rien garder pour ses frais de monnayage. D’où il résulte qu’il ne peut exister aucune différence sensible entre la valeur de l’or en lingot et [II-80] celle de l’or monnayé. Supposons, en effet, qu’une telle différence vint à se produire, qu’une once d’or monnayé vînt à valoir plus d’une once d’or en lingot, on s’empresserait d’apporter un supplément de lingots à la monnaie; supposons qu’elle valῦt moins, on s’empresserait ou de fondre une partie de la monnaie ou de la réserver pour l’usage auquel sont affectés les lingots jusqu’à ce que l’équivalence fῦt rétablie [9] .
[II-81]
Pour rendre cette équivalence plus sensible encore, on a monnayé, dans son tout comme dans ses divisions et ses subdivisions, la valeur servant d’étalon. Cette valeur qui est celle d’un poids d’or de  d’once est divisée en 12 shellings et chaque shelling en 12 deniers. On a donc fabriqué des souverains d’or, ayant exactement le poids de la livre sterling, des shellings d’argent et des pence de cuivre, étalonnés sur les divisions de la livre sterling.
d’once est divisée en 12 shellings et chaque shelling en 12 deniers. On a donc fabriqué des souverains d’or, ayant exactement le poids de la livre sterling, des shellings d’argent et des pence de cuivre, étalonnés sur les divisions de la livre sterling.
[II-82]
Le système monétaire de l’Angleterre se présente ainsi de la manière suivante:
Étalon. La livre sterl. divisée en 20 shellings et 240 deniers, ayant une valeur de:  ou
ou  d’une once d’or.
d’une once d’or.
[II-83]
Dans ce système, il y a, comme on voit, et il ne peut y avoir aucune différence entre la valeur du métal servant d’étalon et celle de ce même métal faconné en monnaie, puisque tout le monde peut porter des lingots à l’hôtel des monnaies et obtenir, en échange de chaque once, 3 souverains 17 shellings et 10 ½ pence monnayés qui pèseraient précisément une once en admettant que les shellings et les pence fussent en or. La monnaie britannique se trouve ainsi fixée aussi exactement que possible sur l’étalon d’or, et elle ne peut subir d’autres fluctuations de valeur que celles que subit l’or lui-même. Si l’or avait une valeur invariable, ce système serait parfait. Malheureusement il n’en est pas ainsi. La valeur de l’or est sujette à varier, et, par suite de la gratuité du monnayage, toutes les variations de la valeur du métal doivent se répercuter immédiatement dans la monnaie. S’il y avait, au contraire, des frais de monnayage à payer, les variations partielles de la valeur du métal se feraient moins sentir dans l’instrument monétaire. Ces frais formeraient comme une espèce de bourrelet qui amortirait les variations soit en hausse, soit en baisse. Quand le métal hausserait, il faudrait que la hausse excédât les frais du monnayage pour qu’on prît le parti de réduire la monnaie à [II-84] l’état de lingot; quand le métal baisserait, il faudrait de même que la baisse atteignît une partie des frais de monnayage pour que l’on trouvât bénéfice à faire frapper un supplément de monnaie.
Quoi qu’il en soit, dans ce système, la valeur de la monnaie est entièrement gouvernée par celle du métal: la monnaie est comme si elle se trouvait encore sous forme de lingots.
La valeur de l’or monnayé étant ajustée, par ce procédé, sur celle du métal non monnayé qui sert d’étalon, il s’agit d’établir un rapport fixe et permanent entre la monnaie d’or et les coupures inférieures de l’instrument monétaire en argent ou en cuivre. Autrement dit, il s’agit, après avoir étalonné la monnaie d’or sur le métal, d’étalonner la monnaie d’argent et de cuivre sur la monnaie d’or, de telle façon que l’instrument monétaire soit un dans toutes ses parties. Comment peut-on obtenir ce résultat? Comment faut-il s’y prendre, par exemple, pour que quatre couronnes d’argent de cinq shellings soient toujours l’équivalent d’un souverain d’or? Pour que douze pièces de cuivre d’un penny soient toujours l’équivalent d’un shelling d’argent?
Supposons que l’on tienne pour vrai ce principe de l’école métallique que la valeur de la monnaie est nécessairement gouvernée par celle du métal dont elle est composée, ce résultat ne pourra être obtenu; il sera impossible d’obtenir un rapport de valeur invariable entre la monnaie d’or et la monnaie d’argent, entre la monnaie d’argent et la monnaie de cuivre. Supposons, en effet, qu’à un moment donné, l’or vaille 15 ½ fois l’argent, il faudra pour fabriquer des couronnes, dont quatre soient l’équivalent d’un souverain ou d’une livre sterling, un poids [II-85] d’argent de  × 15 ½. La couronne fabriquée avec ce poids d’argent, le monnayage étant gratuit, équivaudra exactement à un quart de liv. st. Mais que l’argent vienne à hausser ou à baisser de valeur relativement à l’or, — et l’expérience atteste que la valeur relative de l’or et de l’argent est sujette à d’incessantes variations, quoique ces variations soient ordinairement peu appréciables, — il faudra diminuer ou augmenter chaque fois en proportion de la hausse ou de la baisse le poids des couronnes, si l’on veut que le rapport de valeur entre la monnaie d’argent et la monnaie d’or demeure invariable. Or cette augmentation et cette diminution incessantes du poids des pièces est chose impossible dans la pratique. Ou donc il faut se résigner à laisser varier le rapport de valeur des espèces d’or avec les espèces d’argent et de cuivre, ou il faut fixer ce rapport d’une manière immuable, sans tenir compte du soidisant principe de l’école métallique: “Que la valeur de la monnaie est nécessairement gouvernée par celle du métal dont elle est composée.” C’est, en effet, à ce dernier parti qu’on s’est arrêté en Angleterre pour l’argent et le cuivre, dans les autres pays pour le cuivre seulement.
× 15 ½. La couronne fabriquée avec ce poids d’argent, le monnayage étant gratuit, équivaudra exactement à un quart de liv. st. Mais que l’argent vienne à hausser ou à baisser de valeur relativement à l’or, — et l’expérience atteste que la valeur relative de l’or et de l’argent est sujette à d’incessantes variations, quoique ces variations soient ordinairement peu appréciables, — il faudra diminuer ou augmenter chaque fois en proportion de la hausse ou de la baisse le poids des couronnes, si l’on veut que le rapport de valeur entre la monnaie d’argent et la monnaie d’or demeure invariable. Or cette augmentation et cette diminution incessantes du poids des pièces est chose impossible dans la pratique. Ou donc il faut se résigner à laisser varier le rapport de valeur des espèces d’or avec les espèces d’argent et de cuivre, ou il faut fixer ce rapport d’une manière immuable, sans tenir compte du soidisant principe de l’école métallique: “Que la valeur de la monnaie est nécessairement gouvernée par celle du métal dont elle est composée.” C’est, en effet, à ce dernier parti qu’on s’est arrêté en Angleterre pour l’argent et le cuivre, dans les autres pays pour le cuivre seulement.
Mais avant d’examiner comment se pratique cet étalonnage des monnaies inférieures dites divisionnaires, de billon ou d’appoint, résolvons encore deux questions préalables, savoir: 1° pourquoi l’instrument monétaire doit être composé de plusieurs métaux, sans parler du papier; 2° pourquoi l’instrument monétaire, quoique composé de plusieurs métaux doit être un dans toutes ses parties, comme s’il était composé d’un seul métal.
L’instrument monétaire doit être composé de plusieurs métaux, d’abord à cause de la nature des échanges, ensuite à [II-86] cause de la nature des matières premières monétaires. On échange des valeurs de toutes dimensions, grandes, moyennes et petites; il faut, en conséquence, des pièces de monnaie qui correspondent à ces différentes catégories de valeurs qui se présentent à l’échange, c’est à dire des coupures supérieures, moyennes et inférieures. Mais le même métal n’est pas également propre à la fabrication de ces coupures inégales. Supposons, par exemple, qu’on voulῦt s’en tenir à l’emploi de l’or, on pourrait à la rigueur fabriquer des couronnes, des demicouronnes, ou même de simples shellings avec ce métal, mais ces pièces seraient tellement petites et légères qu’on les trouverait fort incommodes dans l’usage. Quant à fabriquer en or des pièces d’un penny ou d’un farthing, ce serait matériellement impossible. Supposons qu’on voulῦt s’en tenir à l’argent, la pièce de 20 shellings d’argent serait trop massive et celle d’un penny trop menue; supposons qu’on voulῦt s’en tenir au cuivre, il faudrait des pièces énormes pour les échanges moyens et supérieurs. La nature des échanges, d’une part, la nature des matières premières monétaires, de l’autre, exigent, comme on voit, absolument, l’emploi des trois métaux dans la fabrication de la monnaie.
Arrivons maintenant au second point. Pourquoi faut-il que l’instrument monétaire confectionné avec plusieurs métaux soit un comme s’il était fait d’un seul métal? En d’autres termes, pourquoi faut-il que les 20 shellings d’argent valent toujours un souverain d’or et les douze pences de cuivre toujours un shelling d’argent? La réponse à cette question est facile. Faisons une simple hypothèse. Si les rapports de valeur entre les différentes catégories de pièces qui constituent l’instrument monétaire n’étaient point invariables, s’il fallait, par exemple, [II-87] tantôt 19 shellings, tantôt 21 pour équivaloir à un souverain, il en résulterait de graves inconvénients dans la pratique. En premier lieu, chaque fois que l’on emploierait de la monnaie auxiliaire d’argent ou de cuivre, il faudrait l’évaluer, c’est à dire déterminer le rapport de valeur existant, au moment de l’échange, entre la monnaie auxiliaire et l’étalon, constater combien il faut de shellings et de pences pour faire une livre, chose embarrassante et compliquée. En second lieu, tous les contrats, dans lesquels la monnaie auxiliaire entrerait pour une part, contiendraient un élément aléatoire. Ainsi, un homme qui aurait contracté une dette de 15 shellings, lorsque 20 shellings valaient une livre, et qui devrait la rembourser lorsque 20 shellings vaudraient plus d’une livre, se trouverait lésé de la différence. Enfin, ces variations de la monnaie auxiliaire deviendraient la source d’embarras inextricables dans la tenue et le réglement des comptes. Car lorsque 19 shellings d’argent vaudraient une livre, ou bien il faudrait établir la division de la livre par dix-neuvièmes, ou bien, si l’on conservait l’ancienne division par moitié, par quarts et par vingtièmes, ces appoints seraient fort difficiles à former à l’aide d’une monnaie divisionnaire dont chaque pièce vaudrait 1/19e de livre. Il faudrait recourir pour les ajuster à des appoints en cuivre qui étant eux-mêmes variables rendraient chaque échange plus que laborieux. Il est donc indispensable, — et nous croyons inutile d’insister davantage sur ce point, — que la proportion entre les différentes catégories de pièces qui composent l’instrument des échanges demeure invariable, que 20 shellings valent toujours 1 livre, et 12 pences toujours un shelling.
En résumé, il est nécessaire: 1° que l’instrument monétaire soit fabriqué avec plusieurs métaux; 2° qu’il soit un dans toutes [II-88] ses parties, ou, ce qui revient au même, que ses différentes coupures d’or, d’argent ou de cuivre aient entre elles un rapport de valeur invariable.
Comment peut-on obtenir cette invariabilité du rapport de valeur entre des pièces confectionnées avec des métaux dont la valeur relative est sujette à des variations incessantes? Comment l’obtient-on en Angleterre?
On l’obtient en Angleterre à l’aide des procédés suivants: 1° en confectionnant les pièces d’argent et de cuivre avec une quantité de métal dont la valeur est inférieure à celle de la pièce fabriquée; 2° en élevant artificiellement la valeur de la pièce fabriquée par la restriction des émissions; en réglant l’émission des shellings de telle façon que 20 shellings d’argent valent toujours un souverain d’or, et 12 pences de cuivre toujours un shelling d’argent.
C’est ainsi qu’alors que la valeur de la monnaie d’or est toujours égale à celle du métal dont cette monnaie est faite, la valeur de la monnaie d’argent dépasse de 1/14e environ et celle de la monnaie de cuivre de plus de moitié, la valeur de l’étoffe métallique qu’elles contiennent. D’où il résulte qu’à moins d’une révolution qui abaisse la valeur de l’or de plus de 1/14e relativement à l’argent, et la valeur de l’argent de plus de moitié relativement au cuivre, le shelling ne peut jamais valoir plus de ½0e de liv. sterl. et le penny plus de 1/12e de shell. ou de ½40e de liv. sterl.
Ils ne peuvent valoir moins non plus parce que le gouvernement, investi du monopole du monnayage, ne délivre de la monnaie d’argent qu’à ceux qui la lui paient à raison d’un souverain pour 20 shell., et la monnaie de cuivre à raison d’un shell. pour 12 pences. De là l’invariabilité du rapport. Il peut [II-89] arriver cependant que la demande de la monnaie divisionnaire diminue et qu’elle ait alors une tendance à baisser, mais, en ce cas aussi, la demande qui en est faite au gouvernement se ralentit, la fabrication et l’émission deviennent moindres et la valeur se rétablit. Il peut arriver encore que la demande s’accroisse et que la valeur de la monnaie divisionnaire tende à hausser; mais on en demande alors au gouvernement une quantité supplémentaire, la fabrication et l’émission s’augmentent, et la valeur demeure au niveau du rapport établi. Seulement, on le conçoit, il ne faut pas que la valeur métallique de la monnaie divisionnaire dépasse jamais le niveau de sa valeur monétaire, sinon elle serait incessamment demandée pour être fondue et les frais de monnayage seraient faits en pure perte.
Tel est l’étalonnage du système monétaire anglais. La monnaie d’or est étalonnée sur le métal; la monnaie divisionnaire d’argent et de cuivre sur la monnaie d’or, et l’instrument monétaire est invariable dans toutes ses parties. Il le serait aussi dans sa base, si la valeur de l’or était immuable. Mais comme il n’en est pas ainsi, le système monétaire anglais subit incessamment, jusque dans ses dernières ramifications, l’influence des fluctuations du métal étalon, si légères qu’elles soient. C’est comme un édifice solidement construit, dont toutes les parties seraient liées par un ciment indestructible, mais dont les fondations seraient assises sur un terrain mouvant.
Que si maintenant nous jetons un regard d’ensemble sur les monnaies des différents États, nous y remarquerons une extrême diversité, quant à la composition, la façon et l’étalonnage. Si les matières premières monétaires sont à peu près les mêmes partout, on s’en sert dans des proportions fort diverses, [II-90] et chacun les met en œuvre à sa manière. Sous le rapport de l’étalonnage, les États monnayeurs peuvent être partagés en deux grandes catégories: ceux qui ont adopté l’étalon d’or et ceux qui s’en tiennent encore à l’étalon d’argent. Mais dans chaque catégorie, l’étalon diffère de pays à pays, quant à la coupure. En Angleterre, l’étalon est un poids d’or de  d’once nommé livre sterling; aux États-Unis, c’est un poids de 0,05375es d’once d’or, poids de troy nommé dollard. En France, l’étalon est un poids d’argent de 5 grammes à 9/10es de fin, nommé franc; en Hollande, c’est un poids d’argent de 10 grammes à
d’once nommé livre sterling; aux États-Unis, c’est un poids de 0,05375es d’once d’or, poids de troy nommé dollard. En France, l’étalon est un poids d’argent de 5 grammes à 9/10es de fin, nommé franc; en Hollande, c’est un poids d’argent de 10 grammes à  de fin, nommé florin. Les monnaies fixées sur ces étalons sont de même essentiellement diverses dans leurs façons et leurs coupures. Elles ne sont pas non plus étalonnées partout de la même manière, et nous aurons à constater, en France par exemple, combien est imparfait et vicieux le mode d’étalonnage adopté pour la monnaie d’or. Enfin les conditions auxquelles les monnaies sont mises au service du public ne diffèrent pas moins d’époque à époque et de pays à pays. Si partout, — et ce fait ne comporte encore aucune exception, du moins en ce qui concerne la monnaie métallique, — la production de la monnaie est un monopole gouvernemental, la pratique de ce monopole n’a pas été uniforme en tous lieux et en tous temps. Tandis que le prix de façon de la monnaie atteignait parfois un taux exorbitant, — aux époques où le monopole du monnayage constituait une des principales branches du revenu du souverain, — il est actuellement insignifiant pour les monnaies supérieures; dans quelques pays même, comme en Angleterre, le monnayage est gratuit, et le gouvernement ne bénéficie plus, en temps ordinaire, que sur les monnaies inférieures.
de fin, nommé florin. Les monnaies fixées sur ces étalons sont de même essentiellement diverses dans leurs façons et leurs coupures. Elles ne sont pas non plus étalonnées partout de la même manière, et nous aurons à constater, en France par exemple, combien est imparfait et vicieux le mode d’étalonnage adopté pour la monnaie d’or. Enfin les conditions auxquelles les monnaies sont mises au service du public ne diffèrent pas moins d’époque à époque et de pays à pays. Si partout, — et ce fait ne comporte encore aucune exception, du moins en ce qui concerne la monnaie métallique, — la production de la monnaie est un monopole gouvernemental, la pratique de ce monopole n’a pas été uniforme en tous lieux et en tous temps. Tandis que le prix de façon de la monnaie atteignait parfois un taux exorbitant, — aux époques où le monopole du monnayage constituait une des principales branches du revenu du souverain, — il est actuellement insignifiant pour les monnaies supérieures; dans quelques pays même, comme en Angleterre, le monnayage est gratuit, et le gouvernement ne bénéficie plus, en temps ordinaire, que sur les monnaies inférieures.
Pour bien nous rendre compte des changements qui se sont [II-91] operés successivement dans l’exploitation du monopole du monnayage, nous donnerons, dans les leçons suivantes, un aperçu historique du système monétaire de la France. Cet aperçu nous permettra à la fois d’achever d’éclaircir la notion de la monnaie et de mettre en relief ce qu’il y a encore d’imparfait dans les systèmes monétaires actuellement en vigueur. En attendant, il nous reste une dernière question générale à examiner, celle de la quantité de monnaie qui est nécessaire à un pays. Cette quantité est-elle illimitée comme on le croyait jadis, ou, si elle ne l’est point, quelles sont ses limites?
La monnaie sert de véhicule intermédiaire dans les échanges: suivant une expression ingénieuse d’Adam Smith, elle sert à voiturer les valeurs. Combien donc faut-il à un pays de ces voitures monétaires pour effectuer le service des échanges? Il est évident que ce nombre doit subir l’influence de plusieurs causes. Il doit être subordonné: 1° à la somme de valeurs qu’il s’agit de voiturer; 2° à la longueur des voyages; 3° à la rapidité du mouvement imprimé aux voitures; 4° aux procédés et véhicules similaires que l’on peut employer soit pour économiser les transports, soit pour les effectuer sans recourir à la monnaie.
Ce voiturage des valeurs s’opère, comme nous l’avons remarqué, dans l’espace et dans le temps. Une partie de la monnaie est employée aux échanges qui s’accomplissent en vue d’une consommation actuelle; une autre partie à ceux qui s’accomplissent en vue d’une consommation future. Je suis fabricant de drap, par exemple. J’échange mon drap contre de la monnaie. Que fais-je de cette monnaie? J’en emploie immédiatement une partie à acheter des matières premières, à payer mes ouvriers, à me procurer les produits ou services nécessaires à ma consommation [II-92] et à celle de ma famille. J’en réserve une autre partie pour un emploi ultérieur, soit qu’il s’agisse de renouveler ou d’augmenter mes éléments de production, soit simplement de la satisfaction de mes besoins futurs. Dans le premier cas, la monnaie circule; dans le second cas, elle s’accumule, ou, si l’on veut encore, elle circule dans le temps. La quantité requise pour la circulation actuelle dépend de la somme des transactions à effectuer et de la rapidité avec laquelle la même pièce de monnaie peut passer d’un échange à un autre. Dans les pays où la population est faible et disséminée sur de vastes espaces, où les échanges se font entre des populations très éparses, où en même temps le crédit est rare, la quantité de monnaie nécessaire à la circulation est, proportion gardée, considérable. Il en est de même pour l’accumulation on la circulation dans le temps: dans les pays où l’on est obligé de conserver longtemps, sous forme de monnaie, le capital que l’on a accumulé, faute de pouvoir employer ce capital ou l’échanger contre d’autres valeurs capitalisables, la quantité de monnaie nécessaire aux accumulations est également considérable.
On conçoit donc que la quantité de monnaie nécessaire pour effectuer les échanges varie de pays à pays et d’époque à époque; qu’elle augmente ou diminue, tantôt lentement, tantôt rapidement sous l’empire d’une foule de circonstances; qu’elle augmente brusquement, lorsque le crédit qui en tient lieu, en partie, vient à faire défaut, comme dans les moments de crise; qu’elle diminue lorsque les échanges deviennent plus rapides et que le crédit s’étend, etc., etc.; qu’il faille, en conséquence, tantôt accroître l’émission ou l’offre de la monnaie, et tantôt la restreindre, pour subvenir aux besoins essentiellement mobiles du marché.
[II-93]
Mais, en tous cas, l’intérêt de la société exige que l’on fasse, soit dans l’espace, soit dans le temps, la plus grande somme possible d’échanges ou d’accumulations avec la même somme de monnaie, comme il importe que l’on fasse la plus grande quantité possible de transports avec le même matériel de voitures ou de wagons, de manière à ne jamais laisser chômer le capital incorporé en monnaie non plus que celui que l’on emploie sous forme de voitures. En effet, ni l’un ni l’autre ne sont mis gratis au service du public. On loue l’usage du véhicule monétaire, comme on loue l’usage des wagons d’un chemin de fer, et l’intérêt payé pour la monnaie comme le prix de loyer payé pour le wagon, rentrent dans les frais généraux de la production des choses qui ont été échangées par l’une ou transportées par l’autre.
[II-94]
QUATRIÈME LEÇON↩
la monnaie sous l’ancien rÉgime
Le monopole du monnayage. — Influence du monopole sur la formation des prix. — Comparaison avec le monopole du sel. — Pourquoi les seigneurs attachaient une importance particulière au monopole du monnayage. — Comment les rois le leur enlevèrent. — Des étalons de poids et de qualité dont on se servait pour la monnaie. — De l’étalon originaire de la valeur. — Ce qu’était la livre monétaire. — Pourquoi la valeur de la monnaie différait de celle du métal dont elle était faite. — De la traite, du brassage et du seigneuriage. — De la dégradation de l’étalon monétaire. — Comment elle se manifestait. — Dans quelle mesure elle s’est opérée sous l’ancien régime.
Si nous nous reportons au moyen âge et si nous recherchons de quels éléments se composaient les revenus des seigneurs féodaux, nous trouverons qu’outre les corvées et les redevances en nature qu’ils exigeaient de leurs serfs ou de leurs vassaux, ils s’étaient réservé le privilége exclusif d’approvisionner de certaines denrées les habitants de leurs domaines ou de leur rendre certains services. C’est ainsi que, dans beaucoup d’endroits, ils s’étaient attribué le monopole de la vente du sel. [II-95] Ailleurs, les habitants étaient tenus de faire moudre leur farine au moulin et cuire leur pain au four seigneuriaux. Enfin, partout, le seigneur s’était attribué le droit exclusif de battre monnaie, autrement dit le monopole du monnayage.
Nous nous rendons parfaitement compte du mécanisme et des effets des monopoles qui grevaient les denrées alimentaires. Nous savons, par exemple, que le seigneur se procurait le sel à bas prix et qu’il le revendait le plus cher possible aux habitants de son domaine, en leur défendant, sous des peines rigoureuses, d’en acheter ailleurs que chez lui. Nous savons encore qu’à mesure que le pouvoir royal se fortifia et s’étendit, les rois dépouillèrent les seigneurs du monopole du sel pour se l’attribuer; qu’afin d’en rendre l’exploitation plus économique et plus profitable, ils le donnèrent en location à des fermiers; qu’ils déléguèrent à ces fermiers, dits des gabelles, le droit exclusif de vendre du sel, à des prix déterminés, dans toute l’étendue de la monarchie, à l’exception des provinces qui s’étaient rachetées de cet impôt. Nous nous expliquons sans peine comment cette exploitation du monopole d’une denrée nécessaire à la vie pouvait procurer de gros bénéfices au gouvernement et aux fermiers, surtout lorsqu’on l’eut renforcée par l’obligation imposée à chaque famille de consommer annuellement au moins une certaine quantité de sel. Nous nous expliquons de même comment le seigneur pouvait retirer des profits usuraires de la mouture du grain et de la cuisson du pain. On conçoit que le seigneur put dire, par exemple, aux habitants de son domaine: Vous ne ferez cuire votre pain nulle part ailleurs que dans mon four, et sur chaque fournée de 12 pains que vous y apporterez, j’en retiendrai deux pour ma part: l’un pour couvrir les frais d’établissement et d’entretien du four, de [II-96] combustible et de main-d’œuvre, l’autre pour mon bénéfice. Nous nous expliquons enfin non seulement les bénéfices que ces monopoles établis sur des choses nécessaires à la vie procuraient aux seigneurs, mais encore les dommages qu’ils infligeaient aux populations, obligées de payer à des prix artificiellement surélevés le sel, la farine et le pain, comme aussi de se contenter de mauvais sel, de farine mal moulue et mélangée de matières étrangères et de pain mal cuit.
Mais si nous nous rendons clairement compte du mécanisme et des effets du monopole du sel, de la mouture du grain, de la cuisson du pain et de tant d’autres analogues qui florissaient autrefois et qui n’ont pas encore, hélas! entièrement disparu de nos jours, il n’en est pas ainsi du monopole du monnayage. Nous savons bien que les seigneurs et, après eux, les rois réalisèrent de gros bénéfices sur le monnayage; que ce monopole constitua même, à l’origine, une des branches les plus importantes, sinon la plus importante de leurs revenus; nous savons encore qu’aucun monopole ne causa plus de dommages et de souffrances aux populations, mais nous n’avons que des notions confuses et obscures sur son mécanisme et sur ses effets.
Pourquoi cette différence? Pourquoi nous expliquons-nous clairement le mécanisme et les effets du monopole du sel, de la mouture, etc., tandis que nous ne nous expliquons pas aussi bien ceux du monopole du monnayage?
Cela tient à plusieurs causes: d’abord à ce que nous avons encore sous les yeux dans plusieurs pays le monopole du sel, à peu près tel qu’il fonctionnait sous l’ancien régime, tandis que le monnayage a subi des modifications importantes. Cela tient ensuite et surtout à l’imperfection des théories monétaires.
Comment nous expliquons-nous, par exemple, les bénéfices [II-97] extraordinaires qu’il est dans la nature du monopole du sel de procurer? Par l’action même des lois qui président à la formation des prix, c’est à dire de l’offre et de la demande d’une part, les frais de production de l’autre.
Mettez du sel au marché, comment le prix en sera-t-il déterminé? Par le rapport des quantités offertes avec les quantités demandées. Si la quantité offerte est considérable relativement à la quantité demandée, le sel sera à bon marché, et plus on augmentera l’offre, — en admettant que la demande ne s’accroisse point d’une manière correspondante, — plus le prix du sel baissera, Jusqu’à quel point baissera-t-il? Il pourra baisser jusqu’à zéro, si la quantité offerte s’augmente d’une manière illimitée. Mais, dans la pratique, l’offre demeure toujours plus ou moins limitée. Pourquoi? Parce que le sel exige toujours one certaine quantité de travail pour être produit et mis à la portée des consommateurs, dans l’endroit et au moment où ils en ont besoin, c’est à dire dans l’espace et dans le temps. Cette quantité de travail constituant les frais de production du sel forme la limite au dessous de laquelle le prix de cette denrée ne peut descendre d’une manière normale, et à laquelle il est incessamment ramené sous un régime de libre concurrence. En effet, lorsque le prix du sel tombe au dessous de la limite des frais de production, le travail employé à cette production ne recevant plus une rémunération qui suffise pour l’entretenir et le renouveler, la quantité produite doit nécessairement diminuer. Cette quantité diminuant, l’offre devient moindre et le prix se relève. S’il monte de manière à dépasser le niveau des frais de production, qu’arrive-t-il encore? C’est que le travail employé à la production du sel recevant au delà de sa rémunération nécessaire et qu’une prime croissante venant s’ajouter à [II-98] cette rémunération, le travail appliqué à d’autres industries ou simplement le travail disponible qui cherche un emploi est attiré dans cette direction, la production s’accroit en conséquence, l’offre devient plus forte et le prix baisse. Comme l’a admirablement observé Adam Smith, le montant des frais de production, ou, pour nous servir de son expression favorite, le prix naturel devient ainsi le point central autour duquel gravite incessamment, sous un régime de concurrence, le prix courant de toutes choses.
Comme nous l’avons remarqué dans la leçon précédente, la loi qui préside à la formation des prix demeure la même sous un régime de monopole, mais avec la différence essentielle, quant au mode d’opération de cette loi, que le détenteur du monopole règle à sa guise l’offre de sa denrée, puisque personne ne peut en offrir concurremment avec lui. Cela étant, il s’efforce naturellement de maintenir le plus grand écart possible entre l’offre et la demande. Remarquons toutefois que ce résultat ne peut être obtenu au même degré avec toutes les denrées. Lorsqu’il s’agit d’une denrée qui n’est point nécessaire à la vie, quel est l’effet d’une diminution de l’offre et de l’augmentation du prix qui en est la conséquence immédiate? C’est de provoquer aussitôt une diminution de la demande. Supposons, par exemple, que la vente des oranges vienne à être monopolisée, et que le prix des oranges soit porté de 10 centimes à 1 franc, qu’en résultera-t-il? C’est que la demande diminuera dans des proportions telles que le monopoleur ne pourra vendre à raison de fr. 1 qu’un petit nombre d’oranges, et que s’il réalise un bénéfice considérable sur chacune, la somme de ses profits n’en sera pas moins très faible. Il en sera autrement s’il s’agit d’une denrée de première nécessité, telle que le sel. Supposons que [II-99] la vente du sel vienne à être monopolisée, le prix pourra en être élevé dans la proportion de 1 à 10, sans que la demande diminue de plus d’un tiers ou de la moitié. Sous ce rapport, chaque monopole donne des résultats différents, selon qu’il porte sur une denrée plus ou moins nécessaire à la vie, selon, en conséquence, qu’une augmentation du prix agit plus ou moins sur la demande. C’est l’affaire du monopoleur de chercher à quel point il doit fixer l’écart entre l’offre et la demande pour réaliser un maximum de profits.
Quoi qu’il en soit, le monopoleur est le maître de régler l’offre de la denrée monopolisée. Dans la pratique, comment agit-il? Il fixe son prix et il offre toute la quantité qui est demandée à ce prix. Supposons qu’il en offrît moins, qu’arriverait-il? C’est que la denrée hausserait de prix entre les mains des premiers acheteurs; c’est qu’elle ferait prime, exactement dans la proportion de la diminution de l’offre (en tenant compte, bien entendu, de l’influence que la diminution de l’offre et l’augmentation du prix auraient exercée sur la demande). Supposons, au contraire, qu’après avoir fixé son prix, le monopoleur offrît au delà de la quantité qui est demandée à ce taux, comment pourrait-il placer l’excédant? A moins qu’il ne fῦt en son pouvoir d’imposer une augmentation de la demande, en fixant, par exemple, la quantité que chacun serait tenu de consommer, comme dans le cas du sel sous le régime de la gabelle, il serait obligé d’abaisser son prix, jusqu’à ce que l’accroissement naturel de la demande, provoqué par cette baisse, eῦt absorbé l’excédant de l’offre.
Précisons davantage encore la manière dont les prix se forment sous un régime de concurrence et sous un régime de monopole.
[II-100]
Sous un régime de concurrence, chacun commence par offrir sa marchandise au prix le plus élevé possible. Mais il n’y a de demandes que pour les offres faites au taux le plus bas. Les autres demeurent comme non avenues. En conséquence, qu’arrive-t-il? C’est que ceux qui ont offert leur marchandise au taux le plus bas, élèvent leur prix, et que ceux qui l’ont offerte au taux le plus élevé abaissent le leur, de telle sorte qu’il se forme un cours moyen ou prix du marché, au niveau duquel l’offre se met en équilibre avec la demande. Si la demande augmente, sans que l’offre s’élève d’une manière proportionnelle, chacun fixe son prix plus haut, si la demande diminue, l’offre demeurant la même, chacun fixe son prix plus bas. Le prix dépend donc de la proportion des quantités offertes et demandées et celles-ci dépendent, à leur tour, des quantités produites, lesquelles augmentent ou diminuent selon qu’elles peuvent ou non être réalisées à un taux rémunérateur.
Sous un régime de monopole, les lois qui règlent le prix des choses demeurent les mêmes, mais leur mode d’opération se trouve profondément modifié. Comme le monopoleur est le maître de fixer à sa guise la quantité offerte, il se trouve par la même aussi, maître du prix. Il commence par fixer ce prix au taux qui lui paraît le plus avantageux. Trois cas peuvent alors se présenter: 1° que la demande se balance avec l’offre, et dans ce cas, le monopoleur maintient purement et simplement son offre et son prix; 2° que la demande dépasse l’offre, ce qui permet au monopoleur ou d’augmenter son offre sans élever son prix, ou d’élever son prix sans augmenter son offre; 3° que la demande demeure au dessous de l’offre, et dans ce dernier cas, le monopoleur peut à son gré diminuer son offre ou abaisser son prix. Dans tous les cas, il demeure, comme on le [II-101] voit, le maître de fixer à son gré le prix de la denrée monopolisée, en admettant bien entendu, qu’aucune concurrence ne soit possible. Mais il n’en est pas moins hors du pouvoir du monopoleur de modifier les lois qui président à la formation des prix. En vain, voudrait-il, par exemple, élever son prix tout en augmentant son offre, il n’y réussirait point. Il se heurterait à une puissance plus grande que la sienne: celle de la nature des choses.
Si l’on conserve ces observations présentes à la mémoire, on s’expliquera le mécanisme du monopole de la monnaie, tout aussi aisément que l’on s’explique le mécanisme du monopole du sel, du tabac ou de toute autre denrée.
Lors de l’établissement du régime féodal, les seigneurs s’attribuèrent à l’envi le monopole du monnayage, et ils considérèrent même le droit de battre monnaie comme l’un des attributs les plus précieux de la souveraineté. L’importance particulière qu’ils attribuaient à l’exercice de ce droit provenait non seulement de ce que le monopole du monnayage leur rapportait de beaux bénéfices, mais encore de ce que ces bénéfices se réalisaient sous la forme de métaux précieux, c’est à dire d’un produit investi d’un pouvoir d’échange presque illimité dans l’espace et dans le temps. Quand on faisait cuire du pain au four seigneurial, on payait au seigneur une redevance en pains, et l’on acquittait de la même manière la plupart des autres impôts ou redevances. C’était en nature qu’on les fournissait, en blé, en bétail, en vin, etc., et comme les débouchés manquaient pour échanger ces denrées, il fallait bien les consommer sur place et dans un délai assez court. Le seigneur avait donc en abondance toutes les choses produites sur son domaine, mais il pouvait difficilement se procurer celles qui [II-102] étaient produites au dehors. Il ne lui était pas moins difficile d’accumuler, de capitaliser en vue d’un échange à venir des redevances fournies sous forme de produits agricoles. Les redevances provenant du monopole du monnayage étaient, sous ce double rapport, bien préférables. Comme elles étaient, en vertu de leur nature particulière, pourvues à un plus haut degré qu’aucun autre produit, du pouvoir de s’échanger dans l’espace et dans le temps, on pouvait s’en servir soit pour se procurer les produits de luxe qui provenaient des contrées lointaines, soit pour constituer des capitaux faciles à mobiliser et à dérober aux atteintes des pillards de toute condition. On conçoit donc qu’à cette époque les métaux précieux fussent considérés comme la richesse par excellence et que les souverains, grands et petits, regardassent le monopole au moyen duquel ils se les procuraient (et, sauf le pillage, c’était à peu près l’unique moyen qu’ils eussent de se les procurer) comme le plus enviable de tous.
Ce monopole si avantageux devait naturellement tenter plus vivement qu’aucun autre la cupidité des membres les plus puissants de la corporation féodale. Aussi fut-il le premier que les rois de France s’efforcèrent d’enlever aux seigneurs, leurs vassaux. Les procédés qu’ils employèrent pour atteindre ce but sont curieux à étudier. Ils commencèrent par intervenir, aussi souvent qu’ils le purent, dans la fabrication des monnaies seigneuriales, sous le prétexte de sauvegarder les intérêts des populations ou leurs propres intérêts. C’est ainsi qu’ils déléguèrent auprès des seigneurs investis du droit de battre monnaie des juges-gardes dont les fonctions, dit M. de Bettange, “étaient de veiller à ce que les seigneurs fissent battre bonne monnaie et qu’ils n’en fondissent point de celle du roi.” Mais [II-103] le pouvoir royal ne s’en tint pas là. Il absorba peu à peu les monnaies seigneuriales soit eu les confisquant, soit, — et ceci paraît avoir été le cas le plus fréquent, — en les rachetant. Nous lisons, par exemple, dans les Lettres sur l’histoire monétaire de la Normandie et du Perche, de M. Lecointre Dupont, que le sire Robert de Meun vendit son droit de monnayage à Charles le Bel, le 22 avril 1322, moyennant six mille livres. D’après Bettange, les comtes de Toulouse furent les derniers qui vendirent le leur. Sous la troisième race, dit le même écrivain, il n’y avait plus que les ducs de Bretagne, de Bourgogne, de Berry, de Normandie, d’Anjou, de Lorraine, d’Orange, le duc d’Austrasie et quelques petits seigneurs qui eussent le droit de battre monnaie. Ce nombre se réduisit successivement et les rois finirent par posséder seuls le droit de monnayage dans toute l’étendue de la monarchie [10] .
[II-104]
Ce serait une question assez intéressante à examiner que celle de savoir si cette “unification” du monnayage, pour nous [II-105] servir d’une expression aujourd’hui à la mode, a été avantageuse ou non aux populations. Certains seigneurs battaient, à la [II-106] vérité, de fort mauvaise monnaie, et comme cette monnaie n’avait point cours en dehors de leurs domaines, il en résultait pour les transactions de seigneurie à seigneurie des embarras analogues à ceux qu’occasionne actuellement la diversité des monnaies, et le mauvais état de quelques-unes, dans les transactions d’État à État. Mais, d’un autre côté, lorsque les rois furent investis, sans partage, du monopole du monnayage, ils trouvèrent plus de profit qu’auparavant à fabriquer de mauvaise monnaie, et ils cessèrent, en même temps, d’avoir intérêt à la faire bonne, pour provoquer dans l’esprit des populations [II-107] qui souffraient de la mauvaise monnaie des seigneurs, des comparaisons favorables à la monnaie royale. Le progrès eῦt consisté à laisser subsister les monnaies seigneuriales, en permettant aux populations de se servir, à leur choix, des espèces qui leur auraient paru les meilleures. Mais à une époque où le monopole était la loi universelle, personne n’aurait pu évidemment s’aviser d’une telle solution. Les monopoles se faisaient la guerre en vertu de leur nature, et les gros finissaient nécessairement par engloutir les petits. Sous ce rapport, il en devait être du monnayage comme de tout le reste.
Examinons maintenant comment était établi et comment fonctionnait le monopole du monnayage exercé par les rois de France; quel était le mécanisme de ce monopole, et quels en furent les résultats, tant pour le souverain qui l’exploitait que pour les populations qui le subissaient.
Comment s’effectuait le monnayage? Ceux qui avaient besoin de monnaie pour opérer des échanges, faire des prêts, payer des employés, etc., portaient des métaux précieux à l’atelier monétaire [11] , absolument comme ceux qui avaient besoin de [II-108] farine portaient leur grain au moulin seigneurial, et on rendait aux uns les métaux précieux convertis en monnaie comme aux autres le blé converti en farine, en retenant aux premiers la quantité de métal nécessaire pour couvrir les frais du monnayage et le bénéfice du monétaire, aux seconds, la quantité de grain nécessaire pour couvrir les frais de la mouture et le bénétice du meunier.
De même qu’il fallait mesurer le blé qui était apporté au moulin et la farine qui en était tirée, il fallait mesurer aussi les métaux précieux apportés au monnayage et la monnaie qui en était fabriquée. Ce dernier mesurage exigeait l’emploi de deux sortes d’étalons, l’un pour la quantité, l’autre pour la qualité ou le degré de pureté.
On se servait pour peser les métaux précieux et les monnaies [II-109] du même étalon qui était employé pour peser toutes choses, c’est à dire de la livre. Seulement, la division adoptée pour les métaux précieux était plus étendue que celle dont on se servait pour le commerce des autres marchandises, à cause de la supériorité de leur valeur [12] .
Quant à la qualité ou au degré de finesse du métal, on l’évaluait en prenant pour type le métal lui-mème dans son état d’entière pureté. On établit 12 degrés de finesse ou de pureté pour l’argent, auxquels on donnait le nom de deniers de fin ou simplement de deniers. L’argent fin était à 12 deniers, avec 1/12e d’alliage à 11 deniers, etc. L’or ayant une valeur beaucoup plus grande, on estimait sa pureté au moyen d’une échelle de [II-110] 24 degrés, nommés carats, lesquels étaient subdivisés en 32es. L’or pur était dit à 24 carats.
On pesait donc les métaux précieux qui étaient apportés aux ateliers de monnayage pour connaître leur quantité, et on les essayait pour s’assurer de leur qualité ou de leur degré de pureté. On les taillait ensuite en pièces de monnaie dont le poids et le degré de pureté étaient déterminés par des ordonnances, et l’on délivrait ces pièces à qui de droit, en retenant une certaine partie du métal ou des pièces frappées pour le prix de la façon ou la traite. On comprenait sous cette dénomination de traite les frais de fabrication ou le brassage et le bénéfice du monétaire ou le seigneuriage. On avait fini par compter en marcs ou demi-livres, le poids des métaux précieux à l’état de lingots ou façonnés en monnaie, parce que, selon toute apparence, la demi-livre ou le marc s’accommodait mieux à l’usage que la livre elle-même. Le marc contenait 8 onces et se subdivisait en 4,608 grains.
Cependant, il ne suffisait point de mesurer la quantité et la qualité des métaux précieux et des monnaies, il fallait encore mesurer leur valeur en fixant la monnaie sur un étalon aussi peu variable que possible. Cet étalon que les Romains léguèrent à leurs successeurs consista au commencement du moyen âge dans la valeur d’une livre d’argent pur. On n’est pas d’accord sur le poids de cette livre. Cependant, il paraît bien établi qu’elle était la même que la livre servant au pesage, laquelle consistait, sous la domination romaine, en un poids de 6,144 grains équivalant à 326 grammes. Un écrivain spécial M. Guerard affirme que cette livre monétaire fut augmentée vers l’an 779 et portée à 7,680 grains ou 407 grammes 92/100. D’après M. Guerard, la livre servant d’étalon monétaire aurait [II-111] donc consisté, à dater de 779, dans la valeur d’un poids d’argent pur de 7,680 grains ou 407 grammes 92/100. On la divisait en sols vingt et chaque sol en 12 deniers.
Une livre d’argent pur, divisée en vingt parties, nommées sols et subdivisée en 240 autres parties ou deniers, tel était, en résumé, l’étalon monétaire primitif de l’ancien régime. Cet étalon qui portait le nom de monnaie de compte, parce qu’il servait à mesurer ou à compter la valeur de toutes choses, y compris celle des métaux précieux et de la monnaie elle-même, était parfaitement distinct de la monnaie réelle. On ne frappait point, en effet, comme paraissent l’avoir cru certains écrivains, des monnaies d’une livre, d’un vingtième ou d’un deux cent quarantième de livre. A la fin de la domination romaine, par exemple, on fabriquait des espèces d’argent, dout on taillait 60 dans une livre pesant d’argent pur, et des pièces d’or, dont on taillait 72 dans une livre d’or pur. Comme les Romains avaient fini par adopter le système du monnayage gratuit, après avoir abusé de l’autre, le monétaire rendait à qui lui apportait une livre d’argent, 60 pièces d’argent pesant une livre. Cela étant, quelle devait être la valeur de chacune de ces pièces? Elle ne pouvait évidemment dépasser celle du métal dont la pièce était fabriquée nitomber au dessous. Si elle l’avait dépassée, on aurait, en effet, apporté du métal aux hôtels des monnaies jusqu’à ce que la valeur du métal monnayé fῦt tombé au niveau de celle du métal non monnayé; si elle était tombée au dessous, on aurait cessé d’apporter du métal au monnayage, on aurait même fondu la monnaie jusqu’à ce que l’équivalence se fῦt encore rétablie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, en Angleterre, la valeur de la livre sterling monnayée sous forme de souverain ne peut jamais différer de celle de la livre sterling en métal, servant d’étalon monétaire.
[II-112]
Des espèces taillées à raison de 60 dans la livre d’argent devaient donc valoir  ou 1/3 de sol ou 4 deniers, ni plus ni moins. Quant aux espèces d’or taillées à raison de 72 dans la livre d’or, elles valaient, au témoignage des historiens, 12 pièces d’argent ou 4 sols; mais l’or n’ayant point avec l’argent un rapport de valeur invariable, il y a apparence qu’elles valaient tantôt un peu plus, tantôt un peu moins. Quoi qu’il en soit, si une pièce d’or, taillée à raison de 72 à la livre valait 12 pièces d’argent taillées à raison de 60, cela établissait le rapport de valeur entre l’or et l’argent de 14 2/5 à 1, autrement dit, cela signifiait qu’une livre pesant d’or valait 14 2/5 livres pesant d’argent.
ou 1/3 de sol ou 4 deniers, ni plus ni moins. Quant aux espèces d’or taillées à raison de 72 dans la livre d’or, elles valaient, au témoignage des historiens, 12 pièces d’argent ou 4 sols; mais l’or n’ayant point avec l’argent un rapport de valeur invariable, il y a apparence qu’elles valaient tantôt un peu plus, tantôt un peu moins. Quoi qu’il en soit, si une pièce d’or, taillée à raison de 72 à la livre valait 12 pièces d’argent taillées à raison de 60, cela établissait le rapport de valeur entre l’or et l’argent de 14 2/5 à 1, autrement dit, cela signifiait qu’une livre pesant d’or valait 14 2/5 livres pesant d’argent.
Si la monnaie avait continué d’être ainsi étalonnée sur le métal, si, en échange d’une livre d’argent apportée au monnayage, on avait toujours délivré une livre d’espèces monnayées, il est évident, d’une part, que la valeur des espèces n’aurait jamais pu différer de celle du métal dont elles étaient faites, d’une autre part, que l’étalon monétaire n’aurait point subi d’autres variations que celles de la valeur du métal, et qu’en 1789 la livre monétaire aurait, en conséquence, consisté encore dans la valeur d’une livre pesant d’argent pur comme à la fin de la domination romaine.
Or, si nous étudions l’histoire des monnaies françaises, nous nous convaincrons, en premier lieu, qu’à partir de la fin de la domination romaine, la valeur des espèces a toujours différé d’une manière plus ou moins sensible de celle du métal qui leur servait d’étoffe, et que cette différence était parfois énorme; en second lieu que la valeur de l’étalon monétaire s’est écartée davantage de siècle en siècle de celle de la livre d’argent fin; que si la livre d’argent métal a baissé de valeur à certaines [II-113] époques, notamment lors de la découverte de l’Amérique, la livre monétaire qui en était, à l’origine, la reproduction, a baissé dans une proportion infiniment plus considérable; bref, que ces deux livres qui se confondaient à l’origine ont fini par n’avoir plus ensemble de commun que le nom.
Étudions successivement ces deux phénomènes qui ont, entre cux, comme nous le verrons, les relations de cause et d’effet. Recherchons d’abord sous l’influence de quelle cause la valeur des espèces pouvait différer de celle du métal qui leur servait d’étoffe.
Nous avons dit que les Romains, comme aujourd’hui les Anglais, avaient fini par adopter le régime du monnayage gratuit, autrement dit par reporter sur l’impôt les frais du monnayage, d’où cette conséquence qu’il ne pouvait exister aucune différence entre la valeur du métal monnayé et celle du métal non monnayé. Mais ce système ne tarda pas à être abandonné, et les souverains ou les seigneurs barbares qui s’étaient attribué le monopole du monnayage s’efforcèrent d’en tirer les profits les plus élevés possibles. De quelle manière pouvaient-ils bénéficier sur ce monopole? Évidemment, en se faisant payer un prix de façon pour la monnaie au lieu de monnayer gratis, en établissant une traite sur les monnaies, ce qu’ils firent. Or, quelle était la conséquence de l’établissement de cette traite destinée à couvrir les frais de fabrication de la monnaie ou le brassage et de procurer un bénéfice au monétaire ou un seigneuriage? C’était de créer une différence entre la valeur du métal monnayé et celle du métal non monnayé, différence qui devait aller croissant à mesure que la traite s’élevait davantage. Supposons que l’on apportât à la monnaie une livre d’argent fin et que le monétaire après avoir fabriqué avec cette quantité de matière première [II-114] 60 pièces d’argent, en retint pour le prix de façon ou la traite 3 pièces, il est évident que les 57 pièces qu’il délivrait devaient valoir une livre d’argent fin. En effet, si elles avaient valu moins d’une livre, on aurait cessé d’apporter du métal au monnayage, si elles avaient valu plus d’une livre, on en aurait apporté au contraire jusqu’à ce que la différence ou la prime sur la monnaie eῦt disparu. Ainsi donc, sauf l’action de certaines causes perturbatrices que nous examinerons, la valeur de la monnaie devait différer de celle de l’étoffe métallique dont elle était fabriquée, du montant de la traite ou prix de façon que le souverain, investi du monopole du monnayage, était le maître de fixer à sa guise [13] .
[II-115]
Comment s’exprimait ou se traduisait cette différence? Nous la trouvons traduite dans les tables monétaires de l’ancien [II-116] régime par la différence constante quoique fort inégale selon les époques que ces tables indiquent entre le prix du marc d’argent [II-117] non monnayé et celui du marc d’argent monnayé. On recevait aux hôtels des monnaies un marc d’argent fin à un prix déterminé [II-118] et on rendait ce même marc taillé et façonné en pièces de monnaie à un prix plus élevé de tout le montant de la traite [II-119] qu’il convenait au souverain de prélever. La valeur de chaque pièce contenait donc: 1° la valeur intrinsèque du métal; 2° le prix de façon, prix de monopole, porté quelquefois à un taux excessif, et qui formait la différence existant entre la valeur de l’étoffe métallique de la pièce et la valeur pour laquelle cette pièce était émise [14] .
Le second phénomène que nous avons à étudier, c’est la dégradation successive de l’étalon monétaire. Constatons d’abord dans quelle mesure cette dégradation s’est opérée.
[II-120]
Si l’étalon monétaire était demeuré invariable, s’il avait continué d’être, dans le cours des siècles, la valeur d’une livre pesant d’argent fin, il est évident que la valeur de l’argent fin exprimée en livres n’aurait pas varié non plus. Ainsi, l’argent se vendant par marcs de 8 onces ou 4,608 grains, le prix du marc évalué en livres aurait dù être et demeurer invariablement de 4608/7680 (en admettant pour le poids de la livre monétaire l’estimation de M. Guerard qui la porte à 7,680 grains, à partir de l’an 779) soit de 6/10 de livre, c’est à dire de 12 sous, la livre monétaire étant, comme on sait, divisée en 20 sous. Or, si nous consultons les tables des prix du marc d’argent fin depuis l’an 1258, époque où l’on a commencé à les relever, nous trouvons qu’à cette époque déjà, le marc d’argent fin valait liv. 2. 14s. 7d. ce qui signifie que depuis l’an 779, dans l’espace de 500 ans environ, il avait haussé relativement à la livre monétaire dans la proportion approximative de 9 à 2, ou, ce qui revient au même, que la livre monétaire s’était dépréciée dans la proportion de 9 à 2 relativement à l’argent fin; qu’une livre monétaire en 1258 ne représentait plus que les 2/9es de la valeur d’argent fin qu’elle possédait en 779. A dater de 1258 jusqu’en 1789, la livre monétaire se déprécie dans une proportion bien plus considérable encore. Elle s’abaisse de siècle en siècle de telle façon que le marc d’argent qui, d’après l’estimation de M. Guerard, aurait dῦ valoir 12s en 779, qui valait liv. 2. 14. 7 en 1258 s’était élevé à liv. 54. 10 en 1789 et que le marc d’or avait monté en proportion.
A quoi il faut ajouter que la valeur de l’or et de l’argent dans le même intervalle, et, en particulier, dans les trois derniers siècles, n’étant pas demeurée stationnaire; que cette valeur ayant baissé considérablement à la suite de la découverte de [II-121] l’Amérique, la valeur de la livre, étalon monétaire, ne s’était point amoindrie seulement dans la proportion de liv. 2. 14. 7 à 54.10 pour un marc, de 1258 à 1789, mais encore, en sus, de tout le montant de la dépréciation que le métal avait subie dans cet intervalle.
L’extrait suivant des tables annexées à l’Essai sur les monnaies de Dupré de Saint-Maur nous montrera, d’une part, à combien s’élevèrent à différentes époques les traites sur les monnaies; d’une autre part, dans quelle mesure se dégrada successivement, à travers une longue série de fluctuations, les unes en hausse, les autres en baisse, la livre servant d’étalon monétaire.
[II-122]
[II-123]
| Prix du marc d'argent fin, reçu aux monnaies comme matière. | Valeur du marc d'argent fin monnayé. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉES. | liv. | sous | den. | ANNÉES. | liv. | sous | den. | |
| 1295 | 2 | 18 | " | 1295 | 3 | 8 | 3 | |
| 1304 | 6 | 12 | " | 1304 | 8 | 7 | 1 1/3 | |
| 1327 | 5 | " | " | 1327 | 6 | " | " | |
| 1330 | 2 | 15 | 6 | 1330 | 3 | " | " | |
| 1338 | 4 | 12 | " | 1338 | 6 | " | " | |
| 1339 | 5 | 10 | " | 1339 | 7 | 10 | " | |
| — | 6 | 5 | " | — | 7 | 10 | " | |
| 1340 | 8 | 4 | " | 1340 | 10 | 10 | " | |
| — | 9 | 4 | " | — | 12 | " | " | |
| 1342 | 11 | " | " | 1442 | 15 | " | " | |
| 1343 | 3 | 4 | " | 1343 | 3 | 15 | " | |
| 1348 | 6 | " | " | 1348 | 9 | " | " | |
| 1350 | 4 | 15 | " | 1350 | 6 | " | " | |
| — | 6 | 18 | " | — | 9 | " | " | |
| ANNÉES. | liv. | sous | den. | ANNÉES. | liv. | sous | den. | |
| 1351 | 7 | 8 | " | 1351 | 12 | " | " | |
| — | 8 | 10 | " | — | 13 | 10 | " | |
| 1352 | 5 | 12 | " | 1352 | 10 | " | " | |
| 1355 | 12 | 10 | " | 1355 | 20 | " | " | |
| 1358 | 6 | 15 | " | 1358 | 8 | " | " | |
| 1359 | 9 | " | " | 1359 | 15 | " | " | |
| — | 16 | 4 | " | — | 24 | " | " | |
| — | 29 | 8 | " | — | 45 | " | " | |
| — | 53 | 17 | 6 | — | " | " | " | |
| — | 72 | 16 | " | — | " | " | " | |
| — | 102 | " | " | — | " | " | " | |
| — | 11 | " | " | — | 12 | " | " | |
| 1360 | 11 | " " | 1360 | 16 | " | " | ||
| — | 4 | 18 | " | — | 6 | " | " | |
| 1389 | 6 | " | " | 1389 | 6 | 15 | " | |
| 1413 | 7 | " | " | 1413 | 11 | 14 | quot; | |
| 1417 | 9 | " | " | 1417 | 15 | " | " | |
| 1418 | 16 | 10 | " | 1418 | 24 | " | " | |
| 1420 | 26 | " | " | 1420 | 40 | " | " | |
| 1423 | 6 | 18 | " | 1423 | 7 | 10 | " | |
| 1447 | 8 | 10 | " | 1447 | 9 | " | " | |
| 1467 | 9 | 5 | " | 1467 | 11 | 5 | " | |
| 1483 | 10 | " | " | 1483 | 22 | " | " | |
| 1502 | 11 | " | " | 1502 | 11 | 10 | " | |
| 1519 | 12 | 15 | " | 1519 | 13 | " | " | |
| 1563 | 15 | 15 | " | 1563 | 16 | 13 | 4 | |
| 1602 | 20 | 5 | 4 | 1602 | 22 | " | " | |
| 1636 | 23 | 10 | " | 1636 | 27 | 10 | " | |
| 1692 | 30 | " | " | 1692 | 31 | 12 | 3 | 5/11 |
| 1701 | 32 | 16 | " | 1701 | 32 | 16 | 7 | 7/11 |
| — | " | " | " | — | 36 | 19 | 3 | 3/11 |
| ANNÉES. | liv. | sous | den. | ANNÉES. | liv. | sous | den. | |
| 1703 | 34 | " | " | 1703 | 34 | 0 | 10 | 10/11 |
| 1712 | 42 | 10 | 10 10/11 | 1712 | 43 | 12 | 8 | 8/11 |
| 1715 | 34 | 18 | 2 | 2/11 | 1715 | 43 | 12 | 3 |
| 1718 | " | " | " | 1718 | 65 | 9 | 1 | 1/11 |
| 1719 | 50 | 12 | 4 4/11 | 1719 | 63 | 5 | 5 | 5/11 |
| 1720 1er janvier | " | " | " | 1720 1er janvier | 61 | 1 | 9 | 9/11 |
| — 22 " | " | " | " | — 22 " | 65 | 9 | 1 | 1/11 |
| — 3 février | " | 60 | " | — 3 février | 65 | 9 | 1 | 1/11 |
| — mars | " | 80 | " | — | " | " | " | |
| — 5 " | " | " | " | — 5 mars | 87 | 5 | 5 | 5/11 |
| — " | " | " | " | — " | 98 | 3 | 7 | 7/11 |
| — 1er avril | " | " | " | — 1eravril | 76 | 7 | 3 | 3/11 |
| — 1er mai | " | " | " | — 1ermai | 70 | 18 | 2 | 2/11 |
| — 29 " | " | " | " | — 29 " | 90 | " | " | |
| — 1er juillet | " | " | " | — 1er juillet | 81 | 16 | 4 | 4/11 |
| — 16 " | " | " | " | — 16 " | 73 | 12 | 8 | 8/11 |
| — 30 " | " | " | " | —30 " | 130 | 18 | 2 | 2/11 |
| — 1er septembre | " | " | " | — 1er sept. | 114 | 11 | 9 | 9/11 |
| — 16 " | " | " | " | — 16 " | 98 | 3 | 77 | 7/11 |
| — 24 octobre | " | " | " | — 24 octobre | 85 | 1 | 9 | 9/11 |
| 1720 1er décembre | " | " | " | 1720 1er déc. | 68 | 14 | 6 | 6/11 |
| 1723 août | 74 | 3 | 7 7/11 | 1723 août | 75 | 5 | 5 | 5/11 |
| 1724 4 février | " | " | " | 1724 4 février | 67 | 1 | 9 | 9/11 |
| — 27 mars | 52 | 9 | 1 1/11 | — 27 mars | 54 | 10 | 10 | 10/11 |
| — sept. | 44 | 8 | " | — sept. | 43 | 12 | 8 | 8/11 |
| 1726 janvier | 37 | 1 | 9 9/11 | 45 | 5 | 5 | ||
| Du 26 mai 1726 | " | " | " | Du 26 mai 1726 | ||||
| Jusqu'en mars 1746 | 51 | 3 | 3 3/11 | Jusqu'en mars 1746 | 54 | 6 | 6 | 6/11 |
Cette table qui résume les variations monétaires de l’ancien régime accuse deux faits essentiels.
[II-124]
C’est en premier lieu une différence qui s’élève parfois jusqu’à près de moitié entre la valeur du marc d’argent fin non monnayé et celle de l’argent fin monnayé.
C’est, en second lieu, une dégradation successive quoique non continue et fort irrégulière dans la valeur de l’étalon monétaire. On voit, en effet, le prix du marc d’argent fin monter jusqu’à 102 liv. comme en 1355, puis descendre jusqu’à 4 liv. 18, puis monter de nouveau et descendre encore; mais, à travers ces fluctuations, l’abaissement de la valeur de l’étalon ne se manifeste pas moins d’une manière progressive [15] .
[II-125] Comment le premier de ces deux phénomènes a engendré le second, voilà ce que nous avons encore à examiner.
[II-126]
[II-127]
CINQUIÈME LEÇON↩
la monnaie sous l’ancien rÉgime (suite)
Comment la valeur de la monnaie pouvait différer de celle du métal. — Exemple de la monnaie de billon. — Que cette différence, sans engendrer nécessairement la dépréciation de l’étalon, le rendait possible. — Des causes de la limitation naturelle des profits du monnayage. — Limitation du débouché. — Longévité des monnaies. — Des opérations sur les monnaies. — Que ces opérations se résumaient dans la levée d’un impôt extraordinaire sur la circulation. — Procédés employés pour la levée de cet impôt. — Décri des anciennes monnaies; monnayage forcé des nouvelles. — Réquisition des métaux précieux, de la vaisselle, etc. — Défense de billonner les anciennes espèces; prohibition à la sortie des métaux précieux, lois somptuaires. — Pourquoi la levée d’un impôt sur la circulation avait pour conséquence ordinaire l’affaiblissement de l’étalon. — Conséquences de cet affaiblissement. — Comment les populations essayaient de s’y soustraire. — Refus d’accepter la nouvelle monnaie. — Adoption de l’étalon métal. — Concession d’un autre impôt, le fouage ou les aides. — Comment on rétablissait l’étalon monétaire après une période d’affaiblissement. — Époques des grandes perturbations monétaires, occasionnées par la levée de l’impôt extraordinaire sur la circulation. — Comment le monopole du monnayage était géré dans les temps ordinaires. — L’affermage. — La régie. — Causes perturbatrices qui agissaient alors pour affaiblir l’étalon. — La contrefaçon des monnaies et le faux monnayage. — Les espèces étrangères. — La mau [II-128] vaise proportion établie entre l’or et l’argent. — L’excès de la monnaie de billon. — Les pièces usées ou rognées. — Progrès de la pratique du monnayage. — Supériorité de la monnaie française au XVIIIe siècle, d’après Jacques Steuart. — Montant de l’affaiblissement de l’étalon depuis la domination romaine. — Résumé.
Achevons d’abord d’éclaircir, au moyen d’une comparaison avec le système monétaire moderne, un point essentiel, savoir comment la valeur de la monnaie pouvait dépasser quelquefois, dans une proportion considérable, celle du métal dont les espèces étaient faites.
Si, en Angleterre, le monnayage est gratuit au moins pour la monnaie d’or, il en est autrement en France et dans la plupart des autres pays. En France, il en coῦte fr. 1,50 pour faire monnayer un kil. d’argent. Avec ce kil. de métal à 9/10 de fin, on fabrique 40 pièces de 5 fr. pesant chacune 25 grammes et valant 200 fr. Mais sur cette somme, on retient fr. 1,50 pour le monnayage, soit 75 c. par 100 fr. ou 3/4 p. c. D’où il résulte que la valeur du franc monnayé est supérieure de 3/4 p. c. à celle de l’étoffe métallique dont il est fabriqué. Ce qui établit ainsi le prix de l’argent non monnayé, exprimé en francs:
Un kilogramme d’argent + 7 1/2 gr. (étoffe métallique de fr. 1,50) + 0,0075 (prix de façon de fr. 1,50) = 200 fr.
Ou ce qui revient au même:
Un kilogramme d’argent = fr. 200 — fr. 1,50 = fr. 198,50.
Autrement dit encore, on reçoit le kil. d’argent non monnayé pour fr. 198,50 et on le rend monnayé pour fr. 200, en gardant pour le prix de façon ou la “traite” fr. 1,50, comme sous l’ancien régime, en 1327, par exemple, on rece [II-129] vait le marc d’argent non monnayé pour 5 liv. et on le rendait monnayé ’pour 6 liv., en gardant à titre de traite ou prix de façon, la différence soit 1 liv. — Sous le régime nouveau, le prix de façon ou la traite est extrêmement faible, mais il pourrait être évidemment beaucoup plus fort. Supposons, par exemple, qu’on le porte de fr. 1,50 par kil. à fr. 15, qu’en résultera-t-il? C’est que le prix du kil. d’argent non monnayé s’abaissera à fr. 185, tandis que celui de l’argent monnayé demeurera à fr. 200; car on ne rendra plus que fr. 185 au lieu de fr. 198,50 à qui apportera un kil. d’argent au monnayage. Mais ces fr. 185 n’en auront pas moins exactement la même valeur que les fr. 198,50, et le franc monnayé, au lieu de valoir seulement 0,75 c. pour 100 fr. ou 0,0075 en sus de son étoffe métallique vaudra 7 1/2 p. c. de plus. Pour ne rien changer à la valeur du franc, tout en augmentant son prix de façon, on pourrait indifféremment diminuer la quantité de l’étoffe métallique des pièces (affaiblissement du poids) jusqu’à concurrence de l’augmentation du prix du monnayage ou en altérer la qualité (affaiblissement du titre) en augmentant la proportion de l’alliage de cuivre.
En admettant donc que les gouvernements modernes voulussent augmenter le produit du monopole du monnayage, en élevant le prix de fabrication de la monnaie, il pourrait arriver de nouveau, comme sous l’ancien régime, que le kil. d’argent monnayé valῦt un quart ou la moitié de plus que le kil. d’argent non monnayé. Cependant, nous avons quelque peine à accepter une telle hypothèse. Nous sommes si accoutumés à regarder le franc d’argent comme l’équivalent de son étoffe métallique que nous ne concevons pas qu’il puisse valoir davantage, et l’école métallique enseigne comme un article de foi qu’il serait impossible [II-130] au gouvernement d’attribuer à une pièce de 50 c. la valeur de 1 fr. Il en serait ainsi, sans doute, si le gouvernement, en déclarant qu’à l’avenir 50 c. vaudront 1 fr., c’est à dire qu’ils seront l’équivalent de 5 gr. d’argent à 9/10es de fin, quoiqu’ils n’en contiennent que 2 1/2, se mettait à monnayer gratis pour tout venant de ces francs nouveaux. Alors, en effet, on ne manquerait pas d’en faire monnayer jusqu’à ce que leur valeur monétaire fῦt tombée au niveau de leur valeur métallique; mais, en admettant que le gouvernement, comme cela se pratiquait sous l’ancien régime, après avoir déclaré qu’à l’avenir la pièce de 50 c. vaudrait 1 fr. retînt, pour son prix de façon, 1/2 kil. à tous ceux qui lui apporteraient un kil. d’argent à monnayer, et fabriquât avec le 1/2 kil. restant 200 pièces d’un franc pesant 2 1/2 grammes au lieu de 5, il est clair que ces nouveaux francs continueraient à valoir autant que les anciens, quoique pesant moitié moins, et qu’alors que le kil. d’argent non monnayé se payerait fr. 200 aux hôtels des monnaies, le kil. d’argent monnayé en vaudrait 400.
Veut-on un fait patent à l’appui de cette hypothèse, que l’on considère la monnaie de cuivre ou de billon. Les pièces de cuivre ou de billon ont une valeur monétaire double environ de leur valeur métallique, ce qui signifie qu’un kil. de cuivre s’achète aux hôtels des monnaies moitié moins cher qu’il ne se revend monnayé. Comment cela se peut-il? Cela se peut, parce que le gouvernement investi à la fois du monopole de la fabrication et de l’émission du billon, en règle l’émission de manière à faire accepter pour 5 centimes des pièces qui contiennent seulement une valeur de 2 c. de métal. Mieux encore. Il y a quelque temps, on a substitué en France à l’ancienne monnaie de cuivre une monnaie de bronze plus légère, contenant [II-131] une valeur moindre en étoffe métallique. Qu’est-il arrivé? Le nouveau billon a-t-il valu moins que l’ancien, de toute la différence existant entre la valeur de chacune des deux étoffes métalliques? En aucune façon. Il a valu, au contraire, un peu plus, et voici pourquoi. C’est que l’ancien billon ayant été émis en quantité surabondante subissait, en beaucoup d’endroits, une perte relativement à la monnaie d’argent. L’émission du nouveau billon, ayant été mieux proportionnée à l’état de la demande, ne subit point cette perte, ensorte qu’il se trouva posséder une valeur monétaire supérieure à celle de l’ancien, bien que sa valeur métallique fῦt moindre [16] .
En résumé, l’établissement d’une traite ou prix de façon de la monnaie avait pour première conséquence de faire naître une différence égale au montant de la traite entre la valeur du métal non monnayé et celle du métal monnayé, et cette différence se manifestait par l’excédant du prix du marc monnayé sur le prix du marc de métal fin. Il suffisait, comme on l’a vu, de soustraire du prix du marc monnayé celui du marc non monnayé pour connaître le montant de la traite ou prix de façon de la monnaie, comme il suffit encore aujourd’hui de déduire de la valeur d’un kil. de cuivre ou de bronze monnayé, par exemple, celle du cuivre métal pour connaître le prix auquel le gouvernement se fait payer la façon de sa monnaie de billon.
Nous voilà donc pleinement édifiés sur la possibilité d’établir une différence entre la valeur de la monnaie et celle de [II-132] l’étoffe métallique dont la monnaie est faite. Sous l’ancien régime, à partir de la fin de la domination romaine, cette différence existait, tantôt faible, tantôt forte, sur toutes les monnaies, comme, au surplus, elle existe encore de nos jours, faible sur les monnaies d’or et d’argent, forte sur la monnaie de billon.
Cette différence entre la valeur monétaire des espèces et leur valeur métallique a engendré, comme nous allons le démontrer, la dépréciation de l’étalon monétaire. Cependant, peut-on dire que la dépréciation de l’étalon ait été une conséquence nécessaire de l’établissement d’une traite sur les monnaies? En aucune façon. Si, d’une part, les souverains étaient demeurés maîtres absolus du marché monétaire; si, d’une autre part, ils s’étaient bornés à monnayer pour le compte du public, en ayant soin toutefois de retirer de la circulation leurs espèces à mesure qu’elles s’usaient, ils auraient pu porter leurs traites à un taux considérable, sans qu’il en résultât aucun amoindrissement dans la valeur de la livre, servant d’étalon monétaire, comme aujourd’hui on pourrait, dans les mêmes conditions, augmenter le prix de façon des pièces de 5 francs en réduisant d’autant leur poids ou leur titre, ou bien encore le prix de façon des pièces de 5 centimes de cuivre, de bronze ou de nickel, sans diminuer en rien la valeur du franc. Il suffirait pour cela que le gouvernement se bornât à percevoir en métal le montant des frais de fabrication de la monnaie, en évitant d’ajouter, par le monnayage et la mise en circulation de cette quantité de métal, à l’approvisionnement monétaire; qu’en admettant par exemple qu’on lui apportât un kil. d’argent à monnayer, et qu’il en prît la moitié pour ses frais de fabrication, il revendit cette moitié sous forme de métal. Dans ce cas, les francs de 2 1/2 grammes [II-133] fabriqués avec l’autre 1/2 kil. vaudraient tout autant que s’ils pesaient, comme aujourd’hui, 5 grammes. Car s’ils valaient moins, on se garderait bien de continuer à apporter du métal au monnayage.
Mais si l’existence d’une différence entre la valeur monétaire et la valeur métallique des espèces n’engendre point nécessairement une dépréciation artificielle de l’étalon (et par dépréciation artificielle nous entendons celle qui ne provient point du fait de la baisse de la valeur du métal dont l’étalon est tiré), elle la rend possible, et, trop souvent aussi, inévitable.
Les souverains étant investis du monopole du monnayage devaient, surtout aux époques où ils étaient pressés par des besoins d’argent, s’efforcer d’en tirer un maximum de revenu. Or, l’importance de ce revenu dépendait de l’étendue du débouché ouvert à l’instrument de la circulation, et ce débouché était naturellement limité, à la fois dans l’espace et dans le temps.
Dans ’espace. Le débouché de la monnaie se réduisait, sauf quelques rares exceptions, au marché intérieur, que chaque souverain s’efforçait de réserver aux produits de son monnayage. Or les besoins de ce marché limité étaient limités aussi: ils consistaient dans la quantité de monnaie nécessaire au service des échanges et au service des épargnes.
Aussi longtemps que subsista le régime du servage, les redevances agricoles se payèrent en travail ou en denrées, c’est à dire sans l’intermédiaire de la monnaie. Une foule d’autres prestations auxquelles il faut ajouter la plupart des impôts se payaient également en nature, ce qui restreignait d’autant le débouché monétaire. En revanche, l’absence presque complète des procédés et des instruments de crédit rendait l’intervention [II-134] de la monnaie indispensable dans une foule de transactions pour lesquelles on peut aujourd’hui s’en passer [17] .
Quant aux épargnes, elles auraient pu en exiger une quantité relativement plus considérable que de nos jours, car le défaut de placements sῦrs et avantageux obligeait les gens économes à thésauriser; mais toutes les monnaies n’étaient pas également propres à cet usage: on ne thésaurisait volontiers de la monnaie que lorsqu’elle renfermait la presque totalité de sa valeur en métal et ne courait, en conséquence, qu’un faible risque de dépréciation, c’est à dire lorsqu’on se trouvait sous le régime de la monnaie forte. Quand il n’y avait pas de monnaie forte, on préférait thésauriser de la vaisselle, des bijoux, des pierres précieuses, etc.
[II-135]
La monnaie n’était donc un instrument indispensable que pour un nombre assez limité d’échanges, accomplis ceux-là principalement d’un lieu à un autre, ceux-ci d’un temps à un autre, et cette somme d’échanges ne s’accroissait que fort lentement.
A quoi il convient d’ajouter que le débouché de l’entrepreneur de monnayage se trouve encore et principalement borné par la durabilité de l’instrument qu’il fournit à la circulation. La monnaie s’use peu surtout lorsque la circulation en est lente, et l’on n’a, en conséquence, besoin de la renouveler qu’à des intervalles fort éloignés. D’où il résulte que si l’on peut réaliser de gros bénéfices en approvisionnant de monnaie un marché qui en est dépourvu, il en est autrement lorsque ce [II-136] marché est saturé, lorsque la population possède toute la quantité de monnaie nécessaire au service ordinaire des échanges et des épargnes. Alors, en effet, on ne peut plus frapper, d’année en année, que les quantités supplémentaires réquises: 1° pour subvenir à l’accroissement annuel de la quantité des échanges et des épargnes; 2° pour remplacer les pièces usées par des pièces neuves. En vertu de sa nature même, le monopole du monnayage est donc assez peu productif. Il l’est moins, par exemple, que celui du sel ou du tabac. Car l’approvisionnement du sel ou du tabac doit être incessamment renouvelé, au grand profit du monopoleur, tandis que celui de la monnaie ne doit l’être qu’à de longs intervalles [18] .
Mais si, par sa nature, le monopole du monnayage est peu [II-137] productif, on peut en augmenter artificiellement la productivité. De quelle manière?
S’il ne dépend pas, — ainsi que nous venons de nous en convaincre, — des détenteurs du monopole du monnayage, d’augmenter à volonté l’étendue du débouché ouvert à la monnaie, ils peuvent en revanche, hâter le terme naturel de la mortalité des espèces, en les démonétisant pour les remplacer par d’autres, et augmenter ainsi leurs profits d’autant plus qu’ils renouvellent plus fréquemment l’approvisionnement monétaire. En admettant que la vie moyenne des monnaies fῦt de vingt ans, on pourrait, en la réduisant à deux ans, par des démonétisations successives, décupler les profits du monnayage. Aussi est-ce dans l’emploi de ce procédé que se résument les [II-138] opérations que faisaient les souverains sur les monnaies, quand des besoins urgents les obligeaient à demander au monopole du monnayage un supplément extraordinaire de ressources. Ils vidaient alors, aussi complétement et aussi rapidement que possible, le marché monétaire pour le remplir de nouveau avec une monnaie plus faible de poids ou d’un titre inférieur.
[II-139]
Ces opérations sur les monnaies ont été parfaitement décrites par les anciens écrivains, notamment par Henry Poullain, et elles n’étaient point, pour le dire en passant, aussi absurdes que le prétendent les modernes. Elles consistaient dans un ensemble de mesures convergeant toutes vers un même but, savoir la levée d’un impôt extraordinaire sur les consommateurs de monnaie, et elles attestent bien plus l’habileté fiscale sinon l’honnêteté scrupuleuse de ceux qui les mettaient en œuvre que leur ignorance. Le problème à résoudre consistait à rendre cet impôt extraordinaire aussi productif, et à le faire rentrer aussi promptement que possible. Pour obtenir le premier résultat, il fallait expulser du marché l’ancien approvisionnement ou mieux encore le racheter à vil prix et vendre cher le nouveau. Pour obtenir le second résultat, de manière à pourvoir en temps utile aux besoins du trésor aux abois, il fallait obliger les détenteurs de l’ancienne monnaie à l’échanger, à bref délai, contre la nouvelle, si dommageable, si désastreux même que pῦt être pour eux cet échange.
Comment s’y prenaient les financiers de l’ancien régime pour arriver à cette double fin?
Ils émettaient une nouvelle monnaie dont la valeur intrinsèque était diminuée par l’affaiblissement du poids ou du titre des espèces, tandis que sa valeur monétaire était maintenue au niveau de l’ancienne, ou bien dont la valeur monétaire était augmentée, tandis que sa valeur intrinsèque demeurait la même. En admettant qu’ils parvinssent à substituer dans la circulation cette monnaie affaiblie à la monnaie existante, il devait en résulter pour le souverain un gain égal à la différence de la valeur intrinsèque des deux monnaies, moins les frais de remonétisation. Plus cette différence était forte, plus le bénéfice était grand.
[II-140]
Mais comment obliger le public à se dessaisir de l’ancienne monnaie pour la remplacer par une nouvelle, dont la valeu intrinsèque était plus faible, qui se trouvait par là même exposée à un risque de dépréciation plus intense, sans compter encore qu’elle était moins propre à certains usages, tels que la capitalisation et les échanges avec l’étranger?
On débutait par prohiber les anciennes espèces, tout en donnant cours forcé aux nouvelles.
On prohibait les anciennes espèces, en défendant aux particuliers d’en faire usage ou même de les garder, en défendant encore aux changeurs de les exposer en vente; en ordonnant enfin à tous ceux qui en étaient détenteurs de les porter, dans un certain délai, aux hôtels des monnaies pour les échanger contre les nouvelles espèces. Cela s’appelait décrier la monnaie.
D’un autre côté, on enjoignait à tous les particuliers, changeurs, etc., de recevoir la nouvelle monnaie au taux fixé par l’ordonnance; on édictait des peines sévères contre ceux qui refusaient de l’accepter à ce taux, et qui établissaient ainsi une différence entre la valeur de la monnaie ancienne et celle de la nouvelle.
Cependant, cette prohibition de l’ancienne monnaie, ce cours forcé donné à la nouvelle ne suffisaient point encore. Lorsque l’ancienne monnaie possédait une forte proportion de valeur intrinsèque, lorsque c’était une monnaie forte, que faisaient les détenteurs? Ils la gardaient malgré la prohibition, plutôt que d’aller l’échanger aux hôtels des monnaies, contre des espèces de moins bonne qualité, ou bien encore plutôt que de s’en servir pour les usages ordinaires. Il se créait ainsi un vide sur le marché monétaire. Ce vide, on se pressait d’autant [II-141] moins de le combler que le risque de dépréciation attaché à la nouvelle monnaie était plus considérable, c’est à dire qu’il existait une différence plus grande entre la valeur intrinsèque ou métallique de cette monnaie et sa valeur monétaire. Les détenteurs de matières propres au monnayage ne se décidaient à les porter aux hôtels des monnaies, où on leur en retenait maintenant une proportion plus forte pour la traite, qu’à la condition de pouvoir se défaire du métal monnayé, assez promptement et avantageusement pour se couvrir de l’augmentation du risque de dépréciation; autrement dit, qu’à la condition de pouvoir le louer moyennant un intérêt plus élevé ou l’échanger contre des produits abaissés de prix. En attendant, le public souffrait de la rareté du numéraire, l’ancienne monnaie se retirant, la nouvelle n’arrivant qu’avec lenteur pour prendre sa place.
Le gouvernement intervenait alors pour activer l’opération, en forçant le monnayage. Il obligeait les particuliers et les changeurs de porter à la monnaie ce qu’ils avaient de métaux précieux soit en barres, soit même en vaisselle ou en bijoux, et le monarque en donnait l’exemple lui-même; en d’autres termes, le gouvernement frappait les métaux précieux de réquisition pour le service de la monnaie [20] .
[II-142]
Quel était le résultat de ce monnayage forcé? C’était évidemment de faire baisser dans une progression rapide, conformément [II-143] à la loi des quantités et des prix, la masse du numéraire en circulation; c’était en même temps de faire hausser samatière [II-144] première métallique, dont l’approvisionnement se trouvait diminué de toute la quantité que l’on avait ainsi [II-145] frappée de réquisition pour la transformer en monnaie; c’était enfin de faire hausser, d’une manière générale, toutes les chosesqui [II-146] s’échangeaient contre de la monnaie, y compris encore les métaux précieux. Sous l’influence de ces phénomènes, unmoment [II-147] venait où la valeur du métal contenu dans les anciennes espèces dépassait la valeur monétaire de ces espèces, [II-148] dépréciées d’ailleurs dans une certaine mesure par la prohibition dont elles étaient frappées, et où l’on avait intérêt à les fondre soit pour les transformer en espèces nouvelles, soit pour les livrer au commerce sous forme de métal.
[II-149]
Pour rendre ceci plus clair, supposons que le gouvernement veuille faire aujourd’hui une opération de ce genre, qu’à partir du 1er janvier 1864, les pièces de 5 fr. actuelles soient démonétisées, et qu’il soit enjoint à leurs détenteurs de les apporter à l’hôtel des monnaies pour les remplacer par des pièces de 10 p. c. inférieures en titre ou en poids, ou bien égales en poids et en titre, mais côtées à 10 p. c. de plus, soit à fr. 3–50. Quelle que pῦt être la rigueur des pénalités comminées contre ceux qui persisteraient à se servir de la monnaie prohibée, peu de gens se présenteraient pour effectuer cet échange, surtout s’il était à craindre que la nouvelle monnaie ne vint promptement à se déprécier. Mais supposons que le gouvernement mette en réquisition le métal chez les changeurs, les orfévres, les particuliers mêmes qui en possèdent des quantités plus ou moins considérables sous forme d’argenterie, de bijoux ou de vaisselle, et qu’il fasse frapper avec le métal obtenu par ce procédé un supplément d’espèces nouvelles, qu’arrivera-t-il? C’est qu’on verra baisser la valeur du métal monnayé dont l’approvisionnement sera augmenté et hausser celle du métal non monnayé dont l’approvisionnement sera diminué. Supposons que la baisse du métal monnayé soit de 1 p. c., et la hausse du métal non monnayé également de 1 p. c., l’étoffe métallique des anciennes pièces de 5 fr. montera de fr. 198,50 par kil. à fr. 202,47. Il y aura donc avantage à les fondre et à les exporter plutôt qu’à s’en servir comme de monnaie, ou, à défaut de pouvoir les fondre et les exporter librement, à les porter aux hôtels des monnaies, en admettant que le gouvernement veuille les payer à un prix convenable. Or, le gouvernement trouverait avantage à payer les 2 p. c. de hausse et au delà, car, avec une quantité de métal provenant de ces anciennes pièces, qui lui coῦterait [II-150] fr. 202,47, il fabriquerait une quantité de monnaie qui lui rapporterait fr. 200 + 10 p. c., soit fr, 220.
C’était donc en provoquant, par une émission forcée de monnaie, une dépréciation de la masse du numéraire en circulation, bien plus encore qu’en prohibant les anciennes espèces et en donnant un cours obligatoire aux nouvelles, que l’on parvenait à expulser les unes de la circulation pour faire place aux autres.
Mais pour porter au maximum les bénéfices de l’opération, comme aussi pour effectuer cette opération aussi rapidement que possible, il ne suffisait pas d’expulser purement et simplement les anciennes espèces; il fallait les obliger à venir se convertir à bref délai en espèces nouvelles. Pour obtenir ce résultat, qu’y avait-il à faire? Il fallait boucher hermétiquement toutes les issues par lesquelles elles auraient pu s’échapper, à l’exception des hôtels des monnaies. Dans ce but, on prenait un ensemble de mesures vexatoires et barbares sans doute, comme le sont au surplus la plupart des mesures fiscales, mais dont l’efficacité était attestée par l’expérience: on défendait de billonner, c’est à dire de fondre ou de déformer les espèces; on prohibait l’exportation de ces mêmes espèces, ainsi que celle des métaux précieux; on défendait aux orfévres d’acheter du métal au dessus du cours des hôtels des monnaies, parfois même d’en acheter; on limitait encore par des lois somptuaires l’emploi des métaux précieux sous forme de vaisselle, d’argenterie ou de bijoux. Lorsque, toutes ces issues étant bouchées autant qu’elles pouvaient l’être, on avait soin de payer pour le marc des anciennes espèces un prix proportionné à la hausse du métal dont elles étaient faites, leurs détenteurs s’empressaient de les porter aux hôtels des monnaies dans les délais fixés par l’ordonnance, et l’opération réussissait.
[II-151]
Il suffisait, comme on l’a vu plus haut, d’une baisse assez faible dans la valeur monétaire des espèces, pour faire sortir le métal de l’ancienne monnaie et l’obliger à entrer dans la nouvelle. Cette baisse aurait pu même n’être que temporaire si l’on avait cessé de forcer le monnayage; si, l’opération de la rentrée de l’ancienne monnaie effectuée, on avait laissé aux particuliers seuls, changeurs, prêteurs, etc., le soin de pourvoir librement à l’approvisionnement du marché. Alors, en effet, malgré l’affaiblissement de la valeur intrinsèque de l’espèce nouvelle, sa valeur monétaire aurait pu se relever au niveau de celle de l’ancienne, puisque la différence était comblée par une augmentation du prix de façon et qu’aucun particulier ne se serait avisé de faire monnayer pour son propre compte, à moins que la valeur monétaire des espèces ne fῦt assez élevée pour couvrir pleinement et la valeur du métal et le prix de façon.
Les opérations qui avaient pour objet la levée d’un impôt extraordinaire sur la circulation, tout en occasionnant une série de fluctuations dans la valeur des espèces, n’impliquaient donc pas nécessairement la dégradation progressive de l’étalon monétaire qui en a été cependant le résultat, pas plus que la substitution du papier-monnaie à la monnaie métallique n’implique nécessairement cette même dégradation. Il aurait pu se faire que les souverains altérassent leur monnaie jusqu’à lui enlever la presque totalité de sa valeur intrinsèque, sans diminuer d’une manière permanente sa valeur monétaire, sans altérer, en conséquence, l’étalon des valeurs. Mais, une fois lancés sur la pente du monnayage forcé, les souverains pouvaient difficilement s’arrêter, surtout si l’on songe qu’ils avaient recours à ces opérations sur les monnaies dans des moments de besoins urgents. Ils étaient excités à continuer à monnayer pour leur propre [II-152] compte, sans avoir égard aux besoins du marché, par l’appât de bénéfices d’autant plus grands, que la différence entre la valeur métallique et la valeur monétaire de la nouvelle monnaie était plus considérable; et ces bénéfices, ils pouvaient les réaliser sans difficulté aucune, la substitution de la nouvelle monnaie à l’ancienne mettant à leur disposition une masse de métal égale pour chaque pièce à la diminution de son poids ou de son titre, ou bien encore à l’augmentation de sa valeur monétaire. Ils auraient pu, sans doute, se borner à revendre ce métal. Mais ils trouvaient un bien plus grand avantage à le transformer en monnaie, puisque, dans ce cas, ils ajoutaient à leur premier profit consistant dans la quantité de métal qu’ils avaient recueillie, un second profit consistant dans le montant de la traite ou prix de façon que le monnayage leur procurait. Ils monnayaient donc cet excédant de métal ordinairement sous forme de petites coupures, dont la circulation était infestée. Qu’arrivait-il alors? C’est que la quantité de monnaie allant croissant sans proportion avec la demande, la valeur monétaire des nouvelles espèces s’abaissait d’une manière progressive. Elle aurait bientôt atteint le niveau de la valeur intrinsèque des espèces, si en monnayant lui-même, le souverain n’avait arrêté le monnayage pour compte des particuliers. Ce monnayage, en effet, ne pouvait plus se faire qu’à perte, puisque la concurrence du souverain abaissait la valeur monétaire des espèces au dessous de la valeur de la matière première augmentée du prix de façon exigé des particuliers. Cependant, lorsque le souverain, débarrassé de la concurrence des particuliers et chargé seul désormais de pourvoir aux besoins du marché, continuait indéfiniment à monnayer, les espèces devaient continuer aussi à baisser. Jusqu’où pouvait aller la baisse? Jusqu’à ce que [II-153] la valeur monétaire des espèces tombât au niveau de leur valeur métallique augmentée des frais de monnayage, c’est à dire jusqu’à ce que le souverain ne trouvât plus aucun profit à monnayer. Or, comme la traite s’élevait parfois à 25 p. c. et au delà, il y avait de la marge pour la dépréciation de la monnaie.
Les conséquences de cette dépréciation, nous les avons précédemment décrites. A mesure que la monnaie baissait de valeur, on voyait hausser les prix de toutes les marchandises et de tous les services qui s’échangeaient contre elle. Il en résultait que tous ceux qui avaient, antérieurement, prêté ou loué des produits ou des services, perdaient le montant de cette hausse aussi longtemps que durait leur contrat. Telle était la situation des propriétaires de terres, à la vérité assez peu nombreux, qui avaient stipulé leurs fermages en argent, telle était encore celle des propriétaires de maisons et des prêteurs à intérêt, dont la perte était d’autant plus grande, qu’ils avaient loué ou prêté à de plus longs termes. Telle était enfin la situation des classes dont les produits ou les services se trouvaient plus offerts que demandés, et qui ne pouvaient, en conséquence, en exhausser immédiatement les prix en proportion de la dépréciation de la monnaie. D’un autre côté, le risque de dépréciation que suscitait l’affaiblissement de la valeur intrinsèque des monnaies avait pour résultat d’entraver par la hausse de l’intérêt (lequel s’augmentait naturellement de la prime nécessaire pour couvrir ce risque) sinon d’empêcher complétement la conclusion de toute opération à terme. L’affaiblissement de la monnaie occasionnait ainsi des dommages sensibles et de vives souffrances à des classes nombreuses de la population. Quelquefois, on essayait d’égaliser ces dommages et ces souffrances qui accablaient [II-154] certaines classes en effleurant seulement les autres, et l’on employait pour cela le procédé du maximum [21] On défendait aux détenteurs des choses les plus nécessaires à la vie de les vendre au dessus d’un prix déterminé, et, en obligeant ainsi la classe qui pouvait le plus aisément se soustraire à la taxe monétaire à supporter sa part de cette taxe, on la rendait moins lourde pour la masse du peuple. Mais le maximum, lorsqu’il était fixé trop bas ou lorsque la dépréciation continuait, amenait la ruine de ceux à qui on l’imposait; les plaintes n’en devenaient alors que plus générales, et l’affaiblissement de la valeur intrinsèque des monnaies, ou ce qui revient au même l’augmentation de leur valeur monétaire (d’où ces deux expressions, [II-155] en réalité synonymes quoique en apparence fort différentes, affaiblissement des monnaies et augmentation des monnaies) était le plus redouté des impôts.
Les populations ne manquaient pas d’essayer de se soustraire à cet impôt onéreux et barbare. Quelquefois, elles refusaient d’accepter la nouvelle monnaie; mais pour que ce moyen réussît, il aurait fallu une entente générale des consommateurs de monnaie, et cette entente était impossible à établir. Comme la nouvelle monnaie avait cours légal et obligatoire, on s’exposait en la refusant à des pénalités que des individus isolés ne se souciaient pas d’encourir. Or, ceux qui l’avaient acceptée cherchaient aussitôt à s’en défaire, surtout dans les moments où elle subissait une dépréciation rapide. D’ailleurs, grâce au mystère dont on enveloppait à dessein les opérations monétaires et aux moyens que l’on employait pour dissimuler les affaiblissements, la nouvelle monnaie s’insinuait d’une manière sournoise dans la circulation, et sa présence n’y était révélée que lorsqu’il était trop tard pour arrêter son envahissement [22]
[II-156]
Un autre moyen plus efficace de l’empêcher de se répandre consistait à changer l’étalon monétaire. A l’origine, cet étalon avait été, comme on sait, la valeur d’une livre pesant en monnaie d’argent, laquelle, le monnayage étant alors gratuit, équivalait à une livre d’argent non monnayé. Mais par le fait de l’établissement du seigneuriage et de l’affaiblissement successif de la valeur intrinsèque des espèces, bientôt suivi de l’affaiblissement de leur valeur monétaire, la livre étalon était devenue une valeur arbitraire, sujette à diminuer à chaque surémission des espèces affaiblies. Supposons maintenant qu’on eῦt substitué à l’étalon monnayé l’étalon métallique, qu’au lieu de stipuler en livres représentant une certaine quantité de monnaie que des affaiblissements de poids ou de titre diminuaient, et que des surémissions dépréciaient incessamment, on eῦt stipulé en marcs d’argent, que serait-il arrivé? C’est qu’on n’aurait plus été exposé, dans toutes les opérations à terme, à subir d’autre perte que celle provenant de la dépréciation ordinairement fort lente et peu sensible du métal; c’est qu’à mesure que la monnaie en circulation aurait baissé de valeur, sous l’influence [II-157] combinée d’un affaiblissement et d’une surémission, les propriétaires de terres, de maisons, les prêteurs à intérêts, les ouvriers, les marchands ne la recevant plus qu’à son prix actuel et variable, mesuré sur un étalon fixe, en auraient exigé une quantité plus considérable, et que la perte résultant de la dépréciation eῦt été ainsi supportée infailliblement par ceux qui auraient commis l’imprudence d’accepter cet instrument de circulation sujet à se déprécier. Cela étant, il eῦt été beaucoup plus difficile au souverain d’émettre une monnaie dont la valeur intrinsèque se serait écartée notablement de sa valeur monétaire; car on aurait répugné bien davantage à assumer, en l’acceptant, le risque d’une dépréciation que l’on n’aurait pu désormais faire retomber sur d’autres, que la classe nombreuse des débiteurs, en particulier, n’aurait pu rejeter sur celle des créanciers. Avant d’accepter une nouvelle monnaie, on se serait enquis avec soin du risque de dépréciation, et si ce risque avait été considérable, on aurait, malgré toutes les défenses, continué de se servir des anciennes monnaies, plutôt que de recourir à la nouvelle. Faute de demande, celle-ci se serait alors promptement [II-158] dépréciée, et l’opération eῦt été manquée. Aussi, chaque fois que les populations essayèrent de recourir à ce moyen de faire échouer l’impôt monétaire, les souverains ne manquèrentils pas de le leur interdire, en prohibant sévèrement le “compte en marcs [23] “
Enfin, les populations essayèrent de se soustraire aux maux de la taxe perçue sous forme d’un affaiblissement de la monnaie, [II-159] en offrant de la remplacer par un autre impôt. Les souverains consentirent à cette substitution, ou, pour mieux dire, ils acceptèrent le nouvel impôt qu’on leur proposait en échange de la taxe monétaire, et ils prirent, en conséquence, l’engagement de ne plus affaiblir leurs monnaies. Telle fut l’origine de l’impôt du fouage et des aides [24] Mais cet engagement, il était rare que les souverains persistassent à le tenir: chaque fois [II-160] qu’ils étaient pressés par des besoins extraordinaires, ils ne manquaient pas de recourir, de nouveau, à l’affaiblissement de la monnaie, comme de nos jours ils recourent à l’émission du papier-monnaie, ce qui est, comme nous pourrons nous en assurer, le nec plus ultra de l’affaiblissement monétaire. Alors, les populations poussées à bout, recouraient parfois à l’émeute, c’est à dire à la force qui est la dernière raison des peuples comme celle des rois, et ce procédé leur réussissait quand les souverains n’étaient pas les plus forts.
Ce n’était toutefois, le plus souvent, que lorsque les besoins extraordinaires auxquels la taxe monétaire était destinée à pourvoir avaient cessé, que les affaiblissements cessaient à leur tour, ou bien encore lorsque la monnaie était affaiblie de telle sorte qu’il n’y avait plus que peu de profit à l’affaiblir davantage. On en revenait alors au régime de la monnaie forte, ou, pour nous [II-161] servir de l’expression du temps, on enforcissait la monnaie, en démonétisant les espèces affaiblies et en les remplaçant par d’autres qui contenaient une forte proportion de valeur intrinsèque et ne laissaient, par conséquent, au souverain qu’un faible seigneuriage [26] Cependant, on ne rétablissait point l’étalon [II-162] monétaire au point de départ de l’affaiblissement. Car on aurait ainsi provoqué une série de perturbations en sens inverse de celles que l’affaiblissement avait produites; on aurait spolié les débiteurs au profit des créanciers après avoir spolié les créanciers au profit des débiteurs, et fait succéder à une hausse excessive de toutes choses une baisse non moins excessive. Ordinairement on émettait la nouvelle monnaie pour une valeur un peu plus élevée que celle à laquelle avait fini par tomber l’ancienne, et l’étalon monétaire se trouvait ainsi dégradé de la plus grande partie de la dépréciation qu’il avait subie pendant l’affaiblissement; mais l’augmentation de la valeur intrinsèque des pièces assurait du moins les populations contre une dépréciation éventuelle aussi longtemps que durait ce régime de monnaie forte.
Les époques auxquelles les monnaies ont été affaiblies sont nombreuses. On doit signaler surtout, comme les plus désastreuses, celles de Philippe le Bel, du roi Jean et de Charles VI; c’est à ces époques que se rapportent les principales chutes de valeur de l’étalon [27] En temps ordinaire, c’est à dire lorsque [II-163] des besoins urgents n’obligeaient point les souverains à recourir [II-164] aux affaiblissements, le monopole du monnayage était mieux [II-165] géré qu’on ne le suppose d’habitude. Tantôt ce monopole était [II-166] affermé, ce qui était le mode d’exploitation le plus écono [II-167] mique(1), tantôt il demeurait en régie; mais quel que fῦt le [II-168] mode d’exploitation, le souverain se contentait d’en tirer un profit ou seigneuriage modéré. Toutefois, même en temps ordinaire, l’instrument monétaire était soumis à l’influence de plusieurs causes de dégradation, dont on ne réussissait pas toujours à le préserver, malgré les mesures qui étaient prises pour atteindre ce but. Nous en donnerons un court aperçu.
[II-169]
La concurrence des monnaies contrefaites, de la fausse monnaie et des monnaies étrangères, figurait au nombre des principales causes de dégradation de l’instrument monétaire. Lorsque la traite sur les monnaies était considérable, lorsqu’il existait, en conséquence, une grande différence entre la valeur métal-lique et la valeur monétaire des espèces, la contrefaçon de la [II-170] monnaie devenait une industrie fort avantageuse, comme pourrait l’être encore aujourd’hui celle de la monnaie de billon, puisque cette monnaie ne contient guère que le tiers ou la moitié de sa valeur en métal. On pratiquait donc la contrefaçon sur une grande échelle, surtout aux époques où l’imperfection des procédés de fabrication des espèces en rendait l’imitation facile. Tantôt on faisait de la contrefaçon pure et simple; tantôt les contrefacteurs augmentaient encore leurs bénéfices en accroissant la proportion de l’alliage, ce qui constituait, à proprement parler, le faux monnayage. La contrefaçon pure et simple se pratiquait surtout lorsque la monnaie était faible, et elle donnait d’autant plus de bénéfice qu’il y avait plus de différence entre la valeur métallique des espèces et leur valeur monétaire. Le faux monnayage se pratiquait davantage sous le régime de la monnaie forte, parce que la contrefaçon pure et simple des espèces fortes n’aurait donné qu’un profit insuffisant pour couvrir les risques de cette fabrication interlope [28] .
[II-171]
A la concurrence des espèces contrefaites ou fausses, venait [II-172] encore se joindre celle des espèces étrangères qui s’infiltraient [II-173] dans la circulation, tantôt par suite de la tolérance ou plutôt [II-174] de la nonchalance de l’administration, tantôt malgré les prohibitions dont elles étaient frappées [29] . Ces monnaies étaient, à [II-175] la vérité, affectées le plus souvent à des emplois auxquels la monnaie indigène n’était pas propre. Ainsi, par exemple, elle servait pour l’épargne. On ne thésaurisait guère que des monnaies fortes, et quand il n’en existait pas assez dans le pays, on y suppléait au moyen de celles de l’étranger. Les piastres fortes d’Espagne, en particulier, furent longtemps affectées à cette destination [30] . Mais ces monnaies faisaient aussi une concurrence plus directe aux monnaies indigènes, en entrant dans la circulation et en grossissant ainsi l’offre de la monnaie, la demande demeurant la même. En admettant toutefois que cette concurrence fῦt demeurée toujours parfaitement libre, elle eῦt été salutaire au lieu d’être perturbatrice. En effet, si les espèces étrangères avaient pu circuler d’une manière permanente, à leur cours naturel, on n’aurait pas manqué de se servir des meilleures, et cette concurrence aurait obligé le souverain à [II-176] fournir désormais de bonne monnaie à ses consommateurs, sous peine de perdre tout ou partie de son débouché monétaire. Mais les choses ne se passaient pas ainsi. Tantôt les espèces étrangères étaient admises ou tolérées sur le marché, et alors elles affluaient en faisant baisser la masse du numéraire en circulation. Tantôt, elles en étaient expulsées, et leur expulsion faisait hausser le numéraire restant. On ajoutait encore au désordre en les taxant. Lorsque, comme il arrivait quelquefois, le prix auquel on les taxait était supérieur à celui de la monnaie indigène, lorsque les particuliers avaient en conséquence plus d’avantage à exporter des métaux précieux pour importer en échange des monnaies étrangères que de transformer ces métaux en monnaies indigènes, les espèces étrangères affluaient et les espèces indigènes disparaissaient. On remédiait alors au mal en les taxant trop bas, ce qui provoquait leur expulsion après une série de perturbations en sens inverse.
A ces causes extérieures de perturbation, venaient s’en joindre d’autres qui provenaient de la mauvaise gestion intérieure du monopole du monnayage, de l’ignorance ou de la méconnaissance des conditions naturelles et nécessaires qu’il fallait observer pour maintenir enbon état l’instrument monétaire. Les perturbations les plus ordinaires provenaient de l’étalonnage vicieux de la monnaie d’or ou de l’émission excessive de la monnaie de billon. A quoi on peut ajouter encore la négligence à retirer les espèces usées ou rognées.
Lorsqu’on établissait une mauvaise proportion entre l’or et l’argent; lorsque, par exemple, la proportion naturelle étant de 1 à 12, on la fixait de 1 à 13, c’est à dire lorsqu’on admettait au monnayage 1 marc d’or comme valant 13 marcs d’argent, tandis qu’il n’en valait en réalité que 12, que devait-il arriver? [II-177] C’est que ceux qui faisaient monnayer un marc d’or obtenant une valeur égale à celle qu’ils auraient obtenue en faisant monnayer 13 marcs d’argent, tandis qu’ils pouvaient se procurer dans le commerce un marc d’or en échange de 12 marcs d’argent, chacun devait faire frapper de préférence de la monnaie d’or, et même, lorsque le prix de façon n’était pas compris pour une part trop forte dans la valeur de la monnaie d’argent, on avait intérêt à fondre celle-ci pour en échanger le métal contre de l’or qui produisait, monnayé, une valeur plus grande. La monnaie d’argent disparaissait en conséquence, la monnaie d’or prenait sa place et l’étalon monétaire se dégradait de la différence. Lorsque c’était au contraire l’argent qui était surévalué, la monnaie d’or était expulsée et l’étalon se dégradait encore.
Enfin, lorsque la monnaie de billon, que le souverain émettait pour son propre compte, était frappée avec ou sans dessein, en quantité surabondante, on ne manquait jamais de voir se produire les phénomènes que nous avons décrits plus haut, savoir: l’expulsion des monnaies supérieures et la dégradation de l’étalon, jusqu’à ce qu’on eῦt retiré l’excédant qui provoquait ces perturbations, et, d’après Henry Poullain, c’était là de toutes les causes du désordre des monnaies la plus fréquente et la plus dangereuse [31] .
[II-178]
La négligence à retirer de la circulation les pièces usées ou rognées doit encore être citée parmi les causes des perturbations [II-179] monétaires. Aussi longtemps que ces monnaies avaient cours, chacun s’efforçait de les faire passer, ne se souciant pas [II-180] de supporter, surtout lorsque la traite était élevée, la perte de la différence existant entre leur valeur intrinsèque et leur valeur monétaire. Mais alors qu’arrivait-il? C’est que les pièces usées ayant cours comme celles qui étaient en bon état, on rognait les pièces neuves et la circulation n’était bientôt plus remplie que de mauvaises pièces. On avait beau en frapper de nouvelles, elles subissaient le même sort, malgré les pénalités comminées contre les rogneurs de monnaie. Le seul remède à ce mal, qui se fit d’ailleurs plus sentir en Angleterre qu’en France, où l’on ne laissait guère aux monnaies le temps de vieillir, consistait à [II-181] retirer les anciennes espèces, à mesure qu’elles venaient à s’user [32] .
Mais ceci soulevait une question fort intéressante et fort débattue, savoir qui devait supporter le frai ou l’usure des espèces. Il est juste que ceux qui se servent de la monnaie en supportent l’usure, cela ne saurait guère être contesté. Cependant, dans la pratique, il serait impossible d’obliger chacun de ceux qui ont contribué à user une pièce de monnaie à payer sa part de l’usure, et il serait injuste d’obliger le dernier consommateur qui a accepté une pièce arrivée, peu à peu, au point presque insaisissable où elle cesse d’être propre à la circulation, à payer pour tous, en mettant à sa charge le montant total de l’usure. Que faire donc? La combinaison la plus équitable consisterait à ajouter au prix de façon du monnayage un tantième pour l’amortissement du frai, en tant du moins que ce frai proviendrait de l’usure naturelle des pièces, et, à stipuler, en conséquence, au bout d’un certain délai calculé d’après la longévité naturelle des différentes sortes de monnaies, le retrait par l’établissement monétaire des espèces vieillies et impropres à circuler davantage. C’était ainsi, du reste, que les choses se pratiquaient d’ordinaire. Mais on en tirait une conséquence fausse, savoir que la monnaie ne cessait point d’appartenir au souverain, qu’il la prêtait seulement au public; d’où l’on faisait découler son droit de défendre non seulement de la rogner, mais encore de la fondre. Que l’on sévit contre les rogneurs de monnaie, comme enfreignant les conditions du contrat passé entre le monétaire et [II-182] le public, comme aggravant d’une manière artificielle et frauduleuse l’usure des espèces, rien de plus juste. Mais que l’on défendît de les fondre, comme si elles n’avaient pas cessé d’appartenir au souverain, c’était commettre un abus de pouvoir. Sansdoute, les consommateurs de monnaie n’avaient pas le droit de contrefaire l’effigie monétaire, pas plus que toute autre marque de fabrique: en revanche, ils avaient le droit d’user à leur guise de la marchandise portant cette effigie, puisqu’ils l’avaient acquise. Du reste, le billonnage ou fonte de la monnaie ne devenait avantageux au consommateur et dommageable au producteur que dans des circonstances exceptionnelles: 1° lorsque le souverain frappait de la monnaie tellement forte qu’il ne couvrait pas même ses frais de monnayage. Alors il arrivait fréquemment que l’on trouvât avantage à fondre cette monnaie forte, pour transporter le métal dans un pays où la même quantité d’étoffe métallique produisait une valeur monétaire plus grande [33] ;2° lorsque le souverain, en émettant une monnaie [II-183] affaiblie, voulait reprendre la monnaie forte à un taux inférieur à sa valeur métallique; il avait encore intérêt à empêcher qu’on ne la fondît. Ces cas exceptés, le billonnage lui procurait un accroissement de bénéfices, puisque chaque pièce fondue devait être remplacée, et qu’il était investi du monopole du monnayage [34] .
Quoi qu’il en soit, grâce à une longue pratique et à de nombreuses écoles, on avait fini par bien connaitre les conditions qu’il fallait remplir et observer pour mettre au service du public un bon instrument monétaire, et l’on avait réalisé, sous ce rapport, des progrès notables. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par exemple, le régime monétaire français était, au témoignage [II-184] de Jacques Steuart, le plus parfait qui existât [35] . La meilleure preuve de sa supériorité, c’est que certaines monnaies fran [II-185] çaises, telles que les louis d’or, circulaient non seulement en France, mais encore dans toute l’Europe pour leur entière [II-186] valeur monétaire, bien que le prix de façon (brassage et seigneuriage) fῦt compris dans cette valeur pour environ 8 p. c.
[II-187]
Mais, on n’en était pas revenu à ce bon règlement des monnaies, après un ricorso de 1200 ans, occasionné par l’invasion [II-188] des barbares, sans traverser de nombreuses périodes de désordres monétaires qu’accusaient les fluctuations et l’affaiblissement successif de l’étalon. On doit maintenant comprendre de quelle façon ces fluctuations et cet affaiblissement s’étaient produits. A l’origine, l’étalon monétaire, légué par les Romains à leurs successeurs barbares, consistait dans la valeur d’une livre romaine de 12 onces ou 6144 grains équivalant à 326 grammes d’argent fin, ou, pour être plus exact, d’une livre pesant d’argent monnayé équivalant à une livre d’argent fin non monnayé, le monnayage étant gratuit. Mais bientôt, les souverains barbares recommencèrent à faire payer un prix de façon pour la monnaie. Que devait-il arriver alors? Évidemment que la livre pesant d’argent monnayé devait valoir une livre d’argent métal plus le montant des frais de monnayage. La livre monétaire devait hausser, en conséquence, et c’est probablement cette hausse qui a fait croire à M. Guerard que le poids de la livre avait été augmenté sous Pépin, chose tout à fait inexplicable et invraisemblable, tandis que sa valeur seule s’était accrue par l’imposition du seigneuriage. Mais lorsque après avoir rétabli le seigneuriage que les Romains avaient abandonné, on eut recours aux affaiblissements, pour augmenter les bénéfices du monétaire, et surtout pour lui créer des ressources extraordinaires dans les moments de besoins urgents, la dépréciation de la livre devint, [II-189] comme nous l’avons vu, la conséquence inévitable de cette pratique. L’affaiblissement se pratiquait, en effet, de deux façons: 1° par la diminution du poids ou du titre des espèces, autrement dit de leur valeur intrinsèque en métal, leur valeur monétaire demeurant la même; 2° par l’augmentation de leur valeur monétaire, leur valeur intrinsèque demeurant la même. Mais, dans les deux cas, il fallait employer le procédé de l’émission forcée pour substituer les espèces affaiblies aux espèces fortes. L’emploi de ce procédé amenait des surémissions qui faisaient tomber communément la valeur monétaire des nouvelles espèces de toute la quantité de l’affaiblissement opéré dans la valeur intrinsèque. D’abord, on fabriquait une quantité de monnaie pesant et valant une livre avec une livre d’argent métal; ensuite, le seigneuriage étant imposé, on fabriqua avec une livre d’argent métal une quantité de monnaie pesant encore une livre, mais valant davantage de tout le montant du seigneuriage. La livre d’argent monnayé, servant d’étalon monétaire, cessa dès lors et pour toujours d’être l’équivalent de la livre d’argent métal pour devenir une valeur artificielle, que la diminution progressive de l’étoffe métallique dont on se servait pour la produire devait incessamment affaiblir. Après l’avoir produite, en mettant en œuvre une livre pesant d’argent métal, on n’employa plus qu’une fraction de plus en plus faible de ce poids primitif, en bénéficiant chaque fois de la différence, et comme par le fait des surémissions, la chute de la valeur monétaire des espèces manquait rarement de suivre celle de leur valeur intrinsèque, la livre étalon finit par ne plus représenter que la valeur d’une fraction minime de la livre originaire. En 1295, par exemple, le marc d’argent fin de 8 onces on 4608 grains vaut déjà 2 livres 18 s., ce qui donne pour équivalent de la livre monétaire à cette [II-190] époque, non plus la valeur d’une livre pesant d’argent de 6144 grains ou 326 grammes, mais celle de: 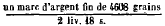 ou, ce qui revient au même, la valeur d’un poids d’argent fin de 1589 grains ou 84. 50 grammes. Enfin, de chute en chute, la livre monétaire finit par n’être plus que la représentation de la valeur d’un poids de:
ou, ce qui revient au même, la valeur d’un poids d’argent fin de 1589 grains ou 84. 50 grammes. Enfin, de chute en chute, la livre monétaire finit par n’être plus que la représentation de la valeur d’un poids de: 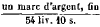 , c’est à dire de 84 1/2 grains ou 4. 48 grammes.
, c’est à dire de 84 1/2 grains ou 4. 48 grammes.
Essayons encore, au moyen d’une simple hypothèse fondée sur l’état actuel des choses, de rendre tout à fait sensible la cause de cette dégradation successive de la livre monétaire. Notre étalon est actuellement le franc d’argent, c’est à dire un poids d’argent monnayé de 5 grammes à 9/10es de fin. Le monnuayage coutant fr. 1,50 par kil., et le gouvernement fabricant avec un kil. d’argent à 9/10mes de fin 40 pièces de 5 fr. soit fr. 200, la valeur du franc, étalon monétaire, peut s’exprimer ainsi: 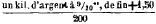 . Outre les espèces d’argent et d’or que le gouvernement fait fabriquer à bas prix pour le compte des particuliers, il fabrique aussi, comme on sait, de la monnaie de cuivre, de bronze ou de nickel qui ne contient qu’environ la moitié ou même le tiers de sa valeur intrinsèque en métal et sur laquelle il réalise par conséquent un bénéfice considérable.
. Outre les espèces d’argent et d’or que le gouvernement fait fabriquer à bas prix pour le compte des particuliers, il fabrique aussi, comme on sait, de la monnaie de cuivre, de bronze ou de nickel qui ne contient qu’environ la moitié ou même le tiers de sa valeur intrinsèque en métal et sur laquelle il réalise par conséquent un bénéfice considérable.
Supposons maintenant que le gouvernement soit pressé par des besoins d’argent extraordinaires et qu’il n’ait plus d’autre ressource que son monopole monétaire, comment devra-t-il s’y prendre pour augmenter le produit actuellement insignifiant de ce monopole? Il pourra d’abord élever son prix de monnayage, le porter par exemple de fr. 1,50 par kil. à fr. 15 et même davantage. Cependant il ne pourra se procurer un supplément notable de ressources, au moyen de cet exhaussement du prix du monnayage [II-191] , qu’à une condition, savoir d’expulser du marché l’ancien approvisionnement monnayé à raison de fr. 1,50 pour le remplacer par le nouveau, à monnayer à raison de fr. 15. Supposons que l’instrument monétaire se compose de 10 millions de kil. d’argent monnayé, constituant une valeur de 2 milliards, le gouvernement pourra, en remplaçant cet approvisionnement, réaliser, à raison de fr. 15 par kil., un bénéfice brut de 150 millions, dont il y aura à déduire seulement les frais peu élevés de la façon.
Cette nécessité de vider le marché monétaire étant bien comprise, le gouvernement décrétera d’abord l’augmentation du prix de façon des espèces, et pour éviter de rien changer à leur valeur, il prendra cette augmentation sur le métal apporté au monnayage, dont il retranchera l’équivalent de fr. 15 ou 75 gr. à 9/10mcs de fin par kil. Les nouvelles espèces seront donc affaiblies relativement aux anciennes de fr. 15—1,50 ou fr. 13,50 par kil., soit sur le poids ou sur le titre. Mais, en admettant que le public consente à les accepter, qu’elles trouvent un débouché régulier, leur valeur monétaire ne pourra tomber au dessous de celle des anciennes, sinon il y aurait perte à les faire monnayer. Seulement, il s’agit de leur procurer ce débouché, en déterminant, chose qui paraît impossible au premier abord, les consommateurs à se dessaisir de leurs espèces fortes pour les remplacer par des espèces affaiblies. Pour obtenir ce résultat, duquel dépend la réussite de l’opération, que fera le gouvernement? Il annoncera qu’il reçoit la nouvelle monnaie sur le même pied que l’ancienne et il autorisera les débiteurs à s’acquitter également sur ce pied; il établira même des pénalités contre ceux qui feraient une différence entre les deux monnaies; enfin il déclarera qu’au bout d’un certain délai [II-192] l’ancienne monnaie cessera d’avoir cours, et que ceux qui continueront à l’offrir et à la faire circuler seront mis à l’amende ou même pis; en revanche, qu’il la recevra au pair ou même avec une légère prime à l’hôtel des monnaies. Que si, comme il y a apparence, ces mesures de compulsion ne suffisent pas encore, si le public persiste à se servir de la monnaie forte malgré le risque d’amende ou de prison attaché désormais à l’emploi de cette monnaie prohibée, si, en conséquence, on n’apporte point à l’hôtel des monnaies de matière à transformer en espèces nouvelles faute d’une demande suffisante pour ces espèces, le gouvernement devra recourir à l’expédient extrême du monnayage forcé. Il obligera, en invoquant la nécessité publique, les détenteurs de la matière première à en faire monnayer une certaine quantité de manière à augmenter l’offre du numéraire tout en diminuant celle du métal (et il suffit comme on sait d’une variation extrêmement faible de l’offre pour en déterminer une beaucoup plus considérable dans le prix [36] . Le monnayage forcé engendrera la baisse du numéraire et la hausse du métal. Celui-ci tendra à sortir du numéraire en baisse pour rentrer dans le stock métallique en hausse. On commencera à fondre les espèces qui contiennent la plus grande quantité d’étoffe métallique, c’est à dire les anciennes espèces. Mais le gouvernement intervient alors de nouveau: il prohibe la fonte des espèces; il prohibe aussi l’exportation du métal, de manière à ne laisser aux anciennes espèces, dont la valeur métallique tend maintenant à dépasser la valeur monétaire, d’autre issue que l’hôtel des monnaies, où il les [II-193] reçoit avec prime. On a donc intérêt à les y porter, et les nouvelles espèces prennent la place des anciennes. Le gouvernement réalise sur la masse composant l’instrument démonétisé un bénéfice brut de fr. 15 par kil., dont il faut déduire: 1° les frais de monnayage; 2° le montant de la prime allouée pour hâter l’apport des anciennes espèces; 5° la dépréciation que le monnayage forcé a occasionnée dans la masse du numéraire; mais, si l’opération est bien conduite (au point de vue fiscal, cela s’entend), ces déductions n’auront qu’une faible importance. La dépréciation du numéraire, par exemple, ne sera que temporaire; elle cessera dès que le gouvernement n’aura plus besoin de recourir au monnayage forcé, et l’étalon monétaire, un moment altéré, pourra en conséquence se trouver rétabli tel qu’il était auparavant.
Jusque-là l’altération de la qualité de l’instrument monétaire n’aura pas causé de grands maux aux consommateurs de monnaie; et ils ne s’en ressentiraient que faiblement si le gouvernement évitait d’en augmenter l’offre sans avoir égard à l’état de la demande. Mais pour transformer cet instrument que nous avons supposé d’un poids de 10 millions de kil., il a retenu fr. 15 ou 75 gr. par kil.; ce qui lui a rendu, en totalité, 75,000 kil. Que va-t-il faire de cette quantité de métal? Le parti le plus sage serait de la vendre comme métal; mais ce ne serait pas le parti le plus lucratif. Car en la monnayant pour son propre compte, ou mieux encore en l’échangeant contre de l’étoffe du billon, sur lequel il obtient un prix de façon de 50 ou même de 75 p. c., il pourra faire produire à ces 75,000 kil. de métal une valeur bien plus considérable que s’il se bornait à les exposer en vente à l’état de matière première. Si les besoins continuent à être urgents, il ne manquera pas de [II-194] recourir à ce nouvel expédient; mais alors aussi commenceront les grandes perturbations du marché monétaire et l’affaiblissement décisif de l’étalon.
Supposons qu’il transforme le rendement métallique de l’opération en monnaie d’argent, en pièces de 5 fr. par exemple, qu’arrivera-t-il? C’est que l’offre se trouvant accrue, au delà de la proportion où elle fait équilibre à la demande au niveau de 5 fr., la valeur des espèces baissera. Jusqu’où baissera-t-elle? Elle pourra baisser jusqu’au niveau de la valeur métallique de la monnaie affaiblie, et alors l’étalon subira une diminution de valeur égale au montant de l’affaiblissement. Cette dégradation de la mesure des valeurs se manifestera par une hausse du prix de toutes choses et, en particulier, de l’argent métal. Au lieu de fr. 198,50 le kil., l’argent vaudra fr. 213,50 mais la chute de la valeur de l’étalon sera bien plus considérable encore si, après avoir employé une partie du métal résultant de l’opération à fabriquer des pièces de 5 francs jusqu’à ce qu’il n y trouve plus de profit, le gouvernement se sert du restant pour acheter du cuivre ou du nickel, et s’il multiplie à l’excès sa monnaie de billon sur laquelle il réalise non pas 15 p. c., mais 50 p. c. ou même 75 p. c. de bénéfice.
Supposons donc que, reduit aux abois, il ait recours à ce dernier expédient, si bien décrit par Henry Poullain, et qu’il multiplie indéfiniment sa monnaie de billon, que se passera-t-il? D’abord, le gouvernement devra étendre autant que possible le débouché de cette monnaie inférieure en autorisant les débiteurs à s’en servir pour toute sorte de paiements. Ensuite, il lui suffira de continuer d’en émettre pour chasser de la circulation les monnaies d’or et d’argent, dont la valeur métallique haussera à mesure que le billon se multipliera, mais qui perdront [II-195] par là-même leur débouché monétaire, car tout débiteur préférera s’acquitter avec du cuivre plutôt que de payer une prime pour s’acquitter avec de l’or ou de l’argent. Les monnaies d’or ou d’argent seront donc fondues ou réservées comme instruments d’épargne; en tous cas, elles disparaîtront de la circulation, et le débouché ouvert au billon se trouvera, en conséquence, bientôt porté à son maximum. L’accroissement de ce débouché empéchera la baisse du billon, et s’il a baissé, elle le fera remonter. Les choses iront ainsi, sans que le billon subisse une baisse appréciable, jusqu’à ce que le vide laissé par le retrait de l’or et de l’argent soit comblé. Seulement les transactions seront gênées par la substitution d’un instrument de circulation lourd, incommode et chargé d’un gros risque de dépréciation à un instrument plus commode et moins dépréciable. Mais si les besoins du gouvernement persistent, il continuera ses émissions, et alors commencera sur une large échelle la dépréciation du billon. Comment se manifestera-t-elle? Par la hausse de tous les produits ou services qui s’échangent contre de la monnaie, y compris bien entendu les métaux précieux. Le kilogramme d’argent montera successivement de fr. 198,50 à fr. 250, 300, 400, à mesure que la dépréciation deviendra plus forte, et tous les autres produits ou services suivront la même progression, à l’exception de ceux qui ont été antérieurement vendus ou loués à terme ou qui se trouvent en présence d’une demande insuffisante. Peut-être le souverain aura-t-il alors recours au maximum pour repartir plus équitablement, entre les différentes classes de la population, le dommage spécialement infligé à quelques-unes par la dépréciation de l’instrument des échanges. Mais si les surémissions continuent, le maximum ne fera que substituer un injustice à une autre: à [II-196] moins qu’on ne l’élève à mesure que la monnaie se déprécie, il accablera d’un poids de plus en plus lourd ceux qui y auront été soumis, il agira comme une confiscation progressive. Cependant, les émissions pourront-elles continuer toujours? Non! Un moment arrivera où l’accroissement de la quantité du billon en fera baisser la valeur monétaire à peu près au niveau de la valeur métallique, et à ce moment, le gouvernement ne trouvera plus aucun profit à en frapper. Que s’il persistait néanmoins, la valeur du billon tomberait au dessous de celle de sa matière première, il le frapperait à perte, et, de plus, on s’empresserait de le fondre à mesure qu’il le frapperait. Arrivé à ce point, il sera donc obligé de renoncer à émettre du billon; mais déjà auparavant, c’est à dire au moment où ses bénéfices sur le monnayage du billon commençaient à tomber au dessous des fr. 15 par kil. qu’il réalisait sur le monnayage de l’argent, il aura eu intérêt à abandonner le billon pour revenir à l’argent. Ce retour à la monnaie forte sera pour lui une nouvelle source de profits: 1° si l’argent reprend la place qu’a usurpée le billon; 2° si le retrait du billon s’opère à un taux assez bas, pour que les frais de ce retrait n’atteignent pas les bénéfices à réaliser sur l’émission de l’argent. Or, ceci dépendra du niveau auquel on rétablira l’étalon monétaire.
Pendant le cours des opérations que nous venons d’esquisser, qu’est devenu cet étalon? C’est toujours le franc, mais ce franc ne consiste plus, comme à l’origine, en un poids d’argent monnayé de 5 grammes à 9/10 de fin. Il consiste dans une quantité de 20 pièces de 5 centimes, ou de cent pièces d’un centime de cuivre lesquelles, après avoir été au début réellement l’équivalent d’un poids d’argent monnayé de 5 grammes à 9/10 de fin ont fini par n’en plus valoir que la moitié ou même le tiers. [II-197] Les personnes qui payent ou qui contractent alors en francs ne fournissent ou ne promettent de fournir, en réalité, que la moitié ou même le tiers de la valeur du franc primitif. De là, de nouvelles perturbations lorsqu’il s’agit de revenir au régime de la monnaie forte. Peut-on rétablir l’ancien franc et obliger ainsi tous ceux qui ont contracté sous le régime du franc déprécié à fournir à leurs créanciers une valeur double ou triple de celle qu’ils se sont engagés à livrer? Ce serait provoquer de nouveaux désastres, spolier les débiteurs après avoir spolié les créanciers, et susciter, après une hausse successive, une baisse soudaine de toutes choses. L’intérêt général des consommateurs de monnaie ne commande donc pas d’en revenir à l’ancien étalon, et, d’un autre côté, le gouvernement est intéressé à consolider l’étalon déprécié au niveau où la dépréciation l’a amené, afin de réduire au minimum les frais du retrait du billon démonétisé. Que si, par exemple, le franc de cuivre n’est plus que l’équivalent de 2 gr. d’argent au lieu de 5, le gouvernement est intéressé à fabriquer des francs de 2 gr., car il ne subira à ce taux aucune perte sur le billon démonétisé qui sera rapporté à l’hôtel des monnaies. Il y a apparence donc qu’il consolidera l’étalon au taux qui sera le plus avantageux pour lui, c’est à dire au taux le plus bas, et, en admettant que des opérations de ce genre se renouvellent fréquemment, l’étalon subira des affaiblissements successifs: de même que la livre monétaire, qui au temps de la domination romaine consistait dans la valeur d’une livre pesant d’argent, était descendue, dans les dernières années du XVIIIe siècle, à la valeur de 4 1/2 grammes environ, le franc pourra descendre jusqu’à la valeur actuelle du centime.
Si nous nous sommes étendu, d’une manière peut-être surabondante sur ces explications, c’est à cause des erreurs graves [II-198] qui n’ont point cessé d’obscurcir les questions monétaires. S’il est vrai, comme l’affirment les métallistes, que la valeur de la monnaie réside tout entière dans la matière première métallique dont elle est composée, et qu’il soit par conséquent impossible d’attribuer à une pièce de monnaie une valeur supérieure à celle du métal qu’elle contient, les opérations monétaires des anciens souverains deviennent tout à fait absurdes et inexplicables, car ils n’auraient jamais pu, dans ce système, tirer le moindre profit de l’affaiblissement de la valeur intrinsèque de leurs espèces. Dans ce système encore, la circulation du billon, c’est à dire d’une monnaie qui ne contient guère plus de la moitié de sa valeur en métal, présente un problème complétement insoluble. D’un autre côté, s’il est vrai, comme l’ont prétendu quelques écrivains de l’école mercantile, que la valeur des monnaies dépende uniquement de la volonté du souverain, quelle que soit la quantité des émissions, on peut en émettre sans limite aucune, en réduisant, d’une manière illimitée aussi, la quantité de l’étoffe métallique dont on les fabrique. Il est certain que la vérité n’est ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux systèmes et qu’il faut la chercher dans une observation plus complète des faits.
Que nous enseigne donc l’observation des faits? Que la valeur de la monnaie se forme comme celle de toutes les marchandises par l’action de la double loi de l’offre et de la demande et des frais de production. En vertu de cette double loi, la valeur des choses finit toujours, comme on sait, par tomber au niveau de leurs frais de production, ce qui semblerait, au premier abord, donner raison aux métallistes, les frais de production de la monnaie résidant en presque totalité dans la valeur du métal dont elle est faite. Mais ce à quoi les métallistes n’ont pas pris [II-199] garde: c’est que la production de la monnaie a été de tous temps un monopole, d’où il résulte qu’en étudiant les phénomènes monétaires, il faut avoir égard aux perturbations que le monopole a le pouvoir d’apporter dans le règlement du prix des choses. Ainsi, le monopoleur, étant le maître de l’un des deux termes de la loi de l’offre et de la demande, peut empêcher et empêche en effet communément l’offre du produit monopolisé de faire équilibre à la demande au niveau des frais de production: il peut maintenir et il maintient le prix courant de ce produit fort au dessus de son prix naturel. S’il s’agit de monnaie, le souverain investi du monopole du monnayage peut, en conséquence, comme tout autre monopoleur, élever la valeur monétaire des espèces bien au dessus de leur valeur métallique ou intrinsèque.
Quel rôle joue donc la valeur métallique ou intrinsèque des espèces dans ce régime? Elle n’est point, comme l’affirment les métallistes, le fondement de la valeur de la monnaie; elle est simplement une garantie contre l’abaissement artificiel de sa valeur. Quand une monnaie renferme, comme en Angleterre, la totalité, ou, comme actuellement en France, la presque totalité de sa valeur en étoffe métallique, on est assuré qu’elle ne pourra subir d’autre dépréciation que celle même de l’étoffe dont elle est faite. Quand, au contraire, une monnaie ne renferme qu’une partie de sa valeur en métal, les 9/10, les 2/3, la 1/2 ou le 1/3, elle est soumise, en cas de surémission, à un risque de dépréciation égal à la différence existant entre sa valeur intrinsèque et sa valeur monétaire. Voilà tout.
L’esquisse historique que nous venons de tracer de l’ancien régime monétaire renferme, croyons-nous, la preuve irréfutable de la vérité de cette théorie. Que si nous avions maintenant à [II-200] porter un jugement sur ce régime, nous n’oserions point, en vérité, nous montrer trop sévère. Sans doute, les souverains de l’ancien régime ont abusé du monopole du monnayage, et les expédients dont ils se sont servi pour élever artificiellement le produit de ce monopole aux dépens des consommateurs de monnaie peuvent être à bon droit condamnés; mais y a-t-on renoncé de nos jours? Si l’on a cessé d’affaiblir les monnaies de métal, ce n’est point, hélas! parce que les gouvernements sont devenus moins besoigneux ou plus honnêtes, c’est tout simplement parce qu’ils ont découvert un procédé d’affaiblissement infiniment plus économique et plus productif, en substituant le papier au métal. Grâce à ce “progrès”, le monopole du monnayage est devenu de nos jours, comme il nous sera facile de nous en assurer, beaucoup plus funeste aux consommateurs qu’il n’avait pu l’être à aucune époque de l’ancien régime.
[II-201]
SIXIÈME LEÇON↩
le nouveau rÉgime monÉtaire
Esquisse du nouveau régime monétaire français. — Ressemblance de ce régime avec l’ancien. — Le billon. — Défectuosité de l’étalonnage de la monnaie d’or. — Conséquences de cette défectuosité. — Retrait et affluence de l’or. — Inconvénients de la substitution de l’or à l’argent. — Moyens de la prévenir. — La refonte, la tarification et le billonnage de l’or. — Ce qu’il faut penser du système dit du double étalon. — Anachronisme de ce système. — L’opinion des économistes sur le choix de l’étalon engage-t-il la science? — Rôle de la science économique dans le règlement des questions monétaires. — Nécessité actuelle d’un progrès de l’instrument des échanges.
Il y a beaucoup moins de différence qu’on n’a l’habitude de le supposer entre le système monétaire actuel de la France et celui de l’ancien régime.
D’abord l’étalon est demeuré à très peu de chose près ce qu’il était à partir des premiers temps du XVIIIe siècle. En 1726, après les fluctuations occasionnées par le système de Law, la valeur de la livre se trouva ainsi établie: 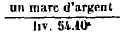 , et elle ne changea plus jusqu’en 1789. Traduite en monnaie [II-202] actuelle, c’est une valeur de 99 c. environ. En prenant donc pour étalon le franc, soit un poids d’argent monnayé de 5 gr. à 9/10es de fin, on n’apporta qu’une modification insignifiante à l’ancien système. Seulement, d’une part, on substitua l’échelle décimale à l’échelle duodécimale, et, d’une autre part, on fit frapper des espèces ayant exactement la valeur de l’étalon, c’est à dire des francs, tandis que sous l’ancien régime on n’avait point fait frapper de livres.
, et elle ne changea plus jusqu’en 1789. Traduite en monnaie [II-202] actuelle, c’est une valeur de 99 c. environ. En prenant donc pour étalon le franc, soit un poids d’argent monnayé de 5 gr. à 9/10es de fin, on n’apporta qu’une modification insignifiante à l’ancien système. Seulement, d’une part, on substitua l’échelle décimale à l’échelle duodécimale, et, d’une autre part, on fit frapper des espèces ayant exactement la valeur de l’étalon, c’est à dire des francs, tandis que sous l’ancien régime on n’avait point fait frapper de livres.
Le prix de façon du monnayage ne fut, de même, que très légèrement modifié. A l’époque où écrivait James Steuart, il s’élevait à 8 p. c., en sorte qu’il donnait encore un assez beau bénéfice. Mais, dans les années qui précédèrent la révolution, il avait été diminué, et il ne représentait plus qu’une fraction tout à fait insignifiante de la valeur de la monnaie [37] . On le rétablit à peu près au même taux lors de la reconstitution du système monétaire. Il est actuellement de fr. 1,50 par kil. soit de 3/4 p. c. pour l’argent, et de 6 francs par kil. soit de 2 millièmes environ pour l’or.
Le régime de la monnaie d’appoint ou de billon n’a pas été modifié davantage. Le billon a continué d’être émis pour le compte du gouvernement, et, comme sous l’ancien régime, les populations ont eu pendant longtemps à se plaindre du mauvais règlement de cette émission. Jusqu’à l’époque du retrait du vieux billon et de son remplacement par la monnaie de bronze [II-203] de Napoléon III, elle dépassa la demande, en sorte que le billon subissait une perte. Pour remédier à cet inconvénient, on n’avait rien trouvé de mieux que de limiter à 5 francs la somme de billon que chacun serait tenu de recevoir dans un paiement. Mais si les classes moyennes et supérieures étaient ainsi, en grande partie, affranchies du dommage de la dépréciation, ce dommage retombait en revanche d’un poids d’autant plus lourd sur la masse du peuple, qui recevait la plus grosse part de ses salaires en monnaie de billon, et qui, en tous cas, se servait principalement, dans ses transactions journalières, de cette monnaie inférieure [38] . Les différents gouvernements qui se sont succédé en France, à partir de la révolution jusqu’au second empire, méritent à cet égard les plus graves reproches. Le remplacement du vieux billon par la monnaie de bronze actuelle a été un bienfait signalé pour la masse du peuple, en même temps qu’une opération avantageuse à l’État [39] ; mais le [II-204] danger d’une émission surabondante continue à subsister; il s’est même aggravé, car la proportion de la valeur en métal de la nouvelle monnaie de bronze est moindre que ne l’était celle de l’ancien billon. Le procédé le plus efficace que l’on puisse employer pour écarter ce danger consiste à rendre le billon toujours échangeable, à bureau ouvert, chez les percepteurs des contributions et dans les hôtels des monnaies contre de la monnaie étalon. Ce procédé a été mis en vigueur par le gouvernement suisse et imité par le gouvernement belge. Il rend impossible la baisse ou la hausse du billon relativement à [II-205] la monnaie étalon, absolument comme le fait pour le papier la convertibilité des billets de banque ou des assignats [40] .
[II-206]
Enfin, on reprit, purement et simplement, pour la monnaie d’or, le système imparfait d’étalonnage, qui était en vigueur [II-207] sous l’ancien régime. Comme on avait reconnu que l’argent ne pouvait être employé à la fabrication des pièces de plus de 5 fr. [II-208] à cause de sa lourdeur, et qu’il était indispensable d’avoir pour les transactions supérieures une monnaie d’or auxiliaire, en [II-209] coupures appropriées aux besoins de la circulation, on recommença à fabriquer sous le nom de napoléons des louis et des [II-210] doubles louis de 20 et de 40 francs, en se réglant sur la proportion de la valeur des deux métaux, laquelle était de 1 à 15 1/2 environ, à l’époque de la reconstitution de l’appareil monétaire, et en supposant cette proportion invariable. C’est ainsi que l’on employa pour fabriquer les pièces de 20 francs un poids d’or de 6,451 gr. à 9/10es de fin, équivalant exactement, d’après la proportion de 1 à 15 1/2, à 100 gr. d’argent à 9/10es de fin, étoffe métallique de 4 pièces de 5 francs. Si le rapport entre la [II-211] valeur de l’or et celle de l’argent avait été, en effet, invariable, ce procédé d’étalonnage n’aurait rien laissé à désirer: les espèces d’or n’auraient pas plus varié relativement aux espèces d’argent que si les unes et les autres avaient été fabriquées avec le même métal. Malheureusement, cette invariabilité du rapport de valeur des deux métaux était une pure fiction. Sans doute, l’or et l’argent varient rarement d’une manière sensible dans un court intervalle. Cela tient à des particularités que nous [II-212] avons signalées dans une leçon précédente, savoir à ce qu’ils ont une grande durée et à ce qu’ils ne sont point des articles de première nécessité; mais ils varient, l’expérience l’atteste, lorsque la production de l’un augmente ou diminue pendant une période de quelque étendue, sans que celle de l’autre subisse une augmentation ou une diminution correspondante. Ce phénomène s’est produit maintes fois. Ainsi il paraît bien avéré que l’or était, dans l’antiquité, plus abondant qu’il ne l’est aujourd’hui relativement à l’argent; d’où il résultait que le rapport de valeur des deux métaux n’était que de 1 à 10, autrement dit qu’avec 1 kil. d’or on n’achetait que 10 kil. d’argent, tandis qu’on en achète aujourd’hui 15. Au moyen âge, ce rapport a commencé à se modifier à l’avantage de l’or, et il paraît avoir été, en moyenne, de 1 à 12. La découverte de l’Amérique eut pour résultat de faire baisser à la fois l’or et l’argent dans une proportion considérable. Mais cette baisse (laquelle s’effectua, comme on sait, avec une grande lenteur, dans une période de 50 à 70 ans) affecta l’argent plus que l’or, l’exploitation s’étant portée de préférence sur les riches gisements d’argent du Mexique et du Pérou. La proportion monta, en conséquence, successivement de 1 à 12 à 1 à 15 1/2 environ, et telle était la situation lorsque la France reconstitua son régime monétaire. Comme il y avait assez longtemps que les deux métaux n’eussent subi de variations sensibles, on crut pouvoir considérer comme invariable le rapport de valeur existant entre eux.
Mais l’expérience ne tarda pas à démontrer que l’on se trompait. D’abord, soit que le rapport adopté ne fῦt point l’expression exacte du rapport réel, soit que la production de l’or eῦt diminué dans une proportion plus forte que celle de l’argent, par le fait des révolutions de l’Amérique espagnole, la quantité [II-213] d’or contenue dans une pièce de 20 francs se trouva bientôt valoir plus que la quantité d’argent contenue dans 4 pièces de 5 francs. Cela étant, comme les paiements pouvaient s’effectuer indifféremment en argent ou en or, on fit frapper de préférence les espèces qui coῦtaient le moins cher et l’or disparut peu à peu de la circulation. Les espèces d’or ne furent plus demandées que par exception, pour certains usages auxquels elles étaient spécialement propres, pour les voyages par exemple; car à leur valeur légale s’ajoutait une prime proportionnée à la différence existant entre le rapport réel de valeur des deux métaux et leur rapport légal. Cette prime, qui portait la valeur vénale de la pièce de fr. 20 à fr. 20, 10, fr. 20, 20, constituait, le plus souvent, une perte pour l’acheteur. En effet, ceux auxquels il offrait ses espèces d’or n’ayant, pour la plupart, aucune raison particulière de préférer un paiement en or à un paiement en argent, refusaient naturellement de payer la prime. Alors même, du reste, que le remboursement de la prime sur l’or serait devenu général, l’adjonction de cette prime et sa variabilité auraient diminué la circulation des espèces d’or en les rendant moins propres à l’usage. Pendant trente ans, la monnaie d’or disparut donc presque complétement de la circulation française.
Mais, par suite des découvertes successives des gisements aurifères de la Sibérie, de la Californie et de l’Australie, la situation changea. La production annuelle de l’or qui ne dépassait pas le chiffre de cent millions, au commencement du siècle, atteignit régulièrement celui d’un milliard. Bien qu’en vertu de sa nature particulière, l’or ne subisse qu’à la longue l’influence d’une augmentation ou d’une diminution de sa production, il commença dès lors à baisser. Après avoir valu pendant trente ans 15 3/4 kil. d’argent environ, le kil. d’or ne valut plus que [II-214] 15 1/2 kil. d’argent, puis 15 1/3 à 15 1/4. Il en est là aujourd’hui. Le résultat immédiat de cette baisse de l’or fut de le faire reparaître dans la circulation. Comme on pouvait payer indifféremment avec de l’or ou de l’argent, et comme le métal nécessaire pour fabriquer 20 fr. en or coῦtait moins désormais que le métal nécessaire pour fabriquer 20 fr. en argent, on cessa de monnayer de l’argent et l’on recommença à monnayer de l’or. A mesure que l’or pénétrait dans la circulation, l’argent s’en retirait, car on pouvait l’exporter avec profit. Tandis qu’en France 15 1/2 kil. d’argent et 1 kil. d’or portés au monnayage produisaient exactement la même valeur en monnaie, à Londres, il suffisait de 15 1/4 kil. d’argent pour acheter 1 kil. d’or. Exporter de l’argent à Londres pour importer en échange de l’or en France devint donc une opération profitable, et cette opération ne manqua pas de se faire jusqu’à ce que l’on eῦt presque entièrement remplacé l’argent dans la circulation française. Le gouvernement activa encore cette substitution, qui avait le mérite à ses yeux de remplacer les vieilles effigies royales par l’effigie impériale, en faisant frapper des pièces de 5 fr. d’or pour tenir lieu de celles d’argent qui s’en allaient. Les monnaies d’appoint seules demeurèrent; encore devinrentelles rares, et celles qui contenaient tout leur poids d’argent furent-elles triées et exportées. Aujourd’hui c’est l’or qui est devenu, en France comme en Angleterre, la monnaie principale: l’argent n’est plus, dans l’usage, qu’une monnaie d’appoint supérieure au billon [42] .
[II-215]
Cette substitution a engendré une situation précisément inverse à celle qui existait auparavant. On manquait alors de la [II-216] monnaie la mieux appropriée aux transactions supérieures; on manque maintenant de celle qui est la mieux appropriée aux [II-217] transactions moyennes, car la pièce de 5 fr. d’or n’est pas, à beaucoup près, d’un usage aussi commode que la pièce de 5 fr. d’argent.
[II-218]
Cependant l’inconvénient de la substitution de l’or à l’argent dans les transactions inférieures est plus grave que celui qui résultait de la substitution de l’argent à l’or dans les transactions supérieures, en ce qu’il amène un affaiblissement de l’étalon monétaire. Pendant la période de rareté de la monnaie d’or, l’étalon monétaire ne s’est point trouvé modifié. On frappait [II-219] plus de monnaie d’argent et l’on remplaçait autant que possible l’or par des billets de banque, dans les transactions supérieures, voilà tout! Sans doute, le débouché de l’argent métal étant ainsi accru, il pouvait en résulter une légère hausse de l’étalon, mais cette hausse demeura insensible. Ce qui le prouve, c’est que la proportion de valeur entre l’or et l’argent [II-220] n’en parut point affectée et que la monnaie d’or continua d’être rare.
Du moment, au contraire, où l’or a pris la place de l’argent dans la circulation, l’étalon a commencé à s’affaiblir. Un franc d’argent, étalon monétaire, consiste en 5 grammes d’argent monnayé à 9/10es de fin, et il équivaut, en supposant que l’or vaille 15 1/2 fois l’argent, à 0,32 gr. d’or monnayé à 9/10es de fin. Mais dès que l’or ne vaut plus 15 1/2 fois l’argent, 0,32 gr. d’or ne valent plus 5 gr. d’argent, et l’étalon monétaire se trouve affaibli du montant de la baisse. Car les débiteurs peuvent s’acquitter indifféremment avec des francs d’or de 0,32 gr. ou avec des francs d’argent de 5 gr. En s’acquittant avec des francs d’or de 0,32 gr., comme ils y sont autorisés légalement, ils infligent à leurs créanciers une perte égale au montant de la dépréciation que l’or a subie. Dans l’état actuel des choses, cette perte est peu importante, car la baisse de l’or est assez faible; mais supposons qu’elle devienne plus forte, que l’or ne vaille plus que 14 fois, 12 fois ou même 10 fois l’argent, la perte des créanciers qui auront stipulé sous le régime des francs d’argent et que l’on remboursera avec des francs d’or, pourra s’élever fort haut. Ce sera exactement comme si, en laissant par négligence ou autrement le mètre se raccourcir de 10 à 15 centimètres, on autorisait ceux qui se sont engagés à fournir tant de mètres d’étoffe, ancienne mesure, à un certain prix, à s’acquitter de leurs livraisons avec le même nombre de mètres raccourcis.
Il s’agit maintenant de savoir comment cette substitution de l’or à l’argent, entraînant l’affaiblissement de l’étalon, pouvait être empêchée ou arrêtée? Sous l’ancien régime, on remédiait de deux manières à ce mal qui se faisait, à ce qu’il semble, [II-221] fréquemment sentir, car Henry Poullain la signale au nombre des principales causes du désordre des monnaies. Tantôt on refondait la monnaie d’or, en augmentant le poids des nouvelles espèces, dans la proportion de la dépréciation; tantôt, — quand on voulait éviter les frais d’une refonte, — on abaissait dans la même proportion, la valeur monétaire des espèces d’or existantes. Ces deux remèdes pourraient encore être appliqués dans les circonstances actuelles; mais ils présenteraient, l’un et l’autre, des inconvénients sérieux. Si l’on adoptait le procédé de la refonte, à une époque où l’or est en voie de dépréciation, sans que personne puisse prédire à quel point cette dépréciation s’arrêtera, on s’exposerait à devoir, chaque fois que la valeur de l’or s’abaisse, renouveler cette opération coῦteuse. Si l’on recourait à l’abaissement de la valeur monétaire, soit en autorisant les créanciers à ne plus recevoir les espèces d’or qu’au cours variable du commerce, soit en tarifant ces espèces aux environs du cours, et en modifiant cette tarification à chaque nouvelle baisse du métal, on éviterait les frais de la refonte, mais en rendant la monnaie d’or beaucoup moins propre à servir de medium circulans. Car elle n’aurait plus qu’une coupure irrégulière, et, de plus, ses détenteurs seraient exposés à subir une moins value à chaque abaissement du cours ou du tarif.
Il y avait un troisième remède, à notre avis bien préférable à ceux-là, et qui consistait à importer en France le régime de l’étalonnage anglais, en reduisant la monnaie d’or à l’état de “billon.”
Ainsi que nous l’avons vu (3e leçon), en Angleterre l’or sert d’étalon monétaire, et la monnaie d’argent n’est en réalité qu’un billon supérieur, fabriqué avec une étoffe métallique [II-222] d’une valeur inférieure à sa valeur monétaire. Comme l’émission en est proportionnée exactement aux besoins de la circulation, la monnaie d’argent n’a point de fluctuations propres: sa valeur est toujours gouvernée par celle de la monnaie étalon. Rien n’aurait été plus facile, en France, que d’appliquer ce régime à la monnaie d’or. Il aurait suffi pour cela d’en arrêter la fabrication au moment où elle commençait à empiéter sur le domaine naturel de l’argent, et, mieux encore, de la rendre toujours échangeable à vue contre de la monnaie d’argent, comme fait la Suisse pour le billon. Cela fait, l’or métal aurait eu beau se déprécier, la valeur de la monnaie d’or n’aurait point varié, de même que le cuivre, le bronze ou le nickel ont beau subir des fluctuations, la valeur des monnaies de billon fabriquées avec ces métaux demeure invariable [43] .
[II-223]
On aurait eu ainsi un système monétaire rationnel, à base d’argent, comme l’Angleterre a un système monétaire rationnel à base d’or.
Au point où en sont venues les choses, il est un peu tard pour recourir à ce remède. Car il faudrait se résigner à faire les frais de l’échange de la monnaie d’or, émise en quantité surabondante, contre de la monnaie étalon. Il y a donc apparence [II-224] que la France sera conduite à ratifier le fait accompli, en adoptant légalement l’étalon d’or et en affaiblissant la monnaie d’argent indispensable au service des menus échanges; ceci afin de pouvoir la conserver dans la circulation. Elle billonnera l’argent, comme a fait l’Angleterre, autrement dit, elle adoptera purement et simplement le système anglais. C’est ainsi qu’après avoir fait un si grand étalage des avantages prétendus [II-225] de l’application du système métrique à l’étalonnage de la monnaie, elle l’abandonnera sans retour. Son étalon monétaire ne sera plus, en effet, en droit comme il n’est déjà plus en fait, 5 gr. d’argent monnayé à 9/10es de fin; mais la somme aussi peu décimale que possible de 0,32 gr. d’or monnayé à 9/10es de fin.
Ce qui a empêché selon toute apparence de remédier, en [II-226] temps opportun, au vice de l’étalonnage du système français, c’est l’antagonisme des opinions sur le choix du métal étalon. En général, les économistes, M. Michel Chevalier en tête, défendent l’étalon d’argent, tandis que l’étalon d’or a pour lui les banquiers et les hommes d’affaires. Mais, quelque opinion qu’on ait sur ce point, on doit reconnaître que le système actuel est vicieux. Que l’on tienne pour l’étalon d’argent ou pour l’étalon d’or, on ne peut admettre comme rationnel et satisfaisant un système sous l’empire duquel la monnaie étalon peut être chassée de la circulation, chaque fois que l’étoffe de la monnaie auxiliaire vient à se déprécier, un système dans lequel l’étalon est essentiellement variable et précaire, alors que sa qualité essentielle est la stabilité. Nous n’ignorons pas que cette défectuosité même a été vantée comme une qualité et élevée à la hauteur d’un système par les partisans du régime dit du double étalon. Mais se rend-on bien compte de ce qu’est, en réalité, ce régime? Il est permis d’en douter.
En admettant même que deux étalons existent, en droit, que l’or soit investi de cette qualité aussi bien que l’argent, que le franc soit un poids d’or monnayé de 0,32 gr. aussi bien qu’un poids d’argent de 5 gr. et que l’on puisse, en conséquence, s’acquitter toujours, indifféremment, avec l’un ou l’autre de ces deux francs, en fait il ne peut jamais exister qu’un seul étalon. Deux situations peuvent ici se présenter. En premier lieu, la monnaie d’or peut être exactement proportionnée, dans sa valeur, avec celle d’argent, de telle façon qu’une pièce de 20 francs d’or vaille 4 pièces de 5 francs d’argent, ni plus ni moins. Dans ce cas, l’étalon est un quoique composé de deux métaux. En second lieu, la proportion peut cesser d’exister, la pièce de 20 francs d’or peut valoir plus ou moins que 4 pièces de 5 fr. [II-227] d’argent. Dans ce cas, l’étalon est encore un, car la monnaie métallique la plus chère disparait invariablement de la circulation: l’étalon sera l’argent si l’or hausse de prix ou si l’argent baisse, ce sera l’or si l’argent hausse ou si l’or baisse. Que résultet-t-il de là? C’est qu’avec ce système, si système il y a, on a toujours pour étalon le métal dont la valeur est le plus dépréciée.
Si les métaux étalons n’étaient exposés qu’à un risque de hausse, on pourrait ainsi, sans aucun doute, affaiblir sensiblement ce risque. A moins, chose peu probable, que la hausse des deux métaux ne fῦt égale et simultanée, le métal le plus stable resterait étalon, tandis que le métal en hausse cesserait de l’être. Mais, au temps où nous sommes, les métaux monétaires sont bien plutôt exposés à un risque de baisse, et il en résulte que si l’étalon est double, le risque de dépréciation sera double aussi, car chaque fois qu’une baisse surviendra, soit dans la valeur de l’or soit dans la valeur de l’argent, elle entraînera un affaiblissement de l’étalon. Ce régime qui a pu avoir son utilité aux époques où les métaux monétaires étaient à la hausse n’est donc plus qu’un anachronisme nuisible aux époques où ils sont à la baisse, puisqu’au lieu de ralentir la chute de l’étalon il l’accélère par l’accumulation d’un double risque de dépréciation.
Dans cette situation, il faut ou renoncer aux étalons métalliques, ou adopter pour étalon le métal dont la valeur présente le plus de chances de stabilité. Le choix de cet étalon a divisé et divise encore les économistes; mais, comme nous l’avons déjà remarqué, ce choix n’est point, à proprement parler, du ressort de l’économie politique.
L’économie politique ne fournit, en effet, aucun moyen de tirer l’horoscope de la valeur d’un produit quelconque, car une foule de circonstances étrangères à son domaine agissent sur la [II-228] valeur des choses. Nous ne pouvons pas plus savoir quelle sera, dans dix ans ou dans vingt ans, la valeur de l’or ou de l’argent que celle du blé, du coton ou de fer. Supposons, par exemple, que les gisements aurifères s’épuisent et que de riches mines d’argent viennent à être découvertes, ou simplement que les mines du Mexique et du Pérou viennent à être mises en pleine exploitation, les probabilités de baisse augmenteront pour l’argent, tandis qu’elles diminueront pour l’or. Dans l’état actuel des choses, notre opinion est favorable à l’argent: nous inclinons à croire avec M. Michel Chevalier que les probabilités de stabilité sont plus grandes pour l’argent que pour l’or. Mais cette opinion, que l’événement peut démentir puisqu’il s’agit de simples probabilités, n’engage en rien la science économique, qui n’a pu nous fournir qu’une faible portion des éléments sur lesquels elle se fonde.
En résumé, le rôle de la science dans les questions monétaires consiste: 1° à reconnaître le besoin auxquel pourvoit l’instrument des échanges et à analyser les fonctions qu’il remplit, soit comme mesure des valeurs soit comme medium circulans; 2° à constater, en conséquence de cette analyse, les qualités particulières que doivent posséder l’étalon des valeurs et le medium circulans; 3° à signaler les inconvénients et les maux que l’insuffisance de ces qualités indispensables, telles que la stabilité de la valeur de l’étalon, le défaut d’unité dans les différentes parties de l’instrument monétaire, occasionnent dans la circulation; enfin 4° à provoquer la recherche des moyens de perfectionner l’instrument monétaire, lorsqu’il est reconnu défectueux ou insuffisant.
Qu’il y ait lieu de provoquer aujourd’hui un progrès de cette nature, cela nous paraît indubitable. En effet, nous pouvons, [II-229] en nous appuyant sur les données que nous fournissent l’économie politique, d’une part, la statistique, de l’autre, constater:
En premier lieu, qu’à mesure que la masse des échanges s’augmente et, en particulier, des échanges à terme, on éprouve à un plus haut degré le besoin de posséder un étalon des valeurs aussi stable que possible;
En second lieu, que l’or et l’argent ont subi et subissent tous les jours des fluctuations de valeur qui les rendent, en présence du besoin croissant de stabilité de l’étalon, de moins en moins propres à servir de mesure commune des valeurs.
D’où cette conclusion nécessaire qu’on sera tôt ou tard amené à abandonner les étalons métalliques pour en adopter de plus parfaits.
A quoi nous ajouterons que ce progrès serait, selon toute apparence, déjà réalisé si le monnayage, au lieu de demeurer un monopole gouvernemental, avait été abandonné à l’industrie privée et soumis à la loi de la concurrence.
[II-230]
SEPTIÈME LEÇON↩
le papier-monnaie
Perfectionnement apporté à l’altération des monnaies par l’introduction du papier-monnaie. — Caractère du papier-monnaie. — En quoi il diffère de la monnaie métallique. — Comment il peut acquérir une valeur et remplir les fonctions de monnaie. — Analyse de la valeur du papier-monnaie. — Effet de la limitation des émissions. — Origine du papier-monnaie. — Causes qui ont retardé son introduction sous l’ancien régime. — Complément de la théorie du papier-monnaie. — Histoire des assignats en France. — Causes de leur dépréciation. — Moyens employés pour l’arrêter. — Maux occasionnés par la dépréciation. — Le maximum, moyen de péréquation de l’impôt monétaire. — Ce que les assignats ont rapporté au gouvernement révolutionnaire et ce qu’ils ont coῦté à la France. — Que l’expédient du papier-monnaie a remplacé partout celui des affaiblissements des monnaies métalliques au grand profit des gouvernements, au grand dommage des peuples.
S’il n’y a point autant de différence qu’on se plaît généralement à le supposer entre les systèmes monétaires actuellement en vigueur et ceux de l’ancien régime, en revanche nous ne voyons plus les gouvernements aux abois lever des impôts [II-231] extraordinaires sur la circulation au moyen d’un affaiblissement des monnaies métalliques. Au premier abord, il semble que l’on doive s’en féliciter et que l’on ait même quelque droit, en se fondant sur ce progrès, de jeter l’anathème sur les souverains faux-monnayeurs de l’ancien régime. Cependant, quand on y regarde de plus près, on ne tarde pas à s’apercevoir que si les gouvernements modernes ont abandonné l’ancien procédé à l’aide duquel leurs devanciers taxaient la circulation, ils n’ont point renoncé à ce genre de taxe; que s’ils ont cessé d’altérer les monnaies métalliques, ce n’est point sous l’empire de scrupules moraux ou autres, c’est tout simplement parce qu’ils ont trouvé un procédé à l’aide duquel ils peuvent lever à moins de frais une taxe plus forte; c’est, pour tout dire, parce qu’ils ont perfectionné l’altération des monnaies en substituant, dans les cas de besoins extraordinaires, à la monnaie métallique le papier-monnaie.
Examinons ce qui caractérise le papier-monnaie, en quoi’il diffère de la monnaie métallique.
Le caractère de la monnaie métallique, qu’elle soit fabriquée en or, en argent, en cuivre ou en nickel, c’est de porter avec elle, dans la valeur de son étoffe, une garantie totale ou partielle de sa valeur monétaire. Le caractère du papier-monnaie, au contraire, c’est d’être fait d’une étoffe sans valeur et de ne porter, en conséquence, avec lui, aucune garantie substantielle. De là cette différence au désavantage du papier-monnaie: c’est qu’alors que la dépréciation de la monnaie métallique est toujours limitée par la valeur intrinsèque de l’étoffe dont elle est faite, la dépréciation du papier-monnaie n’est limitée par rien. Tandis que, en cas de surémission, l’une ne peut se déprécier que du montant de la différence existant [II-232] entre la valeur intrinsèque de son étoffe et sa valeur monétaire, l’autre peut perdre la totalité de sa valeur.
Mais si l’absence d’une valeur intrinsèque attachée au papiermonnaie porte au maximum le risque de dépréciation à la charge du consommateur, l’émission d’une monnaie de ce genre porte, en revanche, au maximum aussi, les bénéfices du producteur. Tandis que les profits de l’émission de la monnaie métallique se réduisent à la différence existant entre la valeur intrinsèque de l’étoffe et celle de la monnaie, déduction faite des frais de monnayage, les profits de l’émission du papier-monnaie s’étendent à toute sa valeur, déduction faite seulement des frais insignifiants de sa fabrication, à moins toutefois qu’un fonds spécial ne soit affecté à sa garantie. Dans ce cas, les frais résultant de la constitution de ce fonds spécial doivent venir encore en déduction des profits de l’émission. Mais la constitution d’un fonds spécial de garantie est un fait exceptionnel, du moins lorsqu’il s’agit du papier-monnaie proprement dit.
On conçoit, d’après cela, que les gouvernements, investis du monopole du monnayage, n’aient pas demandé mieux que de substituer, dans la confection de l’instrument des échanges, l’étoffe quasi-gratuite du papier à l’étoffe plus ou moins coῦteuse du métal, et qu’ils aient notamment, dans les cas de besoins extraordinaires, eu recours à l’emploi de cette étoffe sans valeur plutôt qu’à l’ancien procédé plus grossier et moins lucratif de la diminution de la valeur intrinsèque des espèces. D’un autre côté, on conçoit aussi que le public consommateur, après avoir expérimenté à ses dépens l’aggravation des risques que la monnaie à papier faisait peser sur lui en cas de suré-mission ait exigé, chaque fois qu’il en a eu le pouvoir, que l’on [II-233] en revînt à la monnaie métallique, au moins pour les transactions dans lesquelles elle est préférable au papier, et, quant à celles où le papier est préférable au métal, que l’on entourât son émission de garanties assez étendues et assez sῦres pour suppléer à l’absence d’une valeur intrinsèque. Nous verrons que la première de ces garanties a consisté dans l’obligation imposée au gouvernement de se dessaisir du pouvoir d’émettre de la monnaie de papier pour le confier ou l’abandonner à des établissements spéciaux, plus ou moins indépendants, c’est à dire à des banques.
Maintenant que nous avons bien spécifié la différence qui existe entre la monnaie métallique et le papier-monnaie; que nous savons que cette différence consiste en ce que la monnaie métallique porte avec elle, en valeur intrinsèque, une garantie plus ou moins étendue, depuis la moitié environ pour le billon jusqu’à la totalité ou la presque totalité pour la monnaie étalon, tandis que le papier-monnaie, dépourvu de valeur intrinsèque, ne porte avec lui aucune garantie matérielle; maintenant, dis-je, que nous sommes pleinement édifiés sur ce point capital, il s’agit de savoir comment un instrument, dépourvu de toute valeur intrinsèque, peut acquérir une valeur monétaire et remplir les fonctions de monnaie.
Ce phénomène, la théorie des métallistes le laisserait inexpliqué et inexplicable. En effet, si la valeur d’une monnaie dépend uniquement de celle de l’étoffe dont elle est faite, on ne peut fabriquer une monnaie, c’est à dire un instrument pourvu de valeur avec une étoffe sans valeur. Dans cette théorie la circulation du papier-monnaie est une impossibilité. une chimère. Cependant, cette impossibilité est un fait, cette chimère existe. Comment donc donner de son existence, si peu conforme [II-234] aux principes, une explication quelque peu présentable? L’école métalliste l’a essayé en affirmant que le papier-monnaie n’est pas une monnaie, mais la représentation ou le signe d’une monnaie. Ce n’était pas résoudre la difficulté, c’était simplement la reculer, car il s’agit toujours d’expliquer comment cette représentation ou ce signe peut acquérir une valeur monétaire. C’est, ajoutent les métallistes, quoique d’un ton moins affirmatif, parce qu’il est remboursable, à terme sinon à présentation, en monnaie métallique. Mais cette assertion est matériellement inexacte. Lorsque les gouvernements, pressés par des besoins extraordinaires, émettent du papier-monnaie, ils commencent par le déclarer actuellement non remboursable, sans assigner aucun terme à son remboursement, et l’expérience atteste ou qu’il ne l’est jamais ou que s’il lui arrive de l’être, c’est, le plus souvent, à un taux bien inférieur à celui de son émission. Cependant, il n’en remplit pas moins les fonctions d’une monnaie, et de même que la monnaie métal-lique, il ne se déprécie qu’en cas de surémission. Comment donc se fait-il que cet instrument qui n’a point de valeur intrinsèque, et qui, n’en déplaise aux métallistes, n’est point la représentation, le signe ou la promesse d’une monnaie pourvue d’une valeur intrinsèque, puisse néanmoins acquérir et même conserver indéfiniment, quand l’émission en est convenablement réglée, une valeur monétaire?
Remarquons que si la théorie des métallistes est impuissante à donner la raison de ce phénomène, elle ne l’est pas moins et pour la même cause, à expliquer pourquoi la valeur monétaire des espèces métalliques peut différer de la valeur de leur étoffe. Comme nous l’avons déjà observé, l’existence d’un seigneuriage, c’est à dire d’un profit résultant d’une différence [II-235] entre la valeur monétaire des espèces et leur valeur intrinsèque, est une impossibilité dans cette théorie. Cependant, le seigneuriage a existé autrefois sur toutes les monnaies, et il existe encore aujourd’hui sur la monnaie de billon. Or, il n’est pas difficile d’apercevoir le rapport intime qui existe entre le seigneuriage et le papier-monnaie. S’il est possible de faire circuler les monnaies métalliques pour une valeur supérieure, ne fῦt-ce que d’une quantité infinitésimale, à celle de leur étoffe augmentée des frais de fabrication, et de percevoir ainsi un seigneuriage, pourquoi ne ferait-on pas circuler des monnaies dont l’étoffe est sans valeur; dont, par conséquent, toute la valeur, déduction faite des frais de fabrication, réside dans le seigneuriage? Si l’on a pu, sous le roi Jean et sous le dauphin Charles VII, faire circuler des monnaies ne renfermant pas plus de 50 p. c. de valeur intrinsèque, pourquoi n’en ferait-on pas circuler dont la valeur intrinsèque soit de 40 p. c., de 30 p. c., de 20 p. c., de 10 p. c. seulement, et finalement même dont la valeur intrinsèque soit nulle?
L’existence du seigneuriage et la création du papier-monnaie reposent donc sur la même base, et si les métallistes n’ont réussi à expliquer ni l’une ni l’autre, c’est, comme nous l’avons remarqué au sujet du seigneuriage, faute d’avoir appliqué à la formation de la valeur des monnaies les principes quir égissent la formation de la valeur de toutes choses, en tenant compte, en même temps, de l’action particulière du monopole du monnayage.
Cette explication que l’école métalliste est impuissante à nous donner, nous la trouverons dans l’analyse de la valeur du papier-monnaie.
La valeur du papier-monnaie, comme celle de tout autre produit ou service, se compose de deux éléments: l’utilité et la rareté.
[II-236]
L’utilité du papier-monnaie réside dans les qualités qui le rendent propres à servir de monnaie. Ces qualités sont de deux sortes: physiques et économiques. Les premières sont la divisibilité, la transportabilité, l’inaltérabilité. Les secondes sont la valeur et la stabilité de la valeur.
Les qualités physiques nécessaires à un instrument des échanges, le papier-monnaie les possède même à un plus haut degré que la monnaie métallique. Il est divisible à l’infini, car on peut fabriquer, à volonté, du papier-monnaie pour les plus petites sommes comme pour les plus considérables. Il est essentiellement facile à transporter, car on en peut enfermer pour des millions dans un portefeuille. Il est particulièrement commode à manier et à compter, au moins lorsqu’il s’agit de transactions supérieures. Bref, sauf pour les transactions inférieures, il est physiquement préférable à la monnaie métallique. En ce qui concerne la durée, la monnaie de papier s’use assez rapidement, mais si, comme c’est l’habitude, on remplace les vieux billets salis ou détériorés par des neufs, elle acquiert une durée illimitée, et le frai qu’elle supporte par le fait du remplacement des vieux billets ne s’élève qu’à une somme tout à fait insignifiante. Si nous ajoutons à cela la propriété d’être aisément et à peu de frais monnayé, nous trouverons que le papier a toutes les qualités physiques requises pour servir de matière première à la monnaie.
En revanche, et c’est en cela que l’étoffe de papier differe de l’étoffe d’or ou d’argent, les qualités économiques indispensables à une monnaie, plus encore que les qualités physiques, savoir la valeur et la stabilité de la valeur manquent à cette matière première monétaire. Tandis que l’or et l’argent, qui entrent dans la composition de la monnaie, ont une valeur [II-237] propre, résultant de leur utilité pour divers usages et de leur rareté, tandis qu’il suffit, en conséquence, de les tailler et de les façonner en pièces commodes à manier, pour avoir un instrument des échanges réunissant à la fois les qualités physiques et les qualités économiques nécessaires à la monnaie, le papier-monnaie ne trouve dans sa matière première aucune partie de sa valeur: cette valeur lui vient tout entière de l’opération du monnayage. Observons à ce propos que la monnaie est du petit nombre des choses qui tirent leur utilité de leur valeur. Sous ce rapport, on peut distinguer deux catégories de produits: dans la première, de beaucoup la plus importante, figurent toutes les choses directement nécessaires à la satisfaction de nos besoins essentiels, les denrées alimentaires, par exemple, qui conserveraient toute leur utilité, alors même que la Providence jugerait bon de nous les fournir gratis, et les dépouillerait ainsi de toute valeur. Dans la seconde catégorie figurent les choses qui n’acquièrent la propriété de satisfaire directement à certains de nos besoins ou de remplir certaines fonctions économiques qui contribuent à faciliter cette satisfaction, que parce qu’ils sont pourvus de valeur. Tel est, pour le premier cas, le diamant qui perdrait certainement de son utilité comme article d’ostentation s’il devenait aussi commun que le charbon ordinaire. Telle est, pour le second cas, la monnaie qui, ayant pour fonction spéciale de faciliter la transmission des valeurs, eu leur servant d’intermédiaire, demeurerait absolument sans utilité si elle était sans valeur.
Ainsi donc, le papier-monnaie ne peut trouver dans son étoffe qu’une partie des qualités constitutives de sa valeur, tandis que la monnaie métallique les y peut trouver réunies. L’étoffe de papier ne possède que les qualités physiques nécessaires à [II-238] une monnaie, alors que l’étoffe d’or ou d’argent y joint les qualités économiques de la valeur, et, dans une certaine mesure, de la stabilité de la valeur.
Que résulte-t-il de là? C’est qu’alors qu’on n’ajoute par l’opération du monnayage qu’une simple portion de valeur à l’étoffe métallique, parfois même qu’on n’y ajoute aucune portion de valeur lorsque le monnayage est gratuit, on procure au papier, en le monnayant, toute sa valeur monétaire. De quelle manière? En lui attribuant artificiellement la qualité que les métaux précieux possèdent naturellement, savoir la rareté. En d’autres termes, en créant avec une matière première commune, mais physiquement propre au monnayage, un instrument monétaire plus ou moins rare.
Le procédé à employer pour atteindre ce but, c’est de limiter l’émission du papier-monnaie, de manière à lui attribuer la somme de valeur requise. Que ce procédé suffise pour amener le résultat voulu, c’est à dire pour donner de la valeur à un produit dont la matière première en est presque dépourvue, et dont la façon ne coùte que peu de chose, c’est un fait d’expérience, et ce fait est d’ailleurs pleinement conforme aux lois qui gouvernent la valeur.
Essayons de nous en rendre compte.
Il existe, dans toute société, au sein de laquelle les industries ont commencé à se spécialiser et les travaux à se diviser, où, en conséquence, chacun a besoin d’échanger les produits de son travail ou son travail même contre les produits ou le travail d’autrui, il existe, disons-nous, un besoin, partant, une demande d’une certaine quantité de monnaie, autrement dit d’un produit sui generis, ayant les qualités nécessaires pour servir d’instrument des échanges. Il devient, en conséquence, [II-239] avantageux de façonner ce produit, et on ne manque pas de le faire. La demande de la monnaie en provoque l’offre, et la valeur de ce produit nouveau, comme celle de tout autre, est déterminée par le rapport de l’offre et de la demande. Quand la monnaie est beaucoup demandée et peu offerte sa valeur s’élève et vice-versâ.
Mais pour qu’une monnaie soit demandée, il faut qu’elle réunisse à la fois les qualités physiques et les qualités économiques d’un instrument des échanges, qu’elle soit, d’une part, maniable, transportable, etc., d’une autre part, pourvue d’une valeur suffisamment stable. Les monnaies façonnées avec des matériaux précieux possèdent, dans leur étoffe même, ces deux sortes de qualités. Les monnaies façonnées avec des matériaux sans valeur ou d’une valeur inférieure à celle qu’il s’agit de leur attribuer ne possèdent, entièrement du moins, que les premières. D’où résulte la nécessité de compléter ou de créer les secondes. Comment? N’oublions pas que la valeur est le produit de deux éléments bien distincts, l’utilité et la rareté; n’oublions pas, non plus, que, — particularité exceptionnelle, — la valeur même est un des éléments constitutifs de l’utilité de la monnaie. Si donc une chose possède les qualités constituantes de l’utilité monétaire moins la valeur, il suffira d’y ajouter l’élément pur de la rareté, dans le degré requis, pour la rendre propre à servir de monnaie. Or la rareté s’obtient par la limitation de la production.
Il suffit, comme on le voit, de limiter la production du papiermonnaie pour lui donner la seule qualité qui lui manque, — qualité essentielle à la vérité, — pour servir d’instrument des échanges. Cela fait, si le public consommateur possède ou croit posséder les garanties nécessaires à l’observation de cette condition, [II-240] il y aura demande pour le papier-monnaie comme pour la monnaie métallique. A quoi il faut ajouter que si le papiermonnaie est mieux approprié à certaines catégories d’échanges que tout autre instrument monétaire, il sera, pour les échanges de cette catégorie, demandé de préférence.
Nous venons de voir à quelles conditions la demande du papier-monnaie est possible. Comme toute demande, celle-ci ne peut manquer de provoquer une offre correspondante, du moment où les éléments et les conditions nécessaires à la production de la chose demandée se trouvent réunis quelque part. Ainsi donc, on a dῦ produire du papier-monnaie, dès qu’il s’est rencontré un entrepreneur de monnayage ayant à sa disposition la matière première nécessaire à la fabrication de cet instrument particulier des échanges, les outils et les procédés propres à la façonner, le pouvoir, la science et la volonté d’en limiter, dans le mesure requise, la production.
L’histoire atteste que c’est ainsi, en effet, que les choses se sont passées; et déjà à une époque reculée on voit apparaître des instruments monétaires fabriqués avec des peaux, des étoffes ou des écorces d’arbres, dans lesquels on reconnaît les caractères essentiels du papier-monnaie. Les Carthaginois, par exemple, possédèrent une monnaie en cuir, qui tirait évidemment sa valeur de la limitation de l’émission. Mais les peaux et les étoffes n’avaient point au même degré que le papier les qualités nécessaires pour servir de matière première à une monnaie: elles étaient plus lourdes, moins maniables, plus difficiles à monnayer, et la monnaie qui en était tirée pouvait être plus aisément contrefaite. Le papier seul réunissait à un degré suffisant les qualités physiques réquises pour ce genre de monnayage. Aussi les Chinois qui inventèrent le papier, paraissentils [II-241] l’avoir appliqué, de bonne heure, à cet usage. Koblaï, petit fils de Gengis Khan, émit du papier-monnaie à la fin du XIIIe siècle, et il y a apparence qu’on trouverait, à une époque bien antérieure, des traces de son existence à la Chine.
Cependant le papier-monnaie fut lent à se propager, et aussi longtemps que les gouvernements conservèrent le monopole de son émission, son existence ne fut jamais que temporaire. Après l’avoir accepté ou subi pendant une période plus ou moins longue, les consommateurs finissaient toujours par le rejeter, en exigeant qu’on leur rendît de la monnaie métallique. A quoi cela tenait-il? A la supériorité physique de la monnaie de métal? Non! L’expérience a démontré, plus tard, que pour un bon nombre de transactions, la monnaie de papier est physiquement supérieure à la monnaie de métal. Cela tenait à une autre cause, savoir, à ce que les gouvernements, investis du monopole du monnayage, ne se trouvèrent jamais, au moins d’une manière suivie, dans les conditions voulues pour conserver longtemps au papier-monnaie ses qualités économiques (valeur et stabilité de la valeur), en en réglant l’offre conformément à la demande; c’est que chaque fois qu’ils en firent l’essai, ils finirent, sous l’empire de quelque nécessité urgente, par exagérer l’offre du papier et par tuer ainsi littéralement la poule aux œufs d’or.
Que les gouvernements de l’ancien régime, par exemple, ne se trouvassent point dans les conditions voulues pour entreprendre l’émission du papier-monnaie; qu’ils fussent, par conséquent, pour la plupart du moins, dans l’impossibilité d’en émettre, malgré l’avantage qu’ils y auraient trouvé, c’est ce que nous allons essayer de faire comprendre en peu de mols.
Il y a deux moyens de faire entrer le papier-monnaie dans la [II-242] circulation, de gré ou de force. Le premier de ces deux procédés eῦt-il été efficace? Examinons. Il aurait fallu, pour se tenir dans les conditions d’une émission libre, que le gouvernement se bornât à offrir du papier-monnaie à tous ceux qui lui en auraient demandé; ou ce qui revient au même à tous ceux qui lui auraient offert en échange une contre-valeur sous forme de métaux ou d’autres produits. Cette contre-valeur aurait été pour lui, en totalité, un seigneuriage, déduction faite seulement des frais d’étoffe et de monétisation du papier. Mais qu’avonsnous constaté en esquissant l’histoire du monnayage sous l’ancien régime? C’est qu’aussitôt que le souverain élevait, d’une manière sensible, son seigneuriage, on cessait de lui apporter des métaux à échanger contre sa monnaie. Pourquoi? Parce que le risque de dépréciation de la monnaie s’était accru d’autant; parce que l’expérience démontrait que le souverain ne se faisait point faute, en cas de nécessité, de monnayer au rabais pour son propre compte, aussi longtemps qu’il y pouvait trouver un bénéfice. Or si le souverain s’adonnait à cette pratique, lorsque le seigneuriage n’entrait que pour 10 p. c. ou 15 p. c. dans la valeur de la monnaie, à plus forte raison s’y serait-il livré lorsque le seigneuriage aurait compris la totalité de cette valeur. Il n’aurait certainement pas manqué, en cas de nécessité (et ce cas était pour ainsi dire permanent), de monnayer du papier pour son propre compte et d’en offrir des quantités croissantes, sans avoir égard à l’état de la demande, jusqu’à ce qu’il cessât d’y trouver profit, c’est à dire jusqu’à ce que le papier-monnaie eῦt perdu toute valeur. L’introduction libre du papier-monnaie eῦt donc été impossible sous ce régime. Pouvait-on davantage l’imposer? Nous avons vu qu’on ne parvenait déjà qu’avec une difficulté extrême à imposer des monnaies dont la [II-243] garantie était affaiblie dans la proportion de la moitié ou du quart, et par conséquent dépréciables seulement dans cette proportion; à plus forte raison eῦt-il été difficile d’imposer une monnaie sans aucune garantie matérielle et par conséquent dépréciable de la totalité de sa valeur. Il aurait fallu pour cela un pouvoir plus grand que celui dont disposaient les gouvernements de l’ancien régime.
Si nous joignons à ce défaut des conditions économiques requises pour l’émission du papier-monnaie, chez ceux qui avaient le monopole de la production de la monnaie, l’ignorance où l’on demeura longtemps de son invention, l’absence des matières propres à le fabriquer, la difficulté d’opérer cette fabrication, de manière à éviter le danger de la contrefaçon, l’insuffisance même des moyens d’empêcher la contrefaçon en la réprimant, nous nous expliquerons que le papier-monnaie ait tardé si longtemps à se répandre, malgré les bénéfices énormes que sa fabrication pouvait présenter en comparaison de ceux que l’on tirait du monnayage des métaux.
C’est seulement à dater du XVIIe siècle qu’on le voit apparaître; mais l’insuffisance des conditions requises pour son émission ne manque pas dès lors d’occasionner des catastrophes. Les populations ne l’acceptent qu’avec défiance, et les gouvernements sont obligés de recourir, pour forcer la circulation de cette monnaie dépourvue de garantie matérielle, à des procédés analogues à ceux que les gouvernements du moyen âge employaient pour forcer la circulation des monnaies métalliques dont ils avaient affaibli la garantie. Nous nous convaincrons de l’entière similitude de ces procédés en esquissant l’histoire des assignats en France. Mais, auparavant, nous avons à compléter encore la théorie du papier-monnaie.
[II-244]
Au point où nous avons amené cette théorie, nous pouvons regarder comme démontré: 1° que la valeur du papier-monnaie renferme les deux éléments constitutifs de toute valeur, l’utilité et la rareté, avec cette particularité que la rareté y figure en partie double, savoir, d’abord comme partie intégrante de l’utilité, ensuite comme partie complémentaire; 2° que la valeur du papier-monnaie est gouvernée, comme celle de toute chose, par la loi de l’offre et de la demande; qu’elle est déterminée, dans les échanges, par les quantités qui en sont offertes d’une part, demandées de l’autre; que le rapport de ces quantités en fixe le niveau.
Il nous reste maintenant à rechercher comment il se fait que ce niveau puisse demeurer, d’une manière normale, au dessus de celui des frais de production du papier-monnaie, contrairement à la seconde loi régulatrice des valeurs, en vertu de laquelle la valeur de tous les produits ou services tend incessamment à s’établir au niveau de leurs frais de production.
Les frais matériels de production du papier-monnaie sont à peu près nuls, car un assignat de 10,000 fr., par exemple, ne coῦtait certainement pas plus d’un franc d’étoffe et de frais de fabrication; en outre, cette étoffe et ces frais étaient à peu près les mêmes pour un assignat de 10,000 fr. que pour un assignat de 10 fr. Comment donc expliquer cette dérogation apparente à la loi des frais de production?
Cette explication se trouvera aisément si l’on songe qu’il s’agit ici d’une industrie de monopole. C’est seulement, comme on sait, sous un régime de libre concurrence que la valeur des choses tend à se niveler avec leurs frais de production. Sous un régime de monopole, au contraire, le producteur étant le maître de régler à sa guise l’offre du produit ou du service en [II-245] présence de la demande, la valeur de ce produit, ou de ce service peut se maintenir fort au dessus des frais de production.
Cela étant, la théorie du papier-monnaie est complète, en ce sens que l’on sait pourquoi le papier-monnaie a une valeur, d’où lui vient cette valeur et comment elle se règle. Mais il semble résulter de cette théorie, comme de celle de la monnaie de billon, que le monopole est le seul régime qui convienne pour l’émission de ces deux monnaies; qu’en admettant, par exemple, que le monnayage de l’or et de l’argent vint à être abandonné à la libre concurrence, il faudrait réserver toujours au gouvernement le monopole du monnayage du billon et du papier-monnaie. Sinon, la société se trouverait placée en présence de cette alternative: ou de n’avoir à sa disposition que des monnaies dont la valeur ne dépasserait point celle de leur étoffe augmentée des frais de fabrication réglés au taux ordinaire de la concurrence, ou, en admettant qu’il pῦt exister, sous ce régime, des monnaies dont la valeur serait supérieure à celle de leurs frais de production, la société serait obligée de payer, de ce chef, une rente, provenant de la différence de la valeur du produit-monnaie avec celle de ses frais de production. Or cette rente, ne vaudrait-il pas mieux que les consommateurs de monnaie la payassent à la communauté elle-même représentée par l’État, plutôt qu’à des entreprises particulières? En conséquence, l’émission du papier-monnaie et du billon ne devrait-elle point être, par sa nature même, un monopole d’État?
Nous nous bornerons, pour le moment, à répondre d’une manière sommaire à cette question, en nous réservant d’y revenir au chapitre des banques.
[II-246]
En premier lieu, quoique la supériorité de la valeur du papier-monnaie et du billon, sur leurs frais de production, ait sa source dans le monopole du monnayage, cette supériorité pourrait être maintenue cependant sous un régime de concurrence, en admettant, chose qui n’est nullement incompatible avec ce régime, que les entreprises libres de monnayage eussent la propriété exclusive de leurs marques et coins particuliers, ainsi que des moyens efficaces de la garantir. Cela étant, ces entreprises pourraient limiter l’offre de la monnaie marquée à leur coin et du papier-monnaie revêtu de leurs empreintes, absolument comme le ferait un gouvernement. Que s’il existait donc une demande de monnaie de billon et de papier-monnaie, c’est à dire d’instruments des échanges non garantis en totalité ou en partie par une valeur intrinsèque, cette demande pourrait être satisfaite sous un régime de concurrence et de propriété combinées, aussi bien que sous un régime de monopole.
En second lieu, la supériorité de la valeur du papier-monnaie et du billon sur leurs frais de production donnerait-elle nécessairement, sous ce régime, naissance à une rente? En aucune façon. Qu’est-ce que la rente? C’est une prime qui s’ajoute aux frais de production [44] . Et quel est l’effet de cette prime? C’est d’attirer vers la branche de la production à laquelle elle s’attache les capitaux, les intelligences et les bras jusqu’à ce que, par le fait de cet accroissement naturel de la concurrence, elle ait disparu. Eh bien! si l’industrie libre du monnayage du papier ou du billon venait à percevoir une rente en sus des profits ordinaires de la production, la concurrence ne [II-247] manquerait pas d’y affluer, jusqu’à ce que cette rente eῦt disparu. Seulement, l’action de la concurrence ne porterait point sur la valeur monétaire de l’instrument des échanges; les nouvelles entreprises, attirées par la prime dont jouissaient les anciennes, n’offriraient point du billon ou du papier-monnaie d’une valeur moindre, ce qui ne présenterait aucun avantage aux consommateurs, puisque la monnaie est utilisée en raison de sa valeur, mais ils en feraient payer l’usage moins cher. La production du papier-monnaie ou du billon n’exige point, — et ceci est une observation fondamentale, — l’investissement d’un capital aussi considérable que celle de la monnaie dite réelle. Car à la matière coῦteuse dont est faite celle-ci et qui lui sert de garantie, on substitue une matière moins chère ou presque sans valeur, en remplaçant la garantie matérielle de la substance des espèces par des sécurités d’une autre nature et beaucoup moins coῦteuses. Le capital employé à la production d’une somme donnée de papier-monnaie ou de billon étant moindre que celui qui est nécessaire pour produire une somme égale de monnaie réelle, il en résulte que le prix de loyer du papier-monnaie ou du billon peut être diminué de la différence. Sous un régime de monopole d’État ou de délégation de ce monopole à des banques privilégiées, les producteurs de monnaie profitent de cette différence, qui constitue le principal avantage du papiermonnaie; qui en fait, par excellence, la monnaie à bon marché; tandis que sous un régime de libre concurrence, ce profit, résultant de l’invention d’un instrument perfectionné des échanges, irait nécessairement au consommateur.
Maintenant que nous avons esquissé à grands traits la théorie du papier-monnaie, illustrons-la en racontant un des épisodes les plus célèbres et les plus lamentables du douloureux [II-248] enfantement de cette monnaie à bon marché, nous voulons parler de l’épisode des assignats.
Les embarras des finances ont été, comme on sait, l’occasion, sinon la cause de la révolution française. Les guerres de Louis XIV, le système de Law, les désordres et les banqueroutes du règne de Louis XV avaient fait passer le déficit à l’état chronique. Sous Louis XVI, cette situation n’aurait pas manqué de s’améliorer, si la guerre d’Amérique n’était venue imposer au trésor, de longue date obéré, des dépenses extraordinaires. Cette guerre qui ne coῦta pas moins de 1,800 millions à la France porta à 140 millions le déficit annuel, et ce déficit motiva la convocation des États Généraux. Mais l’assemblée nationale, au lieu de remédier au mal, ne fit que l’aggraver. Les retranchements qu’elle opéra dans les impôts pour se créer une popularité facile, sans réduire, dans la même proportion, les dépenses publiques, contribuèrent, au contraire, à élargir le déficit qu’elle avait pour mission de combler. Les embarras financiers allèrent donc toujours croissant. On essaya de les conjurer en mettant en vente les biens du clergé que l’on venait de réunir au domaine public, mais les scrupules religieux, d’une part, la crainte d’une réaction, de l’autre, éloignèrent les acheteurs. On imagina de créer un papier assigné sur ces biens, c’est à dire un papier auquel les biens nationaux serviraient de gage spécial, que l’on retirerait de la circulation à mesure que les ventes le feraient rentrer, et à l’aide duquel on pourrait ainsi escompter la valeur du gage. La première émission d’assignats eut lieu au mois d’avril 1790. Elle fut de 400 millions. Comme la place naturelle qui revient au papier dans la circulation n’était occupée qu’en partie par les billets de la Caisse d’escompte, comme, d’une autre part, la somme émise [II-249] demeurait fort au dessous de la valeur du gage spécial sur lequel elle se trouvait hypothéquée, comme enfin les assignats étaient reçus sur le même pied que les espèces métalliques en paiement des impôts, et devaient l’être dans le règlement des comptes entre débiteurs et créanciers, les assignats furent demandés, d’abord, autant qu’ils étaient offerts, et ils ne subirent, en conséquence, aucune dépréciation. Tous ceux qui avaient préconisé l’adoption de la mesure firent naturellement sonner bien haut ce succès. Voici notamment, en quels termes, Mirabeau en félicitait l’assemblée:
“Vous décrétâtes successivement, dit-il, que l’on procéderait à la vente de 400 millions de biens nationaux et qu’en attendant que la vente en fῦt effectuée, le gage de cette vente et son produit anticipé tiendraient lieu de numéraire. Vous créâtes à cet effet, sous le nom d’assignats, des billets, espèce de lettres de change, qui sont en fait de valeur tout ce que peut être un effet qui n’est pas de l’argent réel.
“Cette mesure eut tout le succès annoncé par ceux qui l’avaient conçue. Les mauvais succès présagés par ses adversaires ont été rélégués parmi les fictions malheureuses, et la chose publique sortit alors de cet état de détresse qui nous menaçait d’une ruine prochaine.”
Mirabeau faisait valoir encore les motifs politiques qui devaient engager, selon lui, le gouvernement à multiplier les assignats.
“Vous hésiteriez à les adopter comme une mesure de finance, disait-il, que vous les embrasseriez comme un instrument sῦr et actif de la révolution. Partout où se placera un assignat-monnaie, là sῦrement reposera avec lui un vœu secret pour le crédit des assignats, pour leur solidité; partout où quelque partie de ce gage public sera répandue, là se trouveront [II-250] des hommes qui voudront que la conversion de ce gage soit effectuée, que les assignats soient échangés contre des biens nationaux, et comme enfin le sort de la constitution tient à la sῦreté de cette ressource, partout où se trouvera un porteur d’assignats vous compterez un défenseur nécessaire de vos mesures, un créancier intéressé à vos succès.”
Sous cette double influence des raisons financières et politiques, on se laissa facilement entraîner à multiplier les assignats. On n’avait d’ailleurs encore que des notions confuses sur la nature de la richesse et sur les causes de la valeur de la monnaie. On croyait volontiers que l’abondance de la monnaie constitue la richesse, ainsi que l’enseignaient les docteurs du système mercantile; on était aussi disposé à s’exagérer le pouvoir que le monopole du monnayage confère au gouvernement, quant au règlement de la valeur de la monnaie. Bien des gens étaient persuadés que ce pouvoir était illimité, et, en conséquence, que la mine des assignats, qui venait de donner des résultats si prestigieux et si inespérés, serait inépuisable. Les circonstances rendaient, en outre, cette ressource de plus en plus nécessaire. La république avait succédé à la monarchie, et tandis que les revenus ordinaires diminuaient par suite de la suppression de la plupart des impôts et des progrès de l’anarchie intérieure, les dépenses allaient croissant par suite des exigences de la lutte que la république avait entreprise contre l’Europe coalisée. Les assignats devinrent bientôt l’unique ressource de la république, et cette ressource, elle l’exploita à outrance. Les émissions devenant excessives, les assignats se déprécièrent. Alors des mesures draconiennes furent prises soit pour arrêter la baisse, soit pour en répartir, de la manière la plus égale possible, le dommage entre les différentes classes [II-251] de la population. Dans son Histoire de la Révolution française, M. Thiers expose avec beaucoup de lucidité ces mesures et leurs résultats:
“La révolution qui, en abolissant la monarchie, avait voulu néanmoins payer sa dette; qui, en détruisant la vénalité des offices, s’était engagée à en rembourser la valeur; qui, en défendant enfin le nouvel ordre de choses contre l’Europe conjurée, était obligée de faire les frais d’une guerre universelle, avait, pour suffire à toutes ces charges, les biens nationaux enlevés au clergé et aux émigrés. Pour mettre en circulation la valeur de ces biens, elle avait imaginé les assignats qui en étaient la représentation, et qui, par le moyen des achats, devaient rentrer au trésor et être brῦlés. Mais comme on doutait du succès de la révolution et du maintien des ventes, on n’achetait pas les biens. Les assignats restaient dans la circulation, comme une lettre de change non acceptée et s’avilissaient par le doute et par la quantité.
“Le numéraire seul restait toujours comme mesure réelle des valeurs; et rien ne nuit à une monnaie contestée comme la rivalité d’une monnaie certaine et incontestée. L’une se resserre et refuse de se donner, tandis que l’autre s’offre en abondance et se discrédite en s’offrant. Tel était le sort des assignats par rapport au numéraire. La révolution, condamnée à des moyens violents, ne pouvait plus s’arrêter. Elle avait mis en circulation forcée la valeur anticipée des biens nationaux; elle devaît essayer de la soutenir par des moyens forcés. Le ll avril 1793, malgré les Girondins, qui luttaient généreusement mais imprudemment, contre la fatalité de cette situation révolutionnaire, la Convention punit de six ans de fers quiconque vendrait du numéraire, c’est à dire échangerait une certaine quantité d’argent ou d’or contre une quantité nominale plus grande d’assignats. Elle punit de la même peine quiconque stipulerait pour les marchandises un prix différent, suivant que le paiement se ferait en numéraire ou en assignats.
“Ces moyens n’empêchaient pas la différence de se prononcer rapidement. [II-252] En juin, un franc métal valait trois francs assignats; et en aoùt, deux mois après, un franc argent valait six francs assignats. Le rapport de diminution, qui était de un à trois, s’était donc élevé de un à six.
“Dans une pareille situation, les marchands refusaient de donner leurs marchandises au même prix qu’autrefois, parce que la monnaie qu’on leur offrait n’avait plus que le cinquième ou le sixième de sa valeur. Ils les resserraient donc et les refusaient aux acheteurs. Sans doute, cette diminution de valeur eῦt été pour les assignats un inconvénient absolument nul, si tout le monde ne les recevant que pour ce qu’ils valaient réellement les avait pris et donnés au même taux. Dans ce cas, ils auraient toujours pu faire les fonctions de signe dans les échanges et servir à la circulation comme toute autre monnaie; mais les capitalistes qui vivaient de leurs réserves, les créanciers de l’État qui recevaient ou une rente annuelle ou le remboursement d’un office, étaient obligés d’accepter le papier suivant sa valeur nominale. Tous les débiteurs s’empressaient de se libérer, et les créanciers, forcés de prendre une valeur fictive, ne touchaient que le quart, le cinquième ou le sixième de leur capital. Enfin, le peuple ouvrier, toujours obligé d’offrir ses services, de les donner à qui veut les accepter, ne sachant pas se concerter pour faire augmenter les salaires du double, du triple, à mesure que les assignats diminuaient dans la même proportion, ne recevait qu’une partie de ce qui lui était nécessaire pour obtenir en échange les objets de ses besoins. Le capitaliste, à moitié ruiné, était mécontent et silencieux; mais le peuple furieux appelait accapareurs les marchands qui ne voulaient pas lui vendre au prix ordinaire et demandait qu’on envoyât les accapareurs à la guillotine.
“Cette fâcheuse situation était un résultat nécessaire de la création des assignats, comme les assignats eux-mêmes furent amenés par la nécessité de payer les dettes anciennes, des offices et une guerre ruineuse; et, par les mêmes causes, le maximum devait bientôt résulter des assignats. Pen importait, en effet, qu’on eῦt rendu cette monnaie forcée, [II-253] si le marchand, en élevant ses prix, parvenait à se soustraire à la nécessité de la recevoir. Il fallait rendre le taux de la marchandise forcé comme celui de la monnaie. Dès que la loi avait dit: le papier vaut dix francs, elle devait dire: telle marchandise ne vaut que six francs; car, autrement le marchand, en la portant à douze, échappait à l’échange.
“Il avait donc fallu encore, malgré les Girondins, qui avaient donné d’excellentes raisons puisées dans l’économie ordinaire des choses, établir le maximum des grains. La plus grande souffrance pour le peuple, c’est le défaut de pain. Les blés ne manquaient pas, mais les fermiers qui ne voulaient pas affronter le tumulte des marchés ni livrer leur blé au taux des assignats se cachaient avec leurs denrées. Le peu de grain qui se montrait était enlevé rapidement par les communes et par les individus que la peur engageait à s’approvisionner. La disette se faisait encore plus sentir à Paris que dans aucune autre ville de France, parce que les approvisionnements pour cette cité immense étaient plus difficiles, les marchés plus tumultueux, la peur des fermiers plus grande. Les 3 et 4 mai, la Convention n’avait pu s’empêcher de rendre un décret par lequel tous les fermiers ou marchands de grains étaient obligés de déclarer la quantité de blé qu’ils possédaient, de faire battre ceux qui étaient en gerbe, de les porter dans les marchés, et exclusivement dans les marchés, et de les vendre à un prix moyen fixé par chaque commune et basé sur les prix antérieurs du ler janvier au ler mai. Personne ne pouvait acheter pour suffire à ses besoins au delà d’un mois; ceux qui avaient vendu ou acheté à un prix au dessus du maximum, ou menti dans leurs déclarations, étaient punis de la confiscation ou d’une amende de 300 à 1,000 francs. Des visites domiciliaires étaient ordonnées pour vérifier la vérité; de plus, le tableau de toutes les déclarations devait être envoyé par les municipalités, au ministre de l’intérieur, pour faire une statistique générale des subsistances de la France. La commune de Paris, ajoutant les arrêtés de police aux décrets de la Convention, avait réglé en outre la distribution du pain dans les boulangeries. [II-254] On ne pouvait s’y présenter qu’avec des cartes de sῦreté. Sur cette carte, délivrée par les comités révolutionnaires, était désignée la quantité de pain qu’on pouvait demander, et cette quantité était proportionnée au nombre d’individus dont se composait chaque famille. On avait réglé jusqu’à la manière dont on devait faire queue à la porte des boulangers. Une corde était attachée à leur porte; chacun la tenait par la main, de manière à ne pas perdre son rang et à éviter la confusion. Cependant de méchantes femmes coupaient souvent la corde; un tumulte épouvautable s’ensuivait et il fallait la force armée pour rétablir l’ordre. On voit à combien d’immenses soucis est condamné un gouvernement, et à quelles mesures vexatoires il se trouve entraîné, dès qu’il est obligé de tout voir pour tout régler. Mais, dans cette situation, chaque chose s’enchaînait à une autre. Forcer le cours des assignats avait conduit à forcer le cours des échanges, à forcer les prix, à forcer même la quantité, l’heure, le mode des achats; le dernier fait résultait du premier, et le premier avait été inévitable comme la révolution elle-même [45] .”
Les effets désastreux de l’émission excessive des assignats se trouvent exposés, avec beaucoup de clarté, dans ce morceau; en revanche, l’explication que l’auteur en donne est, sur certains points, erronée, et, sur d’autres, insuffisante.
Nous avons vu pourquoi les assignats purent entrer, sans se déprécier, dans la circulation. Ils se soutinrent ensuite quelque temps, malgré l’augmentation des émissions, sous l’influence de la situation exceptionnelle que la révolution avait créée. En premier lieu, l’état de crise où se trouvait la France avait eu pour résultat d’anéantir presque entièrement le crédit et par conséquent d’exiger une somme plus considérable de [II-255] monnaie pour effectuer les échanges, bien que le nombre et l’importance de ceux-ci fussent considérablement réduits. En second lieu, le manque de sécurité dans le présent et de confiance dans l’avenir avait engagé beaucoup de gens à réaliser leurs capitaux sous forme d’espèces métalliques et à thésauriser ces espèces, en les dérobant ainsi à la circulation. Les assignats comblèrent le déficit monétaire créé par l’action de ces deux causes. De là le succès de premières émissions: cependant le gouvernement n’avait pas émis les assignats en vue de pourvoir aux besoins de la circulation, mais en vue de pourvoir à ses propres besoins. Ceux-ci allant croissant, il continua ses émissions après que la circulation eut cessé d’en réclamer de nouvelles. De là, la dépréciation. Cette dépréciation qui frappait la ressource la plus précieuse dont le gouvernement révolutionnaire pῦt disposer était désastreuse pour lui. Il s’attacha en conséquence à la combattre. Le procédé auquel il eut recours, consista en premier lieu, dans la défense d’établir une différence entre la valeur des assignats et celle de la monnaie métallique. Quel pouvait être l’effet de cette mesure? Pouvait-elle arrêter la dépréciation? Directement, non; indirectement, oui. Comme on punissait de six ans de fers tout individu qui refusait de céder de la monnaie métallique au cours des assignats; qui demandait en échange d’un franc en métal plus d’un franc en assignats, ou qui se faisait payer plus ou moins cher ses produits ou ses services, selon qu’il les échangeait contre des assignats ou contre des espèces métalliques; comme personne ne se souciait néanmoins de perdre la différence existant entre la valeur des espèces et celle des assignats, dès que la dépréciation se fut prononcée, chacun renonça à employer du numéraire pour effectuer ses échanges, ou du moins on ne l’employa [II-256] plus que lorsqu’on pouvait le faire passer à son cours naturel sans attirer sur soi les rigueurs de la loi. Dans l’effervescence du régime de la terreur, le risque de l’application de la loi ayant acquis une grande intensité, le numéraire se retira presque en totalité d’un marché où il ne pouvait plus s’échanger qu’à perte, à moins d’exposer les échangistes à un risque redoutable, et il en résulta, au profit des assignats, une augmentation artificielle du débouché monétaire. On obtint, au moyen de cette mesure, un résultat analogue à celui que les gouvernements de l’ancien régime atteignaient en décriant les bonnes monnaies existantes pour leur substituer des monnaies affaiblies. Si l’on ne relevait pas directement le cours des assignats, en obligeant les détenteurs du numéraire à le céder au pair du papier, chose impraticable, et qui, en la supposant possible, n’aurait fait que déprécier les espèces sans profit pour le papier, on le relevait indirectement en chassant de la circulation la monnaie de métal, et en y élargissant par là même la place de la monnaie de papier.
Cependant, l’effet de cette mesure ne pouvait être que temporaire. Les émissions continuant sous la pression des besoins croissants de la révolution, la concurrence de la monnaie de métal avait beau être écartée, la limite extrême du débouché ouvert aux assignats devait être bientôt atteinte et dépassée. La dépréciation reprit donc son cours, et elle se prononça chaque jour davantage. Cette dépréciation causait un mal général que M. Thiers paraît méconnaître, et qui, par l’inégalité de ses incidences, causait à certaines classes de la population des maux particuliers, dont l’historien de la révolution a fort bien décrit les effets.
Le mal général provenait de l’instabilité du papier-monnaie, [II-257] remplissant, comme la monnaie métallique, le double rôle de mesure des valeurs et d’instrument intermédiaire des échanges.
La dépréciation occasionnait d’abord, chaque fois qu’elle venait à se produire, une perte d’autant, à tous les détenteurs du papier-monnaie. Sans doute, la richesse existant sous forme de monnaie n’est qu’une faible portion de la richesse générale, et si l’on fait le bilan de chacune des familles qui composent une nation, on trouvera que la monnaie en caisse ou en portefeuille ne forme qu’une fraction minime de son avoir; mais encore la dépréciation de cette portion de la richesse générale est-elle à considérer.
Le dommage provenant de l’existence d’un risque de dépréciation était plus considérable encore. Quand on a entre les mains une valeur exposée à se déprécier du jour au lendemain, on s’efforce de s’en défaire le plus tôt possible; on n’en garde que ce qui est rigoureusement nécessaire. On fait, par conséquent, des achats et des approvisionnements de tous genres au delà de ses besoins réels, et l’on finit par se mettre ainsi dans la gêne. Quand cette situation se prolonge, on est réduit soit à emprunter à de dures conditions, soit à revendre à perte, et l’on s’appauvrit d’une manière progressive. D’un autre côté, les marchands qui n’ont pas un besoin urgent de vendre tiennent compte du risque de dépréciation attaché à la monnaie, en supputant, autant que possible, le temps pendant lequel ils seront obligés de la conserver. Les marchandises haussent, en conséquence, non seulement par le fait de la dépréciation déjà accomplie, mais encore par le fait de la dépréciation éventuelle. M. Thiers remarque, à la vérité, que “la diminution de valeur eῦt été pour les assignats un inconvénient absolument nul, si tout le monde ne les recevant que pour ce qu’ils valaient réellement [II-258] les avait pris et donnés au même taux. “Mais c’est là une hypothèse absurde. La dépréciation ayant lieu, et elle devait infailliblement avoir lieu à la suite d’émissions exagérées, il était impossible que chacun prît et donnât les assignats au même taux. On les prenait à un certain taux, et la dépréciation survenant on les donnait au taux diminué, en perdant la différence, sauf quand on avait pu se couvrir de ce risque, en rehaussant le prix des marchandises ou des services en échange desquels on avait reçu la monnaie maintenant dépréciée. Dans ce dernier cas, on subissait encore un dommage provenant de la diminution de la demande des marchandises ou des services dont le prix était exhaussé, et cette diminution de la demande devait encore engendrer une réaction vers la baisse.
Cependant si la dépréciation des assignats occasionnait une perte qui ne pouvait être évitée, que les consommateurs de monnaie pouvaient seulement essayer avec plus ou moins de succès, selon leur situation particulière, de se renvoyer les uns aux autres, certaines classes de la population devaient nécessairement en souffrir plus que d’autres. Les rentiers de l’État, les propriétaires de terres ou de maisons, les prêteurs à longue échéance, les employés et, en général, les classes vivant de revenus fixes ou modifiables seulement à longs termes étaient particulièrement atteints. A la vérité, les propriétaires dont les baux venaient à expirer et les prêteurs à courte échéance pouvaient, dans une certaine mesure, s’assurer contre le risque de la dépréciation, en élevant ceux-là, en proportion, le taux des loyers, ceux-ci le taux de l’intérêt. Mais cette hausse diminuait la demande, et les propriétaires d’immeubles, par exemple, ne pouvaient s’assurer qu’en partie contre le risque de la dépréciation. Quant aux capitalistes, leur situation était meilleure. [II-259] Ou ils gardaient leurs fonds sous forme d’espèces métalliques, ou ils les faisaient passer à l’étranger, ou ils s’en servaient pour acheter à vil prix des immeubles, ou bien encore ils les prêtaient à un taux excessif, de manière à se couvrir, autant que possible; de tout le risque de la dépréciation. C’est ainsi qu’on vit le taux courant de l’intérêt s’élever à 25 p. c. et au delà et comme le nombre des opérations qui pouvaient supporter cet énorme intérêt était fort limité, les affaires à terme se trouvèrent presque supprimées. Les classes ouvrières souffraient moins que les propriétaires ou les capitalistes qui avaient loué ou prêté à longs termes, et, en particulier, que les rentiers de l’État qui avaient prêté sans échéance; mais elles souffraient plus que les entrepreneurs d’industrie et les marchands. Sans doute, elles avaient la liberté d’élever le prix de leurs services, comme les industriels et les marchands élevaient les prix de leurs marchandises; mais, ainsi que le remarque M. Thiers, la situation particulière des classes ouvrières ne leur permettait guère d’user de cette liberté. En tous temps, elles avaient été à la merci des entrepreneurs, et elles l’étaient plus que jamais depuis que la crise révolutionnaire, en fermant la plupart des ateliers, avait réduit, dans d’énormes proportions, les débouchés ordinaires du travail. Il leur était, en conséquence, impossible d’obtenir que leurs salaires fussent augmentés à mesure que les assignats se dépréciaient, à plus forte raison de se couvrir du risque de la dépréciation qui survenait pendant qu’ils avaient les assignats entre les mains. Ils se hâtaient donc, plus encore que d’habitude, de dépenser leurs salaires, et leur misère s’en augmentait.
De là les plaintes véhémentes des classes sur lesquelles retombait particulièrement le fardeau de l’impôt perçu sur la [II-260] circulation par l’émission des assignats, et la nécessité de prendre des mesures pour répartir plus équitablement cet impôt ainsi que les maux dont il était la source. Le maximum fut établi dans ce but. Il eut pour objet d’empêcher les agriculteurs, les industriels et les marchands de rejeter sur les ouvriers, les propriétaires, les rentiers, etc., la grosse part du fardeau de la dépréciation. Mais ce procédé de péréquation de l’impôt monétaire, quoique présentant une certaine efficacité, étail grossier et imparfait. Tantôt il dépassait le but, tantôt il ne réussissait point à l’atteindre. Le maximum aurait dῦ, pour être équitable, être toujours fixé en proportion du montant de la dépréciation effectuée, en atteignant seulement cette portion du prix de la marchandise qui constituait la prime destinée à couvrir la dépréciation éventuelle, et s’élever à mesure que ce risque venant à écheoir, la valeur de l’assignat baissait. Mais il ne remplissait exactement ni l’une ni l’autre de ces deux conditions, et comme la seconde surtout lui faisait défaut, il exposait les agriculteurs, les industriels et les négociants à une perte progressive. Ils se retiraient donc des affaires, et quand on ne le leur permettait point, ils s’y ruinaient, à moins qu’ils n’éludassent le maximum, en altérant, par exemple, la qualité de leurs produits à mesure que l’assignat baissait et en proportion de cette baisse; ce qui ne manquait point d’arriver.
On finit par s’apercevoir que l’excès des émissions était la véritable cause de la dépréciation croissante des assignats, et des maux que cette dépréciation infligeait en dépit du maximum, et, en 1793, on en retira une partie de la circulation au moyen de l’emprunt forcé. L’effet de cette mesure fut des plus efficaces. Les assignats remontèrent au pair. Mais les besoins du gouvernement rendirent bientôt de nouvelles émissions nécessaires, et [II-261] la dépréciation devint en conséquence, quoi qu’on pῦt faire pour l’arrêter, de plus en plus forte.
Citons encore à cet égard quelques renseignements intéressants, empruntés à l’histoire de M. Thiers:
“. . . On a vu quelles ressources furent imaginées au mois d’aoῦt 1793, pour remettre les assignats en valeur, en les retirant en partie de la circulation. Le milliard retiré par l’emprunt forcé, et les victoires qui terminèrent la campagne de 1793 les relevèrent, et comme nous l’avons dit ailleurs, ils remontèrent presque au pair, grâce aux lois terribles qui rendaient la possession du numéraire si dangereuse. Cependant cette apparente prospérité dura peu, les assignats retombèrent bientôt, et la quantité des émissions les déprécia rapidement. Il en rentrait bien une partie par les ventes des biens nationaux, mais cette rentrée était insuffisante. Les biens se vendaient au dessus de l’estimation, ce qui n’avait rien d’étonnant, car l’estimation avait été faite en argent, et le payement se faisait en assignats. De cette manière, le prix était réellement fort au dessous de l’estimation, quoiqu’il parῦt être au dessus. D’ailleurs, cette absorption des assignats ne pouvait être que lente, tandis que l’émission était nécessairement immense et rapide. Douze cent mille hommes à solder et à armer; un matériel à créer, une marine à construire, avec un papier déprécié, exigeaient des quantités énormes de ce papier. Cette ressource était devenue la seule, et le capital des assignats, d’ailleurs, s’augmentait chaque jour par les confiscations; on se résigna à en user autant que le besoin le réclamerait. On abolit la distinction entre la caisse de l’ordinaire et de l’extraordinaire, l’une réservée au produit des impôts, l’autre à la création des assignats. On confondit les deux natures de ressources, et chaque fois que le besoin l’exigeait, on suppléait au revenu par des émissions nouvelles. Au commencement de 1794 (an II), la somme totale des émissions s’était accrue du double. Près de quatre milliards avaient été ajoutés à la somme qui existait déjà, et l’avaient portée à environ huit milliards. En retranchant les sommes [II-262] rentrées et brῦlées, et celles qui n’avaient pas encore été dépensées, il restait en circulation réelle, cinq milliards 536 millions. On décréta en messidor, an Il (juin 1794), la création d’un nouveau milliard d’assignats de toute valeur, depuis 1000 francs jusqu’à 15 sous . . .”
Le mal alla donc croissant, et il infligeait à tous les intérêts de tels dommages qu’une réaction était inévitable. Cette réaction eut lieu à la suite du 9 thermidor (aoῦt 1794) [46] . La plupart [II-263] des mesures violentes que le gouvernement de la Terreur avait prises soit pour généraliser la circulation des assignats, soit pour en soutenir le cours, soit pour équilibrer autant que possible les pertes résultant de leur dépréciation, la plupart de ces mesures qui n’avaient opposé qu’un correctif insuffisant aux dommages causés par la surémission du papier-monnaie, et qui avaient engendré, en outre, des maux qui leur étaient propres, [II-264] furent successivement rapportées. Le maximum, en particulier, qui obligeait les agriculteurs, les industriels et les commerçants à vendre leurs marchandises à un prix invariable, tandis [II-265] qu’ils recevaient en échange une monnaie en voie de constante dépréciation, le maximum fut aboli. On vit alors toutes les marchandises hausser dans la proportion de la dépréciation [II-266] accomplie et du risque de la dépréciation à venir, et comme les émissions avaient atteint des quantités fabuleuses, la hausse fut énorme. Les rentiers de l’État et les propriétaires qui [II-267] n’avaient pu renouveler leurs baux souffraient surtout de ce nouvel état de choses: on vit à Paris, par exemple, les rentiers réduits à vivre de la charité publique. Quant aux ouvriers, la guerre ayant ouvert un vaste débouché aux bras surabondants que la crise industrielle et commerciale avait laissés sans emploi, ils purent obtenir plus aisément l’augmentation de leurs salaires.
[II-268]
Il aurait fallu, pour mettre fin à tant de maux, que le gouvernement pῦt cesser d’émettre de nouvelles quantités de papiermonnaie. Malheureusement, la planche aux assignats continuait d’être sa principale ressource. Il la fit, en conséquence, fonctionner aussi longtemps qu’il y trouva quelque profit, c’est à dire aussi longtemps qu’il put émettre des assignats à un taux supérieur à leurs frais de fabrication. Ce moment arriva enfin. [II-269] En 1796, les assignats ne valaient plus qu’un 200e environ de leur taux originaire d’émission. Une livre de beurre se payait alors 200 fr. en assignats, une paire de bottes 2,000 fr.; les ouvriers gagnaient 600 fr. par jour, etc.; les rentiers de l’État seuls, continuant à recevoir les assignats comme si aucune dépréciation n’avait eu lieu, se trouvaient complétement ruinés. Après avoir fait quelques nouvelles tentatives pour relever le cours du papier, après avoir essayé aussi de substituer les mandats aux assignats, le gouvernement, s’apercevant que sa mine de papier-monnaie ne valait plus la peine d’être exploitée, se décida à l’abandonner. On brisa donc cette planche aux assignats qui avait fourni pendant six ans la plus grande partie des ressources à l’aide desquelles la révolution s’était soutenue, on retira aux assignats le cours forcé, on cessa même de les recevoir en paiement des contributions et des biens nationaux. Les assignats, cessant alors presque entièrement d’être demandés, tandis que l’offre en était énorme, perdirent toute valeur et devinrent, par conséquent, impropres à servir d’instrument des échanges; la monnaie métallique revint d’ellemême remplir le vide qu’ils laissaient et, après une des plus désastreuses perturbations dont l’histoire fasse mention, les choses reprirent leur cours ordinaire.
Recherchons maintenant quelle fut l’importance approximative des ressources que l’émission des assignats procura à la France révolutionnaire, et à quel prix ces ressources furent acquises; combien les assignats rapportèrent au gouvernement et combien ils coῦtèrent à la nation.
Voyons d’abord quelles sommes en avaient été successivement introduites dans la circulation. En avril 1790, eut lieu une première émission de 400 millions. Au mois de septembre [II-270] de la même année, cette somme fut portée à 1,200 millions. Au ler janvier 1795, il y avait en circulation 3,626 millions d’assignats, en valeur nominale; au 7 septembre 1794, 8,817 1/2 millions; au 7 septembre 1795, 19,699 ½ millions. Enfin, le 7 septembre 1796, la somme des émissions s’élevait au chiffre inouï de 45,599 millions. Pendant cette période, on en avait retiré à diverses reprises pour 12,744 millions. Il en restait donc pour 32 milliards environ, dans la circulation, lorsque la planche aux assignats fut brisée.
M. Thiers évalue à 4 ou 5 milliards de francs, la valeur réelle des ressources que l’émission des 45 milliards d’assignats procura à la révolution. Il faudrait, pour contrôler cette assertion, avoir un tableau du produit réel que le gouvernement retirait de chacune des émissions, et nous ne possédons pas les données nécessaires pour dresser ce tableau, savoir: le prix des métaux précieux, et des principales marchandises en assignats (sans tenir compte du maximum); le relevé des réquisitions faites au prix du maximum pour le compte du gouvernement et des diverses administrations, et payées en assignats à un cours inférieur à leur cours réel de toute la différence existant entre le prix du maximum et le prix naturel du marché. Nous savons seulement qu’aussi longtemps que les émissions ne dépassèrent pas ou ne dépassèrent que faiblement les besoins de la circulation, la dépréciation demeura peu sensible et, en conséquence, que le produit réel des émissions équivalut à peu de chose près à leur valeur nominale. Mais il en fut tout autrement dès que les émissions devinrent excessives, et l’on estime que les 20 derniers milliards sortis de la mine des assignats rapportèrent à peine 200 millions au gouvernement.
Du produit des assignats, il convient encore de déduire la [II-271] perte que leur dépréciation occasionnait àl’État considéré comme créancier. Tous ses revenus, l’État les recevait en assignats, à l’exception de la contribution foncière dont la moitié fut, dans les derniers temps du papier-monnaie, perçue en nature. Cependant cette perte se trouvait atténuée sous l’influence de deux causes. En premier lieu, parce qu’un bon nombre d’impôts avaient été supprimés et que les autres n’étaient perçus que d’une manière incomplète et irrégulière: en 1796, l’arriéré ne s’élevait pas à moins de 13 milliards. En second lieu, l’État, payant en assignats, sans augmentation ou avec une augmentation sans proportion avec la baisse du papier, les rentiers et les employés qu’il aurait dῦ payer en bonne monnaie si les assignats n’avaient pas existé, allégeait ainsi une partie de sa dépense: cela faisait compensation à la perte que lui imposait l’obligation de recevoir des assignats pour la rentrée des impôts.
L’estimation de M. Thiers ne doit point toutefois s’éloigner beaucoup de la vérité. On peut admettre que la contribution extraordinaire levée sur la circulation au moyen des assignats s’éleva en six années à 4 ou 5 milliards; mais on ne saurait apprécier, même d’une manière approximative, l’étendue des sacrifices et des dommages de tous genres que la levée de cette contribution imposa à la nation. Ces sacrifices et ces dommages consistèrent:
- 1° Dans la perte occasionnée à tous les détenteurs du papiermonnaie, d’abord par sa dépréciation successive, ensuite par l’annulation complète de sa valeur. En admettant que les 45 milliards de valeur nominale successivement émis eussent possédé, lors de leur mise en circulation, une valeur réelle ou, ce qui revient au même, un pouvoir d’échange équivalant à celui [II-272] d’une somme de 4 à 5 milliards en numéraire, la perte des consommateurs de monnaie entre les mains desquels les assignats avaient passé pendant le cours de la dépréciation, et de ceux entre les mains desquels ils étaient finalement demeurés s’élevait donc à 4 ou 5 milliards. Mais cette perte s’était trouvée singulièrement aggravée par le fait des réquisitions dont l’État et les communes frappaient les produits ou les services dont ils avaient besoin et qu’ils payaient en assignats au prix du maximum, c’est à dire en ne tenant compte aux victimes des réquisitions que d’une faible partie de la dépréciation.
- 2° Dans l’inégalité des dommages infligés par la dépréciation. D’abord, les rentiers, les propriétaires et les ouvriers en subirent la plus forte part; ensuite, sous l’influence du maximum, ces dommages retombèrent principalement sur les agriculteurs, les industriels et les commerçants, qui fournirent, au fur et à mesure de la dépréciation, une part progressive de l’impôt monétaire.
- 3° Dans l’existence du risque de dépréciation, et dans les perturbations qui en étaient la suite: dépenses hàtives, destruction du crédit, élévation excessive du taux de l’intérêt, difficulté presque insurmontable de conclure des opérations à terme, etc., etc.
- 4° Dans le dommage causé à la moralité publique par le fait de l’autorisation accordée à tous les débiteurs de faire, à l’exemple du gouvernement lui-mème, banqueroute à leurs créanciers du montant de la dépréciation. Tous n’usèrent point de cette autorisation sans doute; mais le plus grand nombre se fit d’autant moins scrupule d’en user, qu’il était fort difficile de retrouver le véritable étalon monétaire en présence de la surabondance du papier et de la rareté du métal.
[II-273]
En totalisant ces pertes et ces dommages, on arriverait certainement à une somme triple ou quadruple du produit net de l’opération; en sorte que l’émission des assignats serait l’équivalent d’un impôt arbitraire dont la perception aurait coῦté 3 ou 400 p. c. Jamais impôt plus désastreux ne fut levé sur un peuple. Mais la révolution n’avait pas le choix. Les assignats la sauvèrent, à la vérité, comme le constate M. Thiers, mais ce fut pour mieux la perdre. Ils rendirent le gouvernement républicain odieux et firent accepter comme un bienfait véritable le rétablissement, sous d’autres noms, du système d’impôts et de gouvernement de l’ancien régime.
Au dommage immédiat causé par l’expédient des assignats, il faut encore joindre celui qui résulta de la contagion de l’exemple. Sans doute, la France révolutionnaire n’inventa point les assignats: en France même, le système de Law les avait inaugurés sous une autre forme; les Provinces Unies en avaient fait usage dans leur lutte contre l’Espagne, et les colonies anglaises d’Amérique dans leur lutte contre la métropole britannique; mais la révolution française les popularisa, en montrant toute l’étendue des ressources qu’on en pouvait tirer, dans un moment d’extrême nécessité. A dater de cette époque, tous les gouvernements qui ont eu à soutenir des luttes intérieures ou extérieures, sans pouvoir trouver dans les impôts ordinaires ou dans le crédit les moyens nécessaires pour y subvenir, ont eu recours à des émissions de papier-monnaie, soit directement soit par l’intermédiaire de banques d’État. On peut citer notamment l’Angleterre, la Russie, l’Autriche, la Hongrie, et finalement les États du Nord et du Sud de l’Union américaine. Dans ces différents pays, le papier-monnaie n’a point causé des désastres aussi grands que ceux dont il avait été la source en [II-274] France, parce que l’émission en a été plus modérée; mais les procédés employés pour l’introduire dans la circulation, pour en soutenir ou en relever la valeur, pour équilibrer les dommages causés par sa dépréciation, etc., etc., ont été généralement les mêmes; et ces procédés sont les mêmes aussi que ceux dont les souverains de l’ancien régime faisaient usage pour substituer des monnaies affaiblies aux monnaies fortes. La seule différence entre les monnaies métalliques affaiblies et les monnaies de papier, c’est que les dernières peuvent causer et causent des dommages infiniment plus considérables que les premières; mais quant aux procédés d’émission, ils sont identiques. Ils n’ont point changé depuis Philippe le Bel. Aussi peut-on s’étonner de voir des écrivains spéciaux flétrir les expédients monétaires de l’ancien régime comme des monstruosités qui seraient inconnues de nos jours. Ces expédients, on les a, au contraire, perfectionnés, en les rendant à la fois plus dommageables pour le public et plus profitables pour les gouvernements. Le papier-monnaie a permis de pousser à leur limite extrême, au nec plus ultra les altérations monétaires.
Cependant malgré le déplorable usage qu’en ont fait les gouvernements, investis du monopole du monnayage, le papiermon[ww]aie n’en demeure pas moins le plus parfait et le plus économique des instruments monétaires. Il s’agit seulement de savoir dans quelles conditions il devrait être émis pour devenir aussi utile qu’il a été et qu’il est encore, entre les mains de ceux qui sont investis du monopole de son émission, dangereux et nuisible.
Ces conditions nous les connaîtrons en étudiant le phénomène du crÉdit.
[II-275]
HUITIÈME LEÇON↩
le crÉdit. — notions gÉnÉrales
Introduction. — Définition du crédit. — Comment se forment les capitaux. — Formes sous lesquelles les capitaux peuvent être investis; destinations auxquelles on peut les affecter. — En quoi consiste l’offre des capitaux. — De la privation et du risque qu’implique tout engagement de capitaux. — De la demande des capitaux. — Ce qui la limite. — De la tendance de l’offre et de la demande des capitaux à s’équilibrer au niveau du prix naturel de l’intérêt. — Des instruments du crédit. — Des obligations commerciales. — Analyse de la vente à crédit. — Comment se paye le crédit en nature. — Cause de l’extrême multiplication des marchands de détail. — Caractère somptuaire du maximum imposé aux prix des choses nécessaires à la vie. — De la transmissibilité des obligations commerciales, et de son influence sur le développement du crédit. — Des obligations auxquelles donnent naissance les prêts en argent. — Des titres de propriété et des effets de leur transmissibilité. — La mobilisation des valeurs a-t-elle pour résultat de multiplier les capitaux? — Des garanties du crédit. — Des garanties réelles, personnelles, mobilières et immobilières. — Des garanties morales et légales. — Des assurances.
Les institutions de crédit jouent aujourd’hui dans le monde économique un rôle sur l’importance duquel il est superflu d’insister. [II-276] Dans tous les pays où l’industrie est en voie de transformation, où l’introduction de nouveaux moteurs à la fois plus puissants et plus coῦteux détermine la substitution des grandes exploitations aux petites, où le capital nécessaire à la formation et au fonctionnement des entreprises devient, en conséquence, de plus en plus considérable, il est rare que les entrepreneurs n’en doivent pas emprunter une partie sous une forme ou sous une autre. Cette nécessité deviendra, selon toute apparence, plus générale encore, à mesure que les progrès agricoles, industriels et commerciaux en se multipliant exigeront, dans chaque entreprise, de plus fortes agglomérations de capitaux. An moment où nous sommes, le crédit est déjà un organe vital de la production, et il est destiné à prendre, chaque jour, une place plus grande dans la constitution économique de la société.
Il est donc essentiel de bien étudier cet organe en voie de développement de l’économie de notre société. Cela est d’autant plus nécessaire qu’il en est de la puissance du crédit comme de toutes les puissances: autant elle peut être bienfaisante lorsqu’elle est sainement développée et dirigée, autant elle peut causer de mal, lorsqu’elle est établie sur une base vicieuse et gouvernée par des mains inhabiles. On peut comparer les grandes institutions de crédit qui se sont substituées aux petits comptoirs des usuriers d’autrefois à ces puissantes et merveilleuses locomotives qui ont pris la place des chaises à porteurs, des diligences et des malles-postes: elles rendent mille fois plus de services; mais quand elles viennent à dérailler ou à faire explosion, soit parce que la voie sur laquelle elles circulent manque de solidité, soit parce que leur construction est vicieuse, soit parce que leurs conducteurs sont [II-277] ignorants, elles occasionnent des accidents bien autrement graves que ceux qui pouvaient résulter de la chute d’une diligence ou de tout autre véhicule de l’ancien régime. Où il n’y avait autrefois, le plus souvent, que quelques voyageurs contusionnés, il y a maintenant des centaines de victimes qui périssent d’une mort cruelle.
C’est ainsi que dans les pays où les institutions de crédit se sont particulièrement multipliées et développées, en Angleterre et aux États-Unis par exemple, on a vu éclater d’intervalle en intervalle des crises désastreuses qui ont englouti des milliers d’établissements, en jetant dans le monde des affaires une perturbation soudaine et profonde. Ces crises, dont le nom même était ignoré autrefois, sont comme les explosions de la machine du crédit. Elles font des victimes d’autant plus nombreuses, que tous les peuples se trouvant maintenant engagés dans les liens d’une immense solidarité économique, grâce au développement des échanges internationaux, chacun ressent l’influence de la prospérité de ses voisins ou subit le contre-coup des désastres qui les atteignent.
Or ces explosions, — que le télégraphe communique littéralement avec la rapidité de la foudre dans toute la vaste étendue du monde des affaires, — il n’y a que deux moyens de les prévenir.
Le premier consisterait à s’isoler des autres nations et à empêcher chez soi tout développement de la machinery du crédit; ce qui serait à peu près aussi intelligent que de prohiber les chemins de fer pour éviter les accidents qui résultent du déraillement des convois et de l’explosion des chaudières des locomotives.
Le second moyen d’éviter les crises consiste à se rendre bien [II-278] compte des conditions naturelles d’établissement et de fonctionnement du mécanisme du crédit, et à s’y conformer, en gouvernant avec une prudence qui n’exclut pas la hardiesse cette puissance nouvelle à la fois si féconde et si redoutable.
Nous croyons inutile d’ajouter qu’à nos yeux cette dernière méthode seule est la bonne; qu’en matière de crédit comme en toute autre, il faut regarder toujours en avant, non en arrière, et demander au progrès les remèdes aux maux que le progrès amène.
Cela dit, entrons en matière.
Crédit vient de credere, croire, avoir foi, et l’étymologie du mot explique parfaitement la chose que ce mot signifie. Car la base du crédit, c’est la confiance. Confier des capitaux, c’est à dire des accumulations de choses pourvues de valeur, ou, pour nous servir de l’expression consacrée, des valeurs à ceux qui en ont besoin et qui sont disposés à en payer l’usage, voilà l’opération du crédit.
Les capitaux sont, comme on voit, l’objet du crédit. D’où il résulte que le développement du crédit est subordonné à celui de la production des capitaux.
Les capitaux naissent du produit net des entreprises (voir la première partie. Les besoins et les moyens de production) et le produit net à son tour apparaît seulement lorsque le produit brut dépasse le montant des frais de la production comprenant l’entretien et le renouvellement nécessaires du personnel et du matériel. Ce produit net peut être ou appliqué à une consommation improductive ou conservé, soit sous sa forme primitive, soit, après avoir été échangé, sous une forme appropriée à la destination qu’on veut lui donner, et, dans ce cas, on dit qu’il est capitalisé. La première condition requise [II-279] pour la formation et la multiplication des capitaux, c’est donc que la production, dans ses différentes branches, soit active et abondante, c’est que les entreprises agricoles, industrielles, commerciales et autres soient nombreuses et qu’elles fournissent un produit net. Cela ne suffit pas cependant. Le produit net n’est que la matière première dont on se sert pour former le capital. Si au lieu d’appliquer le produit net à cette destination, on le gaspille dans des dépenses inutiles ou nuisibles, le capital ne s’accroîtra point, et même, dans le cas des dépenses nuisibles qui détériorent, par exemple, le personnel de la production, il diminuera. Quelle façon doit donc recevoir le produit net pour être transformé en capital? Il doit être épargné, c’est à dire soustrait aux appétits qui sollicitent son application à un accroissement de jouissances et réservé soit en vue d’un emploi productif, soit encore, si les débouchés manquent, pour subvenir simplement à des nécessités éventuelles. Cette façon de l’épargne que doit recevoir le produit net pour être transformé en capital exige d’abord une opération intellectuelle qui consiste à prévoir, dans toute leur étendue probable, les besoins à venir; elle exige ensuite une opération morale qui consiste à opposer un frein aux appétits, le plus souvent matériels mais quelquefois aussi intellectuels et moraux, qui nous poussent à une consommation immediate. Les pays où la production est active et fructueuse, où, en même temps, les populations possèdent les qualités intellectuelles et morales requises pour la transformation du produit net en capital sont naturellement ceux où les capitaux se produisent avec le plus d’abondance. Ce sont l’Angleterre, la Hollande, la Suisse, la Belgique, certaines parties de l’Allemagne, de la France, etc. Ces pays produisent non seulement [II-280] des capitaux pour la consommation intérieure, mais encore ils en exportent annuellement des quantités considérables.
Les capitaux, à mesure qu’ils se forment par l’épargne d’une portion du produit net, peuvent être investis sous les formes les plus diverses. On ne les constitue point, nécessairement, sous la forme du produit que l’on fabrique ou de la marchandise dont on fait commerce. On réalise communément ce produit ou cette marchandise, en l’échangeant contre des instruments monétaires, que l’on échange ensuite en partie contre des objets de consommation, en partie contre les choses dans lesquelles on veut investir son capital. Quelquefois, on le prête en nature pour un délai plus ou moins long par la vente à crédit; quelquefois encore on le prête, à mesure qu’on le réalise, sous la forme d’instruments monétaires.
Quelle que soit, du reste, la forme sous laquelle on crée les capitaux ou sous laquelle on les investit, par le procédé de l’échange, après les avoir créés, on peut les affecter à trois destinations: 1° on peut les conserver improductifs, en attendant le moment favorable pour les consacrer à un emploi utile; 2° les employer pour son propre compte, soit isolément, soit en les joignant à d’autres par voie d’association; 3° les louer si ce sont des capitaux fixes, les prêter si ce sont des capitaux circulants.
Les capitaux qui se présentent au marché pour chercher un placement utile, sous une forme ou sous une autre, constituent l'offre des capitaux.
Cette offre se rencontre sur le marché avec la demande, laquelle comprend la masse des capitaux qui sont partout, en tout temps et sous toutes les formes, requis pour constituer, alimenter ou développer les entreprises de production, ou bien [II-281] encore, quoique dans une mesure infiniment plus restreinte, satisfaire à d#00FF40es besoins de consommation, en suppléant à l’insuffisance actuelle des revenus des consommateurs.
Jetons un coup d’œil sur ces deux phénomènes.
L’offre consiste dans la masse des capitaux qui cherchent un placement par voie d’association, de prêt ou de location. Cette offre est limitée d’abord par la quantité du capital existant, ensuite par la portion de ce capital qui se trouve disponible. Celle-ci comprend, notons le bien, non seulement les capitaux qui ne sont point engagés dans la multitude des entreprises de production en activité, mais encore, au moins par intermittences, une partie des capitaux engagés dans ces entreprises. En effet, la quantité du capital requis pour chacune n’est pas, en tous temps, la même. A cet égard, il y a une distinction à établir entre les capitaux fixes, immobilisés sous forme de terres, de bâtiments, de machines, etc., qui demeurent engagés, sans interruption, aussi longtemps que l’entreprise subsiste, et les capitaux circulants, qui existent sous forme de matières premières, de numéraire, de produits emmagasinés ou en voie de réalisation. Aux époques où les produits se réalisent, par exemple, une partie du capital circulant devient momentanément disponible, jusqu’à ce qu’elle soit requise pour l’achat des matières premières, le payement successif des ouvriers, etc. On peut, en conséquence, ou la conserver inactive ou la placer d’une manière temporaire et elle grossit, dans ce dernier cas, l’offre générale des capitaux.
Mais on n’offre des capitaux qu’à la condition d’y être déterminé par l’appât d’un intérêt ou d’un profit. En dernière analyse, les capitaux, sous quelque forme qu’ils se trouvent investis, constituent des pouvoirs productifs. Ceux qui les possèdent [II-282] et qui s’en dessaisissent se privent des avantages qu’ils en retireraient, soit en les gardant à leur disposition, soit en les employant eux-mêmes; ils s’imposent une privation. D’un autre côté, ils s’exposent encore à un risque. Tout engagement de capitaux, sous une forme ou sous une autre, implique à la fois une privation et un risque. D’où il résulte qu’on ne les engage point, à moins d’être couvert de cette privation et de ce risque. La compensation de la privation et la prime du risque sont, comme nous l’avons vu (Deuxième partie, XIe leçon, La part du capital), les éléments constitutifs du prix naturel de l’usage des capitaux.
Selon que l’ensemble des branches de la production donne des profits plus ou moins élevés, selon encore qu’on s’expose à un dommage plus ou moins intense et probable, en cessant de conserver la disponibilité de son capital, par le fait d’accidents ou de sinistres qui seraient de nature à nécessiter son intervention immédiate, la privation provenant de ce double chef, savoir, pour nous servir des expressions des vieux jurisconsultes, du lucre cessant et du dommage naissant, a plus ou moins d’étendue. Ce qui revient à dire que plus le pouvoir productif ou réparateur du capital est grand, plus grande aussi est la privation que l’on s’impose en cessant de conserver ce pouvoir disponible pour l’engager dans une entreprise quelconque. D’où il résulte que la compensation destinée à couvrir la privation d’un capital engagé dans une direction spéciale doit être d’autant plus élevée, que le pouvoir général du capital ou son aptitude générale à procurer des profits et à réparer des dommages est plus considérable. De même, la prime d’assurance s’élève d’autant plus, que l’on subit, en engageant son capital, dans n’importe quelle direction, un risque plus grand. [II-283] Ces deux éléments diversement combinés constituent le prix naturel de chaque catégorie de profits, d’intérêts ou de loyers.
La demande consiste dans la masse des capitaux ou des pouvoirs productifs qui sont incessamment réclamés pour concourir à toute sorte d’entreprises. Elle est limitée d’abord par l’étendue du marche, autrement dit par le nombre et l’importance des entreprises qu’il s’agit de constituer, d’alimenter ou de développer. Elle est limitée ensuite par le prix auquel les capitaux s’offrent à l’engagement. Quand ce prix est élevé, relativement au produit des entreprises, la demande est faible; quand, au contraire, le prix du service des capitaux est bas relativement au produit des entreprises, la demande en est active. C’est alors aussi qu’on voit la production prendre un essor particulièrement rapide.
“On peut regarder, dit Turgot, le prix de l’intérêt comme une espèce de niveau au dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout commerce cessent. C’est comme une mer répandue sur une vaste contrée: les sommets des montagnes s’élèvent au dessus des eaux, et forment des îles fertiles et cultivées. Si cette mer vient à s’écouler, à mesure qu’elle descend, les terrains en pente, puis les plaines et les vallons paraissent et se couvrent de productions de toute espèce. Il suffit que l’eau monte ou s’abaisse d’un pied pour inonder ou pour rendre à la culture des plages immenses. — C’est l’abondance des capitaux qui anime toutes les entreprises, et le bas intérêt de l’argent est tout à la fois l’effet et l’indice de l’abondance des capitaux [48] .”
Il convient de remarquer toutefois que le prix des capitaux [II-284] peut être très bas, sans que l’industrie soit active, si elle manque de débouchés faute de voies de communication ou par le fait des obstacles artificiels du régime prohibitif, par exemple. En ce cas, les capitaux demeurent sans emploi, ou, quand ils le peuvent, ils émigrent vers les pays où l’industrie leur offre un débouché plus vaste et plus avantageux. Le prix des capitaux peut, au contraire, être élevé et l’industrie active si, grâce à l’étendue de son marché, elle réalise des profits considérables. Mais comme le marché s’étend à mesure que les prix s’abaissent, et comme les prix ne peuvent s’abaisser, d’une manière régulière et permanente, que par la diminution des frais de production, lesquels dépendent de la quantité des agents productifs qu’il faut mettre en œuvre et du prix auquel il faut payer leur concours, la comparaison de Turgot n’en est pas moins, en dernière analyse, aussi vraie qu’elle est pittoresque.
La demande des capitaux est donc limitée par l’étendue du débouché qui leur est ouvert, et ce débouché à son tour s’étend ou se resserre selon que le prix courant des capitaux s’abaisse ou s’élève. A mesure qu’il s’abaisse, une multitude d’entreprises peuvent se constituer ou se développer avec avantage; à mesure qu’il s’élève, au contraire, une partie des entreprises existantes cessent de couvrir leurs frais, et elles sont obligées de ralentir leur production ou même de la suspendre.
Le prix courant des capitaux, soit qu’on les engage isolément dans une industrie que l’on exerce à ses frais et risques, soit qu’on les associe à d’autres pour recevoir en échange un dividende, soit qu’on les prête ou qu’on les loue, ce prix courant est déterminé, comme celui de toutes choses, par les phénomènes de l’offre et de la demande; mais il tend de même, incessamment, [II-285] sous l’impulsion de la loi des quantités et des prix, à se confondre avec le prix naturel du service des capitaux. On en connaît la raison. Lorsqu’il tombe au dessous, la privation et le risque impliqués dans tout engagement de capitaux n’étant plus suffisamment couverts, les capitaux se retirent par le fait de la privation ou se détruisent par le fait du risque, jusqu’à ce que la diminution de l’offre ait fait remonter le prix courant au niveau du prix naturel ou même l’ait porté au dessus. Lorsque la situation inverse se produit, la formation ou l’immigration des capitaux est encouragée par une prime égale à la différence existant entre le prix courant et le prix naturel, et l’équilibre se rétablit encore.
La même tendance naturelle à l’équilibre existe entre les formes, les conditions, les lieux et les époques d’engagement. Si, par exemple, les capitaux investis sous forme de terres, de maisons, debâtiments d’exploitation, de machines, etc., donnent un revenu plus élevé, — à privation et à risques égaux, — que les capitaux investis sous forme de matières premières ou de monnaie, ceux qui sont en voie de formation s’investirent de préférence sous la forme la plus avantageuse. De même, s’il est plus profitable de courir tous les risques d’une entreprise et de percevoir la rémunération de son capital sous la forme d’une part éventuelle plutôt que sous la forme d’une part fixe, les capitaux délaisseront le marché des intérêts ou des loyers pour se porter vers celui des profits ou des dividendes. De même enfin, si l’engagement est plus avantageux dans tel lieu ou dans tel moment que dans tel autre. Et comme, en vertu de la loi des quantités et des prix, tout déplacement des quantités opéré en raison arithmétique engendre une hausse ou une baisse des valeurs, qui se développe en raison géométrique, cette tendance [II-286] au nivellement ou à l’équilibre peut être considérée comme irrésistible. Des obstacles naturels et artificiels se mettent, à la vérité, incessamment en travers, mais elle agit, incessamment aussi, pour les écarter ou les surmonter.
L’étude du crédit et des conditions de son développement peut, en conséquence, être ramenée à des termes fort simples.
En premier lieu, il s’agit de créer des capitaux en s’abstenant de consommer tout le produit net des entreprises.
En second lieu, les capitaux étant créés, il s’agit de les engager dans la production, sous la forme, aux conditions, dans le temps et dans le lieu le plus utiles. La somme des capitaux disponibles et cherchant un placement utile constitue l’offre du crédit. Cette offre se rencontre sur le marché des capitaux avec la demande, qui consiste à son tour dans la masse des capitaux nécessaires aux entreprises, et dont on est disposé à payer l’usage, en fournissant aux capitalistes une compensation pour la privation et une prime pour les risques, inhérents à tout engagement de capitaux. L’élévation du prix naturel du service des capitaux, vers lequel le prix courant de ce service gravite incessamment, détermine, en dernière analyse, l’étendue de la demande. D’où il résulte que le crédit demeure à son minimum de développement lorsque la privation et le risque, qui sont les éléments constitutifs du prix naturel des capitaux, sont à leur maximum; qu’il se développe, au contraire, d’une manière progressive, à mesure que la privation et le risque devenant moindres, le prix naturel des capitaux s’abaisse.
De même que l’immense développement de l’industrie moderne est dῦ à l’invention de machines et de méthodes perfectionnées qui ont permis de réduire, dans une proportion considérable, les frais de production et, par conséquent, les prix [II-287] d’une multitude de produits, de même l’extension rapidement croissante du crédit est due à la création d’instruments, de procédés et d’établissements spéciaux qui ont permis de réduire les frais de production du service des capitaux, en diminuant la privation et les risques qui en sont les éléments. C’est ainsi que la privation a été diminuée par la mobilisation des titres de propriété des capitaux engagés, et que les risques ont été affaiblis par la création des garanties et divisés par le procédé des assurances, tandis que des institutions spéciales, créées pour recueillir les capitaux et les distribuer, en favorisaient la production et en facilitaient l’approvisionnement.
Comment se sont créés, développés et perfectionnés ces instruments, ces procédés et ces institutions? Voilà ce que nous allons examiner en étudiant successivement:
| 1° Les instruments |  |
|
| 2° Les garanties et les assurances | du crédit. | |
| 3° Les intermédiaires |
I. Les Instruments Du CrÉdit. Les capitaux sont composés de valeurs et constituent des propriétés. Tout capital, soit qu’il se trouve investi dans des créatures vivantes, des terres, des bâtiments, des matières premières ou des produitsfabriqués, est composé de valeurs, et ces valeurs sont appropriées à des individus ou à des collections d’individus. La propriété se constate de différentes manières, par l’état civil pour les personnes, par des titres pour les immeubles et les meubles, et même, au besoin, par la simple possession pour ces derniers. Quand on échange des objets mobiliers, des marchandises contre de la monnaie, par exemple, on ne fait point de contrat; mais on constate ordinairement [II-288] cet échange au moyen d’écritures. Quand il s’agit, au contraire, d’immeubles, on s’en fait délivrer un titre de propriété; enfin, si on vend une marchandise à terme, autrement dit à crédit, ou bien si l’on prête à terme ou pour un temps indéfini une valeur mobilière, on s’en fait délivrer un reçu avec engagement de remboursement dans les conditions et dans les délais convenus; de même, si on loue une valeur immobilière, on constate cette location au moyen d’un contrat, spécifiant les conditions de la location. De là une quantité immense de titres représentant les uns des propriétés, les autres des créances, contrats, reçus, obligations de toute sorte, variant selon la nature des capitaux ou des créances qu’ils représentent, et qui constituent, grâce à leur échangeabilité ou à leur transmissibilité, les instruments du crédit.
Nous nous bornerons à signaler parmi ces instruments ceux qui, possédant à un plus haut degré que les autres le caractère de transmissibilité, sont actuellement les principaux véhicules du crédit. Telles sont, par exemple, et en première ligne, les obligations commerciales auxquelles donnent naissance les ventes à crédit.
Les ventes à crédit contiennent un prêt en marchandises et constituent ce qu’on pourrait appeler le crédit en nature. Elles forment de véritables cascades de crédit qui descendent du producteur jusqu’au plus infime consommateur. Le manufacturier vend à crédit au marchand de gros, lequel revend à crédit au marchand en demi-gros, lequel revend au détaillant, lequel revend au consommateur. La masse des marchandises qui se trouvent ainsi prêtées à terme est énorme, et chacun de ces prêts en nature donne lieu à la création d’une obligation commerciale. En achetant la marchandise à terme au manufacturier, [II-289] le marchand de gros souscrit un billet par lequel il s’engage à en payer ou à en faire payer le montant soit au manufacturier lui-même, soit à son ordre, à une certaine époque et dans un certain lieu déterminés. Le marchand en demi-gros et le détaillant en font autant, lorsque la marchandise leur arrive. La vente en détail seule ne donne point naissance, ordinairement du moins, à la création d’obligations commerciales. Le détaillant se borne à tenir note de ses ventes; il vend, comme on sait, en partie au comptant, en partie à terme, et les crédits qu’il accorde dépendent toujours de la quantité de capital qu’il a pu engager dans son commerce et de la somme de crédit qu’on lui accorde à lui-même. En général, sa clientèle se proportionne, d’une part, à la quantité de crédit qu’il peut lui fournir ou lui transmettre, d’une autre part, au prix qu’il en exige.
Ce prix auquel se paye le crédit en nature n’est pas visible; mais il n’en existe pas moins. Dans toutes les branches de commerce, le prix de la marchandise vendue au comptant est moins élevé que celui de la marchandise vendue à crédit. La différence constitue l’intérêt du capital prêté en nature dans la vente à terme. Le plus souvent, le prix de vente est stipulé à terme, et, lorsque, par dérogation aux habitudes prises, l’acheteur paye au comptant, on lui bonifie la différence. Cette bonification se fait en totalité, dans le cas d’un payement au comptant, ou seulement en partie si l’acheteur se borne à avancer son payement d’une partie du délai ordinaire.
La différence entre le prix de vente au comptant et le prix de vente à terme, formant le taux d’intérêt du crédit en nature, est plus ou moins forte, selon le plus ou moins d’élévation du taux général de l’intérêt des capitaux, selon encore la longueur du terme et l’intensité des risques, impliqués dans la vente à [II-290] crédit.Quand la marchandise arrive au détaillant, elle est chargée de l’intérêt du capital qu’elle représente, depuis sa sortie de la manufacture, et cet intérèt se trouve grossi d’une série de primes d’assurances: prime pour couvrir le manufacturier de ses risques vis-à-vis du marchand de gros, prime des risques du marchand de gros vis-à-vis du marchand en demigros et de celui-ci vis-à-vis du détaillant. Quand enfin la marchandise arrive au consommateur, son prix a subi, par cette accumulation de risques, une surcharge considérable; et en admettant, chose trop fréquente, que le consommateur soit pauvre et qu’il achète à terme, cette surcharge peut devenir exorbitante. En effet, le petit détaillant qui vend à la classe ouvrière, par exemple, n’ayant d’ordinaire que peu de ressources et n’offrant que peu de garanties, achète à terme et fort cher. D’un autre côté, il a affaire à des débiteurs encore moins solides qu’il ne l’est lui-même, et contre lesquels les moyens d’exécution, en cas de non payement, sont à peu près nuls. Il est donc obligé de se couvrir, par une prime extraordinaire, du risque extraordinaire qu’il subit. Trop souvent, à la vérité, il abuse de la condition misérable de son ignorante et imprévoyante clientèle, en lui fournissant le crédit en nature à un taux usuraire. Toutefois, sous un régime de liberté de l’industrie et du commerce, cette usure ne peut être qu’accidentelle. Car, aussitôt que les profits du détaillant dépassent ceux des autres branches de travail ou de commerce, la concurrence ne manque pas d’intervenir pour augmenter l’offre des petits crédits, à l’avantage des consommateurs. L’extrême multiplication des marchands de détail provient donc de ce qu’ils ne sont pas seulement les fournisseurs de la classe ouvrière, mais encore ses prêteurs ou ses banquiers. Ils lui font sans doute payer à un [II-291] taux énorme le crédit en nature qu’ils lui offrent et dont elle n’est que trop portée à abuser. Mais le remède que les écoles socialistes ont voulu opposer à ce mal, savoir, la limitation du nombre des intermédiaires, ne ferait que l’aggraver, en créant non seulement un monopole commercial, mais encore un monopole de crédit, au profit des intermédiaires demeurés par privilége en possession du marché.
Sous l’ancien régime, les industries et les branches de commerce, organisées en corporations, étaient investies de ce double monopole; mais on y opposait ordinairement la tarification du prix ou le maximum, lequel agissait, en dernière analyse, comme une espèce de loi somptuaire du crédit. Le maximum étant calculé sur le comptant, les détaillants devaient nécessairement limiter leurs crédits en nature, faute de pouvoir comprendre dans leur prix de vente la prime du risque de la vente à crédit. Ils avaient bien, à la vérité, la ressource de percevoir cette prime sous la forme d’une altération de la qualité de la marchandise ou d’une fraude sur le poids; mais la police des corporations se montrait avec raison fort sévère pour ce genre de fraudes; en sorte que le risque de la répression dépassant communément le bénéfice de cette opération véreuse, force était bien de s’en tenir à la vente au comptant, ou, du moins, de ne pratiquer que d’une manière restreinte et exceptionnelle la vente à crédit.
Or, si l’on songe que les classes inférieures étaient, à cette époque, plus encore qu’à la nôtre, incapables d’un bon self-government, peut-être trouvera-t-on que cette restriction du crédit, malgré la grossièreté du procédé dont on se servait pour l’opérer, tournait, en définitive, à leur avantage. Ce n’est point une raison sans doute de continuer à appliquer le régime [II-292] du monopole et du maximun à la vente des denrées nécessaires aux masses, ce régime étant à d’autres égards essentiellement vicieux, — mais c’est une raison d’aviser aux moyens de suppléer à la fonction utile qu’il remplissait, en empêchant les classes mineures d’abuser des dangereuses facilités du crédit [49] .
[II-293]
— Cela serait d’autant plus nécessaire qu’à ce dernier degré de l’échelle du crédit, le renchérissement produit par l’accumulation des intérêts et des risques se perçoit communément adjourd’hui comme il se percevait autrefois, au moyen d’une falsification de la marchandise ou d’une fraude sur le poids. [II-294] Les petits consommateurs s’aperçoivent bien que la marchandise que leur livrent leurs “banquiers en nature” est mauvaise [II-295] et qu’on les trompe sur le poids, mais le besoin qu’ils ont du crédit les empêche de s’adresser à des fournisseurs au comptant [II-296] qui leur livreraient de bonne marchandise et à bon poids. Ceux mêmes qui payent d’habitude comptant se résignent, comme les autres, à être mal servis, afin de pouvoir, en cas de besoin, recourir au crédit de ces petits banquiers qui forment la grande masse des marchands de détail.
Quoi qu’il en soit, la même marchandise peut donner lieu, avant d’arriver au consommateur, à la création d’autant d’obligations commerciales qu’elle a été vendue et revendue de fois. Le fabricant la vend au marchand de gros, première obligation créée, le marchand de gros la revend au marchand en demigros, [II-297] seconde obligation, celui-ci au détaillant, troisième obligation: dans certaines circonstances même, lorsque la spéculation est active, la marchandise, passant en un bien plus grand nombre de mains avant d’arriver au consommateur, les obligations se multiplient en conséquence. Il est à remarquer toutefois qu’un grand nombre de ventes à crédit se soldent au moyen d’obligations antérieurement créées au profit des acheteurs, et dont ceux-ci se servent, à leur tour, pour acquitter leurs dettes commerciales. Mais le nombre de ces obligations ne s’en accroit pas moins à mesure que le crédit s’étend, et, en Angleterre, [II-298] par exemple, il a atteint un chiffre véritablement énorme [50] .
A quoi servent ces obligations commerciales, auxquelles donnent naissance les ventes à crédit? Elles servent d’abord à constater la dette, et l’engagement de la payer dans un lieu et dans un délai déterminés. A l’origine, elles ne paraissent pas avoir eu d’autre utilité. Le vendeur ou le prêteur, comme on voudra, — car la vente à crédit renferme à la fois une vente et un prêt, — les conservait jusqu’à l’échéance. Il les recouvrait alors, ou les faisait recouvrer par un fondé de pouvoirs, si elles étaient payables dans une autre localité. Dans l’intervalle, il perdait complétement la disponibilité du capital qu’il avait ainsi engagé, et la compensation nécessaire pour le couvrir de cette privation se trouvait à son maximum. Mais l’invention du procédé de l’endossement, en rendant les obligations commerciales facilement transmissibles, modifia profondément sous ce rapport la situation des prêteurs, et donna un essor prodigieux au crédit. Que résulta-t-il, en effet, de cette transmissibilité des obligations commerciales? Il en résulta la possibilité de recouvrer en tous temps et en tous lieux, la disponibilité du capital engagé sous la forme d’une marchandise vendue à crédit, et, [II-299] par conséquent, la réduction à un taux minime de la compensation nécessaire pour couvrir l’un des deux éléments constitutifs de l’intérêt, savoir la privation. Supposons, en effet, que j’achète une marchandise à crédit pour la revendre. Je souscris à mon vendeur ou à son ordre une obligation payable à trois mois, par exemple. C’est, en réalité, un emprunt que je fais pendant trois mois, d’un capital égal à la valeur de la marchandise que j’ai ainsi achetée à crédit. Si mon obligation n’était point transmissible, le vendeur serait évidemment privé pendant trois mois de cette portion de son capital, — à moins qu’il ne pῦt s’en servir comme d’un gage pour emprunter à son tour. Mais grâce à la transmissibilité ou à la circulabilité des obligations commerciales, que se passe-t-il? C’est que le vendeur peut recouvrer à sa convenance la disponibilité du capital qu’il m’a prêté, soit en se servant de mon obligation pour acquitter une dette, soit en la vendant au comptant, autrement dit, en la faisant escompter. Vendre au comptant une obligation à terme, c’est une opération précisément inverse à la vente à terme d’une marchandise livrée au comptant. Tandis que l’on ajoute au prix de la marchandise le montant de l’intérêt à courir jusqu’au terme, on le déduit de l’obligation, en y ajoutant encore la couverture des frais de recouvrement et des risques de non payement. Mais du moment où cette sorte de vente peut se faire aisément, les capitaux prêtés dans les ventes à crédit recouvrent à peu près le même caractère de disponibilité que s’ils n’étaient pas engagés.
Après les obligations auxquelles donnent naissance les prêts en marchandises dans les ventes à crédit, il faut mentionner celles qui doivent leur origine aux prêts en monnaie. Celles-ci présentent une variété infinie suivant la destination et les conditions [II-300] des prêts. Viennent d’abord les obligations créées par les gouvernements emprunteurs, et qui ont pour gage leur fidélité à remplir leurs engagements et les ressources matérielles dont ils disposent. Les emprunts publics sont, les uns, conclus à terme, les autres, pour un temps illimité. Les gouvernements qui ont besoin d’argent offrent des obligations portant intérêt à des taux divers, 3, 4, 5 p. c., et selon que ces obligations sont plus ou moins demandées elles se vendent plus ou moins cher. Elles sont plus facilement transmissibles encore que les obligations commerciales, en ce qu’elles sont souscrites impersonnellement, c’est à dire non à un prêteur déterminé, mais à la série des prêteurs qui se les passent de main en main, sans avoir besoin de recourir à l’endossement, car elles sont payables, intérêts et principal, au porteur. La transmissibilité de ces obligations est donc absolue, et il en résulte pour les gouvernements qui les émettent un maximum de facilité à trouver des prêteurs. — Viennent ensuite les obligations résultant des emprunts conclus par des particuliers ou des associations de particuliers. Ces emprunts sont faits sur gage de capitaux immobiliers ou mobiliers, ou d’obligations provenant d’emprunts faits en marchandises ou en argent, ou bien encore, ils sont faits, sans gage réel, sur la simple signature ou sur la parole de l’emprunteur, et dans ce dernier cas ils n’ont d’autre garantie que sa bonne foi. Les obligations qui proviennent de ces emprunts sont plus ou moins aisément transmissibles; mais, toujours, le taux auquel se concluent les emprunts est plus ou moins élevé, et les emprunts sont plus ou moins faciles selon le degré de transmissibilité des obligations.
Enfin, non seulement le prêt, mais encore tout engagement de capital peut donner naissance à une valeur transmissible. [II-301] A cet égard, la substitution progressive de la propriété actionnaire à la propriété individualisée renferme une véritable révolution économique. Les valeurs immobilières, par exemple, ne peuvent être transmises que moyennant des formalités compliquées et en payant des impôts onéreux, aussi longtemps qu’elles demeurent à l’état de propriétés patrimoniales. En outre, elles se présentent fréquemment au marché, — lorsqu’il s’agit de grandes ou même de moyennes propriétés — par quantités trop grandes pour que la masse des petits capitalistes puissent les demander. Lorsqu’il s’agit, au contraire, de petites propriétés, elles présentent au point de vue de l’exploitation ou de la jouissance, des désavantages qui en réduisent encore la demande. A ces divers égards, la propriété collective et actionnaire est investie d’une supériorité qui finira certainement par la faire prédominer. Cette forme de la propriété permet, en effet, en premier lieu, de proportionner toujours exactement l’étendue des entreprises et, par conséquent, la quantité du capital qu’il faut réunir, aux besoins de la production; en second lieu, elle permet, par la division du capital en actions essentiellement mobilisables, de faciliter au maximum l’engagement et le dégagement des capitaux sous cette forme, en réduisant au minimum la privation des capitalistes et, par conséquent, la compensation nécessaire de cette privation. Les frais de production qu’ont à supporter les entreprises par actions se trouvant abaissés de la différence, relativement à ceux qu’ont à supporter les entreprises dites patrimoniales, il est évident que celles-ci devront disparaître devant la concurrence de celles-là, aussitôt qu’aucune entrave artificielle ne sera plus opposée à la constitution des associations pour l’exploitation des différentes branches de l’activité humaine, comme disparaissent [II-302] les métiers à la main devant la concurrence des métiers mécaniques.
Ce phénomène de la mobilisation des valeurs de toute sorte est certainement, au point de vue de l’avenir économique des sociétés, l’un des plus considérables du monde moderne. S’il n’est pas exact de dire qu’il multiplie les capitaux, en ce sens qu’il n’augmente point la masse des capitaux existants, en revanche, il produit un résultat analogue, en rendant disponibles pour la production une masse de capitaux qui ne s’y seraient point engagés, soit qu’ils eussent été conservés inactifs, soit que, faute d’un emploi productif aisément accessible, ils eussent été appliqués à des dépenses inutiles ou nuisibles. Du moment, au contraire, où l’on peut en tous temps et en tous lieux, engager à mesure qu’il se forme, et en parcelles minimes, le capital dans la production, sans difficultés et sans frais, et le dégager de même, il n’y a plus de raison de laisser des capitaux inactifs. De plus, la tentation de les gaspiller s’affaiblit, et l’excitation à les former s’accroît. Enfin, l’abondance des capitaux offerts à la production s’augmentant, la production se développe, les entreprises se multiplient, et le résultat final, quoique indirect, est une multiplication des capitaux. Ainsi donc, en deroière analyse, l’effet de la mobilisation des capitaux, c’est de diminuer le prix naturel de leur service, par la diminution de la privation résultant de leur engagement, puisqu’il est désormais possible de les dégager à volonté, en totalité ou en partie, en tous temps et en tous lieux; c’est, par là même, d’en augmenter la masse disponible pour toute sorte d’emplois productifs.
II. Les GarantieS Du CrÉDit Et Les Assurances. De même que tout engagement de capital implique une privation, il [II-303] implique aussi un risque. On diminue la privation, en mobilisant la propriété des valeurs engagées, après l’avoir fractionnée en coupons appropriés aux besoins du marché; on diminue le risque en multipliant les garanties du placement, et on le rend moins sensible en le divisant au moyen des assurances. On peut dire que le développement du crédit s’opère en raison de la mobilité ou de la circulabilité des valeurs engagées, des garanties du placement et de la division des risques.
Les garanties peuvent être partagées en deux grandes catégories: celles qui concernent le gage offert, et celles qui concernent l’exécution de l’engagement. Les premières sont personnelles ou réelles; les secondes morales ou légales.
Il est dans la nature de tout placement de comporter des risques. Toute entreprise, comme nous l’avons vu précédemment, comporte deux sortes de risques: des risques généraux et des risques spéciaux. Les uns proviennent des conditions générales de sécurité dans lesquelles se trouvent placées les entreprises. Si la propriété n’est point convenablement garantie, si les débouchés sont précaires, etc., les risques généraux incombant à l’ensemble des branches de la production d’un pays seront considérables. D’un autre côté, si certaines industries sont exposées à des accidents provenant de leur nature particulière et des conditions dans lesquelles elles s’exercent, tels que sécheresses, inondations, épizooties pour l’agriculture, risques de mer pour les transports et le commerce maritimes, elles subiront des risques spéciaux qui viendront s’ajouter aux risques généraux qui atteignent l’ensemble des branches de la production. Si ces divers risques qui menacent, dans son existence, le capital engagé, atteignent un niveau élevé, la rémunération du capital devant être en proportion, les frais de la [II-304] production seront considérables, et, par conséquent, les produits ne seront accessibles qu’à un petit nombre de consommateurs. Dans ce cas, la production sera peu développée et elle demandera peu de capitaux. L’offre des capitaux se proportionnera naturellement à la demande, car si elle venait à la dépasser, les risques cessant d’être suffisamment couverts, les capitaux engagés seraient dévorés par eux, jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli; si elle demeurait en dessous, la prime qui s’attacherait à la rémunération naturelle des capitaux ne manquerait pas d’en attirer l’offre dans cette direction jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt encore rétabli.
A mesure que les risques diminuent, au contraire, la prime nécessaire pour les couvrir s’affaiblit, la rémunération nécessaire des capitaux s’abaisse, et le prix des produits avec elle. En conséquence, le débouché de la production augmente, partant celui des capitaux. Le développement du crédit s’opère ainsi en raison de l’affaiblissement des risques.
Il y a deux manières d’engager les capitaux dans la production, sous le rapport des risques. La première consiste à participer à toutes les chances et à courir tous les risques des entreprises. Dans ce cas la rémunération du capital se perçoit sous la forme d’une part éventuelle, qui se nomme profit ou dividende. La seconde manière consiste à se faire assurer, par l’entrepreneur contre les risques de l’entreprise, et à recevoir sa rémunération sous la forme d’une part fixe, intérêt ou loyer. Dans ce cas, le capital engagé reçoit sa part fixe, quels que soient les résultats de l’entreprise. Mais, on le conçoit, cette assurance nécessite des garanties. Si je prête un capital pour un délai déterminé moyennant un certain intérêt, il faut que j’aie une sécurité suffisante que l’intérêt me sera exactement [II-305] servi et, finalement, que le capital me sera intégralement remboursé. En quoi peut consister cette sécurité? D’abord, dans les gages que m’offre l’emprunteur-assureur. Ces gages peuvent affecter autant de formes qu’il existe de modes d’investissement des valeurs. L’emprunteur peut m’offrir en gage des valeurs personnelles, immobilières et mobilières. Jadis, sous le régime de l’esclavage, on prêtait sur le gage de la personne du débiteur: quand il n’exécutait point ses engagements. quand il ne remboursait pas les intérêts ou le principal, au temps prescrit, on le saisissait, et on le vendait pour réaliser le gage. La contrainte par corps est un reste imparfait de ce régime d’esclavage, auquel tend à se substituer le régime de l’engagement libre, et, par conséquent aussi, de l’hypothèque librement stipulée sur le travail [51] . L’emprunteur peut encore [II-306] offrir en gage des valeurs immobilières, terres, maisons, bâtiments, mines, forêts, voies de communication, pêcheries, etc.; sur lesquelles le prêteur prend hypothèque, en ayant soin de constater préalablement si la valeur du gage suffit pour garantir le capital prêté (et cette valeur doit naturellement être plus forte que la valeur prêtée pour compenser les risques inhérents à la réalisation du gage). L’emprunteur peut offrir enfin [II-307] des valeurs mobilières, telles que marchandises et effcts mobiliers de toute sorte; mais, dans ce cas, il ne suffit pas de prendre hypothèque sur ces valeurs qui, par leur nature, peuvent être dérobées au prêteur, il faut ou s’en saisir jusqu’à accomplissement des obligations du prêt qu’elles servent à garantir ou les faire déposer dans des mains sῦres. Il en est de même pour une autre catégorie de gages, auxquels la mobilisation [II-308] des titres de propriété a donné naissance, nous voulons parler des actions et obligations de toute sorte, lesquelles sont à leur tour susceptibles de servir de gages, comme représentant des valeurs réelles.
En dernière analyse, toute valeur investie sous n’importe quelle forme, personnes, objets mobiliers ou immobiliers, et susceptible d’être réalisée par l’échange, peut servir de gage ou [II-309] de garantie. On peut en dire autant de tout titre de propriété ou de toute obligation conférant un droit sur une valeur investie et susceptible de réalisation.
Mais suffit-il de pouvoir offrir ces gages réels pour se procurer des capitaux? Non, il faut y ajouter des garanties soit morales et intellectuelles, soit légales, sinon les gages réels auront beau exister, comme on ne pourra se les faire livrer, conformément aux stipulations faites, ce sera comme s’ils n’existaient point.
Les garanties morales et intellectuelles résident dans la moralité et la capacité industrielle des emprunteurs. Ces garanties ne sauraient suppléer aux gages réels, mais elles sont dans la plupart des cas indispensables pour en assurer la livraison. Que l’individu ou la collection d’individus auxquels on confie des capitaux manquent de probité, et ils s’abstiendront de livrer le gage, soit en le détournant de sa destination, soit de toute autre manière; qu’ils manquent de capacité, et ils s’exposeront à perdre dans des spéculations mal conçues ou mal exécutées, non seulement le capital emprunté, mais encore celui qui lui sert de garantie. Les garanties légales servent à suppléer aux garanties morales et intellectuelles, en fournissant, par l’intervention de la puissance publique, aux engagistes, en premier lieu, les moyens de se faire livrer le gage, nonobstant la mauvaise foi des engagés, en second lieu, les moyens de le conserver intact et disponible, dans le cas où les débiteurs feraient de mauvaises affaires, en reportant, dans ce dernier cas, le risque sur la portion non hypothéquée des biens. Plus les garanties morales et intellectuelles d’une part, les garanties légales, de l’autre, sont complètes, plus la sécurité des gages est grande. Elles ne peuvent suppléer aux gages [II-310] réels, mais, sans elles, les gages réels, qu’ils consistent en valeurs personnelles, mobilières ou immobilières, demeurent comme non avenus [54] .
[II-311]
Les assurances considérées par rapport au crédit ont pour effet de diviser les risques et, par conséquent, de diminuer la prime nécessaire pour les couvrir. Elles peuvent s’appliquer à [II-312] toutes les causes de destruction ou de perte qui menacent les capitaux engagés dans les entreprises; que ces causes de destruction ou de perte, manifestées par des risques, soient générales [II-313] ou spéciales. Ainsi toutes les entreprises sont soumises à des risques de destruction, de pillage, de vol ou de dépossession, provenant de la violence ou de la fraude, et les gouvernements [II-314] ne sont autre chose que des mutualités établies pour combattre ces risques généraux. L’impôt, sous quelque forme qu’il soit perçu, n’est donc, au moins pour une bonne part, [II-315] qu’une prime d’assurance. Seulement, cette espèce d’assurance diminue les risques, plutôt qu’elle ue les divise. En établissant, par exemple, une bonne police, un gouvernement abaisse le [II-316] niveau des risques d’assassinat, de pillage et de vol, mais sans diviser ceux qui subsistent, en ce sens qu’il ne rembourse pas les dommages causés par l’échéance de ces risques [56] . Les assurances proprement dites ont, au contraire, pour objet de diviser les risques, sans les diminuer au moins d’une manière directe. Telles sont les assurances contre les risques de mer, naufrages, avaries, etc., les assurances contre l’incendie, contre la grèle et les autres intempéries, contre les épizooties, contre les causes de mortalité ou d’accidents qui menacent l’espèce humaine. Ce n’est qu’indirectement que les entreprises d’assurances contre les risques de mer, par exemple, agissent pour réduire ces risques, en provoquant une meilleure construction des navires, l’établissement de phares, etc., ou bien encore, s’il s’agit d’assurances contre l’incendie, qu’elles déterminent l’emploi, dans les constructions, de matériaux moins combustibles ou l’organisation de services plus efficaces pour la répression des incendies. L’objet direct et principal de ces assurances, c’est de diviser les risques d’une certaine catégorie, en répartissant les dommages ou les pertes qu’il est dans leur nature de causer, sur la généralité de ceux qui y sont exposés. C’est ainsi [II-317] que les risques de mer causent, chaque année, la destruction d’un certain capital sous forme de navires et de marchandises, sans parler des équipages. Ce capital, si considérable qu’il soit, ne forme cependant qu’une fraction minime de la masse du capital qui est annuellement exposé aux risques de mer. En revanche, il forme une fraction importante parfois même la totalité des fonds productifs de ceux qui en subissent la perte. Cela étant, tous ceux qui courent des risques de mer ont un intérêt visible à s’associer et à se cotiser, — chacun dans la proportion du capital exposé et de l’intensité du risque qui menace ce capital et qui varie selon les traversées et selon les saisons, — pour répartir entre leur multitude qui la ressent à peine, une perte qui serait accablante pour quelques-uns. Telle est, en effet, l’opération des assurances maritimes [57] . Chaque année, le capital nécessaire pour compenser les pertes que l’échéance des risques de mer inflige à quelques-uns est levé sur tous ceux ou sur le plus grand nombre de ceux dont les capitaux ont été exposés à ces risques. A la cotisation requise pour la couverture des risques vient s’ajouter naturellement la rémunération nécessaire du travail et du capital engagés dans [II-318] l’industrie des assurances; mais, sous un régime de libre concurrence, cette rémunération ne peut excéder longtemps son taux naturel ni demeurer en dessous.
Les assurances ont donc pour résultat direct et principal de diminuer pour chaque entreprise la hauteur des risques en proportion de la division qui en est faite. Supposons, par exemple, qu’un armateur, dont le capital est d’un million, assure lui-même tous les risques qui menacent ses navires. Comme il sera exposé à perdre, par suite de sinistres maritimes, le tiers, la moitié, la totalité même de son capital, il devra comprendre dans les frais de production de ses services une prime proportionnée à cette éventualité de perte. Les frais de transport maritimes, chargés de cette lourde prime, s’élèveront, en conséquence, fort haut, et les armateurs réaliseront de gros bénéfices quand ils ne subiront point de sinistres. En revanche, ils pourront être ruinés par un naufrage. En un mot, leur industrie sera essentiellement aléatoire. Que les assurances interviennent, au contraire, et l’industrie des armateurs ne sera plus grevée, du chef des risques de mer, que du montant de la cotisation relativement minime, qui sera payée par tous pour compenser les pertes subies par quelques-uns. La prime nécessaire pour couvrir les risques de l’engagement des capitaux dans cette industrie sera abaissée en proportion, et cette réduction du prix naturel de l’intérêt, amènera un développement correspondant du crédit.
[II-319]
NEUVIÈME LEÇON↩
les intermÉdiaires du crÉdit
Des banques de prêt et des banques d’escompte et de circulation. — Mécanisme et opérations des banques de prêt sur gage. — Monts-de-piété. — Banques de prêt sur marchandises entreposées. — Récépissés et warrants. — Services que rendent les banques de prêt sur marchandises entreposées. — Mécanisme et opérations des banques de crédit foncier. — Formes et intermédiaires primitifs du prêt hypothécaire. — Progrès résultant de l’établissement des banques de crédit foncier. — Banques agricoles. — Banques industrielles. — Crédits mobiliers. — Du crédit personnel et de son développement possible. — Les banques d’escompte. — Nature de leurs opérations. — Division naturelle du travail entre les intermédiaires du crédit. — Hiérarchie et fonctions diverses des intermédiaires. — Comment les banques d’escompte sont issues des banques de dépôt. — Opérations des banques de dépôt. — Virements de comptes. — Assurance de la monnaie. — Ce qu’était la monnaie de banque. — Comment la monnaie de banque a donné naissance au billet de banque. — De l’étalonnage des billets de banque. — Économie résultant de la substitution partielle des obligations commerciales et autres au numéraire et aux métaux précieux dans la monétisation des billets de banque.
Il existe deux catégories générales de banques, divisées à leur tour en un grand nombre de variétés ou de spécialités, [II-320] savoir: les banques de prêt et les banques d’escompte, auxquelles on peut ajouter les banques d’émission ou de circulation, ordinairement annexées aux banques d’escompte, quoiqu’elles ne soient point, à proprement parler, des banques mais de véritables ateliers monétaires.
Etudions successivement ces différents genres d’institutions de crédit ainsi que les opérations auxquelles elles se livrent et qui les caractérisent.
Les banques de prêt les plus anciennes et les plus connues sont les monts-de-piété ou banques de prêt sur gage mobilier. En quoi consistent les opérations de ces banques? Comme toutes les institutions de crédit, elles empruntent des capitaux d’une main pour les prêter de l’autre. Comment empruntent elles? En émettant des obligations, portant un intérêt plus ou moins élevé et remboursables soit à terme fixe, soit graduellement, par voie d’amortissement. Ces obligations, elles les offrent sur le marché en demandant, en échange, des capitaux investis sous forme de monnaie. Dès qu’elles se sont ainsi procuré des capitaux monnayés, elles les prêtent pour un temps plus ou moins long, sur garantie d’effets mobiliers de toute sorte, marchandises, vêtemens, meubles vieux ou neufs, bijoux etc., en exigeant de leurs emprunteurs un intérêt plus élevé que celui qu’elles fournissent à leurs prêteurs. La différence sert à couvrir leurs frais et risques, et à leur procurer un bénéfice. Seulement, grace aux précautions que prennent les banques de prêt sur gage mobilier, leurs risques sont insignifiants. En premier lieu, elles se font livrer les gages qui servent de garanties à leurs prêts, et elles ne les restituent que contre remboursement du capital prêté. En second lieu, elles ne prêtent qu’un capital ordinairement fort inférieur [II-321] à la valeur du gage, en sorte que si le remboursement n’est pas effectué à l’échéance, ou l’engagement renouvelé par le payement des intérêts échus, la vente du gage suffit et au delà pour couvrir le montant de la créance.
Les banques de prêt sur gage mobilier créent deux sortes d’instruments de crédit. 1° Les obligations à l’aide desquelles elles se procurent le capital qu’elles prêtent et qui sont essentiellement transmissibles. 2° Les reconnaissances ou reçus des objets servant de gage et déposés dans les magasins de la banque. Ces reconnaissances ou reçus en échange desquels la banque restitue les objets déposés, lorsqu’on lui rembourse le montant du prêt, sont aussi, le plus souvent, transmissibles. Comme les banques de prêt sur gage mobilier ou monts-de-piété ne prêtent qu’une partie assez faible de la valeur du gage, on peut trouver profit à acheter la reconnaissance, véritable titre de propriété mobilière, en fournissant au détenteur de ce titre contre lequel se délivre le gage la différence existant entre la valeur du gage et le montant du prêt, déduction faite de la prime nécessaire pour couvrir les risques de ce genre d’opération, de l’intérêt du capital qui s’y trouve engagé et du bénéfice des entrepreneurs. On peut de même, prêter sur reconnaissances, si la banque n’a l’habitude de prêter qu’une proportion minime de la valeur du gage. En ce cas, le second prêteur se fait délivrer le gage en remboursant le premier prêt, et il trouve sa garantie dans la différence existant entre le montant de ce premier prêt et la valeur vénale du gage.
Les banques de prêt sur gage ou monts-de-piété peuvent opérer sans engager dans leurs transactions aucun capital qui leur soit propre. Mais il est indispensable qu’elles offrent à la fois aux emprunteurs engagistes et aux prêteurs des garanties [II-322] solides. Il faut, en ce qui concerne les emprunteurs, qu’ils aient la certitude que les gages qu’ils ont déposés dans les magasins de la banque demeureront intacts et leur seront restitués sur la présentation de leur reconnaissance; il faut que les prêteurs aient la même sécurité en ce qui concerne le service des intérêts et le remboursement de leurs obligations. Ces diverses garanties peuvent être à la rigueur purement morales. Si les entrepreneurs de prêt mobilier joignent la prudence à l’honnêteté, s’ils prennent soin, notamment, de faire assurer contre l’incendie les gages déposés dans leurs magasins, les emprunteurs ne courront aucun risque; de mème, s’ils n’émettent des obligations que jusqu’à concurrence des prêts qu’ils effectuent, et s’ils ne prêtent que contre des garanties suffisantes, c’est à dire de manière à être toujours couverts par la vente du gage, ils ne feront courir aucun risque à leurs prêteurs. Toutefois comme les garanties morales sont fort difficiles à réunir et surtout à perpétuer, toute banque de prêt sur gage mobilier doit ou posséder un capital de garantie qui serve de caution à sa bonne et honnête gestion, ou se faire assurer par des institutions capables de fournir cette caution aux intéressés [58] .
[II-323]
Cette forme primitive de la banque de prêt sur gage mobilier a donné naissance aux banques de prêt sur marchandises [II-324] entreposées. Ici, la division du travail a fait un pas de plus. Les marchandises servant de gage sont déposées dans des [II-325] docks ou entrepôts, appartenant à des tiers responsables du dépôt. Ces entreposeurs délivrent aux déposants, qui leur [II-326] confient des marchandises, un récépissé transmissible par voie d’endossement, sur la présentation duquel ils se dessaisissent [II-327] du dépôt, moyennent payement des frais. Les négociants qui possèdent des marchandises ainsi entreposées peuvent ou les [II-328] vendre ou s’en servir comme d’un gage pour emprunter. S’ils les vendent, ils se bornent à endosser leur récépissé à [II-329] l’acheteur. Mais s’ils jugent que le moment n’est pas favorable à la vente, et s’ils ont besoin néanmoins de réaliser une partie [II-330] du capital investi sous cette forme, ils contractent un emprunt sur hypothèque de leur marchandise. Le prêteur prend hypothèque au moyen d’une inscription dans les livres de l’entrepôt, et, de plus, il reçoit un instrument de crédit nommé warrant qui lui permet de mobiliser sa créance, en la cédant par voie de simple endossement.
La marchandise hypothéquée peut néanmoins être vendue avant l’échéance du prêt et retirée de l’entrepôt, mais, en ce cas, on ne la délivre que sur la présentation du récépissé et du warrant acquitté. Si le porteur du warrant n’est pas connu, la somme due, avec adjonction des intérêts, est consignée dans la caisse de l’entrepôt. Si le prèt échoit avant que la marchandise ait pu être vendue, et si l’emprunteur n’est pas en mesure d’acquitter sa dette, la vente du gage a lieu à la réquisition du prêteur. Des intermédiaires, banquiers ou commissionnaires, se chargent ordinairement d’effectuer les prêts sur marchandises entreposées; ils transmettent ensuite les warrants à une banque, qui escompte cette obligation sur hypothèque mobilière comme tout autre effet de commerce.
Le grand avantage de cette forme du prêt sur gage, c’est d’augmenter la disponibilité des marchandises dans le temps, en permettant aux négociants de choisir le moment le plus favorable à la vente, ce qui n’a point lieu lorsqu’ils ne peuvent dégager une partie de leur capital, en engageant la marchandise dans laquelle il est investi. Dans ce cas, en effet, s’ils doivent se procurer des fonds pour acquitter des obligations antérieures ou s’ils veulent entamer une opération avantageuse, ils sont obligés de vendre leurs marchandises au comptant ou à terme en recourant à l’escompte [II-331] pour en réaliser immédiatement la valeur sans attendre le moment le plus propice à la vente [60] .
[II-332]
Emprunter d’une main des capitaux, soit à un prèteur déterminé dont la créance est personnelle, soit à un prêteur [II-333] impersonnel par une émission d’obligations transmissibles; prêter de l’autre ces capitaux sur garantie de marchandises [II-334] détenues par le prêteur sur gage, ou, mieux encore, par un tiers responsable, et trouver, avec la couverture de ses frais et [II-335] risques, son bénéfice dans la différence du taux de l’emprunt avec le taux du prêt, voilà toute l’opération du prêt sur gage [II-336] mobilier. Cette opération est fort simple, et elle n’exige de la part des banques qui s’y livrent, que quelques précautions élémentaires. Il leur suffit: 1° d’assurer la conservation du gage aussi longtemps que l’engagement subsiste; 2° de ne point dépasser dans le prêt une proportion telle, qu’en cas de vente pour défaut de remboursement à l’échéance, le montant du prêt soit couvert par le produit de la vente; 3° d’échelonner les échéances de leurs obligations remboursables à terme, de manière à ce que ces échéances correspondent toujours avec la rentrée des sommes prêtées sur gage, en tenant compte des retards résultant du non-remboursement. En supposant que ces règles soient observées et que la banque de prêt sur gage possède un capital suffisant pour cautionner son honnêteté et sa bonne gestion, le prêt sur gage mobilier pourra s’effectuer avec une sécurité presque entière.
De même que les capitaux se prêtent sur la garantie d’une marchandise ou de tout autre objet mobilier, ils se prêtent aussi sur la garantie d’une valeur investie en immeubles, terres, bâtiments, voies de communication, etc. Ces deux catégories de prêts ne présentent des différences qu’en ce qui concerne le mode de conservation du gage et les conditions de remboursement des emprunts.
Prenons pour exemple le prêt sur gage de valeurs foncières. Un propriétaire foncier a besoin d’un capital, soit pour améliorer et développer son exploitation agricole, soit pour tout autre usage. Il s’adresse à un capitaliste qui lui prête la somme requise, sur le gage de la valeur de la terre. Seulement, il n’est pas nécessaire dans ce cas, comme dans celui du prêt sur valeurs mobilières, que le gage soit livré au prêteur ou remis en mains tierces. Il suffit que la créance soit inscrite sur les livres de [II-337] l’état civil de la propriété foncière, et qu’en cas de non-payement des intérêts ou de non-remboursement de la somme prêtée, la terre engagée puisse être saisie et vendue à la réquisition du créancier. Tandis que dans le cas du prêt sur effets mobiliers, il faut immobiliser artificiellement le gage jusqu’au moment où il est libéré de toute hypothèque, dans le cas du prêt sur immeubles, cette immobilisation existant naturellement puisque le gage ne peut être déplacé et soustrait physiquement au prêteur, il suffit de compléter cette garantie matérielle par une garantie légale, sauf toutefois à veiller à ce que le gage ne soit point détérioré et à le mettre sous le séquestre en cas de détérioration.
Ces prêts connus sous la dénomination générique de prêts hypothécaires comportent, comme tous les autres, l’emploi d’intermédiaires, les capitalistes ne pouvant pas toujours trouver facilement eux-mêmes des emprunteurs et apprécier la valeur des gages offerts, les emprunteurs de leur côté possédant rarement les moyens d’information nécessaires pour aller demander les capitaux dans les endroits et dans les moments où ils s’offrent aux conditions les plus avantageuses. Les notaires et, en général, les agents ayant pour fonction spéciale d’opérer ou de constater les mutations de la propriété immobilière, ont été les premiers et les naturels intermédiaires des prêts sur gage de valeurs foncières. Ils se bornaient communément à mettre l’emprunteur en rapport avec le prêteur, parfois aussi ils faisaient eux-mêmes l’office de prêteurs, soit en se servant de leurs propres fonds, soit en empruntant des capitaux pour les prêter sur hypothèques et en fournissant aux prêteurs leur garantie personnelle, en sus de celle qui dérivait de la nature de leurs opérations.
[II-338]
Mais, sous cette forme primitive, le prêt hypothécaire rencontrait des obstacles et présentait des inconvénients de différente sorte. D’abord, les formalités coῦteuses de l’engagement, l’insécurité du gage sous un régime d’hypothèques occultes, les lenteurs et les frais de la réalisation des biens engagés, constituaient autant de risques qui grossissaient la prime d’assurance attachée à l’intérêt; ensuite les difficultés de la transmission des créances hypothécaires élevaient, de même, la compensation nécessaire pour couvrir la privation du capital engagé; d’où le taux souvent excessif du prêt sur valeurs foncières. L’élévation naturelle de ce taux ne faisait, du reste, pas seule obstacle au développement du crédit foncier. Il était dangereux pour les propriétaires d’user du crédit, à cause des embarras qu’ils éprouvaient toujours à reconstituer eux-mêmes d’année en année le capital qu’ils avaient emprunté, de manière à le rembourser exactement à l’échéance. Ils n’empruntaient donc qu’en cas d’extrème nécessité, à moins qu’ils ne fussent adonnés à la dissipation, et peut-être les obstacles que la législation opposait à la multiplication des prêts hypothécaires avaient-ils, à cet égard, un caractère somptuaire.
Les banques de crédit foncier, qui se substituent de plus en plus aux anciens intermédiaires, ont réalisé, au double point de vue des intérêts du prêteur et de l’emprunteur, un progrès considérable. Grâce à une combinaison fort simple, elles permettent à l’emprunteur de se libérer d’année en année, en ajoutant à l’intérêt stipulé un tantième pour l’amortissement du capital emprunté. Ce tantième est plus ou moins élevé selon que l’époque du remboursement est plus ou moins rapprochée. L’emprunteur estime approximativement l’augmentation de revenu que lui procurera l’application d’un supplément de capital, [II-339] et, selon que cette augmentation de revenu lui parait plus ou moins importante et probable, il consent à payer un intérêt plus ou moins élevé, il rapproche ou il éloigne le terme de remboursement de son emprunt, et par conséquent il augmente ou il diminue le montant annuel de l’amortissement.
Comment les banques foncières se procurent-elles le capital qu’elles prêtent sur gage immobilier? Elles l’empruntent en fournissant pour sécurités aux prêteurs: 1° l’ensemble des garanties hypothécaires fournies par les emprunteurs, garanties que les améliorations introduites dans la législation ont rendues de plus en plus sῦres et efficaces; 2° un capital souscrit par les actionnaires, mais dont une faible partie seulement est réalisée, ce capital servant uniquement de garantie supplémentaire.
A mesure qu’une banque foncière effectue des prêts hypothécaires, elle émet des obligations soumises à un amortissement correspondant à celui des prêts effectués. Ces obligations connues sous le nom de lettres de gage ont pour garanties, en premier lieu, l’ensemble des hypothèques fournies à la banque par les emprunteurs, en second lieu, le capital de la banque. Divisées en coupures commodes et transmissibles, elles offrent un placement facile et sῦr. D’une part, en effet, le capitaliste qui a engagé ses fonds dans l’achat d’une lettre de gage peut toujours les dégager, en revendant ce titre de créance mobilisable, à un autre capitaliste qui demande à engager ses fonds sous cette forme. La privation contenue dans le prêt hypothécaire, privation qui, dans l’ancien système, était considérable à cause de la longue échéance de cette sorte de prêt, se trouve ainsi presque annulée. D’une autre part, si le capitaliste qui effectue un prêt foncier, soit en achetant une lettre de gage lors de son émission, soit en se substituant au premier prêteur par la [II-340] transmission de cette obligation, ne possède plus, comme dans l’ancien système, le droit de se saisir du gage spécial offert par l’emprunteur; en revanche, il n’a plus à craindre les retards de payement et les autres embarras et risques de l’engagement direct. Il est assuré par la banque (quelquefois encore il y a réassurance par un établissement séparé) contre les retards et les risques de non-payement, et dans le cas où la banque elle-même manquerait à ses engagements à son égard, il pourrait se faire livrer sa quote-part dans la somme des créances hypothécaires et dans le capital de la banque [62]
[II-341]
Les banques de crédit foncier ont pour spécialité de procurer à l’agriculture un complément de capital qui s’investit en améliorations permanentes sous forme de bâtiments, de matériel, d’engrais, etc., c’est à dire qui se transforme en capital fixe; en conséquence, elles ne prêtent qu’à de longs termes. Mais les agriculteurs ont besoin encore de prêts à court terme pour acheter leurs semences, payer leurs ouvriers, etc, en un mot, pour compléter leur capital circulant. Les capitaux affectés à cette destination leur sont fournis, soit par des prêteurs ordinaires, soit par des banques agricoles sur engagement [II-342] des récoltes ou de toute autre valeur mobilière, immobilière ou personnelle.
[II-343]
Des opérations de crédit analogues à celles-là s’effectuent ou peuvent s’effectuer dans toutes les autres branches de l’activité humaine. Ainsi, les compagnies de chemins de fer, les entrepreneurs de bâtiments, les constructeurs de navires, etc., empruntent sur hypothèques, directement ou par l’intermédiaire des banques. Les compagnies de chemins de fer, par exemple, complètent ordinairement leur capital par des émissions d’obligations portant un intérêt fixe, soumises à un amortissement plus ou moins long et hypothéquées sur la propriété représentée par les actions.
Ces opérations, qui peuvent se diversifier beaucoup selon les besoins des entreprises et les convenances des capitalistes, ont donné naissance aux Banques industrielles, plus connues aujourd’hui sous le nom de Crédits mobiliers. Ces Banques servent d’intermédiaires pour recueillir les capitaux nécessaires aux grandes entreprises, soit qu’il s’agisse de les engager sous forme d’actions ou d’obligations. Elles se chargent également d’effectuer des prèts sur gage d’actions ou d’obligations quand les porteurs de ces titres veulent en dégager momentanément une partie de leur capital, sans cependant les aliéner. Quelquefois, enfin, elles achètent les actions et les obligations d’un certain nombre d’entreprises, et, à la place, elles émettent des actions ou des obligations, dont le dividende ou l’intérêt forme une moyenne, par la mise en commun des chances et des risques de chaque entreprise [64] .
[II-344]
Nous avons peu chose à dire du prêt sur gage de valeurs personnelles. [II-345] Le grand obstacle au développement de ce genre de [II-346] prêt, c’est, comme nous l’avons vu dans la leçon précédente, la [II-347] protection que les lois accordent à la personne du débiteur, en [II-348] empêchant le créancier de se saisir du gage sur lequel il a [II-349] prêté, de l’échanger ou de l’exploiter, comme dans le cas des [II-350] hypothèques prises sur les biens mobiliers ou immobiliers. A [II-351] défaut de garanties légales suffisantes, le prêteur est obligé de [II-352] se contenter de garanties purement morales, lesquelles sont [II-353] d’une nature trop précaire pour servir de base à une organisation [II-354] du crédit personnel, analogue à celle qui commence à s’établir [II-355] pour le crédit réel. Nous n’affirmerons pas cependant que [II-356] le crédit personnel ne soit pas destiné à progresser aussi; mais les institutions nécessaires à ses progrès, le marchandage, l’engagement volontaire, la garantie mutuelle et les assurances sur la vie, n’apparaissent encore qu’à l’état de germes, et les préjugés soi-disant protecteurs de la liberté des travailleurs s’opposeront longtemps à ce que ces germes se développent [68]
[II-357]
Abordons maintenant cette forme particulière du prêt qui porte le nom d’escompte et qui a donné naissance à une catégorie de banques connues sous le nom de Banques d’escompte et de circulation.
Nous avons vu déjà ce qui donne lieu à l’opération de l’escompte. C’est la vente à terme. Je vends, par exemple, pour [II-358] cent mille francs de marchandises que je livre immédiatement [II-359] à mon acheteur, en échange de promesses, de mandats ou de [II-360] lettres de change de pareille somme, payables dans un certain [II-361] lieu et dans un certain temps, soit dans trois mois. J’ai fixé le [II-362] prix de mes marchandises, en raison de ce mode de payement, [II-363] c’est à dire que j’ai ajouté au prix du comptant, les intérêts de [II-364] ce prêt en nature pendant trois mois. Mais j’ai besoin de réaliser immédiatement, sous forme de monnaie, le capital dont je me suis dessaisi sous forme de marchandises. Que fais-je? Je vends au comptant les obligations à terme qui m’ont été livrées en échange de mes marchandises. A quelle condition puis-je [II-365] trouver un acheteur? Évidemment, à la condition de lui fournir: 1° l’intérêt de son capital pendant trois mois; 2° une prime d’assurance pour les risques de non payement ou de retard de payement de mes obligations commerciales; 3° le montant des frais de recouvrement de ces obligations payables dans [II-366] un ou dans plusieurs endroits spécifiés et, parfois aussi, dans une monnaie différente de celle que je lui demande; 4° un profit rémunérateur de son industrie. La somme de ces différents articles se déduit du montant de mes obligations commerciales et constitue leurs frais d’escompte et de recouvrement.
Ainsi done, en vendant à terme, j’ai prêté un capital sous forme de marchandises. En faisant escompter les obligations commerciales qui m’ont été fournies en échange de mes marchandises, j’emprunte à mon tour un capital en argent équivalent à celui que j’ai prêté, déduction faite de l’intérêt, de la prime des risques et des frais de recouvrement. Si le taux auquel j’ai prêté en marchandises ne dépasse pas celui auquel j’emprunte en argent, je fais une opération nulle, sauf toutefois I’avantage qui me revient des facilités de crédit que j’accorde. Si le taux auquel j’emprunte en argent est supérieur à celui auquel je prête en marchandises, je perds comme intermédiaire du crédit, sinon comme industriel ou comme négociant et vice-versa.
La règle, c’est que l’opération doit me procurer un bénéfice comme intermédiaire du crédit. Car je ne suis pas autre chose. Je prête d’une main un capital en marchandises, tandis que j’emprunte de l’autre un capital en argent, en fournissant à mon prêteur l’obligation commerciale qui constate ma créance et en assurant cette obligation par l’endossement qui entraîne pour moi l’engagement de la rembourser en cas de non payement. Si je ne recevais point du crédit en argent, je ne pourrais en fournir en marchandises, et, selon les facilités que l’on m’accorde à cet égard et le prix auquel je les paye, j’étends ou je resserre mon crédit, j’en élève ou j’en abaisse le prix. De là le rôle considérable que jouent les banques d’escompte dans le monde industriel et commercial.
[II-367]
Les conditions naturelles de l’escompte étant bien définies, à qui m’adressé-je pour faire escompter mes obligations commerciales? Est-ce à la masse des capitalistes qui ont des fonds disponibles? Mais ces capitalistes ne sont point, pour la plupart, en position de juger si les obligations que je leur offre proviennent d’une opération effective, si elles ont réellement pour gage des marchandises vendues, si je n’ai pas aventuré imprudemment ce gage, si enfin mon assurance par voie d’endossement a une valeur sérieuse. Des intermédiaires ayant pour spécialité de faire l’escompte sont ici nécessaires. Non seulement ces intermédiaires apparaissent quand le besoin s’en fait sentir, mais encore ils se hiérarchisent [72] . De simples banquiers se chargent [II-368] d’escompter les obligations commerciales, auxquelles donne naissance la vente des marchandises à terme, en s’enquérant [II-369] si l’opération a été réelle, comme aussi en estimant la valeur de la garantie présentée par celui qui a endossé l’obligation [II-370] et par celui qui l’a acceptée. Cela fait, le banquier escompte l’obligation qui lui est offerte; mais, le plus souvent, cette [II-371] opération se résout pour lui en une simple assurance vis-à-vis d’un établissement auquel il passe à son tour l’obligation par [II-372] voie d’endossement, et qui la lui paye au comptant. Cet établisement supérieur, c’est la banque d’escompte proprement dite.
[II-373]
La banque d’escompte achète donc des obligations commerciales à terme, quand elle les juge suffisamment assurées, soit [II-374] pour les revendre, soit pour les garder en portefeuille jusqu’à l’époque de leur échéance, et elle fournit en échange à ceux [II-375] qui les lui vendent des capitaux sous forme de monnaie. Ces capitaux, comment se les procure-t-elle?
[II-376]
Si nous recherchons comment les choses se passaient à l’époque où l’escompte se faisait généralement au moyen de la [II-377] monnaie métallique, nous trouverons que les escompteurs empruntaient, de la main à la main, les fonds dont ils avaient [II-378] besoin, à des capitalistes auxquels ils inspiraient la confiance requise. Ils empruntaient naturellement à un taux plus bas que [II-379] celui auquel ils prêtaient, et ils avaient soin d’échelonner les termes de remboursement de leurs emprunts, de manière à les [II-380] faire correspondre avec ceux de leurs prêts. Les inconvénients principaux de ce système résidaient, en ce qui concernait les prêteurs, dans la non disponibilité du capital qu’ils avaient temporairement prêté; d’où résultait pour eux non seulement la nécessité d’une compensation pour cette privation, mais encore [II-381] l’impossibilité de consacrer à cet usage les sommes dont ils n’avaient la disposition qu’à très court délai. En ce qui concernait les emprunteurs, ils souffraient d’une cherté habituelle de l’escompte, provenant et de l’élévation naturelle du prix auquel pouvait se prêter la monnaie métallique et de la non disponibilité [II-382] dont étaient frappés les fonds consacrés à ce genre de prêts, sans parler de l’inconvénient de se servir d’un instrument monétaire lourd, encombrant, lent à compter, peu propre, en un mot, à remplir l’office de medium circulans pour les grandes opérations commerciales.
Ce vieux système tend à disparaître, mais, par le fait de la confusion originaire des banques d’escompte et des banques d’émission sous la dénomination de banques d’escompte et de circulation, et des obstacles qu’opposent à leur séparation le monopole gouvernemental du monnayage d’une part, le régime des banques privilégiées de l’autre, celui qui l’a remplacé laisse fort à désirer sous le double rapport de la sécurité et du bon marché du crédit. Nous nous en convaincrons en jetant un coup d’œil sur l’histoire des banques d’escompte et de circulation.
Ces banques sont issues des banques de dépôt qui prirent naissance dans les grandes cités commerçantes du moyen âge et qui eurent pour objet de satisfaire à un double besoin: 1° de faciliter et de simplifier les règlements de comptes entre les capitalistes de la même cité commerçante, comme aussi peutêtre d’augmenter la sécurité matérielle de leur capital monétaire ou de diminuer ses frais de garde, en remplaçant par la caisse unique de la banque, la multitude des caisses des capitalistes; 2e d’assurer les capitaux investis sous forme de numéraire contre les risques de dépréciation provenant des opérations que les souverains avaient l’habitude de faire sur les monnaies et que nous avons longuement décrites.
Nous pouvons aisément nous rendre compte de l’utilité de la première de ces deux catégories d’opérations. Dans de grands foyers d’industrie, de commerce et de crédit, tels qu’étaient [II-383] Venise, Gênes, Amsterdam, Hambourg, etc., une foule de négociants, de changeurs, de banquiers étaient obligés, d’une part, de conserver constamment dans leurs caisses de fortes sommes de numéraire; d’une autre part, ils faisaient entre eux des affaires importantes qui occasionnaient d’incessants transports d’espèces. L’établissement d’une caisse centrale de dépôt pour leurs capitaux monnayés ou simplement métalliques, et d’un bureau commun pour le règlement de leurs comptes, était de nature à rendre leurs opérations plus sῦres et plus économiques. D’abord, en déposant leurs fonds dans une caisse unique, placée sous la garde et sous la responsabilité des autorités de la cité, ils cessaient d’être obligés de barricader leurs maisons comme des forteresses, ils s’assuraient mieux et à moins de frais contre les risques ordinaires de vol, tout en évitant de signaler leurs richesses à la cupidité des masses ignorantes. Ensuite, la centralisation de leurs fonds leur permettait de régler leurs transactions journalières par de simples virements de comptes, opérés sur les livres de la banque, au lieu de recourir à des transports continuels de numéraire de caisse en caisse.
Mais la fonction la plus importante des banques de dépôt consistait à assurer le capital monétaire des déposants contre le risque de dépréciation, provenant des opérations sur les monnaies. Comment effectuaient-elles cette espèce d’assurance? Elles recevaient toute sorte de monnaies au cours du jour, mais elles en créditaient les déposants en monnaie de banque, c’est à dire en les rapportant à un étalon monétaire qu’elles avaient adopté pour leur usage spécial. Ce rapport établi, elles déduisaient de la somme déposée, un agio qui n’était autre chose que la prime nécessaire pour assurer contre tout risque [II-384] de dépréciation le montant du dépôt [74] . Elles tenaient leurs livres, effectuaient les virements et les payements pour compte des déposants, et, finalement, elles remboursaient les dépôts en monnaie de banque, ou, pour mieux dire, — la monnaie de banque n’étant qu’un étalon et non une monnaie réelle, — en métaux précieux ou en numéraire, évalués en monnaie de banque. Si donc la monnaie de banque demeurait stable, les négociants et les capitalistes qui s’en servaient dans leurs transactions se trouvaient affranchis du risque que les affaiblissements monétaires faisaient peser sur les opérations à terme. Ils n’avaient à craindre de dépréciation que sur les espèces qui se trouvaient dans leurs caisses, où ils avaient soin de n’en conserver que le moins possible. L’agio se proportionnait au risque afférent à chaque espèce de monnaie. Cet agio étant bien connu, la valeur de toutes les variétés de monnaies qui circulaient [II-385] dans les grandes cités commerçantes se réglait en conséquence. Maintenant, quel était l’étalon dont faisaient usage les banques de dépôt? On ne possède à cet égard que des données assez obscures. Les uns prétendent que les banques de dépôt faisaient uniquement usage d’étalons métalliques, et ils citent comme preuve à l’appui de leur opinion, la monnaie de banque de Hambourg, laquelle n’était, affirment-ils, autre chose que la valeur d’un certain poids d’argent fin [75] ; les autres, au contraire, [II-386] affirment que l’étalon de banque était purement idéal, en ce qu’il consistait ordinairement dans la valeur de quelque ancienne monnaie, telle que le florin, par exemple, qui se conservait, selon toute apparence, en s’étalonnant sur l’ensemble des choses échangeables contre de la monnaie. Quoi qu’il en soit, les monnaies de banque n’existaient qu’à l’état d’étalons; elles n’étaient point des monnaies réelles, mais elles paraissent être demeurées à peu près invariables, et, à ce titre, elles ont, en assurant la masse des opérations à terme contre le risque de dépréciation, rendu d’immenses services au commerce.
Comment de ces banques de dépôt et d’assurance de la monnaie sont sorties les banques d’escompte et de circulation, c’est ce qui demeure également assez obscur. Cependant, cette transformation peut aisément s’expliquer. En échange des sommes qu’elles recevaient en dépôt, certaines banques, notamment la banque de Stockholm, délivraient aux déposants des reçus ou récépissés dont le montant était spécifié en monnaie de banque, et sur la présentation desquels on obtenait le remboursement des dépôts [76] . Un premier progrès consista à rendre ces reçus [II-387] transmissibles soit par l’endossement, soit par l’impersonnalisation, c’est à dire en les délivrant simplement au porteur; un second progrès consista à diviser ces reçus transmissibles en fractions appropriées à l’acquittement de la généralité des dettes commerciales. Le système des virements de compte se trouvait ainsi simplifié et élargi. Les déposants en banque pouvaient, en transmettant leurs récépissés à leurs créanciers s’acquitter envers eux, sans avoir recours aux virements, et sans que les créanciers, de leur côté, eussent besoin d’avoir un compte ouvert à la banque. Ou pour mieux dire, leur compte s’y ouvrait par la transmission qui leur était faite de la propriété des récépissés puisqu’ils acqueraient ainsi le droit d’y disposer de la somme représentée par ces récépissés. Cela étant, qu’arriva-t-il? C’est que les récépissés ayant pour garantie les sommes déposées à la banque en monnaie métallique, et se trouvant, d’une autre part, plus commodes comme instruments des échanges commerciaux que ne l’était la monnaie métallique elle-même, on ne les échangea que par exception contre celleci, en sorte qu’au lieu de retirer le numéraire pour l’employer [II-388] comme medium circulans, on se servit désormais des titres de propriété du numéraire déposé. Cette substitution du papier au métal dans la circulation commerciale ne procurait par ellemême aucune économie, puisqu’il fallait, pour obtenir des récépissés circulables, en déposer la contre-valeur en numéraire ou en métaux précieux; mais elle permettait de généraliser les facilités et l’économie résultant des virements de compte, que l’on pouvait désormais opérer à l’extérieur de la banque, par la simple transmission des récépissés. En outre, le billet de banque, ainsi se nomma le récépissé monétaire, présentait à l’origine une fixité de valeur plus grande qu’aucune monnaie métallique, puisqu’il n’était autre chose que la monnaie de banque elle-même rendue circulable.
Un nouveau progrès s’accomplit alors, qui acheva la transformation des banques de dépôts en banques de circulation et d’escompte. Les récépissés des dépôts remplaçant avec avantage comme instruments de circulation le numéraire déposé, celuici demeurait inactif dans les caisses de la banque. On n’en retirait des quantités quelque peu considérables en échange des récépissés circulables, que dans les moments de crise; encore dans ce cas même, les demandes n’atteignaient jamais le tiers des sommes déposées. Cela étant, on se demanda s’il était nécessaire que les billets de banque, pour remplir l’office de monnaie, fussent les titres de propriété d’une monnaie métallique ou d’une étoffe monétaire en dépôt; s’il ne suffirait pas qu’ils représentassent des valeurs investies sous une forme quelconque, et dont l’immobilisation comme garantie monétaire coῦterait moins cher que celle de la monnaie métallique ou des métaux précieux; si toute valeur, actuellement réalisée ou même simplement réalisable, pourvu que la réalisation en [II-389] fut assurée, ne pourrait pas servir de base à une circulation en papier. Du moment où l’on pouvait se servir du titre de propriété d’une valeur, aussi bien que de cette valeur elle-même comme instrument monétaire, n’était-il pas superflu que la valeur possédée fῦt expressément investie sous forme de monnaie plutôt que sous toute autre forme? L’expérience ne tarda pas à vérifier cette conjecture, en démontrant qu’il n’était point nécessaire que les banques reçussent en dépôt des valeurs métalliques pour en émettre la contre-valeur en billets; qu’il leur suffisait de se procurer des valeurs investies sous une forme quelconque, ou, ce qui revenait au même, des titres de valeurs existantes, ou bien encore des obligations d’un recouvrement assuré, ou bien enfin même de simples garanties reposant sur des valeurs réelles, pour étoffer de valeur leur circulation en papier.
A dater de ce moment le régime des banques se transforma. De simples banques de dépôt, avec ou sans monnaie de banque circulable, elles passèrent à l’état de banques d’escompte et de circulation. Ce progrès était, en effet, la conséquence logique et nécessaire de la possibilité désormais reconnue de monnayer toute espèce de valeurs. Comment s’accomplit la transformation?
Les opérations de prêt et d’escompte étaient, comme nous l’avons vu plus haut, originairement effectuées par des banquiers qui y appliquaient, soit leur propre capital investi en numéraire, soit des capitaux, également en numéraire, qu’ils empruntaient d’une main pour les prêter de l’autre. Ces banquiers trouvèrent d’abord avantage à déposer leurs fonds disponibles dans une caisse centrale ou banque de dépôt qui se chargeait de faire pour eux des payements et des virements de [II-390] compte, tout en les assurant contre le risque de dépréciation des monnaies. Ensuite, la monnaie de banque ayant été rendue circulable par la création des récépissés, en coupures propres à servir de medium circulans, et cette monnaie nouvelle, essentiellement appropriée aux transactions commerciales, étant demandée de préférence à l’ancienne, les banquiers se la procurèrent en échange de leur numéraire. Mais lorsque l’expérience eut démontré qu’il n’était pas nécessaire que la valeur représentée fῦt investie en monnaie, qu’il suffisait qu’elle existât sous une forme quelconque, au lieu de fournir du numéraire à la banque pour obtenir des billets en échange, les banquiers purent se contenter de lui livrer ou de lui consigner les obligations provenant des prêts et des escomptes qu’ils effectuaient. Il en résulta un abaissement notable des frais de production on du prix de revient des prêts et des escomptes. Auparavant, ils se trouvaient grevés de l’intérèt du capital réalisé en espèces métalliques, qui servait à les opérer, de la prime du risque de non payement, des frais du recouvrement et de la rémunération nécessaire des intermédiaires. Maintenant, ils n’étaient plus grevés que des trois dernières charges, en y ajoutant le prix auquel la banque se faisait payer le monnayage des obligations. Quels étaient les éléments du prix de ce service? Ces éléments, nous les trouverons dans l’analyse de l’opération qu’une banque effectue, en transformant en monnaie les matières premières, propres à cet usage, que lui fournissent les banquiers escompteurs. D’une part, elle doit achever d’assurer les obligations si leur assurance n’est pas complète, c’est à dire si elles présentent encore quelque risque de non payement, et pourvoir à leur recouvrement à l’échéance. D’une autre part, elle doit couvrir les frais de fabrication et de [II-391] bon étalonnage de sa monnaie de papier, enfin cautionner, au moyen d’un capital ad hoc, la vérité et l’honnêteté de l’ensemble de ses opérations. Le taux auquel elle échange ses billets contre les obligations commerciales et autres qui leur servent de matières premières doit couvrir, avec adjonction des profits ordinaires du capital requis, les frais de monnayage du papier, et, sous un régime de libre concurrence, il les couvrirait ni plus ni moins.
Les frais de production de cette monnaie de banque, dont l’étoffe consiste dans la valeur assurée mais non réalisée des obligations en échange desquelles elle est fournie, sont fort inférieurs à ceux de la monnaie métallique, dont l’étoffe consiste en une valeur réalisée. Aussi les prêteurs ou les escompteurs qui pouvaient se procurer cette monnaie à la fois plus circulable et à meilleur marché ont-ils fini par prendre la place de ceux qui se servaient de l’ancien instrument monétaire, absolument comme les industriels pourvus de métiers mécaniques ont supplanté ceux qui persistaient à employer des métiers à la main. Toutefois, le public consommateur de monnaie est loin d’avoir recueilli jusqu’à présent tout le bénéfice de cette substitution d’un instrument de circulation économique à un instrument plus cher, les nouvelles fabriques de monnaie ayant dès l’origine été soumises à un régime de monopole et de réglementation qui a eu pour résultats, en premier lieu, de permettre aux producteurs de la monnaie de banque de s’attribuer la grosse part des profits de cette invention monétaire; en second lieu, de l’empêcher de recevoir tous les perfectionnements dont elle est susceptible.
[II-392]
DIXIÈME LEÇON↩
les intermÉdiaires du crÉdit (Suite et fin)
Cause du retard de développement des banques d’escompte et de circulation. — Avantages qui résulteraient de la spécialisation de l’escompte et de l’émission, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage — Élargissement du marché de l’escompte, abaissement du prix de la monnaie. — Comment fonctionneraient des banques libres et spéciales d’escompte et de circulation. — Des instruments monétaires dont pourrait se servir une banque de circulation spéciale, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage. — Des frais de production d’une circulation purement métallique; — d’une circulation mixte en métal et en papier; — d’une circulation en papier. — Des différents modes de production de la monnaie de papier. — Du papier monnaie, — vices de cet instrument monétaire. — Du billet de banque. — Comment il est produit et étalonné sous un régime de privilége et de réglementation. — Qu’il n’est autre chose qu’un billon de papier. — Avantages que procure aux banques privilégiées le monopole de l’émission de cet instrument monétaire. — Maux qui en résultent pour le public consommateur; — cherté de la monnaie; crises monétaires causées par la réglementation vicieuse de l’étalonnage. — Que cette réglementation ne garantit point la conversibilité des billets. — D’un système de circulation en papier-monnaie inconversible. — Possibilité démontrée de l’établissement de ce système, sous un régime de liberté du crédit et du monnayage. — De ses avantages, au double [II-393] point de vue de l’économie et de la sécurité. — Comment pourrait être étalonnée une monnaie de papier inconversible. — Ce qu’étaient les anciens étalons de banque. — Supériorité de l’étalon composé sur l’étalon simple. — Que l’avenir appartient au papier-monnaie inconversible, à étalon composé.
Enrayées dans leur développement naturel par l’intervention gouvernementale, les banques d’escompte et de circulation sont actuellement des machines de crédit moins perfectionnées que les banques de prêt sur gage de valeurs mobilières et immobilières. Deux opérations fort différentes, l’escompte ou le prêt, d’une part, le monnayage, de l’autre, s’y trouvent réunies, contrairement au principe de la division du travail. Il en résulte que ces établissements à deux fins laissent également à désirer et comme banques et comme fabriques de monnaie.
Nous nous en convaincrons en recherchant quelles sont les conditions naturelles d’établissement et de fonctionnement des banques d’escompte et des banques d’émission; ce qu’elles seraient si elles avaient pu librement se fonder et se développer en se spécialisant; ce qu’elles seront certainement un jour lorsque les vieux régimes du monopole et de la réglementation en matière de monnayage et de crédit auront disparu.
Supposons qu’une banque eῦt pour fonction spéciale d’escompter des obligations commerciales et autres, de prêter sur ces obligations etc.; quelle serait pour elle la méthode rationnelle de se procurer des capitaux? Ce serait d’émettre des obligations portant intérêt, analogues à celles que créent les banques de crédit foncier et les banques industrielles, avec la seule différence que les obligations des banques d’escompte devraient être à des échéances plus courtes, c’est à dire à des échéances correspondant à celles des valeurs escomptées. Ce principe [II-394] observé, la banque serait constamment en mesure de pourvoir au remboursement de ses obligations par la rentrée successive des effets de commerce, bons du trésor, etc., qui rempliraient son portefeuille. Quelles garanties offriraient les obligations émises par la banque? Elles auraient pour “sécurités” en premier lieu, les valeurs à terme en échange desquelles elles seraient émises et qui se trouveraient assurées déjà par un ou plusieurs intermédiaires; en second lieu, un capital de garantie servant à parachever cette assurance.
Telle serait pour les banques d’escompte comme pour les banques de crédit foncier et les banques industrielles, la méthode rationnelle d’emprunter. Elles se borneraient, comme on voit, à remplacer les obligations commerciales et autres qu’elles escompteraient par d’autres obligations également à terme, mais complétement assurées au moyen d’un capital spécialement affecté à cet usage, émises en coupures circulables, transmissibles sans endossement et payables dans tous les endroits où la banque aurait des comptoirs.
Ces obligations, les banques d’escompte les fourniraient à leurs clients, qui se procureraient de la monnaie, en les offrant sur les marchés monétaires, ou bien encore elles se chargeraient elles-mêmes de les échanger contre de la monnaie. Comme nous allons essayer de le démontrer, cet échange pourrait se faire dans des limites plus larges et à des conditions plus avantageuses pour le consommateur de monnaie qu’il ne se fait sous le régime des banques mixtes d’escompte et de circulation.
Dans l’état actuel des choses, les banques d’escompte sont obligées de subir les conditions des banques d’émission ordinairement privilégiées et toujours réglementées (au moins en ce [II-395] qui concerne l’étalonnage de la monnaie) auxquelles elles se trouvent annexées ou dont elles sont les dépendances. Elles subissent, sous ce rapport, un monopole qui entrave et renchérit leurs opérations. En premier lieu, le bureau d’émission ne livre sa monnaie qu’en échange d’effets de commerce et autres, remplissant diverses conditions réglementaires, quant à la sécurité du recouvrement, l’époque et le lieu de l’échéance. Ces effets doivent être assurés par un certain nombre de signatures, échoir endéans une certaine période arbitrairement fixée, parfois même, être payables dans une certaine circonscription. En second lieu, le bureau d’émission fixe sa monnaie à un prix que le monopole dont il jouit lui permet de surélever, au moins jusqu’à la limite du prix des instruments de circulation métalliques.
En supposant que les banques d’escompte fussent complétement séparées des banques d’émission, et qu’il y eùt entre celles-ci une suffisante concurrence, la situation serait toute différente; d’abord, les banques d’escompte n’auraient plus à subir de conditions quant à la sécurité du recouvrement, l’époque et le lieu des échéances des obligations commerciales et autres qu’elles escompteraient; elles seraient, à ces différents égards, libres d’agir selon leur convenance, sauf à diversifier le taux de leur prime d’assurance en raison de la somme des risques afférents à chaque espèce de valeurs à terme, sauf encore à échelonner les échéances de leurs obligations conformément à celles des valeurs escomptées, sans s’astreindre à un maximum arbitraire. Ensuite, mettant au marché des obligations à coupures régulières, impersonnelles et remboursables partout où elles auraient des comptoirs ou des correspondants, chose possible et même facile à une époque où le télégraphe peut transmettre, [II-396] d’une manière instantanée, des ordres de payement et des ouvertures de crédit dans toute l’étendue du monde civilisé, elles élargiraient économiquement le marché des escomptes: au lieu d’être réduites, comme aujourd’hui à offrir des effets de commerce et d’autres valeurs à terme, incomplétement assurées et imparfaitement circulables à une seule banque d’émission privilégiée, elles pourraient offrir leurs obligations sur un marché immense, où une foule de banques d’émission, sans parler des simples capitalistes, se feraient concurrence pour échanger contre ces instruments de crédit assurés et circulables, des instruments monétaires à aussi bon marché et aussi bien appropriés que possible aux besoins de la circulation. Le taux auquel se ferait cet échange dépendrait, d’un côté, de la masse des instruments monétaires disponibles, c’est à dire non engagés comme véhicules de l’échange des produits ou des services; d’un autre côté, de la masse des titres ou des obligations représentant des capitaux ou des créances à charge de capitaux, et donnant droit à un intérêt ou à un profit. Ce taux serait tantôt plus élevé et tantôt plus bas selon la masse des instruments de crédit et celle des instruments de circulation qui se présenteraient à l’échange; mais il tendrait incessamment, en vertu d’une force irrésistible, à s’établir en équilibre vers un certain niveau, marqué par les frais de production des instruments réciproquement offerts. En effet, lorsque la masse des instruments de crédit offerts à l’échange serait telle qu’en les réalisant sous forme de monnaie, on n’obtiendrait plus la somme nécessaire pour couvrir leurs frais de production avec adjonction des profits ordinaires, on cesserait d’engager ses capitaux sous forme d’instruments de crédit jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt rétabli; lorsque, au contraire, la masse des instruments de [II-397] circulation serait telle qu’en les échangeant contre des instruments de crédit, on ne couvrirait plus leurs frais de production avec adjonction des profits ordinaires, on cesserait d’engàger ses capitaux sous forme de monnaie jusqu’à ce que l’équilibre se fῦt encore rétabli.
Faisons une hypothèse analogue, en ce qui concerne les banques d’émission ou fabriques de monnaie. Supposons qu’une banque s’établisse dans des conditions de pleine liberté, en se proposant pour objet unique et spécial d’approvisionner le marché d’instruments monétaires. Ces instruments, en métal ou en papier, la banque doit se les procurer ou les fabriquer elle-même, dans les quantités et dans les sortes requises par la demande. Si la demande ne porte que sur les monnaies métalliques, que devra faire la banque? Elle devra employer son capital à acheter des étoffes métalliques et à les faire monnayer dans les coupures demandées. Ce capital, elle ne pourra se le procurer qu’à la condition de lui fournir une rémunération en harmonie avec celle que les capitaux peuvent obtenir dans les autres branches de la production. La banque devra donc échanger sa monnaie à un taux assez élevé pour en couvrir les frais de production, consistant dans la valeur des matières premières, dans les frais de fabrication et d’échange, avec adjonction des profits ordinaires. En échange de quelles valeurs offrira-t-elle cette monnaie? Sera-ce en échange de valeurs investies sous forme de produits ou de services? Mais, en ce cas, elle sera obligée de revendre ces produits ou ces services, et, en conséquence, de s’annexer une maison de commerce universelle. Si elle veut, comme la nature des choses l’y oblige, demeurer uniquement une banque, elle se bornera à échanger sa monnaie contre des valeurs investies sous forme de capitaux [II-398] engagés dans la production, et représentés par des titres ou des obligations productives d’un profit ou d’un intérêt, autrement dit, contre des instruments de crédit. Selon le taux auquel elle achètera ces titres ou ces obligations, selon encore qu’ils seront plus ou moins assurés, elle réalisera des bénéfices plus ou moins élevés et certains. Si les banques d’émission se font une concurrence suffisante, le taux auquel elles échangeront leur monnaie gravitera toujours vers le taux nécessaire pour procurer aux capitaux investis dans la production monétaire une rémunération en harmonie avec celle qu’ils pourraient trouver dans les autres branches de la production. En effet, s’il tombait plus bas, les capitaux se retireraient de cette industrie pour se porter ailleurs et vice-versâ. On voit par là que le prix de l’argent dépend du taux général des profits des capitaux, d’une part, de la quantité de capital nécessaire à la production des valeurs monétaires, de l’autre.
Supposons maintenant que la demande porte sur de la monnaie de métal et de la monnaie de papier, ou, comme c’est le cas de plus en plus général, principalement sur de la monnaie de papier, comment devra se comporter la banque d’émission? Elle devra employer une partie de son capital à se procurer de la monnaie de métal, et en appliquer une autre partie à la création de la monnaie de papier, dans la proportion requise.
Si elle est obligée d’employer à la production de la monnaie de papier la même quantité de capital qu’à celle de la monnaie de métal, elle ne pourra, évidemment, la livrer à meilleur marché; s’il lui suffit, au contraire, d’y appliquer un capital moindre, elle pourra la livrer à un prix inférieur de toute la différence des quantités de capital employées.
[II-399]
Comment donc se produit la monnaie de papier?
On peut la produire de différentes manières: d’abord, sans y employer d’autre capital que celui qui est nécessaire à la fabrication des coupures monétaires, comme dans le cas d’un papier monnaie inconversible; ensuite, en y employant des quantités de capital plus ou moins considérables pour en garantir la valeur, comme dans le cas des billets de banque.
Nous avons vu comment s’y prennent les gouvernements pour créer du papier monnaie ou, ce qui revient au même, de la monnaie de papier inconversible. Il leur suffit d’émettre des instruments monétaires en papier, dans les coupures réclamées par les besoins de la circulation. La valeur de ces instruments monétaires naît de leur utilité combinée avec leur rareté, et elle se règle par la proportion de l’émission avec la demande. Cependant, le papier monnaie même n’acquiert une valeur qu’à la condition d’être étoffé de certaines garanties. Ces garanties résident dans la masse des valeurs possédées par le gouvernement, parfois même, comme dans le cas d’un gouvernement insurrectionnel non encore investi d’une domination effective et assurée, dans de simples probabilités de prise de possession. Elle servent à assurer l’utilité et la rareté qui constituent la valeur de l’instrument monétaire, d’une part contre les risques de la démonétisation destructifs de l’utilité, d’une autre part contre les risques de l’émission illimitée, destructifs de la rareté: selon que ces garanties sont plus ou moins solides et étendues, le papier monnaie peut acquérir un débouché plus ou moins vaste. En résumé donc, la valeur du papier monnaie repose sur un gage général, résidant dans la somme des valeurs que possède le gouvernement ou qu’il a une suffisante probabilité de posséder.
[II-400]
Mais l’expérience démontre que le papier monnaie est toujours un instrument de circulation cher et dangereux. Investis du monopole de sa fabrication et de son émission, les gouvernements, tout en expulsant du marché les autres instruments monétaires, livrent à la circulation cette monnaie de papier, dont le prix de revient est insignifiant, comme si elle était en métal, et ils bénéficient de la différence. Le public ne profite donc point du bon marché de la production du papier monnaie. Le seul avantage qu’il retire de l’introduction de ce nouvel instrument des échanges, c’est, dans les pays où il n’existait que de la monnaie métallique, d’être pourvu d’une monnaie plus commode pour les transactions supérieures; en revanche, cet avantage est compensé et au delà, lorsque la monnaie métallique étant expulsée de la circulation, il est réduit à se servir de papier monnaie pour les transactions inférieures.
D’un autre côté, le public subit presque toujours un dommage plus ou moins considérable par le fait de l’échéance des risques inhérents à la circulation du papier monnaie. Si le gouvernement qui l’a émis est renversé, on ne manque pas de le frapper de prohibition, et, en perdant son débouché, il perd sa valeur. Si ce gouvernement subsiste et se consolide, la valeur du papier monnaie peut subsister aussi, et ne subir même aucune altération, mais c’est à la condition que l’émission en demeure exactement proportionnée aux besoins du marché. Or, presque toujours, cette émission est rendue excessive sous l’empire de besoins extraordinaires. Le plus souvent même, comme dans le cas des assignats de la révolution française, l’exagération des émissions va jusqu’à annuler presque entièrement la valeur du papier monnaie, et elle aboutit finalement à [II-401] la démonétisation, sans indemnité, de cet instrument déprécié. Bref, l’émission du papier monnaie par les gouvernements engendre exactement les mêmes maux que l’affaiblissement de la monnaie métallique, en portant ces maux à leur maximum possible, puisque la dépréciation n’a pour limites, en cas de surémission, que les frais insignifiants de la fabrication d’un instrument monétaire, dont l’étoffe est sans valeur.
Ce mode d’émission de la monnaie de papier, par voie de monopole d’État et sous une garantie générale, plus ou moins précaire, ne fournit donc au public consommateur qu’un instrument de circulation aussi cher que la monnaie métallique et plus dangereux.
Le second mode d’émission, aujourd’hui généralement usité, consiste à conférer le privilége de la production de la monnaie de papier à une banque, placée sous la dépendance du gouvernement, ou, tout au moins, obligée d’obéir, en cas de besoin, à ses réquisitions. Dans ce système, la monnaie de papier est émise sous une garantie spéciale, elle est conversible en monnaie métallique, et elle porte, comme on sait, le nom de billet de banque.
Examinons comment se produit le billet de banque, quelles sont les garanties sur lesquelles repose sa valeur, et les éléments de son prix de revient ou de ses frais de production.
Les banques de circulation émettent leurs billets en échange d’obligations commerciales et autres. Ces obligations assurées par les escompteurs intermédiaires servent de première garantie aux billets de banque. Le risque qui pèse encore sur elles, étant ordinairement très faible, il suffit d’un capital très faible aussi pour compléter leur assurance.
La garantie spéciale des billets de banque se compose donc: [II-402] 1° des obligations à terme escomptées par la banque, et qu’elle garde en portefeuille jusqu’à leur échéance, ou bien encore qu’elle échange contre d’autres valeurs qui prennent leur place dans le portefeuille des “sécurités; “2° du capital nécessaire pour compléter l’assurance de ces sécurités. Le billet de banque ainsi garanti, diffère de la monnaie métallique en ce que celle-ci porte avec elle toute sa valeur (sauf les frais de fabrication), investie dans l’étoffe précieuse dont elle est composée, tandis que l’étoffe monétaire du billet demeure immobilisée dans le portefeuille de la banque. De là, le nom de monnaie réelle donnée à la monnaie métallique et le nom de monnaie fiduciaire donnée à la monnaie de papier. Si la valeur qui sert de gage au billet de banque sous forme d’obligations représentant des marchandises vendues à terme, est effective et pleinement assurée, cette monnaie fiduciaire ne sera pas d’un usage moins sῦr que la monnaie réelle, et elle aura l’avantage d’être produite à bien meilleur marché. En effet, si la banque émet de la monnaie réelle, elle devra engager sous forme d’étoffes métalliques un capital égal à la valeur de ses émissions; si elle émet de la monnaie fiduciaire, il lui suffira d’appliquer à sa production monétaire: 1° le capital nécessaire pour compléter l’assurance des valeurs en échange desquelles elle émet ses billets, et qui leur servent de gage; 2° le capital nécessaire à la fabrication et à l’étalonnage de ces mêmes billets.
Les frais d’assurance des valeurs qui servent de garantie aux billets de banque sont peu élevés. Les frais de fabrication des billets le sont moins encore. En revanche, l’étalonnage, tel qu’il est imposé aux banques, en vertu des vieilles traditions du monopole gouvernemental du monnayage, est demeuré fort coῦteux.
[II-403]
En quoi consiste l’étalonnage des billets de banque? Il se résume dans l’obligation imposée aux banques, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles où cette obligation est suspendue, d’échanger toujours, à présentation, leurs billets contre de la monnaie métallique, servant d’étalon. La valeur des billets de banque se trouve ainsi exactement gouvernée par celle de la monnaie étalon. En effet, si les billets de banque sont émis en quantité surabondante, si leur valeur tend à baisser en conséquence, on les présente à la banque, en demandant en échange de la monnaie étalon, jusqu’à ce que le niveau soit rétabli. Si, au contraire, les billets de banque sont émis en quantité insuffisante, si leur valeur tend, en conséquence, à s’élever au dessus de celle de l’étalon, on apporte à la banque de la monnaie métallique ou des métaux monétaires, en demandant des billets en échange, jusqu’à ce que le niveau se trouve encore rétabli.
Dans ce système, qu’est donc le billet de banque? Il n’est autre chose qu’un billon de papier, approprié aux transactions supérieures, et correspondant, de l’autre côté de la monnaie étalon, au billon de cuivre, de bronze ou de nickel, approprié aux transactions inférieures. Les seules différences que présente la production de ces deux sortes de billon, sont: 1° qu’à part le cas du papier monnaie, l’émission du billon de papier est abandonnée à l’industrie des banques, tandis que l’émission du billon de cuivre, de bronze ou de nickel est demeurée partout un monopole gouvernemental; 2° que le billon inférieur de cuivre, de bronze ou de nickel porte avec lui une partie de sa valeur, tandis que le billon de papier n’en porte aucune; 3° que l’étalonnage du billon inférieur s’opère communément par la simple observation de la proportion utile de l’émission, [II-404] sans l’auxiliaire de la conversibilité en monnaie étalon, tandis, au contraire, que la conversibilité est la règle pour le billon supérieur, sauf le cas des circonstances exceptionnelles, où l’on autorise les banques à suspendre leurs payements en espèces. Dans ce cas, ou bien l’on cesse de se préoccuper de l’étalonnage des billets de banque, ou bien on s’efforce de le maintenir en s’écartant le moins possible de la proportion utile des émissions.
Mais, sous un régime d’étalon métallique, la conversibilité est le seul procédé d’étalonnage qui offre des garanties de précision suffisantes, soit qu’il s’agisse du billon supérieur ou du billon inférieur. De là, l’obligation, parfaitement rationnelle sous ce régime, que l’on impose aux banques d’immobiliser dans leurs caisses, une somme de monnaie étalon, ou de métal propre à la fabriquer, suffisante pour couvrir le risque du remboursement, calculé à sa plus haute probabilité. Ce risque ayant été évalué à un maximum de 33 p. c., on a exigé des banques qu’elles conservassent constamment dans leurs caisses une somme de numéraire égale au tiers du montant de leurs billets en circulation. Émis à cette condition réglementaire d’étalonnage, le billon de papier conserve encore un prix de revient passablement élevé. Cependant, en comparaison de la monnaie de métal, il présente une économie de frais de production de plus de moitié, même en admettant que les banques remplissent scrupuleusement l’obligation de conserver toujours dans leurs caisses, disponible pour le remboursement, une somme de monnaie étalon égale au tiers du montant de leur circulation.
Les banques de circulation ne sont, comme on voit, autre chose, dans ce système, que des fabriques d’une espèce particulière de monnaie de billon, plus propre que la monnaie [II-405] métallique, servant d’étalon, à remplir l’office de medium circulans dans les transactions supérieures. Cette monnaie de billon pouvant, en outre, être produite au moyen d’un capital fort inférieur à celui qu’exigerait la production d’une somme égale de monnaie métallique, qu’en doit-il résulter? C’est que les banques qui émettent cet instrument monétaire, à la fois mieux approprié aux besoins d’une portion considérable de la circulation et moins cher à produire que la monnaie métallique, doivent nécessairement supplanter celles qui opèrent avec du numéraire. C’est, en effet, ce qui n’a pas manqué d’arriver. Dans les pays, où existe une certaine liberté en matière de crédit et de monnayage, où par conséquent les banques de circulation peuvent se faire concurrence, le public consommateur a fini par profiter de l’abaissement des frais de production de l’instrument monétaire. Tel a été le cas dans les États de la Nouvelle Angleterre. Mais, dans les pays, — et c’est le plus grand nombre, — où les banques de circulation sont investies d’un privilége, cette économie réalisée dans les frais de production du medium circulans n’a que, pour une bien faible part, profité aux consommateurs de monnaie; elle a été presque entièrement retenue par les banques, comme dans le cas d’une invention brevetée, mais avec cette différence notable qu’on peut faire concurrence aux inventions existantes par des inventions nouvelles, tandis que les banques de circulation sont, en vertu de leur privilége, mises à l’abri de toute concurrence progressive. Autorisées exclusivement à produire un instrument monétaire plus parfait et moins cher que le vieil instrument métallique, elles ont pu aisément supplanter ou se subordonner les établissements qui étaient réduits à se servir de cet outil de circulation arriéré. Cela fait, elles ont pu faire remonter le prix [II-406] de leur monnaie de papier au niveau de celui de la monnaie de métal, en bénéficiant de toute la différence des frais de production des deux instruments monétaires. De là, les profits extraordinaires que réalisent les banques de circulation privilégiées. De deux choses l’une, ou l’État qui confère ce genre de privilége, devrait se réserver le monopole de la production du billon de papier comme il se réserve celui de la production du billon de cuivre, de bronze ou de nickel, et s’en attribuer la “rente”, ou, mieux encore, vu son incapacité industrielle, il devrait l’affermer au plus offrant, en suivant, en cela, la tradition de cet ancien régime si mal connu et si calomnié par une science superficielle; ou bien enfin, il devrait laisser complétement libres le monnayage et le crédit, en permettant ainsi au public consommateur de recueillir finalement le bénéfice de cette invention d’une monnaie à bon marché. Mais, il n’a adopté aucun de ces trois systèmes rationnels; il a préféré accorder gratis ou à peu près le privilége de l’émission de la monnaie de papier, et il a permis en conséquence à quelques privilégiés de s’attribuer, sous la forme d’une rente usuraire, la meilleure part de l’économie de la production de cette monnaie à bon marché.
Cependant, le régime de privilége et de réglementation qui prévaut actuellement en matière de banques d’escompte et de circulation n’a pas seulement enrayé leurs progrès, en conférant aux privilégiés, sans profit pour les gouvernements et au détriment du public consommateur, le monopole des avantages de la production du billon de papier, il a encore engendré d’incessantes perturbations dans le monde des affaires.
Ces perturbations proviennent, d’abord, de la réglementation vicieuse de l’étalonnage des billets de banque.
[II-407]
Les banques sont obligées d’étalonner leur billon de papier sur la monnaie métallique, et, pour assurer cet étalonnage, de conserver en caisse une somme de métal fixée au tiers environ de leur circulation. Cependant, en admettant que les émissions fussent convenablement réglées, le risque de conversion du billon de papier supérieur ne dépasserait pas, au moins dans les circonstances ordinaires, celui du billon inférieur, c’est à dire qu’il demeurerait insignifiant. Il suffirait donc que la banque conservât dans ses caisses pour couvrir ce risque, non le tiers, mais le dixième ou même le vingtième du montant de sa circulation. Le prix de revient de son billon de papier s’en trouverait naturellement abaissé d’autant [77]
Mais des circonstances surgissent dans lesquelles la demande des métaux précieux ou de la monnaie métallique s’accroît tout à coup dans des proportions extraordinaires, lorsqu’il s’agit, par exemple, de pourvoir au déficit de la récolte par des achats considérables de grains à l’étranger. La monnaie métallique acquérant ainsi un supplément de débouché hausse de prix relativement au billon de papier. En conséquence, on ne manque pas de se présenter à la banque pour échanger des billets contre du métal. Toutefois, c’est une erreur trop commune de croire que cette demande de conversion puisse se prolonger longtemps et prendre des proportions alarmantes. En [II-408] vertu de la loi des quantités et des prix, le retrait d’une petite quantité de billon de papier en exhausse promptement la valeur, et cette hausse est encore activée par le vide que crée dans l’approvisionnement monétaire, l’exportation d’une partie de monnaie métallique. On ne trouve plus alors aucun profit à réclamer l’échange des billets contre du métal, et l’écoulement des encaisses métalliques s’arrête de lui-même. Même dans ces circonstances exceptionnelles, il suffit aux banques sagement gouvernées d’un faible encaisse pour couvrir le risque de conversion.
Comment donc le besoin extraordinaire que provoque l’exportation d’une partie du medium circulans métallique peut-il se satisfaire? Rien de plus simple. Dès que la valeur de la monnaie étalon s’élève, sous l’influence d’un accroissement inusité de la demande, quel phénomène voit-on se manifester? On voit baisser dans la proportion de la hausse de la monnaie, toutes les valeurs qui s’échangent contre elle, produits, services, obligations à terme ou perpétuelles. Quelle est la conséquence de cette baisse? C’est de faire affluer la monnaie ou, ce qui revient au même, les étoffes métalliques qui servent à la fabriquer vers le point où se produit la dépression des autres valeurs; où, par conséquent, on peut recueillir un bénéfice exceptionnel en échangeant de la monnaie accidentellement en hausse, contre des produits, des services et des obligations accidentellement en baisse. Le vide causé par l’exportation du numéraire se comble ainsi rapidement, parfois même avec excès: les importations des métaux précieux deviennent surabondantes, les produits, les services et les obligations subissent un retour excessif de hausse, et ces mouvements, en sens inverse des premiers, se prolongent en s’affaiblissant graduellement jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli.
[II-409]
Malheureusement, la réglementation vicieuse de l’étalonnage des billets de banque a pour résultat de retarder sinon d’empêcher le rétablissement de cet équilibre. Obligées de conserver en caisse, pour couvrir le risque de conversion, un capital surabondant en numéraire, que font les banques? Elles s’empressent d’élever le taux de leurs escomptes, en d’autres termes, elles augmentent le prix de la monnaie qu’elles offrent en échange des obligations commerciales et autres. Cette hausse de l’escompte a pour résultat naturel et immédiat, de diminuer la demande de la monnaie, et par conséquent la somme qui en est mise en circulation. Pendant ce temps, l’échéance successive de la masse des obligations escomptées avant la hausse, fait rentrer dans la caisse de la banque une somme de monnaie supérieure à celle qu’elle a émise depuis la hausse. La circulation étant réduite par ce procédé, le risque de conversion s’affaiblit d’autant. Mais, en s’empressant d’élever le taux de son escompte, afin de défendre son encaisse, la banque précipite la baisse des produits, des services et des obligations. Que font alors les banques des autres pays, qui sont soumises à un régime analogue? Elles élèvent de leur côté le taux de leurs escomptes, pour empêcher le numéraire qu’elles sont tenues de conserver en caisse de se précipiter vers le point où les produits, les services et les obligations subissent une baisse. En présence de ces échelles mobiles qui se dressent partout pour empêcher la sortie du numéraire enfoui dans les caisses des banques, au moment où il s’en fait une demande extraordinaire, “l’argent devient rare” sur tous les marchés. L’argent abonde cependant dans les caisses des banques, mais il n’en peut sortir qu’en s’échangeant contre le billon de papier en circulation, et les banques en diminuant artificiellement la quantité de ce dernier [II-410] par la hausse de l’escompte, en élèvent progressivement la valeur, de telle sorte qu’au lieu de leur demander du numéraire en échange des billets, on finit quelquefois par leur demander des billets en échange du numéraire. La crise va s’aggravant jusqu’à ce que toutes les branches de la production se trouvant atteintes par le ralentissement des escomptes et la masse des échanges diminuant en conséquence, une portion du numéraire qui servait à les opérer devient disponible, et on l’applique à satisfaire le besoin extraordinaire qui a provoqué la crise. Les ban ques peuvent alors abaisser l’échelle mobile qui leur a servi à défendre leurs encaisses, elles réduisent le taux de l’escompte, et la production reprend peu à peu son activité normale; mais, en attendant, la crise que “la défense des encaisses” a artificiellement aggravée, laisse après elle de nombreuses ruines. Au moins, les banques participent-elles aux souffrances générales que cause leur politique restrictive? En aucune façon. Tandis que les profits de toutes les autres entreprises ont baissé, qu’un bon nombre même de ces entreprises ont succombé, leurs bénéfices à elles se sont accrus. Les années de crise sont toujours celles où les actionnaires des banques privilégiées touchent les plus beaux dividendes. Si elles débitent moins de billon de papier, elles le vendent, en revanche, à un prix qui s’est élevé en raison géométrique, tandis que la quantité vendue diminuait seulement en raison arithmétique. Aussi ne manquent-elles jamais de mettre le plus vif empressement à “défendre leurs encaisses” dans les moments de crise.
La situation s’aggrave encore par ce fait que l’encaisse réglementaire est rarement effectif dans les temps ordinaires. Car on a l’habitude d’y comprendre le montant des dépôts en métaux précieux qui sont effectués, temporairement, dans les banques [II-411] et pour lesquels elles ne payent aucun intérêt. Ces dépôts ne manquent pas d’être rappelés dès qu’un débouché nouveau s’ouvre au numéraire. La banque est obligée aussitôt de se replacer dans les conditions réglementaires dont elle s’était écartée en réalité sinon en apparence, et elle n’y parvient que par une hausse, entraînant un resserrement brusque et désastreux de ses escomptes [78] .
En résumé, l’obligation imposée aux banques de conserver en tous temps un encaisse surabondant pour couvrir le risque de conversion de leur billon de papier augmente, en tous temps aussi, le prix de revient de ce billon, et aggrave si elle ne les provoque point les crises causées par les ruptures accidentelles de l’équilibre de la production et de la consommation. Au moins, cette réglementation a-t-elle pour résultat d’assurer pleinement la conversibilité du billon de papier en monnaie étalon?
Aucunement. Dès qu’une crise politique survient, par exemple, les gouvernements ne manquent jamais de suspendre cette garantie réputée indispensable de l’étalonnage, et, pis encore, de transformer les fabriques de billon de papier étalonné sur la monnaie métallique, en fabriques de papier monnaie inconversible, sans étalon fixe.
Comment se comporte, en effet, un gouvernement qui est obligé de se procurer des quantités extraordinaires de capitaux soit pour se constituer par voie de révolution, soit pour se défendre contre un ennemi intérieur ou extérieur? Il cherche [II-412] d’abord à contracter des emprunts volontaires; mais si les circonstances ne sont point favorables, et s’il n’inspire pas une confiance suffisante aux capitalistes, les emprunts volontaires ne lui procureront des fonds qu’à un taux excessif et en quantité fort limitée. Que peut-il faire pour suppléer à l’insuffisance de son crédit? Il a le choix entre deux procédés. Il peut émettre du papier-monnaie, directement ou par l’intermédiaire d’une banque. Tantôt il a recours au premier procédé, et nous savons déjà de quelle manière; tantôt il a recours au second, et c’est aujourd’hui le cas ordinaire.
Comment s’y prend-il en ce cas? La banque possède une circulation en billets et un encaisse ordinairement excessif pour en assurer la conversion. Que fait le gouvernement? Il contracte, de gré ou de force, un emprunt auprès de la banque. De deux choses l’une, ou la banque lui fournit le montant de cet emprunt en billets ou elle le fournit en numéraire. Si elle fait une émission extraordinaire de billets sans en retirer une quantité correspondante de la circulation (elle en retire d’habitude une partie en restreignant ses escomptes et elle aggrave ainsi la crise industrielle et commerciale qui accompagne toute crise politique), son papier baissera, et l’on viendra lui en demander l’échange contre du numéraire, jusqu’à ce que le niveau se trouve rétabli entre la valeur du billon de papier et celle de la monnaie étalon. Si la banque effectue son prêt directement avec du numéraire pris sur son encaisse, celui-ci étant presque toujours surabondant, aucune perturbation ne s’ensuivra peutêtre. Mais dans les deux cas, l’encaisse de la banque se trouvera entamé jusqu’à concurrence du montant de l’emprunt. Or, les gouvernements qui subissent une crise, dont il leur est presque toujours impossible de prévoir l’intensité et la durée, [II-413] n’ont garde de commencer par entamer l’encaisse des banques ou de le laisser entamer. C’est une ressource qu’ils ont soin de mettre, tout d’abord, hors d’atteinte pour se la réserver in extremis. En conséquence, ils autorisent les banques, d’une part, à faire une émission extraordinaire de billets pour couvrir l’emprunt qu’ils exigent d’elles, d’une autre part, à suspendre le remboursement de leur circulation en espèces. L’encaisse se trouve ainsi sauvegardé, mais le billon de papier conversible s’est changé en papier monnaie inconversible. Toutefois, ce changement dans la nature de la monnaie de papier n’en provoque point nécessairement la dépréciation. En admettant que l’émission des billets de banque devenus inconversibles fῦt réglée de manière à n’en pas dépasser la demande, au niveau de la valeur de l’étalon, aucune dépréciation n’aurait lieu. Le régime du billon inférieur de cuivre, de bronze ou de nickel nous en fournirait au besoin la preuve. Que ce billon soit ou non conversible, sa valeur dépend toujours, uniquement, de la proportion des émissions: la conversibilité n’est qu’une simple garantie contre l’excès ou l’insuffisance de cette proportion. La dépréciation du billon de papier devenu inconversible ne peut donc avoir lieu qu’à la suite d’émissions excessives; mais les gouvernements s’abstiennent rarement d’abuser de cette facile ressource. La dépréciation d’ailleurs est lente, le numéraire cédant successivement la place au papier. Ce n’est que lorsque le numéraire a complétement disparu que la valeur de papier commence à subir une chute rapide. Comme dans le cas du papier monnaie, émis directement, la dépréciation peut alors se poursuivre jusqu’à ce que la valeur des billets de banque tombe au niveau des frais nécessaires pour les fabriquer. Mais en quoi consiste, dans l’intervalle, l’étalon monétaire? Il ne [II-414] réside plus dans la monnaie métallique; il réside dans le billon de papier devenu monnaie principale ou même unique, et il s’élève ou s’abaisse selon les fluctuations de l’offre et de la demande. Or, l’offre du billon de papier, émis par la banque, dépendant comme celle du papier-monnaie, émis directement, des besoins du gouvernement, l’étalon monétaire n’offre plus aucune garantie de fixité, et il varie du jour au lendemain [79] .
Le système actuel des banques privilégiées pour l’émission du billon de papier ne procure, comme on voit, au public consommateur ni l’avantage du bon marché ni celui de la sécurité.
Supposons maintenant qu’il existât une entière liberté, en matière de monnayage et de crédit; que les banques de circulation pussent, en conséquence, émettre librement toute espèce de monnaie de papier ou de métal, en adoptant, librement aussi, l’étalon le plus demandé, c’est à dire le mieux approprié aux besoins de la circulation, qu’arriverait-il? Que les banques de circulation seraient inévitablement conduites, sous la pression de la concurrence, à produire et à mettre au marché, au prix le plus bas possible, l’instrument monétaire le plus économique et le meilleur, en reportant ainsi sur le public consommateur tous les bénéfices des progrès réalisés dans la production des véhicules de la circulation.
En quoi pourrait consister cet instrument monétaire perfectionné? [II-415] Évidemment, dans une monnaie de papier inconversible, mais fixée sur un étalon aussi stable que possible.
Mais d’abord, la possibilité de l’établissement d’un système de circulation en papier inconversible est-elle admissible?
Cette possibilité est pleinement démontrée par l’existence et la circulabilité du papier-monnaie. En effet, si le papier-monnaie peut servir d’instrument monétaire, quoiqu’il ne possède ni une étoffe ni une garantie métalliques, quoique sa valeur dépende uniquement des quantités qui en sont offertes d’un côté, demandées de l’autre, qu’en faut-il conclure? C’est qu’une monnaie peut exister sans étoffe et sans garantie métalliques, et qu’en admettant que les métaux monétaires vinssent à disparaitre soudainement, on n’en serait pas réduit à revenir aux grossiers et imparfaits véhicules de circulation dont on se servait avant l’invention des monnaies d’or et d’argent; c’est qu’on pourrait rendre normal et permanent le régime de la circulation en papier, demeuré jusqu’à présent accidentel et temporaire.
Essayons donc de nous faire une idée de ce que pourrait être un système de circulation en papier inconversible, c’est à dire un système dans lequel la monnaie de papier, au lieu de n’être qu’un billon supérieur, étalonné sur la monnaie métallique, comme dans le cas du billet de banque, serait la monnaie étalon elle-même, comme dans le cas du papier-monnaie, mais avec des garanties de stabilité que le papier-monnaie ne possède point; dans lequel enfin, la monnaie métallique, en supposant qu’elle continuât d’être demandée, serait réduite à l’état de monnaie auxiliaire ou de billon.
D’abord, il est clair qu’une monnaie de papier inconversible serait la plus économique possible. Nous savons en quoi consistent [II-416] les frais de production d’une circulation purement métallique. Nous avons constaté que cette circulation est la plus chère de toutes, puisqu’elle exige l’application d’un capital égal au montant même de la monnaie émise, et que le capital investi sous cette forme doit recueillir un profit analogue à celui qu’il pourrait trouver dans les autres emplois de la production. Dans le cas d’une circulation composée en partie de monnaie métallique, en partie de billon de papier, les frais de production sont moindres, le prix de revient du billon de papier étant inférieur à celui de la monnaie métallique, de toute la différence des quantités de capital réquises pour la production de ces deux sortes de véhicules de la circulation. Cependant, l’obligation imposée aux banques de conserver, en métal, au moins le tiers de la valeur de leurs émissions porte encore à un niveau élevé, le prix de revient de cette circulation mixte. Quant à son prix courant, il ne diffère pas sensiblement de celui d’une circulation purement métallique, par suite du privilége dont se trouvent généralement investies les banques qui émettent du billon de papier.
Les frais de production d’une circulation en papier inconversible seraient infiniment plus faibles que ceux d’une circulation métallique ou d’une circulation mixte. En quoi consisteraientils? Dans la somme nécessaire pour remunérer le capital que les banques d’émission devraient consacrer à la production de la monnaie de papier. Ce capital serait de deux sortes: réalisé et simplement réalisable.
En admettant que les banques d’émission ou les fabriques de monnaie fussent complétement séparées des banques d’escompte, et qu’elles n’émissent, en conséquence, leur monnaie qu’en échange d’obligations parfaitement assurées, elles n’auraient [II-417] besoin que d’une très faible quantité de capital réalisé. Ce capital serait employé: 1° à pourvoir aux frais relativement peu élevés de la fabrication et de l’émission de la monnaie de papier, frais d’impression, d’administration, de bureau, etc.; 2° à pourvoir aux frais de fabrication et d’émission de la monnaie de billon en métal, or, argent ou cuivre, qui pourrait être demandée de préférence au papier pour les transactions inférieures. Toutefois, ce billon métallique pourrait ne contenir qu’une faible proportion de sa valeur en métal, et ne comporter par là même que des frais de production peu élevés.
En sus de leur capital réalisé, les banques d’émission auraient besoin d’un capital de garantie destiné à assurer la valeur de leur monnaie, en cautionnant leurs opérations; mais ce capital composé de valeurs simplement réalisables, soit qu’elles demeurassent entre les mains des actionnaires, soit qu’elles fussent mises en dépôt, sous forme d’actions ou obligations libérées d’autres entreprises, ne subirait qu’un faible risque, — puisque la monnaie de papier ne serait émise qu’en échange de valeurs assurées, — et n’exigerait, en conséquence, pour couvrir ce risque, qu’une faible prime.
En résumé donc, une circulation en papier inconversible ne requérant l’application que d’une très faible quantité de capital réalisé, et d’un capital de garantie exposé à un très petit risque, les frais de production de cette circulation demeureraient fort au dessous de ceux d’une circulation purement métallique, ou d’une circulation en métal et en papier à base de métal. Il suffirait d’émettre cette monnaie de papier inconversible à un taux des plus modiques, pour en couvrir les frais de production, avec adjonction des profits ordinaires. Ce serait essentiellement une monnaie à bon marché.
[II-418]
Il en est ainsi, du reste, du papier monnaie; mais avec cette différence capitale que les gouvernements s’attribuent le bénéfice résultant de l’infériorité du prix de revient du papier monnaie en comparaison de la monnaie métallique, tandis que, sous un régime de liberté du monnayage et du crédit, les banques d’émission se faisant concurrence, tout le bénéfice résultant de l’invention de ce véhicule de circulation économique finirait par aller au public consommateur de monnaie.
Le papier monnaie, soit qu’il se trouve émis directement par un gouvernement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une banque privilégiée, présente, en outre, comme nous l’avons vu, un inconvénient particulièrement grave: c’est de constituer une monnaie étalon, dont la valeur varie suivant les quantités qui en sont émises, lesquelles, à leur tour, dépendent des besoins essentiellement variables des gouvernements.
Il serait indispensable de remédier à cet inconvénient capital, en fixant la monnaie de papier inconversible sur un étalon qui présentât une stabilité aussi grande ou plus grande que les étalons métalliques. Cet étalon trouvé, la monnaie de papier inconversible, ayant sur ses rivales l’avantage du bon marché et peut-être même celui de la stabilité de la valeur finirait par être universellement préférée.
Recherchons donc sur quel étalon on pourrait fixer une monnaie de papier inconversible.
Nous avons actuellement pour étalon monétaire, le franc, c’est à dire la valeur d’un poids d’argent monnayé de 5 grammes à 9/10es de fin, adjonction faite des frais de monnayage. Nous savons pourquoi la valeur du franc ne peut s’élever au dessus de celle de cette quantité de métal, ni tomber au dessous; pourquoi, en conséquence, la circulation monétaire doit subir [II-419] l’influence de toutes les fluctuations de la valeur de l’argent métal, ou, pour mieux dire, par suite du régime du double étalon, de l’or métal. Eh bien, supposons que le système d’une circulation en monnaie de papier inconversible succède à celui d’une circulation en monnaie de métal et en billon de papier conversible en métal, que deviendra le franc? comment la valeur en sera-t-elle déterminée?
Nous le savons déjà par les nombreuses expériences qui ont été faites du papier monnaie: la valeur du franc dépendra uniquement, dans ce cas, du rapport existant entre l’offre et la demande de la monnaie de papier inconversible, c’est à dire entre les quantités émises et offertes de cette monnaie, d’un côté, et les quantités demandées, de l’autre. Le problème à résoudre, pour maintenir la stabilité de l’étalon dans le cas d’une circulation en papier inconversible, consiste donc à régler les émissions monétaires de telle manière que l’offre et la demande de la monnaie se mettent toujours en équilibre au niveau de la valeur actuelle du franc.
Cela étant, n’existe-t-il point une boussole d’après laquelle les banques de circulation peuvent se guider pour régler leurs émissions de manière à maintenir intacte la valeur du franc; nous voulons parler de l’ensemble des prix des choses qui s’échangent contre de la monnaie? Si les prix de ces choses, produits, services, obligations, viennent à baisser ou à hausser en même temps et dans la même proportion, ne fῦt-ce que d’une quantité infinitésimale, qu’en faudra-t-il conclure? Indubitablement que ce ne sont point les valeurs de cette multitude de choses diverses qui ont diminué ou augmenté, en même temps et dans la même proportion, chose impossible, mais que c’est la valeur de la monnaie contre laquelle ces choses [II-420] s’échangent qui est en voie de hausse ou de baisse; qu’il est, en conséquence, nécessaire, dans le premier cas, d’en diminuer, dans le second cas, d’en augmenter l’émission. Cette règle adoptée, l’étalon monétaire ne réside plus dans la valeur toujours plus ou moins flottante d’un ou de deux produits, tels que l’or et l’argent, ou dans celle d’une monnaie dont les émissions dépendent du gouvernement, qui en a le monopole; il réside dans la valeur de l’ensemble des choses échangeables et il ne comporte plus que des variations infinitésimales [80] .
[II-421]
Si maintenant on se reporte à ce que nous avons dit des anciennes monnaies de banque, on aura de fortes raisons de croire qu’elles étaient étalonnées de cette façon. D’après le témoignage unanime des écrivains du temps, les banques de dépôt se servaient d’un étalon monétaire purement idéal, consistant ordinairement dans la valeur de quelque ancienne monnaie, qui avait disparu de la circulation. Cet étalon se maintenait, selon toute apparence, en se mesurant incessamment sur la valeur de l’ensemble des choses qui s’échangeaient contre la [II-422] monnaie de banque. De là une fixité telle que l’on s’accordait généralement à regarder la monnaie de banque comme un étalon invariable [81] . Une monnaie de papier inconversible, étalonnée sur la valeur de l’ensemble des produits, services, capitaux, qui s’échangent contre de la monnaie, ne serait donc autre chose que l’ancienne monnaie de banque, rendue circulable. Il y a apparence même que ce système d’étalonnage, inauguré par les banques de dépôt, aurait depuis longtemps pris la place des systèmes métalliques, si, d’une part, ceux-ci n’avaient point été imposés par voie réglementaire, et si, d’autre part, le papier monnaie, émis par des gouvernements aux abois, [II-423] n’avait jeté un complet discrédit sur les monnaies dont l’étalonnage dépendait uniquement de la quantité des émissions.
L’étalon de banque étant trouvé, ou, pour mieux dire, retrouvé, il resterait à savoir si des banques de circulation libres proportionneraient toujours l’offre de leur monnaie de papier inconversible à la demande qui en serait faite, au niveau de la valeur de l’étalon, si elles n’auraient point une tendance soit à exagérer leur offre, soit à la restreindre, de manière à faire baisser ou hausser incessamment la valeur de l’étalon, en provoquant ainsi le retour des maux qui ont, de tous temps, accompagné le régime du papier monnaie.
Nous connaissons assez le jeu de la loi des quantités et des prix, sous un régime de libre concurrence, pour savoir que des banques de circulation libres seraient, au contraire, irrésistiblement conduites à régler leurs émissions de manière à produire le meilleur étalonnage possible. Supposons, en effet, qu’elles resserrent leurs émissions, en vue de faire hausser le prix de leur monnaie, qu’arrivera-t-il? C’est qu’elles réaliseront aussitôt des profits supérieurs à ceux des autres branches de la production, que les capitaux seront attirés dans l’industrie des banques de circulation, et, par conséquent, que la production partant l’offre de la monnaie de papier inconversible s’augmenteront jusqu’à ce que le niveau soit rétabli. Supposons, au contraire, que les banques émettent de la monnaie avec excès, qu’arrivera-t-il encore? C’est que cette monnaie trop offerte s’échangera à un taux insuffisant pour couvrir ses frais de production, et que les capitaux se retireront des banques jusqu’à ce que le niveau soit de nouveau rétabli. Or, comme il suffit d’un très faible déficit ou d’un très faible excédant pour amener une hausse ou une baisse comparativement [II-424] beaucoup plus forte dans une valeur investie sous une forme quelconque, jamais la quantité de monnaie émise ne pourrait sensiblement dépasser la quantité nécessaire aux besoins de la circulation, ni sensiblement demeurer en dessous.
L’avenir appartient certainement à ce système de circulation en papier, à étalon composé, autant supérieur peut-être à celui de la circulation à étalon simple, sous le double rapport du bon marché et de la sécurité, que la locomotion à vapeur peut l’être aux anciens modes de transport. Il s’imposera donc tôt ou tard, et d’autant plus vite, que les étalons de métal deviendront moins stables, et, par conséquent, moins propres à servir de bases à la circulation, dans un temps où la multiplication énorme des opérations à terme rend la stabilité de l’étalon plus que jamais nécessaire.
[II-425]
QUATRIÈME PARTIE de la consommation
[II-427]
ONZIÈME LEÇON↩
le revenu. — la consommation utile et la consommation nuisible
Comment se forment les revenus. — Sources et formes diverses des revenus. — Des causes naturelles de l’inégalité des revenus. — Inégalité des aptitudes productives et des milieux où elles s’exercent. — Inégalité des aptitudes conservatrices ou accumulatives. — Que l’égalité des revenus, partant des conditions est contraire à la nature des hommes et des choses. — Que les revenus sont naturellement mobiles comme ils sont naturellement inégaux. — Des causes artificielles de l’inégalité des revenus. — Que ces causes se résument dans la spoliation. — Raison d’être économique de la spoliation. — Des formes progressives de la spoliation, vol, brigandage, piraterie, conquête, esclavage, monopoles, priviléges. — De la spoliation contenue dans l’ancien régime des corporations; — dans le régime moderne de la protection; — son mode d’action et ses résultats. — Des autres forteresses de la spoliation, le monopole gouvernemental, les priviléges en matière de crédit, d’association, etc. — De la spoliation sous forme de communisme, en matière de production intellectuelle. — Des procédés employés pour immobiliser l’inégalité artificielle des revenus. — De la déperdition de forces et, de richesses que la spoliation occasionne. — Ce qu’il faut penser d’une liquidation sociale des résultats de la spoliation. — Que les révolutions ne suppriment pas la spoliation; qu’elles la transforment en l’aggravant. — Qu’il importe d’atteindre les inégalités artificielles non dans leurs résultats mais dans leurs causes. — Que ces causes ayant disparu, les inégalités artificielles feront place non à une égalité chimérique [II-428] mais à l’inégalité naturelle. — Des emplois du revenu. — Des classes dont le revenu est insuffisant pour couvrir leurs frais d’existence et de renouvellement, — dont le revenu est suffisant, et au delà. — De la consommation utile. — Des éléments et des conditions d’un bon gouvernement de la consommation. — Des facultés intellectuelles et morales qu’il exige. — De la consommation nuisible. — Ce qu’il faut entendre par consommations absolument et relativement nuisibles. — Causes de la consommation nuisible. — Analyse des effets de la prodigalité et de l’avarice. — Qu’elles sont également contraires à une bonne économie privée. — De l’influence de la consommation utile et de la consommation nuisible sur la conservation et le progrès des sociétés. — Des coutumes, des institutions ou des lois qui ont pour objet de déterminer et d’assurer la consommation utile, d’empêcher la consommation nuisible. — De l’esclavage et du servage envisagés au point de vue de la consommation. — Des lois somptuaires. Leur raison d’être. Pourquoi elles sont devenues surannées. — Qu’en cessant d’être réglementée, la consommation ne doit pas cesser cependant d’être réglée. — Que la règle volontaire doit succéder à la règle imposée. — Tous les hommes sont-ils capables de gouverner utilement leur consommation? — Opinion affirmative des individualistes, négative des socialistes. — Que ces opinions opposées contiennent chacune une portion de la vérité. — Que le self government en matière de consommation ne peut être ni utilement imposé à ceux qui en sont incapables, ni utilement refusé à ceux qui possédent l’intelligence et la force morale nécessaires pour l’exercer.
Les agents productifs que nous avons désignés sous les dénominations généralement usitées, quoique un peu arbitraires, de terre, de capital et de travail, et qui constituent le matériel et le personnel de la production, sont associés ou combinés dans des proportions diverses pour créer des produits ou des services. Ces produits ou ces services se distribuent entre les propriétaires des agents productifs ou leurs créanciers, sous forme de revenus, déduction faite des frais nécessaires pour entretenir et renouveler le materiel des entreprises. Tous les [II-429] hommes trouvent leurs moyens d’existence dans des revenus, provenant soit d’une source unique, soit de sources diverses, mais dont l’origine est toujours une production.
Si nous analysons, en effet, la multitude des entreprises agricoles, industrielles, commerciales, scientifiques, littéraires, artistiques, religieuses, politiques, etc., par le moyen desquelles il est pourvu à l’immense variété des besoins des hommes, que trouverons-nous? Qu’elles exigent, toutes, quoique dans des proportions inégales, la réunion et la mise en œuvre d’un personnel et d’un matériel. Le personnel se compose de travailleurs pourvus, à différents degrés, des aptitudes et des connaissances nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Le matériel, à son tour, comprend les fonds de terre, les bâtiments, les machines, les outils, les matériaux et les approvisionnements de toute sorte à l’aide desquels l’opération productive s’accomplit. Dès que l’entreprise fonctionne, elle donne naissance à un produit brut. Quelle destination reçoit ce produit brut? Il est employé:
- 1° A entretenir et à renouveler le matériel, dont une partie, celle que l’on désigne sous le nom de capital fixe s’use ou se consomme lentement; tels sont les bâtiments d’exploitation, les forces productives du sol, les outils, les machines, les bétes de somme; dont l’autre partie, au contraire, celle que l’on désigne sous le nom de capital circulant et qui se compose des matières premières et des approvisionnements, se consomme entièrement dans chaque opération;
- 2° A compenser la privation que s’imposent et à couvrir les risques que courent les propriétaires des capitaux fixes et circulants, qui composent le matériel de l’entreprise, en engageant ces capitaux dans la production;
- [II-430]3° A entretenir et à renouveler le personnel de l’entreprise.
Si le produit brut suffit exactement pour fournir ces parts nécessaires, l’entreprise couvre ses frais de production et elle peut se poursuivre sans augmentation ni diminution; s’il ne suffit point, la production diminue; s’il dépasse les frais, le produit net qui constitue l’excédant se distribue entre les coopérateurs de l’entreprise, et son existence rend possible une augmentation de la production.
D’après cette analyse, on voit que toute la portion du produit brut qui n’est point employée à l’entretien et au renouvellement du matériel, quelle que soit, du reste, la productivité de l’entreprise, soit qu’elle couvre ou non ses frais, se résout en une série de revenus, revenus des agents naturels appropriés, revenus des capitaux fixes et circulants, revenus du travail. Ces revenus affectent différentes formes et portent différents noms selon la nature des fonds engagés dans la production et selon le mode d’engagement: rentes ou profits fonciers pour les agents naturels appropriés; profits, dividendes, loyers ou intérêts pour les capitaux; profits, salaires, appointements pour le travail.
Le revenu de chaque homme dépend, en conséquence: 1° de la quantité des agents productifs qu’il possède ou sur lesquels il a un droit; 2° du degré de productivité de ces agents.
Les revenus sont essentiellement inégaux et mobiles. Les classes riches ou aisées, aristocratie ou bourgeoisie, possédant la presque totalité du matériel de la production, les terres, les bâtiments, les machines, les matières premières, les approvisionnements, joignent au revenu qu’elles tirent de leurs propriétés [II-431] personnelles (facultés et connaissances productives) celui de leurs propriétés immobilières et mobilières (agents naturels appropriés, capitaux fixes et circulants), tandis que les classes inférieures qui forment la masse du peuple, n’ont ordinairement d’autre revenu que celui qu’elles tirent de l’exploitation de leurs propriétés personnelles. De tous temps, et en tous lieux, l’inégalité des revenus a caractérisé, quoique à des degrés divers, les sociétés humaines. Cette inégalité provient à la fois de causes naturelles et de causes artificielles.
I. Causes Naturelles De L’inÉgalitÉ Des Revenus. Ces causes apparaissent d’abord dans l’inégalité naturelle des capacités ou des aptitudes productives, ensuite dans celle des milieux, essentiellement divers dans le temps et dans l’espace, où l’homme pourvu de ces capacités ou de ces aptitudes se trouve placé. Supposons deux hommes inégalement pourvus de forces physiques, intellectuelles et morales, placés dans un milieu qui leur offre des ressources égales, l’un s’enrichira tandis que l’autre demeurera relativement pauvre. Supposons encore deux hommes également doués (quoique une complète égalité physique, intellectuelle et morale soit sans exemple dans la nature) mais placés dans des milieux inégaux, le premier dans une région fertile et à une époque de progrès, le second dans une région stérile et à une époque de décadence, l’un s’enrichira, de même, tandis que l’autre demeurera pauvre. Voilà des causes naturelles d’inégalité qui échappent à l’action de la volonté humaine. Elles peuvent être atténuées sous l’influence du progrès, mais non disparaître. Quoi qu’on fasse, on ne rendra jamais toutes les individualités égales sous le rapport des aptitudes productives. Encore moins rendra-t-on les milieux où elles se trouvent placées, égaux dans l’espace et dans le temps. Si, à mesure [II-432] que les voies de communication se multiplient, les hommes peuvent plus aisément se déplacer dans l’espace pour y choisir le milieu le plus favorable à l’exploitation de leurs facultés productives, pourront-ils, en revanche, jamais se déplacer dans le temps?
Des hommes inégalement doués et placés dans l’espace et dans le temps doivent nécessairement se créer des revenus inégaux. Mais les inégalités naturelles ne s’arrêtent pas là. En admettant que tous les hommes fussent placés dans des conditions égales et qu’ils eussent la même aptitude à produire des revenus, il faudrait, de plus, qu’ils eussent la même aptitude à les conserver, pour que ces revenus, créés égaux, demeurassent égaux. Or, ici encore, l’inégalité apparaît comme l’essence de la nature humaine. Certains hommes non seulement consomment tout leur revenu, mais encore ils entament et ils détruisent les fonds productifs dont ils les tirent; les autres, au contraire, n’en consomment qu’une partie, ils en capitalisent le restant, et ils augmentent ainsi, avec leurs fonds productifs, leurs revenus. A l’inégalité naturelle des aptitudes nécessaires pour créer des revenus, vient donc encore se joindre celle des aptitudes nécessaires pour les conserver. Ces inégalités naturelles se diversifient à l’infini, tantôt s’ajoutant les unes aux autres, tantôt se compensant les unes par les autres. Ainsi, tel joindra à la supériorité des moyens de production celle des aptitudes conservatrices ou accumulatives; en conséquence, il accroîtra rapidement et dans de vastes proportions ses revenus; tel autre, au contraire, ne possédera que de faibles moyens de production et qu’une insuffisante aptitude à les conserver; il entamera ses capitaux et finira peut-être par tomber à la charge d’autrui, faute de pouvoir couvrir même ses frais d’existence. [II-433] Vouloir établir l’égalité des revenus et, par conséquent, l’égalité des conditions entre des créatures inégales, placées dans des milieux inégaux, serait donc poursuivre une chimère contraire à la nature des hommes et des choses.
En revanche, il ne serait pas moins chimérique de vouloir immobiliser les revenus dans leur inégalité que de vouloir les égaliser. En effet, ni l’aptitude à créer un revenu, ni l’aptitude à le conserver ne se transmettent de père en fils. Dans telle famille, une génération s’élève dans l’échelle des revenus, et la génération suivante descend, tandis que, dans telle autre, on voit se produire le mouvement inverse. Sans doute, certaines familles qui ont hérité d’immenses capitaux, créés et accumulés par le travail et l’épargne d’une série de générations laborieuses et économes, jouissent d’un avantage manifeste sur celles qui ne possèdent rien en dehors des capitaux personnels de leurs membres (capitaux composés de forces, d’aptitudes, de connaissances physiques, intellectuelles et morales qu’une bonne culture et de bons exemples donnés et légués de génération en génération ont pu cependant développer, de manière à procurer à ceux qui les possèdent une productivité supérieure, dès qu’ils peuvent librement en faire usage), mais cet avantage n’a rien d’assuré ni de permanent. En vain, un homme aura hérité d’une grande fortune, s’il la gère mal, s’il se livre à des spéculations imprudentes, s’il s’adonne au jeu ou à la debauche, il la gaspillera, et la génération suivante descendra dans l’échelle des revenus, tandis qu’à côté, les enfants de quelque famille pauvre seront devenus riches.
Les aptitudes nécessaires pour bien gouverner un revenu ne se transmettant point de génération en génération, l’immobilisation des fortunes est aussi bien un fait contre nature que pourrait [II-434] l’être leur égalisation. Les hommes, considérés dans une de leurs générations, apparaissent comme inégalement pourvus de forces physiques, morales et intellectuelles, et, en mettant en œuvre ces forces inégales, ils se procurent des biens inégaux; mais si l’on embrasse du regard une série de générations, la tendance à l’égalité reparaît. Parmi les familles pauvres d’aujourd’hui, combien de riches d’autrefois! Parmi les familles riches d’aujourd’hui, combien de pauvres de demain! C’est un mouvement de va et vient continuel, et si, en séparant l’espace du temps, dans la vie des membres successifs des sociétés, on est frappé de l’inégalité de leurs conditions, en considérant la multitude des familles dans l’espace et dans le temps, on voit les différences s’amoindrir ou s’effacer entre elles, et reparaître dans l’ensemble, sinon dans le détail des générations, une tendance naturelle à l’égalité.
II. CauseS Artificielles De L’inÉgalitÉ Des Revenus. Ces causes d’inégalité peuvent se résumer dans tout emploi de la violence ou de la ruse pour créer, conserver ou augmenter les revenus des uns aux dépens de ceux des autres. Il serait fort difficile de spécifier, même d’une manière approximative, leur action particulière sur la distribution des revenus; de faire la part qui revient aux causes naturelles et celle qui revient aux causes artificielles dans les inégalités sociales. Mais on peut affirmer que la violence et la ruse ont, de tout temps, exercé une influence considérable sur la formation des revenus et il ne paraît pas malheureusement que cette influence perturbatrice ait sensiblement diminué de nos jours. Les moyens dont on se sert pour s’emparer du bien d’autrui sont peut-être moins brutaux qu’ils ne l’étaient jadis, mais sont-ils moins nombreux et moins productifs? Comme toutes les autres industries, la [II-435] spoliation a perfectionné ses procédés et ses méthodes: à mesure que les moyens de créer de la richesse se développent, ceux de la détourner de ses destinations légitimes et utiles semblent se développer d’une manière parallèle; en sorte qu’en considérant l’industrie de la spoliation dans la multitude de ses branches, on ne saurait affirmer qu’elle occupe dans les sociétés modernes une place moindre que celle qu’elle s’était faite dans les sociétés anciennes. La seule différence à l’avantage de notre époque, c’est qu’on commence à mieux étudier les procédés que la spoliation met en œuvre, comme aussi la nature, l’étendue et l’incidence des dommages qu’elle cause. Un jour viendra peut-être où, en analysant ses opérations et en faisant ses comptes, en montrant clairement ce qu’elle coῦte et à qui elle coῦte, on parviendra à soulever contre elle la masse des intérêts aux dépens desquels elle s’exerce, mais cette analyse est peu avancée, car on ne saurait attribuer aucune valeur scientifique aux critiques vagues et boursouflées du socialisme: selon toute apparence, elle sera lente à faire, et, si l’on songe aux ténèbres intellectuelles et morales au sein desquels sont plongées les masses, plus lente encore à vulgariser.
Nous ne pouvons donc, en l’absence de toute histoire analytique et raisonnée de la spoliation, qu’indiquer ici les causes principales de l’inégalité artificielle des revenus et par conséquent des conditions. Dès l’origine des sociétés apparaissent les industries qui ont la spoliation pour objet. La création d’un revenu, dans n’importe quelle branche de la production, exigeant une application laborieuse des facultés, une série continue d’efforts et de peines, il était naturel que des hommes de proie, supérieurs en force et en courage physiques au commun de [II-436] leurs semblables, trouvassent plus d’avantage à ravir les fruits du travail d’autrui qu’à les créer eux-mêmes. De là, les industries du vol, du brigandage, de la piraterie, de la conquête, exercées soit individuellement, soit par voie d’association. En thèse générale, on peut affirmer que ces industries nuisibles se sont développées de tous temps, en raison de la différence qui existait entre les profits des entreprises de production et ceux des entreprises de spoliation. Lorsque les premières étaient plus avantageuses, on s’y adonnait de préférence; mais, dans la situation inverse, les secondes exerçaient sur les populations qui y étaient propres un pouvoir d’attraction irrésistible, et parce qu’elles étaient particulièrement lucratives, elles devenaient aussi particulièrement honorables. Elles ne manquèrent point de se développer rapidement et de progresser en se développant. A l’origine, les races de proie qui avaient plus d’aptitude et trouvaient plus de profit à dérober des produits qu’à produire elles-mêmes, se bornaient à faire des razzias aux dépens des populations laborieuses et paisibles, en les massacrant quand elles s’avisaient de défendre les fruits de leur travail. Mais, sous cette forme élémentaire, la spoliation ne pouvait procurer que des profits limités et temporaires. Partout où les bandes de vautours à face humaine avaient passé, de florissantes contrées se trouvaient transformées en déserts, et les débouchés du brigandage se trouvaient ainsi promptement taris. De là, pour cette industrie nuisible, la nécessité de transformer son mode d’action et ses procédés; ce qu’elle fit en substituant aux razzias temporaires les conquêtes et les occupations permanentes, au massacre des populations et fréquemment aussi, à l’anthropophagie, l’esclavage ou le servage. Les conquérants ne se bornèrent plus à s’emparer des fruits du [II-437] sol et du travail; ils firent main-basse sur les terres et sur les travailleurs eux-mêmes. Assujetties au travail forcé, les populations conquises durent se contenter de la somme strictement nécessaire pour couvrir leurs frais d’entretien et de renouvellement. Le surplus alla tout entier aux conquérants. Cependant, dès que ceux-ci se furent rendus maîtres du sol et des populations qui le meublaient, leur intérèt se modifia avec leur situation et, par conséquent, leur manière d’agir à l’égard des classes productives. De brigands devenus propriétaires, ils eurent intérêt à s’assurer la jouissance et l’exploitation paisibles de leurs conquêtes. Ils opposèrent, en conséquence, une barrière aux invasions, et ils procurèrent ainsi aux classes assujetties la sécurité dont elles avaient besoin pour subsister et pour les faire subsister eux-mêmes. Peu à peu, grâce à cet accroissement de sécurité dont elles étaient redevables à la conquête, les populations asservies purent augmenter et faire progresser la production, elles devinrent plus nombreuses et plus riches: elles reconquirent alors leur liberté ou elles la rachetèrent de gré à gré [82] . Toutefois, la spoliation ne disparut point dans ce nouvel état de la société. A mesure qu’une portion des classes assujetties s’émancipait et parvenait à entrer en partage du pouvoir avec les classes dominantes, elle ne manquait pas aussi d’entrer en partage de l’exploitation de la masse du peuple. Elle employait son influence grandissante dans l’État à se faire allouer des monopoles et des priviléges industriels et commerciaux qui se greffaient ainsi sur les monopoles et les priviléges politiques.
Telle nous apparaît successivement, sous les formes du vol, [II-438] du brigandage et de la piraterie, de la conquête et de l’esclavage, du monopole et du privilége, l’industrie de la spoliation. Ces trois formes ont, à vrai dire, coexisté de tous temps et elles coexistent encore, mais la dernière est aujourd’hui visiblement prépondérante. Tandis que les revenus provenant soit du vol, du brigandage et de la piraterie, soit de la conquête et de l’esclavage, l’emportaient autrefois sur les autres; de nos jours, les monopoles et les priviléges que les classes investies du pouvoir ou de l’influence politique ont réussi à s’attribuer aux dépens des masses sont, de beaucoup, les branches les plus productives de l’industrie de la spoliation.
C’est ainsi que les corporations établies d’abord dans un but de protection mutuelle par les travailleurs émancipés du servage s’attribuèrent peu à peu le monopole des marchés communaux, afin d’augmenter artificiellement leurs revenus, comme aussi de les perpétuer [83] . Protégés à la fois contre la concurrence extérieure par la défense d’importer des produits similaires sur le marché communal, et contre la concurrence intérieure par la limitation du nombre des maîtrises et la réglementation du travail, les maîtres de chaque corporation purent élever le prix courant de leurs produits ou de leurs services au dessus du prix naturel et s’allouer, en conséquence, une rente aux dépens des consommateurs. Cette rente, les monopoleurs s’évertuaient à l’accroître autant que possible, mais tous ne pouvaient également la grossir. Ceux qui fabriquaient ou vendaient des articles de première nécessité, par exemple, pouvaient en élever les prix beaucoup plus haut que ceux qui [II-439] fabriquaient ou vendaient des articles de seconde nécessité ou de luxe. Aussi les administrations communales soumirent-elles de bonne heure les denrées nécessaires à la vie au régime du maximum, afin de limiter le tribut exceptionnel que les fournisseurs privilégiés de ces denrées pouvaient prélever sur les autres membres de la communauté. Sans doute, ce frein artificiel du maximum avait le défaut d’être arbitraire et trop souvent insuffisant, mais en l’absence du régulateur naturel de la concurrence, il valait mieux que “la liberté du monopole; “il modérait, s’il ne la supprimait point, la rente que les consommateurs payaient aux corporations investies du privilége de l’approvisionnement des articles de première nécessité et qu’elles n’auraient pas manqué de porter à un taux usuraire.
Comme toutes les institutions qui contiennent une nuisance, les corporations finirent par se rendre odieuses et par être renversées. Mais la spoliation industrielle et commerciale ne disparut point avec elles; elle changea seulement de forme. Le système qualifié de protecteur de l’industrie ne fut guère autre chose qu’une transformation progressive du vieux régime des corporations. Les barrières douanières qui existaient primitivement aux limites de chaque commune, puis à celles des cantons ou des provinces, furent reculées aux frontières des États, mais elles devinrent permanentes, tandis que l’ancien régime de protection comportait du moins l’exception des foires franches, ces espèces de trèves de Dieu du monopole [84] , et elles [II-440] enveloppèrent successivement la généralité des branches de la production. L’objet réel, quoique non avoué, du système protecteur, c’était d’élever et de maintenir à un niveau artificiel supérieur au niveau naturel, les revenus des producteurs protégés. Cet objet était-il atteint? Apparemment, sinon il aurait cessé bientôt d’être poursuivi; mais il l’était dans des proportions fort diverses selon la nature des industries qui recevaient les faveurs de la protection. On va voir pourquoi.
Le premier résultat de l’établissement de la protection, c’est de créer un déficit artificiel des produits protégés. En effet, le marché intérieur était approvisionné auparavant: 1° par les produits du pays; 2° par les produits de l’étranger. La protection [II-441] établie, les produits étrangers sont repoussés du marché; d’où un déficit dans l’approvisionnement. Ce déficit provoque la hausse des produits indigènes, demeurés seuls en possession du marché et, par conséquent, l’augmentation des revenus de ceux qui les produisent. En sus des profits ordinaires de leur industrie, ceux-ci récoltent alors une rente provenant de la hausse artificielle du prix. Mais cette rente est inégalement élevée et inégalement durable selon la nature des industries protégées. Elle est plus ou moins élevée selon que les articles protégés sont plus ou moins nécessaires, et, de même, plus ou moins durable selon que la concurrence intérieure peut ou non se développer sans obstacles. Les capitaux ne manquent pas, en effet, d’affluer vers les industries qui jouissent de cette rente — et d’autant plus rapidement qu’elle s’élève davantage — jusqu’à ce qu’elle ait disparu. Or, elle disparaît dès que la concurrence intérieure devient suffisante pour abaisser le prix courant des articles protégés au niveau de leurs frais de production. Alors, la protection cesse de procurer une rente aux producteurs en sus de leurs profits ordinaires, tout en demeurant cependant onéreuse pour les consommateurs, car les frais de production des articles protégés continuent d’être plus élevés que ceux des similaires étrangers soit parce que la protection, en se généralisant, augmente, d’une manière artificielle, les prix de la plupart des éléments de la production, soit parce qu’elle ralentit le progrès industriel en le rendant moins nécessaire. La situation est différente lorsqu’il s’agit de branches de la production dans lesquelles le développement de la concurrence intérieure rencontre des obstacles naturels ou artificiels. Ici la rente de la protection peut acquérir sinon un caractère de permanence, du moins un caractère de longuedurée. [II-442] Tel est le cas de la protection accordée aux fonds de terre, aux forêts et aux mines, dans les pays où l’offre de ces agents productifs est naturellement ou artificiellement limitée, en présence d’une demande croissante. Dans ce cas, après avoir utilisé les fonds de 1re qualité, on exploite ceux de 2e qualité, puis ceux de 3e et ainsi de suite jusqu’à ce que les frais de la mise en exploitation cessent d’être couverts. Les fonds les plus productifs obtiennent ainsi une rente égale à la différence qui existe entre leurs frais d’exploitation et ceux des fonds inférieurs. Si la protection n’était point intervenue, chaque espèce de fonds aurait été appropriée à sa destination naturelle, les terres les plus propres à la culture du blé, par exemple, auraient continué d’y être appliquées; mais on n’aurait point consacré à cette production des terres qui y sont moins propres, autrement dit, qui sont pour la production des céréales un instrument de 2e ou de 3e qualité, tandis qu’elles pourraient être un instrument de 1re qualité pour un autre genre de production, dont le système protecteur entrave le développement. En rendant certains emplois artificiellement avantageux aux dépens de certains autres, le système protecteur bouleverse, comme on voit, l’assiette naturelle de la production et, par conséquent, celle des revenus. Ce système est actuellement en décadence, et le jour n’est pas éloigné peut-être où les barrières tant fiscales que protectrices qui séparent encore les peuples auront disparu. Alors disparaîtront aussi les rentes illégitimes que la protection ajoutait aux revenus de certains fonds, tout en frappant les autres de dépréciation.
Mais la spoliation conserve encore bien d’autres forteresses. A mesure qu’on la chasse de ses vieux repaires, on la voit même s’en creuser de nouveaux, plus vastes et plus redoutables. [II-443] A peine les corporations privilégiées ont-elles été démolies et au moment où l’édifice de la protection commence à s’écrouler, nous voyons, par exemple, le monopole gouvernemental se développer partout, comme un monstrueux polype, aux dépens des industries de concurrence. Or, ce monopole qui se trouve, partout aussi, en droit ou en fait, entre les mains des classes supérieures ou moyennes, embrasse une multitude de fonctions et fournit, par conséquent, une multitude de revenus. Au premier aspect, ces revenus ne paraissent pas dépasser le niveau général; mais si l’on considère l’insuffisance du travail fourni en échange, sous le double rapport de la quantité et de la qualité, la nullité même de ce travail quand il s’agit de sinécures, on s’aperçoit qu’ils contiennent, en comparaison des revenus fournis par les industries de concurrence, une rente considérable. Au monopole gouvernemental proprement dit viennent se rattacher, à titre de dépendances ou d’annexes, une multitude croissante d’autres monopoles, en matière de crédit, d’industrie, de commerce, etc., qui ont uniformément pour objet, — quels que soient du reste les prétextes invoqués en faveur de leur établissement, — une augmentation artificielle des revenus de ceux qui ont eu le pouvoir de les faire établir. Ces monopoles, institués au moyen d’une limitation quelconque de la concurrence, contiennent nécessairement une spoliation, d’abord en ce qu’ils obligent les consommateurs des produits ou des services monopolisés à les payer à un prix supérieur à celui de la concurrence, en fournissant aux monopoleurs une rente proportionnée à la différence des deux prix; ensuite, en ce qu’en ralentissant les progrès naturels des branches de travail monopolisées, ils retardent l’abaissement de leurs frais de production, toujours au détriment de la masse des consommateurs.
[II-444]
Tandis qu’on se sert du monopole pour augmenter artificiellement les revenus naturels de certaines catégories de producteurs, on se sert, au contraire, du communisme pour diminuer artificiellement les revenus naturels d’autres catégories de producteurs, au bénéfice prétendu de la société. C’est ainsi qu’on limite à de certaines frontières arbitrairement fixées de l’espace et du temps, la propriété des inventeurs, des savants, des hommes de lettres et des artistes. Comme nous l’avons remarqué ailleurs [85] en soumettant la propriété intellectuelle à ce régime de maximum, on laisse intacts les revenus des producteurs médiocres, dont les œuvres ne franchissent point les frontières dans lesquelles la propriété intellectuelle est reconnue, tandis qu’on entame ceux des producteurs de génie, dont les œuvres se répandent indéfiniment dans l’espace ou subsistent dans le temps. On décourage ainsi l’éclosion des œuvres d’élite, on abaisse, par là même, le niveau de la production intellectuelle, des sommets de laquelle découle tout progrès. Le communisme, qui n’est que le monopole retourné, apparaît donc, en dernière analyse, comme une cause d’appauvrissement et de retard pour la communauté, dans l’intérêt de laquelle il est établi.
Les classes investies du pouvoir politique ne se sont pas bornées à surélever artificiellement leurs revenus aux dépens de ceux du reste de la communauté, elles ont entrepris de perpétuer dans leur sein, à travers les générations successives, ces [II-445] revenus surélevés. De là, tout un échafaudage de mesures prohibitives ou restrictives destinées à empêcher les fonctions, les industries et les patrimoines des classes privilégiées de tomber entre les mains des classes concurrentes, les majorats, les substitutions, les obstacles opposés à la vente des biens patrimoniaux et aux emprunts hypothéqués sur ces biens, etc., etc. Les titres nobiliaires, en facilitant à ceux qui les portent, l’accès de certaines fonctions supérieures, contribuent, de même, à créer et à maintenir l’inégalité artificielle des revenus et des conditions.
Le vice commun et irremédiable de tous les instruments et de tous les procédés si variés et parfois si habilement combinés dont se sert le génie de la spoliation pour arriver à ses fins, c’est qu’ils détruisent ou empêchent de créer cent fois plus de richesses qu’ils n’en détournent. Qu’une bande de voleurs infeste une route, que des pirates établissent leur nid dans des parages fréquentés par le commerce, aussitôt on verra se ralentir le mouvement des voyageurs et des marchandises, et pour chaque millier de francs dont se grossiront les revenus des voleurs ou des pirates, les revenus des autres membres de la communauté seront diminués de cent mille francs et davantage. Que l’on privilégie quelque branche d’industrie et de commerce, on verra de même dépérir toutes les autres branches sur lesquelles l’intérêt favorisé perçoit un tribut, et, comme une conséquence inévitable, leur appauvrissement entraîner celui de la branche privilégiée. Que l’on crée un monopole financier, en instituant une banque d’État, et il en résultera un renchérissement général de la circulation et du crédit qui entravera le développement de la production, en empêchant de naître une multitude de revenus pour grossir à l’excès un petit nombre. [II-446] Que l’on impose de même un maximum à la propriété et, par conséquent, aux revenus des savants, des inventeurs, des littérateurs, des artistes, dans l’intérêt prétendu de la société, et pour la faible somme qu’on lui permettra de dérober à la rétribution due au génie et au travail, on la privera de la somme incalculable de profits que lui auraient valus l’exploitation des nouveaux véhicules de production, dont le maximum ralentit ou empêche la recherche et la découverte. Enfin, qu’après avoir privilégié certaines classes, on s’efforce d’immobiliser entre leurs mains, de génération en génération, les revenus qu’elles retirent de l’exploitation de ces priviléges, que l’on empêche, en conséquence, les instruments de production qu’elles détiennent de tomber en des mains plus capables de les utiliser, que l’on arrête ainsi le mouvement naturel d’ascension des classes physiquement, intellectuellement et moralement les plus vigoureuses, en maintenant à la tête de la société une caste immobilisée, que le monopole va affaiblissant et corrompant chaque jour, le résultat sera plus funeste encore. La société entière déclinera, et, à une époque de barbarie, elle finira par sombrer sous le choc d’une invasion à laquelle elle n’aura pu opposer qu’une force de résistance insuffisante; à une époque de civilisation, elle disparaîtra de même, à la longue, sous la concurrence de sociétés dont aucun vice intérieur n’aura entravé le mouvement naturel d’expansion.
C’est une question que les écoles socialistes ont mise à l’ordre du jour que celle de savoir si les classes exploitées ont le droit de se soulever contre les classes exploitantes et de leur “faire rendre gorge;” s’il serait légitime, par exemple, d’opérer une liquidation de la “vieille société,” pour répartir les fruits des spoliations anciennes et modernes parmi les masses aux [II-447] dépens desquelles ils ont été acquis. Cette question, les écoles socialistes ne manquent pas de la résoudre par l’affirmative. Examinons-la à notre tour.
Remarquons d’abord qu’une liquidation sociale ne pourrait être opérée qu’à la suite d’une “révolution” qui ferait passer la puissance politique des mains des classes exploitantes dans celles des classes exploitées. Telle a été, par exemple, la première révolution française qui a liquidé l’ancien régime, non seulement en abolissant les priviléges de la noblesse et du clergé, mais encore en confisquant une bonne partie des biens de ces deux corps privilégiés. A certains égards, cette confiscation pouvait sembler équitable, les revenus de la noblesse et du clergé ayant été, pendant des siècles, artificiellement surélevés, et donnant par là même ouverture à une action en restitution de la part des classes aux dépens desquelles l’excédant illégitime de ces revenus avait été acquis. Telle serait la “révolution démocratique et sociale” dont on nous menaçait en 1848, en admettant que les masses devenues maitresses du pouvoir entreprissent la liquidation des fortunes acquises ou grossies au moyen des priviléges politiques, industriels, commerciaux ou financiers du régime actuel. En faveur d’une liquidation de ce genre, elles pourraient faire valoir des motifs analogues à ceux que les classes actuellement prépondérantes ont invoqués pour “liquider” les biens de la noblesse et du clergé de l’ancien régime. Mais rien en ce monde n’est plus difficile à produire que la justice, et il est sans exemple qu’on l’ait produite par des “moyens révolutionnaires.”
Déposséder des individus ou des collections d’individus, non seulement de leurs priviléges, mais encore des biens qu’ils ont acquis, de génération en génération, en exploitant des fonctions [II-448] ou des industries privilégiées, c’est presque toujours commettre une injustice plus grande que celle qu’il s’agit de réparer. Comment, en effet, faire le départ de ce qui a été la rétribution légitime des industries ou des fonctions privilégiées de ce qui a été la rente illégitime du privilége? S’agit-il de propriétaires d’esclaves, par exemple? S’ils ont exploité d’autres créatures humaines, en revanche, ils ont exercé à l’égard de ces créatures ordinairement inférieures au physique et au moral l’office de tuteurs, ils les ont protégées et gouvernées aux époques où elles étaient incapables de se protéger et de se gouverner ellesmêmes. C’est grâce à cette tutelle intéressée et par là même efficace, qu’elles ont pu échapper aux atteintes destructives des races ennemies et qu’elles ont pu sortir de l’état sauvage pour commencer leur ascension dans l’échelle de la civilisation. Ce service dont elles ne pouvaient et dont elles ne peuvent encore se passer, car la tutelle venant à leur manquer, elles retournent promptement à la barbarie, et elles finissent par disparaître devant la concurrence des races supérieures [86] — ce service, [II-449] le monopole contenu dans l’esclavage le leur a fait payer à un taux usuraire sans doute, mais ne méritait-il donc aucune rémunération? S’agit-il de la noblesse et du clergé? Ces deux corporations sont demeurées pendant des siècles investies du monopole des services les plus nécessaires à la conservation et au progrès de la société, services politiques, militaires, religieux, pédagogiques. Elles ont gouverné, défendu, moralisé, éclairé la société, et elles ont mérité assurément d’être rétribuées pour ces immenses et utiles travaux. Comment reconnaître et délimiter la portion de leurs biens qui tire son origine de la rétribution légitime de leurs services nécessaires pour la séparer de celle qui est le fruit illégitime des rentes accumulées des monopoles nobiliaires et religieux, partant revendicable et confiscable? S’agit-il des classes actuellement investies de monopoles politiques, industriels, commerciaux, financiers, etc., comment faire, de même, dans leurs revenus, la part des profits légitimes de leurs fonctions ou de leurs industries et celle des rentes illégitimes de leurs monopoles?
[II-450]
C’est là évidemment une œuvre impossible. Aussi, à moins qu’elles ne s’appliquent à des biens ou à des revenus provenant [II-451] d’industries complétement spoliatrices, telles que le brigandage et la piraterie, les liquidations opérées par la violence ne font [II-452] que substituer une injustice à une autre. Presque toujours aussi, les révolutions, au lieu de supprimer les priviléges, se [II-453] bornent à les déplacer, au profit de la classe qui a réussi à faire main basse sur le pouvoir. Cette classe devenue subitement [II-454] maîtresse de l’appareil à fabriquer les priviléges se garde bien de mettre au rebut une machine si productive; elle se hâte de [II-455] l’adapter à ses intérêts particuliers, en remplaçant, par exemple, les monopoles militaires et religieux appropriés aux intérêts des [II-456] classes dépossédées par des monopoles industriels, commerciaux et financiers, parfois même en ajoutant ceux-ci à ceux-là. [II-457] C’est ainsi, comme on sait, qu’a procédé la bourgeoisie dans tous les pays où elle a remplacé la noblesse et le clergé, ou bien [II-458] encore, où elle est entrée en partage de pouvoir avec ces deux anciennes corporations gouvernantes. Que les classes inférieures réussissent, à leur tour, à supplanter la bourgeoisie, dans le gouvernement des sociétés, la spoliation ne disparaitra pas davantage; elle modifiera simplement ses formes et ses applications, en les appropriant de nouveau aux intérêts prédominants, voilà tout! Ainsi, l’impôt sera rendu progressif par en haut au lieu de l’être par en bas; le communisme, se résumant dans un maximum égalitaire qui abaisse les revenus des classes supérieures au profit des masses, remplacera le monopole qui abaisse les revenus des masses au profit des classes supérieures. Enfin, on verra reparaître, adapté aux intérêts actuels et apparents du grand nombre, le régime protecteur lui-même. On cessera d’exclure du marché national les produits étrangers, en vue d’augmenter artificiellement les profits des entrepreneurs d’industrie, mais on en exclura les bras étrangers, en vue d’augmenter artificiellement les salaires des ouvriers [92] [II-459] Bref, on ne supprimera pas la spoliation, on se contentera de la déplacer, et, selon toute apparence, en l’aggravant.
Le progrès ne consiste donc point, comme le supposent les doctrinaires de la bourgeoisie et les jacobins de la démocratie, à s’emparer de l’appareil de la spoliation, et, après avoir fait main-basse sur les biens de la classe que l’on a dépouillée du pouvoir, à conserver et à agrandir même cet appareil, en l’appropriant aux intérêts particuliers du nouveau souverain, mais à le détruire sans entreprendre une liquidation inique des iniquités du passé. Il faut, dans toutes les branches de l’activité humaine, supprimer les monopoles et les priviléges qui engendrent une inégalité artificielle des revenus, pour les remplacer par le régime de la libre concurrence qui aura pour conséquence nécessaire non une égalité utopique mais l’inégalité naturelle des revenus, résultant de l’inégalité naturelle des forces physiques, intellectuelles et morales à l’aide desquelles les revenus se créent. Cela fait, les classes dépossédées de leurs [II-460] priviléges suivront désormais la commune destinée; elles conserveront leurs revenus et les accroîtront selon leurs aptitudes [II-461] naturelles à les conserver et à les accroître. Ou, si elles manquent de l’intelligence et de la moralité requises, elles les gaspilleront, [II-462] et elles seront obligées de céder leur rang dans l’échelle sociale à des classes plus intelligentes et plus morales. [II-463] Elles descendront, et elles finiront peut-être, si elles ne se retrempent point sous une forte tutelle, par succomber dans le vaste et incessant conflit de la concurrence universelle. Ainsi, c’est à dire avec l’appareil dont se sert le génie de la spoliation pour enrichir les uns aux dépens des autres, disparaîtra l’inégalité artificielle des revenus.
Si nous considérons maintenant la multitude des familles qui composent la société, nous trouverons que les unes n’ont qu’un [II-464] revenu insuffisant pour les faire subsister, tandis que les autres ont un revenu suffisant ou suffisant et au delà.
Comment vivent les familles dont le revenu est insuffisant pour couvrir leurs frais d’existence? Elles entament d’abord leur capital et, par là même, elles diminuent encore, progressivement, leur revenu. Ensuite, quand elles ont consommé toute la portion de ce capital qu’il est en leur pouvoir d’aliéner, ou elles périssent ou elles recourent à la charité, qui leur fournit [II-465] le supplément de moyens d’existence indispensable pour combler la différence de leur revenu effectif avec leur revenu nécessaire. Telle est, il faut le dire, la condition de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, soit qu’elle y ait été réduite par des institutions et des lois iniques ou par son incapacité à se gouverner elle-même, le plus souvent, par la réunion de ces deux causes. Cette classe vit au jour le jour consommant actuellement tout son revenu, sans en pouvoir rien réserver et accumuler pour les besoins de l’avenir, menacée par toutes les crises en y comprenant même celles que suscite le progrès, et victime de tous les maux dont le mauvais gouvernement de la nature et des hommes accable les sociétés. Elle s’est incessamment grossie depuis que le régime de tutelle auquel elle était jadis assujettie a disparu. Elle va s’appauvrissant et se dégradant chaque jour; elle perd la beauté et la santé du corps; il semble même que la rouille de la misère corrode et affaiblisse peu à peu en elle les ressorts de l’intelligence et de l’àme. La liberté imposée, en la livrant au gouvernement d’elle-même, avant qu’elle ne fῦt capable de l’exercer, dans un milieu où le vieux régime des priviléges perfectionné et augmenté continue à déprimer le développement de ses forces productives, lui a été plus funeste que ne l’avait été, dans aucun lieu et dans aucun temps, la servitude. Il a fallu inventer un mot nouveau pour exprimer cet état de pauvreté et d’abjection croissantes et irrémédiables, où peut descendre une multitude qui succombe à la fois sous le fardeau d’un self government qu’elle est incapable de supporter, et d’un régime d’exploitation hypocrite qui rend illimitée la responsabilité des faibles en continuant à limiter leur liberté au profit des forts. Ce mot qui signifie le progrès dans la misère et la dégradation, c’est le paupérisme.
[II-466]
Au dessus des familles qui ne possèdent point un revenu suffisant pour couvrir leurs frais d’existence, s’étagent celles dont les revenus y suffisent, ou bien encore s’élèvent au dessus. Ces familles aisées ou riches emploient leurs revenus, partie à satisfaire à leurs besoins actuels, partie à subvenir à leurs besoins futurs, en d’autres termes, elles consomment et elles épargnent. Quelquefois elles épargnent au delà de ce qui leur est nécessaire pour se maintenir à la station qu’elles ont atteinte dans l’universelle ascension vers le sommet de la pyramide sociale. Alors, en s’aidant des forces nouvelles qu’elles ont acquises et capitalisées, elles montent plus haut, elles atteignent une station supérieure. Quelquefois, elles épargnent moins qu’il n’est nécessaire pour se maintenir à leur rang, elles descendent à un degré inférieur, et trop souvent elles finissent par tomber, de chute en chute, dans les bas fonds fangeux du paupérisme.
Tout revenu, quels que soient du reste son origine et son importance, aboutit à une consommation. Selon que la consommation est bien ou mal gouvernée, elle peut être utile ou nuisible.
Étudions successivement ces deux modes d’existence du phénomène de la consommation.
I. la Consommation Utile. Le gouvernement de la consommation est du ressort de la morale avant d’appartenir à celui de l’économie politique. Tout homme a des obligations à remplir envers lui-même, envers les siens et envers la société. Quelques-unes de ces obligations lui sont imposées par la nature, en dehors de l’action de sa volonté. Telle est la nécessité de pourvoir au maintien de sa propre existence. Mais sa volonté intervient dans la création du plus grand nombre, lorsqu’il se charge, par exemple, de la responsabilité d’une [II-467] famille. S’il ne satisfait pas à ces obligations diverses, soit qu’elles lui aient été imposées en dehors de l’action de sa volonté, soit qu’il se les impose à lui-même, de deux choses l’une, ou il les laisse en souffrance ou il les reporte indῦment sur autrui. Dans le premier cas, il commet une nuisance à l’égard de lui-même et des siens, dans le second cas, il commet une nuisance à l’égard de la société.
Il suffirait donc d’observer la justice, c’est à dire de remplir exactement toutes ses obligations envers soi-même et envers autrui pour gouverner utilement sa consommation. Mais l’observation de la justice n’a été, en aucun temps, chose facile, et il semble même qu’elle le devienne de moins en moins. A mesure, en effet, que la société s’élève de la barbarie à la civilisation, et que nous nous élevons nous-mêmes dans ses rangs ou dans ses cercles superposés, à mesure, en conséquence, que la masse de nos obligations s’accroît et se diversifie, il nous faut, à la fois, appliquer plus de lumières et un sens plus exercé à la connaissance de la justice, et mettre en œuvre des forces morales plus grandes pour maîtriser les penchants qui nous poussent incessamment à l’enfreindre [95] .
[II-468]
Chacun doit faire d’abord la part nécessaire de la consommation actuelle et celle de la consommation future. Pour opérer utilement cette répartition, il doit considérer: 1° la quotité et les probabilités de durée de son revenu; 2° le nombre et l’importance des obligations diverses auxquelles il est tenu de satisfaire; la portion de ces obligations qui incombe au présent et celle qui incombera à l’avenir. Parmi les obligations actuelles vient, en premier lieu, la nécessité d’entretenir en bon état le capital de forces physiques, intellectuelles et morales dont chacun dispose pour produire et se gouverner soi-même. Comme nous l’avons remarqué précédemment [86] , le montant de cet entretien nécessaire varie suivant la dépense de forces qu’exigent les fonctions productives auxquelles tout capital personnel est appliqué. En second lieu, après l’obligation de pourvoir à l’entretien du personnel de la production vient celle de pourvoir à son renouvellement, c’est à dire à l’élève et à l’éducation des enfants, dans la mesure requise par leurs facultés et par la situation sociale dans laquelle ils sont nés. Viennent enfin toutes les autres obligations naturelles ou conventionnelles qui sont imposées à chacun ou qu’il a pu contracter.
[II-469]
Parmi les obligations qui concernent spécialement l’avenir, viennent, en première ligne, celles qui dérivent de la nécessité de conserver et d’accroître au besoin le revenu, d’où chacun retire les moyens de satisfaire à ses obligations actuelles ou futures. Si ce revenu provient uniquement de la mise en œuvre d’un capital personnel de forces, d’aptitudes et de connaissances, ce capital étant soumis à des risques spéciaux, tels que maladies, accidents, vieillesse, etc., une partie du revenu qu’il procure doit être incessamment épargnée et capitalisée, de manière à couvrir ces risques, afin que le consommateur puisse survivre au producteur. Si le revenu provient encore de l’exploitation de capitaux mobiliers ou immobiliers, il faut, de même, en épargner la portion nécessaire pour couvrir les risques qui menacent tout capital engagé dans la production. Enfin, la plupart des obligations qui pèsent sur l’homme s’étendant du présent à l’avenir, il faut en proportionner le nombre et le poids aux ressources que l’on possède ou sur lesquelles on peut compter pour y faire face, au moins s’il s’agit de celles qui sont soumises à l’influence de la volonté (la fondation d’une famille par exemple). En tous cas, on doit calculer sa dépense actuelle de manière à ne laisser en souffrance aucune obligation essentielle, soit dans le présent, soit dans l’avenir. Sinon, l’on s’expose à infliger des nuisances à ceux envers qui on a des obligations à remplir ou bien encore à ceux sur qui on en reporte le fardeau.
Ce gouvernement utile de la consommation constitue un véritable travail dont la rémunération s’élève précisément en raison des aptitudes qui y sont déployées et du bon usage qui en est fait. Lorsque ce travail est bien exécuté, il procure au consommateur et à la société un maximum d’utilité, partant de [II-470] jouissances; lorsqu’il l’est mal, il y a, au contraire, nuisance ou tout au moins déperdition d’utilité, partant souffrance ou diminution de jouissances. Comme nous l’avons remarqué plus haut, le gouvernement de la consommation exige la mise en œuvre de facultés de deux sortes; intellectuelles et morales. Il faut de l’intelligence pour apprécier les ressources probables dont on pourra disposer dans le cours de son existence, et pour mesurer, d’après l’étendue de ces ressources, la satisfaction à accorder aux obligations non volontaires auxquelles on est assujetti, comme aussi pour y proportionner le nombre et l’importance de ses obligations volontaires. Il faut de l’intelligence encore pour bien établir la hiérarchie des obligations qu’on est tenu de remplir et mesurer la satisfaction à accorder à chacune d’après son importance effective. Il faut enfin de l’intelligence pour faire la part utile des obligations présentes et celle des obligations futures. Cependant, l’intelligence seule ne suffit pas. Il faut y joindre des forces morales. En vain jugerait-on que telles satisfactions matérielles qui concernent le présent doivent être réduites au profit d’autres dépenses qui concernent l’avenir, l’assurance de la vieillesse ou l’éducation des enfants par exemple, on serait impuissant à établir cet ordre utile dans ses consommations, si l’on ne possédait point la force morale nécessaire pour combattre et réfréner ses appétits et leur imposer des privations. Sans l’auxiliaire de l’intelligence, la force morale s’appliquerait mal, elle imposerait aux besoins actuels des privations inutiles parfois même nuisibles; sans l’auxiliaire de la force morale, l’intelligence à son tour aurait beau concevoir le meilleur gouvernement possible de la consommation, elle serait impuissante à le réaliser.
Lorsque le consommateur possède l’intelligence et la force [II-471] morale requises pour bien gouverner l’emploi de son revenu et lorsqu’il a soin de se livrer au travail incessant que ce bon gouvernement exige, lorsqu’il remplit en conséquence toutes ses obligations envers lui-même et envers autrui, dans l’ordre, dans la mesure et dans le temps opportuns, il résout le problème de sa consommation conformément aux lois de la morale et de l’économie politique.
II. la Consommation Nuisible. Il existe une immense variété de gouvernements privés, depuis ceux des hommes qui se préoccupent uniquement de la satisfaction présente de leurs appétits matériels, sans rechercher s’ils ne nuisent pas à eux-mêmes et aux autres en négligeant tout le reste, jusqu’à ceux des hommes qui imposent à leur consommation une règle fondée sur la Justice et sur l’Utilité, autrement dit, qui gouvernent leur consommation au moyen d’une charte conforme, d’une part, aux lois générales de la morale et de l’économie politique, appropriée, d’une autre part, à leur situation spéciale, et dont ils observent religieusement les articles. Toute consommation qui s’écarte de cette règle, invariable dans ses principes, mais infiniment variée dans ses applications, est nuisible, soit d’une manière absolue, soit d’une manière relative.
Par consommations absolument nuisibles, il faut entendre celles qui détruisent ou détériorent le capital personnel du consommateur, au lieu de l’entretenir et de l’améliorer. Tel est l’abus des liqueurs fortes et, en général, tout excès qui use le corps et énerve l’âme, en rendant ainsi l’homme moins apte à produire et à se gouverner. Par consommations relativement nuisibles, il faut entendre celles qui proviennent d’un mauvais aménagement de la consommation, eu égard, d’un côté, au montant et au degré de stabilité du revenu du consommateur, d’un autre [II-472] côté, au nombre et à l’importance des obligations qui pèsent sur lui. Remplir incomplétement une obligation essentielle pour satisfaire plus largement une obligation secondaire, négliger, par exemple, l’éducation de ses enfants, ou refuser à ses semblables une assistance nécessaire pour augmenter son confort personnel, sans même s’adonner à aucun excès, mais de manière à laisser dépérir, d’un côté, plus de capital qu’on n’en accroît de l’autre, c’est faire une consommation relativement nuisible.
Toute consommation nuisible a sa source dans des vices ou des défauts qui sont des exagérations ou des lacunes de notre organisation, exagération de nos penchants physiques, faiblesse de notre intelligence et insuffisance de nos forces morales. Ces vices ou ces défauts déterminent, dans l’économie de la consommation, les deux tendances opposées, mais également nuisibles, de la prodigalité et de l’avarice. En général, les prodigues sont affligés d’une lacune morale à l’endreit des sentiments de la prévoyance et de la responsabilité, et ils sacrifient, en conséquence, les obligations de l’avenir aux besoins du présent. Non seulement, ils n’épargnent rien sur leur revenu, mais encore ils l’entament progressivement et ils finissent par ne plus couvrir leurs frais d’existence. Les avares pèchent, au contraire, par une exagération des sentiments de la prévoyance et de l’amour de soi, qui les pousse à tout sacrifier à une satisfaction ou plutôt à une assurance lointaine de leurs besoins personnels. Si les prodigues ne méritent guère les sympathies qu’on a coutume de leur accorder, car ils méconnaissent et négligent trop souvent des obligations essentielles, en revanche, les avares ne méritent pas non plus qu’on les réhabilite comme on a essayé de le faire, au nom de la science économique. On [II-473] ne peut pas dire, en effet, que les avares gouvernent utilement leur consommation. Lorsqu’ils se privent des nécessités mêmes de la vie pour subvenir à des risques que leur imagination exagère ou pour s’abandonner aveuglément à la passion excessive de l’accumulation, ils détériorent leur capital personnel, en ne lui accordant point la somme de réparations physiques, intellectuelles et morales qu’il exige; ils s’appauvrissent ainsi d’un côté s’ils s’enrichissent d’un autre. C’est bien pis encore lorsqu’ils négligent de remplir leurs obligations actuelles envers autrui, lorsqu’ils lésinent sur l’entretien et l’éducation de leurs enfants ou sur l’assistance qu’ils doivent à leur prochain, en infligeant, par là même à une portion du capital personnel de la société une moins-value ou un dommage que ne compense point la plus value dont leur épargne sordide accroit le stock général des capitaux mobiliers et immobiliers. S’ils augmentent, d’un côté, le matériel de la production, ils en détériorent et en appauvrissent, d’un autre côté, le personnel, en sorte que l’emploi qu’ils font de leur revenu rentre décidément dans la catégorie des consommations nuisibles.
En résumé, la consommation utile entretient et accroît incessamment la somme des moyens d’existence et de progrès de la société, tandis que la consommation nuisible la diminue, soit qu’elle endommage le personnel ou qu’elle entame le matériel de la production.
C’est pourquoi, de tous temps, des coutumes, des institutions et des lois, fondées sur la notion plus ou moins exacteet complète de l’intérêt général sont intervenues pour contraindre les hommes à gouverner leur consommation d’une manière utile.
Ainsi, dans l’ancien état de la société, les classes inférieures, [II-474] asservies à des degrés divers, n’étaient pas plus maîtresses de gouverner leur consommation que leur production. On gouvernait, par exemple, la consommation des esclaves exactement comme celle des autres bêtes de somme attachées au domaine du maître. Le serf possédait, sous ce rapport, une latitude plus grande; mais sa consommation n’en était pas moins strictement réglementée, soit par la volonté du seigneur, soit par la “coutume” de la seigneurie. Au sein des corporations, une intervention analogue était exercée, soit par les maîtres à l’égard des ouvriers, soit par les ouvriers eux-mêmes, les uns à l’égard des autres. Ces réglementations ou ces interventions étaient souvent vexatoires et tyranniques, mais, telles quelles, malgré leurs imperfections et leurs abus, elles contribuaient à empêcher les classes les moins capables de bien gouverner leur revenu, de s’adonner à des consommations nuisibles; elles constituaient, pour ces classes mineures, un régime préventif, imparfait sans doute mais nécessaire, des nuisances de la consommation [97] .
[II-475]
On peut en dire autant des lois somptuaires qui réglementaient la consommation des classes non asservies. Quel était l’objet de ces lois que l’on retrouve à toutes les époques et chez tous les peuples? C’était de combattre l’action de certains penchants excessifs ou vicieux, tels que la gourmandise, la luxure, l’ostentation, etc., qui poussent à des consommations absolument ou relativement nuisibles; c’était d’établir et de maintenir une proportion utile entre les diverses parties de la consommation de chacune des classes dont se composait la société, en prenant pour base la moyenne de leurs revenus. Les lois somptuaires réglementaient le plus grand nombre des consommations matérielles, la nourriture, le vêtement, l’habitation, les moyens de transport, etc., et quoiqu’elles ne fussent point irréprochables, quoique leur mise à exécution laissât, de même, souvent à désirer, elles exerçaient certainement une influence salutaire [100] . Si elles finirent par devenir odieuses et insupportables, cela tenait d’abord à ce qu’aux époques où s’accomplissait le déclassement de l’ancienne société, où les classes supé [II-476] rieures déclinaient tandis que les classes moyennes s’élevaient, elles maintenaient entre les consommations de ces deux catégories sociales des distinctions qui avaient cessé d’avoir une raison d’être dans la différence de leurs situations et de leurs revenus; cela tenait encore à ce qu’elles continuaient de limiter la consommation de produits et de denrées qui, à l’époque où elles avaient été établies, étaient des articles de grand luxe, mais que les progrès de l’industrie et du commerce avaient rendues successivement accessibles à toutes les classes de la société. Elles entravaient donc, par leurs règlements surannés, le progrès industriel et commercial, tout en imposant à la masse des consommateurs des privations inutiles sinon nuisibles, et elles devaient, en conséquence, devenir doublement impopulaires.
De nos jours, la plupart des restrictions que l’ancien régime opposait à la liberté de la consommation ont disparu, mais est-ce à dire que la consommation ait cessé d’avoir besoin d’une règle? Non à coup sῦr. Il en est, sous ce rapport, de la consommation comme de la reproduction. Parce qu’elle n’est plus réglée d’autorité, il ne s’ensuit pas qu’elle ne doive plus être réglée; que chacun puisse aveuglément et indifféremment, en matière de consommation comme en matière de reproduction, obéir à ses penchants; qu’il suffise de laisser faire la nature. Non! A la règle imposée il faut substituer une règle volontaire, mieux ajustée à la situation de chacun et plus mobile, mais non moins formelle et non moins rigide, sous peine de subir et de faire subir aux autres des nuisances analogues à celles que l’antique réglementation de la consommation avait pour objet de prévenir.
La nécessité d’une règle en matière de consommation étant bien démontrée, il reste à savoir si toutes les individualités [II-477] dont se composent nos sociétés possèdent et la capacité nécessaire pour l’établir et la force morale requise pour l’observer? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que la multitude a encore besoin, quoique à des degrés divers, d’une tutelle pour suppléer à l’insuffisance de sa capacité et de ses forces morales dans le gouvernement de sa consommation, et nous en trouvons la preuve dans l’impossibilité où elle se trouve de couvrir ses frais d’existence sans recourir à l’assistance, dans le travail hâtif ou excessif dont les chefs de famille des classes ouvrières accablent les mineurs qu’ils ont l’obligation d’entretenir, même lorsque leur salaire utilement employé pourrait suffire pour subvenir aux besoins de la famille. Si cette multitude incapable du self government était libre de se placer sous la tutelle qui lui est encore nécessaire, il y a apparence qu’elle n’y manquerait point; qu’elle échangerait d’elle-même sa condition misérable et précaire contre une tutelle qui se résoudrait pour elle en une assurance libre contre le paupérisme.
Quant aux individualités qui possèdent la capacité et la force morale requises pour gouverner elles-mêmes leur consommation aussi bien que leur production, la tutelle leur serait nuisible, d’abord en ce qu’elle les assujettirait à une règle générale toujours moins exactement ajustée aux besoins de leur gouvernement individuel que ne pourrait l’être la règle spéciale qu’elles s’imposeraient à elles-mêmes, ensuite, en ce qu’elle entraverait le développement de leurs facultés morales et intellectuelles, en les privant du débouché du self government, maintenant à leur portée. Il importe, en conséquence, de laisser ces individualités capables du self government pleinement libres de gouverner leur consommation aussi bien que leur production, sauf répression en cas de nuisance.
[II-478]
La répression eu cas de nuisance dans l’exercice du self government privé peut être de deux sortes: morale ou matérielle. La répression morale s’opère au moyen de l’intervention de l’opinion publique. Sans doute l’intervention de l’opinion publique dans le self government privé peut être parfois abusive et nuisible dans la pratique; mais elle n’en est pas moins légitime et utile, en principe. Du moment, en effet, où un homme se conduit de telle manière qu’il résulte de sa conduite une nuisance pour autrui, l’opinion publique, qui représente l’intérêt commun auquel il porte atteinte, est fondée à exercer sur lui une censure et à lui infliger soit un blâme, soit toute autre pénalité morale ou sociale, en proportion avec la nuisance commise. Que si une pénalité de ce genre ne suffit point, — et on peut espérer qu’elle suffira un jour, — il y a lieu de recourir aux pénalités matérielles.
Cette question du self government individuel divise aujourd’hui profondément les esprits. Les uns sont d’avis non seulement que tous les hommes ont droit au self government, mais encore qu’il faut le leur imposer, même quand l’expérience a démontré qu’ils ne possèdent ni l’intelligence ni la force morale requises pour le pratiquer; quand, en conséquence, ils préfèrent être gouvernés plutôt que de se gouverner. Les autres, au contraire, refusent d’une manière non moins absolue aux individus l’aptitude à se gouverner eux-mêmes, conformément à la justice et à l’utilité générale, et ils rêvent le rétablissement, sous d’autres formes, des antiques régimes de tutelle qui soumettaient toutes les individualités au gouvernement de la société. La vérité est entre ces deux thèses opposées de l’individualisme et du socialisme. L’observation et l’expérience démontrent qu’il n’est pas vrai, comme l’affirment les individualistes, [II-479] que tous les hommes soient capables de se gouverner; qu’il n’est pas vrai, non plus, comme l’affirment les socialistes que tous les hommes soient incapables de se gouverner. D’où la conclusion qu’il faut les laisser pleinement libres, soit de pratiquer le self government, soit de ne le point pratiquer.
[II-480]
DOUZIÈME LEÇON↩
les consommations publiques
Du partage du revenu entre les consommations publiques et les consommations privées. — Proportion dans laquelle se fait ce partage. — En quoi consistent les services publics. — Que l’ensemble de ces services constitue la tutelle sociale exercée par les gouvernements. — Des attributions et de la constitution naturelles ou utiles des gouvernements dans les trois phases du développement économique des sociétés, — sous les régimes de la communauté, du monopole et de la concurrence. — Que les gouvernements débutent par la communauté et que leurs fonctions se spécialisent avec celles de l’industrie privée. — Que toute fonction ou toute industrie spécialisée existe d’abord à l’état de monopole naturel. — Exemples. — Comment les monopoles naturels se transforment en monopoles artificiels. — Que tout monopole est productif de nuisances. — Que les gouvernements doivent réprimer les nuisances causées par le monopole. — Raison d’être du régime réglementaire dans la seconde phase du développement économique de la société. — Que les gouvernements eux-mêmes sont constitués dans cette seconde phase sous la forme de monopoles plus ou moins limités. — Pourquoi le régime communautaire est alors populaire. — Comment la société passe de la phase du monopole à celle de la concurrence. — Des attributions utiles des gouvernements dans la phase de la concurrence. — Que la production de la sécurité doit se développer et se perfectionner dans cette phase; — que l’intervention du gouvernement dans la production [II-481] et dans la distribution de la richesse cesse, en revanche, d’avoir une raison d’être. — Des nuisances de la consommation et de la mesure dans laquelle le gouvernement doit intervenir pour les empêcher. — Que la constitution du gouvernement se modifiant avec celle des autres entreprises, l’unité économique s’établit dans chaque phase du développement des sociétés. — Que cette unité a maintenant cessé d’exister. — Que le gouvernement est demeuré à l’état de monopole, tandis que les autres entreprises entraient dans la phase de la concurrence. — Maux qui découlent de cette dissonnance entre la constitution du gouvernement et celle de la société. — Pourquoi un gouvernement de monopole devient de plus en plus anti-économique au sein d’une société régie par la concurrence. — Comparaison. — Pourquoi les gouvernements sont demeurés des monopoles, tandis que les entreprises privées étaient soumises à la loi de la concurrence. — Comment la question de la constitution des gouvernements était en visagée à l’époque de la révolution française. — Que, dans l’opinion générale, cette question se trouvait en dehors du domaine de l’économie politique. — Solutions qu’on lui a données. — Du régime constitutionnel et de son insuffisance. — Autres solutions, le socialisme, le principe des nationalités. — Inanité de ces utopies. — Que la constitution des gouvernements est du ressort de l’économie politique aussi bien que celle des autres entreprises. — Critique de la constitution des gouvernements modernes au point de vue économique. — Qu’ils pèchent contre les lois de l’unité des opérations, de la division du travail, des limites naturelles, de la concurrence, de la spécialité et de la liberté des échanges. — Nuisances qui résultent pour la société de ces vices de constitution des gouvernements. — Mauvaise qualité et cherté croissante des services publics, inégalité de leur distribution. — Que les gouvernements sont les ulcères des sociétés. — Remède économique que ce mal comporte. — Qu’il faut simplifier les gouvernements et les soumettre à la loi de la concurrence comme toutes les autres entreprises. — Que l’unité économique se trouvera ainsi rétablie. — Possibilité et résultats de la concurrence politique.
Quoique la consommation ait généralement cessé d’être réglementée, le domaine du self government en cette matière n’est [II-482] pas cependant illimité. Tout revenu se divise en deux parts: l’une est saisie par l’impôt et sert à alimenter les consommations publiques, standis que l’autre est abandonnée au self government du producteur du revenu et sert à alimenter les consommations privées.
La somme qui est prélevée dans chaque pays pour subvenir aux consommations publiques est plus ou moins considérable. On l’évalue communément, dans les pays civilisés, à la sixième ou à la septième partie du revenu de chacun des membres de la société. Mais les statistiques laissent encore beaucoup à désirer sur ce point. Si elles spécifient exactement le montant de l’impôt par tête d’habitant, en revanche elles ne fournissent que des renseignements incomplets sur le montant des valeurs imposées et des indications vagues sur la répartition et l’incidence de l’impôt. En outre, elles négligent le plus souvent de faire la somme des taxes générales et des taxes locales, de l’impôt en argent et de l’impôt en nature (de la conscription par exemple), en sorte que la part proportionnelle de revenu qui est enlevée à chacun pour les consommations publiques demeure fort incertaine.
Quoi qu’il en soit, c’est au moyen de cette portion du revenu de chacun des membres de la société ou des capitaux à l’aide desquels le revenu se constitue, qu’il est pourvu aux dépenses des gouvernements producteurs des services qui font l’objet des consommations publiques. En quoi consistent ces services et les gouvernements qui les produisent?
Le premier et le plus essentiel des services publics concerne le besoin de sécurité. Ce besoin est provoqué, d’un côté, par l’imperfection morale de l’homme, de l’autre par la nature du milieu où il se trouve placé. Dès l’origine, les hommes paisibles [II-483] eurent à se défendre soit contre les agressions individuelles, soit contre les agressions collectives des hommes de proie, sans parler des périls auxquels les exposaient les attaques des autres créatures vivantes ou les cataclysmes de la nature. En conséquence, il leur fallut, de bonne heure, établir un appareil destiné à les préserver des risques de destruction qui menaçaient incessamment leurs propriétés personnelles, mobilières ou immobilières. D’un autre côté, les races de proie, qui combinaient leurs forces en vue d’assujettir les races laborieuses et paisibles, ne tardèrent pas à reconnaître la nécessité d’observer dans leurs rapports mutuels et de faire régner au sein des communautés qu’elles avaient asservies une certaine justice. C’est ainsi que nous voyons les brigands eux-mêmes se soumettre à des règles fondées toujours à quelque degré sur la justice, sans lesquelles leurs bandes ne pourraient subsister. Produire de la sécurité, telle est en résumé la fonction essentielle des gouvernements. Dans ce but, ils établissent et ils entretiennent, d’une part, des tribunaux et une police, d’une autre part, une armée. Les tribunaux et la police ont pour mission de faire régner la sécurité à l’intérieur, en préservant les différents membres de la communauté, de l’assassinat, du vol et, en général, de toute atteinte contre leurs personnes et leurs propriétés. L’armée a pour mission de défendre la communauté contre les agressions ou les prétentions abusives des autres communautés comme aussi d’étendre au besoin la clientèle de la classe gouvernante par voie de conquête.
Ces fonctions sont communes à tous les gouvernements; elles l’ont été partout et de tous temps. Beaucoup d’autres encore viennent se joindre à celles-là, mais sans avoir le même caractère de permanence et d’universalité. Non seulement les [II-484] gouvernements produisent de la sécurité, mais encore ils entretiennent les voies de communications naturelles et ils en créent d’artificielles, ils battent monnaie, ils distribuent l’enseignement, ils commanditent le culte, ils subventionnent les beaux-arts, ils protégent diversement l’agriculture, l’industrie, le commerce, la navigation, ils assistent les pauvres, enfin, ils interviennent plus ou moins dans toutes les branches de l’activité humaine. Ces attributions qui varient en nombre et en étendue suivant les lieux et les époques constituent la tutelle sociale qui est exercée au nom et dans l’intérêt de tous sur chacun des membres de la communauté ou de “l’État.”
Considérée dans ses conditions d’existence et de développement, d’une part, dans ses rapports avec le besoin auquel elle est destinée à pourvoir, de l’autre, la tutelle sociale exercée par les gouvernements ne diffère pas des autres branches de l’activité humaine. Elle est soumise aux mêmes lois et elle passe par les mêmes phases. En général, elle tend à s’organiser de la manière la plus économique et à satisfaire aussi complétement que possible aux besoins de la consommation. Cependant, au moment où nous sommes, elle est visiblement en retard sous ce double rapport, si on la compare aux autres branches de la production, et, à mesure que celles-ci progressent, les maux qui résultent de ce retard de développement de la plus importante des industries, deviennent plus sensibles.
Si nous voulons connaître la cause de cette discordance qui se manifeste de nos jours entre l’état des gouvernements et celui des autres branches de l’activité sociale, nous devrons d’abord jeter un coup d’œil sur les phases naturelles du développement économique des sociétés, et rechercher quelles sont, dans chacune, les attributions et la constitution utiles des gouvernements. [II-485] Ces phases sont au nombre de trois: 1° la communauté, 2° le monopole, 3° la concurrence.
I. la Communauté. A l’origine, les sociétés se constituent par l’aggrégation d’un certain nombre de familles qui s’associent en vue de la protection et de l’assistance mutuelles. Cette réunion de familles forme une tribu ou une commune. Lorsque les familles composant la tribu ou la commune trouvent leurs moyens d’existence dans une industrie rudimentaire, telle que la chasse, la communauté est à peu près complète. Lorsque l’agriculture se substitue à la chasse, chaque famille se met à produire isolément ses moyens de subsistance, et la propriété privée ou patrimoniale remplace de plus en plus la propriété cômmunale. La communauté ne subsiste plus alors que pour les services qui requièrent l’association et la combinaison des forces particulières: ces services consistent d’abord dans l’établissement et la mise en œuvre d’un appareil de défense, parfois aussi, d’aggression, s’il s’agit d’une tribu guerrière dont les moyens d’existence résident en partie dans le brigandage. Mais d’autres besoins se manifestent successivement qui ne peuvent de même être satisfaits que par une action commune: ce sont des routes et des ponts qu’il faut établir dans le village et aux environs, un puits qu’il faut creuser, un temple qu’il faut élever pour le culte, etc., etc. D’un autre côté, la commune ne demeure point isolée, elle a des rapports inévitables avec ses voisines. Il faut délimiter les domaines de chacune et résoudre les litiges généraux ou particuliers qui résultent incessamment du voisinage; il faut encore conclure, en cas de nécessité, des ligues offensives ou défensives. Que si enfin une commune en assujettit une autre, il faut maintenir celle-ci dans l’obéissance. — En même temps, se développent au sein de la petite communauté [II-486] certains vices auxquels on reconnaît à la longue le caractère de nuisances sociales: l’imprévoyance, la corruption des mœurs, l’ivrognerie. La portion de la communauté qui en est atteinte va s’appauvrissant et se dépravant de génération en génération. Elle devient, en conséquence, pour la communauté tout entière une cause d’affaiblissement et de ruine. Il est donc nécessaire d’extirper ces germes de dissolution ou, du moins, de les empêcher de se développer. On y avise par l’établissement de coutumes fondées sur l’expérience des nuisances qui résultent de certains actes, et c’est le gouvernement qui est chargé de faire observer ces coutumes indispensables au maintien et au progrès de la communauté.
A mesure que les services publics deviennent ainsi plus nombreux et plus compliqués pour répondre aux besoins croissants de la communauté, l’organisation de ces services tend davantage à se spécialiser. D’abord chacune des familles dont se composait la tribu ou la commune primitive contribuait, dans la mesure de ses forces et de ses ressources, à fournir le matériel et le personnel nécessaires au gouvernement: dans cet état primitif, de même que les membres de chaque famille pourvoyaient grossièrement à la subsistance et à l’entretien de la famille en cumulant les métiers de pasteurs ou de cultivateurs, de tisserands, de forgerons, de charrons, etc., ils concouraient au gouvernement de la communauté des familles en cumulant les fonctions de juges, de gendarmes, de soldats, etc., etc. Mais du moment où la commune grandissant en nombre et en richesse, les services publics se multiplièrent, en se perfectionnant, il fallut les spécialiser. Les nécessités de la défense ou de l’attaque, par exemple, donnèrent naissance à l’art militaire; les nécessités de l’ordre intérieur et de la paix [II-487] extérieure firent naitre, de même, les sciences du droit privé et du droit public ainsi que l’art de la police. Ces arts nouveaux, qui exigeaient des aptitudes et des connaissances spéciales, ne pouvaient être qu’imparfaitement exercés par tous, et à mesure qu’ils se développaient, ils échappaient davantage à la communauté. Aussi voit-on la “spécialisation” s’opérer peu à peu dans les services publics comme dans les travaux privés. Elle n’apparaît jamais, toutefois, qu’au moment où elle devient absolument nécessaire. Le métier de soldat, par exemple, demeure longtemps dans le domaine de la communauté, tandis que les officiers qui ont besoin de s’assimiler un capital de connaissances spéciales pour pratiquer utilement leurs fonctions, deviennent uniquement des hommes de guerre. Les fonctions des hommes politiques, des administrateurs, des juges, des prêtres, des instituteurs, se spécialisent sous l’influence de la même cause. Parmi ces fonctions gouvernantes, celles qui ont une certaine affinité demeurent d’abord unies, tout en se séparant des autres, puis, à mesure que la société en se développant leur offre un marché plus vaste, elles se séparent pour constituer autant de ramifications distinctes de la tutelle sociale. Comme toutes les autres branches de travail, celles-ci deviennent le domaine d’un groupe de familles qui s’en transmettent, de génération en génération, les aptitudes, les connaissances et les procédés.
En résumé, la société apparaît, dans la première phase de son existence, comme une réunion de familles, dont chacune produit isolément ce qu’elle peut produire avec ses seules forces, et, en commun, ce qui ne peut être produit que par l’association et la combinaison des forces de toutes, savoir la sécurité intérieure et extérieure, les voies de communication, [II-488] etc. Les membres de chaque famille contribuent à produire l’ensemble des services nécessaires à la communauté, comme ils produisent l’ensemble des services nécessaires à la famille, jusqu’à ce que le progres amène dans la production des services publics comme dans celle des services privés, la spécialisation des fonctions et, avec elle, une nouvelle phase de développement économique de la société.
II. le Monopole. A mesure que la spécialisation des industries prend naissance, on voit apparaître le monopole. Toute industrie spécialisée constitue d’abord un monopole. Éclaircissons ceci par quelques exemples. Avant l’établissement d’un atelier spécial de forgeron ou de charron au sein de la société embryonnaire, chacun exerçait plus ou moins grossièrement ce métier dans la mesure de ses besoins. Mais du moment où le marché de la commune devient assez étendu pour fournir des moyens d’existence à un forgeron ou à un charron, il ne manque pas de s’en établir un, et l’on trouve aussitôt plus d’avantage à s’adresser à lui pour les travaux de forgerie ou de charronnage qu’à les exécuter soi-même; on cesse, en conséquence, de savoir forger ou charronner, comme aussi de posséder les outils du métier, et l’on est alors à la merci du forgeron ou du charron. Un autre exemple plus frappant encore est celui de la fabrication du pain. Lorsque chaque famille fait elle-même son pain, quelques-uns de ses membres savent pratiquer, à la vérité d’une manière imparfaite, les métiers de meunier et de boulanger; en outre, elle possède, soit isolément, soit en commun, un moulin et un four. Lorsque la séparation des industries intervient, on cesse au sein de chaque famille de moudre le blé et de faire le pain, surtout lorsqu’on s’adonne à d’autres industries spécialisées; on perd, en conséquence, peu à peu, la [II-489] connaissance et la pratique de la meunerie et de la boulangerie; enfin, on laisse tomber en ruines le moulin et le four. On est alors à la merci du meunier et du boulanger. Sans doute, dans le cas où ceux-ci se feraient payer à un taux usuraire leurs services, on pourrait en revenir au système primitif de fabrication; mais il faut du temps pour reconstruire le moulin et le four, comme aussi pour retrouver les procédés et les tours de main maintenant oubliés des métiers de meunier et de boulanger. En général, s’il s’agit de l’approvisionnement des denrées nécessaires à la vie, au début du régime de la spécialisation des industries, la situation des consommateurs pourra être des plus critiques, elle deviendra même pire que ne l’était leur situation primitive, si les monopoleurs n’imposent point de limites à leurs exigences. Objectera-t-on que les consommateurs sont les maitres d’abandonner leurs industries spéciales pour redevenir producteurs de denrées alimentaires? Soit! mais ils ne possèdent plus les agents productifs, les instruments, les matériaux et les connaissances nécessaires à la production agricole, et, en attendant qu’ils aient pu se les procurer, les mettre en œuvre et en obtenir des produits, ils seront obligés de subir les exigences des monopoleurs ou de mourir de faim. Ce que nous disons de la production des denrées alimentaires s’applique également à toutes les branches de l’activité humaine, toute industrie passant nécessairement par la phase du monopole au sortir de la production embryonnaire. Seulement, il est dans la nature du monopole de causer des nuisances plus ou moins graves selon qu’il s’applique à un produit ou à un service plus ou moins nécessaire. Lorsqu’il s’agit de produits ou de services de première nécessité, le monopole peut engendrer une usure meurtrière; lorsqu’il s’agit de produits ou de services de luxe, sa [II-490] puissance demeure, au contraire, très faible, la demande diminuant alors avec l’offre, souvent même dans une progression plus rapide (Voir la 1re partie, 3e leçon: La valeur et le prix) et il ne peut occasionner qu’une nuisance insignifiante.
Né avec la spécialisation de l’industrie, le monopole subsiste jusqu’à ce que la concurrence ait pu s’établir pleinement dans la fonction spécialisée. Or, c’est une erreur de croire que l’établissement de la concurrence soit partout et toujours immédiat. La concurrence tend à s’établir sans doute, et cette tendance est d’autant plus forte que le monopole porte sur des produits ou des services plus nécessaires et qu’il est, par là même, plus productif; mais il ne s’ensuit pas que la concurrence doive remplacer immédiatement le monopole. Elle rencontre des obstacles à la fois dans la nature et dans l’homme lui-même, et ces obstacles sont quelquefois bien lents à surmonter.
La science économique distingue deux sortes de monopoles: les monopoles naturels et les monopoles artificiels. D’abord, toute industrie spécialisée est à l’état de monopole naturel, mais cet état est essentiellement transitoire; il disparaît à mesure que le nombre des producteurs spéciaux et la masse de leurs produits venant à s’augmenter, ils se font davantage concurrence. Seulement, des obstacles, les uns naturels, les autres artificiels péuvent intervenir pour retarder l’accroissement du nombre des producteurs et de la quantité des produits. Il peut arriver que l’approvisionnement des agents ou des matériaux nécessaires à une production soit naturellement limité, en sorte qu’on ne puisse élever l’offre des produits au niveau de la demande. Tel est le cas de certains vins et de certains tabacs; tel est encore le cas de certaines aptitudes [II-491] extraordinaires pour le chant, la danse, l’art d’écrire, l’éloquence, etc.; tel est enfin le cas de certaines machines ou de certains procédés économiques dont on ne possède point les équivalents jusqu’à ce que ces équivalents soient découverts. Dans ces différents cas, le monopole existe par le fait de la limitation naturelle de la production. Il peut arriver encore que la consommation soit insuffisante pour alimenter une industrie spécialisée, autrement qu’à l’état de monopole, et ce cas est beaucoup plus fréquent qu’on ne le suppose. Admettons qu’il s’agisse d’enseignement: il y a dans une localité isolée une population exactement suffisante pour fournir un marché à une école. Celui qui entreprendra cette école jouira donc d’un monopole jusqu’à ce que la population se soit assez accrue pour fournir un marché à plusieurs établissements d’éducation, ou bien encore, jusqu’à ce que la sécurité et les communications se soient développées et perfectionnées de manière à permettre aux parents d’envoyer, sans risques et à peu de frais, leurs enfants dans les écoles ou dans les pensions des autres localités. Admettons encore qu’il s’agisse de commerce. Il y a dans une localité, un marché de consommation des produits du dehors, qui suffit exactement pour alimenter une boutique spécialement approvisionnée de ces produits. En conséquence, la boutique s’établit, mais elle demeure maîtresse du marché jusqu’à ce que celui-ci devienne assez important pour en alimenter une seconde. Que si le boutiquier abuse de son monopole, un entrepreneur, alléché par les profits extraordinaires qu’il réalise, pourra bien, à la vérité, venir lui faire concurrence; mais si le marché est insuffisant pour alimenter les deux établissements rivaux, le plus faible devra nécessairement succomber. Dans ce cas, les consommateurs se trouveront à la [II-492] discrétion du boutiquier et ils seront plus ou moins durement exploités par lui, selon qu’il leur sera plus ou moins difficile de se passer des articles dont il possède le monopole de vente, selon encore qu’ils auront ou non la possibilité de les acheter à des foires temporaires ou à des marchands ambulants. Dans les deux cas que nous venons de citer et dans bien d’autres, le monopole existe par le fait de la limitation naturelle de la consommation.
A ces monopoles naturels, qui proviennent de circonstances indépendantes de l’homme, viennent se joindre des monopoles artificiels qui sont le fait de la volonté humaine. Dans toute industrie, l’avénement de la concurrence a pour résultat immédiat et sensible la diminution des profits. Il est donc tout simple que les producteurs s’efforcent d’éloigner une si dangereuse ennemie, en prolongeant artificiellement la durée naturelle de l’existence de leurs monopoles. S’ils disposent d’une certaine force ou d’une certaine influence, ils ne manqueront pas de l’utiliser dans ce but; ils feront prohiber l’établissement des entreprises similaires; ou si les entreprises similaires qui leur font concurrence se trouvent placées en dehors des limites de la communauté dont ils sont membres, ils feront prohiber l’importation des produits de ces entreprises. Dans ce cas, le monopole existera par le fait de la limitation artificielle de la production.
Or tout monopole soit naturel soit artificiel est essentiellement productif de nuisances. Les producteurs qui en sont investis prélèvent sur toutes les autres branches de la production une rente ou une usure égale à la différence existant entre le prix naturel ou nécessaire du produit et le prix auquel le monopole parvient à le porter. Cette différence varie, comme [II-493] nous l’avons vu, suivant la nature du produit; elle peut être énorme, et engendrer par conséquent une nuisance meurtrière, quand il s’agit d’articles de première nécessité; en revanche, elle ne peut jamais s’élever bien haut quand il s’agit d’articles de luxe. Là ne s’arrêtent point toutefois les nuisances que cause le monopole. D’une part, la facilité à réaliser des bénéfices usuraires ralentit les progrès des industries monopolisées et les fait même tomber en décadence; d’une autre part, le tribut que la société paye aux monopoleurs empêche le développement de la population et de la richesse générales. La consommation, en conséquence, ne s’accroît point, trop souvent même elle diminue, et les monopoleurs finissent ainsi par être enveloppés dans la ruine qu’ils ont provoquée. Le monopole a été la cause originaire de l’affaiblissement et, par là même, de la destruction violente des anciennes sociétés, et de nos jours, une communauté livrée au monopole s’exposerait non moins infailliblement à être ruinée par la concurrence pacifique des autres communautés.
Dans cette seconde phase du développement économique des sociétés quelles sont les attributions et la constitution utiles des gouvernements?
Les attributions ou les fonctions gouvernementales doivent nécessairement croître en nombre et en importance à mesure que la spécialisation des industries, et les échanges qui en découlent, succèdent à la production embryonnaire. Dans cet état nouveau, les échanges nécessitent, d’abord, la création d’un appareil spécial de protection, ayant pour objet la police des marchés, la vérification des poids et des mesures, le contrôle des monnaies. Ensuite, la société prise dans son ensemble exige une somme plus grande de sécurité. La spécialisation des [II-494] industries ayant pour résultat d’augmenter dans une proportion considérable la richesse produite, la société est plus exposée à des agressions du dehors; à l’intérieur même, l’accroissement de la masse des valeurs appropriées ou des “propriétés”, multiplie le nombre et aggrave l’importance des conflits qui surgissent entre les propriétaires. Il faut, en conséquence, développer les services publics qui ont pour objet la sécurité extérieure et intérieure. Mais à ces attributions qui ne sont qu’une extension de celles de la première phase viennent s’en ajouter de nouvelles, qui appartiennent particulièrement à la seconde, nous voulons parler de la police des monopoles.
On a vu plus haut que toutes les branches d’industrie constituent d’abord, en se spécialisant, des monopoles naturels, lesquels ont une tendance irrésistible à se transformer en monopoles artificiels. Un individu s’adonne à une spécialité dont il a par là même le monopole; si le marché suffit pour alimenter un plus grand nombre d’entreprises, elles s’établissent, mais aussi longtemps que le marché n’est point illimité, et par conséquent que les entrepreneurs possibles sont peu nombreux, ils ont une tendance naturelle á s’entendre et à se coaliser pour limiter la concurrence, celle-ci ayant pour résultat immédiat de limiter leurs profits. C’est ainsi que, dès le début de cette seconde période, on voit toutes les branches de travail s’organiser en corporations composées de groupes plus ou moins nombreux dont les membres sont coalisés d’une manière permanente. Ces différents groupes, coalisés ou organisés en vue du monopole de la branche spéciale d’industrie qui leur fournit des moyens d’existence, se partagent le domaine de la production, et la société entière n’en est bientôt que la collection. Ces groupes ont leurs [II-495] états-majors d’entrepreneurs et leurs armées d’ouvriers, auxquels une clientèle appropriée, en partage de laquelle les étrangers à la corporation ne peuvent entrer, fournit des moyens d’existence assurés. Sous ce régime, le plus nécessaire des instruments de travail, la terre, constitue, comme tout le reste, un monopole entre les mains d’une corporation qui a seule le droit de la posséder. D’abord, les membres de cette corporation exploitent eux-mêmes leurs domaines en se faisant assister par leurs serviteurs ou leurs esclaves; ensuite, lorsque les serviteurs ou les esclaves ont acquis la capacité requise pour entreprendre eux-mêmes une exploitation agricole, les propriétaires divisent entre eux une partie du domaine seigneurial, à la charge de cultiver le restant; autrement dit, ils leur donnent en location une partie du domaine, en exigeant pour prix de loyer une certaine quantité de travail sous forme de corvées. Mais le monopole foncier subsiste toujours: d’une part, les terres ne peuvent être possédées par d’autres que par des membres de la corporation, d’une autre part, les consommateurs de cet instrument de travail sont immobilisés sur la terre seigneuriale, et ils subissent ainsi le monopole de location du seigneur; tandis que le seigneur, de son côté, ne peut louer sa terre à des travailleurs étrangers. Le domaine entier de la production est donc partagé entre une multitude de monopoles. Mais ces monopoles sont extrêmement inégaux en puissance, selon qu’ils portent sur des articles plus ou moins nécessaires à la vie. En les supposant abandonnés à eux-mêmes, ceux qui accaparent la production des articles de première nécessité peuvent exploiter les autres, en raison directe de l’intensité des besoins auxquels ils correspondent. C’est pourquoi, il est nécessaire d’opposer une limite ou un frein à ceux dont la puissance [II-496] est la plus grande, et qui en abusant de cette puissance causeraient à la société la nuisance la plus dommageable. En conséquence, le gouvernement intervient pour réglementer et limiter les monopoles les plus dangereux, il soumet à un maximum les prix des denrées nécessaires à la vie, et le loyer des capitaux; il limite de même le loyer de la terre, en établissant des maximums pour le nombre et la durée des jours de corvée. Cette limitation des monopoles les plus productifs de nuisances demeurait toujours imparfaite sans doute, mais elle était indispensable sous peine de livrer la société à l’exploitation effrénée des monopoles qui se trouvaient, en vertu de leur nature, investis d’une puissance supérieure à celle de la généralité. Dira-t-on qu’au lieu de réglementer les monopoles, il aurait mieux valu de les supprimer? Mais, dans la plupart des cas, cette suppression était impossible. En vain, par exemple, aurait-on supprimé les corporations des boulangers, des bouchers, des marchands de grains, dans les marchés resserrés du moyen âge, elles se seraient incessamment reformées par des coalitions d’autant plus dangereuses qu’elles auraient été secrètes. Mieux valait donc laisser subsister au grand jour des monopoles, dont la suppression effective était impossible, et leur imposer les limites que l’expérience démontrait être les plus utiles dans l’intérêt de la communauté. Le régime réglementaire contre lequel nous nous élevons avec raison aujourd’hui avait alors pleinement sa raison d’être, en ce qu’il était le seul frein possible et efficace que l’on pῦt opposer aux nuisances du monopole.
Enfin, dans cette seconde phase du développement économique des sociétés, la police des nuisances de la consommation acquiert plus d’importance à mesure que les articles de [II-497] consommation deviennent plus nombreux et peuvent être mis plus aisément à la portée des masses encore incapables d’un bon self government. Les lois somptuaires doivent être incessamment étendues à un plus grand nombre d’objets. Il convient de remarquer toutefois que cette partie de la tutelle sociale tend à sortir des attributions gouvernementales, à mesure que la communauté se spécialise. Les entrepreneurs d’industrie groupés dans les corporations, les ouvriers agglomérés dans les sociétés de compagnonnage font eux-mêmes la police de leurs consommations, dans l’intérêt de l’existence et des progrès des communautés spéciales dont ils font partie, et leurs règlements somptuaires contre l’ivrognerie et la débauche par exemple, rendent superflue l’intervention du gouvernement, investi de la tutelle de la communauté générale, composée de la somme des communautés spéciales.
Maintenant, quelle est dans cette phase du développement de la société, la constitution naturelle, ou, ce qui revient au même, la constitution utile du gouvernement? Nous avons vu que les fonctions gouvernantes tendent à se spécialiser comme toutes les autres branches de l’activité humaine. Partout, on les voit devenir la spécialité d’un groupe plus ou moins nombreux de familles, qui se les partagent et qui s’efforcent d’en conserver le monopole. Le gouvernement apparaît comme une corporation ou une réunion de corporations superposées à celles qui ont monopolisé les autres branches de travail. Ces corporations gouvernantes non seulement repoussent la concurrence des intrus qui essayent d’entrer en partage avec elles, mais encore elles repoussent, autant qu’elles le peuvent toute tentative de limitation de leur monopole par voie de réglementation et de maximum. De là, d’incessants débats entre la corporation [II-498] gouvernante, et les masses qui subissent son monopole, celles-ci s’efforçant incessamment d’en limiter la puissance qu’elle s’efforce à son tour de maintenir intacte. De là encore, les tentatives qui sont faites pour confisquer ce monopole, le plus puissant, puisqu’il dispose de la force organisée pour la défense commune, et par là même le plus productif, tentatives qualifiées de criminelles quand elles échouent, de glorieuses et de libératrices quand elles réussissent, mais n’aboutissant, en ce cas, presque toujours, qu’à remplacer des monopoleurs expérimentés et repus par des monopoleurs in expérimentés et à repaitre.
La spécialisation des fonctions gouvernantes n’en a pas moins été un progrès. C’est pourquoi les républiques démocratiques au sein desquelles le gouvernement était l’affaire de tous les membres de la communauté se sont successivement transformées en républiques oligarchiques ou en monarchies, présentant pour caractère essentiel la spécialisation des fonctions gouvernantes dans la classe d’individus qui possédait les aptitudes requises pour les exercer. Comment donc se fait-il que ces communautés primitives soient demeurées un idéal que les hommes se sont efforcés incessamment, quoique en vain, de ressaisir? C’est que les gouvernements en se spécialisant sont devenus des monopoles, et que l’abus qu’ils n’ont pas manqué de faire de leur puissance d’une part, l’insuffisance et l’inefficacité des mesures auxquelles les “consommateurs des services gouvernementaux” de l’autre, ont eu recours pour prévenir ou corriger cet abus, ont dῦ naturellement faire regretter l’état de choses antérieur. Éclaircissons ceci par une simple comparaison. Supposons que chaque famille cesse de produire elle-même ses aliments pour s’adonner à une industrie spécialisée, elle [II-499] devra désormais s’approvisionner auprès des producteurs ou des marchands de denrées alimentaires. Si les circonstances sont telles qu’une concurrence suffisante ne puisse s’établir entre ces fournisseurs des nécessités de la vie, si, d’un autre côté, la réglementation établie pour limiter la puissance de leur monopole demeure inefficace, les consommateurs ainsi exploités ne pourront-ils pas regretter l’ancien état de choses? Leur sera-t-il possible cependant de le rétablir, et, en admettant même qu’ils y parviennent, qu’ils retournent de la production spécialisée à la production embryonnaire, auront-ils réalisé un progrès? Non! ils auront reculé, et le cours naturel des choses ne tardera pas à les ramener au point d’où ils étaient partis. La république démocratique, dans laquelle chacun remplit sa part dans les fonctions publiques, nécessaires à la communauté, est, comme on voit, un idéal rétrograde, mais on conçoit que l’abus du monopole politique des classes gouvernantes ait rendu cet idéal populaire, de même qu’on conçoit que l’abus du monopole des denrées nécessaires à la vie ait pu faire considérer comme un âge d’or cet état primitif de la société, dans lequel chacun était son marchand de grains et son boulanger.
III. La concurrence. C’est l’agrandissement successif du marché de la consommation qui détermine le passage de la société de la production embryonnaire et communautaire, à la production spécialisée et monopolisée d’abord, à la production de concurrence ensuite. Comment s’opère cet agrandissement du marché? Par le développement progressif de la production dans l’intérieur de la commune et au dehors. Du moment où un débouché se forme pour une entreprise spécialisée, cette entreprise ne manque pas de naître. Ainsi, du moment où il existe [II-500] dans un village assez d’agriculteurs pour fournir des moyens d’existence à un charron, on voit s’établir un atelier de charronnage. Si le nombre des agriculteurs s’accroît, si leur richesse s’augmente, si encore des moyens de communication s’établissent entre le village et les hameaux des environs, le charron pourra agrandir ses ateliers et se faire aider par un nombre croissant de compagnons et d’ouvriers. Bientôt, le débouché suffira pour alimenter un second atelier, puis un troisième; mais les entrepreneurs qui exercent cette industrie ne manqueront pas de se coaliser, puis de former une corporation permanente pour l’exploitation exclusive du marché. Cependant, si le marché vientà s’étendre encore, un moment arrivera où les entreprises existantes ne suffisant plus pour l’approvisionner, on réclamera la liberté de l’industrie, c’est à dire la concurrence et où, malgré la résistance désespérée des monopoleurs du charronnage, on finira par l’obtenir. Alors, que se passera-t-il? D’abord les constructeurs de charrettes, voitures, etc., essayeront de se coaliser de nouveau, mais s’ils y réussissent et si, en conséquence, leurs bénéfices s’élèvent à un taux exceptionnel, de nouvelles entreprises s’établiront pour leur faire concurrence; ensuite, s’ils ne peuvent plus interdire la concurrence intérieure ils essayeront du moins de se protéger contre la concurrence étrangère, en faisant prohiber l’importation de ses produits sur les marchés de la communauté dont ils sont membres, et tous les autres producteurs se comporteront de même. Mais si le marché continue néanmoins à s’étendre, si des voies de communications rapides et à bon marché s’établissent entre les différentes communautés devenues plus nombreuses et plus riches, ces restrictions opposées à la concurrence finiront par devenir nuisibles aux intérêts mêmes qu’elles avaient [II-501] pour objet de protéger. En effet, si les constructeurs de charettes, de voitures, etc., sont intéressés à conserver le monopole de leur marché, en revanche ils sont intéressés aussi à le voir s’agrandir. Or ce marché est susceptible d’agrandissement dans l’intérieur de la communauté et au dehors. Dans l’intérieur, son agrandissement peut provenir de deux causes: de l’augmentation du nombre et des ressources des consommateurs de charrettes, voitures, etc., et de l’abaissement du prix de ces véhicules, abaissement qui les mette à la portée d’un plus grand nombre de consommateurs. Au dehors, l’agrandissement du marché peut provenir des mêmes causes, auxquelles s’ajoute le progrès des voies de communication qui n’est autre chose qu’une diminution des frais de production dans l’espace. Mais, l’expérience démontre, peu à peu, que si la limitation de la concurrence assure le marché, c’est en faisant obstacle à son extension au dedans comme au dehors. C’est ainsi notamment que la protection accordée à ceux qui fournissent les matières premières nécessaires à la construction des charrettes et des voitures, élève les frais de production de ces véhicules et diminue par là même l’étendue de leur marché à l’intérieur et à l’étranger. A la vérité, l’exclusion des voitures de l’étranger en agrandissant artificiellement le débouché des producteurs nationaux peut compenser cette diminution; mais il n’en est pas de même à l’extérieur. Là, il faut lutter contre des concurrences étrangères, et ceux-là dont les frais de production sont grevés des surtaxes de la protection des matières premières, etc., y luttent avec un désavantage marqué. Un moment arrive donc, où les marchés étrangers devenant de plus en plus accessibles, le régime protecteur y fait perdre beaucoup plus qu’il ne fait gagner sur le marché national, en admettant qu’il y fasse gagner quelque [II-502] chose. La protection est alors abandonnée, la liberté du commerce s’ajoute à la liberté de l’industrie et l’on entre, malgré les efforts désespérés des intérêts qui s’accrochent au monopole, dans l’ère de la concurrence.
Quelles sont, dans cet état nouveau, les attributions et la constitution naturelles du gouvernement?
Nous connaissons les attributions naturelles du gouvernement dans les deux phases précédentes du développement économique des sociétés. Dans la phase de la concurrence, où nous commençons à nous engager, elles subissent de nouvelles modifications en plus et en moins. Dans cette phase, les sociétés, croissant rapidement en nombre et en richesse, ont besoin par là même d’une sécurité plus parfaite, mieux assise et plus étendue. Pour faire naître et maintenir l’ordre au sein d’une multitude d’intérêts incessamment en contact, il faut à la fois une justice plus exacte et une puissance plus grande pour la faire observer. En outre, les propriétés se multipliant et se diversifiant à l’infini, il faut multiplier et diversifier les appareils qui servent à les défendre. La production des inventions et la production littéraire, par exemple, donnent naissance, en se développant, à un nombre considérable de propriétés d’une espèce particulière, dont les limites soit dans l’espace soit dans le temps, engendrent des contestations continuelles. Il faut pour résoudre ces questions litigieuses une justice ad hoc. En d’autres termes, la justice devra s’étendre et se diversifier en raison de l’extension et de la diversification du débouché que l’accroissement et la multiplication de toutes les branches de la richesse ouvrent à la fraude et à l’injustice. Enfin, la sécurité doit s’allonger, pour ainsi dire, dans l’espace et dans le lemps. Si le développement des voies de communication et les progrès [II-503] de l’industrie permettent aux hommes et aux produits de se transporter aux extrémités du globe, ils devront y trouver des garanties de sécurité suffisantes, sinon ils ne se déplaceront point. Si des contrats ou des engagements sont effectués à longue échéance ou même sans limites de temps, comme dans le cas des rentes perpétuelles, l’exécution de ces contrats ou l’accomplissement de ces engagements devra encore être assuré, sinon on ne les conclura point. La “production de la sécurité” doit donc se développer et se perfectionner dans cette nouvelle phase de l’existence des sociétés, en raison même de l’extension et du raffinement du besoin auquel elle doit pourvoir.
En revanche, si les attributions naturelles du gouvernement s’augmentent et se compliquent de ce côté, elles se réduisent et se simplifient d’un autre. Le gouvernement n’a plus à intervenir ni dans la production ni dans la distribution de la richesse. Il lui suffit de cesser de prêter son appui aux monopoles artificiels et de laisser la concurrence agir pour faire disparaître successivement les monopoles naturels. Cela fait, la production et la distribution de la richesse tendent d’ellesmême à s’opérer de la manière la plus utile.
Nous croyons superflu de revenir en détail sur ces deux points, que nous avons mis, croyons-nous, suffisamment en lumière. (Voir la 1re partie, VIe leçon, et la 2e partie, XIe leçon.) S’agit-il de la production? Non seulement les entreprises se constituent toujours, sous un régime de pleine concurrence, dans le nombre, dans les formes, dans le lieu, et dans les limites d’espace et de temps les plus utiles, mais encore les entrepreneurs sont obligés d’adopter les procédés et les méthodes les plus économiques. Car le progrès devient pour eux une condition d’existence. S’ils produisent à plus haut prix [II-504] que leurs concurrents, leurs frais de production cessent bientôt d’être couverts, ils entament leurs capitaux, et ils sont condamnés à liquider leurs entreprises ou à faire banqueroute. S’agit-il de la distribution de la richesse? De même que la concurrence agit incessamment pour rendre la production plus économique, elle agit aussi pour rendre la distribution des produits aussi utile ou, ce qui revient au même, aussi équitable que possible. Sous un régime de pleine concurrence, les prix de toutes choses ont une irrésistible tendance à se mettre au niveau des frais et de la rémunération nécessaires pour produire ces choses et les mettre au marché. Quand, sous ce régime, une marchandise est accidentellement rare sur un marché, quand, d’un autre côté, le besoin qu’on en a est considérable et urgent, quand le prix s’élève en conséquence, de manière à fournir une rente aux bénéficiaires de ce monopole accidentel, l’appât de cette rente ne manque pas d’attirer la concurrence, l’offre s’augmente, le prix baisse et la rente disparaît. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à une réglementation artificielle pour limiter l’usure qui n’est autre chose que la rente d’un monopole; le régulateur naturel de la concurrence, agissant par le mécanisme de la loi des quantités et des prix, rend l’usure impossible ou la fait disparaître dès qu’elle se produit. En faisant graviter les prix courants de toutes choses vers le niveau des frais nécessaires pour les produire, la concurrence attribue aux détenteurs des divers agents productifs une part exactement proportionnée à la quantité de forces qu’ils ont dépensées, ni plus ni moins.
L’intervention du gouvernement dans la production et dans la distribution de la richesse cesse, comme on voit, d’avoir une raison d’être sous un régime de pleine concurrence. Il y a plus. [II-505] Après avoir été utile dans les deux phases précédentes soit pour suppléer à l’insuffisance des forces individuelles soit pour limiter la puissance abusive des monopoles, elle est maintenant nuisible. Si le gouvernement entreprend une industrie, il est obligé d’en écarter artificiellement la concurrence pour compenser son infériortié industrielle, et d’en faire ainsi un monopole. Si le gouvernement réglemente une industrie, il éloigne encore la concurrence des entreprises réglementées, et il replace de même ces entreprises dans l’état économiquement inférieur du monopole.
En revanche, le gouvernement ne peut-il pas continuer utilement à intervenir pour écarter les nuisances de la consommation? Si les masses sont incapables d’un bon self government de leur consommation, le gouvernement est fondé évidemment à intervenir pour réprimer ou prévenir les nuisances qu’elles commettent en négligeant, par exemple, l’accomplissement de leurs obligations morales pour gorger leurs appétits matériels. Deux cas peuvent ici se présenter. S’il s’agit d’individualités ayant les aptitudes réquises pour se gouverner, le gouvernement doit se borner à réprimer les nuisances qu’elles commettent en se gouvernant mal, sans entreprendre de substituer sa direction à la leur. Sinon il empêcherait les forces morales nécessaires pour pratiquer un bon self government de se développer par un constant exercice, et d’arriver ainsi à faire une concurrence suffisante aux appétits purement matériels. Une individualité gouvernée n’ayant pas, en effet, à exécuter le travail nécessaire au gouvernement de soi-même, les facultés qu’elle possède pour exécuter ce travail et qui demeurent inactives ne peuvent évidemment recevoir tout leur développement utile, et elles courent, de plus, le risque de s’atrophier. S’il [II-506] s’agit, au contraire, d’individualités qui ne possèdent pas encore les facultés requises pour le self government, autrement dit d’hommes-enfants, ayant besoin d’une tutelle appropriée à leur état moral, le gouvernement peut être fondé à se charger de cette tutelle. Mais ses autres attributions l’empêcheront, en ce cas, de remplir les fonctions de tuteur des incapables aussi utilement que pourrait le faire une entreprise spéciale. C’est pourquoi la tutelle des individualités incapables du self government est destinée, selon toute apparence, à devenir l’objet d’une branche d’industrie qui naîtra tôt tard de la transformation progressive de la servitude. (Voir la 2e partie, IXe et Xe leçons.)
Ainsi, dans les trois états économiques que nous venons de passer en revue, les attributions naturelles ou utiles du gouvernement consistent à écarter autant que possible les nuisances qui se manifestent dans la production, dans la distribution et dans la consommation des richesses. Ces nuisances diffèrent selon les états de la société; d’où il résulte que l’intervention du gouvernement pour les empêcher doit différer aussi: dans la première phase du développement social, par exemple, le gouvernement doit se charger de certains travaux qui ne pourraient être exécutés par les forces individuelles et dont la non exécution serait nuisible à la société, tandis que, dans les deux phases suivantes, il doit se borner à interdire les actes positivement nuisibles.
La constitution naturelle ou utile des gouvernements se modifie comme leurs attributions selon l’état de la société. Dans la première phase du développement social, les fonctions gouvernementales sont exercées par tous les membres de la communauté. Dans la seconde phase, elles se spécialisent et [II-507] elles deviennent le monopole d’une classe ou d’une corporation. Au moyen âge, par exemple, la société entière est partagée en corporations, au sein desquelles se spécialisent et se monopolisent les différentes branches de l’activité humaine, depuis les plus élevées jusqu’aux plus basses, sécurité, culte, enseignement, beaux-arts, industrie, commerce. Il y a alors unité dans la constitution du gouvernement et de la société. Les corporations gouvernantes sont constituées exactement comme celles des maçons, des tailleurs, des cordonniers, des boulangers. Chaque corporation, haute ou basse, a son domaine qu’elle exploite d’une manière exclusive et qu’elle s’efforce incessamment d’étendre aux dépens des autres corporations, tant au dedans qu’au dehors: dans ce domaine, les consommateurs sont à sa merci, à moins qu’ils n’aient réussi à opposer des restrictions au pouvoir que son monopole lui confère. Ces restrictions, dont le maximum est la pièce principale, forment un ensemble de garanties contre l’abus du monopole. Les corporations gouvernantes finissent comme les autres par y être assujetties, malgré leurs efforts pour maintenir leur monopole intact et pour en user dans toute son étendue. En langage économique, les chartes ou les constitutions ne sont autre chose que des applications du régime du maximum, faites au profit des consommateurs des services publics. En Angleterre, par exemple, où la corporation gouvernante fut obligée, de bonne heure, de compter avec les consommateurs, la constitution se grossit successivement des garanties qu’ils réussirent de gré ou de force à obtenir. Sauf dans les pays où la classe gouvernante elle-même est assujettie à un chef héréditaire comme l’équipage d’un navire à son capitaine (et ce gouvernement absolutiste même peut avoir sa raison d’être dans certaines circonstances) on voit partout [II-508] cette classe se gouverner comme une grande corporation; elle a son parlement, où siégent ses principaux membres et sans l’assentiment duquel aucune mesure importante n’est prise. En présence de ce parlement, qui est le conseil de la corporation politique, vient se placer, dans les pays où les consommateurs ont réussi à limiter plus ou moins son monopole, une assemblée composée de leurs délégués, et ayant pour mission de défendre leurs droits et leurs intérêts contre les abus particulièrement dangereux de ce monopole. Cette assemblée des représentants ou des délégués des consommateurs surveille la production et la distribution utiles des services publics, elle en débat les prix, et elle se trouve par là même en opposition constante avec les chefs ou les mandataires de la corporation gouvernante quand elle ne se laisse pas intimider ou corrompre par eux. Telles apparaissent, d’une part, la Chambre des lords, de l’autre, la Chambre des communes en Angleterre.
En résumé, dans la première phase de l’existence des sociétés, les services publics sont produits comme les autres par ceux-là mêmes qui les consomment; dans la seconde phase, ils passent, en se spécialisant, entre les mains de corporations, dont le monopole d’abord illimité est successivement, — à mesure que ses abus se font sentir, — restreint au profit des consommateurs. On le restreint au moyen du système de garanties et de maximum que l’expérience fait reconnaître comme le plus propre à assurer la production la meilleure et la plus économique des services publics, et ce système ne diffère pas de celui qui est appliqué aux corporations qui monopolisent de même les autres branches de la production. La constitution naturelle ou utile du gouvernement se trouve ainsi pleinement en harmonie avec celle de toutes les autres entreprises; [II-509] autrement dit, il y a unité dans la constitution politique et économique de la société.
Or, si nous savons, d’une part, quelles ont été dans les deux premières phases du développement social, la constitution utile de la production des services publics et celle des services privés, d’une autre part, quelle est dans la troisième phase la constitution utile des services privés, il nous sera facile de savoir encore quelle doit être, dans cette troisième phase, la constitution utile des services publics. Si, grâce à l’agrandissement progressif des marchés de consommation, les entreprises qui fournissent les produits ou les services nécessaires à la consommation privée passent d’un régime de monopole plus ou moins limité à un régime de concurrence, il y a apparence que la constitution des gouvernements producteurs des services publics devra inévitablement subir une transformation analogue; qu’ils passeront de même du régime du monopole à celui de la concurrence, et que l’unité économique finira ainsi par s’établir dans la troisième phase du développement des sociétés comme elle s’est établie dans les deux précédentes.
Au moment où nous sommes toutefois, cette unité économique ne semble pas près encore d’être reconstituée. Tandis que les entreprises qui pourvoient à la consommation privée sont déjà, pour le plus grand nombre, placées sous le régime de la concurrence, les gouvernements producteurs des services publics se trouvent encore attardés dans le vieux régime du monopole. De là, une situation anormale et périlleuse, car, de même que des gouvernements communautaires ne pouvaient plus suffire à des sociétés qui étaient entrées dans la phase du monopole, des gouvernements de monopole ne peuvent plus suffire à des sociétés qui sont entrées dans la phase de la concurrence. [II-510] En termes plus brefs, si les gouvernements de la première phase étaient antiéconomiques dans la seconde, ceux de la seconde doivent être antiéconomiques dans la troisième.
Nous nous servirons encore d’une simple comparaison pour mettre en pleine lumière ce défaut d’unité qui se manifeste de plus en plus entre la constitution des gouvernements et celle de la multitude des entreprises entre lesquelles se partage l’activité sociale. Reportons-nous à la boutique de village, et recherchons quand elle s’établit et comment elle se développe. Elle s’établit quand les familles dont la réunion constitue la société embryonnaire du village sont devenues assez nombreuses et assez aisées pour lui fournir un débouché permanent, et pour procurer ainsi des moyens d’existence suffisants au boutiquier. A l’origine toutefois le boutiquier est obligé, à cause de l’exiguité de son marché de consommation, d’exercer avec son commerce un ou plusieurs métiers et de comprendre dans ce commerce des articles fort divers. Mais que le village devienne un bourg, puis une ville, que le “marché” de la boutique s’étende en conséquence, le boutiquier devra spécialiser davantage ses occupations et sa vente. S’il continue à exercer quelque autre métier, il ne pourra plus suffire à son commerce dont le débouché aura grandi. S’il continue à débiter les mêmes articles, il lui sera également de plus en plus difficile d’y suffire, car la consommation exigera à la fois une plus grande quantité et un assortiment plus varié de chaque marchandise. S’il s’agit de coutellerie, il lui faudra désormais non seulement des couteaux, mais encore des ciseaux, des canifs, des rasoirs, etc.; s’il s’agit de parfumerie, au lieu d’une espèce grossière de savon, il lui en faudra d’une douzaine de qualités, sans parler des essences et des cosmétiques. De boutiquier devenu commerçant dans un [II-511] marché de consommation agrandi, il devra donc spécialiser de plus en plus son commerce. Au lieu de vendre des épiceries, de la mercerie, de la parfumerie, de la coutellerie, il devra se borner à vendre des épiceries ou même une seule sorte d’épiceries, du thé ou du café par exemple. Bref, au lieu d’exercer une vingtaine de commerces à l’état embryonnaire, il devra se borner à en exercer un à l’état de spécialité. Les choses ne manqueront pas de se passer ainsi, en admettant que le commerce demeure libre dans les phases successives du développement économique du village. Dans ce cas, la pression de la concurrence obligera le boutiquier primitif à spécialiser sa vente; car, en la maintenant sur l’ancien pied, il s’exposerait à perdre sa clientèle, qu’il ne pourrait plus servir aussi bien et à aussi bas prix que ses concurrents dont les établissements seraient spécialisés. Mais il en sera autrement si le boutiquier, d’abord investi du monopole naturel de l’approvisionnement du village, a eu assez de pouvoir ou d’influence pour maintenir ensuite ce monopole à l’état artificiel. Dans ce cas, comment les choses se passeront-elles? Le boutiquier continuera d’exercer son commerce sur l’ancien pied; seulement, à mesure que son débouché s’agrandira, il sera obligé d’augmenter les proportions de son établissement, et finalement, lorsque le village sera devenu une grande ville, d’en faire un bazar colossal. Que s’il lui est impossible de subvenir à une demande qui comprend maintenant autant de milliers d’articles qu’elle comprenait primitivement d’unités, il abandonnera peut-être quelques-unes des branches les moins lucratives de son monopole, ou du moins il tolérera l’établissement de quelques autres magasins pour ces branches secondaires, à la condition qu’ils ne subsisteront que sous son bon plaisir et qu’ils lui payeront tribut. En revanche, il ne manquera [II-512] pas de conserver et de défendre avec un soin jaloux les branches principales de son monopole.
Cependant, à mesure que le marché de consommation s’agrandit ét se diversifie, l’établissement de l’épicier monopoleur se trouve placé dans des conditions de production moins économiques. Tandis que les autres branches de travail se séparent en vertu du principe de la division du travail, se développent dans leurs limites naturelles et se perfectionnent sous le stimulant de la concurrence, celles qu’il monopolise grandissent artificiellement, en dehors de ces conditions organiques de la croissance économique. Qu’en résulte-t-il? c’est que les industries de concurrence livrent à la consommation des produits de plus en plus parfaits et à des prix décroissants, tandis que le commerce monopolisé demeure chaque jour davantage en retard sous ce double rapport. Néanmoins, si ce commerce porte sur des articles indispensables à la consommation, les bénéfices du monopoleur croîtront quand même, par le seul fait de l’agrandissement progressif du marché.
Poursuivons jusqu’au bout notre hypothèse. A mesure que les progrès des industries de concurrence rendront plus sensible et plus dommageable le retard de perfectionnement du commerce monopolisé, les consommateurs murmureront davantage contre ce monopole. Cependant, s’il est sauvegardé par quelque antique superstition, si l’on est universellement convaincu qu’il est dans la nature du commerce de l’épicerie d’être exercé sous forme de monopole, on se bornera d’abord à le réglementer, en imposant au monopoleur l’obligation d’approvisionner convenablement le marché qui lui est inféodé, comme aussi peut-être en soumettant ses marchandises à un maximum. Peut-être enfin, les consommateurs chargeront-ils des délégués de veiller [II-513] à ce que cette réglementation préservatrice de leurs intérêts soit strictement observée. Le monopoleur s’efforcera naturellement de repousser une semblable immixtion dans ses affaires, et il emploiera pour s’en débarrasser tantôt la violence et tantôt la corruption. En admettant qu’il réussisse à remettre les consommateurs complétement à sa merci, il aura le choix entre deux partis: 1° Il pourra interdire, sous des peines rigoureuses, toute plainte au sujet de la qualité et du prix de ses marchandises, et jouir ainsi de son monopole avec quiétude. Mais alors la société retardée et épuisée par un monopole sans frein ira s’affaiblissant, et elle finira par périr en entraînant le monopoleur dans sa ruine. 2° Il pourra donner satisfaction à ses consommateurs mécontents, en amélioraut ses marchandises sous le double rapport de la qualité et du prix, mais l’assiette antiéconomique de son commerce l’empêchera quoi qu’il fasse, d’opérer cette amélioration d’une manière suffisante et durable. Le mécontentement renaîtra bientôt, et si les consommateurs ont crῦ en nombre et en puissance, ils réussiront peut-être, à leur tour, à mettre le monopoleur à leur discrétion. Quelles seront les conséquences de cette “révolution?” De deux choses l’une, ou les consommateurs se borneront à imposer au monopoleur un ensemble de règles et de garanties destinées à assurer la bonne qualité et le bas prix de ses marchandises, en d’autres termes, ils l’obligeront à accepter une constitution, ou ils voudront exploiter pour leur propre compte le monopole de l’épicerie en constituant une gérance et un conseil de surveillance ad hoc, avec diverses précautions pour en assurer la bonne gestion, mais l’un et l’autre remèdes seront presque également inefficaces. De quelque façon qu’il soit organisé et géré, le monopole de cette multitude de branches dans lesquelles se [II-514] ramifie maintenant le petit commerce de l’épicier primitif n’en demeurera pas moins antiéconomique, et, chaque jour même il le deviendra davantage; chaque jour, en conséquence, il causera à la société des nuisances plus nombreuses et plus sensibles. Peut-être cherchera-t-on alors des remèdes d’une autre nature à ce mal chronique. On s’imaginera, par exemple, que le débouché ouvert au commerce monopolisé est insuffisant, et l’on s’efforcera de l’agrandir par “l’annexion” de nouveaux consommateurs, ou bien encore on se persuadera que le mal vient de ce que ceux qui vendent les épiceries et ceux qui les achètent n’appartiennent pas tous à la même race, et l’on s’appliquera à réorganiser le monopole de l’épicerie conformément au “principe des nationalités.” Mais l’expérience ne tardera pas à démontrer que ces soi-disant panacées aggravent le mal au lieu de le guérir. Enfin, en désespoir de cause, la série des remèdes empiriques étant épuisée, on aura recours aux procédés de l’observation et de l’analyse pour remonter à la source du mal, et l’on découvrira, non sans surprise, qu’il n’est pas vrai, ainsi que les monopoleurs s’étaient appliqués à le faire croire, le croyant du reste eux-mêmes, que le monopole soit la forme nécessaire et providentielle du commerce de l’épicerie. En conséquence, au lieu de poursuivre l’œuvre impossible d’une meilleure “organisation” de ce monopole, on travaillera à le démolir, en faisant passer successivement les différentes branches de commerce qui s’y trouvent agglomérées, dans le domaine de la concurrence. Cette agglomération contre nature étant dissoute, chaque branche devenue libre pourra se développer dans ses conditions normales, en proportion des besoins du marché, et la société débarrassée d’un monopole qui la retardait et l’épuisait croîtra plus rapidement en nombre et en richesse.
[II-515]
C’est là l’histoire des gouvernements depuis que la société a commencé à passer de la phase du monopole dans celle de la concurrence.
Lorsque les progrès généraux de la population et de la richesse d’une part, les progrès particuliers de la sécurité et des moyens de communication de l’autre, eurent agrandi les marchés de tous les produits et services, les corporations qui possédaient depuis des siècles, dans chaque localité, le monopole des différentes branches de l’activité humaine devinrent de plus en plus insuffisantes pour satisfaire aux besoins croissants de ces marchés agrandis. Des apôtres d’une science nouvelle apparurent alors, et ils s’appliquèrent à démontrer que cette antique organisation de l’industrie était maintenant surannée, qu’il fallait, dans l’intérêt de la société, substituer la concurrence au monopole. Les corporations privilégiées ne manquèrent pas de se défendre, mais les intérêts auxquels leurs monopoles portaient atteinte grandissant chaque jour, les plus faibles, celles qui occupaient les régions inférieures et moyennes de la société finirent par succomber. En revanche, celles qui occupaient les régions supérieures et dont les fonctions étaient environnées d’un prestige particulier échappèrent à ce régime nouveau qui était imposé aux autres. On s’était accoutumé à croire que les gouvernements, ayant à remplir une mission d’un caractère sublime, ne pouvaient rien avoir de commun, dans leur mode d’établissement et de fonctionnement, avec la multitude des autres entreprises, et l’on n’eut pas même l’idée que les règles qui s’appliquaient à celles-ci pussent également leur être applicables. Telle était la situation des esprits, lorsque la révolution française vint mettre à l’ordre du jour la reconstitution du gouvernement et celle de la société elle-même. L’opinion [II-516] dominante à cette époque, au moins parmi les classes éclairées, dont l’influence, malgré des éclipses temporaires, finit toujours et nécessairement par prévaloir, était que la multitude des branches inférieures de l’activité humaine devaient être abandonnées à la concurrence, sauf toutefois un certain nombre de restrictions. Ainsi, on croyait que les industries et les professions qui concernent la subsistance des masses devaient continuer à être sévèrement réglementées; on croyait encore qu’il importait d’empêcher la formation de grandes associations, afin d’éviter le retour des abus du régime des corporations; on croyait enfin, — et ceci était un reste du droit économique de l’ancien régime, — que le marché national était la propriété de l’industrie indigène, et qu’il fallait, par conséquent, en écarter aussi complétement que possible la concurrence étrangère. Mais, ces restrictions faites, — à la vérité, elles étaient nombreuses, — les esprits éclairés s’accordaient à considérer la concurrence comme le seul régime applicable à la plupart des branches du travail matériel, et c’était en même temps à ces branches qu’ils restreignaient le domaine de la science nouvelle qui se résumait dans la théorie de la concurrence. En revanche, ces mêmes esprits qui appartenaient presque sans exception, notons-le bien, au personnel des anciennes corporations gouvernantes, étaient convaincus que les fonctions qui avaient jusqu’alors formé le domaine de ces corporations supérieures, la sécurité, le monnayage, les transports, le culte, l’enseignement, etc., devaient être nécessairement réservées, en vertu de leur nature propre, au gouvernement; à quoi ils ajoutaient que l’économie politique n’avait point à s’en occuper. Cela étant, il s’agissait de constituer le gouvernement, sans avoir égard aux données de la science économique, [II-517] mais de manière cependant à ce qu’il pῦt remplir, aussi avantageusement que possible pour la société, les fonctions nombreuses et importantes qu’on lui attribuait.
La compétence de l’économie politique en matière de gouvernement étant ainsi récusée, on ne doit pas s’étonner, si, pour résoudre le problème de la constitution utile de la production des services publics, on prit d’abord la voie qui en éloignait le plus. Que fit-on en effet? On commença par fusionner tous les services qui formaient, sous l’ancien régime, le domaine de corporations séparées, service de la sécurité, service de l’enseignement et des cultes, service du monnayage, service des transports, etc., et l’on constitua ainsi une énorme “régie” des services publics; ensuite, on essaya de remettre cette régie aux mains d’une démocratie communautaire, dont les institutions étaient empruntées à celles de la phase embryonnaire de l’existence des sociétés. Mais s’il était possible, à la rigueur, — quoique ce fῦt visiblement une œuvre rétrograde, — de fusionner des services de nature diverse dans une régie unique, il était impossible de faire manœuvrer cette lourde et monstrueuse machine autrement que par un personnel spécial. En conséquence, on vit se reconstituer une classe gouvernante dans laquelle l’ancien personnel gouvernemental se fondit avec l’élément nouveau que la révolution avait fait surgir. Cette classe nécessaire pouvait à la vérité se recruter désormais plus aisément qu’autrefois dans la masse de la nation à laquelle tous les emplois publics devenaient accessibles, mais les familles dont elle se composait ne manquèrent pas de se transmettre de génération en génération, les fonctions politiques, militaires, judiciaires et administratives qui leur fournissaient des moyens d’existence; car elles s’en léguaient les traditions par l’éducation [II-518] du foyer, et leurs relations habituelles leur permettaient d’en assurer la conservation à leurs descendants. C’est ainsi que les familles adonnées à l’agriculture, à l’industrie et au commerce se transmettent de même, communément, de génération en génération, les entreprises à l’aide desquelles elles subsistent.
Le monopole gouvernemental se reconstitua donc, dans les différentes branches de travail qui lui étaient auparavant dévolues, — on pourrait ajouter même qu’il rétrograda en fusionnant des industries que le progrès avaient séparées sous le régime du monopole; il se reconstitua encore dans le personnel spécial que nécessitait la production des services publics.
A la vérité, ce monopole fut plus rigoureusement réglementé et maximé qu’il ne l’avait été auparavant et l’on conçoit qu’il ne pouvait l’ètre trop. En effet, en reconstituant, d’un côté, avec les débris des anciennes corporations gouvernantes, une corporation colossale que l’on investissait du monopole des services les plus nécessaires à la société; en dissolvant, de l’autre, toutes les corporations inférieures et en empêchant leur reconstitution sous des formes nouvelles, appropriées au régime de la concurrence, on faisait de la société gouvernée une poussière sans consistance, et on livrait les consommateurs ainsi individualisés des services publics, à la discrétion de l’aggrégation formidable à laquelle on en conférait de nouveau le monopole. Il importait donc que des garanties aussi complètes et aussi clairement spécifiées que possible fussent accordées à la masse des consommateurs contre l’abus de ce monopole, que la nature même des choses allait faire retomber, à peu près comme autrefois, entre les mains d’une classe spécialement adonnée à la production des services publics. Tel fut l’objet [II-519] des constitutions, c’est à dire des procédés de réglementation et de limitation du monopole gouvernemental qui ont été particulièrement en vogue depuis la révolution française. A l’origine, on avait une confiance illimitée dans cette réglementation politique; on était convaincu qu’avec une constitution bien faite un peuple ne pouvait manquer de se trouver garanti à perpétuité contre les abus d’un mauvais gouvernement. L’expérience ne tarda pas à faire justice de ces illusions. Au lieu de procurer aux peuples un bon gouvernement, les constitutions ne devinrent que trop souvent des instruments d’exploitation entre les mains des classes supérieures, qui avaient eu l’habileté de se faire attribuer le contrôle du gouvernement qui se trouvait, de fait, monopolisé par elles. Alors, les classes exploitées par ce monopole firent des révolutions pour s’en emparer à leur tour. Mais les révolutions n’aboutissant qu’à déplacer le monopole gouvernemental, et presque toujours même à l’aggraver, — car il fallait l’élargir et par conséquent l’alourdir pour y faire entrer les classes conquérantes plus nombreuses et plus faméliques que les classes auxquelles elles se substituaient, — le mal subsista. Les panacées constitutionnelles perdirent peu à peu de leur crédit, et l’on se mit à en chercher d’autres. On s’imagina, par exemple, que le mal provenait non de la mauvaise constitution du gouvernement, mais de la mauvaise constitution de la société elle-même, et l’on voulut étendre le système d’organisation des services publics à tous les autres services, en un mot, englober la société dans le gouvernement. Telle fut la panacée du socialisme, qui prenait précisément le progrès à rebours. L’économie politique, appuyée sur les intérêts que le socialisme menaçait, en eut facilement raison, mais le malaise social persistant toujours, une autre [II-520] panacée succéda à celle-là. On affirma que le mal provenait de ce que les gouvernements n’étaient pas suffisamment “nationaux,” c’est à dire de ce que le monopole des services publics se trouvait, en tout ou en partie, entre des mains étrangères, et l’on se mit à agiter la question dite des nationalités. On en est là aujourd’hui. On croit que le malaise dont souffre la communauté des peuples civilisés provient uniquement de ce que quelques-uns de ces peuples sont soumis à des gouvernements étrangers, et l’on en conclut qu’il importe par dessus tout de remettre les “natifs” en possession des monopoles gouvernementaux. Cela fait, et quelles que soient d’ailleurs l’ignorance et l’immoralité des natifs, — les services publics ne laisseront plus rien à souhaiter, et les nations entreront dans l’ère bénie de la liberté et de la paix. En conséquence, on convie les peuples à verser leur sang et à dépenser leur argent pour reconstituer au plus vite les “nationalités,” ou, ce qui revient au même, pour livrer chaque variété ou sous-variété de la race humaine à un monopole gouvernemental appartenant exclusivement à des hommes de cette variété ou sous-variété. Nous ignorons encore ce qui adviendra de cette nouvelle utopie; mais en admettant qu’on réussît à l’incarner dans les faits, nous pouvons affirmer que le malaise social n’en subsisterait pas moins. Il y a apparence même qu’il s’en trouverait aggravé, d’abord par suite des dépenses énormes qu’exigeraient les révolutions et les guerres nécessaires pour instituer, partout, des gouvernements purement nationaux, ensuite parce que, dans beaucoup de pays, où les aptitudes gouvernantes sont rares et de basse qualité, les gouvernements étrangers sont préférables aux gouvernements nationaux.
Ces utopies et bien d’autres ont leur source dans l’erreur que [II-521] nous avons signalée plus haut, savoir que la constitution des gouvernements n’est point, comme celle des autres entreprises, du ressort de l’économie politique, d’où il résulte que la solution du problème d’un bon gouvernement doit être cherchée ailleurs. L’échec désastreux de toutes les tentatives qui ont été faites pour améliorer les services publics, tant sous le rapport de leur production que sous celui de leur distribution, sans avoir égard aux lois économiques qui président à la production et à la distribution des autres services, démontre suffisamment, croyons-nous, que l’on se trompait en plaçant ainsi les gouvernements dans une région inaccessible à l’économie politique. Science de l’utile, l’économie politique est seule compétente, au contraire, pour déterminer les conditions dans lesquelles doivent être établies toutes les entreprises, aussi bien celles que les gouvernements accaparent que celles qui sont abandońnées à l’activité privée.
Du moment où l’on restitue à l’économie politique cette partie essentielle de son domaine, sans se laisser arrêter davantage par un préjugé trop respéctueux pour des puissances que la crainte des uns, l’orgueil des autres, avaient divinisées, la solution du problème d’un gouvernement utile devient non seulement possible mais encore facile. Il suffit de rechercher, en premier lieu, si les entreprises gouvernementales sont constituées conformément aux lois économiques qui président à la constitution de toutes les autres entreprises, quelle que soit la nature particulière de chacune, en second lieu, comment, dans la négative, on peut les y conformer.
De même qu’il y a des lois physiques et des principes de mécanique qui doivent être observés dans la construction des édifices, il y a des lois économiques qui doivent l’être dans la [II-522] constitution des entreprises. Ainsi, pour produire de la manière la plus économique, toute entreprise doit être construite et mise en œuvre conformément aux principes de l’unité des opérations et de la division du travail, des limites naturelles et de la concurrence; pour distribuer ses produits ou ses services de la manière la plus équitable et par conséquent la plus utile, toute entreprise doit encore se conformer aux principes de la spécialité et de la liberté des échanges. Or les entreprises gouvernementales, telles qu’elles sont construites et mises en œuvre de nos jours, pèchent essentiellement contre ces lois naturelles de la production et de la distribution des services.
I. Les gouvernements pèchent visiblement contre les lois de l’unité des opérations et de la division du travail. Comment nous apparaissent-ils en effet? Comme des entreprises colossales, exerçant à la fois une multitude de fonctions et d’industries. Non seulement les gouvernements pourvoient à la sécurité publique, mais encore, pour la plupart du moins, ils distribuent l’enseignement, ils commanditent le culte et les beaux-arts, ils transportent les lettres, expédient les dépêches télégraphiques, construisent et parfois exploitent les voies de communication, enfin ils interviennent plus ou moins dans les autres branches de l’activité humaine. Comment donc pourraient-ils s’acquitter utilement de ces fonctions multiples? Supposons qu’une compagnie s’établisse pour exploiter à la fois: 1° des chemins de fer et des bateaux à vapeur; 2° des fabriques de tissus de laine et de coton; 3° des magasins d’épiceries; 4° des théâtres, etc., etc., en admettant même que le gouvernement consentit à lui accorder l’anonymat (ce que l’administration ne ferait point, car elle considère naïvement le principe de l’unité des opérations comme essentiel. . .pour autrui), une entreprise pareille ne trouverait [II-523] pas un souscripteur. Pourquoi? Parce que si peu familière que soit la masse du public avec l’admirable livre de la Richesse des nations, elle refuserait de confier ses capitaux à une compagnie qui poursuivrait une foule d’objets différents et disparates: â défaut de la science, le bon sens appuyé sur une expérience de tous les jours lui démontrerait qu’on ne peut utilement, dans aucune direction de l’activité humaine, “chasser plusieurs lièvres à la fois;” qu’alors même que les diverses industries qu’il s’agirait d’entreprendre seraient avantageuses séparément, elles deviendraient mauvaises par leur réunion contre nature. Or qu’est-ce qu’un gouvernement sinon une vaste entreprise, exerçant des industries et des fonctions multiples et disparates? Au point de vue des lois de l’unité des opérations et de la division du travail, un gouvernement qui entreprend la production de la sécurité et de l’enseignement, le transport des lettres et des dépêches télégraphiques, la construction et l’exploitation des chemins de fer, la fabrication des monnaies, etc., n’est-il pas un véritable monstre?
II. Les gouvernements ne pèchent pas moins contre la loi des limites naturelles. Comme nous l’avons remarqué précédemment (T. Ier, Ve leçon. L’Assiette de la production) toute entreprise a ses limites dans lesquelles elle peut s’exercer avec un maximum d’utilité. Si elle les excède et si elle demeure en deçà, sa production devient moins économique. Or les gouvernements n’ont jamais eu aucun égard à cette loi. De tous temps, on les a vus s’appliquer à étendre le domaine soumis à leur monopole, et, “la monarchie universelle” est demeurée l’idéal des politiques sinon des économistes. En tous cas, ce sont les hasards de la guerre ou des alliances de familles et non point des considérations tirées de l’étude des lois de l’utilité qui ont déterminé [II-524] la grandeur des États. Comment d’ailleurs des gouvernements qui exercent plusieurs industries ou plusieurs fonctions se conformeraient-ils à la loi des limites naturelles? Chaque industrie a les siennes, et telle limite qui est utile pour la production de la sécurité cesse de l’être pour celle de l’enseignement. Cela étant, un gouvernement ne peut évidemment observer une loi qui lui imposerait autant de limites différentes qu’il exerce d’industries ou de fonctions.
III. Les gouvernements pèchent contre la loi de la concurrence. Sous ce rapport cependant leur constitution n’est pas uniforme. Pour certains services publics, la sécurité, le transport des lettres et le monnayage par exemple, ils prohibent absolument la concurrence dans les limites de leur domaine; pour d’autres, tels que l’enseignement, la charité, le transport des hommes et des marchandises, ils l’admettent dans une mesure plus ou moins étendue, mais presque toujours dans des conditions fort inégales. Ainsi, en matière d’enseignement, ils ont pour système de produire à perte, en rejetant les déficits de leurs établissements sur les contribuables parmi lesquels sont compris leurs concurrents eux-mêmes; en matière de charité, ils refusent d’autoriser la fondation d’établissements privés, sous forme de sociétés perpétuelles jouissant du droit de propriété dans toute sa plénitude, comme les établissements de la charité publique. Aucun service public, pour tout dire, n’est produit et distribué dans des conditions de pleine concurrence, c’est à dire en laissant le champ entièrement libre aux entreprises rivales et en subissant l’obligation de couvrir les frais de sa production, avec la rémunération ordinaire des capitaux qui y sont engagés. Les industries monopolisées par les gouvernements, pouvant ainsi subsister sans couvrir leurs frais de production, [II-525] n’ont pas besoin, comme les entreprises de concurrence, de perfectionner incessamment leurs procédés et leurs méthodes; elles s’empressent donc moins de satisfaire à ce besoin qui n’est pas pour elles de première nécessité, et elles demeurent par là même en retard sur les autres branches de l’activité sociale.
IV. Les gouvernements pèchent, enfin, dans la distribution de leurs services, contre les principes de la spécialité et de la liberté des échanges.
Dans les industries de concurrence, ces deux principes sont rigoureusement observés. D’une part, chaque consommateur demande spécialement l’espèce de produits ou de services dont il a besoin, dans les quantités et qualités qui conviennent le mieux à son usage, et ces produits ou services lui sont fournis conformément à sa demande; d’une autre part, il en débat librement les prix et les conditions de payement. En matière de services publics, au contraire, l’échange est commun et obligatoire, au lieu d’être spécial et libre. Le gouvernement met ses services à la disposition de la communauté des consommateurs, assujettis à son monopole, et ils sont tenus de les accepter tels quels, sans pouvoir en débattre individuellement les prix et les conditions de payement, à moins qu’ils ne puissent s’en passer, et dans ce cas même, ils sont obligés, le plus souvent, d’en payer leur part. La valeur de l’ensemble des services fournis par le gouvernement est totalisée et elle constitue la dépense publique. La somme nécessaire pour couvrir cette dépense est totalisée de même, et prélevée, d’après une règle de répartition plus ou moins arbitraire, sur la communauté des consommateurs. Si, comme c’est le cas ordinaire, elle demeure insuffisante, le gouvernement comble le déficit au moyen d’un emprunt, en rejetant [II-526] ainsi sur les générations futures une partie de la dépense des services fournis à la génération actuelle.
De la méconnaissance de ces différents principes qui régissent la constitution utile des entreprises, il résulte que les services publics demeurent dans un état de flagrante infériorité, en comparaison des services privés. La différence serait bien plus sensible encore si les gouvernements ne soumettaient point à une réglementation antiéconomique les branches de travail qu’ils n’ont point accaparées, en les empêchant de se constituer dans les formes et dans les limites les plus utiles, en interdisant, par exemple, au plus grand nombre des entreprises de se constituer sous forme de sociétés anonymes, à toutes de se fonder pour une durée illimitée, et, par conséquent, d’émettre des obligations perpétuelles. En entravant le développement utile des entreprises privées, ces restrictions et ces prohibitions ont pour résultat uniforme de diminuer la différence qui existe entre elles et les entreprises dont les gouvernements se sont attribué, à des degrés divers, le monopole.
Néanmoins cette différence est encore énorme, soit que l’on se place au point de vue de la production ou de la distribution utile des services.
I. En ce qui concerne la production, la méconnaissance des principes de l’unité des opérations, de la division du travail, des limites naturelles et de la concurrence a pour résultats inévitables de surélever les prix des services publics et d’en abaisser la qualité. Tandis que tous les produits et services des industries de concurrence sont fournis incessamment en plus grande abondance, en meilleure qualité et à plus bas prix, les services des gouvernements demeurent insuffisants, grossiers et chers. Cependant, à mesure que la population devient plus [II-527] nombreuse et que ses ressources augmentent, grâce à la productivité croissante des industries constituées et mises en œuvre conformément aux lois économiques, les besoins auxquels correspondent les services publics exigent une satisfaction plus ample et plus raffinée. S’agit-il de la sécurité? Elle doit être nécessairement plus complète et plus diversifiée dans une société riche et civilisée, où les propriétés à protéger se sont multipliées et ramifiées à l’infini, que dans une société pauvre et barbare. S’agit-il de l’euseignement? A l’origine, la somme de connaissances que chaque génération avait à léguer à la génération suivante était peu considérable et peu variée; en outre, ces connaissances, pour peu qu’elles dépassassent les notions élémentaires des métiers manuels, n’étaient nécessaires qu’à la classe peu nombreuse qui gouvernait la société: il suffisait donc, pour satisfaire aux besoins de ce petit nombre de consommateurs d’enseignement, de quelques écoles dans lesquelles toutes les sciences connues étaient mises à leur portée, comme tous les produits de l’industrie naissante étaient réunis dans la boutique de village. Mais à mesure que le capital intellectuel et moral de l’humanité s’est grossi par le travail des générations successives; à mesure encore que le besoin des connaissances nécessaires pour créer des richesses ou en gouverner l’emploi a été ressenti par une classe plus nombreuse, il a fallu multiplier et diversifier davantage les ateliers d’enseignement. De nos jours, au moins dans les sociétés où prédomine le self-government, l’acquisition d’une certaine somme de connaissances est devenue un besoin universel. Qui osera affirmer cependant qu’il y soit suffisamment pourvu? Que l’on compare l’extension qu’ont prise et les progrès qu’ont réalisés, depuis un demi-siècle, les industries qui pourvoient à la satisfaction de besoins bien [II-528] moins nécessaires, mais qui sont entrées dans le domaine de la concurrence, à l’extension si insuffisante et aux progrès si lents de l’enseignement accaparé partout, plus ou moins, par le gouvernementalisme? De tous les produits, l’homme est celui que l’on excelle aujourd’hui le moins à façonner: si l’on réussit à lui inculquer, d’une manière suffisante, l’art de gouverner les machines dont il fait usage, combien peu, en revanche, l’art de se gouverner soi-même est avancé et vulgarisé! A quoi peut servir cependant de multiplier et de perfectionner les produits si les hommes n’en savent point faire un emploi utile? S’ils ne se servent des ressources et de la puissance croissantes que leur confère une industrie progressive que pour s’adonner à des vices abrutissants ou pour s’entre-détruire dans des luttes sauvages? Ce retard de l’industrie qui sert à façonner les hommes en leur inculquant les principes du self-government, de tous les arts à la fois le plus difficile et le plus nécessaire, n’est-il pas et ne deviendra-t-il pas de plus en plus une nuisance sociale? — La même observation s’applique aux autres industries que les gouvernements ont accaparées: toutes demeurent en retard sur les industries de concurrence, et à mesure que la société croît en nombre, en richesse et en puissance, elle souffre davantage de ce retard de quelques-unes des branches les plus élevées et les plus nécessaires de son organisme.
II. Envisagée au point de vue de la distribution utile des services, la méconnaissance des principes de la spécialité et de la liberté des échanges, engendre des nuisances plus graves encore, en ce qu’elle entraîne une inévitable inégalité dans la répartition des services publics et des frais de leur production, en ce qu’elle permet même de rejeter sur les générations futures une partie de la dépense des services fournis à la génération [II-529] actuelle. D’un côté, en effet, nul ne peut savoir quelle est sa quote-part dans la distribution des services publics et qu’elle est sa quote-part dans la dépense. On peut affirmer toutefois que les classes les plus pauvres, partant, les moins influentes dans l’État, sont celles qui reçoivent la moindre proportion des services publics, et qui contribuent cependant, pour la plus forte proportion, à les payer. D’un autre côté, la totalité des recettes, quelle qu’en soit du reste la provenance, ne suffit plus que bien rarement à couvrir la totalité des dépenses. Tous les gouvernements sont régulièrement obligés d’emprunter pour combler les déficits sans cesse renaissants et grossissants des branches de travail qu’ils ont monopolisées. Au moment où nous sommes, leurs dettes réunies (sans compter celles des sous-gouvernements provinciaux, cantonnaux ou communaux) dépassent 60 milliards, et elles augmentent d’année en année [101] . Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie qu’une partie des frais de production des services publics est mise à la charge des générations futures au lieu d’être acquittée bond fide par la [II-530] génération qui a consommé ces services. Cette facilité immorale à rejetter sur l’avenir une partie des frais des consommations présentes ne doit-elle pas avoir pour résultat inévitable d’exciter les gouvernements à augmenter incessamment leurs dépenses? Que l’ou se représente ce qui arriverait si une pratique analogue était possible en matière de consommations privées: quelles dettes on ferait chez son épicier, chez son tailleur, chez son bottier, si l’on pouvait, en s’autorisant d’une pratique généralement admise, rejeter sur “les générations futures” l’obligation de les payer! De deux choses l’une, on les générations futures succomberont un jour sous le fardeau de ces dettes accumulées, ou elles refuseront, comme ce sera leur droit, de les acquitter, autrement dit, elles feront banqueroute.
C’est ainsi, par le fait de leur constitution antiéconomique, que les gouvernements sont devenus, suivant une expression énergique de J. B. Say, les ulcères des sociétés [102] . A mesure que la population et la richesse augmentent, grâce au développement [II-531] progressif des industries de concurrence, une masse croissante de forces vives est soutirée à la société, au moyen de la pompe aspirante des impôts et des emprunts, pour subvenir aux frais de production des services publics ou, pour mieux dire, à l’entretien et à l’enrichissement facile de la classe particulière qui possède le monopole de la production de ces services. Non seulement, les gouvernements se font payer chaque jour plus cher les fonctions nécessaires qu’ils accaparent, mais encore ils se livrent, sur une échelle de plus en plus colossale, à des entreprises nuisibles, telles que les guerres, à une époque où la guerre, ayant cessé d’avoir sa raison d’être, est devenue le plus barbare et le plus odieux des anachronismes [103] .
A cet ulcère qui dévore les forces vives des sociétés, à mesure que le progrès les fait naître, quel est le remède?
Si, comme nous avons essayé de le démontrer, le mal provient de la constitution antiéconomique des gouvernements, le remède consiste évidemment à conformer cette constitution aux principes essentiels qu’elle méconnait, c’est à dire à la rendre économique. Il faut pour cela, en premier lieu, débarrasser les gouvernements de toutes les attributions qui ont été annexées à leur fonction naturelle de producteurs de la sécurité, en faisant rentrer l’enseignement, le culte, le monnayage, les transports, etc., dans le domaine de l’activité privée; en second lieu, soumettre les gouvernements, comme toutes les autres entreprises, à la loi de la concurrence.
Déjà, la cause de la simplification des attributions gouvernementales est gagnée dans la théorie, si elle ne l’est pas encore [II-532] dans la pratique [104] . En revanche, l’idée de soumettre les gouvernements au régime de la concurrence est généralement encore regardé comme chimérique [105] . Mais sur ce point les faits devancent peut-être la théorie. Le “droit de sécission” qui se fraye aujourd’hui son chemin dans le monde aura pour conséquence nécessaire l’établissement de la liberté de gouvernement. Le jour où ce droit sera reconnu et appliqué, dans toute son étendue naturelle, la concurrence politique servira de complément à la concurrence agricole, industrielle et commerciale.
Sans doute, ce progrès sera lent à accomplir. Mais il en est ainsi de tous les progrès. Quand on considère la masse d’intérêts et de préjugés qui leur font obstacle, on désespère même de les voir se réaliser jamais. Écoutons plutôt ce que [II-533] disait an siècle dernier, Adam Smith, de la liberté commerciale:
“S’attendre, disait-il, que la liberté du commerce soit jamais rétablie entièrement dans la Grande-Bretagne, ce serait une bonhommie aussi absurde que de compter d’y voir jamais réaliser l’Oceana ou l’ Utopie. Non seulement les préjugés, mais, ce qui est bien plus insurmontable, les intérêts particuliers d’un certain nombre d’individus s’y opposent irrésistiblement.
“Si les officiers d’une armée s’opposaient à toute réduction des troupes avec autant de zèle et d’unanimité que les maîtres manufacturiers en déploient pour s’élever contre toute loi tendante à augmenter la concurrence sur le marché intérieur; si les premiers animaient leurs soldats comme les autres enflamment leurs ouvriers pour les soulever et les déchaîner contre toute proposition d’une pareille mesure, il n’y aurait pas moins de danger à réduire une armée, qu’il n’y en a eu dernièrement à vouloir diminuer à quelques égards le monopole que nos manufacturiers ont obtenu contre leurs concitoyens. Ce monopole a tellement grossi parmi nous le nombre de certaines races d’hommes, que, semblables à un déluge de troupes sur pieds, elles sont devenues formidables au gouvernement et ont intimidé la législature dans mainte occasion.
“Le membre du parlement qui vient à l’appui de toute proposition faite pour fortifier le monopole est sῦr d’acquérir non seulement la réputation de bien entendre le commerce, mais de la faveur et du crédit dans un ordre d’hommes à qui leur multitude et leurs richesses donnent une grande importance. S’il s’y oppose, au contraire, et qu’il ait de plus assez d’autorité pour les traverser dans leurs desseins, ni la probité la plus reconnue, ni le plus haut rang, ni les plus grands services rendus au public ne peuvent le mettre à l’abri de la détraction et des calomnies les plus infâmes, des insultes personnelles, et quelquefois du [II-534] danger réel que produit le déchaînement des monopoleurs furieux et déçus dans leurs espérances [106] .”
Cependant, la liberté commerciale a fini par avoir raison des “monopoleurs furieux” dont parle le père de l’économie politique, et l’on peut aujourd’hui, sans s’abandonner à des rêves utopiques, espérer qu’avant un siècle le système protecteur n’existera plus qu’à l’état de mauvais souvenir dans la mémoire des hommes. Pourquoi les monopoles politiques ne disparaîtraient-ils pas à leur tour comme sont en train de disparaître les monopoles industriels et commerciaux? S’ils disposent d’une puissance formidable, les intérêts auxquels ils portent dommage grandissent aussi, chaque jour, en nombre et en force. Leur heure suprême finira donc par sonner, et l’Unité économique se trouvera ainsi établie dans la phase de la concurrence comme elle l’a été dans les phases précédentes de la communauté et du monopole. Alors, la production et la distribution des services, enfin pleinement soumises, dans toutes les branches de l’activité humaine, au gouvernement des lois économiques, pourront s’opérer de la manière la plus utile.
Notes - Volume II↩
[1.] L’opinion d’un ancien philosophe, cité par Platon (in Theateto), que l’homme est la mesure de toutes choses, convient à ce qui compose les mesures itinéraires et dans un sens littéral, indépendamment d’aucun rapport, aux connaissances purement intellectuelles. L’emploi des termes de pied, de coudée, de palme, de pouce, de doigt, de pas commun, de brasse en est la preuve. Il faut même ajouter qu’il y a tout lieu de croire que la mesure propre aux parties qu’on vient de nommer, selon leur proportion dans la stature commune des hommes, a été d’un usage primitif, en précédant l’usage postérieur des mesures qui passent le naturel par l’étendue qu’on leur a donnée, ce qu’il faut attribuer aux mathématiciens, comme le pas géométrique en fournit un indice. (D’Anville, Traité des mesures itinéraires anciennes et modernes.)
[2] Nous ne parlerons pas, dit l’auteur d’une savante critique du système métrique, de la mesure du temps, parce que nous croyons qu’il n’a été fait à cet égard que de très timides essais; mais, pour la mesure des angles, on ne s’est pas borné à de simples essais, on a fait des calculs prodigieux pour mettre à la disposition des géomètres, des astronomes, des géographes, des tables dans lesquelles l’angle droit est divisé en 100 degrés, les degrés en 100 minutes. . .Nous avons lu quelque part que M. de Prony employa à ces calculs les nombreux garçons perruquiers que l’abandon de la poudre et de la queue avait mis sur le pavé. Peine perdue! les savants n’ont jamais voulu de leur œuvre; ils ont conservé les 90 degrés, comme le peuple a conservé les vingt sous; ils se sont aperçus un peu tard que le calcul décimal cessait d’être bon quand il cessait d’être commode. (J. Dupuit, Dictionnaire de l’économie politique, art. Poids et mesures.)
[3] En France, lisons-nous dans le Dictionnaire des monnaies d’Abot de Bazinghen, les étalons de poids pour l’or étaient, avant François Ier, soigneusement gardés dans le palais des rois de France. Ce prince ordonna en 1540 qu’ils seraient déposés et gardés en la cour des monnaies où ils sont restés depuis.
C’est à la cour des monnaies que l’on s’adresse présentement pour faire étalonner tous les poids qui servent à peser les métaux et autres marchandises, comme les poids de trébuchet, les poids de marc et les poids massifs de cuivre, ensuite on les marque d’une fleur de lis, savoir ceux de Paris en présence de l’un des conseillers de la cour commis à cet effet et ceux des autres villes en présence des juges-gardes des monnaies ou autres juges commis par la cour. Il y a pour cet effet des poids de chaque sorte qu’on nomme étalons, dans les hôtels des monnaies du royaume, étalonnés sur les poids déposés en la cour des monnaies.
Cet étalon du poids de marc se nomme archétype, mot qui signifie original, patron ou modèle. Il est gardé dans le cabinet de la cour, dans un coffre fermé à trois clefs, dont l’une est entre les mains de M. le premier président, l’autre en celles du conseiller commis aux mandements et la troisième en celles du greffier.
Ce fut sur ce poids original qu’en 1494, le sixième du mois de mai, un arrêt du parlement ordonna que tous changeurs, orfévres et autres usant du poids de marc pour peser l’or et l’argent seraient tenus de faire étalonner et ajuster leurs poids, avec défenses sous peine arbitraire et de punition corporelle en cas de récidive de se servir de poids non étalonnés en la cour des monnaies.
C’est encore sur l’étalon de cette cour que doivent être étalonnés les poids dont se servent les maîtres et gardes du corps de l’épicerie et les maîtres apothicaires lorsqu’ils font leurs visites générales ou ordinaires chez les marchands de leur corps et chez tous les autres marchands, ouvriers et artisans qui vendent leurs ouvrages et marchandises au poids. Cet étalonnage se fait en présence de deux conseillers de la cour des monnaies.
L’étalon du poids de marc de France a toujours été si estimé pour sa justesse et sa précision, que les nations étrangères ont quelquefois envoyé rectifier leurs propres étalons sur celui de la cour des monnaies.
On remarque entre autres exemples que l’empereur Charles-Quint envoya à Paris en 1529 M. Thomas Grammaye, conseiller et général de ses monnaies, pour faire étalonner un poids de deux marcs, dont on se servait alors pour étalons dans les monnaies de Flandre. Cet étalon s’étant trouvé trop fort de vingt-quatre grains par marc, fut réduit sur celui de la cour des monnaies, de quoi il fut tenu registre et fait procès-verbal par les officiers commis pour cette opération. Pour conserver la mémoire de cet étalonnement il fut fondu trois poids de laiton par ordre de François Ier, sur lesquels furent empreints d’un côté les armes du roi et de l’autre celles de l’empereur.
De ces trois poids ainsi étalonnés, l’un fut envoyé à l’empereur, l’autre à Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas, et le troisième fut présenté au roi par des députés de la chambre des monnaies. On joignit à ces trois poids trois procès-verbaux dressés le 13 aoῦt de cette même année 1529, l’un pour le roi, l’autre pour l’empereur et le troisième pour la chambre des monnaies.
En février 1756, eut lieu un nouvel étalonnage pour le gouvernement des Pays-Bas.
Enfin, le 3 décembre 1760, vérification fut pareillement faite sur le poids original de France du marc d’Angleterre étalonné et vérifié à la cour de Londres, apporté à la chambre des poids de la cour des monnaies par le sieur Tillet, de l’Académie royale des sciences, ci-devant directeur de la monnaie de Troyes; le marc d’Angleterre de douze onces, poids de Troyes qui est celui d’usage en Angleterre, s’est trouvé plus fort d’un gros deux grains que celui de France. (Aboz De Bazinghem, Traité des monnaies, art. Étalons et Poids de marc.)
Ces étalonnages n’accusent-ils pas une tendance à l’uniformisation des poids et mesures, tendance que l’adoption d’un nouveau système en désaccord complet avec les systèmes en usage a contrariée au lieu de la favoriser?
[4] Au nombre des critiques les plus judicieuses qui aient été faites du système métrique, nous citerons celle qui parut dans la Revue d’Édimbourg à l’occasion de la publication du rapport sur les opérations de la mesure de l’arc du méridien de Dunkerque à Barcelone par MM. Mechain et Delambre. Tel était cependant l’engouement dont ce système était l’objet, que l’écrivain de la Revue d’Édimbourg, après en avoir signalé les défauts, à la vérité d’une manière incomplète, finit par exprimer des vœux en faveur de l’universalisation des poids et mesures métriques. La traduction de cet article a été publiée dans la Bibliothèque britannique. On nous saura gré d’en reproduire les principaux passages.
“Il est à remarquer que, dans le nombre de nos idées les plus claires, il y en a quelques-unes que ni le langage ni aucun symbole arbitraire quelconque ne peuvent jamais exprimer. Il en est ainsi de certaines idées de quantité; tandis que d’autres, qui ne sont ni plus claires ni mieux déterminées, se trouvent dans le cas contraire.
“Ainsi, par exemple, un homme ne peut donner à un autre la notion précise de la grandeur d’une ligne qu’en la comparant à une ligne déjà connue à l’un et à l’autre des deux individus; sans ce terme moyen de comparaison, tous les moyens ordinaires de communication sont en défaut, et il faut en venir à montrer la ligne elle-même. Il n’en est pas ainsi lorsqu’on connaît ou le rapport ou la position angulaire des grandeurs qu’il est question de désigner; alors la communication verbale peut suffire, et il n’est point nécessaire de recourir à l’exposition des objets eux-mèmes. Nous savons ce qu’un géomètre ancien entendait par un angle droit ou par un angle d’un degré aussi bien que si nous avions sous les yeux un cercle divisé par quelque ouvrier d’Athènes ou d’Alexandrie. Nous savons aussi ce qu’il entend lorsqu’il parle du rapport de deux à un, ou de la diagonale d’un carré à son côté; mais, s’il veut désigner une certaine longueur individuelle, un pied par exemple, un spithame ou un stade, nous ignorons ce qu’il entend à moins qu’il n’ait rapporté cette mesure à quelque étalon commun, demeuré le même dans tout l’intervalle qui a séparé les temps anciens des modernes.
“Cet inconvénient a été ressenti de tout temps, et l’on a essayé d’y remédier en se servant de mesures rapportées à des objets d’une certaine fixité.
“Le pied qu’on trouve comme étalon de mesure chez presque toutes les nations a pour origine la longueur du pied humain, et il est ainsi variable dans des limites qui ne sont pas très rapprochées. On a eu quelquefois recours à d’autres étalons que l’on supposait plus exacts. Chez quelques peuples agricoles, on a déterminé le pouce par la longueur de trois grains d’orge rangés bout à bout, et, chez quelques tribus vagabondes d’Arabie, le diamètre d’un certain nombre de crins de cheval juxtaposés a fourni un échantillon du même genre. On a considéré, chez quelques peuples, une goutte d’eau comme l’unité de poids; chez d’autres, c’est un grain de froment qui l’a représentée; et c’est là sans doute l’étymologie de l’expression actuelle. Quelques auteurs ont voulu nous persuader que les anciens, dans leurs efforts pour trouver un étalon de mesures, avaient été beaucoup au delà de ces tentatives grossières. Paucton prétend, dans sa Métrologie, que la circonférence ou le diamètre de la terre était le terme de comparaison auquel ils rapportaient toutes leurs mesures de longueur. Bailly a soutenu cette opinion avec le génie et les connaissances dont il a fait preuve dans tous ses ouvrages, et il cherche à persuader que le stade a toujours été considéré comme faisant une aliquote exacte de la circonférence du globe, quoique l’étendue indiquée sous ce nom ait été différente chez divers peuples et pour divers auteurs. Mais on ne parviendra par aucun effort de génie à donner à cette supposition un certain degré de probabilité.
“Les anciens n’avaient aucun moyen de déterminer avec quelque précision l’étendue de la grande unité à laquelle on suppose que ces mesures se rapportent. Si une comparaison de ce genre eῦt existé, elle n’aurait certainement pas pu leur être inconnue à eux-mêmes: cependant nous savons bien que ni Aristote, ni Possidonius, ni Pline, ni aucun des auteurs anciens qui ont cherché à établir la dimension du globe n’ont imaginé que la différence entre leurs propres assertions à cet égard et celles des autres écrivains n’était qu’apparente, c’est à dire qu’en s’accordant avec eux sur la grandeur absolue du globe, chacun ne différait des autres que sur la lougueur de la mesure qu’il employait pour désigner cette étendue.
“On doit au fertile génie du célèbre Huyghens le premier essai qui ait été fait pour établir un étalon de mesure qui fῦt à la fois exact et universel pour tous les lieux et tous les temps. Ce physicien a démontré que les temps des vibrations des pendules dépendent seulement de leur longueur, et que, quelle que soit sa structure, on peut trouver dans le pendule un certain point qui, dans les pendules dont les oscillations se font dans le même temps, est toujours à la même distance du centre de suspension. Il a conclu de cette propriété que le pendule pourrait fournir une unité ou un étalon pour les mesures de longueur, et, quoiqu’il fallῦt lui appliquer une correction parce que la force de gravitation n’est pas la même dans toutes les latitudes, Huyghens ne doute point que la science ne fournît les moyens de déterminer cette correction avec une exactitude suffisante. Picard adopta cette idée, et Cassini, dans son ouvrage De la grandeur de la terre, proposa une autre unité, prise aussi dans la nature, mais moins facilement: c’était la six millième partie d’une minute de degré d’un grand cercle de la terre. Avant lui, Mouton avait imaginé quelque chose de semblable, mais on n’avait point songé à prendre l’un de ces étalons pour base d’un système régulier de mesures qui pῦt s’adapter aux besoins de la science comme à ceux de l’économie publique et domestique, et l’on ne voyait que confusion et perplexité dans les poids et les mesures en usage dans toute l’Europe. Dans chaque sorte de mesure, on admettait des unités d’étendue différente; elles étaient divisées avec peu d’exactitude, et on les comptait diversement dans un méme pays. On éprouvait partout ces inconvénients, on s’en plaignait, on proposait des remèdes, mais on ne cherchait jamais sérieusement à les appliquer. La France était à cet égard dans la même situation que les autres nations; mais il n’était pas probable qu’un système, qui n’avait en sa faveur que l’autorité des temps anciens et l’inactivité du temps présent, pῦt lutter longtemps contre l’esprit de réforme qui devint si général dans ce pays au commencement de la révolution. Indépendamment des objections réelles qu’on pouvait faire au système des poids et mesures, il avait le malheur de paraître lié à toutes les abominations du régime féodal: on résolut donc de l’abolir. . .
“On eut en vue deux objets principaux dans la réforme proposée. Le premier fut de se procurer un étalon naturel pour les mesures linéaires, et par conséquent pour toutes les autres quantités; le second d’appliquer au calcul de ces mesures le même système arithmétique qu’on emploie dans les autres calculs. Il fallait dans ce but adopter, pour l’unité de mesure, la division décimale, et trouver dans les multiples ou sous-multiples décimaux de cette unité toutes les autres mesures que l’usage rend nécessaires; les fractions ordinaires devaient être ramenées à l’expression décimale et on devait ainsi obtenir le grand avantage de réduire à une seule et même échelle arithmétique les entiers et les fractions de toute espèce; avantage tellement évident, si facile à obtenir qu’il y a lieu de s’étonner qu’on n’ait essayé de s’en prévaloir qu’environ mille ans après que l’arithmétique décimale elle-même a été introduite en Europe.
“Mais, en parlant de cette réforme, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que les académiciens français, quoique se soulevant alors ainsi que tous leurs compatriotes sous cette inertie qui commande aussi puissamment le monde moral que le monde physique et qui donne au passé tant d’influence sur l’avenir; quoique délivrés d’une manière presque absolue de l’action de cette force, les Français, disons-nous, peuvent être accusés cette fois de s’être arrêtés trop tôt dans la carrière des innovations, et d’avoir essayé avec trop de timidité d’abandonner une pratique établie, il est vrai, mais qui n’avait pas la raison pour elle. Nous voulons parler du système de l’échelle arithmétique, dans laquelle ils ont conservé le système décimal au lieu de lui substituer le duodécimal qui, d’après la nature des nombres, lui aurait été si évidemment préférable. La théorie, nous le croyons, ne laisse aucun doute à cet égard; et un être raisonnable, appelé à construire, sans aucun préjugé ni habitude préalable son système de numération, n’hésiterait pas à choisir le duodécimal et à le préérer non seulement au décimal, mais probablement à tout autre. Le nombre 12 est divisible par 2, par 3, par 4 et par 6; cette propriété le rend si propre aux calculs arithmétiques qu’on l’a considéré dans tous les temps comme le plus convenable à adopter pour faciliter les subdivisions de l’unité de poids ou de mesure.
“On peut citer en preuve l’as, le libra, le jugerum, le pied, dont les divisions ont été duodécimales; et cet avantage, qui n’a point échappé dès les premiers temps, se serait trouvé plus évident à mesure que le perfectionnement des sciences arithmétiques aurait multiplié les occasions de l’apprécier. Il est probable que le nombre dix n’a été choisi comme racine du système décimal que parce qu’il exprime l’ensemble des doigts de l’homme. Ceux qui considèrent la science comme fille de la pure raison doivent s’indigner de ce qu’une considération aussi mécanique, et qui lui est tout à fait étrangère, ait déterminé la forme et l’ordre de l’une des sciences les plus intellectuelles et les plus abstraites.
“C’est surtout dans la division du cercle que l’échelle duodécimale se serait trouvée de beaucoup préférable au système décimal, qui est sujet dans ce cas à de fortes objections. Le nombre qui exprime la circonférence du cercle devrait non seulement être divisible par quarts sans fractions, comme il l’est dans le système français, mais aussi en six parties, car la sixième de la circonférence ayant sa corde égale au rayon, doit être naturellement exprimée par un nombre entier, tant sous le rapport de la construction des instruments que sous celui des calculs de la trigonométrie. Dans la division décimale du quart de cercle, non seulement la sixième partie de la circonférence n’est pas un nombre entier, mais la fraction décimale qui doit l’exprimer est continue et sans terme. Voilà au moins une sorte de difformité qui provient de l’admission stricte de la division décimale; et c’est là peut-être la principale source de la difficulté qu’on a éprouvée à l’introduire dans les calculs trigonométriques et astronomiques [5]. L’admission du nombre 12 pour racine de l’échelle arithmétique aurait levé toutes ces difficultés. . .
“Mais, pour en revenir à l’étalon de mesures naturel et universel, nous devons remarquer que le projet de l’établir et de faire cesser la diversité de poids et de mesures fut l’un des premiers objets dont s’occupa l’assemblée constituante. M. de Talleyrand y proposa et il fut décrété que” le roi serait supplié d’écrire à Sa Majesté britannique pour engager le parlement d’Angleterre à concourir avec l’assemblée nationale dans le but de fixer une unité naturelle de poids et de mesures, et pour que, sous les auspices des deux nations, un nombre égal de commissaires appartenant à l’académie des sciences et à la société royale de Londres déterminassent ensemble la longueur du pendule dans la latitude de 45 degrés ou sous tel autre parallèle qu’on croirait plus convenable, afin d’en déduire un étalon invariable de mesures et de poids. “L’Académie nomma une commission composée de Borda, Lagrange, Laplace, Monge et Condorcet, et leur rapport est imprimé dans les mémoires de l’Académie pour 1788. Ces savants examinent trois unités différentes; la longueur du pendule à secondes, le quart du méridien et le quart de l’équateur. Si l’on se décide pour la première de ces quantités, les commissaires croient que le pendule, qui bat les secondes dans la latitude de 45°, doit être préféré parce qu’il est la moyenne arithmétique entre les pendules à secondes sous toutes les autres latitudes. Mais ils observent que la détermination du pendule dépend d’un élément hétérogène, c’est à dire du temps, et d’une autre quantité qui est arbitraire, savoir la division du jour en 86,400 secondes. Ils paraissent donner la préférence à une unité de longueur qui ne dépende point d’une quantité étrangère à sa nature, et que rien d’arbitraire ne contribue à déterminer.
“Les commissaires sont donc amenés à discuter lequel, du quart de l’équateur ou de celui du méridien, mérite la préférence. Ils se décident pour le dernier comme plus accessible et comme plus susceptible d’être mesuré avec précision. On le choisit en conséquence pour unité fondamentale, et on adopte pour unité des mesures linéaires la dix millionième partie comme étant une longueur convenable dans la pratique. On décide en même temps qu’il convient d’abandonner l’ancienne division du cercle en 360°, d’adopter la division décimale pour le quart de sa circonférence, c’est à dire de diviser ce quart en 100 degrés au lieu de 90, et d’appliquer aux nouveaux degrés la subdivision décimale au lieu de la sexagésimale.
“On nous permettra de remarquer, àl’égard de la détermination fondamen tale, que les motifs qui font rejeter le pendule ne nous paraissent pas complétement satisfaisants. L’objection tirée de l’hétérogénéité de l’élément du temps est, selon nous, trop abstraite et trop métaphysique pour devoir être prise en considération dans une question purement pratique. L’élément arbitraire, introduit par la division du jour en secondes, formerait une objection plus réelle, si elle ne portait pas avec une égale force sur l’unité même qui a été adoptée: car cet étalon n’est pas le quart du méridien, mais la dix millionième partie de ce quart, et dix millions est sans doute un nombre tout aussi arbitraire et aussi éloigné d’être indiqué par aucune apparence ou aucun phénomène naturel que 86,400, nombre de secondes adopté pour la division du jour. Ce dernier nombre même nous semble avoir plus d’un phénomène naturel en sa faveur. On sait que le battement du pouls de l’homme en santé et parvenu au milieu de sa carrière est fort rapproché de 60 pulsations par minute, c’est à dire de 86,400 par jour. Le pas ordinaire dans les manœuvres militaires se rapproche fort de cette même durée; et celui du voyageur, en comptant les pas de la même jambe, est encore d’une seconde de temps, à très peu près.
“Il faut convenir que, quelque étalon qu’on adopte, on est toujours forcé de lui appliquer quelque division arbitraire que la convenance décide, sans égard à la nature même de la chose. Soit que nous prenions le quart du méridien ou le rayon du globe, ainsi que Cassini l’avait anciennement proposé pour l’unité à laquelle toutes les mesures doivent être rapportées, la portion de cet étalon que nous pouvons convertir en une verge de laiton ou de platine pour la conserver dans nos musées, ou pour l’employer aux mesures actuelles, sera toujours l’objet d’une détermination arbitraire. L’unité réelle, l’étalon pratique est soumis à la même condition, et cela ne doit point contribuer à l’adoption on au rejet d’une quantité linéaire que d’autres considérations présenteraient comme unité convenable.
“On pourrait même objecter au choix qui a été fait qu’il y a dans l’unité adoptée quelque chose de pire qu’un élément arbitraire, c’est à dire une détermination hypothétique et à quelques égards incertaine. Ce n’est point le quart du méridien dans toute son étendue qui est l’objet de la mesure immédiate; on déduit son étendue totale d’une opération partielle et d’après la supposition que le méridien est une ellipse et que le rapport des deux axes est bien connu. On suppose encore que les méridiens sont des courbes semblables et égales, c’est à dire que, dans quelque partie du globe qu’on mesure un arc du méridien, le quart qui en résultera aura la même étendue. Or, on sait bien que ces suppositions ne sont pas vraies en rigueur; et ce qui est bien plus essentiel encore, on sait qu’il faut mesurer non seulement un très grand arc, mais plusieurs grands arcs de méridiens pour obtenir une quantité moyenne passablement exacte. Sous tous ces points de vue, il nous semble que le pendule à 45° aurait mérité une préférence décidée: cette détermination ne dépend d’aucune théorie, d’aucune au moins sur laquelle il reste le moindre doute; on peut la vérifier dans tous les temps; la nature tient toujours là le prototype avec lequel on peut comparer nos étalons, et qui peut les faire retrouver s’ils avaient été détruits par quelque catastrophe. (BibliothÈque britannique, Sciences et arts, t. XXXV, année 1807.)”
Ces observations au sujet du choix de la mesure de l’arc du méridien de préférence à celui du pendule sont assurément des mieux fondées; mais la mesure de l’arc du méridien était de nature à frapper davantage les esprits, et elle avait en outre l’avantage de procurer de l’ouvrage aux savants qui n’étaient pas moins que les autres travailleurs victimes de la crise révolutionnaire. Mechain et Delambre furent chargés de l’opération, et ils commencèrent cette œuvre plus fastueuse qu’utile dans l’été de 1792. Leurs opérations furent maintes fois entravées par l’hostilité des populations, et plus encore par la dépréciation des assignats qui fit déserter leurs aides. Ils réussirent néanmoins à les mener à bonne fin, et un peu plus tard MM. Biot et Arago furent chargés de les compléter, en poursuivant jusqu’aux îles Baléares la mesure de l’arc du méridien.
Cependant l’adoption du système métrique provoqua des plaintes telles de la part des populations auxquelles on l’imposait sans aucun égard pour leurs convenances et leurs habitudes, que Napoléon fut sur le point d’y renoncer, et que les anciennes mesures ont dῦ être légalement tolérées jusqu’en 1840. Elles l’ont été également en Belgique jusqu’en 1855; mais, à partir de cette époque, on les a rigoureusement proscrites; si rigoureusement que la Gazette de Liége, ayant annoncé dans l’hiver de 1859-60 que “par suite des dernières pluies le niveau de la Meuse s’était élevé de plusieurs pieds,” elle fut condamnée à l’amende pour avoir contrevenu à la loi du ler octobre 1855, imposant l’emploi exclusif des poids et mesures métriques.
Lors de la présentation de cette loi vexatoire, inspirée comme bien d’autres par le mauvais génie de la contrefaçon, l’auteur de ce livre a publié dans l’Eacute;conomiste belge la première protestation radicale qui ait été faite contre le système métrique. Quoique insérée en forme de Variétés et à l’abri d’un pseudonyme, cette protestation n’en a pas moins excité l’indignation la plus vive chez les partisans fanatiques d’un système si mal à propos considéré comme le nec plus ultra du progrès en matière de poids et mesures.
La voici:
“C’est à la France que nous avons emprunté le système métrique, et s’il faut en croire nos voisins, ce système, une des plus belles acquisitions de 89, est infailliblement destiné à faire le tour du monde. Voilà pourtant soixante années que cette belle acquisition a été faite, et hormis le peuple français et deux ou trois autres qui ont la mauvaise habitude de le contrefaire, nul ne s’est soucié d’abandonner son vieux système de poids et mesures pour le nouveau. Comment cela se fait-il? Envie, routine, préjugés nationaux, répondent en chœur les propagateurs du kilomètre, du centilitre et du décagramme. On ne veut pas du système métrique, parce que c’est une invention française, voilà tout! Est-ce bien sῦr? Peut-on citer un seul exemple, un seul, d’une invention utile qui ait été repoussée, sous le prétexte qu’elle était française, anglaise ou chinoise? Le bateau à hélice est une invention française; n’a-t-il pas été adopté par tous les peuples navigateurs de l’Europe? Les chemins de fer et la télégraphie électrique sont anglais; cela les a-t-il empêchés de faire le tour du monde? Si le système métrique était vraiment une invention utile, s’il constituait un progrès réel, n’aurait-il pas été adopté déjà, spontanément, comme l’ont été l’hélice, les chemins de fer et le télégraphe électrique par tous les peuples de la terre?
“Mais je nie que le système métrique soit une invention utile, je nie qu’il constitue un progrès réel, et, n’en déplaise aux auteurs du projet de loi que la chambre va, sans aucun doute, adopter à l’unanimité, je suis convaincu qu’on finira par l’abandonner partout, même en France. Et voici sur quoi mon opinion se fonde:
“La commission de l’Académie des sciences qui a inventé le système métrique des poids et mesures, comme elle a inventé un peu plus tard, le calendrier républicain, une autre innovation destinée à faire le tour du monde! la commission de l’Académie des sciences, dis-je, a fondé ce beau système sur l’axiome que voici: l’unité pour chaque espèce de mesure est arbitraire. Mathématiquement, cela peut être vrai, commercialement c’est une lourde erreur. Or, c’est de commerce qu’il s’agit lorsque l’on pèse ou que l’on mesure une marchandise en vue de l’échanger, et non point de mathématiques. On choisit avant tout un poids ou une mesure en harmonie avec la nature particulière de la marchandise qu’il s’agit de peser ou de mesurer. On ne s’avise point, par exemple, de prendre pour la tourbe et le charbon de terre la même unité de poids que pour le diamant. On choisit ensuite l’unité que l’expérience démontre être la plus commode, c’est à dire, selon toute apparence, celle qu’on demande le plus. C’est la fraction la plus communément demandée d’une marchandise quelconque qui finit partout et toujours par servir d’unité pour le pesage ou le mesurage de cette marchandise. L’unité de poids ou de mesure n’est donc pas arbitraire, comme l’ont affirmé les têtes mathématiques de l’Académie des sciences. Elle ne l’est pas plus que l’unité de temps, en dépit de leur calendrier républicain. Elle est indiquée par la nature des choses. Cela est si vrai, que les étalons de poids adoptés séparément, sans aucun accord, par le plus grand nombre des nations de l’Europe ne diffèrent pas d’une manière essentielle. Vous en jugerez par le tableau, suivant que j’emprunte à l’article Poids et mesures du Dictionnaire de l’économie politique, article dῦ à un savant ingénieur, M. Dupuit, dont le bon sens proteste contre le système métrique, mais que le préjugé finit toutefois par y ramener:
Pords de l’étalon en kilog. Autriche, . . . . . . . . . . . . Bavière 0,56 Bohëme . . . . . . . . . . . . 0,51 Francfort . . . . . . . . . . . . 0,50 Danemark, Hanovre, Hollande . . . . . . 0,49 Hambourg, Suisse, France ancienne . . . . . . 0,48 Espagne, Prusse, Saxe . . . . . . . . . . . . 0,46 Angleterre, Portugal . . . . . . . . . . . . 0,45 Russie . . . . . . . . . . . . 0,41 Sardaigne (donze onces) . . . . . . . . . . . . 0,36 États de l’Église, Toscane (douze onces) . . . 0,34 “L’unité de poids, cette unité que l’Académie prétendait étre arbitraire, est donc à peu près la même partout. D’où cela vient-il? Cela vient de ce que les besoins de l’alimentation, qui provoquent la demande de la plupart des objets de la consommation usuelle, sont aussi partout à peu près les mèmes. De là, la quasi uniformité de l’étalon des poids et des mesures chez les nations les plus diverses. Mais l’Académie des sciences se composait de mathématiciens, de physiciens et d’astronomes, non de négociants ou d’économistes. Elle prit, en conséquence, pour base de son système, non les besoins des hommes, mais la circonférence de la terre, d’une part, le poids de l’eau distillée de l’autre, et le système métrique, convenablement émaillé de dénominations grecques, selon la mode du temps, fut offert au monde comme l’une des plus merveilleuses inventions du génie humain. Quand je dis offert, je me trompe, c’est imposé que je devrais dire: partout, en effet, où pénétrèrent les baïonnettes, porteuses des idées de 89, le kilogramme, le décagramme, le gramme, sans parler du reste de la famille, furent imposés aux ménagères ahuries par tant de grec. Et quel grec? Un savant helléniste ne s’est-il pas avisé de prétendre que les parrains du système ne connaissaient pas le premier mot de la langue d’Homère? Que kilomètre, par exemple, n’avait jamais signifié mille mètres, mais, ô savants, dressez les oreilles! mesure d’une bourrique.”
“Les dénominations ne font toutefois rien à l’affaire. La question est de savoir si le système et sa nomenclature en grec de cuisine sont commodes ou non, si les transactions s’en trouvent facilitées ou rendues plus difficiles. Eh bien! que nos législateurs se donnent la peine de convoquer dans leurs bureaux un certain nombre de ménagères et de cuisinières, et ils ne tarderont pas à être pleinement édifiés sur ce point. Gageons que sur dix personnes appartenant à cette classe intéressante, qui est chargée de pourvoir à la consommation journalière des familles, ils n’en trouveront pas une qui connaisse suffisamment les poids et mesures dont la loi prescrit l’usage. Gageons que les questionneurs eux-mêmes seraient fort embarrassés si on les mettait à leur tour sur la sellette. Les ménagères, les cuisinières, sans parler des législateurs, connaissent cependant la livre, la demi-livre, le quarteron et l’once, c’est à dire les vieux poids; comment donc se fait-il qu’ils ne s’accoutument point aux nouveaux; que leur intelligence refuse de s’assimiler le kilogramme, ses divisions et ses subdivisions? Cela tient simplement à ce que le vieux système, fondé sur l’expérience, est simple et commode, tandis que le nouveau, fondé sur la mesure de la terre (pourquoi pas aussi bien sur la mesure de la lune?) est horriblement compliqué et quasi inapplicable. Qu’en résulte-t-il? Que le système métrique donne lieu à des fraudes de toute sorte; que les acheteurs, et surtout les acheteuses qui ne le comprennent pas, sont obligés de s’en remettre à la bonne foi du marchand, et que celui-ci fait son beurre à leurs dépens. Le système métrique n’est en réalité qu’un instrument de fraude, et il le serait bien plus encore si on ne l’avait un peu corrigé en le greffant tant bien que mal sur celui auquel on l’a brutalement substitué. Écoutons encore à ce sujet M. Dupuit:
“Il est commode de dire que le fret du Havre à Bordeaux est de 6 fr. par tonne: on dirait encore qu’il est de fr. 0 06 par kilogramme; mais on ne dirait pas qu’il est de fr. 0,000,006 par gramme, qui est la véritable unitè de poids du système décimal. La tonne, si commode pour l’armateur, serait fort incommode pour les achats de comestibles: on ne peut pas exiger raisonnablement que la ménagére demande un demi-millième de tonne de beurre. Pour venir à son secours, on a consenti à ce qu’elle en demandàt cinq hectogrammes ou cinq cents grammes. Mais aucun des marchés qu’elle a à conclure n’exige qu’elle descende jusqu’au gramme; c’est à peine si elle se soucie du décagramme. Aussi qu’a-t-elle fait? Du kilogramme, elle a fait le kilo, le demi-kilo: c’est sur le demi-kilo que sont basés les prix de presque tous les comestibles: le demi-kilo a été divisé par le boucher et l’épicier en cinq hectos et l’hecto en demihecto et quart d’hecto, et le système métrique s’est arrangé comme il a pu. S’il s’agit de payer maintenant ce demi-kilo de beurre, le système métrique veut qu’on s’exprime en centimes et qu’on dise 85 centimes au lieu de 17 sous. Ainsi voilà notre ménagère qui, ayant acheté trois objets, l’un à 85 centimes, l’autre à 35 centimes et le dernier à 45 centimes, est obligée de tirer un agenda pour faire l’addition de ces trois chiffres formidables qui, convertis en sous, présentent un calcul simple et facile, qu’elle peut faire de tête. Aussi le sou est-il resté, malgré sa proscription officielle.”
“Je n’ajouterai rien à cette citation que j’emprunte à un partisan du système métrique. Elle démontre suffisamment, je pense, ce que vaut dans la pratique ce système tant prôné. Mais, dira-t-on, que demandez-vous donc? Voulez-vous supprimer le système metrique? A Dieu ne plaise. Je demande seulement qu’au lieu de l’appliquer à toutes choses et de le rendre obligatoire, on cesse de l’imposer. Je demande qu’on permette aux acheteurs et aux vendeurs de se servir des poids et des mesures qui leur paraissent le plus commodes; je demande la liberté des poids et mesures, voilà tout. Maintenant, s’il est vrai que le système métrique soit, comme l’affirment ses partisans, le plus parfait des systèmes; s’il est vrai qu’il existe entre la mesure du méridien terrestre et le poids du beurre, du sucre ou du café, un rapport mystérieux et ineffable; s’il est vrai que le kilogramme, le décagramme et le gramme soient autant supérieurs à la livre, au quarteron et à l’once, que le chemin de fer peut l’être à la diligence ou au coucon, et le télégraphe électrique au vol des pigeons messagers, le système métrique ne subsistera-t-il pas quand même? ne triomphera-t-il pas aisément de ses rivaux? Que si, au contraire, c’est, dans la pratique, un système faux, incommode et absurde, un système qui met chaque jour l’ignorance à la merci de la friponnerie, un système qui ne facilite guère que les petites rapines et les menus vols, ne doit-on pas souhaiter qu’il disparaisse au plus vite?
“On objectera l’inconvénient de la diversité des poids et mesures. C’est un inconvénient, soit! comme la diversité des langues et des patois en est un autre. Mais n’est ce pas un inconvénient plus grand d’employer un système ou une langue uniforme qu’on ne connaît point ou que l’on connaît mal, que de se servir de plusieurs systèmes ou de plusieurs langues que l’on connaît bien. Qu’un utopiste, ayant à sa disposition un nombre suffisant de baïonnettes s’avise d’imposer au monde l’unité de langue; et qu’afin de ne causer aucune jalousie entre les 3 à 4,000 dialectes qui sont actuellement en usage sur la surface de notre globe, il confie à l’Académie des inscriptions et belleslettres le soin de fabriquer exprès une langue nouvelle, dont il se chargera ensuite d’imposer l’emploi, croit-on de bonne foi qu’il en résultera un accroissement de facilités dans les communications des individus et des peuples? En admettant même que la langue académique fῦt aussi parfaite que possible, s’adapterait-elle également à tous les besoins, à toutes les intelligences, à tous les gosiers? Ce serait une cacophonie universelle, n’est-il pas vrai, une nouvelle tour de Babel, et chacun finirait inévitablement par retourner à sa langue ou à son patois.
“Que le gouvernement nous laisse donc peser et mesurer nos marchandises à notre guise, comme il nous laisse parler notre langue ou notre patois; qu’il vérifie les poids et les mesures en les ramenant, si bon lui semble, à l’étalon du système métrique, mais qu’il cesse de nous imposer une invention saugrenue dont il ne serait plus question depuis longtemps, si l’on eῦt écouté votre serviteur.
“Free Weight.”
[5] On a vu plus haut que l’ancienne division a décidément prévalu.
[6] Pour bien comprendre, dit M. John Stuart Mill, les fonctions multiples de l’intermédiaire circulant, ce qu’il y a de mieux à faire, c’est d’examiner les divers embarras que nous éprouverions si cet intermédiaire n’existait pas. Le premier et le plus évident de ces embarras serait le défaut de mesure commune pour les valeurs de différentes sortes. Un tailleur qui n’auraît que des habits et qui aurait besoin d’acheter du pain ou un cheval, aurait bien de la peine à savoir combien il obtiendrait de pains contre un habit et combien il lui faudrait donner d’habits en échange d’un cheval. Il faudrait recommencer le calcul sur des données différentes chaque fois qu’il s’agirait d’échanger des habits contre diverses marchandises, et il n’y aurait point de prix courant ou de cote régulière des valeurs. Au contraire, aujourd’hui toute chose a son prix courant en monnaie, et on lève toutes les difficultés en comptant, par exemple, un habit 4 ou 5 liv. st. et un pain de 4 livres 6 ou 7 pence. Comme il est plus facile de comparer les diverses longueurs, lorsqu’elles sont exprimées en pieds et pouces, selon l’usage ordinaire, il est plus facile de comparer les diverses valeurs en les exprimant couramment en livres, shellings et pence. Il n’y a pas d’autre moyen de faire une échelle des valeurs diverses, pas d’autre moyen de calculer la somme d’une fortune particulière, et il est bien plus facile de se rappeler le rapport de valeur des diverses marchandises à une seule que les rapports complexes qu’elles ont entre elles. (John Stuart Mill. Principes d’économie politique, liv. III, chap. VII. De la monnaie.)
Dans une société commerçante, dit encore Storch, il y a un grand nombre de marchandises, et il importe aux commerçants d’évaluer le prix de chaque marchandise, non seulement par rapport à telle autre, mais par rapport à toutes les autres. Le marchand russe de Kiakhta, par exemple, est intéressé à savoir non seulement combien une archine de son drap vaut de thé, mais encore combien elle vaut de porcelaine, de rhubarbe, d’encre de Chine, de papier, de nankin, etc.; le marchand chinois est dans le même cas. Si le premier n’a jamais troqué son drap contre ces marchandises, il ne peut parvenir à connaître leur prix relativement au drap que par le prix d’autres marchandises qui ont été échangées non seulement contre ces marchandises, mais aussi contre du drap. Mettons qu’une archine de drap s’échange ordinairement contre quinze livres de cuivre et que cette quantité de cuivre puisse s’échanger contre une pièce de mankin: le prix du cuivre relativement à ces deux marchandises présenterait alors un terme de comparaison pour les évaluer entre elles, et il s’ensuivrait qu’une archine de drap pourrait s’échanger contre une pièce de nankin ou qu’elle la vaudrait.
Vous voyez que ce procédé exige autant de termes de comparaison qu’il y a de marchandises en circulation et que, si quelqu’une de ces marchandises n’était pas échangée contre deux autres mais seulement contre une seule, elle ne pourrait point servir de terme de comparaison.
Ces difficultés d’évaluer le prix des marchandises ont fait sentir à toutes les nations commerçantes la nécessité d’un terme commun de comparaison pour toutes les valeurs, comme il faut pour réduire les fractions un dénominateur commun sans lequel on ne pourrait s’entendre. (Storch. Cours d’économie politique, t. ler, ch. VIII.)
L’homme chargé d’évaluer 100 articles divers serait obligé, à défaut de cette mesure commune, de retenir en mémoire 4,950 proportions différentes, c’est à dire  , tandis que 99 lui suffisent désormais. (J. G. Schultze, cité par G. Roscher. Principes d’économie politique, Ch. III.)
, tandis que 99 lui suffisent désormais. (J. G. Schultze, cité par G. Roscher. Principes d’économie politique, Ch. III.)
[7] Il paraît néanmoins que le bétail a rempli quelquefois l’office de monnaie.
“Les historiens de l’époque saxonne en Angleterre, dit M. Blanqui, parlent souvent d’une monnaie vivante (living money) qui était autorisée par la loi et qui consistait à payer en esclaves et en bétail (Catle) toute espèce de marchandises, mises en circulation. Plus tard, à mesure que la monnaie reparut on n’admit plus la monnaie vivante que pour solder les appoints; et dans ce cas les chevaux, les bœufs, les vaches, les moutons et les esclaves ne pouvaient être donnés en paiement que d’après une estimation convenue. Les amendes imposées par l’État ou par l’Église furent seules exceptées et payables à volonté, soit en écus soit en êtres vivants. Il faut rendre néanmoins cette justice à l’Église, que pour décourager le commerce des esclaves, elle finit par refuser d’en accepter aucun en paiement. Le docteur Henry nous a laissé une histoire d’Angleterre dans laquelle se trouvent plusieurs évaluations curieuses du prix correspondant de la monnaie vivante à la monnaie de nos jours. D’après ses calculs, le prix du tarif pour un esclave était, en 997, d’environ 70 fr.; d’un cheval 45 fr.; d’une vache 8 fr.; d’un mouton 1 fr 50. (Blanqui, Histoire de l’Économie politique. T. Ier, p. 400.)
[8] La livre sterling est cependant de tous les étalons monétaires celui qui s’est le moins déprécié.
“Les monnaies anglaises, dit M. Michel Chevalier, n’ont éprouvé d’altération forte que pendant un espace de trois siècles, surtout dans l’intervalle occupé par le règne de Henri VIII, prince dissipateur et sans frein, et la première partie de celui de son fils Édouard IV.
La monnaie anglaise resta pendant près de deux siècles et demi, telle que l’avait instituée Guillaume le Conquérant: la livre pesant d’argent à un titre assez élevé était l’unité monétaire. L’an 1300, le roi Édouard Ier l’affaiblit légèrement. Édouard III, de 1344 à 1363, lui fit subir trois diminutions successives qui cependant lui laissèrent encore plus des quatre cinquièmes de sa teneur première. Henri IV, en 1412, et Édouard IV, en 1464, lui portèrent de nouvelles atteintes, et à l’avénement d’Henri VIII, qui eut lieu au commencement du seizième siècle, elle avait perdu près de la moitié de son poids de fin. Ce prince, qui était violent et sans scrupules, faussa quatre fois la monnaie dans un intervalle de dix-neuf ans, de 1527 à 1546. La livre sterling, telle qu’il l’avait trouvée ferait une livre et onze shellings en monnaie actuelle ou plutôt en monnaie de 1816. En 1546, elle se trouva réduite par ce prince à 9 shell. environ. Son fils Édouard VI l’abaissa encore de moitié, la troisième année de son règne. Mais deux ans après il la releva; sa sœur Marie, qui lui succéda, persévéra dans les mêmes errements, et Élisabeth, par une proclamation solennelle, qui date de la deuxième année de son règne (1560), qualifia l’habitude de la fausse monnaie comme un monstre dévorant qu’elle mettait son honneur à vaincre, ce qui ne l’empêcha pas cependant, quarante et un ans plus tard, de diminuer la livre quelque peu, d’un trente et unième. A partir de ce moment, la monnaie anglaise n’a plus subi d’altération. Elle a été ainsi diminuée de près des deux tiers. Quelque grand que soit l’abaissement en termes absolus, il est très faible en comparaison de tout ce qui a été fait ailleurs. A côté de l’Angleterre, l’Écosse, de 1296 à 1601, a réduit la livre d’argent au trente sixième de son poids.
C’est pour cette cause que la livre anglaise, primitivement fixée par Guillaume le Conquérant à une livre pesant d’argent, de même que Charlemagne l’avait fait en France, a conservé une valeur bien supérieure à la livre des autres contrées.
. . . C’est en 1816 que se fit la substitution de l’or à l’argent comme étalon reconnu par la loi. (Michel Chevalier. De la baisse probable de l’or, p. 136.)
“Tant que le gouvernement fait frapper des monnaies sans retenir les frais de monnayage, les pièces de monnaie ont une valeur égale à celle de tout autre morceau du même métal d’un poids et d’une finesse pareils. Mais si le gouvernement retient un droit de monnayage ou de seigneuriage, la pièce de métal frappée excédera en général la valeur de la pièce non frappée de tout le montant de ce droit.
Quand l’État seul bat monnaie, il ne peut pas y avoir de limites à ce droit de monnayage; car, en restreignant la quantité du numéraire, on peut en élever la valeur indéfiniment.
C’est en vertu de ce principe que circule le papier-monnaie. Toute sa valeur peut être regardée comme représentant un seigneuriage. Quoique ce papier n’ait point de valeur intrinsèque, cependant si l’on en borne la quantité, sa valeur échangeable peut égaler la valeur d’une monnaie métallique de la même dénomination ou de lingots estimés en espèces. C’est encore par le même principe, c’est à dire en bornant la quantité de la monnaie que des pièces d’un bas titre peuvent circuler pour la valeur qu’elles auraient eue si leur poids et leur titre étaient ceux fixés par la loi et non pour la valeur intrinsèque du métal pur qu’elles contiennent. Voilà pourquoi, dans l’histoire des monnaies anglaises, nous trouvons que notre numéraire n’a jamais été déprécié aussi fortement qu’il a été altéré. La raison en est qu’il n’a jamais été multiplié en proportion de sa dépréciation. (Ricardo, Principes de l’Économie politique, chap. XXVII. De la monnaie et des banques.)
Il existe toutefois en Angleterre une légère différence entre la valeur du métal monnayé et celle du métal en lingots. Storch, l’un des écrivains qui ont le mieux entendu les questions monétaires, explique fort bien la cause de cette différence.
Quand, dit-il, le gouvernement se charge des frais de fabrication de la monnaie, il est clair qu’il empêche que la valeur du métal-monnaie ne s’accroisse de la valeur de sa façon. . . Ainsi, dans les pays où tout le monde peut échanger de l’or ou de l’argent, poids pour poids, contre de la monnaie, a façon de la monnaie n’a point de valeur, et le métal monnayé ne vaut pas plus que le métal en lingots.
Si quelquefois le contraire paraît arriver, c’est toujours l’effet d’une circonstance accessoire. En Angleterre, par exemple, l’or monnayé se paie environ 2/5 p. c. plus cher que l’or en lingot; mais pour changer son lingot en guinées à l’hôtel des Monnaies de Londres, le seul qu’il y ait en Angleterre, il faut attendre son tour: ainsi c’est une perte de temps que vous évite celui qui vous paie comptant, et cette légère prime de 2/5 p. c. est une sorte d’escompte qu’il retient pour l’avance qu’il a faite. . . Les frais de fabrication de la monnaie d’or reviennent à 7/10 p. c.. Ainsi cette prime de 2/5 fait un peu plus de la moitié des frais. Si l’on pouvait se procurer plus facilement cette monnaie, la prime ne serait plus que d’un tiers ou d’un quart des frais de fabrication.
La loi qui rendit la fabrication des monnaies gratuite fut d’abord portée sous le règne de Charles II, pour un temps limité; ensuite, par différentes prorogations, elle fut continuée jusqu’en 1769, époque à laquelle elle fut rendue perpétuelle. (H. Storch. Cours d’économie politique, t. VI, liv. V, ch. IX.)
Cette méthode (la gratuité du monnayage) a encore été adoptée deux fois en France mais sans s’y maintenir longtemps. La fabrication des monnaies y a été gratuite, d’abord sous le ministère de Colbert, pendant dix ans (de 1679 à 1689), et ensuite pendant la Révolution depuis le 9 frimaire jusqu’au 26 germinal an IV. (J.-B. Say. Traité d’économie politique, t. ler, p. 442.)
[9] Nous citerons comme témoignage à l’appui, non seulement de cette vérité particulière mais de la théorie générale que nous exposons, l’autorité de Ricardo.
[10]
“Si anciennement divers seigneurs, dit Abot de Bazinghem, barons et évêques avaient droit de battre monnaie, c’est que sans doute ce droit leur avait été cédé avec la jouissance du fief ou qu’ils le possédaient à titre de souveraineté, ce qui sous les deux premières races fut souffert dans le temps faible de l’autorité royale, temps où s’établit le genre d’autorité nommé suzeraineté, espèce de seigneurie que le bon droit eut tant de peine à détruire, après que le mauvais droit l’eut usurpée si facilement.
En 1262, l’ordonnance sur le fait des monnaies porte” que, dans les terres Où les barons n’avaient pas de monnaie, il n’y aura que celle du roi qui y aura cours et que, dans les terres où les barons auraient une monnaie, celle du roi aura cours pour le même prix qu’elle aurait dans ses domaines.”
“Philippe le Bel força le premier les hauts seigneurs à vendre leur droit de battre monnaie, et l’édit de 1313 gêna si fort la fabrication qu’ils y renoncèrent.
Philippe le Long voulait quand il mourut, dit le président Henault, faire en sorte que dans la France on se servît de la même monnaie et à rendre les poids et les mesures uniformes. Louis XI eut depuis le même désir.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. Ier, p. 403, art. Espèces.)
L’ordonnance de 1262, relative aux monnaies des seigneurs, se résumait dans les injonctions suivantes:
- “1° Que les monnaies des seigneurs seraient dorénavant fabriquées des deux côtés, différentes de celles du roi;
- “2° Que, dans les lieux où il n’y avait point de monnaie particulière, nulle antre n’aurait cours que celle du roi, à commencer à la fête de saint Jean 1263, et que, dans les lieux où il y avait des monnaies particulières, celle du roi aurait aussi cours;
- “3° Que les parisis et les tournois, quoique usés, ne laisseraient pas d’avoir cours, pourvu néanmoins qu’on pῦt les connaître, tant du côté de croix que de pile, que le roi les prendrait en paiement et qu’ils auiaient cours dans ses monnaies;
- “4° Que celui qui rognera les monnaies du roi sera puni corporellement et ses biens confisqués.”
Voici quelques renseignements complémentaires sur le même sujet empruntés au Traité des monnaies de Bettange:
“A l’égard du droit que plusieurs princes ou seigneurs de France avaient de battre monnaie, l’ordonnance de Philippe le Bel du 15 juin 1313 porte qu’à cause des abus qui se commettent dans les monnaies des seigneurs par leurs officiers, qu’il ne courrait plus dans leurs terres que la monnaie du roi et la leur: item, il est défendu aux prélats, barons et autres d’allégier ou empirer leurs monnaies, du prix de loi, du point de l’état ancien, et, s’ils font le contraire, ils auront dorénavant leurs monnaies forfaites à toujours; que chacune des monnaies de ces seigneurs aurait un garde de pour le roi à ses frais, afin qu’il veille à ce qu’il ne se commette ni abus ni malversation.
Louis le Hutin, successeur de Philippe le Bel, fit une ordonnance le 17 novembre 1315, par laquelle il voulait priver de ce droit tous les seigneurs qui en jouissaient, mais il n’en put venir à bout tant à cause des remontrances et difficultés qui lui furent faites par ces seigneurs que du peu de durée de son règne qui ne fut que de 19 mois et quelques jours.
Philippe le Long, qui lui succéda, commença à exécuter ce dessein en 1319 par les monnaies de Chartres et d’Anjou, qui appartenaient à Charles de Valois, son oncle, qui lui furent ôtées moyennant la somme de cinquante mille livres qui lui furent payées comptant par ordre de ce roi.” (De Bettange, Traité des monnaies, t. Ier, p. 71.)
Sous Louis XI, la ligue du Bien public fut provoquée par une défense que ce roi, grand monopoleur comme on sait, fit au due de Bretagne de battre de la monnaie d’or.
“Le roi Louis XI, dit Abot de Bazinghem, ne voulant plus souffrir ce que la nécessité et les circonstances du temps avaient fait tolérer à ses prédécesseurs au préjudice des droits de la couronne, envoya son chancelier au duc de Bretagne lui signifier entre autres choses que s’il continuait à faire battre la monnaie d’or il lui déclarerait la guerre. Cette déclaration ou d’autres causes qu’on peut voir dans l’histoire de ce temps furent l’occasion d’une guerre à laquelle les ennemis du roi donnèrent le nom spécieux de Bien public. Elle fut terminée par le traité fait au bois de Vincennes le Ier octobre 1465. Une des conditions du traité fut que le duc de Bretagne pourrait faire battre monnaie d’or à son coin. Le roi lui en fit expédier lettres le même mois, lesquelles furent registrées au parlement et à la chambre des monnaies. Dans ces lettres le roi reconnaît que les prédécesseurs du duc de Bretagne ont joui du droit de faire fabriquer monnaie d’or, blanche et noire. Le roi permettait par ces mêmes lettres le cours de ces monnaies par tout le royaume, en gardant quant à l’or le poids et le titre selon les ordonnances royaux. Sans doute, la nécessité de séparer ses ennemis arracha au roi cette permission.” (Abot De Bazinghem, t. II, p. 177.)
Citons enfin quelques réflexions caractéristiques du même écrivain sur le pouvoir de battre monnaie:
Le pouvoir de battre monnaie appartient de droit aux rois, aux princes souverains et aux républiques. Une invention si nécessaire et si utile eῦt été facilement corrompue si chaque particulier eῦt eu la liberté de s’en servir. Il est vraisemblable qu’au commencement ce pouvoir fut déféré aux anciens et aux chefs des familles qui avaient les autres prérogatives; que les familles étant accrues et les communautés qui en étaient composées se soumettant à la conduite d’un chef, lui attribuèrent aussi ce droit, joignant le pouvoir de battre et de régler la monnaie à celui de commander, étant très juste que ce qui était la base du commerce et le prix de toute chose reçῦt sa valeur et son autorité de celui qui devait être le dépositaire et le protecteur de l’intérêt public: c’est pourquoi ce droit est estimé de sa nature incommunicable. D’autres cependant en ont joui sans être souverains, mais ils avaient quelque dignité attachée à leur personne, tels que les prélats, dues, comtes, barons, les communautés et les villes, soit par usurpation, usage, possession immémoriale ou par concession des souverains, qui ont toujours conservé, en l’accordant, des marques de dépendance, soit en donnant le titre, le poids et la forme des espèces, soit en se réservant le jugement de leur bonté ou obligeant d’y faire graver leurs effigies, leurs armes ou d’autres preuves de concession qui n’a jamais été générale pour toutes sortes de métaux. L’or a presque toujours été excepté comme le plus précieux: la permission de l’employer n’a été accordée que très rarement, et l’on punit rigoureusement ceux qui le font sans autorité.” (Abot De Bazinghem, art. Argent, t. Ier, p. 58.)
[11]
Les villes capitales des provinces et les villes les plus considérables, comme Paris, Rouen, Rheims, Lyon, Soissons, Marseille et autres avaient des fabriques de monnaies fixes et ordinaires: s’il y avait dans les provinces des lieux avantageux par leur situation, ou pour le commerce, comme des châteaux, castra, des maisons publiques, ville publicœ regiœ, des ports de mer comme Quentovic, Dorestat aujourd’hui Utrecht et autres, on y établisait de même des fabriques de monnaies qui étaient sous la direction des ducs ou des comtes des villes: la tête du roi était gravée d’un côté avec son nom ou celui du duc ou du comte, ou celui du monétaire seulement. Sur le revers on gravait une eroix et autour le nom de la ville, ou du château ou de la maison publique. Il y avait encore une monnaie dans le palais où le roi faisait sa principale résidence et les espèces qui y étaient fabriquées avaient pour légende: monela palatina. Le monétaire ou l’intendant de cette monnaie l’était ordinairement de celle de la ville capitale où était situé le palais. La preuve en est sur les pièces de monnaie de Dagobert, dont quelques-unes ont la même légende, moneta palatina et pour nom du monétaire Eligius. D’autres ont pour légende: parisina civitate et pour monétaire le même mot Eligius. Cette monnaie suivait le roi dans tous ses voyages, et lorsqu’il résidait en quelque lieu où l’on avait la commodité de fabriquer, les espèces n’avaient plus pour légende: moneta palatina, mais le nom du palais ou maison où le roi était alors, comme Carisiaco, Banniaciaco, Catoiaco, Viriliaco et ces palais ou maisons royales étaient des séjours ordinaires, où les ouvriers portaient des coins préparés, auxquels il ne fallait ajouter que la légende; la tête et le revers y étaient déjà gravés. Les ouvriers et les officiers de cette monnaie étaient commensaux de la maison royale. La cour des monnaies de Paris a conservé ce privilége. (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. II, p. 91, art. monnaie.)
[12]
La livre de poids avait deux divisions, selon qu’elle était employée à peser les métaux et les autres marchandises de grande valeur, ou les marchandises communes.
Dans le premier cas, elle était divisée en deux marcs, chaque marc en huit onces, chaque once en huit gros, chaque gros en trois deniers, chaque denier en vingt-quatre grains. Soit en totalité 9,216 grains, lesquels représentaient environ le poids d’un grain de blé, unité qui paraît avoir servi originairement à constituer l’étalon de poids.
Dans le second cas, les divisions n’avaient pas besoin d’être poussées si loin: chaque livre se divisait en deux demi-livres, chaque demi-livre en deux quarterons, le quarteron en deux demi-quarterons, le demi-quarteron, en deux onces, et l’once en deux demi-onces.
On pouvait ainsi peser les matières précieuses, avec des poids allant jusqu’à la 9,216e partie d’une livre, et les marchandises communes avec un poids allant seulement jusqu’au 32e, soit la demi-once.
Les poids dits de marc, dont on se servait sous l’ancien régime étaient ordinairement fabriqués en cuivre; les autres en fer ou en plomb. (Abot De Bazinghem. Dict. des monnaies, art., livre.)
[13] Voici la définition que donne Abot de Bazinghem du mot traite:
“Traite, en terme de monnaie, se dit de tout ce qui s’ajoute au prix naturel des métaux qu’on emploie à la fabrication des espèces, soit pour les remèdes de poids et de loi, soit pour les droits de seigneuriage et de brassage; il signifie plus que le rendage qui ne comprend que le seigneuriage et le brassage.
On se sert encore de ce terme quand on fait fabriquer une si grande quantité de billon et de cuivre, qu’on le fait entrer dans le commerce au lieu de bonnes espèces.
Traite se dit encore de la quantité de matières qu’on retient en nature dans les hôtels des monnaies à ceux qui y portent des matières destinées à être converties en monnaies; c’est sur quoi se prennent les frais de fabrication qu’on appelle brassage et le bénéfice du prince qu’on nomme seigneuriage.
On entend aussi par ce mot la différence du prix à la valeur ou entre ce que les matières converties en monnaie produisent et ce qu’elles ont été payées.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies.)
Voici encore un ensemble de renseignements que nous empruntons au même écrivain sur le seigneuriage:
“Seigneuriage, en terme de monnaie, s’entend du droit qui appartient au prince pour la fabrique des monnaies. On l’appelle quelquefois monnoiage du mot de la basse latinité monetagium et quelquefois aussi rendage et traite; c’est pour le paiement de ce droit que l’on a en partie inventé l’alliage, c’est à dire le mélange des autres métaux avec l’or et l’argent dans la fabrique des monnaies.
Ce droit que tous les princes de l’Europe lèvent sur les monnaies qu’ils font faire était non seulement inconnu aux anciens, mais même aux Romains. On ne prenait pas sur leurs monnaies les frais de la fabrication; l’État les payait, de façon qu’un particulier qui portait une livre d’or fin à la monnaie recevait 72 sols d’or fin qui pesaient une livre. Ainsi l’or et l’argent en masse ou convertis en monnaie étaient de la même valeur.
Il est difficile de marquer quand les rois ont commencé à lever ce droit; nous n’avons trouvé sur cet objet rien de plus ancien que l’ordonnance de Pépin de l’an 755, lors du parlement tenu à Verneuil, par laquelle il ordonna que les sols d’argent ne seraient plus taillés que de vingt-deux à la livre de poids, et que de ces vingt-deux pièces le maître de la monnaie en retiendrait une et rendrait les autres à celui qui avait fourni l’argent. De monetá constituimus similiter ut amplius non habeat in librá pesante nisi 22 solidos, et de ipsis 22 solidis, monetarius habeat solidum unum, et illos alios domino cujus sunt reddat.
Il est à croire que les rois de la première race en avaient usé de même, n’étant pas vraisemblable que Pépin eῦt osé, dans le commencement de son règne, imposer un nouveau tribut sur les Français qui venaient de lui donner la couronne.
Dans ce qui nous reste d’ordonnances des rois de la seconde race pour les monnaies, il n’est fait aucune mention de ce droit; cependant la donation que Louis le Débonnaire fit à saint Medard de Soissons du pouvoir de battre monnaie fait voir que l’on en tirait quelque profit; il y est dit qu’il leur accorde ce droit pour être employé au service qui se faisait chez eux en l’honneur de saint Sébastien. Monetam publicam cum incudibus et trapezetam perpetuo famulatu sacris ipsius sancti Sebastini deservituram subdidit.
Charles le Chauve accorda le même privilége aux évêques de Langres. Il paraît par les termes de cette concession que la monnaie produisait quelque utilité à ceux qui avaient droit de la faire battre, ad utilitatem jam prædictarum Ecclesiarum earumque rectoris provisionem volumus pertinere.
Enfin ce droit de seigneuriage est clairement marqué dans une donation que Charles le Simple fit à la chapelle de Saint-Clément de la dixième et neuvième partie du revenu qu’on appelle monéage, de la monnaie qui se fabriquait dans le palais de Compiègne, de monetá ejusdem palatii decimamet nonam partem.
Sous la troisième race, Henri Ier donna à saint Magloire la dixième partie de tous les revenus qu’il tirait de marino portu masteriali castri, excepté la dixième de la monnaie qu’il avait déjà accordée à quelque autre.
Ce droit qui, comme nous l’avons dit, s’appelait quelquefois monetagium, est encore prouvé dans un bail que Philippe-Auguste fit l’an 1202 de la monnaie de Tournai. Nos habebimus tertiam partem monetagii quod inde exiet.
Les seigneurs particuliers qui jouissaient du droit de faire battre monnaie en France levaient aussi cette taxe sur leurs monnaies.
Nous ne pouvons établir bien précisément en quoi elle consistait.
Depuis Pépin, qui prenait la vingt-deuxième partie de douze onces, nous ne trouvons point ce que ses successeurs jusqu’à saint Louis prirent sur les monnaies pour leurs droits de seigneuriage et pour les frais de la fabrication.
Ces droits ont tant varié dans tous les règnes, même sous ceux où les monnaies n’ont point été affaiblies et où elles ont été bien réglées, qu’il est difficile de dire à quoi ils montaient.
Sous Philippe-Auguste il était du tiers de tout le profit que l’on tirait de la monnaie.
Saint Louis régla le seigneuriage et le brassage à la seizième partie du prix du marc d’argent et l’or à proportion.
Ce que saint Louis leva sur les monnaies peut servir en quelque façon de règle, puisque toutes les fois qu’elles tombèrent dans le désordre sous ses successeurs, les peuples demandèrent toujours qu’on les remît au même état qu’elles étaient de son temps.
Ce prince avait fixé le prix du marc d’argent à cinquante-quatre sols, sept deniers tournois et le faisait valoir cinquante-huit sols, étant converti en monnaie, de sorte qu’il prenait sur chaque marc d’argent, tant pour son droit de seigneuriage que pour les frais de la fabrication, trois sols cinq deniers, c’est à dire quatre gros d’argent ou la seizième partie du marc. On prenait aussi à proportion un droit de seigneuriage sur les monnaies d’or. Le roi Jean prenait trois livres pour le seigneuriage et les frais de fabrication de chaque marc d’argent.
“Les rois se sont quelquefois départis du droit de seigneuriage, retenant seulement quelque chose pour les frais de fabrication, ainsi que fit le roi Philippe de Valois au commencement de son règne. “Toutes sortes de personnes, dit-il, porteront le tiers de leur vaisselle d’argent à la monnaie et seront payées sans que nous y prenions nul profit, mais tant seulement ce que la monnaie coῦtera à faire.”
“Il paraît, par une autre ordonnance du roi Jean, qu’il fit la même chose sur la fin de son règne; il s’explique ainsi en parlant des monnaies qu’il venait de fabriquer: Lesquelles avaient été mises à si convenable et si juste prix que le roi n’y prenait aucun profit, lequel il pouvait prendre, s’il lui plaisait, mais voulait qu’il demeurât au peuple.”
“Ce que les rois prenaient sur la fabrication des monnaies était l’un des principaux revenus de leurs domaines, ce qui a duré jusqu’à Charles VII. Le roi pouvait encore, lorsque le besoin de l’Etat le demandait, non seulement augmenter ce droit et lever de plus grosses sommes sur la fabrication des monnaies, mais même les affaiblir, c’est à dire en diminuer la bonté; on en trouve la preuve dans un plaidoyer fait en 1304 par le procureur de Philippe le Bel contre le comte de Nevers qui avait affaibli sa monnaie:
“Item. Abaisser et amenuiser la monnoie est privilége especial au roi de son droit royal, si que à lui appartient et non à d’autres, et encore en un seul cas, c’est à sçavoir en nécessité et lors ne vient pas le ganage ne convertit en son profit especial, mais au profit et en la defense d’au commun.”
“Sous la troisième race, dès que les rois manquaient d’argent, ils affaiblissaient leurs monnaies pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l’Etat, n’y ayant encore ni aides ni tailles. Charles VI, dans une de ses ordonnances, déclare qu’il est obligé d’affaiblir ses monnaies pour résister à notre adversaire d’Angleterre et obvier à sa damnable entreprise. . ., attendu que de présent nous n’avons aucun autre revenu de notre domaine dont nous nous puissions aider.”
“Les grandes guerres que les successeurs de saint Louis eurent à soutenir contre les Anglais les obligèrent souvent de pratiquer ce dangereux moyen pour avoir de l’argent. Charles VII, dans la grande nécessité de ses affaires, poussa l’affaiblissement si loin et leva un si gros droit sur les monnaies qu’il retenait les trois quarts d’un marc d’argent pour son droit de seigneuriage et pour les frais de la fabrication; il prenait encore une plus grosse traite sur le marc d’or; ce prince ayant chassé les Anglais du royaume, rétablit l’ordre dans ses monnaies. On lit dans un ancien manuscrit de ce temps que le peuple se ressouvenant de l’incommodité et des dommages infinis qu’il avait reçus de l’affaiblissement des monnaies et du fréquent changement du prix du marc d’or et d’argent, pria le roi d’abandonner ce droit, consentant qu’il imposât les tailles et les aides, ce qui lui fut accordé. Le roi se réserva seulement un droit de seigneuriage fort petit qui fut destiné au paiement des officiers de la monnaie et aux frais de la fabrication.
Dans un autre manuscrit sur la monnaie, qui paraît avoir été fait sous le règne de Charles VII, nous lisons oncque puisque le roi maist les tailles, des possessions des monnoies ne lui chault plus (ne se soucie plus). D’où nous inférons que l’imposition fixe des tailles et des aides fut substituée à la place d’un ancien tribut infiniment plus incommode que n’étaient alors ces deux nouvelles impositions.
Sous Louis XIII, le droit de seigneuriage était de 6 livres par marc d’or et de 10 sols 1 obole par marc d’argent; dans la suite ce droit fut fixé à 7 livres 10 sols par marc d’or.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, art. Seigneuriage.)
[14]
“Valeur, dit encore Abot de Bazinghem, en terme de monnaie, comprend trois choses, savoir le prix de la matière, le droit qui appartient au roi, appelé seigneuriage, et les frais de fabrication qu’on nomme brassage.
Le prix de la matière n’est pas fixe ni égal partout. Il dépend de la proportion qui se trouve entre l’or et l’argent qui est plus haute ou plus basse selon leur rareté; en quelques endroits, il faut plus d’argent pour payer l’or, il en faut moins en d’autres.
La valeur des monnaies peut bien augmenter ou baisser suivant la volonté du prince; mais leur véritable valeur, la valeur intrinsèque ne dépend que de leur poids et du titre du métal. C’est ordinairement sur cette valeur intrinsèque des espèces qu’elles sont reçues dans les pays étrangers, quoique dans les lieux où elles ont été fabriquées et où l’autorité souveraine leur donne cours elles soient exposées dans le commerce sur un prix beaucoup plus fort.
C’est en partie de la différence de ces deux valeurs, dont l’une est comme arbitraire et l’autre en quelque sorte naturelle, que dépend l’inégalité des changes qui haussent ou qui baissent suivant le prix pour lequel une espèce a cours, s’approche ou s’éloigne du juste prix du métal dont elle est faite.
Les monnaies ont donc deux sortes de valeurs, l’une fixée par l’autorité publique du législateur qui leur donne cours dans ses États sur un certain pied, l’autre fondée sur l’estimation qu’en font les négociants étrangers, en comparant la quantité de fin qu’elles contiennent par rapport aux espèces de leur propre pays.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. II, p. 703.)
[15] Nous complétons ces données sur la dépréciation de la livre monétaire en France par un nouvel emprunt au Traité d’Abot de Bazinghem. Nous citons de préférence cet écrivain, parce que son traité est une compilation bien faite des écrits fort estimables, mais un peu prolixes des Bouteroue, Leblanc, Henry Poullain et autres anciens écrivains. Pour le dire en passant, ces écrivains ont déployé souvent beaucoup de sagacité et de science en traitant la question des monnaies, et les modernes, qui étaient pour la plupart moins versés dans cette matière difficile, ne leur ont pas assez rendu justice.
“La livre de compte ou numéraire de France est composée de vingt sols qui se divisent chacun par douze deniers, mais nous n’avons pas d’espèce qui soit précisément de cette valeur.
“Il y a eu cependant des monnaies d’or et d’argent réelles qui ont valu justement une livre ou vingt sols, comme les francs d’or des rois Jean Ier et de Charles V, et les francs d’argent de Henri III, mais cette valeur n’a été que momentanée. Dans la suite leur prix a considérablement augmenté, ce qui n’arrive point à la livre numéraire qui ne change jamais de valeur, et qui depuis le temps de Charlemagne que nous nous en servons a toujours valu vingt sols et le sol douze deniers, et, quoique le prix des autres monnaies réelles ait changé souvent, on peut dire que la livre de compte et même le sol et le denier, qui en sont les parties, sont des monnaies imaginaires, puisque nous n’avons jamais eu d’espèces qui aient valu constamment vingt sols ou douze deniers. Cependant, en remontant au temps où l’on a commencé en France à compter par livres, on trouve que cette monnaie imaginaire doit son origine à une chose réelle; car sur la fin de la première race on se servait déjà du sol qui valait douze deniers; sous Charlemagne, on commença à se servir de la livre de compte valant vingt de ces sols de douze deniers.
“Pour bien entendre ceci, il faut savoir que pendant la première et la seconde race de nos rois, on ne se servait point pour peser l’or et l’argent du poids de marc composé de huit onces, mais de la livre romaine qui en pesait douze.
“. . . La livre de Charlemagne a conservé sa valeur intrinsèque jusqu’à la fin du règne de Louis VI, mais petit à petit les rois, dans leurs besoins, tantôt chargèrent les sols d’alliage, tantôt en diminuèrent le poids, de sorte que ce sol, qui était autrefois ce qu’est à peu près un écu d’argent, n’est plus qu’une légère pièce de cuivre avec une onzième d’argent tout au plus, et la livre qui était le signe représentatif de douze onces d’argent n’est plus en France que le signe représentatif de vingt de nos sols de cuivre. Le denier, qui était la cent vingt-quatrième partie d’une livre d’argent, n’est plus que le tiers de cette monnaie qu’on appelle un liard. En supposant donc qu’une ville de France dῦt à une autre cent vingt livres de rente, c’est à dire 1,440 onces d’argent du temps de Charlemagne, elle s’acquitterait aujourd’hui de sa dette en payant un écu de six livres.
La livre de compte des Anglais et celle des Hollandais ont moins varié. Une livre sterl. d’Angleterre vaut environ vingt-deux livres de France et une livre de compte hollandaise vaut environ douze livres de France; ainsi les Hollandais se sont écartés moins que les Français de la loi primitive, et les Anglais encore moins.
Table des réductions que la livre de Charlemagne a’souffertes jusqu’à présent, extraite de la table de M. Dernis. Liv. Sols. Deniers. Charlemagne depuis l’an 768 jusqu’en 1113 66 8 “ Louis VI et VII 1113 “1158 18 13 6 Philippe-Auguste 1158 “1222 19 18 4 4/5 Saint Louis et Philippe le Hardi 1222 jusqu’au 1226 18 4 11 Philippe le Bel 1226 “1285 17 19 “ Louis le Hutin et Philippe le Long 1285 “1313 18 8 10 Charles le Bel 1313 “1321 17 3 7 Philippe de Valois 1321 “1344 14 11 10 Le roi Jean 1344 “1364 9 19 2 2/5 Charles V 1364 “1380 9 9 8 Charles VI 1380 “1422 7 2 3 Charles VII 1422 “1461 5 13 9 Louis XI 1461 “1483 4 19 7 Charles VIII 1483 “1497 4 10 7 Louis XII 1497 “1514 3 19 8 François Ier 1514 “1543 3 11 2 Henri II et François II 1543 “1559 3 6 4 4/5 Charles IX 1559 “1574 2 18 7 Henri III 1574 “1589 2 12 11 Henri IV 1589 “1611 2 8 “ Louis XIII 1611 “1642 1 15 3 Louis XIV 1642 “1715 1 4 11 Louis XV 1715 “1720 “ 8 “ Depuis 1720 “1764 1 “ “ “On voit par cette table: 1° qu’en calculant d’après le prix actuel du marc d’argent de huit onces porté à 49 liv. 10 s., la livre de Charlemagne vaudrait aujourd’hui poids pour poids, titre pour titre, 66 liv. 8 s.
“Que notre livre d’aujourd’hui est en rapport avec 3 deniers 3/4 du temps de Charlemagne, et qu’un million du temps de cet empereur vaudrait 66,200,000 livres de la monnaie actuelle.” (Abot De Bazinghem, art. Livre.)
[16] Voir nos Questions d’économie politique et de droit public. — De la dépréciation de l’or, t. Ier, p. 305.
[17]
“Dans chaque État, lisons-nous dans le remarquable Traité des monnaies de Henry Poullain, conseiller à la cour des monnaics sous le règne de Louis XIII, dans chaque État, selon son étendue et fertilité, il doit y avoir certaine quantité de monnaie usuelle pour entretenir le trafic, lequel aucuns subdivisent en plusieurs façons; je n’en ferai ici que de deux sortes, afin d’en faciliter l’intelligence.
“L’un et premier est celui qui se fait chez l’étranger par les nôtres qui vont acheter de leurs marchandises et pour le payement desquelles ils leur portent nos bonnes espèces d’or et d’argent, principalement celles d’or, comme les plus estimées à présent par tous nos voisins. A celui-ci on peut ajouter le payement qui se fait des pensions étrangères, celles des ambassadeurs et autres semblables dépenses; comme pensions et voyages d’aucuns particuliers, pour lesquels nos dites espèces d’or et d’argent sont semblablement transportées hors de l’État.
“L’autre sorte de trafic est celui qui se fait dans l’État par les régnicoles mêmes et de marchand à marchand. A celui-ci, l’on doit comprendre le revenu ordinaire en argent de tous les particuliers y résidant, de quelle qualité ou condition qu’ils soient, comme baux de maisons, de fermes, arrérages de rentes, gages, pensions, appointements et autres revenus qui consistent en recettes et en dépenses.
“Pour entretenir ces deux sortes de trafic, faut que ledit État soit rempli, savoir pour celui qui se fait en dehors avec l’étranger de bonnes espèces d’or et d’argent, l’étranger ne faisant aucune estime de celles de billon ou cuivre, et pour celui qui se fait au dedans dudit État et entre les régnicoles, l’on se sert de la monnaie courante, pour bonne ou mauvaise qu’elle soit.
“Ainsi donc, en tout État, selon qu’il est grand, fertile et plein de denrées et marchandises nécessaires et utiles à la vie humaine, il doit aussi y avoir proportionnément certaine quantité d’espèces de monnaie, limitée, pour l’entretien du trafic et commerce qui se fait en icelui. Autrement les habitants y demeurant ne pourraient vendre aux leurs mêmes, ce qui leur serait utile, ni pareillement ne pourraient acheter de l’étranger ce qui leur serait nécessaire.
“Cette quantité d’espèces, autrefois, a été estimée en France de sept à huit millions de livres.” (Henry Poullain, Traité des monnaies, p. 63, 66).
[18]
“La diminution de l’approvisionnement monétaire par le frai ou l’usure des pièces est fort lente. Consultons à ce sujet un des hommes qui ont le mieux étudié la question des monnaies, M. Michel Chevalier.
“Des expériences fort soignées, faites en France sous la direction de MM. Dumas et de Colmont, sur un très grand nombre de pièces de 5 francs (400,000 pièces), interprétées ensuite, à l’aide des formules du calcul des probabilités, par M. Libri, ont conduit à cette conclusion que “la loi du frai paraît être uniforme, ou à fort peu de chose près, pendant toute la durée de la circulation des monnaies, et que l’on peut l’évaluer, pour les pièces de 5 fr. à 4 milligrammes par an et par pièce.” C’est 16 parties sur 100,000 ou 1 sur 6,250.
“Les expériences anglaises de la fin du dernier siècle faisaient ressortir le frai à peu près au même chiffre que celles de MM. Dumas et de Colmont, pour les couronnes dont les dimensions diffèrent peu de celles de nos pièces de 5 fr., mais à une fraction beaucoup plus forte pour les moindres pièces. Ainsi, pendant un intervalle de onze ans (de 1787 à 1798), les pièces anglaises d’argent de divers calibres, déjà usées au point de ne plus offrir d’empreinte, et par conséquent un peu moins exposées à souffrir du passage de main en main, avaient perdu comme il suit, en moyenne, chaque année:
Couronnes, 18 parties sur 100;000 ou 1 sur 5,643 Demi-couronnes, 173 — 1 — 577 Schellings, 456 — 1 — 219 Six pences, 286 — 1 — 350 (*) [19] La faiblesse du déchet des demi-schellings, comparée à celui des schellings, est ici une anomalie. Toutes les antres expériences autorisent à penser que plus les pièces sont petites et plus elles perdent.
“M. Jacob a tiré des expériences de 1826 la conclusion que la monnaie d’or perd annuellement un huit centième de son poids, et celle d’argent deux centièmes. Les expériences de 1807, d’après l’interprétation qu’il y donna, accuseraient un frai annuel d’un sur 1050, pour les pièces d’une guinée, et d’un sur 460 pour les demi-guinées.
“Quant à l’argent, prenant pour base le schelling, qui est la pièce la plus multipliée et la plus courante, il adopte la proportion de l sur 200 en nombre rond.
“Quant à l’or, la masse des demi-guinées n’étant que le dixième de celle des guinées, il adopte pour moyenne générale du frai, 1 sur 950.
“La monnaie éprouve d’autres pertes que le frai. Il s’en enfouit une certaine quantité; il s’en égare des pièces qui ne retombent plus entre les mains des hommes; la mer en absorbe, par les naufrages, de petites quantités. M. Mac Culloch a émis l’opinion que la quantité de métal précieux qu’une nation avait sous la forme de monnaie, était réduite d’un centième tous les ans. M. Jacob, dans ses recherches sur les quantités d’or et d’argent que chaque siècle avait léguées au suivant, depuis l’empire romain, sous Vespasien, jusques aux temps modernes, a admis une déperdition annuelle de l sur 360.
“. . .A ce compte, en écartant toute autre cause de disparition, un milliard serait réduit après un siècle, à 755 millions, après 500 ans à 140, après mille ans à 60 millions; ainsi une masse de monnaie qui aurait été de 5 milliards sous Constantin, et que le produit des mines eῦt absolument cessé d’entretenir, n’aurait plus été que de 300 millions sous le règne de Philippe le Bel.
“Si pour avoir égard à toutes les causes de disparition, l’on adoptait la loi de déperdition soutenue par M. Mac Culloch, de l p. c. par an, le phénomène serait encore plus tranché. Un milliard frappé à l’ouverture d’un siècle ne présenterait plus que 366 millions à la fin, et après 500 ans ce ne serait plus que la somme insignifiante de 6,600,000 fr.; cinq milliards qui auraient existé, comme je viens de le supposer, sous Constantin, n’auraient plus fait, sous Philippe le Bel, qu’une somme du genre de celle qu’une banque de second ordre a dans ses caisses en espèces.” (Michel Chevallier, Cours d’économie politique, t. III, la Monnaie, p. 129 et 332.)
[20] En général, les souverains investis du monopole du monnayage s’appliquaient à attirer les métaux précieux vers leurs hôtels des monnaies, et ils employaient dans ce but les procédés les plus variés. Tantôt ils frappaient de réquisition les métaux précieux, tantôt ils entravaient l’industrie des orfévres, qui en absorbait des quantités notables au détriment, pensaient-ils, du monnayage; tantôt ils prohibaient la sortie de l’or et de l’argent, et ils s’efforçaient d’en encourager l’importation.
Citons d’abord, d’après Bettange, quelques exemples de mise en réquisition des métaux précieux, et de limitation de la concurrence de l’orfévrerie pour la consommation de ces métaux.
“Henri Ier, dit Bettange, rendit une ordonnance en 1053 par laquelle tout particulier devait porter à la monnaie la vaisselle qui lui était superflue, laquelle lui serait payée sur le pied du prix courant, proportion gardée du titre qu’elle tiendrait.
“Philippe-Auguste confirma la même ordonnance en 1204, en défendant en outre aux orfévres de battre vaisselle qui pesât plus de 12 marcs.
“Philippe IV, dit le Bel, manquant de matière rendit une ordonnance le jeudi de devant Pâques fleurie en 1314, qui portait que ceux qui n’auraient pas 6,000 livres de rentes, fissent porter la troisième partie de leur argenterie à l’hôtel de la monnaie le plus prochain, qui leur serait payée selon le titre auquel elle se trouverait suivant l’évaluation du prix du marc d’argent fin, sous peine de perdre la moitié de celle qu’ils auraient cachée.
“Une autre ordonnance rendue en l’année 1310, le 20 janvier, interdit la fabrication de vaisselles d’or et d’argent excédant un marc. Le 12 juin 1313, il ordonna que nul orfévre ne travaillerait aucune vaisselle jusqu’à un an. Celle du ler octobre 1314 porte qu’il soit pris la quatrième partie des vaisselles d’or et d’argent du royaume, qui sera payée à prix raisonnable et défend aux orfévres de travailler pendant deux ans.
“Le même roi rendit aussi une ordonnance qui enjoignait à tous ses sujets qui n’auraient 2,000 livres parisis de rente, de faire porter à la monnaie la plus prochaine les pièces de vaisselle qui pèseraient plus de quatre marcs.
“Et, pour donner l’exemple, ce monarque envoya à la monnaie plusieurs gros effets en or massif, de même qu’une table d’argent, lesquels effets furent convertis en bonne monnaie à ses coins et armes.
“Philippe V, dit le Long, par son édit du 15 janvier 1315, défend aux orfévres de faire vaisselles jusqu’à deux ans sous peine de corps.
“Charles le Bel, par ordonnance du 11 mai 1322, défend à tous orfévres de faire des vaisselles d’argent excédant un marc, sinon pour le roi, sanctuaire, église, sous peine de confiscation des vaisselles et du corps à la volonté du roi.
“Philippe de Valois en 1330, 17 février, permet à Michel de Rams, orfévre de Paris, de travailler en vaisselle d’argent pour l’abbé de Saint-Denis en France, et de faire quatre douzaines d’écuelles de 12 plats pour le seigneur de Roye.
“Le même roi, le 25 mai 1332, défend à tous les orfévres de faire des vaisselles ni grands vaisseaux d’argent, ni hanaps d’or, si ce n’est pour calices ou vaisseaux à sanctuaire. Item que ceux qui auront au dessus de 12 marcs de vaisselle, porteront à la monnaie la troisième partie d’icelle, qui sera payée proportion gardée du titre qu’elle tiendra.
“Le comte de Saint-Paul obtint un mandement du roi en date du 23 aoῦt 1335, pour faire forger vaisselles d’argent jusqu’à 15 marcs.
“L’ordonnance du 23 aoῦt 1343, défend la fabrication de la vaisselle ou joyaux d’or ou d’argent, si ce n’est pour église, et par un autre du 21 juillet 1347, il est dit que nul orfévre ne pourra faire vaisselle d’argent que d’un marc et au dessous, sinon pour église.
“Le roi Jean Ier, dit le Bon, confirma l’ordonnance de son père Philippe de Valois du 21 juillet 1347, par celle du 25 novembre 1356, qui porte que nul n’ait à vendre aucune vaisselle d’or ou d’argent à aucun orfévre, mais au maître de la monnaie la plus prochaine.
“Cette ordonnance fut confirmée par celle du 10 avril 1361 du même roi, qui porte que nul orfévre ne pourra travailler aucune vaisselle sans un congé de nous ou de nos généraux maîtres des monnaies ni faire aucune ceinture d’or ni d’argent ni joyaux pesant plus d’un marc.
“Charles V, dit le Sage, par son ordonnance du 15 mai 1365, fait les mêmes défenses que celles du roi Jean, et en outre de ne vendre aucune matière d’or ou d’argent ni même vaisselle à aucun orfévre.
“Louis XII, surnommé le père du peuple, par son ordonnance du 22 novembre 1506, défend à tous orfévres de faire aucune vaisselle de cuisine, comme bassins, pots à vin, flacons et autres grosses vaisselles, sinon du poids de 3 marcs et au dessous sans sa permission vérifiée par les généraux maîtres des monnaies, ni de faire aucun ouvrage en or pesant plus d’un marc sans ses lettres patentes.
“Par lettres patentes du même roi en date du 25 janvier 1506, il fut permis à messire Levi, évêque de Mirepoix, de faire battre deux cents marcs de vaisselle d’argent.
“Du même jour il fut aussi permis à la comtesse de Dunois, cousine du roi, de faire travailler 50 marcs d’argent pour son usage.
“Le 15 février de la même année, pareilles lettres furent accordées au grand maître de Rhodes, de faire battre 72 marcs d’argent en vaisselle, et le même jour pareille permission fut donnée au seigneur de Threvolh, conseiller du grand conseil, de faire travailler 60 marcs d’argent; au sieur de la Chambre il fut permis d’en faire battre 80 marcs; au cardinal de la Trimouille il fut permis d’en faire battre 100 marcs en argent et 16 en or.
“François Ier, le 5 juin 1521, ordonna qu’il fῦt fait monnaie des emprunts qu’il avait faits de vaisselles d’argent de plusieurs notables de son royaume pour subvenir à ses guerres.
“Du 10 septembre 1521, défenses furent faites de faire vaisselle d’or et d’argent et autres ouvrages d’orfévrerie pendant six mois.
“Charles IX défendit au mois d’avril 1571 aux orfévres du royaume de faire de trois ans aucune vaisselle d’or ni d’argent excédant un marc et demi, et celle d’octobre de la même année défend de faire aucun ouvrage en or de quel poids que ce soit, ni vaisselle d’argent excédant deux marcs la pièce, sans une permission du roi enregistrée en la cour des monnaies.
“Louis XIII, par son édit du 20 décembre 1636, défend aux orfévres du royaume de faire à l’avenir aucun ouvrage en argent pour qui que ce soit, pendant un an au dessus du poids de 4 marcs, et en or au dessus de 4 onces, sans en avoir, pour ceux qui commanderont ces ouvrages, la permission spéciale du roi, par lettres patentes scellées du grand sceau, registrées en la cour des monnaies, sous peine de confiscation des ouvrages, de 500 livres d’amende et clôture de la boutique pour la première fois.
“Louis XIV a réitéré les mêmes défenses par son édit de 1645; mais à l’égard des ouvrages d’argent, il permet d’en faire jusqu’à 6 marcs.
“Par l’ordonnance du mois d’avril 1672, Sa Majesté défend toute sorte de travail d’or pour table de quel poids que ce soit. En argent, le poids est permis jusqu’à 12 marcs pour les bassins, pour les plats et toute vaisselle de table. Les grands ouvrages sont défendus, sous peine de confiscation, de 1,500 livres d’amende et de punition corporelle en cas de récidive.
“Sa Majesté a confirmé cette ordonnance par celle du mois de février 1687 qui défend à tous orfévres, marchands, ouvriers, etc., de fabriquer, vendre, exposer en vente, des sceaux, cuvettes, ni autres vases d’argent servant pour l’ornement des buffets, feux d’argent, brasiers, etc., à peine de 3,000 livres d’amende.
“Enfin, par édit du mois d’octobre 1689, il défend à tous orfévres, ouvriers et marchands de fabriquer, vendre, exposer en vente aucun ouvrage d’or excédant une once, à la réserve des croix d’archevêques, évêques, abbés et chevaliers; de ne vendre ni exposer en vente des effets d’argent comme brasiers, foyers, cuvettes, etc., sous peine de confiscation, de 6,000 livres d’amende pour la première fois et de punitions corporelles en cas de récidive, et enjoint Sa Majesté à ceux qui ont chez eux des effets en argent ci-dessus détaillés, de les faire porter à la monnaie la plus prochaine pendant le cours du même mois, sous pareilles peines, pour lesdits effets être convertis en espèces aux coins et effigies de Sa Majesté, et la valeur en être payée à raison de 29 livres 10 sols pour chaque marc de vaisselle plate et 29 pour chaque marc de vaisselle montée et marquée du poinçon, de Paris. A l’égard de celles qui ne sont point marquées dudit poinçon, elles seront fondues, essayées et payées suivant le rapport de l’essayeur.
“Il est aussi défendu, sous peine de confiscation et de 6,000 livres d’amende, a tous orfévres, ouvriers et marchands de travailler, exposer en vente ou débiter aucun ouvrage doré, si ce n’est pour ciboires et autres vases d’églises, ni argenter aucun ouvrage en bois ou en métal. Le roi a bien voulu faire porter à la monnaie les ouvrages qui servaient d’ornements à ses palais, pour les faire convertir en espèces à ses coins et armes.” (de Bettange, Traité des monnaies, t. Ier, p. 171–183.)
On pourra s’étonner du poids considérable des pièces de vaisselle et de bijouterie que les orfévres fabriquaient, au témoignage de ces ordonnances; mais il est bon de remarquer qu’autrefois les placements étant difficiles et peu sῦrs, chacun avait l’habitude de garder son épargne sous une forme durable. On bâtissait des maisons capables de résister à l’effort des siècles, on accumulait les provisions de linge, enfin on thésaurisait des métaux précieux sous toutes les formes. Comme les monnaies étaient faites trop souvent à bas titre, et qu’il était défendu de garder les espèces décriées, c’est à dire démonétisées, on thésaurisait de la vaisselle et des bijoux, ce qui permettait, en outre, de faire, dans certaines occasions, étalage d’un grand luxe.
Quel devait être le résultat des mesures prises pour empêcher les particuliers d’accumuler au delà d’une certaine quantité de métaux précieux sous forme de vaisselle ou de bijoux comme aussi pour les obliger, dans certaines circonstances, à les échanger contre une monnaie dépréciable? C’était de décourager l’épargne et de pousser précisément à ces dépenses de luxe que l’on semblait vouloir empêcher. Car nul ne gardait volontiers une monnaie à laquelle était attaché un risque intense de dépréciation. On se hâtait de s’en défaire, d’une manière ou d’une autre, et le capital de la société se trouvait diminué d’autant.
Cela n’empêche pas M. de Bettange de s’indigner fort de voir des gens de condition vile accumuler “au détriment du souverain et du public” vaisselle et bijoux.
“N’est-il pas affreux, s’écrie-t-il, dans un accès d’indignation, de voir de l’argenterie à un cordonnier qui devrait se ressouvenir que son corps venant de terre et devant s’y pourrir, il doit prendre sa nourriture dans des vases de terre. Et quelque chose de plus fort, c’est qu’on le voit, avec ses mains pleines de poix, tirer de dessous son tablier puant une montre d’or.” (Id., p. 188.)
Enfin, la défense de conserver plus d’une certaine quantité de vaisselle et de bijoux, les interdictions temporaires jetées sur le travail des orfévres, etc., avaient encore pour résultat de diminuer le débouché des métaux précieux, d’en rendre le commerce moins actif et plus chanceux, et par conséquent l’approvisionnement moins abondant et plus précaire.
Quoi qu’il en soit, ces mesures restrictives ou prohibitives auxquelles on recourait d’ordinaire pour assurer la levée des impôts extraordinaires sur la circulation jettent un jour nouveau non seulement sur les causes réelles de l’établissement de certaines lois somptuaires, mais encore sur l’origine du système protecteur. Nous nous moquons avec raison aujourd’hui de cette théorie des vieux écrivains de l’école mercantile qui attribuent à l’or et à l’argent le privilége de constituer seuls des richesses, et qui enseignent qu’un État doit pour s’enrichir attirer autant que possible les métaux précieux et augmenter la quantité de sa monnaie en circulation. Il est clair cependant qu’à une époque où le monopole du monnayage constituait la principale ressource du souverain, son intérêt devait consister à attirer les métaux précieux pour les transformer en monnaie, et il était naturel que les écrivains qui s’occupaient spécialement des moyens d’augmenter les ressources de l’État (et par ce mot on entendait le gouvernement) s’attachassent, avant tout, à ceux qui pouvaient rendre plus productif le monopole, d’où le souverain tirait la plus grande partie de ses ressources.
Le moyen qui devait sembler le plus efficace pour atteindre ce but, c’était la prohibition de la sortie des métaux précieux, et l’on ne manqua pas d’y recourir. Cependant, cet expédient devait, à la longue, aller à l’opposé du but que l’on se proposait d’atteindre, en détournant les métaux précieux d’un marché où ils étaient pris comme dans une souricière. On était donc conduit à chercher les moyens les plus propres à les forcer à y entrer. Quels étaient ces moyens? En suivant la logique du système, il fallait interdire l’entrée des autres marchandises, en accordant au contraire toutes facilités à l’importation des métaux précieux. Cela fait, ceux qui exportaient des produits du pays, ne pouvant en échange y importer des marchandises ordinaires, étaient bien obligés de se rabattre sur les métaux précieux, et le résultat se trouvait obtenu. Ce raisonnement était fondé, mais tous les gouvernements l’ayant fait de leur côté, et ayant en conséquence opposé des prohibitions à l’importation des marchandises ordinaires, il en était résulté que: 1° chacun s’attachant à décourager l’importation des marchandises ordinaires pour encourager celle des métaux précieux, l’exportation des marchandises ordinaires se trouvait, par là même, empêchée; 2° qu’alors que les prohibitions extéricures n’auraient pas entravé l’exportation des marchandises ordinaires, l’interdiction d’importer des contre-valeurs autres que les métaux précieux aurait produit un effet analogue. En effet, les articles d’exportation avaient beau trouver des débouchés au dehors, comme le nombre des articles qu’on pouvait prendre en retour était artificiellement limité, comme, d’une autre part, les matières d’or et d’argent, le seul de ces articles de retour qu’on pῦt importer librement, se trouvaient sur le marché en présence d’un monopole d’achat qui en abaissait artificiellement le prix, l’exportation ne pouvait avoir lieu qu’à la condition que les marchandises exportées fussent à un prix excessivement bas dans le pays, excessivement élevé au contraire à l’étranger, de manière à compenser la perte sur les retours. Les droits et les prohibitions sur les articles d’importation n’atteignaient pas seulement, comme on voit, les consommateurs de ces articles, mais ils équivalaient encore à une taxe sur les marchandises d’exportation.
Quels qu’aient été, du reste, les résultats de ce système, on en peut trouver, au moins pour une bonne part, les racines dans le monopole du monnayage.
[21] C’est ainsi que l’ordonnance de Philippe le Bel de mars 1304 défendit de vendre le setier du meilleur froment, mesure de Paris, plus de 40 s. parisis. Le setier des meilleures fèves et du meilleur orge plus de 30 s. parisis. Le setier de la meilleure avoine plus de 20 s. parisis. Le setier du meilleur son plus de 10 s. parisis.
“En 1418, le 15 mars, le blé fut si cher que le setier valut 8 francs, et environ huit jours à l’issue dudit mois fut crié par les carrefours de Paris que nul ne fῦt si hardi qu’il vendît blé seigle plus de 4 francs le setier, le meilleur setier de méteil plus de 60 s. parisis, le meilleur froment plus de 72 s. parisis et que nul moulnier ne prinst point de la mouture que argent, c’est à savoir 8 blancs pour setier et chacun bourgeois fit bon pain blanc, pain bourgeois et pain festiz à toute sa fleur et de certain dit ou cri. Quand les marchands qui alloient aux blés et les boulangers ouirent le cri si cessèrent de cuire et les marchands d’aller hors.” (DuprÉ De Saint-Maur, Essai sur les monnaies, p. 6 et 35.)
On pourrait citer encore de nombreuses ordonnances établissant le maximum, aux époques d’affaiblissements monétaires. Sous ce rapport donc comme sous bien d’autres, la révolution française s’est bornée à suivre les plus mauvaises traditions des plus mauvais jours de l’ancien régime.
[22] On se servait, par exemple, pour exprimer le nombre de pièces taillées dans un marc d’argent, ou pour être plus clair, fabriquées avec un marc d’argent fin, d’expressions techniques, qui demeuraient inintelligibles pour la masse du public.
“Au lieu de marquer simplement le nombre de pièces qu’il devait y avoir au marc, on le désignait par un compte de sols et deniers, et pour connaître ce nombre de pièces, il fallait réduire ces sols en deniers. Cette réduction faite, il y avait autant de pièces de monnaie au marc qu’il se trouvait de deniers. Ainsi dans le mandement du 23 novembre 1356, il est dit que les gros deniers blancs seront fabriqués à 6 sols 8 deniers de poids au marc, c’est à dire qu’il y aura 80 pièces au marc, parce que 6 sols valent 72 deniers, auxquels si on ajoute 8 deniers, il s’en trouvera 80. On ne sait quelle a été l’origine de cette manière de compter, qui est si ancienne que dans une charte d’Alphonse, comte de Toulouse, frère de saint Louis, il y est parlé d’une monnaie du poids de 14 sols et demi.” (Abot De Bazinghem, t. II, p. 149, art. Monnaie.)
Depnis le règne de Philippe le Bel jusqu’en 1467, on se servit encore des termes de monnais première, seconde, etc., que Dupré de Saint-Maur explique de la manière suivante
“Pour bien entendre ce que signifiaient les termes de monnaie première, seconds, troisième, quatrième, etc., il est à remarquer que le marc d’argent fin était toujours fictivement divisé en soixante pièces. Chacune des soixante pièces valait autant de deniers que le nombre donné pour la monnaie exprimait d’unités. Par exemple, lorsque la monnaie était vingt-quatrième, chacune des soixante pièces valait vingt-quatre deniers ou deux sols et les soixante ensemble faisaient six livres qui répondaient à la valeur du marc d’argent fin. Lorsque la monnaie était vingt-troisième, chacune des soixante pièces valait vingt-trois deniers ou un sol onze deniers, et les soixante ensemble formaient cent quinze sols pour la valeur du marc d’argent fin. Ainsi du reste.
“Ce qui signifiait en multipliant le nombre donné par cinq sols (60 deniers fictifs) que le marc d’argent fin produisait tant. “(DuprÉ De Saint-Maur, Essai sur les mosnaies, p. 121.)
[23]
“La variation des monnaies, dit à ce sujet Abot de Bazinghem, causait de grands dérangements dans les paiements. A mesure qu’elles baissaient ou qu’elles haussaient, ceux qui avaient fait des marchés, ceux qui avaient prêté de l’argent, ceux qui en devaient, etc., souffraient des pertes ou faisaient des gains, à proportion de ce que l’argent valait lorsqu’ils avaient contracté et du prix qu’il avait à l’échéance du terme des paiements. Ainsi un homme qui, pour prêter 6 livres, avait donné un marc d’argent qui valait alors ce prix, perdait la moitié de ce qu’il avait donné si on le payait lorsque l’argent valait 12 livres, car on ne lui rendait qu’un demi-marc d’argent; mais aussi il gagnait le double s’il avait fait ce prêt lorsque l’argent était à 12 livres et qu’on le payait lorsqu’il ne valait plus que 6 livres: c’était la même chose pour les débiteurs.
“Pour remédier à ces inconvénients, le public s’était accoutumé à ne plus contracter à livres et à sols; mais à marcs d’or ou d’argent, à florins ou autres espèces, c’est à dire, on ne disait pas: je vous prête cinquante livres en monnaies courantes et vous me rendrez dans un certain temps cinquante livres en monnaies qui auront cours alors; mais je vous prête tant de marcs d’or et d’argent, et vous m’en rendrez autant; je vous prête une certaine quantité de florins ou de bons gros tournois, et vous m’en rendrez le même nombre en nature. Ces sortes de contrats étaient une des raisons pour lesquelles le public conservait dans le commerce les monnaies décriées; on en avait besoin pour remplir les engagements que l’on avait pris, lorsque, en empruntant une certaine quantité d’espèces courantes, on s’était obligé de les rendre en nature. Ce fut apparemment pour lever l’obstacle que ces conventions apportaient à l’observation des mandements qui décriaient certaines espèces, qu’il fut défendu par l’art. III de l’ordonnance du 12 mars 1356 de faire des marchés et des contrats au denier d’or, au mouton ni à d’autres monnaies d’or et d’argent; mais seulement à sols et à livres, payables en monnaies qui auront cours, si ce n’est dans le cas des préts sérieux et véritables et des dépóts. Les parties qui passaient de ces actes prohibés et les notaires qui les recevaient devaient être mis à l’amende. “(Abot De Bazinghem, art. Monnaie.)
[24]
“Si les altérations successives, que se permettaient à l’envi tous les princes qui jouissaient du droit de monnayage, étaient pour eux la source de grands profits, elles étaient d’un autre côté fort dommageables à leurs sujets. Aussi, en Normandie, voulut-on arrêter le mal avant qu’il n’empirât encore, voulut-on empêcher que de nouveaux affaiblissements ne vinssent avilir davantage la monnaie. A cet effet, les États consentirent la levée d’un impôt triennal de douze deniers sur chaque feu, et moyennant cet impôt qu’on appela fouage ou monnéage, le duc promit de ne plus altérer ses monnaies. (Lecointre Dupont. Lettres sur l’histoire monétaire de la Normandie et du Perche).
Cet impôt fut, comme on le verra dans les notes suivantes, établi dans toute l’étendue de la monarchie.
M. Lecointre Dupont, signale au sujet de cet impôt et du droit qu’avaient les souverains de le lever, une dissertation curieuse de Nicolas Oresme, ancien précepteur de Charles V, et l’un des plus célèbres théologiens de l’université de Paris. Monté en 1377 sur le siége épiscopal de Lisieux, qu’il occupa jusqu’à sa mort, arrivée en 1382, il composa, dans cet intervalle, un traité philosophique fort remarquable sur les changements du cours des monnaies, pour démontrer qu’un prince ne peut, de son autorité privée, changer arbitrairement les monnaies ayant cours dans ses États, en régler la valeur à son gré et retirer de leur fabrication un bénéfice illimité [25] .
“Le prince, dit-il dans le XXIe chapitre de ce traité, ne pouvant faire tous ces changements, n’a droit à aucune indemnité pour s’abstenir de ces exactions illégitimes. Supposons néanmoins en fait, mais sans l’admettre en droit, qu’un prince eut le privilége de prélever un impôt pour faire la monnaie forte et la maintenir toujours au même titre, nous disons qu’il devrait perdre un pareil privilége au cas où il en abuserait en changeant et falsifiant sa monnaie, pour augmenter ses profits par une cupidité aussi basse que déloyale.”
[25] Ce MS. se trouve à la Bibl. de Poitiers. — Tractatus de mutationibus monetarum, editus à mag. Nicholao Oresme, sacr[ww] theologi[ww] professore.
On trouvera sur Nicolas Oresme de plus amples détails dans un savant mémoire de M. L. Wolowski, lu dans la séance publique annuelle des cinq académies du 14 aoῦt 1862 et publiè dans le Journal des Économistes, sous ce titre: Un grand Économiste francais du XIVe siècle, t. xxxv, p. 355.
[26] Enforcir la monnaie, c’est augmenter le fin de poids d’or ou d’argent, qui est en l’espèce.
La différence qui est entre les affaiblissements et les enforcissements est qu’aux affaiblissements la perte se continue et se répète toutes les fois que l’on fait un paiement, et aux enforcissements, au contraire, s’il y a perte, ce n’est que pour une fois, après laquelle l’augmentation de fin de poids d’or ou d’argent se continue et se répète autant de fois que l’on fait un paiement.
Il y a six sortes d’enforcissements de monnaies, de même qu’il y a six sortes d’affaiblissements. (Henry Poullain, Réponse à M. Godefroy.)
- 1° En augmentant le poids de l’espèce;
- 2° En augmentant leur bonté intérieure;
- 3° En rabaissant également le cours des bonnes espèces;
- 4° En les diminuant également ou ne les chargeant d’aucune traite;
- 5° En s’approchant de la plus haute ou de la plus basse proportion reçue par les voisins ou revenant à la commune de la plupart des États voisins;
- 6° En défendant le cours ou du moins interdisant la fabrication des espèces de billon ou de cuivre quand le royaume en est suffisamment rempli.
Aux enforcissements des monnaies, toutes denrées et marchandises baissent et diminuent de leur prix, de même qu’aux affaiblissements elles augmentent et enchérissent.
Lorsque le prince enforcit les espèces, on ne ressent point aussi vite le rabais des denrées et marchandises, que l’on a ressenti leur enchérissement quand les espèces ont été affaiblies.
Le marchand prompt à enchérir sa marchandise lors d’un affaiblissement de monnaie est lent à la rabaisser, quand les enforcissements sont ordonnés.
Le rabais du prix des marchandises ne se fait guère ressentir qu’après que les marchands se sont défaits des vieilles, et qu’ils commencent à vendre les nouvelles achetées depuis l’enforcissement.
Souvent, afin que l’on profite de cet enforcissement pour le rabais des denrées et marchandises, il faut qu’il arrive quelque abondance qui soit sensible et qui rende les denrées très communes.
Souvent aussi pour profiter d’un tel rabais, il faut que le magistrat interpose son autorité et tienne la main à ce que les marchandises et denrées soient vendues à bas prix. (Abot De Bazinghen. Enforcir.)
[27] L’affaiblissement des monnaies fut très fréquent, particulièrement sous les rois de la troisième race: dès que ces rois manquaient d’argent, ils affaiblissaient leurs monnaies pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l’État. Il n’y avait alors ni aides ni tailles.
Charles VI, dans une de ses ordonnances, déclare qu’il est obligé d’affaiblir ses monnaies pour résister à notre adversaire d’Angleterre et obvier à sa damnable entreprise. . ., attendu qu’à présent nous n’avons aucun autre revenu de notre domaine dont nous nous puissions aider.
On lit dans l’Abrégé de l’Histoire de Charles VI, ensuite de celle de Juvénal des Ursins, un portrait très fidèle des maux que causa l’affaiblissement des monnaies sous Charles VI: nous le rapporterons ici mot à mot pour donner une idée de ces maux, toujours inséparables de l’affaiblissement des monnaies.
“Depuis l’an 1415, que la bataille d’Azincourt se donna, il y eut en France de grandes tribulations et pertes pour le sujet des monnaies et couronnes, qui ayant au commencement été forgées pour dix-huit sols seulement, commencèrent insensiblement à monter à dix-neuf et vingt sols, depuis toujours montant petit à petit jusques à neuf francs, avant que cette excessive valeur fῦt réglée. Pareillement toute autre monnaie monta au prorata, chacune à sa quantité. Il courait lors une monnaie qu’on nommait fleurettes ou fleurettes, qui valait dix-huit deniers; mais enfin, elles furent remises à deux deniers, puis on les défendit tout à fait, tellement qu’elles n’eurent plus de cours. Pour ce, il y eut plusieurs riches marchands qui y perdirent grandement. Aussi du temps qu’icelles monnaies avaient cours pour si grand prix. cela était fort au préjudice des seigneurs, car les censiers qui leur devaient argent, vendaient un septier de blé dix ou douze francs et pouvaient ainsi payer une grande cense par le moyen et la vente de huit ou dix septiers de blé seulement: de quoi plusieurs seigneurs et pauvres gentilshommes reçurent de grands dommages et pertes. Cette tribulation dura depuis l’an 1415 jusqu’à l’an 1421, que les choses se remirent à un plus haut point, touchant les monnaies, car un écu fut remis à vingt-quatre sols: puis on fit des blancs doubles de la valeur de huit deniers, et toute autre monnaie fut à l’équipollent remise chacune à sa juste valeur et quantité. Or, en icelle année que les monnaies furent de la sorte remises à leur règle et légitime valeur, cela fit naître quantité de procès et de grandes dissentions entre plusieurs habitants du royaume, à cause des marchés qui avaient été faits dès le temps de la susdite faible monnaie. En quoi il y avait grande décevance, tromperie et confusion pour les acheteurs.”
Charles VII, dans le grand besoin d’argent où la longueur des guerres qu’il eut à soutenir l’avait réduit, poussa l’affaiblissement des monnaies si loin et leva sur elles un si gros droit, qu’il retenait les trois quarts d’un marc d’argent pour son droit de seigneuriage et pour les frais de la fabrication; il prenait encore une plus grosse traite sur le marc d’or. Ce prince ayant chassé les Anglais du royaume, commença à retablir l’ordre par le règlement des monnaies. On lit dans un ancien manuscrit, environ de ce temps là, que le peuple se ressouvenant de l’incommodité et des dommages infinis qu’il avait reçus de l’affaiblissement des monnaies et du fréquent changement du prix du marc d’or et d’argent, pria le roi d’abandonner ce droit, consentánt qu’il imposât les tailles et les aides, ce qui leur fut accordé. Le roi se réserva seulement un droit de seigneuriage fort petit, qui fut destiné au paiement des officiers de la monnaie et aux frais de la fabrication.
Un ancien registre des monnaies, qui paraît avoir été fait sous le règne de Charles VII, dit que oncques puis que le roi meit les tailles des possessions, des monnaies ne lui chalut plus. (Abot De Bazinghen, t. Ier, p. 39. art. Affaiblissement des monnaies.)
Comme ces fréquentes variations dans les monnaies, dit le même écrivain, dérangeaient extrêmement le commerce et causaient beaucoup d’autres inconvénients, le peuple obtenait quelquefois du roi que les monnaies resteraient quelque temps dans un état fixe, moyennant les aides que le peuple lui octroyait pour le dédommager de l’émolument qu’il aurait tiré du changement des monnaies.
Le dauphin Charles le marque précisément dans le mandement du 25 mai 1359, dans lequel il déclare qu’à la prière et à la requête du peuple, il avait fait faire une monnaie forte “en espérance d’avoir les plus grans et bonnes finances que l’on pourroit bonnement par fouaiges, impositions, subsides ou autrement pour subvenir aux dépenses de la guerre, mais qu’il n’a pu maintenir cette monnoie forte pendant longtemps, parce que ces impositions n’ont pas produit des sommes assez considérables. “En sorte, que pour y suppléer, il a été obligé d’avoir recours “à la revenue du prouffit et émolument des monnoies, par quoi il a convenu. . . le fait et gouvernement desdites monnoies, de mener et mettre en tel état, qu’elles sont tellement affeboyées, que le peuple en a eu indignation et moult contre cœur.”
Dans l’ordonnance du 14 mai 1358, par laquelle fut établie une aide qui devait durer un an, le dauphin ordonna que l’on ferait une monnaie forte, et il promit de la maintenir dans le même état et sur le même pied pendant un an, sans la muer, croître ou abaisser en quelque manière.
L’ordonnance du 28 décembre 1355, qui établit une aide, annonce en même temps une fabrication de monnaie forte, qui devait être stable à perpétuité; mais le roi déclare que si la guerre continue, et que les Etats ne lui octroyent pas des subsides pour la soutenir, il retournera à son domaine des monnaies, c’est à dire qu’il rentrera dans le droit d’augmenter et diminuer les monnaies à sa volonté, afin de tirer du profit des variations, et en effet, le produit du subside qui lui fut accordé n’ayant pas été assez considérable, il ordonna une fabrication de monnaie faible, par un mandement du 26 juillet suivant.
Le roi Jean de retour d’Angleterre, après avoir remis les monnaies en bon état, demanda une aide; mesmement dit l’ordonnance du 5 décembre 1360, “que à notre dite forte monnaie aurons nul ou moult petit acquest et gain, lequel, nous peut être très garant, si comme chacun peut scavoir et aussi pour charger le moins que nous pourrons notre dit peuple.”
Sur la fin du règne du roi Jean, le prince de Galles, à qui Édouard III, roi d’Angleterre, dont il était le fils aîné, avait cédé l’Aquitaine, et qui la gouvernait à peu près sur les principes établis en France, ayant assemblé les Etats de cette province pour leur demander un fouage pendant cinq ans, Froissart rapporte que quelques communautés y consentirent, à condition qu’il tiendrait ses monnaies stables pendant sept ans.
Le chapitre XV de l’ancienne coutume de Normandie, peut servir encore à confirmer ceci; en voici les termes: “Le monnayage est une aide de deniers, qui est due au duc du Normandie de trois ans en trois ans, afin qu’il ne fasse changer la monnaie qui court en Normandie. Ce monnayage se nommait aussi fouage.
Les besoins de l’État obligèrent très souvent le roi Jean et le Dauphin à tirer des profits considérables des monnaies; ils le faisaient en deux façons: 1° En augmentant le prix des monnaies qui avaient cours. (Ils se sont servi rarement de ce premier moyen.) 2° En ordonnant des fabrications de nouvelles monnaies et en ôtant du commerce celles qui avaient cours auparavant. Dans les mandements qui étaient donnés à cet effet, on fixait le prix du marc mis en œuvre en nouvelles espèces et le prix que l’on devait donner aux hôtels des monnaies du marc en espèces décriées; l’excédant de ce premier prix au second tournait au profit du roi. Par exemple, par le mandement du 30 aoῦt 1360, le marc en nouvelles espèces fut fixé à 8 liv. 5 sols, et le marc des espèces décriées à 7 liv. . .. Ce gain si considérable en luimême se renouvelait très souvent; pendant l’année 1360, il y eut au moins onze mandements pour des fabrications de nouvelles espèces. Ainsi en supposant que le gain ait été de 20 sols, par marc de chaque fabrication, le roi aura tiré pendant une année 11 liv. de chaque marc.
Ces changements étaient quelquefois plus fréquents et si soudains que, à grand’ peine étoit homme qui en juste payement des monnoies de jour en jour se pῦt connoîtrs.
Pour empêcher que les monnaies décriées ne fussent mises dans le commerce, on établissait des coupeurs de monnaies, c’est à dire des gens chargés de couper ou de percer celles qui étaient décriées, afin qu’on ne pῦt plus s’en servir dans le commerce; on leur payait pour leurs peines un droit qui augmentait encore la perte que l’on faisait sur ces monnaies. Lorsqu’elles étaient ainsi coupées, elles ne pouvaient plus être d’aucun usage, on les portait aux hôtels des monnaies ou on les vendait à des changeurs, qui les achetaient moyennant une certaine remise qui faisait encore une nouvelle perte et qui les portaient aux hôtels des monnaies.
Indépendamment de la fréquente mutation des espèces, il y avait encore bien des désordres dans les monnaies. On en fabriquait à différents titres dans les provinces du royaume: Ces différentes espèces que l’on fabriquait dans la même monnaie n’étaient point proportionnées et équipollées entre elles, en sorte qu’il y avait du profit à donner en paiement les unes plutôt que les autres.
Nous ne détaillerons point tous les inconvénients qui naissaient du désordre des monnaies, comme la cherté des denrées et des marchandises, la difficulté des paiements, le dérangement du commerce, etc.; nous nous bornerons aux plus considérables.
Le gain que le roi faisait sur les fabrications des nouvelles espèces, présentait un appât trop considérable pour ne pas tenter ses sujets et principalement les étrangers à le tourner à leur profit, en contrefaisant les espèces. On transportait hors du royaume une partie des espèces décriées et on les convertissait en monnaies qui avaient cours en France, où on les rapportait. Quelquefois même, on en altérait le titre qui était déjà très bas, en sorte que le royaume était rempli de monnaies contrefaites ou fausses.
Lorsqu’on fabriquait de nouvelles espèces, on les faisait quelquefois semblables à celles qui avaient cours auparavant par le poids, par la forme et par l’empreinte. On n’en affaiblissait que le titre. Alors on mettait sur ces nouvelles espèces une marque que l’on nommait différence et qui servait à distinguer ces espèces des anciennes, auxquelles elles étaient semblables, à l’extérieur; mais on jugeait quelquefois à propos de ne pas faire connaître au public que l’on faisait une nouvelle fabrication d’espèces, et de le mettre hors d’état de distinguer les nouvelles monnaies dont le titre était affaibli, des anciennes auxquelles, à cela près, elles ressemblaient entièrement. Dans ce cas, il était porté, dans le mandement par lequel la nouvelle fabrication avait été ordonnée, de mettre sur ces nouvelles monnaies la différence la moins appercevante que l’on pourra, ou même de n’en pas mettre du tout. Tel est le mandement du 27 juin 1360 où il est dit sans y mettre aucune différence à ceux du présent et pour cause. Dans celui du 2 mai de la même année, il y a: “sans y mettre ni faire aucune différence, car ainsi l’avons-nous ordonné, afin de tenir la chose plus secrète. “Et dans celui du 2 décembre 1359, “sans mettre ou faire mettre en iceux point de différence pour ce que nous voulons cette chose, pour certaine cause, être tenue la plus secrète pourra.”
Quelquefois le public, fatigué des fréquentes mutations des monnaies, refusait de recevoir les nouvelles. Le 23 novembre 1356, le roi ordonna de faire fabriquer une monnaie blanche et noire sur le pied des monnaies 48es. Cette nouvelle monnaie ne fut publiée à Paris, c’est à dire ne fut distribuée et répandue dans le public que le 10 décembre suivant. Le peuple de Paris, animé par Marcel, prévòt des marchands, et par ceux de sa faction, en fut très mécontent, ainsi que d’une diminution d’espèces qui avait été ordonnée par lettre du 25 novembre 1356. Le prévôt des marchands, accompagné d’un grand nombre d’habitants, alla trouver le comte d’Anjou, second fils du roi, que le duc de Normandie, qui était allé à Metz, avait laissé son lieutenant à Paris, et lui dit que le peuple ne souffrirait pas que cette nouvelle monnaie eῦt cours. Le comte d’Anjou promit d’en faire cesser la fabrication jusqu’à ce qu’il eῦt reçu les ordres de son frère. Ainsi cette monnaie n’eut plus de cours, et l’on ne garda pas les ordonnances sur le cours des autres monnaies, qui continuèrent d’être prises sur l’ancien pied. Le duc de Normandie, revenu à Paris, consentit que la nouvelle monnaie n’eῦt point cours.
Le peuple continuait aussi quelquefois à se servir, au mépris des ordonnances, des monnaies décriées, et il les conservait dans le commerce pour un prix plus fort que celui que l’on en donnait à la monnaie; quelquefois aussi il faisait monter le prix de celles qui avaient cours, au delà du prix porté par les ordonnances.
On se conformait quelquefois dans les recettes royales à la volonté du public en cela et sans avoir égard aux prix fixés par les mandements, on y recevait ces espèces pour celui qu’elles avaient communément dans le commerce. Les monnaies étrangères étaient aussi reçues dans le commerce, malgré les défenses du roi, et le public seul en déterminait le prix.
Ainsi, indépendamment des monnaies fausses, la France était remplie d’une très grande quantité d’espèces de titre différent et dont le prix dépendait uniquement de la volonté et du caprice du public et peut-être encore plus des manœuvres secrètes de ceux qui étaient plus intelligents et plus fins que les autres dans le commerce de l’argent.
Ce fut inutilement que le Dauphin et le roi Jean tâchèrent de réprimer ces abus par leurs ordonnances. La preuve qu’elles furent mal observées, c’est qu’ils les renouvelèrent très souvent. (Abot De Bazinghem, t. II, p. 143.)
(Note de la page 167). A l’égard des baux des monnaies, le premier fut fait par Charles VII, fils du roi de France, régent du royaume, dauphin de Viennois, duc de Berry et de Touraine, comte de Poitou, par mandement donné au château de Loches le 18 octobre 1419, par lequel les monnaies de Tours, Chinon, Angers, Poitiers, La Rochelle, Limoges, Saint-Pourçain, Lyon, Bourge, Guise, Saint-André, Beaucaire, Montpellier, Toulouse, Saint-Esprit, Cremieux, Romans, Mirabel, Loches, Sens, Mouron, et Villefranche en Rouergue furent données à bail à Marots de Béton pour lui et ses compagnons moyennant deux millions soixante mille livres chaque année.
Charles VI fit un autre bail par mandement donné à Corbeil le 10 aoῦt 1420 par lequel les monnaies qui étaient alors affermées savoir: Paris, Tournay, Saint-Quentin, Châlon, Troye, Macon, Nevers et Auxerre furent affermées à Guillaume Sanguin pour six mois, moyennant la somme de cinq cent mille livres, non compris cent mille livres qu’il donna encore au roi de lui-même sans y être obligé. (De Bettange, Traité des monnaies t. Ier, p. 69. Paris, 1760.)
[28] Le crime de fausse monnaie, lisons-nous dans le Traité des monnaies d’Abot de Bazinghem, est un crime public que l’on commet en abusant de la monnaie en quelque manière que ce puisse être contre la prohibition de la loi.
Ce crime de faux est de toutes les espèces de faux le plus punissable, parce que le souverain ayant seul le droit de faire fabriquer les monnaies, ceux qui les fabriquent sans sa permission expresse commettent un crime de lèse-majesté au second chef qui est puni de mort.
Ce crime peut être puni de plusieurs manières:
Premièrement quand on fabrique de la monnaie sans la permission du souverain, quoiqu’elle soit du poids et du titre ordonnés;
- 2° Quand la monnaie est fausse par la matière;
- 3° Quand on fabrique la monnaie en d’autres lieux que ceux établis pour sa fabrication;
- 4° Quand on falsifie l’image du prince ou l’inscription qui y doit être;
- 5° Quand on se charge sciemment de fausse monnaie pour l’exposer et qu’on participe avec les faux monnayeurs;
- 6° Quand on rogne ou que l’on altère la monnaie qui a été faite et marquée légitimement, pour affaiblir le juste poids qu’elle doit avoir, ou quand on en achète les rognures sciemment et qu’on participe avec les altérateurs;
- 7° Quand ceux qui fabriquent la monnaie avec la permission du souverain la font plus faible ou de moindre titre qu’il n’est porté par les ordonnances;
- 8° Quand on refond les monnaies en fraude et pour son compte particulier;
- 9° Enfin quand on fond la monnaie ou que l’on difforme les espèces pour les employer en d’autres ouvrages.
Le crime de fausse monnaie a toujours été estimé de telle conséquence que Constance, ne trouvant pas les peines ordonnées par les lois précédentes assez rigoureuses pour l’arrêter, ordonna que ceux qui en seraient convaincus seraient punis par le feu et promit une récompense aux dénonciateurs.
Les rois de France ont suivi cet exemple et ont mis le crime de fausse monnaie au nombre de ceux de lèse-majesté et ont ordonné qu’il n’y aurait que les officiers royaux qui en pourraient connaître.
Louis Ier dit le Débonnaire, par le règlement que ce roi fit sur les monnaies en 819, ordonna une peine contre les faux monnayeurs; c’est la première qui se trouve dans les ordonnances des rois de France; de falsá monetâ jubemus ut qui eam percussisse comprobatus fuerit, manus ei amputetur et qui hoc consenserit, si liber est, 60 solidos componat, si servus, 60 ictus accipiat.
Quant à la peine du feu ordonnée par la loi, elle a été en usage en France conformément à l’ordonnance de Charles le Chauve et aux coutumes de Bretagne et de Loudun.
L’ordonnance de Charles le Chauve, donnée à Piste le 7 des kalendes de juillet en l’année 864, porte “que le faux monnayeur qui sera convaincu sera puni selon la loi romaine dans les lieux où elle était observée ou bien qu’il perdra la main, ainsi qu’il est prescrit dans le quatrième livre des Capitulaires.”
La coutume de Bretagne porte en termes exprès: Les faux monnayeurs seront bouillis, puis pendus.
Celle de Loudun (chap. Ier art. 39) porte: Qui fait ou forge fausse monnaie doit être traíné, bouilli ou pendu.
Les rois ont aussi obtenu des papes des bulles contre les faux monnayeurs, rogneurs et expositeurs: savoir, Philippe le Bel, une bulle de Clément V, en 1308; Charles le Bel, une bulle de Jean XXII en 1320; Philippe de Valois, une bulle de Clément VI en 1349, et Henri III, de Grégoire XIII en 1533.
Les pénalités édictées par les rois, les excommunications fulminées par les papes s’appliquaient aussi bien aux simples contrefacteurs qui se bornaient à imiter la monnaie du roi sans l’altérer, qu’à ceux qui l’altéraient en l’imitant. Les bulles des papes étaient surtout dirigées contre les princes voisins, qui contrefaisaient la monnaie du roi, et qui se trouvaient hors des atteintes de la loi.
“Les petits princes voisins de la France, dit à ce sujet l’abbé Le Blanc, contrefaisaient les monnaies du roi, ce qui causait un grand désordre dans l’État, en le remplissant de mauvaises espèces et en tirant toutes les bonnes que l’on fondait ensuite pour faire ces monnaies altérées et contrefaites. Le roi eut recours à un remède, dont ses prédécesseurs s’étaient souvent servis. Il obtint du pape une bulle d’excommunication contre tous ceux qui contrefaisaient ses monnaies; et dont ils ne pouvaient être absous que par le pape, si ce n’est à l’article de la mort.
“Beaucoup de rapports dignes de foi l’ont appris à nos oreilles apostoliques, disait Clément V dans la première de ces bulles, plusieurs personnes qui n’ont aucune autorité pour faire monnaie, en fabriquent de fausse dans le royaume de France et lieux circonvoisins; d’autres s’appliquent à altérer, en lui ôtant son poids réel, la monnaie fabriquée au véritable type de notre cher fils en Jésus-Christ, Philippe, illustre roi de France: un plus grand nombre encore, qui dans les terres voisines de celles de ce prince, ont autorité pour frapper monnaie en vertu d’un droit, de la coutume ou d’une concession, cherchent à revêtir les espèces qu’ils fabriquent de l’empreinte particulière de la monnaie royale de France, et en leur donnant même poids, même modèle, même module, même forme de lettres, imitent, rendent et contrefont, aussi exactement qu’ils peuvent, la ressemblance et le type de la monnaie du roi, etc. etc.”
Le crime de fausse monnaie ou même de simple contrefaçon de la monnaie était qualifié de crime de lèse-majesté, parce qu’il causait dommage au roi. Ce crime était, par conséquent, poursuivi avec infiniment plus de diligence et puni avec plus de sévérité que les sévices qui causaient seulement dommage aux sujets. Quoique les gouvernements aient cessé généralement de retirer un revenu du monnayage, les lois pénales ont conservé l’empreinte des sévérités du temps passé, en ce qui concerne la contrefaçon et l’altération des monnaies. Pendant la révolution les contrefacteurs de la monnaie nationale ont été punis de mort, plus tard ils sont devenus passibles des travaux forcés à perpétuité ou à temps. Nous rappellerons les dispositions du code pénal français à cet égard.
132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à temps.
134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l’émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.
Il est assez curieux de remarquer 1° que la “simple contrefaçon” reste assimilée à la fabrication des monnaies altérées; 2° que la contrefaçon du billon soit punie de moindres peines que celle des monnaies d’or et d’argent, quoique sous le régime monétaire actuel on puisse trouver de beaux profits à altérer la monnaie de cuivre émise pour une valeur supérieure à sa valeur métallique, tandis qu’on n’en peut plus trouver aucun à contrefaire la monnaie principale, dont la valeur monétaire ne peut plus dépasser la valeur métallique.
D’un autre côté, tandis que la contrefaçon ou l’altération de la monnaie demeure soumise à des pénalités d’une rigueur extrême, la contrefaçon des marques de fabrique et même l’adultération des denrées à l’aide de substances nuisibles à la santé ne sont passibles que de pénalités comparativement légères. Cependant, le mal que peux causer une adultération des denrées alimentaires, par exemple, est certainement plus grand que celui que cause une contrefaçon ou même une adultération de la monnaie. Sur ce point, comme sur bien d’autres, la législation moderne continue les traditions de l’ancien régime qui considérait les crimes et délits qui portaient dommage au souverain comme bien autrement repréhensibles et punissables que ceux qui portaient simplement dommage aux particuliers.
[29] Dans chaque pays la monnaie nationale est reçue pour sa valeur numérique, mais les monnaies étrangères ne sont comptées que pour leur valeur réelle. Les monnaies étrangères ne pouvaient autrefois circuler en France. Cette prohibition, déjà fort ancienne, avait été renouvelée par deux arrètés de la cour des monnaies du 17 février 1777 et du 14 octobre 1780, qui interdisaient de faire entrer en France des espèces de billon et de cuivre de fabrique étrangère, à peine de confiscation et de 3,000 livres d’amende contre chacun des contrevenants. Les mêmes arrêts défendaient de les donner ou recevoir en paiement, à peine de 500 livres d’amende contre tous les contrevenants. Le décret du 11 mai 1807 maintient cette défense, mais en modifie la pénalité, etc. La déclaration du 7 octobre 1755 permet à tous marchands, banquiers, négociants, de faire librement, et sans aucune espèce de restrictions, le commerce de toutes les matières d’or et d’argent, même des espèces étrangères. Ces pièces étrangères ne peuvent néanmoins avoir aucun cours en France ni être données, reçues ou exposées à la pièce. (Répertoire de législation, de Dalloz, art. Monnaie.)
[30] Telle avait été aussi, longtemps auparavant, la destination des célèbres monnaies fortes frappées sous le règne de saint Louis.
“Saint Louis fit fabriquer des deniers d’or sous le nom de deniers d’or à l’agnel qu’on nomma dans la suite moutons d’or. Le denier d’or à l’agnel fut ainsi nommé de ce qu’il avait pour effigie un agneau portant une longue croix ornée d’une bannière, avec cette légende: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Au revers une grande croix fleurdelisée et fleuronnée avec cette légende Christus regnat, vincit, imperat. Cette monnaie fut nommée dans la suite moutons à la grande laine, moutons à la petite laine. Rien de si fréquent dans les anciens titres que cette monnaie sous le nom de mutones ou multones; elle dura en France jusqu’au règne de Charles VII, et tous les successeurs de saint Louis, excepté Philippe de Valois, en firent fabriquer. Ils furent toujours d’or fin, hors sous le règne de Charles VII, et eurent grand cours dans toute l’Europe à cause de leur bonté; plusieurs souverains même dans la suite firent fabriquer des espèces pareilles auxquelles ils donnèrent le même nom de moutons.” (Abot De Bazinghem, t. ler, p. 107.)
[31] Henry Poullain a analysé avec une sagacité vraiment merveilleuse, — eu égard à l’époque où il écrivait, — les différentes causes du désordre des monnaies.
“Il y a, lisons-nous dans son traité, six diverses sortes d’affaiblissements que les princes peuvent faire sur leurs monnaies: la première, en diminuant le poids de l’espèce; la deuxième, leur bonté intérieure; la troisième, en surhaussant également le cours de l’une et l’autre des bonnes espèces; la quatrième, en chargeant de traites excessives ses espèces d’or ou ses espèces d’argent ou les unes et les autres tout ensemble; la cinquième, en s’éloignant beaucoup de la proportion reçue entre tous ses voisins ou en la changeant souvent de peu par le surhaussement de prix de l’une des bonnes espèces sans toucher à l’autre; et la sixième, en faisant fabriquer par excès une si grande quantité d’espèces de bas billon ou de cuivre ou peu de grand prix et cours, qu’elles entrent au commerce et se reçoivent en sommes notables au lieu de bonnes pièces d’or et d’argent.
“Explication. La première a lieu en diminuant le poids de l’espèce sans toucher au cours ni à sa bonté intérieure; comme prenant l’exemple sur nos pièces de seize sols, qui doivent peser sept deniers douze grains trébuchants pièce, si le roi les diminuait de douze grains de poids, en sorte qu’elles ne pesassent plus que sept deniers de poids la pièce et néanmoins qu’elles eussent cours pour seize sols tournois, et demeurassent à onze deniers de loi argent fin, cette première façon d’affaiblir s’appellerait affaiblissement sur le poids.
“La deuxième, en diminuant la bonté intérieure de l’espèce sans toucher au poids ni au cours, comme, continuant l’exemple, sur les pièces de seize sols qui doivent être à onze deniers de loi argent fin, si le roi les diminuait d’un denier de fin de bonté, en sorte qu’elles ne fussent plus qu’à dix deniers de loi argent fin, et néanmoins qu’elles pesassent sept deniers douze grains et eussent cours pour seize sols tournois pièce, cette deuxième façon d’affaiblir s’appellerait affaiblissement sur la loi ou bonté intérieure.
“La troisième, en surhaussant proportionnellement le cours des espèces d’or et d’argent tout ensemble, sans toucher au poids ni à la bonté intérieure de l’une ni de l’autre. Comme par l’ordonnance de 1577, l’écu d’or du poids de deux deniers quinze grains et à vingt-trois karats d’or fin avait cours pour soixante sels et le quart d’écu d’argent du poids de sept deniers douze grains et à onze deniers de loi argent fin, avait cours pour quinze sols tournois, le roi, par ordonnance de l’année 1602, leur donna cours, savoir à l’écu pour soixante-cinq sols et au quart d’écu d’argent pour seize sols, surhaussant, en le faisant, le cours de l’écu et de la pièce de seize sols presque en égale proportion de l’une à l’autre, savoir l’écu de cinq sols et les quatre pièces de seize sols d’argent, de quatre sols, sans toucher à leur poids ni bonté intérieure, et cette troisième façon d’affaiblir était et se peut appeler affaiblissement sur le cours.
“La quatrième, en chargeant de traites excessives l’espèce d’or ou l’espèce d’argent, ou l’une et l’autre tout ensemble. Comme si le roi, sans toucher au poids, bonté intérieure et cours de l’écu, qui est, suivant la dernière ordonnance de 1602, à 65 sols, le chargeait de 5 sols de traite, en sorte que le poids de l’or de l’écu difformé ne valut que 60 sols. Ou bien s’il chargeait la pièce de seize sols de deux sols six deniers de traite, en sorte que le poids de l’argent de cette pièce de seize sols ainsi difformée ne valut que treize sols six deniers. Ou encore si le roi chargeait l’écu et la pièce de seize sols tout ensemble de ces traites excessives, savoir l’écu de cinq sols et la pièce de seize sols de deux sols six deniers, sans toucher à leur poids, bonté intérieure et cours. Cette quatrième façon d’affaiblir s’appellerait affaiblissement sur la traite.
“La cinquième, en s’éloignant beaucoup de la proportion de l’or à l’argent reçue entre tous ses voisins, ou en la changeant souvent de peu, pensant attirer et se remplir davantage de l’une de ces matières. Comme à présent que le roi observe par ordonnance au cours de ses espèces d’or et d’argent une proportion onzième et quelque peu plus, s’il venait à observer par nouvelle ordonnance une proportion neuvième et moins, donnant cours à la pièce de seize sols pour dix-huit sols tournois, et aux autres espèces d’argent à l’équipolent, sans toucher au poids et bonté intérieure de l’êcu d’or. Ou bien s’il observait par ordonnance une proportion douzième et plus, donnant cours à l’ècu pour 72 sols, sans toucher au poids et bonté intérieure de la pièce de seize sols. Ou encore s’il changeait souvent, comme d’année en année, la proportion, surhaussant peu à peu le cours de son espèce d’or, sans toucher à celle d’argent ou le cours de son espèce d’argent sans toucher à celle d’or ni à leur poids et bonté intérieure; cette cinquième façon d’affaiblir s’appellerait affaiblissement sur la proportion.
“Et la sixième et dernière, en faisant fabriquer par excès une grande quantité de petites espèces de bas billon ou de cuivre, ou si peu de grosses de grand prix et cours, que les petites espèces se reçoivent en sommes notables, qu’elles entrent en trafic et commerce, et par la continuation de leur fabrication, qu’elles apportent une rareté des bonnes espèces d’or et d’argent entre ses sujets. Comme si le roi faisait fabriquer une si grande quantité de petits liards, doubles ou deniers de cuivre ou de billon, à un ou à deux deniers de loi argent fin, ou peu de grosses espèces de cuivre ou billon qui eussent cours pour un sol ou pour dix-huit deniers tournois pièce; en sorte que par l’excès de leur fabrication il s’en fit des payements notables entre ses sujets, causant une rareté et chassant les bonnes espèces d’or et d’argent hors la province. Cette sixième façon d’affaiblir s’appellerait affaiblissement sur l’excès de fabrication des espèces de billon ou de cuivre, à laquelle, quand les princes y ajoutent une grande traite, comme ils font ordinairement, je la tiens, comme elle est, la plus dangereuse de toutes les six.” (Henry Poullain, Traité des Monnaies, p. 33–41.)
[32] Consulter, au sujet des maux causés par les rogneurs de monnaie en Angleterre, l’Histoire de Macaulay. Les rogneurs de monnaie.
[33] Voici à cet égard un fait assez curieux. Lorsque les Anglais furent maîtres de la France, ils firent frapper d’excellentes monnaies (1422-36) notamment les angelots, espérant par ce moyen, dit un ancien écrivain, aliéner l’amitié des Français de Charles VII qui avait été contraint d’empirer beaucoup sa monnaie. Ces bonnes monnaies anglaises, Charles VII les faisait fondre et il s’en servait pour fabriquer, à gros bénéfice, des monnaies d’une valeur intrinsèque fort inférieure.
“Dans tout le cours des XIVe et XVe siècles, dit M. Lecointre Dupont, la France n’eut point d’aussi belles monnaies que les saluts, les angelots et les blancs de Henri VI, de système monétaire aussi bien entendu et aussi stable que celui qui fut établi pendant l’occupation anglaise.” (Lettres sur l’histoire monétaire de la Normandie et du Perche, par Lecointre Dupont; p. 72.)
“L’ordonnance de Louis XII du 25 novembre 1506; l’édit de François Ier du 27 septembre 1543; les lettres patentes d’Henri II du 14 janvier 1549; la déclaration de Louis XIV du 14 décembre 1689, prononcent des peines rigoureuses contre les fondeurs de monnaie. — “Défendons à tous orfévres ou ouvriers, portait ce dernier acte, qui emploient de l’argent, de fondre ou difformer aucune espèce de monnaie pour employer à leur ouvrage, à peine des galères à perpétuité.” Et pour qu’aucun ne contrevînt à cette interdiction, l’article 18 du règlement du 30 décembre 1679 avait pris des précautions sévères. Les orfévres étaient tenus de ne travailler qu’en public, d’avoir leur forge dans leur boutique sur rue et vue du public avec défense de travailler ailleurs et qu’aux heures portées par les ordonnances. Un arrêt notable, rendu par la Cour des comptes le 3 décembre 1759, réunit toutes ces dispositions en vigueur et renouvelle toutes les prohibitions portées par les édits, tant contre la fonte des monnaies que contre l’accaparement et l’emploi des matières d’or et d’argent. Cependant un arrèt du parlement de Dijon permettait la fonte des monnaies aux alchimistes,” à ceux qui changeraient l’étain en argent et le cuivre en or.” (Répertoire de Dalloz.)
[34] Cependant le billonnage continua, comme on va le voir, de demeurer interdit pendant toute la durée de l’ancien régime.
[35] Cette attestation, Jacq. Steuart la donne en exposant avec une admirable lucidité, le régime monétaire de la France, tel qu’il existait au XVIIIe siècle.
“Dans les hôtels des monnaies de France, le marc est l’unité de poids; il est composé de 8 onces, et chaque once contient 576 grains; de sorte que le marc contient 4,608 grains, poids de Paris, appelé poids de marc.
“C’est d’après ce poids que l’hôtel des monnaies remet le métal brut aux ouvriers, et qu’il le reprend d’eux lorsqu’il est converti en espèces: le roi leur alloue 36 grains sur chaque marc qu’ils rendent en espèces monnayées; c’est ce qu’on appelle le remède de poids.
“Un marc d’espèces françaises d’argent ne doit donc pas être calculé sur le pied de 4,608 grains, mais seulement 4,572 grains effectifs.
“Le titre des espèces d’argent de France consiste dans 11 parties de fin et I partie d’aloi (alliage). Ainsi un marc d’espèces monnayées consistant en 4,572 grains d’argent au titre, contient donc 4,191 grains d’argent fin et 381 grains d’aloi.
“Mais on alloue encore aux ouvriers 3 grains sur la finesse; ce qui donne lieu à une nouvelle proportion entre le nombre de grains d’argent fin et le nombre de grains d’aloi.
“Une masse d’argent (quant à la finesse) est supposée, dans les hôtels des monnaies de France, divisée en 12 deniers, et chaque denier en 24 grains, qui, dans ce sens, sont l’un et l’autre des dénominations de proportion et non de poids.
“Toute masse quelconque d’argent, quel que en soit d’ailleurs le poids, peut être supposée contenir 12 × 24 = 288 grains de proportion; par conséquent, si le titre était exactement de 11 deniers de fin, la proportion serait ainsi exprimée: 264 grains de fin sur 24 d’aloi. Mais la remise de 3 grains de proportion, dite remède d’aloi, rend la proportion comme 261 à 27. Tel est le titre exact des monnaies d’argent de France qui répond à 10 deniers et 21 grains de fin, expression employée dans les hôtels des monnaies.
“Pour trouver le nombre de grains d’argent fin contenus dans un marc d’argent monnayé de France, il faut établir cette proportion, 288: 261 :: 4,572: x = 4,143,38.
“Le marc d’argent monnayé, toutes déductions faites pour l’aloi et le remède de poids contient donc 4,143,38 grains poids de marc d’argent fin.
“De ce marc on tire 8 3/10 écus de 6 livres, qui valent 49 livres 16 sous.
“Si donc 4,143,38 grains d’argent fin valent 49 livres 16 sous, 4,608 grains (ou un marc d’argent fin) vaudront 55 livres 6 sous 9 deniers.
“Mais le prix que donne l’hôtel des monnaies de l’argent fin n’est que de 51 livres 3 sous 3 deniers.
La différence entre ce prix de l’hôtel et le prix de l’argent fin monnayé est donc le montant exact des frais du monnayage. On retient donc pour ces frais et le droit de seigneuriage (déduction et imposition qu’on appelle la traite des monnaies) 4 livres 3 sous 6 deniers sur chaque marc d’argent fin. Pour connaître combien pour cent, cela produit, faisons la proportion suivante:
“51,162: 55,38 :: 100: x = 108,2; d’où il résulte qu’en France on déduit 8.2 pour cent, pour le monnayage de l’argent.
“Examinons maintenant les règlements semblables relatifs à l’or.
“Le marc est encore ici l’unité de poids et contient toujours 4,608 grains, dont 15 sont alloués aux ouvriers pour le remède de poids. Il reste donc 4,593 grains d’or au titre dans un marc.
“La finesse de l’or est comptée en carats (ce qui n’est pas un poids, mais une simple dénomination de proportion) comme celle de l’argent, par deniers. L’or fin est dit de 24 carats de même qu’en Angleterre. Le carat est divisé en 32 parties, de sorte que 32 × 24 = 768 est le nombre de parties dans lesquelles toute masse donnée d’or est supposée divisée, lorsqu’il est question de son degré de finesse.
“Le titre de l’or de France est, comme celui de l’argent, de 11/12 ou de 22 carats; sur quoi on accorde aux ouvriers 12/32 parties d’un carat pour le remède d’aloi; ce qui réduit le titre à 21 20/32 carats de fin, sur 212/32 d’aloi. Ceci exprimé dans les divisions mentionnées ci-dessus devient 692 parties de fin sur 76 parties d’aloi
“On trouvera donc le nombre de grains d’or fin contenus dans un marc d’or monnayé par la proportion suivante:
“768: 692 :: 4,593: x = 4,138,48; d’où il suit que, toutes déductions faites, il y a 4,138,48 grains d’or fin dans un marc d’or monnayé.
“De ce marc on tire 30 louis d’or de 24 livres, valant ensemble 720 livres.
“Si donc 4,138,48 gains d’or fin valent 720 livres dans les espèces monnayées, 4,608 grains ou un marc d’or fin vaudra 801 livres 12 sous.
“Mais l’hôtel des monnaies ne donne que 740 livres 9 sous 1 denier du marc d’or fin.
“C’est dans la différence entre ce prix du métal fin selon l’hôtel, et celui qu’il a réellement étant monnayé (savoir 61 livres 3 sous 2 deniers), que consiste exactement le prix du monnayage.
“Pour découvrir combien pour cent cela produit, on n’a qu’à faire cette proportion:
“740,409: 801,68 :: 100: x = 108,2; de sorte qu’en France, il y a 8.2 pour cent de déduction sur le monnayage de l’or.
“Les calculs ci-dessus nous font voir que le roi prend au delà de 8 p. c. sur le monnayage de l’or et de l’argent.
“Depuis plusieurs années on n’a fait usage d’aucuns moyens violents pour faire porter les métaux bruts à l’hôtel des monnaies, et cependant nous voyons par les dates des espèces françaises qu’on en a frappé une grande quantité de l’un et de l’autre métal. Ceci prouve, selon moi, de la manière la plus convaincante, que l’imposition du monnayage, convenablement établie, n’interrompt en aucune façon la fabrication des monnaies, et le fait, bien attesté par l’expérience, sert à confirmer ce principe.
“Passons actuellement à l’examen du rapport qui existe, soit entre les valeurs des métaux monnayés, soit entre les prix que l’hôtel des monnaies donne des métaux bruts.
“Pour cela nous mettrons les prix de l’hôtel en une équation, et les valeurs relatives de l’or et de l’argent dans une autre.
“L’hôtel des monnaies paye 51,162 livres du marc d’argent fin et 740,409 livres du marc d’or fin; par conséquent, la première proportion est 51,162: 740,409 :: 1: x = 14,47.
Un marc d’argent fin en espèces vaut 55,38 livres, et un marc d’or fin en espèces vaut 801,68 livres. Ainsi la seconde proportion sera 55,38: 801,68 :: 1: x = 14,47.
“Les deux proportions donnent donc également le rapport de 1 à 14,47, rapport très rapproché de celui adopté par les écrivains français, qui est comme 1 à 14 9/19. Le premier est cependant plus exact, et revient, à très peu de chose près, à celui de 1 à 14,5.
“Ces calculs nous conduisent à découvrir la quantité d’or fin contenu dans un louis, et celle d’argent fin contenu dans un écu de 6 livres.
“Dans un louis d’or il y a 137.94 grains d’or fin, et 153.1 d’or au titre.
“Dans l’écu de 6 livres il y a 499.22 grains d’argent fin, et 550.843 grains d’argent au titre.
“De plus, après avoir comparé le rapport adopté par les écrivains français entre le grain poids de Troye et le grain poids de marc, avec le rapport adopté par les écrivains anglais entre le grain de France et le grain de Troye et après avoir soumis ces divers rapports aux épreuves les plus exactes, par des expériences sur les poids mêmes des deux nations, et par des résultats moyens pris sur d’autres en grand nombre, j’ai trouvé qu’un grain poids de marc est à un grain poids de Troye comme 100: 121,78.
“La proportion suivante nous donnera donc le nombre de grains Troye d’or fin eontenus dans un louis.
“121,78: 100 :: 137,94: x = 113,27.
“Or, une guinée contient 118,651 grains Troye d’or fin, et cependant, dans presque tous les pays de l’Europe, le louis, en temps de paix, passe au même taux que la guinée, dans la supposition où l’une et l’autre pièces ont leur poids légal. Ceci est un fait connu, et qui sert à confirmer un autre principe, savoir que l’imposition du monnayage renforce la valeur des espèces d’une nation, méme dans les pays étrangers.” (Jacques Steuart, Recherche des principes de l’économie politique, liv. III, ch. VII.)
[36] Voir l’Exposé de la loi fondamentale des quantités et des prix, t. ler, p. 90.
[37] Le seigneuriage alla toujours en décroissant, et au moment de la révolution, en vertu du dernier tarif, celui de 1771, il n’était, d’après Necker, que de 1 192/1000 pour cent sur l’argent, 1 167/1000 sur l’or. Le brassage était, pour l’argent, de 14 6/10 sur mille, pour l’or de 2 8/10 sur mille. (Michel Chevalier. Cours d’Économie politique. La monnaie, sect. III, chap. Ier, p. 104.)
[38] Voir les Questions d’économie politique et de droit public: De la dépréciation de l’or, t. Ier, p. 305.
[39] La plus vaste opération à laquelle ait donné lieu le billon est celle à laquelle s’est livré le gouvernement français à partir de 1852 ct qui vient d’être heureusement terminée. Il s’agissait de retirer la masse entière des anciennes pièces en cuivre et en métal de cloche qui était lourdes et mal frappées, et de les remplacer par un billon d’une exécution supérieure et relativement léger, fait d’un bronze très riche en cuivre. On a adopté pour le décime le poids de 10 grammes, qui était au dessous du poids de la plupart des billons de cuivre connus jusqu’à ce jour. De cette manière, avec un kilogramme de cuivre on fait des pièces pour une valeur courante de 10 fr. Ce qui est bien supérieur à la valeur réelle du métal. Les sept hôtels des monnaies de France ont concouru à cette fabrication qui a été close en 1858. On a retiré près de 10 millions de kilogr. (exactement 9,939,292 kil.) de sous en cuivre ou en métal de cloche, représentant une valeur nominale de fr. 48,512,698, et on a livré à la circulation, en pièces neuves, une valeur nominale de fr. 48,500,000, formant un poids total de 4,850,434 kilogr., et répartis ainsi:
| Pièces | de 10 | centimes | . . . . . . . . . . . . fr. | 25,965,839 70 |
| Id. | 5 | “ | . . . . . . . . . . . . | 20,702,905 15 |
| Id. | 2 | “ | . . . . . . . . . . . . | 1,162,665 64 |
| Id. | 1 | “ | . . . . . . . . . . . . | 668,589 51 |
| Total. . .fr. | 48,500,000 00 |
Les frais de fabrication ont été de fr. 7,762,077; l’excédant du métal, qu’on a vendu, a produit fr. 10,834,977; l’opération a ainsi donné un bénéfice net d’un peu plus de 3 millions de francs.
La quantité de billon livrée ainsi à la circulation s’est trouvée insuffisante, et cette année (1860) une loi a pourvu à la fabrication de 12 millions de plus. (Michel Chevalier, Dictionnaire du commerce et de la navigation, art. Monnaie.)
L’insuffisance du nouveau billon tient surtout à ce que ce billon a pénétré dans la circulation de quelques pays voisins, notamment dans celle de la Belgique. S’il vient, quelque jour, à en être expulsé, il se trouvera de nouveau en France à l’état d’excédant et il se dépréciera, au grand dommage de la foule des petits consommateurs de billon, à moins que cet excédant ne soit retiré de la circulation.
[40] Dans aucun pays le mauvais étalonnage de la monnaie de billon n’a causé plus de désordres qu’en Russie. On trouve à cet égard des renseignements fort curieux dans le Cours d’économie politique de Storch.
“Les annales de notre patrie, dit cet économiste trop peu apprécié, dans une des remarquables leçons qu’il a consacrées à la monnaie, nous fournissent un fait curieux, savoir l’existence d’une monnaie de confiance représentant non pas de l’or et de l’argent, mais des peaux et des fourrures. Dans le temps où les peaux servaient de numéraire en Russie, l’incommodité attachée à la circulation d’un numéraire si volumineux et si périssable, donna lieu à l’idée de les remplacer par de petits morceaux de cuir timbrés, qui par là devinrent des signes payables en peaux et fourrures. — Dans la suite, et lorsqu’on commença à battre de la petite monnaie, ces signes représentèrent les fractions des copeks d’argent. Ils conservèrent cet emploi jusqu’en 1700, du moins dans la ville de Kalouga et dans ses environs, comme on le voit par un édit de Pierre Ier. du 8 mars de cette année, par lequel ce prince ordonna de les délivrer contre de la petite monnaie de cuivre, qu’il venait de faire frapper pour cela.
“Dans des temps plus récents, le cuivre, comme représentant de l’argent, a joué un rôle moins singulier mais plus important dans notre histoire monétaire. Déjà sous le tzar Alexis, on eut l’idée de le substituer à l’argent, de manière à rendre ce dernier métal absolument inutile dans la circulation. Ce prince fit frapper, en 1655, des copeks de cuivre du même volume que ceux d’argent, qui étaient alors la principale monnaie courante, et il ordonna de les recevoir les uns et les autres pour la même valeur. Comme le souverain lui-même les accepta à ce taux dans ses caisses, les copeks de cuivre se maintinrent au niveau de ceux d’argent jusqu’en 1658; mais dès lors ils commencèrent à se déprécier [41] . En 1659, cent copeks d’argent valaient 104 copeks de cuivre; en 1661, ils en valaient déjà 200; au commencement de 1662, de 300 à 900; au mois de juin de l’année suivante, jusqu’à 1,500. A cette époque, une révolte ayant éclaté parmi le peuple de Moscou à cause de cette monnaie, elle fut supprimée.
“Quoique dans les temps postérieurs à cette époque, l’abus de la monnaie de cuivre n’ait jamais été porté aussi loin, cependant, il n’a pas laissé de causer de grands désordres dans notre système monétaire et d’entraîner des suites très pernicieuses.
“En mettant de côté la monnaie de cuivre du tzar Alexis qui ne fut que de courte durée, les pièces de cuivre qui eurent cours en Russie avant le règne de Pierre Ier l’étaient que des fractions du copek d’argent, qui constituait alors l’unité monétaire et la principale monnaie courante. Ce prince, après avoir réduit le rouble d’argent à la moitié de sa valeur, fit battre cinq espèces différentes de monnaie de cuivre, depuis la valeur d’un huitième de copek (polpolouchka) jusqu’à celle de cinq copeks. Le taux légal de cette monnaie a beaucoup varié dans les différentes périodes de son règne. En 1704, il fut fixé à 20 roubles au poud, c’est à dire qu’il fut ordonné de frapper 20 roubles d’un poud de cuivre: or, comme le prix courant du cuivre en barres était alors de 5 roubles le poud de cuivre, vous voyez que l’empereur attribuait à sa monnaie de cuivre une valeur trois fois plus grande ou qu’elle était surévaluée de 300 pour cent. Un rouble en cuivre n’avait de valeur intrinsèque que 25 copeks, et cependant le gouvernement le faisait circuler pour un rouble, et il devait légalement s’échanger contre un rouble d’argent.
“Ce taux de la monnaie de cuivre était beaucoup plus haut qu’il ne l’avait été jusque-là; néanmoins, dans la suite de son règne, Pierre Ier l’éleva encore: depuis 1718 il fit battre 40 roubles d’un pond de cuivre, taux qui a subsisté pendant les règnes de Catherine Ier et de Pierre II. Alors la monnaie de cuivre se trouva surévaluée de 566 2/3 pour cent; et un rouble en cuivre ne valait effectivement que 15 copeks.
“Tout exorbitante qu’était cette surévaluation, la monnaie de cuivre aurait peut-être conservé sa valeur nominale, si on lui avait conservé son caractère de petite monnaie. Mais non seulement on la frappa en coupures trop fortes, mais encore on en émit des quantités si prodigieuses, qu’elle chassa bientôt de la circulation une partie de la monnaie d’argent. Dans un temps où la valeur de dix copeks en argent suffisait à un homme pour acheter sa nourriture journalière, des pièces de 5 copeks en cuivre ne pouvaient guère circuler comme monnaie de billon. Aussi n’était-ce pas l’intention du gouvernement de leur donner cette destination; ces espèces viles et pesantes devaient remplacer l’or et l’argent dont le gouvernement avait besoin pour autre chose. Mais s’il eῦt été possible de les substituer aux métaux précieux, une surévaluation plus que quintuple n’était certainement pas le moyen d’atteindre ce but.
“Les suites d’un pareil système ne pouvaient qu’être que désastreuses. Tant que la monnaie de cuivre conserva sa valeur nominale, la circulation fut inondée de monnaie contrefaite dans les pays voisins. On voit par les mémoires du comte Munich qu’outre les quatre millions de monnaie de cuivre frappés dans l’empire, il s’y trouvait encore pour plus de six millions de cette monnaie importée de l’étranger. Pour cette quantité de monnaie contrefaite, les étrangers avaient acheté de la monnaie d’argent et des marchandises russes avec un profit de 560 pour cent: la Russie se trouvait appauvrie de toute cette valeur, et dénuée d’espèces d’argent. Ces circonstances ne pouvaient manquer de faire baisser la valeur nominale de la monnaie de cuivre; mais à mesure qu’elle se rapprocha de sa valeur intrinsèque, toutes les menues denrées renchérirent en proportion, le peuple en souffrit, et le gouvernement, obligé de recevoir cette monnaie à sa valeur nominale, et ne pouvant plus l’employer dans ses achats que pour sa valeur intrinsèque, en éprouva une diminution sensible dans ses revenus.
“Tant de calamités dessillèrent enfin les yeux des administrateurs: en 1735, l’impératrice Anne fit émettre de la nouvelle monnaie au taux de 10 roubles au poud. Cette monnaie n’était surévaluée que de 53 4/5 pour cent; la valeur intrinsèque du rouble en cuivre était 65 copeks. Cependant, comme l’ancienne monnaie subsistait toujours dans la circulation, elle fut employée à acheter les bonnes espèces, qui disparaissaient ainsi à mesure qu’elles sortaient du balancier. Après bien des tentatives infructueuses qu’on avait faites depuis dix ans pour se débarrasser de la mauvaise monnaie, on prit enfin le parti de la démonétiser à trois reprises, en 1744, 45 et 46, de sorte que les pièces de 5 copeks furent successivement réduites à la valeur nominale de 4, de 3 et de 2 copeks. Cette opération ordonnée par l’impératrice Élisabeth se fit aux dépens du gouvernement et lui causa une perte de 78 1/2 pour cent sur toute la valeur de cette monnaie.
“La démonétisation du cuivre fit naître de nouveaux embarras. Quatre millions de cette monnaie venaient d’être réduits à un million et demi; les pièces d’argent avaient disparu; le défaut de petite monnaie se faisait sentir dans tout l’empire, et le poids de la nouvelle monnaie la rendait plus incommode pour la circulation que ne l’avait été l’ancienne. Quoique ces inconvénients fussent très sensibles au gouvernement lui-même, et qu’il trouvât les plus grandes difficultés à se procurer la quantité de cuivre nécessaire pour la nouvelle monnaie, l’idée de la remplacer par des pièces d’argent ne lui vint point; au contraire, il s’obstina à vouloir réduire la valeur monétaire du cuivre à sa valeur courante. En 1755, les pièces de 2 copeks furent mises hors de cours, et l’on entreprit de frapper de la nouvelle monnaie au taux de 8 roubles au poud. Cette monnaie était trop bonne; car le prix courant du cuivre en barre étant alors le même que le taux de la monnaie, vous voyez que les frais de fabrication retombaient sur le gouvernement, ce qui lui causait une perte considérable et même fort inutile, vu la fonction de la monnaie de cuivre qui ne consiste qu’à représenter l’argent dans les achats où ce dernier ne peut être employé. Aussi cette bonne monnaie ne fut-elle pas de longue durée: la guerre de Prusse étant survenue, on revint au projet du comte Munich qui avait conseillé de donner à la monnaie de cuivre une valeur nominale double de sa valeur intrinsèque. En conséquence, dès l’année 1757 la monnaie de cuivre fut frappée au taux de 16 roubles au poud.
“. . . Le taux de 16 roubles au poud a été maintenue depuis 1757 jusqu’en 1810, pendant un espace de 53 ans. Durant toute cette période, le rapport de la valeur monétaire du cuivre à celle de l’argent n’a changé qu’une fois, en 1763, par la diminution de la monnaie d’argent. Le rouble en cuivre ayant conservé son poids, dans le temps où le poids de l’argent fin contenu dans un rouble d’argent fut diminué, il en résulta une proportion différente entre la valeur monétaire de ces deux métaux: du temps d’Élisabeth cette proportion avait été comme 1 à 49,3; depuis elle a constamment été comme 1 à 57. Les mêmes pièces de cuivre valaient une moindre quantité d’argent fin sous Catherine qu’elles n’avaient valu sous Élisabeth.
“Mais si la valeur monétaire du cuivre a peu varié durant cette période, sa valeur courante, au contraire, a essuyé les plus grandes altérations. En 1757, la proportion entre le cuivre et l’argent avait été comme 1 à 135. En 1765, nous la trouvons déjà comme 1 à 114; et depuis cette époque le prix du cuivre monte d’année en année, de sorte qu’en 1803 une livre d’argent ne peut acheter que 50 liv. de cuivre. Or, comme la proportion monétaire entre ces deux métaux ne fut point changée, il en arriva que le profit du monnayage sur la monnaie de cuivre diminua d’année en année, et qu’à la fin il se changea en perte. Le gouvernement continua toujours à donner dans ses monnaies 57 livres de cuivre contre une livre d’argent, tandis que dans le commerce une livre d’argent ne pouvait plus acheter que 50 livres de cuivre. Cette disproportion entre le prix monétaire et le prix courant du cuivre devait naturellement encourager la fonte et l’exportation de la monnaie de cuivre, puisqu’elle était bieu meilleur marché que le cuivre en barres. Nul doute que ces deux opérations ne se soient pratiquées pendant tout le temps qu’elles ont présenté un profit suffisant pour couvrir les risques et les frais de transport qui y étaient attachés.
“Ainsi, la première faute qu’on peut reprocher au système de cette période, c’est d’avoir conservé le même taux pour la monnaie de cuivre malgré la hausse prodigieuse qu’avait subi le prix courant de ce métal. Mais une erreur bien plus grave dont on doit l’accuser, c’est d’avoir augmenté la monnaie de cuivre hors de toute proportion avec la monnaie d’argent. Par cette mesure la première avait entièrement perdu son caractère de petite monnaie; les espèces les plus courantes, celles qui reparaissaient à tout moment dans les échanges, c’étaient les pièces de 5 copeks, pièces informes et pesantes, dont la circulation ne pouvait s’opérer que d’une manière excessivement incommode. Le gouvernement était si loin d’en sentir les inconvénients, qu’il paraissait vouloir réduire la nation à ce seul numéraire, du moins les quantités énormes qu’il en émettait chaque année eurent l’effet de chasser entièrement de la circulation les petites espèces d’argent que les assignats y avaient encore laissées. La somme des monnaies d’or et d’argent frappées depuis 1762 jusqu’en 1811 est de 137 millions de roubles, et celle des monnaies de cuivre émises dans le même espace de temps va au delà de 90 millions: donc l’émission de la monnaie de cuivre était à celle des monnaies d’or et d’argent dans la proportion de 1 à 1 1/2. Aucun pays de l’Europe n’offre, que je sache, l’exemple d’un pareil rapport entre le véritable numéraire et la petite monnaie.
“Le système monétaire de 1810 prouve que l’administration actuelle a reconnu les erreurs du temps passé et qu’elle est occupée à en réparer les suites. Les principales mesures par rapport à la monnaie de cuivre consistent: 1° à la réduire à sa véritable destination de petite monnaie, en ne faisant frapper que des pièces de 2 copeks, de 1 copek et d’un 1/2 copek; 2° à régler le taux légal de cette monnaie sur le prix courant du cuivre en barres.
“. . . L’édit monétaire veut que le taux légal de la monnaie de cuivre soit changé de temps à autre suivant le prix courant du cuivre en barres, calculé en monnaie d’argent sur un certain nombre d’années. Lorsque cet édit fut donné, le taux subsistant de 16 roubles au poud paraissait trop bas; car dans les six années de 1800 à 1806, le prix courant du cuivre avait été au delà de 16 roubles et même jusqu’à 18 roubles et 40 copcks; de sorte que le rouble en cuivre avait eu la valeur intrinsèque de 100 1/2 jusqu’à 115 copeks d’argent, et qu’il avait causé une perte de 2/5 jusqu’à 13 1/20 p. c. sur la matière sans compter les frais de fabrication. En prenant en somme les dix années de 1800 à 1809, on trouve que le prix moyen du cuivre en barres a été 15 roubles 38 cop. L’exemple d’Élisabeth et de Catherine, celui de la plupart des pays de l’Europe autorisaient à évaluer le cuivre dans les monnaies au double de son prix courant comme marchandise: ainsi le taux aurait pu être fixé à 30 roubles; on se contenta de le fixer à 24.
“Cependant toute modérée que paraissait être cette évaluation, elle n’en est pas moins devenue par hasard beaucoup plus forte que l’administration ne semble avoir eu l’intention de la faire; car le prix du cuivre ayant subitement baissé dans les années suivantes, il en est résulté qu’en 1811 la valeur intrinsèque du rouble en cuivre s’est vue réduite à 38 4/5 copeks, et l’année suivante à 37 6/11 de 83 1/2 copeks qu’elle était en 1810. Cette diminution tout excessive qu’elle est aurait peu d’inconvénients si la monnaie de cuivre était chez nous ce qu’elle est dans la plupart des pays, savoir de la petite monnaie; mais en Russie elle a une tout autre importance: elle entre plus ou moins dans tous les marchés, et les denrées les plus communes et les plus indispensables pour tout le monde ne s’achètent guère qu’avec cette monnaie. (Henri Storch. Cours d’économie politique, t. IV, note XIII.)
[41] Évidemment, par suite de l’excès des émissions.
[42] On trouvera les détails statistiques les plus complets sur cette révolution monétaire dans le savant ouvrage de M. Michel Chevalier: De La Baisse Probable De L’or, des conséquences commerciales et sociales qu’elle peut avoir et des mesures qu’elle provoque.
“Au commencement du siècle, y lisons-nous, la quantité d’or versée par les différents pays producteurs sur le marché général où puisent les États de la civilisation occidentale ou chrétienne, était d’environ 24,000 kilogr. de métal fin.
“Mais pour arriver à cette quantité, il faut compter la production de diverses contrées qui, alors, n’avaient que peu de relations commerciales avec les grandes nations chrétiennes, et, par exemple, l’île de Bornéo et diverses autres localités du grand archipel. En se bornant à l’extraction du continent américain, de l’Europe et de la Russie asiatique, M. de Humboldt a calculé que c’était alors 15,800 kil. C’est à peine si l’or que les peuples de la civilisation chrétienne puisaient à d’autres sources et particulièrement en Afrique ajoutait à cet approvisionnement un poids de 2,000 kilog. On pourrait ainsi estimer à 18,000 kil. la masse d’or qui, au commencement du siècle, venait grossir tous les ans la richesse métallique des États chrétiens. Elle s’éleva peu au dessus jusqu’à l’époque où l’exploitation des mines d’or de l’Oural et plus tard de celles de la Sibérie vint, avec le concours d’autres ressources secondaires, la porter assez brusquement à plus du triple. On en était là, au commencement de 1848, lorsque eut lieu la découverte des riches gisements de la Californie qui devait être suivie de si près d’un événement semblable dans l’Australie. En ce moment, on peut évaluer en nombres ronds la masse d’or fournie aux peuples chrétiens à 275,000 kil., sinon davantage. L’augmentation est donc dans le rapport de l à 15 depuis une quarantaine d’années, et presque dans le rapport de 1 à 5 depuis 1848. Pour l’argent, au contraire, le changement est peu notable: la production, au commencement du siècle, était de 900,000 kil., on estime que présentement elle excède peu un million de kil.
“On peut exprimer autrement la véritable révolution qui s’est opérée dans la production de l’or. La contrée qui, jusqu’à l’exploitation des mines de la Sibérie, en était, pour les peuples de l’Europe, le principal foyer, l’Amérique tout entière, depuis le premier voyage de Christophe Colomb jusqu’à la découverte des mines de la Californie, c’est à dire pendant 356 ans (de 1492 à 1848), et en comptant l’or retiré des lingots d’argent aussi bien que celui des mines d’or proprement dites, n’a donné que 2,910,000 kil. de métal fin soit 10 milliards 126 millions de francs, en prenant pour un franc, d’après la loi française du 7 germinal an XI, 29 centigrammes d’or (0,32 à 9/10es de fin). Aujourd’hui la production de l’or approchant de 300,000 kil., en une seule année les peuples civilisés reçoivent de ce métal le dixième environ du total qui en avait été fourni par l’Amérique depuis le premier départ de Christophe Colomb jusqu’à 1848.” (De La Baisse Probable De L’Or, sect. III, chap. Ier. p. 48.)
L’accroissement du monnayage, principal débouché des métaux précieux, a été la conséquence naturelle de cette augmentation si rapide et si considérable de la production de l’or. Le Dictionnaire du commerce et de la navigation nous fournit sur cet accroissement du monnayage de l’or dans les principaux pays consommateurs, en Angleterre, aux États-Unis et en France, des renseignements statistiques complets et significatifs.
“Voici en millions de francs, la valeur des métaux monnayés en Angleterre de 1848 à 1857 inclusivement: or, fr. 1,377,000,000; argent, fr. 62,200,000; total, fr. 1,439,200,000.
“La moyenne annuelle est de 143 1/2 millions, dont 137 pour l’or et 6 1/2 pour l’argent; de 1840 à 1843, elle était seulement de 115 millions.
“Aux États-Unis, de 1848 à 1859, on a fabriqué 2,427 millions de monnaie d’or et 241 millions de monnaie d’argent: total, 2,668 millions. La moyenne annuelle est de 242 millions, dont 220 pour l’or et 22 pour l’argent. Le monnayage de l’argent est d’un tiers plus considérable qu’avant 1844 celui de l’or l’est seize fois plus.
“En France, sous l’ancien régime, la fabrication des monnaies, de 1726, époque de la refonte générale jusqu’en 1789 s’est élevée à 2,914,237,989 livres auxquelles il faut ajouter 23 1/2 millions en bas argent, ce qui donne une moyenne annuelle de 45 millions.
“Depuis ce temps, le monnayage a toujours augmenté. De 1795 à 1848, on a frappé en France:
OR. ARGENT. TOTAUX. Première république (depuis le décret du 15 aoῦt 1795) . . .. . .fr. “ 106,237,255 00 106,237,255 00 Consulat et Empire . . . . . . . . . 328,024,440 887,582,321 50 1,415,606,761 50 Louis XVIII . . . . . . . . . 389,333,060 614,668,520 00 1,004,001,580 00 Charles X . . . . . . . . . 52,918,920 631,914,637 50 684,833,557 50 Louis-Philippe . . . . . . . . . 215,912,800 1,750,273,238 50 1,066,146,038 50 ————————— ————————— ————————— 1,186,189,220 3,990,675,972 50 5,176,765,192 50 La moyenne annuelle est de 22,811,231 fr. pour l’or et de 76,743,768 pour l’argent: total 99,555,099 francs. La moyenne des dix-huit années du règne de Louis-Philippe est différente de la moyenne générale; elle n’est que de 11,995,155 fr. pour l’or, et elle est de 97,237,402 fr. pour l’argent: total 109,232,557 fr. La quantité de la monnaie augmentait, mais l’or était rare.
Le monnayage, pendant les neuf dernières années, a été en:
| OR. | ARGENT. | TOTAUX. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1848 | . . . . . . . . . . . fr. | 39,697,840 | 119,731,095 25 | 159,428,835 23 |
| 1849 | . . . . . . . . . . . | 27,109,560 | 206,548,663 90 | 233,658,223 90 |
| 1850 | . . . . . . . . . . . | 85,192,390 | 86,458,485 20 | 171,650,875 20 |
| 1851 | . . . . . . . . . . . | 269,709,570 | 59,327,308 90 | 329,036,878 90 |
| 1852 | . . . . . . . . . . . | 27,028,270 | 71,918,445 50 | 98,946,715 50 |
| 1853 | . . . . . . . . . . . | 312,964,020 | 20,099,488 20 | 333,063,508 20 |
| 1854 | . . . . . . . . . . . | 526,528,200 | 2,123,887 20 | 528,652,087 20 |
| 1855 | . . . . . . . . . . . | 447,427,820 | 25,500,305 50 | 472,928,125 50 |
| 1856 | . . . . . . . . . . . | 508,281,995 | 54,422,214 00 | 562,704,200 00 |
| 1857 | . . . . . . . . . . . | 572,561,225 | 3,809,611 30 | 576,370,836 30 |
| 1858 | . . . . . . . . . . . | 488,698,633 | 8,663,568 70 | 497,362,203 70 |
| —————— | —————— | —————— | ||
| Fr. | 3,305,199,423 | 658,603,073 65 | 3,963,802,498 65 |
“La moyenne annuelle est de 249,325,507 fr. pour l’or et de 71,781,099 francs pour l’argent: total 321,106,606 francs.
“La moyenne de l’argent a baissé. Jamais, depuis 1795, il n’en avait été frappé moins qu’en 1854. Elle est d’environ 1/15 plus faible que celle de la période entière; elle est de plus de 1/4 au dessous de la moyenne du règne de Louis-Philippe.
“De 1795 à 1848, l’or entrait dans le monnayage pour 22,09 et l’argent pour 77,1 p. c.
“De 1830 à 1848, l’argent était représenté par 89, l et l’or par 10,9 p. c.
“De 1848 à 1859, l’or est représenté par 77,6 et l’argent par 22,4 p. c.
“Ainsi, en France, depuis onze ans, le monnayage est trois fois plus considérable qu’il n’était sous le gouvernement de juillet: on frappe un quart moins de monnaie d’argent; mais on frappe 21 fois plus d’or (presque 22 fois): aussi la circulation des pièces d’or, assez rare, il y a quelques années, est-elle devenue générale. “Dictionn. du commerce et de la navigation, art. Métaux précieux, par E. Levasseur.
Les chiffres cités plus haut attestent que la consommation de l’or par le monnayage s’est élevée en Angleterre, aux États-Unis et en France à plus de 7 milliards pendant ces onze années. Cette consommation extraordinaire a eu pour résultat d’empêcher une chute sensible de la valeur du métal; mais il est évident qu’elle devra cesser dès que la circulation sera saturée d’or et qu’alors les probabilités de dépréciation de ce métal croîtront rapidement.
Les mêmes renseignements statistiques nous montrent que le débouché du monnayage a progressivement diminué pour l’argent, tandis qu’il s’accroissait pour l’or. Les tableaux de l’importation et de l’exportation de l’argent accusent au profit de l’exportation une différence de 1,283,363,580 francs de de 1848 à 1860; attestant le remplacement, d’ailleurs bien visible, de la plus grande partie de la monnaie d’argent par de la monnaie d’or. L’argent ainsi expulsé de la circulation américaine et européenne a été exporté en quantité croissante en Asie. De 1851 à 1857, cette exportation (ports d’Angleterre et de la Méditerranée vers l’Orient) a présenté la progression suivante:
| 1851 | fr. | 42,900,000 |
| 1852 | . . . . . . . . . . . | 63,570,000 |
| 1853 | . . . . . . . . . . . | 138,950,000 |
| 1854 | . . . . . . . . . . . | 114,575,000 |
| 1855 | . . . . . . . . . . . | 198,325,000 |
| 1856 | . . . . . . . . . . . | 552,700,000 |
| 1857 | . . . . . . . . . . . | 513,625,000 |
| TOTAL . . . .fr. | 1,626,645,000 |
Dans le même intervalle, l’exportation de l’or vers l’Asie n’a été que de 135,320,000 francs.
Cet accroissement du débouché asiatique a soutenu la valeur de l’argent pendant que la substitution de l’or à l’argent, dans la circulation monétaire des principaux marchés du monde civilisé, empêchait la chute de la valeur de l’or. En admettant que la production de l’argent continue à demeurer stationnaire, ce métal devra, selon toute apparence, hausser dès que les exportations vers l’Asie, ne pourront plus être alimentées par les approvisionnements monétaires que la substitution de l’or à l’argent a rendus disponibles. Ainsi, d’un còte, il y aura de plus en plus, à moins d’un changement dans l’état actuel de la production des deux métaux, tendance à la baisse pour l’or, tendance à la hausse pour l’argent. D’où cette conclusion que les deux métaux sont exposés, quoique en sens inverse, à perdre de plus en plus aussi la qualité essentielle de l’étalon monétaire, savoir la stabilité de la valeur.
[43] On trouvera l’exposé de ce système dans le Journal des Économistes, mai 1854; il a été reproduit dans les Questions d’économie politique et de droit public. T. Ier, p. 281. De la dépréciation de l’or. M. Michel Chevalier en a fait la critique suivante dans son ouvrage sur la Baisse probable de l’or.
“M. Gustave de Molinari a recommandé un mécanisme monétaire destiné à maintenir en France la double circulation de l’argent et de l’or, tout en reconnaissant à l’argent seul la qualité d’étalon. Pour assurer à l’or, dans toute la latitude possible, la qualité d’auxiliaire que la loi de l’an XI a attribuée à ce métal et pour empêcher en même temps qu’il n’y ait chance de la lui voir outre-passer, M. de Molinari voudrait qu’il y eῦt des pièces d’or ne contenant qu’une quantité de métal sensiblement inférieure à celle qui correspond à la valeur de l’or par rapport à l’argent. Ce serait, suivant lui, billonner l’or, tout comme, en Angleterre, on billonne l’argent. Dans ce système, le gouvernement français se réserverait seul le droit d’émettre de la monnaie d’or, comme le gouvernement anglais se réserve seul le droit d’émettre de la monnaie d’argent; et comme la circulation de la France commence à être saturée d’or, il faudrait aussi qu’il en arrêtât, provisoirement du moins, la fabrication. En outre, pour donner aux détenteurs de la monnaie d’or une garantie contre l’excès des émissions, pour assurer en quelque sorte la valeur de cette monnaie auxiliaire, fabriquée avec un métal aujourd’hui sujet à dépréciation, il faudrait que la monnaie auxiliaire d’or fῦt toujours remboursable en argent comme sont les billets de banque. Ces conditions remplies, la valeur de la monnaie d’or deviendrait aussi stable que celle de la monnaie d’argent sur laquelle elle se trouverait fixée, et comme l’or est d’un usage plus commode que l’argent, dans la plupart des transactions on s’en servirait de préférence. L’or actuellement dans la circulation n’en serait donc point retiré pour étre échangé contre de l’argent, pas plus que ne le sont les billets de banque, et le régime monétaire de la France unirait la sécurité du système hollandais ou belge, qui repose sur l’argent, à la commodité du système anglais, qui repose sur l’or.”
Les objections que M. Michel Chevalier oppose à ce système portent: 1° sur le danger de la contrefaçon; 2° sur les frais résultant de la nécessité de conserver dans les caisses publiques un capital en argent pour garantir la circulation de l’or.
“Si c’est une violente tentation que de battre monnaie avec du papier, en imitant des titres généralement admis du public, tels que les véritables billets de banque, la spéculation malhonnête d’émettre des pièces d’or passant pour 25 francs et n’en valant que 15, serait encore lucrative. Il serait même plus facile de fabriquer de ces jetons que de contrefaire les billets de banque. L’imitation naturelle de ces derniers titres est déjà malaisée et pourrait être rendue très difficile. Au contraire, la reproduction de pièces d’or dont l’empreinte aurait été plus ou moins déformée par la circulation est d’une extréme facilité. Ce ne serait qu’un jeu pour des fabricants de boutons de livrée, montés comme sont aujourd’hui les ateliers de cette industrie dans certaines villes comme Birmingham.
“Le danger d’une panique qui porterait une masse de peuple à venir demander le remboursement de ces jetons d’or, contre leur montant nominal en argent, serait presque aussi fort qu’avec de petits billets de banque, dans l’hypothèse où je me suis placé d’un grand écart entre la valeur nominale et la valeur réelle.
Il est vrai qu’on se soustrairait à ces deux périls en s’imposant la règle de n’avoir entre la valeur nominale et la valeur réelle qu’un écart de 5 p. c. à 10 au plus. Mais alors la combinaison deviendrait onéreuse à cause de la somme qu’il faudrait toujours garder en pièces d’argent pour opérer le remboursement à volonté. Supposons une émission d’un milliard de francs en billon d’or: si l’écart est de 7 1/2 p. c., ce sera une économie de 75 millions dans le capital requis pour former l’instrument des échanges; mais si les caisses publiques destinées à garantir le remboursement à volonté absorbent à cet effet une réserve de 100 millions en pièces d’argent, l’opération aboutit à une perte. “De la baisse probable de l’or. Sect. VII, chap. V. D’un procédé recommandé pour maintenir la circulation parallèle de l’argent et de l’or.
Aux objections que nous oppose le savant auteur de la Monnaie, nous ne ferons que de courtes réponces, car le remède proposé par nous en 1854 serait maintenant d’une application plus difficile et plus coῦteuse. Nous croyons toutefois que son adoption serait encore préférable, au double point de vue du juste et de l’utile, à la substitution légale de l’étalon d’or à l’étalon d’argent, entraînant comme une conséquence nécessaire l’affaiblissement et le billonnage de l’argent.
Si à l’époque où l’or affluait dans la circulation française, répondronsnous à M. Michel Chevalier, le gouvernement s’était réservé, d’une part, le droit d’en régler l’émission, en le déclarant, d’une autre part, toujours échangeable contre l’argent et vice-versá, la différence entre la valeur intrinsèque de la pièce d’or de 20 fr. et sa valeur monétaire eῦt été trop faible pour provoquer la contrefaçon. En admettant l’éventualité d’une baisse considérable de l’or, la différence se serait accrue sans doute; mais jamais elle n’aurait procuré aux contrefacteurs des bénéfices comparables à ceux que rapporte la contrefaçon des billets de banque. La contrefaçon de l’or eῦt été plus facile, à la vérité; mais celle du billon de cuivre est plus facile encore sans être moins lucrative, et on ne voit pas cependant qu’elle s’effectue sur une échelle quelque peu étendue.
Quant au capital de garantie, il serait insignifiant si les émissions de la monnaie d’or étaient convenablement réglées, en d’autres termes, si l’émission de cette monnaie était toujours proportionnée aux besoins du marché monétaire.
Seul, du reste, ce remède à la défectuosité de l’étalonnage français pouvait empêcher la substitution de l’étalon d’or à l’étalon d’argent, sans coῦter — du moins à l’époque où il fut proposé — aucun sacrifice au trésor, et en permettant à l’or de prendre, au grand avantage des consommateurs, sa place naturelle dans la circulation.
[44] Voir le t. Ier, chap. XIV, p. 389.
[45] A. Thiers. Histoire de la Révolution française, liv. XVI.
[46] Voici encore le tableau de la situation économique de la France à cette époque, esquissé par M. Thiers:
“Les assignats, malgré les victoires de la république, avaient subi une baisse rapide et ne comptaient plus dans le commerce que pour le sixième ou le huitième de leur valeur, ce qui apportait un trouble effrayant dans les échanges, et rendait le maximum plus inexécutable et plus vexatoire que jamais. Évidemment, ce n’était plus le défaut de confiance qui dépréciait les assignats, car on ne pouvait plus craindre pour l’existence de la république; c’était leur émission excessive et toujours croissante au fur et à mesure de la baisse. Les impôts difficilement perçus et payés en papier fournissaient à peine le quart ou le cinquième de ce que la république dépensait chaque mois pour les frais extraordinaires de la guerre, et il fallait y suppléer par de nouvelles émissions. Aussi, depuis l’année précédente, la quantité d’assignats en circulation, qu’on avait espéré réduire à moins de deux milliards, par le moyen de différentes combinaisons, s’était élevée, au contraire, à quatre milliards six cents millions.
“A cette accumulation excessive de papier-monnaie et à la dépréciation qui s’ensuivait, se joignaient encore toutes les calamités résultant soit de la guerre, soit des mesures inouïes qu’elle avait commandées. On se souvient que pour établir un rapport forcé entre la valeur nominale des assignats et les marchandises, on avait imaginé la loi du maximum, qui réglait le prix de tous les objets et ne permettait pas aux marchands de l’élever au fur et à mesure de l’avilissement du papier; on se souvient qu’à ces mesures on avait ajouté les réquisitions, qui donnaient aux représentants ou aux agents de l’administration la faculté de requérir toutes les marchandises nécessaires aux armées et aux grandes communes, en les payant en assignats et au taux du maximum. Ces mesures avaient sauvé la France, mais en apportant un trouble extraordinaire dans les échanges de la circulation.
“On a déjà vu quels étaient les inconvénients principaux du maximum: établissement de deux marchés, l’un public, dans lequel les marchands n’exposaient que ce qu’ils avaient de plus mauvais et en moindre quantité possible; l’autre, clandestin, dans lequel les marchands vendaient ce qu’ils avaient de meilleur contre de l’argent et à prix libre; enfouissement général des denrées que les fermiers parvenaient à soustraire à toute la vigilance des agents chargés de faire les réquisitions; enfin, trouble, ralentissement dans la fabrication, parce que les manufacturiers ne trouvaient pas dans le prix fixé à leurs produits les frais même de la production. Tous ces inconvénients d’un double commerce, de l’enfouissement des subsistances, de l’interruption de la fabrication, n’avaient fait que s’accroître. Il s’était établi partout deux commerces, l’un public et insuffisant, l’autre, secret et usuraire. Il y avait deux qualités de pain, deux qualités de viande, deux qualités de toutes choses, l’une pour les riches qui pouvaient payer en argent ou excéder le maximum, l’autre pour le pauvre, l’ouvrier, le rentier qui ne pouvaient donner que la valeur nominale de l’assignat. Les fermiers étaient devenus tous les jours plus ingénieux à soustraire leurs denrées; ils faisaient de fausses déclarations; ils ne battaient pas leur blé, et prétextaient le défaut de bras, défaut qui, au reste, était réel, car la guerre avait absorbé plus de quinze cent mille hommes; ils arguaient de la mauvaise saison, qui, en effet, ne fut pas aussi favorable qu’on l’avait cru au commencement de l’année, lorsqu’à la fête de l’Ètre suprême on remerciait le ciel des victoires et de l’abondance des rêcoltes. Quant aux fabricants, ils avaient tout à fait suspendu leurs travaux. On a vu que, l’année précédente, la loi, pour n’être pas inique envers les marchands, avait dῦ remonter jusqu’aux fabricants, et fixer le prix de la marchandise sur le lieu de fabrique, en ajoutant à ce prix celui des transports; mais cette loi était devenue injuste à son tour. La matière première, la main-d’œuvre, ayant subi le renchérissement général, les manufacturiers n’avaient plus trouvé le moyen de faire leurs frais, et avaient cessé leurs travaux. Il en était de même des commerçants. Le frêt pour les marchandises de l’Inde était monté, par exemple, de 150 francs le tonneau à 400: les assurances de 5 et 6 p. c. à 50 et 60. Les commerçants ne pouvaient donc plus vendre les produits rendus dans les ports au prix fixé par le maximum, et ils interrompaient ainsi leurs expéditions. Comme nous l’avons fait remarquer ailleurs, en forçant un prix il aurait fallu les forcer tous; mais c’était impossible.
“Le temps avait dévoilé encore d’autres inconvénients particuliers au maximum. Le prix des blés avait été fixé d’une manière uniforme dans toute la France. Mais la production du blé étant inégalement coῦteuse et abondante dans les différentes provinces, le taux légal se trouvait sans aucune proportion avec les localités. La faculté laissée aux municipalités de fixer le prix de toutes les marchandises amenait une autre espèce de désordre. Quand des marchandises manquaient dans une commune, les autorités en élevaient le prix; alors ces marchandises y étaient apportées au préjudice des communes voisines; il y avait quelquefois engorgement dans un lieu, disette dans un autre, à la volonté des régulateurs du tarif; et les mouvements du commerce, au lieu d’être réguliers et naturels, étaient capricieux, inégaux et convulsifs.
“Les résultats des réquisitions étaient bien plus fâcheux encore. On se servait des réquisitions pour nourrir les armées, pour fournir les grandes manufactures d’armes et les arsenaux de ce qui leur était nécessaire, pour approvisionner les grandes communes, et quelquefois pour procurer aux fabricants et aux manufacturiers les matières dont ils avaient besoin. C’étaient les représentants, les commissaires près des armées, les agents de la commission du commerce et des approvisionnements, qui avaient la faculté de requérir. Dans le moment pressant du danger, les réquisitions s’étaient faites avec précipitation et confusion. Souvent elles se croisaient pour les mêmes objets, et celui qui était requis ne savait à qui entendre. Elles étaient presque toujours illimitées. Quelquefois on frappait de réquisition toute une denrée dans une commune ou dans un département. Alors les fermiers ou les marchands ne pouvaient plus vendre qu’aux agents de la république; le commerce étant interrompu, l’objet réquis gisait longtemps sans être enlevé ou payé, et la circulation se trouvait arrêtée. Dans la confusion qui résultait de l’urgence, on ne calculait pas les distances; et l’on frappait de réquisition le département le plus éloigné de la commune ou de l’armée qu’on voulait approvisionner; ce qui multipliait les transports. Beaucoup de rivières et de canaux étant privés d’eau par une sécheresse extraordinaire, il n’était resté que le roulage, et l’on avait enlevé à l’agriculture ses chevaux pour suffire aux charrois. Cet emploi extraordinaire, joint à une levée forcée de quarante-quatre mille chevaux pour l’armée, les avait rendus très rares, et avait épuisé presque tous les moyens de transport. Par l’effet de ces mouvements mal calculés et souvent inutiles, des masses énormes de subsistances ou de marchandises se trouvaient dans les magasins publics, entassées sans aucun soin, et souvent exposées à toute espèce d’avarie. Les bestiaux acquis pour la république étaient mal nourris, ils arrivaient amaigris dans les abattoirs, ce qui faisait manquer les corps gras, le suif, la graisse, etc. Aux transports inutiles se joignaient donc des dégâts, et souvent les abus les plus coupables. Des agents infidèles revendaient secrètement, au cours le plus élevé, les marchandises qu’ils avaient obtenues au maximum par le moyen des réquisitions. Cette fraude était pratiquée aussi par des marchands, des fabricants qui, ayant invoqué d’abord un ordre de réquisition pour s’approvisionner, revendaient ensuite secrètement et au cours, ce qu’ils avaient acheté au maximum.
“Ces causes diverses, s’ajoutant aux effets de la guerre continentale et maritime, avaient réduit le commerce à un état déplorable. Il n’y avait plus de communications avec les colonies, devenues presque inaccessibles par les croisières des Anglais, et presque toutes ravagées par la guerre. La principale, Saint-Domingue, était mise à feu et à sang par les divers partis qui se la disputaient. Ce concours de circonstances rendait déjà toute communication extérieure presque impossible; une autre mesure révolutionnaire avait contribué aussi à amener cet état d’isolement; c’était le séquestre ordonné sur les biens des étrangers avec lesquels la France était en guerre. On se souvient que la Convention, en ordonnant ce séquestre, avait eu pour but d’arrêter l’agiotage sur le papier étranger, et d’empêcher les capitaux d’abandonner les assignats pour se convertir en lettres de change sur Francfort, Amsterdam, Londres, etc. En saisissant les valeurs que les Espagnols, les Allemands, les Hollandais, les Anglais avaient sur la France, on provoqua une mesure pareille de la part de de l’étranger, et toute circulation d’effets de crédit avait cessé entre la France et l’Europe. Il n’existait plus de relations qu’avec les pays neutres, le Levant, la Suisse, le Danemark, la Suède et les États-Unis; mais la commission du commerce et des approvisionnements en avait usé toute seule pour se procurer des grains, des fers et différents objets nécessaires à la marine. Elle avait requis pour cela tout le papier; elle en donnait aux banquiers français la valeur en assignats, et s’en servait en Suisse, en Suède, en Danemark, en Amérique, pour payer les grains et les différents produits qu’elle achetait.
“Tout le commerce de la France se trouvait donc réduit aux approvisionnements que le gouvernement faisait dans les pays étrangers, au moyen des valeurs requises forcément chez les banquiers français. A peine arrivait-il dans les ports quelques marchandises venues par le commerce libre, qu’elles étaient aussitôt frappées de réquisition, ce qui décourageait entièrement, comme nous venons de le montrer, les négociants auxquels le frêt et les assurances avaient coῦté énormément et qui étaient obligés de vendre au maximum. Les seules marchandises un peu abondantes dans les ports, étaient celles qui provenaient de prises faites sur l’ennemi; mais les unes étaient immobilisées par les réquisitions, les autres par les prohibitions portées contre tous les produits des nations ennemies. Nantes, Bordeaux, déjà dévastées par la guerre civile, étaient réduites, par cet état du commerce, à une inertie absolue et à une détresse extrême. Marseille, qui vivait autrefois de ses relations avec le Levant, voyait son port bloqué par les Anglais, ses principaux négociants dispersés par la terreur, ses savonneries détruites ou transportées en Italie, et faisait à peine quelques échanges désavantageux avec les Génois. Les villes de l’intérieur n’étaient pas dans un état moins triste. Nimes avait cessé de produire ses soieries, dont elle exportait autrefois pour vingt millions. L’opulente ville de Lyon, ruinée par les bombes et la mine, était maintenant en démolition, et ne fabriquait plus les riches tissus dont elle fournissait autrefois pour plus de 60 millions au commerce. Un décret qui arrêtait les marchandises destinées aux communes rebelles en avait immobilisé autour de Lyon une quantité considérable, dont une partie devait entrer dans cette ville, et l’autre la traverser seulement pour de là se rendre sur les points nombreux auxquels aboutit la route du Midi. Les villes de Châlons, Macon, Valence, avaient profité de ce décret pour arrêter les marchandises voyageant sur cette route si fréquentée. La manufacture de Sedan avait été obligée d’interrompre la fabrication des draps fins pour se livrer à celle du drap à l’usage des troupes, et ses principaux fabricants étaient poursuivis, en outre, comme complices du mouvement projeté par Lafayette, après le 10 aoῦt. Les départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de l’Aisne, si riches par la culture du lin et du chanvre, avaient été entièrement ravagés par la guerre. Vert l’Ouest, dans la malheureuse Vendée, plus de six cents lieues carrées étaient entièrement ravagées par le feu et le fer. Les champs étaient en partie abandonnés, et des bestiaux nombreux erraient au hasard sans pâture et sans étable. Partout, enfin, où des désastres particuliers n’ajoutaient pas aux calamités générales, la guerre avait singulièrement diminué le nombre des bras, et la terreur chez les uns, la préoccupation politique chez les autres, avaient éloigné ou dégoῦté du travail un nombre considérable de citoyens laborieux. Combien préféraient à leurs ateliers et à leurs champs, les clubs, les eonseils municipaux, les sections, où ils recevaient quarante sous pour aller s’agiter et s’émouvoir!
“Ainsi, désordre dans tous les marchés, rareté des subsistances, interruption dans les manufactures par l’effet du maximum, déplacements désordonnés, amas inutiles, dégâts de marchandises, épuisement de moyens de transport par l’effet des réquisitions, interruption de communications avec toutes les nations voisines par l’effet de la guerre, du blocus maritime, du séquestre; dévastation des villes manufacturières et de plusieurs contrées agricoles par la guerre civile, diminution de bras par la réquisition, oisiveté amenée par le goῦt de la vie politique: tel est le tableau de la France sauvée du fer étranger, mais épuisée un moment par les efforts inouïs qu’on avait exigés d’elle (47 )
[47] Thiers. Histoire de la Révolution française. Livre XXIII.
[48] Turgot. Sur la formation et la distribution des richesses. T. Ier, p. 59. Collection des principaux économistes. Edition Guillaumin.
[49] Le principal remède à cet abus consiste évidemment dans le développement de l’épargne et dans la multiplication des banques de dépôt à l’usage du peuple. Si l’éducation économique et morale des masses était moins négligée, si tout homme libre possédait une notion exacte et claire de l’étendue de la responsabilité qui pèse sur lui, de l’importance des obligations positives qu’il doit remplir envers lui-même et envers les siens, de la nature et de l’intensité approximative des risques auxquels ses conditions d’existence se trouvent soumises; si les forces morales indispensables pour combattre et réprimer les appétits qui le poussent à dépenser non seulement son salaire actuel, mais encore à escompter son salaire à venir, étaient, en même temps, développées davantage en lui, grâce à une culture morale plus complète et plus efficace, il gouvernerait mieux sa vie, et au lieu de se trouver presque constamment en arrière, il aurait une réserve qui lui permettrait sinon d’acheter toujours au comptant les objets de sa consommation, du moins de n’user que par exception du crédit en nature. La création des caisses d’épargne a déjà amélioré, sous ce rapport, la situation des classes ouvrières. Mais pour que les caisses d’épargne deviennent vraiment populaires, plusieurs conditions sont nécessaires: 1° Il faut qu’elles présentent la plus grande somme possible de sécurité, c’est à dire qu’elles soient sinon organisées du moins assurées par des établissements supérieurs de crédit ou d’assurances; 2° qu’elles soient complétement à la portée de leurs clients; qu’elles reçoivent les plus petites sommes, et qu’elles les remboursent en tous temps et en tous lieux, en s’ingéniant aussi à vulgariser, au moyen de publications populaires, les avantages de l’épargne, comme font les compagnies d’assurances sur la vie, par exemple. Malheureusement, les caisses d’épargne établies sur la base étroite de la philanthropie et entravées par les restrictions à la liberté des banques sont demeurées fort imparfaites. Celles qui remplissent le mieux les conditions requises sont les caisses d’épargne des bureaux de poste, instituées récement en Angleterre. L’instruction émanée de ces caisses mérite d’être reproduite comme un modèle:
Caisse d’épargne des bureaux de poste. — Quelques simples mots sur cette institution. — Avis aux hommes prévoyants et rangés.
“Si vous voulez faire des épargnes et en opérer un placement qui vous présente toute sécurité, si vous voulez ajouter facilement à vos économies et en opérer le retrait promptement et à volonté, vous pouvez en faire le versement à la Caisse d’épargne des bureaux de poste.
“Trois cents bureaux de caisses d’épargne de la poste seront ouverts le 16 septembre 1861 en Angleterre, et vous pouvez en voir la liste affichée dans tous les bureaux de poste de la Grande-Bretagne. D’autres bureaux semblables vont être incessamment ouverts, et la liste en sera de même affichée dans tous les bureaux de poste du Royaume-Uni.
“Ces bureaux seront ouverts, pour la réception et le remboursement des dépôts, tous les jours de la semaine, de neuf heures du matin à six heures du soir.
“Dans ces bureaux, vous pourrez déposer depuis un schelling (1 fr. 25) jusqu’à la somme limitée pour une année, de 30 livres sterling (750 fr.)
“En faisant votre premier versement, vous recevrez un livret numéroté où seront inscrits vos noms, adresse, profession, ainsi que la date et le montant de votre dépôt.
La couverture de ce livret portera, imprimé d’une manière claire et précise, le règlement établi par la direction générale des postes pour vous guider dans votre versement, et il est essentiel que vous en preniez connaissance avec la plus grande attention.
“Le jour où vous opérez votre versement, le chef du bureau de la poste qui le reçoit en donne avis au directeur général, et deux ou trois jours après, vous recevez une lettre imprimée de la direction centrale des postes à Londres, dans laquelle elle vous informe qu’elle a eu régulièrement avis de votre dépôt.
“Dans le cas où vous ne recevriez pas cette lettre dans les dix jours qui suivent votre versement, vous devrez en écrire au directcur général de la poste à Londres.
“Toutes les lettres qui vous seront adressées par la direction des postes devront être enfermées par vous dans un portefeuille à ce destiné que vous trouverez dans votre livret.
“Lors de chaque nouveau versement que vous ferez à la caisse d’épargne des bureaux de poste, vous aurez soin de vous munir de votre livret, afin d’y faire inscrire le montant et la date de votre nouveau dépôt, et chaque fois vous devrez prendre soin d’en recevoir de Londres l’accusé de réception.
“Pour retirer vos épargnes, vous n’aurez qu’à vous adresser au bureau de poste le plus voisin, où l’on vous remettra une demande imprimée de retrait pour le directeur général des postes à Londres. Vous aurez à remplir cette demande de retrait en vous conformant aux instructions indiquées sur la couverture de votre livret; vous y mentionnerez à quel bureau de poste vous devez toucher votre argent, et vous adresserez votre demande au directeur général des postes à Londres.
“Deux ou trois jours après, vous recevrez de la direction générale un mandat de payement pour le bureau où vous aurez désiré être payé. Vous n’aurez alors qu’à vous présenter à ce bureau, muni de ce mandat, ainsi que de votre livret, et là vous recevrez la somme que vous retirerez et que l’on inscrira avec la date de payement dans votre livret.
“Pendant tout le temps que votre épargne restera dans la caisse des bureaux de poste, vous aurez droit à un intérêt de 2 1/2 p. c.
“Toutes les lettres relatives à votre placement seront exemptes de port. Le livret numéroté vous sera aussi délivré gratis; si vous le perdez, vous aurez à payer 1 fr. 25 pour en obtenir un autre; vous devez donc en prendre grand soin, et vous ferez bien de l’enfermer dans un étui, afin de le conserver en bon état.
“En résumé, rappelez-vous:
- “1° Que si vous placez votre argent dans la caisse d’épargne des bureaux de poste, il est placé tout aussi sῦrement qu’à la Banque d’Angleterre;
- “2° Que si, après avoir fait un versement à un bureau de poste, vous changez de lieu de résidence, vous n’avez pas besoin de retirer votre argent et de l’emporter avec vous; de plus, que vous pouvez ajouter à votre épargne, en vous adressant à n’importe quel bureau de poste de l’endroit où vous allez;
- “3° Que vous pouvez recevoir le montant de vos épargnes partout où vous voudrez, quel que soit le lieu où vous en aurez fait le versement;
- “4° Que les père et mère peuvent placer des épargnes au nom de leurs enfants et que toute femme, mariée ou non, peut de même opérer des versements pour son propre compte;
- “5° Que les bureaux de poste étant ouverts pendant huit heures chaque jour de la semaine, vous pourrez choisir votre moment sans avoir à attendre ou à souffrir des inconvénients de la foule;
- “6° Que votre argent vous rapportera un intérêt minime, il est vrai, mais raisonnable, et que vous n’avez aucun frais à supporter, soit pour déposer, soit pour retirer;
- “7° Que les directeurs des bureaux de la poste ont l’ordre formel de ne révéler à qui que ce soit le nom du déposant ou le montant de la somme déposée, excepté au directeur général de la poste de Londres et à ses employés.
- “8° Si vous réfléchissez à tous ces avantages, vous comprendrez que, par l’établissement de la caisse d’épargne des bureaux de poste, le gouvernement vous a rendu un grand service, et qu’il vous est maintenant facile de mettre de côté quelque argent en le plaçant avec sécurité pour vous en servir dans les mauvais jours.”
Cependant, ces caisses d’épargne perfectionnées mêmes laissent encore â désirer, et, en admettant que le gouvernement et la philantbropie laissassent le champ pleinement libre à l’industrie privée pour recueillir et administrer les épargnes de la multitude, le système des banques du peuple serait, selon toute apparence, beaucoup plus développé et beaucoup mieux approprié au besoin qu’il s’agit de satisfaire. Abandonnées à elles-mêmes, les banques du peuple s’établiraient au centre des quartiers populeux, leurs agents ou leurs commissionnaires ne se borneraient pas à attendre les déposants, ils iraient, les jours de paie, par exemple, solliciter les dépôts à la porte des manufactures et des ateliers; la récolte des petits capitaux serait aussi active et aussi étendue que possible; enfin, les banques du peuple pourraient se charger d’effectuer des paiements pour leurs clients, peut-être même de leur faire des avances sur gages réels ou sur garantie mutuelle, de manière à les faire participer, dans la proportion de leurs facultés, au bienfait du crédit.
Les sociétés de consommation, établies pour l’achat en gros des provisions peuvent exercer également une influence bienfaisante sur le développement de l’épargne et l’amélioration, sinon la suppression, du crédit en nature Malheureusement encore, ces sociétés n’ont pu prendre nulle part une extension suffisante, à cause de la conception vicieuse qui leur a donné naissance. On en a fait, à tort, de véritables maisons de commerce, achetant des provisions en gros pour les revendre en détail, dans le cercle de la mutualité. Or, des opérations de ce genre exigent de la part du gérant ou de l’agent de l’association, une certaine capacité commerciale, elles impliquent aussi des soins de conservation pour les articles en magasin, etc., et comme ces conditions sont difficiles à réunir, du moins à peu de frais, les sociétés de consommation n’ont réussi nulle part à supplanter les intermédiaires commerciaux, comme leurs fondateurs en affichaient la prétention. Si elles s’étaient bornées à réunir un certain nombre de petits consommateurs, en adoptant le principe de la garantie mutuelle, elles eussent été certainement plus fécondes. Ces petits consommateurs associés et se garantissant les uns les autres auraient pu agir comme le fait un gros consommateur, un bon hôtelier par exemple, qui s’adresse aux meilleurs magasins de détail sans avoir la prétention de les supplanter, mais que l’on sert bien, à cause de l’importance de sa clientèle, et d’autant mieux aussi, qu’il paye plus régulièrement et à des termes plus rapprochés. Il s’agirait simplement dans une association de ce genre, de recueillir et de rassembler les demandes de chaque famille pour l’approvisionnement de la semaine, et de distribuer entre elles, en détail, les provisions achetées en bloc, partie au comptant, partie à court terme. Des sociétés de consommation, établies sur cette base, répondraient véritablement à leur titre, et, en se multipliant, elles contribueraient efficacement à améliorer les consommations de la classe ouvrière tant sous le rapport de la qualité que sous le rapport du prix.
[50] D’après les relevés faits par MM. William Newmarch et Leatham, le montant total des lettres de change circulant à la fois dans le Royaume Uni était, en 1839, de liv. 132,023,000; en 1847, il était, dans la Grande-Bretagne seule, de liv. 132,021,000, se divisant ainsi: liv. 113,161,000 pour les lettres de change de l’intérieur; liv. 18,860,000 pour les lettres de l’extérieur. (Recherches sur la circulation des lettres de change dans la Grande-Bretagne, de 1828 à 1847, par William Newmarch. — Journal des Économistes, t. XXXI, p. 62 et 135, t. XXXII, p. 35.)
[51] Tout homme constitue un capital plus ou moins considérable, selon le degré d’utilité et de rareté de ses facultés productives. Le revenu provenant du fonds de forces et d’aptitudes physiques, intellectuelles et morales, dont la Providence a gratifié, quoique fort inégalement, toutes ses créatures, mais qu’elle leur laisse le soin de défricher, de cultiver et d’exploiter elles-mémes, ce revenu n’est autre chose que le profit ou l’intérêt du capital investi dans l’individualité humaine. Quand l’homme est esclave, celui qui le possède peut, comme nous l’avons remarqué déjà, ou réaliser ce capital, ou l’exploiter pour son propre compte, ou le louer. Le propriétaire d’esclaves peut aussi, en cas de besoin, emprunter en hypothéquant son personnel de travailleurs, absolument comme un propriétaire de bétail peut emprunter sur la valeur de ses troupeaux, soit qu’il les consigne entre les mains des prêteurs, soit qu’il en conserve l’usage, sauf expropriation en cas de retard ou de non remboursement de sa dette. Eh bien, s’il est possible d’emprunter sur la valeur d’un esclave, pourquoi l’homme libre, c’est à dire propriétaire de lui-même, ne pourrait-il pas emprunter sur sa propre valeur? Le crédit que l’on accorde aux individus dont la capacité productive et la moralité sont suffisamment attestées, n’est du reste, pas autre chose qu’un crédit fondé sur le gage de la valeur personnelle de l’emprunteur, et il se proportionne presque toujours, avec une grande exactitude, à l’importance de cette garantie. Le risque de mort, c’est à dire de destruction du capital servant de gage, rend, à la vérité, le crédit personnel particulièrement chanceux; mais on peut couvrir ce risque au moyen des assurances sur la vie, et l’un des principaux obstacles au développement du crédit sur garantie de la valeur personnelle de l’emprunteur se trouve ainsi écarté. Restent encore cependant les obstacles que les lois rendues pour protéger la liberté individuelle opposent, soit à la saisie, soit à l’exploitation du capital investi dans les personnes. Si ces lois n’empêchent pas complétement le crédit personnel de se développer, elles restreignent toutefois son extension dans des limites assez étroites. On prête à des entrepreneurs d’industrie, à des négociants, quelquefois même à des hommes exerçant des professions libérales, en raison composée de leur moralité et de leur capacité industrielle, commerciale ou artistique; mais on ne prête guère à de simples ouvriers qui n’offrent que leur capacité et leur moralité pour garanties. Comme toujours, ici, l’excès de la protection tourne au détriment de l’intérêt protégé. Si l’engagement du travail était entièrement libre, si chacun pouvait donner, en garantie d’un emprunt, une quantité spécifiée de son travail futur, si la loi apportait une sanction efficace à cette espèce d’engagement, en prêtant main forte au créancier pour contraindre le débiteur à s’acquitter de ses obligations, en l’assujettissant au travail forcé jusqu’à ce qu’il eῦt remboursé sa dette, le crédit personnel ne manquerait pas de prendre une extension dont nous n’avons aujourd’hui aucune idée. Des intermédiaires, mutualités ou sociétés ordinaires, s’interposeraient entre le prêteur et l’emprunteur pour assurer le gage, et le crédit du travail prendrait la place qui lui revient à côté du crédit agricole, industriel ou commercial.
Déjà, on trouve quelques exemples de ce genre de crédit dans l’émigration par voie de contrats d’engagement.
“Pourquoi quittez-vous votre pays? disait M. A. Esquiros à des émigrants en partance pour la Nouvelle Zélande. — Il n’y a point de place pour nous dans la Vieille Angleterre. — Que comptez-vous faire à la Nouvelle Zélande? — Ce que nous pourrons. — Emportez-vous un capital? — Oui, notre courage et nos bras. — Un petit nombre d’entre eux se vantaient d’être libres, c’était assez dire que les autres ne l’étaient point. Par libres, on entend ceux qui ont payé tout leur passage, tandis que beaucoup, n’ayant donné en partant qu’un faible à-compte, doivent travailler en arrivant jusqu’à ce qu’ils aient payé le reste. Ces derniers se trouvent sous une sorte de servitude, en ce sens qu’ils sont tenus de déclarer le lieu de leur résidence dont ils ne peuvent s’écarter sans prévenir la compagnie[52] .”
Il s’agissait en ce cas d’une émigration pour un pays écarté et peu étendu, où la compagnie créancière avait, par conséquent, quelque chance de pouvoir empêcher ses débiteurs de se dérober à l’acquittement de leurs obligations. Mais quand il s’agit d’une émigration pour un pays immense et divisé en un grand nombre d’Etats, l’insuffisance des garanties légales du crédit personnel oppose un obstacle presque insurmontable à l’allocation d’avances aux émigrants, sur garantie de leur travail futur, si bienfaisant que puisse être ce système d’avances, en facilitant la mobilisation utile du travail et l’établissement de l’équilibre des salaires [53] .
Parmi les tentatives faites jusqu’à présent pour développer le “crédit personnel” la plus connue est celle dont M. Schultze Delitzsch a pris l’initiative en Allemagne par la fondation des Banques d’avances (Vorschurs-banken ou Volks-banken). C’est à Eulenbourg que le premier essai en a été fait, le ler octobre 1850. Les banques d’avances se sont rapidement propagées depuis cette époque; mais elles sont plutôt à l’usage des petits entrepreneurs, industriels ou artisans qu’à celui de la masse des ouvriers salariés. Il en sera ainsi, selon toute apparence, aussi longtemps que les “capitaux personnels” ne pourront être librement engagés et, au besoin, facilement et à peu de frais saisis et utilisés par voie de contrainte. Quoi qu’il en soit, les banques d’avances sont des associations de petits industriels, d’artisans, etc., qui empruntent, sur le principe de la garantie mutuelle, des capitaux qu’elles prêtent ensuite à leurs membres, selon la mesure des garanties morales et matérielles offertes par chacun. M. Schultze Delitzsch évaluait le nombre de ces banques de la petite industrie à 150 en 1859 et le chiffre de leurs opérations de 6 à 8 millions de th. (Annuaire international du crédit public pour 1860, par J.-E. Horn, p. 309. Les Banques d’avances et de crédit, par H. Schultze Delitzsch.)
[52] L’Angleterre et la vie anglaise. L’or et l’argent dans la Grande Bretagne, par Alph. Esquiros. Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1862.
[53] Voir au sujet du développement possible de ce système d’avances et de ses applications, Questions d’économie politique et de droit public. L’abolition de l’esclavage, t. ler, p. 130.
[54] Les qualités morales constituent les garanties les plus essentielles du crédit. Que l’emprunteur manque de probité ou simplement d’exactitude, qu’il ait un goῦt exagéré pour la dépense, qu’il soit paresseux, débauché, et il réussira difficilement à se procurer un capital, quelles que soient, du reste, son intelligence et son aptitude aux affaires. Dans les pays où la moralité est peu répandue, le crédit est peu développé, car les garanties matérielles ne suppléent qu’imparfaitement aux garanties personnelles. Dans ces pays, la prime destinée à couvrir le risque du prêt est très élevée; le crédit est cher, partant restreint. D’un autre côté, les précautions méticuleuses qui sont nécessaires pour obvier au manque de foi des emprunteurs constituent encore autant d’obstacles à l’extension du crédit. On voit par là quel rôle considérable jouent les qualités morales dans la production de la richesse. Sans crédit, en effet, point de production développée, et sans qualités morales, point de crédit.
Il y a des populations qui sont naturellement plus morales que d’autres, comme il y en a de plus intelligentes et de plus belles. C’est une remarque assez vraie de Montesquieu qu’il existe moins de moralité naturelle dans le Midi que dans le Nord. “Vous trouverez, dit-il, dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même; des passions plus vives multiplieront les crimes, chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. . .; la plupart des châtiments y seront moins difficiles à soutenir que l’action de l’âme, et la servitude moins insupportable que la force d’esprit qui est nécessaire pour se conduire soi-même [55] .”
Cette observation n’est pas vraie toutefois d’une manière absolue; elle comporte de nombreuses exceptions. A quoi il faut ajouter que les qualités morales comme les facultés intellectuelles sont susceptibles de se développer par la culture. Malheureusement, la culture morale de l’homme laisse encore beaucoup à souhaiter. Le clergé qui en est principalement chargé, néglige presque partout l’enseignement de la morale appliquée. C’est seulement dans les pays où plusieurs cultes se font une pleine concurrence, que la culture morale occupe la place qui lui revient dans l’éducation. Envisagée à ce point de vue, la liberté des cultes acquiert, il est à peine nécessaire de le dire, une immense importance économique.
Remarquons encore que la nécessité d’une bonne culture morale se fait sentir davantage à mesure que l’industrie se développe et s’organise sur un plan plus vaste. Lorsque les machines et les procédés de la production étaient encore dans leur état d’imperlection et de grossièreté primitives, lorsque les débouchés étaient peu étendus par suite de la difficulté et de la cherté des communications, les limites et l’importance des entreprises étaient naturellement restreintes. Il suffisait alors d’un faible capital pour constituer et alimenter une entreprise. Mais, de nos jours, la situation a changé. L’outillage et les procédés de la production ont reçu l’impulsion énergique du progrès et les débouchés acquièrent une étendue de plus en plus vaste, grâce à l’abaissement successif des obstacles naturels et artificiels qui morcelaient jadis le champ de la consommation. Les entreprises doivent s’agrandir en conséquence. Elles exigent maintenant, de plus en plus, des capitaux tellement considérables, que la fortune d’un particulier ne pourrait y suffire, en admettant même qu’il consentît, chose peu sage, à engager tous ses fonds dans une seule affaire. Dans ce nouvel état de la production, l’association et le crédit deviennent donc chaque jour plus nécessaires. Or, les qualités morales sont les bases sur lesquelles reposent l’association aussi bien que le crédit, et le temps n’est pas loin où la supériorité industrielle d’un peuple apparaîtra comme le criterium de sa moralité.
Après les qualités morales viennent les facultés intellectuelles. Il ne suffit pas, en effet, de mériter la confiance par sa probité, son exactitude scrupuleuse, son esprit d’économie, pour obtenir l’usage d’un capital, il faut encore, pour faire fructifier ce capital, être suffisamment pourvu d’intelligence; il faut, selon l’expression consacrée, être doué de l’esprit des affaires. Sinon, qu’arrivera-t-il? C’est que l’on dirigera mal son entreprise; c’est que l’on fera de mauvaises opérations et que l’on compromettra l’existence du capital emprunté. L’esprit des affaires ne se compose pas, au surplus, seulement d’une réunion de certaines facultés intellectuelles, il se compose aussi de certaines qualités morales, telles que la fermeté, la prudence, etc. L’association de ces qualités diverses et peu communes est indispensable pour former un bon entrepreneur ou un bon directeur d’industrie.
En résumé, la moralité et l’intelligence ou l’aptitude aux affaires, telles sont les garanties personnelles requises de l’emprunteur, et nécessaires au développement du crédit.
Aux garanties personnelles se joignent les garanties réelles ou matérielles. Celles-ci résident dans les biens mobiliers ou immobiliers que possèdent les emprunteurs et qu’ils peuvent engager pour garantir leurs emprunts. Quand la propriété de ces biens peut être clairement établie, quand aucun obstacle provenant des coutumes ou des lois ne s’oppose à ce qu’ils soient engagés ou hypothéqués, quand l’engagement et l’hypothèque ne sont point soumis à des formalités lentes et coῦteuses, ou bien encore rendus incertains et précaires par les défectuosités de la législation, les garanties réelles ou matérielles fournissent un utile et notable supplément aux garanties personnelles et elles contribuent pour une large part à la diffusion du crédit.
Communément, ces deux sortes de garanties se présentent associées dans une certaine mesure, quoique dans des proportions fort diverses. On prête des capitaux en raison et des garanties personnelles et des garanties réelles ou matérielles qui sont offertes par les emprunteurs. Il est rare que l’on prête une somme importante à un homme qui n’a que des garanties personnelles à offrir. Il est rare aussi que l’on prête à celui qui n’offre que des garanties matérielles et dont on suspecte la moralité, car on peut toujours redouter de sa part la chicane et la fraude.
La législation peut entraver ou faciliter, dans une large mesure, le développement du crédit, selon qu’elle interdit ou qu’elle autorise, en lui apportant sa sanction, l’emploi des garanties qui servent de base aux transactions des prêteurs et des emprunteurs. S’agit-il des garanties personnelles? Il convient que la loi apporte une sanction positive et inéludable aux engagements contractés, tout en laissant aux contractants la liberté la plus entière, quant à la nature même des stipulations. La loi ancienne allait jusqu’à autoriser le créancier à s’emparer de la personne du débiteur, à défaut d’un autre gage, et de la réduire en esclavage. La loi moderne permet seulement au créancier de faire mettre son débiteur en prison. On s’est, de tous temps, beaucoup élevé contre ces dispositions légales qui permettent au créancier de s’emparer de la personne du debiteur ou de la faire mettre sous le séquestre. On les a considérées comme excessives et inhumaines. Mais on n’a vu, croyons-nous, que les maux qu’elles entraînaient sous l’empire de certaines circonstances extérieures, sans considérer les avantages qu’elles procuraient aux débiteurs eux-mêmes. Bien des emprunts, commandés par une nécessité impérieuse, n’auraient pu être contractés si les emprunteurs, dépourvus de garanties matérielles, n’avaient pas été autorisés à s’engager de leurs personnes; s’ils n’avaient pu offrir comme garantie à leurs créanciers ce bien précieux que l’on nomme la liberté. On manquait rarement d’accuser la loi, quand les débiteurs étaient contraints de se livrer à leurs créanciers, faute de pouvoir satisfaire à leurs engagements, mais n’était-ee pas bien plutôt l’imprévoyance des débiteurs qu’il aurait fallu accuser? En cette matière comme en beaucoup d’autres, la loi ne doit, au surplus, rien prescrire. Elle doit se borner à sanctionner les engagements contractés, pourvu que ces engagements ne portent aucune atteinte aux lois éternelles de la morale, lesquelles sont toujours en harmonie avec celles de l’économie politique.
S’agit-il des garanties réelles ou matérielles? La loi doit faciliter, autant que possible, l’accession à ce genre de garanties. Voulez-vous, par exemple, engager des marchandises ou n’importe quel objet mobilier? Il convient que la loi vous laisse faire; qu’elle vous permette de disposer à votre guise de vos marchandises ou de vos effets mobiliers pour les engager comme pour les vendre, en se bornant à vous assister au besoin pour recouvrer votre gage, lorsque vous vous êtes acquitté de vos obligations. Voulez-vous hypothéquer des biens immobiliers? Il convient encore que la loi vous accorde à cet égard toute facilité; que vous puissiez engager à volonté votre champ, votre atelier ou votre maison, comme les marchandises qui remplissent vos magasins, les outils qui garnissent votre atelier, les meubles qui ornent votre demeure et la montre même que contient votre gousset. Mais ici l’engagement ou l’hypothèque exige quelques formalités de plus à cause de la nature immobilière de l’objet engagé ou hypothéqué. Quand vous fournissez un objet mobilier comme garantie d’un emprunt, cet objet passe communément de vos mains entre celles du prêteur ou d’un tiers dépositaire, et vous en perdez l’usage. Cette collocation du gage au prêteur est indispensable, à cause de la nature mobilière de la chose engagée. Mais il en est autrement lorsqu’il s’agit de biens immobiliers. Ceux-ci peuvent demeurer, en vertu de leur nature même, entre les mains de l’emprunteur, car il ne peut ni les détruire ni les emporter. Il suffit que le prêteur soit assuré en premier lieu que le gage qui constitue sa garantie ne se trouve point déja grevé d’hypothèques pour le montant de sa valeur; en second lieu, que ce gage lui sera livré, sans difficultés, en cas de non-exécution des engagements contractés. La loi devrait s’attacher, en conséquence, à rendre, d’une part, la situation des biens immobiliers aussi claire que possible, à empêcher qu’ils ne pussent être grevés ou hypothéqués d’une manière occulte; d’une autre part, elle devrait rendre l’expropriation de ces mêmes biens aussi expéditive et aussi peu coῦteuse que possible.
Malheureusement, la législation au lieu de faciliter l’engagement des biens immobiliers semble, au contraire, s’être proposé pour but de l’entraver. Cela tient aux circonstances économiques et sociales de l’époque où cette l’égislation a pris naissance. Ces circonstances ont changé; la législation est demeurée la même.
Dans l’antiquité, la production encore à l’état embryonnaire n’exigeait, que dans une faible mesure, le concours du crédit. Le crédit de la production était peu développé. Le credit de la consommation seul avait pris quelque extension. Or celui-ci était la source de nombreux abus. Trop souvent, des jeunes gens imprévoyants empruntaient pour satisfaire leurs appétits déréglés, et quand les garanties personnelles qu’ils pouvaient offrir ne suffisaient pas, ils engageaient leur patrimoine. La loi essaya de mettre un terme à ce genre d’abus en hérissant de difficultés l’accession aux garanties réelles. Ces difficultés, on les multiplia encore plus pour les biens immobiliers que pour les biens mobiliers, car ceux-là constituaient, en vertu de leur nature même, la partie la plus solide du patrimoine des familles, et, en vertu de la situation économique des sociétés anciennes, ils en étaient aussi la partie la plus considérable. Les obstacles dont la législation environnait le prêt sur hypothèque avaient pour résultat de restreindre ce geure de prêts, en diminuant la valeur des garanties matérielles que pouvaient offrir les emprunteurs.
Peut-être cette législation, dont le caractère était, remarquons-le bien, purement somptuaire, avait-elle sa raison d’être à une époque où l’on n’empruntait guère que pour consommer et où l’imprévoyance était un défaut commun à toutes les classes de la société. Mais, de nos jours, la situation économique de la société a bien changé. La production, dans toutes ses branches, exige impérieusement le concours du crédit: le crédit de la production ’emporte de plus en plus sur celui de la consommation, en sorte que les obstacles opposés à l’engagement des propriétés, en retardant le développement du crédit causent à la production un dommage de plus en plus considérable. Le bien que ces obstacles peuvent faire en opposant un frein à l’imprévoyance est insignifiant en comparaison du mal qu’ils causent en ralentissant l’essor de l’industrieuse activité des peuples. Le moment est donc venu d’abandonner cette législation surannée qui renchérit artificiellement le crédit. (Des Conditions et du mécanisme du crédit, par G. de Molinari (1er article). Messager russe de Moscou, 1858.)
[55] De l’Esprit des lois. Liv. XIV, chap. VI.
[56] Voir les Questions d’économie politique et de droit public. De la production de la sécurité. T. II, p. 245.
[57] Des hommes qui courent des chances pareilles, dit M. Horace Say, se réunissent et s’associent pour supporter en commun la perte éventuelle, indépendante de toute volonté qui pourrait frapper l’un d’entre eux. Chacun consent ainsi, à l’avance, à prendre à sa charge une perte partielle et faible pour obtenir en échange d’être garanti lui-même des conséquences d’une perte éventuelle totale. Que l’on donnc ensuite au payement que chacun fait, le cas éventuel arrivant, le nom de cotisation ou de prime, il n’y en a pas moins au fond de toute assurance un véritable contrat d’association mutuelle. (Horace Say, Dictionnaire de l’économie politique, article Assurances.)
[58]
“Les premiers monts-de-piété, dit M. Horace Say, furent établis en Italie de 1462 à 1490, dans les villes de Pérouse, de Savone, de Mantoue et de Florence. Ils prêtaient d’abord gratuitement, mais, par cela même, leur action était restreinte. Les fonds fournis par la charité sont toujours insuffisants pour satisfaire à des demandes nombreuses et fournir à des opérations de longue durée.
Dès 1493, des moines franciscains fondèrent des monts-de-piété où l’on prêtait à 5 et 6 p. c. d’intérêt.
L’Eglise ayant pendant longtemps proscrit le prêt à intérêt, de vives discussions ne manquèrent pas de s’élever sur ce que ces nouvelles institutions pouvaient avoir d’irrégulier. Le débat fut porté au concile de Latran; et, en 1515, une bulle du pape Léon X approuva solennellement le système des nouveaux monts-de-piété. Ils se multiplièrent de plus en plus en Italie; celui de Rome devint célèbre; ce fut une véritable banque, où les riches placèrent leurs capitaux, les pères de famille leurs épargnes destinées à former la dot de leurs filles, et où les malheureux trouvèrent à emprunter sur gages à des conditions plus avantageuses que celles qu’ils avaient dῦ jusque - là subir.
Des monts-de-piété se fondèreut bientôt également dans la plupart des villes commerçantes des Pays-Bas, et presque partout ils avaient le caractère mixte de banques pour le commerce et d’établissements charitables. Ils prétaient généralement à un taux élevé. L’institution fut plus tard régularisée par de judicieuses mesures prises de 1609 à 1621 sous le gouvernement d’Albert et d’Isabelle. Le taux de 15 à 18 p. c. fut toujours cependant nécessaire pour permettre de servir les intérêts aux bailleurs de fonds et pour couvrir les dépenses de toute nature de ces établissements.
Malgré un premier essai tenté dès l’origine dans la petite ville de Salins, la France n’imita pas cependant l’Italie et les Pays-Bas dans leur empressement à créer des monts-de-piété. Les ordonnances se succédaient pour défendre l’usure et pour régulariser les formes du contrat de nantissement; mais il faut arriver jusqu’à Louis XIII pour trouver un premier essai sérieux de fondation d’un mont-de-piété à Paris; encore une mauvaise organisation financière et l’insuffisance des capitaux arrêtèrent-elles le développement de l’institution. La même tentative fut, sans plus de succès, renouvelée sous le règne suivant. Le mont-de-piété de Paris ne remonte donc pas plus haut pour sa fondation qu’aux lettres patentes du 9 décembre 1777, première année du ministère de Necker.” Horace Say, Dictionnaire de l’Économie politique, art. Monts-de-piété.
Empruntons encore quelques renseignements complémentaires sur les monts-de-piété à l’analyse d’un “Rapport sur l’administration des montde-piété, par M. Ad. de Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance en France (1850).”
A dater de l’époque de leur fondation, ces établissements se multiplièrent rapidement: on en comptait déjà vingt-deux en 1789. Leurs opérations furent arrêtées par un décret de confiscation du 23 messidor an II. Ils furent aussitót remplacés par des maisons de prêt sur gage. Les perturbations causées par le papier monnaie et l’absence d’une police efficace ayant amené de graves abus dans le prêt sur gages, une loi du 16 pluviôse an XII intervint pour réorganiser les monts-de-piété. Malheureusement, les auteurs de cette loi crurent qu’il n’y avait autre chose à faire pour empêcher les abus de la liberté du prêt sur gages, que de la supprimer. Le premier article de la loi de l’an XII est ainsi conçu: “Aucune maison de prêts sur nantissements ne pourra être établie qu’au profit des pauvres et avec l’autorisation du gouvernement.” En outre, défense formelle était faite d’établir des monts-de piété par actions. Les communes et les hospices étaient tenus d’en faire les fonds, à l’exclusion des particuliers. C’est à cette interdiction qu’il faut attribuer le peu de développement que le prêt sur gages a pris en France. A la vérité, le prêt sur gages interlope supplée à l’insuffisance des monts-de-piéte. A Paris même, il existe un assez grand nombre de maisons de prêt clandestines, qui font une concurrence active à l’établissement privilégié.
D’après les documents recueillis par M. de Watteville, les quarante-cinq monts-de-piété existant en France en 1850 pouvaient disposer d’un fonds de roulement de 35,103,648 fr. ainsi composé: fonds appartenant aux montsde-piété, 2,859,135 fr.; aux hospices, 4,460,615 fr.; emprunts à des particuliers, 22,641,356 fr.; cautionnements, 4,120,554 fr.; fonds pupillaires, bonis non réclamés, 1,175,987 francs. La plus grande partie des fonds avec lesquels opèrent les monts-de-piété appartiennent donc à des particuliers. En général, les monts-de-piété empruntent à d’excellentes conditions. Dans les temps ordinaires, le mont-de-piété de Paris ne paye pas plus de 3 p. c. et il a emprunté même à 2 1/2. A Paris, les emprunts du mont-de-piété se font par des bons à un an de date. Ces bons sont de 250 fr., 500 fr., 1,000 fr. et 10,000 fr. Les prêteurs qui appartiennent presque tous au petit commerce parisien préfèrent le placement sur le mont-de-piété même au placement sur l’État. Cinq monts-de-piété prêtent gratuitement, 24 capitalisent leurs bénéfices pour augmenter leur fonds de roulement ou leur dotation, 13 versent leurs bénéfices dans les caisses des hospices ou des bureaux de bienfaisance, 3 partagent leurs bénéfices avec les administrations charitables. Les recettes de ces 45 monts-de-piété se sont élevées, en 1847, à 3,051,129 fr. Dans cette somme, les intérêts et droits prélévés sur les emprunteurs sont compris pour 2,852,929 fr. Les dépenses totales ont été 2,457,321 fr.; ce qui donne un bénéfice de 665,808 fr. Sur cette somme, 274,246 fr. ont été versés aux hospices et aux administrations hospitalières dont les monts-de-piété dépendent. Le nombre des engagements effectués dans le cours de l’année 1847 a été de 3,400,787, représentant une valeur de 48,922,261 fr. A lui seul, le mont-de-piété-de Paris a fait plus d’affaires que tous les autres réunis: il a eu 1,578,348 nantissements sur lesquels il a prêté 28,108,810 fr. Il y a une grande diversité dans le taux des prêts. A Grenoble, à Montpellier, à Parayle-Monial et à Toulouse, on prête gratis; à Avignon et à Brignoles, le taux est de 4 p. c.; à Toulon, de 7 p. c.; à Bordeaux et à Paris, de 9 1/2 p. c. (non compris 3 p. c. pour les engagements effectués par l’entremise des commissionnaires); à Besançon, Boulogne, Brest, etc., de 12 p. c.; enfin à Cambrai et à Douai, le taux s’élève jusqu’à 15 p. c. La moyenne est de 8 p. c. environ. La moitié des prêts n’ont qu’une valeur de l à 5 fr.; plus des deux tiers n’ont pas atteint celle de 10 fr., 748 seulement se sont élevés au dessus de 1,000 fr. et 33 ont dépassé 5,000 fr. Il y en a eu un de 60,000 fr. à Paris. Le prêt le plus élevé dont on ait conservé le souvenir a eu lieu en 1813, il était de 200,000 fr. La moyenne générale des prêts est de fr. 16-80. Mais cette moyenne varie beaucoup selon les localités; à Cambrai elle n’est que de fr. 4-22 et à Valenciennes de fr. 4-26, tandis qu’elle s’élève à fr. 46-39 à Toulouse et à fr. 59-18 à Montpellier. Le minimum des prêts varie aussi d’une manière notable; il n’est que de 50 c. à Bergues, de l fr. à Angers, à Nancy, à Lunéville, etc.; à Paris, à Marseille, au Havre, il est de 3 fr.; à Grenoble et à Nîmes, de 5 fr., et de 6 fr. à Nantes. La durée moyenne des prêts est de 7 mois 1/2. Cette durée varie beaucoup, selon la nature des populations. Dans les villes de fabrique et dans les villes de passage, elle est très courte. A Douai, elle n’est que d’un mois, à Lille de 3 mois, au Havre de 4. La durée des prêts dépend beaucoup aussi du taux de l’intérêt. Dans les villes où l’on prête gratuitement ou à petit intérêt, la durée des prêts est naturellement très longue; à Apt, elle est de 30 mois; à Montpellier, de 18; à Toulouse, de 12. Lorsque le nantissement n’est pas renouvelé ou retiré en temps utile, on le met en vente; la proportion moyenne de ces ventes est de 5 p. c.
Il est assez difficile de savoir quelles classes recourent le plus souvent au mont-de-piété. Sur ces 45 établissements, 24 n’ont pu donner de renseignements à cet égard. Voici le résultat des recherches partielles qui ont été faites par M. de Watteville: les commerçants, fabricants et marchands ont contracté 152,776 prêts; les rentiers et propriétaires, 49,936; les personnes exerçant des professions libérales, 40,248; les employés, 23,134; les militaires, 7,151; les ouvriers et les journaliers, 909,993. A Avignon, les rentiers et les propriétaires forment la classe la plus nombreuse des engagistes; à Lille, le nombre des négociants qui ont eu recours au mont-de-piété est aussi considérable qu’à Paris. Les localités dans lesquelles les monts-depiété ont prêté les sommes les plus considérables aux ouvriers sont les villes de riches fabriques comme Lyon, Avignon et Paris. Il ne paraît pas que les monts-de-piété contribuent à favoriser la dissipation, comme on les en a souvent accusés. Les engagements sont généralement moins nombreux la veille des jours fériés que les autres jours; le nombre des engagements relevés le samedi n’a été que de 477,926, tandis que les dégagements s’élevaient au chiffre de 667,058. D’après tous les renseignements recueillis, l’immense majorité des engagements servent à soulager des misères ou des gênes réelles.
En Hollande, les monts-de-piété sont généralement exploités au profit des villes. C’est le pays où ces établissements sont le plus nombreux. On n’en comptait pas moins de 108 en 1850, dont 74 sont affermés à des entrepreneurs, les autres sont dirigés par les communes elles-mêmes ou les établissements de bienfaisance. Il existe, en outre, des banques de petits prêts dépendantes des monts-de-piété, et qui à Amsterdam seulement sont au nombre de 60.
“Avant 1840, dit M. Watteville, le prêteur pouvait avancer 10 et 20 centimes. Depuis cette époque, le minimum a été fixé à 30 centimes et le maximum à 1 franc 40 centimes, et toujours par progression de dix centimes. Des avances supérieures sont interdites sous peine disciplinaire; mais cette disposition est facilement éludée au moyen de la division du gage. Ainsi, on prête 1 franc 40 centimes sur une casserole, et 1 fr. 40 sur son couvercle. Une reconnaissance triangulaire et de très petite dimension est délivrée à l’emprunteur. Les nantissements ne sont pas portés au grand mont-de-piété. Ils sont conservés chez le prêteur.
C’est un curieux spectacle que le magasin d’un prêteur, à raison de la variété des nantissements. On y voit des souliers, des bibles, des chapeaux, des babouches, des marmites, des guenilles de toutes couleurs, des pipes, des vieilles ferrailles, etc., le tout méthodiquement rangé, aligné, étiqueté avec l’ordre et la propreté qui caractérisent le Hollandais; c’est l’échoppe du marchand de bric-à-brac du Temple transformée en musée.
La durée de l’engagement est de trois mois, et le taux de l’intérêt qui varie de 25 à 34 p. c. par an, selon le montant des prêts, est fixé pour ce terme; mais comme la durée ordinaire des prêts n’est que de six semaines, il s’élève en réalité à 56 1/3 p. c. en moyenne. Beaucoup de ces petits prêts sont hebdomadaires. Les juifs principalement engagent des parties de leurs habillements le samedi soir et les dégagent le vendredi avant le coucher du soleil pour célébrer le sabbat. L’intérét s’élève alors à un taux énorme. La moyenne des petits prêts pendant chacune des années 1846, 1847 et 1848 a été de 889,142 articles [59] .”
Cette grande multiplication des établissements de prêts sur gage en Hollande trouve son explication dans l’esprit de calcul et d’économie qui caractérise la nation. Ailleurs, on s’entr’aide davantage, en cas de nécessité, et il existe une espèce de mutualité de crédit gratuit qui supplée, en partie, au crédit intéressé. En Hollande, et, en général, chez les nations économes et prudentes, qui ont les défauts de ces qualités, les abeilles ne peuvent guère compter sur l’assistance des fourmis. Car:
La fournu n’est pas prêteuse.
Le mont-de-piété est donc la ressource ordinaire des abeilles et parfois aussi des fourmis dans l’embarras.
Dans les autres pays, l’Angleterre exceptée, les monts-de-piété constituent également des monopoles exploités soit au profit des villes soit au profit des établissements de bienfaisance. En Belgique, il existe 22 monts-de-piété, prêtant à des taux divers, de 6 à 24 p. c. Les fonds à l’aide desquels ils opèrent sont fournis par les administrations publiques de bienfaisance. Les bénéfices, payement fait des intérêts et des frais, sont employés à grossir la dotation des monts-de-piété, et le surplus doit être versé aux établissements de bienfaisance. Les prêts sur marchandises neuves ne peuvent excéder 1,000 fr. (Loi du 30 avril 1848). En Angleterre, il n’existe pas de monts-de-piété, organisés par privilége; mais l’industrie des pawn brokers (prêteurs sur gage) est étroitement réglementée; une loi du 28 juillet 1800 fixe notamment un maximum pour le taux de l’intérêt; enfin, les restrictions opposées à la liberté des banques combinées avec cette réglementation spéciale ont jusqu’à présent entravé le développement économique des institutions de prêt sur gage.
En définitive, les monts-de-piété sont les banques des pauvres ou des nécessiteux, et l’on n’y a recours, d’habitude, que lorsqu’on a épuisé toutes ses ressources. Il serait donc à souhaiter que ces banques de la misère présentassent un maximum de sécurité, et qu’elles fournissent leur crédit au meilleur marché possible. Ce double résultat a-t-il été atteint par le régime de privilége sous lequel elles se sont établies? En aucune façon. Les monts-de-piété sont loin d’offrir une sécurité entière. Récemment encore, le mont-de-piété de Louvain a fait une banqueroute de 300,000 fr., causée par l’infidélité d’un administrateur. D’un autre côté, ils prêtent à un taux généralement usuraire, en se faisant payer 12 p. c. et davantage les capitaux qu’ils se procurent à 3 ou 4 p. c., sans avoir, du reste, presque aucun risque à courir, puisqu’ils ne prêtent que sur une faible partie de la valeur des gages. Enfin. les emprunteurs qui subissent cette usure sont traités comme de véritables mendiants par les employés des monts-de-piété; on leur fait attendre leur tour parfois pendant des heures dans des locaux infects, on rudoie ceux dont les “gages” sont insuffisants, etc., etc. — On objecte, à la vérité, que les bénéfices usuraires des monts-de-piété privilégiés sont versés, pour la plus grosse part, dans les caisses des établissements de bienfaisance; mais l’immoralité en est-elle moindre? En prélevant sur les malheureux qui ont recours aux monts-de-piété une taxe égale à la différence du taux auquel ils empruntent, sous le régime du monopole soi-disant philanthropique du prêt sur gage, et du taux auquel ils pourraient emprunter sons un régime de liberté du prêt, que fait-on en définitive? On prélève, au moyen du privilége des monts-de-piété, une taxe des pauvres sur les pauvres, au moment même où ils subissent les plus rudes atteintes de la misère, au moment où ils sont obligés de se dépouiller de leurs effets d’habillement ou même de se défaire de leurs matelas pour se procurer un morceau de pain. Ce trait ne peint-il pas la philanthropie officielle?
[59] Rapport sur l’administration des monts-de-piété, par M. Watteville, p. 99.
[60] Les monts-de-piété sont demeurés pendant longtemps les seuls établissements de prêt sur gage mobilier. Ce n’est guère que depuis la fondation des docks en Angleterre que le crédit sur marchandises entreposées a été appliqué aux opérations commerciales. On trouvera à cet égard quelques renseignements intéressants dans la savante introduction que M. Maurice Block a placée en tête du “Traité des magasins généraux (docks) et des ventes publiques de marchandises par M. Damaschino.”
“Ce sont, dit M. Maurice Block, les nombreux vols commis sur les navires chargés de denrées coloniales, stationnant dans la Tamise, qui ont fait naître l’idée de construire les premiers docks de Londres, c’est à dire des bassins à flot entourés de magasins spacieux et solides. C’est ainsi qu’une compagnie s’est fondée, en 1799, pour la construction du West India dock qui fut livré au commerce en aoῦt 1802. Cette compagnie obtint du Parlement le privilége de recevoir tous les navires qui arrivent des Indes occidentales ou y allant, et d’emmagasiner toutes les marchandises d’importation de cette provenance. Les avantages considérables qui résultèrent de cette fondation et qu’on a évalués à 18 p. c. sur les manutentions, le magasinage et les déchets inévitables dans l’ancien mode de déchargement ne tardèrent pas à devenir évidents. On se hâta donc de les multiplier. On construisit successivement le London dock (1805), l’East India dock, le Commercial dock, le Surrey dock, le Catherine dock (1829), et, en dernier lieu, le Victoria dock (1855). Des établissements semblables ont été créés dans d’autres villes du Royaume-Uni.
Quelle que soit l’utilité des bassins à flots et à niveau constant, c’est surtout comme magasins publics que les docks de Londres ont rendu d’immenses services au commerce. Responsables des navires et des marchandises qu’elles admettent, les compagnies ont dῦ établir un système régulier d’enregistrement, se charger de toute main-d’œuvre dans l’intêrieur des magasins, et même de toute agence auprès de l’administration des douanes. La régularité du payement des droits, la sécurité offerte par une enceinte bien close et surveillée avec soin, la précision avec laquelle fonctionne une organisation bien entendue, n’ont pas tardé à procurer aux docks les priviléges d’un entrepôt de douane, c’est à dire la faculté de n’acquitter les droits qu’à la sortie des marchandises.
Les magasins publics ont dispensé les négociants de Londres d’avoir des magasins particuliers, et ont ainsi diminué considérablement leurs frais généraux; ils ont de plus multiplié l’intervention du crédit, sans qu’en réalité on ait eu pour cela à généraliser l’usage de cette chose vague et indéfinissable qu’on nomme confiance. Voici comment:
On sait qu’à Londres le numéraire et même les effets de commerce n’interviennent que fort peu dans les transactions. Chaque négociant dépose chez son banquier, qu’on nomme aussi caissier, soit directement soit par l’intermédiaire d’un courtier, toutes les valeurs, espèces, lingots, effets de commerce ou publics qu’il encaisse. Dans le plus grand nombre de cas, lorsqu’il a un payement à faire, il donne un chèque (mandat à vue) sur son caissier; ses débiteurs se libèrent envers lui de la même manière. Les banquiers se chargent du recouvrement, sur leurs confrères, des mandats qui leur sont apportés par leurs clients, et effectuent ainsi les payements de ces derniers. Généralement, comme tous les jours chaque banquier reçoit des mandats sur plusieurs autres, il suffit, pour opérer ces recouvrements et ces payements, de compenser les créances et de porter plusieurs sommes d’un compte à un autre. Il existe à Londres un établissement fondé en 1775 où un certain nombre de maisons de banque entretiennent chacune un commis à demeure et y envoient tous les jours les chèques qu’elles reçoivent, afin que les virements puissent être opérés et les différences soldées sans délai. Cet établissement, connu sous le nom de clearing house (bureau de compensation ou de virements) n’admet actuellement qu’une trentaine de banquiers, pour la plupart descendants ou successeurs des fondateurs, et en exclut, par jalousie de métier, dit-on, beaucoup de nouvelles maisons très solvables. Néanmoins, les virements opérés dans le clearing house ont atteint, en 1857, 1,900,000,000 de liv. st. (47 milliards de francs) et il ne faut, pour le solde de cette somme, qu’environ 7 p. c. de son montant. Il n’a même fallu que 5 p. c. au clearing house de New York et de Philadelphie.
Le crédit ou compte courant ouvert à un négociant est en rapport avec le montant des valeurs qu’il a déposées chez le banquier. L’idée de virement est exclusive de tout découvert. Il est donc important pour le commerçant d’avoir en dépôt chez son caissier la plus grande somme possible. Or, la fortune d’un négociant, sur laquelle repose en grande partie sa solvabilite et par conséquent la confiance qu’il inspire, consiste principalement en marchandises en magasin ou en entrepôt. Selon la nature de son commerce, ces marchandises peuvent immobiliser le capital pendant un temps, et rendre ainsi le négociant momentanément moins solvable. En effet, une marchandise qu’on ne peut pas convertir facilement et sans délai en numéraire possède une bien moindre puissance, tant comme garantie que comme capital. Un fabricant de machines travaillant pour un filateur aimera mieux entendre parler de numéraire déposé chez le banquier que de coton emmagasiné au Havre ou à Liverpool. Eh bien, en Angleterre, on est parvenu à rendre ce coton équivalant à des espèces. Le moyen est de la plus grande simplicité. Lè propriétaire du coton se borne, à cet effet, à déposer chez son courtier ou chez son banquier la reconnaissance, le récépissé, en anglais le warrant, délivré par l’administration du magasin public dans lequel la marchandise est déposée. L’endossement du warrant opère le transfert de la marchandise, qui peut être, au besoin, vendue aux enchères publiques sans formalité et sans délai. Le banquier ne risque donc rien en augmentant le compte courant du négociant en proportion de la valeur approximative de la marchandise représentée par le warrant.
Les magasins publics, d’ailleurs, ne diminuent en rien, pour le uégociant, les chances de vente. S’il n’a pas la marchandise sous la main, il a, ce qui vaut mieux à certains égards, ce qui du moins est plus commode, 1° un récépissé authentique (warrant) indiquant la nature, le poids, l’origine, etc., de la denrée; 2° des échantillons pris sans son intervention, par l’administration du magasin et en présence du courtier, au moment de la réception de la marchandise. La vente s’opère sur échantillon, et au moyen du transfert du warrant, si la totalité de la marchandise est vendue. Au besoin, un warrant peut être échangé contre plusieurs titres relatifs chacun à une partie de la quantité primitive.
Les six grands docks de Londres ne sont pas les seuls magasins publics qui délivrent des warrants négociables. Londres possède encore cinq legal quays qui sont de véritables docks dont la Tamise représente le bassin; ils tirent leur nom de la faculté d’entrepôt qui leur a été accordée. On compte, en outre, quatre-vingt-sept sufferance wharves ou quais de tolérance, dont les priviléges sont fixés par l’administration des douanes. Il existe encore des caves dites bonded vaults qui, moyennant le dépôt d’une somme assez importante, ou sur la caution de deux notables de la cité, responsables des droits en cas d’infraction au tarif d’entrée, sont autorisées par la douane à recevoir en entrepôt des liquides pour la consommation ou la réexportation. Enfin, en dehors de ces diverses catégories d’établissements plus ou moins en rapport avec les douanes, plus de cinquante magasins publics sont réservés aux marchandises franches de droits ou dont les droits ont été payés; et les warrants délivrés par ces magasins sont également négociables.
Il n’est pas possible de déterminer la valeur totale des marchandises vendues annuellement en Angleterre au moyen des warrants. On l’a évaluée approximativement, pour les docks de Londres, à 1 milliard 590 millions de francs; pour les legal quays, à 250 millions; pour les sufferance wharves, à 63 millions; pour les bonded vaults et pour les simples magasins publics non privilégiés, la somme de 100 millions paraît certainement une évaluation très modérée [61] .”
Ce système de prêts sur gage mobilier s’est généralisé en Angleterre, à mesure que les docks se sont multipliés. En France, le gouvernement provisoire a autorisé, par un décret du 21 mars 1848, l’établissement de magasins généraux destinés à venir en aide aux négociants atteints par la crise révolutionnaire, en facilitant le prêt sur marchandises. Mais les obstacles que l’interdiction soit disant philanthropique du prêt sur gage, d’une part, et une législation commerciale surannée, de l’autre, opposaient à ce genre de prêt, en ont retardé le développement. Deux lois du 28 mai 1858 sur les magasins généraux et les ventes publiques ont en partie levé ces obstacles. En Belgique (loi du 18 novembre 1862 sur les warrants), la législation a également été modifiée pour faciliter l’engagement et la saisie du gage, c’est à dire l’établissement et la disponibilité des garanties requises par le prêt sur marchandises. Mais un préjugé enraciné dans l’esprit de la vieille génération des négociants s’oppose encore à l’extension de ce mode de crédit. — Parce qu’on ne recourait au prêt sur gage qu’en cas d’extrême nécessité, lorsque les monts-depiété et les pawn brokers étaient seuls à l’effectuer, à des conditions le plus souvent usuraires, l’engagement d’une marchandise a continué d’être considéré comme l’indice d’un état de gêne. Mais si le perfectionnement des institutions de prêt sur gage mobilier permet désormais d’emprunter sur marchandises, à des conditions commerciales, pourquoi ce mode d’emprunt n’entrerait-il pas dans les habitudes régulières du commerce, aussi bien que le mode d’emprunt par voie d’escompte? Vendre une marchandise à terme, et s’en faire avancer la valeur par l’émission et l’escompte d’une lettre de change, n’est-ce pas une opération analogue à celle qui consiste à déposer la marchandise entre les mains d’un tiers et à se faire avancer une partie de sa valeur par l’émission d’un warrant. Il n’existe aucune différence substantielle entre ces deux manières de recourir au crédit. D’où il résulte que le préjugé, pour être logique, devait frapper l’emprunt par voie de vente à terme et d’escompte aussi bien que l’emprunt par voie de dépôt et d’engagement de la marchandise. A quoi on peut ajouter que ce dernier mode d’emprunt est le complément nécessaire du premier, en ce qu’il épargne aux négociants la nécessité de vendre leurs marchandises à vil prix dans les moments de dépression, ou, ce qui revient au même, à emprunter à usure sous forme d’escompte pour se procurer les capitaux nécessaires à l’exécution de leurs engagements; enfin, ils trouvent en tous temps avantage à pouvoir choisir entre deux modes concurrents de crédit.
[61] Traité des magasins généraux, etc., par M. Damaschino. Introduction, par M. Maurice Block, p. 48 et suivantes.
[62] La transformation progressive du crédit hypothécaire a commencé à s’opérer dans la seconde moitié du siècle dernier. C’est à un négociant de Berlin, Kaufmann Buring, que revient l’honneur de l’invention de cette nouvelle forme du crédit. Sous les auspices de Kaufmann Buring, la première société de crédit foncier fut fondée en Silésie, après la guerre de Sept ans. A dater de cette époque (1770), les institutions de crédit foncier se propagèrent rapidement en Allemagne et en Pologne, tantôt sous la forme de mutualités des propriétaires, tantôt sous la forme de sociétés d’actionnaires.
Dans le premier système, les propriétaires fonciers se réunissent pour constituer une garantie mutuelle. Lorsque l’un d’entre eux veut contracter un emprunt, il s’adresse à l’association dont il fait partie. L’association apprécie les garanties hypothécaires qu’il offre, et elle lui fournit, dans la mesure de ces garanties, des obligations ou lettres de gage, qu’il se charge de négocier lui-même. Il se procure ainsi des capitaux plus facilement et à meilleur marché que s’il avait emprunté isolément sur hypothèque, grâce: 1° à l’augmentation de la sécurité du prêt résultant de la garantie mutuelle, 2° à l’accroissement de la transmissibilité du contrat hypothécaire assuré par la mutualité et divisé en coupures commodes, sous la dénomination de lettres de gage. Mais les mutualités de propriétaires offrent une double imperfection, d’abord en ce qu’elles ne peuvent réaliser aisément la portion de capital nécessaire pour assurer le service des intérêts et de l’amortissement des emprunts, ensuite, en ce que le cercle de leurs opérations est limité par le nombre même de leurs membres. En conséquence, elles ont une tendance naturelle à se transformer en sociétés d’actionnaires.
En dépit des préjugés qui poursuivent encore les sociétés d’actionnaires, elles constituent, en effet, une forme d’association visiblement supérieure à celle des mutualités. Leur supériorité provient, en premier lieu, de ce que leurs actions étant transmissibles, le taux nécessaire de la rétribution du capital de garantie d’une société de crédit foncier, par exemple, est moindre que celui du capital de garantie d’une mutualité, dans laquelle les parts d’engagement sont personnelles; en second lieu, en ce que la sphère d’opérations d’une société est illimitée, les emprunteurs n’ayant pas besoin, comme dans le cas d’une mutualité, de faire partie de l’association, autrement dit, de commencer par se faire prêteurs ou, tout au moins, assureurs de prêts, pour devenir emprunteurs. Le société d’actionnaires est donc, quoi qu’on en dise, un progrès sur la mutualité, et celle-ci, en raison de l’infériorité de son mécanisme, ne peut guère subsister qu’à titre de rouage local ou comme formation embryonnaire d’une société.
C’est grâce à l’institution des sociétés, proprement dites, que le crédit foncier a pu se propager et acquérir même un caractère international. Longtemps arrêté dans son développement par l’imperfection des législations hypothécaires, il ne s’est implanté en France qu’après la révolution de 1848. Le Crédit foncier de France, dont la création est due principalement à l’initiative de M. L. Wolowski, a été institué, sous forme de banque privilégiée, par un décret du 28 mars 1852; mais on peut lui reprocher d’avoir étendu principalement ses opérations dans les villes, et fait pousser plus de monuments que de blé. D’autres sociétés, fondées plus tard en Belgique et en Hollande, spécialement en vue d’effectuer des prêts hypothécaires en Autriche, ont mieux conservé le caractère primitif du crédit foncier: ces sociétés ont eu, les premières, le mérite d’internationaliser le prêt hypothécaire, en permettant aux propriétaires fonciers des pays où les capitaux sont rares et chers de s’en procurer, avec facilité et à des conditions modérées, dans les pays où ils sont abondants ct à bon marché. Dans ce cas, quelques garanties de plus peuvent être requises, en raison de l’éloignement, de la difficulté de constater la réalité des garanties offertes, etc., mais le mécanisme demeure le même [63] .
L’écueil des sociétés de crédit foncier, et, en général, des sociétés de garantie, c’est ce qu’on pourrait appeler la non-effectivité de leur capital. Ce capital servant simplement de caution, au moins pour la plus forte part, n’a pas besoin d’être réalisé intégralement. Il suffit que les actionnaires en versent la moitié, le quart, le dixième ou même le vingtième. En revanche, il faut que le restant du versement soit assuré, absolument comme s’il était dans la caisse de la société. Sinon, la société, au lieu d’offrir pour garantie son capital nominal, n’en offre en réalité qu’une fraction souvent insignifiante. Des précautions doivent évidemment être prises contre cet abus, qui peut faire naître une multitude d’entreprises reposant sur des pointes d’aiguilles, et susciter par là même des crises désastreuses. On peut, par exemple, rendre les administrateurs responsables des versements à faire, ou bien encore exiger des actionnaires le dépôt d’une caution, composée de bonnes valeurs, jusqu’à concurrence du montant non versé de leurs souscriptions. Ces précautions ne manqueront pas, du reste, d’être prises volontairement, dès que le public, mieux familiarisé avec cette nouvelle forme des entreprises, n’accordera plus sa confiance qu’à celles dont l’organisation présentera les garanties nécessaires de solidité.
[63] On consultera avec fruit sur les sociétés interuationales de crédit foncier, instituées pour le prêt en Autriche, une remarquable brochure de M. P. de Haulleville: Considérations économiques et financières sur les ressourres de l’empire d’Autriche. Paris, Guillaumin et Cie.
[64] La grande transformation industrielle qui s’opère de nos jours et qu’un écrivain anglais a appelée, d’une manière si pittoresque, la révolution silencieuse, a rendu indispensable la création d’intermédiaires entre les entreprises qui demandent des capitaux d’une part, et la masse des capitalistes qui en offrent de l’autre. Lorsqu’il suffisait de quelques milliers de francs et, au maximum, de quelques centaines de mille, pour établir un atelier de production, soit qu’il s’agit d’agriculture, d’industrie ou de commerce, ce capital pouvait être demandé directement à un seul individu ou à un petit nombre. Maintenant que des millions sont nécessaires pour constituer la plupart des entreprises, il faut s’adresser à la masse. Ajoutons qu’il en sera de plus en plus ainsi. Car les grandes entreprises constituées au moyen de l’association sont destinées à supplanter successivement les moyennes et les petites, par les mêmes raisons qui rendent inévitable, malgré toutes les résistances, la substitution des métiers mécaniques aux métiers à la main. C’est, en premier lieu, parce que les entreprises constituées par voie d’association peuvent toujours proportionner économiquement leur puissance à l’effort qu’il s’agit d’accomplir. C’est, en second lieu, parce que la mobilisation des titres représentant la propriété du capital engagé, en diminuant la privation du capitaliste, réduit d’autant les frais de production du service du capital. C’est encore parce que le marché d’approvisionnement des capitaux demandés par petites coupures et représentés par des titres mobilisables est plus étendu que celui des capitaux demandés par grosses fractions, et dont les titres ne sont point aisément circulables. Par ces causes, sans parler de bien d’autres, la Société tend à devenir, et deviendra infailliblement, dans un avenir plus ou moins prochain, le type général des entreprises, et l’individualisme industriel, qui est encore aujourd’hui la règle, passera de plus en plus à l’état d’exception. Sans doute, cette transformation progressive est retardée et continuera de l’étre par les empêchements et les restrictions que des législations qu’on croirait inspirées par la politique des “briseurs de machines,” opposent partout à la constitution et au développement des sociétés, ainsi que par l’accaparement des grandes entreprises, au profit du vaste et monstrueux monopole de l’État; mais la force des choses finira par surmonter ces obstacles. A quoi on peut ajouter que les pays, où l’individualisme industriel cessera le plus tôt d’être protégé contre la concurrence de la grande industrie, librement constituée dans ses conditions naturelles, obtiendront sur les autres les mêmes avantages que leur procurerait l’initiative de l’adoption de nouvelles et puissantes machines.
Cette transformation inévitable des entreprises, provoquée par les progrès de la machinery et l’agrandissement des débouchés de la production, aura-t-elle, comme l’affirment les socialistes, pour résultat, inévitable aussi, de concentrer en un petit nombre de mains les forces productives de la Société, et d’amener ainsi la constitution d’une féodalité financière, à la merci de laquelle serait placée la masse subalternisée des travailleurs? En aucune façon. Il est évident, au contraire, que cette évolution progressive des entreprises aura pour résultat nécessaire de démocratiser la production, en obligeant les grandes puissances industrielles à se constituer par l’agglomération des petites forces. Tandis, en effet, que les capitaux aristocratiques et bourgeois participent encore à peu près seuls à la formation des entreprises de moyenne ou de petite dimension, les capitaux de la multitude sont indispensables à la constitution des grandes. Un entrepreneur qui emploie dans une fabrication quelconque un capital de quelques centaines de milliers de francs, n’a ordinairement que deux ou trois associés, pris le plus souvent dans sa propre famille, et appartenant, en tous cas, à la classe riche; tandis qu’une compagnie de chemins de fer, par exemple, a pour actionnaires ou pour prêteurs des milliers d’individus, appartenant à toutes les classes de la société. Au lieu de demeurer le monopole d’un petit nombre, les bénéfices de la production se distribuent ainsi dans la masse. Il suffit pour y participer d’une économie qui ne dépasse point les facultés du simple ouvrier, pour peu qu’il soit laborieux et rangé; car les actions et les obligations à l’aide desquelles se constitue le capital des sociétés, dépassent rarement 500 francs, et elles peuvent, au besoin, se sous-diviser.
Mais, par suite même de cette participation de la multitude aux entreprises de production, des intermédiaires sont devenus, plus que jamais, indispensables entre les demandeurs de capitaux et les capitalistes. Pour bien juger de l’utilité d’une entreprise, de la capacité et de la moralité de ceux qui la forment, et, par conséquent, de ses chances de réussite, il faut une aptitude et des notions spéciales, que ne possède point la multitude et qu’elle ne saurait suffisamment acquérir. Qu’un homme possédant une modeste épargne de 10,000 francs veuille la répartir, comme la prudence le lui conseille, entre un certain nombre d’entreprises, il lui sera impossible de se rendre compte de la valeur réelle de ces placements, c’est à dire de la sécurité et des chances de bénéfices qu’il peut y trouver. Il courra incessamment le risque d’être dupé par les faiseurs, il gaspillera ses capitaux dans des entreprises folles ou onéreuses, et les désastres qui en résulteront ne manqueront pas de retarder la constitution des entreprises utiles et sérieuses. De là, la raison d’être des intermédiaires pour les commandites ou les placements de fonds dans la grande industrie [65] .
Il semblerait que ce rouage nouveau de l’organisation progressive de l’industrie eῦt dῦ se créer d’abord en Angleterre. Mais, par suite de la concentration aristocratique des capitaux dans ce pays, et des restrictions naguère encore opposées à l’établissement des sociétés, la constitution des intermédiaires du crédit industriel y est demeurée en retard. C’est dans l’ancien royaume des Pays-Bas que les premières banques commanditaires de la production ont été établies par l’initiative d’un des souverains qui ont eu, au plus haut degré, l’intelligence des faits économiques, le roi Guillaume Ier. Deux grandes sociétés, l’une de crédit mobilier commercial, la Société de commerce des Pays-Bas, l’autre de crédit mobilier industriel, la Société générale pour favoriser l’industrie nationale, ont été instituées, en 1822, par ce monarque intelligent, et même, en grande partie, avec ses propres fonds.
“La Société générale, dit M. J. J. Thonissen dans son excellente histoire de la Belgique sous le règne de Léopold Ier, s’établit au capital de 50 millions de florins (fr. 105,820,106), composé de 20 millions de biens domaniaux cédés par le roi et de 60,000 actions de 500 florins à émettre. La plus grande latitude lui était laissée dans ses opérations; car, indépendamment de l’émission de billets de banque et de l’escompte des effets de commerce, elle pouvait se charger du dépôt de sommes en compte courant et faire des avances sur fonds publics, sur créances, sur marchandises et même sur immeubles. Les biens domaniaux que le roi lui avait abandonnés, et qu’elle était autorisée à vendre, avaient une valeur bien supérieure au taux de l’évaluation, et cependant elle jouissait d’un terme de vingt-six années pour se libérer de cette avance. De plus, pour vaincre toutes les hésitations des capitalistes; Guillaume fit du nouvel établissement le caissier général de l’État et se déclara personnellement responsable du payement des intérêts des actions. Enfin, comme le public, malgré tous ces avantages, refusait concours, il prit lui-même 25,500 actions qui n’avaient pas trouvé de souscripteurs (Sur 32,000 actions d’abord émises, il n’y eut demande que pour 6,500) [66] .”
La Société générale a été le levier au moyen duquel se sont constituées les plus importantes entreprises industrielles de la Belgique, charbonnages, hauts fourneaux, etc., soit qu’elle se chargeât de placer leurs actions et leurs obligations, soit qu’elle leur fît des avances en compte courant ou par voie d’escompte. Son influence aurait été, sans aucun doute, plus vaste et plus bienfaisante encore si elle n’avait pas été privilégiée, et si elle s’était bornée aux opérations de la commandite, au lieu d’être en même temps une banque de circulation. En 1835, la Banque de Belgique est venue lui faire une utile quoique insuffisante concurrence; enfin, en 1850, la constitution de la Banque nationals lui a enlevé ses attributions de banque de circulation pour la restreindre à la spécialité d’un intermédiaire de commandite industrielle.
De la Belgique, les banques commanditaires de l’industrie ont passé en France, où la Société générale du crédit mobilier a été autoriséce par un décret du 18 novembre 1852, au capital de 60 millions de francs, avec faculté d’émettre des obligations jusqu’à concurrence de dix fois son capital. Cette société, placée sous la direction de M.M. Isaac et. E. Pereire, est devenue la plus considérable des banques commanditaires, et elle a servi de modèle aux Sociétés de crédit mobilier qui se sont fondées ensuite en Espagne, en Autriche et en Hollande.
“Aux termes de ses statuts, dit M. A. Vuhrer, ses opérations consistent à souscrire ou acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit constituées en sociétés anonymes, à émettre pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions et acquisitions, ses propres obligations et jusqu’à concurrence de dix fois son capital; à vendre ou donner en nantissement d’emprunts tous effets, actions et obligations acquis et à les échanger contre d’autres valeurs; à soumissionner tous emprunts, à les céder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics; à prêter sur effets publics, sur dépôt d’actions et obligations, et à ouvrir des crédits en comptes courants sur dépôt de ces diverses valeurs; à recevoir des sommes en compte courant; à opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies susénoncées, à payer leurs coupons d’intérêts ou de dividendes; à tenir une caisse de dépôt pour tous les titres de ces entreprises.
Telles sont les bases sur lesquelles la société a assis ses opérations. Ainsi que l’a fait remarquer son principal fondateur, M. Isaac Pereire, elle est à la fois: 1° société commanditaire; 2° société financière; 3° banque de placement, de prêt et d’emprunt; 4° banque d’émission. Comme société commanditaire, elle met ses ressources et son crédit à la disposition de la haute industrie, et les emploie à la formation de grandes entreprises, sur lesquelles elle exerce son patronage, et à la direction desquelles elle concourt. Comme société financière et comme banque de prêt et de placement, elle prend part aux opérations dans lesquelles le crédit public ou le crédit industriel se trouve engagé; et, sous cette forme, elle manifeste son intervention soit par des souscriptions d’emprunts, soit par des prêts directs, soit par des placements d’obligations des compagnies, soit enfin par des opérations de reports, d’achats et de ventes d’effets publics. Enfin, comme banque d’émission, elle doit créer et lancer dans la circulation ses propres obligations en échange des valeurs de toute nature, de toute origine et de toute échéance dout elle est autorisée à faire l’acquisition et le commerce. Cette dernière fonction, l’une des plus importantes, des plus délicates et en même temps des plus contestées, les circonstances ont jusqu’ici empêché la Société de crédit mobilier de la remplir.
. . .Sans nul doute, le Crédit mobilier n’a pas inventé le crédit commanditaire, et avant lui les grandes industries trouvaient les capitaux nécessaires à leurs opérations; mais au prix de quels sacrifices y parvenaient-elles? et pour n’en citer qu’une seule, qui ne se rappelle tout ce que, il y a vingt ans, il a fallu d’efforts, de persévérance et de conviction ardente aux hommes qui, plus tard, fondèrent le Crédit mobilier, pour faire comprendre au monde financier tout ce que recélait d’avenir l’industrie des chemins de fer? Ce n’est donc rien hasarder que de dire que jamais, et avec autant d’opportunité, un aussi puissant instrument n’a été mis au service des idées nouvelles, des vastes entreprises et des gouvernements eux-mêmes.
Cependant le Crédit mobilier, tel que nous le connaissons, est loin de répondre à l’idée que s’en est formé l’homme éminent qui le dirige aujourd’hui. Dans sa pensée, le capital de cette société devait n’être, en quelque sorte, qu’un fonds de garantie complémentaire destiné à servir de gage à un capital nouveau et dix fois plus considérable, qu’il comptait réaliser, et qui devait être obtenu au moyen de l’émission des obligations dont nous avons parlé en commençant. Ces obligations devaient être de deux sortes: les unes à courte échéance, correspondaient aux divers placements temporaires de la société; les autres, émises à longue échéance, étaient l’équivalent des valeurs sans échéances déterminées successivement acquises par elle, telles qu’inscriptions de rentes, actions et obligations de grandes entreprises industrielles. Le premier avantage de ces obligations devait être de ramener à un type unique, et par conséquent d’une négociation et d’une circulation toujours faciles, une quantité considérable de valeurs, diverses d’origine, de mode de jouissance et d’échéance. Elles devaient, en outre,” par leur forme et par la facilité qu’elles offriraient de régler chaque jour, d’un coup d’œil, l’intérét qui y serait attaché, prendre le caractère et le rôle de monnaie fiduciaire.“Par ce double avantage, elles devaient avoir pour effet,“d’une part, d’utiliser une masse considérable de fonds de caisse, de capitaux momentanément sans emploi; d’autre part, de fournir à tous un moyen de placement régulier et permanent. “Nous sommes disposés à reconnaitre qu’il serait avantageux, en effet, de ramener à un type uniforme plusieurs des valeurs qui circulent à la Bourse; mais pour que le rôle de monnaie fiduciaire pῦt être facilement rempli par les obligations que la Société générale du crédit mobilier voudrait introduire dans la circulation, il faudrait que ces titres fussent représentés par des valeurs d’une solidité très grande et d’un revenu assuré; il faudrait, en outre, que le capital de la société fῦt une garantie sérieuse et jugée incontestable.
Sous ce dernier rapport, la proportion du 10e pour le capital de garantie nous paraît beaucoup trop faible; il n’était, à la vérité, dans l’esprit des fondateurs de la société, qu’une limite qu’ils n’auraient jamais cherché à atteindre: aussi les critiques ont-ils eu beau jeu en transformant une faculté en un fait réalisé ou sur le point de l’être.
Mais si ce système pouvait, par ses côtés exagérés, donner lieu à de justes observations, dans ses conséquences secondaires; si on pouvait contester certains avantages qu’on avait cru légitime de lui attribuer, il était apte à fournir à l’établissement qui parviendrait à le faire réussir des ressources d’une puissance énorme, et, à ce point de vue, il avait une portée, un caractère de grandeur et même de solidité qui écartent toute analogie avec le système de Law, auquel on s’est efforcé de le comparer. Il y a entre les deux systèmes cette différence radicale que, dans celui-ci, l’auteur ne tendait à rien moins qu’à faire représenter toutes les valeurs d’un pays par une monnaie de papier sans intérêt, ce qui équivalait à la confiscation de la propriété au profit d’une compagnie ou du gouvernement; tandis que le système sur lequel repose la Société générale du crédit mobilier consiste uniquement à mettre de l’unité dans des titres de diverses natures, à leur donner des facilités de crédit, de mobilisation et de circulation par la création de titres portant intérêt et qui n’en sont que la représentation. Ces titres nouveaux peuvent devenir à la fois un appendice utile pour la circulation du pays et un puiasant encouragement pour toutes les affaires d’intérêt général. Ce système a d’ailleurs pour corollaires d’autres idées dont on ne saurait méconnaître l’ampleur et la fécondité. Les capitaux considérables que les obligations fourniraient à la Société générale du crédit mobilier deviendraient, entre les mains de son fondateur, l’instrument, l’âme et le lien d’une série d’institutions qu’il vondrait créer dans les principales places de l’Europe, sur le modèle de celle de Paris et en communauté d’action et d’intérêt avec elle. Par elles, disait-il, on verrait successivement, quoique dans un avenir peut-être éloigné, les sociétés atteindre des buts à peine entrevus jusqu’ici, la réunion, dans de grands centres, de capitaux disponibles, dispersés et enfouis dans les diverses contrées de l’Europe; l’application directe de ces capitaux aux emplois les plus utiles et, par conséquent, les plus fructueux; l’abaissement et la régularisation du taux de l’intérêt sur tous les marchés; l’établissement d’un papier de crédit et de circulation européen; la disparition graduelle de la plupart des entraves, qui rendent si difficiles, si lentes et si coῦteuses les relations de crédit dans l’intérieur de l’Europe; plus tard enfin, l’unité de crédit et de monnaie, et probablement la solution des problèmes les plus ardus que se posent aujourd’hui, en tous pays, les industriels et les économistes. (Dictionnaire universel du commerce et de la navigation, art. Crédit mobilier, par A. Vuhrer.)”
Cependant, cet établissement présente des vices de construction et de fonctionnement qui neutralisent, en grande partie, ses avantages. On est frappé d’abord de la masse et de la diversité de ses opérations. Nous voyons dans son dernier compte rendu (9 avril 1863) qu’elles ont embrassé les chemins de fer russes, autrichiens, espagnols, suisses; les transports maritimes (Compagnie générale transatlantique); les transports urbains (omnibus de Paris); le percement des rues et la construction des habitations (Compagnie immobilière); l’éclairage (éclairage de la ville de Paris par le gaz); la fondation d’établissements de crédit à l’étranger (Société générale du crédit mobilier espagnol, Banque d’escompte et de circulation de Constantinople), et, dans les années précédentes, la négociation des emprunts publics. Les opérations du Crédit mobilier de France s’étendent, comme on voit, dans les régions les plus diverses et embrassent les entreprises les plus disparates. Cela étant, peut-il remplir convenablement son rôle d’intermédiaire qui consiste à diriger les capitaux vers les entreprises les plus utiles et, par conséquent, les plus avantageuses? Non, car pour s’acquitter utilement de cette fonction, il devrait, avant tout, s’astreindre à observer les lois de la division du travail et de la limitation naturelle des entreprises. C’est pourquoi ses adversaires ont pu lui reprocher, avec quelque raison, le mauvais choix de ses commandites.
“A voir le défilé de ces entreprises, dit M. Eug. Forcade (Semaine financière des 11 et 18 avril), on ne se douterait guère que la conclusion du rapport, soit la proclamation d’une accumulation inouie de profits. La morne procession s’ouvre par les chemins russes qui, à leur cours actuel, font perdre à leurs actionnaires 40 millions; elle continue par les chemins autrichiens qui ont vu, il y a quelques années, comme le Midi, il y a quelques mois, le cours de 900 fr. et qui sont revenus au pair. Puis viennent les tristes chemins suisses, et la canalisation de l’Ebre elle-même n’est pas oubliée. Que de mécomptes! Et cependant le Crédit mobilier gagne, en 1862, 32 millions; il aura distribué 125 fr. pour cette année, en montrant la perspective d’un dividende égal pour deux années encore!
Ce contraste montre d’une façon saisissante que le Crédit mobilier tire ses énormes et capricieux profits non de ses fonctions de banque commanditaire, mais du mouvement de son portefeuille, c’est à dire de l’influence irrésistible que sa puissance d’accaparement lui assure par moments sur la spéculation de la Bourse, de la faculté étrange qui lui a été donnée d’agir arbitrairement sur les prix des valeurs.
. . .Ainsi, dit le même écrivain, dans le dernier exercice, d’après ses propres articulations, le Crédit mobilier a retiré tout au plus 7 1/2 millions d’opérations que nous appellerons normales, et tout au moins 12 millions d’opérations de spéculation.
Or, qu’est-ce que la spéculation et avec quels moyens a-t-elle coutume d’agir?
La spéculation est l’anticipation des profits de l’avenir. On prévoit que la valeur d’une marchandise, d’un terrain, d’un fonds public, d’une action doit s’élever dans un temps plus ou moins long, on escompte, comme on dit, l’avenir et l’on achète la marchandise, le terrain, le titre. Mais la justesse du coup d’œil du spéculateur n’est pas la seule condition de la réussite de la spéculation. Une de ses plus efficaces conditions de succès est la puissance du spéculateur.
Le prix des choses ne se détermine pas seulement par leur valeur intrinsèque. Il subit l’influence de l’offre et de la demande, de l’abondance et de la rareté. Un spéculateur qui a une puissance de capitaux suffisante peut produire la cherté d’une chose, titre ou marchandise, en l’accaparant et en la rendant passagèrement rare sur le marché. Enfin, un des moyens de succès les plus efficaces du spéculateur, c’est son influence sur les autres spéculateurs et sur le public, c’est l’entrainement de son exemple et la conviction de ses imitateurs qu’en marchant sur ses traces, ils feront une bonne affaire.
Tous ces moyens d’ascendant, le Crédit mobilier les possède au plus haut degré. Il connait ou il est censé connaître la valeur intrinsèque des titres sur lesquels il spécule, puisque ces titres représentent des entreprises à la gestions desquelles il est mêlé. Il a une puissance exceptionnelle de capital. . .Le Crédit mobilier, en se portant sur une valeur, y amène donc une puissance d’accaparement qui n’a pas d’égal à la Bourse et qui lui permet d’exercer sur les prix une influence considérable. Il peut acheter des actions par dizaine de mille et sacrifier ainsi momentanément les titres de telle ou telle entreprise. Enfin, le Crédit mobilier a, comme il le dit lui-même, “une clientèle de capitalistes grands et petits;” on peut croire très naturellement dans le public, puisque c’est encore lui qui le dit, “que tout le monde gagne avec ou après lui,” et que “sa force d’impulsion et d’exemple est irrésistible. “
Malgré une certaine exagération, il y a quelque chose de vrai dans ces accusations, et le danger qu’elles signalent ne pourrait que s’aggraver si les projets d’agrandissement illimité des fondateurs du Crédit mobilier venaient à se réaliser. De quoi s’agirait-il, en effet? De couvrir l’Europe d’un réseau de Crédits mobiliers privilégiés, qui seraient des émanations du Crédit mobilier de France et qui se rattacheraient à lui comme autrefois les colonies à leur métropole. Supposons ce réseau établi et fonctionnant au gré des promoteurs du système, le gouvernement financier du monde sera entre leurs mains. Car ils pourront, à l’aide de l’énorme puissance de spéculation dont ils disposeront, anéantir les meilleures entreprises fondées en dehors d’eux, au profit de celles qu’ils auront commanditées et ressusciter ainsi, sous une autre forme, le régime de la protection industrielle. On reconnaît, dans cette conception, l’idée du saint-simonisme, dont les fondateurs du Crédit mobilier de France étaient jadis les adeptes.
Mais pour réaliser ce monopole universel de la commandite, il faudrait que le Crédit mobilier de France et ses colonies obtinssent partout un privilége exclusif que les gouvernements sont peu disposés à leur accorder, et, en admettant même qu’ils réussissent à l’obtenir, qu’ils demeurassent unis. Dans cette hypothèse encore, ils finiraient par tomber tôt ou tard en décomposition, par l’action des vices inhérents an monopole.
C’est un des résultats les plus fâcheux du régime du privilége de donner un corps à de pareilles chimères, et de vicier ainsi le développement de l’admirable organisme du crédit. Supposons, en effet, qu’une entière liberté existât partout, en matière d’association et de crédit, qu’en résulterait-il? C’est que les institutions de crédit de tous genres devraient nécessairement observer dans leur établissement et leur fonctionnement, les conditions économiques de la division du travail et de la limitation naturelle des entreprises, qu’elles peuvent impunément méconnaître, au moins pour quelque temps, sous un régime de monopole. Se faisant concurrence, elles devraient pour attirer la clientèle présenter au public des capitalistes un maximum de bénéfices combiné avec un maximum de sécurité, et ce double résultat, elles ne pourraient l’atteindre, qu’en spécialisant leurs commandites d’abord, c’est à dire en s’appliquant les unes à l’industrie de la locomotion, les autres aux industries textiles, etc., en évitant ensuite de trop étendre leurs opérations. C’est, seulement, en observant ces deux lois économiques qu’elles deviendraient capables, non seulement de faire un bon choix d’entreprises à commanditer, mais encore, ce choix fait, qu’elles pourraient surveiller efficacement la gestion des entreprises commanditées et réaliser ainsi ce bon gouvernement de la production qui n’est qu’une décevante utopie sous un régime de monopole.
Supposons encore que des Crédits mobiliers, créés dans les conditions naturelles et saines de la concurrence, gardent en portefeuille les actions et les obligations des entreprises commanditées par eux pour les remplacer par leurs actions et leurs obligations émises dans les coupures et dans les formes les plus demandées, quel sera finalement le rôle de cet intermédiaire du crédit? Ce sera celui d’une assurance des capitaux et de l’industrie elle-même. D’une part, en effet, les porteurs des actions et des obligations des Crédits mobiliers spécialisés participeront aux benéfices de toute une catégorie d’entreprises de production, tout en s’assurant contre les risques afférents à chacune en particulier; d’une autre part, grâce à la participation intéressée et éclairée des Crédits mobiliers au gouvernement des entreprises commanditées, la somme de ces risques se trouvera sensiblement diminuée. Que si enfin l’intermédiaire voulait se faire payer trop cher son service (ce qu’il fait impunément sous un régime de monopole), les capitaux ne manqueraient pas de se porter vers l’établissement de nouveaux Crédits mobiliers jusqu’à ce que la rémunération de ce service tombât au niveau de son prix nécessaire.
En résumé donc, le privilége n’est point pour le Crédit mobilier une garantie utile, comme l’affirmaient naguère les fondateurs du Crédit mobilier de France [67] , c’est, au contraire, une cause de perturbation et de ruine. Les Crédits mobiliers étendent à l’excès leurs opérations, en vue d’exploiter aussi complétement que possible leur privilége. En conséquence, ils choisissent et surveillent mal leurs commandites. Alors, ils cherchent dans des spéculations qui leur offrent, grâce encore à leur situation privilégiée, l’appât de gains faciles mais aléatoires, des profits extraordinaires. Ils pèsent sur le marché jusqu’à ce qu’ils soient emportés dans quelque crise, après avoir retardé, en le faussant, le développement utile et normal du crédit.
[65] Voir les Questions d’économie politique et de droit public. T. Ier, p. 253. Le crédit mobilier.
[66] J. J. Thonissen. La Belgique sous le règne de Léopold Ier. Tome II. Chapitre XVI, page 259.
[67] En ce qui touche la concurrence organisée entre les societés du Credit mobilier espagnol, voici comment nous nous exprimions dans notre rapport du 23 avril 1856:
“Le temps modifiera, sans doute, ce qu’il peut y avoir eu d’excessif dans le nombre des sociétés auxquelles le gouvernement espagnol a donné l’investiture.
L’expérience amènera la démonstration des inconvénients de la concurrénce dans un genre d’affaires où les moindres fautes peuvent devenir la cause de ruines fâcheuses pour un grand nombre de familles.” — Société générale du crédit mobilier. Rapport du 9 avril 1863.
[68] Le développement du marchandage (commerce de travail) et du système des engagements libres qui est destiné, selon toute apparence, à supprimer l’esclavage en le remplaçant, suscitera, selon toute apparence aussi, de nouvelles formes du crédit et des assurances. Essayons d’en donner une idée.
Le problème de l’amélioration du sort, aujourd’hui si misérable et si précaire de la grande masse des travailleurs qui ne possèdent guère qu’un capital personnel, se présente sous deux faces: la production et la consommation.
En premier lieu, il s’agit pour eux de faire le meilleur emploi possible de leur capital de forces productives et d’obtenir de la manière la plus constante un maximum de rémunération pour leur travail.
En second lieu, il s’agit encore pour eux de donner à leur revenu la destination la plus utile et d’obtenir en échange un maximum d’objets de consommation.
Considérés comme producteurs, les travailleurs se trouvent pour le plus grand nombre dans l’impossibilité d’entreprendre eux-mêmes une industrie quelconque. Pourquoi? Parce que, outre la difficulté qu’ils éprouveraient à s’associer dans ce but, ils ne disposent point du capital nécessaire pour se procurer le matériel requis par l’entreprise, comme aussi pour subvenir à leurs frais d’entretien jusqu’à ce que le produit soit confectionné et réalisé. Les industries sont donc entreprises par une classe particulière d’individus qui, possédant eux-mêmes ou réunissant au moyen de l’association un capital suffisant pour couvrir les risques afférents à toute production, empruntent, d’une part, le capital complémentaire, en fournissant aux prêteurs une portion du produit éventuel et aléatoire de l’entreprise sous la forme anticipative et assurée d’un intérèt; d’une autre part, le travail auxiliaire, en fournissant aux travailleurs une autre portion du produit, sous la forme également anticipative et assurée d’un salaire. Comme nous l’avons remarqué déjà, le salaire n’est en réalité qu’une des formes de l’intérêt: c’est l’intérêt du capital investi dans les personnes, et, sauf l’action des causes perturbatrices, il tend incessamment à se niveler avec celui des capitaux investis sous forme de terres, de bâtiments, de machines, de matières premières, de monnaie [69] .
Le salaire peut être fourni en argent ou en nature, c’est à dire en articles propres à la consommation du travailleur; il est conventionnel ou contractuel, quand le travailleur est propriétaire du capital de forces productives investi dans sa personne; il est fixé sans convention ou sans contrat quand l’entrepreneur est, en même temps, propriétaire du capital personnel du travailleur. Sous un régime de liberté, le salaire est ordinairement stipulé en argent et il est toujours le résultat d’une convention; sous un régime d’esclavage le salaire est ordinairement en nature, et il est toujours fixé sans débat, au gré du maître.
Si nous analysons le salaire de l’esclave, nous y trouverons le crédit et l’assurance du travail tels que le comportait l’état politique et économique des sociétés primitives. Les esclaves fournissent, de gré ou de force, le travail nécessaire aux entreprises. En échange, le maître pourvoit à tous les besoins de leur existence et de leur renouvellement. Il les gouverne, les nourrit et les abrite, prend soin d’eux dans leurs maladies et dans leur vieillesse, se charge des frais d’élève et, quand il y a lieu, des frais d’instruction professionnelle de leurs enfants. Comment se procure-t-il ce salaire en nature de son personnel esclave? Il le tire du produit brut de son entreprise. Une partie de ce produit brut est consacrée à l’entretien et au renouvellement du matériel, une autre partie à l’entretien et au renouvellement du personnel. Seulement, il ne faut pas oublier que le produit de toute entreprise est, en premier lieu, plus ou moins lent à former et à réaliser, en second lieu, plus ou moins aléatoire. En conséquence, que font les maîtres, en fournissant au jour le jour les frais d’entretien et de renouvellement à leurs esclaves? Ils leur avancent et ils leur assurent une part de produit brut, quel que soit le résultat de la production. Supposons, en effet, que le produit ne se réalise point, les esclaves n’en auront pas moins été nourris et entretenus, comme s’il l’avait été. L’esclavage renferme donc bien, comme on voit, à l’état embryonnaire, le crédit et l’assurance du travail. L’intérét et la prime que le maître perçoit pour se couvrir de cette avance et de cette assurance peuvent être, à la vérité, excessifs, puisque le travailleur esclave n’a pas le droit d’en débattre le taux: cependant, ils ont pour limites naturelles les frais d’entretien et de renouvellement nécessaires du travailleur. A moins de détériorer son personnel, et de gaspiller par là même le capital qui s’y trouve investi, le maître ne peut s’attribuer que la part de produit net afférente à la rémunération des travailleurs, leurs frais d’entretien et de renouvellement nécessaires étant couverts.
Lorsque le régime de la liberté du travail succède à l’esclavage, les travailleurs, recouvrant la propriété d’eux-mêmes, peuvent exploiter pour leur propre compte leur capital personnel et en tirer un profit, ou en louer l’usage et en tirer un salaire, lequel n’est autre chose que l’intérêt ou le loyer de cette espèce de capital. Ce salaire ou cet intérêt du capital investi dans les personnes a pour taux naturel la somme nécessaire à l’entretien et au renouvellement du travailleur, avec adjonction d’une part proportionnelle de produit net; mais son taux courant est déterminé par les mouvements de l’offre et de la demande. Or l’ouvrier qui loue isolément son capital de forces productives (et des lois iniques lui interdisent presque toujours de le louer autrement) se trouve vis-à-vis du locataire ou de l’emprunteur de cette espèce de capital dans une situation ordinairement fort inégale, en ce qu’il dispose à un moindre degré de l’espace et du temps. Il en résulte que le taux courant de son salaire peut tomber fort au dessous du taux naturel, en le réduisant à une condition pire que celle de l’esclave [70] .
D’un autre côté, si nous considérons la situation de l’entrepreneur d’industrie sous ce régime, nous trouverons que le salariat le grève de charges lourdes et inégales pour lesquelles il est obligé d’exiger une compensation et une prime d’assurance considérables, qui viennent en déduction du salaire naturel de l’ouvrier. Comme dans le cas de l’esclavage, il fait à son personnel de travailleurs auxiliaires l’avance assurée d’une part du produit brut de l’entreprise, au moyen d’un capital appliqué spécialement à cette destination, et dont il paye l’intérêt, assurance comprise, sauf à s’en rembourser, dans la transmission de ce crédit aux travailleurs. Mais les conditions auxquelles les entrepreneurs d’industrie se procurent du crédit sont essentiellement inégales. Tandis que les uns obtiennent à bon marché le capital qu’ils consacrent au payement des salaires, les autres sont obligés de le payer cher. Il en résulte pour les premiers une véritable rente provenant de la supériorité de leur crédit sans que les ouvriers ni les consommateurs y participent, car c’est la masse de l’offre des services et des produits, en présence de la masse de la demande, qui détermine le prix, en gravitant toujours vers le niveau des frais de production les plus élevés des services ou des produits offerts. L’intérêt et l’assurance qui se déduisent de la rémunération avancée et assurée, de semaine en semaine, aux travailleurs, s’établissent donc en proportion de l’intérêt et de la prime les plus élevés que les entrepreneurs d’industrie payent pour le capital qu’ils appliquent à la rétribution de leur personnel. Mais dans le cas d’une augmentation de l’offre des produits ou d’une diminution de l’offre du travail, les entrepreneurs qui se procurent aux conditions les moins avantageuses le capital appliqué au payement des salaires se trouvent en perte et, par conséquent, obligés de ralentir ou de cesser leur production, tandis que leurs concurrents, plus favorisés sous le rapport du crédit, voient simplement diminuer la rente que cette inégalité de situation leur permet de s’attribuer.
Le développement et la généralisation du marchandage (commerce de travail) auraient, comme nous l’avons vu, pour résultats, d’une part, de faire graviter en tous temps et en tous lieux le salaire courant vers le niveau du salaire naturel, au grand avantage de l’ouvrier, d’une autre part, de réduire au minimum les charges qui viennent en déduction du salaire naturel, en atténuant du même coup les inégalités de crédit, qui rendent essentiellement précaire la situation du plus grand nombre des entrepreneurs. Envisagées au point de vue du crédit, les entreprises de marchandage seraient de véritables banques de crédit personnel dont les opérations offriraient une complète analogie avec celles des banques de crédit foncier ou mobilier. Supposons, en effet, qu’une compagnie s’organise pour l’exploitation spéciale du marchandage dans un foyer quelconque de production. Comment opérera-t-elle? D’une part, elle devra emprunter une certaine quantité de capital personnel aux travailleurs qui possèdent ce capital sous forme de capacités productives, et qui l’offrent; d’une autre part, elle devra louer ce même capital aux entrepreneurs de production, qui en ont besoin et qui le demandent. Les travailleurs engageront donc leur capital personnel à la compagnie, à un taux et pour un temps déterminés par leurs convenances, et la compagnie, à un taux et pour un temps également déterminés par les convenances, et la compagnie, à son tour, réengagera ce capital aux entrepreneurs de production, à un taux et pour un temps également déterminés par les convenances ou les nécessités des entreprises. La différence de ces deux taux, comme dans le cas des autres banques, servira à couvrir les frais de l’intermédiaire, et à lui procurer un bénéfice. A quoi on peut ajouter que, sous un régime de libre concurrence, cette différence ne pourra jamais, au moins d’une manière permanente, s’élever au dessus ni tomber au dessous de la rémunération nécessaire de l’intermédiaire.
Entrons un peu plus avant encore dans le détail de cette opération particulière de crédit. La compagnie emprunte des capitaux personnels, en s’engageant à fournir aux propriétaires de ces capitaux, un loyer stipulé à un certain taux et pour un certain temps. De leur côté, les travailleurs s’engagent à lui fournir à ce taux et pendant ce temps, l’usage clairement spécifié et délimité de leur capital personnel. Pour que ce contrat soit possible, il faut d’abord que les deux parties aient pleine liberté de le conclure, sans restriction d’espace ni de temps, sauf toutefois le cas d’incapacité démontrée de l’un des contractants, auquel cas l’intervention d’un tuteur devrait être requise; il faut ensuite qu’il existe des deux côtés des garanties suffisantes pour assurer l’exécution du contrat. Ainsi, par exemple, il faut que la compagnie puisse se servir du capital personnel qu’on lui a engagé, et le transmettre jusqu’à expiration de l’engagement, se faire allouer des dommages-intérêts, sous la forme d’un prolongement de l’engagement et d’une réduction du salaire stipulé, en cas de refus d’exécution ou d’exécution imparfaite du contrat de la part du travailleur. Il faut encore qu’elle puisse faire garantir ce capital personnel, au moyen d’une assurance prise sur la vie du travailleur, qui lui en loue l’usage. Il faut enfin que le travailleur, de son côté, puisse avoir un recours facile et peu coῦteux contre une compagnie qui se refuserait à l’exécution des clauses du contrat.
Vis-à-vis de sa clientèle d’entrepreneurs de production, emprunteurs de capitaux personnels, la compagnie de marchandage se trouve dans une situation précisément inverse à celle où elle est placée vis-à-vis des travailleurs prêteurs de ces mêmes capitaux. Tandis qu’elle paye à ceux-ci un salaire ou, si l’on veut, un intérêt, elle en reçoit un de ceux-là. Mais, ici encore, elle procède par voie d’engagements, spécifiant la quantité et la qualité du travail à livrer, le taux et les termes de la livraison. Des garanties doivent être, de même, fournies des deux parts pour assurer la bonne exécution des contrats, avec réserve de dommages-intérêts, etc., etc.
On peut, du reste, imaginer pour simplifier et faciliter l’exécution de ce genre d’engagements, un procédé de mobilisation analogue à celui qui existe déjà pour les autres capitaux. On peut supposer qu’un travailleur qui a engagé son capital personnel pour un certain laps de temps et à un certain taux et qui désire le dégager, cède son contrat à un autre, sauf ratification par la compagnie et remboursement ou transmission des avances qu’il a pu recevoir d’elle. Cette cession pourra se faire au pair de l’engagement, avec perte ou avec bénéfice selon l’état actuel du marché des salaires. Supposons, de même, que la compagnie n’ait point le placement de toute la quantité de capitaux personnels qu’elle a engagés, elle pourra, de son côté, les mobiliser en les cédant à d’autres compagnies. Supposons enfin que les entrepreneurs à qui elle les a fournis n’en aient plus l’emploi, ils pourront en transmettre l’usage à d’autres, avec perte ou avec bénéfice selon l’état du marché.
Les avantages que les préteurs comme les emprunteurs de capitaux personnels trouveraient dans la généralisation du marchandage ont déjà été analysés [71] Insistons seulement sur les plus essentiels. Pour les ouvriers, prêteurs de capitaux personnels, ce serait la possibilité d’en obtenir le placement régulier au cours du jour, c’est à dire au cours déterminé par l’état général de l’offre et de la demande, en échappant ainsi à l’usure qu’ils subissent, lorsqu’ils sont obligés de louer isolément et directement leurs capitaux personnels à des entrepreneurs qui disposent à un plus haut degré de l’espace et du temps. En effet, la publication quotidienne des cours des marchés de travail, qui serait la conséquence nécessaire de la généralisation du marchandage, les mettrait en mesure de choisir entre des intermédiaires concurrents, dans le lieu et dans le temps le plus favorables, sauf à conserver leur capital inactif, en l’hypothé-quant au besoin, dans les moments de dépression du marché, ou à ne contracter alors que des engagements à courts termes. Pour les entrepreneurs, ce serait de même, la possibilité de s’assurer un approvisionnement régulier de travail, tout en réduisant le capital nécessaire au fonctionnement de leurs entreprises, et en atténuant ainsi l’inégalité de situation qui existe entre les grands entrepreneurs et les petits. Au lieu d’exiger d’eux un payement au comptant, comme l’ouvrier est obligé de le faire, la compagnie de marchandage pourrait, en effet, se contenter d’obligations à terme, qu’elle réaliserait, selon ses besoins, eu tout ou en partie, par voie d’escompte ou d’engagement. En d’antres termes, elle ferait crédit aux entrepreneurs pour le payement des salaires, ou, pour mieux dire, elle leur transmettrait le crédit qu’elle recevait elle-même, en vendant ou en engageant leurs obligations à terme. Non seulement, ils se procureraient plus aisément le capital nécessaire à la rémunération de leur personnel, mais encore ils l’obtiendraient à de meilleures conditions, par l’intermédiaire et sous la garantie de la compagnie. Or n’oublions pas que le salaire n’étant autre chose que l’avance assurée d’une part du produit brut des entreprises, toute diminution de la rétribution du capital employé à effectuer cette avance assurée, dégrève d’autant le salaire naturel. Sous ce régime donc, le salaire naturel vers lequel, gravite incessamment le salaire courant, serait la part de produit brut afférente au travailleur, déduction faite de l’intêrêt de l’avance et de la prime du risque, abaissés au minimum.
La généralisation et le développement du marchandage, sous forme de banques de crédit personnel, placeraient, comme on voit, les travailleurs dans les conditions les meilleures que comporterait l’état actuel de la production, en leur assurant de la manière la plus constante et sous les déductions les plus faibles leur part dans le produit brut des entreprises. Il leur resterait encore, à la vérité, à gouverner leur consommation de manière à conserver et à accroître leurs capitaux personnels. Sous ce rapport, le développement du marchandage permettrait aussi de suppléer à l’insuffisance de leur self government. De même que les institutions de crédit foncier stipulent des conditions destinées à prévenir la détérioration des biens engagés, et, en cas de non observation de ces conditions, se saisissent du gage et le font administrer pour leur propre compte, des sociétés de marchandage pourraient stipuler des conditions analogues pour prévenir la détérioration des capitaux personnels qui leur seraient engagés et, en cas de non observation de ces conditions, placer les engagés sous une tutelle conservatrice. Ainsi apparaîtraient, sous des formes perfectionnées, et comme des conséquences du développement libre de la production et du crédit, non seulement l’avance et l’assurance, mais encore la tutèle qui sont contenues sous une forme embryonnaire dans l’esclavage.
Le Crédit personnel comporte encore une foule d’autres applications, que l’on ne manquera pas sans doute de taxer de chimériques aussi longtemps qu’elles ne seront point réalisées, mais dont la réalisation est rigoureusement conforme aux données de la science. Tel est, par exemple, le crédit du travail intellectuel dont il a été question dans ces derniers temps. Ce crédit aurait déjà, selon toute apparence, ses institutions spéciales, si le travail intellectuel n’avait point été, en partie du moins, dépouillé de ses garanties légitimes et nécessaires; si la propriété des produits que les savants, les littérateurs, les artistes, les inventeurs peuvent tirer soit de l’exploitation, soit de la location de leurs capitaux personnels, n’avait pas été artificiellement restreinte dans l’espace et dans le temps. Sous le régime actuel, les grandes entreprises de production intellectuelle sont à peu près impossibles. Supposons, par exemple, qu’il s’agisse de rédiger l’histoire complète d’une science ou d’un peuple. Cette œuvre, pour être convenablement exécutée, exigera l’emploi d’un nombreux personnel scientifique et littéraire, sous une direction habile, et l’avance d’un capital considérable. Mais comment pourra-t-on en couvrir les frais et réaliser un bénéfice en harmonie avec les profits ordinaires des entreprises, si la propriété n’en est pas pleinement garantie, si au delà de certaines frontières arbitrairement marquées de l’espace et du temps, le domaine de la contrefaçon commence? Sous ce régime encore, aucun homme de science ne pourrait obtenir un crédit régulier sur la simple garantie de son capital personnel. Pourquoi? Parce que la limitation de la propriété diminue la valeur des œuvres, et particulièrement de celles dont le débouché est le plus étendu et le plus durable. Mais supposons que la propriété intellectuelle soit pleinement garantie dans le temps et dans l’espace, aussitôt la situation change. Les entreprises peuvent s’agrandir en proportion de l’extension de leur débouché, et le crédit du travail intellectuel devient possible. Qu’une compagnie se fonde, par exemple, pour exploiter ce genre d’entreprises, en faisant exécuter soit isolement, soit par une combinaison d’efforts, des œuvres scientifiques ou littéraires, elle pourra rémunérer largement son personnel de savants et de littérateurs, et leur avancer au besoin, en tout ou en partie, leur rémunération. Alors aussi, la production intellectuelle pourra se diviser et se spécialiser davantage, au double avantage des producteurs et des consommateurs.
Ces exemples paraîtront peut-être entachés d’utopie; mais pour qui étudie de près le mécanisme du crédit et les applications dont il est susceptible, ils ne donnent qu’une idée bien insuffisante des possibilités de l’avenir. Si l’on ne peut, en effet, transformer le monde économique, conformément à une conception arbitraire, il n’en est pas moins vrai que le monde économique se transforme incessamment; que l’organisation des entreprises de production se perfectionne et se développe exactement comme leur outillage sous l’influence du principe générateur de tout progrès, savoir de l’économie des forces; enfin que sous le régime de propriété et de liberté qui tend à remplacer le communisme et le monopole primitifs, la société dépassera certainement, par la grandeur, la diversité et la beauté de ses formes nouvelles, tout ce que l’imagination la plus féconde peut aujourd’hui concevoir.
[69] Voir le T. Ier, page 304: La part du capital.
[70] Voir le T. Ier, page 262: La part du travail.
[71] Voir le T. Ier, page 260 et sniv.: La part du travail.
[72] Dès que les capitaux commencent à se multiplier et que la demande en devient active, on voit des intermédiaires se placer d’eux-mêmes entre les producteurs de capitaux ou capitalistes et les consommateurs de capitaux ou emprunteurs. Ces intermédiaires prennent différents noms selon la nature des emprunts auxquels ils servent d’agents, mais ils sont généralement désignés sous la dénomination de banquiers. Nous allons voir que leurs fonctions ont la plus grande analogie avec celles des négociants ou des commerçants qui servent d’intermédiaires entre les producteurs agricoles, industriels et autres, et les consommateurs.
Quelles sont, en effet, les fonctions du négociant ou du commerçant? C’est de mettre à la portée du consommateur, en franchissant le temps et l’espace, les marchandises de toute espèce qui sortent incessamment de la multitude des ateliers de la production. En remplissant cette fonction, le commerçant rend à la fois service aux producteurs et aux consommateurs. Aux premiers, il épargne la peine de vendre leur marchandise au jour le jour et par quantités souvent fort petites à la foule des consommateurs. Aux seconds, il épargne la peine d’aller se pourvoir aux lieux souvent fort éloignés où s’opère la production des choses dont ils ont besoin. Comme on l’a remarqué avec raison, le commerce est véritablement une branche de la production. Tandis que le manufacturier, par exemple, fait subir un changement de forme aux matériaux qu’il travaille, afin de les rendre propres à pourvoir aux besoins des consommateurs, le commerçant fait subir aux matériaux fabriqués ou non fabriqués qui passent entre ses mains un changement de temps et de lieu pour les approprier davantage à ces mêmes besoins. Dans la première période du développement économique des sociétés, le producteur agricole ou industriel remplit, en même temps, les fonctions du commerçant en débitant, lui-même, sa marchandise aux consommateurs; mais à mesure que la division du travail fait des progrès, on voit les deux fonctions se séparer, puis le commerce même se diviser et se sous diviser en une multitude de ramifications. On distingue les commerçants en gros, en demi-gros et en détail; enfin chaque espèce de produits finit par avoir ses commerçants spéciaux, au moins dans les grands foyers de consommation.
Eh bien, ce rôle utile que jouent les commerçants entre les producteurs et les consommateurs, les banquiers le remplissent à leur tour entre les prêteurs et les emprunteurs. Entrons dans quelques détails pour bien faire ressortir la raison d’être de ce rouage intermédiaire ou de ce medium du crédit.
Vous exercez une industrie quelconque. Chaque année, vous obtenez par la vente de vos produits, non seulement de quoi couvrir les frais de votre production et ceux de votre entretien personnel, mais encore un excédant plus ou moins considérable, selon que l’année a été plus ou moins heureuse. Qu’allez-vous faire de cet excédant? L’appliquerez-vous à votre industrie? Mais votre établissement est déjà bien assez important, eu égard à l’étendue de votre débouché. Il n’exige point l’application d’un capital supplémentaire. Que ferez-vous done de votre excédant? Le consacrerez-vous à une augmentation de vos dépenses personnelles? mais vos besoins et vos goῦts se trouvent suffisamment satisfaits par votre dépense actuelle. En outre, vous n’êtes pas fâché de vous ménager une réserve de capital pour parer aux mauvaises éventualités de l’avenir. Vous vous décidez, en conséquence, à capitaliser cet excédant de produit, autrement dit, ce produit net. Cela fait, et votre nouveau capital étant réalisé sous la forme de valeurs monétaires, vous pouvez le garder ou le prêter. Vous pouvez encore l’engager, par voie d’association, dans des entreprises de production.
Si vous conservez votre capital, sans l’employer, il ne vous rapportera rien; si vous le prêtez, il vous rapportera un intérêt.
Vous vous décidez à prendre ce dernier parti et vous cherchez des emprunteurs. Il s’en présente beaucoup, mais comme ce n’est pas votre spécialité de faire le métier de prêteur, vous le faites mal. Ou bien vous confiez votre capital à des individus sur lesquels vous n’avez pu recueillir toutes les informations nécessaires et qui ne présentent point de bonnes garanties, ou bien vous le prêtez dans une localité où les capitaux sont déjà offerts en abondance, où, par conséquent, le taux de l’intérêt est peu élevé, tandis que vous pourriez en obtenir davantage ailleurs. Mais voici qu’apparaît un intermédiaire qui s’attribue spécialement la fonction d’emprunter des capitaux d’une main pour les prêter de l’autre. En conséquence, il s’enquiert des garanties tant personnelles que matérielles que présentent les emprunteurs et il s’informe des endroits où les capitaux se prêtent au taux le plus élevé. Il parvient ainsi à opérer d’une manière plus sῦre et à des conditions plus favorables que ne pourrait le faire le propriétaire du capital. Il peut offrir, par là même, de meilleures conditions de prêt au capitaliste que celui-ci n’en aurait pu obtenir s’il avait voulu s’aboucher directement avec les emprunteurs.
L’intermédiaire ou banquier est done utile au propriétaire de capitaux ou capitaliste; il ne l’est pas moins au consommateur de capitaux ou emprunteur. Supposons, en effet, que l’intermédiaire n’existât point, l’emprunteur serait obligé de se mettre continuellement à la recherche de prêteurs, et, faute de connaître suffisamment la situation du marché des capitaux, il emprunterait parfois à un taux excessif, souvent même il ne trouverait pas à emprunter, tandis que dans d’autres parties du marché les capitaux se prêteraient à vil prix ou même ne trouveraient point de preneurs.
En résumé done, l’intermédiaire, en empruntant d’une main pour prêter de l’autre, rend à la fois service aux prêteurs et aux emprunteurs. Quant à son bénéfice, il le trouve dans la différence du taux auquel il emprunte et de celui auquel il prête. Sous un régime de libre concurrence, cette différence ne peut jamais s’élever de manière à attribuer aux intermédiaires du crédit un bénéfice supérieur, toutes proportions gardées, à celui des autres producteurs. En tous cas, ce bénéfice a pour limite extrême l’importance même du service rendu: il ne peut aller au delà, car les emprunteurs et les prêteurs ne manqueraient pas de s’aboucher directement plutôt que de surpayer le service de l’intermédiaire.
Ainsi, le crédit s’organise de lui-même, dès que les capitaux commencent à se former, d’une part, dès qu’ils commencent à se demander, d’une autre part. Il procède dans son organisation par l’établissement d’intermédiaires qui facilitent la diffusion et l’emploi utile des capitaux tout en assurant mieux leur conservation.
L’établissement des intermédiaires du crédit est done, à tous égards, un progrès. On s’en convaincra plus complétement encore si l’on considère les conditions qu’ils doivent réunir pour attirer la confiance des capitalistes, sans laquelle il leur serait impossible de se former une clientèle.
Ayant pour fonction spéciale d’emprunter des capitaux pour les prêter, les intermédiaires doivent évidemment offrir au plus haut degré, toutes les garanties matérielles, intellectuelles et morales que l’on exige des simples emprunteurs. Ils doivent, d’abord, posséder un capital assez considérable pour leur servir de caution vis-à-vis de leurs prêteurs. Plus ce capital est libre, aisément réalisable, et plus la caution est valable. Il n’est pas nécessaire que le capital appartenant au banquier soit engagé dans les opérations de la banque. Il est même préférable qu’il ne le soit pas; il est préférable qu’il soit placé ailleurs, en valeurs solides et facilement réalisables. Ceci afin qu’il demeure intact et qu’on puisse y recourir dans le cas où la situation de la banque se trouverait compromise. Cette caution si considérable qu’elle soit, ne suffit pas cependant. Elle ne présentera même qu’une faible sécurité si celui qui la fournit manque de probité, s’il ne joint pas les garanties morales aux garanties matérielles. Elle sera de peu de valeur encore s’il ne possède pas assez d’intelligence ou d’esprit des affaires pour distribuer utilement le crédit dont il est le dispensateur. Car s’il choisit mal ses clients, s’il aventure dans des opérations chanceuses ou dans des entreprises chimériques les capitaux qui lui sont confiés, s’il manque, pour tout dire, de jugement et de prudence, il ne tardera guère à subir des pertes assez considérables, non seulement pour absorber le capital qui lui sert de caution vis-à-vis de ses prêteurs, mais encore pour entamer les fonds qu’il a empruntés en vue de les faire valoir.
La profession d’intermédiaire du crédit ou de banquier exige, comme on voit, une réunion de garanties matérielles et personnelles assez rares. Sans doute, tous les hommes qui exercent cette profession si importante et si délieate, sont loin de les posséder au même degré; mais les capitalistes ne confient volontiers leurs fonds qu’à ceux qui ont la réputation d’en être largement pourvus. Sans doute aussi, la voix publique se trompe quelquefois: les réputations financières peuvent être surfaites comme les réputations politiques, littéraires ou artistiques. Mais, en général, l’erreur est ici l’exception plutôt que la règle. D’où il résulte que la multiplication des intermédiaires a pour résultat non seulement d’établir un trait d’union entre les emprunteurs et les prêteurs, mais encore d’assurer davantage le prêt des capitaux, partant de réduire le taux de l’intérêt. Car une institution de crédit, grande ou petite, dont la réputation est bien établie et qui est intéressée à la maintenir pour conserver sa clientèle, présente une somme plus élevée de garanties que les emprunteurs isolés avec lesquels les capitalistes devraient s’aboucher directement si l’intermédiaire n’existait point. Alors même, du reste, que les garanties seraient égales des deux parts, les capitalistes, pris individuellement, ne possédant pas les mêmes moyens d’information et de contrôle que des intermédiaires qui ont pour spécialité de prêter et d’emprunter, seraient obligés de se couvrir du risque dérivant de l’insuffisance même de leurs moyens d’information, en élevant, d’une manière proportionnelle, la prime d’assurance comprise dans le taux de l’intérêt. L’introduction des intermédiaires dans le mécanisme du crédit, n’a donc pas eu seulement pour résultat de faciliter les emprunts, mais encore de diminuer les risques réels ou supposés du prêt et de rendre, par là même, le taux de l’intérêt réductible d’autant.
Les fonctions et les opérations de chaque intermédiaire different selon le rang qu’il occupe dans la hiérarchie du crédit, selon encore la spécialité à laquelle il est voué.
Mais d’abord que faut-il entendre par ces expressions le rang et la spécialité, appliquées aux institutions de crédit?
Le rang d’abord. En examinant ces institutions qui sont nées d’ellesmêmes et qui se sont développées, comme une véritable végétation économique, pour satisfaire aux besoins réciproques des prêteurs et des emprunteurs, on s’aperçoit que la même hiérarchie qui s’établit dans le commerce ordinaire, où l’on distingue, comme chacun sait, des négociants en gros et en demi-gros et des marchands de détail se retrouve aussi dans le commerce des capitaux. Viennent d’abord les grandes banques qui reçoivent et qui distribuent les capitaux en masses, en négligeant les opérations secondaires. Viennent ensuite les petites banques, ordinairement les succursales ou les satellites des grandes et qui servent d’intermédiaires entre celles-ci et le haut commerce ou la grande industrie. Viennent enfin les banquiers du moyen et du petit commerce, de la moyenne et de la petite industrie, qui font le détail des opérations de banque.
La spécialité ensuite. Le commerce des capitaux a encore, comme le commerce des produits, ses spécialités et il les aura de plus en plus à mesure qu’il se développera davantage. Tels établissements fournissent spécialement des capitaux à l’agriculture sous des conditions et à des termes appropriés à ce genre de prêts; tels autres en fournissent à l’industrie et au commerce. Les uns encore s’occupent de rassembler et de constituer les capitaux nécessaires aux entreprises en voie de formation; les autres, au contraire, s’abstiennent d’immobiliser des capitaux dans les nouvelles entreprises; mais ils pourvoient aux besoins de crédit des entreprises existantes, dont ils se chargent, en même temps, de recouvrir les créances et d’effectuer les paiements.
Essayons maintenant de donner une idée des fonctions qui sont dévolues à ces diverses catégories d’établissements de crédit.
Commençons par le degré inférieur de la hiérarchie. Transportons-nous dans une localité manufacturière où l’on fabrique, par exemple, des étoffes de laine ou de coton. Nous y trouvons des industriels de tous rangs, les uns possédant d’immenses manufactures, les autres n’ayant que de petits ateliers. Ces industriels sont fort inégalement pourvus de capitaux, même en tenant compte de l’inégalité du chiffre de leurs affaires. Les uns possèdent non seulement les bâtiments et les machines nécessaires à leur industrie, c’est à dire le capital fixe mais encore tout le capital circulant nécessaire à l’achat successif du combustible, de la laine ou du coton, des produits chimiques et des autres matières premières qu’ils employent, ainsi qu’au payement de leurs ouvriers, jusqu’au moment de la réalisation de leurs produits. Ces industriels si amplement pourvus de capitaux n’ont, on le conçoit, aucunement besoin de recourir au crédit pour s’en procurer, du moins dans les circonstances ordinaires. Au contraire! Leurs capitaux étant suffisants pour couvrir toutes leurs dépenses de production jusqu’aux époques de la réalisation de leurs produits, à ces époques ils se trouvent surchargés de fonds et ils ne sont pas fâchés de les placer d’une manière temporaire. Un des modes de placement les plus usités, en pareil cas, consiste dans l’augmentation des crédits à la vente des marchandises. Car c’est là un moyen presque infaillible, quoiqu’il soit, à la vérité, fort dangereux, d’accroître le nombre de ses acheteurs. Les marchands qui achètent à de longs termes sont naturellement portés à acheter davantage, le crédit qu’on leur accorde leur permettant d’augmenter les facilités de payement qu’ils accordent de leur côté aux consommateurs et de les exciter par là même à consommer davantage.
Si les industriels qui possèdent des capitaux au delà même des nécessités de leur industrie, ont encore un excédant de fonds après avoir accordé à leur clientèle un crédit aussi étendu que possible, et s’ils ne veulent point garder ces fonds, d’une manière improductive, dans les intermittences de leurs besoins, qu’en peuvent-ils faire? Ils peuvent les placer directement eux-mêmes; mais, s’ils sont prudents, ils les placent de manière à pouvoir les réaliser aisément, en cas de besoins imprévus. Ils peuvent encore les confier à une banque ou à un banquier qui leur en bonifie un intérêt et qui se charge de les faire valoir.
Voilà donc, en définitive, une catégorie d’industriels qui n’empruntent point le secours du crédit. Mais nous n’avons pas besoin d’ajouter que cette aristocratie de l’industrie est peu nombreuse. Au dessous d’elle se place à des degrés divers la multitude des entrepreneurs qui ne possèdent point une quantité suffisante de capital, et qui sont, en conséquence, incessamment obligés de recourir au crédit.
Ces entrepreneurs mal pourvus de capitaux n’en doivent pas moins, remarquons-le bien, vendre leurs produits à terme. Ils sont tenus d’imiter sous ce rapport leurs concurrents plus riches, afin de pouvoir se former une clientèle ou la conserver. En revanche, ils achètent autant que possible à terme aussi, les matières premières dont ils font usage. Ils ont toutefois à payer, en tous cas, au comptant, les salaires de leurs ouvriers et à pourvoir aux dépenses courantes. Dans ce but, ils doivent se procurer un supplément plus ou moins considérable de capital circulant sous forme de numéraire. Ils recourent pour cela à un banquier auquel ils remettent des traites ou des mandats sur les négociants en draps ou en cotonnades, à qui ils ont vendu des marchandises payables à terme. Le banquier leur avance le montant de ces mandats ou de ces traites, représentant des marchandises vendues et il se charge d’en faire le recouvrement. Quelquefois encore, les industriels les moins pourvus de capitaux sont obligés d’emprunter tout à fait à découvert, c’est à dire sans fournir, en échange, des créances payables à terme.
La situation du banquier faisant commerce de capitaux vis à vis de ces différentes catégories de clients est, comme on voit, fort diverse. Aux uns, il ne prête point, il emprunte au contraire. Aux autres, il prête en leur achetant des créances exigibles à des termes plus ou moins éloignés et représentant des marchandises vendues. Aux derniers enfin, il prête purement et simplement sans être couvert par des sécurités d’aucune sorte.
Mais si les banquiers ne fournissent point à tous leurs clients des capitaux complémentaires, ils leur rendent à tous certains services généraux dont il est nécessaire de donner un aperçu. 1° Ils font, pour leur compte, des payements et des recouvrements, leur servant ainsi de caissiers. 2° Ils leur fournissent des espèces pour salarier leurs ouvriers ou des lettres de change pour payer les matières premières ou les instruments de leur fabrication, lorsque ceux-ci proviennent d’autres localités ou d’autres pays.
Un industriel ou un négociant a toujours une multitude de payements à faire, en laissant de côté même les salaires et les approvisionnements qu’il est tenu de payer à des époques périodiques. Il est obligé, en conséquence, de conserver toujours dans sa caisse une somme d’argent plus ou moins considérable. Mais il peut se débarrasser de ce soin en chargeant un banquier de remplir pour son compte l’office de caissier; il donne alors, au lieu d’espèces, pour régler ses achats, des mandats ou chèques payables à vue sur son banquier. Ce système, généralement usité en Angleterre et aux États-Unis occasionne une assez notable économie de travail et de capital. En premier lieu, il permet à l’industriel ou au négociant de se passer d’un employé spécial pour tenir sa caisse. Trois ou quatre commis chargés de la comptabilité et de la caisse d’un seul banquier font dans ce système toute la besogne qui en exigeait auparavant trente ou quarante chez les industriels ou chez les négociants qui payaient chez eux. En second lieu, le banquier n’a pas besoin de conserver en caisse une somme égale à la totalité des sommes qui étaient nécessaires aux trente ou quarante caissiers qu’il remplace, les virements de compte se substituant pour une large part, daus ce système, aux payements en espèces, d’où résulte une économie de capital plus importante encore que celle de travail [73] .
Le banquier n’est pas chargé seulement de faire des payements pour le compte des industriels et des négociants; il l’est aussi de faire des recouvrements.
Examinons en quoi consistent communément les créances qu’il est chargé recouvrer et comment les choses se passent à cet égard.
Vous avez, je suppose, vendu dans une localité plus ou moins éloignée du siége de votre industrie, une certaine quantité de vos produits à un terme de deux ou trois mois, ce qui signifie que vous accordez pendant deux ou trois mois à votre acheteur un crédit égal au montant de la valeur de la marchandise. De quelle façon allez-vous opérer le recouvrement de cette créance? Vous pouvez exiger de votre acheteur qu’il vous en envoie, à l’échéance, le montant en numéraire. Mais d’abord ce procédé implique un transport d’argent toujours passablement coῦteux. Ensuite, il ne vous permet pas de tirer parti de votre créance avant qu’elle ne vienne à échoir, dans le cas où vous auriez besoin d’argent. Vous avez recours, en conséquence, à un autre procédé de recouvrement beaucoup plus économique et auquel le développement des relations commerciales a conduit naturellement, c’est le procédé du billet à ordre, du mandat ou de la lettre de change. Ou bien vous faites un billet, une traite sur votre acheteur pour le montant des marchandises que vous lui avez vendues et qui échoient au terme stipulé, ou bien il vous envoie une promesse de payement, ou bien encore il vous remet des billets tirés par lui sur des acheteurs de ses marchandises ou sur son banquier jusqu’à concurrence du montant de votre créance. Maintenant, que faites-vous de ces mandats de payement, lesquels peuvent affecter, comme on voit, les formes les plus diverses? Vous pouvez les faire recouvrer directement, à leur échéance, dans les endroits où ils sont payables et vous en faire expédier le montant en numéraire. Vous pouvez encore les remettre à vos propres fournisseurs qui vous ont vendu à terme des matières premières ou d’autres produits, en tenant compte de la différence des échéances. Vous pouvez enfin les remettre à un banquier pour qu’il se charge de les faire recouvrer, puis de vous en envoyer le montant, soit sous forme de numéraire, soit sous forme d’autres lettres de change, à moins que vous ne préfériez en disposer chez lui ou chez ses correspondants, auprès desquels il vous ouvre, dans ce but, un crédit. Ces divers modes de recouvrement sont tour à tour employés, selon qu’ils répondent plus ou moins aux convenances du moment. Le premier toutefois (l’envoi direct de numéraire) est rarement usité. Il arrive plus souvent que des billets ou des mandats fournis par un acheteur, en payement de marchandises qui lui ont été livrées, soient remis à un vendeur en payement des marchandises reçues. Mais presque toujours ces billets sont finalement remis à un banquier qui se charge d’en opérer le recouvrement; et qui, ayant, dans ce but, des correspondants daus la plupart des localités industrielles ou commerciales, se trouve mieux en mesure qu’un simple négociant d’effectuer cette rentrée à peu de frais. Selon que la localité est plus ou moins écartée, et que les affaires y sont plus ou moins nombreuses et actives, selon encore que la somme à recouvrer est plus ou moins importante, le banquier exige une commission de recouvrement et stipule une perte de place plus ou moins forte. Dans les grands foyers d’affaires, il n’y a pas de perte de place. Beaucoup de petits banquiers ou de succursales de banques ont pour fonction spéciale et presque unique d’opérer des recouvrements, surtout dans les pays où le crédit est encore peu développé.
En échange, et comme contre valeur de ces créances industrielles ou commerciales qu’on leur donne à recouvrer, que demande-t-on aux banquiers? On leur demande, comme nous venons de le dire, tantôt des envois de numéraire, tantôt l’autorisation de disposer chez eux ou chez leurs correspondants du montant de la somme qu’ils ont recouvrée, tantôt enfin des lettres de change sur certaines places que le commerce est convenu de choisir pour effectuer ou pour recevoir le payement des principales marchandises qui font l’objet des échanges intérieurs ou internationaux.
Complétons cette explication du mécanisme des recouvrements, au moyen de l’hypothèse que nous avons formulée tout à l’heure.
Vous êtes, je suppose, fabricant de tissus de laine ou de coton. Vous avez vendu à terme certaines quantités de vos tissus dans le pays même (en Belgique), d’autres quantités en Hollande, d’autres encore en Italie, d’autres enfin aux États-Unis. Comment allez-vous vous y prendre pour obtenir le payement de ces marchandises que vous avez vendues à des termes plus ou moins éloignés? S’il s’agit de vos acheteurs de l’intérieur, vous pourrez faire des traites sur eux. Vous pourrez en user de même avec vos acheteurs de la Hollande, de l’Italie et des Etats-Unis; mais s’ils demeurent dans des localités écartées, vous serez exposé à payer des frais considérables pour le recouvrement de vos traites. Que faites-vous donc? Vous stipulez, en livrant vos marchandises, qu’elles seront payables dans des villes qui sont les foyers d’un grand mouvement d’affaires, où les relations sont nombreuses et les recouvrements faciles. Certaines villes deviennent ainsi, par l’accord libre des parties contractantes, les lieux où se règlent la plupart des grandes transactions commerciales. Vos acheteurs vous fourniront donc des lettres de change ou vous ouvriront des crédits sur Livourne, sur Amsterdam, sur Amsterdam, sur Francfort-s/Mein, sur Paris, sur Londres ou sur tout autre foyer d’opérations de banque. Mais comment auront-ils fait pour se procurer ces lettres de change ou ces crédits? Rien de plus aisé à concevoir. Vous leur avez vendu, vous fabricant, des étoffes qu’ils ont revendues à leur clientèle, laquelle est ordinairement disséminée dans une foule de localités différentes. Ils ont fait des traites sur leurs clients ou ils ont reçu d’eux du numéraire ou des mandats de payement. Ces traites, ce numéraire ou ces mandats, ils les ont remis à leurs banquiers, et ceux-ci leur en ont fourni la contre-valeur en lettres de change ou en crédits ouverts sur les villes où s’opère le règlement des grandes opérations commerciales ou, pour nous servir de l’expression consacrée, sur les places de change. Voilà comment vos acheteurs étrangers ont pu se procurer des moyens de payement convenables pour s’acquitter envers vous.
Vous recevez donc, en payement des marchandises que vous avez fournies à l’intérieur, des billets ou des mandats sur différentes localités de la Belgique; en payement des marchandises que vous avez fournies au dehors, des lettres de change ou des crédits ouverts sur l’étranger. Que faites-vous des uns et des autres? Si vous avez précisément à l’époque où vous recevez ces remises des marchandises à payer (matières premières et autres éléments de production) à l’intérieur et à l’étranger, vous pouvez vous servir des remises qui vous sont faites pour vous libérer, en les passant directement à vos vendeurs. Vous pouvez passer à vos vendeurs belges les remises qui vous ont été faites sur la Belgique, à vos vendeurs américains vos lettres de change ou vos crédits sur Londres, etc., etc. Mais il n’est pas ordinaire que les époques où vous avez des payements à faire pour les marchandises que vous avez achetées soient les mêmes que celles où vous recevez des remises pour les marchan-dises que vous avez vendues; il n’est pas ordinaire non plus que les remises qui vous sont fournies soient payables précisément sur les places où vous devez faire vos propres payements, ni que les sommes que vous recevez d’un côté s’ajustent avec celles que vous avez à fournir d’un autre. Que faites-vous donc? Vous passez à votre banquier, à mesure que vous les recevez, toutes les remises que vous ne pouvez utiliser directement pour solder vos achats, et vous lui en demandez la contre-valeur, en lettres de change ou en crédits ouverts sur les places convenables, aux époques où vous avez des payements à effectuer. Vous lui demandez pour payer aux échéances stipulées les laines que vous avez achetées en Allemagne, des lettres de change ou des crédits ouverts sur Francfort-sur-Mein; pour payer les laines d’Australie ou les cotons d’Amérique, des lettres de change ou des crédits ouverts sur Londres; pour payer les indigos de Java des lettres de change ou des crédits ouverts sur Amsterdam.
Recevoir des remises, en billets de toute sorte pour les recouvrer ou les faire recouvrer, fournir d’autres remises en papier, en crédits ouverts ou en numéraire, comme contre-valeur des premières, voilà donc une des principales fonctions des banquiers. Remarquons qu’à la rigueur le crédit peut n’intervenir que d’une manière accessoire dans les opérations de ce genre. Il se peut, en effet, que le banquier ne soit qu’un simple commissionnaire de recouvrements; qu’il ne fasse à ses clients aucune avance; qu’il se borne à leur fournir la contre-valeur de leurs remises après qu’elles ont été recouvrées. Toutefois, le crédit joue communément un rôle considérable dans ces opérations, car les industriels ou les négociants ont besoin pour la plupart, par suite de l’insuffisance de leurs capitaux, de réaliser, avant l’échéance, les remises qui leur sont faites, et ils recourent dans ce but, au procédé de l’escompte.
Des conditions et du mécanisme du crédit (2e article), Messager russe 1858.
[73] Voici une description empruntée à une correspondance de Londres de cet ingénieux systeme de chèques que tous les pays du continent devraient emprunter à l’Angleterre.
“Toute maison de commerce, grande ou petite, tout fabricant et marchand, a sa banque où il dépose une somme plus ou moins forte. La banque d’Angleterre n’accepte point de dépôts inférieurs à 12,500 fr. La Banque de l’Union et quelques autres de création récente se contentent d’un dépôt de 2,500 francs. Lorsque le déposant fait son premier versement, il recoit deux livrets; l’un qui porte son nom, sa profession, sa demeure, et le montant du dépôt. La colonne de gauche de ce livre constate les versements successifs du déposant. C’est la colonne du crédit.
L’autre, à droite, mentionne les mandats ou chèques tirés et accuse le débit. Quand il y a balance entre les deux colonnes, les chèques sont impitoyablement refusés, à moins de jouir d’une certaine confiance auprès du secrétaire de la banque, qui d’ailleurs prévient le tireur d’avoir à couvrir immédiatement l’institution. Le second livret est un petit registre à souche et imprimé, sur lequel on a laissé les blancs nécessaires pour inscrire en toutes lettres la somme, le nom du bénéficiaire, puis la signature du tireur. La souche répète brièvement cette inscription.
Les commercants ne sont pas les seuls à jouir du bénénce des chèques. Toutes les classes de la société ont un compte ouvert à une ou à plusieurs banques. Médecins, avocats, rentiers, artistes, artisans, voire les gens de lettres, n’achetent, ne soldent leurs factures de tout genre qu’à l’aide de ces commodes mandats qui partent du chiffre modeste de 25 schellings jusqu’aux sommes les plus considérables. Indépendamment de la facilité de payer en un papier presque toujours accepté comme un billet de banque, ce système offre l’immense avantage de permettre à tout individu qui banque quelque part, de ne point conserver de grosses sommes chez lui.
Les meubles solides sont rares, les serrures perfectionnées plus rares encore, et le vol domestique est favorise par les singularités de la loi anglaise et par l’absence du ministère public. Après avoir constaté le flagrant délit avec deux témoins, il reste au volé à intenter un procés au voleur et à ses risques et périls. Dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, l’on se résigne, et le coupable va voler ailleurs.
Le chèque n’a rien à craindre du voleur, quoiqu’il ait cette vague formule: Ordre de James ou au porteur. Mais lorsqu’on envoie un chèque par la poste ou par un agent en qui la confiance n’est pas absolue, on croise par deux bases transversales le centre du mandat. Ce signe dit a la banque sur laquelle il est tiré, que le porteur ne peut recevoir lui-même, mais bien par l’intermédiaire d’une autre banque. Si donc ce porteur infidèle n’a point un compte ouvart quolque part, le chèque devient lettre-morte dans ses mains.
Le refus par une banque de payer un chèque équivaut, pour le crédit du tireur, à un effet de commerce protesté. Les banques y mettent du ménagement, parce qu’il arrive souvent que le tireur s’est trompé sur le chiffre de sa balance. Elles ont plusieurs formules pour exprimer leur refus:”
- “1° En écrivant en tète du chèque ces deux lettres N. S.not sufficient.” (balance insuffisante) Ces deux lettres, grosses ou petites, suivant que le tireur est plus ou moins en odeur de sainteté à la Banque.
- “2° Refer to the drawer.” (En référer au tireur). C’est un refus mitigé, qu’on interprète par une erreur on un malentendu.
- “3° Effects not cleared.” (Valeurs non encore encaissées, pour converture.) Dans les cas ordinaires, ces sortes de chèques sont payés le lendemain.
- “4° No effects.” (Point de fonds). La balance est éteinte, et souvent même la banque est à découvert. C’est la formule brutale.
- “5° Order not to pay.” (Ordre de ne point payer). Signifie que le chèque a été escroqué. Non payement, quand bien même le tireur aurait un million à son crédit. Caissrer responsable en cas de payement.
- “6° Accound closed.” (Compte fermé). Signe d’une seission définitive entre la banque et les client.
“Ainsi au moyen de ces réglementations très simples et familières à tout le monde, ac hat et ventes, échanges, acquits de billets à ordre, de factures, mémoires, transactions de toute nature, s’opèrent avec une promptitude, une aisance et une sécurité que l’on ne saurait concevoir qu’en voyant fonctionner la machine soi-même. Inutile d’ajouter que l’on ne voit jamais à Londres, ces garçons de caisse de Paris succombant sous le poids des groups encaissés dans tous les quartiers de votre capitale.
Au-dessus d’une certaine somme, ordinairement 2,500 francs, la banque vous paye un intérêt dont le taux est établi suivant l’état du marché monétaire, et surbordonn au taux de la banque d’Angleterre. Cet intérêt varie fréquemment. Pendant la crise de 1857, les dépositaires ont tirè 6, 7 et 8 p. c. du capital versé. Après la crise le taux est tombé à 2 p. c. seulement.
Si la balance du dépositaire est constamment très faible la Banque vous fait paver deux guinées par an (53 fr.) pour la couvrir de ses frais d’administration. Personne ne se plaint d’un commis zélé, fidèle, incorruptible dont les services sont mis à prix.
D’ailleurs, avoir un compte ouvert à une banque vous pose singulièrement un homme, que cet homme soit marchand ou artiste, qu’il ait un dépôt de dent mille francs ou de trois mille et mème moins. Aussi fait on des effort prodigieux à cette fin de posséder un check-book on livre à mandats portant en tête London and Westminster Bank, Union of London, et mieux encore Bank of England. Ceux qui disposent de cette dernière vignette sont les matamores du pays.”
[74] Les banques de dépôt avaient encore pour but d’empêcher la détérioration des espèces monétaires, en ne recevant les métaux précieux qu’en barres ou du moins en ne les recevant monnayés que d’après leur valeur propre. Les métaux restant intacts dans les caves ne pouvaient pas perdre par l’usure. Toutes les affaires se traitaient en argent de banque et se trouvaient ainsi à l’abri des fluctuations que de fréquentes altérations, surtout au moyen àge, avaient apportées dans le cours des monnaies en circulation, au grand préjudice du commerce. Il s’ensuivit que les effets payables en monnaie de banque se négocièrent beaucoup plus facilement et que le cours s’en établit à l’avantage de certaines places, ce qui ne fut pas une des moindres causes de leur prospérité. La monnaie de banque gagnait sur la monnaie courante une différence nommée agio; de là, le nom d’agioteurs qui désigna plus tard un genre particulier d’opérations intervenant dans toutes les branches de commerce. (H. Scherer. Histoire du commerce, traduit par H. Richelot et Ch. Vogel. T. II. P. 42.)
[75] Le marc banco, qui est l’étalon monétaire de la Banque de Hambourg, a-t-il consisté originairement dans la valeur d’un certain poids d’argent fin? Oui, disent les métallistes, et la preuve, c’est que pour chaque marc de Cologne d’argent fin déposé à la banque, on y est crédité de 27 marc 12 schellings de banque, ce qui établit la valeur du marc banco à ![]() ; mais il est clair que ce prix, auquel la Banque de Hambourg reçoit la marchandise argent, n’est point invariable de sa nature; qu’en admettant que cette marchandise vint à hausser ou à baisser, la banque pourrait modifier le taux auquel elle la reçoit. — A l’origine, la Banque de Hambourg avait pris pour étalon la valeur de l’écu d’Empire; mais cet écu ayant été affaibli, la banque maintint son étalon à un point intermédiaire entre l’ancien écu et le nouveau. Voici ce que dit à ce sujet Ch. Coquelin, d’après Busch. (La Banque de Hambourg rendue facile.)
; mais il est clair que ce prix, auquel la Banque de Hambourg reçoit la marchandise argent, n’est point invariable de sa nature; qu’en admettant que cette marchandise vint à hausser ou à baisser, la banque pourrait modifier le taux auquel elle la reçoit. — A l’origine, la Banque de Hambourg avait pris pour étalon la valeur de l’écu d’Empire; mais cet écu ayant été affaibli, la banque maintint son étalon à un point intermédiaire entre l’ancien écu et le nouveau. Voici ce que dit à ce sujet Ch. Coquelin, d’après Busch. (La Banque de Hambourg rendue facile.)
“A l’origine, la Banque de Hambourg avait adopté comme type l’écu d’Empire qui valait 540 ases de Hollande, et l’avait accepté sur ce pied; mais plus tard, elle fut contrainte de se départir de cette règle, par suite des altérations de monnaies entreprises par quelques souverains. Dans le XVIIe siècle, l’empereur Léopold Ier, et dans le XVIIIe, Marie-Thérèse d’Autriche renversèrent le plan des Hambourgeois, comme le dit Busch, en faisant frapper des écus d’Empire qui n’avaient que 516 ases de valeur effective.
Un certain nombre de ces nouveaux écus s’étant glissés dans la banque à l’insu des administrateurs, il en résulta un grand embarras dans les payements. Comme on ne savait sur qui devait retomber la perte, on voulut la faire porter proportionnellement sur tous les déposants en les remboursant, partie en écus de bon aloi, partie en écus altérés. Pour dresser les comptes et faire une juste répartition, on chercha une moyenne proportionnelle entre l’ancien et le nouvel écu, et l’on trouva que cette moyenne était de 528 ases pour chaque écu. Voilà comment l’écu banco de la Banque de Hambourg fut fixé à cette époque à la valeur de 528 ases, valeur idéale, inférieure à celle de l’ancien écu d’Empire, mais supérieure à celle de l’écu nouveau, et qui est demeurée inaltérable au milieu des variations en plus ou en moins que les monnaies courantes ont encore subies.” (Ch. Coquelin. Dictionnaire de l’économie politique. Art. Agio.)
[76] Voltaire, dans son Histoire de Charles XII, avance, un peu légèrement peut-être, que la Banque de Stockholm est la plus ancienne de l’Europe. Le fait est qu’elle fut fondée en 1668, c’est à dire assez longtemps après celles d’Amsterdam et de Hambourg, et fort longtemps surtout après celles de Gênes et de Venise., Mais ce qui lui mériterait une attention particulière, c’est qu’elle parait avoir fait usage la première des billets de circulation. “Les récépissés que la Banque de Stockholm délivrait aux négociants qui avaient des fonds à leur crédit chez elle circulaient, en effet, dit M. Gautier (Des Banques et des institutions de crédit en Amérique et en Europe), comme argent comptant dans toute la Suède; ils étaient reçus en payement de marchandises de toute espèce, et même, depuis un édit du 11 janvier 1726, en payement de lettres de change.” (Ch. Coquelin. Dictionnaire de l’économie politique. Art. Banque.)
[77] On trouvera dans tous les traités d’économie politique et dans une foule d’ouvrages spéciaux des notices historiques sur les banques de circulation et sur les divers régimes auxquels elles se trouvent soumises. Nous y renvoyons nos lecteurs et, en particulier, à l’excellent résumé de M. Joseph Garnier dans son Traité d’économie politique. (Des Banques et des autres institutions de crédit, chap. XX.)
[78] Consulter sur le mécanisme des crises, Charles Coquelin, Du Crédit et des Banques, chapitre VII. Des crises commerciales.—Unité et multiplicité des banques. — Privilége et liberté.
[79] Voir sur les relations des banques avec les gouvernements le Dictionnaire de l’économie politique, art. Banque, par Charles Coquelin; le Traité théorique et pratique des opérations de banque, par J. G. Courcelle-Seneuil, liv. IV, chap. III; G. Dupuynode, De la Monnaie, du crédit et de l’impót, etc., etc.
[80]
“C’est à sir James Stewart que nous devons, je pense, l’idée première d’une circulation affranchie de tout étalon particulier; mais il n’a été donné à personne de nous indiquer le contrôle qui doit servir à fonder l’uniformité de la valeur dans un système monétaire ainsi conçu. Ceux qui ont émis cette opinion n’ont pas remarqué qu’une telle circulation, loin dêtre invariable, restait soumise aux plus grandes fluctuations, que la seule fonction dévolue à l’étalon consiste à régler la quantité, et avec la quantité, la valeur de la circulation; qu’enfin, sans un criterium reconnu, elle demeurerait exposee à toutes les variations qui naîtraient de l’ignorance et de l’avidité de ceux qui l’émettent.
On a prétendu, il est vrai, que nous devons calculer sa valeur en la comparant avec l’ensemble de toutes les marchandises, et non avec telle ou telle marchandise spéciale. Mais, en admettant même, ce qui est contraire à toute probabilité, que les créateurs de la monnaie de papier voulussent régler le montant de la circulation sur ces bases, ils n’auraient aucun moyen de le faire; car les marchandises sont soumises à des altérations continuelles dans leur valeur relative. Et comme il est impossible de déterminer quelle est celle dont le prix a haussé, et celle dont le prix a fléchi, il faut reconnaître l’impuissance radicale d’un tel contrôle.
Certaines marchandises augmentent de valeur en raison des impôts, de la rareté des matières premières qui les constituent, ou de toute autre cause qui a pu accroître les difficultés de la production. D’autres, au contraire, fléchissent sous l’influence des perfectionnements mécaniques, d’une meilleure division du travail, d’une habileté nouvelle chez les travailleurs, en un mot, sous l’influence de moyens de production plus faciles. Pour déterminer la valeur de la monnaie d’après l’épreuve proposée, il faudrait la comparer successivement avec l’innombrable variété de marchandises qui circulent au sein de la société, sans tenir compte, pour chacune, de tous les effets qu’ont pu produire sur sa valeur les causes ci-dessus. Cette tâche, selon moi, est tout simplement impraticable. (Ricardo. Propositions tendant à l’établissement d’une circulation monétaire économique et sure. (Euvres complètes, édit. Guillaumin, p. 581.)”
Cette objection de Ricardo est évidemment très faible. Il n’est pas nécessaire, en effet, de “comparer successivement la valeur de la monnaie avec l’innombrable variété de marchandises qui circulent au sein de la société”, il suffit de constater si cette masse de marchandises diverses ne subit que des fluctuations de prix particulières, c’est à dire des fluctuations propres à chaque catégorie de produits, et qui proviennent soit d’une réduction, soit d’une augmentation des frais de production, ou, d’une manière immédiate, de l’état de l’offre et de la demande; ou bien si la masse de ces marchandises diverses qui s’échangent contre de la monnaie subit une hausse ou une baisse générale. Dans ce cas, il est clair que la variation provient non des marchandises ellesmêmes, mais de la monnaie, et qu’il faut, en conséquence, étendre ou resserrer les émissions monétaires pour maintenir l’intégrité de l’étalon. Or, maintenant surtout que nous pouvons connaître chaque jour, grâce à la rapidité de la transmission des nouvelles, les prix de toutes les marchandises sur les marchés les plus éloignés, rien ne serait plus facile que de constater, chaque jour aussi, s’il y a une tendance générale à la hausse ou à la baisse dans les prix.
[81]
“Un florin banco, dit notamment Jacques Steuart, a une valeur plus déterminée que ne l’a une livre pesant d’or ou d’argent fin; c’est une unité de mesure dont l’invention est due aux connaissances raffinées du commerce.
Cette monnaie de banque est aussi invariable et aussi ferme qu’un rocher au milieu des flots. Cet étalon idéal sert à régler le prix de tout, et peu de personnes peuvent dire exactement sur quoi il se fonde. Il n’y a pas jusqu’à la valeur intrinsèque des métaux précieux qui ne varie à l’égard de cette mesure commune. Une livre pesant d’or ou d’argent, un millier de guinées, d’écus, de piastres ou de ducats valent tantôt plus, tantôt moins, relativement à cet étalon invariable, selon que la proportion de valeur varie entre les métaux dont ils sont composés.
Quelque changement que les espèces monnayées subissent dans leur poids, leur finesse ou leur dénomination, rien n’est capable d’affecter la monnaie de banque. Ces espèces courantes sont considérées par la banque comme tout autre objet d’échange. Telle est donc la monnaie de banque d’Amsterdam. Elle peut toujours être représentée à quelque temps que ce soit, avec la plus grande exactitude par une certaine portion déterminée d’or ou d’argent; mais elle peut être aussi peu liée à cette valeur pendant l’espace de vingt-quatre heures qu’à celle d’une tonne de harengs. “Jacques 1Steuart. Recherche des principes de l’économie politique. Liv. III, chap. II.
[82] Voir le Dictionnaire de l’économic politique. Art. Noblesse.
[83] Voir, au sujet de l’organisation du monopole des corporations, l’excellente Histoire des classes ouvrières en France, par M. E. Levasseur.
[84]
“La plupart de nos villes flamandes, dit M. Coomans, avaient une ou deux foires par an. J’ai à présenter à cet égard une observation essentielle.
Nos économistes ont tort, je pense, de ne pas appuyer plus souvent leurs théories sur l’expérience. Ainsi le free trade est loin d’être une idée nouvelle, et les hommes pratiques qui le qualifient d’utopie ne savent pas l’histoire. Le free trade a été pratiqué de la manière la plus large dans les grandes cités du moyen âge, même avant l’établissement officiel des communes. En effet, les commerçants de toutes les nations étaient invités à se rendre aux foires où ils jouissaient, pendant quelques semaines, eux et leurs biens d’un traitement tellement libéral, que les libéraux d’à présent n’oseraient plus l’offrir à des rivaux étrangers. Les marchandises n’étaient assujetties à aucune visite, à aucun droit de perception ni de barrière, et les marchands ne pouvaient, durant la foire, être condamnés ni même arrêtés dans le cas de flagrant délit. C’était une liberté de commerce absolue.
Les métiers privilégiés avaient d’abord redouté et combattu cette concurrence, autorisée par les seigneurs à beaux deniers comptant; mais ils s’y résignèrent, et bientôt ils y applaudirent, quand ils virent les négociants étrangers leur apporter ce qui leur manquait, en échange des produits de l’industrie nationale. La moindre ville voulut alors avoir sa foire, et plus d’une qui pour n’en avoir pas avait d’abord payé le seigneur, le paya pour en avoir une. La foire de 30 ou 40 jours était le free trade intermittent; illimitée, elle eῦt réalisé le free trade régulier.” Coomans. Les Communes belges. Journal la Paix, 8 mars 1863.
[85] Voir le Dictionnaire de l’économie politique, art. Propriété littéraire; l’Économiste belge, lettres à M. P. J. Proudhon sur la propriété littéraire et artistique, nos du ler et du 20 novembre 1858; les Questions d’économie politique et de droit public, la propriété des inventions, t. II, p. 339.
[86] Que la concurrence des races supérieures, ou, si l’on veut, des races plus avancêes en civilisation soit funeste aux races inférieures ou plus récemment sorties de l’animalité, c’est un fait aujourd’hui hors de doute. C’est ainsi que les tribus indiennes qui remplissaient jadis le continent de l’Amérique du Nord disparaissent graduellement, et qu’un bon nombre d’entre elles sont complétement éteintes.
“Toutes les tribus indiennes qui habitaient autrefois le territoire de la Nouvelle Angleterre, dit M. de Tocqueville, les Narragansetts, les Mohicans, les Pecots, ne vivent plus que dans le souvenir des hommes; les Lénapes, qui reçurent Penn, il y a cent cinquante ans, sur les rives de la Delaware, sont aujourd’hui disparus. J’ai rencontré les derniers des Iroquois: ils demandaient l’aumône. Toutes les nations que je viens de nommer sétendaient jadis jusque sur les bords de la mer; maintenant il faut faire plus de cent lieues dans l’intérieur du continent pour rencontrer un Indien. Ces sauvages n’ont pas seulement reculé, ils sont détruits. A mesure que les indigènes s’éloignent et meurent, à leur place vient et grandit sans cesse un peuple immense. On n’avait jamais vu parmi les nations un développement si prodigieux, ni une destruction si rapide [87] .”
Sans doute, cette destruction doit-être en partie imputée à la violence. Trop souvent, les Européens ont traité les. Indiens comme des bêtes fauves; ils les ont traqués et détruits par le fer et le poison (en envoyant par exemple, en cadeau, aux tribus dont ils voulaient se défaire, des vêtements infectés de petite vérole); mais, alors même que les tribus indiennes étaient efficacement protégées contre les violences des blancs, elles n’en disparaissaient pas moins devant leur concurrence.
Ainsi, les Indiens vivaient communément de l’exploitation de leurs terrains de chasse. Les Européens arrivaient dans leur voisinage. Aussitôt, la chasse devenant par ce fait même moins productive, les terres qui y étaient appliquées se dépréciaient tandis que celles que les nouveaux venus appliquaient à l’agriculture augmentaient rapidement de valeur. A mesure que s’opéraient ces mouvements en sens inverse, les Européens trouvaient plus d’avantage à acheter les terres des Indiens, tandis que ceux-ci en trouvaient moins à conserver des terres en voie de dépréciation, et, en échange desquelles, on leur offrait des articles de consommation nouveaux et séduisants.
“Quand les Indiens arrivent dans l’endroit où le marché doit avoir lieu, disent MM. Clark et Lewis Cass, dans un rapport adressé au congrès des États Unis, le 4 juillet 1829, ils sont pauvres et presque nus. Là, ils voient et examinent un très grand nombre d’objets précieux pour eux, que les marchands américains ont eu soin d’y apporter. Les femmes et les enfants qui désirent qu’on pourvoie à leurs besoins commencent alors à tourmenter les hommes de mille demandes importunes et emploient toute leur influence sur ces derniers pour que la vente des terres ait lieu. L’imprévoyance des Indiens est habituelle et invincible, pourvoir à ses besoins immédiats et gratifier ses désirs présents est la passion irrésistible du sauvage: l’attente d’avantages futurs n’agit que faiblement sur lui; il oublie facilement le passé, et ne s’occupe pas de l’avenir.”
“Le 19 mai 1830, M. Ed. Everett affirmait devant la Chambre des représentants que les Américains avaient déjà acquit par traité à l’est et à l’ouest du Mississipi, 230,000,000 d’acres.
En 1808, les Osages cédaient 48,000,000 d’acres pour une rente de 1,000 dollars.
En 1818, les Quapaws cédèrent 20,000,000 d’acres pour 4,000 dollars; ils s’étaient réservé un territoire de 1,000,000 d’acres, afin d’y chasser. Il avait été solennellement juré qu’on le respecterait; mais il n’a pas tardé à être envahi comme le reste.
Afin de nous approprier les terres désertes dont les Indiens réclament la propriété, disait M. Bell, rapporteur du comité des affaires indiennes au congrès, le 24 février 1830, nous avons adopté l’usage de payer aux tribus indiennes ce que vaut leur pays de chasse après que le gibier a fui ou a été détruit. Il est plus avantageux et certainement plus conforme aux règles de la justice et plus humain d’en agir ainsi que de s’emparer à main armée du territoire des sauvages.
L’usage d’acheter aux Indiens leur titre de propriété n’est donc autre chose qu’un nouveau mode d’acquisition que l’humanité et l’intérêt ont substitué à la violence, et qui doit également nous rendre maîtres des terres que nous réclamons en vertu de la découverte, et que nous assure d’ailleurs le droit qu’ont les nations civilisées de s’établir sur le territoire occupé par les tribus sauvages.
Jusqu’à ce jour, plusieurs causes n’ont cessé de diminuer aux yeux des Indiens le prix du sol qu’ils occupent, et ensuite les mêmes causes les ont portés à nous le vendre sans peine. L’usage d’acheter aux sauvages leur droit d’occupant n’a donc jamais pu retarder, dans un degré perceptible, la prospérité des États-Unis [88] .”
Ce mode d’acquisition. quoique plus conforme à la justice et à l’humanité que la dépossession violente, n’en est pas moins fortement entaché d’usure. Mais, en admettant même que les Européens n’abussassent point de l’ignorance et de l’imprévoyance des Indiens, et qu’ils leur payassent la terre à sa valeur réelle, — laquelle est en tous cas très faible, — les Indiens n’en disparaîtraient pas moins. Pour résister à la concurrence des Européens, il faudrait en effet, qu’ils fussent en état, 1° de se créer d’eux-mêmes de nouveaux moyens d’existence, 2° de les conserver; c’est à dire qu’ils fussent en état de gouverner utilement leur production et leur consommation, dans les conditions nouvelles où les place la concurrence et le contact d’une race plus civilisée.
Or, à peine ont-ils vendu leurs domaines de chasse, qu’ils se hâtent d’en consommer le produit d’une manière stérile ou nuisible, incapables qu’ils sont de résister d’eux-mêmes aux tentations que leur offrent les produits de la civilisation, et en particulier la meurtrière “eau de feu.” Ils se trouvent donc sans ressources pour entreprendre de nouvelles industries et embrasser un nouveau genre de vie, auquel d’ailleurs ils ne sont point préparés.
Les misères de cette situation se trouvent admirablement esquissées dans une pétition des sauvages montagnais des bords du Saint-Laurent, adressée au gouverneur général du Canada, et qui semble avoir été rédigée par quelque économiste, à l’état sauvage.
“Nous sommes trois cents familles, sans compter les veuves et les orphelins, nous n’avons pas d’autre moyen de vivre que la chasse et la pêche: depuis plusieurs années, la famine fait des ravages parmi nous et diminue chaque jour notre nombre. La chasse disparaît peu à peu dans le bois, et nos places de pêche nous sont enlevées de toutes parts par les blancs. A nos justes réclamations, ils répondent par ces paroles: — Travaillez, vous ne serez pas malheureux. — Qu’entendent-ils par ce travail? Est-ce la chasse ou la pêche? Ce reproche est injuste. — Est-ce la culture des champs? Il est alors insensé.
Grand chef, le Grand Esprit en créant l’homme a donné à chacun un génie particulier, ce génie est différend aussi pour chaque nation. A ta nation, l’instinct de se bâtir de grands villages de pierres, d’habiter ensemble, de se construire de grands canots de bois pour traverser les mers. A nous, il a donné l’instinct de vivre dispersés dans les forêts, d’habiter dans des cabanes d’écorce, de nous construire de légers canots, afin de pouvoir parcourir jusqu’à leurs sources nos rivières et nos lacs.
Grand chef, l’oiseau de passage qui revient chaque printemps vers le lieu qui l’a vu naître, oubliera plutôt son chemin que le sauvage montagnais.
Lorsque nous avons voulu imiter les blancs en cultivant le peu de sable aride qui, avec les rochers, compose notre territoire, la bêche nous tombait des mains, en rêvant à nos forêts; au jour de la récolte, nous oubliions même les quelques patates que nous avions à recueillir.
Vivant de chasse et de pêche, le Grand Esprit nous a donné le même instinct qui fait émigrer le gibier et le poisson: en imitant ces périodiques voyageurs, nous obéissons à une force intérieure. Lorsque le moment arrive de sortir de nos forêts ou d’y rentrer, il faut partir ou nous dépérissons, comme ces oiseaux dans des climats qui ne sont plus les leurs [89] .”
Seulement, est-il possible de perpétuer, en présence de la concurrence envahissante des races civilisées, cette existence nomade et primitive? En continuant à obéir à leurs instincts, à la mode de leurs ancêtres, sans essayer de les approprier aux emplois que la civilisation peut offrir au génie particulier de chaque race, les Indiens ne doivent-ils pas disparaître, refoulés de déserts en déserts, comme les espèces sauvages des buffles ou des bisons qui ne s’assouplissent point à la domesticité? Ou se civiliser ou périr, voilà pour eux l’alternative!
Cela étant, il s’agit de savoir si les Indiens peuvent passer d’eux-mêmes, sans la transition d’un régime spécial de tutelle, de la barbarie à la civilisation. Cette question, l’expérience l’a résolue presqu’à présent d’une manière négative. On a cru, par exemple, qu’il suffirait d’élever de jeunes Indiens à l’européenne pour en faire des Européens, et l’on n’a obtenu que des sauvages vernis de civilisation. M. de Tocqueville rapporte encore, à ce sujet, un fait caractéristique.
“L’indigène de l’Amérique du Nord, dit-il, conserve ses opinions et jusqu’an moindre détail de ses habitudes avec une inflexibilité qui n’a point d’exemple dans l’histoire. Depuis plus de deux cents ans que les tribus errantes de l’Amérique du Nord ont des rapports journaliers avec la race blanche, ils ne lui ont emprunté, pour ainsi dire, ni une idée ni un usage. Les hommes d’Europe ont cependant exercé une très grande influence sur les sauvages. Ils ont rendu le caractère indien plus ordonné, mais ils ne l’ont pas rendu plus européen.
Me trouvant dans l’été de 1831 derrière le lac Michigan, dans un lieu nommé Green Bay, qui sert d’extrême frontière aux États-Unis du côté des Indiens du Nord-Quest, je fis connaissance avec un officier américain, le major H., qui, un jour, après m’avoir beaucoup parlé du caractère indien, me raconta le fait suivant:
J’ai connu autrefois, me dit-il, un jeune Indien qui avait été élevé dans un collége de la Nouvelle Angleterre. Il y avait obtenu de grands succès, et y avait pris tout l’aspect extérieur d’un homme civilisé. Lorsque la guerre éclata entre nous et les Anglais, en 1810, je revis ce jeune homme; il servait alors dans notre armée, à la tête des guerriers de sa tribu. Les Américains n’avaient admis les Indiens dans leurs rangs qu’à la condition qu’ils s’abstiendraient de l’horrible usage de scalper les vaincus. Le soir de la bataille de ∗∗∗, C. vint s’asseoir auprès du feu de notre bivouac; je lui demandai ce qui lui était arrivé dans la journée; il me le raconta, et s’animant par degrés aux souvenirs de ses exploits, il finit par entr’ouvrir son habit en me disant: — Ne me trahissez pas, mais voyez! Je vis en effet, ajouta le major H., entre son corps et sa chemise, la chevelure d’un Anglais encore toute dégouttante de sang [90] .”
Quelle conclusion faut-il tirer de ce fait? Que les Indiens ne sont pas civilisables? En aucune façon. Il faut en conclure seulement que le travait de l’éducation appliqué à une seule génération ne suffit pas plus pour modifier les instincts d’une race particulière d’hommes que ceux d’une race particulière d’animaux. L’histoire naturelle de l’homme aussi bien que celle des races inférieures de l’animalité démontre que les instincts se transmettent avec les modifications qu’on leur a fait subir. On sait que les nègres nés en Amérique, même quand ils n’ont aucun mélange de sang européen dans les veines, sont fort supérieurs à ceux que la traite importe d’Afrique et qu’ils éprouvent, en conséquence pour ceux-ci, un profond mépris. Cependant l’éducation de l’esclavage est, à coup sῦr, fort grossière et fort imparfaite. Mais, telle quelle, elle n’agit pas moins, de génération en génération, pour élever l’homme de la barbarie à la civilisation.
L’erreur dans laquelle on tombe à cet égard provient de ce qu’on suppose a priori qu’il suffit d’inculquer au sauvage un certain nombre de notions intellectuelles et morales pour le civiliser. L’éducation des instincts doit précéder celle de l’intelligence, et cette éducation qui s’opère au moyen de changements graduels dans la nourriture, les occupations, la manière de vivre, etc., exige pour porter ses fruits un nombre plus ou moins considérable de générations selon qu’il s’agit d’une race plus ou moins vigoureuse partant plus ou moins réfractaire à la civilisation. C’est faute d’avoir en égard à cette observation, qu’on n’a point, de même, réussi encore à réduire à l’état de domesticité des races d’animaux qui, pour être plus réfractaires que les autres à la domestication, n’en sont pas moins, selon toute apparence, domesticables.
Maintenant, l’histoire entière démontre que l’immense majorité de l’espèce humaine a dῦ passer par un régime de tutelle pour s’élever de la barbarie à la civilisation. C’est ainsi que les civilisations du Nouveau Monde étaient fondées comme celles de l’ancien sur un régime de tutelle auquel étaient assujetties les masses incapables du self government. Tel était, par exemple, au Pérou, le gouvernement des Incas. Lorsque les Espagnols eurent détruit ce régime, si admirablement approprié à la nature des races autochthones, les Indiens retournèrent peu à peu à l’état sauvage, et leur nombre qui s’était élevé à plus de 8 millions au temps de l’Inca Atahualpa tomba à quelques centaines de mille. Les jésuites, excellents observateurs, copièrent, dans ses parties essentielles, le système des anciens civilisateurs de l’Amérique et ils l’introduisirent au Paraguay, où, grâce à ce système, leurs “missions” prospérèrent pendant plus de deux siècles. Les missions détruites, les Indiens du Paraguay, comme auparavant ceux du Pérou, retournèrent à la barbarie. On a objecté, nous ne l’ignorons pas, que ce régime de tutelle empêchait les Indiens d’arriver au self government au lieu de les y préparer.
“La nouvelle de l’expulsion des jésuites du Paraguay, dit notamment M. Alf. Sudre, fut accueillie avec des cris de joie; mais la civilisation fausse et incomplète à laquelle ils avaient été initiés ne put se soutenir par elle-même. Les missions tombèrent dans une rapide décadence. Le despotisme était devenu nécessaire pour ces âmes auxquelles l’habitude de la liberté et le sentiment de la dignité individuelle étaient étrangers [91] .”
Il se peut, en effet, que le gouvernement des jésuites du Paraguay ait été une tutelle imparfaite, mais encore valait-il mieux que l’absence de tutelle. La preuve, c’est qu’à côté des missions, les Indiens libres demeuraient à l’état sauvage, où retournèrent aussi les Indiens des missions après l’expulsion des jésuites.
N’oublions pas, non plus, que la plupart des hommes libres de l’Europe ont passé par la tutelle de l’esclavage et du servage, et que c’est grâce à cette tutelle, si grossière et si coῦteuse pourtant, qu’ils sont successivement devenus capables du self government. Singulière révolution des idées! jadis, on ne concevait même point la possibilité de l’existence d’un self government; aujourd’hui, on ne peut plus (du moins en théorie) concevoir autre chose. Tandis que nos ancêtres refusaient de croire que les hommes pussent devenir un jour majeurs, nous refusons de croire aujourd’hui qu’ils ne le soient pas encore tous devenus, et nous voulons non seulement accorder la liberté à ceux qui en sont capables, mais encore l’imposer à ceux qui en sont incapables.
Cette conception étroite et bornée de la liberté conduit fatalement, dans la pratique, à la destruction des races actuellement inférieures. Que l’on suppose, en effet, des races incapables de se gouverner elles-mêmes et obligées cependant de se contenter de ce gouvernement insuffisant et vicieux, en concurrence avec des races capables d’un bon self government, les premières devront inévitablement disparaître devant les secondes. Tel est le cas des Indiens et l’on peut ajouter aussi, des nègres libres en Amérique. Cette conséquence fatale, les doctrinaires de la liberté imposée, l’acceptent, du reste, sans hésiter. — S’il est, disent-ils, des races retardaires auxquelles la concurrence des races civilisées soit funeste, tant pis pour elles! Qu’elles périssent puisque telle est leur destinée! — Si donc les Indiens et les nègres ne peuvent supporter le régime qui convient aux Européens, — et que l’on suppose bien entendu le seul qui convienne à l’homme pris d’une manière abstraite, que les Indiens et les nègres disparaissent devant les Européens! — Mais est-on bien sῦr que la disparition de races inférieures, soit par voie d’extermination, soit par voie de self government imposé ne constitue point un appauvrissement de l’humanité? Toutes les races recèlent, dans leur sein, au moins à l’état de germes, des aptitudes spéciales; toutes aussi peuvent, à la condition d’être soumises au régime qui convient à leur état actuel, développer ces germes et les faire fructifier à l’avantage de la communauté. Qui pourrait affirmer que telle race maintenant encore à l’état sauvage ne marchera pas un jour à la tête de la civilisation, tandis que les races actuellement prépondérantes seront en décadence? Qu’auraient répondu les Romains de l’époque de Cicéron et de Jules César, si on leur avait dit que des Barbares sortis des forêts de la Germanie et des steppes de la Scythie gouverneraient un jour le monde? Vouloir imposer à tous les hommes un certain régime que l’on suppose seul équitable et seul utile, en déclarant que ceux-là qui ne peuvent supporter ce régime doivent périr, n’est-ce pas imiter ces utopistes qui veulent jeter le monde dans un certain moule politique et social de leur invention, en proclamant ennemis du peuple ceux qui refusent de s’y laisser enfermer? N’est-ce pas faire de la liberté elle-même une variété du despotisme, et non la moins abrutissante et la moins meurtrière?
[87] A. de Tocoueville. De la Démocratie en Amérique. T. II. Chap. X. État actuel et avenir probable des tribus indiennes qui habitent le territoire possédé par l’Union.
[88] Al. de TocqÛeville. T. II. Chap, X.
[89] Cette pétition composée par le chef Estlo de la tribu des Betshiamits se trouve reproduite dans l’ouvrage de M. J. C. Taché: Des Provinces de l’Amérique du Nord et d’une Union fédérale. Appendice.
[90] Al. de Tocqueville. T. II. Chap. X.
[91] Histoire du communisme, par Atf. Sudre. Des communautés ascétiques.
[92] Le protectionisme spécialement appliqué aux intérêts des classes ouvrières, était devenu aux États. Unis la doctrine fondamentale du parti des natifs (voir, à ce sujet, les Questions d’économie politique et de droit public. La liberté du commerce. T. II, p. 88). Les natifs voulaient opposer une barrière à l’immigration européenne, eu vue de “protéger” les travailleurs américains, et ils avaient emprunté, pour réclamer cette protection contre les bras étrangers, les arguments dont faisaient usage les fabricants de tissus de la Nouvelle Angleterre et les maîtres de forges de la Pennsylvanie pour défendre les tarifs qui les protégeaient contre “l’invasion” des produits similaires du dehors. En d’autres termes, les natifs voulaient appliquer à la protection des salaires des ouvriers le même appareil que les protectionistes proprement dits ont réussi à faire appliquer à la protection des profits des entrepreneurs d’industrie.
Les doctrines des natifs n’ont point prévalu aux États-Unis; mais elles ont eu plus de succès en Australie, où les travailleurs de race européenne sont parvenus à se faire protéger contre la concurrence des Chinois.
“En Australie, dit M. Jules Duval, les Chinois étaient, en 1856, environ 18,000, nombre qui a triplé depuis lors; c’est surtout dans la province de Victoria qu’ils se rendent, attirés par la richesse des gîtes aurifères: c’est là aussi qu’ont éclaté contre eux les antipathies les plus agressives. On a parlé d’expulsion, on a redouté un carnage; finalement l’esprit anglais a transigé par des droits sur l’opium, et une taxe d’entrée de 10 livres sterling, plus 2 livres par mois pour la patente de mineur, et 20 schellings par tête pour les frais de perception. L’entrée par la voie de terre est fixée à 4 livres. Un impôt de résidence, fixé à 6 livres par an, a été ultérieurement ajouté à ces capitations exorbitantes. Enfin, les navires qui abordent à Melbourne ne peuvent introduire qu’un Chinois par 10 tonneaux de chargement. Les Chinois échappent à une partie de ces vexations par une sorte de contrebande, en débarquant sur les rivages de l’Australie méridionale, moins bien gardés par la douane, et d’où ils pénètrent par les frontières de terre sur le territoire de Victoria.
Les mineurs australiens ont en vain essayé de donner le change à l’opinion publique, en accusant les vices des Chinois, leur société sans femmes, leur saleté, leurs habitudes de ruse, et, ajoute-t-on, de fraude et de vol, leur éloignement des mœurs européennes, tel qu’il s’oppose à toute fusion, même à tout rapprochement; enfin, un instinct d’association qui les trouve toujours prêts à ourdir des intrigues, dans un secret inviolable. Le nom de protection money, donné à l’impôt de résidence, réduit à leur mesure ces accusations, où un fonds de vérité se trouve exagéré en de telles proportions que la conduite des Européens, commentée avec la même malveillance, soulèverait la même réprobation. Jalousie de métier, concurrence redoutée, telle est la clef de toute cette haine [93] .”
En Californie, où les Chinois affluèrent également, le protectionisme essaya à diverses reprises de les faire expulser, mais sans succès, grâce surtout, ajoute M. Jules Duval, au libéralisme de la partie allemande de la population. Les protectionistes californiens publièrent, il y a quelques années, sous la forme d’une “adresse de l’Institut industriel de San-Francisco,” un Manifeste extrêmement curieux en ce sens qu’il renferme tous les arguments du protectionisme des classes supérieures et moyennes, appliqué aux intérêts spéciaux des classes inférieures.
Voici cette pièce instructive et intéressante:
considÉrants:
“Attendu que le travail est le capital de l’ouvrier et que la Californie est un État dans lequel le travail libre est garanti par la Constitution contre la concurrence que pourrait lui faire, soit le travail des esclaves nègres, soit celui des serfs asiatiques;
Attendu qu’il est dans les prérogatives incontestables des hommes de travail de cet État de sauvegarder la dignité du travail et de protéger la question des salaires;
Nous, membres de l’Institut Mechanic de San Francisco, avons dῦ nous pénétrer de l’importance des faits et des considérations qui suivent:
Des Chinois coolies ou serfs, constituant une population méprisable, arrivent chaque année par milliers sur nos rivages, occupent et détruisent nos mines, portent préjudice aux intérêts du travail des blancs et, par la concurrence qu’ils leur font, abaissent graduellement leur salaire jusqu’au dessous de ce qui est nécessaire à la vie.
Des compagnies de capitalistes chinois établies soit a San Francisco, soit en Chine, font venir, tous les ans, des masses de cette population déplorable, engagées pour un certain nombre d’années, et font par elles une concurrence ruineuse aux travaux de la race blanche. Ces Chinois ne diffèrent des esclaves d’Afrique que par la durée du temps de leur engagement; ils ne peuvent pas plus que ces derniers devenir citoyens des États-Unis;
Le capital ne manquera pas de tirer avantage de la présence de cette misérable population qui, poussée bientôt par la nécessité, fera de plus en plus la guerre aux intérêts des classes laborieuses de notre race; et celles ci tomberont alors dans la dégradation, subiront l’oppression et les conséquences du manque d’emploi;
Il ne saurait convenir à la dignité des citoyens libres appartenant à la race blanche d’accepter le travail à des conditions présumées égales à celles faites à la race mongolienne ou en concurrence, soit avec elle, soit avec tous autres dont le travail s’accomplit contrairement aux vues exprimées dans notre Constitution;
Lorsque les États-Unis ont conclu leur traité avec la Chine, nul ne pouvait s’attendre à la voir jeter sur notre sol des hordes d’une vile population incapable d’aspirer à la citoyenneté. Ce n’est pas ainsi que le traité a été compris. — Dans les décisions émanées de la cour suprême des États-Unis, on peut voir qu’elles ne sont relatives qu’à des émigrants capables de devenir citoyens et non à des hordes incivilisées dont la présence et les habitudes immorales sont une honte pour notre civilisation, un abaissement de notre dignité;
Il est certain que les lois qui réglementent l’immigration en notre pays stipulent pour les populations capables de prendre part à la citoyenneté américaine, et toutes les fois qu’il y est fait exception, c’est invariablement au sujet des personnes dont la couleur fait obstacle à cette citoyenneté. Whose Color precludes capacity to become american citizens;
Si des restrictions légales ne s’y opposent c’est par centaines de mille que ces populations inférieures vont inonder de plus en plus notre pays, usurper les fonctions réservées au travail honorable, envahir les occupations des hommes de race blanche.
En conséquence, les résolutions suivantes ont été adoptées:
RÉSOLUTIONS.
Nous ne pensons pas qu’une juste interprétation des lois des États-Unis puisse avoir pour effet de priver un État du pouvoir de protéger ses intérêts industriels contre un mal local, complétement destructeur de ces intérêts et complétement imprévu par les dispositions qui réglementent l’immigration.
Nous recommandons ce sujet à l’étude toute nouvelle de la législature californienne, comme digne de son attention spéciale, attendu qu’il affecte directement la prospérité d’une classe nombreuse de citoyens qui n’a que son travail pour capital.
En sa qualité de représentant des classes laborieuses de la Californie, cet “Institute” est énergiquement opposé à la continuation des importations de barbares (barbarians) incapables de devenir citoyens, dont l’égalité avec nous n’est reconnue nulle part ni dans les mines, ni dans les ateliers, ni sur aucun terrain; dont les exigences sont autres que les nôtres et doivent un jour anéantir les justes salaires dus à l’homme qui travaille.
Les vues de cet “Institute” seront imprimées et communiquées à tous les travailleurs de la Californie, et ils seront requis de coopérer par leur union (dans les limites permises par la loi) à la suppression d’un mal qui menace de destruction la dignité du travail et les salaires équitables.”
Ce serait une erreur de croire que cette espèce de protectionisme n’existe point dans les couches inférieures de la société européenne comme il existe dans celles de la société américaine ou parmi les descendants des convicts de la Nouvelle Galle du sud. Il fut notamment sur le point de déborder en 1848. Tandis que les théoriciens du socialisme allaient au Luxembourg discuter les moyens “d’organiser le travail,” les hommes pratiques de la classe ouvrière demandaient l’expulsion des ouvriers étrangers, et en particulier des Anglais, des Belges, des Savoisiens et des “Auvergnats.” Un bon nombre de ces malheureux furent même expulsés par voie d’émeute, et le 19 mars, le préfet de police, M. Caussidière, défendait aux ouvriers étrangers de se rendre à Paris, en les avertissant que s’ils persistaient, malgré cet avis, “ils s’exposeraient à s’en voir éloignés et même à être expulsés du territoire français par une mesure exceptionnelle que les circonstances motiveraient.”
Il s’est passé, écrivions-nous à cette occasion, dans les premiers jours de la révolution, un fait déplorable. A Rouen et dans plusieurs autres localités” les ouvriers anglais ont été chassés par les ouvriers français, et renvoyés dans leur pays sans avoir reçu même les salaires qui leur étaient dus. Ce fait a été porté devant le parlement anglais, et un membre de la chambre des communes à demandé si le gouvernement ne comptait pas user de représailles. Lord John Russell à répondu que telle n’était point son intention; que l’Angleterre serait toujours charmée de conserver chez elle les étrangers qui lui ont apporté le tribut de leur industrie et de leur travail, et qu’elle n’imiterait dans aucun cas l’exemple de barbarie qui venait de lui être donné par la France.
Ces paroles du ministre anglais étaient rassurantes pour les résidents français, mais il paraît que les mêmes sentiments de modération et de sagesse n’animent pas les classes inférieures de la population de la Grande-Bretagne. Les ouvriers anglais veulent renvoyer les Français établis en Angleterre, et peut-être y réussiront-ils. Si ce malheur arrive, si chaque nation exclut les étrangers de son sein, que deviendront les principes de fraternité universelle que nous nous honorons d’avoir proclamés les premiers? Nous conjurons notre population ouvrière de se pénétrer un peu mieux du sens du mot fraternité, et d’accueillir l’étranger comme un frère au lieu de le repousser comme un ennemi. Nous l’en conjurons dans l’intérêt du pays et dans son propre intérêt; car tout étranger qui nous apporte le tribut de son travail, de ses lumières et de ses capitaux contribue à nous enrichir [94] .”
Les ouvriers étrangers n’en demeurèrent pas moins, aussi longtemps que prédomina l’influence populaire, exclus des ateliers français. En admettant que les classes ouvrières réussissent aujourd’hui à se rendre maîtresses du pouvoir, se montreraient-elles plus libérales et plus fraternelles à l’égard de leurs concurrents du dehors que ne l’étaient en 1848, les apôtres par excellence de la liberté, de l’égalité et de la fraternité? Il est permis d’en douter. Nous ne sommes point débarrassés, hélas! du protectionisme, et qui sait si nos descendants n’auront pas à le subir, appliqué aux intérêts spéciaux des ouvriers, comme nous l’avons subi jusqu’à présent appliqué aux intérêts spéciaux des entrepreneurs d’industrie?
[93] Jules Duval. Histoire de l’émigration européenne, asiatique et africaine au XIXe siècle. Liv. II, Chap. V. La Chine.
[94] Journal la République francaise, 21 mars 1848.
[95]
“Aujourd’hui, — remarque M. Ch. Le Hardy de Beaulieu dans un opusenle rempli de vues neuves et élevées sur la Morale agent du bien-étre, — aujeurd’hui que les sciences ont fait d’immenses progrès et que leur enseignement a été simplifié de manière à les rendre accessibles à un très grand nombre de personnes, le pouvoir d’agir, c’est à dire de faire également le bien et le mal, s’est étendu dans la même proportion, et pour que ce pouvoir fῦt constamment dirigé vers le bien, ou tout au moins vers l’abstention du mal, il faudrait qu’il fῦt soumis à une puissance rectrice, au moins égale, émanant des facultés morales de l’homme, ou, en d’autres termes, celles-ci devrait grandir et se fortifier en lui, au moins dans la mesure du développement de ses facultés intellectuelles. Or, nous ne voyons pas que, dans les sociétés modernes, l’enseignement moral ait fait, à beaucoup près, les mêmes progrès que l’enseignement intellectuel, tandis qu’il aurait dῦ dépasser celui-ci.
. . .Pour rétablir l’équilibre rompu entre le pouvoir de faire le mal et la volonté de s’en abstenir ou de faire le bien, il faut donc que l’éducation morale du genre humain reçoive de notables perfectionnements.” Ch. Le Hardy De Beaulieu. — La Morale agent du bien-être, p. 3.
[96] Voir le T. Ier, VII leçon, La part du travail.
[97]
“Les prudhommes ou les consuls des corporations, dit M. Levasseur, exerçaient non seulement la charité et la justice repressive, mais une sorte de justice préventive; ils veillaient à ce que les règlements fussent bien exécutés, à ce qu’aucun travail ne fῦt imparfait, et qu’aucune mauvaise action ne deshonorât la société.”
Au sein des confréries et des sociétés de compagnonnage, une surveillance analogue, plus active et plus minutieuse encore, était exercée sur la conduite et les mœurs des membres de la communauté. L’association des francsmaçons constituée en 1459 à Strasbourg, peut être citée à titre d’exemple.
“Aucune association ouvrière, dit M. Levasseur, ne paraît avoir été pénétrée d’un esprit religieux plus profond et plus sévère. C’est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de la vierge Marie et aussi de ses quatre serviteurs, les quatre saints couronnés, “que les statuts sont publiés. Les gens qui vivent dans le concubinage [98] , les joueurs [99] et les chrétiens tièdes, qui n’observent pas “ponctuellement leurs devoirs” et ne reçoivent pas “annuellement les saints sacrements,” sont proscrits de la communauté et défense est faite à tout franc-maçon d’entretenir avec eux aucune relation.”
[98] Statut 11. Il ne faut recevoir dans la société aucun ouvrier ou maître qui vivrait en concubinage; si cela arrivait à quelqu’un de la société, toute relation avec lui devrait cesser.
[99] 12. On ne recevra dans la société que les ouvriers et les maîtres qui observeront ponctuel-lement leurs devoirs religieux et recevront, annuellement, les saints Sacrements; on en exclura avec soin ceux qui seront convaincus de risquer leur argent au jeu. — Ord, des tailleurs de pierre de Strasbourg, 1459. (Histoire des classes ouvrières en France, par Em. Levasseur. T. Ier. Les Corps de métiers, — les Confréries, — le Compagnonnage.)
[100] Voir au sujet des lois somptuaires. G. Roscher, Principes de l’économie politique, — politique du luxe. T. II, p. 250, trad. Wolowski.
[101] Le capital nominal des dettes publiques se montait en 1859, d’après l’Annuaire de M. J. E. Horn, aux sommes que voici: États-Unis, 241. 1 millions de fr.; Autriche, 6.850; Bade, 186.5; Bavière, 684.1; Belgique, 599,7; Brésil, 400; Danemark, 313.3; Espagne, 3.658,7; France, 9113.3; GrandeBretagne, 20,093.3; Grèce, 17; Hanovre, 170; Italie, 2500; PaysBas, 2.354.1; Portugal, 501,8; Prusse, 1200; Russie, 6.480; Saxe royale, 227,5; Suède et Norwége, 452; Turquie, 885; enfin, Wurtemberg, 119,3; ee qui donnerait un total de cinquante un milliards cent cinquante-trois millions trois cent mille francs. (Annuaire international du crédit public pour 1860, par J. E. Horn, p. 292.)
Depuis que ce relevé a été fait;, la seule dette des États de l’Union américaine s’est accrue de près de dix milliards.
[102]
Si par une suite des profusions où nous jettent des machines politiques abusives et compliquées, dit encore J. B. Say, le système des impôts excessifs prévaut, et surtout s’il se propage, s’étend et se consolide, il est à craindre qu’il ne replonge dans la barbarie les nations dont l’industrie nous étonne le plus; il est à craindre que ces nations ne deviennent de vastes galeres, où l’on verrait peu à peu la classe indigente, c’est à dire le plus grand nombre, tourner avec envie ses regards vers la condition du sauvage. . .du sauvage qui n’est pas bien pourvu, à la vérité, ni lui ni sa famille, mais qui du moins n’est pas tenu de subvenir, par des efforts perpétuels, à d’énormes consommations publiques, dont le public ne profite pas ou qui tournent même à son détriment. (J. B. Say. Traité d’économie politique. Liv. III, chap. X.)
[103] Voir à ce sujet le Dictionnaire de l’économie politique, art. Paix, et L’abbé de Saint-Pierre, sa vie et ses œuvres. Introduction.
[104] Nos deux précédents ouvrages, les Soirées de la rue Saint-Lazare et les Questions d’économie politique et de droit public, auxquels nous prenons la liberté de renvoyer nos lecteurs, sont presque entièrement consacrés à la démonstration des nuisances de l’intervention gouvernementale. Nous avons fondé, dans le même but, le journal l’Economiste belge.
[105] Nous n’en croyons pas moins devoir revendiquer, hardiment, la priorité de cette prétendue chimère. Voir les Questions d’économie politique et de droit public. La liberté du gouvernement. T. II, p. 245, et les Soirées de la rue Saint-Lazare. lle soirée. P. 303. Consulter encore, pour les développements, L’Économiste Belge, le Sentiment et l’intérét en matière de nationalité, no du 24 mai 1862, polémique avec M. Hyac. Deheselle sur le même sujet, nos des 4 et 21 juin, 5 et 19 juillet, le Principe du sécessionisme, 30 aoῦt; Lettres à un Russe sur l’établissement d’une constitution en Russie, 2 et 30 aoῦt; 19 septembre 1862; la Crise américaine, 17 janvier 1863; un nouveau Crédit Mobilier, 14 février; une Solution pacifique de la question polonaise, 9 mai, etc., etc.
[106 ] Adam Smith. La Richesse des nations. Liv. IV. Chap. II.