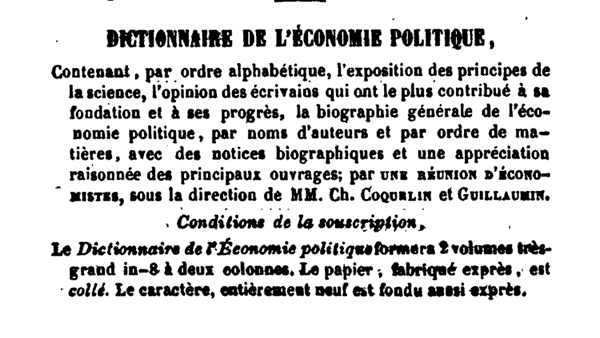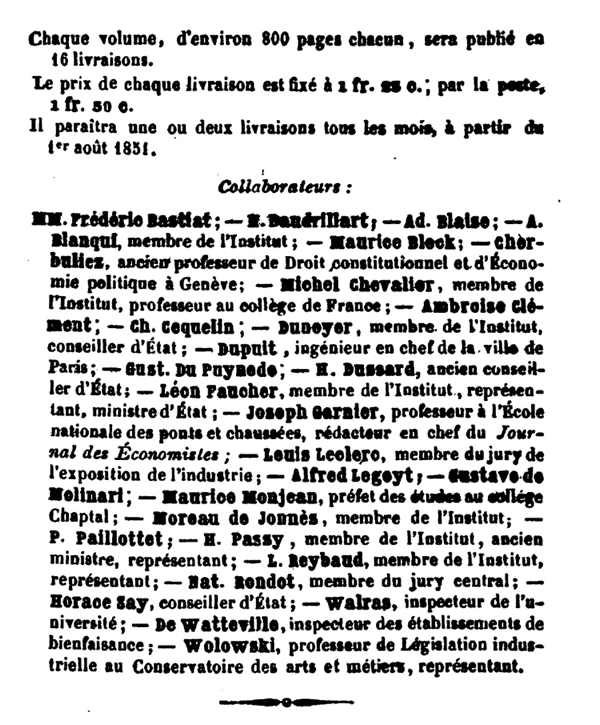GUSTAVE DE MOLINARI,
The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53)
 |
 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
[Created: 11 June, 2019]
[Updated: 10 March, 2025 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/DEP/index.html
Gustave de Molinari, The Collected Articles from the Dictionnaire de l'Économie politique (1852-53). Edited by David M. Hart (The Pittwater Free Press, 2023).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
The articles were taken from the Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. Troisième Édition (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1864), 2 vols. (1st ed. 1852-53.)
See the facs. PDF of:
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).
Table of Contents
- Editions of the DEP
- Announcement in Guillaumin Catalogue (early 1851)
- Molinari’s JDE article on the DEP Project
- Préface de l’éditeur (Guillaumin)
- Introduction (Ambroise Clément)
- Biographical Articles (5)
- Principle Articles by Molinari (25)
- Beaux-arts, T. 1, pp. 149-57.
- Céréales, T. 1, pp. 301-26.
- Civilisation, T. 1, pp. 370-77.
- Colonies, T. 1, pp. 393-403.
- Colonies agricoles, T. 1, pp. 403-5.
- Colonies militaires, T. 1, p. 405.
- Émigration, T. 1, pp. 675-83.
- Esclavage, T. 1, pp. 712-31.
- Liberté des échanges (Associations pour la), T. 2, p. 45-49.
- Liberté du commerce, liberté des échanges, T. 2, pp. 49-63.
- Mode, T. 2, pp. 193-96.
- Monuments publics, T. 2, pp. 237-8.
- Nations, T. 2, pp. 259-62.
- Noblesse, T. 2, pp. 275-81
- Paix, Guerre, T. 2, pp. 307-14.
- Paix (Société et Congrès de la Paix), T. 2, pp. 314-15.
- Propriété littéraire et artistique, T. 2, pp. 473-78
- Servage, T. 2, pp. 610-13
- Tarifs de douane, T. 2, pp. 712-16.
- Théâtres, T. 2, pp. 731-33.
- Travail, T. 2, pp. 761-64.
- Union douanière, T. 2, p. 788-89.
- Usure, T. 2, pp. 790-95.
- Villes, T. 2, pp. 833-38.
- Voyages, T. 2, pp. 858-60.
Editions of the DEP↩
Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. Troisième Édition (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1864), 2 vols. (1st ed. 1852-53.)
Editions:
- 1st ed. 1852-53
- 2nd ed. 1854
- 3rd ed. 1864
- 4th ed. 1873
Molinari’s JDE article on the DEP Project↩
Source
Gustave de Molinari, ”Dictionnaire de l’économie politique, par M. G. de Molinari,” JDE, T. 37, N° 152. 15 Décembre 1853, pp. 420-32.
[420]
Dictionnaire de L’économie politique contenant par ordre alphabétique
L’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie générale de l’économie politique, par noms d’auteur et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, par une réunion d’économistes, sous la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin. [1]
Depuis la fin du siècle dernier, une immense transformation s’est opérée dans la production. L’antique matériel de l’industrie, après avoir subsisté pendant des siècles, sans recevoir presque aucune modification, a été remplacé par un matériel plus parfait : des forces mécaniques, empruntées à des agents naturels d’une irrésistible puissance, ont pris la place de la force physique de l’homme, dans la plupart des œuvres inférieures de la production. En même temps, une révolution non moins importante et féconde s’opérait dans l’organisation même de l’industrie : les vieux règlements qui entravaient l’essor de la production, en faisant de chacune de ses branches le monopole à peu près exclusif de quelques familles, en imposant même des procédés et des méthodes de fabrication dont il était défendu de s’écarter, sous peine d’amende et de confiscation, ces vieux règlements tombaient en poussière : l’industrie , transformée et agrandie, brisait son moule séculaire, comme le Pantagruel enfant, de Rabelais, mettait en pièces le berceau où l’on avait emprisonné ses membres robustes, et le régime de la libre concurrence succédait au régime suranné des corporations industrielles. A dater de cette époque, les progrès se sont multipliés, accumulés d’une manière vraiment prodigieuse : les sciences appliquées aux arts de la production ont révélé à l’homme de nouvelles forces qu’il ne soupçonnait point ou qu’il ne [421] connaissait que par leurs effets destructeurs, et elles lui ont enseigné les moyens de les ployer à son usage comme des serviteurs obéissants. La fable des Titans enfermés dans les profondeurs de l’Etna s’est réalisée au profit de l’industrie moderne : la vapeur emprisonnée dans une chaudière et employée ici à filer ou à tisser des étoffes, là à extraire du minerai ou du combustible des entrailles de la terre , ailleurs à transporter avec une vélocité prodigieuse des masses de voyageurs et de marchandises ; l’électricité, emprisonnée dans un fil de fer et transformée en une messagère mille fois plus rapide et plus laborieuse que le Mercure ailé de la mythologie païenne; la lumière du soleil même, devenue, dans une chambre obscure, un merveilleux dessinateur : voilà les Titans auxquels l’homme commande aujourd’hui en maître, et qu’il emploie, sans jamais épuiser ou lasser leur vigueur, à la production des choses nécessaires au soutien et à l’embellissement de son existence.
Mais cette transformation grandiose du vieux matériel de la production, cette révolution industrielle, bien plus vaste et bien plus profonde qu’aucune révolution politique, ne s’est pas opérée sans atteindre une multitude d’intérêts et d’existences, sans susciter une foule de problèmes importants et redoutables.
C’est ainsi, par exemple, que les grandes manufactures de l’industrie moderne, en se substituant aux petits ateliers de l’industrie ancienne, ont exigé l’agglomération de capitaux considérables. Ces capitaux , un seul homme était rarement en position de les fournir. C’est au crédit ou à l’association qu’il a fallu les demander. Les établissements de crédit se sont multipliés, et les banques de circulation, remplaçant les banques de dépôts, sont devenues un des moteurs puissants de la production. Mais, selon que l’action de ces moteurs est bien ou mal réglée, elle peut vivifier la production ou la troubler, y faire régner la santé ou le malaise.
C’est ainsi encore que ces mêmes manufactures ont exigé, avec l’agglomération d’une masse de capitaux, celle d’une multitude de travailleurs, qu’elles ont placés dans des conditions d’existence toutes nouvelles. Autrefois, l’ouvrier, enchaîné par les liens de la corporation ou du servage, ne quittait guère le lieu qui l’avait vu naître. Il était obligé de céder son travail à vil prix, et il avait bien peu d’espoir d’améliorer sa condition; en revanche, son existence avait une certaine stabilité. Le marché dont il disposait était fort resserré, et il s’y trouvait à la merci d’un maître ou d’un seigneur ; mais, du moins, il n’avait pas à craindre d’être supplanté par des travailleurs venus du dehors. En outre, des lois ou des coutumes observées comme des lois suppléaient à l’imprévoyance des classes laborieuses, en imposant un frein à leur multiplication désordonnée. Maintenant, l’ouvrier dispose d’un marché plus vaste, mais dont il peut difficilement apprécier l’étendue, et c’est à sa prévoyance seule qu’est remis le soin de proportionner la quantité de son travail aux emplois disponibles. D’un autre côté, la grande industrie est soumise à des [422] éventualités imprévues et redoutables, éventualités qui bouleversent du jour au lendemain toutes les existences qui dépendent d’elle, à moins qu’une prévoyance active et infatigable n’agisse pour en neutraliser les effets. Elle a besoin d’un débouché immense. Or, ce débouché a rarement un caractère de permanence. Des tarifs prohibitifs, des guerres, des disettes le rétrécissent fréquemment d’une manière soudaine. Des masses d’ouvriers sont alors rejetées de l’atelier dans la rue. Obligés de subir, s’ils ont manqué d’économie, les dures extrémités de la misère, ils s’abandonnent aisément aux suggestions de l’esprit de désordre et d’utopie: ils font des coalitions, des émeutes, des révolutions, en vue d’améliorer leur sort; et, au bout de ces coalitions, de ces émeutes, de ces révolutions, ils ne trouvent qu’une aggravation de leurs maux.
C’est ainsi enfin que les gouvernements, dont les progrès de la production et du crédit augmentaient incessamment les ressources, ont fini par se persuader que ces ressources étaient illimitées, et qu’ils ont augmenté leurs dépenses dans une proportion plus forte encore. Depuis un demi-siècle, ils ont usé et abusé des emprunts publics. Ils ont épuisé le sang des générations présentes et escompté les ressources des générations à venir pour satisfaire leurs mauvais appétits de domination et de conquêtes. Ces admirables mécanismes que la science avait créés pour augmenter le bien-être de l’humanité, ils les ont transformés en des instruments de ruine et de mort.
En présence d’une révolution si vaste et si profonde, révolution dont les résultats devaient infailliblement tourner au profit de la civilisation, mais que l’ignorance des uns, les passions malfaisantes des autres pouvaient détourner de sa voie naturelle et entraîner dans des précipices dangereux, n’était-il pas plus nécessaire que jamais d’étudier l’organisation de la société ? Les hommes disposaient de nouvelles forces que leur labeur intelligent avait dérobées à la nature; mais ces forces ne pouvaient-elles pas leur causer plus de bien ou plus de mal, selon qu’une direction bonne ou mauvaise leur était imprimée? Une locomotive qui emporte, dans sa course vertigineuse, des centaines de voyageurs, rend plus de services qu’un cheval d’attelage; mais une locomotive qui déraille ne cause-t-elle pas des accidents plus désastreux qu’un cheval qui prend le mors aux dents? A mesure que le mécanisme de la production se renforce et s’agrandit, au profit de l’espèce humaine, la mauvaise direction de ce mécanisme ne doit-elle pas engendrer des catastrophes plus redoutables ? L’étude approfondie de l’organisation sociale, étude qui fait l’objet de l’économie Politique, est donc devenue plus que jamais une nécessité depuis l’avénement de la grande industrie, car elle seule peut signaler les moyens d’empêcher cette puissante locomotive de dérailler.
Qui le croirait cependant? Cette nécessité d’étudier l’organisation sociale, nécessité si palpable à l’époque où nous sommes, on l’a contestée. Il y a peu de temps, un homme d’Etat illustre, M. Thiers, déclarait que [423] l’étude de l’économie politique lui paraissait plus nuisible qu’utile. « C’est l’économie politique, affirmait-il, qui a engendré le socialisme. » Est-il nécessaire de repousser une accusation si étrangement contraire à la vérité ? Sans doute, l’économie politique a remué une foule de problèmes redoutables; mais si l’économie politique s’était abstenue de toucher à ces problèmes, le socialisme ne les aurait-il point agités? Ne les agitait-il pas avant même que l’économie politique eût commencé à les examiner? La propriété n’avait-elle pas été attaquée théoriquement par les communistes, pratiquement par les protectionistes, avant d’être défendue par les économistes? Des socialistes, Thomas Morus, Campanella, Harrington, Morelly, n’avaient-ils pas imaginé de nouvelles sociétés, avant que les économistes eussent démontré « qu’on ne peut refaire la société? » Non ! quoi qu’en disent les adversaires de l’économie politique, il y a des époques où certaines questions surgissent, pour ainsi dire, des entrailles mêmes de la société et s’imposent irrésistiblement aux hommes. Telles ont été les questions économiques depuis l’avénement de la grande industrie. Ces questions sont devenues, par la force même des choses, la grande préoccupation des masses, dont l’existence a été si profondément modifiée par l’introduction des véhicules perfectionnés de la production. La science n’était-elle pas tenue de répondre à cette préoccupation si naturelle et si légitime des masses ? N’était-ce pas aux économistes qu’appartenait la mission de porter la lumière dans le champ nouveau de la production, champ immense et fécond, mais rempli de précipices inconnus? Eût-il mieux valu laisser ce soin aux utopistes?
L’économie politique avait donc une tâche importante à remplir, en présence de la transformation progressive de la production, et nos lecteurs savent qu’elle n’a point failli à cette tâche. Quoiqu’elle soit d’une date encore bien récente, elle a déjà rendu à la société des services signalés, soit en poussant les gouvernements à réformer des lois surannées, soit en combattant des utopies funestes.
En Angleterre, par exemple, la propagande active des saines théories de l’économie politique a déterminé la chute du régime prohibitif. Nous n’avons pas à refaire, en ce moment, la critique de ce régime qui se base sur un prétendu antagonisme d’intérêts entre les nations, et qui préconise la cherté comme un moyen d’enrichir les peuples. Les admirables résultats des réformes commerciales opérées successivement par Huskisson, Robert Peel, lord John Russell et M. Gladstone attestent aujourd’hui, d’une manière assez claire, combien l’Angleterre a gagné à suivre les conseils des économistes. L’introduction du régime de la liberté du commerce dans ce grand pays est un progrès dont l’économie politique peut, à bon droit, se glorifier.
En France, l’économie politique n’a pu encore obtenir qu’une réforme douanière partielle; en revanche, elle a le droit de revendiquer une part honorable dans la défense de la société, menacée par le socialisme. C’est [424] dans les livres des économistes qu’ont été puisés tous les arguments dont on s’est servi depuis 1848 pour démontrer la folie des nouveaux systèmes d’organisation sociale, et M. Thiers lui-même, dans son remarquable livre de la Propriété, ne s’est point fait scrupule de mettre à contribution les maîtres de la science.
Que l’enseignement de l’économie politique soit actuellement plus nécessaire qu’à aucune époque antérieure de l’histoire; que cet enseignement ait déjà porté de bons fruits, tant par les progrès qu’il a fait réaliser que par les fautes qu’il a fait éviter ; qu’il soit destiné à en porter de meilleurs encore lorsqu’il sera devenu usuel parmi les masses, voilà, en résumé, ce que l’on peut affirmer hardiment.
Bien convaincus des vérités que nous venons d’énoncer, pénétrés de l’importance de la mission qu’ils avaient à remplir dans la nouvelle évolution de la société, les économistes se sont principalement appliqués, depuis un demi-siècle, à vulgariser les principes de leur science. En Angleterre, en France, en Allemagne, dans la plupart des autres pays civilisés, des traités élémentaires d’économie politique, des catéchismes, des pamphlets, des tracts, des journaux ont été publiés en vue de l’éducation économique des masses, et cette œuvre de propagande d’une science nécessaire a été heureusement secondée par les associations instituées pour faire pénétrer dans les législations douanières le principe de la liberté commerciale.
Mais un ouvrage d’ensemble, réunissant comme dans un vaste tableau synoptique toutes les acquisitions de la science, manquait encore. L’économie politique n’avait pas de Dictionnaire. M. Ganilh avait bien essayé, il y a une trentaine d’années, de lui en donner un; mais sa tentative n’avait point été heureuse. Le Dictionnaire de l’économie politique de M. Ganilh n’est qu’une imparfaite esquisse, et il ne pouvait guère être autre chose. Les sciences, fécondées par la méthode d’observation, sont maintenant trop vastes pour qu’un seul homme puisse les embrasser dans toutes leurs parties. Un dictionnaire qui serait l’œuvre d’un seul écrivain présenterait certainement de nombreuses lacunes ; il manquerait, en outre, de l’attrait particulier qui résulte de la diversité des appréciations et du style dans ce genre d’ouvrages.
M. Guillaumin a eu l’heureuse idée d’exécuter, avec le concours d’un nombreux personnel de collaborateurs, l’œuvre que M. Ganilh, réduit à ses propres forces, n’avait pu qu’esquisser; et, grâce à lui, l’économie politique possède maintenant son dictionnaire.
M. Guillaumin se trouvait placé d’ailleurs dans la situation la plus favorable pour mener à bonne fin une œuvre si importante.
D’abord, la France est incontestablement le pays qui convient le mieux pour l’exécution d’un travail de ce genre. Peut-être le génie allemand a-t-il plus de profondeur que le génie français; peut-être les Anglais sont-ils de meilleurs observateurs; mais il est une qualité que les [425] écrivains français possèdent, de l’aveu de tous, à un plus haut degré, c’est la méthode, c’est la science de l’exposition. Le génie français est essentiellement lucide et méthodique. Aussi est-ce, le plus souvent, grâce aux vulgarisateurs français que les découvertes scientifiques des autres nations se sont répandues dans le monde. Pour n’en citer qu’un seul exemple, emprunté à l’histoire de l’économie politique, n’est-ce pas le Traité de J.-B. Say qui a le plus contribué à propager les théories exposées avec une admirable lucidité, mais distribuées d’une manière un peu confuse dans le Traité de la Richesse des nations d’Adam Smith ?
Ensuite, par un concours particulier de circonstances, les économistes français se trouvaient précisément dans les conditions les meilleures pour élever en commun un monument à la science. Exclue de l’enseignement officiel; considérée encore généralement, malgré son utilité manifeste, comme une science de pure curiosité, l’économie politique n’est cultivée en France que par un petit nombre d’esprits d’élite qu’une vocation irrésistible attire vers cette branche trop négligée des connaissances humaines. Mais, à cause même de leur petit nombre et du peu de faveur dont jouissent leurs doctrines, les économistes ont senti la nécessité de se réunir pour agir plus efficacement sur l’esprit public. Dès le dix-huitième siècle, c’est-à-dire à l’origine même de la science, ils ont formé une école, demeurée célèbre sous le nom d’école des physiocrates. Groupés autour de leur maître, le docteur Quesnay, les physiocrates, malgré leur petit nombre, n’en exercèrent pas moins une influence considérable sur les esprits et sur les événements. Cette influence, auraient-ils pu l’acquérir si chacun d’eux avait cultivé isolément la science, s’ils n’avaient point formé un faisceau, constitué une école? Les économistes du dix-neuvième siècle ont suivi l’exemple de leurs aînés. Après la mort de J.-B. Say, qui avait tenu pendant trente ans, on sait avec quel éclat, le sceptre de la science, ses principaux disciples se réunirent pour poursuivre en commun la propagande des vérités économiques. Le Journal des Economistes fut fondé avec leur concours, en 1841, et, l’année suivante, quelques-uns d’entre eux commençaient les réunions mensuelles de la Société d’économie politique. Dès lors, la science eut en France un point de réunion, un foyer. Les hommes qui la cultivaient isolément, sans se connaître pour la plupart, se rapprochèrent en concourant à la rédaction du Journal et en participant aux réunions de la Société. Des hommes d’Etat, des administrateurs, des journalistes, des professeurs, des négociants, etc. appartenant aux opinions politiques les plus diverses, se trouvèrent ainsi engagés dans une œuvre commune de propagande. Ils n’étaient pas d’accord, sans doute, sur tous les points de la science; mais leurs divergences d’opinion, qui servaient d’ailleurs à alimenter leurs discussions périodiques, ne pouvaient manquer à la longue de s’affaiblir, sinon de s’effacer. Des hommes intelligents qui poursuivent une œuvre commune et qui se trouvent fréquemment en contact ne finissent-ils pas toujours par éclaircir [426] mutuellement leurs doutes et par contracter, presqu’en dépit d’eux-mêmes, l’habitude de penser de la même manière ? En science comme en religion, l’association des efforts n’est-elle pas souverainement efficace pour amener l’unité dans les doctrines? C’est ainsi que l’économie politique a fini par posséder en France une école dont tous les membres s’accordent sur les points fondamentaux de la science, et qui présentent à leurs adversaires, protectionistes ou communistes, un bataillon peu nombreux, mais uni, serré, compacte.
Ce personnel scientifique que la fondation du Journal des Économistes et de la Société d’économie politique a successivement rassemblé, convenait à merveille, tant par la diversité de ses connaissances que par l’unité de ses doctrines, pour la rédaction d’un Dictionnaire destiné à résumer les acquisitions de la science. Pendant douze ans, toutes les questions qui se rattachent de près ou de loin à l’économie politique avaient été examinées et discutées dans le Journal des Économistes ou au sein de la Société de l’Économie politique; en sorte qu’il suffisait aux rédacteurs du Journal ou aux membres de la Société de résumer leurs travaux antérieurs pour doter la science d’un répertoire aussi complet que possible.
M. Guillaumin avait donc à sa disposition les ouvriers qu’il lui fallait pour élever à l’économie politique un monument digne d’elle. Les circonstances étaient aussi des plus favorables à l’édification de ce monument scientifique. La révolution de Février avait montré quels abîmes l’ignorance des gouvernements et des peuples avait creusés sous les pas de la société. N’était-ce pas le moment de présenter, dans un vaste et harmonieux ensemble, les acquisitions de la science qui avait sondé ces abîmes et signalé les moyens de les combler ? M. Guillaumin le comprit, et il commença, dans les derniers mois de 1850, la publication du Dictionnaire de l’Économie politique.
La direction de cette importante entreprise fut d’abord confiée à M. Ambroise Clément, de Saint-Etienne, qui en dressa le programme et qui rédigea les principaux articles des deux premières lettres; mais M. Clément, rappelé dans sa ville pour y occuper de nouveau une position administrative, fut obligé d’abandonner la tâche qu’il avait si bien commencée. Il demeura néanmoins un des collaborateurs les plus assidus du Dictionnaire, et c’est à lui qu’est due l’excellente Introduction, donnant un aperçu général de la science au point où elle est actuellement parvenue, qui se place en tête du premier volume. Charles Coquelin, de si regrettable mémoire, fut le digne successeur de M. A. Clément. Malheureusement, la mort vint le frapper au milieu même de cette belle œuvre, à laquelle il consacrait une vaste érudition et un jugement éprouvé. Il eût été difficilement remplacé. M. Guillaumin continua seul, avec l’aide des conseils de quelques-uns de ses collaborateurs; parmi lesquels nous citerons MM. Horace Say, Joseph Garnier et Courcelle-Seneuil, l’œuvre [427] commencée, et, grâce à un labeur qui fut sur le point de lui coûter la vue, il réussit à la terminer en moins de deux années.
Voici comment M. Guillaumin exposait le plan de son Dictionnaire, dans le prospectus de cet ouvrage:
« Le dictionnaire que nous annonçons formera un immense répertoire, une vaste encyclopédie des connaissances économiques, au double point de vue de la pratique et de la théorie. Tout ce qui, de près ou de loin, se rattache à la science dans ses diverses applications y trouvera sa place, sera l’objet d’un article spécial : impôts, finances, crédit, papier-monnaie, administration, charité, bienfaisance, paupérisme, caisses d’épargne, caisses de retraite, monts-de-piété, routes, canaux, chemins de fer, travail, salaires, douanes, liberté des échanges, protection, agriculture, législation et commerce des blés, etc., etc.
« Une telle publication ne serait pas complète, à notre point de vue, si nous n’y ajoutions deux parties essentielles: la biographie et la bibliographie. Malgré le travail immense qu’exige une véritable bibliographie, et les difficultés inouïes qu’elle rencontre dans l’exécution, la nôtre sera infiniment plus complète que tout ce qui a été fait jusqu’à présent en ce genre, tant en France qu’à l’étranger.
« Pour atteindre le but d’utilité qu’elle se propose, celui d’offrir à l’administrateur, à l’homme d’État, au publiciste, la nomenclature complète des principaux ouvrages écrits sur la matière qui l’intéresse ou qui fait l’objet de ses études, cette partie de notre publication devait se présenter sous deux aspects différents. Elle devait donner tour à tour la Bibliographie par ordre de matières et la Bibliographie par noms d’auteurs. Par exemple, quiconque voudra étudier à fond la question des banques,de la bienfaisance, du crédit foncier, des enfants trouvés, etc., trouvera d’abord, à la suite des articles consacrés à chacun de ces mots, la liste complète des ouvrages publiés sur ces diverses questions, soit en français, soit en langue étrangère. Mais cette première satisfaction ne suffirait pas pour un grand nombre de lecteurs, si, d’un autre côté, il n’était pas possible de connaître à volonté tous les écrits publiés par un même auteur sur les matières économiques. Pour répondre à ce dernier besoin, nous avons donné, au nom de chaque auteur, la liste complète des ouvrages publiés par lui ; et cette liste, au lieu d’être, comme dans la plupart des bibliographies, une sèche nomenclature de titres d’ouvrages, sera accompagnée de notes, d’appréciations, de jugements puisés aux meilleures sources, qui guideront le lecteur d’une manière certaine et efficace dans ses études et ses recherches.
« Le nom de chaque auteur sera suivi d’une notice biographique plus ou moins étendue, selon l’importance de l’écrivain et le rôle qu’il aura joué pendant sa vie. Quant aux vivants, on comprendra les raisons de convenance qui nous détermineront à donner succinctement, sans éloge et sans blâme, l’indication des principaux faits de leur carrière, avec la liste sommaire de leurs publications. »
Ceux qui ont le Dictionnaire sous les yeux peuvent s’assurer que les promesses du prospectus ont été, chose assez rare, remplies et au delà. A elle seule, la partie bibliographique et biographique du Dictionnaire pourrait former un ouvrage considérable. On y trouve, sauf un bien petit nombre de lacunes, tout ce qui a été écrit et tous ceux qui ont écrit sur l’économie politique.
[428]
« Pour accomplir cet immense travail, dit encore l’éditeur dans sa Préface, il a fallu compulser page par page, colonne par colonne, les dix volumes de la France littéraire, de M. Quérard ; les cinq volumes de la Littérature contemporaine, qui font suite à cet ouvrage, et les Tables de la Bibliographie générale de la France. Nous avons, en outre, mis à contribution la Biographie universelle deMichaud; la Biographie des Contemporains, la Collection des Economistes italiens de Custodi; une bibliographie des Économistes espagnols, par M. de Bona y Ureta; les notes bibliographiques de M. R. de la Sagra, les bibliographies allemandes de Ersch, Kaiser, Hinrichs ; le Dictionnaire de la conversation, de Brockhaus; le Dictionnaire des sciences de l’Etat (Staats Lexicon), par Rotteck et Welcker ; les Archives d’économie politique, de Rau; le Journal des sciences de l’Etat, de Tubingen ; et surtout In bibliographie tout à fait spéciale de M. Mac Culloch, intitulée : Literature of political Economy.
« Confiées d’abord à M. Ath. Gros, aujourd’hui bibliothécaire à Draguignan, la biographie et la bibliographie ont été continuées, à partir de la lettre B, par M. Maurice Block, sous-chef du bureau de la statistique générale de la France, qui a rédigé un nombre considérable d’articles, recueilli les notes biographiques et bibliographiques, et traduit en français les titres d’ouvrages publiés en langues étrangères. D’autres collaborateurs ont aussi pris part à ce travail : MM. A. Clément, Baudrillart, Gustave de Molinari, Maurice Monjean, et notamment M. Joseph Garnier, auquel nous devons un grand nombre d’articles biographiques et bibliographiques, où l’on reconnaît son goût pour l’érudition et la connaissance qu’il a de la littérature économique. »
Parmi les articles biographiques les plus importants, nous signalerons J.-B. Say, par M. A. Clément, qui a fait une étude toute spéciale des œuvres de cet illustre maître dont il a été le disciple; Sismondi, Adam Smith, Turgot, par M. Maurice Monjean, qui a consacré à ces hommes célèbres des notices dignes d’eux; Jean Bodin, Colbert, Condillac, Condorcet, Platon, Rousseau, Destutt Tracy, Voltaire, par M. Henri Baudrillart, qui a abandonné l’arène de la philosophie et de la littérature pour celle de l’économie politique, à laquelle il a apporté un esprit élevé et une plume élégante; Jean de Witt, par M. Esquirou de Parieu, un homme politique qui partage ses loisirs entre l’économie politique et la jurisprudence ; Droz, Galiani, Genovesi, Godwin, Hume (David), List (le docteur), Malthus, Mably, Quesnay, Ricardo, Roland, Rossi, Saint-Simon, etc., etc., par M. Joseph Garnier, dont nos lecteurs ont pu apprécier le talent solide et varié. Mentionnons, d’une manière spéciale, dans l’œuvre biographique de M. Joseph Garnier, la notice sur Montchrétien, auteur du premier Traité d’économie politique en 1615, et la notice sur Fromenteau, cet économiste du seizième siècle, qui a joué un rôle si curieux dans l’assemblée générale du tiers Etat, de la noblesse et du clergé, et dont M. Joseph Garnier a eu le mérite de découvrir dans la poussière des bibliothèques les travaux trop oubliés.
Voilà pour ce qui concerne la partie biographique et bibliographique de l’ouvrage. Arrivons maintenant à la partie doctrinale.
[429]
Dans un ouvrage de ce genre, il était essentiel d’avoir égard à la formule saint-simonienne : A chacun sa capacité, c’est-à-dire de confier à chaque collaborateur les travaux qui convenaient le mieux à sa spécialité. La direction du Dictionnaire n’y a pas manqué. Elle a divisé entre ses savants collaborateurs le travail à exécuter, conformément à leurs aptitudes et à la direction de leurs études, de manière à obtenir d’eux ce qu’ils étaient le plus capables de bien faire.
C’est ainsi que M. Hippolyte Passy, ancien ministre des finances et auteur du remarquable ouvrage sur l’Influence des Systèmes de culture sur l’économie sociale, a écrit, d’une part, l’article Impôt, de l’autre les articles Agriculture et Climat. Esprit presque encyclopédique, M. Passy n’a point borné là sa collaboration au Dictionnaire : on lui doit encore trois articles sur les questions les plus ardues et les moins éclaircies de la science: Rente de la terre, Utilité et Valeur. Comme pour se délasser de cette tâche sévère, il a fait justice des aberrations du socialisme dans l’article Utopie. Cette guerre aux utopistes, M. Léon Faucher, ancien ministre comme M. Passy, l’a poursuivie dans plusieurs articles importants, tels que Droit au travail, Intérêt, Propriété, Salaires. Dans ces articles, qui forment presque autant de traités complets, M. Léon Faucher a démoli avec une rare vigueur les sophismes dont les socialistes se sont servis pour ébranler les institutions fondamentales de la société. Dans l’article Intérêt, il a tracé un historique curieux du préjugé qui s’est élevé depuis l’antiquité jusqu’à nos jours contre cette forme de la rémunération du capital. Complété par l’article Usure, de M. G. de Molinari, le travail de M. Léon Faucher donne un aperçu complet de cette question qui a occupé tour à tour Aristote, saint Thomas d’Aquin, Calvin, Bossuet, Turgot, Jérémie Bentham et M. Proudhon ! — A M. Louis Reybaud, l’auteur si populaire des Etudes sur les socialistes, revenait de droit l’article Socialisme. On sait que ce mot qui a fait malheureusement un si grand bruit dans le monde a été créé et mis en circulation par M. Reybaud. Les articles Socialisme de M. Louis Reybaud, Droit au travail de M. Léon Faucher, Utopie de M. Passy, auxquels il convient de joindre un travail de M. Henri Baudrillart, sur le Communisme, l’article Organisation du travail et la biographie de Fourier, par M. Courcelle-Seneuil, la biographie de Saint-Simon, par M. Joseph Garnier, donnent un aperçu aussi complet que possible des fausses doctrines qui ont été sur le point de bouleverser la société. Les articles Navigation et Quarantaine sont encore dus à la plume élégante de M. Louis Reybaud, à qui sa position de député d’un de nos grands ports de mer avait fait une obligation d’étudier à fond les questions maritimes. M. Ch. Dunoyer nous ramène à la science pure. Le savant auteur du traité de la Liberté du travail, a reproduit, dans l’article Production, l’analyse si méthodique et si complète qu’il a donnée des différentes branches de l’industrie humaine. Dans l’article Gouvernement, qui a fait l’objet d’un débat intéressant au [430] sein de l’Académie des sciences morales et politiques, M. Charles Dunoyer a défini et délimité les véritables attributions du gouvernement.
M. Cherbuliez, aujourd’hui professeur d’économie politique à Lausanne, a donné au Dictionnaire les articles Bienfaisance publique, Coalitions, Cultes, Disette, Paupérisme, Taxe des pauvres. Dans le premier et les deux derniers de ces articles, M. Cherbuliez a fustigé, d’une main parfois un peu rude, cette fausse philanthropie, si proche parente du socialisme, qui aggrave les souffrances du pauvre en allouant une prime à son imprévoyance. Les articles Hôpitaux et Hospices, Secours publics,de M. Vée, inspecteur de l’assistance publique ; Enfants trouvés, de M. Frédéric Cuvier, l’un des esprits les plus éclairés du Conseil d’Etat ; Monts-de-piété, par M. Horace Say ; Sociétés de secours mutuels, par M. Alfred Legoyt ; Caisses de retraites, par M. Emile Thomas, complètent ce qui concerne l’assistance publique dans ses diverses ramifications.
M. Michel Chevalier qui a consacré, comme on sait, une grande partie de son cours du Collége de France aux travaux publics et à la monnaie, s’est chargé des articles Canaux, Chemins de fer, Métaux précieux, Monnaie, remplis de faits habilement condensés, etc. Son appréciation raisonnée des causes qui doivent amener, dans un délai plus ou moins long, la baisse de l’or (article Métaux précieux), est aussi particulièrement intéressante. M. Dupuit, dont les lecteurs du Journal des Economistes ont pu apprécier l’esprit original et les connaissances solides, M. Dupuit, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, a traité des sujets qui rentrent dans sa spécialité, tels que Eau, Péages, Poids et mesures, Ponts et Chaussées, Routes, Voies de communication, complétés par l’article Travaux publics de M. Biaise (des Vosges), rédacteur en chef du Journal des Chemins de fer.
M. Wolowski, professeur au Conservatoire des arts et métiers, qui, le premier, a fait connaître en France les institutions de crédit foncier de l’Allemagne, et qui a été l’un des principaux promoteurs de la réforme du régime hypothécaire, était naturellement désigné pour écrire les articles Crédit foncier et Hypothèques. Charles Coquelin, qui avait soutenu avec tant de vigueur, dans son remarquable livre sur le Crédit et les Banques, la thèse, nouvelle en Europe, de la liberté des banques, s’était réservé les articles Banques, Circulationet Crédit.Le Dictionnaire qu’il a dirigé jusqu’à sa mort avec tant de science et d’autorité lui est redevable encore de plusieurs autres travaux importants, parmi lesquels nous signalerons : Acte de navigation, Brevets d’invention, Budget, Cabotage, Capital, Centralisation, Commerce, Concurrence, Crises commerciales, Harmonie industrielle, Industrie, etc., et surtout Economie politique qui est un des plus remarquables écrits de ce recueil. Les articles Crédit public et Emprunts publics sont dus à M. Gustave Dupuynode, qui vient de publier un savant ouvrage sur la monnaie, le crédit et l’impôt.
M. Horace Say, qui a mis au service du Dictionnaire sa vaste érudition [431] économique, sa science pratique des affaires et son ferme bon sens, M. Horace Say a écrit les articles Agents de change, Agiotage, Assurances, Bourse, Warrants, qui se rattachent plus ou moins aux questions du crédit; l’article Douane, qui renferme un historique complet de la législation douanière des principaux pays civilisés et, en particulier, de la France ; l’article Enquête, que le directeur de la grande enquête sur l’industrie parisienne était mieux que personne en état d’écrire, etc. — M. Renouard , ancien pair de France et conseiller à la Cour de cassation, a écrit les articles Législation, Marques de fabrique, Société commerciale, et Parasites, l’une des esquisses les plus piquantes du Dictionnaire.
M. Vivien, ancien ministre, dont nous n’avons pas besoin de vanter les Etudes administratives, a donné l’article Police, où l’on retrouve, dans un cadre trop resserré peut-être, les qualités qui ont valu au livre un succès si honorable. — M. Esquirou De Parieu, ancien ministre de l’instruction publique, a fourni, pour sa part, Mariage, Octroi, Sel, Successions, Timbre et Enregistrement, Vente. Ces travaux se distinguent par une érudition variée, et l’on peut dire, notamment des articles Mariage et Successions, qu’ils éclairent l’économie politique par le droit, et le droit par l’économie politique. — M. Quételet, le savant directeur de l’observatoire de Bruxelles, président de la Commission royale de statistique de Belgique, qui a fait de si ingénieuses applications de la théorie des probabilités aux phénomènes économiques, et à qui la Belgique doit une nouvelle table de mortalité, a écrit les articles Probabilités et Tables de mortalité. Les principales Tables de mortalité connues sont reproduites dans ce dernier article. — M. Alfred Legoyt, directeur du bureau de la statistique générale, a traité, avec savoir et érudition, différentes questions qui se rattachent à sa spécialité : Domaine public, Mines, Morcellement, Population (Statistique de la), Recensement, Recrutement, Sociétés de secours mutuels, etc. — MM. Jules De Vroil, Léon Say, De Watteville, A. De Clercq, Moreau Christophe, M. Block, N. Rondot, A. Courtois, A. Dumont, E. Duval, etc., ont fait l’historique et l’appréciation de diverses institutions financières, agricoles, commerciales, manufacturières, charitables, etc., dans les articles: Amortissement, Chambres de commerce, Comptoirs d’escompte, Comices agricoles, Consulats, Dépôts de mendicité, Fermes modèles, Haras, Ligue anséatique, Prisons, Loteries, Télégraphie, etc., etc.
M. Joseph Garnier, qui a été avec Charles Coquelin, MM. Horace Say, Ambroise Clément, Courcelle-Seneuil, G. de Molinari, l’un des collaborateurs les plus assidus du Dictionnaire, a traité une grande variété de sujets. On lui doit notamment Population, sujet que nul n’était plus apte à traiter que le savant annotateur de Malthus; Statistique, aperçu substantiel et clair de cette science auxiliaire de l’économie politique ; Blocus continental, Boulangerie, Changes, Consommation, Contrebande, Finances, Liberté du travail, Ligue anglaise, Machines, Maximum, [432] Physiocrates, Tabac, etc., où se retrouvent les connaissances approfondies de l’auteur des Eléments de l’économie politique. — M. Gustave de Molinari a écrit Beaux-Arts, Céréales, Civilisation, Colonies, Emigration, Esclavage, Liberté du commerce, Noblesse, Paix, Propriété littéraire, Servage, Travail, Usure, Villes, etc . [2] Citons encore : Expositions industrielles, par M. Ad. Blanqui, à qui un état de santé précaire a malheureusement interdit une collaboration plus active au Dictionnaire; Traités de Commerce, par M. Charles De Brouckère, bourgmestre de Bruxelles, ancien président de l’association belge pour la liberté des échanges ; Instruction publique, par M. Ch. Vergé, rédacteur du Compte-rendu de l’Académie des sciences morales et politiques; Vins (Impôt sur les), par M. Louis Leclerc, qui a consacré à l’industrie vinicole de si agréables articles dans la presse quotidienne; Garantie des matières d’or et d’argent, Prud’hommes, par M. P. Paillottet; Morale, par M. Cochut; etc., etc. N’oublions pas enfin l’article Abondance, qui ouvre le Dictionnaire et qui a été l’un des derniers travaux d’un homme quia laissé dans la science une trace si brillante, Frédéric Bastiat.
M. Guizot disait, il y a trente ans, des encyclopédies : « C’est comme un vaste bazar intellectuel où les résultats de tous les travaux de l’esprit humain s’offrent en commun à quiconque s’y arrête un moment, et sollicitant à l’envi sa curiosité. » [3]
Le Dictionnaire de l’économie politique n’embrasse qu’une des nombreuses catégories des travaux de l’esprit humain, mais, dans cette sphère naturellement limitée, il est plus détaillé, plus complet qu’aucune encyclopédie ne pourrait l’être. C’est, pour nous servir de l’expression pittoresque de M. Guizot, le « bazar de l’économie politique » , bazar où se trouvent accumulés et mis à la portée de tous, les produits de cette branche utile des connaissances humaines. En élevant à l’économie politique ce monument durable, M. Guillaumin a dignement couronné l’ensemble de ses grandes publications économiques, le Dictionnaire du commerce et des marchandises, la Collection des principaux économistes, le Journal des économistes, l’Annuaire de l’économie politique et de la statistique, etc., et il a acquis un nouveau titre à la reconnaissance des amis de la science.
Endnotes to Molinari’s JDE article
[1] Deux magnifiques volumes grand in-80 à deux colonnes de 900 pages chacun, avec 8 portraits des principaux économistes. Chez Guillaumin et Ce. Prix, 50 fr.
[2] Notre collaborateur se borne à énumérer quelques-uns de ses travaux dans le Dictionnaire. Il n’est pas nécessaire d’ajouter, pour nos lecteurs, que M. de Molinari a, lui-même, une place marquée parmi les auteurs les plus distingués de cette belle publication, tant à cause de la netteté de son esprit que de l’élégance de son style. (note de la rédaction.)
[3] Encyclopédie progressive, article Encyclopédie.
PRÉFACE DE L'ÉDITEUR (Guillaumin)↩
Source
“Préface de l’éditeur (Guillaumin),” DEP, T. 1, pp. v-viii.
[v]
Chaque science compte un certain nombre de Dictionnaires plus ou moins étendus; l'Économie politique seule n'en avait pas encore qui répondît aux besoins de ceux qui veulent la consulter et s'éclairer de ses lumières. C'est cette lacune que nous sommes venus combler, et le brillant accueil qu'a obtenu notre livre, tant en France qu'à l'étranger, nous est un témoignage que nous avons produit une œuvre aussi vivement désirée qu'elle est digne, à tous égards, des écrivains éminents qui ont bien voulu s'associer à nous.
Pour s'éclairer sur toutes les questions qui touchent à l'ordre économique, pour se former une opinion raisonnée, les bons ouvrages ne manquent pas: un grand nombre de traités généraux, complets ou élémentaires, offrent aujourd'hui l'ensemble des notions qu'il importe à tout homme de posséder ; mais la forme didactique de ces ouvrages ne présente pas les avantages de la forme alphabétique si propre aux recherches, si utile pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les ouvrages techniques, ou pour celles qui n'ont pas le temps de se livrer à une étude spéciale.
Le Dictionnaire de l'Économie politique est donc le complément indispensable des traités fondamentaux que possède la science. Tous nos efforts ont tendu à ce que, malgré le nombre des auteurs et les diverses nuances de leurs opinions, ce fût toujours la même doctrine générale qui prévalût, afin que notre livre pût servir de guide au lecteur, à travers l'océan des doctrines contradictoires qui se sont produites surtout de nos jours. Aussi est-ce avec intention que nous lui avons donné le titre de Dictionnaire de l'Économie politique au lieu de celui de Dictionnaire d'Economie politique.
Nous venons de dire que l'Économie politique ne possédait pas jusqu'à présent de Dictionnaire qui satisfît à ses besoins. En effet, rien d'analogue à ce que nous voulions faire et à ce que nous avons fait n'avait été tenté, soit en France, soit ailleurs. Le Dictionnaire d'Economie politique de Ganilh [4] n'a été qu'un essai bien incomplet, et dont il serait superflu de démontrer l'insuffisance; le Répertoire général dEconomie politique, (Voyez Sandelin.) publié à La Haye il y a peu d'années, se compose d'articles empruntés à divers traités ou publications périodiques, et l'auteur n'a d'ailleurs pas eu la prétention de faire un livre de doctrine. C'est là ce qui nous a donné pleine confiance dans le succès de notre entreprise.
Mais le Dictionnaire réduit aux seuls mots de la science nous paraissait incomplet ; il nous a semblé que la Bibliographie des ouvrages consacrés et même la Biographie des auteurs qui les ont écrits devaient en être le complément.
C'est donc pour la première fois que l'Économie politique aura une bibliographie complète, méthodiquement disposée à la fois par ordre de matières et par noms d'auteurs, et dans laquelle les hommes d'étude, les administrateurs, et tous ceux qui ont des indications à chercher, pourront puiser les renseignements les plus nombreux et les plus précis. [5]
Pour accomplir cet immense travail, il a fallu compulser page par page, colonne par colonne, les dix volumes de la France littéraire de M. Quérard, les cinq volumes de la Littérature contemporaine qui font suite à cet ouvrage et les Tables de la Bibliographie générale de la France. Nous avons en outre mis à contribution la Biographie universelle de Michaud, la Biographie des contemporains, la Collection des Économistes italiens de Custodi; une bibliographie des Économistes espagnols, par M. de Bona y Ureta; [6] les notes Bibliographiques de M. R. de La Sagra, les Biographies allemandes de Ersch, Kaiser, Hinrichs; le Dictionnaire de la conversation, de Brockhaus; le Dictionnaire des sciences de l’État [Staats-Lexicon) par Rotteck et Welcker; les Archives d'Économie politique de Rau et le Journal des sciences de l État, de Tubingue, et surtout la Bibliographie tout à fait spécial de M. Mac Culloch intitulée: Literature of Political Economy.
M. Maurice Block, sous-chef du bureau de la statistique générale de la France, a rédigé un grand nombre d'articles biographiques et bibliographiques, et traduit en français les titres d'ouvrages publiés en langues étrangères. D'autres collaborateurs ont aussi pris part à ce travail : MM. A. Clément, Baudrillart, Gustave de Molinari, Maurice Monjean, et notamment M. Joseph Garnier, auquel nous devons aussi un assez grand nombre d'articles biographiques et bibliographiques où l'on reconnaît son goût pour l'érudition et la connaissance parfaite qu'il a de la littérature économique. — Nous avons la satisfaction de penser que les lecteurs nous tiendront particulièrement compte des efforts qui ont été faits pour cette partie spéciale de notre Dictionnaire, dans laquelle une foule d'ouvrages, plus ou [vii] moins oubliés, ont été remis en lumière, un grand nombre d'erreurs et d'inexactitudes ont été redressées, et où les Economistes érudits pourront constater plus d'une remarquable découverte.
Dans les articles bibliographiques, soit par noms d'auteurs, soit par ordre de matières, nous avons généralement classé les ouvrages selon l'ordre chronologique de leur publication, et nous avons mis tous nos soins à en reproduire les titres exactement et complètement. A la suite de chaque titre nous avons ajouté, pour les ouvrages les plus importants ou les plus remarquables à divers égards, des notes explicatives et des appréciations sur leur contenu ; pour cela nous avons également fait de nombreux emprunts à la Bibliographie de M. Blanqui, à celle de M. Mac Culloch, aux articles de critique écrits dans le Journal des Économistes et à d'autres publications faisant autorité ; mais pour les écrivains encore vivants, nous avons cru devoir nous borner, par des raisons de convenance qui se comprendront facilement, à ne donner, pour la Biographie, que des indications sommaires sans aucune réflexion, et pour la Bibliographie, que des appréciations empruntées à d'autres ouvrages; car, quelque sincère qu'eût été notre désir d'impartialité, il nous eût été difficile de dire toutes choses dans une juste mesure, avec fidélité et indépendance. A cet égard, on nous avait quelquefois conseillé de nous abstenir entièrement. Nous n'avons point jugé à propos de suivre cet avis; une grande partie des ouvrages économiques étant dus à la plume d'hommes encore vivants, notre œuvre, sans les détails qui concernent ces ouvrages et ces écrivains, eût été vraiment incomplète; et nous avons pu remarquer que les courtes notices biographiques que nous avons publiées ont été accueillies avec un vif intérêt.
Nous avons confié la direction scientifique de notre Dictionnaire successivement à M. Ambroise Clément et à feu Charles Coquelin. M. A. Clément, un des collaborateurs les plus appréciés du Journal des Économistes, dont la personne et le caractère ont inspiré à tous nos amis la plus profonde estime, ayant dû quitter Paris, a eu pour successeur, dans cette honorable tâche, feu Charles Coquelin, qui a mis au service du Dictionnaire les brillantes qualités dont la nature l'avait doué et la science profonde qu'il avait acquise : une vaste mémoire, une raison sûre, une grande facilité de travail, une connaissance complète des chefs-d'œuvre de l'Économie politique, un grand respect [viii] pour les fondateurs de la science, une saine appréciation des théories et une remarquable connaissance de l'industrie et des faits en général.
Après sa mort, si regrettable pour la science, notre œuvre commune a pu s'achever facilement, grâce à la direction qui lui avait été imprimée dès le principe, et aidé comme nous l'avons été par les conseils et les avis de nos savants collaborateurs. Qu'il nous soit permis de citer dans ce nombre M. Horace Say, qui, par son savoir et par son zèle pour tout ce qui touche à l'Économie politique, est si digne du nom qu'il porte.
On trouvera naturel, sans doute, qu'après le succès de cet ouvrage l'éditeur revendique ici pour siens l'idée et le plan du livre qui constitue un de ses principaux titres à l'estime et à l'affection que veulent bien lui témoigner les amis de la science en général, et les collaborateurs du Dictionnaire en particulier. Cette nouvelle publication est d'ailleurs le complément d'une collection de travaux dont il avait conçu le projet après avoir publié le Dictionnaire du Commerce, collection qui forme un ensemble dont toutes les parties se lient entre elles, et qui comprend le Journal des Economistes, la Collection des principaux Economistes, l’Annuaire de l'Economie politique et de la Statistique, le Dictionnaire de l'Economie politique et enfin la Bibliothèque des Économistes contemporains, vers laquelle nous allons maintenant diriger principalement nos efforts.
Paris, ce 10 septembre 1853
GUILLAUMIN.
Afin que le lecteur puisse juger d'un seul coup d'œil l'ensemble des matières contenues dans notre Dictionnaire, nous l'avons fait suivre de la Table des principaux articles avec les noms des auteurs en regard, et d'une autre Table de toutes les biographies, donnant aussi les noms des rédacteurs.
Nous avons pensé qu'il serait agréable aux souscripteurs du Dictionnaire de posséder les portraits des Économistes les plus éminents, de ceux auxquels la science doit le plus. Nous avons tenu à ce que ces portraits, tous gravés sur acier et d'une ressemblance authentique, fussent dignes par le fini de l'exécution de ceux dont ils reproduisent les traits.
Les poitrails, au nombre de huit, sont ceux de :
Fr. Quesnay, gravé par Outhwaite, d'après le beau portrait de François, célèbre graveur du dernier siècle. Ad. Smith, gravé par Bosselmann, d'après le seul portrait authentique que l'on connaisse. Malthus, par madame Fournier, d'après la belle gravure anglaise de J. Linnell. Turgot, par L. Massard , d'après la photographie de la statue qui orne la salle des séances du palais du Luxembourg. J.-B. Say, par Hopwood, d'après le beau tableau peint par Decaisne et appartenant à M. Horace Say. Sismondi, par Eug. Gervais, d'après le portrait du célèbre graveur Toschi. Rossi, par Eug. Gervais, d'après une photographie de l'admirable buste de Tenerani, que possède la famille. Fr. Bastiat, par madame Fournier, d'après une épreuve au daguerréotype.
EXPLICATION DES ABREVIATIONS.
Les abréviations Bl. et M.C. indiquent les bibliographies de MM. Blanqui et Mac Culloch citées plus haut.
Barb. indique le Manuel de librairie de M. Barbier.
Biogr. univ. la Biographie universelle pubié par MM. Michaud.
Fr. litt. et Q. la France littéraire, par M. Quérard.
Quelques collaborateurs ont signé à diverses reprises avec leurs initiales : ce sont MM.
Ambroise Clément, A. C.
Ath Gros, G. A.
Charles Coquelin, Ch. C.
Courcelle Seneuil, C. S.
Gustave de Molinari, G. de M.
Horace Say, H. S.
Joseph Garnier, Jph G.
Jules de Vroil, J. V.
Maurice Block, M. B.
Jacques de Valserre, J. de V.
Endnotes to Preface
[4] Voyez Ganilh.
[5] Jusqu'à présent la bibliographie économique consistait dans une courte liste des principaux ouvrages qui accompagne la Théorie des richesses sociales de Skarbeck, dans celle dont M. Blanqui a fait suivre son Histoire de l'Economie politique, déjà beaucoup plus étendue, et remarquable par de piquantes annotations; et enfin dans celle de M. Mac Culloch (Literature of Political economy), beaucoup plus étendue encore, très-estimable à tous égards par les savantes appréciations de l’auteur, mais loin d’être complète que la nôtre.
[6] Clave de los Economîstas. Madrid, 1850, in-8 de 70 pages.
INTRODUCTION (Ambroise Clément)↩
Source
“Introduction (Ambroise Clément),” DEP, T. 1, pp. ix-xxvii.
[ix]
I.
Dans les recherches scientifiques comme dans l'industrie, la division des travaux est l'une des conditions essentielles du progrès. Il est donc raisonnable de faire, de chacun des divers ordres de phénomènes auxquels s'appliquent ces recherches, l'objet d'une science distincte et circonscrite, autant du moins que peut le permettre la nature des faits à étudier.
On a souvent reproché à la science dont ce Dictionnaire est destiné à exposer et développer les principes, de n'avoir pas su fixer les limites de son domaine, ou de les avoir souvent franchies pour porter ses investigations sur certains ordres de faits appartenant à d'autres sciences sociales, et par exemple, à la politique, à la législation, à la morale. Mais ces reproches, bien qu'ils aient quelquefois été formulés par d'éminents esprits, et par des Économistes eux-mêmes, paraissent résulter d'idées un peu confuses sur la nature ou les rapports des phénomènes sociaux en général; car, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît bientôt que ces phénomènes sont trop étroitement liés entre eux pour que l'on puisse en diviser l'étude par des limites infranchissables, et qu'aucune des sciences sociales ne saurait être complètement exposée sans quelques explorations sur le domaine des autres.
« Il ne serait pas possible à l'Économie politique, par exemple, de nous faire voir quelles sont les causes de l'augmentation ou de la diminution des richesses, si elle restait étrangère au domaine de la législation, si elle n'exposait pas les effets d'une multitude de lois, de règlements, de traités, relatifs aux monnaies, au commerce, aux manufactures, aux établissements de banque et aux relations commerciales des nations. A son tour, le savant qui s'occupe de législation ne traiterait des lois que d'une manière très-imparfaite s'il ne montrait pas l'influence qu'elles ont sur l'accroissement, la distribution ou la diminution des richesses, … il est également impossible que le savant qui décrit les institutions civiles ou politiques d'un peuple, et le moraliste qui recherche les causes des vices ou des vertus de ce peuple, ne passent pas alternativement l'un sur le territoire de l'autre. » [7]
Les sciences morales sont liées entre elles, non-seulement par les rapports intimes [x] qui existent entre les divers ordres de phénomènes qu'elles ont mission de faire connaître, mais encore par un but commun que nous croyons pouvoir légitimement leur assigner, et qui n'est autre que de mettre le plus possible en lumière les véritables intérêts des sociétés. Tout ce que l'on peut établir quant à leurs caractères distinctifs, c'est que, dans la poursuite de ce but commun, chacune d'elles et appelée à s'occuper de tel ordre de phénomènes sociaux plus particulièrement que de tous les autres, sans pouvoir toutefois négliger entièrement ces derniers. Ainsi la politique et la législation ont plus particulièrement pour objet ce qui concerne l'organisation des sociétés au point de vue de la défense nationale ou de la protection des personnes et des propriétés : elles ont à rechercher et à déterminer les limites qu'il convient de poser à la liberté individuelle dans l'intérêt de la liberté de tous, les règles de la justice à appliquer aux différends qui surviennent entre les particuliers, etc.; mais elles ne sauraient nettement distinguer les intérêts des sociétés sous ces divers rapports qu'en s'appuyant sur les lumières fournies par l'Économie politique et par la morale. Ainsi encore la morale, en recherchant quelles sont les habitudes ou les principes de conduite privée et publique les plus favorables au perfectionnement de l'homme et des sociétés, ne saurait fournir à cet égard des indications sûres sans tenir compte des vérités de l'ordre économique. Ainsi enfin l'Économie politique, en concentrant plus spécialement ses investigations sur les phénomènes par lesquels se produisent, se distribuent et se consomment les richesses, ne saurait négliger l'influence qu'exercent sur les phénomènes de cet ordre les institutions politiques, la législation et les mœurs, qu'en se renfermant dans de stériles abstractions.
Cette connexité des sciences sociales empêchera toujours que l'on puisse donner de chacune d'elles en particulier une définition qui la renferme dans une circonscription exclusive et rigoureusement déterminée; car, encore une fois, on ne pourrait lui interdire toute excursion au delà des limites qu'on lui aurait assignées, qu'à la condition de la mutiler. Cela est, d'ailleurs, aussi vrai de la Législation, de la Politique ou de la Morale que de l'Économie politique. Mais, si l'on ne peut circonscrire absolument le champ d'exploration de chacune de ces sciences, il est facile de les distinguer par la spécialité de leur but, et celle de l'Économie politique a été déterminée avec une précision suffisante : elle est, ainsi que nous venons de l'indiquer, de faire connaître dans leur nature, leurs causes et leurs résultats les phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, en se tenant aux caractères généraux de ces phénomènes et sans entrer, par exemple, dans l'examen des procédés techniques des diverses productions; elle est encore et surtout de nous éclairer le plus possible sur les conditions sociales qui sont favorables ou nuisibles, soit à la fécondité de la production générale, soit à l'équitable répartition des produits, soit à leur emploi avantageux.
Si c'est là, en effet, la tâche spéciale de l'Économie politique, — et nous pensons qu'il serait difficile de le contester, — on reconnaîtra qu'il serait peu utile de lui chercher d'autres définitions; elle se trouve ainsi suffisamment distinguée des autres sciences sociales, sans que le champ de ses investigations ait d'autres limites que celles au delà desquelles elle ne trouverait plus aucun secours utile pour le convenable accomplissement de sa mission. Nous croyons donc pouvoir nous abstenir de plus longs développements sur ce point, pour passer à d'autres considérations.
[xi]
II.
Sous le régime auquel l'enseignement public a été soumis par nos gouvernements, la propagation des connaissances acquises en Économie politique n'a pu opérer qu'avec une excessive lenteur. Aussi notre pays est-il au rang de ceux où ces connaissances sont le moins répandues, non-seulement parmi les masses populaires, mais dans les classes plus ou moins lettrées, où le grand nombre n'a aucune notion de cette science et ne se doute seulement pas de l'importance des problèmes qu'elle est appelée à résoudre. Cependant les études qu'elle embrasse sont assurément, de tous les travaux de l'esprit, ceux qui devraient le plus généralement exciter l'intérêt ; car leurs résultats sont destinés à exercer sur le sort des populations l'influence la plus considérable et la plus salutaire : aucun autre ordre d'études ne saurait offrir aux sociétés autant de lumières propres à les guider dans les voies d'une civilisation réelle, et à leur faire éviter celles qui conduisent à la décadence et à la ruine.
L'histoire de nos révolutions politiques depuis soixante ans est pleine d'enseignements de nature à confirmer la vérité de ces assertions. Assurément, chez un peuple moins étranger que le nôtre aux vérités économiques, l'état de l'opinion n'aurait pas permis d'égarer l'activité nationale dans les voies rétrogrades et ruineuses où elle s'est laissé si souvent entraîner à partir de 1793; si l'opinion générale eût été moins arriérée ou moins faussée sous ce rapport, l'essor libéral et vraiment civilisateur de 1789 ne se serait point fourvoyé dans les folles ou déplorables directions où il ne tarda pas à s'engager; on n'aurait pas vu, par exemple, une nation qui voulait fonder son existence sur le travail libre s'efforcer de se donner les opinions et les mœurs d'antiques sociétés, qui fondaient la leur sur la guerre, la spoliation et l'esclavage; plus tard, les dispositions guerrières qu'avait provoquées le besoin de la défense nationale, n'auraient pas dégénéré en esprit de conquête et de domination; nous ne nous serions point engoués de cette gloire militaire qui consiste dans le succès obtenu par les armes, quel qu'en soit le but et dût-il en résulter un pas en arrière vers la barbarie; sentiment sauvage et aveugle dont l'exaltation a, plus que toute autre cause, retardé les progrès moraux et politiques de l'Europe; nous n'aurions pas vu les lois de maximum, rémission désordonnée des assignats, le système continental, le commerce par licences, etc., et toute cette suite de mesures désastreuses ou absurdes qui décélaient l'ignorance la plus complète des intérêts des sociétés, ou un souverain mépris pour ces intérêts. Mais recueil dont les lumières de l'Économie politique auraient pu surtout nous préserver si elles eussent été plus répandues, c'est l'établissement de ce système gouvernemental et administratif qui, multipliant les attributions de l'autorité publique au point de tout subordonner à ses directions, semble vouloir anéantir l'initiative et la puissance individuelles pour ne laisser subsister que la puissance collective; système qui, n'ayant cessé de s'aggraver depuis trente ans, tend à substituer de plus en plus l'activité nuisible à l'activité utile, en détournant les facultés et les efforts d'un nombre toujours croissant d'individus , de l'exploitation des choses vers celle des hommes eux-mêmes; qui, en chargeant nos gouvernements d'une responsabilité aussi illimitée que leurs attributions, devient la cause principale de leur instabilité et de l'insécurité qui en est la suite; [xii] qui, enfin, a paru sur le point d'atteindre dans ces derniers temps son extrême limite, en présentant comme une question à résoudre l'accaparement de tous les travaux par l'État et l'avènement d'un communisme universel.
Et il ne faudrait pas croire que ces dernières aberrations économiques fussent le résultat d'une ignorance particulière aux sectes socialistes : sous ce rapport, les partis se disant conservateurs ne se sont pas montrés plus généralement éclairés. S'ils ont résisté aux tendances qui poussaient à convertir les travaux restés plus ou moins libres en services publics, à étendre encore les régies gouvernementales, à affaiblir de plus en plus l'initiative et la responsabilité individuelles, ce n'est pas que le système en lui-même leur inspirât aucune répugnance, ni que leurs opinions fussent basées sur des principes fort différents de ceux de leurs adversaires; car ils avaient admis ou professé avant ces derniers que l'intervention de l'État n'a pas de limites assignables, et qu'il appartient aux gouvernements de diriger l'activité sociale dans tous ses développements; seulement, en adoptant ce pernicieux principe, ils entendaient rester seuls maîtres d'en déterminer les applications. Toutefois, et pour le besoin du moment, ils s'appuyaient alors volontiers sur les vérités proclamées par l'Économie politique; ils professaient avec elle qu'il n'y a de production féconde et de répartition équitable des produits que dans la liberté du travail et des transactions ; que chacun doit avoir la responsabilité de son sort, et que, si les instincts du cœur comme les lumières de la raison commandent d'aider les malheureux autant qu'on le peut, nul n'a le droit de se décharger sur autrui du soin de se procurer du travail ou des moyens d'existence; que l'autorité publique a pour mission de protéger la personne, la liberté et les biens de tous, mais qu'il ne saurait lui appartenir de disposer des facultés de chacun et de ce qu'elles produisent, de prendre aux uns pour donner aux autres, de soustraire, de par la loi, les paresseux, les dissipateurs, les parasites, aux mauvaises conséquences de leur conduite, pour faire retomber ces conséquences sur ceux qui suivent une conduite opposée.
Mais ces vérités si claires s'obscurcissaient tout à coup à leurs yeux dès qu'il s'agissait d'en faire la moindre application aux abus constitués. S'ils se déclaraient partisans de la liberté du travail, c'était sous condition de ne pas toucher au régime qui exclut cette liberté d'une multitude de professions monopolisées ou réglementées. S'ils n'admettaient pas que l'État dût prendre aux uns pour donner aux autres, ils n'en étaient pas plus disposés à tolérer que l'on contestât la légitimité des subventions des primes, des garanties exceptionnelles accordées sur les produits des contributions publiques à un grand nombre d'entreprises jouissant de leur appui à un titre quelconque. S'ils flétrissaient les parasites, c'était sans préjudice du parasitisme dévorant qu'ils avaient eux-mêmes créé en poussant à l'exagération des attributions et des dépenses gouvernementales. S'ils s'élevaient fortement contre la prétention de l'autorité du moment de diriger l'application des fonds productifs du pays et d'empêcher chacun de disposer librement de ses facultés et des fruits de son travail, ils ne défendaient pas avec moins d'énergie la législation commerciale qui, au moyen des prohibitions douanières et des droits prohibitifs, produit précisément ces deux résultats.
Ainsi les uns réclamaient les privilèges, les secours et les largesses de l'État en faveur des classes ouvrières dans lesquelles ils cherchaient un appui; les autres n'en voulaient que pour ceux qui se trouvaient nantis. L'Économie politique n'en aurait voulu pour personne, l'une de ses conclusions étant qu'il faut laisser à chacun ce qui lui appartient et ne jamais se servir de l'autorité ou de la loi pour [xiii] dépouiller les uns au profit des autres. Très-hostile aux spoliations légales, sous quelque forme qu'elles se déguisent et sous quelque drapeau qu'elles s'abritent, elle devait déplaire à la fois à tous ceux qui s'en disputent le bénéfice; aussi a-t-elle été successivement proscrite par les deux camps opposés. Après la tentative faite en 1848 pour subordonner son enseignement au point de vue de l’organisation (arbitraire) du travail, est venue, en 1850, celle d'un conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, qui prétendait imposer aux professeurs d'Économie politique l'obligation de coordonner leurs leçons au point de vue de la législation commerciale actuelle de la France, c'est-à-dire de manière à justifier le système protecteur ou prohibitif.
Mais l'Économie politique ne doit être enseignée qu'à un seul point de vue, celui de la nature des choses exactement observée, et il est bien évident que l'on ne pourrait imposer d'autres bases à son enseignement sans en faire tout autre chose qu'une science : car les sciences ne comportent pas de conclusions préconçues; celles auxquelles elles arrivent ne sont que des résultats de la connaissance des faits et de leurs rapports. Il ne serait assurément pas plus absurde d'exiger que l'astronomie fût enseignée au point de vue du système de Ptolémée, que de prétendre faire servir l'enseignement de l'Économie politique à la justification du système protecteur ou de tout autre système arrêté d'avance et indépendamment des résultats de l'observation.
III.
Parmi les formes diverses que peut comporter l'exposition de l'Économie politique, celle du Dictionnaire paraît des plus favorables à la propagation rapide de ses principales notions. Il est un grand nombre d'individus, appelés à s'occuper d'intérêts publics ou collectifs, qui, pour remplir leur mission le mieux possible, trouveraient dans les notions dont il s'agit de précieuses directions, et qui néanmoins s'abstiennent de les acquérir, parce qu'ils ne le pourraient qu'en consacrant beaucoup de temps et d'attention à l'étude des traités méthodiques. Un Dictionnaire complet et bien conçu, en leur permettant de fractionner cette étude, de choisir à volonté les questions auxquelles la marche des affaires ou des événements viendrait imprimer un intérêt d'opportunité, pourra les initier peu à peu aux vérités économiques et leur inspirer le désir d'en connaître l'ensemble.
D'un autre côté, ceux qui se sont livrés à cette étude sans en faire une occupation constante, ou sans y revenir fréquemment, conservent difficilement le souvenir de tous les principes et de leur enchaînement, en sorte qu'ils sont parfois embarrassés en présence de difficultés ou d'objections qui n'ont le plus souvent aucune importance réelle. Le secours d'un Dictionnaire pourra leur permettre de ressaisir promptement les notions nécessaires aux solutions cherchées.
Un semblable ouvrage nous parait donc susceptible d'être plus souvent consulté que les traités méthodiques et de recevoir ainsi une utilité plus usuelle et plus générale. Mais était-il possible, dans l'état actuel de la science, de faire un bon Dictionnaire d'Économie politique? La tentative n'était-elle pas prématurée? Les travaux antérieurs sur cette matière ont-ils constitué un ensemble de principes suffisant pour expliquer toute la série des phénomènes économiques et résoudre théoriquement [xiv] les nombreuses questions qui s'y rattachent? Chaque principe et chaque solution ont-ils été amenés au degré d'évidence nécessaire pour que l'on puisse les exposer avec la concision que réclame la forme du Dictionnaire? Nous espérons qu'au jugement des hommes compétents, l'ensemble de l'œuvre collective que nous publions paraîtra répondre d'une manière satisfaisante à ces questions. Malheureusement les juges véritablement compétents en Économie politique sont peu nombreux, et le sont moins encore en France que dans plusieurs autres pays. Cette science n'est guère connue de la plupart de nos hommes d'État, de nos administrateurs, de nos publicistes, que par les attaques intéressées ou inintelligentes dont elle a été l'objet depuis vingt ans. Ils partagent d'ailleurs généralement les préventions soigneusement entretenues contre elle par toutes les cupidités qui croient avoir quelques raisons de redouter sa lumière, et, lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à la proscrire comme une utopie dangereuse, ils se plaisent à la classer au nombre des systèmes purement hypothétiques. Les moins hostiles, sans contester la vérité de ses théories, lui dénient toute portée pratique. Quelques-uns cependant veulent bien accorder que plusieurs de ces théories devront être appliquées un jour; mais ils reculent l'époque de leur application à un point décourageant pour les générations actuelles, et cela non-seulement pour laisser à l'opinion générale le temps de se modifier dans le sens des réformes à accomplir, mais parce qu'un ajournement à long terme leur semble nécessaire pour compléter et mieux assurer les bases de la science, qui ne leur paraissent pas encore suffisamment établies.
Malgré le respect que nous inspirent les fondateurs de l'Économie politique, nous sommes loin de penser que de nouvelles investigations ne puissent ajouter à l'utilité de leurs travaux, ou même rectifier ce qu'il peut y avoir eu d'incomplet ou d'erroné dans quelques-unes de leurs vues. Comme toutes les autres branches des connaissances humaines, l'Économie politique est indéfiniment perfectible; mais nous avons la conviction qu'elle est aujourd'hui assez avancée pour ne laisser sur ses principes essentiels aucun doute légitime, et que les vérités exprimées par ces principes ne seront pas plus ébranlées par les recherches ou les découvertes ultérieures que ne l'ont été les éléments de la géométrie ou les lois de la gravitation universelle par les travaux de Lagrange ou de Laplace. Nous croyons pouvoir affirmer que, de toutes les sciences qui ont l'homme ou les sociétés pour sujet, l'Économie politique est la plus positive et la moins incomplète; qu'elle est incomparablement plus avancée que la politique proprement dite, plus que ce que l'on enseigne de nos jours sous le nom de philosophie, plus encore que les sciences de la législation et de la morale, et que sans elle on ne peut faire ni politique, ni philosophie, ni législation, ni morale utiles et vraies.
On signale dans les écrits des Économistes certaines dissidences que l'on exagère autant que possible afin d'en conclure que rien dans leurs principes n'est suffisamment arrêté; mais on s'abstient de rappeler la foule des vérités sur lesquelles ils s'accordent absolument. Ou bien, pour trouver des contradicteurs, on accorde complaisamment la qualification d'Économistes à des écrivains qui n'y ont aucun titre; on s'abstient encore de remarquer, qu'il n'est pas une seule science qui n'ait été, même les mathématiques pures, et ne soit encore à quelques égards l'objet de dissentiments plus ou moins profonds entre ceux qui s'en occupent. Les différents ordres de faits ou de phénomènes qu'embrassent respectivement la géologie, la physique, la zoologie, la chimie, etc., n'ont-ils pas été, sur plusieurs points, appréciés diversement par les savants qui les ont observés? et s'est-on jamais avisé de conclure de ces dissidences que les sciences dont il s'agit [xv] étaient problématiques et sans principes certains? D'où vient donc que l'Économie politique, tout aussi riche qu'elles en vérités constatées, n'obtient pas à beaucoup près le même crédit? Cela tient surtout à deux causes qu'il importe de rappeler.
En premier lieu, les principaux objets des études économiques, — le travail, l'échange, la valeur, le capital, etc., étaient le sujet des préoccupations universelles longtemps avant que la science fût fondée, et la généralité des hommes s'en occupe encore aujourd'hui sans comprendre le besoin de ses directions; il est donc tout simple qu'un grand nombre de personnes aient pu se croire compétentes pour se former une opinion sur toutes les questions que peuvent soulever des objets qui leur sont aussi familiers. Or ces opinions, basées sur des vues trop incomplètes des phénomènes économiques, de leurs conséquences plus ou moins éloignées et des rapports qui les lient entre eux, devaient le plus souvent s'écarter des vérités qu'une étude approfondie et généralisée peut seule permettre de saisir; mais une fois adoptées, elles n'en ont pas moins résisté aux démonstrations scientifiques avec la ténacité ordinaire des préjugés.
En second lieu, la législation économique des sociétés s'étant formée en l'absence de toute véritable notion scientifique, et en conformité des préjugés régnants, la science n'a pu découvrir et dénoncer les vices de cette législation sans alarmer de nombreux intérêts, légalement fondés sur l'erreur ou l'injustice.
L'Économie politique devait donc réunir contre elle, indépendamment des opinions préconçues, l'hostilité active et persévérante des intérêts illégitimes qu'elle peut menacer: tels sont les principaux obstacles qui, en entretenant parmi nous les doutes réels ou affectés sur la certitude ou l'efficacité de ses principes, retardent la propagation et par suite l'application des salutaires vérités qu'elle a mises en lumière.
Mais ces obstacles s'affaibliront. Les intérêts injustement fondés que l'Économie politique peut alarmer sont infiniment moins nombreux et moins importants dans leur masse que les intérêts légitimes qu'elle est destinée à servir : à mesure que ceux-ci s'éclaireront davantage, ils lui prêteront un appui plus énergique, et un jour viendra où elle acquerra par ce concours une force irrésistible.
Ce jour est déjà venu pour l'Angleterre, où les principales vérités économiques ont pénétré dans l'opinion des masses, et où elles sapent et démolissent avec une facilité inespérée des abus qu'avaient enracinés des habitudes séculaires et que soutenaient des intérêts puissants.
Aux États-Unis, le profond bon sens de Franklin et des autres fondateurs de l'Union avait pour ainsi dire devancé les théories économiques. Les institutions de ce pays, — à part celles des États où l'esclavage est encore admis, — semblent avoir été inspirées par les plus saines doctrines de la science ; aucune autre nation n'a su renfermer aussi complètement l'action de l'autorité publique dans ses limites rationnelles, ni fonder des institutions qui laissent autant de liberté au travail et aux transactions et qui protègent aussi bien les développements de l'activité utile, en donnant aussi peu de prise ou d'aliment à l'activité nuisible.
L'opinion publique, au surplus, commence à se prononcer dans le même sens en Belgique, en Piémont, dans plusieurs parties de l'Allemagne et de l'Italie; l'enseignement de l'Économie politique y a une place notable dans l'instruction publique. Il en est de même en Espagne et en Russie. La France est de tous les États de l'Europe celui qui, dans les vingt dernières années, a le moins participé à ce mouvement civilisateur; mais elle y sera entraînée, plus tôt peut-être que ne le pensent ceux qui s'efforcent de la maintenir au dernier rang sous ce rapport, par l'exemple des nations plus avancées ou par l'excès même des abus dont elle subirait les [xvi] conséquences si elle persistait longtemps encore à lutter aussi imprudemment qu'elle l'a fait jusqu'ici contre les vérités économiques.
IV.
Afin de justifier ce que nous avons dit du degré d'avancement de l'Économie politique et de la grandeur de sa mission, nous allons rappeler quelques-unes des vérités qu'elle enseigne, sans toutefois nous écarter de la ligne des considérations générales, et en nous abstenant de développements qui ont leur place dans les articles de ce Dictionnaire.
Si la création terrestre fût restée dans son état primitif, les hommes n'auraient pu ni se multiplier, ni progresser dans aucun sens : ils ne formeraient que de faibles peuplades dispersées dans les forêts et vivant de proie à la manière de diverses espèces d'animaux; peut-être même auraient-ils fini par disparaître devant les difficultés exceptionnelles de leur existence originaire. Mais ils avaient été doués d'une merveilleuse faculté, celle d'agir sur la plupart des êtres de la création de manière à les approprier de plus en plus à leurs besoins ; et c'est par l'exercice de cette faculté, par les prodigieux développements qu'avec le temps elle a reçus de l'accumulation des moyens de travail et des découvertes successives de l'intelligence, que notre race est véritablement devenue maîtresse du globe, qu'elle a pu couvrir de ses essaims toutes les contrées habitables, et élever les conditions de son existence physique, intellectuelle et morale à la hauteur où nous les voyons aujourd'hui chez les nations les plus avancées.
C'est cette puissante faculté que désigne, en Économie politique, le mot industrie; l'exercice de l'industrie est indiqué par le mot travail; les résultats du travail, consistant en utilités de toute espèce applicables à nos besoins, se nomment produits, et les produits, conservés ou accumulés, composent les richesses.
Bien que les richesses n'aient jamais cessé d'être ardemment recherchées, les travaux qui les créent sont loin d'avoir toujours été honorés par l'opinion. Les peuples les plus fameux de l'antiquité, et ceux-là même que notre enseignement public offre encore pour modèles à la jeunesse des écoles, ont longtemps jugé incomparablement plus noble et plus méritoire de dépouiller les travailleurs des richesses qu'ils avaient produites, que de s'appliquer eux-mêmes à leur production. Ces peuples n'estimaient que les occupations stériles ou spoliatrices, et principalement celles que comportent la guerre et l'exercice de la domination ; quant aux travaux producteurs, ils étaient généralement l'objet de leur dédain, et rien ne leur semblait plus avilissant que de s'y livrer. Ce singulier mépris de l'emploi de la plus haute et de la plus admirable de nos facultés s'est maintenu à travers les siècles, en s'affaiblissant peu à peu, jusqu'à des temps voisins du nôtre, et il n'est point encore entièrement effacé chez toutes les classes des populations européennes.
Il appartenait à l'Économie politique de réhabiliter complètement le travail producteur; et elle l'a fait de la manière la plus éclatante, en démontrant, d'une part, qu'il est la source de toutes les richesses, le véritable fondement de l'existence des sociétés, l'agent principal de la civilisation, la condition essentielle de tout progrès, de toute prospérité; d'autre part, que c'est à lui désormais que les populations [xvii] intelligentes devront attacher l'estime et la considération usurpées par l'activité spoliatrice, et qu'elles ne sauraient trop s'appliquer à distinguer celle-ci sous les formes diverses qu'elle emprunte, afin de la flétrir de tout le mépris, de toute la honte qu'elle a si longtemps déversés sur l'activité productive.
Nous avons dit que l'un des objets de l'Économie politique était de faire connaître les conditions sociales favorables ou nuisibles à la fécondité de la production et à l'équitable répartition des richesses. Or ces conditions se rapportent principalement, soit au degré de liberté assuré a l'industrie par les institutions, soit à la manière dont le produit général du travail est distribué. Nous allons indiquer sommairement les conclusions de la science sur ces deux points fondamentaux.
En premier lieu, la liberté du travail et des transactions est une des conditions essentielles de la fécondité de la production : d'une part, parce qu'elle laisse à chacun la faculté de suivre les inspirations de son intérêt personnel dans le choix du genre d'occupation auquel sa position, ses goûts ou ses aptitudes particulières lui permettent de se livrer avec le plus de fruit, et que, tout bien considéré, l'intérêt personnel est généralement en ceci le guide le plus sûr ou le moins faillible; d'autre part, parce qu'elle maintient dans toutes les branches du travail producteur une concurrence aussi étendue que la nature des choses peut le comporter, et que la concurrence est incontestablement le stimulant le plus puissant de l'activité et du perfectionnement des travaux.
Tout ce qui, dans les institutions sociales, restreint cette liberté est par conséquent nuisible à la fécondité de la production, et tel est le caractère que l'on peut sûrement assigner, par exemple, aux monopoles légaux réservant soit à des corporations privilégiées, soit aux gouvernements, la faculté exclusive d'exercer certains travaux ou professions; — aux règlements par lesquels l'autorité publique prétend diriger la marche de certaines branches d'activité productive; — aux restrictions légales apportées à la faculté d'échanger et qui restreignent nécessairement, en même temps, la faculté de travailler, etc.
En second lieu, nos facultés industrielles variant en nature et en puissance d'un individu à l'autre et leur fécondité étant généralement proportionnée à l'activité de leur application, cette activité ne pouvant avoir de mobile plus puissant que l'intérêt personnel, il est facile de concevoir que le seul mode de distribution juste et efficace des utilités qu'elles produisent consiste simplement à laisser et à garantir à chacun la jouissance et la libre disposition, ou en d'autres termes la propriété, du fruit de ses travaux.
Toute perturbation apportée dans cette distribution naturelle des produits, soit par la violence, soit par la fraude, soit par le défaut de lumières, constitue une évidente injustice, puisqu'elle prive les uns de ce qu'ils ont produit pour l'attribuer à d'autres ; en même temps elle diminue l'étendue ou la sécurité des jouissances qui sont le but général de tous les efforts, d'où résulte inévitablement une réduction dans l'activité et dans la puissance des facultés productives.
Pour que la propriété puisse se former et les richesses s'accroître, le travail ne suffit pas, car ses résultats peuvent être plus ou moins rapidement consommés; il faut y joindre l'épargne, que l'on ne saurait provoquer sans garantir à chacun, non-seulement la jouissance personnelle, mais l'entière et libre disposition de ce qu'il a produit, comprenant avant tout la faculté de le transmettre à ses enfants, à sa famille, aux personnes qui lui sont chères. Sans cette condition, les stimulants [xviii] du travail perdraient considérablement de leur énergie et les accumulations seraient incomparablement moins importantes; chacun se trouverait excité à consommer pendant sa vie tout ce qu'il aurait pu acquérir; les générations se succéderaient sans que l'une transmit à l'autre aucune réserve agrandie; les anciennes accumulations tendraient, au contraire, à se réduire de plus en plus, et l'industrie, bientôt privée de capitaux, deviendrait impuissante.
A la vérité, cette faculté de transmission des propriétés amène, avec le temps, de nombreuses inégalités dans la position des familles. Mais lorsque la propriété et les libertés productives sont complètement garanties, l'inégalité des fortunes ne peut provenir, sauf de rares exceptions, que de l'inégalité des productions et des accumulations dues à ceux qui les possèdent; elle n'est ainsi que la consécration de la justice : les familles qui, pendant deux ou plusieurs générations, auront apporté dans toute leur conduite une activité bien dirigée, une prévoyance éclairée, une sage économie, sont justement récompensées par l'aisance à laquelle elles parviennent ainsi; celles qui suivent une conduite opposée et dont les membres s'abandonnent à la paresse, à l'intempérance, aux diverses habitudes vicieuses, sont justement punies par la misère qui finit inévitablement par les atteindre, et de laquelle il importe qu'elles ne puissent se relever qu'à force de se bien conduire. Il est utile, indispensable au perfectionnement de la vie humaine qu'il en soit ainsi, et un régime social qui, soit pour maintenir la prééminence de certaines classes de la population sur toutes les autres, soit pour établir entre toutes les classes une égalité forcée, empêcherait les conséquences naturelles des bonnes et des mauvaises habitudes de retomber principalement sur ceux qui s'y livrent serait également funeste dans les deux cas.
L'expérience confirme pleinement ces résultats théoriques. L'histoire de tous les temps et de tous les peuples prouve que les sociétés sont d'autant plus prospères et plus perfectionnées qu'elles garantissent mieux, par leurs mœurs et par leurs institutions, les libertés productives et la propriété contre les atteintes infiniment variées dans leurs formes qui peuvent leur être portées par l'activité spoliatrice. C'est là la principale condition à laquelle paraît avoir été lié jusqu'ici le sort des populations ; celles qui l'ont le mieux observée sont les plus avancées sous tous les rapports essentiels ; celles qui l'ont le moins respectée sont les plus arriérées et les plus misérables. Si quelques peuples anciens ont pu obtenir passagèrement un certain degré de prospérité matérielle en s'écartant de cette condition, en fondant leur existence sur la guerre, la rapine ou l'esclavage; si, au sein même de chaque nation, certaines classes ont pu s'organiser de manière à asservir les autres et à vivre à leurs dépens, ce n'a été qu'en faisant le malheur du grand nombre, en soulevant des haines générales, et en développant parmi les populations ou les classes dominatrices une corruption qui a toujours entraîné leur déchéance et leur ruine.
D'un autre côté, les tentatives faites pour maintenir parmi les sociétés humaines une égalité factice fondée sur des communautés de travaux et de biens, ont toutes misérablement échoué, parce que, ne tenant pas compte des inégalités naturelles qui existent entre les hommes, et traitant les facultés supérieures à l'égal des plus infimes, elles ont détruit le stimulant indispensable de l'intérêt personnel et abaissé toutes les activités au niveau des moins intelligentes et des moins fécondes.
« Les maux qui pèsent sur une nation, a dit à ce sujet le profond publiciste que nous avons déjà cité, sont donc toujours également graves, soit qu'une partie de la population s'approprie les produits des travaux de l'autre, soit que les [xix] individus dont elle se compose aspirent à établir entre eux une égalité de biens et de maux. Il résulte de là que l'inégalité entre les individus dont un peuple se compose est une loi de leur nature; qu'il faut, autant qu'il est possible, éclairer les hommes sur les causes et sur les conséquences de leurs actions; mais que la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre les fruits de ses vertus ou de ses travaux. » [8]
Les lumières de l'Économie politique ont seules pu compléter les connaissances nécessaires à cette importante démonstration, et elles ont en même temps fourni une foule de notions indispensables pour reconnaître à travers toutes les complications sociales, dans les institutions, les lois, les actes privés ou collectifs, l'existence, souvent dissimulée et parfois difficile à dévoiler, de cette activité perverse qui s'applique sans cesse à s'approprier les fruits de l'activité productive.
L’une des parties les plus positives et les plus utiles de l'Économie politique est celle qui rend compte des phénomènes sociaux par lesquels s'accomplit l'échange général des produits ou des services.
Il est assez connu que la division ou plutôt la spécialisation des professions ou des travaux est une des causes principales de la puissance de l'industrie, qui, sans cette condition, serait tout à fait hors d'état de pourvoir aux besoins si nombreux et si divers des sociétés civilisées. Or cette condition oblige chaque travailleur à s'adonner à la production d'objets uniformes, alors que ses besoins réclament des produits variés, et elle entraîne ainsi la nécessité de l'échange.
A l'état rudimentaire, l'échange consiste dans le troc direct des objets les uns contre les autres; mais l'inefficacité de ce mode se manifeste à mesure que les besoins se développent et que les objets à échanger se multiplient et se spécialisent davantage. Les populations sentent alors la nécessité d'adopter un intermédiaire uniforme et dont les qualités soient telles que chacun se montre disposé à l'accepter comme équivalent dans les transactions; cet intermédiaire, quelle qu'en soit la nature, constitue la monnaie dès qu'il est généralement admis. Les monnaies formées d'or et d'argent sont devenues d'un usage universel; la longue habitude de tout évaluer par elles, d'y voir l'équivalent de tous les produits, les a fait considérer pendant longtemps comme la richesse par excellence, ou même comme l'unique richesse, et de là sont nés une multitude de préjugés et d'erreurs qui, par suite du défaut de vulgarisation des notions de l'Économie politique, tiennent encore une grande place dans l'opinion générale.
C'est sur cette fausse idée de la richesse que l'on a fondé l'opinion, encore admise par un grand nombre de publicistes et d'hommes d'État, que les impôts ne sauraient être une cause d'appauvrissement pour le pays qui les supporte, par la raison que l'argent perçu est rendu au pays par les dépenses des gouvernements ; c'est le même préjugé qui fait encore écrire tous les jours que l'achat des produits exotiques constitue un tribut payé à l’étranger. La même erreur sert aussi de fondement au système de la balance du commerce, suivant lequel chaque peuple aurait à considérer [xx] comme un gain l'excédant de ses exportations sur ses importations, tandis qu'il devrait compter comme une perte tout surplus dans les valeurs importées sur celles exportées, attendu que dans les deux cas la différence étant probablement soldée en monnaie, et la monnaie étant supposée la seule richesse, peut seule constituer la perte ou le gain.
Rien n'est plus rigoureusement exact que les démonstrations de l'Économie politique sur ces différents points; elle a fait voir clairement que l'or et l'argent, loin de composer toute la richesse, n'en constituent partout qu'une très-faible partie (ils ne forment probablement pas le cinquantième de la masse totale des valeurs accumulées). La valeur des monnaies est due, au surplus, comme celle de tout autre produit, à leur utilité d'abord, comme moyen de faciliter les échanges, et ensuite aux frais qu'il faut faire pour les obtenir. La quantité de monnaie contre laquelle s'échange couramment un hectolitre de blé a autant de valeur que cette quantité de blé; mais elle n'en a pas davantage, et rien n'autorise à penser que l'une de ces valeurs soit plus précieuse que l'autre. Il y a même de fortes raisons de croire que, pour un peuple considéré dans son ensemble, les accumulations de richesse sous forme de monnaie sont moins avantageuses que sous toute autre forme. Car la monnaie se distingue essentiellement de tous les autres produits en ce qu'elle sert à nos besoins, non point, comme ces derniers, proportionnellement à sa quantité, mais uniquement en raison de sa valeur ; or la valeur de la monnaie s'abaisse nécessairement dans tout pays où sa quantité est considérablement accrue. Il n'y a donc aucun motif raisonnable pour engager un peuple à préférer la monnaie à tous autres produits de même valeur. —Il est aussi absurde de dire que nous payons tribut aux étrangers en leur achetant des produits, qu'il le serait de considérer le consommateur de pain comme tributaire du boulanger et celui-ci comme tributaire du marchand de farine. Le système de la balance du commerce n'est pas autre chose qu'une sottise; car il est ridicule de prétendre qu'une nation perd lorsque dans son commerce avec les étrangers elle reçoit plus de valeurs qu'elle n'en livre en échange, et qu'elle gagne, au contraire, lorsqu'elle livre plus en échange de moins. Les différences entre les valeurs importées et exportées sont généralement compensées entre les diverses nations par l'application de la dette des unes au payement de la créance des autres au moyen des lettres de change, et il arrive rarement qu'il y ait des soldes considérables à fournir en monnaie; mais, alors même qu'il en serait autrement, on ne pourrait en tirer aucune induction quant au gain ou à la perte donnée par les opérations. Il est fort probable que, si les états des douanes donnaient exactement les valeurs importées et exportées, ils présenteraient partout des excédants d'importation, attendu que ces excédants sont indispensables pour fournir les profits des négociants, qui ne tarderaient pas à abandonner le commerce s'il ne donnait pas plus de profits que de pertes. — Enfin les contribuables ne sauraient admettre sans un excès de niaiserie que les gouvernements leur restituent les impôts en en dépensant le montant, attendu que, si l'argent prélevé pour ces dépenses est reversé dans le pays, ce n'est qu'en échange de produits ou de services dont la valeur est ou doit être la même.
Les indications de la science ne sont pas moins sûres en ce qui concerne l'usage des billets de banque remplissant jusqu'à un certain point l'office de monnaie. Elle montre que ces billets, n'étant pas autre chose que des titres de créance, n'ajoutent absolument rien aux richesses existantes, et que leur unique fonction consiste à faire passer la faculté de disposer d'une portion de ces richesses d'une personne à une autre. Cette fonction est aussi celle de la monnaie métallique; mais il y a entre [xxi] celle-ci et les billets de banque, ou autres titres de même nature, cette différence essentielle que la monnaie d'or ou d'argent porte en elle-même le gage de sa valeur, tandis que le gage que les billets représentent ou sont censés représenter peut ne pas exister. Il reste vrai toutefois que, lorsque ceux-ci sont généralement acceptés avec confiance, ils suppléent plus ou moins à la monnaie réelle, et peuvent ainsi procurer une économie importante de métaux précieux, en même temps qu'ils constituent un instrument d'échanges d'un très-facile emploi.
Mais ces avantages sont chèrement achetés toutes les fois que l'émission des billets n'est pas sagement mesurée et que leur remboursement en monnaie métallique à toute réquisition n'est point suffisamment assuré. Il en résulte alors une extension exagérée et dommageable du crédit. Celui dont jouissent les banques, poussé à se répandre par la facilité de multiplier les escomptes en multipliant les émissions, passe avec leurs billets à une multitude de personnes qui n'en obtiendraient pas autrement et qui s'en servent le plus souvent, non pour créer, mais pour dissiper des richesses. Il en résulte encore que l'abondance progressive de cet intermédiaire des échanges le déprécie de plus en plus, bien que les billets conservent la même valeur nominale, ce qui entraîne une hausse factice dans le prix des produits et des services, et de désastreuses perturbations dans toutes les transactions, au moins lorsque les billets ont un cours forcé.
En exposant ces principes, l'Économie politique ne tend nullement à proscrire un convenable emploi des titres dont il s'agit, comme moyen de faciliter les échanges et le crédit; elle a pour objet de prémunir les populations contre les dangers d'un emploi exagéré ou imprudent, et contre les illusions auxquelles elles se laissent trop souvent entraîner à cet égard.
Après avoir ainsi fait connaître la nature et les véritables fonctions des monnaies ou de leurs signes représentatifs, il restait à l'Économie politique, pour donner une intelligence complète des lois naturelles sous l'action desquelles s'opère l'échange général des produits ou des services, à assigner les conditions qui déterminent le taux de la valeur de chacun d'eux, et elle est encore parvenue à poser sur ce point des principes certains.
Tous les objets de nos besoins ne sont pas susceptibles d'être échangés. Il en est un grand nombre, tels que la lumière et la chaleur du soleil, l'air respirable, etc., que la nature fournit à tous et dont nous jouissons sans efforts et sans avoir rien à céder en retour ; tandis que les autres, ne pouvant être obtenus qu'à l'aide des facultés ou des efforts personnels, constituent des propriétés privées qui, hors les cas de donation, de succession, etc., ne se cèdent pas volontairement pour rien. La qualité qui distingue les objets échangeables de ceux qui ne le sont pas est, ce que l'on entend en Économie politique par le mot valeur. La valeur est plus ou moins grande dans les différents objets, et elle peut se mesurer dans chacun d'eux par la quantité de tout autre objet valable qu'il peut faire obtenir en échange. La monnaie étant l'intermédiaire général des échanges, le taux de la valeur de chaque produit ou de chaque service s'exprime ordinairement par une quantité de monnaie déterminée, et cette expression du taux de la valeur par la monnaie se nomme prix.
En général, la différence de prix entre deux objets valables d'espèces diverses provient de la différence de leurs frais de production, c'est-à-dire de la différence entre les valeurs des services ou des produits qu'il a fallu consacrer à la création de chacun d'eux. On comprend qu'en admettant une entière liberté de travaux et de transactions, le prix d'une espèce d'objets ne pourrait longtemps se maintenir fort [xxii] au-dessus des frais de production, parce que l'avantage exceptionnel qu'on trouverait à les produire amènerait une concurrence qui ferait bientôt baisser les prix; et, d'un autre côté, il est bien évident qu'une production qui ne donnerait que de la perte ne serait pas longtemps continuée dans de telles conditions; sa quantité serait réduite jusqu'à ce que les prix eussent été relevés tout au moins au niveau des frais.
Ces conditions sous-entendues, le prix courant des produits ou des services dépend du rapport existant entre les quantités offertes et demandées de chacun d'eux : si l'offre augmente plus que la quantité demandée, le prix s'abaisse; si la demande s'accroît dans une proportion plus forte que la quantité offerte, le prix s'élève.
Telle est la loi générale qui préside à la détermination du taux respectif de la valeur de produits ou de services différents.
Cette loi permet au travail libre de maintenir — beaucoup mieux que ne saurait le faire aucun régime arbitraire — dans chacune des branches si multipliées et si diverses de l'activité industrielle une constante proportionnalité entre la quantité de chaque classe de produits et l'étendue du besoin qui la réclame, ou de la demande que l'on en fait. Car, si la demande est dépassée par la quantité produite, la surabondance est aussitôt signalée par l'abaissement du prix, et alors la production se restreint; et si, au contraire, celle-ci ne suffit pas à l'étendue delà demande, l'élévation du prix signale cette insuffisance et amène bientôt un accroissement dans la quantité produite.
Il résulte encore de cette loi que le prix des services industriels s'abaisse inévitablement si ces services sont plus offerts que demandés; et, comme les services les plus accessibles à la concurrence, les plus susceptibles d'être surabondamment offerts, sont en général ceux des ouvriers des classes les plus pauvres, l'Économie politique en conclut que ces ouvriers ont le plus grand intérêt à user de prudence et de retenue avant et pendant le mariage, pour ne pas accroître inconsidérément leur nombre, et par suite l'offre de services déjà trop dépréciés.
Une autre conséquence de cette loi féconde est que la multiplication des capitaux tend à abaisser le prix de leur service et à les rendre ainsi de plus en plus accessibles à ceux qui peuvent les employer reproductivement; et, comme le travail des ouvriers est d'autant plus demandé, par conséquent d'autant mieux payé que les capitaux sont plus abondants, l'Économie politique en conclut encore que les classes ouvrières sont puissamment intéressées à la multiplication des capitaux, et par suite à tout ce qui peut la favoriser : à l'activité et au progrès de l'industrie, à l'abondance des accumulations ou des épargnes, et surtout au maintien de la sécurité publique, condition indispensable de la conservation et de l'accroissement des capitaux.
L'une des plus belles et des plus solides théories qui soient sorties de l'étude des phénomènes sociaux par lesquels s'accomplit l'échange général des produits ou des services, est celle des débouchés, si admirablement formulée par J.-B. Say. Il résulte de cette théorie que ce qui s'échange en définitive, ce sont des produits contre d'autres produits ; par conséquent, tout produit est un moyen d'échange, un débouché pour les autres; d'où il suit que les débouchés sont d'autant plus étendus et d'autant plus avantageux pour chaque branche de travail en particulier que la production a été plus généralement abondante dans toutes les branches; d'où il suit encore que les industries diverses ont des intérêts solidaires, l'une d'elles ne pouvant être en état de prospérité ou de souffrance sans que les autres s'en ressentent plus ou moins. On sait, d'ailleurs, depuis longtemps que les campagnes sont [xxiii] intéressées à la prospérité des villes comme celles-ci le sont à la prospérité des campagnes, parce que les unes et les autres trouvent alors un placement plus facile et plus avantageux de leurs produits respectifs; mais les mêmes liaisons d'intérêt s'étendent à toutes les branches d'industrie, et elles se manifestent également dans les relations commerciales de nation à nation. Lorsqu'un peuple est en voie de progrès et de prospérité, tous ceux avec lesquels il est en position de faire des échanges en profitent, soit à cause de l'abondance des débouchés qu'il leur offre, soit par suite du bon marché des produits qu'il peut leur fournir; c'est ainsi que le développement prodigieux de l'Union américaine a profité à nos diverses branches d'industrie, au point que la ruine de ce pays, si elle était possible, serait aujourd'hui un véritable fléau pour une grande partie de notre population. Les nations sont donc solidaires dans la bonne comme dans la mauvaise fortune ; leur intérêt est d'accroître de plus en plus, en multipliant leurs échanges, les services qu'elles peuvent se rendre mutuellement, et non de chercher à s'affaiblir et à se nuire, comme une politique aveugle les y a poussées trop longtemps.
C'est en s'appuyant sur ces vérités, et en invoquant en même temps le respect dû à la propriété, que l'Économie politique réclame la liberté du commerce international, liberté qui aurait pour résultats de faire participer tous les peuples aux avantages naturels très-diversifiés que Dieu a inégalement répartis dans les différentes contrées du globe, d'étendre le réseau des intérêts qui lient déjà les nations civilisées, malgré tous les obstacles législatifs opposés à leurs relations, au point d'établir entre elles une solidarité aussi manifeste que celle qui unit les diverses provinces d'un même État, et de rendre les guerres internationales aussi impopulaires et aussi impraticables qu'elles le seraient aujourd'hui entre les diverses parties de la France.
L’Économie politique a perfectionné la morale en fournissant de solides bases d'appréciation pour un grand nombre de sentiments, d'actions et d'habitudes que le préjugé avait mal classés. Ce sont d'importants progrès en morale que la complète réhabilitation du travail producteur, et l'acquisition d'un ensemble de notions positives permettant de distinguer sûrement l'activité utile de l'activité nuisible et de faire à l'une et à l'autre la juste part qui leur revient dans l'estime publique. La démonstration de la solidarité qui unit les intérêts des diverses fractions du genre humain constitue encore un immense progrès moral; car, en faisant ressortir toute l'absurdité des haines et des rivalités nationales; en montrant que ce sont là des sentiments aveugles et indignes d'hommes civilisés , bien que l'ignorance et le charlatanisme politique les aient souvent décorés du nom de patriotisme, elle a considérablement affaibli dans l'esprit des classes les plus influentes les dispositions qui poussent à la guerre, et préparé ainsi pour l'avenir l'abandon du système des grandes armées permanentes, l'une des causes les plus puissantes de la misère des populations, et par conséquent de toutes les défaillances, de tous les désordres moraux que cette misère entraîne à sa suite. Un autre perfectionnement important que la morale devra aux lumières répandues par l'Économie politique, consiste dans les moyens que fournit celle-ci pour apprécier justement le mérite relatif des différents emplois que l’on peut faire de la richesse. C'est ainsi, par exemple, que [xxiv] la prodigalité et le faste, si souvent préconisés, parce qu'on les confondait avec la générosité ou le désintéressement, et surtout parce qu'on les supposait favorables à l'activité de l'industrie, ont été définitivement reléguées par les démonstrations économiques au nombre des habitudes funestes et par conséquent vicieuses ; tandis que l'économie, trop souvent, décriée comme un indice d'égoïsme ou d'avarice, et aussi parce que l'on supposait que les valeurs épargnées étaient un aliment enlevé au travail, a été définitivement rangée parmi les habitudes les plus utiles à l'humanité et par conséquent les plus vertucuses. L’Économie politique a rendu tout à fait évidente une vérité qui semble encore généralement ignorée de la plupart de nos hommes publics : c'est que l'habitude du faste ou des dépenses de luxe, bien loin de fournir plus d'aliments à l'industrie ou au travail, tend au contraire à la destruction, à l'anéantissement de ce qui peut les maintenir en activité; c'est qu'une valeur épargnée et consommée reproductivement dans une opération industrielle procure aux classes laborieuses infiniment plus de travail et de moyens d'existence que ne peut leur en offrir une valeur égale consommée improductivement dans un repas, un bal, une fête ou autre dépense du même genre : attendu que, dans le premier cas, la valeur consommée offre le même emploi aux travailleurs autant de fois qu'elle se reproduit, ce qui peut aller à l'infini ; tandis que, consommée improductivement, elle disparait pour toujours après avoir offert les mêmes moyens de travail une fois seulement.
Un des progrès les plus considérables que les sciences morales devront aux recherches des Économistes consiste dans le perfectionnement de la notion de la liberté.
La liberté est depuis longtemps l'objet des tendances d'une grande partie des populations européennes; mais elles la recherchent par une sorte d'instinct et sans discerner nettement ni ce qui la constitue, ni les conditions nécessaires à son maintien et à ses développements. Il était réservé à l'Économie politique de démontrer que la liberté est l'équivalent de la puissance effective, et que nous devenons plus libres à mesure que nous réussissons soit à étendre notre empire sur les agents naturels, soit à mieux subordonner notre propre activité aux directions qui peuvent lui donner le plus de puissance; c'est ainsi que nous parvenons à réduire de plus en plus les obstacles qui s'opposent à la satisfaction et à l'extension de nos besoins, à l'emploi fructueux et au perfectionnement de nos facultés physiques, intellectuelles ou morales, en un mot à l'amélioration et a la diffusion de la vie humaine.
Ces obstacles se rencontrent soit dans les choses, soit dans les hommes. L'industrie a pour mission de surmonter les premiers, et c'est ainsi qu'elle est parvenue, par exemple, à asservir et multiplier les races d'animaux qui nous sont utiles en restreignant le développement de celles qui nous sont nuisibles, — à substituer, sur une grande partie de la terre, aux diverses espèces de végétaux qui la couvraient sans utilité pour nous, celles qui peuvent le mieux satisfaire nos besoins, — à vaincre les difficultés que les fleuves, les montagnes, l'immensité des mers, opposaient aux relations entre les diverses nations, etc., etc. Quant aux obstacles provenant de l'homme lui-même, — de son ignorance, de ses passions, de sa cupidité, de son penchant à asservir et dominer ses semblables, — l'industrie n'est point étrangère à leur atténuation, mais elle n'y concourt qu'indirectement et en fournissant les moyens indispensables pour que les lumières puissent s'accroître et se [xxv] propager. — Quoi qu'il en soit, les obstacles de ce dernier ordre s'affaiblissent à mesure que nous apprenons à mieux prévoir toutes les conséquences prochaines ou éloignées de nos actions ou de nos habitudes, et à mieux conformer notre conduite aux indications de cette prévoyance, — à mesure aussi que les sentiments de dignité et de justice se répandent, que chacun se sent mieux disposé à résister courageusement à toute violence, à toute injuste atteinte contre sa personne ou sa propriété, et à respecter scrupuleusement les mêmes droits chez autrui.
Il résulte de l'ensemble de ces conditions que la liberté des nations grandit à mesure qu'elles deviennent plus industrieuses, plus éclairées et plus morales; qu'elle est ainsi proportionnelle au degré de leur avancement sous ces divers rapports, et que c'est en vain qu'elles aspireraient à être plus libres que ne le comporte l'état de leur industrie, de leurs lumières et de leurs mœurs. [9]
Depuis 1789, la nation française s'est trouvée plusieurs fois maîtresse de son établissement gouvernemental, et, bien que ses tendances les plus générales fussent pour la liberté, les fausses notions qu'elle avait adoptées sur ce point ne lui ont pas permis de réussir à fonder des institutions propres à atteindre le but. La plupart de nos hommes politiques ont toujours considéré les institutions gouvernementales comme les principaux et presque les seuls organes de la vie des sociétés, comme les forces dont elles doivent attendre l'impulsion et subir la direction dans tous les modes de leur activité : préoccupés de l'exemple de certains personnages que nos historiens se plaisent à signaler comme de grands hommes d'État, parce qu'ils sont parvenus à faire dominer leur volonté ou leurs vues personnelles, quelque absurdes et quelque désastreuses qu'elles aient été le plus souvent; — influencés, parfois à leur insu, par des réminiscences classiques sur les institutions des Grecs et des Romains, sur les systèmes législatifs de Lycurgue, de Solon, etc., ou par des notions non moins propres à les égarer, puisées dans des écrits tels que ceux de Montesquieu, de Rousseau, de Mably, de Raynal, etc., ils n'ont vu dans les sociétés civilisées que des corps incapables de vivre et de prospérer par eux-mêmes; ils n'ont pas compris que leur existence et leurs progrès dépendent avant tout d'efforts individuels dont les principes sont en nous-mêmes et non dans la législation ou dans l'action de l'autorité publique, efforts que la Providence a rendus d'autant plus puissants pour assurer le bien général qu'ils sont moins contrariés par les lois d'invention humaine et que chacun les exerce avec plus de liberté dans tout ce qui ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui; qu'en conséquence, la mission rationnelle du législateur n'est pas de conduire les hommes, de diriger leur activité, mais de les préserver de toute injuste atteinte dans leur personne ou dans leurs intérêts, de garantir à chacun la libre disposition des facultés qui lui sont inhérentes et de ce qu'elles produisent.
C'est en ce sens que les populations des États du nord de l'Union américaine comprennent la liberté politique; elles la font consister surtout dans une indépendance des facultés et des activités individuelles aussi complète que possible, c'est-à-dire uniquement subordonnée, pour chaque individu pris en particulier, à la condition de respecter les mêmes droits chez tous les autres. La liberté n'a jamais été entendue ainsi par nos hommes politiques, même par ceux qui faisaient profession d'appartenir à l'opinion libérale; ceux-ci jugeaient la liberté suffisamment établie dès que la puissance législative, à laquelle ils donnaient mission de diriger la société sur tous les points, avait son origine dans le suffrage de la majorité de la [xxvi] population, et que les règles qu'elle imposait étaient communes à tous; pourvu que cette puissance leur parût être l'expression de la volonté la plus générale, ils n'hésitaient pas à lui sacrifier la liberté individuelle. Il est à remarquer, au surplus, que, lorsque des changements politiques sont venus substituer à la volonté générale, pour la formation du pouvoir législatif, la volonté d'une fraction plus ou moins restreinte de la population, ou même celle d'un seul homme, l'omnipotence du législateur n'a pas été plus contestée qu'auparavant.
Sous l'empire de pareilles idées, renforcées en France, et dans d'autres pays qui ont tort de nous imiter, par une disposition universelle à l'exercice de la domination et à la recherche des emplois publics comme moyens d'existence ou de fortune, il était inévitable que l'action du gouvernement ne tendit sans cesse à s'accroître. Dès que l'on attribuait au législateur, quel qu'il fût, une mission illimitée, il devait avoir continuellement à ajouter aux prescriptions, aux règles nécessaires pour faire marcher la société selon ses vues. Aussi les hommes que la succession des événements a investis tour à tour de ce suprême mandat en ont-ils usé si largement que l'on compte par centaines de mille le nombre des lois ou des règlements qu'ils nous ont imposés depuis soixante ans.
C'est ainsi que notre système gouvernemental et administratif a acquis des proportions colossales et sans exemple jusqu'ici dans aucun pays du monde; qu'il a étendu successivement son action, ses règlements, ses entraves, à presque toutes les branches d'activité, en restreignant leurs développements et leur fécondité proportionnellement à ce qu'il enlevait à leur liberté; que, pour suffire à l'immensité des attributions qu'il comporte, il a multiplié les services et les emplois publics au point de faire vivre une très-grande partie de la population sur le produit des contributions, et de pousser ainsi au développement des races parasites demandant à vivre de la même manière, jusqu'à en faire une force subversive des plus dangereuses et l'une des principales causes d'agitation et de désordre qui rendent chez nous la sécurité si précaire.
L'Économie politique étudie et analyse tous les éléments de perturbation que renferme un semblable régime; elle en montre les fâcheux résultats; elle en signale le remède, qui consiste principalement à réduire et à simplifier l'action gouvernementale par la restitution à l'activité privée du libre exercice de toutes les branches de travaux qui, par leur nature, sont hors des attributions rationnelles de l'autorité publique, et que nos gouvernements ont voulu diriger, monopoliser ou réglementer.
Dans un pays comme le nôtre, où tant de gens sont possédés de la manie de gouverner leurs semblables, l'enseignement de pareilles doctrines devait susciter à l'Économie politique une multitude d'adversaires. Les partis qui recherchent l'exercice du pouvoir, l'armée des gens en place, l'armée plus nombreuse encore de ceux qui aspirent à être placés, et tous les réformateurs qui ont inventé un plan quelconque de refonte sociale, devaient se réunir contre une science qui menace de soustraire un jour la société aux soins trop multipliés qu'ils veulent absolument lui prodiguer. Aussi est-ce à cette partie de ses doctrines qu'elle a dû la plupart des attaques dont elle a été l'objet.
Nous avons essayé de résumer, dans un cadre fort restreint, des vérités et des doctrines que l'on trouvera exposées avec tous les développements nécessaires dans les diverses parties du Dictionnaire. Ce résumé est loin, sans doute, d'être complet; mais nous croyons qu'il indique fidèlement les bases principales et les tendances de [xvii] la science; il nous semble d'ailleurs qu'il justifie suffisamment l'assertion que l'Économie politique est dès à présent une des sciences les plus positives et les plus avancées, et celle de toutes, assurément, dont la propagation importerait le plus au progrès de la civilisation, au bien-être et au perfectionnement moral des sociétés.
On ne saurait raisonnablement contester le haut degré d'avancement d'une science, lorsque, dans l'ordre des phénomènes qu'elle embrasse, elle prouve qu'elle est en mesure d'annoncer d'avance avec précision les conséquences ultérieures des faits qui se produisent. Or l'Économie politique a été soumise dans ces derniers temps à une double épreuve de ce genre. Tous ceux qui ont suivi les publications des Économistes français depuis douze ans, et tous ceux qui voudront prendre la peine de parcourir ces publications, ont pu ou pourront facilement se convaincre que l'avortement complet de toutes les tentatives faites en 1848 par le socialisme pour réaliser ses plans d'organisation du travail, ses systèmes d'association, de crédit, de nivellement des positions, etc., y avait été très-fréquemment et très-positivement annoncé plusieurs années à l'avance. D'un autre côté, l'Angleterre a, depuis peu de temps, profondément modifié sa législation économique dans le sens expressément indiqué par les principes de la science. C'était là une épreuve des plus solennelles et dont les résultats étaient attendus avec anxiété par le grand nombre, mais avec une confiance absolue par les Économistes. On sait que cette confiance a été justifiée sur tous les points de la manière la plus éclatante, et que les résultats annoncés se sont produits dans une mesure plus large encore qu'on ne l'avait présumé.
Il faudrait désespérer d'amener au bon sens une population dont les préjugés et les erreurs résisteraient à de semblables démonstrations ; aussi nous aimons à penser qu'elles ne sauraient beaucoup tarder à entraîner d'heureuses modifications dans les opinions économiques qui, jusqu'à ce jour, ont prévalu dans notre pays, et que ceux d'entre nous qui connaissent les vérités de la science, qui se sont voués à leur propagation, et qui sont pénétrés de l'ardente conviction du bien qu'elles pourraient produire, ne seront pas réduits pendant longtemps encore, en voyant l'impuissance de leurs efforts et de leur dévouement, à répéter douloureusement cette protestation de la vérité méconnue : E pur si muove!
Ambroise CLÉMENT.
Août 1853.
Endnotes to Introduction
[7] Traité de législation, par Charles Comte, tome I, pages 31 et 32.
[8] Traité de législation, par Charles Comte, première édition , tome IV, page 536.
[9] Cette belle et importante démonstration , que nous n'avons pu qu'indiquer ici, est donnée de la manière la plus complète et la plus satisfaisante dans le grand ouvrage de M. Ch. Dunoyer, De la liberté du travail.
Biographical Articles
Comte (Charles)↩
Source
"Comte (Charles)," DEP, T. 1, pp. 446-47.
[446]
COMTE (François-Charles-Louis), secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, député de la Sarthe, naquit le 25 août 17 82 , à Sainte-Eminie , petite ville du département de la Lozère. Il débuta dans la vie politique en refusant son vote à l'établissement de l'empire (1804). Quelque temps après il se rendit à Paris, s'y fit recevoir avocat, et prit part à la rédaction du célèbre recueil d'arrêts que publiait M. Sirey; mais sa carrière de publiciste ne date réellement que de la publication du Censeur, qu'il commença le 12 juin 1814, trois jour- après la promulgation de la Charte. Il fonda ce journal pour résister à la réaction qui marqua le retour des Bourbons, et qui finit par entraîner la perte du gouvernement de la restauration. Après la publication du second cahier du Censeur, il s'adjoignit pour collaborateur un de ses compagnons de l'école de droit, M. Charles Dunoyer, et ces deux écrivains, animés d'un même amour pour les libertés constitutionnelles, d'une même foi dans l'a-venir des institutions représentatives, tinrent tête pendant six ans aux champions de l'absolutisme.
Rien de plus curieux que l'histoire des démêlés du Censeur avec les deux gouvernements qui se succédèrent dans cette période; rien de plus honorable, en même temps, pour les deux écrivains indépendants qui le rédigeaient. La censure ayant été rétablie par une ordonnance, en 1814, M. Comte démontra que l'ordonnance était illégale, et il refusa de s'y soumettre. « Pendant plusieurs mois, dit M. Mignet, il demeura seul en possession de la liberté de la presse comme d'un privilège de son courage. » [10] Mais une loi ayant confirmé l'ordonnance royale, les rédacteurs du Censeur se soumirent. Cependant ils trouvèrent moyen d'échapper à la censure, en publiant leur recueil en volumes de plus de vingt feuilles. Lorsque Bonaparte eut débarqué à Cannes, M. Comte, qui détestait par dessus tout la dictature militaire, publia un pamphlet rempli de verve et d'indignation sous ce titre : De l'impossibilité d'établir une monarchie constitutionnelle sous un chef militaire, et particulièrement sous Napoléon. La véhémence de ce manifeste n'empêcha pas une feuille royaliste d'accuser les rédacteurs du Censeur d'avoir conspiré le retour de Napoléon. MM. Comte et Dunoyer, sans se préoccuper de la marche triomphale du dictateur, poursuivirent le rédacteur de ce journal comme les ayant calomniés. La cause fut appelée le 19 mars, lorsque Napoléon entrait déjà dans Fontainebleau. « La position des juges était délicate, dit M. Mignet, à qui nous empruntons ces détails ; placés entre le gouvernement qui existait encore et le gouvernement qui allait exister bientôt, ils devaient éprouver quelque embarras à se prononcer : ce qui était délit aujourd'hui, pouvant être un titre d'honneur demain. La prudence du journaliste accusé les tira de ce pas difficile. Il demanda l'ajournement de la sentence, dans l'espoir qu'il serait plus tard aussi impossible de la provoquer que de la rendre; e'était mal connaître MM. Comte et Dunoyer, et leur opiniâtreté intrépide. Appelés devant la justice, lorsque l'empereur fut remonté sur le trône, pour retirer une plainte devenue sans objet, ils y persistèrent, en faisant inscrire sur le registre du greffe que, « si l'imputation d'avoir coopéré au rétablissement du gouvernement impérial ne les exposait à aucune peine, celle d'avoir cherché à renverser le gouvernement établi, les exposait au mépris public. » De pareils traits révèlent un caractère. Le cinquième volume du Censeur fut provisoirement saisi par la police impériale, et le septième fut condamné et mis au pilon par les magistrats de la seconde restauration. La publication du Censeur demeura , pendant quelque temps, suspendue; mais elle fut reprise, avec un éclat nouveau, en 1817. Dans l'intervalle, MM. Comte et Dunoyer avaient dirigé toute leur attention vers l'étude de l'économie politique. J.-B. Say devint l'instituteur de Charles Comte, qui épousa la fille de cet illustre économiste. La nouvelle publication se ressentit heureusement de la nouvelle direction qu'avaient prise deux esprits si distingués.
Dans la seconde série du Censeur, qui prit le nom de Censeur Européen, la plupart des grandes réformes , qui sont la préoccupation et le besoin de notre temps, furent exposées et discutées avec une remarquable supériorité de vues. La réduction de l'armée, la simplification des attributions du gouvernement, la liberté du travail et du commerce trouvèrent dans les rédacteurs du Censeur Européen des défenseurs énergiques et convaincus. Malheureusement des persécutions inintelligentes obligèrent MM. Comte et Dunoyer à renoncer à leur œuvre de propagande libérale. Condamné à deux mois de prison et à 2,000 fr. d'amende pour avoir publié une souscription défendue, M. Comte, ne trouvant pas sa condamnation fondée , s'exila en Suisse. Une chaire de droit naturel lui fut offerte à Lausanne en 1820, et il la remplit avec éclat jusqu'en 1823. Son expulsion fut alors demandée par le gouvernement français ; les autorités du canton de Vaux résistèrent noblement à cette injonction; mais M. Comte ne voulut point que son séjour devînt une cause d'embarras et de péril pour ses hôtes.
« Je reconnaîtrais mal, écrivait-il au landamman et aux conseillers d'État du canton, la confiance dont vous m'avez honoré en m'appelant à donner des leçons à la jeunesse de votre pays, si je souffrais qu'une lutte si pénible se prolongeât plus longtemps. A aucun prix je ne consentirais à être le prétexte d'une agression contre la Suisse ; vous voudrez bien permettre que je me retire, et que je mette ainsi un terme aux débats dont j'ai été ou dont je pourrais être l'objet. »
Charles Comte se retira en Angleterre, où il se lia étroitement avec Bentham. Après le temps exigé pour la prescription de sa peine, il rentra en France, où il termina son Traité de législation, véritable monument scientifique, pour lequel l'Académie française lui décerna, en 1828, le grand prix Montyon. Dans ce bel ouvrage, Charles Comte a entrepris d'exposer les lois naturelles qui président au développement de la société, ainsi que les causes qui peuvent faire obstacle à ses progrès. Son but était d'appliquer aux sciences morales, [447] les mêmes procédés d'observation qui ont permis aux sciences physiques de réaliser des progrès si rapides. Il rejettait impitoyablement les hypothèses et les systèmes préconçus, pour s'en tenir a l'observation des faits. L'étude des lois auxquelles un peuple est soumis, disait-il, n'est autre chose que l'étude des forces qui déterminent la manière dont ce peuple, existe, se maintient et se perpétue. Ces lois ou ces forces, il faut les chercher dans la nature de l'homme et dans le milieu où il vit. Rien de plus fécond que cette recherche, entreprise par un esprit positif et judicieux; rien de plus intéressant aussi que la réfutation à laquelle il soumet les systèmes conçus en dehors de l'observation des faits, notamment le système de Rousseau.
Frédéric Bastiat, qui s'était longtemps nourri de l'étude du Traité de législation, appréciait aussi ce beau livre :
« Je ne connais, disait-il, aucun livre qui fasse plus penser, qui jette sur l'homme et la société des aperçus plus neufs et plus féconds, qui produise au même degré le sentiment de l'évidence. Sans l'injuste abandon où la jeunesse studieuse semble laisser ce magnifique monument du génie, je n'aurais peut-être pas le courage de me prononcer ainsi, sachant combien je dois me défier de moi-même, si je ne pouvais mettre mon opinion sous le patronage de deux autorités : l'une est celle de l'Académie qui a couronné l'ouvrage de M. Comte; l'autre est celle d'un homme du plus haut mérite, à qui je faisais cette question que les bibliophiles s'adressent souvent : Si vous étiez condamné à la solitude, et qu'on ne vous y permît qu'un ouvrage moderne, lequel choisiriez-vous ? Le Traité de législation de M. Comte, me dit-il ; car si ce n'est pas le livre qui dit le plus de choses, c'est celui qui fait le plus penser. » [11]
Après la révolution de Juillet, Charles Comte fut envoyé à la chambre par les électeurs de la Sarthe, puis nommé procureur du roi près du tribunal de la Seine. Mais l'indépendance naturelle de son caractère ne lui permit pas de remplir longtemps ces dernières fonctions. Appelé à faire partie de l'Académie des sciences morales et politiques, à l'époque de la reconstitution de ce corps savant, il en devint bientôt le secrétaire perpétuel. En 1834 il publia son Traité de la propriété, qui fait suite au Traité de législation. Ce livre, où sont décrites et justifiées, au moyen du critérium de l'utile, les différentes applications du principe de la propriété, est un arsenal rempli de toutes les armes nécessaires pour combattre les errements rétrogrades du communisme. Comme secrétaire perpétuel de l'Académie, Charles Comte prononça les éloges de Garât et de Malthus, dont il apprécia savamment la doctrine. Mais, épuisé de bonne heure par les luttes de la politique et par les travaux de la science, il mourut le 13 avril 1837, à l'âge de cinquante-cinq ans, en laissant la réputation d'un penseur vigoureux, d'un loyal et ferme caractère.
« Sous des formes un peu âpres, et avec des apparences froides, dit M. Mignet, il avail cette bonté du cœur, cette chaleur de l’âme, cette élévation de sentiments, cette verve de la conviction, qui se montrent à la fois dans ses écrits et dans sa vie. C'est par là qu'il a inspiré de solides affections, mérité l'estime universelle , et que sa mémoire sera honorée tant que notre pays demeurera fidèle au culte de la science, et gardera le souvenir de ceux qui l'ont servi. »
G. de M.
BIBLIOGRAPHIE.
Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l'Etat, par MM. Comte et Dunoyer. 6 vol. in-8 (1814 à 1815). Le 7e volume a été saisi et mis au pilon.
Le Censeur européen ou examen de diverses questions de droit public et de divers ouvrages littéraires et scientifiques, considérés spécialement avec les progrès de la civilisation, par MM. Comte et Dunoyer. 12 vol. in-8 publiés de 1817 à 1819.
Parmi les articles de ce recueil qui intéressent spécialement les économistes, nous signalerons les suivants;
- Considérations sur l'état moral de la nation française, et sur les causes de l'instabilité de ses institutions.
- Examen du Traité d'économie politique de J.-B. Say.
- De l'organisation sociale considérée dans ses rapports avec les moyens de subsistance des peuples.
- L'industrie, ou discussions politiques, morales et philosophiques, dans l'intérêt de tous les hommes livrés à des travaux utiles et indépendants.
- De la loi de 1817 sur les finances.
- De la nature et de l'organisation de la force armée.
- Essai sur l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique en France.
- De la multiplication des pauvres, des gens à places et des gens à pensions.
- Du projet de loi relatif à l'abolition de la traite.
- Examen du livre de M. De Laborde: De l'esprit d'association dans tous les intérêts de la communauté.
- Du projet de loi suites poudres et salpêtres.
- Du projet de loi sur le monopole du tabac.
- De quelques dispositions des lois des 28 avril 1816 et 21 avril 1819 sur les douanes.
Des garanties offertes aux capitaux et aux autres genres de propriété par les procédés de chambres législatives, dans les entreprises industrielles, et particulièrement dans la formation des canaux, et de l'influence que peut avoir un canal du Havre à Paris, sur la prospérité des villes commerciales de France, par Ch. Comte. Paris, Delaforest. Contre l'ouvrage (de M. Derbigny) intitulé : Paris, port de mer.
Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires. Paris, Sautelet, 1827, 4 vol. in-8, 2e édit., Paris, Chamerot, Ducollet, 1835, 4 vol. in-8.
« Le Traité de législation de M. Comte est un véritable traité d'économie sociale, dont le 4e volume, entièrement consacré à la question de l'esclavage, passe avec raison pour le plus important de l'ouvrage. Nulle part cette question n'a été approfondie avec une plus grande indépendance de jugement et une plus riche profusion de faits. » (Bl.)
Traité de la propriété. Paris, Chamerot, Ducollei, 1834, 2 vol. in-8.
« L'auteur déclare dans sa préface que cet ouvrage n'est que la suite du précèdent; il y examine les rapports qui s'établissent naturellement entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils peuvent exister. Ce plan lui permet d'examiner les choses, et souvent de résoudre une foule de questions économiques qui se rattachent à la propriété.
« Le livre est écrit avec clarté, sans aucune prétention de style, et la lecture en est attachante, malgré l'aridité du sujet. » (Bl.)
Endnotes to Comte
[10] Notice historique sur la vie et lus travaux de M. Charles Comte, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie (lue dans la séance annuelle du 30 mai 1846), par M. Mignet. (Journal des Économises, n° de juin 1846.)
[11] Le Libre-Échange, n° du 11 juillet 1847.
Necker (Jacques)↩
Source
"Necker," DEP, T. 2, pp. 272-74.
[272]
NECKER (Jacques) naquit à Genève, le 30 septembre 1732, d'une famille originaire de l'Allemagne. Destiné au commerce, il fit son apprentissage chez un banquier de Genève, puis il fut envoyé à Paris, où il entra dans la maison de banque de M. Vernes. En 1772, M. Vernes, dont il avait gagné la confiance, lui prêta une somme considérable, avec laquelle Necker commença des affaires pour son propre compte. Il monta, avec MM. Thélusson, une maison de banque qui devint en peu d'années la première de France. A quarante ans, Necker avait fait sa fortune. Son ambition se tourna alors vers des objets plus élevés. Il publia un éloge de Colbert, qui fut couronné par l'Académie française, et il fut chargé de représenter la république de Genève auprès de la cour de France. En 1775, il publia son ouvrage déplorablement célèbre sur la Législation et le commerce des grains. Ce livre, dans lequel Necker opposait avec une certaine chaleur de style les vieilles pratiques de l'administration aux doctrines libérales deTurgot et des économistes, lui valut une grande réputation. En 1776, M. de Maurepas proposa d'adjoindre Necker comme directeur du trésor au contrôleur général Taboureau; la proposition de Maurepas fut agréée par le roi, et ce fut ainsi que Necker débuta dans les affaires publiques. L'année suivante il devint contrôleur général des finances. Son administration, qui dura jusqu'en 1781 , fut signalée par diverses réformes, dont il a donné le détail dans son fameux Compte rendu.
Quoique les réformes accomplies par M. Necker n'eussent rien de radical, elles ne lui suscitèrent pas moins une vive opposition. En 1781, il fut obligé de donner sa démission , par suite des manœuvres que ses adversaires avaient employées pour le discréditer dans l'esprit du roi. Sa retraite fut considérée comme une calamité publique, et plusieurs souverains lui offrirent la direction de leurs finances; Necker refusa, et il composa alors son traité de l'administration des finances. Jamais livre sur les matières financières n'obtint un succès aussi populaire; en peu de temps on en débita 80 mille exemplaires. Cependant l'insuffisance croissante des revenus du trésor précipitait à grands pas la crise révolutionnaire. Ni Calonne, ni l'archevêque de Brienne n'avaient été capables de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de la monarchie. On eut de nouveau recours à Necker, dont la présence aux affaires fit renaître la confiance, au moins d'une manière momentanée ; malheureusement, dans le rude hiver de 1789, Necker eut la funeste idée d'intervenir dans les approvisionnements, conformément aux principes [273] qu'il avait exposés dans son ouvrage sur la Législation et le Commerce des grains. Au témoignage d'Arthur Young, cette intervention malencontreuse seule engendra l'horrible famine qui contribua pour une si forte part à répandre l'esprit de sédition et d'anarchie. (Voyez Céréales. ) Necker n'en demeura pas moins populaire, et, le 6 mai 1789 , son entrée dans la salle des états généraux fut saluée par des applaudissements à peu près unanimes. Le 11 juillet, Necker, qui avait refusé d'assister à la séance royale du 23 juin, fut disgracié, et il reçut l'ordre de quitter le royaume. Il se rendit à Bâle. A peine la nouvelle de son renvoi fut-elle connue, que l'émeute gronda dans Paris : trois jours après, la Bastille était prise. Le roi s'empressa de rappeler Necker : le retour du ministre fut une ovation continuelle. Cependant Necker avait un caractère trop indécis et des convictions trop flottantes pour que son influence pût se maintenir dans ces conjonctures difficiles. En voulant concilier tous les partis il ne réussit qu'à les mécontenter. Dégoûté des affaires, il envoya sa démission en septembre 1790. S'étant retiré en Suisse, il fut, pendant son voyage, insulté et bafoué par le même peuple qui l'avait conduit naguère en triomphe. En 1791 il publia, du fond de sa retraite de Coppet, la justification des actes de son ministère, sous ce titre : De l'administration de M. Necker par lui-même. En novembre 17 92, il se présenta pour défendre Louis XVI , et il fit paraître, dans l'intérêt de ce malheureux prince , des Réflexions offertes à la nation française. Ce plaidoyer le fit inscrire sur la table des émigrés, et occasionna le séquestre de ses biens, y compris une somme de deux millions qu'il avait déposés au trésor public, pour servir de caution à l'approvisionnement de Paris. Cette somme ne fut restituée à sa famille qu'après 1815. En 1796, Necker publia encore un ouvrage en quatre volumes, intitulé : De la Révolution française; en 1800 un Cours de morale religieuse; enfin, en 1802, ses Dernières vues de politique et de finances, dans lesquelles il dévoilait les desseins ambitieux du premier consul. En 1794, M. Necker avait perdu sa femme (Suzanne Curchod), personne du plus grand mérite; mais dont l'esprit honnête et élevé manquait de souplesse et de grâce. Dix ans plus tard, le 9 avril 1804, l'ancien ministre de Louis XVI allait rejoindre sa compagne qu'il avait tendrement aimée.
Des déclamations imprudentes contre la propriété ont valu à Necker toutes les sympathies des écrivains socialistes. M. Louis Blanc, notamment, s'est empressé de le hisser sur le glorieux piédestal de la fraternité, tandis qu’il reléguait Turgot dans les bas-fonds de l'individualisme.
« Comme hauteur de vues et chaleur de sentiments, affirme M. Louis Blanc, nul doute que Necker ne fût supérieur à Turgot.
« Les opinions de ce dernier allégeaient singulièrement la charge du pouvoir. Détruire les obstacles, puis laisser faire, c'était gouverner, selon Turgot; et, s'il fallait pour cela le courage de l'homme d'action, on se pouvait passer de l'intrépidité du penseur. Necker voulait, au contraire, qu'on fit à l'autorité une laborieuse et grande situation. Suivre à travers les complications sociales, suivre d'un coeur ému et vigilant l'existence agitée du pauvre; pourvoir à la subsistance de tous et à ce que chacun trouvât place dans le domaine sacré du travail; avoir de la force pour les faibles, de la sagesse pour les ignorants; défendre, sinon le bonheur, au moins le pain de la multitude contre le brutal régime de la concurrence et les désordres d'un antagonisme universel ..., voilà par quels soins et par quelle sollicitude Necker entendait mériter l'honneur de gouverner un empire. » [12]
Comme preuve à l'appui, M. Louis Blanc donne une analyse de l'ouvrage de Necker sur la Législation et le Commerce des grains, et malheureusement ce livre ne laisse que trop de prise aux éloges de M. Louis Blanc. Ce n'est autre chose, en effet, qu'un long réquisitoire contre le droit de propriété. A ce droit, qui était invoqué par les économistes en faveur de la liberté du commerce des grains, Necker opposait, dans l'intérêt du peuple, à ce qu'il croyait du moins, le droit de l'humanité. Ayant sous les yeux le spectacle des maux que causaient aux classes Inférieures les privilèges encore attachés à la propriété territoriale, il attribuait, par une confusion trop commune, à l'exercice même du droit les abus du privilège. Il ne croyait point, avec Quesnay, que la société fût gouvernée par des lois naturelles « instituées pour opérer le bien, » et il pensait que les mêmes maux qui découlaient du régime de la propriété privilégiée ne pouvaient manquer de signaler aussi celui de la propriété libre. En conséquence il demandait que le pouvoir social intervînt pour faire prévaloir le « droit de l'humanité » sur le droit de propriété.
« Il ne lui avait pas échappé, ajoute M. Louis Blanc, qu'au milieu d'une lutte universelle, et quand les armes sont inégales, la liberté est tout simplement l'hypocrisie de l'oppression. Au nom de la liberté, permettrez-vous à l'homme robuste d'améliorer son sort aux dépens de l'homme faible? Or, disait Necker, l'homme fort dans la société, c'est le propriétaire, l'homme faible, c'est l'homme sans propriété. » [13]
Ailleurs, Necker comparait les propriétaires à des lions « toujours prêts à s'élancer, » et il engageait les amis du peuple à se méfier des hommes qui invoquaient l'intérêt des masses pour augmenter la liberté de ces animaux nuisibles.
« C'est un grand abus, s'écriait-il, que de faire servir la compassion pour le peuple à fortifier les prérogatives des propriétaires : c'est presque imiter l'art de ces animaux terribles qui, sur les bords des fleuves de l'Asie, prennent la voix des enfants pour dévorer les hommes. » [14]
Enfin, il portait à cette engeance pernicieuse le coup de grâce, dans cette tirade si souvent citée et acclamée par les écrivains socialistes :
« On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après s'être partagé la terre, ont fait des lois d'union et de garantie contre la multitude, comme ils auraient mis des abris dans les bois pour se défendre contre les bêtes sauvages. Cependant, on ose le dire, après avoir établi les lois de propriété, de [274] justice et de liberté, on n'a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens. « Que nous importent vos lois de propriété, pourraient-ils dire? nous ne possédons rien. Vos lois de justice? nous n'avons rien à défendre. Vos lois de liberté? si nous ne travaillons pas demain, nous mourrons. » [15]
On conçoit quels ravages ce livre, émané d'un nomme dont on vantait les connaissances pratiques, dut causer à une époque où les abus de la propriété privilégiée avaient, par une réaction inévitable, poussé les esprit jusqu'aux confins du communisme. Il obtint un succès énorme; on en fit successivement plus de vingt éditions. La commotion révolutionnaire qui éclata quatorze ans plus tard donna malheureusement à la jeune génération, imprégnée de ses maximes, l'occasion de les mettre en pratique. C'est en s'appuyant sur les arguments développés par l'auteur de la Législation et du Commerce des grains, que les jacobins firent décréter le maximum, l'emprunt forcé et tant d'autres mesures antiéconomiques et spoliatrices. M. Louis Blanc a donc bien ses raisons pour louer Necker, et l'on doit plaindre sincèrement l'ancien ministre de Louis XVI d'avoir mérité une approbation si compromettante.
L'ouvrage de Necker sur l’Administration des finances de la France est conçu dans le même esprit que le précédent. En revanche on y trouve d'utiles renseignements sur les institutions économiques et financières de la France avant la révolution. On peut encore le consulter avec fruit, et, malgré de nombreuses inexactitudes et le ton déclamatoire qui y règne, il demeure le meilleur titre scientifique de son auteur.
G. de M.
Voici la liste des Œuvres économiques et financières de Necker:
Éloge de J.-B. Colbert, discours qui a remporté le prix de l'Académie française en 1773. Paris, J.-B. Drunet, 1773, in-8.
De la législation et du commerce des grains. 1775, I vol. in-8. Reproduit dans la Collection des Principaux Économistes, de Guillaumin, tome XV.
Compte rendu présenté au roi au mois de janvier 1781. Paris, de l'impr. roy., 1781, in-4 do 116 pages.
De l'Administration des finances de la France. Paris, Panckoucke, 1784, 3 vol. in-8.
Correspondance de M. Necker avec M. de Calonne, 1787, in-12.
Défense contre M. de Calonne, 1787, in-12.
Sur l'Administration de M. Necker, par lui-même. Pans, Plassan, in-8 de 469 pages.
Dernières vues de politique et de finances offertes à la nation française. Genève, 1802, in-8.
Et un grand nombre de mémoires recueillis dans la collection de ses Œuvres complètes, publiées par M. le baron de Staël, son petit-fils. Paris, Treuttel et Würtz, 1820-21, 15 volumes in-8.
Endnotes to Necker
[12] Histoire de la Révolution française, t. 1, p. 555.
[13] Ibid., p. 557.
[14] De la législation et du commerce des grains, partie 1, chapitre xxvi.
[15] De la législation et du commerces grains, partie III, chapitre XII.
Peel (Robert)↩
Source
"Peel (Robert)," DEP, T. 2, pp. 351-54.
[351]
PEEL (Robert). Ce grand homme d'État, qui a attaché son nom à l'une des réformes les plus fécondes de notre siècle, est né à Chamber-Hall, dans le voisinage de Bury, en 1788, et est mort à Londres, d'une chute de cheval, le 2 juillet 1850. Son père, qui portait comme lui le prénom de Robert, avait acquis une immense fortune dans la fabrication du coton, et il avait été créé baronnet en récompense de l'appui dévoué qu'il avait prêté à la politique de Pitt. Le jeune Peel fut envoyé au collège de Harrow, où il eut Byron pour condisciple et pour camarade. On a souvent cité ce passage qui le concerne dans les mémoires du grand poète :
« Peel, dit Byron, avait toujours donné beaucoup d'espérances et à ses maîtres et à ses camarades ; il ne les a pas démenties. Pour l'instruction classique, il était de beaucoup mon supérieur; pour la déclamation et l'action, j'étais au moins son égal. Quand nous sortions, j'étais toujours dans de mauvais pas, lui jamais. Au collège, il savait toujours sa leçon, moi rarement; mais quand je la savais, je la savais à peu près aussi bien que lui. Pour l'instruction générale, l'histoire, etc., je crois que je lui étais supérieur. »
Robert Peel alla achever ses études à l'université d'Oxford, où il obtint les succès les plus brillants. A l'âge de 21 ans, il fut nommé membre de la chambre des communes par Cashel, un bourg-pourri de l'Irlande, qui comptait douze électeurs. Il passa la première année de son séjour à la chambre à étudier le terrain parlementaire, et ne prononça son maiden-speech que l'année suivante, à l'occasion de la discussion de l'adresse. Ce discours le posa d'emblée comme l'un des hommes d'État futurs de son parti. La même année, il fut nommé sous-secrétaire d'État de l'intérieur. Son éducation économique n'était pas encore bien avancée à cette époque, car, en mai 1811, il faisait partie de la majorité qui votait la [352] fameuse résolution de M. Van Sittart, déclarant, en dépit de l'évidence, que les billets de la banque d'Angleterre n'avaient pas cessé d'être l'équivalent du numéraire. L'année suivante (1812), il obtint le poste important de secrétaire d'État pour l'Irlande. Il organisa dans ce malheureux pays une force municipale (constabulary force), qui commença à y faire régner un peu de sécurité. En 1817, M. Abbott, le représentant d'Oxford, ayant été élevé à la pairie, la célèbre université confia à son ancien lauréat l'honneur de la représenter. En 1819, il était nommé président du comité d'enquête chargé d'examiner la question de la reprise des payements en espèces. Dans le même comité siégeaient aussi M. Canning.M. Tierney, Sir James Mackintosh, et M. Huskisson. L'influence de ces esprits éclairés modifia complètement son opinion sur cette question, et il en convint avec une franchise des plus honorables :
« Je ne rougis pas d'avouer, dit-il dans le cours de la discussion, que je suis entré dans la commission avec des idées bien différentes de celles que j'ai aujourd'hui ; mais j'y suis entré avec la ferme résolution d'oublier toutes mes impressions passées, et le vote que j'avais donné quelques années auparavant. »
Le 7 avril, il présentait le bill qui ordonnait la reprise des payements en espèces, et il contribuait puissamment à le faire adopter.
Devenu ministre de l'intérieur par suite de la retraite de lord Sidmouth (novembre 1821), Robert Peel signala son passage aux affaires par la reforme de la législation criminelle, réforme préparée par les écrits de sir Samuel Romilly et de sir James Mackintosh, mais qu'il eut le mérite de réaliser aussitôt qu'elle se trouva mûre dans les esprits. En 1826, il la commençait en faisant passer deux bills, l'un qui appelait à être membre du jury tout propriétaire ayant 10 livres sterling de revenus en terres, ou possédant à bail, pour 21 ans, des terres rapportant 20 livres sterling ; l'autre qui réduisait le nombre des accusations criminelles, et limitait la juridiction des juges de paix. Le 9 mars 1827, il présentait un bill pour la révision des statuts concernant le vol. Il proposait d'adoucir, dans certains cas, la pénalité, et d'exonérer les plaignants des frais de poursuites. Cette réforme fut adoptée par la chambre des communes le 17 avril, et par la chambre des lords le 18 mai. Dans la session suivante, il fit passer encore quatre bills modifiant les lois relatives aux atteintes à la propriété, et aux crimes contre la paix publique. La mort de lord Liverpool, survenue au commencement de l'année 1827, ayant amené la dissolution du ministère et l'avénement de M. Canning, Robert Peel donna sa démission (11 avril), en la motivant sur son opposition à la mesure de l'émancipation des catholiques. Moins d'un an après, M. Canning mourait; le duc de Wellington était appelé à former un nouveau ministère, et Robert Peel se trouvait réintégré dans son poste de secrétaire d'État de l'intérieur. Le 8 mai 1828, il combattait encore une proposition de sir Francis Burdett, relative à l'émancipation des catholiques; mais l'année suivante, la fameuse élection d'O'Connell dans le comté de Clare lui fit comprendre que le moment était venu de céder au vœu de l'opinion. L'émancipation fut annoncée dans le discours d'ouverture du parlement. Aussitôt les vieux protestants de l'université d'Oxford jetèrent à la face de leur représentant ce reproche de trahison que les protectionnistes devaient lui prodiguer plus tard. Robert Peel, sans se laisser ébranler par ces inintelligentes clameurs, donna sa démission de représentant de l'université. Non réélu (sir Robert Inglis, le candidat des vieux anglicans, l'emporta sur lui), il fut obligé de se faire élire par Wesbury, un des bourgs-pourris dont disposait la couronne. Le 5 mars 1821, il faisait la motion de l'émancipation des catholiques.
Le ministère du duc de Wellington fut forcé de se retirer après la révolution de juillet (17 novembre 1830), et deux ans après les whigs réussirent à faire passer le bill de réforme. Les premières élections qui eurent lieu après l'adoption du bill (29 janvier 1833) furent tellement favorables aux whigs, qu'on crut un moment que le parti tory ne s'en relèverait jamais. Mais on avait compté sans Robert Peel : à force de persévérance, d'habileté et d'éloquence, il réussit à réorganiser et à relever son parti. Le 9 décembre 1834, le roi, lassé des whigs, eut la velléité de le rappeler au ministère. Mais c'était trop tôt. Constamment en minorité à la chambre des communes, le ministère Peel ne vécut que quatre mois.
Ce fut seulement en 1841 que Robert Peel recueillit le prix de ses laborieux efforts. Mais alors il arriva au pouvoir, porté par une majorité aussi considérable que celle que les whigs avaient eue après le bill de réforme, et dont ils n'avaient pas su profiter. Cependant la situation était des plus critiques, et un homme d'État moins habile et moins sûr de lui-même aurait hésité à en prendre la responsabilité : une crise affreuse pesait, depuis 1838, sur l'industrie et sur le commerce de la Grande-Bretagne. Le déficit du trésor, qui s'était élevé à 36 millions en 1839, à 44 millions en 1840, à 36 millions en 1841, allait atteindre 102 millions en 1842. Robert Peel comprit alors, et c'est son immortel titre de gloire, que le moment était venu de porter hardiment la hache dans la vieille et informe législation économique de la Grande-Bretagne. Il comprit que le régime prohibitif, âme de cette législation, entravait le développement de la prospérité publique, et en conséquence aussi l'accroissement du revenu du trésor, et il commença son admirable série de réformes commerciales. Après avoir rétabli l’income tax pour assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, il modifia ou supprima, pour son coup d'essai, 44 articles du tarif. La prohibition fut levée sur les bestiaux, la viande fraiche et le poisson, et remplacée par des droits modérés. A la sortie, les charbons de terre, les livres, les peaux, les minerais, la terre de pipe, furent affranchis de tout droit. Des réductions notables furent opérées sur les autres articles, parmi lesquels se trouvaient le lard, le bœuf salé, la faïence, le bois d'acajou, l'huile d'olive, les bois de construction, les cuirs, les chaussures, le goudron, le suif, le riz, le café. Ces réformes furent poursuivies en 1843 et 1844. Les prohibition [353] furent abolies, les droits sur les matières premières abaissés à une limite maximum dee 50 pour 100, et les droits sur la plupart des articles manufacturés réduite à 12 ou 20 pour 100. Contrairement aux prévisions des vieux tories, qui se lamentaient de voir le chef du parti conservateur abandonner l'arche sainte de la protection, ces réformes furent avantageuses au trésor public aussi bien qu'aux consommateurs. En dépit, ou pour mieux dire à cause des réductions de droits, le revenu ordinaire, qui était tombé a 47 millions 917 mille livres en 1841, s'éleva à 48 millions 125 mille livres en 1844.
Le privilège de la banque ayant expiré en 1844, Robert Peel le fit renouveler par l'acte qui porte son nom. Cet acte, dont les dispositions ont été reproduites ailleurs (voyez Banque), fut une de ses conceptions les moins heureuses. Il ne résista point, comme on sait, à la crise de 1847 : on fut obligé alors d'en suspendre les effets, pour éviter une catastrophe commerciale et financière.
1845, Robert Peel, enhardi par le succès de ses premières réformes commerciales, marcha plus avant dans cette utile et glorieuse voie. Les droits sur les matières brutes mises en œuvre dans les manufactures, sur les matières tinctoriales, sur les huiles, furent supprimés. Les manufactures de verres et de cristaux furent exonérées en même temps de tout droit d'accise. Le sucre subit un premier dégrèvement; les cotons et les laines furent affranchis, ainsi que 430 articles (sur 812) de moindre importance. Enfin ces réformes furent couronnées en 1846 par l'abolition des lois céréales, que le mouvement de l’anti-corn-law-league préparait depuis huit années (voyez Ligue. En présence du déficit de la récolte dans la Grande-Bretagne, et de l'épouvantable famine qui désolait l'Irlande, comme aussi de l'agitation des esprits, remués par les prédications de la ligue, l'abolition des lois céréales était devenue une nécessité. Robert Peel le comprit Néanmoins il pensa que ce n'était pas à lui, qui avait si longtemps repoussé cette réforme au nom du parti protectionniste, à la réaliser. Il voulut laisser cet honneur aux whigs, et il donna sa démission. Mais lord John Russell n'ayant pas réussi à former un cabinet, il reprit son portefeuille avec la résolution bien arrêtée de donner satisfaction à l'opinion , en dépit des résistances de son propre parti. A l'ouverture du parlement (22 janvier 1846), il annonça la réforme des corn-laws, et cinq jours plus tard (27 janvier), il en demanda l'abolition dans son plan financier. Cette nouvelle excita au plus haut degré la colère des protectionnistes ; mais Robert Peel ne céda pas plus à leurs clameurs qu'il n'avait cédé à celles des bigots du protestantisme, à l'époque de l'émancipation des catholiques. Grâce à l'ascendant moral qu'il avait acquis en cédant au vœu de l'opinion, grâce aussi à son éloquence persuasive, il réussit a faire adopter son pian à la chambre des communes, et l'appui du duc de Wellington lui valut le même succès à la chambre des lords. Après avoir remporté cette victoire glorieuse, Robert Peel abandonna les affaires à lord John Russell, qu'il soutint constamment dans les questions commerciales, et à qui l'appui du bataillon des peelites, c'est-à-dire des conservateurs qui avaient abandonné avec Robert Peel la vieille bannière de la protection, permit d'accomplir la réforme du tarif des sucres et celle des lois de navigation. Dans les derniers jours de juin 1850, Robert Peel prononçait un discours où il justifiait d'une manière éloquente l'appui désintéressé qu'il accordait au cabinet whig, et où il manifestait toute sa confiance dans l'avenir de la réforme commerciale :
« Bien loin, disait-il, d'avoir fait à l'égard des principes de la liberté commerciale le moindre compromis avec les membres qui siègent auprès de moi, et dont j'ai eu le malheur de perdre la confiance, je répète solennellement que chaque jour qui s'écoule me convainc de plus en plus que la paix et la prospérité de ce pays sont intimement liées à l'adoption franche, dénuée de toute arrière-pensée, de ces principes. »
A quelques jours de distance, une chute de cheval étendait Robert Peel meurtri, blessé à mort, sur le pavé de Constitution-Hill (29 juin). Trois jours après il rendait le dernier soupir. Conformément à ses dernières intentions, son corps fut inhumé sans pompe dans le modeste cimetière de Drayton-Bassett. Mais sur la proposition de lord John Russell, la chambre des communes décida qu'un monument serait consacré à sa mémoire dans l'abbaye de Westminster. Des statues lui ont été élevées aussi dans plusieurs villes de l'Angleterre.
Le succès des grandes réformes accomplies par Robert Peel s'est consolidé de jour en jour davantage. Si l'on veut avoir une idée de l'importance de ces réformes, que l'on songe que, sur 1,250 articles du tarif, Robert Peel en a aboli ou réduit environ 750, et que le montant des droits réduits ou supprimés par lui et par lord John Russell, de 1842 à 1850, n'a pas été de moins de 10 millions 251,295 livres sterling. [16] Or veut-on savoir quelle a été la perte finale qu'une réforme si radicale a causée au trésor ? Cette perte a été en dernier lieu de 774 mille livres sterling seulement. D'un autre côté, la diminution des secours publics, l'augmentation progressive des importations et des exportations, l'accroissement du nombre des mariages, etc., etc., ont prouvé à quel point la réforme commerciale a profité à l'immense majorité du peuple anglais. Aussi les adversaires les plus acharnés de sir Robert Peel, lord Derby (auparavant lord Stanley) et M. Disraeli ont-ils été obligés de respecter son œuvre à leur arrivée aux affaires, et ils ont été renversés pour ne l'avoir point continuée avec assez d'ardeur. Le nom de Robert Peel est devenu populaire jusque dans les campagnes, où il était naguère voué aux dieux infernaux de la protection, et les ouvriers des champs comme ceux des villes suspendent avec reconnaissance au-dessus de leur foyer le portrait de l'homme qui leur a procuré le bienfait de la vie à bon marché. [17] Ainsi se trouve exaucé le vœu touchant que Robert Peel exprimait au fort de la lutte engagée pour le rappel des lois céréales :
« Il se peut que je laisse un nom dont on se souviendra avec plaisir dans la demeure de celui qui gagne son pain quotidien à la sueur de son front, lorsqu'il lui sera permis de réparer ses forces épuisées par une nourriture abondante, à bon marché, et d'autant plus agréable qu'elle ne sera plus rendue amère par le sentiment d'une injustice. »
G. de M.
The life of the right honourable sir Robert Peel, bart, as subject and citizen, as legislator and ministre, and as patron of learning and the arts. — ( Vie du très honorable sir Robert Peel, baronnet, comme sujet et citoyen, comme législateur et ministre, et comme protecteur des sciences et des arts.) By William Harvey. London, George Routledge, 1850, 1 vol. in-18.
Endnotes to Peel
[16] Droits de douane 8,218,958 l. st. / Accise 1,434,280 / Timbre 598,056 / Total 10,251,294 I. st.
[17] Discours de M. Villiers. Séance de la chambre des communes du 23 novembre 1852.
Saint-Pierre (abbé de)↩
Source
"Saint-Pierre (abbé de)," DEP, T. 2, pp. 565-66.
[565]
SAINT- PIERRE ( Charles - Irénée - Castel, abbé de). L'auteur du Projet de paix perpétuelle et l'un des plus ardents amis de l'humanité ; naquit, le 18 février 1658, au château de Saint-Pierre-Église près de Barfleur. Sa famille était alliée à celle du maréchal de Villars. Possesseur d'un petit revenu, il se rendit à Paris pour y suivre la carrière des lettres et des sciences, après avoir embrassé l'état ecclésiastique, conformément au vœu de ses parents. Il fut reçu, en 1695, membre de l'Académie française; mais ayant jugé avec une juste sévérité Louis XIV, auquel il reprochait d'avoir fait à ses voisins des guerres injustes, écrasé les peuples d'impôts et révoqué l'édit de Nantes, il fut expulsé de cette compagnie, sur la demande du cardinal de Polignac (1718). Sur vingt-trois académiciens présents à la séance où son exclusion fut prononcée, un seul, Fontenelle, osa voter en sa faveur. Après sa mort, Maupertuis, qui lui succéda, ne put obtenir l'autorisation de faire son éloge. Ce fut seulement trente-deux ans plus tard que l'interdit fut levé, et que d'Alembert put payer un tribut mérité à la mémoire du digne et courageux prédécesseur de Maupertuis. En 1702, l'abbé de Saint-Pierre avait acheté la charge de premier aumônier de madame la duchesse d'Orléans, par l'intervention de laquelle il obtint l'abbaye de Tiron. En 1712, l'abbé de Polignac l'emmena au congrès d'Utrecht, où les difficultés qu'éprouvait la conclusion de la paix lui suggérèrent l'idée de son fameux Projet de paix perpétuelle. Ce projet, l'abbé de Saint-Pierre l'attribua à Henri IV, afin de le faire accepter plus aisément. L'évêque de Fréjus, depuis cardinal de Fleury, auquel il en donna communication, lui répondit : « Vous avez oublié un article essentiel, celui d'envoyer des missionnaires pour toucher le cœur des princes et leur persuader d'entrer dans vos vues. » A dater de cette époque, l'abbé de Saint-Pierre passa sa vie à formuler des projets de réforme qu'il ne manquait jamais d'adresser aux princes et aux ministres, avec l'espoir assez naif de les leur faire agréer. Ce fut lui qui employa le premier, au dire de d'Alembert, ou qui remit en usage le mot bienfaisance ; et il ne se contentait pas de se servir du mot, il pratiquait largement la vertu que ce mot désigne : il consacrait la plus grande partie de son revenu au soulagement des malheureux. Donner et pardonner, tels étaient à son avis la base de toute la morale. L'abbé de Saint-Pierre mourut à Paris, le 27 avril 17 43, à l'âge de 85 ans. Il laissait plusieurs ouvrages en manuscrit. Son neveu les remit avec les autres à Jean-Jacques Rousseau pour qu'il en tirât le meilleur parti possible. Jean-Jacques se borna à faire des extraits du Projet de paix perpétuelle et de la Polysynodie, à l'occasion de laquelle l'abbé de Saint-Pierre avait été chassé de l'Académie. « Je m'en tins là, dit-il, ne voulant pas m'exposer, en répétant les censures de l'abbé de Saint-Pierre, à me faire demander de quoi je me mêlais. » (Confessions, liv. IX).
Le cardinal Dubois avait coutume de dire des idées de l'auteur du Projet de paix perpétuelle, qu'elles étaient les « rêves d'un homme de bien. » Sans doute, les peuples n'ont pas encore oublié [566] leurs animosités séculaires ; ils ne savent pas encore assez non plus, quoique de cruelles expériences le leur aient appris, à quel point ils sont intéressés au maintien de la paix ; cependant qui sait si, grâce aux progrès qui facilitent l'échange des produits et la diffusion des lumières, grâce aux chemins de fer, aux télégraphes électriques et à la liberté du commerce, sans parler de tant d'autres progrès que chaque jour voit éclore, les « rêves d'un homme de bien » ne finiront point par devenir des réalités?
G. de M.
Voici la liste des principaux ouvrages de l'abbé de Saint-Pierre :
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, etc. Utrecht (Paris), 1713-1717, 3 vol. in-12. Le même ouvrage abrégé. Rotterdam (Paris), 1729, in-12. L'auteur demandait l'établissement d'une espèce de sénat ou de tribunal arbitral sous le nom de Diète européenne, composé de membres de toutes les nations civilisées, et qui se chargerait de mettre fin, sans effusion de sang, aux différends des princes.
Mémoire pour l'établissement d'une taille proportionnelle. 1718, in-12 et in-4. Réimprimé sous le titre de Projet d'une taille tarifée, 1718, in-4. Ce projet, qui substituait une taxe fixe à la taxe arbitraire, qui était habituellement perçue, fut adopté par plusieurs intendants de provinces.
Discours sur la polysynodie. 1718, in-4. C'est dans cet ouvrage que l'abbé de Saint-Pierre refusait à Louis XIV le nom de Grand.
Mémoire sur les pauvres mendiants et sur les moyens de les faire subsister, 1724, in-8.
Mémoire pour diminuer le nombre des procès. 1725, in-12. L'auteur recommandait, entre autres remèdes, l'établissement d'un code uniforme pour tout le royaume.
Mémoire pour augmenter les revenus des bénéfices. 1725, in-8.
Projet pour perfectionner l'éducation. 1728, in-12. C'est dans la préface de cet ouvrage que le mot bienfaisance se trouve employé pour la première fois.
Projet pour perfectionner l'orthographe des langues de l'Europe. 1730, in-8. L'auteur proposait d'adopter un système d'orthographe conforme à la prononciation, de marquer la quantité des syllabes, etc., et comme il appliquait son système à ses ouvrages, il les rendait extrêmement difficiles à déchiffrer.
Ouvrages de politique et de morale. Rotterdam, 1738, 4741, 10 vol. in-12. C'est le recueil de la plupart de ses opuscules.
Annales politiques. Nouv. édit. Genève (Lyon, Du-plain), 1767 ,2 vol. in-8. Extrait résumé de ses écrits et «le ses vues.
Alletz a publié : Les rêves d'un homme de bien qui peuvent se réaliser, ou les Vues utiles et praticables de l'abbé de Saint-Pierre. Paris, 1775, in-12. Compilation par ordre alphabétique.
On cite encore de lui un écrit intitulé Mémoire sur les billets d'Etat.
Sully (duc de)↩
Source
"Sully (duc de)," DEP, T. 2, pp. 684-85.
[684]
SULLY (Maximilien de BÉTHUNE, duc de) surintendant des finances, et grand-maître de l'artillerie, l'un des hommes d'État qui ont le plus honoré la France, naquit à Rosny, le 13 décembre 1560, de François de Béthune et de Charlotte d'Auvet. Il entra tout jeune au service du roi de Navarre, depuis Henri IV, avec qui il se lia d'une étroite amitié. Il se distingua par sa valeur brillante dans plusieurs batailles, notamment à Coutras et à Ivry. Henri IV, qui sut apprécier de bonne heure les éminentes qualités de son compagnon d'armes, l'employa dans plusieurs négociations importantes ; et, en 1596, il lui confia le soin de ses finances. Une tentative sur Arras avait échoué faute d'argent, et le roi se trouvait réduit aux plus tristes extrémités. Dans son langage plein de verve originale, il accusait les financiers de sa misère : « Leur rapacité l'avait réduit, disait-il, à n'avoir presque aucun cheval sur lequel il put combattre, ni un harnois complet qu'il pût endosser. Ses chemises étaient déchirées, ses pourpoints troués au coude et sa marmite souvent renversée. » Sully accepta la mission difficile de rétablir les finances de son maitre; et, grâce à son esprit d'ordre, à sa sévère économie et à son activité infatigable, il y réussit à merveille.
« A peine investi de la confiance de Henri IV, dit M. Blanqui, il commença par bien étudier les charges et les ressources de la France, et il dressa le premier budget qui ait servi de base à la comptabilité publique. Ses recherches firent connaitre une dette d'environ 300 millions de francs, vers la fin de l'année 1596; il s'appliqua aussitôt sans relâche à la création des voies et moyens nécessaires pour l'éteindre. Sa maxime principale était d'appliquer à chaque partie de la dépense une partie de la recette, sans permettre qu'elle fût jamais détournée pour un autre emploi. Il mit un frein à la fureur des traitants, qui exploitaient le pays avec une telle audace que, sur 150 millions de francs demandés aux contribuables, à peine 30 millions entraient dans le trésor public. Défense fut faite aux receveurs de saisir, sous aucun prétexte, le bétail et les instruments de labourage des cultivateurs en retard avec le fisc, et les peines les plus sévères furent infligées aux soldats qui vexeraient le paysan, soit pendant leurs marches, soit arrivés dans leurs quartiers, ce qui était une des plus horribles plaies de ce temps. Il ne fallait pas moins de fermeté pour réprimer l'avidité des gouverneurs de province, qui avaient poussé la licence jusqu'à lever des contributions pour leur compte et de leur seule autorité. Le duc d'Épernon, qui se faisait, par de semblables violences, 60 mille écus de rentes, osa résistera Sully, qui soutint, dit Forbonnais, en homme de guerre, son opération de finance.
« Le courageux ministre, après avoir mis à la raison tous ces pillards de haut et bas étage, eut bientôt compris, et il répétait souvent que, pour enrichir le prince, il fallait enrichir les sujets. Tous ses soins se portèrent donc sur l'amélioration de l'agriculture, qu'il considérait comme la première industrie du pays. Il lui prodigua des encouragements de toute sorte, et, avant peu d'années, la plus grande partie des terrains qui étaient tombés en friche par suite des malheurs de la guerre avaient été remis en culture. Il abolit les entraves les plus gênantes pour la circulation, et il supprima les petites faveurs de toute espèce que l'habileté des courtisans avait surprises au roi. » [18]
Ce système de sage économie financière, qui fondait la prospérité du trésor public sur le soulageaient des contribuables, ne manqua point de porter de bons fruits : les finances se rétablirent promptement, et, à la mort du roi Henri IV, Sully avait réussi à amasser une épargne de 42 millions qui était déposée en espèces à la Bastille. On l'a blâmé d'avoir enlevé à la circulation une somme si considérable pour la laisser dormir dans les caves d'un château-fort ; mais si l'on songe, d'une part, qu'à cette époque les gouvernements n'avaient point la ressource des emprunts publics, et, d'une autre part, qu'il leur eût été difficile de trouver un placement sûr pour leurs économies, on se convaincra, croyons-nous, que l'accumulation de cette réserve était un acte de sage prévoyance. En douze années de paix et de bonne administration, on vit se cicatriser la plupart des plaies de la guerre civile, et Henri IV put se bercer de l'espoir que les plus humbles d'entre ses sujets seraient un jour en état de « mettre la poule au pot le dimanche. » Cependant Sully avait à soutenir des luttes de chaque jour contre les courtisans et les maitresses du roi. Il leur disputait pied à pied, et avec une fermeté qui ne se démentait jamais, les deniers des contribuables. Un jour que la duchesse de Verneuil s'efforçait de lui démontrer qu'il était juste et raisonnable que le roi accordât des dotations et fit des cadeaux à ses parents et à ses maîtresses, Sully lui répondit avec une franchise quelque peu brutale :
« Tout cela serait bon, madame, si Sa Majesté prenait [685] l’argent en sa bourse; mais de lever cela sur !es marchands, artisans, laboureurs et pasteurs, il n'y a nulle raison, estant ceux qui nourrissent le roi et nous tous; et se contentent bien d'un seul maitre, sans avoir tant de cousins, de parents et de maîtresses à entretenir. »
Le roi, qui comprenait tout ce que valait un tel serviteur, eut le bon esprit de ne le point sacrifier à ses maîtresses, et il fit même un jour cette dure réponse à Gabrielle d'Estrées, qui se plaignait de Sully : « Je me passerais mieux de dix maîtresses comme vous que d'un serviteur comme lui. »
Sully, précurseur en cela de l'école des physiocrates, n'estimait guère que l'agriculture, qu'il considérait comme la source de toute richesse. « Le labourage et le pastourage, avait-il coutume de répéter, voilà les deux mamelles dont la France est alimentée, les vrayes mines et trésors du Pérou. » Cette préoccupation un peu trop exclusive des intérêts de l'agriculture lui fit négliger ceux de l'industrie; il maltraita même certaines branches de la production qu'il regardait comme parasites et nuisibles. Ainsi, remarque M. Blanqui, il frémissait à l'idée de laisser se développer en France la fabrication des soieries, et il s'efforçait d'arrêter par des lois somptuaires les progrès du luxe des habillements. Il renforçait les règlements restrictifs des corporations d'arts et métiers, il refusait d'abolir la douane de Valence, qui interceptait le commerce de la France avec l'Italie, et il établissait des règlements pour empêcher les monnaies étrangères de circuler en France. Cependant, en dépit de ces erreurs, qui tenaient à l'époque où il vivait, Sully avait adopté une politique économique et financière qui pourrait être, de nos jours encore, proposée comme un modèle à suivre. Il en a résumé admirablement les maximes dans une note présentée au roi, et qui se trouve reproduite dans ses Mémoires :
« Pour voir si mes idées se rapportaient aux siennes, dit-il, le roi voulut que je lui donnasse une note de tout ce que je croyais capable de renverser ou simplement de ternir la gloire d'un puissant royaume. Je la présente ici comme un abrégé des principes qui m'ont servi de règle. Ces causes de la ruine ou de l'affaiblissement des monarchies sont : les subsides outrés ; les monopoles, principalement sur le blé; le négligement du commerce, du trafic, du labourage, des arts et métiers ; le grand nombre de charges, les frais de ces offices, l'autorité excessive de ceux qui les exercent; les frais, les longueurs et l'iniquité de la justice; l'oisiveté, le luxe et tout ce qui y a rapport; les débauches et la corruption des mœurs; la confusion des conditions; les variations dans la monnaie; les guerres injustes et imprudentes ; le despotisme des souverains ; leur attachement aveugle à certaines personnes; leur prévention en faveur de certaines conditions ou de certaines professions ; la cupidité des ministres et des gens en faveur ; l'avilissement des gens de qualité; le mépris et l'oubli des gens de lettres j la tolérance des méchantes coutumes et l'infraction des bonnes lois ; la multiplicité des édits embarrassants et des règlements inutiles. »
A la vérité, Sully ne suivit pas toujours ses propres maximes, notamment lorsqu'il refusa de supprimer la douane de Valence, mais au moins y conforma-t-il sa conduite d'une manière générale. Il est regrettable que l'on en ait dévié plus tard pour favoriser, comme le fit Colbert, par exemple, les manufactures aux dépens de l'agriculture.
Ce fut en allant faire une visite à Sully, qui demeurait à l'Arsenal comme grand maître de l'artillerie, que Henri IV tomba sous le poignard de Ravaillac. Aussitôt après la mort de ce monarque, qui appréciait si bien ses services, Sully se démit de ses charges, et il se retira à la campagne, où il s'occupa de la rédaction de ses mémoires. Il était âgé alors de cinquante et un ans, et il avait administré pendant quatorze ans les finances. Louis XIII, à qui il allait quelquefois donner des conseils, lui conféra le titre de maréchal do France (1634). Sully mourut le 22 décembre 1641, dans sa terre de Villebord, en laissant la réputation d'un grand administrateur et d'un honnête homme, quoiqu'on lui reprochât de s'occuper un peu trop du soin d'augmenter sa fortune privée. Il avait été marié deux fois : d'abord, avec Anne de Courtenay, ensuite, avec Rachel de Cochefilet, qui lui survécut, et lui fit élever un magnifique tombeau à Nogent-le-Rotrou.
G. de M.
Mémoires de Sully, ou Économies royales, arrangés par l'abbé de l'Écluse.
« Nous possédons peu de monuments historiques aussi précieux que les mémoires de Sully, auxquels il a donne le titre d'Économies royales. C'est une narration étendue des événements du règne d'Henri IV, des opérations du gouvernement, surtout de celui que Sully dirigea. On y trouve d'intéressants détails sur la vie privée du roi, celle de son ministre et les intrigues de la cour. La forme du récit est des plus bizarres : les secrétaires de Sully racontent à leur maitre les circonstances de sa vie, qu'il devait certainement mieux connaître que personne. On a pensé que ces secrétaires si bien instruits sont des personnages supposés, mis en scène pour éviter à Sully l'embarras de raconter lui-même ses actions. Sully publia les deux premiers volumes en 1634. Le titre, sans date d'année, porte que l'impression a été fuite à Amsterdam ; mais elle eut lieu au château de Sully. C'est la première édition connue sous le nom d'édition aux VV verts, à cause des enluminures de la vignette. Le troisième et le quatrième tomes parurent à Paris, en 1602, vingt ans après la mort de Sully, par les soins du savant Jean Le Laboureur. Depuis ce temps, les réimpressions se sont multipliées.
« En 1743, l'abbe de l'Écluse eut l'idée d'arranger d'après un nouvel ordre, et en style moderne , ces mémoires, peu supportables par leur mauvaise rédaction. Ce travail n'est pas sans mérite, à cause des notes dont il est accompagné; mais la vérité de l'histoire y est trop fréquemment altérée par des suppressions, par la refonte générale des faits, des pensées et du style. Sully et les personnages du temps ne paraissent plus que sous le travestissement d'une physionomie moderne. »
(Biographie universelle, article Sully.)
« Ce livre sera éternellement digne d'être consulté, comme le point de depart des reformes économiques qui ont mis fin aux abus du moyen âge, et qui ont abouti à la révolution française. » (Blanqui.)
Endnotes to Sully
[18] Histoire de l'Économie politique, par Blanqui. T. I, chap. XXV.
Principle Articles
Beaux-arts↩
Source
"Beaux-arts," DEP, T. 1, pp. 149-57.
[149]
BEAUX-ARTS. Le goût du beau, c'est-à-dire le besoin d'un certain ordre, d'une certaine harmonie dans les choses qui affectent nos sens et notre intelligence, dans le son, dans la couleur, dans la forme, dans le mouvement, ce goût a donné naissance aux beaux-arts. Disposer ou façonner des sons, des formes, des couleurs, des mouvements de manière à leur faire produire une impression agréable sur les sens ou sur l'intelligence, tel est l'objet que se proposent le musicien, le peintre, l'architecte, le sculpteur, le poète, le danseur, ou, pour nous servir du terme générique, les artistes. Dans les dictionnaires spéciaux, on restreint communément le domaine des beaux-arts, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture et à la musique. Quelques-uns même ne donnent le nom d'art qu'à l'imitation par des moyens mécaniques de toutes les formes dans leur plus haut degré de beauté naturelle ou idéale. C'est ce que les Allemands nomment la plastique. Ce mot ne comprend que la réunion des arts qui tiennent à la connaissance du dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture avec la gravure et la mosaïque. [19] [150] Mais cette définition est évidemment trop étroite. Quand un musicien et une danseuse éveillent dans les âmes le sentiment du beau, celui-là par des sons harmonieusement cadencés, celle-ci par des mouvements expressifs et gracieux, ne sont-ils pas des artistes au même titre que le peintre, le sculpteur et l'architecte ? Peu importent la matière et l'instrument dont l'artiste se sert pour agir sur les sens et sur l'intelligence, pourvu qu'il réussisse à les émouvoir. Les beaux-arts pourraient donc être définis d'une manière générale : toute application du travail humain à la production du beau.
On trouve des beaux-arts chez tous les peuples, même chez les plus barbares; seulement, ils sont plus ou moins développés, plus ou moins parfaits, selon l'état de la civilisation et les aptitudes particulières du peuple auquel ils appartiennent. Les Grecs semblent avoir possédé au plus haut degré le goût du beau et les facultés nécessaires pour satisfaire ce besoin élevé des sens et de l'intelligence. Aussi la Grèce a-t-elle été, pendant longtemps, un merveilleux atelier où peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, poètes, s'occupaient à l'envi d'alimenter la passion dominante d'un peuple artiste. Quelques autres peuples, les anciens Mexicains, par exemple, semblent, au contraire, avoir été presque entièrement dépourvus du sentiment du beau. Autant les formes des statues et des monuments grecs sont belles, autant celles des statues et des monuments mexicains sont hideuses.
Les beaux-arts ne peuvent prendre un certain essor qu'après que les premiers besoins ont été satisfaits. La musique et la danse apparaissent vraisemblablement les premières. Tandis que l'art de l'architecte ou du sculpteur ne peut se développer avant que l'industrie du maçon ou du tailleur de pierres ait été créée, il suffit que l'homme fasse usage de ses jambes pour inventer la danse; il suffit, de même, qu'il déploie librement sa voix ou qu'il s'avise de souffler dans un roseau pour inventer la musique.
Dans son essai trop peu connu, Sur la nature de l'imitation dans les arts imitatifs, Adam Smith s'est livré à des conjectures ingénieuses sur l'origine de la musique, de la danse et de la poésie, comme aussi sur la manière dont les premiers progrès de ces différents arts ont dû s'opérer :
« Après les plaisirs qui naissent de nos appétits satisfaits, il n'en est point de plus naturels à l'homme que la musique et la danse. Dans la marche progressive de la civilisation et des arts, ces plaisirs sont les premiers peut-être qui soient de son invention : car on ne peut point dire qu'il invente ce qui dépend immédiatement de ses besoins et de ses appétits corporels. On n'a encore découvert aucune nation assez retardée dans ses progrès vers la civilisation pour être entièrement privée de ces arts d'agrément. Il semble même que c'est chez les nations les plus barbares que l'usage en est plus fréquent et la pratique plus universelle. C'est ce qu'on observe chez les nègres d'Afrique et dans les tribus sauvages d'Amérique. Chez les nations civilisées, les classes inférieures du peuple ont très peu de loisir, et les classes supérieures ont nombre d'autres amusements, en sorte que les unes et les autres n'ont pas beaucoup de temps à donner à la danse et à la musique. Chez les nations sauvages, le corps entier du peuple a fréquemment de grands intervalles de loisir, et à peine ces hommes simples ont-ils d'autres amusements : aussi ils se trouvent naturellement enclins à y consacrer une grande partie de leur temps. Ce que les anciens appelaient rhythme, ce que nous appelons temps ou mesure, est le principe de liaison entre ces deux arts. La musique consiste dans la succession d'une certaine espèce de sons ; la danse dans la succession d'une espèce de pas, de gestes et de mouvements, réglés de part et d'autre par le temps ou la mesure, et réduits par ce moyen en un seul tout ou système. C'est ce que dans l'un de ces arts on nomme un air, et dans l'autre une danse. Le temps ou la mesure de la danse correspond toujours exactement avec celui de l'air qui l'accompagne ou la dirige.
« La voix humaine, qui est toujours de tous les instruments le plus agréable, fut le premier et le plus ancien que les hommes purent employer. Lorsqu'elle s'éleva jusqu'au chant, ou qu'elle tenta du moins de produire ces accents nouveaux, elle dut naturellement employer des sons aussi semblables qu'il était possible à ceux auxquels elle était accoutumée, c'est-à-dire qu'elle dut employer des mots, quels qu'ils fussent, en s'appliquant seulement à les prononcer avec temps et mesure, et, en général, avec un ton plus mélodieux que celui de la conversation ordinaire. Ces mots ne durent probablement avoir d'abord aucun sens. Ils ressemblaient sans doute à ces syllabes dont on fait usage en solfiant, ou à celles qui terminent en refrain certaines chansons ou ballades. Ils servaient seulement à aider la voix à former des sons propres à être modulés en mélodies, et qu'on pût allonger ou raccourcir selon le temps ou la mesure de l'air. Cette forme grossière de musique vocale est de beaucoup la plus simple et la plus facile, et doit être la première et la plus ancienne qui ait été pratiquée.
« Dans la suite des temps on ne put manquer de remarquer qu'au lieu de ces mots insignifiants, et qu'on pourrait appeler musicaux, il était aisé de substituer des mots qui eussent quelque sens, et qu'il n'était point impossible de faire coïncider la prononciation de ces mots-là avec le temps et la mesure de l'air, aussi bien que celle des mots musicaux. De là l'origine du vers et de la poésie . » [20]
La peinture, la sculpture et surtout l'architecture n'ont pu se développer qu'avec l'auxiliaire des arts industriels. L'industrie du bâtiment a dû nécessairement précéder l'architecture. Celle-ci a servi à donner à chaque édifice le genre de beauté que comportent sa destination et les exigences locales. En architecture comme en littérature, le même style ne saurait convenir indifféremment à toute espèce d'œuvres. L'architecte est tenu de donner, par exemple, un caractère religieux à une église, un caractère profane à une salle de spectacle ou à une salle de danse. Le style gothique parait être jusqu'à présent celui qui s'approprie le mieux aux manifestations du sentiment religieux. Dans la [151] cathédrale gothique, la hauteur éthérée tes voûtes, les vastes profondeurs des nefs, le demi-jour mystérieux des vitraux s'associent aux accents profonds et solennels du plain-chant, aux sons graves et majestueux de l'orgue, pour éveiller dans les âmes le sentiment de la vénération. Le style bariolé de la renaissance est plus propre à exciter des sentiments mondains et profanes. Aussi le choisit-on de préférence pour les théâtres et pour les salles de danse.
Les propensions originelles des peuples ont naturellement exercé une grande influence sur le développement des beaux-arts. Un peuple religieux et mélancolique pouvait seul inventer l'architecture gothique ; et l'on retrouve dans l'architecture grecque ce cachet d'exquise élégance qui a marqué toutes les habitudes comme toutes les œuvres de la race privilégiée des Hellènes. Les habitudes maniérées et bizarres des Chinois se reflètent encore dans leur architecture aussi bien que dans leur costume.
Les nécessités du climat et la configuration du sol sont entrées pour beaucoup dans la formation des différents genres d'architecture, et elles en ont souvent déterminé le caractère. Des nécessités d'un autre ordre ont agi encore sur le développement de l'architecture et des autres arts.
De toute antiquité, on aperçut l'influence que les beaux-arts exerçaient sur les âmes, et l'on songea à l'exploiter. Pendant longtemps, on les considéra comme un instrumentum regni, comme un moyen de frapper et de soumettre les imaginations par la terreur ou le respect. Les constructions gigantesques des Assyriens et des Égyptiens, constructions dont nous cherchons vainement aujourd'hui l'utilité, n'eurent peut-être pas d'autre destination. Ces signes extérieurs de la puissance étaient nécessaires alors pour faire accepter à des peuples enfants la domination absolue d'une race ou d'une caste. Il fallait que ceux-là, qui se disaient les représentants de la Divinité sur la terre, se montrassent supérieurs aux autres hommes, en tout ce qui était considéré comme une manifestation de la force ou de la majesté. Le concours des beaux-arts leur était donc indispensable pour organiser la mise en scène de leur puissance. Ils en avaient besoin pour construire leurs temples et leurs palais, pour les orner de décors somptueux, pour composer leurs fêtes, pour façonner leurs vêtements et leurs armes. Les architectes, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les poètes ne leur étaient pas moins nécessaires que les soldats et les prêtres pour soutenir l'édifice imparfait et vicieux de leur domination. On s'explique ainsi le soin particulier que les gouvernements ont de tous temps apporté au développement des beaux-arts, et la protection fastueuse qu'ils leur ont accordée, le plus souvent au grand dommage des autres branches de la production.
Heureusement si, dans le passé, les beaux-arts ont été les puissants auxiliaires de la politique et de la religion, à mesure que les peuples se sont développés intellectuellement et moralement, à mesure que leur intelligence et leurs sentiments se sont agrandis et épurés, cette mise en scène a exercé moins d'influence sur les âmes, et les beaux-arts ont perdu de leur importance politique et religieuse. Le goût du beau, ce noble appétit de l’âme, a cessé peu à peu d'être exploité connue un instrument de domination.
Les économistes se sont posé, au sujet des beaux-arts, deux questions principales. Ils se sont demandé, d'abord, si les beaux-arts constituent une richesse pour les peuples ; en second lieu, s'il est nécessaire que le gouvernement intervienne pour les protéger.
Les produits des beaux-arts constituent-ils une richesse? En ce qui concerne les produits de l'architecture, de la peinture et de la sculpture, la réponse ne saurait être douteuse. Un édifice, une statue, un tableau sont des richesses matérielles dont l'accumulation augmente évidemment le capital d'une nation. Mais peut-on en dire autant des produits de la musique et de la danse? Peut-on regarder comme productif le talent du musicien et du danseur ? Adam Smith dit non, J.-B.Say et M. Dunoyer disent oui. Selon la doctrine de Smith, on ne doit pas donner le nom de produits aux choses dont la consommation a lieu au moment même de leur formation.
A quoi J.-B. Say répond avec raison, selon nous : «
« Si l'on descend aux choses de pur agrément, on ne peut nier que la représentation d'une bonne comédie ne procure un plaisir aussi réel qu'une livre de bonbons ou une fusée d'artifice, qui, dans la doctrine de Smith, portent le nom de produits. Je ne trouve pas raisonnable de prétendre que le talent du peintre soit productif, et que celui du musicien ne le soit pas. » [21]
Cependant si J.-B. Say reconnaît que le talent du musicien est productif, il n'admet pas que ses produits puissent contribuer à augmenter le capital d'une nation. Voici comment il motive son opinion à cet égard :
« De la nature des produits immatériels, dit-il, il résulte qu'on ne saurait les accumuler et qu'ils ne servent point à augmenter le capital national. Une nation où il se trouverait une foule de musiciens, de prêtres, d'employés, pourrait être une nation fort divertie, bien endoctrinée et admirablement bien administrée. Son capital ne recevrait de tout le travail de ces hommes aucun accroissement direct, parce que leurs produits seraient consommés à mesure qu'ils seraient créés . » [22]
Mais parce qu'un produit matériel ou immatériel est consommé immédiatement après avoir été créé, s'ensuit-il bien qu'il n'augmente pas le capital d'une nation? ne peut-il pas augmenter, sinon son capital extérieur, du moins son capital intérieur, pour nous servir de l'expression de Storch, le capital de ses facultés physiques, intellectuelles et morales? Une population privée des services des prêtres, des administrateurs, des musiciens et des poètes, une population à laquelle manquerait par conséquent l'éducation religieuse, politique et artistique, vaudrait-elle bien autant que celle qui se trouverait suffisamment pourvue de ces différents services ? L'homme, considéré à la fois comme capital et comme agent de la production, ne vaudrait-il pas moins là que partout ailleurs ?
[152]
Dans son traité De la liberté du travail, M. Charles Dunoyer a parfaitement démontré que la consommation des produits matériels ou immatériels des beaux-arts développe dans l'homme des facultés précieuses, essentielles; d'où il résulte visiblement que la production artistique, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, ne saurait être considérée comme stérile. [23]
Achevons cette démonstration de la productivité des beaux-arts au moyen d'une simple hypothèse. Supposons qu'on enlève à l'Italie ses musiciens et ses chanteurs, ne la privera-t-on pas d'une richesse, dût-on remplacer ces artistes par un nombre égal de laboureurs, de charpentiers ou de forgerons? L'Italie tire profit des œuvres de ses musiciens et de ses chanteurs absolument comme s'il s'agissait des produits de l'agriculture ou de l'industrie manufacturière. D'abord, elle en consomme une partie, et cette consommation sert à l'éducation du peuple italien, en développant son intelligence, en adoucissant et en polissant ses mœurs. Ensuite, une autre partie des produits des beaux-arts, dont l'Italie est la pépinière, s'exporte chaque année. L'Italie approvisionne de ses compositeurs, de ses musiciens et de ses chanteurs, un grand nombre de théâtres étrangers. En échange de leurs produits immatériels, ces travailleurs de l'art reçoivent d'autres produits purement matériels, dont ils reportent communément une partie dans leur pays. Quel laboureur, par exemple, aurait autant ajouté que Rossini à la richesse de l'Italie? Quelle couturière ou quelle chemisière, si habile et si infatigable qu'on la suppose, aurait valu la Catalani ou la Pasta, à ce même point de vue ? La production des beaux-arts ne saurait donc être considérée comme stérile pour l'Italie.
En résumé, les beaux-arts peuvent contribuer directement à augmenter le capital d'une nation, soit le capital matériel qui repose sur le sol, soit le capital immatériel qui réside dans les faculté physiques, morales et intellectuelles de la population. Ils sont, en conséquence, productifs au même degré et au même titre que toutes les autres branches du travail humain.
La production artistique s'opère aussi, comme toutes les autres, à l'aide d'accumulations antérieures, avec le concours du capital et du travail. Sous ce rapport, la production artistique n'offre rien de particulier si ce n'est qu'elle donne naissance, plus fréquemment qu'aucune autre, l'industrie agricole exceptée, à des monopoles naturels. Les grands artistes possèdent un monopole naturel, en ce sens que la concurrence qu'ils se font entre eux n'est pas suffisante pour limiter le prix de leurs œuvres au niveau de ce qui leur serait strictement nécessaire pour les exécuter. Jenny Lind est pourvue d'un monopole naturel, car la rémunération qu'elle obtient à cause de la rareté de sa voix, est de beaucoup supérieure à ce qui lui serait indispensable pour exercer son métier de chanteuse. La différence constitue une rente, laquelle est absolument de la même nature que la rente de la terre. Si la nature et l'art avaient produit un millier de Jenny Lind au lieu de n'en produire qu'une, il est évident que le monopole dont jouit celle-ci n'existerait pas ou qu'il serait infiniment moins productif. Les peintres, les sculpteurs et les architectes en réputation possèdent un monopole plus étendu encore, car il subsiste et se développe même principalement après leur mort. La valeur de ce monopole dépend du mérite de l'artiste et de la quantité de ses productions. Selon que l'œuvre d'un peintre ou d'un sculpteur est plus ou moins considérable , le prix des différents morceaux dont elle se compose demeure plus ou moins élevé. A mérite égal, les tableaux ou les statues des maîtres les moins féconds se vendent plus cher que ceux des maîtres dont les productions sont nombreuses. Ainsi, pour citer un exemple, un tableau ordinaire du peintre hollandais Hobbema se vend communément plus cher qu'un tableau ordinaire de Rubens, quoique Hobbema n'occupe point dans l'art un rang aussi élevé que Rubens. Mais l'un n'a produit qu'un petit nombre de tableaux, tandis que l'autre a laissé une œuvre immense. En supposant, de même, que les tableaux de M. Ingres et de M. Horace Vernet soient également prisés des amateurs, les premiers conserveront toujours une valeur vénale supérieure à celle des seconds, simplement parce qu'ils sont plus rares. Ces différences dans les prix des objets d'art et les variations que subit leur valeur échangeable, notamment lorsque la mode reprend un style ou un genre qu'elle avait délaissé, sont curieuses à étudier ; on y trouve des notions précieuses sur l'influence que les mouvements de l'offre et de la demande exercent sur les prix ; on y trouve aussi des données intéressantes sur la manière dont naissent, se développent et s'éteignent, à la longue, les monopoles naturels.
Après avoir examiné la question, longtemps débattue, de la productivité des beaux-arts, il nous reste à rechercher si ce genre de production doit être spécialement dirigé et encouragé par le gouvernement, ou s'il doit être abandonné à la libre activité des individus, comme tous les autres genres de production.
Les faits attestent que, dans l'antiquité comme dans les temps modernes, la protection que les gouvernements ont accordée aux beaux-arts n'a jamais été bien féconde. Les plus merveilleuses créations des arts ont été dues, de tout temps, à la libre initiative des particuliers.
Les Égyptiens et presque tous les peuples de l'antiquité condamnaient à l'esclavage leurs prisonniers de guerre et même quelquefois des peuples entiers qu'ils avaient subjugués. Ils se servaient de ces esclaves pour construire leurs monuments. On sait notamment que le peuple israélite travailla à la construction des pyramides. Mais les monuments égyptiens sont bien plutôt remarquables par leurs proportions gigantesques que par leur beauté. On s'aperçoit que le peuple, ou, pour mieux dire, la caste qui les a élevés, avait pour but de frapper les esprits plutôt que de les charmer. En Grèce, les produits des beaux-arts ont un tout autre caractère. Ils portent par-dessus tout le cachet de la liberté. L'art grec n'était pas inféodé, en effet, à un gouvernement ou à une caste. Le plus grand nombre des monuments de la Grèce ont été bâtis au moyen de dons volontaires. Le [153] fameux temple de Diane a Éphèse, par exemple, avait été édifié, à l'aide d'une contribution des républiques et des rois de l'Asie, à peu près comme Saint-Pierre de Rome le fut en partie des deniers de la chrétienté. Lorsque Érostrate l'eut réduit en cendres, on fit une nouvelle souscription pour le relever. Tous les citoyens d'Éphèse tinrent à honneur d'y contribuer. Les femmes sacrifièrent jusqu'à leurs bijoux. [24] A Delphes, le temple fut rebâti, de même, à frais communs, après un incendie. L'architecte Spantharus de Corinthe s'était engagé à le terminer pour la somme de 300 talents. Les trois quarts de cette somme furent fournis par différentes villes de la Grèce et l'autre quart par les habitants de Delphes, qui firent une quête jusque dans les pays les plus éloignés pour compléter leur contingent. Une famille d'Athènes ajouta même à ses frais des embellissements qui n'étaient pas dans le projet. La plupart des ornements du temple avaient été offerts par les villes de la Grèce ou par de simples citoyens. Treize statues de la main de Phidias étaient un don des Athéniens. Ces statues provenaient de la dixième partie des dépouilles enlevées par les Athéniens dans les champs de Marathon. Un grand nombre d'autres objets d'art rappelaient des victoires des différents peuples de la Grèce, dans leurs luttes intestines. [25]
Une partie du revenu des temples grecs était consacrée à l'entretien des prêtres, une autre partie à l'entretien et à l'embellissement des édifices. Les prêtres faisaient les plus grands sacrifices pour orner la demeure des dieux, et ces sacrifices étaient rarement improductifs, car, en Grèce comme ailleurs, les dieux les mieux logés étaient toujours ceux qui rapportaient le plus. Les beaux-arts se trouvaient encore alimentés par les rivalités de la foule des petits États entre lesquels se partageait le territoire grec. C'était à qui aurait les plus beaux temples, les plus belles statues, les plus beaux tableaux. Cette émulation poussée à l'excès engendra même plus d'un abus. Ainsi, il avait été convenu après l'invasion des Perses qu'une contribution serait levée désormais sur la Grèce pour subvenir aux frais de la dépense commune, et que les Athéniens en seraient les dépositaires. Périclès ne se fit pas scrupule de détourner ces fonds de la destination qui leur était affectée pour les employer à l'embellissement d'Athènes. Un si odieux abus de confiance indigna toute la Grèce contre les Athéniens, et il fut une des principales causes de la guerre du Peloponèse.
Moins heureusement doués que les Grecs, au point de vue artistique, les Romains ne s'imposèrent point des sacrifices aussi considérables pour faire fleurir les beaux-arts. A Rome comme en Egypte, les arts furent principalement employés à manifester aux yeux des peuples vaincus, la puissance et la majesté du peuple souverain. La construction des monuments des arts était encore pour les Romains un moyen d'entretenir leurs troupes dans l'habitude du travail et d'occuper leurs esclaves. Le goût du beau n'entrait pas pour beaucoup dans ces entreprises, et naturellement l'art s'en ressentait. Cependant, sous Auguste, il y eut à Rome un grand mouvement artistique, mouvement qui dut en grande partie sa naissance au développement des communications de Rome avec la Grèce. Auguste fit construire pour sa part, le portique d'Octavie, le temple de Mars Ultor, le temple d'Apollon, le nouveau Forum et plusieurs autres monuments de moindre importance. Ses amis, L. Cornificius, Asinius Pollion, Marcius Philippus, Cornélius Balbus, et entre tous son gendre Agrippa, firent élever aussi, à leurs frais, un grand nombre de monuments. S'attribuant, comme c'est assez l'habitude des souverains, tout le mérite de cette impulsion que les arts avaient reçue sous son règne, Auguste disait quelque temps avant sa mort : J'ai reçu une Rome de boue et je lègue à mes descendants une Rome de marbre. A Rome comme dans la Grèce, les statues étaient innombrables. La plupart des citoyens notables s'en faisaient élever à leurs frais. Les censeurs s'efforcèrent de leur enlever cette légère satisfaction, en défendant d'élever des statues à Rome sans leur permission. Mais comme cette défense ne s'étendait pas jusque sur les statues qui ornaient les maisons de campagne, les citoyens riches éludaient les ordonnances des censeurs, en multipliant leurs images au sein de leurs splendides villas.
A l'époque de la chute de l'empire romain, les barbares détruisirent avec une rage stupide les plus nobles chefs-d'œuvre de l'art ancien. Les beaux-arts disparurent alors avec la civilisation un moment éclipsée. Mais ils allaient bientôt renaître, grâce à l'expansion du sentiment religieux appuyé sur les libertés municipales. L'art gothique dut sa naissance et ses progrès au sentiment chrétien développé dans les communes émancipées du moyen âge. Chose que l'on ignore généralement, les frais de construction du plus grand nombre des magnifiques cathédrales qui décorent nos villes ont été en grande partie couverts par les offrandes volontaires des membres de la cité, nobles, bourgeois ou simples compagnons. Rien n'est intéressant, même au simple point de vue économique, comme l'histoire de ces merveilles de l'art gothique. A une époque où la pauvreté était universelle, il ne fallait rien moins que l'enthousiasme religieux pour décider les populations à s'imposer les sacrifices nécessaires pour les élever. Mais cet enthousiasme, on ne négligeait rien, non plus, pour le faire naître et pour l'échauffer. L'évêque et les simples prêtres prêchaient d'exemple en sacrifiant une partie de leurs revenus pour subvenir aux frais de construction de la cathédrale ; des indulgences sans fin étaient promises à tous ceux qui contribueraient à l'œuvre sainte, soit de leur temps, soit de leur argent. Au besoin, des miracles venaient réchauffer le zèle languissant des fidèles. En jetant un coup d'œil sur l'histoire de nos principales cathédrales, on pourra se convaincre qu'il ne fallut pas moins d'habileté diplomatique que de génie artistique pour mener à bonne fin ces grandes et religieuses entreprises. A Orléans, par exemple, saint Euverte ayant entrepris la construction de la première cathédrale dans le quatrième siècle, un ange révéla à ce pieux évêque le lieu même où il devait bâtir. En creusant les fondements de l’édifice, les ouvriers trouvèrent un trésor considérable, [154] et le jour même de la consécration de l'église, au moment où saint Euverte célébrait la messe, une nuée resplendissante parut au-dessus de sa tête, et de cette nuée sortit une main qui bénit par trois fois le temple, le clergé et le peuple assemblé. Ce miracle convertit plus de sept mille païens et mit l'église d'Orléans en grande réputation.
A Chartres, l'évêque Fulbert consacra d'abord trois années de ses revenus et de ceux de la manse capitulaire à la construction de la cathédrale (1220) ; il légua ensuite une somme considérable pour continuer les travaux. La pieuse Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant, s'associa à son œuvre, en fournissant la plus grande partie de la couverture de plomb de la cathédrale. Un médecin du roi Henri I er fit bâtir à ses frais un portail latéral. Ceux qui n'avaient pas d'argent donnaient leur travail. On vit des artisans de toutes les professions faire volontairement l'office de manœuvres dans cette entreprise bénie du ciel. Un grand nombre d'habitants de Rouen et des autres diocèses de la Normandie, munis de la bénédiction de leur archevêque ou de leur évêque, vinrent se joindre aux travailleurs. La troupe des pèlerins se choisissait un chef qui distribuait à chacun l'emploi qu'il devait exercer. Les travaux s'exécutaient avec recueillement, et pendant la nuit on mettait des cierges sur des chariots autour de l'église, et l'on veillait en chantant des cantiques.
A Strasbourg, de grandes indulgences furent promises aux fidèles qui contribueraient à la fondation de la cathédrale. Aussi les dons affluèrent-ils de toutes parts. Cependant la construction de ce magnifique édifice dura près de quatre siècles. Commencé dans le douzième siècle, il ne fut terminé que dans le quinzième. La construction de la cathédrale environna d'une haute considération les tailleurs de pierres de Strasbourg. Ces ouvriers, qui fournirent les plus grands architectes du temps, formaient déjà dans l'empire germanique, ainsi qu'en France, une corporation distincte de celle des maçons ordinaires. Jusqu'à la révolution française, ils demeurèrent chargés de l'entretien et de la conservation de la cathédrale de Strasbourg. [26]
On voit donc que nos cathédrales, c'est-à-dire les monuments les plus grandioses et les plus originaux que nous possédions, sont dues, en grande partie, au zèle et à la foi des particuliers. Quelquefois, sans doute, ce zèle et cette foi furent excités par des fraudes pieuses ; quelquefois aussi on s'adressa à l'orgueil des bourgeois et des artisans de la cité pour les engager à construire une cathédrale plus spacieuse et plus belle que celle d'une cité voisine et rivale; mais, en général, on n'eut point recours à des moyens coercitifs ; on n'établit point des impôts spécialement affectés à la construction des églises ; on se contenta des sacrifices que s'imposait généreusement le clergé et des dons volontaires des fidèles, et l'on réussit ainsi à multiplier les chefs-d'œuvre de l'art gothique à une époque de misère et de barbarie universelles.
En Italie, la constitution d'une multitude de petites républiques municipales fut singulièrement favorable aux développement des beaux-arts. Rivales pour le commerce, les républiques italiennes le furent aussi pour les arts. Les riches négociants de Gênes, de Pise, de Florence et de Venise se faisaient un point d'honneur de protéger les arts et de doter leurs cités de monuments magnifiques. Cet esprit d'émulation gagna les papes, et Rome disputa à Florence les grands artistes de l'Italie. La basilique de Saint-Pierre fut commencée ; mais comme les ressources ordinaires de la papauté ne suffisaient pas pour mener à bonne fin cette immense entreprise, on eut recours à une émission spéciale d'indulgences ; malheureusement ce papier d'une espèce particulière ayant été trop multiplié se déprécia, et il finit par être tout à fait refusé dans un grand nombre de pays chrétiens. Aussi la gigantesque basilique ne fut-elle jamais complètement terminée. — Avec la décadence politique et commerciale des républiques qui couvraient comme un réseau le sol italien , commença celle des beaux-arts en Italie. Jamais les encouragements du despotisme ne réussirent à leur restituer l'éclat dont ils avaient brillé au temps des républiques municipales du moyen âge et de la renaissance.
En France, Louis XIV jugea que le soin de sa grandeur l'obligeait à protéger les arts. Sous l'inspiration du grand roi, Colbert fonda l'Académie des beaux-arts. Par malheur, le grand roi et son ministre ne s'en tinrent pas à cette création. Louis XIV enfouit des sommes immenses dans ses demeures royales. Sous son règne, les beaux-arts devinrent les auxiliaires de la guerre pour accabler les peuples.
Dans sa savante Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, M. Pierre Clément estime à 165 millions, monnaie du temps, les sommes que Louis XÏV dépensa en bâtiments et en encouragements aux beaux-arts et aux manufactures. En voici le détail :
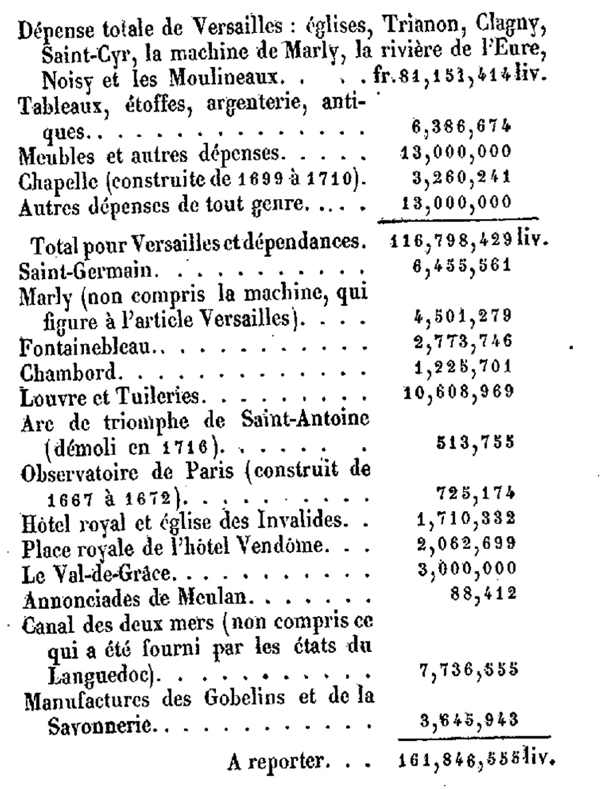
[155]
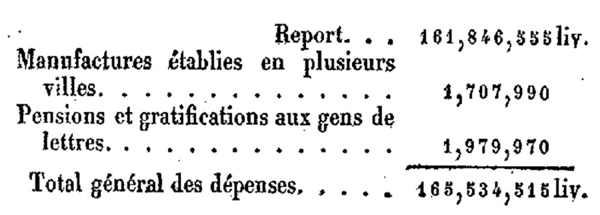
« Si l'on cherche, ajoute M. Clément, à se rendre compte approximativement de la valeur actuelle de cette somme et qu'on se contente de prendre pour base la moyenne du marc d'argent sous Louis XIV et en 1846, on trouve que les dépenses de ce roi, en bâtiments, encouragements et gratifications, représenteraient de nos jours 350 millions environ. Mais que l'on évoque un instant devant son imagination les seules merveilles de Versailles, et que l'on se demande ensuite si, exécutées de notre temps, toutes les constructions de Louis XIV ne coûteraient pas près de 1 milliard. » [27]
Cependant ces dépenses fastueuses ne contribuèrent en aucune façon aux progrès des beaux-arts. Sous Louis XIV, l'art ne fut qu'une réminiscence de l'antiquité ou de la renaissance. Dans le dix-huitième siècle, le goût, enchaîné par les règles immuables des Académies subventionnées, alla se corrompant de plus en plus. La révolution détruisit la protection officielle, mais elle eut le tort de ne pas s'en tenir là : les Vandales de celte époque portèrent leurs mains sacrilèges sur les chefs-d'œuvre du passé, comme s'ils eussent été suspects de royalisme. D'un autre côté, la ridicule imitation des institutions et des mœurs grecques et romaines, qui avait séduit alors toutes les imaginations républicaines, se reproduisit non moins ridiculement dans les arts. Au goût corrompu des Watteau, des Boucher et des Vanloo succéda le goût faux de l'école de David. Napoléon ne manqua pas de rétablir la protection officielle : « Je veux, écrivait-il à son ministre de l'intérieur, le comte Cretet, je veux que les beaux-arts fleurissent dans mon empire. » Mais les beaux-arts ne se pressèrent point d'obéir à l'injonction du despote, et l'époque impériale ne fut rien moins qu'artistique.
Depuis ce temps, on n'a point cessé de protéger officiellement les arts en France. Voici quel a été leur budget en 1849 :
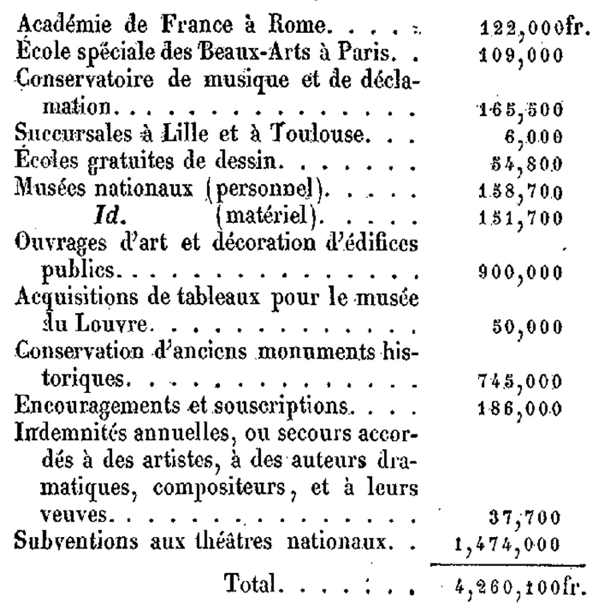
L'administration des beaux-arts dépend du budget de L'intérieur. Elle en constitue une division, dont le directeur est spécialement chargé de « faire fleurir l'art en France, » pour nous servir de l'expression de Napoléon. Au budget des cultes figurent encore quelques paragraphes qui concernent plus on moins directement les beaux-arts. Nous y trouvons en 1849 :
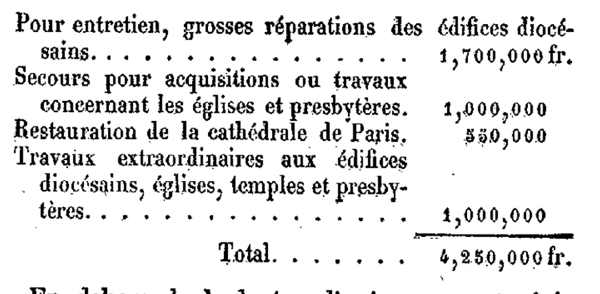
En dehors du budget ordinaire, on vote fréquemment des allocations pour construire ou achever des édifices dits nationaux, soit aux dépens du budget de l'État, soit aux dépens des budgets municipaux. Pour citer quelques chiffres, on a consacré extraordinairement 10 millions a la construction de l'Arc-de-Triomphe de l'Étoile, 11 millions 500 mille francs au palais du conseil d'État, 7 millions 500 mille francs à la Bourse, [28] 13 millions 400 mille francs à l'église de la Madeleine, 2 millions à Notre-Dame-de-Lorette.
La dotation que le gouvernement français accorde aux beaux-arts est donc assez considérable. Au moins si elle contribuait à les faire progresser! Mais en France comme partout, le progrès des arts s'est presque toujours accompli en dehors de la sphère gouvernementale. Parmi les tableaux qui ont été commandés depuis vingt ans par le gouvernement, pourrait-on citer une seule œuvre hors ligne ? Le genre historique et religieux, que l'on protège spécialement, est en pleine décadence ; le paysage, les tableaux d'intérieur, le genre proprement dit que le public seul subventionne en les achetant, sont en progrès. De même, si la construction des édifices publics laisse beaucoup à désirer, celle des maisons particulières a réalisé des progrès considérables sous le rapport de l'élégance et du confortable. On s'explique, du reste, parfaitement que le gouvernement ne soit pas apte à protéger les beaux-arts. Le gouvernement protecteur des arts se personnifie dans une administration et dans un ministre. L'administration est routinière de sa nature; le ministre, ancien avocat, professeur ou journaliste, n'acquiert pas nécessairement, en prenant possession de son portefeuille , le goût éclairé d'un Mécène ou d'un Médicis. D'ailleurs, il a bien d'autres affaires : il est obligé de correspondre avec les préfets, d'endoctriner les maires, de diriger la gendarmerie, de défendre à la tribune la politique du gouvernement. Le temps lui manque pour diriger ou surveiller l'emploi des fonds d'encouragement accordés aux beaux-arts. Il est forcé de s'en remettre pour cette besogne à des subalternes qui ne sont pas plus responsables qu'il ne l'est lui-même du bon emploi des subventions. Doit-on s'étonner, [156] après cela, si ces fonds d'encouragement si péniblement arrachés aux contribuables servent plutôt à alimenter l'intrigue et le savoir-faire qu'à encourager le mérite et le savoir ?
L'établissement d'une université subventionnée des beaux-arts a eu encore pour résultat de perpétuer les routines classiques et de provoquer une réaction souvent exagérée et excentrique contre ces routines. La guerre célèbre des classiques et des romantiques a eu pour cause principale la protection que le gouvernement accordait aux classiques. Ceux-ci voulaient conserver à toute force l'imitation du style grec ou romain, en affirmant que si l'on sortait de là, on tomberait dans la plus épouvantable anarchie. Leurs adversaires voulaient au contraire innover à tout prix, et n'importe de quelle manière, dût-on remplacer l'imitation de l'antique par celle du moyen âge ou de la renaissance : en présence des conservateurs classiques, ils représentaient assez bien les socialistes. Mais si le gouvernement ne s'était pas chargé de soutenir artificiellement les vieilles routines classiques, si l'enseignement et la pratique des beaux-arts avaient été complètement abandonnés aux frais et risques des particuliers, n’est-il pas probable que les errements du passé se seraient plus promptement modifiés et que la protestation du romantisme eût été moins violente, moins échevelée? Sans les abus et les routines de notre régime économique et administratif, eussions-nous vu apparaître le socialisme? La protection du gouvernement a donc été dommageable aux arts mêmes. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'elle l'a été davantage encore au trésor public : on a payé d'abord l'éducation et la subvention des artistes ; on a payé ensuite les édifices élevés par eux, et ces édifices renouvelés des Grecs et des Romains, ces édifices dont le style et l'aménagement ne convenaient ni aux nécessités de leur appropriation spéciale, ni aux exigences du climat, n'ont pas manqué d'être fort incommodes et de coûter fort cher.
« L'architecture, dit M. Horace Say, qui a vu de près les abus de cette branche du régime universitaire et protectionniste, s'enseigne à Paris, à l'École des Beaux-Arts. Pour obtenir admission dans cette école, il faut savoir faire un beau dessin ; tout le surplus est considéré comme fort peu utile. Pour en sortir avec honneur, il faut faire un dessin plus beau encore, et obtenir ainsi d'être envoyé aux frais du gouvernement à l'école que la France entretient à Rome. Arrivé sous le beau ciel de l'Italie, l'élève en architecture, camarade du peintre, du sculpteur, du musicien, sent s'épanouir son imagination ; il saisit son pinceau ; ses aquarelles prennent plus de vigueur ; il fait des ciels d'un bleu d'azur et reproduit toutes les ruines. Ayant atteint l'âge d'homme, il revient enfin en France, particulièrement familiarisé avec les usages d'un monde qui n'est plus, mais connaissant peu les besoins de notre époque; sachant fort peu de mathématiques, moins encore de physique, de chimie, de mécanique ; ayant peu songé à calculer les forces, le poids, les résistances des matériaux de construction, et n'ayant aucune idée de l'emploi qu'on est parvenu à faire en Allemagne ou en Angleterre du bois ou du fer, non plus que des méthodes employées en Prusse et en Russie pour faire fermer les portes et pour obtenir des logements chauds.
« L'artiste en architecture, après avoir ainsi répondu aux intentions du gouvernement qui a veillé sur son éducation, et qui ne lui demandait pas autre chose que ce qu'il a fait, cherche à se créer un nom par ses travaux, en imprimant à tout ce qu'il prépare ce cachet dont il a dérobé le secret dans là contemplation des ruines grecques ou romaines ; il veut arriver à son tour à l'Institut, et l'accès lui en sera rendu facile par la camaraderie de l'école de Rome ; en attendant, il a toute la bienveillance de la direction des beaux-arts au ministère de l'intérieur ; il devient membre du conseil des bâtiments civils, et peut dès lors contribuer à faire arrêter par un veto tout projet utile qui s'éloignerait de ce qu'il considère comme les règles classiques. On sait que la tutelle imposée aux communes veut qu'elles ne puissent élever une construction quelconque sans que les plans en aient été au préalable approuvés par le ministre ; or, le ministre ne donne son approbation qu'après avoir pris l'avis du conseil des bâtiments civils, et l'école classique en architecture, qui fournit généralement d'assez mauvais plans et des projets très incomplets, est encore ainsi en position de faire repousser tout ce qui ne vient pas d'elle ou des siens . » [29]
On voit donc que le monopole en fait d'arts ne vaut pas mieux qu'en fait d'industrie ou de commerce.
C'est une opinion vulgaire que la civilisation moderne n'est point favorable au progrès des beaux-arts. Comme preuve à l'appui de cette opinion, on cite les Anglais et les Américains qui, placés à la tête de la civilisation industrielle, sont demeurés dans un état d'infériorité déplorable au point de vue artistique. Mais on oublie que tous les peuples n'ont pas été doués de toutes les aptitudes, non plus que tous les sols n'ont été pourvus de toutes les fécondités. Tandis que certains peuples du Nord obtenaient en partage le génie industriel, les aptitudes artistiques devenaient le lot des peuples méridionaux. Certains pays ont été pendant des siècles les grands ateliers des beaux-arts, comme d'autres sont devenus ceux de l'industrie manufacturière. A mesure que les échanges internationaux acquerront plus de développement, cette division du travail se marquera davantage, et elle facilitera de plus en plus le progrès des beaux-arts, aussi bien que celui des arts industriels. Les progrès des arts seront accélérés encore par la généralisation de l'aisance qui augmentera leur débouché et par les progrès de l'industrie, qui mettront de nouveaux matériaux et de nouveaux instruments à leur disposition. On bâtira peut-être moins de palais, on peindra moins de batailles que dans le passé, mais on construira des gares de chemins de fer et des palais pour les expositions industrielles; on peindra les paysages splendides et grandioses du nouveau monde que la vapeur rend de jour en jour plus accessibles à nos artiste?, et l'on élèvera des statues aux hommes utiles après en avoir élevé aux conquérants. D'un [157] autre côté, l'emploi des matériaux légers, du fer et du verre, par exemple, rend possibles aujourd'hui des combinaisons artistiques inconnues aux anciens. L'emploi de nouveaux Instruments inventés ou perfectionnés par l'industrie donnera naissance à d'autres progrès : déjà la multiplication des instruments de musique n'a-t-elle pas l'ait faire un pas immense, à la musique instrumentale? Sous le rapport artistique comme sous tous les autres, la civilisation moderne est destinée vraisemblablement à dépasser la civilisation ancienne. Mais si la liberté a été la condition essentielle du progrès des arts dans le passé, elle le sera encore dans l'avenir. Comme toutes les autres branches de la production, plus encore à cause du caractère de spontanéité qui leur est propre et qui leur a valu le nom d'arts libéraux, les beaux-arts progresseront d'autant plus rapidement qu'ils seront plus tôt affranchis de toute protection et de toute entrave.
G. de Molinari.
Endnotes to Beaux-arts
[19] Dictionnaire de Millin : Article Beaux-Arts.
[20] Essai sur la nature de l'imitation dans les arts imitatifs. Œuvres posthumes, tome II, page 84.
[21] J.-B. Say, Traité d'économie, politique, livre 1er, chap. xiii.
[22] J.-B. Say, Traité d'économie, politique, livre 1er, chap. xiii.
[23] Voir le traité De la liberté du travail, par Ch. Dunoyer, livre IX, chap. iii.
[24] Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis, t. 1er , page 480.
[25] Ibid., page 288.
[26] Les cathédrales de France, par Chapuy et Jolimont.
[27] Pierre Clément, Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, page 201.
[28] Les frais de construction de la Bourse ont été couverts au moyen d'un impôt spécial levé sur le commerce de Paris.
[29] H. Say, Études sur l'administration de la ville de Paris, page 295.
Céréales↩
Source
"Céréales," DEP, T. 1, pp. 301-26.
[301]
I. DÉFINITION ET ORIGINE.
Aliments principaux d'un grand nombre de peuples, les céréales jouent un rôle considérable dans l'économie des sociétés. Cependant on n'est d'accord ni sur le nombre des végétaux qu'il convient de ranger sous cette dénomination, ni sur leur origine. Or désigne communément sous le nom de céréales le froment, l'épeautre, le seigle, l'orge et l'avoine ; mais quelques auteurs appliquent aussi ce nom générique au riz, au mais, au millet et au sarrasin. Selon les plus anciens monuments de l'histoire égyptienne, c'est près de Nysa ou Bethsané, dans la vallée du Jourdain, qu'Isis et Osiris trouvèrent à l'état sauvage le blé, l'orge et la vigne. Osiris découvrit la vigne, et Isis le blé. « C'est à Nysa, dit Diodore de Sicile, que Isis trouva le blé et l'orge croissant au hasard parmi les autres plantes, mais inconnus aux hommes. » C'est aussi dans la Palestine que, selon la Genèse, les céréales ont été découvertes et que l'agriculture a commencé. — Quelle que soit, du reste, la patrie des céréales, c'est-à-dire la contrée où elles croissaient et se multipliaient naturellement sans le secours de la culture, elles sont connues depuis plusieurs milliers d'années. On a retrouvé dans les tombeaux de la Thèbes égyptienne du blé et même du pain : ce blé et ce pain, qui ont trente ou quarante siècles d'existence, attestent encore que l'espèce n'a point changé.
Lorsque Isis en Egypte, Cérès et Triptolème dans la Grèce, eurent découvert les procédés artificiels de la culture du blé, les populations jusqu'alors errantes, en quête d'une subsistance précaire, se fixèrent sur le sol, et la civilisation prit naissance avec l'agriculture. Nous ne suivrons point le développement de la production agricole, ni les phénomènes économiques auxquels cette branche do la production générale a donné lieu. (Voir Agriculture, Esclavage, Fermage, Rente de la terre.) Nous nous bornerons à examiner spécialement les faits qui concernent le commerce des céréales et les législations diverses auxquelles ce commerce a été assujetti.
II. COMMERCE ET LÉGISLATION DANS L'ANTIQUITÉ.
Dans l'antiquité, le commerce des céréales était peu étendu : la difficulté des communications, l'insécurité des routes de terre et de mer apportaient alors des obstacles presque insurmontables au transport des denrées encombrantes. La plupart des substances alimentaires se consommaient sur les lieux mêmes de la production. Sous la domination romaine, l'Italie commença à tirer des quantités de blé assez considérables de l'Egypte et de la Sicile. Mais ces blés étaient, en grande partie, apportés à Rome à titre de tribut, et on les distribuait gratuitement au peuple souverain. — Ce fut en l'an de Rome 629 que Caïus Gracchus obtint une loi sur les céréales (lex frumentaria) pour faire distribuer aux citoyens pauvres du blé presque gratuitement, c'est-à-dire à raison de 5/6es d'as le modius, pesant 13 1/2 de nos livres. [30] Cette loi, dont les bons esprits du temps, Cicéron, Salluste, Jules César, Auguste, ont aperçu et déploré les inconvénients, subsista cependant jusqu'à la chute de l'empire romain ; elle fut motivée et en quelque sorte nécessitée par l'extension de la culture par les bras esclaves. Avant la dictature de César (an 105 de Rome), 320,000 citoyens romains sur 450,000 recevaient des distributions gratuites de vivres, sans parler de la sportule que les clients allaient mendier à la porte des riches patriciens. César réduisit à 150,000 le nombre des bénéficiaires de la loi de Caïus Gracchus; mais cette mesure rigoureuse ne put être longtemps maintenue. Il fallait bien donner la subsistance à cette foule de citoyens besoigneux qui n'avaient pour occupations que la politique et la guerre. Le peuple romain gouvernait le monde ; ne fallait-il pas que le monde nourrit le peuple romain? La Sicile fournissait une bonne partie des blés nécessaires aux distributions gratuites. On y prélevait une dime sur une partie des terres cultivées en blé ; en l'an 682 de Rome, cette dîme fournissait 3,000,000 de modius de blé. Une autre portion des terres cultivées en céréales n'était point soumise à la dime, mais ses propriétaires étaient forcés de vendre et de conduire chaque année à Rome, et à leurs frais, 800,000 modius de blé, dont le prix était taxé à 4 sesterces (fr. 1,12) le modius. La répartition de cette vente forcée se faisait entre tous les propriétaires qui jouissaient de l'exemption des dîmes ou des tributs. M. Dureau de la Malle évalue à 50,000 le nombre des citoyens romains qui trouvaient dans les blés de Sicile un aliment gratuit. Les autres provinces a blé fournissaient de même leurs contingents. Ces distributions gratuites ne manquèrent pas de devenir funestes à l'agriculture de la campagne romaine, qui ne trouvait plus de marché pour ses céréales.
« Il devint absolument impossible, dit M. de Sismondi, aux petits [302] propriétaires de se maintenir autour de Rome, et tout le reste des petits héritages fut vendu aux riches. L'abandon de l'agriculture s'étendit de proche en proche. La vraie patrie des Romains, l'Italie centrale, comme elle avait à peine achevé la conquête du monde, n'avait plus de population agricole. Dans les campagnes, on ne trouvait point de paysans pour recruter les légions, point de guérets pour les nourrir. De vastes pâturages, où quelques bergers esclaves conduisaient des milliers de bêtes à cornes, remplaçaient les nations qui avaient apprêté de nouveau.» triomphes à la république romaine. » [31]
Sous cette double influence de l'esclavage et des distributions gratuites, les famines se multiplièrent en Italie ; il y en eut de terribles sous Auguste et sous Tibère. On cite surtout celle de l'an 759 de Rome. Tibère fixa un maximum pour le prix du blé vendu au peuple, et il accorda aux marchands, à titre d'indemnité, deux sesterces en sus par modius. Ces deux sesterces étaient fournis par le trésor public. Plus tard, Dioclétien imagina d'établir un maximum sur la plupart des denrées de consommation ; mais comme ce maximum était fixé trop bas, les marchands cessèrent de vendre, les producteurs renoncèrent à produire, et une disette générale fut la conséquence de cette mesure anti-économique. En l'an 363 de J.-C, l'empereur Julien fit de nouveau, à Antioche, l'expérience du maximum, unie à celle des distributions gratuites.
« Il adopta , dit Gibbon , l'expédient dangereux et meurtrier de fixer la valeur du blé, qu'il ordonna, dans un temps de disette, de vendre à un prix qu'on n'avait guère connu dans les années les plus abondantes ; et pour fortifier ses lois de son exemple, il envoya au marché 420,000 modii, ou mesures, qu'il fit venir des greniers d'Hiérapolis, de Chalcis, et même de l'Egypte. Il n'était pas difficile de prévoir les suites de cette opération , et l'on ne tarda pas à les sentir. Les propriétaires ou les marchands cessèrent d'approvisionner la ville, et le peu de grains que l'on y amena se vendit au-dessus du prix fixé. » [32]
Cette nouvelle leçon, que la nature des choses donnait à des législateurs ignorants, devait être, comme on-le verra, suivie encore de beaucoup d'autres.
Pendant le moyen âge, le commerce des céréales fut plus restreint encore qu'il ne l'avait été dans l'antiquité. A cette époque d'oppression et de misère, la sécurité n'existait nulle part, si ce n'est dans quelques républiques municipales de l'Italie. L'Europe se trouvait morcelée en une multitude de petits États, dont les souverains s'arrogeaient le droit de taxer ou d'entraver à leur guise les transactions commerciales. Lorsqu'une spéculation leur paraissait avantageuse , ils ne manquaient pas non plus de l'exécuter pour leur propre compte. En 624, dit l'historien Cassiodore, Théodoric, roi d'Italie, ordonna à tous les magistrats des provinces de faire charger de grains les vaisseaux de l'État et de les expédier en France, où sévissait une famine.
« Vous en avez, lui écrivait-il, au delà de ce qui vous est nécessaire, et en les menant à des gens qui sont dans la disette, vous leur vendrez au prix que vous voudrez. Quand on négocie avec ceux qui sont rassasiés, c'est un combat perpétuel : ils veulent tout avoir à leur mot ; mais menez des vivres à ceux qui ont faim, ils les achètent sans marchander.» [33]
On voit que ce barbare n'entendait pas trop mal le commerce.
III COMMERCE ET LÉGISLATION EN FRANCE.
§ 1 er . Sous la monarchie.
En France, les baillis et les sénéchaux s'étaient, dès l'origine, arrogé le droit de défendre ou de permettre, chacun dans son ressort, la sortie des blés et des autres marchandises. Ils abusaient fréquemment de ce pouvoir arbitraire, soit en retenant les blés pendant que la disette sévissait dans les provinces voisines, soit en vendant à quelques particuliers le privilège exclusif d'exportation. Les marchands privilégiés étaient naturellement devenus odieux au peuple. Les jurisconsultes, qui partageaient, à leur égard, les ressentiments populaires, les désignaient sous toutes sortes de noms injurieux, tels que dardanarii (de Dardanus, fameux magicien qui pouvait, assurait-on, amener à son gré l'abondance ou la disette), pantopolœ, pantometaboli, sitocapeli, cociatores, cociones, sive coquini, ariblatores, directarii, aeruscatores, annonae flagellatores. On leur imputait presque toujours les maux de la disette. Quelquefois aussi on en accusait les démons. Dans une disette qui eut lieu du temps de Charlemagne, le bruit se répandit que les démons avaient dévoré la récolte de l'année, et que l'on avait entendu leurs voix qui signalaient les vices du temps. Charlemagne ordonna alors de faire rentrer exactement les dimes pour apaiser la colère du ciel. [34] Charlemagne défendit aussi l'exportation des blés, et taxa le prix du pain et du froment. Lorsque la féodalité commença à s'affaiblir, les rois s'efforcèrent d'enlever aux seigneurs ou à leurs délégués le droit de réglementer le commerce des grains. Ainsi, à son retour de la terre sainte, saint Louis fit un règlement général « pour réformer les abus du commerce des blés. » Un article de ce règlement portait que les baillis et sénéchaux ne défendraient point les transports du blé, du vin et des autres marchandises hors de leur territoire, si ce n'est en cas de grande nécessité, « et que cela soit jugé nécessaire par un bon et sage conseil non suspect; qu'après avoir fait ces défenses, elles ne seront révoquées que par un semblable conseil, et que, tant qu'elles subsisteront, ils n'en exempteront personne par grâce ou faveur. » [35] Bientôt les gouverneurs des provinces contestèrent absolument aux sénéchaux le droit de permettre ou d'interdire l'exportation dans leurs ressorts; mais, à défaut des seigneurs et de leurs délégués, les municipalités et les parlements continuèrent d'intervenir fréquemment dans le commerce des grains.
Les règlements du roi de France, concernant les blés, nous donnent une idée de ce que pouvaient être ceux des sénéchaux et des baillis, et nous expliquent en même temps l'état précaire des [303] approvisionnements pendant tonte la durée de la monarchie. Voici un aperçu chronologique de dite législation. — Sous Philippe le Bel, en 1304, année de disette, un recensement général des grains fut ordonné. A la suite de ce recensement, le blé fut taxé à un maximum de 20 sous le setier, mesure de Paris. Mais les marchands ayant alors resserré leurs grains et la disette s'étant accrue, l'ordonnance fut révoquée. On se borna à enjoindre aux laboureurs et aux marchands de ne garder que les quantités nécessaires à leur alimentation, et de porter le reste au marché. Défense fut faite en même temps à tout marchand de revendre du blé à un autre marchand. Défense fut faite encore d'enlever de Paris les grains qui y étaient apportés. En 1391, le système réglementaire se perfectionnant, on ajouta aux interdictions précédentes la défense d'acheter en dehors des marchés. En 1418, apparaît une nouvelle tentative de maximum : le prix du froment fut fixé à 72 s. parisis le setier, mesure de Paris; le méteil à 60 s., le seigle à 48 s. ; mais les marchands ayant représenté que ces prix ne couvraient pas leurs frais, que les provinces étaient pleines de soldats et de malandrins qui arrêtaient et rançonnaient les convois, on éleva le maximum : pour le froment, à 5 écus d'or; pour le méteil, à 72 s., et pour le seigle, à 64. Il est presque superflu d'ajouter que la disette n'en continua pas moins. En 1430, nouveau maximum : le froment est tarifé à 62 s., et le petit blé à 54. Le pain est taxé en proportion. En 1436, autre année de disette : on défend à Paris de faire des échaudés, des brioches et du pain blanc. Les boulangers sont invités à ne plus cuire que deux espèces de pain. En 1531 (ordonnance du 28 octobre), les défenses d'acheter ailleurs que dans les marchés sont renouvelées sous des peines sévères; les considérants de l'édit valent la peine d'être cités :
« Comme nous ayons esté avertis et informés que plusieurs personnages, par avarice et rapacité, non ayans Dieu, charité, ni le salut de leurs âmes devant leurs yeux, ont acheté grande quantité de tous bleds, les uns devant la cueillette et estant encore en verdure sur les champs; et les autres du populaire hors du marché et en leurs maisons pour mettre en grenier pour iceux vendre à leur plaisir et volonté, lorsqu'ils verront le peuple estre en nécessité. A cause de quoy, ainsi que notoirement se peut voir et connoistre, le bled s'est enchéri grandement et le peuple en a grande faute à nostre grand regret et déplaisir, lequel de tout nostre cœur et désir voulons soulager, supporter et faire vivre en paix, et empêcher que par tels moyens iniques et pervers ne soient travaillés et mis en nécessité. »
Ce langage atteste que les marchands de grains étaient aussi mal vus par le souverain que par le peuple. Bientôt on les soumit à des règlements plus sévères encore. Par un édit de 1587, édit inspiré par le chancelier de Lhospital et renouvelé en 1577, il est expressément défendu aux laboureurs, personnes nobles, officiers du roi, principaux officiers des villes, de faire le commerce des grains. Par le même édit, ceux qui se livraient à ce commerce étaient astreints à se faire enregistrer aux greffes royaux des lieux de leur domicile, sous peine d'amende et de confiscation des grains. Dans le siècle suivant, la réglementation fait de nouveaux progrès. En 1621, le lieutenant civil publie une ordonnance spéciale pour la police des grains à Paris. Il ordonne à toutes personnes qui voudront se livrer à ce commerce de faire enregistrer leurs noms et demeures au greffe du Châtelet; de déclarer le lieu et la quantité de leurs achats; de mener leurs grains au marché deux fois par mois au moins. Quant aux marchands forains, ils sont tenus de vendre leurs grains eux-mêmes, ou de se faire remplacer par des gens de leur famille. On leur accordait trois jours pour les vendre. Dans cet intervalle, ils en fixaient le prix, et ce prix une fois fixé, ils ne pouvaient plus l'augmenter. Si les grains n'étaient point vendus le troisième jour, on les mettait au rabais. Défense expresse était faite aux marchands, soit de les remporter, soit de les mettre en dépôt à Paris. Défense était faite en outre à tous marchands d'acheter des grains dans un rayon de dix lieues autour de Paris. D'un autre côté, les boulangers de Paris ne pouvaient aller faire leurs achats qu'à une distance de huit lieues. Il y avait, de la sorte, trois zones d'achats, du moins sur le papier. En dedans du rayon de huit lieues, les laboureurs ou les propriétaires, ne pouvant s'aboucher avec les marchands, venaient apporter eux-mêmes leurs blés au marché. Les boulangers achetaient ou étaient censés acheter directement entre huit et dix lieues; plus loin, les marchands étaient libres de commencer leurs opérations. Cette réglementation compliquée avait pour objet de mieux assurer l'approvisionnement de la capitale, et, comme bien on suppose, elle produisait un résultat tout opposé : Paris était l'endroit de France où les disettes étaient le plus fréquentes. — En 1629, les parlements de Bretagne et de Normandie défendirent de transporter des grains hors de leurs ressorts. Tous les marchands se portèrent dans la Beauce, l'Ile-de-France, le Vexin, le Valois, la Picardie et la Brie, qu'ils épuisèrent par leurs achats. L'approvisionnement de Paris se trouva compromis. Une assemblée générale de police eut lieu. On peut voir dans le Traité de la Police de Delamare le compte rendu de la séance de cette assemblée. Les opinions les plus réglementaires y dominèrent. A la suite de cette séance, une ordonnance fut rendue pour autoriser des commissaires à aller rechercher à Noyon, à Compiègne, à Soissons, les blés appartenant aux marchands de Paris. Il était enjoint à ceux-ci de conduire leurs blés à Paris, dans la quinzaine, sous peine de confiscation. C'est le système des réquisitions dont la révolution devait faire plus tard un si ample usage. En 1660, 61 et 62, années de disette, les ordonnances relatives au commerce des grains se multiplièrent. Le parlement interdit notamment, sous des peines sévères, les coalitions ou associations pour l'achat et la vente des blés. En 1662, le roi fit acheter pour 2 millions de blés dans les ports de la Baltique. Ces blés furent distribués dans Paris à raison d'un setier pour chaque famille pauvre, à 26 liv. le setier, tandis que le prix du commerce était de 50 liv. Des disettes terribles signalèrent la fin de ce siècle, et, [304] comme toujours, elles donnèrent occasion de renforcer encore le régime règlement aire. En 1692 et 93, on ordonna aux propriétaires ou fermiers d'ensemencer leurs terres, faute de quoi il était permis à toute personne étrangère de les ensemencer et de jouir de la récolte sans payer aucun fermage. On renouvelait encore l'obligation imposée aux marchands forains de vendre en personne leurs grains, et l'on motivait cette obligation d'une manière assez curieuse et originale :
« Il leur est défendu sous de grosses peines d'y employer aucuns facteurs ou commissionnaires. Ainsi les marchands de la ville et les forains se rencontrant ensemble sur les mêmes ports ou dans les mêmes marchés, les forains, toujours pressés de retourner à leur commerce ou à leurs affaires, lâchent la main , vendent à meilleur marché ... Cela sert encore à entretenir l'abondance, car plus tôt le marchand forain a débité ses grains, plus tôt il s'en retourne et en amène d'autres. » [36]
Ainsi vexés, les marchands forains finirent par confier aux marchands de la ville la vente de leurs denrées; en sorte que la concurrence qui existait entre les deux classes de marchands, à l'avantage des consommateurs, disparut tout à fait. En 1699, nouvelle famine et nouvel édit renouvelant et augmentant tous les règlements antérieurs. Le commerce des blés fut interdit de province à province. Mais ces mesures déplorables ne firent qu'accroître le mal, et nous voyons dans Vauban que les populations se trouvèrent alors réduites aux dernières extrémités. En 1709, nouvelle famine plus terrible qu'aucune des précédentes : la plus grande partie des blés furent gelés dans les sillons ; on aurait pu cependant remédier au mal ; mais l'autorité qui ordonnait naguère d'ensemencer les champs demeurés en friche défendit, cette fois, de renouveler les semis, et la famine devint inévitable.
« On crut d'abord, dit M. Joly de Fleury, avocat général au parlement, qui a laissé à cet égard une note pleine d'intérêt, on crut que le blé repousserait et l'on défendit de retourner les terres semées en blé pour y mettre de l'orge ; mais enfin le printemps étant venu, on connut qu'il n'y avait aucune ressource pour le blé que dans quelques provinces, telles que la basse Bretagne, la basse Normandie, la Guyenne où, le pays étant fort couvert, les neiges avaient résisté au vent, et les terres en étaient demeurées chargées. Dans le Perche et le Maine, il y eut aussi un quart d'année, et dans quelques autres provinces; mais dans toutes les plaines, l'Ile-de-France, la Beauce et les principales provinces furent tout à fait stériles, en sorte que le blé, qui avait valu l'année dernière 8 et 10 francs le setier, monta au mois de juillet à 55 francs. Quand on vit la stérilité, on permit, aux mois d'avril et de mars, de semer des menus grains. Quelques précautions que l'on prit, l'orge fut vendu jusqu'à 60 francs le setier. On les sema autant que l'on put; mais jusqu'à la récolte de l'orge, la misère fut à un point excessif, le blé étant monté à un prix exorbitant et la guerre désolant les peuples par des dépenses qu'il fallait prendre sur eux. »
A ces règlements établis communément en temps de disette, mais qui étaient fréquemment renouvelés, il faut joindre la défense de brasser de la bière et de la cervoise dans les mauvaises années. Nous trouvons à ce sujet des édits de 1263, 1416, 1482 et même de 1693. Par ce dernier édit, il fut défendu de brasser des bières blanches et doubles, de distiller des eaux-de-vie de grains, sous peine de confiscation et de 3,000 fr. d'amende. Le tiers des grains confisqués appartenait au dénonciateur et les deux tiers aux pauvres.
Venait enfin une législation essentiellement compliquée et variable sur les exportations. Quant aux importations on ne songeait pas encore à les interdire. L'état d'avilissement et d'oppression où se trouvait l'agriculture, joint aux obstacles de toute nature qui entravaient la circulation et le commerce des blés, les rendaient insignifiantes. Souvent même on les sollicitait par des gratifications et par des primes. En revanche, les exportations étaient réglementées et taxées depuis un temps immémorial. Désignées sous le nom de traites foraines, elles se trouvaient déjà soumises à un droit sous les rois de la première race. En 1488, Charles VIII fixa ce droit à six deniers pour livre du prix des denrées qui se tiraient du diocèse de Paris, et à un sou pour celles qui se prenaient ailleurs. François 1er le régla à un écu d'or le tonneau. L'écu était une pièce d'or à vingt-trois carats, du poids de 71 1/6 au marc. Il valait, en ce temps la, 45 sous. Le tonneau contenait 6 setiers, mesure de Paris, ou 1,300 litres. Les grains exportés en fraude étaient confisqués. Sous François II, en 1559, un bureau de huit commissaires fut chargé d'accorder ou de refuser des passeports pour la sortie des grains, selon l'abondance ou la pénurie des récoltes. En 1567, Charles IX rendit une nouvelle ordonnance à ce sujet. Le roi ordonnait : 1° qu'il ne se ferait aucune traite hors du royaume sans sa permission accordée par lettres patentes, sous peine de punition corporelle, de confiscation et de 500 liv. parisis d'amende; 2° que les gouverneurs, sénéchaux, baillis avertiraient tous les ans le roi de l'abondance ou de la stérilité de leurs provinces ; 3° que les traites de province à province seraient libres. En juin 1571, un édit fut encore rendu au sujet de l'exportation, et dans cet édit le roi proclamait solennellement son droit d'accorder seul des permis d'exportation.
« Celte faculté et puissance d'octroyer des congés et permissions pour le transport des grains hors le royaume est de droit royal et du domaine de la couronne, incommunicable à quelque personne que ce soit. »
En conséquence, le roi défend indistinctement à tous ses sujets d'accorder de ces permissions ou de transporter des grains en fraude, sous peine de crime de lèse-majesté ; puis il insiste sur la nécessité de mettre un frein à des exportations abusives :
« Désirans pourvoir aux excessifs et démesurez transports qui se font journellement des bleds hors notre royaume, dont en provient bien souvent grande faute et nécessité à nos sujets, estant, par une si débordée licence et insupportable avarice, la graisse et fertilité de nos provinces [305] commuées en une fréquente nécessité cl cherté, jusqu'à être quelquefois nos sujets contraints faire venir des bleds des pays étrangers, avec infinis frais et dépenses; chose où nous voulons donner ordre de ne retomber, s'il est possible, pour le trop grand intérêt et préjudice que cela apporte a Nous et à nos dits sujets. »
Henri III renouvela en 1577 la défense d'exporter sans une permission spéciale, et il défendit l'exportation en Picardie et en Champagne, où l'on souffrait de la disette. Henri IV prohiba l'exportation par un édit du 12 mars 1595, mais il la rétablit en 1598. Sully, qui comprenait que l'agriculture serait d'autant plus prospère qu'elle posséderait des débouchés plus vastes, se montrait partisan de la liberté d'exportation. Il écrivait à Henri IV, au sujet d'un arrêt rendu par les magistrats de Saumur contre la sortie des blés : « Si chaque juge du royaume en fait autant, bientôt vos sujets seront sans argent et par conséquent Votre Majesté. » Sous Louis XIII, en 1631, l'exportation fut de nouveau défendue. Louis XIV débuta par accorder la permission d'exporter. Un arrêt du conseil, rendu pendant l'administration de Fouquet (24 janvier 1657), motivait cette permission sur ce que « les habitants des provinces, étant contraints de vendre le blé à vil prix, n'avaient pas de quoi payer leurs tailles et autres impositions. » [37] Mais, sous Colbert, les mesures réglementaires prévalurent au dehors comme au dedans. Vingt-neuf arrêts furent rendus au sujet de l'exportation, dans la seule période de 1669 à 1683.
« Durant cette période de quatorze ans, dit M. Pierre Clément, l'exportation fut prohibée pendant cinquante-six mois. Huit arrêts l'autorisèrent en payant les 22 livres par muid fixées par le tarif de 1664, cinq en payant la moitié ou le quart de ces droits et huit avec exemption de tous droits. Mais il faut remarquer que les autorisations d'exporter n'étaient accordées que pour trois et six mois, et rarement pour un an. La plupart des édits de prohibition étaient motivés sur la nécessité de maintenir l'abondance dans le royaume et de faire subsister avec plus de facilité les troupes pendant les quartiers d'hiver.»
A quoi Boisguillebert et Forbonnais objectaient avec raison qu'en n'accordant que des permis limités et en rendant ainsi le débouché instable, on décourageait les cultures et on diminuait le produit sur lequel le pays aurait pu compter en temps de disette.
Cette législation, qui soumettait le commerce intérieur aux règlements les plus vexatoires, et le commerce extérieur au régime précaire des permissions temporaires, continua de prévaloir dans la première moitié du dix-huitième siècle. Enfin, en 1763, grâce aux nouvelles lumières économiques que les physiocrates commençaient à répandre, grâce aussi aux durs enseignements de l'expérience, on sentit la nécessité d'adopter un régime plus libéral. Par une ordonnance du 25 mai, permission fut accordée à tous, nobles, bourgeois ou laboureurs, de faire librement le commerce des grains, farines et légumes dans toute l'étendue du royaume, en exemption de tous droits, même de ceux de péages ; par d'autres ordonnances en date de juillet et novembre 1764, la sortie des grains du royaume fut autorisée moyennant un droit d'un demi pour cent, lorsque le blé n'aurait pas atteint la limite de 12 liv. 10 sous le quintal. Au-dessus de cette limite, l'exportation demeurait suspendue. Seuls les règlements relatifs à l'approvisionnement de Paris étaient maintenus. L'administration des blés du roi, qui avait pris naissance sous Louis XIV, fut aussi conservée et elle devint malheureusement la source des plus criants abus. Le contrôleur général Laverdy, le même qui avait rétabli la liberté de la circulation et du commerce des blés, afferma la gestion de ces blés à une compagnie. Le capital de cette compagnie était de 180,000 fr. divisés en 18 sous d'intérêt. Les opérations commencèrent le 1 er septembre 1765, sous la direction du nommé Malisset, ancien boulanger meunier. En 1766, la part attribuée à chaque sou d'intérêt fut de 2,000 livres, ce qui faisait 20 p. 100 de bénéfice. Ce chiffre n'était pas exorbitant, mais la compagnie n'en devint pas moins odieuse, d'abord parce qu'elle était seule autorisée alors que les associations ou les coalitions entre marchands de grains continuaient d'être défendues ; ensuite parce qu'elle opérait avec les fonds de l'Etat et qu'elle faisait, en conséquence, une concurrence meurtrière au commerce ordinaire. Enfin on prétendit que les principaux personnages de l'État, et le roi lui-même, se trouvaient intéressés dans ses opérations. Un secrétaire du clergé, M. Leprevost de Beaumont, qui eut connaissance de certaines stipulations secrètes du marché, osa les dénoncer au parlement. Mais cette dénonciation ne devait être funeste qu'à son auteur. Arrêté le 17 novembre 1768, Leprevost de Beaumont fut jeté dans les prisons et il y demeura jusqu'en 1789. Turgot supprima la manutention des blés du roi et il fit vendre tous les grains qui restaient en magasin (environ 170,000 setiers). Mais, en attendant, le gouvernement marchand de grains avait jeté dans ce commerce une perturbation funeste et il avait encouru, mérité peut-être, le reproche d'exploiter à son profit la faim du peuple. Le pacte de famine devait devenir plus tard un grief redoutable dans la bouche des révolutionnaires. [38] La politique libérale qui avait été inaugurée en 1763 et 64 demeura en vigueur pendant six ans ; niais, en 17 67, les récoltes ayant été mauvaises, on ne manqua pas de rendre la liberté responsable de la cherté du blé. Le parlement, qui était le foyer des traditions réglementaires et qui avait presque toujours suggéré les mesures les plus restrictives, s'assembla à diverses reprises pour protester contre la police récemment établie. Ses remontrances étant demeurées sans résultat, le prévôt des marchands convoqua, à son instigation, le 28 novembre 1768, une assemblée générale de police comme il s'en était déjà tenu pour traiter le même sujet en 1630, [306] 1693 et 94. Cette assemblée se composait de la réunion des diverses chambres du parlement, du lieutenant de police, du prévôt des marchands et des échevins, de quatorze députés du clergé, de quinze représentants des métiers et du commerce de Paris, de quatorze notables, des fermiers généraux et des directeurs de l'hôpital général. Le procès-verbal de la séance, qui a été conservé, [39] prouve à quel point les doctrines réglementaires étaient alors populaires. Les attaques les plus vives furent dirigées contre les « théoriciens » qui avaient provoqué un changement dans la législation, notamment contre l'abbé Baudeau, et deux ou trois voix à peine s'élevèrent pour les défendre. A la vérité, les physiocrates (voyez ce mot), envisageant de préférence la question au point de vue des intérêts agricoles, avaient eu le tort de prétendre que la liberté du commerce et de la circulation aurait pour résultat d'exhausser les prix, et cette erreur devait naturellement rendre leur doctrine impopulaire auprès des consommateurs des villes. On ne manqua pas de les accuser de vouloir affamer le peuple dans l'intérêt des propriétaires et des marchands. Ces derniers furent également fort malmenés par les principaux orateurs de l'assemblée, qui dénoncèrent leur cupidité, leur avarice et leurs manœuvres malfaisantes.
« Celui qui, sans être fermier, dit un maître des comptes, M. Clément, fait de grands amas de cette denrée, qui l'achète de toutes parts pour la vendre à un prix excessif à ses concitoyens, est regardé comme coupable par toutes les ordonnances ... Cruel par lui-même contre l'indigent, qu'il traîne à une mort affreuse et lente, le monopoleur se présente avec un air de commisération pour ses concitoyens : à l'entendre, c'est pour secourir une province qu'il cherche des blés de toutes parts ; il les offre même dans les marchés, mais des gens affidés les ramènent dans ses magasins, jusqu'à ce qu'il ait obtenu le prix excessif fixé par son avarice ... Il n'est pas possible, concluait-il, que le monopole des fermiers avares, ou des commerçants avides, exerce sa cruauté, et qu'il soit indomptable sous les yeux de tant de magistrats éclairés, et sous l'autorité d'un gouvernement sage et paternel. Il est juste que le pauvre triomphe de l'injustice des monopoleurs, sous le règne d'un monarque qui voudrait essuyer les larmes de tous ses sujets, et dont le cœur est plein de tendresse et d'amour pour ses peuples . » [40]
L'avocat général Séguier, le même qui protesta au nom du parlement contre la suppression des maîtrises et des jurandes, ainsi que la plupart des autres orateurs, parlèrent dans le même sens. L'assemblée conclut en demandant, à la presque unanimité, l'abrogation des lois de 1763 et 64. En conséquence, le parlement présenta au roi ses très humbles remontrances sur la législation établie. Mais, à son tour, le roi, dont la liberté du commerce avait augmenté les revenus, le roi tint bon.
« L'augmentation des prix, répondit-il au premier président qui portait la parole au nom du parlement (11 décembre 1768), est l'effet des craintes inspirées par les mauvaises saisons, des inquiétudes des esprits faibles ou prévenus, des artifices des gens intéressés ou mal intentionnés, de l'aisance même des laboureurs, cette portion si précieuse de mes sujets. D'après ces considérations, je ne juge pas à propos de changer une loi en matière si délicate, surtout au moment où l'exportation est défendue par la loi même qui l'autorise. Ce changement ne produirait aucun bien, et pourrait à l'avenir être nuisible à mes sujets.» [41]
Cependant la cherté ayant continué, l'abbé Terray, alors contrôleur général, fit révoquer les précédents édits (1770) et rétablir les anciennes lois. A cette occasion Turgot lui adressa, de son intendance de Limoges, ses éloquentes Lettres sur le commerce des grains, dans lesquelles il sut, beaucoup mieux que les autres économistes, défendre la bonne cause par de bons arguments. Mettant sa doctrine en pratique, Turgot maintint dans son intendance la libre circulation des blés, et cette mesure contribua efficacement à la préserver des horreurs de la disette. Dans la même année parurent les fameux Dialogues sur le commerce des blés, de l'abbé Galiani. Le spirituel abbé napolitain mit sa plume légère et piquante au service des doctrines réglementaires, sans toutefois les défendre d'une manière absolue. Un des économistes, l'abbé Morellet, se chargea de réfuter Galiani. Malheureusement la Réfutation des Dialogues sur le commerce des blés, [42] supérieure pour le fond au livre de Galiani, n'était ni aussi légère ni aussi attrayante, et elle fut beaucoup moins lue. A quelques années de là (en 1775) Necker publiait encore son livre sur la législation et le commerce des grains, où les vieilles pratiques réglementaires de l'administration se trouvaient justifiées et couvertes du vernis de la philanthropie. On verra plus loin quelle influence désastreuse ce livre et son auteur exercèrent sur l'alimentation publique, dans un des moments les plus critiques de notre histoire. Pendant la durée de cette guerre de plume, à laquelle le public prit un intérêt passionné, Louis XV mourut. A peine monté sur le trône, le nouveau roi, que les doctrines si pures et si progressives des économistes avaient séduit, appela aux affaires l'auteur des lettres sur le commerce des grains. Devenu contrôleur général des finances, Turgot s'empressa de faire rapporter les ordonnances restrictives de l'abbé Terray. En vertu d'un édit du 13 septembre 1774, et de plusieurs autres édits subséquents, la liberté du commerce des grains et farines fut rétablie à l'intérieur, les droits d'octroi sur les blés furent supprimés, ainsi que diverses autres dispositions restrictives de la législation. Comme l'année était mauvaise, le gouvernement se réservait de statuer sur la liberté de la vente à l'étranger lorsque les circonstances seraient devenues plus favorables. Pour donner une idée des privilèges et des monopoles locaux qui s'étaient successivement constitués aux dépens de la subsistance du peuple, et que Turgot entreprit de détruire, nous citerons deux exemples : A Lyon, on avait laissé s'établir une corporation de [307] boulangers qui empêchait presque complètement l'introduction du pain fabriqué au dehors, et qui s'était, du consentement de l'autorité municipale, arrogé le privilège de vendre le sien à un prix supérieur. A Rouen, une compagnie de cent douze marchands avait seule le droit d'acheter les grains qui entraient dans la ville, et son monopole s'étendait même jusque sur les marchés d'Andelys, d'Elbeuf, de Duclair et de Caudebec, les plus importants de la province. Venait ensuite une compagnie de quatre-vingt-dix officiers porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, qui avaient seuls le droit de transporter les blés. Venait enfin la ville elle-même qui exploitait, avec un raffinement de combinaisons vexatoires, cinq moulins jouissant du droit de banalité, dont elle était propriétaire. [43] Turgot fit main basse sur ces abus, mais ce ne fut pas sans soulever de vives colères. Les monopoleurs et les courtisans, dont il compromettait la subsistance, cherchèrent avidement une occasion pour le dépopulariser et le perdre. Cette occasion se présenta bientôt. La récolte de 1774 avait été médiocre. Le prix des grains haussa, sans atteindre cependant une limite fort élevée, au commencement de 1775. A l'occasion de cette hausse, des troubles éclatèrent en Bourgogne, puis à Pontoise, à Versailles et à Paris. L'émeute paraissait combinée à l'avance, et les émeutiers obéissaient visiblement à un mot d'ordre : tantôt ils achetaient les subsistances, tantôt ils les enlevaient de force, mais toujours pour les détruire. Ils brûlaient les granges, coulaient à fond les bateaux de blé, et interceptaient les arrivages par la basse Seine et l'Oise. Une de leurs bandes arriva à Versailles, le 2 mai, en demandant à grands cris que l'on abaissât le prix du pain. Le roi eut la faiblesse de céder à cette injonction, et il ordonna de réduire la taxe à deux sous la livre. Encouragés par ce succès, les agitateurs se rendirent à Paris où ils se mirent à piller les boutiques des boulangers, et à jeter à l'eau les sacs chargés sur les bateaux à blé. Le lieutenant de police les laissa faire, et l'on prétendit que le parlement, ainsi que plusieurs hauts personnages, encourageaient sous main le désordre. Le roi avait défendu aux troupes de tirer sur les émeutiers, et le parlement avait fait afficher dans Paris un arrêté qui défendait les attroupements, mais qui portait que le roi serait supplié de diminuer le prix du pain. Turgot comprit la nécessité d'employer des mesures énergiques pour dompter la mauvaise volonté des uns et la faiblesse des autres. Il fit placarder sur l'arrêté du parlement une ordonnance qui interdisait d'exiger le pain au-dessous du cours ; il força ensuite le parlement lui-même, dans un lit de justice tenu le 5, à enregistrer une proclamation du roi, qui attribuait la répression de la révolte à la juridiction prévôtale. Enfin, il fit poursuivre les émeutiers dans toutes les directions, par un corps de 25,000 hommes sous les ordres du maréchal de Biron, assura ainsi la subsistance de la capitale, et remplaça le lieutenant de police Lenoir, qui avait pactisé avec l'émeute, par l'économiste Albert. Un marchand de grains, dont les bateaux avaient été pillés, fut immédiatement indemnisé. [44] Les mesures vigoureuses de Turgot mirent fin à cette échauffourée, qui est connue sous le nom de guerre des farines; les approvisionnements purent se faire régulièrement et l'abondance reparut; mais les ennemis du ministre novateur ne s'en montrèrent que plus ardents à le perdre. Le livre déclamatoire et vide de Necker, sur la législation des grains, fut porté aux nues en haine de Turgot, et l'un des amis du banquier genevois, le marquis de Pezai, se mit à faire contre Turgot et les économistes une série de pamphlets et de caricatures. [45] Voltaire vint au secours du ministre que la coalition des privilégiés et des envieux s'efforçait de perdre, et il leur décocha son étincelante Diatribe à l'auteur des Éphémérides. Cependant, malgré l'appui de Voltaire et de tous les esprits libéraux, Turgot succomba sous la coalition formidable qui s'était formée contre sa politique réformatrice. Abandonné par le faible Louis XVI, il quitta le ministère un an après l'épisode de la guerre des farines (12 mai 1776), et le plus grand nombre de ses réformes disparurent avec lui.
§ 2. Législation pendant la révolution et sous l'empire.
En 1788, l'archevêque de Brienne, qui avait adopté les maximes libérales des économistes, autorisa l'exportation. Les récoltes avaient été bonnes, et l'abondance régnait dans le pays. Mais le 13 juillet 1788 une grêle dévasta les récoltes aux environs de Paris, et l'hiver, qui commença de bonne heure, sévit avec une rigueur cruelle. M. Necker, de retour au ministère, crut que le moment était venu d'appliquer le système qu'il avait développé dans son déplorable livre de la législation et du commerce des blés. Il ordonna à toutes les autorités des provinces de prendre des informations sur le produit de la récolte. Ce recensement dressé à la hâte ayant accusé un déficit, Necker s'empressa de prendre des mesures pour assurer les approvisionnements. L'exportation fut défendue par un édit du 7 septembre 1788, complété par d'autres édits du 23 novembre 1788 et du 22 avril 1789; l'ancienne obligation de ne vendre et de n'acheter que dans les marchés fut renouvelée ; des primes furent accordées à l'importation ; en outre, on autorisa les commissaires envoyés dans les provinces et les magistrats de police a faire au besoin approvisionner les marchés par ceux qui auraient des blés en grenier, et à prendre des informations sur « les approvisionnements auxquels on pourrait avoir recours dans les moments où la liberté du commerce ne suffirait pas. » Ces mesures étaient motivées sur la nécessité d'empêcher « les achats et les accaparements entrepris uniquement en vue de profiter de la. hausse des grains. » En même temps, M. Necker faisait faire pour le compte du gouvernement des achats considérables sur les marchés étrangers. Pourtant, s'il faut croire Arthur Young, qui voyageait alors en France, ces précautions, qui redoublaient partout les alarmes, étaient dirigées contre un fantôme, car la récolte n'était pas au-dessous de celle d'une année ordinaire.
« Partout où je passai, dit-il (et je traversai plusieurs provinces), je m'informai des causes de la disette, et l'on [308] m'assura dans tous les endroits que la cherté du grain était la chose du monde la plus extraordinaire ; que, quoique la moisson n'eût pas été abondante, cependant c'était une moisson ordinaire, et conséquemment qu'il fallait que le manque de grains eût été occasionné par l'exportation. Je leur demandai s'ils étaient sûrs qu'on en eût beaucoup exporté; ils répondirent que non, mais que cela avait pu être fait secrètement : ces réponses prouvaient assez que les exportations étaient chimériques. » [46]
En effet, les exportations et les importations s'étaient balancées en 1787 avec un petit excédant en faveur des importations, et en 1788 les exportations n'avaient enlevé au pays qu'une quantité relativement insignifiante (662,723 q. m. dont il faut déduire encore 181,174 q. m. pour les importations). Mais si la disette n'était d'abord qu'un fantôme, les imprudentes mesures du ministre en firent bientôt une réalité. L'alarme devint universelle, et le blé haussa rapidement jusqu'à 50 et 57 liv. le setier. M. Necker multiplia alors ses achats à l'étranger. En six mois, à partir de l'automne de 1788, il ne dépensa pas moins de 45,533,697 liv. en achats de grains. Il se procura ainsi 1,404,863 quintaux de grains, ou 585,192 setiers (à 240 liv. le setier), quantité à peine suffisante pour nourrir, pendant un an, 195,064 individus. A 3 setiers par tête et par an, pour une population de 26 millions d'âmes , dit Arthur Young, ce secours si vanté n'aurait pas suffi pendant trois jours à la France. Il y aurait eu un déficit de 55,908 setiers, car la consommation journalière de la France était estimée alors à 213,700 setiers par jour. Or ces achats qui étaient d'un si faible secours, mais qui signifiaient « que le roi était obligé de nourrir lui-même son peuple, » ne pouvaient manquer d'accroître la panique, ainsi que l'atteste Arthur Young.
« Lorsque M. Necker fit venir en France pour trois jours de provisions de pain, remarque ce judicieux observateur, dans un moment où il était revêtu de tout l'appareil de l'autorité, le prix haussa à ma connaissance, dans les marchés, de 25 p. cent. Quelle pouvait être l'importance de trois jours de subsistances ajoutées à celles du pays, en comparaison de la misère et de la famine que ces mesures occasionnèrent? N'aurait-il pas été infiniment plus sage de n'avoir jamais mis d'entraves au commerce des grains, qui n'avait jamais été qu'un commerce d'importation? de n'avoir jamais témoigné aucune inquiétude? de n'avoir jamais fait aucune démarche publique, mais d'avoir tranquillement souffert que les besoins et les secours se rencontrassent sans bruit et sans ostentation? Par cette conduite, M. Necker aurait épargné 45 millions à l'État, et prévenu la mort de plusieurs milliers d'hommes, que la hausse du prix fit périr, quoiqu'il n'existât réellement pas de disette; car je suis persuadé que si l'on n'avait pris aucune mesure publique, et que l'édit de l'archevêque de Sens n'eût pas été révoqué, le prix du blé n'aurait été, en 1789, à 30 liv. dans aucune partie de la France, au lieu qu'il s'éleva jusqu'à 50 et 57 livres. » [47]
Ce fut au milieu de cette famine et des émeutes qu'elle suscita sur tous les points du pays, [48] que l'assemblée nationale se réunit. La question des subsistances avait déjà occupé les électeurs, et, dans la plupart des cahiers, des vœux avaient été émis sur cet objet. La plupart de ces vœux témoignaient, il faut bien le dire, de l'ignorance la plus profonde. Ainsi, par exemple, le tiers état de Meudon demande « que, comme la France est exposée aux rigueurs de la famine, chaque fermier soit obligé de faire enregistrer ses récoltes de toute espèce : gerbes, bottes, muids, etc., avec la quantité qu'il vend tous les mois. » Le tiers état de Paris veut « que l'exportation du grain soit sévèrement prohibée, ainsi que sa circulation d'une province à une autre, et que son importation soit toujours permise. » Le tiers état de Reims demande « que l'on fasse les lois les plus sévères contre les monopoleurs qui désolent actuellement le royaume. » Il n'y a pas moins de douze cahiers qui réclament un règlement contre l'exportation, et quinze se prononcent en faveur de l’établissement de magasins publics ou greniers d'abondance. Cependant l'assemblée constituante montra plus de lumières en matière de subsistances que les électeurs qui l'avaient nommée et que le gouvernement lui-même. Aussitôt qu'elle se trouva constituée (juin 1789), elle nomma un comité des subsistances, pour préparer un décret sur la matière. Ce comité choisit l'économiste Dupont de Nemours pour son rapporteur. Dupont de Nemours déposa son rapport le 4 juillet, et, le 29 août, l'assemblée rendait un décret qui renouvelait la défense d'exportation, mais qui garantissait en même temps la liberté de la circulation à l'intérieur. D'autres décrets du 28 septembre et du 5 octobre 1789, du 30 avril 1790, furent rendus encore dans le même sens. Un serment, dit fédératif, fut exigé des gardes nationales, qui jurèrent d'assurer partout la libre circulation des subsistances. Sauf la défense d'exportation, ces mesures étaient excellentes ; malheureusement un mémoire de M. Necker venait de redoubler encore la panique. Ce « mémoire instructif, remis de la part du roi au comité des subsistances » (juin 1789), peignait la situation avec les couleurs les plus sombres, dans le but visible de relever le mérite des mesures que le ministre avait prises pour assurer la subsistance du pays. Les marchands de grains, déjà en butte aux suspicions et aux haines populaires, s'y trouvaient dénoncés d'une manière formelle : « Les accaparements, disait le ministre, sont la première cause à laquelle la multitude attribue la cherté des grains, et en effet on a souvent eu lieu de se plaindre de la cupidité des spéculateurs. » Comme ce langage, dans la bouche d'un ministre alors populaire, devait rassurer les marchands de grains! M. Necker déclarait encore que le roi ne mangeait plus à sa table que du pain mêlé de seigle et de froment. « Quelles [309] conséquences le peuple devait-il tirer de ces assertions, dit Arthur Young, si ce n'est que la France étant réduite à cette extrémité, tout le monde était dans un danger imminent d'éprouver une famine? »
Bientôt la circulation et le commerce des grains se trouvèrent partout entravés ou interrompus. On n'entendait que récits de séditions occasionnées par la disette.
« Au mois de mars 1789, dit M. Ed. Fleury, qui a recueilli des renseignements pleins d'intérêt sur la disette dans le département de l'Aisne, les habitants de Quessy, à bout de patience, envahirent les fermes des cultivateurs, les greniers des marchands, arrêtèrent de force les convois qui s'en allaient vers Chauny pour embarquer les blés destinés à la nourriture de Paris. » [49]
Or que fit M. Necker sur la nouvelle de cette émeute? Au lieu de rétablir la liberté de la circulation, il autorisa le département de Soissons « à ne plus permettre aucun enlèvement qui pourrait nuire à la subsistance de la population. » Les municipalités accroissaient le désordre en intervenant dans les opérations du commerce, et parfois même en taxant les blés. A Guise le blé fut taxe à 12 liv. le jallois, tandis qu'il se vendait 15 ou 16 fr. sur les marchés environnants. «Les marchands disparurent aussitôt, dit M. Fleury, et l'administration municipale dut pourvoir elle-même aux besoins de la cité, au moyen d'une vingtaine de muids achetés à grands frais et à grand'peine. » Partout les marchands étaient traqués comme des bêtes fauves.
Quand on ne taxait pas les blés, on les pillait.
« Chaque village, dit M. Fleury, était un long défilé périlleux, chaque montagne un coupe-gorge, chaque chemin creux un traquenard où le marchand courait risque de la fortune et de la vie. On cite le sonneur de Saint-Thomas, auprès de Corbeny, qui s'était donné pour mission de sonner le tocsin sur chaque blatier se hasardant à traverser le village. » [50]
Dans beaucoup d'endroits, les gardes nationales, oubliant le serment fédératif, se rendaient en armes sur le passage des convois, et se faisaient céder les blés au-dessous du prix courant. Lorsque les cultivateurs ou les blatiers s'avisaient de résister à ces exactions odieuses, ils étaient maltraités et dépouillés. [51] A Paris, la municipalité insurrectionnelle, qui s'était organisée lors de la prise de la Bastille, avait établi un comité des subsistances, lequel se hâta de faire acheter des masses de blés sur les marchés avoisinants, où les prix subissaient des hausses effrayantes par suite de ces achats irréguliers, et où le peu de sécurité des communications empêchait ensuite de renouveler les approvisionnements. Les gros convois étaient protégés par de vastes déploiements de la force armée ; mais il n'était pas aussi facile de protéger, en présence d'une population pleine d'alarmes, les petits envois destinés à combler les vides que ces grands enlèvements avaient causés. La municipalité de Paris eut encore le tort de taxer le pain à un taux inférieur à celui de la farine et du blé. L'administration était obligée, en conséquence, d'approvisionner elle-même les boulangers au-dessous du cours; et comme le bas prix du pain attirait à Paris la foule des consommateurs de la banlieue, sa tâche devenait de jour en jour plus lourde. Le 5 octobre 1789, le pain manqua chez les boulangers. Les femmes coururent aussitôt à l'hôtel de ville pour se plaindre aux représentants de la commune. Alors Maillard, voulant détourner le danger, dit M. Thiers, les engagea à se rendre à Versailles pour demander du pain au roi, à ce roi « qui avait le mérite de nourrir son peuple » , selon M. Necker. Elles suivirent, comme on sait, le conseil de Maillard. Après ces funestes journées, on eut encore à déplorer le meurtre du boulanger François, assassiné le 28 octobre. Mais, grâce à la fermeté des autorités qui firent saisir et condamner les assassins; grâce aux mesures prises par l'assemblée pour faire respecter la liberté de la circulation, la tranquillité se rétablit un peu et les inquiétudes s'apaisèrent. L'assemblée constituante s'efforça constamment, il faut le dire à sa louange, de maintenir la liberté du commerce des grains, et elle cassa à diverses reprises des arrêtés municipaux qui la restreignaient. Malheureusement, la force lui manqua souvent pour faire exécuter ses décrets. — En 1792, après l'insurrection du 10 août, les communications ayant été partout interrompues, la disette commença de nouveau à se faire sentir. A peine réunie, la convention, ne se rendant pas bien compte de la cause du mal, ordonna un recensement général des grains. Roland, alors ministre de l'intérieur, s'efforça d'empêcher l'accomplissement de cette déplorable mesure, ainsi que de plusieurs autres qui étaient conseillées ou en cours d'exécution. En octobre et novembre, il adressa à la convention nationale et à la municipalité de Paris plusieurs lettres remarquables en faveur de la libre circulation des blés et de la non intervention du gouvernement et des municipalités dans les approvisionnements.
«La seule chose peut-être, disait-il, que l'assemblée puisse se permettre sur les subsistances, c'est de prononcer qu'elle ne doit rien faire, qu'elle supprime toute entrave, qu'elle déclare la liberté la plus entière de la circulation des denrées, qu'elle ne détermine point d'action, mais qu'elle en déploie une grande contre quiconque attenterait à cette liberté. » [52]
Roland s'élevait avec énergie contre les entraves qui étaient apportées à la libre circulation. Dans certains départements, disait-il, le prix du grain s'élève jusqu'à 64 liv. le setier, par suite des entraves artificielles apportées à la circulation, tandis qu'ailleurs le prix ne dépasse pas 25 à 26 liv. Il démontrait ensuite que le recensement ordonné redoublerait les alarmes de la population, au lieu de les calmer.
« Si l'appréciation est infiniment au-dessous de la vérité, disait-il ; si ce que nous possédons en grains est amoindri d'un tiers, d'une moitié ; si, d'après cette donnée vicieuse, il en résulte que la France n'a, je le suppose, que pour six mois de subsistances, quel champ vaste ouvert aux inquiétudes, aux agitations! Les maux de l'imagination que l'assemblée législative a voulu [310] prévenir ne deviendront-ils pas plus dangereux et plus irrémédiables? » [53]
L’opinion de Roland fut soutenue au sein de la convention par les modérés et les girondins. Barbaroux, Valazé, Joseph Serre, Julien Souhait, Lequinio parlèrent en faveur de la liberté de la circulation (novembre 1792). Malheureusement, les montagnards n'étaient pas fâchés de saisir cette occasion de nuire à leurs adversaires politiques, en les accusant de faire les affaires « des accapareurs. » Robespierre prononça un discours perfide et haineux, comme il savait en faire, pour demander compte au ministre de la subsistance du peuple.
« Vous devez, disait-il, soumettre à un examen sévère toutes les lois faites sous le despotisme royal, et sous les auspices de l'aristocratie nobiliaire, ecclésiastique ou bourgeoise ; et jusqu'ici vous n'en avez point d'autres. L'autorité la plus imposante qu'on nous cité est celle d'un ministre de Louis XVI , combattue par un autre ministre du même tyran. J'ai vu naître la législation de l'assemblée constituante sur le commerce des grains; elle n'était que celle du temps qui l'avait précédée; elle n'a pas changé jusqu'à ce moment, parce que les intérêts et les préjugés qui en étaient la base n'ont point changé ... Les auteurs de la théorie de la liberté du commerce, ajoutait-il, ont compté pour beaucoup les profits des négociants ou des propriétaires, et la vie des hommes à peu près pour rien. Et pourquoi? C'étaient les grands, les ministres, les riches qui gouvernaient. Si c'eût été le peuple, il est probable que ce système aurait reçu quelques modifications. »
Voici maintenant de quelle manière l'orateur montagnard posait le problème à résoudre en matière de subsistances :
« Il faut, disait-il, assurer à tous les membres de la société la jouissance de la portion des fruits de la terre, qui est nécessaire à leur existence, aux propriétaires et aux cultivateurs le prix de leur industrie, et livrer le superflu à la liberté du commerce. »
Pour atteindre ce but, Robespierre se ralliait à deux mesures qui avaient été proposées : la première consistait à constater la quantité de grains produite dans chaque canton, et récoltée par chaque propriétaire ou cultivateur ; la seconde, à forcer les marchands ou les cultivateurs à vendre exclusivement leurs grains dans les marchés et à défendre tout transport des achats pendant la nuit. Lorsque la subsistance de chacun se serait trouvée assurée par ces deux procédés, lorsque le nécessaire aurait été garanti à tous les citoyens, on aurait abandonné le reste à la liberté du commerce. Robespierre ne manquait pas d'assaisonner son opinion des injures les plus violentes contre les monopoleurs, et de dénoncer perfidement comme les complices de ces « assassins du peuple » les partisans de la liberté du commerce.
« Quel remède nous propose-t-on? disait-il. Le système actuel. Je vous dénonce les assassins du peuple, et vous répondez : Laissez-les faire! ... Je n'ôte aux riches et aux propriétaires aucune propriété légitime; je ne leur ôte que le droit d'attenter à celle d'autrui. Je ne détruis point le commerce, mais le brigandage des monopoleurs ; je ne les condamne qu'à la peine de laisser vivre leurs semblables. »
Et comme péroraison :
« Riches égoïstes, sachez prévoir et prévenir d'avance les résultats terribles de la lutte de l'orgueil et des passions lâches contre la justice et contre l'humanité. Que l'exemple des nobles et des rois vous instruise. Apprenez à goûter les charmes de l'égalité et les délices de la vertu, ou du moins contentez-vous des avantages que la fortune vous donne, et laissez au peuple du pain, du travail et des mœurs. »
Un autre montagnard, S.-B. Lejeune, dépassant encore Robespierre, commençait ainsi son discours :
«Voulez-vous détruire les terribles effets de la famine artificielle qui se fait sentir autour de vous? ayez le courage de remonter jusqu'à la cause de ce fléau. La cause du mal existe dans les murs de cette ville , elle est dans la tour du Temple : faites tomber sur l'échafaud la tête de Louis XVI, et le peuple aura du pain. »
Qu'on se représente l'effet que devaient produire ces discours imprimés par ordre de la convention, et répandus dans toutes les parties du territoire par les soins des sociétés populaires.
La majorité eut beau se prononcer en faveur de la liberté de la circulation, qui aurait osé faire circuler des blés, après les terribles Imprécations de Robespierre et de ses séides contre les accapareurs, assassins du peuple? La situation alla donc s'aggravant : le blé devint de jour en jour plus rare et plus cher. Le commerce en était presque détruit faute de sécurité, et, d'un autre côté, il devenait de jour en jour plus difficile de faire accepter des assignats par les marchands. On rendit une loi qui punissait de six ans de fers tout individu qui vendrait du numéraire, c'est-à-dire qui établirait une préférence de prix entre le numéraire et les assignats ; mais cette loi ne fit qu'aggraver la situation. Partout les marchands refusaient leurs denrées, à moins qu'on ne leur en donnât un prix proportionné à la dépréciation des assignats. Ou bien il fallait leur rendre pleine liberté à cet égard, ou bien il fallait les forcer de livrer leurs denrées à un prix déterminé ou maximum. On employa ce dernier parti, et l'on établit d'abord le maximum sur les grains. La convention résista longtemps à cette mesure funeste, et les jacobins eux-mêmes lui vinrent en aide ; mais enfin elle fut obligée de céder, comme toujours, devant les clameurs populaires. La loi du 4 mai, qui établit le maximum, est un résumé de toutes les lois réglementaires qui avaient été rendues depuis Philippe le Bel. En vertu de cette loi, tout marchand, propriétaire ou cultivateur, était tenu de déclarer à la municipalité les quantités de grains qu'il possédait. Les fausses déclarations étaient punies de la confiscation des grains. Les ventes ne pouvaient avoir lieu ailleurs que dans les marchés, sous peine d'une amende de 300 à 1,000 liv. qui était encourue par le vendeur et l'acheteur. Les corps administratifs et municipaux étaient autorisés à requérir, chacun dans son arrondissement, tous marchands, cultivateurs ou propriétaires à garnir les marchés. Ils pouvaient également requérir les ouvriers pour battre les gerbes, en cas de refus des propriétaires. Nul ne pouvait, sous peine de confiscation, se soustraire aux réquisitions, à moins de prouver qu'il ne possédait [311] pas assez de grains pour sa propre consommation Jusqu'à la récolte. Tout individu se livrant au commerce des grains était obligé d'en faire la déclaration à la municipalité. On lui délivrait un extrait de cette déclaration, qu'il était tenu d'exhiber dans les marches , où des officiers publics écrivaient en marge les quantités qu'il avait achetées, Il était obligé aussi de tenir des registres portant les noms des personnes à qui il avait acheté et vendu. Dans les lieux où il achetait, on lui délivrait un acquit-à-caution signé du maire et du procureur de la commune. Dans les lieux de vente, on lui en donnait une décharge avec les mêmes formalités ; après quoi il était tenu de représenter son acquit-à-caution dans les lieux d'achat : le tout sous peine de confiscation et de 300 à 1,000 liv. d'amende. A cela près, «la libre circulation » était maintenue. Enfin la loi ordonnait l'établissement d'un maximum. Pour fixer ce maximum, les directoires des districts avaient adressé à ceux des départements les mercuriales des marchés de leurs arrondissements depuis le 1 er janvier jusqu'au 1 er mai. Le prix moyen devait servir de maximum. Le maximum devait décroître ensuite dans les proportions suivantes : au 1 er juin, il devait être réduit d'un 10 e , d'un 20 e sur le prix restant au 1 er juillet, d'un 30° au 1 er août, d'un 40 e au 1 er septembre. Tout citoyen convaincu d'avoir vendu ou acheté au-dessus du maximum était passible d'une amende de 300 à 10,000 liv. Ceux qui étaient convaincus d'avoir gâté ou perdu volontairement des grains étaient punis de mort ; 1,000 fr. étaient accordés aux dénonciateurs. Comme bien on suppose, cette loi, qui rendait tout commerce à peu près impossible, n'améliora pas la situation. Les plaintes continuèrent ; mais, selon l'habitude, on continua aussi de mettre tout le mal sur le compte des accapareurs : imputation absurde ; car, en ce temps où le moindre amas de grains devenait suspect, les accapareurs n'existaient et ne pouvaient exister que dans l'imagination populaire. Ce qui le prouve, du reste, c'est que dans tout le cours de la révolution on ne réussit pas à découvrir une seule « manœuvre d'accaparement. » [54] Le commerce, qui n'est qu'une série d'accaparements (voyez ce mot), le commerce était détruit, et l'administration s'était attribué en fait le monopole des approvisionnements. Or, qui donc aurait osé faire concurrence à ce terrible monopoleur? Qui aurait eu l'audace de braver les pénalités formidables dont il punissait les moindres infractions à ses lois et règlements? Cependant on n'en imputa pas moins aux accapareurs un mal qui provenait précisément de l'absence des accaparements, et Collot d'Herbois fit un rapport foudroyant contre ces sangsues du peuple.
« Quoi de plus nuisible, disait Collot, que cette ligue barbare qui médite jour et nuit tous les genres d'assassinats, et surtout l'assassinat des pauvres! car c'est assassiner le pauvre que de lui ôter, par d'horribles spéculations, les moyens de pourvoir à ses besoins les plus pressants : la nourriture et le vêtement. La nature est abondante et libérale, et les accapareurs s'efforcent continuellement, par des attentats sacrilèges, à la rendre stérile et impuissante. La nature a souri à notre révolution, et l'a sans cesse protégée ; et les accapareurs, d'accord avec les tyrans nos ennemis, machinent chaque jour des calamités et des moyens de contre-révolution : ils craignent que le véritable ami de la liberté, le vertueux indigent, n'ait trop de sang à verser pour cette belle cause, etc., etc.»
A la suite de ce rapport, un décret draconien fut rendu contre les accapareurs (27 juillet 1793). En vertu de ce décret, l'accaparement était déclaré crime capital ; les accapareurs étaient punis de mort et leurs biens confisqués. Le tiers du produit des marchandises dénoncées appartenait au dénonciateur. Tout détenteur de marchandises de première nécessité était tenu de les déclarer à la municipalité, et d'en afficher le tableau devant sa porte. Il devait déclarer ensuite s'il consentait ou non à vendre ces denrées en détail, à tout venant et sans interruption, sous l'inspection d'un commissaire délégué à cet effet. S'il n'y consentait point, les officiers municipaux mettaient la marchandise en vente pour son compte, en la tarifant au prix courant. Mais cette loi, qui fut encore renforcée plus tard (12 germinal an II), n'était pas de nature à rendre les approvisionnements plus faciles. Les plaintes redoublèrent. Alors on renouvela, sous les peines les plus terribles, la défense d'exporter; on aggrava la loi du 4 mai (décret du 11 septembre 1793 sur les subsistances); on fixa uniformément le prix des blés à un maximum de 14 liv. le quintal , le transport en sus, mais à un prix également maxime ; enfin on établit une commission des subsistances et des approvisionnements, qui fut chargée de pourvoir à l'alimentation du pays, soit par des achats de gré à gré, soit par des réquisitions ou des préhensions. Composée d'abord de trois membres, puis de cinq, ayant voix au conseil, cette commission acquit bientôt une importance extraordinaire. Obligée de suppléer au commerce que les décrets révolutionnaires avaient détruit, elle dépensa jusqu'à 300 millions par mois, et elle eut à son service plus de dix mille employés. Seule, elle eut le droit d'exercer des réquisitions (décret du 24 pluviôse an II) et de diriger les approvisionnements d'un département à un autre. Elle ordonna des achats considérables de grains à l'étranger, et ces grains qu'elle achetait au prix moyen de fr. 21 en argent, elle les revendait au prix maximum de fr. 17 en assignats. Aussi, lorsqu'elle fut dissoute, quinze mois plus tard (7 janvier 1795), son déficit s'élevait-il à 1,400 millions. Et pourtant son insuffisance à pourvoir à l'alimentation publique était telle, qu'on agita sérieusement la question d'ordonner un jeûne général et un carême civique. [55] Des dilapidations scandaleuses avaient lieu dans cette immense et informe administration. En outre, soit par la négligence des employés, soit par le défaut de moyens de transport, des amas de blés, ou d'autres aliments qui avaient été mis en réquisition, pourrissaient dans ses dépôts. Jamais, en un mot, expérience plus désastreuse ne fut faite ! au régime des approvisionnements par l'État. Heureusement, le 9 thermidor mit fin à ce régime, dont la prolongation aurait ramené la [312] France à la barbarie. Toutefois, la réaction procéda avec lenteur. La loi du maximum (voyez ce mot), d'abord modifiée, ne fut abolie que le 25 décembre 1794. Les réquisitions furent maintenues, après avoir été un peu adoucies, et le régime spécial de l'approvisionnement de Paris fut conservé intact. On démolissait en partie le régime d'intervention brutale et spoliatrice de l'État, mais on n'osait pas encore accorder au commerce assez de sécurité et de liberté pour qu'il pût reprendre ses opérations. Cette manière de procéder, hésitante et timide, eut les conséquences les plus fâcheuses. Les cultivateurs, décimés par les réquisitions militaires et découragés par le maximum, avaient laissé en friche une partie de leurs terres, en sorte que la récolte demeura insuffisante dans un grand nombre de départements. Le commerce, encore entravé, ne se réorganisant pas assez vite pour secourir les départements en déficit, il y eut des souffrances effroyables pendant toute la durée de l'hiver, qui fut extrêmement rigoureux. La disette sévit surtout à Paris, où elle occasionna les terribles émeutes du 12 germinal et des premiers jours de prairial.
Depuis le commencement delà révolution, Paris était nourri aux frais du gouvernement. En 1792, la municipalité faisait porter chaque jour à la halle 12 à 1,500 sacs de blé nécessaires à la subsistance de cette immense ville. Ce blé lui revenait à 62 liv. le sac, et elle le cédait à 54 liv. aux boulangers. Elle perdait ainsi jusqu'à 12,000 liv. par jour. [56] Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les marchands de blé ne se présentaient plus à la halle, où les boulangers trouvaient à s'approvisionner au-dessous du cours. Demeurée la seule pourvoyeuse de la capitale, la municipalité dut bientôt employer les procédés les plus vexatoires pour empêcher les habitants du voisinage de venir s'y approvisionner.
« La commune de Paris, dit M. Thiers, avait réglé la distribution du pain entre les boulangers. On ne pouvait s'y présenter qu'avec une carte de sûreté : sur cette carte, délivrée par les comités révolutionnaires, était désignée la quantité de pain qu'on pouvait demander, et cette quantité était proportionnée au nombre d'individus dont se composait chaque famille. On avait réglé jusqu'à la manière dont on devait faire queue à la porte des boulangers. Une corde était attachée à leur porte : chacun la tenait par la main, de manière à ne pas perdre son rang et à éviter la confusion. Cependant de méchantes femmes coupaient souvent la corde : un tumulte épouvantable s'ensuivait, et il fallait la force armée pour rétablir l'ordre. » [57]
Moyennant ces précautions vexatoires et en s'imposant les sacrifices les plus onéreux, la municipalité maintenait le prix du pain à 3 sous la livre en assignats. Tant que dura la terreur, Paris fut approvisionné au moyen des réquisitions; et comme les grains requis étaient payés en assignats, au taux du maximum, les pertes de la municipalité étaient, relativement, peu considérables ; mais, après thermidor, le ressort gouvernemental s'étant détendu, les réquisitions ne furent plus exécutées, et, d'une autre part, les règles établies pour la distribution des subsistances se trouvèrent plus souvent enfreintes. On continuait bien d'exiger la présentation des cartes de sûreté pour délivrer du pain, mais chacun exagérait ses besoins : les consommateurs parisiens payaient avec du pain leurs laitières et leurs blanchisseuses. Les boulangers revendaient en fraude de la farine aux habitants des campagnes. Par suite de ces abus, la consommation de Paris s'était élevée de 1,500 sacs à 1,900.
Le 16 mars 1795, la consommation continuant de s'augmenter tandis que les approvisionnements devenaient de jour en jour plus difficiles et plus coûteux, on mit les habitants à la ration. Le nombre d'individus composant chaque famille devait être indiqué sur la carte, et l'on n'accordait plus, chaque jour, qu'une livre de pain par tête. Sur la proposition du montagnard Romme, cette quantité fut portée à une livre et demie pour les ouvriers. Le 17 mars on distribua 1,897 sacs de farine pour l'alimentation des 636,000 habitants de Paris; 324,000 avaient reçu la demi-livre de supplément. Cette mesure extraordinaire excita des murmures universels, et elle valut à Boissy d'Anglas, qu'on accusait d'en être le promoteur, le surnom de Boissy-famine. Ce fut bien pis, lorsque, dans la matinée du 7 germinal, on ne distribua qu'une demi-ration. Les émeutes de femmes devinrent alors permanentes. Les jacobins vaincus exploitaient habilement cette calamité publique, en affirmant que tout le mal venait de ce que la constitution de 93 n'était pas mise en vigueur. Ils réussirent à entraîner encore une fois la multitude, et les funestes insurrections du 12 germinal et des premiers jours de prairial eurent lieu aux cris : du pain! la constitution de 93!
Cependant ce régime, qui devenait de jour en jour plus onéreux , demeura en vigueur jusqu'au mois de janvier 1796. Les assignats étaient tellement avilis, que le gouvernement rentrait à peine dans la 200e partie de la dépense que lui causait l'approvisionnement de Paris. Benezech, ministre de l'intérieur du directoire, eut alors le courage de proposer la suppression des rations, en exceptant seulement de la mesure les indigents, les rentiers et les fonctionnaires dont les revenus ou les appointements ne s'élevaient pas au-dessus de 1,000 écus ( les rentiers et les fonctionnaires continuaient d'être payés en assignats). Le directoire agréa la proposition de Benezech, et l'approvisionnement de Paris fut enfin rendu au commerce. Chose curieuse ! tous les partis se coalisèrent contre le ministre qui venait de provoquer cette excellente mesure, et ils l'abreuvèrent de dégoûts, au point qu'il voulut donner sa démission. Heureusement le directoire eut le bon esprit de le maintenir, et son système avec lui. Dès ce moment, l'alimentation publique cessa d'être compromise.
Les mesures de la période révolutionnaire concernant les subsistances ont été diversement appréciées par les historiens. M. Thiers a entrepris de les justifier.
« Si, dans l'administration générale de l'État, avant le 9 thermidor, dit-il, quelque chose était irréprochable et pleinement justifié, c'était l'administration des finances, des subsistances et des approvisionnements ... La commission du commerce et des [313] approvisionnements avait fait transporter les grains, les fourrages, les marchandises des campagnes aux frontières ou dans les grandes communes; et le commerce, effrayé par la guerre et les fureurs politiques, n'aurait jamais fait cela spontanément. Il avait fallu y suppléer par la volonté du gouvernement, et cette volonté énergique, extraordinaire, méritait la reconnaissance et l'admiration de la France, malgré les cris de ces petits hommes qui, pendant le danger de la patrie, n'avaient su que se cacher. » [58]
Oui, mais qui avait incessamment contribué à effrayer le commerce ? qui avait, dès le début de la révolution, exploité et envenimé les préjugés populaires contre les accapareurs? qui avait transformé la question des subsistances en une arme politique? n'était-ce pas le parti des terroristes? faut-il donc savoir gré à ce parti d'avoir nourri la France, et de quelle manière ! après lui avoir enlevé les moyens de se nourrir elle-même?
M. Granier de Cassagnac, dans son Histoire du Directoire, a commis une erreur d'un autre genre, en attribuant aux théoriciens révolutionnaires, aux Mably, aux Brissot, etc., l'idée de substituer l'action du gouvernement à celle du commerce. Comme on a pu le voir, cette idée avait été depuis longtemps mise en pratique, d'une manière plus ou moins radicale, par l'administration. Les législateurs de la révolution se bornèrent à reproduire, sous d'autres formules, les ordonnances des rois, depuis Philippe-le-Bel jusqu'à Louis XV. Si le langage des Robespierre et des autres promoteurs des lois restrictives du commerce des grains diffère par la forme de celui des orateurs réglementaires de l'assemblée de police de 1768 , il n'en diffère aucunement par le fond. Les révolutionnaires n'inventèrent rien en fait de réglementation et de mesures arbitraires; ils n'eurent qu'à copier, mais il faut convenir que ce furent de terribles copistes.
On devait croire que cette violente et lamentable expérience de la réglementation en matière de subsistances servirait pour jamais de leçon au législateur. Mais, hélas ! la leçon fut encore une fois perdue : sous l'empire, on voit reparaître tous les vieux errements qui avaient occasionné naguère des maux si effroyables, et on les voit produire les mêmes maux. L'année 1811, si favorable aux vendanges, n'avait donné qu'une récolte de grains médiocre. Napoléon, qui se proposait de partir pour sa funeste campagne de Russie, voulut se hâter « d'assurer la subsistance de la capitale. » En conséquence il créa, par un décret du 28 août 1811, un conseil de subsistance, et il ordonna des achats pour la réserve de Paris. Son projet était d'avoir à Paris une réserve permanente de grains, et il avait déjà commencé l'exécution de ce projet par la construction du magasin monumental du boulevard Bourdon. Il voulait, disait-il, influer sur les prix au moyen de ses approvisionnements, et empêcher les manœuvres des agioteurs. Il ne se doutait pas que la présence d'une réserve, que l'ordre arbitraire d'un despote pouvait répandre soudainement sur le marché, suffirait pour éloigner plus de grains que ses greniers d'abondance n'en pourraient contenir. Quoi qu'il en soit, il fit acheter des quantités considérables de grains pour compléter sa réserve. L'effet de ces achats fut naturellement d'exhausser les prix. Napoléon, qui ne voulait pas mécontenter les Parisiens au moment de les quitter, ordonna de taxer le pain au-dessous du cours du blé, et de fournir aux boulangers les grains de la réserve. Mais, comme celle-ci n'en pouvait donner assez, un grand nombre de boulangers furent ruinés et plusieurs fermèrent boutique. On venait acheter à Paris, où la taxe était de 18 sous, des masses de pain pour la banlieue, où le prix était de 26 à 28 sous. Le transport du pain, en dehors de Paris, fut sévèrement interdit ; mais il s'en passait des quantités considérables en fraude. On fut obligé de faire des réquisitions dans les magasins du commerce pour subvenir aux besoins croissants de la réserve. Deux décrets, du 4 et du 8 mai, complétèrent le système de réglementation conseillé par les membres du conseil de subsistance. En vertu du premier, il était ordonné à quiconque ferait des achats pour les départements qui auraient des besoins, de n'y procéder qu'après en avoir fait la déclaration au préfet. Défense était faite également d'accumuler des grains ou des farines pour les garder en magasin. En conséquence, tout détenteur de denrées alimentaires devait en faire la déclaration immédiate, et en apporter les quantités qui lui seraient indiquées sur tel marché qu'on lui désignerait. Les fermiers et les propriétaires étaient soumis aux mêmes déclarations et réquisitions. Le second décret complétait ces mesures par l'établissement d'un maximum. Le blé ne pouvait être vendu au-dessus de fr. 33 dans les départements où les grains suffisaient à la consommation. Dans les autres, les préfets devaient fixer immédiatement le maximum, en ayant égard aux frais de transport. On eut soin cependant de déclarer que l'exécution du décret ne pourrait être prorogée au-delà de quatre mois (de mai à septembre 1812). Ces mesures furent accueillies par les flagorneries accoutumées des courtisans qui n'avaient rien à redouter de la disette ; ce qui ne les empêcha pas d'aggraver le mal. Quelques préfets intelligents, ayant eu le bon esprit de fixer un maximum fort élevé, réussirent ainsi à attirer les blés dans leurs départements.
« Mais, dit M. Vincens, à qui nous empruntons ces détails sur la disette de 1812, on ne put ou l'on ne sut pas en faire autant partout. Nombre de préfets entrèrent aveuglément dans la voie qu'on leur avait ouverte, exécutèrent le décret sans ménagement, ou crurent se faire un mérite en l'aggravant. Là, les rigueurs exercées faisaient cacher les grains. On requit en vain de garnir les marchés, ils restaient vides. Les départements de la Mayenne, du Cher, de Loir-et-Cher, de la Meuse, et, de proche en proche, de la Seine-Inférieure et du Calvados, se trouvaient sans ressources; ils envoyaient des agents à Paris pour réclamer des secours, et l'on n'avait rien à leur donner. Dans certaines campagnes on ne se nourrit que d'herbages et de racines, et il en résulta des épidémies. » [59]
A Paris, les boulangers furent réduits à faire farine de tout.
On ne sait pas au juste ce que coûta cette [314] nouvelle et désastreuse expérience de l'intervention de l'État dans les approvisionnements; mais il parait qu'à Paris seulement les pertes de la réserve s'élevèrent à plus de 12 millions.
Sous l'empire, l'exportation des blés, qui avait été prohibée depuis 1790, demeura permise jusqu'à la fin de 1810; interdite à cette époque, elle fut de nouveau permise à la rentrée des Bourbons, lorsque le prix dépassait certaines limites ( ordonnance royale du 26 juillet 1814, convertie en loi le 2 décembre). L'exécution de la loi relative aux exportations fut suspendue, encore une fois, pendant les cent jours, et reprise seulement après la disette de 1816. Dans cette année désastreuse, une prime de 5 fr. par hectolitre fut accordée aux Importateurs de grains étrangers (Voyez Approvisionnements).
§ 3. Législation depuis l'empire. —; Lois-céréales.
Jusque-là les importations avaient échappé, en France, aux dispositions restrictives du régime réglementaire ; on les avait considérées comme étant de trop peu d'importance pour Inquiéter les producteurs nationaux. Il n'y avait, en effet, que certains points des côtes, tels que le littoral de la Provence et du bas Languedoc qui s'approvisionnassent avec des grains étrangers; de 1778 à 1790, par exemple, l'importation totale n'excéda l'exportation que de 394,000 hect. Le peu d'Importance des importations avait pour causes principales les prohibitions à l'exportation qui existaient dans la plupart des pays avoisinants et l'instabilité des communications internationales, presque toujours suspendues, en totalité ou en partie, par la guerre. Mais après 1816 la situation changea : les communications générales s'étaient rouvertes, et la sécurité dont on jouissait, jointe à la multiplication des voies de transport, permettait de livrer au commerce général des quantités considérables de denrées alimentaires. Une concurrence avait surgi surtout, qui épouvantait les agriculteurs du Midi; nous voulons parler de celle des grains de la Crimée : naguère presque inconnus sur nos marchés, les blés d'Odessa s'y présentaient maintenant à des prix excessivement bas. La récolte ayant été abondante en 1818 , les propriétaires des départements de l'Est et du Midi envoyèrent à la chambre pétitions sur pétitions pour être préservés de cette concurrence nouvelle. En 1819, le gouvernement, qui était alors à la dévotion des grands propriétaires , présenta une loi pour limiter l'importation des blés. Cette loi fut votée avec aggravation par la chambre des députés. A peu près seul, l'honorable M. Voyer d'Argenson protesta en faveur des malheureux consommateurs, sacrifiés à l'intérêt de la grande propriété :
« Croit-on, disait-il, que les salaires s'élèveront en proportion du prix des grains? J'en appelle à tous ceux qui ont habité !e fond des campagnes : ils verront ce qu'ils ont vu mille fois : à mesure que le prix des denrées s'élève, la nourriture du pauvre devient plus grossière; de l’usage du méteil, il passe à celui de l'orge, de l'orge à la pomme de terre ou à l'avoine. Je ne veux pas chercher à émouvoir; je ne puis cependant oublier que j'ai mis en herbier vingt-deux espèces de plantes, que nos habitants des Vosges arrachaient dans nos prés pendant la dernière famine; ils en connaissaient l'usage en pareil cas par la tradition de leurs pères; ils l'ont laissée à leurs enfants, et c'est â peine si ces plantes sont complètement desséchées au moment où nous examinons s'il faut combattre législativement l'avilissement du prix des grains. » [60]
Malgré cette protestation éloquente, la loi passa à une majorité de 134 voix contre 28. Cette loi était greffée sur la législation relative à l'exportation, qui avait été établie en 1814. Voici quelle en était l'économie. En 1814, on avait divisé les départements frontières en trois classes et en huit sections ; dans la première classe, qui comprenait les départements où le prix du grain était habituellement le plus élevé, l'exportation cessait d'être permise lorsque le prix atteignait 23 fr. l'hect. Dans la seconde classe, où les prix formaient la moyenne, elle était autorisée jusqu'à 21 fr. Enfin, dans la troisième, où les prix offraient la limite la plus basse, l'exportation n'était libre que jusqu'à 19 fr. Ces trois classes étaient partagées en huit sections, et chaque section renfermait plusieurs marchés, dont le cours servait à déterminer le prix moyen régulateur. Ce prix, qui devait être publié dans le Moniteur le 1er de chaque mois, se réglait d'après les mercuriales des deux premiers marchés du mois précédent et du dernier marché du mois antérieur. Le tarif pouvait ainsi changer et changeait, en effet, douze fois par an, selon le cours variable de la denrée.
Les divisions adoptées en 1814 furent conservées en 1819, et les prix qui servaient de limite à l'exportation servirent de premier degré à l'échelle mobile des droits d'importation. Il y eut d'abord un droit permanent de fr. 0,25 par hect. de grains, et de fr. 0,75 par quintal métrique de farine à l'importation par navires français, de fr. 1,25 sur les grains, et de fr. 3,75 sur les farines a l'importation par navires étrangers. A ces droits permanents venait se joindre un droit supplémentaire de 1 fr. par hect., lorsque le prix descendait à la limite de 23 fr. dans la première classe, de 21 fr. dans la seconde, de 19 fr. dans la troisième. L'importation commençait ainsi à être grevée par le droit supplémentaire, et mobile, juste à la limite où l'exportation cessait d'être permise. Mais ce n'était pas tout : à mesure que le prix baissait, le droit supplémentaire s'aggravait; il y avait à chaque franc de baisse augmentation de 1 fr. sur le droit; enfin, lorsque les prix étaient tombés à 20 fr. dans la première classe, à 18 fr. dans la seconde, à 16 fr. dans la troisième, l'importation était prohibée. Les droits supplémentaires sur le quintal métrique de farine étaient fixés au triple des droits sur l'hectolitre de grains. Les dispositions de la loi étaient applicables au seigle et au mais ; la prohibition commençait pour ces grains lorsque les prix étaient descendus à 17, 15 et 13 fr. Le but de cette législation, importée d'Angleterre, et connue sous le nom d'échelle mobile, était de forcer le prix du blé à graviter dans de certaines limites, dont les termes extrêmes étaient 23 et 16 fr., et, autant que possible, de le maintenir à une moyenne générale de 19 à 20 fr.
On la renforça encore par une disposition de la loi de douane du 7 juin 1820. Les droits [315] permanents établis à l’importation par navires français furent portés à fr. 1,26 par hect. de grains, et à fr. 2,50 par quintal métrique de farine, lorsque l'Importation n'était pas faite directement, de certains pays dits de production, c'est-à-dire des ports de la mer Noire, de L'Egypte, de la Baltique, de la mer Blanche et des États-Unis. D'un autre côté, les droits à l'importation par navires étrangers furent portés à fr. 2,50 lorsque les prix ne s'élevaient pas a la limite où le droit supplémentaire cessait d'être exigible ; aussitôt qu'ils arrivaient à cette limite, le droit différentiel retombait à fr. 1,25.
Malgré cette aggravation, la loi de 1819 ne remplit pas son but, qui était d'empêcher le blé de tomber au-dessous du taux de 20 fr., que l'on considérait comme rémunérateur pour l'agriculture. La récolte de 1819 avait été abondante, celle de 1820 fut magnifique. En conséquence, le taux moyen des blés, qui avait été en 1819 de fr. 18,43, tomba en 1820 à fr. 16,60.
Les propriétaires s'émurent de nouveau, et ils demandèrent que la législation fût aggravée. Les importations, qui consistaient principalement en blé d'Odessa, avaient dépassé les exportations d'environ 700,000 hect.; il fallait, disait-on, empêcher que ces importations désastreuses ne pussent se renouveler. Le gouvernement, qui n'avait rien à refuser à la grande propriété, présenta une nouvelle loi en 1821 ; mais la majorité de la chambre des députés, ne la trouvant pas suffisamment restrictive, en aggrava notablement les dispositions. Les prohibitionnistes du temps allaient même jusqu'à demander la prohibition absolue des grains étrangers. L'un d'entre eux, M. Humblot-Conté, affirmait, en invoquant l'exemple de l'Angleterre, que la prohibition absolue aurait seule la vertu de faire régner l'abondance dans le pays :
« C'est seulement, disait-il, depuis que les Anglais ont adopté des lois prohibitives et encouragé l'exportation, qu'ils ont détruit les causes de ces disettes fréquentes qui, d'après leur histoire, désolaient jadis cette contrée. La législation prohibitive, qui s'applique si heureusement à l'Angleterre, a besoin d'être renforcée quand elle s'applique à la France, pour laquelle il n'y a qu'une prohibition entière qui puisse prévenir les disettes ; parce que ce n'est qu'avec les prohibitions absolues que nous pouvons encourager le commerce des grains et les spéculations sur cette denrée. » [61]
Sous l'influence de cet esprit prohibitionniste, la loi fut votée, malgré la vive opposition de la gauche, notamment de M. Benjamin Constant, qui souleva une tempête en accusant la grande propriété, en majorité à la chambre, d'avoir exigé cette loi de renchérissement. La majorité en faveur du projet de loi fut de 282 voix contre 54.
En vertu de cette loi, datée du 4 juillet 1821, les départements frontières furent divisés en quatre classes; l'exportation fut défendue quand le prix dépassait 25 fr. dans la l re , 23 fr. dans la 2 e , 21 fr. dans la 3 e , 19 fr. dans la 4 e ; à l'importation , le premier droit devenait applicable lorsque les prix étaient descendus, dans la l re classe, à 26 fr., à 24 fr. dans la 2 e , à 22 fr. dans la 3 e , et à 20 fr. dans la 4 e ; au dessous de ces limites un second droit de 1fr. par chaque franc de baisse commençait à être perçu ; enfin, lorsque les prix étaient descendus au-dessous de 24 fr. dans la 1re classe, de 22 fr. dans la 2", de 20 fr. dans la e , et de 18 fr. dans la 4e , toute importation demeurait prohibée- Des modifications équivalentes étaient introduites dans le tarif des grains de qualité inférieure.
Cependant cette loi, qui doublait pour le moins la protection dévolue à la production des céréales, atteignit encore moins son but que la précédente. Au lieu de hausser, le prix des grains continua de baisser dans une progression rapide : en 1821, le prix moyen de l'hect. avait été de fr. 18,65, il tomba à fr. 15,08 en 1822; il fut de 17,20 en 1823, de fr. 15,86 en 1824, de fr. 14,80 en 1825, de fr. 15,23 en 1826 , et de fr. 15,97 en 1827 ; alors le cours se releva, et il demeura à une moyenne de fr. 21, 22 jusqu'en 1833. La loi n'avait donc pas eu le pouvoir de relever les prix, quoiqu'elle fût à peu près prohibitive, car dans la 1re classe, à Marseille, l'importation ne fut permise que pendant un seul mois (février 1828), de 1821 à 1830. Il est vrai que les négociants en céréales trouvaient moyen d'éluder la loi en expédiant des cargaisons de blé d'Odessa à Nantes, où l'importation demeurait permise, tandis qu'elle était interdite à Marseille, et en renvoyant de là à Marseille ces blés ainsi francisés; mais ces expéditions, que l'inégalité des droits selon les zones rendait quelquefois avantageuses, ne furent jamais bien considérables. Les récoltes ayant été mauvaises en 1828 et 29, le gouvernement de Juillet voulut se populariser en modifiant, dans un sens libéral, la loi de 1821. Il proposa : 1° d'abolir provisoirement les surtaxes établies, soit sur les blés provenant des pays dits de non production, soit sur les blés importés par la frontière de terre (les importations par terre étaient assimilées aux importations par navires étrangers), et d'abaisser de 25 cent, tous les droits supplémentaires ; 2° d'admettre les cargaisons de blé qui, expédiées en temps utile, mais retardées par les accidents de la navigation, arrivaient après la clôture de l'importation. Quelques autres dispositions secondaires complétaient cette loi provisoire, qui demeura en vigueur jusqu'au 30 juillet 1831. A cette époque une ordonnance royale renouvela celles de ses dispositions sur lesquelles il pouvait être statué par de simples ordonnances. Le 17 octobre suivant, le gouvernement présentait une nouvelle loi céréale dont les dispositions étaient passablement libérales; mais une commission de la chambre des députés, dont le rapporteur fut M. Ch. Dupin, refondit complètement ce projet dans un sens protectionniste. Malgré les efforts de MM. Duvergier de Hauranne, Alexandre Delaborde et d'Harcourt, et de quelques autres orateurs libéraux, le projet ainsi modifié fut adopté à une majorité de 218 voix contre 24. On avait décidé à la vérité que la loi ne serait que provisoire; qu'elle demeurerait en vigueur pendant une année seulement; mais elle fut ensuite indéfiniment prorogée, et elle subsiste encore, au moment où nous écrivons, sans avoir reçu aucune modification. En voici l'analyse :
En 1821 le pays avait été divisé en quatre zones [316] pour l'importation et l'exportation des grains; la loi de 1832 maintint cet état de choses sans aucune altération importante. La classification établie est la suivante : 1re classe (section unique), Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Yar, Corse. Marchés régulateurs :Toulouse, Gray, Lyon, Marseille; 2me classe ( 1re section), Gironde , Landes , Hautes et Basses-Pyrénées, Ariége, Haute-Garonne. Marchés régul. : Marans, Bordeaux, Toulouse (2e section), Jura, Doubs, Ain, Isère, Hautes et Basses-Alpes. Marchés régul. : Gray, Saint-Laurent, le Grand-Lemps; 3e classe (1re section), Haut et Bas Bhin. Marchés régul. : Mulhouse et Strasbourg (2e section), Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inférieure, Eure, Calvados. Marchés régul. : Bergues, Arras, Roye, Soissons, Paris, Rouen (3e section), Loire-Inférieure, Vendée, Charente-Inférieure. Marchés régul. : Saumur, Nantes, Marans ; 4e classe (1re section), Moselle, Meuse, Ardennes, Aisne. Marchés régul. : Metz, Verdun, Charleville, Soissons (2e section), Manche, llle-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan. Marchés régul. : Saint-Lô, Paimpol, Quimper, Hennebon, Nantes.
Voici maintenant quels sont les droits perçus dans chaque région sur les importations et les exportations : Lorsque le prix régulateur dépasse 28 fr. dans la 1re classe, 26 fr. dans la 2e , 24 fr. dans la 3e et 22 fr. dans la 4e , l'importation est libre aussi bien par navires étrangers que par navires français, ou du moins elle n'est soumise qu'à un simple droit de balance de fr. 0,25 par hect.; lorsque les prix vont de fr. 28 à fr. 27,01, de fr. 26 à fr. 25,01, de fr.24 à fr.23,01, de fr.22 à fr. 21,01, selon les classes, l'importation continue à être permise au droit de balance de fr. 0,25 par navires français et par terre, mais elle est frappée d'un droit de fr. 1,50 par navires étrangers. Ce droit différentiel continue à être perçu lorsque le prix descend à des limites inférieures. Au dessous de 26, 24, 22 et 20 fr., et jusqu'à fr. 23,01, 21,01, 19,01 et 17,01, le droit de balance de fr. 0,25 s'augmente de 1 fr. par chaque franc de baisse. Au-dessous de ces limites, et si bas que tombent les prix, l'augmentation est de fr. 1,50 par chaque franc de baisse. L'exportation est permise au droit de balance de fr. 0,25, jusqu'à ce que les prix aient atteint 25 fr. dans la 1re classe, 23 fr. dans la 2 e , 21 fr. dans la 3e et 19 fr. dans la 4e ; au-dessus de ces limites l'exportation est grevée de 2 fr. par chaque franc de hausse. Pour les farines, les droits par quintal métrique sont, à l'importation, le triple des droits sur le blé par hect., moins une fraction insignifiante (25 c), et le double seulement à l'exportation. Le droit différentiel, établi en faveur de la marine nationale, est de fr. 1,66 par quintal métrique. Les droits perçus à l'entrée et à la sortie des grains inférieurs sont gradués sur la même échelle, proportionnellement à leur valeur. Telle est cette législation qui semble avoir épuisé la mesure des complications douanières. Cependant elle trompa une fois de plus l'attente des cultivateurs qui avaient espéré qu'elle maintiendrait les prix à un taux régulier et rémunérateur. En 1831, le prix moyen du blé avait été de fr. 22,71 ; en 1832, de fr. 21,85; en 1833, il descendit à fr. 15,62; en 1834 et 1835, à fr. 15,25; en 1836 seulement, il remonta à fr. 17,32. Ce fait trouve, du reste, son explication naturelle dans les illusions que la protection fait naître chez les agriculteurs protégés : persuadés qu'elle leur permettra de vendre leurs grains à un prix plus élevé, ils en cultivent davantage, et cet excédant ne manque pas d'encombrer les marchés et d'avilir les prix ; on restreint alors les cultures, et les récoltes deviennent insuffisantes, après avoir été surabondantes. Le régime des classes est particulier à la législation française ; il a pour but d'obliger les départements du midi, où la récolte ne suffit pas, année commune , à l'alimentation de la population, à aller chercher le surplus dans les départements du nord. L'élévation exorbitante des droits dans les régions méridionales a permis aux départements du nord, de l'est, de l'ouest et du centre, d'envoyer dans le midi l'excédant de leurs récoltes, nonobstant la cherté des communications. Marseille et le littoral de la Méditerranée reçoivent, avec les farines du Languedoc, les blés des côtes de l'Océan, depuis Dunkerque jusqu'à Rochefort, et notamment des divers ports des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure et de la Vendée. Tandis que les Marseillais pourraient recevoir, en temps ordinaire, du blé d'Odessa au prix de 16 fr. à 18 fr., ils sont obligés de consommer du blé de la Bretagne et de la Vendée, qui leur revient à 25 fr. ou 26 fr., soit 50 pour 100 plus cher. C'est un véritable tribut que les habitants du midi sont obligés de payer à ceux du nord pour leur alimentation. Le gouvernement possède encore en France la faculté de suspendre provisoirement les droits d'importation et de prohiber les exportations dans les années de disette. Il a usé de cette faculté en 1846.
IV. LÉGISLATION EN ANGLETERRE.
En Angleterre, la législation sur les céréales n'a pas subi moins de vicissitudes qu'en France. Sous le règne d'Elisabeth, l'exportation était permise moyennant un droit de 2 shillings, lorsque le prix du froment s'élevait à 20 shillings par quarter (2 hect. 90). Jacques II éleva la limite à 32 sh. et Cromwell à 40 ; mais, en 1688, Guillaume III, qui voulait se concilier la faveur des propriétaires fonciers, supprima le droit d'exportation, et, de plus, accorda une prime d'exportation de 5 sh. lorsque le prix du blé serait descendu à 48 sh. et au-dessous. Le droit d'importation, qui était de 16 sh. sous Charles II, fut porté, en même temps, à 18 sh.; la reine Anne et Georges II y ajoutèrent chacun 2 sh. Mais il semble que la prime d'exportation n'ait pas contribué beaucoup à développer l'agriculture britannique, car on éprouva alors plusieurs disettes consécutives, et l'opinion publique réclama des modifications dans la législation des grains. Malheureusement l'opinion n'était pas encore bien éclairée à cette époque , et elle ne demandait guère la suppression d'une prohibition que pour la remplacer par une autre. En vertu d'une loi, datée de la troisième année du règne de Georges III, l'exportation fut prohibée lorsque le prix du blé atteindrait ou dépasserait 44 sh. par quarter sur le marché intérieur, et le droit d'importation fut réduit au taux [317] nominal de 6 den. (62 c.) lorsque le prix s'élève-rait a 48 sh. ; mais l'ancien droit (de 22 sh.) demeura en vigueur pour le cas où la limite de 44 sh. ne serait pas dépassée. En 1787, on prit pour base la limite de 48 sh.; au-dessous de ce taux, le droit devait être de 24 sh. En 1791, la protection fut augmentée. Le prix rémunérateur fut fixé à 54 sh. A ce taux, le droit devenait purement nominal ; mais il était de 2 sh. et demi, quand le prix du blé n'atteignait pas 54 sh. et de 24 sh. si le prix restait au-dessous de 50 sh. par quarter. Le maximum du droit fut successivement porté à 30 sh. Quelquefois, à la vérité, lorsque la récolte était par trop mauvaise, la loi était suspendue par un ordre en conseil. En 1804, les propriétaires fonciers réclamèrent un nouveau supplément de protection : la limite dite rémunératrice fut portée à 66 sh.; au-dessous de ce taux, le droit fut fixé à 3 sh., et à 30 sh. au-dessous de 63 sh. En 1813, le droit de 30 sh. fut porté à 3!) sh. 7 den. Enfin, en 1814, l'importation étrangère fut prohibée, lorsque les blés indigènes n'auraient pas atteint le taux de 80 sh. En 1822, la limite à laquelle le droit nominal de 1 sh. devenait applicable fut portée à 85 sh. ; le droit fut fixé à 5 sh. pour le taux de 80 sh., et à 17 sh. au-dessous de 80 sh. Au-dessous de 70 sh. l'importation demeurait prohibée. A dater de 1822, commence une réaction contre les exigences excessives de la propriété foncière. M. Huskisson imagine le système d'une échelle décroissante de droits que M. Canning se charge d'appliquer en 1828. M. Canning voulait assurer à l'agriculture nationale un prix rémunérateur de 66 sh. par quarter; mais cette limite, qui avait été adoptée par la chambre des communes, fut portée à 72 sh. par la chambre des lords. La législation de 1828 subsista jusqu'en 1842. A cette époque, Robert Peel remania pour la dernière fois la loi-céréale en maintenant la limite de 72 sh., mais en abaissant le taux des droits d'importation. Voici comment ces droits étaient gradués d'après l'acte de 1828 et d'après celui de 1842:
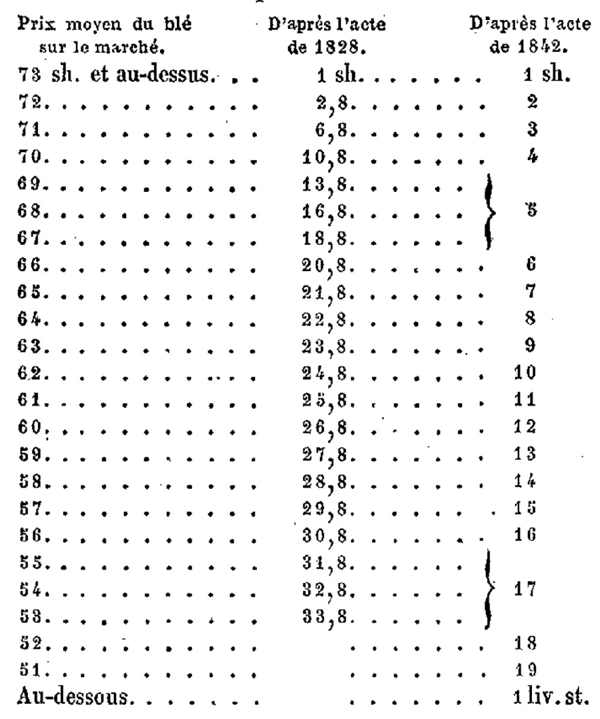
Ces diverses lois avaient pour but : 1° d’assurer un prix rémunérateur plus ou moins élevé aux agriculteurs; 2° de maintenir une certaine fixité dans les prix des céréales ; mais en Angleterre, comme en France, les lois céréales trompèrent complètement, sous ce double rapport, l'attente de ceux qui les avaient établies. L'acte prohibitif de 1815, dit M. Léon Faucher à qui nous empruntons ces renseignements sur la législation britannique, [62] n’empêcha pas le prix du blé de descendre, sur le marché anglais, à 56 sh. en 1821; à 44 sh. en 1822; à 53 sh. en 1823, et à 56 sh. en 1827. Sous l'empire de l'acte presque aussi restrictif de 1828, les mercuriales, qui avaient présenté un moment le taux moyen de 81 sh., tombèrent à 58 sh. en 1832, à 52 sh. en 1833, à 46 sh. en 1834, à 39 sh. en 1835, et à 36 sh. en 1836. Malgré la loi de 1842, le blé ne valait pas en Angleterre plus de 45 sh. le quarter (fr. 19,70 par hect.). Au mois d'avril 1842, les variations des cours étaient considérables et soudaines. En 1832, la différence entre le cours le plus élevé et le cours le plus bas a été de 30 pour 100, de 27 pour 100 en 1834, de 19 pour 100 en 1835, de 42 pour 100 en 1836, de 31 pour 100 en 1837 et de 60 pour 100 en 1838.
Si le système adopté en Angleterre n'a pas donné aux agriculteurs les avantages qu'ils s'en promettaient, il n'en a pas moins coûté fort cher au trésor public. On calcule, dit encore M. Léon Faucher, que l'échiquier a payé, dans le cours du dix-huitième siècle, sous forme de primes à l'exportation, près de 170 millions de francs, et dans les premières années du dix-neuvième, sous forme de primes temporaires à l'importation, environ 72 millions. En outre, les droits d'entrée établis, d'après le système de l'échelle mobile, ne pouvaient donner qu'un faible produit. De 1828 à 1840, ils n'ont rapporté en moyenne que 5 millions et demi de francs par an, bien que les importations devinssent d'année en année plus considérables. M. Léon Faucher donne la raison de ce fait :
« Les marchands , dit-il, achètent de grandes quantités de blés étrangers pendant que les prix sont bas; puis, ils les gardent en entrepôt jusqu'à ce que l'augmentation des prix sur le marché ait fait réduire le tarif de l'importation à un taux nominal. Plus de la moitié des blés introduits en Angleterre avant la loi de 1842 n'avaient payé qu'un droit de 1 sh.. » [63]
Cependant, les corn-laws établies visiblement pour favoriser les intérêts de l'aristocratie territoriale soulevaient des plaintes générales; en 1838, une ligue se forma à Manchester pour les renverser et pour demander la libre importation des céréales. Cette association, dont l'histoire sera racontée plus loin (Voyez Ligue contre les lois céréales) , parvint à son but, après huit années d'efforts persévérants. L'insuffisance des récoltes, la maladie des pommes de terre et les nombreux meetings de la ligue obligèrent sir Robert Peel à rappeler les lois-céréales, après les avoir temporairement suspendues. A la suite d'une discussion mémorable, le bill pour le rappel des corn-laws fut voté à la chambre des communes, en juin 1846, [318] et mis en vigueur le 1er février 1849. Imitant l'exemple de l'Angleterre, la Hollande et la Belgique réformèrent également leurs lois-céréales.
V. CRITIQUE DE LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES CÉRÉALES.
Passons maintenant en revue les arguments que les économistes ont opposés à la réglementation du commerce des grains et aux dispositions restrictives des lols-céréales. Nous avons vu que les entraves apportées à la liberté intérieure étaient de plusieurs sortes. On a défendu les ventes ailleurs que dans les marchés ; on a réglementé ou prohibé les exportations en dehors de certaines circonscriptions; on a soumis les intermédiaires, désignés à l'animadversion populaire sous le nom d'accapareurs, à l'obligation de déclarer le montant de leurs achats et à d'autres formalités non moins vexatoires ; on a agi sur le prix des grains en achetant du blé pour le compte du gouvernement ou des municipalités, en mettant ce blé en réserve dans des greniers d'abondance, puis en le déversant brusquement sur le marché ; on a abaissé, dans les époques de disette , le prix du pain au-dessous du cours des grains sur le marché ; on a fait dans les campagnes des réquisitions de blé pour l'approvisionnement des grands centres de population ; on a établi des maximum, etc., etc. La liste de ces mesures restrictives est longue, et bien qu'elles aient été généralement prises dans l'intention de soulager les masses soutirantes et affamées, elles ont fait plus de victimes que les guerres les plus meurtrières.
Dans sa spirituelle Diatribe à l'auteur des Éphémérides, Voltaire a fait ressortir, avec sa verve et son enjouement accoutumés, les inconvénients de l'interdiction de la vente hors des marchés. Voici un extrait de ce charmant morceau de critique économique :
« Je suis laboureur et j'ai environ quatre-vingts personnes à nourrir. Ma grange est à trois lieues de la ville la plus prochaine; je suis obligé quelquefois d'acheter du froment, parce que mon terrain n'est pas si fertile que celui de l'Egypte et de la Sicile. — Un jour un greffier me dit : Allez-vous-en à trois lieues payer chèrement au marché de mauvais blé. Prenez des commis, un acquit-à-caution ; et si vous le perdez en chemin, le premier sbire qui vous rencontrera sera en droit de saisir votre nourriture, vos chevaux, votre femme, votre personne, vos enfants. Si vous faites quelque difficulté sur cette proposition, sachez qu'à vingt lieues il est un coupe-gorge qu'on appelle juridiction; on vous y traînera, vous serez condamné à marcher à pied jusqu'à Toulon, où vous pourrez labourer à loisir la mer Méditerranée. Je pris d'abord ce discours instructif pour une froide raillerie. C'était pourtant la vérité pure. Quoi ! dis-je, j'aurai rassemblé des colons pour cultiver avec moi la terre, et je ne pourrai acheter du blé pour les nourrir eux et ma famille ! et je ne pourrai en vendre à mon voisin quand j'en aurai de superflu! — Non, il faut que vous et votre voisin creviez vos chevaux pour courir pendant six lieues. — Eh! dites-moi, je vous prie, j'ai des pommes de terre et des châtaignes avec lesquelles on fait du pain excellent pour ceux qui ont un bon estomac ; ne puis-je pas en vendre à mon voisin sans que ce coupe-gorge, dont vous m'avez parlé, m’envoie aux galères?— Oui. — Pourquoi, s'il vous plaît, cette énorme différence entre mes châtaignes et mon blé? — Je n'en sais rien, c'est peut-être parce que les charançons mangent le blé et ne mangent point les châtaignes. — Voilà une très mauvaise raison. — Eh bien, si vous en voulez une meilleure, c'est parce que le blé est d'une nécessité première, et que les châtaignes ne sont que d'une seconde nécessité. — Cette raison est encore plus mauvaise. Plus une denrée est nécessaire, plus le commerce en doit être facile. Si on vendait le feu et l'eau, il devrait être permis de les importer et de les exporter d'un bout de la France à l'autre. »
Ajoutons que s'il est bon que les grains, comme toutes les autres denrées, soient centralisés dans des marchés, où la concurrence s'établisse entre les vendeurs au bénéfice des acheteurs, il faut laisser cette concentration utile s'opérer d'elle-même. Les cultivateurs et les marchands de grains n'ont-ils pas avantage à se réunir dans des lieux désignés, où ils puissent rencontrer des acheteurs? Que s'ils ne s'y rendent point, n'est-ce pas une preuve que les acheteurs ont préféré s'aboucher directement avec eux, et que les uns et les autres ont trouvé plus d'avantage à cette manière de procéder? Pourquoi donc leur en imposer une autre? — On a interdit ou réglementé les ventes en dehors de certaines circonscriptions; mais qui ne voit le mal que ces prohibitions ou ces réglementations inintelligentes, reproduites encore en 1812, ont dû causer aux populations victimes de la disette? Souvent, en France, certaines provinces se trouvaient réduites aux dernières extrémités de la faim, par suite d'un accident de température qui avait fait manquer les récoltes, tandis que les provinces avoisinantes regorgeaient de blé. Dans ses Lettres sur la liberté du commerce des grains, Turgot cite à cet égard un fait des plus frappants :
« Dans la disette de 1740 à 1744, dit-il, tandis que le froment valait 45 livres à Paris, il ne valait à Angoulême que 17 livres; et pendant toute la durée de cette disette l'inégalité des prix entre Angoulême et Paris a été assez grande pour qu'il y eût du profit à porter des grains d'Angoulême à Paris, même par terre, et à plus forte raison par les rivières et par la mer. Je demande pourquoi l'abondance d'Angoulême et des provinces méridionales fut inutile à Paris. N'est-il pas évident que si le commerce des grains avait été monté, si des gênes et des règlements absurdes n'avaient pas détruit la liberté et le commerce avec elle, on ne se fût pas aperçu de cette disette qui suivit la récolte de 1740 et qui fut si cruelle dans une partie du royaume? Les règlements et les gênes ne produisent pas un grain de plus, mais ils empêchent que le grain surabondant dans un lieu ne soit porté dans les lieux où il est plus rare. La liberté, quand elle n'augmenterait pas la masse des grains en encourageant la production, aurait au moins l'avantage de répartir le plus promptement et le plus également qu'il soit possible les grains qui existent. » [64]
Après tant de désastreuses [319] expériences, dont nous avons retracé une Imparfaite esquisse, les gouvernements ont généralement renouer à restreindre ou à réglementer la liberté Intérieure du commerce des grains ; mais les populations ne se montrent pas toujours aussi avancées sous ce rapport que les gouvernements. En 1845 et 1846, des troubles eurent lieu encore dans plusieurs localités de l'ouest de la France, au sujet de l'enlèvement des blés. Selon la coutume usitée en pareil cas, la foule se précipita sur les convois et elle mit le blé en vente au-dessous du cours. [65] Les autorités parvinrent ensuite à rétablir l'ordre ; mais, en attendant, les marchands effrayés avaient retiré leurs grains du marché et les prix s'étaient élevés en conséquence de cette diminution de l'offre. A la vérité, le régime de l'échelle mobile était bien pour quelque chose dans ces désordres. Le tarif des céréales en France est établi de manière à obliger les populations du midi à s'approvisionner dans les provinces de l'ouest et du centre, alors qu'elles pourraient retirer, avec plus d'avantage, leurs grains d'Odessa. Dans les années d'abondance, ce trafic est profitable, sans doute, aux cultivateurs de l'ouest et du centre; mais, dans les années de disette, l'enlèvement des subsistances de dernière qualité, du blé noir de la Bretagne par exemple, peut compromettre sérieusement l'alimentation de la population pauvre de cette province, où le niveau des ressources privées est plus bas qu'en aucune autre partie du pays.
Le préjugé contre les marchands de grains, désignés sous le nom d'accapareurs, date d'une époque où le commerce des blés était universellement entravé, et où des marchands privilégiés pouvaient seuls acheter des grains dans un canton pour les revendre au-dehors. Le blé étant la base de l'alimentation générale, un monopole de cette nature ne pouvait manquer de produire d'immenses bénéfices, aux dépens de la vie même des populations. On conçoit donc que le préjugé contre les accapareurs ait été extrêmement vivace et jusqu'à un certain point légitime à des époques d'oppression et de rapine. (Voyez Monopole.) Mais ce préjugé ne saurait être, en aucune façon, justifié sous un régime de libre circulation. Les accapareurs, c'est-à-dire les marchands de grains, sont des intermédiaires indispensables, qui épargnent aux consommateurs, aussi bien qu'aux producteurs, nombre de frais et de démarches inutiles, qui peuvent seuls, enfin, à l'aide de leurs accaparements (voyez ce mot), prévenir les écarts extrêmes des prix. Un économiste allemand, M. Schmalz, a parfaitement mis en lumière l'utilité des accapareurs, au double point de vue de l'intérêt des cultivateurs et de l'intérêt des consommateurs :
« Considérez, dit-il, la position d'un paysan qui, pour pouvoir vendre les productions de sa ferme on de son champ, se voit dans la nécessité de les charrier lui-même à la ville, ou de les y faire transporter sur des hottes par les différents membres de sa famille. Il ne peut pas même choisir le jour qui lui conviendrait le mieux ; il faut qu'il attende celui du marché. Dès la veille, il se prépare pour sa course; car il doit arriver de fort bonne heure au marché ; il met en ordre ses denrées, et part de son village en chariot ou à pied. Il voyage toute la nuit, arrive de grand matin à la ville, y reste jusqu'au milieu du jour et même plus tard, pour effectuer sa vente, repart et rentre chez lui le soir, excédé de fatigue. Voilà deux jours entiers de perdus pour l'économie rurale, qui ne permettrait pas un seul moment de relâche et qui réclame à tout instant l'exécution d'un travail utile. Le lendemain encore, à quoi pourront s'occuper hommes et bêtes, fatigués de la course? Supposons que vingt femmes d'un village, chacune chargée d'une couple de poulets, d'une douzaine d'oeufs, de quelques livres de beurre et de quelques fromages, se rendent au marché. Pendant tout le temps qu'elles passeront, ainsi, hors de leur ménage, que de travaux n'auraient-elles pas pu faire aux champs, au jardin, dans les étables et dans l'intérieur de leur maison? Elles y auraient filé ou tricoté des bas pour leurs enfants, qui, maintenant, courent nu-pieds au préjudice de leur santé, et qui, par là même, prouvent clairement la misère qui règne dans le village. Une brouetté, un cheval, un prétendu accapareur auraient suffi pour transporter à la ville le chargement de vingt hottes et auraient épargné deux jours de peines et de fatigues à vingt ménages. Souvent même le chariot des paysans qui se rendent en ville ne contient pas, à beaucoup près, une charge complète ; et, chacun d'eux n'ayant ainsi que quelques boisseaux de grains sur sa voiture, il faut dix hommes et vingt chevaux pour le transport de quelques muids de blé. Un accapareur eût facilement pu les charger sur un seul chariot ; et il aurait encore épargné deux jours d'absence à dix hommes et à vingt chevaux enlevés aux soins et aux travaux nécessaires de l'agriculture. L'assertion que le regrattier ou l'accapareur enlève à ces gens de la campagne leurs denrées dans le moment même où ils manquent d'argent, est sans fondement et dénuée de sens. Si le paysan vendait à cause de la pénurie d'argent dans laquelle il se trouverait, ce ne serait incontestablement qu'a-fin de se tirer d'embarras. Or imagine-t-on qu'il lui serait plus avantageux de rester dans cet embarras? D'ailleurs, si le marchand offre trop peu, le paysan ne manquera pas de se rendre lui-même au marché. Il est vrai qu'en général le marchand achètera moins cher au paysan que le paysan n'aurait vendu au marché ; mais cela est fort naturel, puisqu'il prend sur lui le transport, le temps et l'embarras de la vente, et qu'il fait ainsi retrouver au paysan deux jours de travail, qui valent bien mieux pour lui que ce qu'il aurait obtenu de plus au marché. L'existence des marchands regrattiers ne fait pas plus renchérir les denrées pour les habitants des villes : car, si leur bénéfice est considérable, au lieu de dix il s'en rencontrera bientôt vingt, qui chercheront à vendre au rabais les uns des autres. Dans les campagnes, ils s'efforceront de s'enlever réciproquement les vendeurs, en offrant les plus hauts prix possibles. Dans les villes, ils chercheront, à attirer les acheteurs, en donnant à aussi bas prix qu'ils pourront le faire. D'ailleurs, l'habitant des villes est bien aussi obligé de payer, au paysan qui vient lui vendre lui-même ses denrées au marché, les frais de voyage et de [320] transport. Or quand devra-t-il payer meilleur marché ? Sera-ce lorsque les marchandises qu'un seul marchand aurait transportées, avec quatre chevaux, auront été transportées par dix hommes et vingt chevaux ? Sous tous les rapports donc rien n'est plus avantageux que le prétendu accaparement si généralement détesté. » [66]
L'interposition des accapareurs entre le producteur et le consommateur est, comme on voit, un progrès manifeste de la division du travail. Il est presque, superflu d'ajouter que les accaparements, c'est-à-dire les approvisionnements accumulés par les marchands de grains, fournissent les moyens les plus sûrs d'égaliser les prix, dans l'espace et dans le temps, de reporter le superflu d'un pays où la récolte a été bonne dans un pays où la récolte a été mauvaise, et d'une année d'abondance dans une année de disette.
Les recensements des récoltes, ordonnés aux époques de disette, n'ont jamais produit de bons résultats. Comme le faisait remarquer, avec raison, le ministre Roland dans sa lettre à la convention nationale, ces recensements reposent sur des déclarations que des motifs de toute nature, la mauvaise foi des uns, la crainte des autres, contribuent à rendre inexactes. Or, si ces déclarations sont au-dessous de la vérité, quel champ ouvert aux inquiétudes et aux fausses spéculations ! Et si elles sont exagérées, ne doivent-elles pas engendrer une fausse sécurité plus funeste encore que des inquiétudes mal fondées? N'avons-nous pas vu, en 1846, un ministre du commerce, M. Cunin-Gridaine, se fiant aux renseignements recueillis à la hâte par les préfets, annoncer que rien ne faisait pressentir un déficit dans la récolte, et recevoir des faits un cruel démenti? En général, le commerce est beaucoup plus apte que le gouvernement à recueillir des renseignements de cette nature, car il est le premier intéressé à les avoir. Pourquoi donc ne pas le laisser s'éclairer seul, puisque les lumières qu'on peut lui procurer sont moins certaines que les siennes?
Les gouvernements sont intervenus d'une manière plus directe encore dans l'approvisionnement des populations. Ils ont consacré des sommes considérables à des achats de grains étrangers ou indigènes ; ils ont créé des greniers d'abondance et autorisé des municipalités à s'imposer des sacrifices de même nature. Ces sacrifices étaient-ils bien entendus? L'expérience prouve le contraire, et le raisonnement vient à l'appui de l'expérience. Lorsque le gouvernement achète des blés dans une année de disette, il n'en fait pas un objet de spéculation ; il achète presque toujours avec l'intention de revendre à perte; ceci dans l'intention louable de soulager les populations qui souffrent de la disette. Mais le commerce, qui n'a point la ressource de reporter ses déficits sur des contribuables bénévoles, le commerce ne peut imiter ce genre de spéculation philanthropique. Lorsque le gouvernement commence ses achats, le commerce est obligé, en conséquence, de cesser ou de ralentir les siens. Il abandonne le marché au gouvernement plutôt que de le lui disputer en vendant à perte. Or, comme les moyens dont le gouvernement et les municipalités disposent pour approvisionner un pays ne sont jamais comparables à ceux du commerce, les consommateurs finissent toujours par être les victimes de cette intervention anormale : au lieu de recevoir plus de blé, ils en reçoivent moins. Lorsque les gouvernements s'aperçoivent de ce résultat, ils se mettent communément de fort mauvaise humeur contre le commerce, et ils veulent le forcer à livrer ses blés ; ils font faire des visites domiciliaires chez les marchands, ils ordonnent d'apporter les grains au marché, et de les vendre à un prix maximum, etc., etc. Le commerce ainsi violenté déploie moins d'activité que jamais, et cela dans le moment même où tous ses efforts seraient nécessaires pour subvenir aux besoins urgents de la consommation. Le gouvernement n'a plus alors que deux partis à prendre, c'est de cesser de se mêler des approvisionnements et de laisser faire le commerce, ou de se charger seul de l'alimentation publique. Nous avons vu quels ont été en France les résultats de ce dernier système. La même expérience a été faite dans d'autres États plus restreints, où elle a causé aussi de grandes pertes : à Rome, par exemple, la cassa Annonaria, instituée par Paul V au commencement du dix-septième siècle, demeura chargée des approvisionnements pendant près de deux siècles. Elle avait reçu d'abord la mission inexécutable de veiller à ce que le pain se vendit toujours à un prix uniforme, quelle que fût l'abondance ou la rareté du blé; mais, s'apercevant bientôt de l'impossibilité d'assujettir le commerce à cette règle, elle s'empara du monopole des approvisionnements. Pendant près de deux siècles, elle réussit à maintenir uniformément le prix du pain de huit onces à un baïoc ou sol romain, d'un dixième plus fort que le sol de France ; mais, au bout de ce temps, la cassa Annonaria fut renversée avec le gouvernement pontifical, et elle laissa un déficit considérable :
« Quelle que fût l'abondance ou la rareté des blés, dit M. de Sismondi, la chambre apostolique les passait aux boulangers à raison de 7 écus romains (fr. 37,10) le rubbio, mesure qui pèse 640 kil. Ce prix ne s'éloignait pas beaucoup de la moyenne, et il laissait aux boulangers un profit suffisant lorsqu'ils vendaient leurs petits pains au prix d'un baïoc. Jusqu'à l'année 1763, les bénéfices de la chambre compensèrent ses pertes. Mais vers cette époque commença une hausse dans les prix des blés, qui alla toujours croissant jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Malgré ses pertes, la chambre apostolique, redoutant toujours plus de donner lieu au mécontentement populaire, continua de faire vendre le pain au même prix ; aussi, lorsqu'en 1797 le gouvernement pontifical fut renversé, la cassa Annonaria présenta un déficit de 3,293,865 écus. ou 17,457,485 fr..» [67]
Arrivons maintenant à l'intervention du gouvernement dans le commerce extérieur des céréales. Cette intervention s'est manifestée d'un côté par des allocations de primes à l'importation, et à l'exportation, d'un autre côté, par des entraves de diverse nature apportées à l'entrée et à [321] la sortie des céréales. Le système des primes à l'exportation a le double défaut d'encourager une branche particulière de la production aux dépens de toutes les autres, et de fournir aux consommateurs étrangers une véritable subvention aux dépens des contribuables nationaux. (Voyez Primes d'exportation.) Au surplus, l'exemple de l'Angleterre atteste la complète inefficacité des primes pour développer l'agriculture et assurer la subsistance des populations. Les primes d'importation donnent lieu à des manœuvres frauduleuses ; elles ont en outre l'inconvénient de faire hausser les prix en activant, le plus souvent d'une manière prématurée , la demande des céréales dans les pays de production. (Voyez Primes d'importation. ) Le système des entraves à l'exportation contre lequel Turgot a spécialement dirigé ses remarquables Lettres, ce système soulève plusieurs sortes d'objections, soit que l'exportation se trouve absolument prohibée lorsque le blé a atteint un certain prix à l'intérieur, soit qu'on l'assujettisse alors à un droit mobile et croissant : 1° La défense d'exportation empêche la sortie des grains de qualité supérieure, dont la vente à l'étranger donnerait aux populations pauvres les moyens d'obtenir en échange une plus grande quantité d'aliments inférieurs. 2° Elle décourage l'importation des grains étrangers, en ôtant aux négociants la ressource de les réexporter, dans le cas où ils trouveraient à les vendre plus avantageusement ailleurs. La généralisation du système des entrepôts a, du reste, heureusement diminué l'importance pratique de cette objection. 3° Elle ralentit le développement des cultures en enlevant aux cultivateurs le débouché du dehors, précisément aux époques où ce débouché est le plus avantageux. — Les importations sont entravées par des. droits fixes ou par des droits mobiles : le système des droits fixes est actuellement en vigueur en Belgique. Mais il convient de remarquer que ce système n'a de fixe que le nom ; car lorsqu'un pays se trouve menacé de la disette, le gouvernement se hâte toujours de suspendre le droit. D'un autre côté, dans les années d'abondance et de bas prix, le droit n'apporte à l'agriculture indigène qu'une protection nominale. Les droits mobiles, s'élevant à mesure que les prix s'abaissent à l'intérieur, ont été établis dans la vue de maintenir, avec une certaine régularité, un prix dit rémunérateur. Expliquons ce qu'on entend par ce mot. On suppose que le cultivateur, pour rentrer dans tous ses frais, pour payer la rente nécessaire du propriétaire, le salaire nécessaire de ses ouvriers et percevoir son profit nécessaire, a besoin de vendre son blé à un certain prix qualifié de rémunérateur. En France, le prix rémunérateur est évalué à 20 fr. environ, et l'on s'efforce de combiner les droits d'importation et d'exportation de telle sorte que le prix courant des blés ne s'écarte jamais beaucoup de ce prix, qui représente ou est supposé représenter les frais de production de la denrée. Mais les faits attestent que jamais ce but idéal des modernes lois-céréales n'a pu être atteint. Il n'est pas difficile d'en trouver la raison : aucune loi céréale ne saurait, en effet, déjouer les caprices des saisons ; aucune loi-céréale ne saurait empêcher la terre d'être plus féconde dans une année et de l'être moins dans une autre. Or, c'est une remarque qui a été faite maintes fois, qu'un léger excédant ou un léger déficit dans l'approvisionnement d'une denrée nécessaire à la vie suffit pour occasionner une perturbation considérable dans le prix.
« Le fait, dit M. Tooke dans son Histoire des Prix, qu'un faible déficit dans la production du blé, comparée au taux moyen de la consommation, occasionne une hausse hors de proportion avec la grandeur du déficit, ce fait est attesté par l'histoire des prix, à des époques où rien, dans la situation politique et commerciale du pays, ne pouvait exercer une influence perturbatrice sur les marchés. Quelques écrivains ont essayé d'en déduire une règle exacte de proportion entre un déficit donné de la récolte et la hausse probable du prix. M. Gregory King a donné notamment la règle de proportion suivante pour le prix du blé.
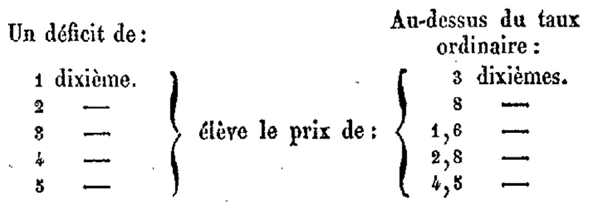
Mais que cette proportion soit exacte ou non, il n'en est pas moins avéré que les variations dans les quantités de blé offertes au marché engendrent des variations beaucoup plus sensibles dans les prix. » [68]
En présence de ce phénomène économique, aucune défense d'importation ou d'exportation ne saurait empêcher le prix du marché de tomber au-dessous du prix rémunérateur dans une année d'abondance, ni de s'élever au-dessus dans une année de disette. Au contraire, les faits attestent que les lois restrictives des importations ou des exportations ne peuvent qu'augmenter les fluctuations des prix, tantôt en surexcitant la production du blé, tantôt en la décourageant. Il est donc impossible d'obtenir régulièrement un prix rémunérateur au moyen d'une loi céréale.
En revanche, on peut occasionner par ce moyen un exhaussement permanent du niveau des prix. Voici comment : Lorsque l'importation des blés étrangers vient à être interdite et que la quantité des blés offerts sur le marché intérieur se trouve ainsi réduite, une hausse s'opère dans le prix, surtout si l'augmentation de la population provoque une demande croissante des substances alimentaires. On trouve avantage, en ce cas, à mettre en culture des terrains inférieurs; ou, ce qui revient au même, des terrains moins propres à la culture spéciale des blés que ceux qui sont déjà affectés à ce genre de production. Les frais de production des céréales cultivées sur ces terrains inférieurs constituent alors le prix rémunérateur, autour duquel gravite incessamment le prix courant , et les propriétaires des terrains supérieurs obtiennent un surplus ou une rente (voyez ce mot). Si les besoins continuent à s'augmenter, l'importation demeurant défendue, le prix du blé ira croissant ; de nouvelles terres moins propres [322] encore que les précédentes à la production des céréales seront mises en culture, et la rente des autres continuera de s'élever. Mais est-il bien avantageux pour une nation de produire à grands frais des blés sur de mauvais terrains, au lieu d'acheter le supplément nécessaire à son approvisionnement dans les pays où ce supplément peut être produit à moins de frais ? Non, sans doute. Si l'importation demeurait libre, la nation réaliserait les bénéfices suivants : 1° Les consommateurs payeraient le blé moins cher; 2° les propriétaires des bonnes terres seraient obligés de faire des efforts, de réaliser des progrès pour soutenir la concurrence des céréales étrangères, tandis qu'ils peuvent parfaitement s'en tenir aux vieilles méthodes sous le régime de la défense d'importation ; en effet, leurs rentes s'accroissent toutes seules, sous ce régime, par le simple fait de l'augmentation du nombre des bouches à nourrir; 3° les terrains impropres à la culture des céréales, que l'on consacre pourtant à cette culture, ces terrains pourraient être employés à d'autres productions; les capitaux et les bras que la défense d'importation pousse artificiellement vers la culture des blés, serviraient à produire plus économiquement d'autres denrées, lesquelles seraient échangées contre les céréales cultivées sur les bonnes terres des pays à blés. La nation gagnerait la différence.
Déjà, en Angleterre, la suppression des corn-laws a agi sensiblement sur les frais de production du blé. Depuis que les propriétaires des bonnes terres ont eu à lutter non plus seulement contre des concurrents placés dans de mauvaises conditions, mais encore contre les propriétaires des bonnes terres de la Pologne et de la Russie, ils ont été contraints d'améliorer leurs procédés agricoles, en un mot de faire progresser leur industrie pour soutenir avantageusement la lutte. Or, tout progrès se résout nécessairement en un abaissement des frais de production, et tout abaissement des frais de production amène une baisse équivalente du prix courant.
VI. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DES CÉRÉALES.
Terminons par quelques renseignements statistiques sur la production et le commerce des blés chez les principales nations du globe.
D'après M. Moreau de Jonnès, la production des céréales en France s'élevait, en 1840, à 182,516,848 hectolitres, se répartissant ainsi :
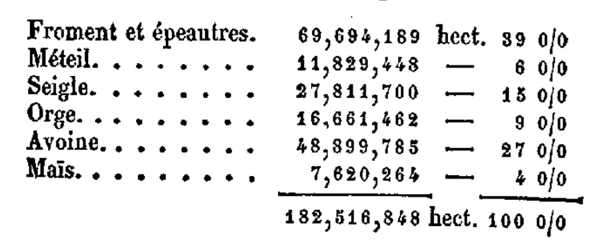
La valeur moyenne de cette quantité de céréales était de 2,055,407,000 francs. Or, comme 13,900,262 hectares étaient cultivés en céréales, c'est un produit brut de 141 francs par hectare. M. Moreau de Jonnès estime qu'en 1700 la France ne produisait que 92,856,000 hect., soit 472 litres par habitant; en 1760, 98,500,000 hect. ou 450 litres; en 1788, 115,816,000 hect. ou 484 litres; en 1813, 132,435,000 hect. ou 441 litres; enfin, elle est arrivée, en 1840, au chiffre de 183,516,000 hect. ou 541 litres par habitant. La quantité moyenne des récoltes en France aurait donc doublé depuis Louis XIV, tandis que la population n'a augmenté que de 70 pour 100. — En 1700, ajoute encore M. Moreau de Jonnès, la production était de 8 hectolitres par hectare ; en 1760 de 7 hectolitres; en 1788 et en 1813 de 8 hect.; en 1840, elle avait atteint le chiffre de 13.14 hect.
La consommation actuelle de la France s'élève à 146,876,000 hect. de toute espèce de grains; ce qui laisse, en moyenne, pour les semences et pour la réserve, 35,640,000 hect., ou environ le quart. La valeur des céréales consommées ne s'élève, pour chaque habitant, qu'à 51 fr. par an, en toutes sortes de grains, y compris la nourriture des animaux.
On évalue la production annuelle de l'Angleterre à 144,375,000 hect. de céréales de toute espèce; de l'Autriche à 206,740,000 hect. ; de la Prusse à 79,750,000 hect.; du reste de l'Allemagne à 57,705,900 hect.; de la Russie et de la Pologne à 304,678,000 hect.; de l'Europe entière à 1,171,217,000 hect. La production des États-Unis n'est pas bien connue, mais on estime que la seule récolte du mais s'élève à 170,000,000 hect. Nous donnons, sous toute réserve, ces chiffres que fournit la statistique; mais on peut hardiment affirmer que l'alimentation des peuples n'a pas cessé de progresser, surtout au point de vue de la régularité des approvisionnements. Au moyen âge, les famines étaient fréquentes. En France seulement, les historiens en comptent 26 au onzième siècle et 51 au douzième ; plus tard, dans le dix-septième siècle, on trouve 33 disettes et 11 famines; au dix-huitième siècle, 28 disettes et 9 famines; au dix-neuvième siècle (en cinquante ans), 13 disettes et 1 famine. [69] Il y a eu donc, sous ce rapport, une amélioration sensible. Sous le rapport de l'abondance de l'alimentation, le progrès est moins visible, mais il n'est probablement pas moins réel ; plusieurs écrivains pensent, à la vérité, que le prix des céréales a augmenté; ce qui serait l'indice d'une diminution relative de la production. M. Moreau de Jonnès notamment évalue à 11 fr. en 1700 et à 14 fr. en 1840 le prix moyen de l'hect. de céréales de toutes sortes; mais, selon M. Passy, la différence du pouvoir de l'argent aux deux époques équivaut bien à celle du prix nominal des céréales. [70] Au reste, depuis un demi-siècle, les prix ne semblent pas avoir varié sensiblement.
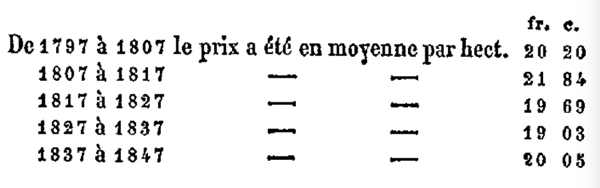
Selon M. Jacob, les prix du blé dans l’antiquité auraient été à peu de chose près l’équivalent des [323] prix actuels. Le prix du pain à Rome, dit-il dans son livre On precious metals (T. 1er , p. I65), semble avoir été, du temps de Pline, le même ou un peu plus bas que de nos jours. M. Dureau de Lamalle partage, à cet égard, l'opinion de M. Jacob. M. Dureau de Lamalle pense encore que le rendement du blé était a peu près le même dans l'antiquité que de nos jours, c'est-à-dire en moyenne de 4 à 6 pour 1. On ne s'étonnera pas de la fixité du prix du blé si l'on songe que, de tout temps, la production agricole a été assujettie à des entraves de toute nature et à des impôts lourds et vexatoires. Aussi est-elle, de toutes les branches de la production, celle qui a réalisé le moins de progrès; d'où la fixité exceptionnelle du prix. Cette fixité a rendu le prix du blé essentiellement propre aux évaluations historiques (voyez ce mot et aussi l'article Monnaies).
Les pays de l'Occident de l'Europe, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, ont habituellement besoin d'un supplément de céréales étrangères pour leur alimentation. La Russie, la Pologne et les États-Unis, sont, au contraire, les principaux pays d'exportation. Au dix-septième et au dix-huitième siècle, de 1677 à 1764 l'exportation des céréales d'Angleterre avait excédé l'importation de 33 millions de quarters; de 1765 à 1814, l'excédant de l'importation sur l'exportation fut de 31 millions de quarters. De 1815 à 1844, la balance en faveur de l'importation a été d'environ 20 millions de quarters. [71] Depuis 1844, les importations ont été sans cesse croissant : en 1847, l'Angleterre n'a pas reçu moins de 9,025,697 quarters de blé de toute espèce, dont 3,436,058 quarters de maïs des États-Unis, plus 7,061,000 quintaux de farine. En 1849, elle a importé 11,882,900 quarters de grains de toute espèce (blé, orge, seigle, avoine, pois, fèves, farines, etc.).
Ces chiffres attestent que le commerce international des céréales est susceptible de prendre une extension immense. Or, comme les disettes ne sont jamais universelles, ce commerce pourra de plus en plus aisément combler les vides qui lui seront signalés d'un côté par les excédants qui se manifesteront d'un autre. Les maux provenant de l'inconstance des saisons se trouveront ainsi atténués autant qu'ils peuvent l'être, et l'alimentation des peuples deviendra de jour en jour plus assurée et plus régulière; à la condition, bien entendu, que les lois céréales cesseront de porter obstacle à la libre circulation des subsistances.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Traité de la police, etc., par Delamare. In-folio, 1710. Le second volume de cet ouvrage renferme un historique complet de la législation des céréales en France jusqu'à la fin du dix-septième siècle.
Mémoire sur les blés, avec un projet d'édit pour maintenir en tout temps la valeur des grains à un prix convenable au vendeur et à l'acheteur, par Ch. Dupin. 1748. Réimprimé dans le Journal économique, en I760.
Discours sur l'entrée et la sortie des grains dans le royaume, par René Caradeuc de la Chalotais, procureur général au parlement de Bretagne. Rennes, 475-5, in-42.
Essai sur la police générale des grains, par C.-J. Herbert. Berlin (Paris), 1755, in-12.
Supplément à l'essai sur la police des grains, par J.-G. Montaudouin. La Haye, 1757, in-12.
Observations sur la liberté du commerce des grains, par Cl.-J. Herbert. Paris, 17509 in-12.
Recherches sur la valeur des monnaies et sur le prix des grains avant et après le concile de Francfort, par N.-F. Dupré de Saint-Maur. Paris, 1762, in-12.
Lettre sur l'imputation faite à M. Colbert d'avoir interdit la liberté du commerce des grains. Paris, 1768, in-12.
Réflexions sur la police des grains en France et en Angleterre, par L. P. Abeille. Paris, 1764, in-8. Abeille a publié à la même époque plusieurs autres écrits sur cette question.
De l'exportation et de l'importation des grains, par M. Dupont (de Nemours). Soissons, 1764, in-8.
Lettre au sujet de la cherté des blés en Guyenne, par Dupont de Nemours, 1764, in-8.
La liberté du commerce des grains toujours utile et jamais nuisible, par M. Le Trosne. Paris, 1765, in-12. Le Trosne a encore publié plusieurs lettres sur le commerce des grains dans le Journal de l'agriculture et dans les Ephémérides du citoyen.
Three tracts on the corn trade and corn laws. — (Trois traités sur le commerce et la législation des grains), par Charles Smith. 1 vol. in-8, 2e édit., Londres, 1766.
Recherches sur la population des généralités d'Auvergne, de Lyon, de Rouen et de quelques provinces et villes du royaume, avec des réflexions sur la valeur du blé tant en France qu'en Angleterre, depuis 1674 jusqu'en 1764, par Messance. 1766.
An inquiry into the causes of the présent high priées of provisions. — (Recherches sur les causes du haut prix actuel des denrées alimentaires). Londres, 1767, 4 vol. in-8. (Attribué à Nathaniel Forster.) « C'est peut-être le meilleur des nombreux écrits publiés à cette époque sur le prix des grains. » (M. C.)
Faits qui ont influé sur la cherté des grains en France et en Angleterre, 1768, in-8.
Memoria sobra los abastos de Madrid. — (Mémoire sur les approvisionnements de Madrid), par P. P. Rod. de Campomanès. Madrid, 1768, 2 vol. in-8.
Lettres sur le commerce des grains, par V. R., marquis de Mirabeau. Amsterdam et Paris, Dessaint, 1768, in-12.
Avis au peuple sur son premier besoin, ou petits traités économiques, par l'auteur des Ephémérides du citoyen (Baudeau). Paris, 1768, in-12, 3 parties.
Lettres sur les émeutes populaires occasionnées par la cherté des grains, par J. Turgot, 1768. Reproduit dans les Œuvres de Turgot, de la Collection des principaux Économistes, de Guillaumin.
Recueil des principales lois relatives au commerce des grains, avec les arrêts, arrêtes et remontrances du parlement sur ces objets, et le procès-verbal de l'assemblée générale de police tenue à Paris le 6 novembre 1768. Paris, 4 vol. in-12.
Représentations aux magistrats, contenant l'exposition raisonnée des faits relatifs à la liberté du commerce des grains, et les résultats respectifs des règlements et de la liberté, par l'abbé D.-J.-A. Roubaud. Londres et Paris, Lacombe, 1769, in-8.
Objection et réponse sur le commerce des grains et des farines, par Dupont de Nemours, 1769.
Lettres à un ami sur les avantages de la liberté du commerce des grains, et le danger des prohibitions, par F.-G. Le Trosne, 1769.
Observations sur les effets de la liberté du commerce des grains, et sur ceux des prohibitions, par Dupont de Nemours. Basle et Paris, 1770, in-8.
Dialogues sur le commerce des blés, par l'abbé Galiani. Londres (Paris), 1770. Reproduit dans la Collection des princip. Econ., de A. Guillaumin.
[324]
Réfutation des Dialogues sur le commerce des blés, par l'abbé Morellet. Paris, 1770, in-8. Une autre réfutation se trouve dans l'ouvrage suivant :
Récréations économiques, etc., par l'abbé A. Roubaud. Paris, 1770.
L’intérêt général de l'État, ou la liberté du commerce des grains, etc., avec la réfutation d'un nouveau système publié par l'abbé Galiani en forme de dialogue sur le commerce des blés, par H. Lemercier de la Rivière. Dessaint, Amsterdam et Paris, 1770, in-12.
Mémoire sur les meilleurs moyens d'assurer l'approvisionnement de la capitale, par Du Vaucelles. 1771, in-4 .
The expérience of a free exportation of corn with some observations on the bounty. - (L'expérience de la libre exportation des grains, avec quelques observations sur les primes), par Arthur Young. Londres, 1772, ln-8.
Ouvrage économique sur les pommes de terre, le froment et le riz, par A.-A. Parmentier, 1774, in-12.
Sur la législation et le commerce des grains, par Necker. Paris, 1775, 1 vol. in-8. Écrit qui a eu près de 20 éditions, et qui se trouve aussi dans la Collect. des princ. Écon. de Guillaumin.
Analyse de l'ouvrage sur la législation et le commerce des grains. Paris, 1776, 4 vol. in-8.
Examen d'un livre de Necker qui a pour titre : De la législation et du commerce des grains, par J.-P.-L. de la Roche du Maine, marquis de Luchet. 1775, in-8.
Vues politiques sur le commerce des denrées, par Henry de Goyon de la Plombanie. Amsterdam et Pans, Vincent, 1776, in-12.
An inquiry into the nature of the corn-laws, etc. — (Recherches sur la nature de la législation sur les céréales), par J. Anderson. Edimbourg, in-8, 1777. On sait que cet ouvrage renferme la première exposition de la théorie du fermage, attribuée habituellement à Ricardo.
Mémoire sur les avantages du commerce des grains et des farines, par A.-A. Parmentier. Pans, 1785 in-8.
Lettres sur les grains, écrites à Terray, par J. Turgot, 1788, in-8. Voyez aussi les Œuvres complètes de Turgot dans la Collection des princ. Écon. de Guillaumin.
Analyse historique de la législation des grains depuis 1692, par Dupont de Nemours. Paris, 1789, in-8.
Tranquillité sur les subsistances, ou moyens pour parer dans tous les temps à la cherté des grains en France, par J -B.-A. Malisset. Paris, Née de La Rochelle, 1789, in-8.
Spéculatif, ou dissertation sur la liberté du commerce des grains, par M. de Saint-Mars. Amsterdam et Paris, Lesclapars. 1790, 2 vol in-12.
Projet d'un décret sur les subsistances, par Vaudrey. Dijon, Causse, 1792, in-8.
Riflessioni sulle leggi vincolanti, principalmente nel commercio de' grani. — Réflexions sur les lois gênantes principalement dans le commerce des grains. etc.), par le comte P. Verri. 4 vol. in-8, Milan 1796.
Dispersion of gloomy appréhensions with respect to the décline of the corn trade. - (Du peu de fondement des tristes appréhensions relativement au déclin du commerce des grains), par le rév. J. Howlett. Londres, 1797, in-8.
A determination of the average depression of the price of wheat in war, below thaï of the preceding peace, and of its readvance in the following , etc-(Détermination de la dépression moyenne que le prix du blé peut subir en temps de guerre, etc., par J. Brand. Londres, 1800, in-8.
An investigation of the cause of the present high price of provision, by the author of the Essay on the principle of population. - (Recherches sur les causes du haut prix actuel des grains, par l'auteur de l’Essai sur le principe de la population) (Malthus). Londres, 1800, in-8.
The question of scarcity plainly slated, and remedies considered; with observations on permanent measures to keep wheat at a more regular price. — (La question de la disette clairement exposée, etc., suivie d'observations sur les moyens de maintenir le prix du blé à un taux presque uniforme), par Arthur Young. Londres, 1800, in-8.
Del libero commercio de' grani, lettera di G. R. Carli al présidente Pompeo Nero. — (De la liberté du commerce des grains), par G.-R. Carli. Reproduit dans la Collection de Custodi.
*Review of the statutes and ordinances of assize which hâve been established in England from the fourth year of king John, 1202, to the 37 of his présent majesty (Georges III), by G. Attwood. Londres, 1804, in-4. Cet ouvrage donne des détails sur le rapport établi par la législation entre le prix des grains, de la farine, et celui du pain ; sur les effets de la taxe, etc., depuis 1202 jusqu'à 1800.
An essay on the impolicy of a bounty on the exportation of grain, and on the principles which ought to regulate the commerce of grain.—(Essai sur les inconvénients d'une prime d'exportation pour le blé, et sur les principes qui devraient régler le commerce des grains), par James Mill, auteur de l'Histoire de l'Inde britannique, Londres, 1804, in-8.
Considérations on the protection required by british agriculture, and on the influence of the price of corn of exportable productions. — (Considérations sur la nécessité d'une protection en faveur de l'agriculture britannique, et sur l'influence du prix du blé sur les marchandises exportées), par William Jacob. Londres, 1814, in-8.
Observations on the effectsof the corn-laws.—(Observations sur l'effet des lois-céréales), par le rév. T.-R. Malthus. Londres, 1814, in-8.
The grounds of an opinion on the policy of restric-ting the importation of foreign corn.—(Raisons en faveur de l'utilité de restreindre l'importation du blé étranger), par le rév. T.-R. Malihus. Londres, 1815, in-8. La brochure suivante est une réponse à celles de Malthus.
An essay on the influence of a low price of corn on the profite of stock, with remarks on Mr. Malthus last two publications. — (Essai sur l'influence du bas prix des g r ains, sur les profits, etc.), par David Ricardo. Londres, 1815, in-8. Ces trois publications se trouvent dans la Collect. des princip. Écon., de Guillaumin.
Reports and evidence from the commitees of the houses of lords and commons on the corn-laws.— (Rapports des comités de la chambre des lords et de celle des communes sur la législation des céréales). Londres, 1814-15, in-folio.
An inquiry into the rise of price in Europe, during the last twenty five years, compared with that which has taken place in England ; with observations on the effects of high and low prices. - (Recherches sur la hausse des prix du blé en Europe dans les dernières vingt-cinq années, comparées à celle qui a eu lieu en Angleterre. Observations sur l'effet du haut et du bas prix), par Arthur Young. Londres, 1815, in-8.
Examen de quelques questions d'économie politique, sur les blés, la population, le crédit public et les impositions, par de Candolle-Boissier. Genève, Pans, Paschoud, 1816, in-8.
Halle aux blés de Nancy, subsistances, boulangers, accapareurs, approvisionnement de réserve, par C.-J .-A. Matthieu Nancy, Vincenot, veuve Bontems, 1818, in-8.
Projet contre la disette des grains, par le marquis de Lastours. Paris, Égron, 1819, in-8.
Essai sur cette question : Quels sont les meilleurs moyens de prévenir, avec les seules ressources de la France, la disette des blés et les trop grandes variations dans les prix, par J.-J. Paris. Paris, Mme Huzard, 1819, in-8.
[325]
Essai historique et critique sur la législation des grains; mémoire sur les moyens de prévenir, avec les seules ressources de la France, les disettes des blés et les trop grandes variations dans leur prix, par Chaillou des Barres. Paris, F. Didot, 1820, in-8.
De la disette et de la surabondance en France ; des moyens de prévenir l'une en mettant l'autre à profit, et d'empêcher la trop grande variation dans le prix des grains, par M. Laboulinière. Paris, 1821-1822, 2 vol. in-8. L. Rousseau a présenté sur cet ouvrage un rapport adressé à la Société d'agriculture d'Etampes; ce rapport a pour titre : Du commerce des grains dans le système général d'économie industrielle. Paris, 1822, in-8.
Examen général et détaillé des récoltes et des consommations de blé en France, avec indication des moyens propres à remédier à la surabondance et aux disettes, par P.-M. Lenoble. Paris, les principaux libraires, 1822, in-8.
Discours contre le projet de loi concernant l'entrepôt des grains étrangers, séance du 7 mai 1825, par P.-L. Roux, 1825. Paris, br. in-8.
Remarks on fair priées and produce-rents, par J.-H. Maclean. Edimbourg, 1825, in-8. Il existe en Ecosse un usage qui date du seizième siècle, et qui consiste à nommer un jury qui, après avoir pris toutes les informations nécessaires pour éclairer sa religion, fixe le prix moyen du blé qui doit servir de base au fermage. C'est ce prix qu'on nomme fair price.
Apologie de l'abondance, ou observations sur la législation actuelle des grains en France, par Alexandre Ruelle. Paris, 1825, in-8.
Prices of corn and wages of labour, with observations. — (Le prix du blé et le taux des salaires, avec des observations), par sir Edward West (auteur d'un ouvrage sur la rente). Londres, 1826, in-8.
A compendium of the laws passed from time to lime for regulating and restricting the importation, exportation and consumption of corn from the year 1660, with tables of price, etc. — (Recueil des lois sur les céréales promulguées depuis 1660, suivi de tableaux des prix du blé, etc.). Londres, 1826, in-8.
Corn and currency. An address to the landowners. — (Le blé et la circulation monétaire), par sir James Graham. Londres, 1827, in-8.
An essay on the externat corn trade. — (Essai sur le commerce extérieur des blés), par le colonel Torrens. 4e édition, Londres, 1827, 1 vol. in-8.
Two reports on the trade in corn and the agriculture of the north of Europe. — (Deux rapports sur le commerce du blé et sur l'agriculture du nord de l'Europe), par William Jacob. Imprimé par ordre de la chambre des communes, en 1826 et 1827, Londres, in-folio.
Report from and évidence taken before the sélect committee of the house of lords on the price of ship-ping foreign grain from foreign ports. — (Rapport sur une enquête ordonnée par la chambre des lords relativement au prix du transport du blé étranger). Londres, 1827, in-folio.
Rapport fait au nom de la commission chargée par la chambre des députés d'examiner le projet de loi sur les céréales, par le baron Dupin. Paris, in-4, 1831.
An inquiry into the expediency of the existing restrictions on the importation of foreign corn; with observations on the présent social and political prospects of Great-Britain. — (Examen de l'utilité des restrictions actuellement imposées à l'importation du blé étranger ; suivi d'observations sur l'état social et politique actuel de la Grande-Bretagne), par John Barton. Londres, 1833, in-8.
De la grande variation du prix des grains, des moyens de le fixer entre des limites plus rapprochées, etc., par P.-J. Milori. Paris, Mme Huzard, 1833, in-8.
Archives statistiques du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, publié par le ministre secrétaire d'État de ce département. Paris, imprimerie royale, 1837, in-folio. Cette publication contient de nombreux renseignements sur la production et le prix des céréales.
The history of prices and of the state of the paper circulation from 1798 to 1837, etc. — (Histoire des prix (du blé) et de l'état de la circulation des effets publics de 1798 à 1837), par Thomas Tooke. Londres, 1838, 2 vol. in-8. (Cet ouvrage est une nouvelle édition augmentée des Thoughts and détails of the high and low prices, etc.)
A history of prices and of the state of the circulation in 1838 and 1839, etc., being a sequel to the forgoing work. — (Histoire des prix et de l'état de la circulation en1838 et 1839), par Th. Tooke. London,1840,1 vol. in-8. Ouvrage faisant suite au précédent.
The effect of restrictions on the importation of corn considered with reference to the landowners, farmers and labourers. — (L'effet des restrictions imposées à l'importation du blé, considéré par rapport aux propriétaires, fermiers et ouvriers agricoles), par G.-R. Porter (du bureau du commerce). Londres, 1839, in-8.
Corn-laws : an authentic report of the late important discussions in the Manchester chamber of commerce on the destructive effects of the corn-laws upon the trade and manufactures of the country.— (Lois-céréales : rapport authentique sur les importantes discussions qui ont eu lieu dans la chambre de commerce de Manchester, relativement à l'effet pernicieux des lois-céréales sur le commerce et les manufactures de la contrée). Londres, 1839, in-8.
Influence of the corn laws as affecting all classes of the community, and particularly the landed interests. — (Influence des lois-céréales sur les diverses classes de la société, et surtout sur les intérêts agricoles), par James Wilson. Londres, 1839, in-8.
Statements illustration of the policy and probable consequences of the proposed repeal of the existing corn-laws, and the imposition in their stead of a moderate fixed duty on foreign corn, when entered for consumption. — (Conséquences probables du rappel des lois-céréales, etc.), par J.-B. Mac Culloch. Londres, 1841, in-8. Cette brochure a provoqué plusieurs réponses, notamment de M. le général J.-C. Dalbiac et de M. Taylor.
De la fabrication du pain chez la classe agricole et dans ses rapports avec l'économie politique, par J.-C. Fawtier, fermier élève de Roville, etc. Paris, Mme Bouchard-Huzard. Chamerot, 1845, brochure in-8.
Cobden et la Ligue, ou l'agitation anglaise pour la liberté des échanges, par Frédéric Bastiat. Paris, Guillaumin et comp., 1846, 1 vol. in-8.
Die Folgen der Aufhebung der englischen Korngesetze fur Deutschland und die deutsche Industrie. — (Les conséquences de l'abolition des lois anglaises sur les céréales, relativement à l'Allemagne et à son industrie), par M. François Stromeyer. Stuttgard, 1816. in-8.
Histoire du tarif des céréales, par G. de Molinari. Paris, Guillaumin et comp., 1847, in-8.
Statistique de l'agriculture de la France, contenant la statistique les céréales, etc., etc., par M. Alex. Moreau de Jonnès. Paris, Guillaumin et comp., 1848.
Mémoire sur la meunerie, la boulangerie et la conservation des grains et des farines, contenant une description complète des procédés, machines et appareils appliqués, etc., précédé de considérations sur le commerce du blé en Europe, par Auguste Rollet, directeur des subsistances de la marine. Paris, Carilian-Gœury et Dalmont, 1848, 1 vol. in-4.
Recherches sur l'influence que le prix des grains, la richesse du sol et les impôts exercent sur les systèmes de culture, par Henri de Thünen. Traduit de l'allemand et augmenté de notes explicatives, par M. Jules La-verrière. Paris, Guillaumin et comp., 1851.
Endnotes to Céréales
[30] Dureau de La Malle, Économie politique des Romains, t. Il, p. 307.
[31] De Sismondi, Études sur l'économie politique, t.11, p. 25.
[32] Éd. Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, chap. 24.
[33] Cassiodore, liv. IV, ép. 5.
[34] Capitulaires de Baluze, col. 267, année 794.
[35] Traité de la Police, par Delamare, t.11, p. 916.
[36] Traité de la Police, par Delamare, t. II, p. 1069.
[37] Pierre Clément, Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, p. 274.
[38] La pièce qu'on a désignée sous le nom de pacte de famine, c'est-à-dire le contrat de société passé pour la manutention des blés du roi entre les sieurs Leray de Chaumont, Rousseau, Perruchot et Malisset, se trouve dans la Police de Paris dévoilée, de P. Manuel, procureur de la commune de Paris, t. I, p. 381. Un romancier, M. Élie Berthet, a écrit un roman et un drame sur le pacte de famine.
[39] Recueil des principales lois relatives au commerce des grains, avec les arrêts, arrêtés et remontrances du parlement sur ces objets, et le procès-verbal de l'assemblée générale de police tenue à Paris le 6 novembre 1768.
[40] Ibid., p. 165-177.
[41] Recueil déjà cité, p. 261.
[42] I vol. in-8, Paris, 1770.
[43] Eug. Daire, Notice historique sur Turgot (Collect. des princ. Econ., t. III, p. 84).
[44] Relation historique de l'émeute arrivée à Paris le 3 mai 1775, et de ce qui l'a précédée et suivie. Insérée à la suite des Mémoires de l'abbé Terray.
[45] Eug. Daire, Notice historique sur Turgot, p. 99.
[46] Arthur Young, Voyage en France, ch. 18. — De la police des grains en France.
[47] Ibid.
[48] A Marseille notamment, la cherté des blés occasionna une émeute le 25 mars. Le peuple voulut forcer les consuls à abaisser le prix du pain au-dessous du cours du blé. Mirabeau démontra l'absurdité de cette prétention dans un Avis au peuple marseillais, qui est un petit chef-d'œuvre, et il réussit à apaiser l'émeute.
[49] Ed. Fleury, Études révolutionnaires : famines, misères et séditions, p. 10.
[50] Idem, p. 28.
[51] Lettres de Roland, ministre de l'intérieur, à la convention nationale (4 novembre 1792).
[52] Lettre de Roland au président de l'assemblée nationale (18 novembre 1792).
[53] Ibid. (4 novembre 1792).
[54] Discours de Julien Souhait, député des Vosges à la convention nationale.
[55] Rapport de Barrère sur le maximum, séance de la convention du 21 février 1794.
[56] Lettre de Roland, ministre de l'intérieur, à la municipalité de Paris (18 novembre 1792).
[57] Thiers, Histoire de la révolution française, liv. 46.
[58] Thiers, Histoire de la Révolution française, liv. 24.
[59] Vincens, Notice sur la cherté des grains de 1814 à 1812. — Journal des Économistes, n° d'octobre 1843.
[60] Discours de M. Voyer- d'Argeuson, séance du 7 juillet 1819.
[61] Discours de M. Humblot-Conté, séance du 4 avril 1821.
[62] Études sur l'Angleterre. — Les lois sur les céréales, t. II, p. 327.
[63] Léon Faucher, Études sur l'Angleterre, tome II, page 343.
[64] Lettres sur la liberté du commerce des grains, Œuvres de Turgot, t. 1, p. 198, édit. Guillaumin.
[65] Le Libre-Échange, n° du 6 décembre 1846.
[66] Économie politique de Schmalz*, traduction de Henry Jouffroy, t. II, p. 73.
[67] Études sur l'économie politique, t. II, p. 44.
[68] Th. Tooke, A history of prices, vol. 1, ch. 2. Effect of quantity on prices, p. 10.
[69] Moreau de Jonnès, Production agricole de la France; Annuaire de l'économie politique cl de la statistique pour 1850, p. 368.
[70] H. Passy, Fixité du prix du blé en France, malgré l'accroissement de la population. Annuaire de 1849.
[71] Léon Faucher, Études sur l'Angleterre, p 345.
Civilisation↩
Source
"Civilisation", DEP, T. 1, pp. 370-77.
[370]
La civilisation consiste dans l'ensemble des progrès matériels et moraux que l'humanité a réalisés et qu'elle réalise tous les jours. Ces progrès ont leur source dans la faculté qui a été départie à l'homme de se connaître lui-même, et de connaître le milieu où il vit, de capitaliser ses connaissances, de les transmettre et de les combiner : ainsi, le progrès matériel provient de la connaissance de plus en plus étendue que l'observation nous donne des ressources naturelles de notre globe et des moyens de les exploiter ; le progrès moral se développe, de même, au moyen des notions de plus en plus justes, de plus en plus complètes que l'observation nous suggère sur notre nature, sur la société au sein de laquelle nous vivons et sur nos destinées.
Les besoins de l'homme sont les stimulants énergiques qui le poussent à multiplier ses observations, à accumuler ses connaissances. La nature lui fournit les matériaux qui lui sont nécessaires pour les apaiser ; mais ces matériaux il est obligé de les recueillir et de les façonner à son usage. Aucun des appétits qui le sollicitent ne peut être satisfait sans qu'il lui en coûte des efforts, du travail. Or ces efforts, ce travail, en vertu de son organisation même, impliquent une souffrance. Il se trouve intéressé, en conséquence, à les réduire autant que possible, tout en accroissant ses satisfactions ; il est intéressé à obtenir un maximum de satisfactions, moyennant un minimum de travail. Comment peut-il y parvenir? Par un seul moyen, un seul ! par l'application de procédés de plus en plus efficaces à la production des choses qui lui sont nécessaires. Et ces procédés, comment peut-il les trouver? Uniquement encore par l'observation et l'expérience.
Poussés par la faim, les premiers hommes se jetèrent sur les animaux les moins capables de se défendre et les dévorèrent. Ils reconnurent que la chair de quelques-uns était propre à apaiser leur faim et agréable au goût ; mais il leur était difficile de s'en procurer régulièrement une quantité suffisante, car la plupart de ces animaux les surpassaient en agilité. Aiguillonnés par le besoin, ils s'appliquèrent à surmonter cette difficulté, et ils y réussirent: un sauvage plus intelligent que les autres, observant la propriété dont certains bois sont pourvus de se courber sans se rompre, et de se redresser avec violence après avoir été courbés, imagina d'utiliser cette force pour lancer des projectiles. L'arc fut inventé. La subsistance de l'homme devint aussitôt plus facile. Il put appliquer son intelligence à recueillir de nouvelles observations et à les combiner pour augmenter ses jouissances et diminuer ses peines. Ses besoins moraux, éveillés par une multitude de phénomènes mystérieux, l'y poussaient en même temps que ses besoins physiques. Le terrible phénomène de la mort, par exemple, en remplissant son âme de curiosité, d'épouvante et quelquefois d'affliction, ne devait-il pas l'exciter à pénétrer le secret de sa destinée? Ainsi sollicité, sans paix ni trêve, par les besoins multiples et irrésistibles de sa nature, l'homme n'a cessé, depuis l'origine du monde , d'accumuler observations sur observations, connaissances sur connaissances, et d'améliorer, grâce à ce travail continu de son intelligence, sa condition matérielle et morale.
La civilisation nous apparaît donc comme un fait naturel; elle résulte de l'organisation même de l'homme, de l'intelligence et des besoins dont il a été pourvu. Elle a sa source dans l’observation stimulée par l'intérêt, et elle n'a de limite que celle des connaissances qu'il est donné à l'homme d'accumuler et de combiner sons l'impulsion de ses besoins. Or celle limite dons échappe ; d'où il suit qu'on a pu dire avec vérité que le progrès est indéfini.
Cependant la civilisation, quoique inhérente à la nature humaine, ne s'est pas également développée chez tous les peuples. De nos jours encore, certains peuples demeurent plongés dans les limbes de la primitive barbarie, tandis qu'à côté d'eux la civilisation se déploie avec toute sa puissance. A quoi tient cette inégalité de développement? [371] Elle tient à l'Inégalité des facultés physiques et morales, dévolues aux différentes variétés de l'espèce humaine; elle tient aussi au milieu où chacune de ces variétés s'est développée. Elle tient, pour nous servir du langage économique, à la quantité des biens naturels, soit internes, soit externes, que le Créateur a départis à chaque peuple. Or ces matières premières de la civilisation ont été fort inégalement distribuées : du Botocudo stupide à l'Anglo-Saxon, devenu son voisin, la distance est immense au double point de vue du physique et du moral, et entre ces deux variétés de l'espèce humaine, qui semblent en former les chaînons extrêmes-, apparaît une multitude de races toutes Inégales el diverses; de même, entre les sables du Sahara et les alluvions du Sénégal, combien de degrés de fécondité!
Comment ces inégalités naturelles ont agi sur la civilisation, voilà ce qu'il importe de bien examiner. Il est évident que si deux peuples inégalement pourvus de biens internes se trouvent placés dans des milieux semblables, le mieux approvisionné de ce capital naturel devra se développer plus rapidement et plus complètement que l'autre. Il n'est pas moins évident que si deux peuples égaux-; sous le rapport des biens internes, se trouvent placés dans des milieux inégaux, leur développement sera encore inégal. L'influence des biens internes et de leur distribution inégale sur la civilisation n'a pas encore été, croyons-nous, suffisamment étudiée et appréciée. En revanche, l'influence des milieux a été beaucoup mieux reconnue et signalée. Jean Bodin, Montesquieu, Herder, en ont parfaitement fait ressortir l'importance. On pourrait même les accuser de l'avoir exagérée.
Quoi qu'il en soit, en tenant bien compte de ces éléments naturels de la civilisation, on s'explique que certaines races aient atteint un niveau élevé de progrès, tandis que d'autres sont demeurées plongées dans la barbarie. En étudiant, pat-exemple, l'histoire naturelle des variétés d'hommes qui peuplent les archipels du grand Océan, ainsi que les circonstances physiques auxquelles elles se trouvent soumises, on s'explique qu'elles soient demeurées les plus arriérées de l'espèce humaine. En premier lieu, ces peuplades ne possèdent généralement qu'une faible dose d'intelligence; elles n'ont qu'à un degré inférieur cette faculté d'observer, d'accumuler ses observations et de les combiner qui est le moteur essentiel de la civilisation. En second lieu, la douceur du climat sous lequel elles vivent, la fécondité naturelle du sol, en leur permettant de satisfaire aisément leurs besoins les plus grossiers, laissent leur intelligence sans aiguillon. Enfin , leur situation topographique, en les isolant du reste de l'humanité, les a réduites à exploiter leurs seules ressources, leurs éléments bornés de civilisation. Pour en emprunter d'autres , elles auraient dû franchir les abîmes de l'Océan. Or, pour traverser l'Océan , il leur aurait fallu connaître l'art de la navigation, la boussole, etc.; connaissances qui dépassaient la portée de leur intelligence ou dont les matériaux mêmes leur manquaient. Ces collections d'hommes, perdues dans l'immensité de l'Océan, se trouvaient ainsi condamnées a languir plus longtemps que les autres dans les ténèbres de la barbarie. Selon toute apparence, elles y seraient encore plongées Si la lumière ne leur était venue du dehors ; si des peuples déjà avancée dans la civilisation n'avaient commencé à les visiter. — Supposons cependant que ces peuplades, au lieu d'être séparées par îles abîmes infranchissables , eussent vécu en terre ferme ou dans le voisinage de la terre ferme, leur condition eut été certainement fort différente. A la longue, elles auraient communiqué les unes avec les autres; elles se seraient mêlées; elles auraient échangé leurs découvertes et leurs productions. Une civilisation serait née de ce contact et de ce mélange de peuplades diversement douées, civilisation grossière et incomplète sans doute, mais qui eût produit un état social bien supérieur à celui de l'ensemble des peuplades isolées des archipels polynésiens. Voilà un exemple de l'influence des biens naturels, internes ou externes, sur la civilisation.
En voici un autre. A l'extrémité opposée de l'échelle de la civilisation nous apparaît le peuple de la Grande-Bretagne. Ce peuple est un composé, un produit de six ou sept races qui ont successivement envahi le sol britannique, et dont les aptitudes diverses se sont unies, combinées pour l'exploiter. Les conditions naturelles du sol, du climat et de la situation topographique de la Grande-Bretagne ont admirablement secondé cette œuvre de civilisation. Le sol est fertile ; mais sa fécondité n'est pas assez exubérante pour permettre à ceux qui l'exploitent de se laisser aller à l'indolence. Le climat, sans être rigoureux à l'excès, exige cependant que l'homme soit vêtu et soigneusement abrité. Enfin, la Grande-Bretagne est séparée du continent par un bras de mer qui, tout en protégeant ses habitants contre l'invasion étrangère, leur permet de communiquer sans difficulté avec d'autres peuples abondamment pourvus des éléments nécessaires au progrès. Favorisée par un tel concours d'avantages naturels, la civilisation ne pouvait manquer de s'y développer avec rapidité. — Mais supposons que les aborigènes de la Grande-Bretagne eussent été jetés sur les plages de la Nouvelle-Zélande: qu'ils n'eussent pu, en conséquence, se mêler à des peuples tels que ceux qui vinrent successivement s'établir à leurs côtés, ni communiquer avec un continent où la civilisation avait déjà projeté ses lueurs, n'y a-t-il pas apparence qu'ils différeraient peu aujourd'hui des indigènes de la Nouvelle-Zélande?
L'influence que la distribution des biens naturels, internes ou externes, exerce sur la civilisation étant, bien reconnue, il s'agit de savoir encore quelle influence l'état des relations des hommes entre eux peut exercer sur leur activité progressive ; dans quelles circonstances sociales ils sont le plus excités à utiliser les éléments de progrès qui se trouvent a leur disposition.
Si la civilisation est un produit de notre intelligence stimulée par nos besoins, il est évident qu'elle se développera d'autant plus vite que nous pourrons appliquer plus librement nos facultés aux objets qui leur conviennent et que nous serons plus assurés de jouir nous-mêmes du fruit de nos efforts. — Si j'ai de l'aptitude pour les mathématiques et que, sans avoir égard à ma vocation, on [372] m'oblige à me livrer à la peinture, la portion la plus énergique et la plus puissante de mon intelligence demeurera comme supprimée. J'aurais pu trouver la solution d'un certain nombre de problèmes de mathématiques ; mais comme on m'empêche de m'adonner à ce travail auquel je suis naturellement propre, les problèmes que j'aurais résolus ne le seront point, ou, du moins, ils le seront plus tard, et la civilisation se trouvera retardée d'autant. En revanche, je ferai de la peinture ; mais comme je suis peu propre à cet art, je ne contribuerai aucunement à ses progrès. J'eusse été un bon mathématicien, je serai un mauvais peintre.— En portant atteinte à la liberté du travail, on annule donc, on supprime des forces qui eussent activé le mouvement progressif de l'humanité ; on ampute, en quelque sorte, la portion de l'intelligence qui pouvait le plus efficacement contribuer à la civilisation. Quand certaines professions sont interdites à des hommes qui pourraient y exceller, ou simplement quand l'accès en est rendu coûteux et difficile, ou bien encore quand des règles immuables marquent à chacun la carrière qu'il doit suivre, c'est une cause permanente de retard pour la civilisation.
Toute atteinte portée à la propriété est une autre cause de retard. Pourquoi est-ce que je condamne mon intelligence au travail d'accumuler des observations, de les combiner et de les appliquer à la satisfaction de mes besoins? C'est, n'est-il pas vrai, pour que ce travail me procure une jouissance ou m'épargne une peine. Je n'ai pas d'autre but. Mais si l'on m'enlève, en tout ou en partie cette satisfaction ; si le fruit de la peine que je me suis imposée est consommé par d'autres, quelle raison aurai-je encore de faire travailler mon intelligence? Si, par exemple, un autre homme m'oblige à travailler pour lui, à labourer son champ, à moudre son grain, en ne me laissant du fruit de mon travail que ce qui m'est rigoureusement nécessaire pour subsister; si, en un mot, je suis esclave, quel intérêt aurai-je à perfectionner la culture du champ, la mouture du blé? Que m'en reviendra-t-il? Ne sais-je pas que le fruit de mes recherches laborieuses ira tout entier à mon maître, c'est-à-dire à mon ennemi naturel, à celui qui me dérobe, chaque jour, une partie de mon légitime salaire pour se l'attribuer? Pourquoi donc augmenterais-je les satisfactions d'un homme qui me prive abusivement des miennes? L'esclavage qui n'est, du reste, qu'une des formes innombrables de la spoliation , apparaît donc comme un des plus sérieux obstacles qui entravent les progrès de l'humanité; de même, toute action arbitraire ou légale qui a pour résultat d'atteindre ou de menacer des propriétés naturelles ou acquises ralentit la marche de la civilisation, en diminuant la puissance du mobile qui pousse les hommes à agrandir le cercle de leurs connaissances et de leurs acquisitions.
La liberté qui permet à chaque homme de tirer le meilleur parti possible des biens dont il est pourvu ; la propriété qui lui attribue la jouissance absolue de ces biens et des fruits qu'il eu peut tirer, voilà quelles sont les conditions nécessaires aux progrès de l'humanité. La spoliation, sous la multitude de formes qu'elle affecte, tel est le grand obstacle qui retarde, depuis l'origine du monde, le développement de la civilisation.
Cela étant, il semblerait que les hommes eussent dû, dès l'origine, s'arranger de manière à maintenir inviolables leur liberté et leur propriété. Malheureusement, ils n'ont appris qu'à la longue et par une rude expérience combien le respect de la liberté et de la propriété est essentiel à leur bien-être. Si l'on essaie de faire abstraction de cette expérience; si l'on examine dans quelles conditions naturelles les hommes se trouvaient placés à l'origine; si l'on se rend bien compte de leurs instincts, de leurs besoins et des moyens qu'ils avaient de les satisfaire, on se convaincra qu'ils ne pouvaient commencer autrement que par la spoliation.
Des hommes ignorants, à peine sortis des mains de la nature, sans autres guides que leurs instincts, sans aucune expérience acquise ni du monde ni d'eux-mêmes, se trouvaient obligés de pourvoir à des besoins qui se renouvelaient chaque jour et qui devaient être satisfaits sous peine de mort. Manquant des instruments et des connaissances nécessaires pour s'assurer une subsistance régulière, ils étaient incessamment exposés aux dures extrémités de la faim. Lorsqu'un de ces hommes ignorants et affamés rencontrait un de ses semblables qui, plus heureux que lui, avait réussi à saisir une proie, une lutte n'était-elle pas inévitable? Pourquoi l'homme affamé et dépourvu n'aurait-il pas essayé de s'emparer du butin qui s'offrait à lui? Il ne se faisait point scrupule de dépouiller l'abeille et de dévorer la brebis, pourquoi aurait-il respecté l'homme? Il y a, sans doute, un instinct naturel qui porte les êtres de même espèce à ne point se nuire, mais cet instinct dont l'intensité varie d'ailleurs selon les individus, ne devait-il point céder devant la pression toute-puissante du besoin? Qu'on se figure ce qui arriverait, même de nos jours, après tant de progrès réalisés, après tant d'acquisitions faites dans le monde physique et moral, si aucune force supérieure n'était constituée pour réprimer les sévices individuels, si la société se trouvait abandonnée à l'anarchie? Les plus affreux désordres naîtraient évidemment de cette situation. Le vol et l'assassinat se multiplieraient d'une manière effrayante jusqu'à ce qu'une force répressive eût été reconstituée. N'en devait-il pas être ainsi, à plus forte raison, dans les premiers âges du monde?
L'histoire atteste, au surplus, que l'abus de la force était général dans ces premiers âges dont l'innocence a été tant vantée par les poètes. La liberté et la propriété des faibles se trouvaient tous les jours à la merci des forts. Chacun était incessamment exposé à ce qu'on lui ravît le fruit de ses travaux. Nul, en conséquence, n'avait intérêt à augmenter ses acquisitions et à les accumuler. Aucun progrès n'était possible sous ce régime. Alors qu'arriva-t-il? C'est que l’expérience des maux de l'anarchie engagea les hommes à se réunir pour mieux protéger leur liberté et leur propriété. Des associations se fondèrent de toutes parts, au sein desquelles l'assassinat et le vol furent défendus et punis. Cependant l'action pacificatrice de ces sociétés de protection mutuelle fut d'abord très limitée : si l'on apercevait clairement [373] la nécessité de vivre en paix avec ses voisins Immédiats, on n'était pas autant frappé des inconvénients d'une guerre avec les hommes qui demeuraient un peu plus loin. Souvent même, on croyait avoir avantagé à les soumettre et à lés dépouiller. Il fallut que l'expérience intervint encore pour étendre de proche en proche la sphère de la paix, c'est-à-dire du respect systématisé et organisé de la liberté et de la propriété : peu à peu, des peuples placés dans le même voisinage, et dont les forces étaient à peu près égales, se convainquirent, à la suite de diverses rencontres, qu'ils perdaient plus qu'ils ne gagnaient à se faire la guerre. Ils convinrent, en conséquence, de suspendre leurs hostilités, de faire des trêves, notamment, s'ils étaient agriculteurs, aux époques des semailles et des moissons. Ils conclurent enfin des alliances, soit pour attaquer, soit pour se défendre en commun. Entre ces peuples qui avaient fait des trêves ou conclu des traités, des communications régulières s'établissaient. Chacun communiquait aux autres les connaissances qu'il avait acquises et accumulées. L'échange des produits s'opérait en même temps que l'échanges des idées. A mesure que l'expérience des maux de la guerre agrandissait ainsi la sphère de la paix, on voyait se développer la civilisation. Le même résultat était obtenu lorsqu'un peuple étendait au loin sa domination, car ce peuple ne tardait pas à s'apercevoir qu'il était intéressé à maintenir la paix dans les régions soumises à son empire. Sous la domination romaine, par exemple, les nations les plus civilisées de la terre cessèrent de se faire la guerre, et de magnifiques voies de communication unirent ces nations demeurées, pendant si longtemps , étrangères ou ennemies. Les progrès que chacune d'elles avait réalises dans son isolement se généralisèrent. Le christianisme de la Judée, la philosophie et les arts de là Grèce, la législation de Rome, se répandirent en Afrique, en Espagne, dans les Gaules, dans la Germanie et jusque dans la Grande-Bretagne. En même temps, le commerce se développait et les plantes utiles passaient d'un pays dans un autre, avec l'art de les cultiver : la cerise était importée de l'Asie Mineure en Europe, la vigne était transportée dans les Gaules ; bref, la civilisation se propageait, sous toutes ses formes, d'Orient en Occident.
Cependant, dans ces premiers âges de l'humanité, la paix ne pouvait être ni générale ni durable : au sein des peuples pacifiés, la servitude à tous ses degrés apparaissait comme une cause permanente de conflits ; au dehors, des multitudes de barbares convoitaient les richesses accumulées par les peuples civilisés. Tous les foyers primitifs de la civilisation, la Perse, l'Egypte, l'empire romain, devinrent, comme on sait, après mille luttes intestines, la proie des barbares.
Ces grandes invasions qui occupent une si large place dans l'histoire du monde n'eurent point partout et toujours les mêmes résultats. Elles furent, selon les circonstances, favorables ou funestes aux progrès de l'humanité. Si l'on veut apprécier l'influence qu'elles ont exercée à ce point de vue, il faut rechercher d'abord quelles quantités de capitaux matériels et immatériels ont péri dans le cours de l'invasion ; il faut examiner ensuite si, la conquête accomplie, les vainqueurs et les vaincus ont gagné par leur contact plus de liberté et de sécurité si leurs forces progressives se sont trouvées accrues. L'anarchie, la servitude et la guerre sont les grands obstacles a la marche de la civilisation ; mais souvent ces causes de retard se sont détruites ou atténuées les unes par les autres. Parfois la servitude a mis fin à l'anarchie et parfois aussi la guerre à la servitude. Il y a eu recul chaque fois que le résultat du conflit a été une diminution de la liberté et de la sécurité acquises; il y a eu progrès chaque fois que la somme de liberté et de sécurité existant dans le monde s'en est trouvée accrue, à moins toutefois que la destruction de capitaux opérée dans le conflit n'eût été assez considérable pour balancer le gain réalisé.
Nous ne saurions dire, par exemple, si l'invasion de l'empire romain par les barbares venus du Nord a hâté ou reculé les progrès de la civilisation; si l'immense destruction de capitaux matériels et immatériels que ce cataclysme a occasionnée a été compensée ou non par des acquisitions d'une autre nature; si l'empire romain ayant continué de subsister, les différentes variétés d'hommes qui habitent aujourd'hui l'Europe se fussent aussi utilement mêlées; si l'esclavage n'eût point subsisté plus longtemps. Nous ne possédons point les données nécessaires pour résoudre ce problème historique. Nous pouvons conjecturer toutefois que si l'établissement de la domination romaine sur des peuples qui avaient, pour la plupart, adopté l'institution de l'esclavage, put servir la cause de la civilisation, en faisant régner la paix entre ces peuples, en augmentant, par conséquent, la somme de sécurité dont jouissait le monde, sans diminuer sensiblement la somme de sa liberté; de même, l'établissement des barbares sur les ruines de la domination romaine put contribuer encore aux progrès de la civilisation, en hâtant la destruction du régime de l'esclavage et en accroissant ainsi la somme de liberté que possédait le genre humain.
Quoi qu'il en soit, depuis la chute de l'empire romain, et surtout depuis la fin de la barbarie féodale qui s'y était substituée, les progrès de la liberté et de la sécurité ont été sans cesse croissants. Ces progrès, qu'ils aient été accélérés ou non par l'invasion des barbares débordant sur la civilisation antique, ont merveilleusement servi le développement de la civilisation moderne. Désormais plus libre d'employer à l'augmentation de son bien-être les éléments de progrès dont il disposait, plus assuré aussi de conserver le fruit de ses efforts, l'homme a donné à son activité un plus large essor. Il a exploré le monde matériel et le monde moral, avec une puissance et un succès dont on n'avait auparavant aucune idée. Il a découvert, tout à la fois, les moyens de mieux conserver les acquisitions anciennes, de multiplier et de propager plus rapidement les nouvelles. Parmi ces découvertes, quelques-unes ont exercé sur la marche de la civilisation une influence telle qu'il importe de s'y arrêter un instant.
Nous citerons au premier rang l'invention de la poudre à canon. L'effet immédiat de cette découverte a été de changer la proportion entre le travail et le capital nécessaires à l'exercice de [374] l'industrie militaire. Il a fallu proportionnellement moins de travail et plus de capital, moins d'hommes et plus de machines. Une pièce de canon, servie par huit hommes, a fait l'office de cent arbalétriers. Qu'est-il résulté de là? C'est que les nations civilisées ont acquis sur les peuples barbares un avantage énorme, au point de vue de l'attaque et de la défense. La supériorité de leur outillage militaire, jointe à celle des capitaux nécessaires pour mettre en activité cette coûteuse machinery, leur a assuré la prédominance. Dès lors , de nouvelles invasions de barbares, venant détruire les acquisitions antérieures de la civilisation, ont cessé d'être à redouter. Débarrassées d'ailleurs de la corruption de l'esclavage, qui pouvait rendre à la longue les invasions utiles, les nations civilisées ont acquis, sous ce rapport, une sécurité qu'elles n'avaient point dans l'antiquité. Au lieu d'être subjuguées de nouveau parles barbares, elles ont, au contraire, commencé partout à les assujettir à leur domination. [72]
Voilà donc les résultats acquis de la civilisation désormais assurés. Voici maintenant qu'un procédé est découvert pour propager à peu de frais et avec une rapidité merveilleuse les connaissances que l'esprit humain accumule : l'imprimerie est inventée. Naguère, la diffusion du capital immatériel de l'humanité était difficile et coûteuse; quelquefois aussi on voyait se perdre une partie des accumulations antérieures, Grâce à l'imprimerie, la même observation, la même pensée, la même invention put se reproduire indéfiniment et traverser, ainsi multipliée, l'immensité des siècles.
Ce n'est pas tout. La civilisation était jadis un fait local. Chaque peuple, séparé de ses voisins, soit par des obstacles physiques, soit par des haines ou des préjugés séculaires, chaque peuple avait sa civilisation étroite et isolée. Voici, d'une part, que l'expérience de plus en plus généralisée des maux de la guerre, jointe aux autres progrès des sciences morales et politiques, commence à rapprocher les nations, en leur démontrant qu'elles ont intérêt à demeurer en paix et à échanger leurs productions. Voici, d'une autre part, que l'application de la vapeur et de l'électricité à la locomotion, en annulant, pour ainsi dire, les distances, rend de plus en plus praticables ces échanges maintenant reconnus utiles. Voici, grâce à ces progrès matériels et moraux, que les civilisations locales , naguère isolées, hostiles, sans communications régulières, commencent à se fondre, tout en conservant les caractères qui leur sont propres, dans une civilisation générale.
Que si l'on recherche l’origine de ces grands progrès qui ont assuré et accéléré la marche de la civilisation, on reconnaîtra qu'ils proviennent, comme tous les autres, de l'application de l'intelligence humaine à l'observation des phénomènes du monde physique et moral, application qui est devenue plus générale et plus féconde, à mesure que les hommes ont été plus intéressés à s'y livrer. On a beaucoup exalté les hommes qui ont systématisé la méthode d'observation, et, entre tous, le chancelier Bacon. Assurément, c'était justice. Cependant il ne faut pas oublier que cette méthode était connue et pratiquée depuis l'origine du monde, puisque c'est à l'observation et à l'expérience, qui n'est qu'une des formes de l'observation, que tous les progrès de l'humanité ont été dus. Si elle était moins féconde, dans l'antiquité, cela venait d'abord de ce que la somme des connaissances antérieures dont on pouvait se servir pour en acquérir de nouvelles était moindre; cela venait, ensuite, de ce que la liberté et la propriété étant moins généralement garanties, un plus petit nombre d'hommes se trouvaient intéressés à observer et à utiliser leurs observations. Les arts matériels, par exemple, abandonnés pour la plupart aux esclaves, demeuraient forcément stationnaires. Quel intérêt les esclaves auraient-ils eu à les faire avancer? Mais ce défaut de progrès dans certaines branches essentielles des connaissances humaines ne devait-il pas à son tour ralentir l'essor de toutes les autres? Ne sait-on pas que tous les progrès se tiennent, et que des découvertes faites dans n'importe quelle partie du domaine ouvert à notre activité en amènent d'autres, souvent à une extrémité opposée? Il y a certainement peu de rapport entre la fabrication du verre et l'observation des corps célestes ; et pourtant combien les progrès de l'art du verrier n'ont-ils pas avancé ceux de l'astronomie! Dans l'antiquité, l'absence de progrès dans les arts matériels, que l'esclavage avait avilis, privait les hommes des notions et des instruments nécessaires pour agrandir le cercle de leurs connaissances. La méthode d'observation était, en conséquence, moins efficace entre leurs mains, quelquefois même elle demeurait stérile. Alors qu'arrivait-il? C'est que les hommes pressés d'obtenir la solution de certains problèmes, et ne voyant pas ce qui leur manquait pour les résoudre, proclamaient, de guerre lasse, la méthode d'observation impuissante, et bâtissaient, sur la base fragile de l'hypothèse, des systèmes dont la science devait faire justice plus tard. La méthode d'observation s'en trouvait discréditée, surtout lorsque certaines classes se croyaient intéressées au maintien des solutions que l'hypothèse avait données; mais son discrédit, qui avait sa source première dans la servitude, devait inévitablement s'effacer avec elle. A mesure que la servitude disparaissait et que la lacune, du progrès des arts matériels commençait à se combler, la méthode d'observation, pourvue de nouveaux instruments , acquérait une portée qu'on ne pouvait naguère lui soupçonner. Son efficacité pour résoudre des problèmes que l'on regardait, auparavant , comme au-dessus de l'intelligence humaine, devenait alors visible à tous les yeux. C'est l'honneur de Bacon d'avoir le premier reconnu ce fait; mais n'est-ce pas à la liberté plus encore, qu'à Bacon que revient le mérite d'avoir vulgarisé, universalisé la méthode d'observation? N'est-ce pas à dater du jour où l'observation a acquis ce tout-puissant auxiliaire et à mesure qu'elle [375] l'a mieux possédé, qu'elle a multiplié ses efforts et obtenu ses résultats les plus merveilleux? Depuis l'avènement de la liberté industrielle, par exemple, en un siècle à peine, n'a-t-elle pas agrandi le domaine de la civilisation plus qu'elle ne l'avait fait auparavant en vingt siècles?
En devenant plus générale, sous l'influence des progrès qui viennent d'être signalés, la civilisation a vu sa puissance s'accroître d'une manière incalculable. Jadis chaque nation, confinée dans son isolement, en était à peu près réduite à ses propres ressources pour développer ses connaissances et augmenter son bien-être. Or, comme les aptitudes des hommes sont essentiellement diverses, selon la race, le climat, les circonstances locales; comme les qualités du sol ne le sont pas moins, comme le même lambeau de terre n'est pas également propre à toutes les cultures, chaque civilisation isolée demeurait nécessairement incomplète. Seules, quelques individualités privilégiées pouvaient appliquer à la satisfaction de leurs besoins des produits venus des autres points du globe. La masse du peuple était obligée de se contenter des productions du pays, et le peu d'étendue du marché apportait un obstacle insurmontable au développement progressif de ces productions. On suppléait, à la vérité, jusqu'à un certain point, au défaut des communications, en augmentant d'une manière artificielle le nombre des industries nationales, en empruntant des industries à l'étranger. Par malheur, cette assimilation, utile dans de certaines limites, fut poussée trop loin. On voulut produire toutes choses, même celles qui coûtaient moins en venant de l'étranger, et l'on y réussit, en partie, en interdisant l'usage de celles-ci. Mais le résultat qu'il s'agissait d'atteindre et qui était d'augmenter la somme des choses propres à satisfaire les besoins des populations , fut aussitôt manqué. Au lieu d'accroitre leurs satisfactions, on les diminua; au lieu de les faire avancer dans la civilisation, on les fit reculer dans la barbarie. Hâtons-nous de dire toutefois que l'observation et l'expérience agissent tous les jours pour faire justice de cette erreur, comme elles ont déjà fait justice de tant d'autres. Les nations, plus éclairées, commencent à s'apercevoir qu'elles ont intérêt à obtenir le plus grand nombre possible de satisfactions, en échange de la moindre somme d'efforts, et qu'elles ne sauraient arriver à ce but en se barricadant contre le bon marché. Un jour arrivera donc où elles renverseront les barrières artificielles dont elles se sont entourées pour suppléer aux barrières naturelles que les progrès de la locomotion ont successivement entamées et abattues. Ce jour-là, les éléments de civilisation que Dieu a mis à la disposition du genre humain, ainsi que les capitaux matériels et immatériels que l'homme a accumulés dans le cours des siècles, pourront recevoir le meilleur emploi, la destination la plus féconde, et la division naturelle du travail entre les peuples, aujourd'hui encore artificiellement entravée, se développera dans toute, sa plénitude. A quelle hauteur la civilisation, ainsi universalisée, élèvera son niveau, jusqu'à quel point elle accroîtra la somme des satisfactions morales et matérielles de l'homme, tout en réduisant celle de ses efforts et de ses souffrances, voilà ce que nous ne pouvons savoir et ce qu'il serait superflu de conjecturer. Tout ce que nous pouvons affirmer, en considérant le chemin que la civilisation a parcouru et le point où elle est arrivée, c'est que l'intelligence humaine, approvisionnée d’un capital de connaissances, qui se multiplie avec d'autant plus de facilité qu'il s'accumule davantage ; pourvue de tous les instruments nécessaires pour conserver et propager ses acquisitions; aiguillonnée par des besoins qui n'ont jamais été assouvis et qui semblent inassouvissables, ira sans cesse en avant, d'un pas plus rapide et plus assuré, jusqu'à la limite indéfinie qu'il ne lui est point donné de dépasser.
Cependant, certains esprits doutent encore de l'avenir de la civilisation, et ils présentent à ce sujet diverses objections auxquelles il est bon de répondre. Si les nations civilisées, disent-ils notamment, ont moins à redouter les invasions de la barbarie du dehors, ne sont-elles pas, en revanche, de jour en jour plus exposées à être envahies par les barbares qu'elles contiennent encore dans leur propre sein? En devenant la proie de ces hommes qui n'ont pas cessé de croupir dans la primitive ignorance, ne courent-elles pas risque de reculer vers la barbarie, ou, tout au moins, de demeurer pendant longtemps stationnaires? Sans aucun doute ! La civilisation peut être retardée dans un pays par l'ignorance, ou, ce qui revient au même, par l'intérêt mal entendu d'une classe dominante. Néanmoins, cette cause de retard n'a pas toute la portée qu'on lui attribue. Si c'est une multitude, imbue de théories chimériques, qui s'empare du gouvernement de la société, l’expérience, ou même la simple discussion de ces théories, ne tarde pas à en montrer l'inanité, et comme la multitude est intéressée la première au bon gouvernement de la société, une réaction s'opère dans son sein ; elle se dépouille de ses illusions dangereuses, et la civilisation reprend aussitôt sa marche progressive. Si la société se trouve, au contraire, sous la domination d'une classe attachée au maintien d'anciens abus, le mal causé par ces abus finit, dans un délai plus ou moins long, — selon l'état plus ou moins avancé des communications intellectuelles, — par devenir visible à tous les yeux. La pression de l'opinion en fait alors justice.
Une question grave vient ici se poser incidemment. Convient-il de briser, au besoin, les résistances de la classe attachée aux abus établis, de faire des révolutions pour détruire ces abus, ou vaut-il mieux attendre qu'ils se déracinent d'eux-mêmes, sous la pression des progrès accomplis en dehors de leur influence délétère? Cette question comporté évidemment deux solutions selon les circonstances de temps et de lieu. On peut affirmer, toutefois, qu’à l'époque où nous sommes parvenus, la solution pacifique est généralement devenue la meilleure. Que l'on considère, en effet, sans parti pris, les résultats de certaines expériences encore récentes, les quantités énormes de capitaux qu'elles ont englouties, les forces vives qu'elles ont absorbées, les expériences funestes qu'elles ont engendrées; que l'on tienne compte, en même temps, des facilités que la diffusion du progrès a acquises depuis l'invention de l'imprimerie et [376] l’application do la vapeur à la locomotion, et l'on se convaincra que les révolutions fournissent de nos jours le progrès à un prix trop élevé, et qu'il importe, en conséquence, d'y renoncer dans l'intérêt même de la civilisation.
Une seconde objection non moins fréquemment reproduite est celle-ci : le bien-être matériel ne se développe, assure-t-on, qu'aux dépens de la moralité publique : les hommes se corrompent moralement à mesure que leur condition s'améliore matériellement, et leur civilisation, si brillante à la surface, n'est au fond qu'une pourriture. Rien de plus faux que cette objection. En premier lieu, l'histoire de la civilisation atteste que les branches des connaissances humaines qui concourent à la moralisation de l'espèce ne se développent pas d'un jet moins rapide que celles qui tendent à augmenter son bien-être matériel. La religion, par exemple, n'a cessé, dans le cours des siècles, de se perfectionner, de s'épurer et d'exercer, par la même, une action plus efficace sur le moral de l'homme. Combien, sous ce rapport, le christianisme n'est-il pas supérieur au paganisme ! Et dans le christianisme même ne peut-on pas aisément apercevoir un progrès ? La religion chrétienne n'est-elle pas aujourd'hui un instrument de moralisation plus parfait qu'elle ne l'était au temps des saint Dominique et des Torquemada? Les sciences philosophiques et spécialement l'économie politique n'agissent-elles pas aussi plus efficacement chaque jour pour moraliser les hommes, eu leur démontrant avec une clarté de plus en plus vive que l'observation des lois morales est une condition essentielle de leur existence et de leur bien-être ? En second lieu, le progrès matériel, en lui-même, loin de faire obstacle au développement moral de l'espèce humaine, ne doit-il pas contribuer, au contraire, à le hâter? En rendant le travail de l'homme plus fécond, son existence plus facile, ne doit-il pas diminuer l'intensité et la fréquence des tentations qui le poussent à violer les lois morales pour satisfaire ses appétits matériels? L'expérience confirme d'ailleurs ces inductions, tirées de l'observation de notre nature. Les tailles de la criminalité attestent que les classes pauvres commettent, toute proportion gardée, un plus grand nombre de crimes que les classes riches; elles attestent aussi que la criminalité baisse et que les mœurs s'améliorent à mesure que l'aisance pénètre plus avant dans les couches inférieures de la société. L'objection d'une prétendue démoralisation des peuples occasionnée par le développement du bien-être matériel se trouve donc en désaccord avec l'observation et l'expérience.
Une troisième objection a été faite : on a prétendu que l'inégalité s'accroissait parmi les hommes à la suite des progrès de l'industrie. La tendance du progrès industriel, a-t-on dit, est d'agglomérer, d'un côté, des masses de capitaux, et, d'un autre, des multitudes d'hommes dont la condition devient de jour en jour plus misérable. Les faits historiques donnent encore un démenti à cette assertion. Que l'on compare les inégalités sociales qui subsistent de nos jours à celles qui existaient du, temps de l'empire romain, que l'on place eu regard de l'esclave des latifundia et du chef puissant d'une famille patricienne le plus pauvre ouvrier de nos campagnes et le plus opulent de nos banquiers, et que l'on dise si les extrémités' de l'échelle sociale, loin de s'éloigner davantage, ne se sont pas rapprochées? Le progrès agit dans le sens de l'égalité, ou du moins sa tendance continue est de réduire les inégalités sociales au niveau des inégalités naturelles. Remarquons, en effet, que la liberté et la propriété sont mieux garanties à mesure que la civilisation gagne du terrain et que le progrès réalisé dans ce sens est la condition essentielle de tous les autres. Or, si chacun est de plus en plus obligé de recourir à sa propre industrie pour subsister; si aucune spoliation visible ou cachée ne vient plus attribuer aux uns les fruits du travail des autres; si, pour tout dire, les causes les plus puissantes et les plus actives d'inégalité disparaissent, les différences sociales ne doivent-elles pas inévitablement finir par s'abaisser au niveau des différences que la nature a mises entre les hommes?
Une seule cause pourrait maintenir, aggraver même ces inégalités, en attribuant aux détenteurs des moyens de subsistance et des instruments de travail une prédominance abusive, ce serait l'excès permanent de la population. Heureusement la multiplication de l'espèce humaine né dépend pas seulement de la puissance prolifique de l'homme ; elle dépend aussi de sa prévoyance. L'homme est le maître de régler la production des êtres semblables à lui; il peut l'activer ou la ralentir, selon qu'il prévoit que sa condition et celle des êtres qu'il met au jour s'en trouveront améliorées ou aggravées. Or cette prévoyance, qui apporte une limite utile aux générations, acquiert naturellement plus de force et plus d'empire à mesure que l'homme s'éclaire davantage.
Dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet démontrait déjà que l'excès de la population deviendrait de moins en moins à craindre, grâce au développement naturel de la prévoyance, sous l'influence de la civilisation :
« En supposant, dit-il, que ce terme dût arriver (où la population presserait sur les moyens de subsistance), il n'en résulterait rien d'effrayant, ni pour le bonheur de l'espèce humaine, ni pour sa perfectibilité indéfinie; si on suppose qu'avant ce temps les progrès de la raison aient marché de pair avec ceux des sciences et des arts…, les hommes sauront alors que, s'ils ont des obligations à l'égard des êtres qui ne sont pas encore, elles ne consistent pas à leur donner l'existence mais le bonheur, elles ont pour objet le bien-être général de l'espèce humaine ou de la société dans laquelle ils vivent, de la famille à laquelle ils sont attachés; et non la puérile idée de charger la terre d'êtres inutiles et malheureux. Il pourrait donc y avoir une limite à la masse possible des subsistances, et, par conséquent, à la plus grande population possible, sans qu'il en résultat cette destruction prématurée, si contraire à la nature et à la prospérité sociale d'une partie des êtres qui ont reçu la vie. » [73]
On voit en définitive que les éléments divers de notre, nature et du monde où nous vivons sont disposés de telle façon, que la civilisation apparaît [377] comme un fait inévitable, irrésistible. Elle n'a cependant rien de fatal, en ce sens qu'elle subit continuellement l'influence de notre libre arbitre. S'il n'est au pouvoir de personne de l'arrêter et de la faire rétrograder, chacun peut néanmoins influer sur sa marche, et, peut-être aussi, sur sa portée définitive. Portez atteinte à la liberté et à la propriété d'autrui ; n'utilisez point autant que vous le pourriez les forces productives dont vous disposez; soyez paresseux, ignorant, dissipateur, et vous retarderez la civilisation. Donnez, au contraire, l'exemple des vertus morales, du respect de la liberté et de la propriété, de l'esprit de recherches, de l'ardeur et de l'assiduité au travail, et vous contribuerez, pour votre part, à la faire avancer. Chaque individualité agit sur la civilisation, en bien ou en mal, dans la sphère plus ou moins étendue de son activité. Seulement, chacun étant de plus en plus intéressé à agir de manière à la faire progresser, le nombre des actions qui l'avancent dépasse de jour en jour davantage le nombre de celles qui la retardent. Dans son impulsion générale, la civilisation dépend de l'ensemble des facultés et des besoins qui ont été départis à l'homme, et des ressources naturelles qui ont été mises à sa disposition ; mais elle n'en demeure pas moins soumise, dans les accidents de sa marche , à l'action du libre arbitre humain. Elle est providentielle. Elle n'est point fatale.
Maintenant que nous avons décrit les éléments de la civilisation, que nous avons montré à l'aide de quels instruments matériels et moraux ce grand travail s'opère, comment il peut être accéléré et comment retardé, résumons en quelques mots les caractères économiques auxquels la civilisation se reconnaît et le but où elle tend.
La civilisation apparaît comme le développement de la puissance de l'homme sur la nature. Or il y a un signe extérieur auquel ce développement se reconnaît, c'est la division du travail. Le pays où le travail est le plus divisé dans l'ensemble de ses branches, où par là même les relations sociales sont le plus développées, est donc manifestement celui où la civilisation est le plus avancée.
La civilisation a pour but la meilleure satisfaction de nos besoins matériels et moraux. Elle nous conduit, en améliorant progressivement les conditions de notre existence, vers l'idéal de puissance et de beauté que comportent notre nature et les ressources que le Créateur a mises à notre disposition.
L'idée d'une civilisation indéfiniment progressive est moderne. Dans l'antiquité, le progrès matériel se trouvant enrayé par la servitude, on ne pouvait concevoir d'autre progrès que celui des sciences et des beaux-arts. Encore le spectacle des dangers que couraient les peuples civilisés, la destruction de tant de civilisations locales sous les invasions des barbares, devaient-ils éloigner toute idée d'un progrès général et continu. Cette idée ne pouvait guère naître qu'après l'invention de la poudre à canon et celle de l'imprimerie. Elle fut lente à germer. Vico la prépara en collectionnant, d'une manière systématique, les observations qu'il avait faites sur le développement des nations civilisées; mais Turgot fut le premier qui la produisit, en l'appuyant sur des données positives (dans ses Discours en Sorbonne et dans ses Essais de géographie politique). Condorcet amplifia, avec quelques variantes, les idées de Turgot. En Allemagne, Kant montra la civilisation dans l'expansion de la liberté humaine; Herder en étudia les éléments naturels, un peu vaguement peut-être; l'économiste Storch entreprit d'en faire la théorie. Quoique incomplète et fautive à certains égards, cette théorie mérite cependant d'être étudiée. A une époque plus rapprochée, M. Guizot a tracé un tableau des progrès de la civilisation en Europe et spécialement en France; mais l'insuffisance des notions économiques se laisse apercevoir dans cette œuvre, d'ailleurs l'une des plus remarquables de notre école historique. [74] Enfin la civilisation a eu aussi ses romanciers. Ne tenant compte ni de la nature de l'homme, ni des conditions de son développement, telles que l'observation et l'expérience nous les révèlent, les socialistes ont édifié des civilisations de fantaisie, civilisations fausses ou incomplètes comme les données sur lesquelles elles reposent. L'observation, qui est le premier instrument de la civilisation, est aussi le seul dont on puisse se servir pour la reconnaître et la caractériser.
G. de Molinari.
Endnotes to Civilisation
[72] « ...La force sera probablement à l'avenir du côté de la civilisation et des lumières, car les nations civilisées sont les seules qui puissent avoir assez de produits pour entretenir des forces militaires imposantes; ce qui éloigne pour l'avenir la probabilité de ces grands bouleversements dont l'histoire est pleine, et où les peuples civilisés sont devenus victimes des peuples barbares. » (J.-B. Say, Traité d'économie politique, 1. III, ch. vii.)
[73] Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, page 358.
[74] Voir, pour les origines de l’idée de la civilisation, A. Javary, De l’idée de progrès, 1851.
Colonies↩
Source
"Colonies", DEP, T. 1, pp. 393-403.
[393]
COLONIES. — COLONISATION. — SYSTÈME COLONIAL.
I. Définitions.
« Les colonies, dit J.-B. Say, sont des établissements formés dans des pays lointains par une nation plus ancienne, qu'on nomme métropole. Quand cette nation veut étendre ses relations dans un pays populeux déjà civilisé, et dont elle ne serait pas bien venue à envahir le territoire, elle se borne à y établir un comptoir, un lieu de négoce, où ses facteurs trafiquent conformément aux lois du pays, comme les Européens ont fait en Chine, au Japon. Quand les colonies secouent l'autorité du gouvernement de la métropole, elles cessent de porter le nom de colonies, et deviennent des États indépendants. » [75]
A l'idée d'une émigration partielle d'un peuple dans une région nouvelle, les mots colonies et colonisation ajoutent encore celle d'une sorte de patronage exercé par la métropole sur les établissements [394] fondés à la suite d'une émigration ; ils impliquent aussi une extension du domaine de la civilisation, car on ne donne point le nom de colonies aux établissements que des conquérants barbares ont fondés chez des peuples déjà civilisés. Sous le nom de système colonial on désigne le système d'assujettissement réciproque, politique et commercial, qui a présidé, depuis la découverte de l'Amérique, aux relations des colonies européennes avec leurs métropoles.
II. APERÇU HISTORIQUE
§ I er . — Colonies de l'antiquité.
La plupart des peuples civilisés de l'antiquité, les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, ont fondé un grand nombre de colonies. Athènes était, comme on sait, une colonie égyptienne, et Carthage une colonie de Tyr. Les Grecs répandirent principalement leurs essaims dans l'Asie Mineure, en Sicile, et dans le midi de l'Italie; ils poussèrent aussi jusqu'au littoral de la Gaule, où ils fondèrent Marseille. La plupart des colonies de l'antiquité, à l'exception de celles des Romains, paraissent avoir été dues à l'initiative des particuliers. Lorsque le territoire de l'État ou de la cité devenait trop étroit pour ses habitants, la portion la plus énergique et la plus aventureuse de la population prenait le parti de s'expatrier, et elle allait fonder, dans un pays moins peuplé, un nouvel établissement. Quelquefois encore ce genre d'entreprise s'organisait à la suite d'une lutte entre des factions rivales ; la faction vaincue émigrait pour se dérober à l'oppression. Les métropoles grecques entretenaient de nombreuses relations avec leurs colonies, souvent même elles en reçurent des secours , notamment à l'époque de l'invasion des Perses ; mais ces rapports n'avaient aucun caractère obligatoire. Les émigrants devenaient indépendants en quittant le sol de la métropole, et ils établissaient, dans leur nouvelle patrie, les institutions qui leur convenaient le mieux. Ce système, qui abandonnait les émigrants à leurs propres forces, sans aucun espoir de subventions et de secours, comme aussi sans aucune disposition restrictive qui pût faire obstacle au développement de leur activité, était évidemment le plus favorable à la colonisation. Les émigrants étaient tenus de tirer le meilleur parti possible des capitaux matériels et immatériels qu'ils emportaient avec eux, et, sauf les mauvaises lois qu'ils pouvaient établir eux-mêmes, rien ne les empêchait d'employer ces capitaux de la manière la plus utile, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se trouvaient placés; aussi le plus grand nombre des colonies de la race active et industrieuse des Hellènes, Éphèse, Milet, Syracuse, Agrigente, Marseille et tant d'autres, arrivèrent-elles à un haut degré de prospérité.
La colonisation romaine eut un tout autre caractère. Les Romains ayant étendu, de bonne heure, leur domination autour d'eux, les membres de l'aristocratie, qui profitaient principalement des conquêtes réalisées, ne trouvèrent aucun avantage à s'expatrier comme de simples émigrants. Seuls, les prolétaires que la concurrence des bras esclaves avait expulsés peu à peu des arts industriels, émigraient volontiers ; mais la métropole s'arrangeait de manière à maintenir sous sa dépendance ces émigrants volontaires, et à les utiliser même au profit de sa domination :
« Généralement, dit Adam Smith, qui a répandu sur cette question les lumineux aperçus de son génie, elle leur assignait des terres dans les provinces conquises de l'Italie , où, demeurant sous la domination de la république, ils ne pouvaient jamais former un État indépendant, et où ils ne faisaient tout au plus qu'une espèce de corporation toujours sujette a la correction, à la juridiction et à l'autorité législative de la métropole. En envoyant des colonies de cette nature, non-seulement elle donnait quelque satisfaction au peuple, mais souvent elle mettait encore une sorte de garnison dans une province nouvellement conquise, et la contenait par là dans l'obéissance ; soit que nous envisagions la nature de l'établissement en lui-même, ou les motifs de le faire, une colonie romaine était donc fort différente d'une colonie grecque; aussi les mots qui les désignent dans les deux langues ont-ils des significations bien différentes. Le mot latin (Colonia) signifie simplement une plantation ; le mot grec (Apoikía) signifie, au contraire, une séparation de demeure, il marque qu'on s'en va du pays et qu'on quitte la maison. » [76]
Les colons cessaient de jouir de tous les droits des citoyens romains ; ils étaient exclus des droits de suffrage et d'éligibilité. [77]
Ainsi assujetties à la métropole, composées d'ailleurs de la portion inférieure de la population, les colonies romaines ne pouvaient arriver au degré de prospérité et de puissance où s'étaient élevées les libres colonies de la Grèce.
§ II. Colonies modernes.
Il faut franchir ensuite un long intervalle pour trouver de nouvelles colonies. Ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, les invasions des barbares ne sauraient être considérées comme des entreprises de colonisation.
« La colonisation suppose, dit avec raison M. Rossi, [78] si ce n'est un lien de dépendance, du moins des relations de parenté actives et reconnues avec une mère-patrie; elle suppose des rapports que les nouveaux États n'avaient nullement conservés avec les hordes des forêts de la Germanie. »
Le régime féodal était essentiellement peu favorable aux entreprises de colonisation : les vainqueurs, confinés dans leurs châteaux-forts, s'occupaient d'exploiter leurs vassaux et de vider leurs querelles intestines; les vaincus, réduits à l'état de serfs de la glèbe, ne pouvaient se déplacer. Le grand mouvement religieux des croisades survint à propos pour arracher la civilisation européenne à l'espèce de pétrification à laquelle la condamnait le régime féodal. Les colonies chrétiennes que les Croisés fondèrent en Orient finirent par succomber sous l'effort du mahométisme ; mais l'esprit d'aventures que les croisades avaient réveillé [395] en Europe ne devait plus s'éteindre. Cet Orient mystérieux, d'où venaient les soieries, les métaux précieux, les perles, les parfums, excitait, au plus haut degré, la curiosité et la convoitise des barbares de l'Occident. Les merveilles de l'Inde et du Cathay devinrent le sujet de toutes les conversations et l'appât de tous les esprits aventureux; or, comme l'Inde et le Cathay n'étaient point accessibles du côté de l'Orient, où d'immenses espaces, occupés par des peuples ennemis, les protégeaient contre l'avidité des Européens, on tourna les yeux dans une autre direction : des aventuriers de génie se lancèrent audacieusement dans un océan inconnu pour y chercher la route de l'Inde. Cette route, le Portugais Barthélémy Diaz la signala le premier, en doublant le cap de Bonne-Espérance. Le Génois Christophe Colomb eut meilleure fortune encore : en cherchant la route de l'Inde, il découvrit l'Amérique.
Le résultat de ces découvertes fut de mettre à la disposition des Européens d'immenses territoires occupés par des peuples encore à demi-barbares, et complètement incapables d'opposer aux envahisseurs une résistance sérieuse. On sait avec quelle facilité les Portugais établirent leur empire dans l'Inde, avec quelle facilité aussi quelques centaines d'aventuriers espagnols détruisirent les empires du Mexique et du Pérou. Le plus souvent, ces vastes conquêtes furent accomplies par de simples particuliers, que la métropole ne subventionnait point, dont elle contrariait même les entreprises , mais dont elle ne manquait jamais de s'attribuer ensuite les acquisitions.
L'exploitation des nouvelles colonies devait naturellement être dirigée en vertu des principes politiques, économiques et religieux qui prévalaient alors en Europe. La même politique jalouse et haineuse qui présidait aux rapports des différentes nations de l'Europe, devait être appliquée aux colonies et gouverner leurs relations avec les métropoles. Produit des idées, des préjugés et des passions du temps, le système colonial devait être aussi plus ou moins intelligent, plus ou moins libéral, selon que les métropoles se trouvaient plus ou moins éclairées.
L'Espagne et le Portugal jetèrent les premières bases du système colonial. Les nations qui se lancèrent ensuite dans la carrière de la colonisation ne firent que les imiter. Or rien n'était plus restrictif que le système politique et économique qui se trouvait en vigueur dans ces deux métropoles. Ce système, elles l'appliquèrent rigoureusement à leurs établissements d'outre-mer. Les colonies furent considérées, à l'origine, comme des établissements que la mère-patrie pouvait exploiter à sa guise et à son seul profit; en conséquence, toutes relations leur furent interdites avec les étrangers, et des règlements furent établis pour rendre leur exploitation exclusive aussi profitable que possible à la métropole, ou, pour parler plus vrai, à la classe qui dominait dans la métropole.
Différentes méthodes d'exploitation furent tour à tour adoptées. Les Espagnols n'instituèrent pas de compagnies privilégiées, mais ils accordèrent le privilège du commerce de l'Inde aux marchands d'un seul port.
« Ce système, dit Adam Smith, ouvrait le commerce des colonies à tous les naturels de la mère-patrie, pourvu qu'ils le fissent du port, à la saison et dans des vaisseaux convenables. Mais comme tous les différents négociants qui réunissent leurs fonds pour équiper ces vaisseaux autorisés trouvent leur compte à agir de concert, leur commerce se fait à peu près sur le même plan ou les mêmes principes que ceux d'une compagnie privilégiée. Leur profit n'est ni moins exorbitant ni moins oppressif. Les colonies sont mal fournies et forcées d'acheter à très haut et de vendre à très bas prix. Ce système a néanmoins été constamment celui de l'Espagne. Aussi dit-on que toutes les marchandises européennes se vendent à un prix énorme dans leurs possessions d'Amérique. A Quito, une livre de fer coûte, au rapport d'Ulloa, environ 4 shellings 6 pence, et une livre d'acier en coûte 6 et 9 pence. Or c'est principalement pour acheter des marchandises d'Europe que les colonies se dessaisissent de leurs productions ; plus elles payent donc pour les unes, moins elles reçoivent pour les autres, par la raison que dans tout échange la cherté d'une chose fait le bon marché de l'autre. » [79]
Tous les ans, deux escadres de galions fortes d'environ douze voiles étaient expédiées de Séville pour Porto-Bello, et une autre flotte de quinze gros vaisseaux était dirigée sur la Véra-Crux. Ces flottes marchandes étaient ordinairement convoyées par des navires de guerre ; ce qui explique l'obligation imposée aux armateurs de faire ensemble leurs expéditions; mais cette obligation rendait leurs coalitions à peu près inévitables, et le commerce des colonies espagnoles se trouvait livré, en fait, à un seul corps de marchands coalisés. Il en était à peu près de même en Portugal, où le port de Lisbonne obtint le privilège exclusif du commerce des colonies.
Une multitude d'autres restrictions venaient s'ajouter à celle-là, pour assurer à la métropole l'exploitation exclusive de ses colonies. C'était, par exemple, un crime capital dans les colonies espagnoles d'entretenir des relations avec les étrangers. Les navires espagnols pouvaient seuls aborder dans les ports des établissements coloniaux : on en repoussait même les navires étrangers que des avaries forçaient à y relâcher. Les habitants des différentes colonies ne pouvaient échanger leurs produits si ce n'est en se soumettant à des formalités onéreuses et vexatoires. Ils ne pouvaient, non plus, produire certaines denrées que la métropole se réservait de leur fournir; tels étaient le vin, l'huile, le chanvre et le lin. La métropole s'attribuait encore le monopole du sel, du tabac, de la poudre de guerre et de plusieurs autres articles moins importants. Des droits élevés étaient perçus sur les importations et sur les exportations des colonies. L'extraction des métaux précieux, industrie vers laquelle les préjugés du temps poussèrent d'abord exclusivement les colons, était soumise à un impôt d'un cinquième au profit de la couronne. D'autres dispositions réglementaires et fiscales venaient encore décourager les extracteurs. Comme on était persuadé que les métaux précieux constituaient seuls la richesse, [396] on en défendit l'exportation sous les peines les plus rigoureuses. A la vérité, cette défense pouvait être aisément enfreinte. Mais elle n'en devait pas moins avoir pour résultat de restreindre jusqu'à un certain point le marché des producteurs de métaux précieux, et, de plus, l'or et l'argent étant des denrées presque indestructibles, de rendre ce marché de moins en moins avantageux. Les privilèges politiques et religieux s'ajoutaient aux restrictions économiques, pour ralentir la prospérité des établissements coloniaux. Les emplois du gouvernement dans les colonies étaient réservés aux natifs d'Espagne. La religion catholique était établie à l'exclusion de toutes les autres; l'inquisition et les dîmes florissaient avec elle. Enfin, la destruction barbare des naturels ayant amené la rareté des bras dans les colonies, des esclaves noirs y furent importés, et avec l'esclavage apparut une nouvelle cause de démoralisation et de retard.
En examinant ce système, on s'explique la lenteur du développement des colonies espagnoles, après la première période de spoliation des indigènes. Cependant l'Espagne posséda sous Philippe II, époque à laquelle le Portugal et ses colonies furent réunis à la monarchie espagnole, un immense empire colonial. Les autres nations n'osaient point s'aventurer dans le nouveau monde, dont l'Espagne revendiquait, en grande partie, la propriété, en se fondant sur une bulle du pape. L'insurrection des Provinces-Unies et la destruction de l'invincible Armada changèrent cet état de choses et rendirent les pays d'outre-mer accessibles à tous les peuples de l'Europe. Les Hollandais, les Anglais et les Français allèrent faire concurrence aux Espagnols et aux Portugais en Amérique et aux Indes. Mais, comme si les nouvelles régions qui leur étaient ouvertes n'avaient pas offert une carrière suffisante à leur activité, ils s'en disputèrent avec acharnement la possession. Depuis le seizième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième, époque à laquelle les colonies commencèrent à se dérober à ceux qui se les disputaient, en se proclamant elles-mêmes indépendantes, les colonies et le commerce de l'Inde et du nouveau monde occasionnèrent des guerres sanglantes. Des torrents de sang furent répandus, d'immenses capitaux furent anéantis dans ces conflits désastreux, et l'on put se demander, en considérant la rage aveugle avec laquelle les peuples de l'Europe se disputaient des contrées encore presque désertes, si les grands navigateurs du seizième siècle ne leur avaient pas fait un présent funeste.
Le régime des compagnies privilégiés prévalut d'abord en Hollande, en Angleterre et en France. Mais, sauf la compagnie des Indes hollandaises et plus tard celle des Indes orientales anglaises, ces compagnies firent de mauvaises affaires, tout en empêchant les colonies d'en faire de bonnes. (Voyez Compagnies privilégiées.)
Parmi les peuples colonisateurs des temps modernes, le peuple anglais est celui qui a étendu le plus loin son empire et qui a le mieux réussi dans les travaux de la colonisation. Ce succès tient au régime comparativement libéral que l'Angleterre introduisit ou laissa s'introduire dans ses colonies. A l'exemple de la plupart des autres nations, elle commença par adopter le système des compagnies privilégiées; mais ces compagnies ayant échoué, du moins en Amérique, elle livra les colonies à la libre concurrence de ses négociants et de ses armateurs. En même temps, elle conféra aux colons ou elle leur laissa s'attribuer les privilèges les plus essentiels du self-govemment. Plus indépendants, plus libres que les colons espagnols, les colons anglais, particulièrement ceux de la Nouvelle-Angleterre, devaient prospérer plus rapidement, par la vertu même de leurs institutions.
Les premières chartes accordées aux colons anglais témoignent aussi d'un certain libéralisme économique. Ainsi les colons de Jamestown, en Virginie, obtinrent d'abord d'être exemptés pendant sept années de tout droit d'importation pour les choses qui leur seraient nécessaires. Il leur fut permis, en outre, de commercer directement avec les étrangers. Ils ne manquèrent pas d'user de cette permission : en 1620, dit l'historien Robertson, ils avaient des entrepôts de tabac dans plusieurs villes du continent européen , notamment à Middelbourg. [80] Les colons conservaient tous les droits des citoyens anglais, et, à ce titre, ils jouissaient de la protection de la métropole. En échange de ces faveurs, la métropole se contentait de réclamer, à l'imitation de l'Espagne, un droit d'un cinquième sur les mines d'or et d'argent qui pourraient être découvertes et exploitées dans la colonie. Malheureusement, l'esprit de monopole et de guerre, qui prévalait alors en Europe, ne permit point à ce régime libéral de se maintenir longtemps. Un acte de 1650, précurseur du fameux acte de navigation, réserva le commerce des colonies aux navires portant le pavillon national. En 1660, l'acte de navigation alla plus loin. Le commerce avec l'étranger fut, en partie, interdit aux colonies. On fit deux catégories de marchandises : les marchandises énumérées ne purent être expédiées que dans la Grande-Bretagne (l'Irlande était exclue du commerce avec les colonies) ; les marchandises non énumérées purent être exportées directement à l'étranger, mais seulement par l'entremise des navires de la métropole ou de la colonie. (Voyez Acte de navigation.) Adam Smith a parfaitement mis en lumière le but que l'on se proposait, en établissant ainsi deux catégories de marchandises, les unes devant être expédiées dans la Grande-Bretagne, soit pour la consommation, soit pour la réexportation ; les autres pouvant être exportées directement à l'étranger :
« Les marchandises énumérées sont de deux sortes, premièrement celles qui sont particulières à l'Amérique et qui ne peuvent être ou du moins ne sont pas produites dans la mère-patrie. Tels sont la mélasse, le café, les noix de cacao , le tabac, le piment, le gingembre, les nageoires de baleines, la soie écrue, le coton, le castor et autres pelleteries d'Amérique, l'indigo , les bois de senteur et autres bois de teinture : secondement celles qui n'étant pas des productions particulières de l'Amérique sont et peuvent être produites chez la mère-patrie, mais en petite quantité [397] relativement à ce qu'elle en tire des pays étrangers. Tels sont les munitions navales, les mâts, les vergues, les antennes, le goudron, la poix et la térébenthine, le fer en saumon et en barre, le minerai de cuivre, les peaux, les cuirs et la potasse. L'importation des marchandises de la première espèce ne pouvait décourager la production ni nuire au débit d'aucune partie du produit de la mère-patrie. En la bornant à la Grande-Bretagne, on se disait que nos marchands pourraient non-seulement avoir ces choses à meilleur marché dans les colonies, et en tirer par conséquent, chez nous, un meilleur profit, mais qu'il s'établirait entre les colonies et les pays étrangers un commerce avantageux de transport dont la Grande-Bretagne serait nécessairement le centre ou l'entrepôt , puisque l'importation se ferait d'abord chez elle. On supposait aussi que l'importation des marchandises de la seconde espèce pourrait s'établir de manière à nuire seulement à la vente des marchandises similaires qui venaient de l'étranger, et non à celle des produits de la mère-patrie, et dans ce but l'on y mettait des droits tels qu'elles fussent en même temps un peu plus chères que les nôtres et à meilleur marché que celles des autres. Le but de cette disposition était de décourager non pas la production de laGrande-Bretagne, mais celle de quelques pays étrangers avec lesquels on croyait que la balance du commerce était défavorable. » [81]
Les marchandises non énumérées étaient celles dont les producteurs anglais pouvaient redouter la concurrence. A l'origine, ces marchandises pouvaient être expédiées en tout pays ; mais l'exportation en fut restreinte, plus tard, aux régions situées au midi du cap Finistère. On motiva cette nouvelle restriction sur ce que les pays situés au nord du cap Finistère étant manufacturiers, les vaisseaux des colonies en rapportaient des choses qui faisaient concurrence aux produits de la métropole.
A l'exemple de l'Espagne, l'Angleterre prohiba dans ses colonies l'exercice d'un certain nombre d'industries. La fabrication de l'acier ainsi que le laminage du fer furent prohibés. On défendit aussi, dans les colonies de l'Amérique du nord, de transporter d'une province à une autre des étoffes de laine et des chapeaux provenant de l'industrie indigène; enfin, on établit des droits prohibitifs à l'importation en Angleterre du sucre raffiné. En revanche, on accorda des primes à l'importation de certains produits coloniaux dont la métropole se croyait intéressée à accroitre artificiellement la production. Tels furent la soie écrue, le lin, le chanvre, l'indigo, les munitions navales et le bois de charpente.
En ce qui concerne les importations, les colonies anglaises furent traitées d'une manière plus libérale que celles des autres pays. Les mêmes remboursements de droits qui étaient accordés à la réexportation des marchandises étrangères par l'entremise des armateurs de la Grande-Bretagne, furent bonifiés à l'expédition de ces marchandises dans les colonies. Il en résulta que certaines denrées de provenance européenne se vendirent dans les colonies anglaises à plus bas prix que dans la métropole. Les manufacturiers nationaux s'en plaignirent, et ils parvinrent a faire révoquer, en partie, cette disposition libérale. [82]
Sous ce régime, qui était libéral en comparaison de celui des colonies espagnoles, les établissements anglais de l'Amérique du nord se développèrent rapidement; mais à mesure que les colons voyaient grandir leur richesse et leur puissance, ils sentaient croître en eux le goût et le besoin de l'indépendance. Une tentative faite par la métropole pour les taxer sans leur consentement devint le signal de leur émancipation. Le système colonial reçut alors un coup mortel. Jusqu'à l'époque de la proclamation de l'indépendance des États-Unis, on était demeuré convaincu, en effet, que les métropoles européennes avaient le plus grand intérêt à maintenir ce système; on était persuadé que l'émancipation des colonies mettrait fin au commerce que l'on faisait avec elles. Or ce fut précisément le contraire qui arriva. Loin de diminuer, comme on s'y attendait, le commerce de la métropole avec les colonies émancipées ne fit que s'accroître, [83] et, de nos jours, les États-Unis sont devenus le principal marché de la Grande-Bretagne. Cependant, il y eut une industrie qui se trouva sensiblement atteinte par la séparation des États de l'Amérique du nord, nous voulons parler de celle des gouverneurs et des autres fonctionnaires civils ou militaires que l'aristocratie britannique fournissait aux colonies. Sous l'influence alors prépondérante de ces industriels, l'Angleterre se mit à conquérir de nouveaux territoires pour réparer la perte de ses colonies émancipées, et elle ne manqua point d'appliquer à ses conquêtes les vieux errements du système colonial. Ce n'est qu'à la fin de la [398] guerre continentale qu'une réaction libérale commença à s'opérer contre ce système. En 1822 et en 1825, lord Goderich et M. Huskisson présentèrent diverses modifications à la législation existante ; mais ces modifications, qui rencontraient encore des résistances presque invincibles dans les intérêts des privilégiés et dans les préjugés du pays, n'eurent qu'une faible importance. Il fallut de nouveaux événements politiques et économiques , tels que l'adoption du bill de réforme, l'abolition de l'esclavage dans les colonies et la campagne organisée en faveur du free-trade pour amener la chute du vieux système colonial de l'Angleterre.
On ne pouvait se dissimuler que ce système était fort coûteux. Il avait fallu, d'abord, dépenser des sommes énormes pour conquérir les colonies, pour les conserver et même pour les perdre. La seule guerre de l'indépendance des Etats-Unis avait coûté 2 milliards à la Grande-Bretagne. Il fallait, ensuite, couvrir, chaque année, une partie de la dépense des colonies, car aucune ne subvenait entièrement à ses frais de gouvernement. La métropole avait à débourser annuellement de ce chef une somme de 2 millions sterling, sans parler des frais d'entretien d'un effectif militaire et naval que l'extension continue de ses possessions coloniales l'obligeait d'augmenter incessamment. Ce n'est pas tout. En 1833, la métropole, mue par le plus généreux sentiment d'humanité, s'imposa un sacrifice de 20 millions sterl. pour émanciper les esclaves de ses colonies. Les contribuables anglais eurent à payer l'intérêt de cette somme, en sus de celui des sommes dépensées dans les guerres coloniales et des frais d'administration des colonies. Enfin, les habitants de la métropole, consommateurs de sucre, de café, de bois de charpente et des autres produits protégés des colonies, avaient à payer les frais de cette protection, et ce n'était pas la moindre de leurs charges. La protection dévolue au sucre colonial seule leur coûtait plus de 80 millions par an. [84]
En compensation de ces charges que le système colonial imposait aux habitants de la métropole, considérés comme contribuables et comme consommateurs, quels avantages leur procurait-il? L'aristocratie seule, qui trouvait dans les colonies un débouché assuré pour son industrie gouvernementale, en tirait un bénéfice net; en revanche, les autres classes de la population n'en souffraient-elles pas plus qu'elles n'en profitaient? Elles expédiaient, à la vérité, pour environ 14 millions de liv. sterl. de marchandises aux colonies; [85] mais n'était-il pas évident que ce débouché leur demeurerait, qu'il s'agrandirait même si le système colonial venait à disparaître? II ne s'agissait plus que de convaincre ces classes, maintenant mieux représentées dans le parlement, qu'elles étaient dupes du système colonial. Les ligueurs se chargèrent de cette besogne, et, bientôt, les deux pièces principales du système, les privilèges accordés aux produits coloniaux sur les marchés de la métropole et l'acte de navigation tombèrent sous leurs coups. Ce vieux régime de spoliation réciproque se trouve maintenant à peu près aboli. Dans la séance de la chambre des Communes du 8 février 1850, lord John Russell exposait ainsi les nouveaux principes qui allaient diriger désormais la conduite de la Grande-Bretagne à l'égard de ses colonies.
« En ce qui concerne notre politique commerciale, dit-il, le système entier du monopole n'est plus. La seule précaution que nous ayons désormais à prendre, c'est que nos colonies n'accordent aucun privilège à une nation au détriment d'une autre, et qu'elles n'imposent pas des droits assez élevés sur nos produits pour équivaloir à une prohibition. Je crois que nous sommes fondés à leur faire cette demande en retour de la sécurité que nous leur procurons ... Nous sommes décidés, ajoute lord John Russell, à ne pas revenir sur cette résolution que désormais votre commerce avec les colonies est fondé sur ce principe : vous êtes libres de recevoir les produits de tous les pays qui peuvent vous les fournir à meilleur marché et de meilleure qualité que les colonies, et d'un autre côté les colonies sont libres de commercer avec toutes les parties du globe, de la manière qu'elles jugeront la plus avantageuse à leurs intérêts. C'est là qu'est pour l'avenir le point cardinal de notre politique.
« En ce qui concerne nos relations politiques avec les colonies, vous agirez sur ce principe d'introduire et de maintenir, autant que possible, la liberté politique dans toutes vos colonies. Je crois que toutes les fois que vous affirmerez que la liberté politique ne peut pas être introduite, c'est à vous de donner des raisons pour l'exception ; et il vous incombe de démontrer qu'il s'agit d'une race qui ne peut encore admettre les institutions libres; que la colonie n'est pas composée de citoyens anglais, ou qu'ils n'y sont qu'en trop faible proportion pour pouvoir soutenir de telles institutions avec quelque sécurité. A moins que vous ne fassiez cette preuve, et chaque fois qu'il s'agira d'une population britannique capable de se gouverner elle-même, si vous continuez à être leurs représentants en ce qui concerne la [399] politique extérieure, vous n'avez plus à Intervenir dans leurs affaires domestiques au-delà de ce qui est clairement et décidément indispensable pour prévenir un conflit dans la colonie elle-même.
« Je crois que ce sont là les deux principes sur lesquels vous devez agir. Je puis au moins déclarer que ce sont ceux que le gouvernement actuel a adoptés. Non-seulement je crois que ces principes sont ceux qui doivent vous diriger, sans aucun danger pour le présent, mais je pense encore qu'ils serviront a résoudre dans l'avenir de graves questions, sans nous exposer à une collision aussi malheureuse que celle qui marqua la fin du dernier siècle. En revenant sur l'origine de cette guerre fatale avec les contrées qui sont devenues les États-Unis de l'Amérique, je ne puis m'empêcher de croire qu'elle fut le résultat, non d'une simple erreur, d'une simple faute, mais d'une série répétée de fautes et d'erreurs, d'une politique malheureuse de concessions tardives et d'exigences inopportunes. J'ai la confiance que nous n'aurons plus à déplorer de tels conflits. Sans doute, je prévois, avec tous les bons esprits, que quelques-unes de nos colonies grandiront tellement en population et en richesse, qu'elles viendront vous dire un jour : « Nous avons assez de force pour être indépendantes de l'Angleterre. Le lien qui nous attache à elle nous est devenu onéreux et le moment est arrivé où, en toute amitié et en bonne alliance avec la mère-patrie, nous voulons maintenir notre indépendance.» Je ne crois pas que ce temps soit très rapproché, mais faisons tout ce qui est en nous pour les rendre aptes à se gouverner elles-mêmes. Donnons-leur autant que possible la faculté de diriger leurs propres affaires. Qu'elles croissent en nombre et en bien-être, et, quelque chose qui arrive, nous, citoyens de ce grand empire, nous aurons la consolation de dire que nous avons contribué au bonheur du monde. » [86]
Telle est la nouvelle politique coloniale de l'Angleterre. Il n'est pas douteux que cette politique ne conduise rapidement à l'émancipation des colonies. Lorsque les illusions du système colonial auront disparu avec les derniers débris de ce système, il y a peu d'apparence que les contribuables anglais consentent encore à se charger d'une partie des frais de gouvernement des colonies. Mais si les colons se trouvent obligés désormais de subvenir à toutes leurs dépenses, ne tiendront-ils pas à régler eux-mêmes l'emploi de leur argent ? ne demanderont-ils point la rupture d'une association dans laquelle ils n'auront plus aucun bénéfice à recueillir, et la métropole pourra-t-elle refuser d'accueillir leur juste demande ?
Le système colonial de l'Angleterre tire donc à sa fin. Malheureusement, les autres peuples sont demeurés, sous ce rapport, beaucoup plus arriérés. L'Espagne, la Hollande et la France ont continué de suivre en grande partie, les errements du vieux système d'exploitation exclusive des colonies. A l'exemple des établissements anglais de l'Amérique du nord, les colonies espagnoles, lasses d'un joug trop pesant, se sont émancipées. De ses vastes possessions d'outre-mer, l'Espagne n'a conservé que les îles Philippines, Porto-Rico et Cuba. L'abolition de l'esclavage dans les Antilles anglaises a valu à cette dernière colonie un accroissement considérable de prospérité. (Voyez Esclavage.) Le gouvernement espagnol a secondé son développement en accordant aux colons la permission de commercer librement avec les étrangers. En revanche, il s'est attribué une part usuraire dans le revenu croissant do la colonie, et il a provoqué ainsi le mécontentement des colons. Ceux-ci se sont tournés du côté des États-Unis, ou ils ont trouvé un parti nombreux disposé a seconder leur émancipation, et, malgré l'insuccès des tentatives du général Lopez, on peut prévoir que Cuba ne demeurera plus longtemps sous la domination espagnole. La Hollande continue à exploit ter l'île de Java au moyen d'une compagnie dont les intérêts sont étroitement unis à ceux du gouvernement. Après s'être imposé des sacrifices considérables pour s'assurer la possession de l’île, les Hollandais retirent maintenant des bénéfices assez importants du système d'exploitation exclusive auquel ils l'ont soumise. Mais l'expérience atteste que des bénéfices de ce genre, basés sur l'asservissement et l'exploitation inique des indigènes, ne sauraient être durables.
Enfin, la France a maintenu a peu près intact son vieux système colonial; mais, de ses vastes possessions en Amérique et dans l'océan Indien, il ne lui est resté que quelques petits établissements dont la population ne dépasse pas 600,000 individus, à quoi il faut ajouter son récent et coûteux établissement de l'Algérie.
III. CRITIQUE DU SYSTÈME COLONIAL. AVANTAGES DE LA COLONISATION LIBRE.
La colonisation a une utilité qu'on ne saurait contester, et que tous les économistes ont reconnue. Il est utile que des nations qui se trouvent à l'étroit dans les limites de leurs territoires s'épandent au dehors; il est utile aussi qu'elles aillent occuper et cultiver des terres fertiles que des races encore barbares laissent en friche. Guillaume Penn et ses compagnons, en fondant un Etat nouveau, dans une contrée où l'on ne rencontrait auparavant que quelques tribus nomades de Peaux-Rouges, ont visiblement contribué aux progrès de la richesse et de la civilisation. Ils y auraient contribué aussi, sans doute, en demeurant en Europe, mais dans une proportion moindre, car l'exercice de leur activité se trouvait entravé, dans la métropole, par une foule de préjugés et de règlements abusifs qui se modifiaient ou cessaient même de se faire sentir au-delà de l'Océan. D'un autre côté, la terre nouvelle où ils s'établissaient leur offrait des ressources naturelles bien supérieures à celles dont ils pouvaient disposer en Europe. Ils s'y trouvaient donc placés dans des conditions économiques plus favorables.
Cependant toutes les entreprises de colonisation n'ont pas également servi le développement de la richesse et de la civilisation. Il est arrivé fréquemment que des émigrants ne se rendant pas bien compte des difficultés de l'entreprise dans laquelle ils s'engageaient, des frais de transport et d'établissement dans la nouvelle colonie, de l'insalubrité du climat, de la barbarie des indigènes, etc., etc., ont aggravé leur situation au lieu de l'améliorer. Il est arrivé fréquemment que [400] des fonds productifs ont été retirés des industries de la métropole pour être engagés avec moins de profit dans des entreprises de colonisation. Comme toutes les autres entreprises, celles-ci sont tantôt ruineuses et tantôt profitables ; on peut y échouer comme on peut y réussir. On y échoue lorsqu'on s'aventure, sans ressources suffisantes, dans une contrée où l'on rencontre des difficultés et des dangers que l'on n'avait point su prévoir; on y échoue encore lorsqu'on n'est point naturellement propre à supporter les énormes fatigues et les rudes privations que nécessitent les premiers travaux de la colonisation. On y réussit lorsqu'on a bien su choisir son établissement et que l'on est pourvu d'assez de capitaux, de forces, de santé et d'énergie pour dompter une nature vierge.
Si l'on se rend bien compte de la nature de ces entreprises, des difficultés et des risques dont elles sont environnées, on se convaincra que les gouvernements ne sauraient s'en charger utilement. Les mêmes arguments dont on se sert contre leur intervention dans l'industrie des métropoles peuvent s'appliquer aussi à leur immixtion dans les entreprises de colonisation : le meilleur système à suivre en cette matière, ou, pour mieux dire, le seul bon, c'est de laisser les émigrants aller où bon leur semble, s'établir, se gouverner et se défendre à leur guise et surtout à leurs frais. Leur liberté et leur responsabilité demeurant ainsi entières , ils se rendent, de préférence, dans les endroits où la colonisation présente le plus d'avantages et le moins d'obstacles ; ils emploient aussi les procédés d'exploitation et de gouvernement qui leur semblent les plus efficaces et les moins coûteux. Toute protection extérieure, en les exonérant, en partie, de la responsabilité des fautes qu'ils peuvent commettre, encourage la mauvaise distribution et le mauvais emploi de leurs fonds productifs ; de même, toute restriction qui les empêche de tirer le meilleur parti possible de leur capital et de leur travail apparaît comme un obstacle au développement de leur prospérité.
En examinant, à ce point de vue, le système colonial, on pourra se faire une idée de l'étendue des dommages qu'il a causés. Ce système avait pour objet d'assurer à chaque métropole un marché colonial qu'elle pût exploiter seule : on ne regardait pas au prix que coûtaient la conquête, l'entretien et la défense de ce marché ; jamais on ne croyait le payer trop cher ; mais, lorsqu'on le possédait, on le réglementait à outrance. On défendait aux étrangers de s'y établir et d'y porter leurs produits; on obligeait les colons à envoyer les leurs dans la métropole, d'où l'on excluait, du reste, les similaires de l'étranger ; on prohibait, dans les colonies, certaines cultures et certaines industries qui pouvaient faire concurrence à celles de la métropole, etc., etc. Essayons d'apprécier l'influence que ces différentes pièces du système pouvaient exercer sur le développement de la richesse.
I. En empêchant les étrangers de s'établir dans une colonie, on diminuait la somme des forces productives qui pouvaient contribuer à la mettre en valeur; on entravait le développement de la production coloniale, en la donnant comme un monopole, à des hommes qui ne possédaient pas toujours les facultés et les lumières nécessaires pour la féconder. S'il avait été permis à des émigrants anglais, par exemple, de s'établir dans les colonies espagnoles, n'est-il pas évident que la richesse de ces colonies en aurait été accrue?
II. En défendant aux colons d'exercer certaines industries , comme aussi d'expédier leurs productions où bon leur semblait et de la manière qui leur paraissait la plus économique, on empêchait leur richesse de croître autant qu'elle aurait pu le faire. Dans le premier cas, on stérilisait entre leurs mains des fonds productifs qu'ils auraient pu exploiter avec profit; dans le second cas, on restreignait le profit qu'ils auraient pu tirer de ceux dont on leur permettait de disposer.
III. On ralentissait encore le développement de la richesse des colonies, en obligeant les colons à acheter les denrées de la métropole de préférence à celles des autres pays. Cette obligation les soumettait à un impôt égal à la différence des prix des denrées de la métropole, et des similaires de l'étranger; à la vérité, l'exclusion des denrées étrangères favorisait les producteurs nationaux qui exploitaient seuls le marché de la colonie; mais le résultat définitif n'en était pas moins une diminution de la production générale, puisque des marchandises chères étaient substituées à des marchandises à bon marché. Toute disposition qui favorisait les producteurs de la métropole au détriment de leurs concurrents provoquait en Europe une distribution moins avantageuse des fonds productifs, partant une diminution de la richesse. (Voyez Système Protecteur.)
IV. En obligeant les habitants de la métropole à consommer certains produits de leurs colonies, de préférence aux similaires des colonies étrangères, on les soumettait, à leur tour, à un impôt équivalent à la différence des prix des denrées de ces deux provenances. Cette obligation suscitait une plus mauvaise distribution des fonds productifs, et elle occasionnait, comme dans le cas précédent, une diminution correspondante de la richesse.
V. En se chargeant d'établir à leurs frais des colonies et de pourvoir à leur sûreté, les gouvernements de l'Europe accordaient de véritables subventions aux entreprises de colonisation. Quel était le résultat de ces subventions? c'était de donner aux capitaux de la métropole une direction artificielle, direction plus mauvaise, moins fructueuse que celle qu'ils auraient prise d’eux-mêmes. En effet, les entreprises subventionnées n'auraient pas attiré les capitaux si elles avaient été abandonnées à elles-mêmes, ou du moins elles ne les auraient attirés que juste au moment où, tous frais compris, elles seraient devenues réellement plus profitables.
En subventionnant la colonisation, que faisaient donc les gouvernements de l'Europe? ils dépouillaient certaines branches de travail pour en favoriser d'autres qui étaient, en réalité, moins productives, dans les conditions où ils les plaçaient; ils provoquaient une distribution moins profitable des fonds productifs, partant une diminution de la richesse. Supposons maintenant qu'au lieu de subventionner [401] la colonisation et de la réglementer, les nations européennes l'eussent abandonnée à elle-même ; qu'elles n'eussent rien fait ni pour la favoriser ni pour l'entraver, que serait-il résulté de là? il en serait résulté, en premier lieu, que les émigrations d'hommes et de capitaux se seraient effectuées partout en temps utile, c'est-à-dire juste au moment où la colonisation devenait réellement plus profitable que les autres emplois des fonds productifs ; il en serait résulté, en second lieu, que les colonies se seraient établies partout dans les conditions les plus économiques (puisque les colons auraient été obligés de supporter seuls tous leurs frais d'établissement et de gouvernement), et que les nations européennes auraient pu, en conséquence, se procurer les denrées coloniales aux prix les plus bas, tandis que les colons auraient obtenu, à de pareilles conditions , les denrées d'Europe : les capitaux et les bras auraient reçu , de la sorte, dans l'ancien monde et dans le nouveau, l'emploi le plus avantageux, et l'on peut affirmer que si le résultat eût été meilleur pour l'ensemble des nations, il n'eût pas été plus mauvais pour chaque nation en particulier.
Si l'on veut être pleinement édifié sur les résultats de la colonisation subventionnée et réglementée, comparés à ceux de la colonisation libre, que l'on jette les yeux sur l'Algérie et sur la Californie, deux pays où l'expérience de ces deux systèmes opposés est en train de s'accomplir. Le gouvernement français a eu, comme on sait, la malheureuse idée de conquérir et de coloniser l’Algérie. Au moment où nous écrivons, il y a dépensé déjà plus de 1,500 millions; cependant cette grosse subvention n'a pas eu la vertu d'attirer les capitaux et les bras en Algérie. Après vingt années, les importations de l'Algérie en France ne dépassent pas 5 millions, et si la France expédie pour une somme plus considérable de ses produits dans sa colonie , c'est pour y entretenir ses soldats et ses employés, quelquefois même aussi ses colons (voyez Colonies agricoles). Pourquoi le subside énorme accordé à la colonisation algérienne n'a-t-il pas donné de meilleurs fruits? parce que ce subside a été absorbé, d'un côté, par les difficultés exceptionnelles que rencontre l'établissement de la sécurité en Algérie, et neutralisé de l'autre par le mauvais régime que le gouvernement français a imposé aux colons. Les émigrants d'Europe préfèrent porter leurs capitaux et leurs bras dans des pays tels que les Etats-Unis par exemple, où la sécurité dont ils sont obligés de payer tous les frais leur est plus profitable que celle dont on les gratifie au-dessous du prix de revient en Algérie.
Si la colonisation de l'Algérie se développe avec une lenteur désespérante, en revanche celle de la Californie marche avec une rapidité presque fabuleuse; cependant aucune subvention n'a attiré les émigrants sur cette côte écartée de l'océan Pacifique ; ils y ont été conduits uniquement par l'appât de bénéfices supérieurs à ceux des autres placements de fonds. Lorsqu'ils sont arrivés en Californie, on ne les a ni protégés ni entravés ; ils ont utilisé leurs capitaux et leurs bras comme bon leur semblait, et ils ont organisé à leurs frais le gouvernement qui leur convenait le mieux , le résultat a été un développement prodigieux de cette libre colonie, où la France même envoie des émigrants, quoique l'Algérie soit, pour ainsi dire, à sa porte.
Ce contraste finira certainement par devenir visible à tous les yeux, et le vieux système colonial en recevra une mortelle atteinte; alors la colonisation, en cessant d'être une industrie subventionnée et réglementée, pourra donner tous les bons résultats qui sont en elle; elle pourra accroître utilement la surface où se déploie la civilisation, et procurer aux peuples civilisés des débouchés qui ne seront plus achetés à un trop haut prix.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Considérations upon the East India trade. — (Considérations sur le commerce des Indes orientales). Londres, 1701, in-8. Cet ouvrage eut une seconde édition, Londres, 1720, in-8, sous le titre suivant: The advantages of the East-India trades, etc., etc. Ouvrage très curieux.
Monarquia indiana. — (La monarchie des Indes), par D. Juan de Torquemada. Madrid, 1723, 3 vol. in-folio.
Discours sur les métropoles grecques, par M. de Bougainville, tiré des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 1745, 1 vol. in-42.
Tratado historico-polilico y légal del comercio de las Indias occidentales. — (Traité historico-politique et de la législation du commerce des Indes occidentales), par D. José Guttierrez Buvalcava. Cadix, 1750, in-8.
Essai sur les colonies françaises. Paris, 1734, in-12.
A summary historical and political of the first planting, progressive improvements and présent state of the british settlements in north America. — (Sommaire historique et politique de l'origine, de l'amélioration progressive et de l'état actuel des établissements anglais dans l'Amérique du nord), par William Douglas. 1e édit., Boston; 2e édit., Londres, 1755, 2 vol. in-8. Cité par Adam Smith, t. I, 203, II, 406, de l'édition Guillaumin.
Essai sur l'admission des navires neutres dans nos colonies. Paris, 1756, in-12.
Lettres d'un citoyen sur la permission de commercer dans les colonies. 1756, in-12.
An account of the european settlements in America. — (Relation des établissements européens en Amérique). Londres, 2 vol. in-8, 1757. Ouvrage attribué habituellement à Edmond Burke, probablement avec la collaboration de son frère Richard et de leur homonyme William Burke.
Appel des étrangers dans nos colonies, par M. de la Morandière. Paris, 1763, in-12.
The right of the british colonies considered. — (Les droits des colonies britanniques examinés). Londres, 1765, in-8.
The administration of the colonies. — (L'administration des colonies), par Thomas Pownall. Londres, 1768, in-8.
Mémoire sur la compagnie des Indes, dans lequel on établit les droits des actionnaires, en réponse aux compilations de M. l'abbé Morellet, par le comte F. de Lauraguais, 1770. (Sans lieu d'impression.)
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux-Indes, par l'abbé Raynal. ) 1e édition, Genève, 1780, 4 vol. in-4, et 10 vol. in-8, avec des planches. Nouvelle édition. Paris, A. Coste et comp., 1820-21, 12 vol. in-8 et atlas.
Historia politica de los establecimientos ultra-marinos de las naciones europeas. — (Histoire politique des établissements coloniaux fondés par les nattons européennes), par Malo de Luque. Madrid, 1784-86, 3 vol. in-8.
[402]
Mémoire sur le commerce de la France et de ses colonies, par de Tolozan. Paris, 1789, in-4.
Vues générales sur l'importance des colonies, sur le caractère du peuple qui les cultive, et sur les moyens de faire la constitution qui leur convient, par J.-F. Dutrône de la Couture, 1790, in-8.
Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles dans les circonstance es présentes, par le citoyen Talleyrand.
Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l'Angleterre, par le même. Ce dernier Mémoire a été traduit en anglais. Londres, 1806, in-8. L'un et l'autre ont été publiés d'abord dans les Mémoires de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national, et Mac Culloch les trouve dignes de la réputation de leur auteur.
Du commerce de la France avec l'Amérique, les possessions au-delà du Cap et le Levant, par Magnier-Grandpré. An iv (1796).
Memorias historicas sobre la legislacion y gobierno del comercio de los Espanoles con sus colonias en las Indias occidentales. — (Mémoires historiques sur la législation et le gouvernement du commerce des Espagnols avec leurs colonies des Indes occidentales), par D. Antunez y Acevedo, du conseil suprême des Indes. Madrid, 1797, I vol. in-4.
Tableau historique et politique des pertes que la révolution et la guerre ont causées au peuple français dans sa population, son agriculture, ses colonies, ses manufactures et son commerce, par sir F. D’Ivernois. Londres, 1799, in-8.
De l'état et du sort des anciennes colonies, par M. de Sainte-Croix. Philadelphie (Paris), 1799, 4 vol. in-8. « L'un des meilleurs ouvrages sur ce sujet. » (M. C.)
Mémoire sur la colonie française du Sénégal, avec quelques considérations historiques et politiques sur la traite des nègres, sur les moyens de faire servir la suppression de cette traite à l'accroissement et à la prospérité de celte colonie, accompagné d'une carte exactement relevée sur les lieux, par J.-G. Pelletan. Paris, veuve Panckoucke, an ix (1800), in-8.
Mémoires sur les colonies, et correspondances officielles sur l'administration coloniale, par Malouet. Paris, an x (1802), 5 vol.
Sur les finances, le commerce, la marine et les colonies, par Ch. E. Micoud d'Umons. Paris, Agasse, an xi (1803), in-8.
Moyens d'amélioration et de restauration des colonies, ou mélanges politiques, économiques, agricoles et commerciaux, etc., relatifs aux colonies, par Charpentier-Cossigny. Paris, Mme Huzard, 1803, 3 vol. in-8.
An inquiry into the colonial policy of the European powers. — (Recherches sur le système des puissances d'Europe à l'égard de leurs colonies), par lord Brougham. 2 vol. in-8, 1808.
Précis historique de l'établissement et des progrès de la compagnie anglaise aux Indes occidentales, par Colquhoun. Traduit de l'anglais par Bertrand et Rodouan. Paris, Nicolle, 1815, in-8.
Histoire critique de l'établissement des colonies grecques, par M. Raoul Rochelle. Paris, 1815, 4 vol. in-8.
Du système colonial de la France sous les rapports de la politique et du commerce, accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissements coloniaux, et du commerce des Européens dans les autres parties du monde, par le comte G. Ch. de Hogendorp. Paris, 1817, Dentu.
The history civil and commercial of the british West Indies. — (Histoire civile et commerciale des Indes occidentales anglaises), par Bryan Edwards. 5e édition. Londres, 1819, 5 vol. in-8.
Mémoire sur la compagnie des Indes, composé avec des documents officiels du parlement anglais, par J.-G-V. de Moléon, (1820).
Histoire des colonies et du commerce des Européens dans les Deux-Indes, depuis 1785 jusqu'en 1824, pour faire suite à l'histoire philosophique et commerciale, de l'abbé Raynal, par J. Peuchet. Paris, impr. de Didot, 1821, 2 vol. in-8.
Substance of a debate in the house of commons on the 22nd of mai, 1823, on the motion of M. Whitmore, « that a sélect committee be appointed to inquire into the duties payable on east and west India sugar. » — (Résumé d'une discussion qui eut lieu à la chambre des communes sur la motion de M. Whitmore : « Qu'une commission soit nommée pour rechercher quel doit être le droit à payer sur le sucre des Indes orientales et occidentales). Londres, 1823, in-8. Ricardo parla en faveur de cette motion ; elle fut néanmoins rejetée à une forte majorité. Ce n'est qu'en 1835 que l'opinion soutenue par Ricardo parvint à triompher.
Exposition sommaire et documents authentiques de la situation de la compagnie des Indes et du commerce anglais en 1825, par Tournachon de Montvéran. Paris, Delaunay, 1825, in-8.
On colonial intercourse, etc. — (Sur le commerce colonial, etc), par Henry Bliss. Londres, 1826, in-8. Brochure provoquée par la proposition d'ouvrir jusqu'à un certain point les colonies au commerce étranger, soutenue par M. Robinson (actuellement lord Ripon) et Huskisson.
Rapport fait par la commission créée par l'ordonnance du 1er septembre 1825 pour l'indemnité aux colons de Saint-Domingue. Paris, 1826. Publié par le ministère de l'intérieur.
Archives de la compagnie des Indes orientales, considérées sous le rapport des revenus, dépenses, dettes, commerce, navigation, etc., de 1600 à 1830, par César Moreau. Paris, Treuttel et Wurtz, 1830.
Considérations on the value and importance of the british north american provinces. — (Considérations sur la valeur et l'importance des provinces (colonies) britanniques de l’Amérique du nord), par sir Howard Douglass. Londres, 1831, in-8.
Essai de statistique raisonnée sur les colonies européennes des tropiques et sur les questions coloniales, avec un appendice des pièces justificatives et des tableaux ou états de population, de commerce..., du mouvement des sucres en France…, par Tournachon de Montvéran Paris, Delaunay, 1833, in-8.
England and America, a comparison of the social and political slate of both nations. — (L'Angleterre et l'Amérique, comparaison de l'état social et politique des deux nations), par E.-G. Waketfield. Londres, 1833, 2 vol. in-8. « L'auteur de cet ouvrage est considéré comme l'inventeur de ce qu'on appelle le nouveau système de colonisation, et son système est largement traité dans cet ouvrage. » (M. C.)
A summary of colonial law, with the practice of the court of appeals from the plantations, charter of justice, orders in council, etc.— (Sommaire des lois relatives aux colonies, avec la jurisprudence de la cour d'appel spéciale, des chartes de justice, des ordres en conseil, etc.), par Ch. Clarke. Londres, 1834, 4 vol. in-8. « Ouvrage concis et utile qui mériterait d'être complété. » (M. C.)
Précis sur les établissements formés à Madagascar. 1830, lmpr. roy.,in-8.
Essai sur l'administration des colonies, par Mauny. Paris, 1837, in-8.
Statistics of the colonies of the british empire, etc. — (Statistique des colonies de l'empire britannique, etc.), par Montgomerie-Martin, Londres, 1839, 4 vol. gr. in-8. Cet ouvrage contient la substance d'un précédent travail en 5 volumes du même auteur et sur le même sujet.
[403]
Colonies étrangères et Haïti, par V. Schœlcher. Paris. Pagnerre, 1843, 1 vol. in-8.
Notices statistiques sur les colonies françaises, imprimées par ordre du ministre de la marine. Paris, Impr. roy., 1837-I840, 4 vol. divisés ainsi:
- 1e partie : Martinique, Guadeloupe.
- 2e partie .- Ile Bourbon.
- 3e partie : Établissement dans l'Inde, Sénégal.
- 4e partie : Madagascar et îles Saint-Pierre.
Ces notices forment le commencement d'une série de publications annuelles émanées du ministère de la marine, et paraissant sous le titre suivant :
Tableaux et relevés de population, de cultures, de commerce et de navigation pour les années 1839 et suivantes, formant la suite des tableaux insérés dans les notices statistiques sur les colonies françaises. Paris, Impr. roy., 1842 et années suiv.
Lectures on colonisation and colonies, delivered before the university of Oxford in 1839,1840 and 1841. — (Cours de colonisation professé à l'Université d'Oxford en 1839, 1840 et 1841), par Herman Merivale. Londres, 1841, 2 vol in-8. « Bien qu'il ne réalise pas tout ce qu'on pourrait désirer, cet ouvrage est certainement le plus complet et le meilleur écrit en anglais sur ce sujet. » (M. C.)
On the government of dependencies. — (Du gouvernement des dépendances ou colonies), par G.-C. Lewis. Londres, 1841, 1 vol. in-8. « Ouvrage savant et plein de mérite sur un sujet qui, bien que du plus haut intérêt, a été étrangement négligé dans ce pays. » (M. C.)
Procès-verbaux des séances de la commission de colonisation de la Guyane, publiés par le ministre de la marine. Paris, 1842, Impr. roy., 1 vol. in-4.
Colonisation de l'Algérie, par M. Enfantin. Paris, Bertrand, 1843, 1 vol. in-8.
Colonisation de Madagascar, par Désiré Laverdant Paris, Amyot, 1844, 1 vol. gr. in-8. Publication de la société maritime de Paris.
Rapport sur les questions coloniales, par M. Jules Lechevalier. Impr. roy. 1844-45, 2 forts vol. in-fol.
Colonisation et agriculture de l'Algérie, par L. Moll. Paris, librairie agricole de Dusacq, 1845.
De l'esclavage et des colonies, par M. Du Puynode. Paris, Joubert, 1845, 1 vol. in-8.
De la nécessité d'affranchir nos colonies, et de modifier les droits de douanes sur les sucres et les cafés, dans l'intérêt général de la France, par Ed. de Jullienne. Aix, veuve Tavernier, 1849, in-8.
Étude sur l'état actuel de la marins et des colonies françaises, par Louis Estancelin, ancien député, etc. Paris, veuve Le Normant, 1849, in-8.
Annales maritimes et coloniales, ou recueil de lois, ordonnances, règlements, etc., et généralement de tout ce qui peut intéresser la marine et les colonies. Paris, à partir de l'année 1819.
Voyez aussi Commerce, Esclavage, Navigation.
Endnotes to Colonies
[75] J.-B. Say, Traité d'Économie politique, liv. Ie, chap xix.
[76] Adam Smith, De la richesse des nations, liv. IV, chap. vii.
[77] La raison en est évidente, dit M. Dureau de la Malle ; composées de prolétaires qui, à Rome même, étaient privés de ces droits politiques, on n'eût pu les leur accorder sans troubler l'ordre des comices par centuries et par tribus, sans porter atteinte à la constitution de la république. » (Économie politique des Romains, tome I, liv. iv, chap. 7, p. 346.)
[78] Cours d’économie politique, 13e leçon.
[79] Richesse des nations, liv. IV, chap. VII.
[80] Robertson's America, liv. IX, p. 104.
[81] Richesse des nations, liv. IV, chap. vii.
[82] Par un statut de la 4e année du règne de Georges III (1763), il fut décidé « que désormais on ne rabattrait rien de ce qu'on appelle l'ancien subside pour les marchandises du cru, de la production ou des manufactures de l'Europe ou des Indes orientales, qui seraient exportées de ce royaume aux colonies ou plantations anglaises de l'Amérique, pour les vins, les toiles blanches de coton et les mousselines. »
[83] Bristol était le principal entrepôt du commerce avec l'Amérique du nord. Les négociants et les principaux habitants se réunirent pour déclarer au parlement de la manière la plus énergique que leur cité était ruinée à jamais si l'indépendance des États-Unis était reconnue, ajoutant qu'il n'entrerait plus dans leur port assez de vaisseaux pour qu'il valût la peine de l'entretenir. Malgré ces représentations, la nécessité força de conclure la paix et de consentir à cette séparation si redoutée. Dix ans n'étaient pas écoulés que les mêmes négociants de Bristol s'adressaient au parlement pour demander un bill qui les autorisât à creuser et à agrandir ce port, qui, loin d'être ruiné, était devenu trop étroit pour contenir tous les navires que l'extension du commerce avec l'Amérique indépendante y amenait. (De Lévis, Lettres chinoises.) En 1776, au commencement de la guerre de l'indépendance, les exportations anglaises pour l'Amérique du nord étaient de l ,300,000 livres sterling ; elles s'élevèrent à 3,000,000 livres en 1784, après que l'indépendance eut été reconnue ; et elles montent aujourd'hui à 12,400,000 livres sterling, somme qui égale presque celle de toutes les exportations que fait l'Angleterre à ses quarante-cinq colonies, puisque celles-ci n'ont pas dépassé, en 1842, 13,200,000 livres sterling. (Fr. Bastiat, Cobden et la ligue, introduction, p. 26.)
[84] A raison de 49 fr. 20 c (39 sh. 8 d.) prix moyen du sucre colonial en entrepôt de 1837 à 1841, plus 30 fr. de droits (24 sh.), il en a coûté au peuple anglais, pour consommer annuellement 3,868,000 quintaux de sucre, la somme de 306 millions et demi, qui se décompose ainsi.
| 103 1/2 | millions qu'aurait coûtés une égale quantité de sucre étranger au prix de 29 fr. 75 c. (21 sh. 8 d.), prix moyen du sucre étranger en entrepôt de 1837 à 1841. |
| 116 | millions impôt pour le revenu à 30 fr. (24 sh.). |
| 86 1/2 | millions, part du monopole résultant de la différence du prix colonial au prix étranger. (Le droit sur le sucre étranger étant de 63 shellings, c'est-à-dire prohibitif.) |
| 306 | millions. |
II est clair que sous le régime de l'égalité et avec un impôt uniforme de 30 fr. par quintal, si le peuple anglais eût voulu dépenser 306 millions de francs pour ce genre de consommation, il en aurait eu au prix de 26 fr. 75 c. plus 30 fr. de taxe, 5,400,000 quintaux ou 22 kil. par habitant au lieu de 16. — Si le peuple se fût contenté de la consommation actuelle, il aurait épargné annuellement 86 millions qui lui auraient procuré d'autres satisfactions et ouvert de nouveaux débouches à son industrie. (F. Bastiat, Cobden et la ligue. Introduction, p. xxxi.)
[85] La moyenne a été de 14,355,461 livres sterling en 1842-46. Les exportations pour les Indes orientales figurent pour 6,770,436 dans ce total.
[86] Journal des Économistes. Nouvelle politique coloniale de l'Angleterre, par F. Bastiat, t. XXV, p. 8.
Colonies agricoles↩
Source
"Colonies agricoles", DEP, T. 1, pp. 403-5.
[403]
La colonisation agricole est une conception purement philanthropique. Après tant de vaines tentatives faites pour éteindre la mendicité, on crut avoir trouvé la solution du problème, en donnant des terres incultes à défricher aux mendiants. On était persuadé que l'établissement des colonies agricoles exonérerait la société des frais d'entretien des pauvres valides, tout en l'enrichissant d'un supplément de produits. Malheureusement on oubliait un élément essentiel dans ce beau calcul ; on oubliait le capital nécessaire à l'établissement et à l'exploitation des colonies Or la dépense ne pouvait manquer de s'élever fort haut, car les terres restant à défricher dans les pays civilisés sont généralement d'une qualité inférieure, et, d'un autre côté, le travail qu'il s'agissait d'employer aux défrichements était de la plus mauvaise espèce.
L'expérience devait dissiper, du reste, les illusions que l'on s'était faites au sujet de ce nouveau remède proposé pour l'extinction de la mendicité. La Hollande, il y a trente ans, et la France, à une époque toute récente, ont l'ait sur une grande échelle l'expérience des colonies agricoles, et elles y ont enfoui des sommes qui auraient pu certes recevoir un meilleur emploi.
C'est en 1818 que le général Vandenbosch fonda en Hollande une société de bienfaisance ayant pour objet de déverser dans des colonies agricoles le trop plein de la population misérable des villes. Cette société, placée sous le patronage du prince Frédéric des Pays-Bas, se composait d'un nombre illimité de membres. On devenait actionnaire ou membre de la société en payant une contribution annuelle de 2 florins 1/2. [87] La Société fonda successivement quatre établissements, savoir: 1° les trois colonies Fredericks' Oord, près de Steenwyk sur les confins des provinces d'Over-Yssel, de Drenthe et de Frise ; 2° L'Ommerschans, près d'Ommers en Over-Yssel, servant de dépôt de mendicité ; 3° Les trois établissements de Veen-huysen, près d'Assen en Drenthe, dont le premier sert d'asile aux orphelins, et les deux autres, comme l'Ommerschans, aux mendiants; 4° Une institution agricole pour 70 orphelins à Wateren. Ces quatre colonies étaient peuplées, à la fin de 1847, de 11,793 habitants. On comptait 3,465 colons libres, 649 colons militaires, 1,511 orphelins et enfants abandonnés, 5,145 mendiants, 645 employés (y compris leurs familles). Cette population se recrute de la manière suivante. Les colons libres sont envoyés par les sous comités de la Société. Chaque fois qu'un sous-comité a réuni une somme de 1,700 florins, il a le droit d'envoyer une famille pauvre aux colonies, et l'on remet à cette famille une petite ferme de deux hectares et demi. Les orphelins et les enfants abandonnés sont placés, pour la plupart, par les grandes villes de la Hollande. Les mendiants sont : 1° Ceux qui ont été condamnés pour délit de mendicité à un emprisonnement de trois à six mois, puis à une détention dans un dépôt de mendicité, selon l'article 274 du code pénal français, qui est resté en vigueur en Hollande; 2° Un petit nombre de mendiants envoyés par les communes qui veulent se débarrasser de leur trop plein de misérables ; 3° Des pauvres qui, ne pouvant gagner leur vie dans la commune, témoignent le désir d être transportés dans les colonies agricoles. Les colonies payent pour cet objet au gouvernement :
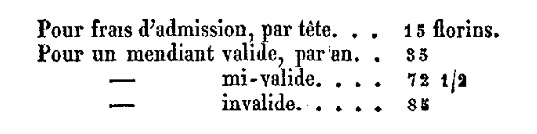
Elles sont obligées, en outre, de supporter les frais de transport de leurs pauvres jusqu'aux colonies. Cette obligation d'envoyer aux colonies les pauvres qui en témoignent le désir leur est extrêmement onéreuse. Elles sont littéralement [404] écrasées sous ce fardeau qui leur est imposé dans le but de favoriser la colonisation agricole.
Cependant ces subsides que les communes hollandaises payent pour l'entretien de leurs orphelins, de leurs pauvres et de leurs mendiants ne sont pas encaissés par la Société de bienfaisance. Le gouvernement sert d'intermédiaire entre les communes et la Société. Il a fait avec celle-ci le marché suivant :
La Société s'engage à entretenir annuellement :
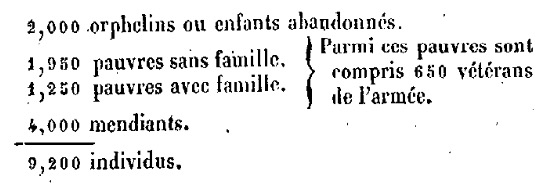
A son tour, le gouvernement s'engage à payer annuellement à la Société pour l'entretien de ces 9,200 individus la somme de 332,000 florins. Si ce nombre est dépassé, le gouvernement fournit en sus un supplément par tête de colon ; s'il n'est pas atteint, le gouvernement ne peut rien déduire, jusqu'à ce que le chiffre des pensionnaires fournis par lui soit tombé à 5,800. Au-dessous de ce chiffre, il a le droit de déduire 35 florins par tête.
La Société emploie ses colons à l'agriculture et à diverses industries, telles que la filature du coton et la fabrication des sacs servant au transport des cafés de l'île de Java. Elle vend ces sacs au gouvernement, qui en a le monopole ; elle vend aussi au-dehors une partie des cotons filés dans les colonies. Les autres denrées sont consommées par les colons. La Société a imaginé un procédé ingénieux pour les obliger à se pourvoir dans ses magasins : elle paye leurs salaires en monnaie de plomb, et elle reçoit cette monnaie purement fiduciaire à un taux déterminé. C'est le truck-system un peu déguisé.
Malgré le subside considérable que le gouvernement lui alloue, et le procédé artificiel qu'elle emploie pour se débarrasser de ses produits, la Société de bienfaisance est constamment en déficit. En 1848, son capital mobilier et immobilier n'était pas évalué à plus de 3 millions de florins, et elle avait de 8 à 9 millions de florins de dettes. L'expérience peut donc être regardée comme manquée. Si le gouvernement hollandais avait laissé les communes maîtresses de pourvoir d'une autre manière à l'entretien de leurs indigents, elles les auraient certainement entretenus à moins de frais, en admettant qu'elles eussent trouvé convenable et utile de les entretenir.
L'expérience des colonies agricoles a été faite aussi en Belgique; mais elle y a échoué plus promptement encore qu'en Hollande. En 1822, une société, fondée à Bruxelles également sous le patronage du prince Frédéric, établit à Vortel, province d'Anvers, une colonie agricole à l'imitation de celle de Frederiks'Oordt. Plus tard, la Société créa un dépôt agricole de mendiants au milieu des bruyères de Mirxplas-Ryekewersel, dans la province d'Anvers. Lors de la séparation de la Belgique et de la Hollande, ces établissements échurent en partage à la Belgique; mais le gouvernement belge n'ayant pas jugé à propos de les soutenir, ils finirent par succomber. En 1836, la Société devait une somme de 1,908,084 fr. 23 c. et son actif ne s'élevait qu'à 915,192 fr. 82 c. ; quelques années après, en 1845, il n'était plus que de 420,000 fr. La population, qui était à l'origine de 127 individus, et qui atteignit en 1827 le chiffre de 1,431, tomba à 530 en 1830. Lors de l'abandon des colonies, les derniers colons restants furent évacués sur les dépôts de mendicité. En 1846, les propriétés de la Société furent mises en vente publique et adjugées au prince Frédéric des Pays-Bas, principal créancier de la Société.
En Fiance, les colonies agricoles demeurèrent à l'état de projet jusqu'en 1848. Sous la restauration , M. de Villeneuve-Bargemont les avait beaucoup vantées. Après la révolution de juillet, une commission fut nommée pour étudier le système en vigueur dans les Pays-Bas, et pour préparer un essai en France. Un peu plus tard, l'Académie décerna le prix Montyon au Traité d'Économie politique chrétienne, de M. de Villeneuve-Bargemont, et à un livre de M. Huerne de Pommeuse sur les colonies agricoles. Mais aucun essai important ne fut tenté jusqu'en 1848. On songea alors à fonder des colonies agricoles pour employer les ouvriers sans ouvrage qui encombraient le pavé de Paris. Le 19 septembre, une loi fut promulguée portant que douze mille colons seraient installés en Algérie aux frais de l'État, et qu'ils seraient pourvus pendant trois années des objets nécessaires à leur installation et à leur entretien. Voici quels ont été les résultats de cette nouvelle expérience philanthropique. A la fin de 1850, quarante-deux villages étaient bâtis ou en voie de construction. Ils étaient habités par une population de 10,376 individus; mais cette population s'était déjà renouvelée une fois, car les colonies, après avoir reçu originairement 12,666 habitants, en ont perdu 10,217, soit par les départs, soit par les décès. Les dépenses effectuées ou à effectuer pour cette population étaient évaluées à 27,250,000 fr. Parmi ces dépenses figurent 1,212,000 fr. pour le transport des colons, 10,442,000 fr. pour travaux de construction, 5,776,000 fr. pour rations de vivres, 1,582,000 fr. pour dépenses administratives, 1,707,000 fr. pour instruments aratoires, 1,416,000 fr. pour bestiaux et semences, etc. Ces dépenses ont été effectuées au profit de 3,230 concessionnaires et de leurs familles occupant 57,000 hectares de terrain. Cela fait :
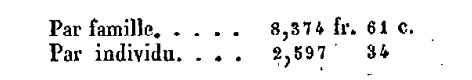
Or n'est-il pas évident que si l'on avait donné, dans la métropole, pareille somme à chacune des familles importées en Algérie, elle se serait aisément tirée d'embarras? Au taux où était la rente en 1848, elle se serait fait, au moyen de cette munificence nationale, un petit revenu de 7 à 800 fr., avec lequel elle aurait pu vivre à l'aise dans n'importe quel bourg ou village de France. Quant au produit réalisé en Algérie au moyen de ce capital de 8,374 fr. 61 c, dépensé pour chaque concessionnaire, il est demeuré jusqu'à [405] présent à peu près nul ; on l'évaluait à 1115 fr. 86 c. au maximum en 1851. S'il ne s'augmente pas dans une proportion considérable, les colonies agricoles de l'Algérie demeureront indéfiniment à la charge de la métropole.
L'expérience a donc prononcé contre les colonies agricoles en Algérie aussi bien qu'en Belgique et en Hollande. On ne s'étonnera point de ce résultat, si l'on remarque que ces colonies manquaient des éléments les plus essentiels au succès d'une entreprise de colonisation. En Hollande et en Belgique, elles ne possédaient ni bonnes terres ni bras propres à la culture. En Algérie elles avaient de bonnes terres ; mais les colons, expédiés sans choix, dans un pays nouveau, étaient tout à fait incapables de supporter les fatigues de la colonisation. Que faut-il conclure de là? Que la colonisation est une opération trop difficile pour être exécutée par des ouvriers pris au hasard ou par des mendiants démoralisés par la misère, et que la bienfaisance publique ou privée est aussi impuissante à coloniser avec profit qu'elle peut l'être à exercer n'importe quelle autre industrie. (Voyez pour les colonies pénitentiaires l'article Système pénitentiaire.)
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Des colonies agricoles, par Huerne de Pommeuse. 1 vol. in-8, Paris, 1832.
Économie politique chrétienne, de M. de Villeneuve-Bergemont, 3e vol.
Les colonies agricoles de la Société néerlandaise de bienfaisance, par M. W.-C. Staring. Brochure de 30 pages en français. Arnheim, chez G.-J. Thième, 1849.
Rapports sur les colonies agricoles de l'Algérie, par MM. de Riancey, Louis Reybaud, et Th. Lestiboudois.
Rapport de M. Ducpétiaux sur les colonies agricoles. Bruxelles.
Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur les colonies agricoles, par MM. de Lurieu et Romand, inspecteurs généraux de bienfaisance. Paris, 1851.En 1849, une commission fut nommée, sur le rapport de M. Buffet, ministre de l'agriculture, pour étudier la question des colonies agricoles dans son ensemble et dans ses détails. MM. de Lurieu et Romand, inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, membres de cette commission, furent chargés d'étudier sur place les colonies agricoles de la France, de la Hollande, de la Suisse et de la Belgique, afin de fournir à la commission les éléments d'information nécessaires à ses travaux.
Colonisation sur les landes de la Bretagne des orphelins et des enfants abandonnés, par M. Achille du Clésieux, 1845.
Des colonies agricoles en France et en Algérie, par Jules Lamarque et Gustave Dugat. 1850.
Colonie agricole de Montmorillon, par M. Emmanuel de Cuizon. 1851.
Voy. les articles de M. P. de Thury sur les colonies agricoles, dans les Annales de la charité. 1851.
Endnotes to Colonies agricoles
[87] Fr. 5,32. Le florin des Pays-Bas vaut 2 fr. 12 1/2 c.
Colonies militaires↩
Source
"Colonies militaires", DEP, T. 1, p. 405.
[405]
Plusieurs nations ont fondé des colonies militaires, afin de protéger leurs frontières menacées de l'invasion. C'était une manière économique de se procurer des services militaires. Sous l'empire romain, par exemple, des légionnaires reçurent des concessions de terres en lllyrie et dans la Pannonie, à la charge de les défendre. Plus tard, les rois de Hongrie et les archiducs d'Autriche organisèrent dans la même contrée une frontière militaire et sanitaire pour se protéger contre les invasions des Turcs, et se garantir de la peste. Les colons s'obligèrent à tenir constamment sur pied un certain nombre d'hommes. En échange de cette obligation, on leur concéda une certaine étendue de terres à blés et de prairies. — En Russie, on créa des colonies militaires dans la vue de maintenir sur pied un effectif considérable sans enlever des bras à l'agriculture. Le comte Araktcheief fut le promoteur principal de ces entreprises qui furent commencées, en 1818, sur un plan extrêmement vaste. On concéda des terres à des paysans, serfs de la couronne, en leur imposant l'obligation d'entretenir les soldats envoyés dans les colonies. Ceux-ci furent astreints, à leur tour, à des prestations de travail envers les paysans. Les règlements les plus minutieux furent imposés aux colonies. Selon un voyageur anglais, M Lyall, ces règlements ne remplissaient pas moins de quatorze volumes. Ils s'étendaient même aux femmes, qui ne pouvaient épouser que des membres de la colonie à laquelle elles appartenaient, et qui étaient tenues de se conformer à la volonté des chefs pour le choix de leurs maris. Au bout de dix ans, 60,000 hommes avec 30,000 chevaux se trouvaient établis au milieu de 400,000 paysans mâles, l'infanterie dans le gouvernement de Novogorod, la cavalerie dans ceux des Slobodes d'Oukraine ou de Kharkof, de Kherson et d'Iékaterinoslaf. Les frais de premier établissement et autres s'élevaient, en 1826, à 32,482,733 roubles. Au point de vue financier, l'entreprise ne répondit pas aux espérances qu'on en avait conçues, et, plus tard, elle parut dangereuse. Après 1830, un grand nombre de colons furent désarmés, et les colonies militaires perdirent leur nom même : on les désigna simplement sous le nom de districts de soldats cultivateurs. En définitive, et sauf des exceptions que motivent des circonstances particulières, il paraît que les travaux agricoles s'associent mal aux travaux militaires, et qu'il vaut mieux entretenir une armée spéciale que d'imposer des services et une organisation militaires à des agriculteurs, — ceci conformément au principe économique de la division du travail.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Tableau du système militaire de la Russie, par M. Tanski.
Essai historique sur le système de colonisation militaire de la Russie, par M. Robert Lyall. Traduit en français. Paris, 1825.
Encyclopédie des gens du monde, article Colonies militaires, de M. Schnitzler.
Émigration↩
Source
"Émigration", DEP, T. 1, pp. 675-83.
[675]
I.
L'émigration peut être définie : une exportation de travail et de capital. Elle a lieu lorsque des travailleurs ou des capitalistes croient pouvoir améliorer leur situation en changeant de lieu, en abandonnant le pays où ils sont nés pour s'établir dans un autre pays. Comme toutes les autres entreprises, l'émigration peut réussir ou échouer, selon les circonstances ; mais il importe essentiellement au bien-être et surtout à l'indépendance des populations qu'elle ne soit entravée par aucun obstacle.
De tout temps, l'émigration a joué un rôle considérable dans l'économie des sociétés. Elle a eu lieu sous l'influence de causes diverses : politiques, religieuses ou économiques.
II. L' ÉMIGRATION DANS LES TEMPS ANCIENS.
A l'origine de la civilisation, avant que les hommes se livrassent à l'agriculture, les émigrations paraissent avoir été nombreuses. Cependant, les historiens, partant de l'idée préconçue de l'unité d'origine de la race humaine, en ont peut-être exagéré l'importance. On ne remarque point, par exemple, que les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, qui pourvoient encore à leur subsistance au moyen de la chasse, se déplacent fréquemment. Chaque tribu a ses terrains de chasse, dont elle dépasse rarement les limites. Cette immobilité de l'existence du sauvage s'explique par sa situation économique. Il ne possède qu'un faible capital, des armes, des filets, quelques avances de subsistance. Ce capital, qui lui fournit à peine les moyens de soutenir son existence dans les localités composant le domaine de sa tribu, n'est-il pas tout à fait insuffisant pour lui permettre d'entreprendre des expéditions lointaines? Sans doute, on peut se livrer partout à la chasse ou à la pêche; mais avant de connaître les endroits où le gibier et le poisson abondent, ne faut-il pas pratiquer des explorations, souvent chanceuses et difficiles? L'accumulation d'un capital relativement assez considérable n'est-elle pas nécessaire pour rendre ces explorations possibles? Or comme le sauvage, naturellement imprévoyant, accumule peu, il demeure essentiellement sédentaire, à moins que l'excès de la population ou la guerre ne le chasse de son territoire primitif. Tels du moins nous apparaissent les sauvages du nouveau monde, et tels devaient être ceux de l'ancien.
Lorsque la civilisation commence à se développer, l'émigration, ou, si l'on veut, la circulation des hommes devient plus active, malgré les obstacles naturels ou artificiels qui l'entravent. On en peut aisément apercevoir la raison. Les besoins de l'industrie deviennent alors plus nombreux et plus divers. La production plus développée se répartit dans différents centres, où le travail, qui en est la principale matière première, se trouve invinciblement attiré. Ici il faut des laboureurs pour cultiver le blé, la des tisserands, des apprêteurs, des teinturiers pour façonner et colorer la soie ou la laine; ailleurs des forgerons, des armuriers pour fabriquer des outils ou des armes. Or tous les hommes, indistinctement, ne sont pas propres à l'exercice de tous les métiers. Chaque espèce de travail est comme une matière première particulière qu'il faut aller chercher où elle se trouve, et apporter à l'industrie qui en a besoin. Dans l'antiquité, les marchands d'esclaves sont les intermédiaires à l'aide desquels s'opèrent cette répartition et ce classement du travail. Ils achètent des hommes dans les endroits où les emplois manquent aux bras, et ils les revendent dans ceux où les bras sont demandés. Un courant d'émigration forcée s'établit ainsi des lieux où l'industrie n'a pas encore commencé à poindre vers ceux où elle s'est déjà développée. (V. Esclavage.)
A côté de cette émigration forcée, dont les marchands d'esclaves sont les intermédiaires, apparaît l'émigration des hommes libres. Tantôt celle-ci s'épand d'un foyer de civilisation dans une contrée encore barbare, et elle est causée soit par l'accroissement de la population , soit par les dissensions politiques ou religieuses des États ; tantôt elle est un reflux de la barbarie sur la civilisation. De nombreux essaims d'émigrants partis de l'Egypte, de la Phénicie, de la Grèce, ont successivement entamé le domaine de la barbarie (V. Colonies.); d'autres, au contraire, partis des plateaux de la haute Asie, des plaines de la Germanie ou des déserts de l'Arabie, ont envahi le territoire de l'antique civilisation. Des causes analogues à celles qui déterminaient les émigrations des peuples civilisés poussaient aussi les barbares à s'expatrier. Ainsi il paraît certain que ce fut l'accroissement de la population des régions septentrionales de l'Europe et de l'Asie qui provoqua les grandes émigrations sous lesquelles disparut l'empire romain : le flot de l'émigration barbare, après s'être longtemps brisé contre cette digue, parvint à l'entamer de toutes parts. Les émigrants du Nord, Goths, Vandales, Franks, Lombards, s'élancèrent sur le monde civilisé comme sur une proie, et ils s'en partagèrent les lambeaux.
Après ces grandes émigrations sur lesquelles, du reste, les données statistiques manquent, le mouvement d'expansion des peuples barbares ou civilisés subit un temps d'arrêt. Au moyen âge, le déplacement des hommes paraît avoir été moins fréquent et moins étendu que dans l'antiquité même; les serfs attachés à la glèbe ne pouvaient émigrer volontairement, et, d'un autre côté, l'on ne pouvait, non plus, les vendre et les exporter comme les esclaves de l'antiquité : chaque seigneur limitait la population de son domaine, en autorisant ou en défendant, à sa volonté, les mariages; les couvents offraient, en outre, un exutoire à la population surabondante. Dans les villes, les règlements des corporations entravaient l'émigration des artisans, tandis que le servage de la glèbe arrêtait celle des laboureurs. Le moyen âge offre l'image d'une véritable pétrification sociale : l'homme meurt sur le coin de terre qui l'a vu naître comme [676] l'huître sur son rocher, et avec la circulation des hommes on voit s'arrêter celle de la richesse.
III. L'ÉMIGRATION DANS LES TEMPS MODERNES.
§ I er. Les émigrations européennes.
Nous avons exposé, dans l'article Colonie , les causes qui ont fait renaître, en Europe, l'esprit d'aventures et de déplacement. Sous l'influence de ces causes on voit peu à peu se relâcher les liens qui retiennent l'homme enchaîné au lieu de sa naissance; on voit l'industrie renaissante attirer irrésistiblement les travailleurs et les capitaux des endroits les plus éloignés. Les émigrations ont lieu à l'intérieur et au dehors, et elles vont se développant à mesure que les obstacles opposés à la circulation des hommes et des choses disparaissent ou s'abaissent.
Comme les émigrations des temps anciens, celles des temps modernes peuvent être rangées en deux catégories bien distinctes : elles sont volontaires ou forcées, libres ou esclaves.
La découverte de l'Amérique a ravivé le commerce des esclaves en rendant profitable l'exportation des nègres de la côte d'Afrique dans les plantations du nouveau monde. On trouvera ailleurs (V. Esclavage) les renseignements relatifs aux émigrations des travailleurs esclaves. Nous nous bornerons à exposer ici les faits qui concernent l'émigration des hommes libres.
Celle-ci se partage encore en deux branches: l'émigration intérieure et l'émigration extérieure. Depuis l'avènement de la liberté du travail, la première a pris une extension immense ; malheureusement les données statistiques manquent pour en apprécier l'importance; on ne sait ni quelle est l'étendue du mouvement de déplacement des hommes de l'intérieur, ni quelles quantités de travail chaque pays importe et exporte annuellement , ni, à plus forte raison, la provenance du travail importé et la destination des bras et des intelligences qui s'exportent. Mais il suffit d'étudier la composition de la population dans un grand centre d'industrie, pour s'assurer de l'importance actuelle de ce mouvement de circulation des travailleurs. La population ouvrière de Paris, par exemple, est un composé d'éléments essentiellement variés, et c'est là évidemment une des principales causes de sa supériorité industrielle; non-seulement chacune des parties de la France lui envoie annuellement son contingent d'émigrants, qui se classent dans les industries où les appellent leurs vocations particulières, mais encore ce contingent se grossit d'une foule d'émigrants belges, allemands, suisses, italiens, qui apportent à la métropole parisienne le tribut de leurs aptitudes spéciales.
« Les conditions favorables dans lesquelles s'exerce le travail, lisons-nous dans la statistique de l'industrie à Paris, [88] et l'attrait du séjour d'une grande ville, y font affluer les ouvriers de tous les points de la France et même de l'étranger. Quelques-uns de ces ouvriers viennent faire un séjour passager ; ils cherchent à recueillir des salaires avec l'espoir de remporter des épargnes ; ils n'ont point avec eux de famille; ils appartiennent à la population mobile. D'autres, au contraire, arrivent sans idée de retour; ils ont foi dans le talent ou l'habileté qu'ils possèdent, souvent dans leur savoir-faire; quelquefois ils viennent cacher, en se perdant dans la foule, de fâcheux antécédents. La population laborieuse absorbe et s'assimile les nouveaux venus, et tous ceux qui composent cette population subissent ensuite l'effet des causes générales qui influent sur les conditions d'existence, sur les mœurs et sur les habitudes de l'ensemble . »
Les autres centres industriels sont aussi des foyers d'attraction où viennent converger incessamment les migrations des travailleurs.
Certains esprits ont vu avec inquiétude le développement qu'ont prisées migrations pacifiques; ils déplorent notamment la tendance qui porte vers les villes les ouvriers des campagnes. Sans doute, le déplacement des hommes est sujet à des inconvénients sérieux, et nous sommes convaincus pour notre part que le système protecteur a rendu un fort mauvais service à l'humanité, en créant des centres artificiels de production où il a attiré des masses d'hommes, désormais voués à une existence précaire; mais l'accroissement de la circulation des travailleurs, leur tendance à émigrer et à s'agglomérer dans de grands foyers de production, n'en sont pas moins des conséquences inévitables, et, selon nous, bienfaisantes du progrès industriel. Dans l'enfance de l'industrie, chaque localité pourvoyait elle-même au plus grand nombre de ses besoins. Chaque village avait non-seulement ses bergers et ses laboureurs, mais encore ses ouvriers en fer et en bois, ses fileurs, ses tisserands, etc. Souvent le même homme était à la fois laboureur et artisan. De nos jours, la fabrication des socs de charrue et des autres instruments de l'agriculture et de l'industrie , la filature et le tissage des étoffes, la fabrication des meubles, s'opèrent en grand, dans de vastes ateliers ou d'immenses manufactures; ces ateliers et ces manufactures, où se concentrent les industries morcelées d'autrefois, s'établissent dans les endroits les plus favorables à leur fabrication spéciale. Les fils des charrons et des tisserands de villages, les filles des fileuses au rouet, et tant d'autres ouvriers des petits métiers que le progrès a transformés en grandes industries, sont obligés d'aller retrouver là leur industrie qui s'est déplacée en s'agrandissant. Le progrès industriel apparaît ainsi comme la cause sans cesse agissante du déplacement et de l'agglomération des travailleurs. Des maux accidentels peuvent surgir sans doute de ce brusque mouvement de circulation imprimé à des populations, naguère vouées à l'immobilité ; mais combien, en revanche, le rapprochement et l'agglomération des masses laborieuses ne sont-ils pas favorables à la diffusion des connaissances humaines et aux progrès de la sociabilité !
Les émigrations extérieures n'ont pas manqué de se développer aussi, à mesure que l'industrie s'est agrandie et que les communications sont devenues plus faciles. Quelquefois encore elles ont été provoquées, comme dans l'antiquité, par des dissensions politiques ou religieuses. L'abolition a jamais regrettable de l'édit de Nantes, par exemple, a rejeté de France 3 à 400 mille protestants qui formaient l'élite de sa population industrielle. [677] On peut voir clans un savant mémoire de M. Charles Weiss quelle perte énorme d'industries et de capitaux cet édit, renouvelé des temps de barbarie, a causée à la France.
« On peut évaluer notamment, dit l'auteur de ce mémoire, à plus de 70 mille le nombre des manufacturiers et ouvriers que la révocation de l'édit de Nantes répandit en Angleterre. Le plus grand nombre étaient originaires de la Picardie, de la Normandie, des provinces de l'Ouest, du Lyonnais et de la Touraine. Les industries jusqu'alors ignorées ou imparfaitement exploitées en Angleterre, et qu'importèrent ou développèrent les ouvriers français, furent celles de la soie, du papier, du verre, de la chapellerie, des tissus légers de lin, de laine et de soie, des brocarts, des satins, des velours, des toiles peintes, des batistes, des serges, des flanelles, des tapisseries à l'instar de celles des Gobelins, des horloges, des montres, de la coutellerie et de la quincaillerie. L'habileté et l'expérience des nouveaux venus, jointes aux dispositions du bill des droits de 1689 qui, en consacrant les libertés du peuple, garantissait la propriété individuelle, devinrent le point de départ de l'industrie, du commerce et de la navigation de la Grande-Bretagne. La fabrication des soieries et des toiles, pratiquée jusqu'alors en France avec le plus grand succès, passa en Angleterre. Le nombre des métiers de Lyon descendit, en 1698, de 18 mille à 4 mille; ceux de Tours, de 8 mille à 12 cents. Ses 700 moulins furent réduits à 70 ; ses 40 mille ouvriers à 4 mille ; ses 3 mille métiers à rubans à moins de 60; et au lieu de 2.400 balles de soie, on n'en consomma plus que 7 à 8 cents dans la capitale de la Touraine. En quinze années, la population générale de Tours descendit de 80 mille âmes à 33 mille. » [89]
Les persécutions religieuses chassèrent aussi d'Angleterre un nombre considérable d'hommes industrieux qui allèrent chercher un refuge dans le nouveau monde. Plus tard, à l'époque de la révolution française, les persécutions politiques occasionnèrent de nouveau un déplacement considérable d'hommes et de capitaux.
Néanmoins, l'influence des causes économiques a agi plus efficacement encore que celle des causes politiques ou religieuses pour déterminer les émigrations. Depuis un quart de siècle surtout, les émigrations volontaires de l'Europe vers le nouveau monde, émigrations provoquées uniquement par le désir d'une augmentation de bien-être, ont reçu une extension véritablement prodigieuse.
A l'origine, les émigrants qui passaient d'Europe en Amérique se partageaient en plusieurs catégories.
On comptait d'abord les émigrants des classes supérieures qui avaient obtenu des concessions aux colonies ; venaient ensuite les religionnaires que les persécutions chassaient de la mère-patrie, puis les aventuriers qui s'en allaient dans les régions lointaines demander la fortune bien moins au travail régulier qu'aux chances heureuses de la spoliation. Les émigrants appartenant à ces trois catégories possédaient communément la somme nécessaire pour payer leur passage, et ils arrivaient libres aux lieux d'émigration. Mais il y avait une dernière classe composée d'artisans et de laboureurs qui émigraient a peu près dépourvus de capital et qui se plaçaient dans un véritable esclavage temporaire, afin de payer leur passage aux colonies. Ces émigrants pauvres aliénaient leur travail pour une période de trois ans, de sept ans ou même de quatorze ans, au profit du capitaine de navire qui se chargeait de les transporter. A son arrivée, le capitaine cédait, moyennant un bénéfice plus ou moins élevé, selon l'intensité de la demande des bras, ses contrats d'engagement aux propriétaires des colonies. Souvent, un travailleur engagé passait successivement à plusieurs planteurs. A l'expiration de son contrat d'engagement, il devenait libre et il allait grossir le nombre des travailleurs indépendants de la colonie.
De nos jours, ce système d'engagements est tombé en désuétude, du moins en Europe. Les émigrants européens possèdent généralement le capital nécessaire pour subvenir aux frais de leur expatriation, et ils arrivent libres aux lieux d'immigration.
Les nations qui fournissent les contingents principaux à l'émigration européenne sont les îles Britanniques et l'Allemagne. Viennent ensuite, pour des contingents beaucoup plus faibles, la France, la Belgique, la Norwége, et dans le Midi, l'île de Malte, le Portugal et l'Espagne. Les endroits où se dirige principalement ce courant d'émigration sont les États du centre et de l'ouest de l'Amérique du Nord et l'Australie. Voici un court aperçu de la manière dont l'émigration européenne s'opère :
Selon M. Vanderstraten Ponthoz, qui a recueilli des renseignements pleins d'intérêt sur la situation des émigrants aux États-Unis, [90] l'émigration comprend trois périodes bien distinctes. La première commence au départ et finit au débarquement. La seconde comprend l'acheminement depuis le port d'arrivée jusqu'au lieu de destination. La troisième embrasse la période des travaux de premier établissement de l'émigrant.
Le transport des émigrants est devenu un élément considérable de fret pour certains ports, tels que Brême, Hambourg, Anvers, le Havre, Liverpool, où ce transport s'est organisé sur une échelle immense. Des maisons importantes y consacrent spécialement leurs navires. Ces maisons ont des agents qui vont à la recherche des émigrants, dans les différentes parties de l'Europe, et qui traitent avec eux pour le passage. Les prix ordinaires sont les suivants : de Liverpool à New-York 38 fr. ; d'Anvers 80 fr. ; du Havre 90 fr. ; de Brême ou de Hambourg 106 fr. 60 c. Les vivres sont compris dans le prix du passage de ces deux dernières villes. Le transport des émigrants a donné lieu à des abus nombreux. Les entrepreneurs d'émigration n'exécutent pas toujours les stipulations, ordinairement verbales, qui ont été faites avec leurs [678] agents. Ils font attendre les émigrants dans les ports d'embarquements jusqu'à ce que leurs cargaisons soient complètes ; ils les embarquent sur des navires en mauvais état et mal emménages, etc., etc. Plusieurs gouvernements ont voulu remédier à de si fâcheux abus, en établissant des règlements relatifs aux emménagements, à la quantité et à la qualité des vivres; mais ces règlements demeurent, le plus souvent, sans efficacité. C'est au développement de la concurrence entre les armateurs et à la surveillance active du gouvernement, quant à l'exécution des engagements pris avec les émigrants, qu'il faut demander l'amélioration de l'état de choses existant. Des règlements qui prescrivent certains modes d'emménagement de préférence à d'autres ne peuvent avoir pour résultat que d'augmenter le prix du passage, au détriment des émigrants pauvres.
Des sociétés philanthropiques se sont établies aux lieux d'embarquement et de débarquement pour protéger les émigrants contre les fraudes et les piéges dont ils peuvent être victimes, comme aussi pour éclairer les démarches de ceux qui cherchent du travail et fournir des secours aux plus nécessiteux. C'est à Philadelphie que la première de ces sociétés a été fondée en 1781, pour les émigrants allemands. D'autres ont été successivement instituées dans les différents ports de l'Union.
M. Vanderstraten Ponthoz attribue à deux causes principales la préférence que les émigrants d'Europe donnent aux États-Unis sur tous les autres lieux d'immigration. 1° A la possibilité que leur donnent les lois de naturalisation de participer promptement aux droits des citoyens américains ; 2° aux facilités qu'ils trouvent dans la loi d'aliénation du domaine fédéral pour se procurer de la terre promptement et à bon marché. Aux États-Unis, tout étranger libre peut être naturalisé à l'âge de vingt et un ans. Deux années après la déclaration qu'il est tenu de faire à cet effet, s'il s'est écoulé cinq années depuis son arrivée aux États-Unis, l'étranger peut obtenir la qualité de citoyen. La présidence de l'Union est le seul emploi dont la constitution américaine écarte l'étranger naturalisé. Cette législation libérale qui assure aux émigrants d'Europe des avantages politiques supérieurs à ceux dont ils jouissaient dans leur patrie, a dû naturellement agir comme une prime donnée à l'immigration. Aussi est-elle devenue un sujet permanent de contestations entre les partis politiques de l'Union. Les whigs, qui redoutent les éléments d'agitation que contiennent les masses flottantes de l'émigration , ont voulu soumettre la naturalisation à des conditions plus restrictives, et ils ont trouvé, depuis quelques années, un certain nombre d'auxiliaires dans les bas-fonds de la démocratie américaine. Un parti dit des natifs s'est constitué au sein des classes inférieures pour repousser les étrangers, en vue de protéger le travail national. Rien de plus étroit et de moins libéral que ce but hautement avoué du parti des natifs. Il faut convenir cependant qu'on prouverait plus efficacement le travail national en prohibant à l'entrée les travailleurs étrangers, qu'on ne le fait en interdisant les produits du dehors : on diminuerait, par ce procédé, la concurrence des bras, et on ferait hausser les salaires, au moins d'une manière momentanée, tandis qu'en prohibant les produits étrangers, on fait simplement hausser les objets de consommation, au grand dommage des travailleurs nationaux.
Heureusement les whigs et les natifs n'ont pu réussir jusqu'à présent à faire révoquer la loi hospitalière qui confère à l'étranger les droits du citoyen américain. La loi d'aliénation du domaine fédéral s'ajoute à celle-là pour attirer les étrangers aux États-Unis. Il serait trop long de rapporter ici les dispositions de cette loi. Qu'il nous suffise de dire que l'émigrant qui se dirige vers l'ouest peut être mis, sans frais ni retard, en possession d'un domaine, qu'il choisit souvent, lui-même, au prix de 50 piastres (fr. 266,50), la portion de 40 acres.
« Le lendemain de son débarquement, dit M. Vanderstraten Ponthoz, il peut recevoir le titre d'une position assurée dans l'industrie agricole du pays, tandis que la loi de naturalisation lui prépare la jouissance des droits de citoyen. » [91]
La seule charge que les émigrants aient à supporter, en touchant le sol de l'Union, consiste en une capitation destinée à subvenir aux frais d'entretien des émigrants pauvres. Le maire de New-York a le droit d'exiger des capitaines de navires une caution pour l'entretien des émigrants pendant deux années; mais la loi permet aux capitaines de se dispenser de fournir cette caution, en payant une taxe dont le minimum est d'une piastre et le maximum de dix piastres par tête. A Philadelphie, la capitation imposée aux émigrants est de deux piastres et demie. A Baltimore, la taxe est d'une piastre et demie ; le produit en est partagé entre les sociétés allemandes et irlandaises pour la protection des émigrants et la maison de charité pour les malades et indigents. A la Nouvelle-Orléans, les émigrants payent une piastre et demie par tête pour soutenir les hôpitaux, et un quart de piastre au maire de la ville. [92]
A leur arrivée aux États-Unis, les émigrants se partagent en deux catégories. Ceux qui sont pourvus de l'aptitude et des capitaux nécessaires pour fonder un établissement agricole se dirigent vers l'ouest, où les chemins de fer et les canaux les transportent à très bas prix. Les autres séjournent dans les États de l'Est, soit pour s'y fixer, soit pour accumuler les capitaux nécessaires à leur établissement dans l'ouest. Souvent ces traînards de l'émigration vont grossir la masse flottante du paupérisme des grandes villes. Les grands entrepôts intérieurs de l'émigration aux États-Unis sont les villes de Buffalo, de Cleveland, de Toledo, de Détroit, de Green-Bay, de Milwaukee, de Chicago; et, dans une autre direction, de Pittsburg, de Cincinnati et de Saint-Louis. De là les émigrants se répandent dans l'ouest. Il y a différents systèmes d'établissement. Les émigrants se réunissent en associations, eu agglomérations, ou demeurent à l'état d'isolement. La plupart des systèmes communistes ou socialistes ont été expérimentés par eux, mais sans qu'on puisse citer un seul succès décisif et, le plus souvent, avec perte. Les établissements isolés ou [679] par agglomérations sont les plus nombreux. Ce dernier mode d'établissement est choisi de préférence les Allemands et par les émigrants qui ne connaissent pas assez la langue anglaise pour s’adjoindre aux noyaux déjà formés de la population américaine.
« Lorsqu'un habitant du continent de l'Europe, dit l'auteur que nous avons déjà cité, veut émigrer aux États-Unis, s'il appartient a une nation dont les émigrants ont formé des établissements en Amérique, il doit se diriger vers ces points. S'il prend l'initiative de l'entreprise, il lui faut des compagnons pour partir d'Europe, et un emplacement salubre et fertile, déterminé d'avance, pour s'établir aux États-Unis. Les colons doivent y rester voisins les uns des autres, comme ils étaient dans le village natal, entre l'église et l'école. Alors l'émigration devient un simple déplacement, et elle cesse d'être comme autrefois un temps d'épreuve pour toute l'organisation morale. — Les Allemands, ajoute M. Vanderstraten, émigrent généralement de cette manière. Les émigrants s'unissent en parti avant de s'embarquer. Ils décident en quel lieu se fera l'établissement. Les lettres de ceux qui les ont précédés ou l'avis des compatriotes qu'ils rencontrent en débarquant et des sociétés de protection servent à les éclairer. Le parti s'arrête ensuite dans une de ces villes de l'intérieur qui servent d'entrepôts aux émigrants. Les plus expérimentés s'en vont reconnaître l'emplacement désigné, et, s'il paraît favorable , l'achètent au bureau terrien ; car les Allemands croient que les terres fédérales doivent être préférées aux autres, parce que le titre présente plus de garantie. Les terres achetées se répartissent en proportion du capital de chaque émigrant. C'est le premier avantage de l'agglomération. Le domaine fédéral ne se vend point par fraction moindre de 40 acres au prix de 50 piastres. Beaucoup d'émigrants ne possèdent pas cette somme à la fin du voyage, et cette étendue de terre ne leur est pas indispensable pour s'établir. » [93]
Ce système d'agglomérations, qui a reçu le nom de système allemand, a été adopté aussi par les Norvégiens qui ont émigré, en assez grand nombre, aux États-Unis depuis 1839.
On n'a pas de données précises sur la quantité de capital que les émigrants emportent avec eux. Des documents statistiques publiés à New-York établissent que les émigrants débarqués dans ce port, depuis 1831 jusqu'à 1842 inclusivement, ont importé aux États-Unis pour une somme de 115 millions de francs. D'autres documents officiels constatent que, depuis 1835 jusqu'à 1839, 18,937 Bavarois se sont établis dans l'Union américaine, avec un capital évalué à 15 millions de francs. Cette évaluation est basée sur les déclarations que le gouvernement bavarois exige des émigrants pour leur imposer une taxe. [94] Parfois le capital employé à l'émigration vient des États-Unis mêmes. Un grand nombre d'Irlandais, par exemple, ont émigré au moyen des avances qui leur étaient faites par leurs parents ou leurs amis déjà établis dans l'Union.
On ne possède pas non plus de données bien précises sur le nombre d'hommes que l'émigration enlève, chaque année, à l'Europe. Les relevés de l'émigration n'ont été dressés avec régularité que dans le royaume-uni. Ces relevés présentent, depuis trente ans, une progression continue. Le nombre des émigrants du royaume-uni a été en :
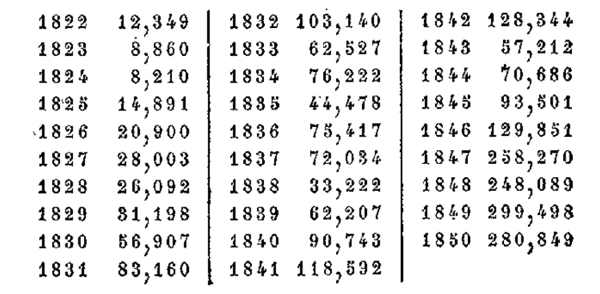
Ainsi que l’a constaté un statisticien distingué, M. J.-T. Danson, les fluctuations qui se remarquent dans ce tableau sont les conséquences immédiates de l'état de prospérité ou de dépression de l'industrie et du commerce de la métropole ; ainsi les années de forte émigration suivent régulièrement celles où les exportations ont été faibles, où le travail a été déprimé. [95] A partir de 1847, l'émigration du royaume-uni a doublé. C'est à la misère et à la famine d'Irlande qu'il faut attribuer principalement cette énorme et soudaine augmentation : dans la période de 1841 à 1851, l'émigration n'a pas enlevé, en effet, moins de 1 million 300 mille habitants à l'Irlande. [96] En ajoutant au contingent du royaume-uni environ 100 mille Allemands, plus un nombre sans cesse croissant d'émigrants norwégiens, belges, basques, portugais, maltais, on aura une exportation moyenne d'environ un demi-million d'hommes pour chacune des dernières années. C'est un déplacement d'hommes beaucoup plus considérable, sans aucun doute, que celui des grandes invasions barbares. La famine d'Irlande, les événements politiques de 1848, la découverte des mines d'or de la Californie ont grossi, à la vérité, d'une manière exceptionnelle, le nombre des émigrants ; mais la facilité sans cesse croissante des communications, la puissance naturelle d'attraction des sociétés en voie de formation sur les terres libres du nouveau monde, sans parler du mauvais régime politique et économique de la plupart des États de l'Europe, ne peuvent manquer de maintenir pendant longtemps encore, à un niveau élevé, le courant de l'émigration transatlantique.
§ 2. Les émigrations intertropicales.
Outre la grande émigration qui abandonne les rivages de l'Europe pour se diriger vers les régions tempérées du nouveau monde et de l'Australie, une autre émigration a commencé à porter les populations surabondantes de l'Inde et de la Chine vers les régions intertropicales de l'archipel des Indes et de l'Amérique. Ce déplacement des populations asiatiques a été provoqué principalement par l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques. [680] A la suite de l'émancipation, les bras manquèrent dans ces colonies, et le salaire haussa considérablement. (Voyez Esclavage. ) Menacés d'une ruine imminente par l'exagération du prix, du travail, les colons envoyèrent des agents d'émigration en Europe, en Afrique, aux Indes orientales et jusqu'en Chine. Les Indes occidentales et la Guyane reçurent des émigrants portugais, maltais, des noirs de Sierra Leone, et principalement des coulis de l'Inde plus laborieux que les nègres et plus propres que les Européens à la culture de la canne. En treize ans (de 1834 à 1846), le nombre de ces émigrants à la Jamaïque, à la Trinité et dans la Guyane anglaise atteignit 60 mille. Mais ce fut surtout vers l'île Maurice que se dirigea l'émigration des travailleurs de l'Inde. L'émancipation des 68 mille esclaves de cette colonie ayant occasionné un déficit considérable dans le travail des plantations, des spéculateurs imaginèrent de combler ce déficit au moyen d'une importation des coulis indous. Ils engagèrent au Bengale, où les salaires ordinaires ne dépassaient par 8 ou 10 centimes par jour, des travailleurs agricoles pour un temps déterminé, et cédèrent leurs contrats aux planteurs mauriciens, ainsi que cela se pratiquait naguère en Europe. De 1837 à 1839 on introduisit de la sorte 25,468 coulis , dont 24,566 du sexe masculin, à l'île Maurice. Mais cette émigration improvisée donna lieu aux plus graves abus. Les entrepreneurs d'émigration envoyaient leurs agents dans les bourgs les plus misérables du Bengale, où ces recruteurs de bas étage séduisaient les coulis par des promesses aussi merveilleuses que mensongères. Les engagés étaient amenés à Calcutta, où on les séquestrait dans un entrepôt jusqu'à ce que les navires qui devaient les recevoir fussent prêts à partir. On les entassait dans des navires à peu près comme des nègres de traite, sans observer aucune précaution hygiénique. En outre, il était rare que les avances de salaires, stipulées dans les contrats, fussent remises fidèlement aux engagés. Les agents subalternes en retenaient frauduleusement la meilleure part. A l'île Maurice, les coulis étaient envoyés aux champs avant d'avoir eu le temps de se remettre des fatigues du voyage, et les planteurs, abusant de leur ignorance et de leur isolement, les surchargeaient de travail, tout en diminuant abusivement leurs rations. Au lieu de travailler à détruire ces abus et d'assurer aux coulis la protection qui leur était due, le gouvernement anglais trouva plus simple de prohiber l'immigration à l'île Maurice. Cependant, sur les plaintes énergiques des intéressés, il fut obligé de lever la prohibition en 1843. L'immigration recommença aussitôt, et de 1843 jusqu'à la fin 1848 elle s'éleva à environ 75 mille individus. Grâce à cette importation considérable de travail, l'île Maurice put traverser sans grands désastres la crise de l'abolition de l'esclavage.
Malheureusement, des abus de toute sorte n'ont pas cessé de signaler ce mouvement d'émigration et d'en corrompre les résultats. En premier lieu, le gouvernement anglais et les conseils des colonies ont eu le tort d'intervenir dans cette grande opération et d'en faire supporter principalement les frais à une classe d'hommes qui aurait dû plus qu'aucune autre en être affranchie, nous voulons parler des travailleurs mêmes des colonies, à qui les émigrants allaient faire concurrence. Les frais de l'émigration aux Indes occidentales et à la Guyane anglaise de 1837 à 1848 se sont élevés à 702,857 livres sterlings qui ont été mis à la charge des budgets de ces colonies. A l'île Maurice, les frais d'émigration de 1834 à 1844 ont atteint le chiffre de 704,652 liv. sterl., dans lequel se trouve comprise une avance de 324,652 liv. sterl. faite par le gouvernement et remboursable par les colons. Bien de plus inique assurément que d'obliger ainsi les classes laborieuses des colonies à payer la grosse part des frais d'une importation de travail destinée à abaisser leurs salaires. En second lieu, les colonies se sont crues, en quelque sorte, propriétaires des hommes dont elles payaient les frais d'émigration et elles les ont assujettis aux règlements les plus oppressifs.
« Quoique les émigrants soient importés aux frais de tous, lisons-nous dans un rapport annuel de la société pour l'abolition de l'esclavage, en fait, personne, à l'exception des planteurs, ne peut profiter de leur travail. Les émigrants ne sont pas libres de choisir le travail et les employeurs qui leur conviennent, à moins qu'ils ne consentent à payer une capitation de 5 schellings par mois, payables d'avance, depuis le jour de leur arrivée jusqu'à ce qu'ils aient achevé ce qu'on appelle « les cinq années de résidence industrielle, » ou, en d'autres termes, à moins qu'ils n'aient travaillé pour un planteur pendant cette période. Ils ne peuvent retourner chez eux sous aucun prêtexte, même à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la période de cinq années, à moins qu'ils n'acquittent un droit de 2 liv. sterl. pour chacune des années qui restent à courir et qu'ils n'obtiennent un passeport spécial, dont le coût est encore assez élevé. Ceux qui travaillent pour les planteurs sont recensés chaque année. Lorsqu'ils abandonnent la plantation, ils sont immédiatement assujettis à la capitation et ils doivent payer en sus une partie des taxes prélevées sur les recensés. Enfin, ils sont soumis à des amendes pour les jours d'absence. Le tout est renforcé de l'emprisonnement avec travail obligatoire, à raison d'une journée pour chaque demi schelling dû par l'émigrant. Cette ingénieuse combinaison de la capitation, des passeports, du recensement, des amendes et de l'emprisonnement avec travail forcé a été imaginée pour le plus grand avantage des planteurs et à l'extrême préjudice de la liberté et du bien-être des malheureux émigrants. » [97]
Ce n'est pas tout. Les administrations coloniales, dans la vue d'économiser sur les frais d'émigration, n'importent en général que des travailleurs du sexe masculin : à l'île Maurice on s'est assuré en 1847 que la proportion des sexes de la population importée de l'Inde était de 87 hommes sur 13 femmes seulement. Cette énorme disproportion des sexes n'a pas manque d'engendrer une révoltante immoralité. Enfin, les émigrants, attirés par l'appât de l'apparente gratuité du transport, ne se trouvent pas toujours dans les conditions nécessaires d'acclimatement. Ainsi, nous voyons figurer parmi les [681] émigrants attires aux Indes occidentales et à !a Guyane anglaise de 1846 à 1848, 14,881 habitants de L’île de Madère, sur lesquels 6,668 sont morts, emportés par la fièvre jaune ou par d'autres maladies. Ces faits déplorables ont motivé, à diverses reprise», les réclamations énergiques de la société pour l'abolition de l'esclavage; [98] et il faut espérer que l'opinion publique, enfin édifiée, finira par exiger l'abolition du système d'intervention et de primes qui les a occasionnés.
Outre les coulis, on importe encore régulièrement aux Indes occidentales, à la Guyane anglaise et à L’île Maurice, des nègres libérés de la côte d'Afrique et des Chinois. L'importation des Chinois a été autorisée et subventionnée par lord Stanley en 1843 : une prime de 65 dollars a été accordée pour chaque individu mâle ou femelle, et la moitié pour les enfants au-dessous de quatorze ans. Moyennant, cette prime, quelques milliers de Chinois ont été importés aux Indes occidentales et à l’île Maurice. Dans cette dernière île, leur activité laborieuse, leur âpreté au gain et leur sobriété exemplaire ont provoqué de nombreuses doléances de la part de la population indolente des créoles :
« II est impossible à des Européens ou à des créoles, disait un des journaux de l’île, de soutenir la concurrence de pareilles gens; ils poussent l'économie jusqu'à l'avarice et la frugalité jusqu'à la parcimonie. Ils ne boivent jamais que de l'eau; un peu de riz et de viande salée, qu'ils font cuire eux-mêmes, leur suffît; ils lavent eux-mêmes leur linge et n'en changent que deux ou trois fois par an. C'est le devoir de tout gouvernement de protéger ses sujets et de veiller à leur bonheur; d'où suit l'obligation de prendre des mesures fermes et énergiques pour faire cesser un abus aussi révoltant que celui qui met ses propres citoyens à la merci d'intrus qui viennent sous le prétexte d'aider aux travaux de l'agriculture, puis se font congédier par leur insubordination et leur inconduite, et enfin nous disputent pouce par pouce la terre qu'ils devaient cultiver, envahissent tous nos biens et finiront, si on ne les arrête, par nous chasser de notre patrie. » [99]
Heureusement ces plaintes, qui rappellent celles des natifs de l'Union américaine contre l'émigration européenne, n'ont pas été écoutées, et l’île Maurice a continué de recevoir des émigrants chinois. L'émigration chinoise a pénétré aussi à l'île Bourbon. — Cette émigration peut recevoir un développement immense, car la Chine est un inépuisable foyer de population , et les Chinois s'acclimatent parfaitement dans les régions intertropicales. Déjà, malgré la défense d'émigrer qui est faite aux sujets du céleste empire, mais qui n'est, à la vérité, rigoureusement maintenue que pour les individus du sexe féminin, l'émigration chinoise a rempli les îles de Java, de Sumatra et la presqu'île de Malacca. Singapour est, en grande partie, peuplée de Chinois. Enfin, chose digne d'attention, les Chinois ont traversé l'océan Pacifique, attirés par le récit des merveilles de la Californie, et leurs essaims laborieux commencent à se multiplier sur la terre de l'or. Qui sait si l'émigration de cette race industrieuse ne donnera pas, prochainement, une solution pacifique au problème de l'abolition de l'esclavage, en permettant aux planteurs des Etats du Sud de substituer un travail libre à bon marché au travail esclave?
L'émigration des coulis de l'Inde ne s'est pas bornée non plus à l’île Maurice et aux Indes occidentales; elle s'est portée encore dans l'île de Ceylan, où l'appelaient l'abolition de l'esclavage et un développement extraordinaire de la culture du caféier. Cette extension d'une branche importante de la production tropicale était due au principe bienfaisant de la liberté du commerce. Jusqu'en 1835 le café des Indes occidentales avait été protégé aux dépens de celui des Indes orientales, sur le marché anglais : l'un payait 6 deniers et l'autre 9 deniers par livre. En 1835, les deux droits furent égalisés à la limite inférieure. En 1842 on abaissa la limite à 4 deniers. Sous l'empire du nouveau tarif, la culture du caféier prit un accroissement énorme à Ceylan. De 2,824,998 livres, en 1832, l'importation du café de Ceylan dans le royaume-uni s'éleva à 30,521,810 livres en 1848. Les travailleurs indigènes ne purent suffire à ce développement des cultures. On appela à leur aide les travailleurs de l'Inde. De 1839 à 1846, 220 mille coulis passèrent à Ceylan, où les deux tiers environ s'établirent d'une manière définitive.
Cette substitution des travailleurs libres aux travailleurs esclaves dans les régions intertropicales a une immense importance économique et morale ; on pourra en apprécier encore mieux la portée, lorsque l'émigration libre de l'Asie et de l'Afrique échappera au régime artificiel d'intervention gouvernementale qui entrave aujourd'hui son essor naturel en prétendant l'encourager.
IV. PORTÉE ET CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE L'ÉMIGRATION.
Le désir d'augmenter leur bien-être et le besoin de se soustraire à l'oppression, voilà quels ont été, de tout temps, les mobiles qui ont poussé les hommes à émigrer. Des obstacles naturels et artificiels ont, de tout temps aussi, combattu et parfois neutralisé l'action de ces mobiles. Au premier rang des obstacles naturels, il faut placer la difficulté des communications et le sentiment d'affection qui attache l'homme à la terre où il est né. Mais ces obstacles s'aplanissent, à leur tour, sous l'influence de la civilisation. Le progrès des arts industriels, en occasionnant une révolution soudaine et prestigieuse dans la locomotion, a rendu faciles des déplacements d'hommes et de capitaux qui semblaient naguère impraticables. Quant au sentiment de l'amour de la patrie, la civilisation a pour résultat de le rendre à la fois moins intense et plus étendu. A mesure que la civilisation gagne du terrain, à mesure que ses acquisitions matérielles et morales se propagent, on voit, en effet, s'établir parmi les hommes une certaine communauté de sentiments, d'idées et d'habitudes. L'homme civilisé cesse d'être un étranger pour l'homme civilisé, et la patrie, d'abord restreinte aux limites d'un village, aux [682] murailles d'une cité, s'agrandit jusqu'à celles de la civilisation même.
En même temps on voit s'aplanir les obstacles artificiels que rencontrait jadis le déplacement des hommes. L'esclavage qui rendait impossibles les émigrations volontaires, le servage qui immobilisait l'homme sur le sol, disparaissent peu à peu. Les inimitiés de cité à cité, de nation à nation s'effacent de même, et avec elles tombent ou s'abaissent les barrières qui ont pendant si longtemps entravé la circulation des hommes et des choses. Dans l'antiquité, l'étranger était universellement considéré comme un ennemi, et l'on suscitait mille obstacles à son établissement dans la cité. On laissait perpétuellement suspendue sur sa tête la menace de l'expulsion, et, à sa mort, on confisquait ses biens au profit de l'État. Bien que nos lois sur les étrangers aient conservé un reflet des préjugés des temps barbares, bien que l'acquisition des droits de citoyen soit encore assujettie à des restrictions nombreuses dans la plupart des pays civilisés, la situation d'un homme expatrié est aujourd'hui infiniment supérieure à ce qu'elle était autrefois. Sa vie et ses propriétés sont protégées avec autant de sollicitude que celles des citoyens eux-mêmes, et le plus grand nombre des professions lui sont ouvertes. Il n'est plus considéré comme un ennemi, mais comme un auxiliaire. Quelquefois, sans doute, on voit reparaître, sous l'influence d'une passion ou d'un intérêt égoïste, les vieux préjugés hostiles aux étrangers. C'est ainsi que la question de l'exclusion des travailleurs étrangers a été agitée dans l'Union américaine et à L’île Maurice (Voir plus haut); c'est ainsi qu'elle a été soulevée en France à une époque récente. Au mois de mars 1848, les masses victorieuses prétendirent utiliser leur victoire en excluant du marché, national les travailleurs étrangers. Un certain nombre d'Anglais, de Belges, d'Allemands, de Savoisiens furent alors obligés de quitter le pays. Mais cette application nouvelle du régime prohibitif disparut heureusement avec l'ébullition populaire qui l'avait provoquée. Si les classes vivant de salaires réussissaient de nouveau à faire prédominer leur influence, peut-être l'exclusion des travailleurs étrangers serait-elle remise encore à l'ordre du jour, et, répétons-le, cette prohibition nouvelle ne serait ni plus absurde ni plus inique que les prohibitions existantes; mais il y a peu d'apparence que les classes inférieures soient, de sitôt, appelées à exercer une influence prépondérante sur la direction des affaires de la société. D'ailleurs, n'est-il pas permis d'espérer qu'elles finiront, à leur tour, par comprendre qu'il est équitable et utile de laisser circuler librement le travail aussi bien que les autres denrées?
Ainsi donc les barrières naturelles et artificielles qui arrêtaient naguère le déplacement des hommes, s'abaissent de toutes parts. D'un autre côté, les nécessités ou les excitations qui poussent les hommes à se déplacer vont sans cesse en se multipliant. Toute industrie qui passe du petit atelier dans la grande manufacture choisit de nouveaux emplacements, mieux appropriés à ses conditions actuelles, et elle rassemble dans une seule localité des travailleurs auparavant disséminés dans vingt localités différentes. Tout progrès, en substituant à l'action de la force de l'homme celle d'une puissance mécanique, oblige encore un certain nombre de travailleurs à se déplacer. Enfin, les inégalités de situation des classes laborieuses, dans les différentes parties du grand atelier du monde, inégalités que le développement des communications fait mieux connaître chaque jour, provoquent activement le» travailleurs à émigrer.
Sous l'influence de ces causes, les émigrations ont acquis de nos jours une importance considérable, et, selon toute apparence, elles prendront des proportions de plus en plus vastes. Il faut s'en réjouir plutôt que s'en affliger, car ces grands déplacements d'hommes ont pour résultat définitif de mieux répartir les forces productives des sociétés, en désobstruant les parties de l'arène industrielle où le travail surabonde pour approvisionner celles où les bras et les intelligences sont rares. Cependant, si le mouvement croissant de la circulation des hommes apparaît comme une cause de progrès, il n'en est pas moins essentiel que ce mouvement demeure abandonné à lui-même ; il est essentiel que l'émigration demeure entièrement en dehors de l'action gouvernementale. On a vu quels ont été les résultats déplorables de l'intervention du gouvernement anglais et des législateurs des colonies dans les émigrations intertropicales, à quels abus et à quelles iniquités cette intervention a donné naissance. Que l'on essaie de se figurer ce qui serait arrivé si le gouvernement anglais avait voulu intervenir aussi, d'une manière active, dans l'émigration irlandaise; s'il avait entrepris de diriger et de subventionner l'émigration des 1,300 mille Irlandais qui ont passé aux États-Unis dans les dix dernières années. Quelles sommes énormes une semblable opération n'eût-elle pas englouties ! quels désastres n'eût-elle pas occasionnés! Le gouvernement aurait-il-pu, en effet, remplacer par ses informations et ses secours généraux les milliers d'informations et de secours particuliers que les Irlandais déjà expatriés faisaient passer à leurs compatriotes? aurait-il pu répartir les émigrants sur le territoire des États-Unis aussi utilement qu'ils se sont répartis eux-mêmes? enfin, l'Union américaine, qui a accueilli les détachements successifs de l'émigration irlandaise, aurait-elle consenti à les recevoir s'ils lui avaient été expédiés par le gouvernement anglais? n'aurait-elle pas refusé de devenir l'exutoire officiel du paupérisme britannique?
En résumé, les gouvernements ne sont pas plus aptes à diriger les émigrations et plus fondés à les subventionner, que n'importe quelle autre espèce d'entreprises agricoles, industrielles et commerciales. Sans doute, les émigrants abandonnés à eux-mêmes font des écoles nombreuses et déplorables : des milliers périssent pour s'être dirigés vers des contrées où ils ne peuvent s'acclimater, ou pour n'avoir pas suffisamment tenu compte des difficultés qu'ils avaient à surmonter; d'autres, mal informés de la situation du marché de travail dans les pays étrangers, aggravent en se déplaçant leur condition qu'ils ont voulu améliorer; mais ces écoles sont inévitables dans toutes les entreprises, et elles ont leur utilité finale, en [683] ce qu'elles signalent les écueils qu'il faut éviter et la route qu'il faut suivre.
G. de Molinari.
Endnotes to Émigration
[88] Statistique de l'industrie à Paris, résultant de l'enquête faite par la chambre de commerce pour les années 1847 et 1848, p. 61.
[89] Mémoire sur l'état de l'agriculture, de l'industrie et du commerce des protestants en France au dix-septième siècle, et sur l'émigration protestante après l’édit de Nantes, par M. Ch. Weiss.
[90] Recherches sur la situation des émigrants aux États-Unis de l'Amérique du Nord, par le baron Vanderstraten Ponthoz, premier secrétaire de la légation de Belgique à Washington.
[91] Vanderstraten Ponthoz, I, p. 29.
[92] Idem, p. 40.
[93] Vanderstraten Ponthoz, p. 110 et 146.
[94] Idem, p. 47.
[95] Voir à ce sujet un tableau dressé par M. Danson dans l’Annuaire de l'Economie politique pour 1850, p. 410, et une note insérée dans le Journal des Economistes, t. XXIX, p. 204.
[96] Economist, p. 410. Reproduit dans le Journal des , Économistes, t.. XXIX, p. 46.
[97] The tenth annual report of the british and foreign anti-slavery society. 1849, p. 84.
[98] Voyez les rapports annuels de la société pour l'abolition de l'esclavage, et notamment un Mémoire contre l'émigration des Kroomen de la côte d'Afrique, signé par M. John Scoble, secrétaire de la société, dans le 10e rapport (1849).
[99] Mauritius Watchman, cité par la Revue coloniale, février 1844.
Esclavage↩
Source
"Esclavage", DEP, T. 1, pp. 712-31.
[712]
I. Origine.
L'esclavage s'est établi dans le monde lorsque les arts de la production ont été assez développés pour fournir aux hommes au delà de ce qui leur était strictement nécessaire pour subsister. Lorsqu'il n'y avait pas d'excédant ou lorsque l'excédant était très faible, l'esclavage ne pouvait s'établir, personne n'ayant intérêt à posséder des esclaves; il n'est devenu possible qu'au moment où certains hommes ont pu trouver avantage à s'approprier le travail de leurs semblables, en leur donnant en échange un minimum de subsistance. Mais du moment qu'il est devenu profitable, il a dû nécessairement s'établir. Sans doute les hommes qui eurent les premiers l'idée de s'emparer de leurs semblables et de les asservir pour s'attribuer une portion du produit de leur travail, ces hommes commirent une spoliation, un vol, ils portèrent une atteinte manifeste et injustifiable à la propriété d'autrui. Malheureusement l'histoire atteste que le respect de la propriété et l'observation de la justice ne se sont introduits qu'avec une extrême lenteur au sein des sociétés humaines; l'histoire atteste qu'il n'est aucune œuvre de spoliation et d'iniquité qui n'ait été commise lorsque des hommes ont cru trouver profit à la commettre.
L'esclavage, cette violation inique du droit de propriété de l'homme sur lui-même, s'est donc établi dans le monde aussitôt qu'il est devenu profitable. Mais comme il ne l'est pas devenu également en tous lieux et à toutes les époques, il n'a été ni uniforme ni universel. Dès la plus haute antiquité il apparaît dans les régions méridionales du globe et il y sert de base aux sociétés. A mesure, au contraire, que l'on s'avance vers le Nord, il perd de son importance, et s'il apparaît encore c'est sous une forme mitigée, adoucie. D'où provient cette différence? Elle provient de ce que le travail de l'esclave pouvait dès l'origine rapporter beaucoup plus dans le Midi que dans le Nord. Cette inégalité s'explique, en premier lieu, par ce fait que les terres des régions septentrionales sont généralement moins fécondes; en second lieu, par cet autre fait que le minimum nécessaire à l'esclave est plus élevé dans le Nord que dans le Midi; il faut à l'esclave des pays septentrionaux plus d'aliments et de vêtements, un meilleur abri, à cause des circonstances naturelles du climat, ce qui diminue d'autant les bénéfices du propriétaire. Enfin les races du Nord, généralement plus vigoureuses, sont plus difficiles à soumettre et elles supportent plus impatiemment le joug. Les esclaves rapportent moins dans le Nord et l'on a plus de peine à les maintenir en servitude.
On s'explique ainsi pourquoi l'esclavage a été un fait exceptionnel dans la Germanie et dans les autres régions du Nord à une époque où il était devenu un fait général dans le bassin de la Méditerranée et dans les autres régions du Midi.
II. L'Esclavage dans l'antiquité.
Examinons maintenant de quelle manière l'esclavage s'est établi dans les sociétés anciennes, comment il s'y alimentait, quelle place il y occupait et sous l'influence de quelles causes il s'est successivement transformé pour finir par disparaître, en grande partie, du monde civilisé.
L'esclavage ne s'est pas établi de la même manière dans tous les États de l'antiquité. Le plus souvent il a eu pour origine la superposition violente d'une race à une autre. Tel fut le cas dans les principaux États de la Grèce : les Ilotes dans la Laconie, les Pœnestes dans la Thessalie, pour ne citer que ceux-là, étaient des peuples autochthones que la conquête avait réduits en servitude. II en était autrement en Italie ou du moins dans le Latium. A l'origine les Romains n'eurent point d'esclaves. Au témoignage de Varron, cinq ou six cents ans après la fondation de Borne, la culture était encore exercée en grande partie par des propriétaires et par des journaliers libres. Mais, à dater de cette époque, la guerre et le commerce firent affluer les esclaves en Italie. Les armées romaines emmenaient en captivité des populations entières et elles ne faisaient aucun échange de prisonniers. Charles Comte expose très judicieusement la raison de ce dernier fait :
« Chez les Romains, dit-il, depuis le commencement jusqu'à la fin de la république, l'aristocratie tendit sans cesse à substituer aux hommes libres qui cultivaient les arts un peuple dont elle eût la propriété ; elle se fit une maxime de ne jamais faire d'échange de prisonniers. Dans l'alternative de laisser dans l'esclavage ceux des soldats romains qui n'avaient pas le moyen de se racheter ou de vendre les soldats étrangers dont elle avait fait [713] des esclaves, elle prenait le parti qu'elle trouvait le plus lucratif. La restitution qu'elle aurait obtenue d'une armée prise sur elle n'aurait profité qu'aux classes pauvres d'où sortaient les soldats, la restitution qu'elle aurait faite elle-même d'une armée étrangère l'aurait privée d'une multitude d'esclaves.
« Parmi les causes nombreuses qui déterminaient l'aristocratie romaine à faire la guerre, il en est une qu'on n'a pas remarquée : le peuple en supportait les frais, les grands en retiraient les bénéfices. Les grands qui, pour prendre les habitants d'une ville industrieuse et les transformer en esclaves, perdaient un certain nombre de soldats , ne voyaient dans cette opération qu'une bonne affaire. C'était un échange dans lequel tout était gain pour l'aristocratie ; à ses yeux un bon esclave valait mieux que deux prolétaires romains. Les dangers même les plus graves ne suffisaient pas pour la déterminer à perdre de vue ce qu'elle considérait comme son intérêt. Annibal ayant fait sur les armées romaines un grand nombre de prisonniers, proposa de les échanger contre ceux qu'on avait fait sur lui. Les patriciens ne voulurent pas consentir à l'échange; mais ils achetèrent huit mille esclaves et les incorporèrent dans leur armée sans leur donner la liberté. Par ce moyen ils conservèrent les soldats carthaginois dont ils avaient fait des esclaves, et se réservèrent la faculté de reprendre la possession de ceux au moyen desquels ils avaient remplacé les soldats tombés dans les mains de l'ennemi.
« Cette politique d'abandonner les soldats romains, soit pour n'avoir pas à en payer la rançon, soit pour ne pas rendre les prisonniers dont on avait fait des esclaves, ne compromettait en rien la liberté des membres de l'aristocratie. Si quelqu'un d'entre eux tombait dans les mains de l'ennemi, et s'il n'était pas assez riche pour se racheter, ses clients étaient tenus de se cotiser pour le tirer de servitude. Les plébéiens, que personne ne rachetait quand ils avaient le malheur d'être fait prisonniers, étaient en effet dans l'obligation de racheter les membres de l'aristocratie . » [100]
A mesure que les conquêtes de Rome s'étendirent, on vit donc diminuer en Italie le nombre des hommes libres et s'augmenter celui des esclaves. L'esclavage se recrutait encore à Rome de différentes manières. Tous les enfants trouvés étaient réduits en esclavage. Des enfants devenaient esclaves s'ils étaient vendus par leurs pères; des débiteurs, s'ils ne pouvaient pourvoir à leurs engagements envers leurs créanciers. Un père pouvait vendre ses enfants quoiqu'ils fussent mariés ; il pouvait vendre aussi ses petits-enfants. La vente d'un citoyen par un autre, dit encore Charles Comte, fut d'abord déclarée illégale ; mais comme il arriva que des individus se laissèrent vendre pour réclamer leur liberté après avoir profité du prix pour lequel ils avaient été vendus, et comme ces ventes frauduleuses nuisaient au commerce de la république, on finit par les déclarer valables. Les hommes condamnés pour crimes étaient quelquefois réduits en servitude et devenaient une propriété publique ; enfin tout enfant né d'une femme esclave était esclave. [101] Le commerce contribuait encore, pour une forte part, à alimenter l’esclavage. Les pays qui fournirent principalement d'esclaves la Grèce et Rome, jusqu'à la conquête des Gaules par Jules César, furent la Thrace, la Scythie, la Dacie, la Gétie, la Phrygie, le Pont, en un mot le sud de l’Europe occidentale et une partie de l'Asie mineure. Les principaux marchés d'esclaves étaient, pour le Nord, l’emporium de Tanaïs, situé à l'embouchure de ce fleuve ; pour l'Asie mineure, Éphèse et Sidé; pour la Grèce, Samos, Athènes et Délos. [102] On se procurait des hommes à bon marché dans le Nord et on les revendait cher dans le Midi, où leur travail donnait un excédant plus considérable.
La condition des esclaves dans l'antiquité a été maintes fois décrite. On sait que ces parias du monde païen étaient traités comme de véritables bêtes de somme et que leur vie se trouvait à l'entière discrétion de leurs maîtres. Ce fut seulement sous les empereurs que la loi commença à intervenir pour les protéger; mais cette protection n'eut jamais qu'une portée fort limitée; on ne saurait mieux l'assimiler qu'aux règlements qui prohibent de nos jours les mauvais traitements commis sur les animaux. Un maitre qui faisait une convention avec son esclave n'était pas tenu de l'exécuter, car la loi romaine considérait l'esclave comme moins vil encore que nul; non tam vilis quam nullus. D'un autre côté, comme ce genre de bétail pouvait devenir fort dangereux, on punissait des supplices les plus cruels les révoltes d'esclaves. Cependant ces révoltes n'en furent pas moins fréquentes et les guerres serviles compromirent plus d'une fois sérieusement la sécurité de la république.
Les esclaves étaient employés aux fonctions les plus diverses. Le plus grand nombre d'entre eux accomplissaient les travaux inférieurs de la société ; mais quelques-uns, plus intelligents que les autres, avaient des occupations assez relevées. Il y avait des esclaves musiciens, grammairiens, philosophes mêmes qui se vendaient fort cher et qui étaient généralement mieux traités que les esclaves ordinaires. Le travail des esclaves s'exploitait de deux manières : ou le propriétaire l'employait pour son compte, ou bien il le louait.
« A Athènes, dit Boeckh, il n'y avait pas jusqu'au plus pauvre citoyen qui n'eût un esclave pour l'entretien de sa maison. Dans les ménages d'un ordre moyen, on en employait plusieurs à toutes sortes d'occupations; à moudre le blé, à cuire le pain, à faire la cuisine et les habits; pour envoyer au dehors et pour accompagner le maitre ou la maîtresse de la maison qui sortaient rarement seuls. Voulait-on faire de l'étalage, attirer les regards? on en prenait trois avec soi. On voit même des philosophes qui en avaient jusqu'à dix. On louait aussi des esclaves comme mercenaires; ils s'occupaient du bétail et du soin des champs ; ils étaient chargés des travaux des mines, des fonderies, des arts mécaniques et de tous ceux des journaliers : on en occupait des troupes entières [714] dans de nombreux ateliers pour lesquels Athènes était renommée ; un grand nombre était employé sur les vaisseaux marchands et sur les bâtiments de guerre. Sans parler de beaucoup d'exemples de gens qui n'en faisaient travailler que quelques-uns, Timarque en avait 11 ou 12 dans ses ateliers; le père de Démosthénes 52 ou 53, sans les femmes esclaves de sa maison ; Lysias et Polémarque 120. Platon fait la remarque expresse que, chez un homme libre, on rencontrait fréquemment 50 esclaves, et davantage chez, les riches; Philémonide en possédait 300; Hipponique 600; Nicias 1,000, dans les mines seulement. [103]
« D'après la nature de la chose, ajoute le même auteur, leur produit devait être très grand, et comme pour le bétail, rendre à la fois le capital avec les intérêts, si élevés dans les temps anciens, puisque leur valeur diminuait par l'âge, et que la mort pouvait en causer la perte totale. Qu'on y joigne le danger de les perdre par la fuite, surtout vers les troupes en temps de guerre, la nécessité de les poursuivre et de faire annoncer une récompense pour les saisir. L'idée d'un établissement d'assurance contre ces inconvénients vint dans la tête d'un noble macédonien, Antigène de Rhodes, qui, pour une prime de 8 drachmes par tête, entreprit de rendre le prix déclaré par le maître pour l'esclave qui se serait échappé; ce qu'il pouvait faire d'autant plus facilement, qu'il forçait les gouverneurs de représenter ou de payer ceux qui s'enfuyaient dans leurs provinces. Il est impossible de calculer quel intérêt rapportait un esclave. Les 32 ou 33 forgerons ou armuriers de Démosthénes rapportaient annuellement 30 mines et les faiseurs de sièges 12, tous frais faits; or, comme ils valaient les premiers 190 et les seconds 40 mines, ils rapportaient les uns 30 et les autres 15 15/19 pour 100, ce qui fait une différence assez frappante. Le maître, au reste, fournissait les matériaux , et une partie du bénéfice total pourrait être attribué au gain qu'il en retirait. » [104]
Le prix des esclaves était naturellement plus ou moins élevé, selon le nombre que l'on en offrait au marché et selon la demande qui en était faite, il variait encore selon la quantité et la qualité du travail qu'on en pouvait tirer. « Le prix des esclaves, dit encore le savant auteur de l’Économie politique des Athéniens, dépendait de la concurrence et du nombre, mais il variait aussi avec l'âge, la santé, les forces, la beauté, l'intelligence, les talents et les qualités morales. Un esclave, dit Xénophon, vaut bien 2 mines, tandis qu'un autre en vaut à peine 1 1/2, et plusieurs 5 ou 10. Nicias, fils de Nicératus, avait payé jusqu'à un talent celui qui inspectait les travaux des mines. Les soldats romains vendus en Achaïe par Annibal, furent rachetés au taux fixé par les Achéens mêmes, pour la somme de 5 mines. On donnait ordinairement 20 à 30 mines pour les joueuses d'instruments et pour les jeunes filles destinées aux plaisirs de leurs maîtres; c'est ainsi que Neœra fut payée 30 mines. » [105]
La concurrence de ces machines vivantes, que l'on entretenait au moyen d'un minimum de subsistances ne pouvait manquer de devenir funeste aux agriculteurs et aux artisans libres. Le travail de l'homme libre était cependant regardé comme fort supérieur à celui de l'esclave. [106] Mais la guerre décimait les travailleurs des classes inférieures, et d'un autre côté les patriciens, propriétaires d'esclaves, avaient sur eux l'avantage du capital. Ils pouvaient organiser sur une vaste échelle leurs exploitations, agricoles ou industrielles, et contre-balancer ainsi, par la supériorité de leurs capitaux, la supériorité du travail de leurs concurrents. Le résultat de la lutte fut l'expulsion graduelle des hommes libres, du plus grand nombre des branches de la production, et la substitution des grandes exploitations aux petites. La plupart des historiens du temps font mention de cette révolution qui s'opéra successivement au sein de la société romaine, et ils la regardent à bon droit comme funeste.
« Le service militaire, arrachant les hommes libres à l'agriculture, dit notamment Appien, les riches employèrent des esclaves à la culture des terres et à la garde des troupeaux ; ces esclaves mêmes étaient pour eux une propriété des plus fructueuses, à cause de leur multiplication rapide, favorisée par l'exemption du service militaire. Qu'arriva-t-il de là? Les hommes puissants s'enrichirent outre mesure, et les champs se remplirent d'esclaves; la race italienne, usée et appauvrie , périssait sous le poids de la misère, des impôts, de la guerre. Si parfois l'homme libre échappait à ces maux, il se perdait dans l'oisiveté, parce qu'il ne possédait rien en propre dans un territoire tout entier envahi par les riches, et qu'il n'y avait point de travail pour lui sur la terre d’autrui, au milieu d'an si grand nombre d'esclaves. » [107]
Mais tandis que la concurrence inégale des grands ateliers d'esclaves décimait la population libre, des causes diverses agissaient pour transformer l'esclavage.
Si la concurrence des bras esclaves devint funeste aux travailleurs libres, en revanche les nécessités mêmes de cette lutte contribuèrent à améliorer la condition des esclaves. L'expérience apprit aux propriétaires romains que l'esclave, à qui l'on permettait de se former un pécule, et qui entretenait l'espoir de se racheter au moyen de ce pécule, travaillait avec beaucoup plus de zèle et d'ardeur que celui qui n'avait pour stimulant que les coups de bâton; l'intérêt bien entendu des propriétaires, intérêt journellement excité par la lutte qu'ils avaient à soutenir contre les artisans libres, les porta, en conséquence, à accorder à leurs esclaves les facilités nécessaires pour se créer un pécule, au moyen duquel ils pussent se racheter. Cette combinaison leur offrait un double avantage : d'abord l'esclave travaillait plus assidûment et mieux ; ensuite il remboursait, en se rachetant, la plus grande partie des frais qu'il avait coûtés, et il les remboursait communément à une époque où il avait perdu une partie de sa vigueur et de son aptitude au travail. A quoi il faut ajouter que le rachat ne donnait pas une complète liberté à l'esclave, que celui-ci demeurait [715] encore, dans une certaine mesure, sous la dépendant! du maître; qu'il était assujetti, par exemple, a lui fournir une redevance, en échange du bienfait de son patronage. Les affranchissements se multiplièrent ainsi, grâce aux avantages qu'ils présentaient aux propriétaires d'esclaves. Quelquefois ils se trouvaient encore encouragés par les lois relatives aux distributions de vivres; ces distributions n'étant accordées qu'aux hommes libres et aux affranchis, les maîtres trouvèrent profit à certaines époques, notamment sous César, à affranchir leurs esclaves pour partager avec eux les vivres distribués. Dans les campagnes, des circonstances d'une nature particulière agirent pour déterminer la transformation de l'esclavage. Au témoignage de Pline et de Columelle, les grands ateliers agricoles, mus par des bras esclaves (latifundia), finirent par épuiser le sol de l'Italie. Ce genre d'exploitation devint, par conséquent, de moins en moins profitable, et il y eut une époque où les propriétaires trouvèrent avantage à morceler le sol et à le donner à cultiver ainsi morcelé à leurs anciens esclaves transformés en serfs, colons ou métayers. Les invasions des barbares, en diminuant la sécurité des propriétaires, en rendant les révoltes et les évasions des esclaves plus faciles, comme aussi en rétrécissant les débouchés ouverts aux produits de la grande culture, contribuèrent encore pour une bonne part à cette transformation. Les causes qui ont amené la suppression de l'esclavage en Europe appartiennent, comme on voit, principalement à l'ordre économique ; la religion chrétienne y concourut aussi, sans doute, en introduisant dans le monde une morale plus épurée, en répandant dans les âmes des germes plus vivaces de justice et de fraternité ; mais ce serait se contenter d'un examen fort superficiel que d'attribuer au christianisme tout le mérite de l'abolition de l'esclavage. Alors même que le christianisme ne serait pas intervenu, l'esclavage n'en aurait pas moins disparu graduellement sous l'influence des faits économiques. L'intervention du christianisme n'agit, du reste, que d'une manière lente et indirecte. C'est seulement au douzième siècle que l'on voit un pape, Alexandre III, publier une bulle pour l'émancipation générale des esclaves; encore, ainsi que le remarque judicieusement Adam Smith (liv. m, chap. ii), cette bulle paraît avoir été plutôt une pieuse exhortation qu'une loi qui prétendit obliger strictement les fidèles, car l'esclavage subsista encore, en Europe même, pendant plusieurs siècles; ce ne fut qu'au dix-septième siècle, en Angleterre, et au dix-huitième siècle, en France, que les dernières traces de l'esclavage primitif disparurent. La loi, qui n'est presque toujours que la constatation des faits généraux existants , interdit, à ces époques, la possession des esclaves, du moins dans les métropoles.
Les historiens et les économistes varient beaucoup dans leurs appréciations sur le chiffre de la population esclave dans l'antiquité. Selon Boeckh, la population de l'Attique se composait de 135,000 hommes libres et de 365,000 esclaves; Wallace porte le nombre des esclaves à 580,000; Sainte-Croix fait même monter ce nombre à 639,500 ; en revanche, Hume le réduit à 40,000. M. Letronne, dont les évaluations sont adoptées par M. Dureau de la Malle, donne le chiffre de 110,000 pour la population esclave et de 130,000 pour la population libre. M. Dureau de la Malle évalue à son tour la population d'esclaves, d'affranchis et de métèques (étrangers) de l'Italie, en l'an 529 de la fondation de Rome, à 2,312,677 individus, et la population libre à 2,665,805. La proportion serait de 26 à 23. D'autres auteurs fournissent des évaluations beaucoup plus fortes pour la population esclave; mais celles de M. Dureau de la Malle paraissent se rapprocher davantage de la vérité.
III. L'esclavage dans les temps modernes.
§ 1. L'esclavage des nègres. — Son établissement. — Moyens employés pour l'abolir.
Après s'être graduellement transformé en Europe, l'esclavage reparaît en Amérique avec son caractère de primitive barbarie. Les immenses et fertiles territoires du nouveau inonde venaient d'être découverts, mais les bras manquaient pour les exploiter. Dans les premiers temps, on eut recours aux indigènes que l'on assujettit au travail forcé des mines, industrie qui apparaissait comme la plus lucrative de toutes ; mais les indigènes n'avaient pas la vigueur nécessaire pour résister aux fatigues incessantes et aux traitements cruels auxquels les soumettaient l'avidité et l'intolérance des conquérants. Leur nombre diminua rapidement. On dut songer à les remplacer sous peine de perdre la plus grande partie des avantages de la découverte du nouveau monde. Or les travailleurs européens ne s'acclimataient aisément que dans les régions tempérées, c'est-à-dire dans celles qui renfermaient le moins de richesses naturelles. L'importation des travailleurs d'Europe était, en outre, rendue difficile parleur condition, même d'hommes libres. Généralement dépourvus de ressources, ils s'engageaient pour payer leur passage ; mais leurs engagements étant limités à trois ans, cinq ans ou sept ans, cette limitation avait pour résultat naturel de borner les profits que l'on pouvait tirer de leur transport. (V. Colonies et Émigration. ) On chercha donc des travailleurs qui pussent mieux s'acclimater dans les régions tropicales du nouveau continent et dont le transport pût donner de meilleurs profits. Ces travailleurs on les trouva sur la côte d'Afrique. On se procura là, en abondance, des hommes robustes, accoutumés au climat des tropiques, et dont le transport pouvait procurer un maximum de bénéfices, car ceux qui les transportaient en acquéraient la propriété perpétuelle : après les avoir achetés à vil prix sur la côte d'Afrique, où l'état encore barbare de la production laissait le travail à peu près sans valeur, ils les revendaient cher en Amérique, où la richesse des agents naturels, jointe à l'intelligence et aux capitaux importés d'Europe, permettait d'en tirer bon parti. Quelques auteurs attribuent l'idée première de la traite au vertueux Las Casas, évêque de Chiapa, qui aurait vu dans l'importation des nègres un moyen de soulager les Indiens indigènes et de convertir au christianisme des peuples idolâtres. Las Casas parait avoir recommandé, en effet, l'importation des nègres, mais l'initiative de ce trafic ne lui appartient pas. Les Portugais faisaient déjà la traite longtemps auparavant. Quoi qu'il en soit, le commerce des nègres prit bientôt une extension [716] considérable. Les compagnies auxquelles on conféra, dans les premiers temps, l'exploitation exclusive du commerce des colonies ne manquèrent pas de se faire attribuer aussi le privilège exclusif de la traite : non-seulement on le leur accorda, mais encore on y joignit des primes de tant par tète d'esclave importé. En France, les compagnies du Sénégal et de Guinée obtinrent une prime de treize livres par tête à charge, la première, d'importer deux mille esclaves tous les ans, et la seconde, mille dans les colonies d'Amérique. Lors de la paix d'Utrecht, l'Angleterre se fit accorder la faveur d'importer des esclaves dans les colonies espagnoles, et cette faveur fut considérée comme un des avantages les plus notoires qu'elle eut retirés de la conclusion du traité.
C'est aux philosophes et aux économistes du dix-huitième siècle, à Turgot, à Montesquieu, à Raynal, à Condorcet que revient, du moins en France, l'honneur d'avoir soulevé l'opinion contre l'esclavage des nègres. En Angleterre, le mouvement contre l'esclavage naquit vers la même époque au sein des sectes dissidentes du protestantisme, principalement parmi les quakers. Dans ces deux pays et dans quelques-uns des nouveaux Etats de l'Amérique du Nord, des esprits généreux et passionnés s'efforcèrent de prouver, ceux-ci en invoquant le droit naturel et l'économie politique, ceux-là en faisant appel à la religion, que l'esclavage des nègres était injuste, nuisible et anti-chrétien. Peu nombreux à l'origine, en butte aux aggressions les plus violentes, traqués comme des bêtes fauves dans les pays à esclaves, les abolitionistes finirent cependant par obtenir, du plus grand nombre des nations civilisées, une adhésion formelle à leurs principes et un concours, malheureusement trop peu éclairé, pour l'accomplissement de leur œuvre.
Nous n'avons pas à raconter ici l'histoire des efforts qui ont été tentés pour l'abolition de l'esclavage des nègres. Nous devons nous borner à examiner, au point de vue économique, les errements qui ont été suivis dans cette grande entreprise d'humanité, et à rechercher si ces errements étaient bien les meilleurs que l'on pût adopter. Deux mesures principales ont été prises jusqu'à nos jours en vue d'arriver à l'abolition de l'esclavage : 1° on a prohibé le transport et le commerce extérieur des esclaves ; 2° certaines nations, notamment l'Angleterre et la France, ont aboli l'esclavage dans leurs possessions. Examinons quels ont été les 'résultats de ces deux mesures.
Les États-Unis et la France disputent à l'Angleterre l'honneur de l'initiative de l'abolition de la traite. L'Etat de Virginie la prohiba dès 1776, et onze autres États de l'Union, de 1776 à 1782, mais cette prohibition fut révoquée ensuite dans la Caroline du Sud, qui importa environ 20,000 esclaves de 1803 à 1808. La France a aboli la traite et l'esclavage pendant sa première révolution, mais elle les a rétablis sous l'empire. L'Angleterre n'a renoncé à la traite qu'en 1807, sous l'inspiration et grâce aux efforts philanthropiques des Wilberforce, des Clarkson, des Grenville Sharp, des Charles Fox ; mais depuis lors, elle n'a point cessé d'être l’âme de la grande croisade entreprise en faveur de la liberté des noirs. Sous son influence active, les souverains de l'Europe convinrent, en 1814, d'unir leurs efforts pour arriver à l'extinction de la traite, et des conventions furent conclues successivement entre les différentes nations civilisées, pour rendre plus efficace la répression de cet infâme commerce. Des croisières furent établies le long de la côte d'Afrique pour poursuivre les négriers : l'Angleterre, la France et l'Union américaine y participèrent. L'Angleterre alla plus loin : elle s'efforça de consacrer une dérogation au droit maritime en faveur de la répression de la traite; elle demanda que les négriers fussent assimilés aux pirates et soumis comme tels au droit de visite, alors même qu'ils se couvriraient du pavillon d'une nation étrangère. Le gouvernement français avait consenti à cette demande, lorsque l'opposition crut voir dans le droit de visite un nouveau tour de la perfide Albion, et la convention ne fut adoptée qu'après avoir subi des modifications qui en restreignaient beaucoup la portée.
Chose triste à dire cependant ! en dépit de tant d'efforts déployés depuis près d'un demi-siècle en vue de la suppression de la traite, cet odieux commerce n'a pas subi aucune diminution sensible. Les négriers ont bravé les prohibitions, ils se sont joués des croisières, et la traite des nègres est demeurée un commerce florissant, quoiqu'elle soit devenue partout, sauf en Afrique même, un commerce de contrebande. On en jugera par le tableau suivant des importations d'esclaves d'Afrique en Amérique, depuis 1788 jusqu'en 1840:
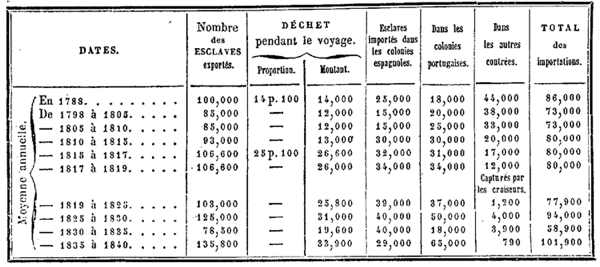
[717]
Le tableau suivant présente les exportations et les importations de 1840 à 1848: [108]
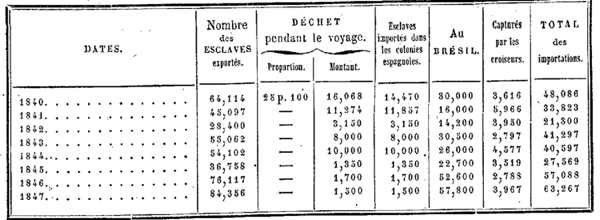
En totalisant ces résultats, on trouve que, depuis 1807, époque de l’abolition de la traite en Angleterre, jusqu'en 1819, époque de l'établissement des croisières, 2 millions 290 mille nègres ont été enlevés à la côte d'Afrique. Sur ce nombre, 680 mille ont été expédiés au Brésil, 615 mille dans les colonies espagnoles, et 562 mille dans les autres pays. Le déchet, pendant la traversée, a été de 433 mille. Depuis 1819 jusqu'en 1847, le nombre des nègres exportés a été de 2 millions 758,506, ainsi répartis: Brésil, 1 million 121,800; colonies espagnoles, 831,027; déchet, 688,299; capturés, 117,380. Totaux, pendant les quarante années : esclaves importés au Brésil, 1 million 801,800; dans les colonies espagnoles, 1 million 446,027; dans les autres contrées, 562 mille; déchet, pendant la traversée, 1 million 121,299; capturés, depuis 1819, 117,380. Ce qui donne en totalité, depuis la prohibition, 5 millions 048,506 victimes de la traite. Ces chiffres attestent combien peu les mesures prises pour empêcher le transport des esclaves de la côte d'Afrique ont atteint leur but.
Ce n'est pas tout. Non-seulement la prohibition de la traite et les mesures prises pour l'assurer n'ont point arrêté cet odieux trafic, mais encore elles ont eu pour résultat d'aggraver les souffrances de ses victimes. Avant la prohibition, les nègres transportés étaient généralement bien traités pendant le voyage, car les négriers avaient intérêt à ce que leur marchandise arrivât en bon état à sa destination. Mais à peine les lois répressives de la traite furent-elles mises en vigueur, que toutes les précautions prises pour procurer quelque bien-être aux transportés disparurent. Les négriers n'eurent plus alors qu'un souci: échapper aux croisières. Dans ce but, ils réduisirent au minimum la place réservée à leurs cargaisons, et ils n'embarquèrent plus que les quantités d'eau et de vivres qui leur étaient rigoureusement nécessaires. Ainsi qu'on a pu le voir dans le tableau ci-dessus, le résultat fut une augmentation de 11 pour 100 dans le déchet des cargaisons. Cette augmentation du déchet s'explique par les horribles souffrances que les conditions actuelles de la traite infligent aux victimes de là cupidité des négriers. Les rapports de la Société pour l'abolition de l'esclavage sont remplis des récits de leurs tortures ; on n'a que le choix des documents. Nous nous bornons à rapporter quelques passages d'une déposition du docteur Cliffe, Américain, qui a participé aux opérations de la traite, et qui a été en position d'en observer toutes les horreurs :
« Les esclaves, dit le docteur Cliffe, sont entassés pêle-mêle et couchés sur le flanc, dans un mélange confus de bras, de têtes, de jambes, grouillants les uns dans les autres, de sorte qu'il est difficile à l'un d'eux de remuer sans que la masse entière remue en même temps. Sur le même bâtiment on forme parfois deux ou trois ponts, encombrés d'esclaves, et dont la hauteur ne dépasse pas un pied et demi ou même un pied. Ils ont ainsi la place nécessaire pour se tenir couchés , aplatis comme l'insecte visqueux; mais un enfant lui-même ne pourrait s'asseoir dans ces longs cercueils à compartiments. On peut dire qu'ils sont arrimés comme des boucants ou comme des livres sur les rayons d'une bibliothèque. Us sont nourris par un homme qui leur descend une callebasse d'eau et une parcelle d'aliments. Un petit nombre d'entre eux, ceux qui semblent plus accablés, sont hissés sur le pont au grand air. Avant le redoublement de sévérité de nos lois, on leur distribuait leur nourriture sur le pont, par escouades successives; mais aujourd'hui ce faible adoucissement ne leur est même plus donné. Jadis les négriers amenaient avec eux un chirurgien; aujourd'hui il n'est pas de praticien de quelque valeur qui voulût les suivre. Les bâtiments perdent quelquefois plus de la moitié de leur cargaison, et l'on cite même l'exemple d'un chargement de 160 nègres sur lesquels 16 seulement survécurent au voyage. Bien ne saurait donner une idée des souffrances auxquelles ces malheureux sont soumis, principalement à cause du manque d'eau : comme la présence à bord d'une grande quantité d'eau et de tonneaux expose les négriers à la confiscation, ils sont arrivés, après des calculs d'une odieuse précision, à reconnaître qu'en distribuant une fois tous les trois jours à un individu l'eau contenue dans une tasse de thé, cela suffisait pour lui conserver la vie. Ils limitent en conséquence leurs approvisionnements d'eau fraîche à ce qu'il faut pour empêcher les esclaves de mourir de soif. Bien ne saurait non plus donner une idée exacte de la saleté horrible [718] d'un navire chargé de nègres. Amoncelés et en quelque sorte encaqués comme le sont les nègres, dit le docteur Cliffe, il devient à peu près impossible de nettoyer le navire, lequel est fort souvent abandonné faute d'un Hercule assez téméraire pour nettoyer ces nouvelles étables d'Augias. Les bâtiments que l'on a purifiés conservent une odeur particulièrement acre et fétide, qui trahit leur destination première. Je reconnus qu'un vaisseau naviguant sur la côte d'Afrique avait servi à la traite par les effluves caractéristiques qui s'en exhalaient. Il est bien certain que si un blanc était plongé dans l'atmosphère où vivent ces malheureux, il serait immédiatement asphyxié. »
Le docteur Cliffe décrit ensuite l'aspect d'une cargaison de nègres au moment du débarquement :
« Les rotules de ces malheureux, dit-il, présentent l'aspect d'un crâne dénudé. Le bras se trouve dégarni de toute la partie musculaire : c'est un os recouvert de peau. Le ventre est protubérant et comme gonflé d'une manière maladive. Il faut qu'un homme prenne ces misérables dans ses bras pour les porter hors du bâtiment, car ils ne sont pas capables de marcher. Comme ils ne se sont pas tenus debout pendant un ou deux mois, leurs muscles sont affaiblis au point de ne pouvoir plus les soutenir. Ils ont un air hébété, hasard, et l'on peut dire qu'ils sont descendus jusqu'au dernier degré d'abaissement au-delà duquel il n'y a plus que la brute. Un grand nombre sont tout meurtris, couverts de larges ulcères, de maladies cutanées profondément repoussantes, et la chique se creuse, à travers l'épiderme et jusque dans les chairs, ses horribles refuges. »
D'après le docteur Cliffe, pour faire parvenir 65 mille nègres au Brésil, il faut en enlever 100 mille à la côte d'Afrique , et, sur les 65 mille, il en meurt communément 3, 4 ou 5 mille dans les deux mois qui suivent leur arrivée. [109]
D'autres témoignages, recueillis dans les rapports de la Société pour l'abolition de l'esclavage, attestent que la déposition du docteur Cliffe n'est nullement empreinte d'exagération.
Comment donc se fait-il que les mesures prises pour la répression de la traite n'aient pas eu la vertu de mettre fin à un si abominable trafic? Ce fait s'explique par les bénéfices considérables du commerce des nègres, bénéfices que la prohibition même de la traite a eu pour résultat d'augmenter dans une proportion énorme.
Avant que la traite ne fût défendue, les opérations des négriers donnaient de 20 à 30 pour 100 de profits, tout au plus. Depuis que la traite est devenue un commerce de contrebande, les bénéfices qu'elle rapporte s'élèvent fréquemment jusqu'à 2 ou 300 pour 100. Cette augmentation provient en premier lieu de la réduction survenue dans la concurrence des capitaux et des bras qui s'offraient pour faire la traite : les entrepreneurs et les capitalistes honnêtes se sont retirés successivement de ce commerce lorsqu'il a été flétri par la conscience publique et poursuivi par les lois. Les entrepreneurs et les capitalistes les moins scrupuleux seuls ont continué de s'y livrer, et le retrait de leurs concurrents honnêtes a eu pour résultat naturel d'augmenter leurs profits. En second lieu, la demande sans cesse croissante des denrées tropicales qui a eu lieu en Europe depuis soixante ans, du sucre, du café, du tabac, du coton, a occasionné un accroissement correspondant de la demande des bras dans les colonies. Les négriers ont ainsi profité à la fois des découvertes de Watt et d'Arkwright en Angleterre, et de l'affranchissement du travail en France. Ils ont profité même des lois rendues contre leur trafic, sous la généreuse inspiration des apôtres de l'abolition de l'esclavage, absolument comme les usuriers ont profité des lois rendues contre l'usure.
La traite a donc résisté à tous les efforts tentés pour l'abolir, et dans un de ses récents rapports, la Société pour l'abolition de l'esclavage était obligée de convenir que « l'étendue et l'activité du commerce des esclaves, bien qu'affectées dans une certaine mesure par la prohibition de la traite, n'avaient pas cessé cependant d'être gouvernées par la demande des produits du travail esclave sur les marchés d'Europe. »
Au reste, l'Angleterre s'aperçut de bonne heure que la prohibition de la traite serait insuffisante pour amener l'abolition de l'esclavage. Les philanthropes qui avaient pris en main la cause des nègres s'efforcèrent alors d'entraîner le gouvernement à donner un grand exemple au monde en affranchissant les esclaves de ses colonies. Le gouvernement résista longtemps; mais l'abolition de l'esclavage était devenue la généreuse passion du peuple anglais, et il fallut céder à la fin au vœu manifeste de l'opinion.
Dix années furent consacrées à préparer l'émancipation. Le 15 mai 1823, M. Fowell Buxton, d'après le désir de son illustre collègue M. Wilberforce, saisit la chambre d'une proposition relative à l'abolition de l'esclavage. M. Canning amenda la motion de M. Buxton, et le parlement décida que des mesures seraient prises pour améliorer l'état moral des noirs et les préparer à la liberté. Dans une circulaire du 9 juillet 1823, lord Bathurst communiqua ces résolutions aux législatures coloniales et leur enjoignit de s'y conformer. Mais les intentions de la métropole rencontrèrent de vives résistances de la part des planteurs des colonies. Les mesures préparatoires recommandées dans la circulaire de lord Bathurst ne furent point remplies, ou le furent mal. En 1831, le gouvernement se décida à passer outre et il préluda à l'émancipation générale en affranchissant les esclaves des domaines de la couronne. Enfin, le 18 mai 1833, lord Stanley présenta au parlement britannique un bill pour l'abolition de l'esclavage. Adopté par la chambre des communes le 12 juin 1833, et par la chambre des lords dans la nuit du 25 du même mois, ce bill fut sanctionné par la couronne le 28 août suivant.
Voici quelles étaient les clauses de l'acte d'émancipation :
- I. Une indemnité de 20 millions de livres sterl. était accordée aux propriétaires d'esclaves.
- II. Les esclaves âgés de six ans et au-dessus, au 1 er août 1834, passaient à l'état d'apprentis travailleurs. On en fit trois catégories : [719]
- Les apprentis travailleurs ruraux attachés au sol ;
- Les apprentis travailleurs ruraux non attachés au sol ;
- Les apprentis travailleurs non ruraux.
Six années d'apprentissage furent imposées aux deux premières classes et quatre années à la troisième, à dater du 1er août 1834. Les maîtres eurent droit au travail de leurs ci-devant, esclaves devenus apprentis, à la charge de pourvoir a leur entretien.
La quantité de travail exigible d'un apprenti fut limitée à 45 heures par semaine.
Les travailleurs noirs eurent la faculté de racheter les années de travail qu'ils devaient fournir a leurs maîtres.
Nous ne mentionnerons pas les dispositions secondaires.
Ainsi 20 millions de livres sterl. payés en argent, plus le droit au travail de la génération esclave, pendant une période de quatre et de six armées, tel fut le prix de rachat alloué aux propriétaires des colonies.
Les populations esclaves des possessions anglaises, soumises à l'acte d'émancipation, se composaient de 780,933 individus. En calculant leur valeur d'après la moyenne des prix de vente de 1823 à 1830, soit à raison de 1,400 fr. par tête, on aura un total de 1,132,043,668 fr. L'indemnité pécuniaire, s'élevant à 500 millions de fr., soit à 635 fr. 61 c. par tête, formait les 3/7 environ de la valeur totale de la population rachetée.
Voici le détail du nombre des esclaves rachetés aux Indes occidentales, à l'île Maurice et au Cap, avec l'indication du prix payé par tête, et du chiffre total de l'indemnité :
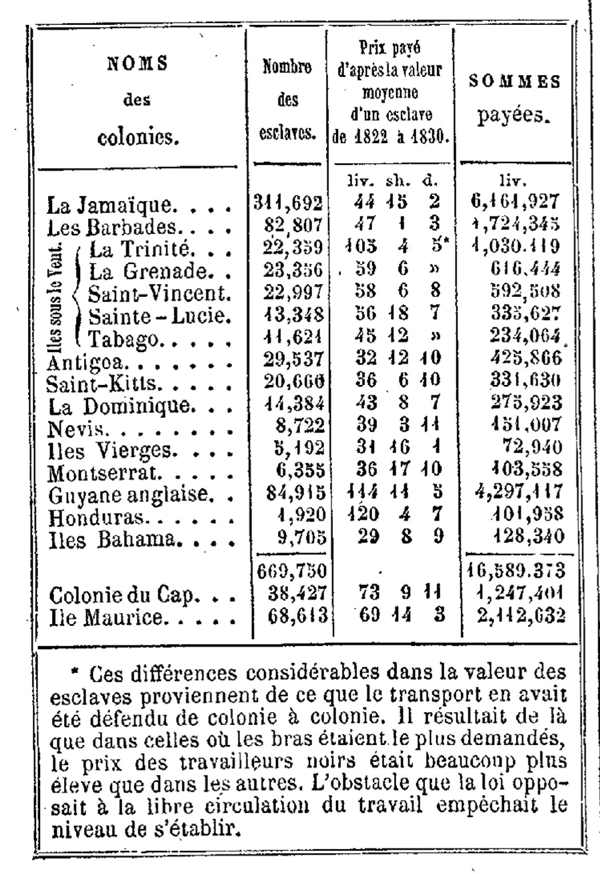
Ces différences considérables dans la valeur des esclaves proviennent de ce que le transport en avait été défendu de colonie à colonie. Il résultait de là que dans celles où les bras étaient le plus demandés, le prix des travailleurs noirs était beaucoup plus élevé que dans les autres. L'obstacle que la loi opposait à la libre circulation du travail empêchait le niveau de s'établir.
L’indemnité accordée en travail servait à couvrir les quatre autres septièmes. On évalue à 7 1/4 années la quantité de travail que peut donner eu moyenne une génération esclave aux Antilles anglaises. En conférant aux planteurs pour une période de quatre et de six années le droit au travail de la génération rachetée, on leur fournissait donc plus des 4/7 de sa valeur, et par conséquent on leur payait largement leur propriété.
Cependant cette combinaison qui semblait satisfaisante pour tout le monde ne satisfit personne. Les nègres, qui avaient compté sur une liberté immédiate, supportèrent impatiemment le régime de l'apprentissage. On vit des apprentis se racheter à des prix véritablement exorbitants. Quelques-uns payèrent 3 à 4,000 fr. une année de liberté. A la Jamaïque, le montant des transactions de cette nature s'éleva, depuis le 1 er août 1834 jusqu'au 1 er août 1838, à la somme de 300,000 dollars (1,620,000 fr.). Les propriétaires à leur tour, obliges de se soumettre à la surveillance sévère des agents du gouvernement, se fatiguèrent bientôt de ce nouveau régime ; au bout de quatre années , ils se décidèrent généralement à abandonner aux apprentis ruraux les deux années qui restaient encore à courir. Le 1 er août 1838 fut donc un magnifique jour de fête aux Indes occidentales et dans les autres colonies à esclaves, appartenant à la Grande-Bretagne. Malheureusement la fête ne dura guère, du moins pour les planteurs. Devenus libres, les affranchis refusèrent, pour la plupart, de retourner à leurs ateliers. Les uns se mirent à cultiver des terrains vagues, les autres entreprirent divers petits métiers; il fallut l'appât de salaires considérables pour engager ceux qui restaient à retourner aux plantations ; le prix de la journée de travail subit des fluctuations tout à fait extraordinaires ; aux époques des récoltes on le vit monter, chose exorbitante! jusqu'à 5, 10 et même 15 fr., tant l’offre était faible et la demande forte. Au bout de quelques mois, un grand nombre de plantations durent être abandonnées faute de bras pour les exploiter, et la production du sucre diminua de plus d'un tiers. Elle augmenta, au contraire, considérablement, et par le fait même de ce désastre, aux Indes orientales.
Voici le tableau des importations du sucre des possessions britanniques en Angleterre, avant et après l'émancipation :
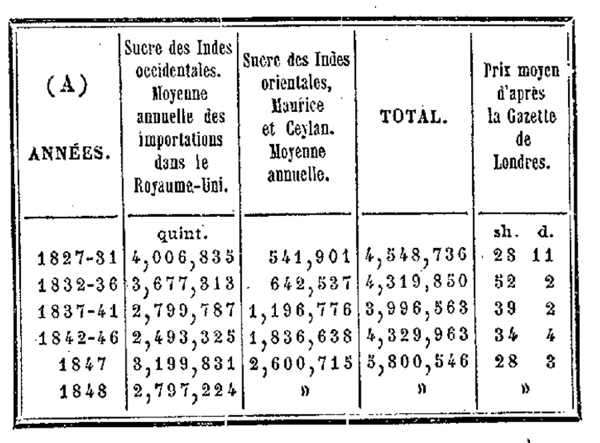
Dans la période de 1827 à 1831, les Indes occidentales fournissaient 88 pour 100 de l'importation totale du sucre colonial en Angleterre ; dans L'indemnité accordée en travail servait à cou- la période de 1842 à 1846, elles n'en ont plus [720] fourni que 57 pour 100. Les importations des produits anglais dans ces colonies ont subi, en conséquence, une diminution assez forte. On en jugera par le tableau suivant des importations de la métropole dans les possessions britanniques.
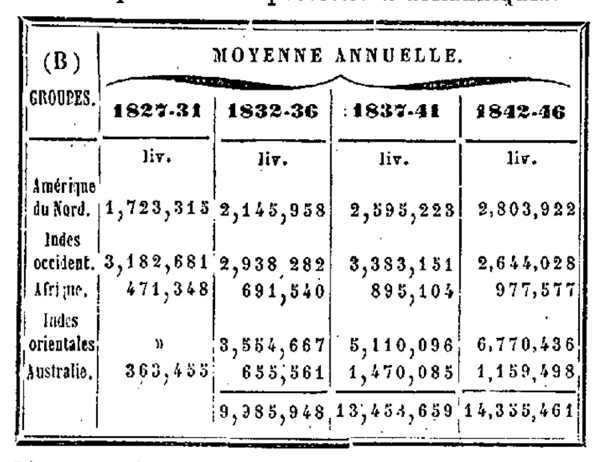
L’augmentation pour l’Amérique du Nord, de 1827-31 à 1842-46, a été de 63p. 100
— pour les possessions d'Afrique. 107 —
— pour les Indes orientales, de 1832-36 à 1842-46 90 —
— pour l'Australie 219 —
En revanche, il y a eu aux Indes occidentales une diminution de 17 — [110]
Ces chiffres attestent combien l'émancipation a été funeste à la prospérité matérielle des Indes occidentales. La Guyane, la Jamaïque et la Trinité sont parmi ces colonies celles qui ont le plus souffert. A la Guyane, la valeur d'un grand nombre de propriétés est tombée presque à rien. Ailleurs, à la Barbade et à Antigoa par exemple, où la population se trouvait plus pressée qu'à la Guyane, les désastres ont été beaucoup moindres. Enfin à l'ile Maurice, la production se soutint, grâce aux importations des coulis de l'Inde (V. Émigration).
Remarquons bien que la métropole participa doublement au désastre de l'émancipation : non-seulement elle paya généreusement une somme de 500 millions pour le rachat des esclaves, mais encore elle supporta, par suite du déficit de la production du sucre colonial, déficit occasionné par l'émancipation, une surtaxe considérable sur sa consommation de sucre, depuis 1834 jusqu'en 1847 (Voir le tableau ci-dessus A). Ce fut seulement en 1847 que le prix du sucre redescendit au niveau où il se trouvait avant l'émancipation, et cette baisse n'eut lieu qu'à la suite de la réforme du tarif des sucres en 1846. Au point de vue de la prospérité actuelle des colonies et des intérêts de la métropole, l'émancipation anglaise fut donc une opération désastreuse.
D'autres nations avaient devancé l'Angleterre dans la voie de l'abolition de l'esclavage, d'autres l'on suivie. [111] La France avait pris une des premières l'initiative de cette grande mesure, à la fin du siècle dernier ; mais Bonaparte lui en avait enlevé le mérite en rétablissant plus tard l'esclavage avec la traite, et en essayant, mais en vain, de ressaisir Saint-Domingue émancipé. Sous la monarchie de juillet, l'agitation abolitioniste recommença avec une certaine énergie. Pendant longtemps les colons, qui disposaient de puissantes influences, réussirent à détourner l'orage qui menaçait de fondre sur eux; mais en 1845 les abolitionistes remportèrent un avantage signalé. Une loi fut rendue stipulant que les esclaves pourraient désormais se constituer légalement un pécule et se racheter même contre le gré de leurs maîtres, moyennant ce pécule. Cette loi, qui soulevait de nombreuses difficultés d'application, mais qui était un premier pas de fait dans la voie de l'émancipation, ne fut mise en vigueur que pendant un court laps de temps. La révolution de 1848 survint, à la suite de laquelle l'émancipation immédiate fut décrétée dans les possessions françaises. (Décret du gouvernement provisoire du 27 avril, confirmé par un autre décret de l'assemblée nationale du 16 septembre). L'indemnité à payer aux colons fut réglée par un autre décret du 30 avril 1849. Les mêmes phénomènes économiques qui avaient signalé l'émancipation dans les possessions anglaises se reproduisirent dans les colonies françaises. Les bras manquèrent aux cultures, la production du sucre diminua, partant l'importation des produits nationaux dans les colonies. Le déficit de la production du sucre colonial fut comblé en grande partie par une augmentation de la production du sucre de betterave; mais les consommateurs n'en eurent pas moins, comme en Angleterre , à supporter les frais d'une hausse occasionnée par l'émancipation. Comme en Angleterre aussi, le gouvernement vint tardivement en aide aux consommateurs en modifiant le tarif des sucres (V. Sucres). Il abaissa la surtaxe des sucres étrangers; mais, en même temps, il s'attacha à protéger, par un droit différentiel, le sucre des colonies contre le sucre de betteraves. Malgré ce droit, la prospérité des colonies ne s'est pas encore relevée. Un décret a été rendu récemment (18 février 1852) pour y encourager l'immigration des travailleurs libres et suppléer ainsi à l'insuffisance des nègres émancipés.
En France comme en Angleterre, l'émancipation a donc été une mauvaise opération économique. Elle a pesé : 1° sur les contribuables de la métropole qui ont eu à payer le montant de l'indemnité coloniale ; 2° sur les consommateurs de sucre qui ont été obligés de payer la hausse occasionnée par l'émancipation ; 3° sur les colons à [721] qui cette double indemnité n'a pas fourni l'équivalent des pertes qu’ils ont subies par suite de la désorganisation de leurs ateliers.
En compensation, la liberté a été rendue à un million de créatures humaines, et certes nous ne dirions pas qu'elle a été achetée trop cher, si malheureusement l'émancipation n'avait eu pour résultat d'augmenter ailleurs, dans une proportion égale sinon plus forte, le développement de l'esclavage. En effet, la demande des denrées tropicales , principalement du sucre , continuant à s'accroître en Europe, tandis que la production baissait dans les colonies émancipées, ce genre de production ne tarda pas à recevoir une impulsion énorme au Brésil et à Cuba, où l'esclavage n'avait pas été interdit. Le commerce des esclaves, qui était demeuré languissant de 1830 à 1835, se ranima lorsqu'on put apprécier les premiers résultats de l'acte d'émancipation dans les colonies anglaises : en peu de temps, le mouvement d'exportation des travailleurs esclaves de la côte d'Afrique doubla d'importance. Des millions de ces malheureux furent employés à mettre en activité les nouvelles cultures qui s'élevaient au Brésil et à Cuba pour remplacer celles que l'émancipation ruinait aux Antilles anglaises. En 1792, la population esclave de l'île de Cuba n'était évaluée qu'à 84,000 individus; elle était de 199,000 en 1817 et de 286,000 en 1827; en 1843, elle se trouva portée à 430,000 par suite des importations extraordinaires de la côte d'Afrique; au Brésil, l'accroissement de la population, provenant de la même cause, paraît avoir été plus considérable encore. En sorte que l'émancipation que l'Angleterre et la France ont accomplie au prix de tant d'efforts et de sacrifices dans leurs colonies n'a abouti qu'à un simple déplacement de l'esclavage, et ce déplacement a été opéré au profit des nations les moins accessibles aux sentiments de justice et d'humanité. Lamentable résultat d'une si noble et si généreuse entreprise !
Ce résultat n'a pas échappé aux abolitionistes ; ils ont même déployé les plus grands efforts pour le combattre. Dès qu'ils se sont aperçus que le sucre produit par le travail des esclaves du Brésil et de Cuba prenait la place du sucre des colonies émancipées, ils ont demandé que des droits différentiels fussent établis en faveur du sucre produit par le travail libre (free grown sugar). Sir Robert Peel accueillit leur demande, qui découlait du système suivi jusqu'alors dans l'affaire de l'abolition de l'esclavage. Avant le 10 décembre 1844, le sucre des colonies payait 24 shell. par quintal et le sucre étranger de toutes provenances 63 shell. Sir Robert Peel débuta par maintenir respectivement ces deux droits sur le sucre des colonies et sur les sucres étrangers provenant du travail esclave, mais il créa une catégorie intermédiaire pour les sucres étrangers produits parle travail libre. Ceux-ci furent soumis à un droit de 34 shell. seulement. Cinq mois plus tard (le 15 février 1845), il alla plus loin, il réduisit à 14 shell. 4 d. le droit sur le sucre des colonies et à 23 shell. 4 d. le droit sur le sucre étranger produit par le travail libre, tout en maintenant à 63 shell. le droit sur le sucre esclave. Mais l'insuffisance des approvisionnements fournis par les colonies et par les pays où la culture était libre ayant maintenu les prix à un niveau élevé, la distinction entre le sucre libre et le sucre esclave fut abandonnée l'année suivante, malgré les efforts désespérés des abolitionistes. En vertu de la loi des sucres présentée par le ministère de lord John Russell et adoptée par le parlement, en août 1846, le droit sur le sucre des colonies fut maintenu à 14 shell., et le droit sur le sucre étranger de toutes provenances abaissé à 21. La loi portait, en outre, que les droits sur les sucres étrangers seraient successivement abaissés jusqu'à la limite des droits fixés sur les sucres coloniaux, de telle manière que l'égalité se trouvât entièrement établie le 5 juillet 1854.
Nous venons de dire que cette loi, qui était une nouvelle conquête du principe de la liberté du commerce, fut vivement attaquée par les abolitionistes, et elle devait l'être, car elle allait directement contre les mesures philanthropiques jusqu'alors adoptées en vue de l'émancipation de la race noire. Quel but l'Angleterre s'était-elle proposé, en effet, en consacrant depuis 1819 des sommes considérables à la répression de la traite ? Elle avait voulu empêcher l'accroissement du nombre des esclaves nègres en Amérique. Quel but s'était-elle proposé encore en dépensant 500 millions pour affranchir les esclaves de ses colonies? Elle avait voulu diminuer le nombre des nègres esclaves. Or que faisait-elle en supprimant le droit prohibitif qui interdisait au sucre esclave l'entrée du marché britannique? Elle augmentait le débouché de la production esclave; elle encourageait l'établissement de nouvelles plantations au Brésil et à Cuba; elle donnait une prime à la traite et à l'esclavage. Elle défaisait, en vue de la liberté du commerce, ce qu'elle avait fait précédemment en vue de l'abolition de l'esclavage.
Aussi la discussion que cette question souleva au sein du parlement fut-elle des plus animées. Les abolitionistes démontrèrent aisément que l'abaissement du droit agirait comme une prime donnée à la production du sucre dans les pays à esclaves ; mais leurs adversaires, notamment M. Macaulay, firent ressortir avec plus de force encore combien il était absurde et nuisible de maintenir une prohibition de cette nature.
« Vous voulez, dirent-ils, empêcher le sucre esclave d'être consommé en Angleterre; pourquoi done consentez-vous à ce qu'il y soit raffiné ? Ne se rend-on pas aussi coupable en préparant du sucre esclave pour la consommation des Belges, des Français, des Allemands, qu'en le consommant soi-même? Pourquoi ne demandez-vous pas aussi la prohibition du coton produit par des mains esclaves aux États-Unis, afin de favoriser la production du coton libre? On ne saurait entrer à demi dans cette voie sous peine d'être illogique et absurde; on n'y saurait entrer entièrement sous peine de causer la ruine des plus florissantes industries du pays. Et quels sont actuellement les résultats de la quasi-prohibition du sucre esclave en Angleterre? C'est de maintenir à un taux exorbitant le prix du sucre, et par conséquent d'en restreindre la consommation, au grand dommage des consommateurs et du trésor. Quant au sucre esclave, il pénètre sans difficulté sur le continent, et il y [722] remplace le sucre libre que l'on nous expédie pour profiter du droit différentiel, et que l'on nous vend à un prix de monopole. »
Les abolitionistes répondaient, à la vérité, que le haut prix que l'Angleterre consentait à payer momentanément pour le sucre libre ne pouvait manquer d'en développer la production et, par conséquent, d'en abaisser le prix ; qu'elle finirait ainsi par être récompensée des sacrifices qu'elle s'était généreusement imposés pour l'abolition de l'esclavage ; mais restait la question d'empêcher efficacement la fraude; restait encore celle de savoir si le gouvernement avait le droit de continuer à taxer indéfiniment les consommateurs de sucre pour empêcher l'esclavage de s'étendre. Le parlement, donnant raison aux partisans de la liberté du commerce, refusa de continuer à favoriser le sucre libre au détriment du sucre esclave, et l'égalité des droits fut prononcée.
Le résultat de cette mesure fut, comme on devait, s'y attendre, une augmentation progressive de l'importation des sucres étrangers. En 1844, sous l'empire du droit prohibitif de 63 schell., la consommation des sucres étrangers dans les îles britanniques n'avait été que de 99 quintaux ; elle fut de 77,307 quintaux en 1845, de 602,739 en 1846, de 974,019 en 1847, et elle s'éleva à 1,220,964 en 1848. La plus forte part de ces importations provenait du Brésil et de Cuba. Le parlement, effrayé d'un tel résultat, releva quelque peu le droit en 1848 (XI et XII, Victoria, chapitre 97 ), et les importations tombèrent à 496,510 quintaux en 1849.
Que prouvait cependant la mesure prise en 1846 ? Prouvait-elle que le gouvernement anglais abandonnait la cause de l'abolition de l'esclavage? Non, elle prouvait tout simplement que l'on commençait à s'apercevoir en Angleterre que le système jusqu'alors suivi était mauvais, et que l'on refusait de le pousser plus loin. Aujourd'hui, l'opinion a fait un pas de plus : quelques-uns de ses organes les plus importants, notamment le Times et l’Economist, sollicitent le gouvernement de revenir résolument en arrière et de supprimer les croisières établies pour empêcher la traite. N'est-il pas absurde, en effet, de continuer à faire obstacle à la traite, alors qu'on a accordé, par l'abaissement du droit sur le sucre esclave, une prime énorme à l'importation et à la multiplication des nègres esclaves en Amérique?
§ 2. Situation actuelle des esclaves de la race nègre. — État de la question de l'esclavage.
En dépit des efforts généreux, mais peu conformes aux lois économiques, que l'Angleterre, la France et plusieurs autres nations ont tentés pour arriver à l'abolition de l'esclavage, le nombre des esclaves appartenant à la race noire n'a pas cessé de s'accroître. D'après un des derniers rapports de la Société pour l'abolition de l'esclavage, on compterait actuellement :
| Esclaves | |
| Aux États-Unis (recensement de 1850) | 3,178,000 |
| Au Brésil | 3,250,000 |
| Dans les colonies espagnoles | 900,000 |
| Dans les colonies hollandaises | 85,000 |
| Dans les républiques de l’Amérique du Sud | 140,000 |
| Dans les établissements de la côte d’Afrique. | 30,000 |
| Total | 7,883,000 |
Au commencement du siècle, les colonies espagnoles de Cuba et de Porto-Rico comptaient à peine 100 mille esclaves; le Brésil n'en avait qu'un nombre insignifiant, et les États-Unis en possédaient 892 mille seulement. Avec les esclaves des colonies anglaises et françaises, ils formaient tout au plus le tiers du nombre des nègres réduits aujourd'hui en servitude sur le continent américain. Ce développement énorme de l'esclavage depuis un demi-siècle, en dépit de tous les efforts tentés pour l'émancipation de la race noire, a été causé par l'accroissement de la consommation des denrées tropicales dans le monde civilisé. Ainsi que le remarquait, avec désespoir, la Société pour l'abolition de l'esclavage, c'est la demande des produits du travail esclave sur les marchés d'Europe qui a été le régulateur constant de l'esclavage, et cette demande a été sans cesse croissant sous l'influence de la découverte de la vapeur et du métier à filer, de l'avènement de la liberté industrielle, et, plus récemment, sous l'influence des progrès de la liberté du commerce.
Au moins l'esclavage, en se développant, s'est-il adouci? Les nègres esclaves sont-ils mieux traités de nos jours que ne l'étaient les esclaves de l'antiquité, que ne l'étaient les nègres eux-mêmes il y a un siècle ou deux? A cet égard, il n'est pas permis non plus de se faire illusion. Que l'on consulte tous les documents publiés sur la question de l'esclavage, les enquêtes, les récits des voyageurs, les lois rendues au sujet du régime des esclaves, et l'on se convaincra que les nègres sont traités de nos jours comme ils l'étaient il y a trois siècles ; comme l'étaient les esclaves de la Grèce et de Rome. Il y a pis encore. De même que les mesures prises contre la traite ont aggravé au delà de toute expression le sort des nègres transportés en Amérique, l'émancipation des esclaves d'un certain nombre de colonies et les tentatives abolitionistes qui se sont produites aux États-Unis ont rendu plus dure la condition des travailleurs encore soumis au régime de l'esclavage. Aux anciennes rigueurs de la discipline des ateliers sont venues s'en joindre de nouvelles, destinées à empêcher des évasions rendues' plus faciles et une propagande devenue plus dangereuse.
Il y a quelques années, la Société anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage (British and Foreign Anti-slavery Society) adressa à la Société américaine une série de questions relatives à la situation de l'esclavage dans l'Union. La Société américaine s'empressa de recueillir tous les documents nécessaires pour y répondre, et elle en composa un volume qui renferme des détails si cruellement avilissants pour la nature humaine, qu'on les croirait empruntés aux légendes de la primitive barbarie, bien plutôt qu'à l'histoire d'un peuple chrétien et civilisé du dix-neuvième siècle. Pourtant les auteurs de cette enquête n'ont rien inventé, rien exagéré; ils se sont bornés le plus souvent à rapporter des faits contenus dans des documents officiels ou recueillis dans les journaux des États à esclaves. Nous empruntons au volume qu'ils ont publié quelques renseignements caractéristiques sur l'organisation économique de [723] l’esclavage et sur la condition des esclaves aux États-Unis. [112]
L'esclavage existe actuellement aux États-Unis dans quatorze États : Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississipi, Louisiane, Missouri, Arkansas et Texas. Les États à esclaves se divisent en deux catégories : les pays de production et ceux de consommation. Dans les premiers, on élève les esclaves; dans les seconds on les applique à la culture du sol. On évalue à 80 mille environ le nombre des esclaves qui sont annuellement transportés des États éleveurs ( breeding States ) dans les États consommateurs.
Les États éleveurs sont le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, le Kentucky, le Tennessee et le Missouri. Le sol de ces États n'étant point propre aux grandes cultures du sucre et du coton, et les denrées qu'on y cultive, le tabac, le chanvre et les céréales n'exigeant en comparaison qu'un nombre peu considérable de travailleurs, les esclaves y sont nourris principalement en vue de l'exportation. L'élève de cette espèce particulière de bétail est devenue une branche importante de la production. Les éleveurs l'ont organisée sur une échelle immense. Non-seulement ils s'attachent à la développer de manière à proportionner leurs approvisionnements aux demandes croissantes des États du Sud, mais encore ils donnent une attention toute spéciale à l'amélioration de leurs produits. Ayant remarqué que les mulâtres se vendent mieux que les nègres, ils ont encouragé, même par des primes, le mélange des races. Le meilleur sang de la Virginie coule dans les veines des esclaves, dit un des témoins cités dans l'enquête, le R. M. Paxton, et l'on rencontre fréquemment des esclaves entièrement blancs. Il faut être connaisseur pour les distinguer des blancs de race pure. Témoin cet avis copié textuellement dans les annonces d'un journal du Sud, où l'on en rencontre fréquemment de semblables :
« 100 dollars de récompense seront accordés à celui qui me ramènera mon nègre, Edmond Kennedy. Il a les cheveux droits et le teint tellement blanc, qu'on croirait qu'il n'a pas une goutte de sang africain dans les veines. Il a déjà été pris, mais il s'est fait relâcher en se donnant pour un blanc.
« Richmond (Virginie), Anderson Bowles. »
L'élève des esclaves donne communément des profits élevés. Au témoignage des intéressés eux-mêmes, aucune propriété n'est d'un meilleur rapport que celle des jeunes négresses lorsqu'elles sont saines et fécondes. Aux yeux des éleveurs, la fécondité est naturellement regardée comme la plus précieuse des vertus : la stérilité, au contraire, est quelquefois considérée comme un crime. On fouette les négresses stériles ; on fouette aussi les mères dont les enfants meurent. [113] La valeur d'un esclave adulte est, en moyenne, de 600 dollars. Toutefois le prix des esclaves est sujet à des variations considérables : ces outils vivants de la production se vendent plus ou moins cher selon l'état du marché du coton et du sucre ; lorsque ces articles sont très demandés, le prix des esclaves s'élève ; lorsqu'ils le sont peu, les esclaves se vendent a vil prix. Comme tous les autres producteurs, les éleveurs d'esclaves s'efforcent d'augmenter leurs débouchés et de se préserver de la concurrence étrangère. Ce sont les éleveurs de la Virginie et de la Caroline qui ont été les plus ardents à demander l'annexion du Texas, et qui se sont montrés, en toute occasion, les plus chauds adversaires de l'importation des nègres d'Afrique.
Le commerce des esclaves n'est pas moins profitable que l'élève. Deux classes d'individus se trouvent engagées dans ce trafic : des capitalistes qui possèdent des établissements considérables à Washington, à Alexandrie, à Baltimore, à Norfolk, à Richmond, etc., et des agents ou courtiers qui vont acheter les esclaves dans les plantations. Le commerce en gros des esclaves est considéré comme aussi honorable qu'un autre : les hommes les plus notables des États-Unis, des magistrats, des membres du clergé, ne se font aucun scrupule d'y engager leurs capitaux. Feu le président Jackson, par exemple, achetait des cargaisons d'esclaves dans le Nord pour les revendre dans le Sud. Les agents secondaires et les courtiers ont, en revanche, une assez mauvaise réputation : ceux-ci vont acheter, à des époques périodiques, les esclaves dans les plantations. En faisant leurs achats, ils n'ont aucun égard aux liens de parenté ou d'affection qui peuvent exister entre les esclaves. Les enfants sont communément séparés de leurs mères, parce qu'ils n'ont presque aucune valeur dans le Sud; on attend, pour les y transporter, qu'ils aient acquis la plus grande partie de leur croissance et de leurs forces. Après l'achat dans les plantations, les esclaves sont dirigés par détachements vers leur destination ; les prisons des États servent d'entrepôts, et naguère encore une partie de la prison nationale de Washington était affectée à cet usage. Les principaux trafiquants possèdent aussi des entrepôts particuliers : ce sont des prisons solidement bâties, moitié forteresses, moitié écuries ; de ces entrepôts les esclaves sont dirigés vers le Sud. Il y a trois principaux modes [724] de transport : 1° par les navires de cabotage, le long des côtes, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, ou jusqu'aux ports intermédiaires ; 2° par les bateaux à vapeur de l'Ohio et du Mississipi jusqu'à la Nouvelle-Orléans; 3° par la voie de terre. Ce dernier mode de transport est le plus pénible. Les esclaves, enchaînés deux à deux, sont disposés en longues files et escortés par des gardiens armés jusqu'aux dents, et tenant à la main un long bâton. A leur arrivée, les esclaves sont conduits au marché et exposés en vente. On les vend en détail ou par lots. Ordinairement aussi la vente a lieu à la criée.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le commerce intérieur des esclaves est parfaitement libre.
C'est principalement dans la Caroline du Sud, dans la Géorgie et dans l'Alabama que sont consommés les esclaves importés de la Virginie et des autres États éleveurs. On les y emploie surtout à la culture du coton et du sucre. Les plantations comprennent ordinairement plusieurs milliers d'acres de terre, et elles sont exploitées par plusieurs centaines d'esclaves. Le plus grand nombre des propriétaires de ces immenses exploitations se contentent d'en toucher les revenus, et ils se fient pour le reste à leurs intendants et à leurs contremaîtres. On conçoit que ce système soit peu favorable aux esclaves : les contre-maîtres, choisis dans les rangs inférieurs de la population blanche, ne se distinguent point parleurs sentiments d'humanité; d'ailleurs, leur intérêt n'est point d'être humains. Leur réputation se proportionne au rendement de la plantation, et leur salaire se proportionne à leur réputation. Or, pour obtenir de bons produits, il faut extraire un maximum de travail d'un nombre minimum d'esclaves.
D'après les documents que nous avons sous les yeux, [114] la durée du travail dans les États du Sud serait beaucoup plus considérable que dans la plupart des autres pays à esclaves. En été, la moyenne serait de 15 heures par jour et de 14 en hiver; aussi les esclaves succombent-ils promptement sous le faix. La vie moyenne d'un esclave importé dans le Sud n'excède pas quatre ou cinq ans ; on estime que le déchet annuel d'une plantation d'esclaves est de 2 1/2 pour 100. Ce travail excessif imposé aux femmes aussi bien qu'aux hommes fait obstacle à la reproduction. L'esclavage disparaîtrait promptement des États producteurs, par le fait de l'extinction de la population esclave, s'il n'était incessamment alimenté par les importations des États éleveurs. La mauvaise nourriture des esclaves, l'insuffisance de leurs vêtements, l'insalubrité des misérables huttes qu'ils habitent pêle-mêle, les traitements cruels qu'ils subissent, contribuent encore à augmenter le déchet des habitations. Peu de planteurs consentent à faire les frais d'un médecin pour leurs esclaves. L'un d'eux, le colonel Robert Watkins, de l'État d'Alabama, propriétaire d'environ 300 esclaves, après avoir eu pendant quelque temps un médecin à son service, le congédia en alléguant qu'il lui en coûterait moins de perdre quelques esclaves de plus que de continuer à entretenir un médecin.
Cependant la question de savoir s'il est préférable d'abuser du travail des esclaves ou de ménager leurs forces a été maintes fois agitée; mais il semble que la solution la plus humaine n'ait jamais été considérée comme la plus économique. Les partisans du travail à outrance allèguent la difficulté de trouver des travailleurs supplémentaires dans la saison des récoltes, et l'embarras qu'occasionnent les vieillards sur les plantations; à quoi ils ajoutent que les esclaves seraient plus enclins à la révolte s'ils étaient moins chargés de travail.
Le système dont nous venons d'esquisser les principaux traits ne se maintient, comme bien on suppose, que par la terreur. Les esclaves sont soumis à une discipline draconienne et fouettés sans merci pour la moindre faute : on leur défend de s'éloigner hors de la vue de l'habitation ; on leur défend aussi, sous les peines les plus rigoureuses, de se rassembler en dehors des heures de travail. Chaque habitation a son code particulier, ses tortures particulières : ici on oblige les esclaves récalcitrants à porter un collier comme les chiens de basse-cour; là on les marque à la joue avec un fer rouge ; ailleurs on leur broie les rotules avec un tourniquet. Un des supplices que l'on inflige le plus communément aux esclaves échappés consiste à leur arracher les dents de devant. Cependant les évasions sont fréquentes, surtout depuis l'établissement des chemins de fer. Les propriétaires vont à la chasse des runaways avec des chiens dressés à chasser le nègre ; l'éducation de ces animaux est devenue une spécialité lucrative. Les chasseurs ne se font aucun scrupule de tirer des coups de fusil aux runaways; ils mettent toutefois leur adresse à ne leur casser aucun membre, afin de ne point trop en diminuer la valeur. [115]
Les législatures des États particuliers ont décrété, à la vérité, différentes lois pour protéger les esclaves contre les cruautés de leurs maîtres ; mais ces lois sont généralement considérées comme non avenues. Elle sont d'ailleurs pleines de réticences et d'exceptions. Ainsi, par exemple, la législature de la Caroline du Nord décréta, il y a quelques années, que le meurtre prémédité d'un esclave serait puni des mêmes peines que celui d'un homme libre ; mais le dernier article du décret adoucissait singulièrement cette sévérité.
[723]
« Cependant, y lisons-nous, cet acte ne sera pas applicable au meurtre d'un esclave placé hors la lui, en vertu de quelque acte de l'assemblée de cet État, ou d'un esclave tué en résistant aux injonctions de son contre-maître ou de son maître, ou d'un esclave qui serait mort en subissant une correction modérée. »
La législation des États du Sud établit une grande différence, quant à la pénalité, entre les crimes des esclaves et ceux des hommes libres. Dans son aperçu des lois de l'esclavage, le juge Stroud dit qu'en vertu des lois de la Virginie il y a soixante-onze crimes pour lesquels les esclaves sont punis de la peine capitale, tandis que les blancs qui commettent ces crimes ne sont passibles que d'un simple emprisonnement. Dans la Caroline du Sud, les esclaves sont punis de mort pour neuf sortes de crimes, de plus que les blancs; dans le Kentucky pour sept ; dans la Géorgie pour six. On ne saurait dire non plus que les mœurs valent mieux que la législation. Lorsqu'un esclave blesse ou tue un blanc, on lui applique communément, et de la manière la plus cruelle, la lynch law. On l'attache au pied d'un arbre, on l'entoure de fagots et on le brûle vif sans autre forme de procès.
Il est presque superflu d'ajouter que les esclaves ne reçoivent aucune éducation. Dans plusieurs États, l'instruction des esclaves est formellement prohibée par la loi, et toute tentative dirigée dans ce sens est sévèrement punie. Une loi de la Caroline du Sud, passée en 1800, autorise à infliger vingt coups de fouet à tout esclave trouvé dans une réunion ayant pour objet « l'instruction mentale, » tenue même en la présence d'un blanc. Une autre loi soumet à une amende de 100 doll. tout individu qui apprendrait à écrire à un esclave. Un acte de la Virginie, daté de 1829, déclare que toute assemblée d'esclaves ou toute école de jour ou de nuit, où on leur apprendrait à lire et à écrire, est une réunion illégale, et que tout agent de l'autorité a le droit de faire infliger vingt coups de fouet aux esclaves trouvés dans une assemblée de cette nature. Dans la Caroline du Nord, le crime d'apprendre à lire ou à écrire à un esclave ou de lui vendre un livre (la Bible non exceptée) est puni de trente-cinq coups de fouet, si le coupable est un nègre libre, et d'une amende de 200 dollars si le coupable est un blanc. Le préambule de la loi justifie de la manière suivante ces pénalités : « Apprendre aux esclaves à lire et à écrire, y est-il dit, tend à exciter la désaffection dans leur esprit et à produire le désordre et la rébellion. » Dans la Géorgie, si un blanc apprend à lire et à écrire à un nègre libre ou esclave, il devient passible d'une amende de 100 dollars et d'un emprisonnement dont la durée est laissée à la discrétion de la cour; si le coupable est un homme de couleur esclave ou libre, il peut être fouetté et emprisonné à la discrétion de la cour. Un père peut être fouetté pour avoir appris à lire à son propre enfant. Cette loi barbare porte la date de 1829. Dans la Louisiane, la pénalité imposée pour avoir appris à lire ou à écrire à un esclave est d'une année d'emprisonnement. Dans quelques-uns des États les moins importants, dans le Kentucky par exemple, l'instruction des esclaves n'est pas défendue par la loi, mais elle rencontre dans l'opinion un obstacle Insurmontable.
L'instruction religieuse n'est guère mieux traitée que l'autre. A peu d'exceptions près, les gouvernements des États particuliers l'entravent matériellement. Dans la Géorgie, tout agent de l'autorité a le droit de dissoudre une assemblée religieuse composée d'esclaves et de faire administrer vingt-cinq coups de fouet aux esclaves présents. Dans la Caroline du Sud, il est interdit à tout esclave de se rendre à une assemblée religieuse avant le lever ou après le coucher du soleil, à moins que la majorité de la réunion ne soit composée de blancs. Il est bien facile, on le conçoit, que les esclaves sachent d'avance si les blancs seront ou non en majorité dans l'assemblée! Dans la Virginie, toute réunion d'esclaves dans un but religieux est sévèrement défendue. Dans le Mississipi, la loi permet au maître de souffrir que son esclave assiste au sermon d'un ministre blanc. [116] Il résulte de ces dispositions des lois du Sud qu'à peine un dixième de la population esclave a reçu les premières notions du christianisme. L'immense majorité demeure plongée dans la primitive idolâtrie. Les propriétaires d'esclaves ont, du reste, trouvé généralement dans les ministres de la religion des complices complaisants. Maintes fois, la chaire a été employée à défendre l'esclavage comme une institution venue du ciel. Des dissertations savantes ont été écrites par des théologiens du Sud pour prouver que l'esclavage était une des institutions des Juifs, que les patriarches possédaient des esclaves et que le Christ et ses apôtres ne se sont jamais élevés contre ce genre de propriété. Des assemblées paroissiales et synodales, d'autres réunions ecclésiastiques ont passé fréquemment des résolutions approbatives de l'esclavage, afin, disent-elles dans leurs préambules, de tranquilliser les consciences des membres de l'Église qui commencent à être troublées par les prédications abolitionistes du Nord. Voici une de ces résolutions, émanée de l'union presbytérienne de Charleston :
« Résolu que, dans l'opinion de cette Église, la possession des esclaves, bien loin d'être un péché aux yeux de Dieu, n'est nulle part condamnée par sa parole sacrée; qu'elle est en harmonie avec les exemples ou avec les préceptes des patriarches, des prophètes ou des apôtres ; qu'elle est compatible avec les sentiments les plus fraternels pour le bien des serviteurs que Dieu a mis à notre charge ; en conséquence, que ceux qui assurent le contraire et qui soutiennent comme un principe fondamental, en morale et en religion, que l'esclavage est injuste, procèdent d'après de faux principes. »
Que les intérêts du Sud aient fait taire la voix de l'humanité dans la question de l'esclavage ; que la servitude se soit présentée au dix-neuvième siècle et dans un pays chrétien sous un aspect aussi hideux que celui sous lequel elle apparaissait dans la Rome païenne, cela ne se conçoit, hélas ! que trop aisément. Chaque fois que des hommes se croient intéressés à faire taire en eux la voix de l'humanité, on ne voit guère qu'ils s'en abstiennent. [726] Mais on s'explique plus difficilement que les États du Nord, où l'esclavage a pu être aboli parce qu'il n'y donnait pas de gros bénéfices, aient consenti à accepter si longtemps la complicité d'un semblable état de choses. Ce fait tient à des circonstances de plusieurs sortes; d'abord à la prépondérance que l'organisation politique de l'Union a donnée aux États du Sud et que ceux-ci se sont efforcés de maintenir à tout prix ; ensuite aux intérêts nombreux qui rattachent le Nord au Midi.
« Pendant longtemps, lisons-nous dans l'enquête que nous avons déjà citée, les produits du travail esclave ne constituèrent qu'une faible portion de la richesse nationale, et l'esclavage demeura relativement sans importance. Mais, graduellement, la culture du coton et celle du sucre, notamment la première, devinrent les grands intérêts du sol. La richesse du Sud s'accrut d'une manière extraordinaire, et les hommes du Nord, avec l'âpre amour du gain qui les caractérise, cherchèrent à avoir leur part dans cette aubaine. Ses manufactures et ses différents genres de commerce s'enrichirent par leurs relations avec le Sud. Ses enfants aventureux, depuis ses fins avocats jusqu'à ses marchands plus fins encore, allèrent chercher fortune dans le Sud. Ses belles filles commencèrent à découvrir que le climat du Nord était trop rigoureux pour leur santé débile, et qu'il leur fallait absolument passer la mauvaise saison sous un ciel moins sévère. Le Sud devint le centre d'attraction de toute l'Union. Ses domaines étaient les plus splendides, ses cultures les plus lucratives, ses mœurs les plus hospitalières. Les planteurs du Sud étaient renommés pour leur hospitalité courtoise, leur chivalry, comme on dit dans le Nord. Ils s'accoutumèrent à héberger pendant la saison d'hiver des milliers de familles qui fuyaient les rigueurs du climat de la Nouvelle-Angleterre, et celles-ci ne pouvaient manquer d'être pleines de reconnaissance pour leurs hôtes. Mais c'était l'esclavage qui permettait aux planteurs d'exercer cette hospitalité princière; c'était l'esclavage qui donnait au Sud ses ressources, son luxe, sa courtoisie et sa générosité chevaleresques. Il était naturel de reporter son admiration des effets à la cause, et l'esclavage finit en conséquence par apparaître aux hommes du Sud et à leurs admirateurs du Nord comme « une institution indispensable. » [117]
Cependant cet engourdissement du sens moral des citoyens du Nord, à l'endroit de l'esclavage, ne devait pas durer toujours. Comme en Angleterre, l'impulsion abolitioniste fut donnée principalement par les sectes dissidentes du protestantisme, notamment par les quakers. En 1832, la première société abolitioniste fut fondée à Boston, dans le Massachusets ; elle ne comptait, à son origine, que douze membres. L'année suivante, la société américaine pour l'abolition de l'esclavage s'établit à Philadelphie. Mais tout d'abord les abolitionistes virent se dresser contre eux la ligue formidable drs intérêts engagés dans l'esclavage. En 1834, leur premier meeting, à New-York, fut dispersé par une populace furieuse. Les plus détestables excès furent commis dans cette émeute anti-abolitioniste. La foule saccagea des églises, envahit et pilla des maisons appartenant à des abolitionistes et à des hommes de couleur. Désignés à la vindicte populaire, les promoteurs de l'agitation abolitioniste furent obligés de s'enfuir de New-York. Cependant la société américaine, loin de se laisser décourager par les fureurs de ses adversaires, redoubla les efforts de sa propagande. Au bout de quelque temps, elle eut des succursales clans tous les États libres, elle organisa des réunions périodiques, subventionna des journaux et fit répandre des tracts par milliers. En mai 1835, elle comptait 225 succursales. En mai 1836, elle en avait 527; en mai 1837, 1,006; en mai 1838, 1,346; en mai 1839, 1,650. Chacune de ces associations abolitionistes possédait en moyenne 80 membres, formant un total de 132,000 adhérents. Depuis cette époque, le mouvement abolitioniste a été sans cesse croissant, et les adhérents se comptent actuellement par centaines de mille pour ne pas dire par millions.
Les abolitionistes américains tournèrent tout d'abord leur attention vers les objets suivants. Ils demandèrent : l'abolition de l'esclavage dans le district de Columbia, où se trouve Washington, la capitale de l'Union, et dans les territoires placés sous la juridiction du congrès; la suppression du commerce des esclaves à l'intérieur, le rejet de toute demande d'annexion de la part d'États à esclaves, et la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Ils s'attachèrent, en outre, à obtenir le rappel de certaines lois oppressives des hommes de couleur dans les États libres, et à faciliter aux esclaves fugitifs les moyens de se réfugier dans ces États ou de passer au Canada. D'abord repoussées avec une colère et un dédain dont on se ferait difficilement une idée par la majorité du congrès, leurs demandes finirent par obtenir les honneurs de la discussion, et par devenir enfin la grande affaire du jour. L'histoire des luttes que les abolitionistes américains ont soutenues au sein du congrès nous entraînerait trop loin. Bornons-nous à ajouter qu'après avoir résisté énergiquement à l'annexion de nouveaux États à esclaves, d'où un certain nombre d'entre eux, qui forment aussi un parti politique, [118] ont pris le nom de free-soilers (partisans du sol libre), ils n'ont pas réussi à empêcher celle du Texas ; mais que cette annexion, qui a eu lieu à la suite d'une guerre sanglante et coûteuse engagée notoirement dans le but de fortifier la prépondérance du Sud, a éveillé toutes les défiances du Nord ; ajoutons encore que la dislocation de l'Union était devenue imminente , il y a deux ans, si M. Clay n'avait réussi à obtenir une trêve momentanée entre les deux partis en leur faisant adopter un compromis. Mais, selon toutes les probabilités, la trêve ne sera pas de longue durée, et si quelque solution inattendue ne se présente point à la satisfaction commune, la rupture de l'Union sortira inévitablement de la question de l'esclavage.
On comptait, aux Etats-Unis, 697,397 esclaves en 1790; 892,406 en 1800; 1,190,930 en [727] 1810; 1,536,127 en 1820; 2,007,913 en 1830; 2,486,138 en 1840, et 3,178,055 en 1850. Ces chiffres Indiquent an accroissement de 28 p, 100 en 1800; de 33 p. 100 en 1810; de 29 p. 100 en 1820; de 31 p. 100 en 1830; de 24 p. 100en 1840, et de 29 1/2 p. 100 en 1850. L'importation des nègres d'Afrique a été pour fort peu de chose dans cette augmentation, car elle a été généralement insignifiante depuis 1808. Elle a recommencé, à la vérité, dans le Texas, où l'insuffisance des bras la rend très avantageuse, et un certain nombre de nègres importés au Texas passent de là dans la Louisiane; mais son influence sur l'accroissement de la population n'en est pas moins demeurée trop faible pour être appréciée.
Dans les colonies espagnoles et au Brésil, les esclaves sont traités avec un peu moins de dureté qu'aux États-Unis. Cela tient d'abord à l'insouciance des maîtres qui sont moins âpres au gain que les Américains du Nord ; cela tient ensuite et surtout à ce que l'importation des nègres d'Afrique a rendu le travail plus abondant sur le marché, d'où il résulte que les maîtres, pouvant acquérir à moins de frais un plus grand nombre de nègres, ne sont pas aussi intéressés à extraire de chacun d'eux un maximum de travail.
Le Brésil a adopté tout récemment des mesures efficaces pour empêcher l'importation de nouveaux esclaves; mais il faut voir dans ces mesures bien moins un progrès de l'esprit abolitioniste qu'une suggestion protectioniste. La prohibition de la traite au Brésil n'est pas autre chose qu'une prime donnée à l'industrie des éleveurs, et elle aura vraisemblablement pour unique résultat au Brésil, comme aux États-Unis, d'aggraver la condition des esclaves.
IV. Conclusion.
Quand on considère la situation actuelle de l'esclavage dans le monde, on demeure frappé de l'inefficacité des efforts qui ont été tentés pour l'abolir d'une manière artificielle. On acquiert la conviction douloureuse que toutes les tentatives que les gouvernements ont dirigées dans ce sens, sous l'impulsion d'une généreuse philanthropie, ont abouti à des résultats diamétralement opposés. Ainsi le plus grand nombre des gouvernements du monde civilisé se sont unis pour empêcher le transport des nègres d'Afrique en Amérique, et ils n'ont réussi qu'à augmenter les profits des négriers et les souffrances des victimes de la traite. Les gouvernements d'Angleterre et de France ont aboli l'esclavage dans leurs colonies, et le résultat de cette noble initiative a été de doubler le nombre des esclaves au Brésil et dans les colonies espagnoles. A mesure que la production du sucre diminuait dans les colonies émancipées, et que les contribuables de l'Angleterre et de la France, après avoir supporté les frais de l'émancipation, étaient obligés de s'imposer de nouveaux sacrifices en surpayant une denrée qu'ils ne pouvaient plus se procurer en quantité suffisante, on voyait la culture de la canne se développer avec une rapidité fabuleuse au Brésil et à Cuba : des nègres étaient enlevés par centaines de mille à la côte d'Afrique, et tels étaient les bénéfices de la traite, que les croisières entretenues à grands frais sous les tropiques demeuraient impuissantes à la réprimer. Vainement les abolitionistes anglais s’efforcèrent de susciter des entraves artificielles au déplacement de l'esclavage en demandant, avec le maintien des droits prohibitifs sur le sucre esclave, rétablissement d'un droit de faveur sur le sucre libre; l'Angleterre était lasse d'un système qui avait abouti à tant de désastres, et après s'être imposé les plus lourds sacrifices pour abolir l'esclavage, elle finit par lui accorder une prime d'encouragement extraordinaire en abaissant indistinctement les droits qui grevaient chez elle l'importation des sucres étrangers.
Quelle conclusion faut-il tirer de ce déplorable échec d'une des plus généreuses entreprises qui honorent les temps modernes? Que l'abolition de l'esclavage est impossible? Nullement. Il faut en conclure simplement que les gouvernements n'ont pas la puissance d'abolir l'esclavage, ce qui est fort différent. Déjà la même impuissance a été constatée lorsque des gouvernements ont entrepris de soulager la misère : l'expérience a démontré que leur intervention bienveillante, intervention sollicitée par une philanthropie généreuse, mais peu éclairée, avait eu pour unique résultat d'étendre et d'aggraver cette plaie sociale ; est-ce à dire cependant que la misère ne puisse être soulagée?
Si les abolitionistes, au lieu de réclamer incessamment l'intervention active des gouvernements dans l'affaire de l'esclavage, avaient agi d'après des errements opposés, ils auraient obtenu des résultats autrement efficaces. Supposons, par exemple, qu'ils eussent dit aux gouvernements: Vous intervenez dans la question de l'esclavage en accordant aux possesseurs d'esclaves de vos colonies l'appui des forces militaires de la métropole et l'exploitation exclusive de son marché. Eh bien ! privez-les de ces deux avantages qui vous rendent leurs complices: cessez de leur accorder le bénéfice de cette double intervention, et fiez-vous à nous pour le reste ! Laissez-nous soulever l'opinion du monde civilisé contre l'immoralité de l'esclavage ! Laissez-nous organiser une ligue volontaire pour interdire la consommation du sucre esclave! Que serait-il résulté de là?
Si l'intervention armée des métropoles avait été refusée aux planteurs des colonies, n'auraient-ils pas été intéressés à mieux traiter leurs esclaves, en vue de leur propre sécurité? N'auraient-ils pas été intéressés à se concilier leur affection en leur accordant une part de liberté et de propriété de plus en plus considérable? S'ils avaient été privés du monopole du marché de la métropole, s'ils avaient été soumis à la concurrence des autres producteurs, libres ou esclaves, des denrées similaires, n'auraient-ils pas été encore vivement stimulés à faire progresser leur industrie? Or comment obtenir ce résultat sans intéresser davantage les esclaves à la production, sans accorder une part de plus en plus libérale au pécule, partant à la possibilité du rachat?
D'un autre côté, en organisant dans toutes les parties du monde civilisé une ligue volontaire contre la consommation des produits du travail esclave, les abolitionistes n'auraient-ils pas encouragé le développement de la production libre, et [728] stimulé énergiquement, par là même, la transformation de l'esclavage?
Malheureusement, les abolitionistes, imbus, comme la plupart des philanthropes, des erreurs du système réglementaire, convaincus que l'intervention des gouvernements seule pouvait mettre fin à l'esclavage, les abolitionistes ont suivi une tout autre voie : ils ont sollicité les gouvernements de prendre des mesures prohibitives contre l'esclavage, et ces mesures qui s'aheurtaient à un fait économique d'une irrésistible puissance, savoir la demande croissante du sucre, du coton et des autres denrées tropicales, n'ont eu d'autre résultat que de déplacer l'esclavage en l'aggravant. Les abolitionistes commencent, du reste, à s'apercevoir qu'ils ont fait fausse route, et ils s'efforcent de revenir sur leurs pas. En Angleterre, la société pour l'abolition de l'esclavage a presque renoncé à l'idée de la répression de la traite, et elle dirige principalement ses efforts du côté du disuse (privation volontaire) des produits du travail esclave. [119] Aux États-Unis, les free-soilers se bornent à demander que l'esclavage ne puisse être autorisé dans les nouveaux États, et ils s'attachent particulièrement à encourager la production libre du coton et du sucre. Un fait nouveau, que nous avons déjà signalé dans l'article Émigration, nous paraît de nature à seconder d'une manière efficace leurs efforts dans ce sens, c'est l'émigration naissante des Chinois sur le revers occidental du continent américain. Si ce courant d'émigration volontaire continue à se développer, si les Chinois s'adonnent à la culture des denrées tropicales en Amérique, comme ils le font dans le midi de la Chine et dans les archipels de l'Inde, leur concurrence active et intelligente obligera les planteurs des États du Sud à mieux traiter leurs esclaves, à les stimuler au travail par l'appât du pécule et la perspective du rachat; puis, en définitive, à substituer la culture libre à la culture esclave. C'est ainsi que l'esclavage a été aboli en Europe ; c'est ainsi qu'il pourra l'être encore en Amérique.
S'il est, en effet, une vérité économique bien démontrée, c'est que le travail libre est supérieur au travail esclave; c'est qu'un homme, si faible et si obscurcie que soit son intelligence, produit plus et mieux sous le stimulant de son intérêt que sous le stimulant du bâton. Si les résultats déplorables de l'émancipation de Saint-Domingue, et, plus tard, de l'abolition de l'esclavage dans les autres colonies des Indes occidentales semblent, au premier abord, infirmer cette vérité, elle n'en ressort pas moins d'un examen plus approfondi de la question. Il est bien vrai que la production a baissé à Saint-Domingue, et que ce magnifique pays est en train de retourner à la barbarie, mais pourquoi? Est-ce parce que les nègres sont devenus libres? Non! c'est surtout parce qu'ils ont exclu les blancs des fonctions supérieures de la société, qu'ils étaient eux-mêmes peu capables de remplir. De même si la production a baissé aux Antilles anglaises et françaises, après l'émancipation, est-ce à dire que le travail des émancipés valût moins que celui des esclaves? Pas davantage. C'est que ce travail ne s'offrait pas en quantité suffisante,- c'est que le travail libre était en déficit sur le marché, circonstance qui permettait aux travailleurs d'en surélever le prix. Cette observation est si vraie, que dans les colonies où la population noire était la plus dense et dans celles où les immigrations libres pouvaient venir combler, avec le plus de facilité, le déficit de l'approvisionnement de travail, la crise de l'émancipation a été à peine sentie. Que le travail libre puisse se multiplier et s'offrir en quantité suffisante dans les contrées que la nature a rendues spécialement propres à la culture du sucre, du coton, du café, du tabac, et le travail esclave finira inévitablement par disparaître sous la concurrence de ce travail supérieur.
Une dernière question est fréquemment soulevée au sujet de l'esclavage. On se demande si l'esclavage n'a pas été utile à certaines époques et dans certaines contrées ; s'il n'a pas contribué au développement de la richesse et aux progrès di la civilisation; si, par conséquent, certains hommes n'ont pas pu légitimement, en invoquant l'intérêt de la société, réduire d'autres hommes en esclavage. Beaucoup d'écrivains, même parmi les plus religieux, répondent à cette question d'une manière affirmative. Nous ne saurions trop énergiquement nous élever, pour notre part, contre une doctrine qui serait la négation déplorable de toute idée de droit et de toute saine notion économique. On affirme, par exemple, que l'institution de l'esclavage a rendu service à l'humanité en mettant fin aux sacrifices des prisonniers de guerre et à la primitive anthropophagie. Mais, remarque fort bien Montesquieu, les peuples qui possédaient des esclaves ne se sont-ils pas toujours montrés aussi impitoyables à la guerre, sinon davantage, que ceux qui n'en possédaient point? Quant à l'anthropophagie, n'a-t-elle pas été de tout temps particulièrement répandue en Afrique, cette terre classique de l'esclavage? Enfin l'esclavage n'est-il pas devenu une source inépuisable de guerres et de brigandages, en transformant, la chasse aux [729] hommes en une Industrie profitable? On entreprend encore de justifier l'esclavage en prétendant que l’insuffisance originaire des instruments de la production le rendait Indispensable dans les âges reculés de l'humanité, et l'on cite à l'appui de cette opinion un mot célèbre d'Aristote : Si la navette marchait seule on pourrait se passer d'esclaves. Mais n'est-il pas évident que l'esclavage a été la conséquence et non la cause des premiers progrès des arts de la production? Avant que ces progrès eussent été réalisés, avant que le travail du jour fournît au delà du minimum de subsistance indispensable au travailleur, qui donc aurait eu intérêt à pourvoir à l'entretien des esclaves? L'esclavage n'a pas précédé les progrès des arts de la production, il les a suivis. L'histoire atteste que les travaux agricoles ont été originairement exercés par des mains libres, notamment à Rome ; elle atteste aussi que l'esclavage a partout arrêté les progrès des arts de la production, et que c'est seulement après sa disparition qu'ils ont recommencé à se perfectionner. Cependant, en admettant même que l'esclavage eût facilité le développement de quelques arts matériels, serait-ce une raison suffisante pour le légitimer? Supposons qu'on invente aujourd'hui des machines qui permettent de produire, en plus grande quantité et à moins de frais, un certain nombre de denrées, mais que la masse de la population refuse d'employer ces machines, agira-t-on d'une manière conforme à la justice et à l'utilité générale en la réduisant en esclavage pour la contraindre à s'en servir? Enfin, l'expérience n'a pas ratifié l'observation d'Aristote, puisque l'esclavage a été aboli en Europe longtemps avant que la navette ne commençât à marcher seule.
Le seul cas dans lequel on pourrait justifier l'esclavage serait celui-ci : que des hommes industrieux, continuellement attaqués par des peuples sauvages, les eussent réduits en servitude pour se préserver de leurs agressions. Ce cas a pu se produire, sans doute; mais n'est-ce pas généralement le cas contraire qui s'est présenté? Ne sont-ce pas les barbares qui ont, le plus souvent, réduit en esclavage les hommes industrieux et non pas les hommes industrieux qui ont asservi les barbares?
On se demande, en dernier lieu, si l'esclavage des nègres n'a pas contribué au développement de a richesse dans les temps modernes. Sans aucun doute. Mais supposons que des trafiquants peu scrupuleux, encouragés et subventionnés par des gouvernements qui ne l'étaient pas davantage, n'eussent point importé des esclaves en Amérique; supposons que les territoires si admirablement féconds des latitudes tropicales du nouveau monde fussent demeurés l'apanage exclusif des hommes libres, que serait-il arrivé? Ces territoires étant essentiellement propres à la production de certaines denrées utiles et de plus en plus demandées, le sucre, le café, le tabac, le coton, les travailleurs libres des régions tropicales de l'ancien monde n'y eussent-ils pas été invinciblement attirés comme l'étaient ceux des régions tempérées vers les latitudes septentrionales da nouveau continent? Peut-être les émigrations libres auraient-elles été plus tardives que les importations d'esclaves; mais, au point de vue des progrès de la richesse et de la civilisation, n'auraient-elles pas été plus fécondes? Les Etats du Nord de l'Union-Américaine, où l'esclavage n'a été qu'un accident sans importance, se sont développés plus tard que les colonies à esclaves; mais combien leur développement n'a-t-il pas été plus ample et plus magnifique?
En arrêtant ses regards sur une courte période de l'histoire de l'humanité, on trouvera peut-être que l'esclavage a hâté le développement de la richesse matérielle chez certains peuples; mais en embrassant une période plus vaste, on demeurera convaincu qu'il a ralenti les progrès de la richesse et de la civilisation générales. Au point de vue des intérêts généraux et permanents de l'humanité, l'esclavage apparaît donc comme un fait nuisible en même temps qu'il est inique, et l'économie politique s'accorde avec la philosophie et la morale pour le proscrire.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Traite et commerce des nègres. Paris, 1704, in-12.
Code noir, ow recueil des règlements concernant les colonies et le commerce des nègres. Paris, 1752, 1 vol. in-24 ; 1767, 1 vol. in-4 et 1 vol. in-18.
An historical account of Guinea, ils situation, produce, etc.; with an inquiry into the rise and progress of the slave trade, ils nature and lamentable effects. — (Relation historique de Guinée; sa situation, ses produits, etc. ; suivie de recherches sur l'origine et les progrès de la traite des nègres, sa nature et ses effets déplorables), par Anthony Benezet. Londres, 1772, in-8.
Réflexions sur l'esclavage des nègres, par Caritat, marquis de Condorcet. (Publié sous le pseudonyme de Schwartz.) Paris,Troulté, 1781 ; aunes éditeurs, 1788.
Réflexions sur la traite et l'esclavage des noirs. Traduit de l'anglais par A. Diannyère. 1788.
Report of the lords of the committee of council for trade, etc. — (Rapport des lords du comité du conseil du commerce..., particulièrement relatif à la traite des esclaves, ses effets sur l'Afrique, les Indes occidentales et le commerce général du royaume). Londres, 1789, 4 gros vol. in-folio. « Cette volumineuse compilation, dont le contenu ne doit cependant être reçu que sous réserve, renferme une immense variété de détails sur la traite des esclaves, sur leur traitement dans les colonies, etc. » (M. C.)
La cause des esclaves nègres, par AI. Frossard. Lyon, 1789, 2 vol. in-8.
Discours sur cette question : Comment l'abolition progressive de la servitude en Europe a-t-elle influé sur le développement des lumières et des richesses des nations? Ouvrage qui a été distingué honorablement par l'Institut national, par J.-J. Leuliette. Paris et Versailles, Mme Locard, 1805, in-8.
A Letter on the abolition of the slave trade, etc. — (Lettre sur l'abolition de la traite les esclaves), par William Wilberforce. Londres, 1807, 1 vol. in-8 (voyez Wilberforce).
Nouvelles réflexions sur la traite des nègres, par J.-C.-L. Simonde de Sismondi. Genève et Paris, Paschond, 1815, in-8.
De l'intérêt de la France à l'égard de la traite des nègres, par J.-G.-L. Simonde de Sismondi. La 3e édition est augmentée de Nouvelles réflexions sur la traite des nègres. Genève et Paris, Paschoud, 1815, in-8.
The history of the rise, progress, and accomplishment of the abolition of the slave trade. — (Histoire de l'origine, des progrès et de l'accomplissement de l'abolition de la traite des esclaves), par Thomas Clarkson. Londres, 1808, 2 vol. in-8; nouvelle édition augmentée, Londres, 1808, 1 vol. in-8. On sait que Th. Clarkson est l'un des abolitionistcs les plus distingués.
[730]
The slavery of the british West-India colonies, as it exists both in law and practice, etc. — (L’esclavage dans les colonies anglaises des Indes occidentales, tel qu'il existe selon les lois et la pratique, etc.), par James Stephen, sous secrétaire d’État pour les colonies. Londres, 1824-30. 2 vol. in-8.
Discours prononcé dans la chambre des communes d'Angleterre à l'appui de la motion pour l'adoucissement et l'extinction graduelle de l'esclavage dans les colonies anglaises, par J. Buxton, précède d'une introduction sur l'état des esclaves dans ces colonies, par Ch. Coquerel, l'un des secrétaires de la Société. Traduit de l'anglais, 1824.
De l'esclavage des noirs et de la législation coloniale, par Victor Schœlcher. Paris, Paulin, 1833, I vol. in-8.
An inquiry into the state of slavery among the Romans. — (Recherches sur l'état de l'esclavage parmi les Romains), par William Blair. Edimbourg, 1833, 1 vol. in-12. « C'est un petit ouvrage savant et d'un grand mérite. » (M. C.)
Discours sur la constitution de l'esclavage en Occident pendant les derniers siècles de l'ère païenne, par P. de Saint-Paul, substitut du procureur général à Montpellier. Montpellier, impr. de J. Martel, 1837.
Esclavage et traite, par M. Agenor de Gasparin. Paris, Joubert, 1838, 1 vol. in-8. L'auteur a publié peu après dans la Revue des Deux-Mondes (juin 1838) un article intitulé : Des tentatives d'émancipation dans les colonies.
De l'affranchissement des esclaves et de ses rapports avec la politique actuelle, etc., par le même. Paris, Joubert, 1839, in-8.
Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l'émancipation anglaise, par M. Victor Schœlcher. Paris, Pagnerre, 1839, 2 vol. in-8.
De l'émancipation des esclaves, lettres à M. de Lamartine, par Granier de Cassagnac. Paris, Delloye, 1840, in-8.
The african slave trade and its remedy. — (La traite des esclaves et les moyens d'y remédier), par M. Fowell-Buxton. Londres, 1810.
De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident; examen des causes principales qui ont concouru à l'extinction de l'esclavage ancien dans l'Europe occidentale, etc., par Ed. Biot. Paris, Jules Renouard et Comp., 1840, in-8.
Execution de l'ordonnance du 5 janvier 1840 relative à l'instruction religieuse et au patronage des esclaves, exposé sommaire imprimé par ordre du ministre de la marine. 1re partie, 1839; 2e partie, 1840 et 1841. Paris, 1841-42, 2 vol.
Colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage, par M. Victor Schœlcher. Pagnerre, 1 vol. in-8.
Recherches statistiques sur l'esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer, par M. Moreau de Jonnès. Paris (Guillaumin), 1842, 1 vol. in-8.
Some account of the trade in slaves from Africa, etc. — (De la traite des nègres depuis son introduction dans l'Europe moderne jusqu'à nos jours, surtout par rapport aux efforts faits par le gouvernement français pour son abolition, par James Bandinel. Londres, 1842, 4 vol. in-8. « Ouvrage concis et bien écrit sur les matières annoncées par le titre. » (M. C.)
Questions relatives à l'abolition de l'esclavage ; avis des conseils coloniaux, etc., publiés par le ministre de la marine. Paris, Impr. royale, 1843, 1 gros vol. in-4.
Commission instituée pour l'examen des questions relatives à l'esclavage et à la constitution politique des colonies. Vol. 1, Procès-verbaux ; vol. II, Rapport au ministre de la marine et des colonies. Paris, 1848, in-4.
Rapport sur les questions coloniales adressé au duc de Broglie, président de la commission coloniale, à la suite d'un voyage fait en Guyane pendant les années 1838 et 1839, par J. Lechevalier. Publié par le ministre de la marine. Paris, Impr. royale, 1843-1844, 2 vol. in-folio.
Procès de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises; rapports recueillis par le département de la marine et des colonies. Quatre publications. Paris, Impr. loyale, 1840 à 1843, 4 vol. in-8.
Exposé des motifs, rapports et débats des Chambres législatives, contenant les lois des 18 et 19 juillet 1845, relatives au régime des esclaves, etc. Paris, 1845, 1 vol.
Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années, par Victor Schœlcher. Paris, Pagnerre, 1843-46, 2 vol. in-8.
De l'esclavage en général et de l'émancipation des noirs, par M. Castelli, ancien préfet apostolique de la Martinique, 1 vol. in-8. Voy. le Journ. des Écon., t. IX, p. 390.
Lettre à M. de Broglie sur les dangers de l'émancipation des noirs, par M. Petit-Baroncourt. Paris, Amyot, 1845, 1 vol. in-18. Voy. Journ. des Écon., t. XI 1, p. 186.
Situation des esclaves dans les colonies françaises, par M. Bouvellat de Cussac. Paris, Pagnerre, 1845, 1 vol. in-8.
Compte-rendu sur l'emploi des fonds alloués depuis 1839 pour l'enseignement religieux et élémentaire des noirs et de l'exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 relatives au régime des esclaves. Paris, Impr. roy., I846, 1 vol.
Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, par M. G. de Molinari. Paris, Capelle, 1846.
Discussion des pétitions pour l'abolition complète et immédiate de l'esclavage. Séances de la chambre des députés des 24, 26 avril et 7 mai 1847. Paris, Duverger, 1847, in-8.
Compte-rendu de l'exécution des lois des 18 et 19 juillet 1834 sur le régime des esclaves, la création d'établissements agricoles par le travail libre. Paris, 1847, 1 vol.
De l'esclavage et des colonies, par Gustave du Puynode, docteur en droit. Paris, Joubert, 1847, in-8.
Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, précédée d'une introduction intitulée : De l'esclavage dans les colonies par M. H. Wallon. Paris, Dezobry, E. Magdeleine. 1847, 4 vol. in-8.
Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail servile dans les républiques grecques et romaine, par M. Moreau-Christophe. Paris, Guillaumin et comp., 1849, 1 vol. in-8.
Annual report of the british and foreign anti-slavery society, etc.— (Rapport annuel de la société pour l'abolition de l'esclavage, etc.). Londres, imprimé aux frais de la société. Le 12 e rapport a paru en 1851, et le premier en 1840. On y trouve des renseignements précieux sur la situation de l'esclavage des nègres, sur la traite, sur les progrès de la cause de l'émancipation, etc. La rédaction de ces rapports est due à M. John Scoble, secrétaire de la Société.
Anti-slavery reporter (journal hebdomadaire publié par la Societé anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage).
Consulter encore A. Smith, Richesse des nations, vol. I, p. 89, 112, 480 j vol. II, p. 207, 338 de l'édit. Guillaumin ; Bœckh, Economie politique des Athéniens ; Dureau de la Malle, t. I, p. 230, Économie politique des Romains; Charles Comte, Traité de législation (4e vol.); J.-B. Say et plusieurs autres économistes ont également traité la question de l'esclavage. Les faits les plus récents sur cette matière se trouvent dans le Journ. des Econ., vol. IX, p. 486; XVIII, 197; mais surtout vol. XX, p. 209; [731] XXI, 152, 396; XXV, 184, 384, 385; XXVI, 58. Voir également la bibliographie de l’article Colonies.
Endnotes to Esclavage
[100] Traité de législation, par Charles Comte, t. III, I. v, chap. Il, p. 469.
[101] Traité de législation, par C. Comte, t. IV, I. v, c. vii.
[102] Economie politique des Romains, par Dureau de la Malle, t. 1, p. 266. Voir aussi un mémoire du savant Heyne : Opusc. acad., t. IV, p. 120
[103] Écon. pol. des Athéniens, par Bœckh, t. I, p. 61.
[104] ld., p. 122. La drachme athénienne valait fr. 0,92. La mine fr. 91,66. Le talent fr. 5,500.
[105] Id., p. 114 et 118.
[106] Le travail de l'esclave n'était évalué qu'à la moitié de celui de l'homme libre. Économie politique des Romains, par Dureau de la Malle, t. 1, p. 151.
[107] Appian., bell. civ., t. I, p. 7.
[108] Ces tableaux sont empruntés aux documents parlementaires de la Grande-Bretagne. Ils figurent dans le 10e rapport de la Société anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage.
[109] Déposition du docteur Cliffe citée dans le Journal des Économistes, tome XXI, page 154.
[110] Nous empruntons ces deux tableaux à un Mémoire de M. J.-T. Danson sur les progrès des colonies anglaises de 1827 à 1846. Voir l'analyse de ce travail dans le Journal des Économistes, tome XXV, page 381.
[111] Voici par ordre chronologique les dates de l'abolition de l'esclavage depuis la fin du siècle dernier. L'esclavage a été successivement aboli : aux États-Unis dans les Etals suivants: Vermont, en 1777; Pensylvanie, 1780; Massachusetts, 1780; Connecticut, 1784; Rhode-Island, 1784 ; New-Hampshire, 1784; New-York, 1799; New-Jersey, 1804. Les républiques de l'Amérique du Sud ont suivi, pour la plupart, ces exemples : Buénos-Ayres, en 1816; la Colombie et le Chili, en 1821 ; la Bolivie, en 1826; le Pérou, Guatemala et Montevideo, en 1828; le Mexique, en 1829; l'Uruguay, en 1843. L'esclavage a été aboli aussi aux Indes orientales en 1843, dans la presqu'île de Malacca et dans le Scinde. En 1844, cette mesure a été étendue à l'établissement de Hong-Kong. En 1846, les états de Suède votaient une somme de 30,000 gourdes (250,000 fr.) pour le rachat des esclaves de la petite ile Saint-Barthélémy. En 1847, le pacha d'Egypte et le bey dé Tunis décrétaient l'abolition de l'esclavage. Enfin, en 1848, la France et le Danemark émancipaient les esclaves de leurs colonies.
[112] Slavery and the internai slave trade in the United States of the North America, being replies to questions transmitted by the committee of the british and foreign anti-slavery Society, etc. 1 vol. in-8.
[113] The following took place on a plantation containing about one hundred slaves. One day the owner ordered the women into the barn : he then went in among them, whip in hand, and told them he meant to flog them all to death. They began immediately to cry out « What have I done massa? what hâve I done? He re-plied : d-n you I will let you know what you have done; you don't breed ; I have not had a young one from one of you for several months. » One of the slaves of another plantation gave birth to a child, which lived but two or three weeks. After his death the planter called the woman to him, and asked her how she came to let the child die ; said it was all owing to her carelessness, and that he meant to flog her for it. She told him, with ail the feeling of a mother, the circumstances of its death; but her story availed her nothing against the savage brutality of her master : she was severely whipped. A healthy child, four months old, was then considered worth one hundred dollars in North Carolina. Narrative of M. Caulkins, who spent eleven months in North Carolina. — American slavery, page 35.
[114] Slavery and the internai slave trade in the United States of North America.
[115] Nous avons sous les yeux plusieurs récits de ces sortes de chasses empruntés aux journaux du Sud, qui en rapportent les détails comme nos journaux racontent ceux de la chasse aux animaux nuisibles. Nous en reproduisons deux comme échantillons:
« Un esclave fugitif a été découvert jeudi auprès du saut de "Washington, dans une pièce de bois où il s'était creusé une espèce de terrier dont l'entrée était masquée avec des feuillages. Lorsque le fugitif s'aperçut que son gîte était découvert, il essaya de fuir; mais M. Adams et ses excellents chiens se mirent aussitôt à le poursuivre, et, en quelques minutes, ils eurent réussi à le forcer. C'était un esclave échappé depuis plus d'une année. » (Maçon Telegraph.)
« Il y a deux jours, un gentleman de cette paroisse, en chassant des esclaves, découvrit leur campement dans les marais de l'île du Chat. Il réussit à en arrêter deux; mais le troisième se sauva à la nage. Il lui tira un coup de fusil et le blessa à l'épaule. Néanmoins le fugitif continuait à nager, lorsque les chiens l'atteignirent et réussirent à se rendre maîtres de lui. » (Chronicle of St-Francisville.)
[116] Jay’s inquiry, pages 136-37.
[117] Slavery and the internal slave trade, page 233.]
[118] On trouvera le programme du parti des free-soilers dans le onzième rapport annuel de la Société anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage. 1850.
[119] Dans son 10e rapport annuel (1849), le comité directeur de la Société omettait les conclusions suivantes: 1° Que les fonds appliqués récemment à la répression de la traite fussent employés à développer la production libre dans l'Inde anglaise ; 2° Que le gouvernement insistât auprès des gouvernants de l'Espagne et du Brésil pour obtenir l'exécution des traités par lesquels ces deux gouvernements se sont engagés à empêcher l'importation des nègres esclaves ; 3° Que des droits différentiels fussent établis en faveur du sucre, produit du travail libre; 4° Que les partisans de l'abolition de l'esclavage s'abstinssent désormais de consommer les produits du travail esclave.
Une pétition fut en même temps adressée à la reine par les dames abolitionistes pour lui demander de donner l'exemple du « disuse » des produits du travail esclave. Les signataires de la pétition rappelaient à la reine qu'à l'époque où le commerce des nègres s'exerçait encore en Angleterre, 300,000 individus s'étaient engagés volontairement à s'abstenir de sucre. La privation serait moindre actuellement puisqu'il ne s'agirait que de donner la préférence au « free-grown sugar. »
Cette pétition des dames abolitionistes était revêtue de 39,688 signatures. Elle figure dans le deuxième rapport de la Société pour l'abolition de l'esclavage, page 24.
Liberté des échanges (Associations pour la)↩
Source
“Liberté des échanges (Associations pour la)” DEP, T. 2, p. 45-49.
[45]
Le grand mouvement économique dont l'Angleterre donnait le spectacle depuis les réformes de M. Huskisson, la constitution de la Ligue contre les lois-céréales (Voy. Céréales) et la répudiation solennelle du régime protecteur par sir Robert Peel ne pouvaient manquer d'exercer dans le monde une influence considérable. C'était, en effet, l'exemple de l'Angleterre qui avait fourni jusqu'alors aux protectionnistes de tous les pays leurs plus redoutables arguments. Parce que l'Angleterre avait devancé toutes les autres nations dans la carrière industrielle, après avoir adopté le régime protecteur, ils n'hésitaient pas à affirmer que ce régime était le fondement et le palladium de sa prospérité. On les croyait volontiers sur parole, sans se demander si la sécurité intérieure, la liberté civile, politique et industrielle dont l'Angleterre jouissait depuis un siècle et demi, ne donnaient pas beaucoup mieux que les errements empiriques du régime protecteur l'explication du développement extraordinaire de sa puissance productive. Mais voici que les économistes s'avisent de passer le système en vogue au creuset de la science, et qu'ils découvrent que cet or pur n'est autre chose qu'un plomb vil ; voici que de hardis agitateurs, mettant au service de la vérité économique les deux admirables leviers de l'association et de la presse, dénoncent aux masses la grande tromperie du système protecteur, et que les hommes d'État anglais, obéissant au commandement de l'opinion convertie, brûlent ce qu'ils ont adoré et adorent ce qu'ils put brûlé; voici que l'Angleterre foule aux pieds le palladium de la protection pour se lancer, la poitrine découverte, dans la carrière de la concurrence internationale. Qu'allait devenir, après un changement si radical, l'argument irrésistible que l'exemple de l'Angleterre fournissait aux prohibitionnistes? Comment réussiraient-ils à maintenir plus longtemps un système dont la nation la plus avancée dans la pratique des affaires, la plus éclairée sur ses vrais intérêts avait reconnu l'inanité? En se débarrassant du système protecteur, l'Angleterre ne venait-elle pas de donner le signal de la chute de ce système dans le monde entier?
Ces conséquences inévitables de la révolution [46] économique qui s'accomplissait en Angleterre frappèrent vivement le petit nombre de partisans dévoués que la liberté commerciale avait conservés sur le continent. Ils se mirent à suivre avec une attention pleine d'anxiété et d'espérance les péripéties de la grande lutte dont l'Angleterre était le théâtre, et à réveiller autour d'eux les vieux échos de la liberté du commerce. En France, notamment, un économiste encore inconnu, mais qui devait bientôt laisser dans la science une trace brillante, Frédéric Bastiat, raconta l'histoire de la Ligue, et traduisit les principaux discours des ligueurs; [120] un autre, qu'une mort hâtive allait moissonner avant sa fleur, Alcide Fonteyraud, consacra aux travaux des ligueurs deux esquisses éloquentes et pittoresques; [121] enfin, M. Léon Faucher expliqua dans deux chapitres de ses remarquables Études sur l'Angleterre la nature et la portée du mouvement contre les lois-céréales. [122] La presse quotidienne, maintenant édifiée sur l'importance de l'agitation anglaise, commença à s'en préoccuper activement : le Journal des Débats, la Patrie et le Courrier français prirent une attitude décidée en faveur de la liberté du commerce, et ils s'efforcèrent de mettre à l'ordre du jour de l'opinion celte question vitale que des intérêts égoïstes et inintelligents avaient tenue si longtemps dans l'ombre. Dans le midi de la France, où depuis trente ans les fauteurs du régime protecteur avaient accumulé plus de ruines que n'en semèrent jadis les farouches promoteurs de la persécution des Albigeois, les grandes réformes de sir Robert Peel apparurent comme un signal de délivrance, et les principaux organes de l'opinion à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, recommencèrent avec une ardeur nouvelle leurs polémiques contre un régime odieux. Sur ces entrefaites, la Société des Économistes de Paris envoya aux ligueurs anglais une adresse pour les féliciter de la généreuse initiative qu'ils avaient prise, et pour les assurer de toutes les sympathies des amis de la liberté du commerce sur le continent. En même temps, Frédéric Bastiat esquissait, dans un journal du Midi, le plan d'une Ligue française pour la liberté des échanges. Les négociants de Bordeaux avaient déjà, le 10 février 1846, jeté les bases d'une association de cette nature et désigné une commission pour l'organiser. Cette commission, à laquelle Bastiat fut adjoint, offrit la présidence de l'association à M. Duffour-Dubergier, maire de Bordeaux, qui s'empressa de mettre sa haute influence et son expérience des affaires au service des nouveaux ligueurs. Le 23 février, l'association bordelaise était constituée, et elle tenait sa première séance publique. L'élite du commerce de Bordeaux assistait à la réunion, dans laquelle MM. Duffour-Dubergier, Fr. Bastiat, Duchon-Doris et Princeteau prirent successivement la parole. A la fin de la séance, une souscription fut ouverte, et elle produisit une somme de 56 mille francs. [123] Ce premier succès stimula l'ardeur des libres-échangistes [124] parisiens. Le 14 mars, une réunion était convoquée au bureau du Journal des Économistes, chez M. Guillaumin, pour aviser aux moyens de constituer une association à Paris. La présidence de la future association fut offerte à un champion émérite de la cause de la liberté du commerce, M. le duc d'Harcourt, qui accepta. Une commission provisoire d'organisation fut ensuite désignée pour rédiger les statuts et demander au gouvernement l'autorisation nécessaire. L'association se trouva constituée le 1er juillet 1846, et elle tint sa première séance publique dans la salle Montesquieu, le 28 août suivant. [125]
L'exemple de Bordeaux et de Paris ne larda pas à être suivi dans d'autres villes : à Marseille, une association pour la liberté des échanges se constitua le 17 septembre sous la présidence de M. Lazare Luce, président de la chambre de commerce; une autre se forma à Lyon, le 13 octobre, sous la présidence de M. Brosset aine; enfin, le 28 novembre, les libres-échangistes du Havre organisèrent une cinquième association sous la présidence de M. Delaunay.
Ces diverses associations réunirent un capital d'environ 200 mille francs, à l'aide duquel elles commencèrent à agir sur l'opinion. Elles s'entendirent pour fonder un journal hebdomadaire, le Libre-Échange, dont le premier numéro parut à Paris, le 29 novembre 1846, et qui eut d'abord pour directeur Fréd. Bastiat, ensuite M. Ch. Coquelin. La publication du journal le Libre-Échange et les réunions de la salle Montesquieu [47] furent les principaux moyens de propagande de l'association parisienne. Les associations de Bordeaux et de Marseille entreprirent, de leur côté, des publications mensuelles.
Dans l'une des premières réunions du comité provisoire de l'association, le secrétaire général désigne, Fréd. Bastiat, avait été chargé de rédiger une déclaration, destinée à caractériser la nouvelle agitation commerciale. Dans cette pièce, dont la rédaction fut adoptée à l'unanimité, la liberté des échanges était réclamée au nom de la propriété, de la justice, de la paix et de la fraternité des peuples.
« L’échange, disait l'auteur de la déclaration, est un droit naturel comme la propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis un produit doit avoir l'option ou de l'appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l'objet de ses désirs; le priver de cette faculté, quand il n'en fait aucun usage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance d'un autre citoyen, c'est légitimer une spoliation, c'est blesser la loi de la justice.
« C'est encore violer les conditions de l'ordre ; car quel ordre peut exister au sein d'une société où chaque industrie, aidée en cela par la loi et la force publique, cherche ses succès dans l'oppression de toutes les autres.
« C'est méconnaître la pensée providentielle qui préside aux destinées humaines, manifestée par l'infinie variété des climats, des saisons, des forces naturelles et des aptitudes, biens que Dieu n'a si inégalement répartis entre les hommes que pour les unir, par l'échange, dans les liens d'une universelle fraternité.
« C'est contrarier le développement de la prospérité publique, puisque celui qui n'est pas libre d'échanger ne l'est pas de choisir son travail, et se voit contraint de donner une fausse direction à ses efforts, à ses facultés, à ses capitaux, et aux agents que la nature avait mis à sa disposition.
« Enfin c'est compromettre la paix entre les peuples, car c'est briser les relations qui les unissent et qui rendront les guerres impossibles à force de les rendre onéreuses. »
L'auteur de la déclaration demandait en conséquence que la douane fût rendue simplement fiscale; mais il admettait volontiers des ménagements et des gradations dans la réforme :
« Même pour revenir du mal au bien, disait-il, et d'un état de choses artificiel à une situation naturelle, des précautions peuvent être commandées par la prudence. Ces détails d'exécution appartiennent aux pouvoirs de l'État; la mission de l'association est de propager, de populariser le principe. »
L'année suivante, le conseil d'administration de la société consacra de nombreuses séances à la préparation de son programme de réformes ; la rédaction de ce programme fut confiée à M. Michel Chevalier. Nous en reproduisons le résumé où se trouvent nettement indiqués le but et les limites que s'était assignés l'association libre-échangiste :
« I. — Dispositions que la loi mettrait en vigueur immédiatement. —Toutes les prohibitions commerciales à l'entrée seraient levées et remplacées par un droit équivalent à la prime de contrebande, ou dans les cas où ce terme de comparaison n'existerait pas, par un droit spécifique dont le chiffre serait calculé de manière à ne pas excéder 20 p. 100 de la valeur.
« Tous les droits d'entrée seraient réduits de même à un taux dont le maximum répondrait à 20 p. 100, à l'exception des droits sur les denrées dites coloniales, qui, à titre de droits fiscaux, pourraient rester plus élevés.
« Les céréales seraient soustraites au régime de l'échelle-mobile, et soumises à un droit fixe de 2 fr. par hectolitre. Le droit sur farines serait exactement proportionnel,
« Pour le bétail, le tarif de 1816 (3 fr. 30 c. par tête de bœuf) serait rétabli. Les viandes salées de toute espèce seraient exemptes de droits.
« Les droits sur la houille et sur la fonte brute seraient supprimés. Les fers en barres, spécialement destinés à la fabrication de l'acier, seraient affranchis de tout droit; le droit sur l’acier serait ramené au tarif de l'empire (99 fr. les 1,000 kil.).
« Les droits sur plusieurs centaines d'articles, qui ne produisent au trésor que des recettes insignifiantes, seraient supprimés.
« Les distinctions qui font varier les droits selon les qualités et les formes des objets d'une même nature seraient, dans la plupart des cas, abolies.
« Les distinctions de zones et de classes, donnant lieu à des différences de droits, selon les frontières de terre ou de mer où les produits se présentent, seraient abolies.
« Tout droit à la sortie serait supprimé.
« II. — Dispositions qui statueraient pour l'avenir. — A l'expiration d'un délai qui serait déterminé d'avance par la loi même de la réforme douanière, tous les droits d'entrée seraient réduits, par voie d'abaissement graduel, de manière à ce qu'aucun n'excédât 10 p. 100, sauf l’exception ci-dessus, relative aux denrées dites coloniales.
« Les droits d'entrée sur les principales matières premières, et notamment sur les cotons en laine, les laines en masse, les chanvres et les lins bruts, teillés ou peignés, les fers et les aciers en barres, les substances tinctoriales, seraient soumis à une réduction immédiate, et ensuite graduellement diminués, de manière à disparaître à l'expiration d'un délai qui serait déterminé d'avance par la même loi.
« A la même époque, les droits sur les céréales et sur le bétail seraient supprimés.
« III. — Drawbacks. — Les primes à la sortie et les drawbacks seraient de même graduellement supprimés.
« IV. — Dispositions relatives aux colonies. — Les droits fiscaux sur les denrées dites coloniales seraient réduits jusqu'au taux qui, par l'accroissement de la consommation, serait le plus productif pour le trésor.
« L'égalité douanière serait successivement établie entre les produits des colonies françaises et ceux de provenance étrangère.
« V. — Dispositions concernant la navigation. — Les règlements et les tarifs auxquels l'industrie, maritime est soumise seraient changés, de manière à permettre à la marine marchande de [48] s’approvisionner librement des matériaux et des objets de tous genres qui lui sont nécessaires, jusques et y compris les navires tout construits;
« A laisser aux armateurs toute latitude dans les dispositions de leur capital et dans l'organisation de leurs entreprises; et à faciliter les rapports avec les marchés extérieurs, et notamment les relations directes avec les entrepôts étrangers, pour l'importation des produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.
« Une loi spéciale déterminerait la progression suivant laquelle les droits différentiels de pavillon iraient en diminuant, et le délai après lequel ils seraient supprimés.
« VI. — Règlements de la douane. — Les règlements de la douane seraient révisés dans le but de simplifier et d'abréger les formalités, et de faire disparaître diverses clauses gratuitement vexatoires.»
Ce programme était assez modéré pour rallier à la cause de la reforme douanière les protectionnistes les moins arriérés; mais les meneurs du parti ne voulurent faire aucune concession, et ils s'empressèrent de constituer, à leur tour, une association pour résister à l'invasion du libre-échange. Cette association instituée « pour la défense du travail national » s'efforça per fas et nefas de neutraliser les effets de la propagande libre-échangiste. Ses membres les plus sanguins allèrent même jusqu'à menacer le gouvernement de s'allier avec ses ennemis s'il s'engageait dans la voie des réformes douanières; plus tard, ils répandirent force placards dans les ateliers, pour dénoncer les promoteurs de la liberté du commerce comme des agents salariés de l'Angleterre; enfin ils demandèrent la destitution des professeurs d'économie politique, qu'ils accusaient spécialement d'avoir soulevé contre eux la tempête du libre-échange.
Des adversaires qui s'abandonnaient à des violences si puériles n'étaient pas, à la vérité, bien redoutables. Les promoteurs de la cause des réformes n'auraient eu aucune peine à en venir à bout, s'ils avaient trouvé dans l'opinion des éléments plus sympathiques, et s'ils avaient été un peu plus favorisés par les circonstances ; malheureusement ils avaient affaire à un peuple qui, façonné de longue date au régime réglementaire, ne voyait de salut que dans « l'intervention du gouvernement. » Les organes principaux du parti républicain et de la démocratie socialiste, le National, la Démocratie pacifique, l'Atelier, la Revue nationale, s'unirent au Constitutionnel et au Moniteur industriel, organes du parti manufacturier, pour crier haro sur le libre-échange. Le National railla fort agréablement les apôtres de Montesquieu's hall , [126] et les journaux à la suite déployèrent tous leurs efforts pour engager les classes ouvrières à se méfier des disciples de Cobden. Un des organes spéciaux des ouvriers, l'Atelier, qui devait fournir plus tard un vice-président à l'assemblée nationale, n'hésita pas à déclarer que les Bordelais, en prenant l'initiative du mouvement du libre-échange, avaient voulu livrer la France à l'Angleterre.
« Cela s'explique, ajoutait ce journal (N° de septembre 1846), à la seule lecture de la liste des grands propriétaires de la Gironde: les noms anglais y foisonnent... Heureusement que dans le Midi comme ailleurs, !e peuple est étranger aux spéculations de l'aristocratie marchande, et qu'il saura bien mettre des entraves aux projets anti-nationaux. »
Un autre recueil populaire, la Revue nationale, allant plus loin, comparait les promoteurs de la réforme douanière aux piqueurs que la restauration avait employés pour détourner les esprits des préoccupations politiques.
« C'est probablement, disait ce journal (N° d'octobre 1847), pour faire diversion aux banquets réformistes et aux événements qui surgissent de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur, que nos Cobden de la salle Montesquieu sont allés parcourir les départements et ont organisé le congrès économiste de Bruxelles.»
L'auteur de l'article terminait en engageant le peuple à se détourner des « inanités » du libre-échange pour donner toute son attention aux réformes politiques et à l'association des travailleurs.
Il n'est donc pas étonnant que les membres de l'association pour la liberté des échanges n'aient pas réussi à passionner les masses en faveur des réformes douanières ; ils avaient eu le malheur d'être devancés par les socialistes auprès des classes ouvrières, tandis qu'ils voyaient se dresser contre eux, dans les régions supérieures de la société, la ligue tenace des intérêts privilégiés. En présence de cette ligue du socialisme en bas et du protectionnisme en haut, leur propagande se trouva sinon paralysée, du moins rendue singulièrement difficile. A force d'énergie et de persévérance ils auraient réussi, sans doute, à vaincre cette coalition de l'égoïsme et de l'ignorance, mais les événements politiques de février 1848 vinrent leur enlever brusquement la parole. Aux « inanités » du libre-échange succédèrent alors les théories politiques et économiques du socialisme, aux séances du congrès des économistes, les séances de la commission du Luxembourg; bref, les utopies les plus extravagantes eurent un moment le haut du pavé. Dans ce désarroi universel, les membres de l'association pour la liberté des échanges ne perdirent cependant pas courage : ils résolurent de poursuivre leur œuvre sous la république comme ils l'avaient poursuivie sous la monarchie; seulement ils modifièrent leur tactique, en ce sens qu'ils dirigèrent leurs principaux efforts contre l'ennemi qui était maintenant le plus à craindre, contre le socialisme. Dans une réunion tenue, le 16 mars, à la salle Montesquieu, M. Clappier, ancien député de Marseille, et M. Charles Coquelin, flétrirent avec énergie les dangereuses « inanités » de l'organisation du travail, et leurs protestations éloquentes soulevèrent des tempêtes d'applaudissements. Deux jours après (17 mars), une députation de l'association allait demander au gouvernement provisoire la suppression des droits d'entrée sur les substances alimentaires. M. Horace Say portait la parole au nom de la députation, que M. Armand Marrast se chargea d'éconduire poliment. Le mois suivant, l'association désespérant enfin de se faire écouter au milieu de la tourmente politique, renonça à la publication de son journal, et, à quelque temps de là, son comité, dont les événements avaient dispersé les principaux [49] membres, cessa de se réunir; les associations des départements cessèrent de fonctionner vers la même époque.
L'agitation pour la liberté des échanges n'a donc pas abouti en France. Nous venons d'exposer brièvement les causes principales de son insuccès. Les auteurs du mouvement de 1846 ne doivent pas regretter cependant leurs travaux de propagande : ils ont ensemencé un terrain où, en dépit des broussailles du socialisme et de l'ivraie du prohibitionnisme, la liberté germera et fructifiera tôt ou tard. Ils ont semé, d'autres recueilleront; qu'importe, si la moisson profite à l'humanité?
Des associations pour la liberté des échanges se sont organisées aussi en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. L'association belge s'est constituée sous la présidence d'un des vétérans de la cause de la liberté du commerce, M. Ch. de Brouckère ; elle a tenu sa première séance publique à Bruxelles, le 12 octobre 1846. C'est par ses soins que le Congrès des Économistes ( voy. ce mot) a été réuni à Bruxelles les 16, 17 et 18 septembre 1847. Les événements de 1848 ont mis fin à l'existence de l'association belge. L'association prussienne, née vers la même époque, a continué de subsister, et elle a lutté avec énergie, sous la direction de M. John Prince Smith, contre la coalition des manufacturiers du zollverein. L'association américaine pour la liberté du commerce (free-trade league) avait pour président en 1850 l'honorable R.-J. Walker, l'auteur du tarif libéral de 1846.
G. de Molinari..
BIBLIOGRAPHIE.
PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DE BORDEAUX.
Association pour la liberté des échanges. Fondation de la Société. Séance du 23 février 1846. Manifeste. Bordeaux, Couder, 1840. Broch. in-8 de 48 pages. Contient des discours de MM. Duffour, Dubergier, maire de Bordeaux ; Frédéric Bastiat, Duchon-Doris, Princeteau ; le manifeste de l'association et le plan d'action.
Du système prohibitif, par Henri Fonfrède. Paris, (Guillaumin ; Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1846, in-8 de 103 pages, (Voyez Fonfrede.)
Lettre adressée par M. de Cormenin à l'association pour la liberté des échanges de Bordeaux (sur la question des subsistances), ln-8 de 7 pages.
Association pour la liberté des échanges. Extrait d'un rapport de la commission de navigation sur les réformes douanières que réclament les intérêts de la marine marchande, ln-8 de 8 pages.
Le monopole des maîtres de forges, par G. Brunet, secrétaire général de l'association. In-8 de 16 pages.
Lettre adressée à M. le baron Charles Dupin, pair de France, par le même, ln-8 de 8 pages.
L'association de Bordeaux avait aussi entrepris la publication d'un bulletin mensuel composé des meilleurs morceaux publiés sur la matière. Deux numéros seulement ont paru, octobre et novembre 1846, in-8 de 32 pages.
PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DE PARIS.
Association pour la liberté des échanges. Déclaration. ln-4 de 4 pages.
Le Libre-Échange, feuille hebdomadaire de l'association. (Voyez Libre-Échange.)
Association, etc. Première séance publique du l'association pour la liberté des échanges, tenue dans la salle Montesquieu le 28 août 1846; deuxième séance, le 20 septembre 1846. Paris, Guillaumin, 1846, deux broch. in-8 de 40 pages. Septième séance, le 1 janvier 1848. ln-4 de 12 pages à 2 colonnes. La première contient les discours de MM. le duc d’Harcourt, président; Léon Faucher et Blanqui; la déclaration indiquée ci-dessus, signée pur la commission provisoire, et les statuts de l'association. La seconde contient les discours de MM. Anisson-Dupéron, président; Michel Chevalier, Horace Say,Wolowski et Bastiat. La dernière contient Ies discours de MM. Anisson-Dupéron, président; Joseph Garnier, Ch. Coquelin, Bastiat. L'association a tenu huit séances publiques; mais il n'a pas été publie séparément d'autres comptes rendus que ceux que nous venons d'indiquer. Ceux des six dernières séances se trouvent dans le Libre-Échange. Voir aussi des extraits et des résumés de ces séances dans le Journal des Économistes. (Voyez aux tables des matières triennales.)
Programme de réforme douanière proposé par l'association pour la liberté des échanges. Paris, Guillaumin, avril 1847, in-8 de 32 pages; le même, in-18 de 18 pages. Ce programme, signé par le duc d'Harcourt et Frédéric Bastiat comme président et secrétaire au nom de l'association, fut discuté dans le conseil d'administration sur un projet d'exposé des motifs rédigé par M. Michel Chevalier, et sur un projet de loi résumant les demandes de l'association, formulé par M. Joseph Garnier. Au sujet des droits sur les céréales et le bétail, dont le conseil demandait la suppression pour l'avenir, MM. Léon Faucher et Wolowski, qui n'auraient pas voulu une décision aussi absolue, se séparèrent de ce conseil sans se séparer de l'association.
Des forces alimentaires des États, et des devoirs du gouvernement dans la crise actuelle. Extrait de la Revue des deux mondes du 1er juin, et réimprime par l'association pour la liberté des échanges. Paris, Guillaumin. 1847, in-8 de 60 pages. Écrit de M, Michel Chevalier, qui se trouve refondu dans son Examen du système protecteur.
Discours de M. de Lamartine à la reunion publique de l'association pour la liberté des échanges, à Marseille, le 24 août 1847. Paris, Guillaumin, 1847, in-12 de 12 pages.
PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DE MARSEILLE.
Libre-Echange. Association marseillaise. Trois publications, janvier, avril et août 1847, contenant les comptes rendus des séances de l'association, et divers travaux sur des questions spéciales, notamment sur les subsistances. In-4 à deux colonnes, extrait du Courrier de Marseille.
PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION BELGE.
Association belge pour la liberté commerciale. Première séance publique de l'association, etc., 11 octobre 1846. Sixième séance, 23 décembre 1847. Bruxelles, Périchon, 1846, 1847 et 1848, 6 brochures in-8. Contiennent les discours de MM. Ch. de Brouckère, président de l'association; le comte Arrivabene, vice-président; Victor Faider, Lehardy de Beaulieu, etc., dans ses séances publiques.
Congrès des Economistes réuni à Bruxelles par les soins de l'association belge pour la liberté commerciale. Session de 1847, séances des 16, 17 et 18 septembre. Bruxelles, Deltombe, 1847, in-8 de 200 pages. Contient les discours de ce congrès ayant pour objet les questions relatives à la liberté commerciale. (Voyez Économistes (Congrès des).
Voir la bibliographie de Liberté des échanges et un article sur cette association, par M. Joseph Garnier, dans l’Annuaire de l'Economie politique pour 1847.
Endnotes to Liberté des échange (associations)
[120] Cobden et la Ligue, ou l'agitation anglaise pour la liberté du commerce, par Fred. Bastiat, membre du conseil général des Landes. Guillaumin, 1843, 1 vol. in-8.
[121] Dans la Revue britannique et dans l’Annuaire de l'Économie politique pour I846.
[122] Études sur l'Angleterre, par M. Léon Faucher, 2e vol.
[123] L'association bordelaise avait pour président M. Duffour-Dubergier; pour vice-présidents M.M. Bruno-Devès, Durin, Duvergié, Paul Vignes; pour secrétaire-général M. Gustave Brunet; pour secrétaires MM. Duchon-Doris, Louis Fabre, Jules Fauché, Hovyn de Tranchère; pour trésorier M. Samazeuilh ; pour archiviste M. Castéja.
[124] Libres-échangistes et libre-échange , deux mots nouveaux qui naquirent du mouvement de 1846.
[125] Le conseil d'administration de l'association subit diverses modifications; MM. Léon Faucher, Wolowski et Denière, qui en faisaient d'abord partie, s'en retirèrent; d'autres membres y furent, en revanche, successivement adjoints. Il était composé, en 1847, de la manière suivante : MM. le duc d'Harcourt, pair de France, président; Anisson-Dupéron, pair de France, vice-président; Dunoyer, membre de l'Institut, vice-président; Béville (baron de), propriétaire ; Blanqui, député ; Bosson, manufacturier à Boulogne ; Boullet, pair de France, président de la cour royale d'Amiens ; Michel Chevalier, conseiller d'État; Calon jeune, banquier; David, négociant à Reims; Guillaumin, éditeur; Guillemin, négociant ; Nicolas Kœcklin, manufacturier; Louis Le-clerc, chef d'institution ; Odiot, orfévre; Ortolan, professeur à l'École de droit ; Paillottet, vice-président du conseil des prud'hommes; Peupin, ouvrier, prud'homme; Potonié, négociant; Renouard, pair de France; Louis Reybaud, député; Riglet, fabricant de bronzes, ancien membre du tribunal de commerce; Horace Say, membre de la chambre de commerce de Paris; Frédéric Bastiat, membre correspondant de l'Institut, secrétaire général; Ad. Biaise (des Vosges), secrétaire adjoint; Charles Coquelin, secrétaire adjoint ; A. Fonteyraud, secrétaire adjoint; Joseph Garnier, rédacteur en chef du Journal des Économistes, secrétaire adjoint; Molinari (G. de), secrétaire adjoint; Adolphe d'Eichthal, trésorier; Casimir Cheuvreux, censeur.
[126] Les réunions publiques de l'association parisienne avaient lieu dans la salle Montesquieu.
Liberté du commerce, liberté des échanges↩
Source
"Liberté du commerce, liberté des échanges", DEP, T. 2, pp. 49-63.
[49]
LIBERTÉ DU COMMERCE. — LIBERTÉ DES ÉCHANGES
I. Ses bases naturelles.
[50]
S'il est un principe solidement appuyé sur l'observation , c'est assurément celui de la liberté des échanges. Il suffît, pour s'en convaincre, de jeter un simple coup d'œil sur l'organisation de l'homme et sur le milieu où il se trouve placé.
L'homme a des besoins physiques, intellectuels et moraux, dont l'apaisement est nécessaire au maintien de son existence et au perfectionnement de son être. Il est obligé de se nourrir, de se vêtir et de s'abriter, sous peine de périr; il est obligé encore de cultiver son esprit et son âme, sous peine de vivre uniquement de la vie des brutes.
Pour subvenir à ces nécessités de son existence, l'homme dispose d'une portion de la création, et il est armé de facultés à l'aide desquelles il peut extraire, du milieu où il vit, tous les éléments de sa subsistance matérielle et morale. La terre avec ses innombrables variétés de minéraux, de végétaux et d'animaux, ses océans, ses montagnes, son humus fertile, l'atmosphère qui l'environne, les effluves de chaleur et de lumière qui alimentent la vie à sa surface, voilà le fonds abondant que la Providence a mis au service de l'humanité. Mais ni les éléments divers qui composent ce fonds naturel de subsistance, ni les facultés dont l'homme dispose pour les utiliser n'ont été distribués d'une manière égale et uniforme. Chacune des régions du globe a sa constitution géologique particulière : ici s'étendent d'immenses couches de charbon, de fer, de plomb, de cuivre; là gisent l'or, l'argent, le platine et les pierres précieuses. Même diversité dans la distribution des espèces végétales et animales : le soleil, qui échauffe et qui éclaire inégalement la terre, qui prodigue dans certaines zones la chaleur et la lumière, tandis qu'il abandonne les autres à la frigidité et à l'ombre, marque à chaque espèce les limites qu'elle ne peut franchir. Même diversité encore dans la répartition des facultés humaines. Un court examen suffit pour démontrer que tous les peuples n'ont pas été pourvus des mêmes aptitudes, que les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Russes, les Chinois, les Indous, les nègres, etc., ont leur génie particulier, provenant soit de la race, soit des circonstances naturelles du sol ou du climat; que les forces physiques, intellectuelles et morales de l'homme varient selon les races, les peuples et les familles ; qu'il n'y a pas dans le monde deux individus dont les capacités soient égales et les aptitudes semblables. Diversité et inégalité des éléments de la production dans les différentes régions du globe; diversité et inégalité non moins prononcées des aptitudes parmi les hommes; tel est donc le spectacle que nous présente la création.
De cet arrangement naturel des choses nait la nécessité des échanges. Aucune région du globe ne pouvant devenir le foyer de l'universalité des industries; aucun individu ne pouvant produire isolément l'ensemble des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, que font les hommes? Les moins heureusement doués, ceux qui forment comme la transition entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, se contentent des produits qu'ils sont capables de façonner eux-mêmes, et dont ils ont les matériaux sous la main. Ceux-ci demeurent plongés dans la primitive barbarie, et ils se trouvent incesssamment soumis aux privations les plus dures. Tels sont les naturels de la Nouvelle-Hollande et de quelques-uns des archipels de la mer du Sud. Mais les plus intelligents s'avisent d'un procédé qui met bientôt à leur service les ressources de la création tout entière. Au lieu de produire indifféremment toutes choses, chacun s'applique à celles que ses aptitudes particulières et la nature des matériaux dont il dispose lui permettent de produire avec facilité, et il les échange contre les choses qu'il produit difficilement ou qu'il est incapable de produire. Grâce à ce procédé, à la fois si simple et si fécond, chacun peut obtenir une quantité de plus en plus considérable des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, étendre et perfectionner indéfiniment son existence. (Voyez Échange.)
L'échange apparaît donc comme une nécessité dérivant de la nature de l'homme et des circonstances au sein desquelles il se trouve placé, et la liberté d'échanger n'est pas moins que celle de travailler, d'institution naturelle.
Le procédé de l'échange étant découvert, la division du travail peut s'établir et l'industrie se perfectionner. (Voyez Division du travail.) Alors les échanges se multiplient, et la sphère dans laquelle ils peuvent s'opérer s'agrandit. Cette sphère est d'abord fort étroite, et elle varie considérablement selon la nature des denrées. Les denrées lourdes et encombrantes ne peuvent être échangées qu'à une très courte distance des lieux de production ; les objets qui renferment une valeur considérable sous un petit volume, tels que les métaux précieux, les aliments, les armes et les étoiles de luxe, les joyaux et les parfums, seuls peuvent être portés sur les marchés lointains. Mais l'obstacle des distances est entamé peu à peu. Les pays qui ont l'avantage d'être sillonnés de nombreux cours d'eau navigables, et baignés par la mer, offrent les premiers le spectacle d'un commerce étendu, et ils deviennent par là même les foyers principaux de la civilisation. Des voies artificielles sont ouvertes ensuite dans l'intérieur des terres, et la sphère des échanges s'agrandit à chaque progrès des voies de communication et des véhicules de locomotion. De nos jours, les substances alimentaires les plus communes, les matériaux les plus grossiers sont transportés beaucoup plus loin que ne pouvaient l'être jadis les métaux précieux, les pierreries et les étoffes de luxe. Ne va-t-on pas chercher un engrais, le guano, jusque dans l'océan Pacifique? Le résultat de cette extension successive de la sphère des échanges est facile à apprécier. Si, comme l'observation l'atteste, les différents peuples de la terre sont pourvus d'aptitudes particulières, si chaque région du globe a ses productions spéciales, à mesure que s'étendra la sphère des échanges on verra chaque peuple s'adonner de préférence aux industries qui conviennent le mieux à ses aptitudes ainsi qu'à la nature de son sol et de son climat; on verra la division du travail s'étendre de plus en plus parmi les nations. Chaque industrie se placera dans ses meilleures conditions de production, et le résultat final sera que toutes les choses nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme pourront être obtenues avec un maximum d'abondance et on échange d'un minimum de peine.
[51]
Tel est le résultat inévitable de l'extension illimitée et indéfinie de la sphère où se meuvent les échanges. Que ce résultat soit conforme au dessein général de la création, on ne saurait le nier. Si la Providence avait voulu que les hommes demeurassent isolés, sans communications entre eux, n'aurait-elle pas mis à leur portée immédiate tous les éléments de la production? Ne les aurait-elle pas doues aussi, au même degré, de toutes les aptitudes? Si elle a diversement et inégalement réparti les éléments et les instruments de la production sur la surface du globe, n'est-ce pas une preuve que l'extension indéfinie des échanges est une nécessité providentielle à laquelle les hommes sont tenus d'obéir? Objectera-t-on que l'homme a tort d'accorder à ses besoins une importance telle qu'il lui soit nécessaire de mettre la terre entière à contribution pour les apaiser? Objectera-t-on que cette simplicité primitive qui se contente des aliments, des vêtements et des autres objets utiles que peuvent fournir le sol natal et l'industrie indigène , est préférable à cette recherche effrénée des jouissances, qui pousse l'homme à explorer jusqu'aux extrémités du globe pour satisfaire ses appétits ou ses fantaisies? Mais ne suffit-il pas de presser un peu l'objection pour en montrer l'inanité? Quelle que soit la manière dont l'homme gouverne ses besoins, soit qu'il donne la préférence à ses appétits matériels, soit qu'il fasse pencher la balance du côté de ses appétits intellectuels et moraux , la bienfaisante nécessité des échanges ne demeure-t-elle pas la même? Où en serait la civilisation si les produits immatériels, par exemple, n'avaient pu s'échanger de peuple à peuple? si la philosophie et les beaux-arts étaient demeurés dans la Grèce, la science de la législation à Rome, la religion chrétienne en Judée? N'est-ce pas au moyen de ces produits d'origine étrangère que l'intelligence des peuples modernes a été cultivée et leur moralité développée? Quel peuple aurait pu se flatter de réunir les aptitudes philosophiques et artistiques des Grecs, la science juridique des Romains et les notions religieuses des Juifs?
Supposons qu'à l'époque où l'échange commença à être en usage, des tyrans endoctrinés par des sophistes eussent absolument proscrit la liberté d'échanger ; supposons qu'ils eussent prohibé l'échange des produits, soit matériels, soit immatériels, et que cette prohibition eût pu se maintenir : n'est-il pas évident que l'humanité serait demeurée éternellement plongée dans la barbarie? N'est-il pas évident que la condition des peuples actuellement placés à la tète de la civilisation ne dépasserait pas celle des naturels de la Nouvelle-Hollande?
II. Des entraves apportées à la liberté des Échanges.
§ 1er. Droits fiscaux.
Malgré son caractère évident d'utilité, la liberté des échanges a cependant été entravée. Elle l'a été par deux sortes de mesures : 1° par des mesures fiscales; 2° par des mesures prohibitives. Occupons-nous d'abord des premières.
Que les échanges aient été entravés dans un but fiscal, cela se conçoit aisément. Dès que les communications ont commencé à se développer et les échanges à se multiplier, les gouvernements n'ont pas manqué de s'apercevoir qu'il y avait possibilité et profit de taxer les denrées qui arrivaient à la consommation par cette voie nouvelle. Tantôt la taxe était un simple péage destiné à couvrir les frais d'entretien et de renouvellement des voies affectées au transport des marchandises; tantôt elle servait encore à rémunérer d'autres services publics, au nombre desquels il convient de signaler la sécurité fournie aux échangistes. Mais en établissant une taxe de ce genre, on n'avait pas pour but de restreindre les échanges; on avait simplement en vue de procurer au fisc un maximum de recettes, et ce but fiscal ne pouvait être atteint même qu'à la condition que les échanges ne fussent pas trop entravés. Malheureusement les bons errements financiers furent rarement suivis en cette matière. Au moyen âge, par exemple, chaque pays se trouva émietté en une multitude de petites seigneuries ou châtellenies dont les propriétaires s'arrogeaient le droit de taxer les échanges dans leur circonscription. On a pu voir au mot Douane combien les péages de toute sorte se multiplièrent alors. Qu'en résulta-t-il? C'est qu'en présence de ces obstacles artificiels qui s'ajoutaient à l'obstacle naturel des distances pour intercepter les échanges, le commerce ne put s'étendre. C'est que l'industrie, bornée aux limites du marché de la châtellenie ou de la commune, demeura dans une longue enfance. Les moyens de production ne pouvant se développer, la richesse et la civilisation ne réalisèrent aucun progrès, si ce n'est cependant sur les côtes maritimes et le long des grands fleuves, où les obstacles apportés à la circulation étaient moindres. Plus tard, la féodalité ayant disparu, le nombre des péages fut diminué, et en même temps la sécurité des communications s'augmenta. Aussitôt la sphère des échanges s'agrandit, le travail put se diviser davantage, et l'on vit la richesse publique se développer comme par enchantement. L'établissement du tarif uniforme de Colbert en France et la suppression des douanes intérieures accomplie par l'assemblée constituante, contribuèrent particulièrement à ces résultats. ( Voyez Douane. )
De nos jours, les droits d'octroi et d'accise, les péages sur les fleuves et les rivières, les droits de tonnage, etc., qui atteignent immédiatement la circulation des denrées, ont conservé un caractère purement fiscal. Jusqu'à ce que des procédés plus parfaits aient été découverts pour subvenir aux dépenses publiques, ou jusqu'à ce que les fonctions que l'impôt sert à rémunérer soient rentrées de plus en plus dans le domaine de l'industrie privée, on remplacera difficilement ce genre de taxes. On doit regretter seulement qu'elles aient été multipliées à l'excès, et, souvent aussi, portées à un taux exorbitant ; car elles entravent par leur exagération le développement des échanges, elles retardent les progrès de la division du travail, et par là même elles apportent un obstacle considérable à l'extension des revenus du fisc. (Voyez Impôt.)
Malgré les entraves qui résultent, pour le développement des échanges, de l'établissement des droits fiscaux, ces droits ne peuvent donc soulever aucune objection de principe. S'ils restreignent la sphère des échanges, c'est par un accident [52] inévitable; mais ils n'ont pas pour but de la restreindre.
§ II. Droits producteurs ou prohibitifs. Leurs caractères et leurs effets.
Les droits protecteurs ou prohibitifs ont un tout autre caractère. Ceux-ci sont établis directement en vue de limiter le rayon des échanges. Ils entravent pour entraver. Les gouvernements qui les ont mis en vigueur, jugeant apparemment que l'organisation et le développement des échanges ne pouvaient être abandonnes au gouvernement de la Providence, sont intervenus pour « réglementer la matière. » Nous aurons à examiner si ces organisateurs de l'échange ont été bien inspirés. Recherchons auparavant de quelles pièces se compose le système protecteur ou prohibitif.
Considéré dans son ensemble, et tel qu'il existe de nos jours, le système protecteur ou prohibitif comprend deux sortes d'obstacles : les prohibitions ou les droits protecteurs établis à l'entrée des marchandises ; les prohibitions ou les droits à la sortie. Il comprend encore les primes accordées à l'importation ou à l'exportation de certaines denrées. Enfin il sert de base au système colonial (voy. ce mot) ainsi qu'à la plupart des conventions douanières ou des traités de commerce.
Les prohibitions ou les droits protecteurs établis à l'entrée des marchandises ont pour objet de favoriser le développement de certaines branches de la production nationale aux dépens des industries similaires de l'étranger.
Les prohibitions à la sortie sont établies tantôt pour maintenir à bas prix certains aliments indispensables à l'industrie ou à la consommation nationale, tantôt pour en priver l'industrie ou la consommation étrangère.
Les primes à la sortie sont des encouragements pécuniaires accordés à certaines branches de l'industrie nationale aux dépens des autres branches. Quelquefois elles ont pour objet de hâter le développement d'une industrie jugée nécessaire, ou de balancer jusqu'à un certain point les droits protecteurs établis dans les pays étrangers. Quelquefois encore elles sont établies simplement pour remédier à une crise soudaine. Les drawbacks sont des primes qui servent à rembourser, à l'exportation d'un produit fabriqué, l'impôt prélevé à l'importation des matières premières. Les primes à l'importation n'ont ordinairement qu'un caractère temporaire; elles sont employées aux époques de disette par exemple, pour encourager l'importation des denrées alimentaires. (Voyez Primes. )
Les conventions douanières et les traités de commerce sont des brèches partielles et temporaires faites aux tarifs prohibitifs, en faveur de certaines nations avec lesquelles on tient spécialement à entretenir des relations amicales. ( Voyez Traités de commerce.)
Les prohibitions et les droits protecteurs à l'entrée constituent la pièce principale du système. Pour nous rendre bien compte de la manière dont ils agissent, posons un exemple. Supposons que la nation A fournisse annuellement à la nation B 1 million de kilogrammes de coton filé. Pourquoi B achète-t-elle ce coton en A au lieu de le fabriquer elle-même? Parce que les manufactures de A sont situées et organisées de manière à produire du coton filé en meilleure qualité et à plus bas prix que ne pourraient le faire des manufactures établies en B; parce que la nation A se trouve placée dans des conditions plus avantageuses que la nation B pour la fabrication du coton. S'il n'en était pas ainsi, on ne manquerait pas de fabriquer du coton en B aussi bien qu'en A. Mais voici qu'un homme d'État de B se persuade qu'il serait utile de «ravir» cette industrie à l'étranger, et qu'il interdit, en conséquence, l'importation des fils de coton. Assurément cet homme d'État peut empêcher le peuple de B de recevoir le million de kilogrammes de coton filé qui lui était annuellement fourni par A, surtout si la frontière est facile à garder et si elle est garnie d'un nombre suffisant de douaniers probes et bien payés. Il peut encore provoquer par la même la création d'un certain nombre de filatures de coton en B. Mais ces filatures, peut-il les placer dans des conditions de production aussi favorables que celles où se trouvent les filatures de A? Peut-il faire en sorte que le coton soit filé en B aussi économiquement et aussi bien qu'il l'est en A? Non, car il n'est pas le maître de changer les conditions naturelles de la production du coton ; tout ce qu'il peut faire, c'est d'empêcher le coton filé à bon marché d'entrer en B. Là s'arrête sa puissance. La nation B cesse donc d'être « envahie» (c'est le terme consacré du vocabulaire prohibitionniste) par le million de kilogrammes de coton filé provenant de A ; elle fabrique du coton à son tour; mais ce coton coûte plus cher que celui de A, et il est de plus mauvaise qualité; en conséquence, on en consomme moins. Avant la prohibition, la consommation de B absorbait 1 million de kilogrammes de coton filé ; après la prohibition elle n'en absorbe plus que 600 mille ou 700 mille kilogrammes ; d'où il résulte que la production générale du coton se trouve diminuée de la différence. Supposons maintenant que la nation A imite la conduite de B et qu'elle prohibe, par exemple, l'importation du lin filé qu'elle recevait en échange de ses fournitures de coton. On se mettra à filer du lin en A ; mais comme on le filera plus chèrement et plus mal qu'en B, la production générale du lin diminuera à son tour. Des deux côtés on produira moins, tout en se donnant autant de peine qu'auparavant, sinon davantage; des deux côtés on sera plus mal pourvu de lin et de coton. A l'époque où cette politique malfaisante était devenue la loi des relations internationales, où chaque nation s'efforçait de « ravir » des industries à l'étranger, une brochure fort spirituelle fut publiée en Angleterre, sous ce titre : Les singes économistes. Une vignette représentant une baraque de singes servait de frontispice. Une demi-douzaine de singes placés dans des compartiments séparés venaient de recevoir leur pitance quotidienne; mais au lieu de consommer en paix cette pitance que le maître de la ménagerie leur avait distribuée d'une main libérale, ces animaux, pleins de malice, s'efforçaient de « ravir » les portions de leurs voisins, sans s'apercevoir que ceux-ci faisaient exactement le même manège. Chacun se donnait ainsi beaucoup de peine pour dérober des aliments qu'il aurait pu prendre aisément devant lui, et la masse de la subsistance commune se trouvait [53] diminuée de tout ce qui se gaspillait ou se perdait dans la bagarre. [127]
Telle a été exactement la conduite des gouvernements qui ont adopté les errements du régime prohibitif. Ils ont négligé les biens dont la Providence les avait gratifiés, pour dérober à grand' peine ceux qu'elle avait distribués à leurs voisins. Ils ont rendu, par leur jalousie malfaisante, la production plus difficile et moins abondante; ils ont ralenti le développement du bien-être des peuples. Un homme d'État qui établit un droit protecteur ou prohibitif agit précisément au rebours d'un inventeur qui découvre un nouveau procédé pour rendre la production plus économique et plus parfaite : il invente, lui, un procédé pour rendre la production plus chère et moins bonne; il invente un procédé qui oblige à abandonner les terres fécondes et les mines abondantes, pour cultiver les mauvaises terres et exploiter les mines pauvres. C'est un inventeur à rebours, un agent de la barbarie, comme l'inventeur est un agent de la civilisation.
Ceci devient plus évident encore lorsqu'on examine l'influence que le régime prohibitif a exercée sur les progrès de l'industrie. La division du travail est, comme chacun sait, le principal élément du bon marché : plus le travail se divise, et plus les frais de production s'abaissent ; plus, en conséquence, les prix se réduisent. Les démonstrations d'Adam Smith à cet égard sont devenues classiques. Mais à quelle condition le travail peut-il se diviser de plus en plus? C'est à la condition qu'il jouisse d'un débouché de plus en plus étendu.
« Comme c'est le pouvoir d'échanger, dit Adam Smith, qui donne occasion à la division du travail, celle-ci ne s'étend pas plus loin que l'autre, ou, en d'autres termes, elle est nécessairement bornée par l'étendue du marché ... Dans les parties reculées et intérieures des montagnes d'Ecosse, il est impossible de trouver seulement une manufacture comme celle des clous. A mille clous par jour et à trois cents jours dans l'année, un cloutier ferait trois cent mille clous par an; mais dans sa position il ne pourrait pas vendre mille clous, c'est-à-dire que dans le cours d'une année il ne vendrait pas l'ouvrage d'un seul jour. » [128]
La division du travail ne peut donc s'étendre qu'autant que le marché s'agrandit; d'où il résulte encore que toute diminution de l'étendue du marché doit inévitablement faire reculer la division du travail et rétrograder l'industrie. Or, en enlevant d'une manière systématique une partie de leur débouché aux industries les plus favorablement situées, le système prohibitif oblige les industriels à réduire l'échelle de leur production, à moins diviser leur travail. S'il s'agit de la fabrication du coton, par exemple, il oblige les fabricants à filer à la fois des numéros gros et des numéros fins, au lieu de se borner à un petit nombre de numéros ou même à un seul. La production en devient naturellement plus chère et moins parfaite. A la vérité, si la prohibition resserre la clientèle des anciens établissements, elle en fait surgir de nouveaux. Mais quelle est la situation de ceux-ci? Placés, relativement à leurs rivaux, dans de mauvaises conditions de production, ils ne peuvent se créer un débouché en dehors du marché national. Or ce marché est limité. On remédie, nous ne l'ignorons pas, à son insuffisance en établissant des primes d'exportation, qui permettent aux industries protégées de se présenter sur les marchés de concurrence. Mais, ce procédé étant extrêmement coûteux et visiblement inique (voy. Primes), on ne peut l'employer que d'une façon restreinte. D'un côté donc, l'industrie située dans de bonnes conditions naturelles est ramenée en arrière ; d'un autre côté , les établissements que la prohibition a fait surgir d'une manière artificielle se trouvent placés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent agrandir leurs débouchés sans imposer à la nation les sacrifices les plus onéreux. C'est ainsi que le fractionnement artificiel des marchés, occasionné par le régime prohibitif, a retardé partout le développement de la division du travail, ralenti les progrès de l'industrie, et perpétué par là même la cherté.
Ce n'est pas tout. La cherté n'est pas le seul mal qu'ait, sinon engendré, du moins perpétué le régime prohibitif. A ce mal, s'en est joint un autre non moins funeste : celui de l'instabilité. Les industries que la prohibition fait surgir dans de mauvaises conditions économiques sont continuellement exposées aux lésions les plus funestes. Que le droit prohibitif qui leur permet de subsister vienne à être abaissé, ou que la surveillance se relâche aux frontières, et elles ne manquent pas d'être dépouillées d'une partie de leur clientèle. Elles subissent alors tous les désastres qu'entraînent les crises industrielles, et leur existence même se trouve compromise. Elles ressemblent à ces plantes de serre-chaude qui périssent aussitôt qu'on se lasse de fournir le combustible nécessaire au maintien de leur existence artificielle. La situation des industries naturelles n'est pas plus sûre. Celles-ci n'ont rien à craindre, à la vérité, pour leur débouché intérieur, car elles sont placées de manière à défier la concurrence étrangère ; mais les débouchés qu'elles ont pu se créer au dehors sont essentiellement précaires. A chaque instant, en effet, la prohibition peut leur ravir ces débouchés, sur lesquels leur existence est en partie fondée. N'avons-nous pas vu, à une époque encore récente, la France frapper de droits prohibitifs l'importation des fils et tissus de lin, et porter ainsi un coup terrible à l'industrie linière de l'Angleterre et de la Belgique? N'avons-nous pas vu aussi les États-Unis modifier, en moins de vingt années, quatre ou cinq fois leur tarif, tantôt dans un sens libéral, tantôt dans un sens prohibitif, et occasionner par ces brusques revirements de système, une série de crises dans les industries en possession d'approvisionner leur marché? Voilà donc un risque permanent que le régime prohibitif fait peser sur l'ensemble de la production, et ce risque ne peut manquer d'influer d'une manière désastreuse sur le développement de l'industrie aussi bien que sur la condition des travailleurs.
Les droits prohibitifs établis à l'exportation ont généralement moins d'importance que les autres, mais leurs effets ne sont pas plus salutaires. On y [54] a recours ordinairement pour empêcher ou pour entraver l'exportation des denrées alimentaires et de certaines matières premières nécessaires à l'industrie. Voyons comment ils agissent. Deux cas peuvent se présenter : ou la production de la denrée dont la sortie est entravée se trouve naturellement limitée, ou elle est indéfiniment extensible. Dans le premier cas, qui est le plus rare, la prohibition agit d'abord simplement comme un impôt prélevé sur certains producteurs au profit de certains consommateurs. Supposons, par exemple, que le gouvernement français s'avise de prohiber la sortie du vin du Clos-Vougeot ou de Chàteau-Lafitte. Qu'arrivera-t-il? On n'en produira probablement pas moins, mais les producteurs, obligés désormais d'offrir sur le marché national tout ce qu'ils récoltent de ces vins exquis, n'en retireront plus un aussi bon produit. Ils seront frappés au profit d'une certaine classe de consommateurs français. Tel sera l'effet prochain de l'établissement du droit prohibitif. Mais les consommateurs finiront par être atteints à leur tour. Les meilleurs vins venant à être taxés au profit des consommateurs nationaux, la production des vins fins sera découragée. On ne fera aucune tentative pour améliorer les vins inférieurs, dans la crainte qu'ils ne viennent à être frappés aussi. Les consommateurs nationaux obtiendront, à la vérité, le Clos-Vougeot et le Château-Lafitte à meilleur marché; mais ils devront renoncer aux avantages qu'ils pourraient retirer de l'amélioration des vins inférieurs. En dernière analyse, ils seront moins bien approvisionnés en vins fins et ils le seront plus chèrement. — Dans le second cas, la prohibition sera immédiatement suivie d'une diminution dans la production de la denrée prohibée. S'il s'agit, par exemple, de blé ou d'autres comestibles, de soie, de lin ou de chanvre brut, on réduira successivement la production de ces denrées jusqu'à ce qu'elle se proportionne au débouché. Les prix pourront, sans doute, tomber fort bas dans l'intervalle; mais ils ne tarderont pas à se relever pour se fixer au-dessus même du niveau antérieur. En effet, la diminution d'étendue du marché obligera les producteurs à restreindre leurs exploitations : ils ne pourront plus diviser autant le travail, ni recourir à des instruments ou à des méthodes de production aussi économiques ; et les frais de production, régulateurs définitifs des prix courants, hausseront en conséquence. Comme dans le premier cas, et plus promptement encore, les consommateurs seront dupes d'une mesure adoptée cependant pour les favoriser. — Que si la prohibition a pour objet de priver une industrie rivale d'un aliment nécessaire, cette mesure égoïste aura pour résultat d'encourager au dehors la production de la denrée similaire. C'est ainsi que l'Angleterre, en mettant un droit élevé à la sortie de ses houilles, a contribué à développer la production minérale en Belgique.
En résumé donc, la cherté et l’instabilité, telles sont les conséquences inévitables du régime prohibitif : la cherté, provenant à la fois des mauvaises conditions de production au sein desquelles le régime prohibitif place l'industrie, et de l'obstacle qu'il apporte aux progrès de la division du travail ; l'instabilité, provenant des modifications que subissent les tarifs, modifications qui bouleversent incessamment les débouchés de la production.
§ III. Causes qui ont motivé l'établissement du régime protecteur ou prohibitif.
Il doit sembler étonnant qu'un régime si visiblement désastreux pour les peuples, si contraire aux progrès de la richesse et de la civilisation, ait pu s'établir. Son origine doit être principalement attribuée à certaines circonstances inhérentes à l'état de barbarie et de guerre au sein duquel il est né. Les nations, formant, à l'origine, des communautés hostiles les unes aux autres et presque continuellement en guerre, ne pouvaient échanger leurs produits d'une manière régulière et permanente. Chacune était obligée de se suffire à elle-même pour la plupart des objets de sa consommation. La guerre agissait alors comme un obstacle artificiel ajouté à l'obstacle naturel des distances. Lorsque la paix succédait à la guerre, cet obstacle artificiel disparaissait. Malheureusement, c'était d'une manière purement accidentelle et provisoire : une nouvelle guerre ne tardait pas à surgir, et l'obstacle se redressait aussitôt. Cherchons à nous faire une idée précise de l'effet que des revirements de cette espèce pouvaient exercer sur l'assiette de la production. Supposons deux nations ; C et D, la première fournissant à la seconde des étoffes de laine et recevant en échange des étoffes de soie. Une guerre survient ; les échanges se trouvent immédiatement interrompus. Les consommateurs de D ne peuvent plus recevoir les étoffes de laine que les producteurs de C avaient coutume de leur fournir. Les consommateurs de C sont privés, de leur côté, des étoffes de soie qu'ils retiraient de D. Cependant, les uns ne continuent pas moins de demander des étoffes de laine, les autres des soieries. Voici alors ce qui arrivera, selon toute apparence. C'est que les fabricants d'étoiles de laine de C, à qui la guerre a ravi leur débouché, se mettront à produire des soieries, et que les fabricants de soieries de D se mettront à produire des étoffes de laine. Chaque nation parviendra à se procurer ainsi, comme avant la guerre, les étoffes dont elle a besoin. Ce sera, à la vérité, à des conditions plus mauvaises. Les soieries que fabriquera C seront probablement plus chères et moins bonnes que celles dont elle se pourvoyait en D. Les étoiles de laine que fabriquera D seront inférieures à celles qu'elle se procurait en C. ; mais, des deux parts, on trouvera plus d'avantage à utiliser les capitaux et les bras, dont la guerre a rétréci le débouché, qu'à les laisser inactifs ; des deux parts aussi, on aimera mieux payer plus cher les étoffes dont on a besoin que de s'en passer. La guerre occasionne, comme on voit, un déplacement forcé de certaines industries dans un sens rétrograde. Elle ruine les branches les plus vivaces de la production, celles qui avaient pu se créer un débouché au dehors, pour leur substituer des industries artificielles que l'interruption des communications internationales seule peut faire subsister. Mais la paix survient à son tour : aussitôt disparaissent la protection que la guerre accordait en C à la fabrication des soieries, en D à la fabrication des étoffes de laine. Il est évident que ces industries [55] du guerre devront succomber, à moins que l'on ne substitue pour les protéger, à l'obstacle résultant de la guerre, un obstacle équivalent. Si la situation du monde est telle que la paix puisse être durable, mieux vaudra assurément les laisser succomber et permettre ainsi à la production de reprendre son assiette naturelle; mais si la guerre est l'état normal des sociétés, si la paix n'intervient que comme une courte trêve, peut-être sera-t-il préférable de renoncer à des relations dont l'existence précaire est une occasion continuelle de perturbations désastreuses. La prohibition apparaîtra alors comme une véritable prime d'assurance accordée aux industries que la guerre a fait surgir et dont elle a rendu le maintien nécessaire.
C'est ainsi, par exemple, que le système prohibitif a pris en Europe et en Amérique une extension considérable à la un de la guerre continentale. (Voy. Douane). Pendant la guerre, l'interruption des communications générales avait déterminé l'établissement d'un certain nombre d'industries dans de mauvaises conditions économiques. La guerre venant à cesser, les industriels demandèrent à grands cris que l'obstacle de la prohibition fût substitué à celui de la guerre pour les protéger. Les gouvernements s'empressèrent de déférer à leur demande. Ce fut une grande faute, sans aucun doute ; car, à une époque où la paix est devenue l'état normal des sociétés, la prohibition n'est plus qu'un coûteux anachronisme. Dans cette situation nouvelle, il en coûte moins de subir les perturbations qu'une guerre passagère peut occasionner dans les relations internationales, que de payer pendant vingt ou trente années une lourde prime de guerre pour les éviter. Cependant on conçoit jusqu'à un certain point qu'à l'issue d'une guerre qui avait bouleversé le monde pendant un quart de siècle en faisant rétrograder les sociétés vers la barbarie, le régime prohibitif ait pu prévaloir.
En revanche, on a plus de peine à comprendre que ce régime de guerre ait pu être étendu et aggravé comme il l'a été, longtemps après que la paix se fut consolidée. Ceci tient à certains effets de la prohibition, dont il importe de bien se rendre compte.
Nous comparions plus haut l'homme d'État qui établit des prohibitions ou des droits protecteurs à un inventeur à rebours. Poursuivons la comparaison, et nous découvrirons les motifs qui ont contribué à étendre et à aggraver en pleine paix le régime prohibitif. Supposons qu'un inventeur découvre un procédé qui lui permette d'introduire dans les frais de production d'une denrée une économie de 10 : en abaissant le prix de cette denrée de 5 seulement, il pourra obtenir la préférence sur ses concurrents et réaliser des bénéfices considérables. Ces bénéfices proviendront de la différence existant entre l'économie obtenue et la quantité dont le prix aura été abaissé, et ils constitueront la prime rémunératrice de l'invention. Maintenant que se passe-t-il lorsqu'un droit prohibitif est établi? Un déficit artificiel se produit aussitôt sur le marché, et ce déficit amène une augmentation de prix. Telle denrée que l'on pouvait se procurer au prix de 20 en moyenne ne peut plus être obtenue qu'à un prix de 30. C'est une hausse artificielle de moitié, qui est causée par la rupture des communications entre les producteurs étrangers et les consommateurs nationaux. Supposons que la denrée prohibée puisse être produite dans le pays moyennant un prix de 22 : les capitaux ne manqueront pas d'affluer dans cette nouvelle industrie; car ils y trouveront, en sus des profits ordinaires des autres branches de la production, une prime extraordinaire égale à 8. Cette prime proviendra de la différence existant entre le prix auquel la denrée peut être produite dans le pays, et le prix artificiel que la prohibition a suscité. On voit donc que, si les bénéfices de l'invention se fondent sur l'abaissement du prix, ceux de la prohibition se fondent absolument de la même manière sur leur renchérissement.
Mais la prime extraordinaire provenant de la prohibition est-elle durable? Les bénéfices des industries protégées ne doivent-ils pas finir par tomber au niveau de ceux des autres branches de la production, sous l'influence de la concurrence intérieure? C'est selon. Cela dépend de la nature de l'industrie protégée. S'il s'agit d'une industrie dont les éléments essentiels ne soient point limités dans le pays, la prime n'aura qu'un caractère temporaire; car de nouveaux établissements pourront se fonder et se fonderont pour obtenir le bénéfice de la prime aussi longtemps qu'elle subsistera. La concurrence intérieure abaissera alors les prix jusqu'à extinction de la prime. Parfois même l'accroissement de l'industrie protégée ne s'arrêtera point à sa limite nécessaire, et les prix tomberont soudainement au-dessous des frais de production. Il en résultera une crise qui absorbera une bonne part des bénéfices provenant de la prime de renchérissement. Les prix se relèveront ensuite ; mais l'industrie protégée aura cessé de réaliser des bénéfices supérieurs à ceux des autres branches de la production. Son brevet d'invention sera expiré, pour nous servir d'une expression judicieuse et profonde de M. Huskisson. Il en sera autrement si l'industrie protégée ne peut s'étendre d'une manière illimitée; s'il s'agit, par exemple, de la production alimentaire dans les pays où les terres propres à la culture du blé sont peu nombreuses, ou bien encore de la production de la houille, du fer, du plomb, etc., dans les pays où les gisements minéraux sont peu abondants. En ce cas, la prime de renchérissement pourra être indéfiniment perçue. Si la prohibition a fait monter le prix de 20 à 30, l'approvisionnement pourra demeurer assez raréfié non-seulement pour que ce dernier prix subsiste, mais encore pour qu'il s'augmente graduellement par le fait de l'accroissement de la population et de la richesse publique. Alors les détenteurs des monopoles naturels protégés, fonds de terre ou mines, verront s'élever chaque année la fructueuse prime qui leur est dévolue ; ils s'enrichiront progressivement sans avoir besoin de se donner la moindre peine.
Mais, que la prime de renchérissement soit durable ou temporaire, l'appât de cette prime suffit et au delà pour multiplier les prohibitions. Quoi de plus tentant, en effet? Tandis que l'argent est si difficile à gagner sous l'abominable loi de la concurrence, voici qu'un procédé est découvert, à l'aide duquel on peut s'enrichir en un tour de main. [56] Qui ne s’empresserait d'user et d'abuser d'un procédé si merveilleux? Qui ne ferait manœuvrer la machine à fabriquer les primes jusqu'à épuisement de la matière? A la vérité, ces primes, on ne peut les obtenir qu'au prix de la ruine ou de l'appauvrissement d'autrui ; elles constituent une spoliation manifeste, un véritable brigandage. Mais s'arrête-t-on à des considérations de si mince valeur quand il s'agit de la fortune? D'ailleurs cette spoliation n'est-elle pas légale ? ce brigandage n'est-il pas consacré par la pratique de toutes les nations civilisées? N'est-il pas admis universellement que l'on peut confisquer au moyen d'une simple ordonnance la clientèle d'une industrie étrangère et imposer à la « nation protégée » une surtaxe de renchérissement, payable entre les mains des bénéficiaires de la clientèle confisquée?
Cependant des théoriciens s'avisent de dénoncer une violation si inique et si désastreuse du droit de propriété. Ils réclament la liberté des échanges, en invoquant la justice et en s'appuyant sur l'intérêt des masses. Mais on n'est pas embarrassé pour répondre à ces théoriciens. D'abord on les accuse de faire de la théorie, et, aux yeux de bien des gens, l'accusation est sans réplique. Ensuite on va chercher, dans le vieil arsenal des erreurs populaires et des préjugés en crédit, toutes sortes d'armes redoutables dont on se sert pour pulvériser une théorie si pernicieuse. Par la même raison que les inventeurs étaient jadis persécutés et bafoués, les promoteurs de la liberté des échanges sont traités de rêveurs dangereux, et les fauteurs du régime prohibitif considérés comme des bienfaiteurs de l'humanité.
Elle est longue la liste des sophismes qui ont été mis en usage pour déguiser les motifs vrais de l'exhaussement progressif des barrières douanières depuis l'établissement de la paix générale. Souvent, il faut le dire, ces sophismes étaient employés de bonne foi par des hommes qui se persuadaient qu'en s'enrichissant au moyen des déprédations internationales de la prohibition, ils contribuaient à la grandeur et à la prospérité de leur patrie. Presque toujours aussi l'ignorance des saines notions économiques était si générale que l'action de profiter des primes de renchérissement, en établissant une industrie à contre-sens de la nature, était considérée, même par les victimes de la prohibition, comme une œuvre de dévouement patriotique.
Nous n'avons pas l'intention de relever tous les sophismes qui ont été forgés pour justifier la prohibition et glorifier les prohibitionnistes. Ce serait à n'en pas finir. Nous nous bornerons à passer en revue ceux qui sont employés le plus fréquemment.
§ IV. Revue des sophismes prohibitionnistes.
(1.) Qu'une nation ne doit pas se mettre sous la dépendance de l'étranger, notamment pour les objets de première nécessité.
Cet argument était le plus important de ceux que les prohibitionnistes anglais opposaient aux free-traders, promoteurs de l'abolition des lois céréales. Se mettre dans l'obligation de recourir à l'étranger pour sa subsistance, disaient-ils, n'est-ce pas renoncer à son indépendance politique? Une nation à qui ses ennemis réussiraient à couper les vivres ne serait-elle pas obligée de se rendre à discrétion? — Mais quoi de plus chimérique qu'une appréhension de cette nature? Lorsque deux nations concluent des échanges, la dépendance qui en résulte n'est-elle pas réciproque? Si l'Angleterre dépend aujourd'hui pour sa subsistance de la Russie, de la France et des États-Unis, ces trois pays ne dépendent-ils pas à leur tour de l'Angleterre pour leur consommation de fer, de houille, de cotonnades, de lainages, etc.? D'ailleurs, en admettant même que l'Angleterre se brouillât avec la plupart des nations qui l'approvisionnent de blé, ne pourrait-elle pas, moyennant un faible supplément de prix, combler son déficit chez les autres nations? La gigantesque folie du blocus continental n'a-t-elle pas démontré l'impossibilité d'isoler commercialement une nation puissante? Et s'il s'agit d'un petit peuple, les relations commerciales qu'il se crée au dehors ne lui fournissent-elles pas de nouvelles garanties d'indépendance, en rattachant à sa cause tous les intérêts qu'il a su rendre solidaires des siens?
Un des plus brillants orateurs de la ligue, M. W.-J. Fox, a fait merveilleusement ressortir, dans un morceau qui est demeuré célèbre, tout ce que l'argument de l'indépendance de l'étranger a de suranné :
« Être indépendant de l'étranger, disait-il, c'est le thème favori de l'aristocratie. Mais qu'est-il donc ce grand seigneur, cet avocat de l'indépendance nationale, cet ennemi de toute dépendance étrangère? Examinons sa vie. Voilà un cuisinier français qui prépare le diner pour le maitre, et un valet suisse qui apprête le maître pour le diner. Milady, qui accepte sa main , est toute resplendissante de perles, qu'on ne trouva jamais dans les huitres britanniques, et la plume qui flotte sur sa tête ne fit jamais partie de la queue d'un dindon anglais. Les viandes de sa table viennent de la Belgique, ses vins du Rhin ou du Rhône. Il repose sa vue sur des fleurs venues de l’Amérique du Sud, et il gratifie son odorat de la fumée d'une feuille venue de l’Amérique du Nord. Son cheval favori est d'origine arabe, et son chien de la race de Saint-Bernard. Sa galerie est riche de tableaux flamands et de statues grecques. Veut-il se distraire? il va entendre des chanteurs italiens, vociférant de la musique allemande, le tout suivi d'un ballet français. S'élève-t-il aux honneurs judiciaires? l'hermine qui décore ses épaules n'avait jamais figuré jusque-là sur le dos d'une bête britannique. Son esprit même est une bigarrure de contributions exotiques. Sa philosophie et sa poésie viennent de la Grèce et de Rome, sa géométrie d'Alexandrie, son arithmétique d'Arabie, et sa religion de Palestine. Dès son berceau, il pressa ses dents naissantes sur du corail de l’océan Indien; et lorsqu'il mourra, le marbre de Carrare surmontera sa tombe ... Et voilà l'homme qui dit : Soyons indépendants de l'étranger ! » [129]
La réfutation n'est-elle pas aussi péremptoire qu'elle est piquante? Ajoutons-y seulement que l'Angleterre, en se mettant pour sa subsistance sous la dépendance de la Russie, de la France et [57] des États-Unis, ses « ennemis naturels », a singulièrement affaibli la portée du sophisme de l'indépendance de l'étranger.
(2.) Qu'une nation doit éviter de multiplier ses achats à l’étranger, afin de prévenir l'épuisement de son numéraire.
On a reconnu déjà le vieux sophisme de la balance du commerce. Naguère encore dans toutes les bouches, ce sophisme est maintenant beaucoup moins employé. Les prohibitionnistes anglais notamment paraissent avoir eu honte de s'en servir. Ce discrédit d'un argument jadis si en vogue tient à plusieurs causes : d'abord à la guerre à mort que les économistes ont faite à la théorie de la balance du commerce; ensuite à la diminution de l'importance relative des importations et des exportations du numéraire dans les transactions internationales; enfin à l'expérience, qui a successivement démontré que la suppression des barrières douanières entre les différentes provinces de France, entre l'Angleterre et l'Irlande, entre les États composant actuellement le zollverein, n'a été suivie d'aucun des désastres monétaires prédits par les théoriciens du système mercantile. Cependant le préjugé n'a point disparu, et aussi longtemps que les lois de la circulation monétaire ne seront point suffisamment vulgarisées, on pourra ameuter les peuples contre la liberté des échanges, en les effrayant du fantôme de l'épuisement du numéraire. (Voyez Balance du Commerce.)
(3.) Qu'il faut compenser, au moyen de droits protecteurs, les impôts établis sur l'industrie nationale.
Si les prohibitionnistes anglais se sont peu servis du sophisme de l'épuisement du numéraire, en revanche ils ont fait largement usage de celui des droits compensateurs. Les agriculteurs anglais supportent, disaient-ils, des impôts plus nombreux et plus lourds que les agriculteurs russes. N'est-il pas juste de compenser la différence au moyen d'un droit protecteur.? N'est-il pas juste d'égaliser les conditions de la production intérieure avec celles de la production étrangère? — Mais, en premier lieu, les différences dans les chiffres des impôts signifient-elles bien toujours ce qu'elles semblent signifier? Les agriculteurs anglais payent plus d'impôts que leurs concurrents russes, rien n'est plus vrai. Mais ne jouissent-ils pas d'une sécurité et d'une liberté plus complètes? ne sont-ils pas mieux protégés contre la spoliation et l'arbitraire? et ce supplément de sécurité et de liberté n'équivaut-il pas bien à l'excédant d'impôts qu'ils ont à payer? En second lieu, la protection peut-elle bien, en réalité, compenser les charges que des impôts excessifs font peser sur la production d'un pays? Protégez l'agriculture nationale, sous le prétexte qu'elle est plus grevée d'impôts que ses rivales, et vous fournirez, sans aucun doute, une compensation aux agriculteurs, en leur permettant d'augmenter les prix de leurs denrées. Mais sur qui retombera le fardeau dont vous les aurez exonérés? Sur toutes les autres branches de la production, qui payeront plus cher et leurs matières premières et la subsistance de leurs travailleurs. Ce qui sera gagné d'un côté sera donc perdu d'un autre. A moins de faire en sorte qu'un impôt qui entre dans les caisses du trésor ne soit payé par personne, les droits compensateurs ne peuvent dégrever la production. Or, s'ils ne peuvent ni détruire ni même atténuer le mal attaché à l'existence de tout impôt, à quoi bon déplacer ce mal? Ne vaut-il pas mieux déplacer l'impôt lui-même, s'il y a lieu, que d'en déplacer les effets par ce procédé détourné et subreptice?
(4.) Qu'il faut protéger le « travail nationale » pour empêcher le nombre des emplois de la production de diminuer sous l'effort de la concurrence étrangère et garantir ainsi des moyens d'existence aux ouvriers.
Ce sophisme a une importance notable en ce qu'il donne à la prohibition un précieux vernis de philanthropie. Si les propriétaires fonciers et les entrepreneurs d'industrie réclament à grands cris des prohibitions, ce n'est pas pour réaliser des profits extraordinaires aux dépens de leurs concurrents et de leurs concitoyens; non! c'est uniquement pour assurer du travail et de bons salaires aux travailleurs nationaux; c'est pour préserver les classes laborieuses des inconvénients funestes de la concurrence illimitée, etc., etc. Mais quoi! si tel était l'unique but des prohibitionnistes, devraient-ils se borner à frapper d'interdiction les produits du dehors ? Ne devraient-ils pas prohiber avant tout l'importation des ouvriers étrangers qui viennent faire concurrence aux nationaux? Voit-on cependant qu'ils s'abstiennent d'employer des ouvriers étrangers, même aux époques où ils invoquent avec le plus d'énergie la nécessité de protéger le « travail national? » Non. Ils ne s'en sont jamais fait scrupule. [130] La contradiction entre leur argument et leur conduite n'est-elle pas flagrante ? (Voyez Émigration.) [58] Maintenant est-il vrai que le système prohibitif ait pour résultat d’augmenter le nombre des emplois productifs de l'industrie nationale? Examinons. Nous avons remarqué que les prohibitions agissent sur les prix à l'inverse des machines nouvelles ; qu'en provoquant certaines industries à se placer dans de mauvaises conditions économiques et en entravant les progrès de la division du travail, elles déterminent l'augmentation des prix, tandis que les machines nouvelles en déterminent l'abaissement. Or est-ce que les machines ont pour résultat de diminuer le nombre des emplois productifs? L'expérience n'atteste-t-elle pas, au contraire, qu'elles ont pour résultat final de l'accroître, par le développement successif et général de la consommation? Ne compte-t-on pas aujourd'hui plus et de meilleurs emplois productifs dans l'industrie cotonnière, par exemple, qu'on n'en comptait avant que la machine à vapeur et la mule-Jenny eussent transformé cette industrie? Un homme qui proposerait de briser les machines à filer et à tisser le coton, et de les remplacer par des métiers à la main pour augmenter les emplois du travail, ne serait-il pas à bon droit qualifié de fou? Mais si les machines nouvelles ont pour résultat final d'accroitre le nombre des emplois productifs, les prohibitions ne doivent-elles pas avoir pour résultat de le réduire? Au point de vue des intérêts de la classe ouvrière, les errements des prohibitionnistes valent-ils mieux que ceux des briseurs de machines?
En enchérissant toutes choses, le système prohibitif diminue la consommation, partant la production, partant aussi le nombre des emplois productifs. C'est ainsi qu'il protège le travail national. Contribue-t-il, au moins, à lui donner plus de stabilité? Donne-t-il aux ouvriers une garantie contre les crises industrielles, ainsi que l'affirment les prohibitionnistes? N'est-ce pas encore le contre-pied de cette assertion qu'il faut prendre? N'avons-nous pas remarqué déjà qu'en mettant l'industrie à la merci de la mobile volonté des législateurs, le système prohibitif a rendu l'instabilité permanente dans toutes les branches de la production? N'avons-nous pas remarqué que tout changement opéré dans un tarif engendre inévitablement une crise dans l'arène industrielle? N'est-ce pas aux perturbations incessantes que le système prohibitif a occasionnées dans les débouchés qu'il faut attribuer tant de crises redoutables qui ont meurtri l'existence des travailleurs? L'histoire de l'industrie moderne offre, à cet égard, de tristes enseignements. On peut voir à toutes ses pages quels maux cruels a attirés sur les classes laborieuses ce système « protecteur du travail national. » (Voyez Paupérisme.)
(5.) Que la nationalité doit être prise pour base du système des échanges.
Cet argument est la pierre principale sur laquelle le docteur List a édifié son système national d'Économie politique. Mais en étudiant l'histoire de la formation des États et en examinant les éléments qui les constituent, on s'aperçoit aisément que la nationalité ne saurait servir de base à un système d'échanges. Les États ont été, pour la plupart, formés par la conquête et agrandis soit par des alliances princières, soit par des guerres, soit par des combinaisons diplomatiques. Aucune considération économique n'a présidé à leur formation. Lorsque la carte d'Europe a été remaniée au congrès de Vienne, par exemple, a-t-on consulté les besoins de l'industrie et du commerce des peuples dont on changeait la nationalité? S'est-on demandé si la situation économique des provinces rhénanes et des autres pays que l'on séparait de l'empire français leur rendait cette séparation avantageuse ou nuisible? S'est-on livré à des recherches approfondies sur la situation de l'industrie et du commerce de la Hollande et de la Belgique avant d'unir ces deux pays? Non ! On n'a pas même envisagé la question sous cet aspect. Les considérations politiques et les intrigues diplomatiques seules ont décidé alors de la nouvelle configuration des États. Et c'est dans des États à la formation desquels aucune vue économique n'a présidé, dans des États que les hasards de la guerre et des alliances, seuls, ont délimités, que l'on voudrait établir un système national d'échanges fondé sur de prétendues nécessités économiques ! Ces frontières que les hasards des événements seuls ont posées et qu'ils peuvent de nouveau rapprocher ou reculer demain, on voudrait les transformer en limites rationnelles des échanges! N'est-ce pas le comble de l'absurdité? Un système économique établi sur une base politique et politiquement modifiable, n'est-ce pas une monstruosité que le bon sens repousse?
(6.) Si le système protecteur n'existait pas, peut-être ferait-on bien de ne pas l'inventer; mais vouloir le détruire aujourd'hui, ce serait prononcer l'arrêt de mort d'une multitude d'industries, occasionner des déplacements ruineux de capital et de travail, etc., etc.
Nous avons signalé plus haut l'analogie profonde qui existe entre l'établissement d'une machine nouvelle et la suppression d’une prohibition. L'un et l'autre procédés ont pour résultat de substituer le bon marché à la cherté et l'abondance à la pénurie. Mais tout progrès, quelle qu'en soit la source, est accompagné d'une perturbation, d'une crise. Tout progrès déplace des capitaux et des existences. Faut-il donc, pour éviter cette perturbation passagère, renoncer à un progrès permanent? Faut-il renoncer aux nouvelles machines, aux nouvelles méthodes, aux nouvelles idées, sous prétexte qu'elles dérangent les vieilles machines, les vieilles méthodes, les vieilles idées? Faut-il, pour éviter de déplacer des existences, immobiliser l'humanité? Écoutons là-dessus M. le docteur Bowring, qui a admirablement réfuté, au congrès des Économistes de Bruxelles, cette objection de paralytique :
« Le déplacement des capitaux, disait-il, le déplacement des capitaux ! mais c'est le représentant du progrès ! La charrue n'a-t-elle pas déplacé [59] la bêche? Que sont devenus les copistes après l'introduction de la découverte de l’imprimerie? ... Nous avions naguère sur la Tamise des milliers de petits batelets; que sont-ils devenus, aujourd'hui que la Tamise est sillonnée de centaines de bateaux à vapeur? Ne croyez-vous pas cependant que l'intérêt public, l'intérêt de l'ouvrier lui-même est servi par ce moyen si rapide et si économique de communication? Je me rappelle que, la première fois que je me suis rendu à Londres, il m'a fallu payer 5 francs pour aller d'une partie de la ville à l'autre. Je fais aujourd'hui le même parcours pour 6 sous; et si vous me demandez comment on est arrivé à ce résultat, je vous répondrai : C'est par le déplacement du travail et des capitaux.
« Ce déplacement se retrouve à chaque instant. Je suis né dans une ville qui figure dans l'histoire commerciale de mon pays et qui occupe une belle page dans l'histoire. J'y ai vu périr une industrie tout entière, l'industrie des laines, à Exeter. J'ai vu dans le port de cette ville des bâtiments de tous les pays, et j'ai entendu mes ancêtres parler de leurs relations avec les pays les plus éloignés. Mais dès le moment que la vapeur s'est emparée des fabriques, comme le combustible est fort cher dans ce pays, l'industrie s'est éloignée pour s'implanter dans les villes ou dans les districts où il est à bon marché. Eh bien! les capitaux se sont déplacés, mais la population ne s'est pas moins augmentée. Quand j'ai quitté Exeter, elle n'avait que 25 mille habitants ; elle en a aujourd'hui 40 mille. Les ouvriers ont été absorbés par d'autres emplois, ils se sont livrés à d'autres occupations.
« D'ailleurs qui a déplacé le travail? qui a déplacé les capitaux? qui a déplacé l'industrie? qui l'a mise sur un faux terrain? qui a construit sur le sable? C'est le prohibitionnisme. Ce que nous demandons, nous, c'est de fonder l'industrie sur un rocher où aucune atteinte ne puisse l'ébranler. » [131]
Cependant les déplacements que pourrait occasionner la substitution de la nouvelle méthode de la liberté des échanges à la vieille méthode du prohibitionnisme, auraient-ils bien les proportions qu'on se plaît à leur attribuer? L'avènement de la liberté des échanges deviendrait-il le signal de la ruine d'une multitude d'industries? Verrait-on des contrées entières désertées pour d'autres, ainsi que l'affirment les pessimistes de la prohibition ? L'observation et l'expérience s'accordent pour démentir de si noires prévisions. L'exposition de Londres a pu convaincre les esprits les plus prévenus que les grandes industries des différentes contrées de l'Europe ont à peu près un égal degré d'avancement, et qu'aucun peuple ne possède, en définitive, une supériorité marquée sur ses rivaux.
« Le palais de cristal, dit notamment M. Michel Chevalier, dans ses intéressantes lettres sur l'exposition de Londres, le palais de cristal est le bon endroit pour vérifier cette similitude, celte fraternité, cette égalité de l'industrie chez les peuples principaux de la civilisation occidentale. Elle y est évidente, elle y crève les yeux. Quand je me transporte du quartier anglais au quartier français, de là dans la région qu'occupe le zollverein, ou chez les Suisses ou chez les Belges, ou chez lea Hollandais, je retrouve des objets d'un mérite à peu près équivalent, qui attestent à peu près et une même aptitude et la même expérience, et le même acquit. C'est plus particulièrement visible, pour l'Angleterre et la France, surtout si l'on a soin de compléter notre exposition de Londres par le souvenir des articles que nous avions au carré Marigny en 1849, et dont les producteurs abusés se sont refusés à envoyer les pareils à Londres. En parlant ainsi d'égalité, je ne prétends pas que les productions des principales nations soient identiques; au contraire, elles sont diverses, elles ont un cachet particulier. Elles révèlent dans le génie industriel des nuances spéciales, une originalité distincte, mais elles accusent, à très peu près, un égal degré d'avancement. Si l'on est dépassé dans un genre d'articles, on est le premier dans un autre genre qui est tout voisin , qui est tout aussi difficile; et il n'est pas douteux que, quant au premier, on n'aurait besoin que d'être aiguillonné pour rattraper la nation qui y excelle. En supposant que les matières premières fussent partout au même degré de bon marché (et l'on en serait bien près si le législateur supprimait chez certains peuples des causes tout artificielles de cherté qu'il s'est plu à multiplier), les frais de production des articles manufacturés seraient à peu de chose près les mêmes, et ces diverses nations seraient à très peu près égales les unes aux autres sous le rapport du bon marché. » [132]
Dans une polémique récente, occasionnée par le célèbre discours de M. Thiers sur le régime commercial de la France, [133] un industriel distingué de Mulhouse, M. Jean Dolfus, est venu corroborer encore les assertions de M. Michel Chevalier. Selon M. Jean Dolfus, le régime prohibitif a pour unique effet d'empêcher l'industrie cotonnière d'adopter les progrès réalisés par ses rivales. Il agit purement et simplement comme une cause de retard.
« Nous ne suivons pas suffisamment, dit cet industriel éclairé, les progrès réalisés en Angleterre. On a commencé, il y a une dizaine d'années, à y remplacer les anciens métiers à filer par des machines qui renvident sans le secours de l'ouvrier; aujourd'hui, pour certains numéros, il n'en existe pas d'autres; chacun s'est vu obligé de suivre le progrès. Chez nous, au contraire, on gagne encore de l'argent avec des machines fort anciennes, et la somme affectée à compenser les dépréciations annuelles, au moins dans la filature de coton, ne serait guère nécessaire, car elle n'est généralement pas employée à améliorer les métiers.
« Pourquoi le progrès réalisé en Angleterre n'est-il pas devenu obligatoire en France? Parce que chacun reste dans la même voie. On continue de cette manière à faire des filés que l'on pourrait fabriquer beaucoup moins cher, à l'aide de quelques dépenses. Ma maison a une filature de 25 [60] mille broches, dont 20 mille pour calicot; elle pourrait, en remplaçant ses métiers, dont une partie date de près de 40 ans, filer le kilogramme à 20 centimes meilleur marché qu'aujourd'hui ; mais la concurrence intérieure n'est pas assez puissante pour l'y contraindre. Cet exemple n'est-il pas assez concluant? Qui est-ce qui paye les 20 centimes? Le consommateur, le pays. Le comité pour la défense du travail national a pensé qu'il ne fallait pas changer nos métiers, parce que beaucoup de fileurs se trouveraient sans ouvrage. Mais pouvons-nous impunément résister ainsi au progrès? A ce compte, nous reviendrions au rouet, et nous aurions à déplorer tous les progrès mécaniques réalisés depuis 50 ans. Si la filature peut produire plus économiquement, la consommation augmentera ; il se vendra plus de cotonnades; on construira plus de machines, et il y aura plus de travail. » [134]
Ainsi donc, aux yeux des industriels eux-mêmes, le système prohibitif apparaît comme une cause de retard pour la production. Que ce régime disparaisse, et toute industrie placée dans des conditions naturelles prendra inévitablement une extension considérable. Il faudra, sans aucun doute, déployer alors plus d'intelligence, d'activité et d'énergie pour conserver et pour accroître sa clientèle : car la liberté des échanges n'est pas, comme la prohibition, un oreiller commode. Il faudra que chaque industrie s'assimile, sans tarder, tous les progrès nouveaux pour se maintenir au niveau de ses rivales. Mais l'humanité tout entière ne bénéficiera-t-elle pas de cette impulsion énergique que la production aura reçue? Les hommes ne seront-ils pas plus abondamment pourvus de toutes choses, et leur intelligence, mieux tenue en éveil par la nécessité, ne deviendra-t-elle pas plus accessible à toutes les lumières?
La nécessité! tel est le puissant aiguillon du progrès, et la liberté des échanges aura surtout pour résultat de rendre le progrès de plus en plus nécessaire. Voyez, par exemple, l'agriculture britannique. Combien de fois les prohibitionnistes avaient prédit qu'elle ne pourrait soutenir la concurrence des États-Unis, de la Pologne et de la Russie! Combien de fois ils avaient montré ses champs dévastés, ses laboureurs ruinés et dispersés par l'ouragan du free-trade, et la vieille Angleterre, privée de ce support de sa puissance, disparaissant de la liste des nations ! Eh bien ! les lois céréales ont été abolies, le free-trade a été intronisé, et qu'est devenue l'agriculture britannique? A-t-elle sombré dans la tourmente? Ses capitaux ont-ils été détruits et ses champs submergés par « l'inondation» des blés étrangers? Propriétaires et fermiers ont-ils réalisé leur menace d'émigrer en Amérique, en abandonnant leurs terres au chardon et à la ronce? Non! L'agriculture britannique est aujourd'hui plus florissante que jamais. A peine les lois céréales étaient-elles abolies, que les agriculteurs, redoublant leurs efforts, mettaient de toutes parts le progrès à l'ordre du jour : les vieux instruments et les vieilles méthodes étaient abandonnés, et l'agriculture, si longtemps vouée à la routine, prenait rang parmi les industries les plus progressives. Ainsi transformée sous la pression énergique de la concurrence extérieure, elle se joue maintenant des efforts de ses rivales, et les agriculteurs haussent dédaigneusement les épaules à l'aspect du fantôme qui les épouvantait naguère.
« Quoique l'abondance et le bas prix des aliments aient pesé lourdement pendant un certain temps sur l'agriculture britannique , écrivait récemment un habile agriculteur anglais, M. Mechi, la concurrence a tellement poussé aux améliorations, que je pense que nous finirons par battre le monde pour le blé aussi bien que pour le calicot.» [135]
Voilà pourtant une industrie qui devait être infailliblement ruinée par l'avénement du free-trade !
En observant donc, comme l'ont fait MM. Michel Chevalier et Blanqui à l'exposition universelle de Londres, la situation actuelle de l'industrie du monde civilisé, et en examinant attentivement les résultats déjà acquis par l'expérience des réformes douanières, on acquiert la conviction que les déplacements ruineux de la production, la destruction des industries protégées et tant d'autres calamités qui doivent, selon les prohibitionnistes, accompagner l'avènement de la liberté des échanges, sont de véritables fantômes. On acquiert la conviction que l'adoption de cette « nouvelle méthode » fortifierait et développerait partout l'industrie, bien loin de la compromettre et de la ruiner.
Nous bornons là notre revue des sophismes prohibitionnistes, bien que la matière soit loin d'être épuisée; mais on sait que ces arguments véreux, employés pour la défense d'une cause détestable, ont été successivement combattus et percés à jour par tous les économistes qui se sont succédé depuis Adam Smith et Turgot. On en trouvera surtout une réfutation pleine de verve malicieuse et spirituelle dans les Sophismes économiques de Fréd. Bastiat. Nous y renvoyons nos lecteurs.
III. Conclusion.
La liberté des échanges apparaît à la fois comme un élément de bon marché et comme un élément d'ordre. Qu'elle vienne à être établie et aussitôt l'industrie, mise en possession d'un marché illimité, prendra tout le développement dont elle est susceptible. En même temps, elle acquerra un maximum de stabilité, en cessant d'être bâtie sur le sable pour se fonder sur le roc, selon l'expression pittoresque du docteur Bowring. A la cherté et à l'instabilité inhérentes au régime artificiel de la prohibition, succéderont le bon marché et la stabilité, comme des conséquences naturelles du retour à l'ordre institué par la Providence. Maintenant est-il chimérique de compter sur un progrès si bienfaisant? La liberté des échanges est-elle un idéal économique auquel il nous soit interdît d'atteindre? Est-ce une pure utopie, un rêve humanitaire, comme l'affirment les défenseurs de la prohibition? Que l'on examine les signes du temps, et que l'on prononce. Au nombre des préoccupations les plus vives, nous pourrions dire les plus [61] ardentes de notre époque, ne voyons-nous pas figurer le développement progressif des voies de communication? Toutes les nations civilisées ne multiplient-elles pas à l'envi sur leurs territoires les canaux, les chemins de fer et les télégraphes électriques? La vapeur et l'électricité n'entament-elles pas de plus en plus l'obstacle naturel des distances? Or le résultat économique de ces progrès merveilleux qui font aujourd'hui l'objet de l'émulation du monde, quel est-il? N'est-ce pas d'étendre de plus en plus le rayon des échanges? Les chemins de fer, les bateaux à vapeur, les télégraphes électriques sont-ils autre chose que des instruments puissants qui entament, qui dévorent les distances au profit des échangea de cité à cité et de peuple à peuple? Mais quoi ! tandis que les nations s'imposent des sacrifices gigantesques pour multiplier les instruments qui facilitent les échanges, elles continueraient de maintenir, d'un autre côté, le système prohibitif qui les intercepte! Elles stimuleraient d'une main le développement des échanges pour l'entraver de l'autre ! Une contradiction si flagrante ne finira-t-elle point par frapper tous les esprits! Ou l'on renoncera à la locomotion à la vapeur et à la télégraphie électrique, ou l'on renoncera au système prohibitif, car l'existence simultanée de ces agents de la civilisation et de ce vestige de la barbarie est un non-sens par trop absurde.
Mais il y a peu d'apparence que l'on renonce à la locomotion à la vapeur et à la télégraphie électrique. Le régime prohibitif est, au contraire, de toutes parts entamé. Les gouvernements ont fini par s'apercevoir que les droits prohibitifs ne leur rapportaient rien et qu'ils pouvaient faire une excellente opération en les remplaçant par des droits fiscaux. Un homme d'État illustre, sir Robert Peel, a pris cette observation pour point de départ de sa politique financière, et le budget de la Grande-Bretagne, qui se soldait en déficit avant les réformes de sir Robert Peel, a présenté ensuite des excédants réguliers de recettes. La même réforme accomplie aux États-Unis a donné des résultats semblables. [136] Les nécessités financières se joignent ainsi aux nécessités économiques et aux tendances progressives de notre siècle pour battre en brèche le régime prohibitif. Les prohibitions peuvent être comparées aux chaînes dont on se servait pour barrer les rues aux époques troublées du moyen âge. Elles apparaissent de nos jours comme un vestige d'un système de défense que les progrès de la civilisation ont rendu inutile et suranné. On cessera donc de barrer les frontières comme on a cessé de barrer les rues, et, n'en déplaise aux utopistes en vieux qui placent leur idéal dans le passé, la liberté finira par devenir la loi universelle des transactions humaines.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Essai sur le commerce (voyez chap. X et XI), par Melon. Paris, 1734, 1736, 1742, 1761. Reproduit dans le 1er vol. de la Collection des Princ. Écon.
Le commerce et le gouvernement, par Condillac. Dernière édit., Paris, Guillaumin, t. XIV de la Collect. des Princ. Écon. (Voyez Condillac.)
New and old principles of trade compared; or a treatise on the principles of commerce between nations. — (Les nouveaux et les anciens principes du commerce comparés*, etc.). Londres, 1764. « Les anciens principes sont ceux du système mercantile et restrictif, les nouveaux ceux de Quesnay et d'Adam Smith. » (M. C.)
Lezioni di commercio, etc. — (Cours de commerce), par l'abbé Antoine Genovesi. Naples, -1764, 2 vol. in-8.
Der geschlossene Handelstaat. — [L'Etat fermé commercialement), par J.-G. Fichte. Tübingue, 1800, in-8. (Voyez Fichte.)
Opinion de M. Begouen, député de la Seine-Inférieure à l'assemblée nationale, sur le tarif de la prohibition des marchandises étrangères. Imprimé par ordre de l'assemblée nationale. Décembre, 1790, in-8 11 pages.
Il colbertismo, ossia della libertà di commercio de' prodotti della terra. — (Du colbertisme, ou de la liberté du commerce des produits du sol), par Fr. Mengotti. Milan, 1802, 2 vol. Couronné en 1791 par l'Académie des géorgophiles de Florence.
Examen des principes les plus favorables aux progrès de l'agriculture, des manufactures et du commerce de la France, par L.-D. B. Paris, 1815, 2 vol. in-8.
Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe, par de Tollenare. Paris, 1820, 4 vol. in-8.
Gewerbe- und Handelsfreiheit. — (Liberté de l'industrie et du commerce), par L.-G. Leuchs. Tübingue, 1827, 1 vol. in-8.
Enquête sur les fers. Commission formée avec l'approbation du roi, sous la présidence du ministre du commerce et des manufactures, pour l'examen de certaines questions de législation commerciale. Paris, Imprimerie royale, 1828, petit in-4. (Voy. l'art. Enquêtes.)
Questions commerciales, par Rodet. Paris, 1828,1 vol. in-8.
Du commerce maritime, considéré sous le rapport de la liberté entière du commerce et sous le rapport des colonies, par le comte de Vaublanc. Paris, 1828, 1 vol. in-8.
Du commerce, des douanes et du système des prohibitions, considéré dans ses rapports avec les intérêts respectifs des nations, par Billiet. Ouvrage couronné par l'Académie de Lyon en 1827. Paris, Renard (Guillaumin), 1828, 1 vol. in-8.
De l’enquète commerciale, par M. Ferrier. Paris, Pélicier et Chatel, 1829, br. in-8 de 72 pages.
Réponse de M. le comte de Polignac à la lettre de MM. Girod (de l'Ain) et vicomte Perrault de Jotemps ... sur la nécessité de la prohibition des laines étrangères. Paris Ve Huzard, 1828, in-4 de 110 pages.
Report of the committee of the house of représentatives on commerce and navigation. — (Rapport de M. Cambreleng sur le commerce et la navigation, adressé à la chambre des représentants). New-York, 1830, in-8. « Exposition d'une évidence frappante de l'influence fâcheuse du système restrictif. » (M. C.)
Mémorial of the committee appointed by « the free-trade convention » held at Philadelphia in september and october 1831.— (Mémoire du comité nommé pur ta convention du libre-échange réunie à Philadelphie.) New-York, 1832, in-8.
Intérêts de l'agriculture, de l'industrie et du commerce français, par M. de Cazaux. Paris, Mme Huzard, 1833, br. in-8.
On commerce, ils principles and history. — (Le commerce, ses principes et son histoire), par M. J.-R. Mac Culloch. Londres, 1833, in-8.
Der Staat und die Industrie. — (L’État et l'industrie), par Bülau, professeur à Leipzig. Leipzig, 1834. En faveur du libre-échange.
Contre-enquête par l'homme aux quarante écus, contenant un examen des arguments et des principes mis en avant dans l'enquête commerciale. Paris, Charpentier, 1834, broch. in-8 de 24 pages.
Enquête relative à diverses prohibitions établies à l'entrée des produits étrangers. Paris, imprimerie royale, 3 vol. in-4. (Voy, l'ant. Enquêtes.)
De la liberté commerciale, du crédit et des banques, avec projet d'une banque générale du crédit et de l'industrie, par Gastaldi. Turin, 1840,1 vol. in-8.
Das nationale system der politischen Economie. — (Le système national de l'Economie politique, t. 1, te commerce international, etc.), par Frédéric List. 1e édit., Tübingue, 1841. Traduit de l'allemand, par H. Richelot. Paris, Capelle, 1851,1 fort vol. in-8. Presque entièrement consacré à la question douanière, réfuté dans l'ouvrage suivant:
List’s national-System der polit. Œconomie kritisch beleuchtet. — Critique du système national, etc., de List), par Ch.-U. Brüggemann. Berlin, 1842, 1 vol. in-8. (Voyez List.)
Influencia del systema prohibitivo en la agricultura, industria, comercio y rentas publicas. — (Influence du système prohibitif sur l'agriculture, l'industrie, le commerce et les revenus publics), par D. Manuel Marliani. Madrid, 1842,1 vol. in-8.
Die Nothwendigkeit der Handelsfreiheit für das National-Einkommen mathematisch bewesen. — (La nécessité de la liberté commerciale pour les revenus de l'Etat, prouvée mathématiquement), par Hagen, professeur à Kœniigsbeig. 1844.
Die Bedeutung der Industrie und die Nothwendigkeit von Schutzmassregeln. — (De l'importance de l'industrie, et de la nécessité de la protection), par le Dr. Glaser, professeur à Berlin. Berlin, 1845.
Der deutsche Zollverein und das Schutz-System. — (L'association douanière allemande et le système protecteur, etc.), par Ch.-H. Brüggemann. Berlin, 1845, forte br. in-8. En faveur de la liberté commerciale.
Le Libre-Echange, journal de l'association pour la liberté des échanges, rédige par MM. Anisson-Dupéron, Fréd. Bastiat, Blanqui, Gustave Brunet, Campau, Michel Chevalier, Ch. Coquelin, Dunoyer, Léon Faucher, Alcide Fonteyraud, Joseph Garnier, Louis Leclorc, de Molinari, Paillottet, Horace Say, Wolowski. 1 vol. in-fol. à 3 colonnes, 1846-47.
Trois discours en faveur de la liberté du commerce, par M. d'Harcourt, ancien pair de France. Paris, Guillaumin et comp., 1846, br. in-8.
Du système prohibitif, par H. Fonfrède. Bordeaux, 1846, hr. in-8. (Voyez Fonfréde.)
Sir Robert Peel et la liberté commerciale , par E. Gout-Desmartres. Bordeaux, Chaumas, 1846, in-8 de 38 pages.
Défense du travail national, ou nécessité de la protection commerciale démontrée à l'aide des principes, des faits et des calculs, par Jules Lebaslier. Paris, Capelle, 1846, in-12.
La liberté des échanges et les droits protecteurs, par M. Lebaillif fils, filateur de coton. Falaise, Levasseur, 1846, in-8 de 20 pages.
De la liberté commerciale et d'autres réformes urgentes, par Georges Clermont. Liège, Desoer, 1846, in-8 de 91 pages.
Coup d'œil sur le tarif des douanes belges à propos du libre-échange, par un négociant de Bruxelles. Bruxelles, Perichon, 1846, in-8 de 30 pages.
Quid faciamus nos? Deutschland, England und der freie Handel. — (Que ferons-nous? Allemagne, Angleterre et libre-échange), par C.-W. Aslier, Berlin, Besser, 1846, in-8 de 38 pages.
Sophismes économiques, par Fr. Bastiat. Paris, Guillauinin et comp., 1re édit, de la 1e série, 1845, 1 vol. in-16; id. de la 2e série, 1847,1 vol. in-16. (Voy. Bastiat.)
Les douanes et l'industrie en 1848 : dangers et nécessités, moyens; par M. le baron Rœderer, pair de France. Paris, F. Didot, 1847, br. in-8, 82 pages.
Économie pratique des nations, ou système économique applicable aux différentes contrées, et spécialement à la France, par le Dr. Thém. Lestiboudois. Paris, Colas, 1847, 1 vol. in-8. (Voyez Lestiboudois.) En faveur de la protection.
De la liberté du commerce et de la protection de l'industrie, lettres échangées entre MM. Blanqui et Emile de Girardin en 1846 et 1847. Paris, br. in-8.
Économistes et industriels, ou résumé de la question du libre-échange, par Henri Dotin. Beauvais, Moisand, 1847, br. in-8.
Association pour la défense du travail national. Mémoire présenté aux chambres sur le projet de loi de douanes. Paris, Guiraudet, 1847, in-4.
Questions du libre-échange mises à la portée de toutes les intelligences, par J.-B. Avril Nevers, Fay, 1847, br. petit in-4 de 100 pages.
La comédie du libre-échange, dialogue sur la liberté commerciale, par Ch. Morlot. Le Havre, Brindeau, 1847, br. in-4.
Du libre-échange et du résultat que l'adoption de ce système aurait pour l'agriculture, le commerce, l'industrie et la marine de la France, par Hantule. Paris, Joubert, 1847, 1 vol. in-8.
Libre-échange et protection, par M. G. Goldenberg. Paris, F. Didot, 1847, in-4.
Association pour la défense du travail national. Examen des théories du libre-échange et du résultat du système protecteur. Paris, Guyot, 1847, in-4.
De la protection et du libre-échange, par Ducrocq. Beauvais, Desjardins, 1847, br. in-8 de 43 pages.
Discours prononcés dans le congrès des Economistes réuni à Bruxelles. Paris, Guillaumin, 1847, 1 vol. gr. in-8.
Études d'Économie politique et de statistique, par M. L. Wolowski. Paris, Guillaumin, 1848, 1 vol. in-8. En partie consacré au commerce des grains, à l'union douanière, à la liberté commerciale.
Second appel au gouvernement et aux chambres sur notre marine marchande, par M. Fonmartin de Lespinasse. Paris, Guillaumin, 1847, br. in-8 de 92 pages.
Principes de législation commerciale et financière, par Mac Gregor; traduit de l'anglais par M. Gustave Brunet. Bordeaux, Chaumas, 1847, in-8 de 30 pages.
Un épicier à M. de Brouckère, à propos du libre-échange. Bruxelles, 1847, Decq, grand in-18.
[63]
Ce qu'il adviendrait de l'agriculture avec le libre-échange, à l'occasion du congrès central d'agriculture de 1847, par M. Huzard. 1847, in-8 de 24 pages.
Abolition du système prohibitif des douanes, grande extension du commerce extérieur, ou entretiens sur le commerce extérieur se rattachant au régime protecteur des douanes, etc., etc., par Jouyne. Paris, Guillaumin et comp., 1848, 1 vol. in-8.
De la liberté du commerce, par M. l'abbé Gainet, curé de Cormontreuil. Reims, Reignier, 1849, in-4 de 20 pages.
Discours de M. Thiers sur le régime commercial de la France, prononcé à l'assemblée nationale les 27 et 28 juin 1851. Paris, Paulin et Lheureux, 1851, in-8 de 144pages. Prononcé à l'occasion d'une proposition de M. Sainte-Beuve à l'assemblée législative. Réfuté par le suivant :
Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur, par M. Michel Chevalier, membre de l'Institut. Paris, Guillaumin et comp., 1852, 1e et 2e édit., 1 vol. in-8.
Études sur les deux systèmes opposés du libre-échange et de la protection, par Ant.-Marie Rœderer. Paris, Guillaumin et comp., 1851, 1 vol. iii-8.
Réponse de M. Rœderer à l'article que M. de Molinari a fait insérer dans le Journal des Economistes du 15 septembre 1851, portant réfutation de quelques passages de l'ouvrage ci-dessus. Paris, les mêmes, 1851, br. in-8.
Voyez la réplique de M. de Molinari dans le Journal des Économistes, t. XXll, p. 159.
Sauf très peu d'exceptions, tous les traités généraux d'Économie politique consacrent un ou plusieurs chapitres à la liberté commerciale. Les partisans du système mercantile ou de la balance du commerce sont contre; les physiocrates et les disciples d'Adam Smith et de J.-B. Say sont pour la liberté des échanges. Voyez surtout Rossi, IIe volume, xie, xiie, xiiie, xive, xve leçons.
Cette question est encore traitée dans un grand nombre d'écrits relatifs à des sujets spéciaux, tels que les fers, les aciers, les sucres, les laines, etc. ; dans les publications des chambres de commerce, parmi lesquelles il est juste de remarquer celles de la chambre de Bordeaux, puis celles des chambres de Marseille, Rouen, le Havre, Lille, etc.; dans les publications des associations pour la liberté des échanges, de divers comités de producteurs, des associations protectionnistes, de la Société industrielle de Mulhouse. Voir notamment dans le Journal des Économistes, t. XVI, p. 81, la Réponse de la chambre de commerce de Bordeaux à la circulaire qui lui avait été adressée par le comité protectionniste de Paris au nom des intérêts maritimes du pays; et, t. XXXII, p. 148, un Rapport de M. Jean Zuber fils à la Société industrielle de Mulhouse sur les progrès de l'industrie des papiers peints, avec son opinion sur la prohibition et la protection.
La question théorique et pratique de la liberté des échanges et de la protection a été souvent traitée dans le Journal des Économistes. Voir aux tables analytiques triennales, t. IX, p. 405; t. XVlll, p. 421; t. XXVll, p. 413. Plusieurs articles ont été publiés dans l’Annuaire de l'Économie politique et de la statistique: — Association douanière allemande, par M. de La Nourais; — Du travail national, par M. J. Garnier (1845) ; — De la ligue en Angleterre, par A. Fonteyraud (1846); — Association française pour la liberté des échanges, par C. L. (J. Garnier); — La protection, ou les trois échevins, par Fr. Bastiat; — Analyse du tarif des douanes françaises (confusion du tarif, prohibitions, droits prohibitifs, droits à la sortie, primes et drawbacks, contrebandes, fraudes et saisies), par M. J. Garnier (1847); — Le maire d’Énios, par M. Bastiat;— De l'union des douanes italiennes, par M. Léon Faucher (1848).
De nombreuses discussions ont eu lieu au sein des pouvoirs parlementaires sur la liberté du commerce et la protection au sujet du remaniement des tarif, notamment en Angleterre, en France et aux États-Unis: en Angleterre, lors de la négociation du traité de 1786, plus tard lors des réductions obtenues par Huskisson (voy. Huskisson), et en 1846, lors de la grande réforme de Robert Peel (voy. les art. Ligue et Robert Peel); en France, sous la première constituante; au commencement de la restauration, quand on a aggravé les tarifs; à diverses occasions, sous le gouvernement de juillet et notamment en 1834 (époque à laquelle M. Thiers, ministre du commerce, proposa plusieurs réductions, fit un exposé des motifs relativement libéral); et en 1851, lors de la proposition de M. Sainte-Beuve. — Aux États-Unis la question a été agitée lors de la révision des tarifs, et en 1846, à l'occasion des réformes soutenues par le président Polk et M. Walker, ministre des finances. (Voyez deux messages du président Polk, dans le Journal des Économistes, t. XIX et XXll ; un rapport de M. Walker sur les finances, t. XXlll, et une lettre de ce dernier à la Société d'Économie politique, t. XXXII, p. 409.)
Voir aussi la bibliographie des articles ; Commerce, Douanes, Huskisson, Ligue, Liberté des Échanges (associations pour la), Unions douanières.
Endnotes to Liberté du commerce
[127] Les singes économistes. Brochure in-8, anonyme, traduite par Benjamin Laroche.
[128] Richesse des nations, livre 1, chap. III.
[129] Meeting du 26 janvier 1844 (Cobden et la Ligue, par Fréd. Bastiat, 1er édit., p. 182).
[130] On trouve à cet égard des renseignements précieux dans l'enquête sur les fers publiée en 1829. On sait que l'industrie des fers obtint en 1822 un supplément extraordinaire de protection. Aussitôt cette industrie prit une extension considérable; mais, chose piquante et curieuse, elle employa surtout pour se développer des capitaux et des travailleurs anglais. Les maitres de forges, bénéficiaires de la prime d'enchérissement payée par les consommateurs français, partagèrent donc cette prime avec ceux-là mêmes que le législateur avait voulu frapper. Les témoignages de M. Boigues, propriétaire de mines à Fourchambault, et de M. Wilson, administrateur des mines du Creusot, attestent notamment que les ouvriers anglais se trouvaient en majorité dans les nouvelles exploitations. Nous nous bornerons à citer le témoignage de M. Wilson :
D. Quel nombre et quelle espèce d'ouvriers entretenez-vous pour la fabrication du fer? Quelle était la proportion des ouvriers anglais et des ouvriers français?
R. 126 ouvriers, savoir : 28 pudleurs, 6 chauffeurs, 42 lamineurs et 80 servants. La première année de l'établissement, à l'exception des simples manœuvres, tous ces ouvriers étaient Anglais. La seconde année, nous avons commencé à employer des pudleurs français qui se sont assez bien formés. Dès 1824 nous employions moitié d'ouvriers français pour le pudlage; mais nous n'avons jamais employé à Charenton des ouvriers français pour le laminage. — Les pudleurs anglais gagnaient 14 francs par 1,000 kil, et les pudleurs français 10 francs. — Le lamineur anglais était payé à raison de 10 francs par 1,000 kil. de fer; il en produisait 80,000 kil. par semaine. Il recevait ainsi 800 francs par semaine, sur quoi il avait à payer tous les frais de servants et d'aides; j'estime qu'il lui restait pour son salaire environ 100 francs par semaine.
D. Est-ce que le salaire des ouvriers français s'est élevé au taux des ouvriers anglais, ou le salaire des ouvriers anglais est-il descendu au taux des ouvriers français ?
R. Il y a eu, au contraire, diminution sur le salaire des ouvriers français eux-mêmes; et les uns et les autres ne gagnent plus que 8 francs pour le pudlage de 1,000 kil. de fer. (Enquête sur les fers, p. 70.)
Le même fait s'est reproduit en 1841 et 1842, lorsque le tarif des fils et toiles de lin a été porté à un taux prohibitif. Les nouvelles manufactures « françaises » que la prohibition a fait surgir se sont montées principalement à l'aide d'une large importation de capitaux et d'ouvriers anglais.
[131] Compte rendu du congrès des Économistes réuni à Bruxelles en 1847, p. 135.
[132] Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur. — Appendice, p. 280.
[133] de M. Thiers sur le régime commercial de la France, prononcé à l'assemblée législative, le 27 juin 1851.
[134] Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur. Pièces justificatives, deuxième lettre de M. Jean Dolfus, p. 354.
[135] Lettre communiquée par M. Natalis Rondot à la Société d’Économie politique de Paris. — Journal da Economistes, no. du 15 avril 1852, t. XXXI, p. 192.
[136] « Mes prévisions au sujet du tarif de 1846, écrivait récemment M. R.-J. Walker, ex-ministre des finances des États-Unis, mes prévisions ont été dépassées : le revenu des douanes, qui avait été de 26 millions de dollars cette année-là avec application du tarif de 1842, s'est élevé, pour 1851, avec application des droits réduits, à 50 millions de dollars, et en même temps nos exportations ont doublé. Sur la demande du sénat américain, j'ai repris en 1847 l'examen de la question, et le rapport officiel que je lui ai fait démontre que, d'après les prix courants étrangers, le renchérissement sur les produits importés, par suite de l'application du tarif de 1842, était tel que, outre les droits perçus et versés dans les caisses du gouvernement, il y avait encore une surélévation des prix, équivalant à une autre taxe prélevée sur le consommateur américain, dont la charge totale pouvait être évaluée à 80 millions de dollars : cette somme énorme représentant la dépense de protection résultant d'un tarif trop élevé.
« Et cependant, ajoute M. Walker, notre tarif de 1842 lui-même était bien moins élevé que votre tarif de France, et il ne contenait aucune prohibition. Il est évident pour moi que, si les droits étaient ramenés chez vous à la juste proportion nécessaire au revenu fiscal, les importations seules tripleraient le produit des douanes, en soulageant en même temps le commerce et même l'industrie. »
(Lettre écrite à M. Horace Say, vice-président de la Société d'Économie politique, par M. R.-J. Walker. —Journ. des Écon., t. XXXII, p. 409.)
Mode↩
Source
"Mode", DEP, T. 2, pp. 193-96.
[193]
La mode exerce une influence considérable sur un certain nombre d'industries, notamment sur celles qui s'occupent du vêtement et du logement. Tout changement qui survient dans la [194] mode est une source de bénéfices pour les uns, une cause de pertes pour les autres. Un homme qui trouve un nouveau dessin ou une nouvelle combinaison de couleurs pour étoffes, une nouvelle forme de meuble ou d'habit, et qui réussit à mettre cette invention a la mode, peut en tirer de beaux profits, surtout si la propriété lui en est garantie. (Voyez Propriété artistique.) En revanche les individus qui possèdent un approvisionnement des objets dont la mode ne vent plus éprouvent une perte. Il en est de même des fabricants et des ouvriers qui s'occupaient de la production de ces objets, lorsque la mode nouvelle s'éloigne sensiblement de l'ancienne. « Nous savons tous, dit Malthus, combien les manufactures sont sujettes à tomber par le caprice de la mode. Les ouvriers de Spitalfield ont été réduits à la misère quand les mousselines ont pris la place des étoffes de soie. Ceux de Sheffield et de Birmingham ont été quelque temps sans ouvrage, parce qu'on porta des attaches et des boutons d'étoile, au lieu de boucles et de boutons de métal. » [137] On pourrait citer des milliers de faits analogues.
M. Mac Culloch trouve dans ces perturbations que la mode occasionne un argument en faveur de la taxe des pauvres. « On peut observer, dit-il, que par suite des changements de la mode, etc., les individus engagés dans les travaux industriels sont nécessairement exposés à une foule de vicissitudes ; et leur nombre étant aussi considérable qu'il l'est dans ce pays (l'Angleterre), il est tout a fait indispensable en réalité d'assurer à l'avance une ressource pour les soutenir dans les époques désastreuses. » [138] Nous ne saurions toutefois partagera cet égard l'opinion de M Mac Culloch. En effet comment agit la mode sur certaines industries et sur certaines catégories de travailleurs? Elle agit comme un risque. Or ce risque, qui se traduit en pertes pour les fabricants, en chômages pour les ouvriers, doit nécessairement être couvert, de telle façon que les profits des uns et les salaires des autres se trouvent en équilibre avec les profits et les salaires de l'ensemble des branches de la production. S'il en était autrement, si le risque provenant des fluctuations de la mode n'était point complètement couvert, les capitaux et les bras cesseraient bientôt de se porter dans j les branches assujetties à ce risque particulier ; alors, la concurrence venant à diminuer dans ces branches, les profits et les salaires ne manqueraient pas de s'y augmenter jusqu'à ce que le risque se trouvât compensé. Cela posé, supposons qu'une loi intervienne pour garantir à l'ouvrier un minimum de subsistances pendant les chômages occasionnés par les fluctuations de la mode : qu'en résultera-t-il? Le risque provenant de cette cause se trouvant en partie couvert, compensé, il en résultera que le salaire de l'ouvrier baissera d'une quantité précisément égale à la couverture du risque, c'est-à-dire au montant de la taxe. En quoi donc la taxe aura-t-elle pu être utile à l'ouvrier, puisqu'elle n'aura pas augmenté en réalité la somme de ses ressources? Sans doute l'ouvrier aurait pu gaspiller son salaire et se trouver au dépourvu, la mode venant à changer, le risque venant à échoir. La taxe des pauvres n'est autre chose qu'une caisse d'épargne obligatoire, dont les fonds sont prélevés sur son salaire et où il a le droit de puiser dans ses chômages. Mais une caisse de ce genre, en débarrassant l'ouvrier du soin de prévoir les époques de crise et d'y pourvoir, ne doit-elle pas perpétuer son infériorité intellectuelle et morale? N'est-ce pas une assurance pour laquelle l'ouvrier fournit une prime beaucoup trop élevée? (Voyez Salaires et Taxe des pauvres. )
J.-B. Say envisage l'influence de la mode à un autre point de vue. Selon cet illustre économiste, la fréquence des changements de la mode occasionne un gaspillage ruineux :
« Une nation et des particuliers feront preuve de sagesse, dit-il, s'ils recherchent principalement les objets dont la consommation est lente et l'usage fréquent. Leurs modes ne seront pas très inconstantes. La mode a le privilège d'user les choses avant qu'elles aient perdu leur utilité, souvent même avant qu'elles aient perdu leur fraîcheur : elle multiplie les consommations, et condamne ce qui est encore excellent, commode et joli, à n'être plus bon à rien. Ainsi la rapide succession des modes appauvrit un État de ce qu'elle consomme et de ce qu'elle ne consomme pas. » [139]
Ces paroles de J.-B. Say sont évidemment des plus judicieuses. Cependant il ne faudrait point sur cette observation, ni sur celle de Malthus que nous avons citée plus haut, condamner la mode au point de vue économique ; car si la mode occasionne certains dommages et certaines perturbations , surtout lorsque ses fluctuations sont trop fréquentes, en revanche elle est un des principaux moteurs du progrès artistique et industriel. Ceci peut devenir sensible au moyen d'une simple hypothèse.
Supposons que la mode cesse d'exercer son influence; supposons que le même goût et le même style continuent indéfiniment à faire loi pour les vêtements, les meubles, les habitations : est-ce que cette immobilité de la mode ne portera point une mortelle atteinte au progrès artistique et industriel? Qui donc s'ingéniera encore à chercher du nouveau en fait de vêtements, de meubles, d'habitations , si les consommateurs ont horreur du changement, si toute modification dans la mode adoptée est considérée comme un scandale, ou même interdite par la loi? On fera toujours les mêmes choses, et il y a apparence qu'on les fera toujours aussi de la même manière. Que le goût des consommateurs ait, au contraire, des allures mobiles, variables, et l'esprit d'invention, de perfectionnement, sera énergiquement stimulé. Toute combinaison nouvelle de nature à flatter le goût des consommateurs devenant alors une source de profits pour l'inventeur, chacun s'ingéniera à chercher du nouveau , et cette activité imprimée à l'esprit d'invention agira de la manière la plus favorable sur le développement de l'industrie et des beaux-arts. Il arrivera quelquefois, sans doute, que des modes ridicules se substitueront à des modes élégantes; mais sous l'influence du besoin [195] de changement, de la papillonne, comme dirait un fouriériste, qui donne naissance à la mode, cette invasion du mauvais goût ne sera point durable, et l'on ira sans cesse d'améliorations en améliorations.
En examinant l'influence que la mode exerce sur le développement de l'industrie et des beaux-arts , on acquiert la conviction que l'impulsion vivifiante qu'elle imprime à l'esprit d'invention et de perfectionnement suffit, et au delà, pour compenser les dommages dont elle peut être la source. D'ailleurs les modes ont leurs limites de longévité dont la moyenne pourrait être aisément calculée, et que l'expérience des producteurs, à défaut d'une table de mortalité dressée ad hoc , est habile à apprécier. Il est rare qu'un fabricant intelligent produise d'un dessin ou d'une nuance plus que la consommation n'en peut absorber avant que ce dessin ou cette nuance ait passé de mode; et si, par aventure, ses prévisions se trouvent démenties, si la mode passe plus vite qu'il ne l'avait prévu, il trouve aisément à se défaire de l'excédant de sa marchandise auprès de la vaste classe des consommateurs arriérés. Telle étoffe ou tel chapeau qui est devenu suranné à Paris, fait encore, au bout de deux ou trois ans, les délices des élégantes de la basse Bretagne ou de l'Amérique du Sud.
Nous venons de signaler l'influence que la mode exerce sur la production. Disons maintenant quelques mots de ses caractères et des causes qui déterminent ses variations. La mode ne subit pas seulement l'influence physique de la température d'un pays et l'influence morale du goût et du caractère des populations ; elle est soumise encore, et pour une large part, à l'influence de l'organisation économique et sociale. Les institutions d'un peuple s'y reflètent comme dans un miroir. Ainsi, dans les pays où les abus du privilège et du despotisme permettent à une classe considérée comme supérieure d'alimenter son oisiveté aux dépens du reste de la nation, les modes sont communément fastueuses et compliquées. Elles sont fastueuses, parce que les privilégiés sentent la nécessité d'éblouir la multitude par la splendeur de leurs dehors, et de la convaincre ainsi qu'ils sont tirés d'une argile supérieure :
From porcelain clay of earth,
« de la terre de porcelaine, » comme disait le vieux poète Dryden. Les modes sont en même temps compliquées, parce que les privilégiés ont tout le loisir nécessaire pour s'occuper longuement de leur toilette, dont le faste sert, comme on l'a dit, à inspirer au vulgaire une haute idée de ceux qui la portent. Mais que la situation de la société vienne à changer ; que les privilèges disparaissent; que les classes supérieures, désormais assujetties à la loi de la concurrence, soient obligées de faire œuvre de leur intelligence pour subsister : aussitôt on verra les modes se simplifier; on verra les habits brodés, les culottes courtes, les robes à queues ou à paniers, en un mot tout l'appareil majestueux et compliqué des modes aristocratiques disparaître pour faire place à des vêtements faciles à ajuster et commodes à porter. Dans une spirituelle brochure , intitulée England, Ireland and America by a Manchester manufacturer, [140] M. Richard Cobden a signalé, avec beaucoup d'humour et de finesse, les nécessités qui ont agi depuis un demi-siècle pour déterminer cette transformation économique de la mode. M. Cobden dépeint l'ancien marchand de Londres avec son costume majestueux et ses habitudes formalistes, et il montre comment l'impitoyable concurrence a fait disparaître ce modèle du bon vieux temps pour le remplacer par un type moderne, revêtu d'un costume et pourvu d'habitudes infiniment plus économiques :
« Ceux de nos lecteurs qui ont connu le marchand de Londres d'il y a trente ans, doivent se rappeler la perruque poudrée et la queue, les souliers à boucles, les bas de soie bien tirés et les culottes étroites, qui faisaient reconnaître le boutiquier de l'ancienne école. Si pressées et si importantes que fussent les affaires qui l'appelaient au dehors, jamais ce superbe personnage ne rompait le pas digne et mesuré de ses ancêtres ; rien ne lui était plus agréable que de prendre sa canne à pomme d'or et de quitter sa boutique pour aller visiter ses voisins plus pauvres, et faire parade de son autorité en s'informant de leurs affaires, en s'immisçant dans leurs querelles, en les forçant de vivre honnêtement et de diriger leurs entreprises d'après son système. Il conduisait son propre commerce exactement à la manière de ses pères. Ses commis, ses garçons de magasin, ses commissionnaires avaient des uniformes particuliers, et leurs rapports avec leurs chefs ou entre eux étaient réglés d'après les lois de l'étiquette établie. Chacun d'eux avait son département spécial ; au comptoir ils gardaient leur rang avec une exactitude pointilleuse, comme des États voisins mais rivaux. La boutique de ce marchand de la vieille école conservait toutes les dispositions et tous les inconvénients des boutiques des siècles précédents ; on ne voyait point à sa devanture un étalage fastueux destiné à amorcer les passants, et le vitrage, enchâssé dans de lourdes travées de bois, était bâti d'après les anciens modèles.
« Le siècle actuel a produit une nouvelle école de marchands, dont la première innovation a été de renoncer à la perruque poudrée et de congédier le barbier avec sa boite à pommade. Grâce à ce progrès, une heure a été gagnée sur la toilette de chaque jour. La seconde a consisté à remplacer les souliers et les inexpressibles, dont les complications de boucles et de cordons et les formes étroites exigeaient une autre demi-heure, par des bottes à la Wellington et des pantalons que l'on met en un tour de main, et qui laissent au corps toute la liberté de ses allures, quoique peut-être aux dépens de la dignité extérieure. Ainsi vêtus, ces actifs marchands peuvent presser ou ralentir le pas selon que les affaires qui les appellent au dehors sont plus ou moins urgentes ; ils sont d'ailleurs si absorbés par le soin de leurs propres affaires, qu'ils savent a peine les noms de leurs plus proches voisins, et qu'ils ne s'inquiètent pas si ces gens-là vivent en paix ou non, aussi longtemps qu'on ne vient pas briser leurs vitres.
« L'esprit d'innovation ne s'est pas arrêté là : [196] les boutiques de cette nouvelle race de marchands ont subi une métamorphose aussi complète que leurs propriétaires. L'économie intérieure de la maison a été réformée en vue de donner au travail toutes les facilités imaginables : on a dispensé les employés de toutes formalités d'étiquette; on a même tacitement consenti à suspendre les égards dus au rang, en tant qu'ils pouvaient arrêter l'expédition des affaires; enfin , à l'extérieur, des vitrines construites en verre plat, avec des bordures élégantes, et s'étendant du sol jusqu'au plafond, ont attiré les regards sur toutes les séduisantes nouveautés du jour.
« Nous savons tous quels ont été les résultats de cette rivalité inégale. Les anciens et paisibles boutiquiers, fidèles à la « vieille mode » de leurs pères, succombèrent l'un après l'autre sous l'active concurrence de leurs voisins plus alertes. Quelques- uns des disciples les moins infatués de la vieille école adoptèrent le nouveau système ; mais tous ceux qui essayèrent de résister au torrent furent engloutis. Nous ajouterons que le dernier de ces intéressants spécimens du bon vieux temps, qui avait survécu à onze générations de boutiquiers, et dont les vitrages non modernisés réjouissaient l’âme des vieux tories passant dans Fleet street, a fini par disparaître après avoir vu son nom figurer dans la gazette à l'article Banqueroutes. «
A travers cet ingénieux et spirituel croquis, on voit apparaître clairement la nécessité qui a déterminé la simplification des modes de l'ancien régime. Cette nécessité, elle réside dans la suppression des antiques privilèges qui permettaient au marchand incorporé ou à l'industriel pourvu d'une maîtrise de passer son temps à sa toilette, ou à intervenir dans les querelles de ses voisins au lieu de s'occuper de ses affaires; elle réside dans le développement fécond de la concurrence, qui a obligé tout marchand, tout industriel, tout chef d'entreprise, à calculer le prix du temps, sous peine de voir son nom finalement inscrit sous la funeste rubrique des banqueroutes. Un régime de concurrence ne comporte pas les mêmes modes qu'un régime de privilége, et la mode subit l'influence des modifications de l'économie intérieure de la société aussi sensiblement que celle des changements de la température.
Cela étant, on aperçoit combien un gouvernement aurait tort de vouloir influer sur la mode, en obligeant, par exemple, ceux qui le servent à porter des vêtements fastueux et compliqués. En effet, de deux choses l'une. Ou l'état de la société est tel que les classes dirigeantes trouvent avantage à étaler un certain faste dans leur costume ; et dans ce cas il est inutile de le leur imposer, ou même de le leur recommander. Ou l'état de la société est tel qu'on a mieux à faire dans tous les rangs de la société qu'à s'occuper longuement de sa toilette; dans ce cas, quel bien pourra résulter de l'intervention du gouvernement dans la mode? Si la somptuosité des costumes devient générale, si les hommes s'accoutument à accorder à leur habillement une portion du temps qui est réclamé par leurs affaires, la société n'en souffrira-t-elle pas un dommage? Si, au contraire, l'exemple donné d'en haut n'est pas suivi, si le faste des costumes de cour ou d'antichambre n'est pas imité, ce faste ne formera-t- il pas une dissonance choquante dans une société affairée? Ne produira-t-il point une impression analogue à celle que l'on reçoit d'une mascarade? Un gouvernement doit donc éviter soigneusement d'intervenir en cette matière, fût-ce même pour encourager la passementerie et la broderie nationales. Il doit suivre les modes, et non les diriger.
En résumé la mode, envisagée au point de vue économique, exerce sur les progrès de la production une influence dont l'utilité compense, et au delà, le dommage qui peut résulter de ses fluctuations. D'un autre côté elle s'établit et se modifie naturellement sous l'impulsion de causes diverses, parmi lesquelles les causes économiques tiennent une grande place. Quand on méconnaît les nécessités qui déterminent ses transformations , on établit des modes artificielles qui ont le double inconvénient d'être antiéconomiques et ridicules.
Endnotes to Mode
[137] Essai sur le principe de la population, livre III, chapitre xiii, page 445, édition Guillaumin.
[138] Principes d'Economie politique. Traduction de M. Augustin Planche, tome II, page 82.
[139] Traité d'Economie politique, livre III, chap. iv.
[140] Brochure in-8. Londres, 1835.
Monuments publics↩
Source
"Monuments publics", DEP, T. 2, pp. 237-8.
[237]
On est généralement porté à vanter les gouvernements qui emploient une large part des revenus publics à élever des constructions monumentales. Ces gouvernements font l'admiration des artistes et les délices des architectes; ils fournissent, enfin, un thème inépuisable à l'enthousiasme des poètes lyriques. Méritent-ils au même degré l'approbation des économistes? C'est ce que nous allons examiner.
Tout gouvernement est chargé de remplir un certain nombre de fonctions nécessaires à la société. Pour s'acquitter convenablement de ces services publics, selon l'expression consacrée, il est obligé d'avoir à sa disposition une quantité plus ou moins considérable de capital fixe et de capital circulant. Il lui faut des bâtiments et un matériel pour la défense et l'administration du pays, pour l'éducation, les travaux publics, etc., etc.; c'est le capital fixe. Il lui faut des approvisionnements et du numéraire pour mettre en œuvre et réparer son capital fixe, entretenir et solder ses employés; c'est le capital circulant. Dans le capital fixe figurent des bâtiments ou des édifices de diverses sortes, des palais de justice, des prisons, des casernes, des bureaux d'administration, des écoles, des musées , des hôpitaux, etc. Lorsque ces bâtiments ont des proportions un peu vastes, ou simplement lorsqu'ils sont construits avec art, on les désigne sous le nom de monuments publics.
Maintenant quelle est la règle économique à observer au sujet de la construction et de la multiplication des édifices de ce genre? C'est qu'ils soient proportionnés, quant à leur nombre et quant à la richesse de leur construction, à l'objet qu'il s'agit de remplir ainsi qu'aux ressources dont la nation dispose. Si les édifices publics ne sont pas assez nombreux, s'ils ne sont pas convenablement aménagés, les services publics en souffriront; si, en même temps, ils sont pauvres d'apparence et mesquins de style, en comparaison des bâtiments qui servent à l'industrie privée, la considération du gouvernement pourra être affectée par cet état de choses. Il sera utile alors d'augmenter la portion de capital fixe afférente aux services publics. Mais l'augmentation pourra-t-elle être indéfinie? Un gouvernement fournira-t-il une preuve bien évidente de sagesse et de bonne administration en multipliant indéfiniment le nombre des édifices publics et en n'épargnant rien pour leur donner une apparence fastueuse? N'en déplaise aux architectes et aux poètes lyriques, nous ne le pensons pas. En effet, si les édifices publics sont plus nombreux ou plus vastes que ne le comportent les exigences réelles des services, le surplus sera inutile. Ce sera une portion de capital qui demeurera frappée de stérilité et dont l'entretien coûtera, en outre, plus ou moins cher. D'un autre côté, si les édifices du gouvernement dépassent en somptuosité ceux de l'industrie privée, si le gouvernement ne proportionne point les frais de ses constructions à l'état de la fortune publique, s'il élève des palais de marbre dans des pays où la masse de la population trafique dans des échoppes et vit dans des cabanes, ne pourra-t-on pas accuser à bon droit sa prodigalité? Le contraste qui se manifestera entre la splendeur de ses monuments et le misérable aspect des constructions particulières ne sera-t-il pas un témoignage accablant de sa mauvaise administration? L'architecte et le poète lyrique pourront s'extasier devant des édifices où les ressources précieuses d'une nation pauvre auront été englouties pour satisfaire la fastueuse vanité du maître ; mais l'économiste s'en détournera avec dégoût.
Il y a donc une proportion utile qui doit être observée entre le nombre et la splendeur des édifices publics d'une part, l'objet qu'il s'agit de remplir et les ressources de la nation de l'autre. Malheureusement il est rare que cette proportion utile soit suivie. Les gouvernements ont, pour la plupart, une fâcheuse tendance à multiplier les constructions monumentales au delà du nécessaire. Cette tendance a sa source dans des tentations auxquelles il leur est quelquefois d'autant plus difficile de résister qu'elles sont encouragées par des préjugés ou des sophismes populaires. Ainsi, par exemple, le gouvernement d'une nation riche élève des édifices somptueux. Ses voisins, moins favorisés de la fortune, sont naturellement tentés de l'imiter : ils se persuadent volontiers que « la gloire nationale » exige qu'ils ne se laissent point devancer dans cette voie, et ils se ruinent en bâtisses. D'un autre côté, la tentation de laisser « des traces durables » de leur passage ne manque jamais d'agir vivement sur l'esprit des gouvernements. Ils sont généralement imbus de la conviction que leur renommée future se proportionnera au nombre et au volume des amas de pierres ou de briques qu'ils auront légués à la postérité. Et cette conviction s'enracine d'autant plus aisément dans leur esprit que les frais de construction des édifices destinés à immortaliser leur mémoire retombent moins directement sur eux. Mais avons-nous besoin de dire que ce procédé d'immortalité n'est pas toujours infaillible? [238] Avons-nous besoin de dire que des amas de pierres on de briques ne suffisent pas toujours pour perpétuer le nom d'un monarque? Les noms des souverains qui ont présidé à la construction des pyramides d'Egypte sont à peine connus de nos jours, tandis que des législateurs et des philosophes, qui n'ont laissé de leur passage que des traces purement morales, ont acquis une renommée immortelle. C'est donc un calcul faux et misérable que celui qui consiste à épuiser un peuple pour léguer à la postérité des monuments somptueux et inutiles. Ces monuments n'accusent que l'ignorance et la barbarie de leurs fondateurs, bien loin de les signaler à l'admiration et à la réconnaissance du genre humain.
Au premier rang des sophismes qui ont été employés pour justifier cet emploi fastueux et improductif des deniers publics, nous signalerons la « nécessité de donner du travail aux ouvriers. » Ce sophisme vulgaire a été admirablement réfuté par F. Bastiat dans son petit pamphlet intitulé : Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
« Qu'une nation, dit le spirituel auteur des Sophismes économiques, après s'être assurée qu'une grande entreprise doit profiter à la communauté, la fasse exécuter sur le produit d'une cotisation commune, rien de plus naturel. Mais la patience m'échappe, je l'avoue, quand j'entends alléguer à l'appui d'une telle résolution cette bévue économique : « C'est d'ailleurs le moyen de créer du travail pour les ouvriers. »
« L'État ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, perce un canal; par là, il donne du travail à certains ouvriers, c'est ce qu'on voit; mais il prive de travail certains autres ouvriers, c'est ce qu'on ne voit pas,
« Voilà la route en cours d'exécution ; mille ouvriers arrivent tous les matins, se retirent tous les soirs, emportent leur salaire, cela est certain. Si la route n'eût pas été décrétée, si les fonds n'eussent pas été votés, ces braves gens n'eussent rencontré là ni ce travail ni ce salaire, cela est certain encore.
« Mais est-ce tout? L'opération, dans son ensemble, n'embrasse-t-elle pas autre chose? Au moment où M. Dupin [141] prononce les paroles sacramentelles : « L'assemblée a adopté, » les millions descendent-ils miraculeusement sur un rayon de la lune dans les coffres de MM. Fould et Bineau? Pour que l'évolution, comme on dit, soit complète, ne faut-il pas que l'État organise la recette aussi bien que la dépense? qu'il mette ses percepteurs en campagne et ses contribuables à contribution?
« Étudiez donc la question dans ses deux éléments. Tout en constatant la destination que l'État donne aux millions votés, ne négligez pas de constater aussi la destination que les contribuables auraient donnée — et ne pensent plus donner — à ces mêmes millions. Alors vous comprendrez qu'une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur l'un figure un ouvrier occupé, avec cette devise : Ce qu'on voit; sur l'autre un ouvrier inoccupé, avec cette devise : Ce qu'on ne voit pas. » [142]
Autre sophisme. On affirme que les gouvernements sont tenus d'élever force monuments pour encourager les beaux-arts et perfectionner le goût public. Nous nous sommes appliqué déjà à réfuter ce sophisme (voyez Beaux-arts). [143] Nous n'en dirons plus que quelques mots. Si un gouvernement consacre à la construction des édifices publics des sommes hors de proportion avec l'objet qu'il s'agit de remplir, hors de proportion aussi avec les ressources de la nation, qu'en résultera-t-il? C'est que le développement de la fortune publique sera retardé d'autant ; c'est que les membres de la nation ne pourront croître, en nombre et en richesse, aussi rapidement qu'ils auraient pu le faire, si le gouvernement s'était montré plus économe de leurs deniers. Mais chacun sait que les beaux-arts sont un luxe qu'une nation ne peut se permettre qu'après que sa richesse a acquis un certain développement. Enfouir dans des monuments inutiles une portion du capital productif d'un peuple, c'est donc, en réalité, retarder le développement ultérieur des beaux-arts au lieu de l'accélérer.
En définitive, les édifices et les monuments publics doivent répondre, par leur nombre et leur étendue, aux besoins des services dont le gouvernement est chargé, et les frais de leur construction se proportionner à l'état de la fortune publique. C'est dire assez que les gouvernements sont tenus de se laisser guider, en cette matière, bien plutôt par les conseils des économistes que par les plans et devis des architectes ou par les dithyrambes des poètes lyriques.
G. de Molinari.
Endnotes to Monuments
[141] Le pamphlet que nous citons a été écrit en 1850.
[142] Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, page 27.
[143] Voir aussi, au sujet de l’influence que l’intervention du gouvernement exerce sur la construction des édifices publics et autres, un excellent chapitre des Études sur l’administration de la ville de Pars, par M. Horace Say; des travaux d’architecture et des architectes chapitre XIII, page 291.
Nations↩
Source
"Nations", DEP, T. 2, pp. 259-62.
[259]
Dès les premiers âges historiques, l'humanité apparaît fractionnée en une multitude de nations dissemblables par les mœurs, par les aptitudes, par le langage, et soumises à des institutions différentes. Chacune de ces nations a sa physionomie particulière et son existence propre, son autonomie.
Ce phénomène, qui intéresse à un haut degré toutes les branches des sciences morales et politiques, doit être envisagé ici seulement au point de vue économique.
L'économiste doit se demander d'abord si le fractionnement de l'humanité en une multitude de nations est utile, ou s'il ne vaudrait pas mieux, comme quelques-uns l'affirment, que l’espèce humaine ne formât qu'une seule communauté, une monarchie ou une république universelle. A cette question, la réponse ne saurait être douteuse. Le morcellement de l'humanité en nations a son utilité, en ce qu'il développe un principe d'émulation d'une puissance considérable. Il y a, dans chaque nation, un point d'honneur ou, si l'on veut, une sorte d'amour-propre collectif qui, dirigé vers des objets utiles, peut enfanter des merveilles. On en a eu un exemple à l'Exposition universelle de Londres, où la plupart des nations civilisées ont apporté le tribut de leur industrie et où chacune a tenu à honneur de ne point demeurer trop au-dessous de ses rivales. Si l'humanité ne constituait qu'une seule agrégation politique, l'esprit d'émulation, dépourvu du stimulant du point d'honneur national, ne se manifesterait-il pas à un degré moindre? Un autre inconvénient plus sérieux encore résulterait de l'unification de l'humanité; c'est que les fautes commises dans le gouvernement de la société auraient bien plus de portée qu'elles n'en ont dans l'état actuel des choses. Qu'une mauvaise mesure soit prise aujourd'hui par un gouvernement, qu'une fausse théorie soit appliquée à la gestion des affaires d'une nation , et le mal qui en résulte demeure jusqu'à un certain point local. Les autres nations peuvent s'abstenir de renouveler une expérience dont les résultats ont été désastreux. Que l'humanité tout entière vienne, au contraire, à être soumise à une loi uniforme, et le mal résultant de l'application d'une fausse mesure ne sera-t-il pas universel? Quant au progrès qui améliorent la [260] condition de l'homme, chacun sait que le fractionnement des sociétés n'est aucunement un obstacle à leur diffusion. Lorsqu'une expérience a réussi chez un peuple, tous les autres peuples ne sont-ils pas intéressés à se l'approprier? Le plus souvent même n'y sont-ils pas obligés par la pression de la concurrence?
Le fractionnement de l'humanité en nations autonomes peut donc être considéré comme essentiellement économique. D'ailleurs ce fractionnement résulte de l'arrangement primitif des choses; c'est un phénomène naturel qu'aucune combinaison artificielle ne saurait détruire ni même sensiblement modifier. Des conquérants , par exemple, ont rêvé l'utopie de la monarchie universelle. Ont-ils réussi à la réaliser? Ceux qui en ont le plus approché n'ont-ils pas vu leurs gigantesques établissements politiques se dissoudre par la force même des choses? L'expérience ne leur a-t-elle pas appris qu'il y a des limites qu'aucune domination ne peut dépasser d'une manière durable? D'autres utopistes ont rêvé l'unité de religion, et quelques-uns ont voulu l'imposer par la violence ; mais ils ont eu beau employer le fer et le feu pour venir à bout de leur dessein , ils ont échoué. Les religions ont continué de refléter la diversité des tempéraments, des mœurs et des lumières des peuples. D'autres enfin ont rêvé l'unité de langage, et l'on a vu des gouvernements s'efforcer d'imposer à des peuples d'origine différente, qu'ils avaient réunis sous leur domination , une langue uniforme. A une époque encore récente, le gouvernement hollandais, par exemple, a entrepris de substituer la langue hollandaise à la langue française dans quelques-unes des provinces méridionales de l'ancien royaume des Pays-Bas. Qu'en est-il résulté? Tout simplement que la langue légale a été prise en aversion par les populations auxquelles on voulait l'imposer, et que cette expérience, contraire à la nature des choses, a contribué pour beaucoup à la chute du gouvernement qui l'avait tentée. C'est que les langues, comme les religions, comme les institutions politiques, sont l'expression du génie particulier des différents peuples, et qu'elles répondent à des besoins ou à des convenances qu'on essaierait en vain de satisfaire autrement. On peut, sans aucun doute, modifier d'une manière artificielle la forme des institutions et du langage, mais le fond subsiste quand même : si les mots changent, l'accent reste.
Cependant, de ce qu'il serait absurde de vouloir effacer, en vue d'une unité chimérique, les signes caractériques des nationalités, il ne s'ensuit pas qu'il faille isoler les nations et les maintenir les unes vis-à-vis des autres dans un état permanent d'hostilité. Non! l'autonomie des nations n'implique ni l'isolement ni l'hostilité. Les nations sont intéressées à communiquer librement entre elles pour croître en richesse et en puissance, elles le sont plus encore à vivre en paix les unes avec les autres.
Ces vérités, trop longtemps méconnues, ont été admirablement mises en lumière par les économistes, notamment par J.-B. Say. A ceux qui prétendent, par exemple, qu’une nation ne; peut s'enrichir que par l'appauvrissement de ses rivales, l'illustre auteur de la théorie des débouchés répond avec raison :
« Une nation, par rapport à la nation voisine, est dans le même cas qu'une province par rapport à une autre province, qu'une ville par rapport aux campagnes : elle est intéressée à les voir prospérer, et assurée de profiter de leur opulence. C'est donc avec raison que les États-Unis, par exemple, ont toujours cherché à donner de l'industrie aux tribus sauvages dont ils sont entourés : ils ont voulu qu'elles eussent quelque chose à donner en échange, car on ne gagne rien avec des peuples qui n'ont rien à vous donner. Il est précieux pour l'humanité qu'une nation , entre les autres, se conduise, en chaque circonstance, d'après des principes libéraux. Il sera démontré, par les brillants résultats qu'elle en obtiendra, que les vains systèmes, les funestes théories, sont les maximes exclusives et jalouses des vieux États de l'Europe, qu'ils décorent effrontément du nom de vérités pratiques, parce qu'ils les mettent malheureusement en pratique . » [144]
Rien de plus trompeur, ajoute ce judicieux économiste, que l'avantage qu'une nation croit retirer d'un empiétement sur le domaine d'autrui, de la conquête d'une province ou d'une colonie sur une puissance rivale.
« Si la France avait joui, dit-il, à quelque époque que ce fût, d'un gouvernement économique, et qu'elle eût employé à fertiliser des provinces au centre du royaume l'argent qu'elle a dépensé à conquérir des provinces éloignées et des colonies qu'on ne pouvait conserver, elle serait bien plus heureuse et plus puissante. Les routes, les chemins vicinaux, les canaux d'irrigation et de navigation, sont des moyens qu'un gouvernement a toujours à sa disposition pour fertiliser des provinces qui ne produisent pas. La production est toujours chère dans une province lorsque beaucoup de frais sont nécessaires pour en transporter les produits. Une conquête intérieure augmente indubitablement la force d'un État, tandis qu'une conquête éloignée l'affaiblit presque toujours. Tout ce qui fait la force de la Grande-Bretagne est dans la Grande-Bretagne ; elle a été plus forte en perdant l'Amérique ; elle le sera davantage quand elle aura perdu les Grandes-Indes . » [145]
Aussi J.-B. Say est-il bien convaincu que, lorsque les lumières économiques seront plus répandues, lorsque les véritables sources de la prospérité et de la grandeur des nations seront mieux connues, la vieille politique qui consiste à conquérir de nouveaux territoires pour en taxer à outrance les populations, à s'emparer de nouveaux marchés pour les soumettre à une exploitation égoïste et impitoyable, cette mauvaise politique d'antagonisme et de haine finira par perdre tout crédit ;
« Toute cette vieille politique tombera, dit-il. L'habileté sera de mériter la préférence et non de la réclamer de force. Les efforts qu'on fait pour s'assurer la domination ne procurent jamais qu'une grandeur factice, qui fait nécessairement de tout étranger un ennemi. Ce système produit des dettes, des abus, des tyrans et des révolutions ; tandis que l'attrait d'une convenance réciproque procure [261] des amis, étend le cercle des relations utiles; et la prospérité qui en résulte est durable parce qu'elle est naturelle. » [146]
Si donc les économistes ne partagent point les illusions des socialistes humanitaires qui voudraient réunir toutes les nations en un seul troupeau gouverné par un berger omniarcal ; s'ils ne pensent point qu'il y ait utilité à effacer, d'une manière artificielle, les différences caractéristiques des nationalités; s'ils n'acceptent qu'en faisant leurs réserves ces beaux vers de l'auteur de la Marseillaise de la paix :
Nations ! mot pompeux pour dire barbarie ! …
Déchirez ces drapeaux ! une autre voix vous crie :
L'égoïsme et la haine oui seuls une patrie ;
La fraternité n’en a pas;
s'ils pensent que les nations ont leur raison d'être même au sein de la civilisation, ils ne travaillent pas moins activement à démolir les murs de séparation que de vieilles erreurs, des préjugés séculaires, des haines barbares ont élevés entre les peuples ; ils démontrent aux nations qu'elles ont intérêt à échanger leurs idées et leurs produits afin d'augmenter leur richesse, leur puissance, leur civilisation ; ils condamnent la guerre comme une mauvaise spéculation, comme une opération dans laquelle les risques de perte dépassent toujours les chances de gain, et sans être humanitaires ou unitéistes, ils enseignent aux peuples les vrais moyens de réaliser la fraternité pratique. ( Voyez Paix. )
Des erreurs non moins funestes, au sujet du gouvernement intérieur des nations, ont encore appelé l'attention des économistes. De même qu'on était convaincu autrefois qu'une nation ne pouvait se fortifier et s'enrichir que par l'affaiblissement et l'appauvrissement de ses rivales, on attribuait au gouvernement une part d'influence et d'action singulièrement exagérée dans la vie des peuples. Parce que le gouvernement et la société demeuraient confondus au sein des communautés primitives, lorsque la division du travail n'avait pas encore séparé les fonctions sociales, on croyait qu'il en devait toujours être ainsi ; on croyait qu'il appartenait au gouvernement d'imprimer le mouvement, l'activité à l'organisme social et d'y faire circuler la vie; on croyait que rien ne pouvait se faire si ce n'est par l'impulsion de ce moteur souverain. L'économie politique a fait bonne justice d'une erreur si désastreuse. Les économistes ont démontré que les fonctions du gouvernement devaient se simplifier et se spécialiser de plus en plus, en vertu du principe de la division du travail, bien loin de s'étendre et de se multiplier; ils ont démontré que le communisme appartenait à l'enfance des sociétés et qu'il cessait de convenir à leur maturité. Avec le sang-froid d'un chirurgien expert qui extirpe des chairs cancéreuses, J.-B. Say a fait voir à quel point un gouvernement, qui ne se borne pas strictement à remplir ses fonctions naturelles, peut jeter le trouble, la corruption et le malaise dans toute l'économie du corps social, et il a déclaré qu'à ses yeux un gouvernement de cette espèce était un véritable ulcère.
Cette expression pittoresque de gouvernement-ulcère, employée par l'illustre économiste pour désigner tout gouvernement qui intervient mal à propos dans le domaine de l'activité privée, les écrivains réglementaires et socialistes l'ont fréquemment reprochée à l'économie politique. Quelques-uns même en ont pris texte pour prétendre que l'économie politique méconnaissait l'importance de la mission dont les gouvernements sont chargés dans la société, et ils l'ont accusée d'avoir enfanté la trop célèbre doctrine de l’an-archie. Rien de moins mérité cependant qu'un tel reproche. L'économie politique sainement entendue ne conduit pas plus à la suppression des gouvernements qu'elle n'aboutit à la destruction des nationalités, et J.-B. Say lui-même a été au devant de ce grief en donnant un aperçu des services qu'un gouvernement sage peut rendre à une nation :
« Lorsque l'autorité n'est pas spoliatrice elle-même, elle procure aux nations le plus grand des bienfaits, celui de les garantir des spoliateurs. Sans cette protection qui prête le secours de tous aux besoins d'un seul, il est impossible de concevoir aucun développement important des facultés productrices de l'homme, des terres et des capitaux; il est impossible de concevoir l'existence des capitaux eux-mêmes, puisqu'ils ne sont que des valeurs accumulées et travaillant sous la sauvegarde de l'autorité publique. C'est pour cette raison que jamais aucune nation n'est parvenue à quelque degré d'opulence sans avoir été soumise à un gouvernement régulier ; c'est à la sûreté que procure l'organisation politique que les peuples policés doivent non-seulement les productions innombrables et variées qui satisfont à leurs besoins, mais encore les beaux-arts, les loisirs, fruits de quelques accumulations, et sans lesquels ils ne pourraient pas cultiver les dons de l'esprit, ni par conséquent s'élever à toute la dignité que comporte la nature de l'homme. [147]
L'économie politique n'est donc pas an-archiste. Les économistes sont parfaitement convaincus que les gouvernements remplissent au sein de la société un rôle nécessaire, et c'est même parce qu'ils apprécient toute l'importance de ce rôle qu'ils sont d'avis que les gouvernements ne doivent pas s'occuper d'autre chose. Enfin , les économistes pensent que les mêmes pratiques de scrupuleuse économie dont l'application est de règle dans l'industrie privée doivent être appliquées aussi au gouvernement des nations.
Écoutons encore à ce sujet J.-B. Say :
« Un peuple qui ne sait respecter son prince que lorsqu'il est entouré de faste, de dorures, de gardes, de chevaux, de tout ce qu'il y a de plus dispendieux, paye en conséquence. Il économise, au contraire, quand il accorde son respect à la simplicité plutôt qu'à l'étalage, et quand il obéit aux lois sans appareil.
«… Les causes purement politiques, et la forme du gouvernement qui en dérive, influent sur les frais de traitements des fonctionnaires civils et judiciaires, sur ceux de représentation, et enfin [262] sur ceux qu'exigent les institutions et les établissements publics. Ainsi, dans un pays despotique, où le prince dispose des biens de ses sujets, lui seul réglant son traitement, c'est-à-dire ce qu'il consomme de deniers publics pour son utilité personnelle , ses plaisirs, l'entretien de sa maison, ce traitement peut être fixé plus haut que dans le pays où il est débattu entre les représentants du prince et ceux des contribuables.
« Le traitement des subalternes dépend également, soit de leur influence particulière, soit du système général du gouvernement. Les services qu'ils rendent sont coûteux ou à bon marché, non-seulement en proportion du prix qu'on les paye, mais encore selon que les fonctions sont moins bien ou mieux remplies. Un service mal rendu est cher, quoique fort peu payé ; il est cher s'il est peu nécessaire. Il en est de cela comme d'un meuble, qui ne remplit pas bien l'office auquel il est destiné, ou dont on n'avait pas besoin, et qui embarrasse plutôt qu'il ne sert. Telles étaient, sous l'ancienne monarchie, les charges de grand-amiral, de grand-maître, de grand-échanson, de grand-veneur et une foule d'autres, qui ne servaient pas même à relever l'éclat de la couronne, et dont plusieurs n'étaient que des moyens employés pour répandre des gratifications et des faveurs.
« Par la même raison, lorsque l'on complique les ressorts de l'administration, on fait payer au peuple des services qui ne sont pas indispensables pour le maintien de l'ordre public : c'est une façon inutile donnée à un produit qui n'en vaut pas mieux pour cela, et qui communément en vaut moins. Sous un mauvais gouvernement qui ne peut soutenir ses empiétements, ses injustices, ses exactions, qu'au moyen de nombreux satellites, d'un espionnage actif et de prisons multipliées ; ces prisons , ces espions, ces soldats coûtent au peuple, qui certes n'est pas plus heureux. [148]
En résumé, l'économie politique reconnaît que le fractionnement de l'humanité en nations a son utilité, sa raison d'être; elle reconnaît qu'aucune nation, à moins de la supposer composée d'anges, ne saurait se passer de gouvernement; mais, en même temps, elle démontre que les nations ont intérêt à baser leur politique extérieure sur la paix et leur politique intérieure sur l'économie ; elle démontre que les nations ont intérêt à entretenir les unes avec les autres des relations libres et amicales, comme à se laisser gouverner aussi peu que possible.
Endnotes to Nations
[144] Traité d'Économie politique, liv. I, chap. xv.
[145] [Idem, liv. II, cap. IX.
[146] Traité d'Économie politique, liv. 1, chap. ix.
[147] Traité d’Économie politique, liv. I, chap. XIV.
[148] Traité d’Économie politique, liv. III, chap. VII.
Noblesse↩
Source
"Noblesse", DEP, T2, pp. 275-81.
[275]
NOBLESSE On a désigné de tout temps sous ce nom, ou sous des dénominations équivalentes, la corporation qui s'est attribué d'une manière exclusive les fonctions supérieures de la société. Le plus souvent, cette corporation a établi sa domination par la conquête . C'est ainsi notamment que la noblesse de la plupart des États de l'Europe doit son origine aux hordes barbares qui envahirent l'empire romain et s'en partagèrent les débris. D'abord ces troupes d'émigrants que l'insuffisance de la subsistance et l'appât du butin poussaient des régions du Nord sur celles du Midi, parcoururent le monde civilisé en le ravageant; mais bientôt, soit que le capital mobilier qui leur servait de proie commençât à s'épuiser, soit que les plus intelligents comprissent qu' une exploitation régulière leur serait plus profitable qu'un simple pillage , on les vit s'établir à demeure fixe sur les débris du monde qu'ils avaient ravagé et conquis.
Cet établissement des barbares dans l'antique domaine de la civilisation et la constitution d'une noblesse féodale, qui en a été la conséquence, ont eu une utilité qu'il serait injuste de méconnaître. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'empire romain, intérieurement miné et corrompu par le cancer de l’esclavage avait fini par tomber en ruines, et que les richesses accumulées par la civilisation gréco-romaine se trouvaient à la merci des barbares. Dans une situation si critique, ce fut un bienfait que l'établissement des Goths, des Vandales, des Lombards et des autres émigrants du Nord sur les territoires où ils avaient porté leurs ravages. Devenus propriétaires de la plus grande partie du capital que les nations vaincues avaient accumulé sur le sol, ces barbares furent désormais intéressés à le défendre contre les hordes qui se pressaient derrière eux. C'est ainsi que les vieux ennemis de la civilisation en devinrent les défenseurs, et que les richesses accumulées par l'antiquité, en passant des mains débiles des anciens propriétaires dans celles des conquérants du Nord, plus nombreux , plus courageux et plus forts , furent préservées d'un anéantissement total. Le flot destructeur de l'invasion s'arrêta devant ce nouveau rempart qui s'était élevé à la place du rempart démantelé de la domination romaine. Accourus du fond de la Tartarie pour avoir leur part dans les dépouilles du monde ancien, les Huns, par exemple , furent détruits ou repoussés par la coalition des Goths et des Francs, établis en Italie et dans les Gaules, et plus tard les Sarrasins, non moins redoutables que les Huns, éprouvèrent le même sort.
Si les Goths et les Francs ne s'étaient pas approprié le capital immobilier des nations qu'ils avaient subjuguées, auraient-ils risqué leur vie et leur butin pour repousser les farouches soldats d'Attila? Et que serait-il resté de la civilisation antique, si ce chef barbare d'une race nomade avait continué de parcourir l'Europe en la ravageant? La Grèce, l'Italie, la Gaule et l'Espagne, dépouillées de leurs richesses mobilières et privées de la plus grande partie de leur population, n'auraient-elles point fini par présenter le même spectacle de désolation et de ruine que l'empire des Assyriens et le royaume de Palmyre? Quand donc on se rend bien compte des circonstances qui ont accompagné l'établissement des barbares au sein de la civilisation européenne, on s'aperçoit que cette substitution violente d'une nouvelle race de propriétaires à l'ancienne race offre plutôt les caractères d'une expropriation pour cause d'utilité publique que ceux d'une spoliation proprement dite . D'où cette conséquence extrêmement importante, que les propriétés nobiliaires, dont l'origine remonte à la conquête, ne méritent point l'anathème spécial dont les ont frappées certains socialistes; car leurs titres originaires se fondent sur l'utilité générale, c'est-à-dire sur la justice .
Les conditions de l'établissement des barbares au sein du monde civilisé furent extrêmement diverses. Les historiens ont constaté toutefois qu'ils s'attribuèrent généralement les deux tiers des terres; telle fut, par exemple, la proportion observée dans les Gaules, lorsqu'elles eurent été conquises par les Francs. Cette proportion n'avait, du reste, rien d'arbitraire : elle était déterminée par des nécessités de situation. Au sein de chaque nation subjuguée, on rencontrait une aristocratie de propriétaires , datant le plus souvent d'une conquête antérieure, envers laquelle les vainqueurs étaient intéressés à garder certains ménagements, pour ne la point pousser aux redoutables extrémités du désespoir. Selon que cette aristocratie avait conservé plus ou moins de vigueur et d'influence, ils lui laissaient une portion plus ou moins considérable de ses domaines, en se bornant à l'assujettir à de simples redevances. De là deux espèces de domaines, et la dénomination de francs-alleux attribuée aux terres occupées par les conquérants, ainsi que l'explique avec beaucoup de clarté le comte de Boulainvilliers :
« Le Gaulois propriétaire, dit ce savant historien de la noblesse française, était tenu à certains tributs des fruits et revenus de ses terres selon l'exigence des vainqueurs. Le Franc, qui possédait les siennes totalement libres et franches, en avait une propriété plus absolue et plus parfaite ; aussi cette [276] distinction était marquée par les termes de terres saliques , c'est-à-dire les terres des Francs nommés aussi Saliens, terres ou alleux des Francs , en un mot francs-alleux , c'est-à-dire absolument et foncièrement propres, héréditaires, libres, non-seulement de toute reconnaissance pour le fonds, mais même de tout tribut pour les fruits. Terra salica, quae salio militi, aut regi assignata erat, dicta ad differentiam allodialis, quae est subditorum . (Basnage, au mot Alleu.) Cette façon de partager les terres conquises fut imitée par les Goths, qui appelaient sortes gothicas les terres qu'ils avaient retenues, et sortes romanas celles qu'ils avaient laissées aux Romains. Les Normands firent la même chose à l'égard des anciens possesseurs de la Neustrie, quand ils la conquirent, et de là l'origine de la plupart de ses francs-alleux ; car la franchise complète de ces terres dont les possesseurs ne relevaient que de Dieu tant seulement , comme dit Boutillier en sa Somme, les fit aussi nommer francs-alleux . » [149]
Deux noblesses se trouvèrent donc juxtaposées après la conquête, l'une composée des membres de l'armée conquérante , l'autre composée des anciens propriétaires non complètement dépossédés. Les premiers, dont les terres étaient franches, eurent d'abord la suprématie; mais, après de longues luttes, dont le beau roman d’Ivanhoe, par exemple, offre une esquisse pittoresque, ces deux noblesses, rapprochées par des intérêts communs, finirent généralement par se confondre.
Quelquefois les vainqueurs s'avisèrent de dresser un inventaire des richesses qu'ils s'étaient appropriées; cela eut lieu notamment en Angleterre après la conquête des Normands. Les résultats de cette curieuse enquête furent consignés dans le Domesday Book . [150]
Le partage du butin et des terres s'opérait d'une manière inégale entre les chefs et les soldats de l'armée conquérante. Cette inégalité était fondée sur la participation différente que chacun avait prise, selon son rang dans l'armée, à l'œuvre de la conquête. La distinction du rang, à son tour, était déterminée par les nécessités de l’entreprise. [277] Lorsque les barbares exécutaient une invasion, ils choisissaient des chefs parmi les plus courageux et les plus capables d'entre eux, et ils leur obéissaient dans l’intérêt commun. Les chefs désignaient des aides ou compagnons ( comités ) pour faire exécuter leurs ordres; et une hiérarchie militaire , fondée sur les nécessités de l'entreprise qu'il s'agissait d'exécuter, s'organisait ainsi d'elle-même. La conquête achevée, il était naturel que les parts de butin se proportionnassent au rang que chacun des ayants droit occupait dans l'armée d'invasion. Le chef suprême eut donc la plus forte part, soit en effets mobiliers, soit en immeubles; les chefs inférieurs et les simples ouvriers de la conquête obtinrent des parts proportionnées à leur rang ou aux services qu'ils avaient rendus. Souvent ces partages occasionnèrent de sanglantes querelles, auxquelles les nécessités de la défense commune pouvaient seules mettre fin.
Lorsque le butin à partager comprit, outre les effets mobiliers, des immeubles, terres ou maisons , l'armée d'invasion se dispersa : chacun de ses membres alla occuper le lot qui lui était échu en partage. Mais en se dispersant dans un pays conquis, partant ennemi, et exposé d'ailleurs à de nouvelles invasions, les conquérants eurent soin de conserver leur organisation militaire : ils demeurèrent organisés de telle sorte, qu'à la première apparence de danger, ils pussent se retrouver tous à leur rang sous la bannière du chef. C'est ainsi que s'établit le régime féodal. Le trait caractéristique de ce régime, c'est le maintien rigoureux de l'organisation hiérarchique de l'armée conquérante , et des obligations qui en dérivaient. Au premier appel du chef suprême, empereur, roi ou duc, les chefs inférieurs convoquaient la foule des ouvriers de la conquête. Chacun étant tenu, sous peine de forfaiture, de se rendre à l'appel de son supérieur hiérarchique, l'armée se retrouvait bientôt debout, en bon ordre, pour défendre ses domaines, soit contre une révolte de l'intérieur , soit contre une agression au dehors.
Les chefs conservèrent ainsi leurs grades après la dispersion de l'armée conquérante. Chaque grade avait sa dénomination particulière, tantôt d'origine barbare, tantôt empruntée à la hiérarchie romaine. Cette dénomination passa de l'homme au domaine; de là les royaumes, les duchés, les marquisats, les comtés, les baronnies, etc. Ceux des ouvriers de la conquête qui ne possédaient aucun grade, mais qui avaient obtenu un lot de terre, prirent simplement le nom de francs tenanciers , et leurs terres celui d'alleux ou de terres franches (en anglais, free-holds ), et ils constituèrent l'échelon inférieur de la noblesse. [151] Soumis à l'obligation de marcher au commandement des chefs, ils jouissaient en revanche, comme ceux-ci, du privilège des exemptions d'impôts et du droit de se faire représenter dans les assemblées ou parlements de la noblesse, où se débattaient les intérêts du corps.
Cependant il importait d'assurer la durée de cette organisation que nécessitait le soin de la défense commune. Le droit d'aînesse et les substitutions furent institués dans ce but. Chacun ayant obtenu une portion du sol, à charge de remplir certaines obligations, il était essentiel, en premier lieu, que ce lot ne fut point morcelé; en second lieu, qu'il ne passât point entre les mains d'une famille étrangère ou ennemie. Le morcellement de la terre aurait anéanti le gage qui assurait l'exact accomplissement des services militaires sur lesquels reposait la sécurité commune; il aurait encore introduit l’anarchie dans l'armée conquérante, en nécessitant un remaniement continuel de la hiérarchie. L'introduction dans les rangs de l'armée d'hommes appartenant à la race vaincue, introduction qui aurait pu avoir lieu à la suite de l'aliénation ou de la vente des terres occupées par les vainqueurs, n'aurait pas été moins dangereuse. Le droit d'aînesse et les substitutions servirent à préserver les conquérants de ce double péril. Le droit d'aînesse maintint intact le domaine gage de l'accomplissement du devoir de chacun envers tous, en le faisant passer de génération en génération à l'aîné de la famille. Les substitutions» empêchèrent des étrangers ou des ennemis de se glisser dans les rangs de l'armée, en paralysant entre les mains des propriétaires nobles le droit d'aliéner leurs domaines.
L'organisation primitive de l'armée conquérante put ainsi se perpétuer après que la conquête eut été accomplie, et la noblesse se constitua comme une véritable corporation au sommet de la société.
Cette organisation avait son utilité manifeste, en ce qu'elle empêchait la contrée où l'armée conquérante s'était établie de devenir incessamment la proie de nouvelles hordes de barbares. Elle avait ses inconvénients inévitables en ce qu'elle livrait des populations industrieuses à la merci d'une horde avide et brutale, qui usait le plus souvent sans modération aucune de son droit de conquête.
D'abord la condition des populations assujetties [278] fut des plus dures. Les conquérants étaient soumis à des lois et à des obligations fondées sur leur intérêt commun; ces lois et ces obligations, qui s'étendaient à tous, aux chefs aussi bien qu'aux soldats, protégeaient dans une certaine mesure les faibles contre les forts. Mais rien de semblable n'existait en faveur des vaincus : ceux-ci étaient une proie dont les vainqueurs dispos-aient à leur gré . Peut-être était-il bon qu'il en fut ainsi, du moins à l'origine ; car, si les conquérants n'avaient pas eu un maximum d'intérêt à supporter les risques de la propriété, alors en butte à de continuelles agressions, ils seraient, selon toute apparence, demeurés de simples pillards nomades, et le capital accumulé par la civilisation eût été entièrement détruit. Mais ce pouvoir absolu des vainqueurs sur les vaincus, qu'il fût nécessaire ou non, ne pouvait manquer d'engendrer l'oppression la plus monstrueuse . Tout serf ou sujet d'un seigneur était taxable et corvéable à merci, ce qui signifiait que le seigneur pouvait disposer selon son bon plaisir de l'avoir du malheureux serf, et le vendre, lui et les siens, après avoir confisqué son bien. Tout individu, marchand ou autre, qui traversait le domaine d'un seigneur, était exposé de même à être pillé , réduit en esclavage ou massacré. Heureusement cet état violent ne pouvait durer : l'ordre et la justice ont un tel caractère d'utilité qu'on les voit se rétablir d'eux-mêmes en quelque sorte, après les plus terribles bouleversements sociaux. Les seigneurs ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils étaient intéressés à accorder à leurs serfs, agriculteurs ou artisans, certaines garanties de sécurité, à ne les point dépouiller d'une manière violente et arbitraire, afin d'en retirer davantage. De là les coutumes . Ces coutumes, dont l'utilité pour le maître comme pour le sujet ressortait de l'expérience, finirent par devenir une solide barrière contre l'arbitraire des seigneurs . La condition du serf, protégée par la coutume, devint plus tolérable, et le revenu du seigneur s'en trouva accru ; les agriculteurs étant moins exposés à la spoliation, l'agriculture commença à refleurir, et les famines, après avoir été la règle, devinrent d'année en année moins fréquentes. Agglomérés dans les villes, et par la même mieux en état que les agriculteurs de se soutenir mutuellement, les artisans obtinrent plus promptement encore des garanties contre l'arbitraire; on leur permit, moyennant des redevances fixes , et parfois même moyennant une indemnité une fois payée, d'exercer en paix leur industrie, et les statuts des corporations ne furent primitivement autre chose que les recueils des coutumes, des accords ou des transactions qui les protégeaient contre la rapacité des seigneurs. Les mêmes coutumes s'établirent et les mêmes transactions s'opérèrent au bénéfice du commerce. D'abord les marchands qui s'étaient aventurés à trafiquer de ville en ville comme ils faisaient au temps de la domination romaine, avaient été dépouillés, réduits en esclavage ou massacrés par les seigneurs barbares dont ils traversaient les domaines. Mais aussitôt, tout commerce ayant cessé, les seigneurs eux-mêmes ressentirent les inconvénients de cet état de choses. Que firent-ils alors.? A leurs déprédations capricieuses et arbitraires, ils substituèrent des redevances fixes et régulières ; ils garantirent aux marchands un passage libre et assuré sur leurs domaines, moyennant un péage. C'était encore onéreux sans doute ; car, chaque contrée étant morcelée en une multitude de petites seigneuries, un marchand qui avait à franchir une distance quelque peu étendue était obligé d'acquitter une multitude de péages. Mais c'était moins onéreux que le pillage et l'assassinat; et le commerce, ainsi protégé par l'intérêt mieux entendu des seigneurs , reprit à son tour un peu d'activité.
L'amélioration ne s'arrêta pas là. Des événements et des progrès de diverse sorte affaiblirent successivement la noblesse féodale, soit en diminuant l'importance de son rôle, soit en accroissant la puissance des classes qui lui étaient subordonnées.
Aussitôt que la féodalité se fut solidement assise et constituée, le péril des invasions devint moindre. Non, comme l'a affirmé, par exemple, l'historien Robertson, que la source d'où elles s'écoulaient eût tari. Il y avait encore, dans le nord de l'Europe et dans le centre de l'Asie, des multitudes avides de butin et disposées à se jeter sur les contrées où les arts de la civilisation avaient accumulé de la richesse; mais, entre ces multitudes faméliques et la proie qu'elles convoitaient, le rempart de la féodalité s'était dressé. Après avoir tenté vainement de pratiquer une brèche à ce rempart qui remplaçait celui des légions romaines, les hordes barbares refluèrent les unes sur les autres jusqu'au fond de l'Asie, et elles se précipitèrent sur l'Inde et sur la Chine. Alors les conquérants établis sur les débris de l'empire romain purent goûter un peu de repos. Mais le repos était antipathique à leur nature. Ils s'épuisèrent en des querelles intestines. Les seigneurs les plus faibles furent assujettis ou dépouillés par les plus forts. Le chef suprême , qui d'abord n'avait eu autorité sur ses anciens compagnons que lorsqu'il s'agissait de pourvoir à la défense commune, profita de leurs dissensions pour augmenter sa puissance à leurs dépens. Il accorda son alliance et sa protection aux faibles, à la condition qu'ils se missent sous sa dépendance et qu'ils lui payassent tribut. C'est ainsi que la plupart des domaines francs ou alleux furent successivement changés en fiefs . [152] Cette modification du régime féodal eut [279] des conséquences fort importantes. Le nombre des luttes intestines diminua, parce que les seigneurs les plus puissants n'osèrent plus s'attaquer aux faibles, lorsque ceux-ci furent devenus les vassaux du roi. D'un autre côté le roi, qui percevait des tributs sur les terres de ses protégés, s'aperçut qu'ils lui rapportaient d'autant plus que les taxes perçues au profit des seigneurs étaient moins nombreuses et moins lourdes. Il s'attacha, en conséquence, à diminuer le nombre des péages particuliers et à modérer les exigences des seigneurs envers leurs serfs. Son intervention salutaire se fit sentir aussi dans le régime des monnaies. A l'origine, chaque seigneur s'était attribué le droit de battre monnaie, en imposant aux habitants de ses domaines l'obligation de se servir uniquement du numéraire frappé à son effigie. La monnaie devint bientôt aussi mauvaise que possible, sans que les sujets des seigneurs faux monnayeurs eussent aucun moyen de se soustraire à cette nuisance. Il en fut autrement lorsque, les alleux ayant été transformés en fiefs, le roi établit des impôts sur les domaines de ses vassaux. Pour prévenir le dommage que lui causaient les altérations des monnaies dans la rentrée des impôts, il institua des, juges-gardes , chargés de surveiller le monnayage des seigneurs et d'empêcher qu'ils ne refondissent sa propre monnaie en l'altérant. Successivement même, à mesure que la puissance de ce protecteur des faibles acquit plus d'étendue, il confisqua ou racheta le droit de monnayage des seigneurs inférieurs pour se l'attribuer. Les classes industrieuses ne manquèrent pas de profiter de ces changements. Leur condition s'améliora encore lorsque la portion la plus belliqueuse et la plus remuante de la noblesse s'en alla aux croisades. Les seigneurs, convaincus que la conquête de l'Orient leur procurerait la fortune en ce monde et assurerait leur salut dans l'autre, cédaient à vil prix la liberté à des multitudes de serfs. Et comme bien peu d'entre eux revinrent de cette Californie religieuse du moyen âge , les serfs qui avaient racheté leur liberté purent la conserver. Enfin les bourgeois des villes, devenus riches et puissants par l'industrie, entreprirent de se rendre complètement indépendants de leurs seigneurs. Le mouvement communal commença, et ce mouvement, secondé par les rois, qui vendirent leur protection aux bourgeois des communes comme ils l'avaient vendue auparavant aux petits seigneurs, contribua encore a affaiblir la puissance de la noblesse.
Le régime féodal tomba ainsi peu à peu en ruines. Les classes assujetties marchèrent chaque jour d'un pas plus rapide vers leur affranchissement, en inscrivant sur leurs bannières le mot liberté . (Voyez Bourgeoisie .) La substitution des armes à feu à l'ancien outillage de la guerre porta le coup de grâce à la féodalité, en permettant désormais aux classes industrieuses de se protéger elles-mêmes contre les invasions des fortes races du Nord. L'artillerie remplaça avec avantage les colosses bardés de fer de la chevalerie, et la corporation nobiliaire cessa d'être le rempart nécessaire de la civilisation. Les services qu'elles rendait perdant de leur valeur, on supporta avec plus d'impatience la suprématie et les privilèges qu'elle continuait de s'arroger. Il en fut ainsi surtout en France, où, le pouvoir royal ayant fini par la réduire à l'état d'une véritable domesticité de cour, elle donna le spectacle de la plus triste déchéance matérielle et morale. Ses aînés, pourvus de fastueuses sinécures, dépensaient leurs revenus dans l'oisiveté, et ils s'endettaient pour n'être pas éclipsés par une bourgeoisie industrieuse dont la richesse allait croissant. Ses cadets, trop nombreux pour les emplois dont le monarque pouvait disposer, et trop orgueilleux pour se livrer au commerce et à l'industrie, [153] remplissaient les tripots et les [280] mauvais lieux. La noblesse, ainsi avilie, perdit son antique ascendant sur les masses, et en 1789 les classes industrieuses s'insurgèrent contre la domination d' une caste qui ne savait plus faire oublier sa morgue et ses privilèges par la grandeur de ses services. La noblesse française disparut, engloutie dans la tourmente révolutionnaire.
Voici, d'après le savant auteur de La France avant la révolution , un exposé des droits et privilèges féodaux dont la noblesse jouissait encore lorsque survint cette grande catastrophe :
« Dans presque toutes les campagnes, il existait de nombreux vestiges du régime féodal. Chaque village avait son seigneur, qui en général possédait les meilleures terres et avait des droits sur celles qui ne lui appartenaient pas. Ainsi c'était le droit exclusif de la chasse sur tout le territoire du fief; c'était la dîme, dont l'étendue était plus ou moins grande; c'était, à chaque mutation de propriété, le droit de lots et ventes. Le seigneur pouvait retenir, pour le prix de vente, le champ vendu dans l'étendue de sa seigneurie, forcer tous les habitants à moudre dans son moulin, à cuire dans son four, à faire leur vin dans son pressoir, etc. Au vassal incombaient aussi des redevances personnelles, comme l'obligation de faire quelques journées de travail sans rétribution, qu'on appelait corvées, de rendre certains hommages dans des circonstances déterminées, etc. Dans quelques provinces, comme la Franche-Comté, la Bourgogne, la mainmorte subsistait encore dans beaucoup de villages; le paysan ne pouvait quitter le sol, se marier, sans la permission de son seigneur, sous peine de perdre son bien, et, s'il ne laissait point d'enfants, le seigneur était son héritier.
« Mais Louis XVI avait aboli la mainmorte dans tous les domaines de la couronne; plusieurs seigneurs suivirent son exemple. Il avait, en outre, aboli dans tout le royaume le droit de suite, c'est-à-dire le droit qu'avait le seigneur d'hériter de la fortune acquise hors du fief par un mainmortable domicilié également hors de la seigneurie.
« La justice était rendue en premier, et quelquefois en dernier ressort, par des juges nommés par le seigneur. Enfin, lorsqu'il avait exercé tous ses droits, le clergé prenait la dime, le gouvernement la taille et l'impôt du sel, et le paysan était soumis en outre à la corvée et à la milice, tandis que tous les nobles et presque tous les fonctionnaires bourgeois en étaient exempts. » [154]
Enfin la noblesse accaparait la plupart des grandes charges de l'État, et avait à sa disposition de nombreuses sinécures.
On ne possède aucune donnée précise sur le nombre des membres de la noblesse, à l'époque où la commotion révolutionnaire la dépouilla de ses privilèges. Selon Sieyès, ce nombre ne dépassait pas 110 mille. Voici de quelle manière Sieyès établissait son calcul :
« Je ne connais, disait-il, qu'un moyen d'approcher du nombre des individus de cet ordre : c'est de prendre la province où ce nombre est le mieux connu, et de la comparer au reste de la France. La Bretagne est cette province, et je remarque d'avance qu'elle est plus féconde en noblesse que les autres, soit parce qu'on n'y déroge point, soit à cause des privilèges que retiennent les familles, etc., etc. On compte en Bretagne dix-neuf cents familles nobles; j'en suppose deux mille, parce qu'il en est qui n'entrent pas encore aux états. En estimant chaque famille à cinq personnes, il y a en Bretagne dix mille nobles de tout âge et de tout sexe. La population totale est de deux millions trois cent mille individus. Cette somme est à la population de la France entière comme un à onze. Il s'agit donc de multiplier dix mille par onze, et l'on aura cent dix mille têtes nobles au plus pour la totalité du royaume. » L'auteur de La France avant la révolution est d'avis que l'opinion de Sieyès s'écarte très peu de la vérité.
Comme la noblesse française, mais avec plus de succès, l'aristocratie britannique s'est attachée à maintenir son ancienne suprématie. Aucune aristocratie n'a su tirer un parti plus avantageux de sa situation. Par l'établissement des lois céréales, elle s'est appliquée à exhausser la valeur des terres appartenant à ses aines. Par l'extension de l'empire colonial de l'Angleterre, elle a successivement agrandi le débouché ouvert à ses cadets. [155] Cependant les classes industrieuses ont fini par comprendre que les frais de cette politique de monopole retombaient principalement sur elles, tandis que l'aristocratie en recueillait le bénéfice le plus clair. Elles ont battu en brèche les monopoles politiques et économiques de l'aristocratie , et, grâce à la grande agitation de la Ligue (voyez ce mot) et aux réformes de sir [281] Robert Peel, continuées par lord John Russell, cette oeuvre d'affranchissement est aujourd'hui fort avancée.
Il convient toutefois d'ajouter que, si l'aristocratie britannique s'est montrée âpre à la curée des monopoles, elle a déployé de grandes et solides qualités dans l'exercice des fonctions qu'elle avait accaparées. Elle a fait mieux encore : chaque fois qu'elle a vu quelque capacité éminente apparaître dans les couches inférieures de la société, elle a eu l'intelligente habileté de l'appeler dans ses rangs . C'est ainsi qu'elle a su rendre son monopole supportable, et conserver un grand et légitime ascendant sur le pays.
Lorsque les classes nobles auront enfin cessé d'être privilégiées, d'une manière directe ou indirecte, il y a apparence que les titres qui servent à les reconnaître perdront toute valeur. Car leur valeur repose bien moins sur un préjugé de l'opinion que sur les avantages positifs qu'ils peuvent conférer. Ces avantages sont nuls dans les professions libres : qu'un négociant, par exemple, soit noble ou roturier, le crédit dont il jouit sur la place demeure le même. Mais il en est autrement dans les fonctions qui dépendent du gouvernement . Il est rare que la noblesse ne soit pas favorisée d'une manière exceptionnelle dans la distribution des emplois et des honneurs. Même dans les pays où le principe de l'égalité a été proclamé avec le plus d'emphase, les titres de noblesse sont encore trop souvent un papier dont la valeur est hypothéquée sur la bourse des contribuables . [156] Aussi longtemps que ce papier conservera quelque valeur, ce sera une preuve que la société n'en a pas encore fini avec le régime des privilèges.
Ces vieilles qualifications nobiliaires constituent du reste un singulier anachronisme dans l'organisation de la société moderne . Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les titres de duc, de marquis, de comte, de baron, servaient à désigner les grades de la hiérarchie militaire de la féodalité ; ils répondaient à peu près aux dénominations modernes de général, de colonel, de major, de capitaine. Des banquiers, des industriels, des savants ou des artistes qui s'affublent de ces titres empruntés à la hiérarchie féodale ne présentent-ils pas un spectacle quelque peu ridicule? Ne seraient-ils pas tout aussi fondés à se décorer des qualifications de mandarin, de grand-serpent ou de sagamore ? En quoi ce dernier travestissement serait-il plus choquant que l'autre? Nos banquiers, nos industriels, nos savants et nos artistes ont-ils plus de ressemblance avec les farouches guerriers du moyen âge qu'avec les chefs indiens ou les mandarins chinois?
Les privilèges, et probablement aussi les titres nobiliaires, finiront par disparaître comme tant d'autres débris du vieux régime de servitude. Mais est-ce à dire que nos sociétés soient destinées à subir un jour le niveau égalitaire? Non. Il y aura toujours, dans l'œuvre de la production, des fonctions supérieures et des fonctions inférieures , des fonctions exigeant à un haut degré le concours des facultés morales et intellectuelles de l'homme, et des fonctions auxquelles suffiront de moindres aptitudes. Les premières seront toujours mieux rétribuées et plus honorées que les secondes. L'aristocratie des sociétés sera formée de leurs titulaires, et cette noblesse naturelle , d'autant plus respectable qu'elle sera mieux fondée sur la supériorité du mérite et sur la grandeur des services, n'aura pas besoin d'étaler, pour obtenir la considération publique, des prétentions orgueilleuses et des titres surannés.
Endnotes to Noblesse
[149] De la noblesse française , par le comte de Boulainvilliers.
[150] Le Domesday Book n'est autre chose qu'un grand inventaire de la conquête normande. Voici quelques détails intéressants que nous empruntons à la belle histoire de M. Augustin Thierry, sur l'origine de cette curieuse enquête, et sur la manière dont elle fut dressée ;
« ... Le roi Guillaume, dit M. Augustin Thierry, fit faire une grande enquête territoriale, et dresser un registre universel de toutes les mutations de propriété opérées en Angleterre par la conquête. Il voulut savoir en quelles mains, dans toute l'étendue du pays, avaient passé les domaines des Saxons, et combien d'entre eux gardaient encore leurs héritages par suite de traités particuliers conclus avec lui-même ou avec ses barons; combien, dans chaque domaine rural, il y avait d'arpents de terre; quel nombre d'arpents pouvait suffire à l'entretien d'un homme d'armes, et quel était le nombre de ces derniers dans chaque province ou comté d'Angleterre ; à quelle somme montait en gros le produit des cités, des villes, des bourgades, des hameaux; quelle était exactement la propriété de chaque comte, baron, chevalier, sergent d'armes; combien chacun avait de terres, de gens ayant fiefs sur ses terres, de Saxons, de bétail, de charrues.
« Ce travail, dans lequel des historiens modernes ont cru voir la marque du génie administratif, fut le simple résultat de la position spéciale du roi normand comme chef d'une armée conquérante, et de la nécessite d'établir un ordre quelconque dans le chaos de la conquête. Cela est si vrai que, dans d'autres conquêtes dont les détails nous ont été transmis, par exemple dans celle de la Grèce par les croisés latins au treizième siècle, on trouve la même espèce d'enquête faite sur un plan tout semblable par les chefs de l'invasion.
« Un vertu des ordres du roi Guillaume, Henri de Ferrières, Gaultier Giffard, Adam, frère d'Eudes le sénéchal, et Rémi, évêque de Lincoln, ainsi que d'autres personnages pris parmi les gens de justice et les gardiens du trésor royal, se mirent à voyager par tous les comtés d'Angleterre, établissant dans chaque lieu un peu considérable leur conseil d'enquête. Ils faisaient comparaître devant eux le vicomte normand de chaque province ou de chaque shire saxonne, personnage auquel les Saxons conservaient dans leur langue l'ancien titre de shire-reve ou shériff. Ils convoquaient ou faisaient convoquer par le vicomte tous les barons normands de la province, qui venaient indiquer les bornes précises de leurs possessions et de leurs juridictions territoriales; puis quelques-uns des hommes de l'enquête, ou des commissaires délégués par eux, se transportaient sur chaque grand domaine et dans chaque district ou centurie , comme s'exprimaient les Saxons. Là ils faisaient déclarer sous serment par les hommes d'armes français de chaque seigneur, et par les habitants anglais de la centurie, combien il y avait sur le domaine de possesseurs libres et de fermiers; quelle portion chacun occupait en propriété pleine ou précaire; les noms des détenteurs actuels, les noms de ceux qui avaient possédé avant la conquête, et les diverses mutations de propriété survenues depuis; de façon, disent les récits du temps, qu'on exigeait trois déclarations sur chaque terre : ce qu'elle avait été au temps du roi Edward, ce qu'elle avait été quand le roi Guillaume l'avait donnée, et ce qu'elle était au moment présent. Au-dessous de chaque recensement particulier, on inscrivait cette formule : « Voilà ce qu'ont juré tous les Français et tous les Anglais du canton. »
« Dans chaque bourgade, on s'enquérait de ce que les habitants avaient paye d'impôts aux anciens rois, et de ce que le bourg produisait aux officiers du conquérant ; on recherchait combien de maisons la guerre de la conquête ou les constructions de forteresses avaient fait disparaître, combien de maisons les vainqueurs avaient prises, combien de familles saxonnes, réduites à l'extrême indigence, étaient hors d'état de rien payer. Dans les cités, on prenait le serment des grandes autorités normandes, qui convoquaient les bourgeois saxons au sein de leur ancienne chambre du conseil, devenue la propriété du roi ou de quelque baron étranger. Enfin, dans les lieux de moindre importance, on prenait le serment du préposé, ou prévôt royal, du prêtre et de six Saxons ou de six vilains de chaque ville, comme s'exprimaient les Normands. Cette recherche dura six années, pendant lesquelles les commissaires du roi Guillaume parcoururent toute l'Angleterre, à l'exception des pays montagneux au nord et à l'ouest de la province d'York, c'est-à-dire des cinq comtés modernes de Durham, Northumberland, Cumberland, Westmoreland et Lancastre. Elle fut terminée en l'an 1086.
« …La rédaction du rôle de cadastre, ou le terrier de la conquête normande pour chaque province qu'il mentionnait, fut modelée sur un plan uniforme. Le nom du roi était placé en tête, avec la liste de ses terres et de ses revenus dans la province; puis venaient à la suite les noms des chefs et des moindres propriétaires, par ordre de grade militaire et de richesse territoriale. Les Saxons épargnés par grâce spéciale dans la grande spoliation ne figuraient qu'aux derniers rangs; car le petit nombre de cette race qui restèrent propriétaires franchement et librement, ou tenants en chef du roi , comme s'exprimaient les conquérants, ne le furent que pour de minces domaines. Le reste des noms à physionomie anglo-saxonne, épars çà et là dans le rôle, appartient à des fermiers de quelques fractions plus ou moins grandes du domaine des comtes, barons, chevaliers, sergents d'armes ou arbalétriers normands.
« ...Ce livre précieux, où la conquête fut enregistrée tout entière pour que le souvenir ne pût s'en effacer, fut appelé par les Normands le grand rôle , le rôle royal on le rôle deWinchester , parce qu'il était conservé dans le trésor de la cathédrale de Winchester. Les Saxons l'appelèrent d'un nom plus solennel, le livre du dernier jugement, Domesday Book , parce qu'il contenait leur sentence d'expropriation irrévocable. »
(Augustin Thierry, Histoire de ta conquête d'Angleterre var les Normands , tome II, pages 237-44.)
[151] Cette noblesse naturelle et générale de tous les vainqueurs, dit M. Augustin Thierry, croissait en raison de l'autorité ou de l'importance personnelle de chacun d'eux. Après la noblesse du roi, venait celle du gouverneur de province, qui prenait le titre de comte ; après la noblesse du comte venait celle de son lieutenant, appelé vice-comte ou vicomte ; et ensuite celle des gens de guerre, suivant leurs grades, barons , chevaliers , écuyers ou sergents , nobles inégalement, mais tous nobles par le droit de leur victoire commune et de leur naissance étrangère. ( Histoire de la conquête d'Angleterre par les Normands , tome II, page 34.)
[152] Montesquieu a exposé avec beaucoup de clarté la nature de cette transformation du régime féodal, ainsi que les causes qui la déterminèrent :
« La manière de changer un alleu en fief, dit-il, se trouve dans une formule de Marculfe. On donnait sa terre au roi; il la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait au roi ses héritiers.
« ...Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très grands avantages. La composition pour les torts qu'on leur faisait était plus forte que celle des hommes libres. Il parait, par les formules de Marculfe, que c'était un privilège du vassal du roi que celui qui le tuerait payerait 600 sous de composition. Ce privilège était établi par la loi salique et par celle des Ripuaires; et, pendant que ces deux lois ordonnaient 600 sous pour la mort du vassal du roi, elles n'en donnaient que 200 pour la mort d'un ingénu. Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique, et que 100 pour celle d'un Romain. »
Après avoir énuméré divers autres privilèges dont jouissaient les vassaux du loi, l'auteur de l' Esprit des Lois ajoute: « Il est donc aisé de penser que les Francs qui n'étaient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l'usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours, et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avait besoin d'un protecteur. »
(De l'esprit des lois , livre XXXI, chap. viii.)
[153] Le préjugé nobiliaire interdisait aux nobles pauvres les emplois de l'industrie et du commerce, autrefois dégradés par l'esclavage. Ce fut seulement au dix-huitième siècle qu'une réaction commença à s'opérer contre ce préjugé. Un écrivain qui jouissait alors de quelque notoriété, l'abbé Coyer, écrivit un ouvrage intitulé la Noblesse commerçante , dans lequel il engageait les nobles à recourir aux utiles et fructueuses occupations de l'industrie et du commerce pour refaire leurs patrimoines, que l'abus du luxe avait considérablement ébréchés. L'ouvrage de l'abbé Coyer fut bien accueilli par la jeune noblesse, qui commençait à s'imprégner des idées philosophiques; mais il excita au plus haut degré l'indignation des partisans des vieilles idées. Un écrivain aristocratique, le chevalier d'Arcq, se chargea de réfuter les propositions malséantes et incongrues qui s'y trouvaient avancées. Les arguments de ce défenseur du préjugé nobiliaire ne manquent pas d'une certaine originalité. Le chevalier d'Arcq constatait d'abord avec un douloureux effroi que la noblesse n'était que trop disposée à suivre les conseils dégradants de l'abbé Coyer, et il la conjurait, au nom de son honneur et du salut de tous, de s'arrêter sur une pente si funeste :
« Il faudrait au contraire, s'écriait-il avec indignation, mettre de nouvelles barrières entre la noblesse et la route qu'on propose d'ouvrir. Sans quoi, au lieu de ne voir qu'un gentilhomme dans une famille suivre cette route, il est à craindre que toute, ou du moins presque toute la famille, ne s'y précipite, et qu'on ne voie une foule de nobles sur nos vaisseaux marchands, sans autres armes que la plume et le tablier, au lieu de les voir sur nos vaisseaux de guerre l'épée et la foudre à la main, pour défendre le commerçant timide.
« ...On dit : Que voulez-vous que fasse un gentilhomme qui ne possède que des titres antiques, motif de plus pour lui de rougir de sa misère ? Est-ce donc en France qu'on ose faire cette question ? Est-ce donc en France qu'un gentilhomme reste oisif sur son champ, tandis que la victoire attend la noblesse aux champs de Mars pour la couronner? Est-ce donc en France qu'un conseille à un gentilhomme de se livrer à la bassesse, à l'infamie, en fin qu'il déshonore le nom de ses ancêtres, vertueux sans doute puisqu'on les jugea dignes de la noblesse, sans autre prétexte que celui de le soustraire à l'indigence, tandis qu'il est un monarque bienfaisant à servir, une patrie à défendre, et des armes toujours prêtes pour quiconque veut marcher dans la carrière de l'honneur? » ( La Noblesse militaire opposée à la Noblesse commerçante, ou le Patriote français , pages 73 et 87.)
Le chevalier d'Arcq admonestait ensuite la noblesse sur l'excès de son luxe; il l'engageait à faire des économies, et il terminait en posant ce curieux dilemme :
« Le commerce en grand, le seul qui pût convenir à la noblesse, si le commerce pouvait lui convenir, ne se l'ait pas sans avoir des fonds primitifs nécessaires pour l'achat des premières denrées, et sans lesquels le désir, le zèle, l'activité, l'intelligence deviennent des instruments inutiles. Ou la noblesse que l'on veut rendre commerçante possède ces fonds, ou bien elle ne les possède pas. Si elle les possède, elle n'a pas besoin du commerce ; ces fonds doivent lui suffire pour subsister, en attendant les récompenses que son mérite et ses services doivent naturellement lui procurer. … Si la noblesse n'a pas les fonds primitifs nécessaires pour l'achat des denrées, de quelle manière veut-on qu'elle fasse les premiers pas dans le commerce? Un gentil-homme ne connaît d'autres maîtres que Dieu, l'honneur, sa patrie et son roi. Est-ce donc au service d'un roturier qu'on veut l'assujettir sous le titre d'apprenti.' Est-ce en déposant le harnais de la guerre pour endosser celui de la servitude qu'on prétend le conduire à la fortune ? Quelles ressources ! Quelle honte ! L'indigence ne lui est-elle pas mille fois préférable ? » ( La Noblesse militaire , etc , page 98.)
L’abbé Coyer riposta avec deux volumes intitulés : Développement et défense du système de la noblesse commerçante , et Grimm, en rendant compte de la querelle dans sa correspondance (année 1757), écrivit à son tour un plaidoyer en faveur de la noblesse militaire. La question demeura pendante, et, de nos jours encore, certains nobles sont demeurés imbus du préjugé que combattait l'abbé Coyer. Cependant les plus obstinés se résignent volontiers à «déroger» en plaçant leurs fonds dans l'industrie, pourvu que le placement soit avantageux.
[154] La France avant la révolution , par Raudot, p. 103.
[155] Voir, au sujet de cette politique de monopole et de guerre de l'aristocratie britannique , l'introduction de Cobden et la Ligue, ou l'Agitation anglaise pour la liberté du commerce , par Fréd. Bastiat.
[156] Selon Bentham, aucun système de récompenses n'est plus coûteux que celui qui consiste à accorder des titres de noblesse pour prix des services rendus à l'État. Voici comment l'illustre philosophe utilitaire motive son opinion à cet égard :
« Les récompenses en honneurs, dit-on communément, ne coûtent rien à l'État. C'est une erreur; car non-seulement les honneurs rendent les services plus chers, mais de plus il y a des fardeaux qui ne s'évaluent point en argent. Tout honneur suppose une prééminence. Entre des individus placés sur une ligne d'égalité, on ne peut favoriser les uns par un degré d'élévation, qu'en faisant souffrir les autres par un abaissement relatif. Cela est vrai surtout des honneurs permanents, de ceux qui confèrent un rang et des privilèges. Il y a deux classes de personnes aux dépens de qui ces honneurs sont conférés: la classe d'où le nouveau dignitaire est tiré, et la classe dans laquelle il est introduit. Plus on ajoute, par exemple, au nombre des nobles, plus on diminue de leur importance, plus on ôte à la valeur de leur état.
« ...La profusion en fait d'honneurs a le double inconvénient de les avilir et d'entraîner encore des dépenses pécuniaires. A-t-on donné une pairie, il faut souvent y ajouter une pension, ne fût-ce que pour en soutenir la dignité.
« C'est ainsi que la noblesse héréditaire a haussé le taux de toutes les récompenses. Un simple citoyen a-t-il rendu de ces services éclatants que l'on ne peut se dispenser de reconnaître, il faut commencer par le tirer de la classe commune, et l'élever au niveau de la noblesse. Mais la noblesse sans dot n'est qu'un fardeau. Il faut donc y ajouter des gratifications, des pensions . La récompense devient si grande, si onéreuse, qu'on ne peut s'en acquitter sur-le-champ. Il faut en faire un fardeau dont on charge la postérité.
« Il est vrai que la postérité doit payer en partie des services dont elle partage les fruits; mais, s'il n'y avait point de nobles par naissance, la noblesse personnelle suffirait. Chez les Grecs, une branche de pin, une poignée de persil ; chez les Romains, quelques feuilles de laurier ou de gramen récompensaient un héros.
« Heureux Américains, heureux à tant de titres, si, pour avoir le bonheur, il suffisait de posséder tout ce qui le constitue! Cet avantage est encore à vous. Respectez la simplicité de vos mœurs; gardez-vous d'admettre jamais une noblesse héréditaire. Le patrimoine du mérite deviendrait bientôt celui de la naissance. Donnez des gratifications, élevez des statues, conférez des titres; mais que ces distinctions soient personnelles. Conservez toute la force, toute la pureté de l'honneur; n'aliénez jamais ce fonds précieux de l'Etat en faveur d' une classe orgueilleuse qui ne tarderait pas à s'en servir contre vous. »
(Théorie des récompenses et des peines , par Jérémie Bentham, t. II, ch. v. Raisons pour l’économie des récompenses .)
Paix, Guerre↩
Source
"Paix, Guerre", DEP, T. 2, pp. 307-14.
I.
Dire que la paix est essentiellement bienfaisante, c'est énoncer une vérité qu'il est à peine nécessaire de démontrer, un truisme. Pour rendre cette vérité tout à fait sensible, il suffît d'examiner les résultats de la rupture de la paix, de la guerre, ou même du simple risque de guerre.
Envisagée au point de vue économique, la guerre a beaucoup de ressemblance avec l'inondation ou l'incendie. La seule différence qui existe entre ces fléaux, c'est que la guerre est causée par le déchaînement des passions de l'homme, tandis que l'inondation et l'incendie proviennent des débordements des forces de la nature. Mais elles ont un résultat commun : c'est la destruction de la vie des hommes et de leurs richesses. La société est, en conséquence, obligée d'entretenir un matériel spécial pour se préserver des ravages de la guerre, comme elle entretient des digues contre l'inondation et des appareils contre l'incendie.
En vain on objectera que la guerre peut être une industrie productive; que les peuples peuvent s'enrichir en faisant la guerre aussi bien qu'en s'adonnant à l'agriculture, à l'industrie, au commerce et aux beaux-arts. L'objection ne résiste pas à un examen sérieux. Supposons que tous les hommes s'adonnent aux travaux pacifiques de la production : tous pourront s'enrichir. Il y a mieux ; les progrès des uns vers la richesse contribueront à la prospérité des autres. Supposons, an contraire, qu'ils détournent une portion de leurs capitaux de l'œuvre de la production pour l'appliquer à l'œuvre destructive de la guerre. La richesse générale ne sera-t-elle pas diminuée, en premier lieu, de toute la quantité de produits que ce capital détourné servait à créer; en second lieu, de toute la quantité de richesse que ce même capital servira désormais à détruire? A la vérité l'opération pourra être profitable, au moins d'une manière temporaire, à ceux qui l'auront entreprise. Elle le sera s'ils réussissent à s'approprier une portion considérable de la richesse d'autrui, sous forme de butin, de contributions de guerre, de conquêtes territoriales, etc. Mais voyez la différence qui existe entre l'industrie productive et l'industrie destructive : tandis que les acquisitions de la première profitent à tout le monde, celles de la seconde finissent, en dernière analyse, par ne profiter à personne. La richesse déplacée par la guerre n'est-elle pas, en effet, ordinairement dissipée dans l'oisiveté et la débauche? En outre, les peuples aux dépens desquels elle a été acquise ne finissent-ils pas le plus souvent par se réunir contre les spoliateurs et par leur ravir le fruit de leurs rapines? Si donc ceux-ci avaient continué de se livrer aux travaux pacifiques de la production, la richesse des autres peuples n'aurait reçu aucune atteinte, tandis que leur propre existence eût été plus assurée et leur prospérité plus durable.
Il suffît, comme on le voit, d'analyser les résultats de la guerre pour se convaincre qu'elle est toujours et pour tous un fléau. Mais les peuples sont-ils les maîtres d'éviter les atteintes de ce fléau ? sont-ils les maîtres de faire régner d'une manière permanente la paix dans le monde? Voilà ce qu'il est essentiel d'examiner.
II.
Dans les premiers âges de l'humanité, la guerre apparaît comme un accident inévitable, fatal, et, pour peu que l'on ait étudié la nature de l'homme, on s'explique aisément qu'il en ait été ainsi. Sans doute l'homme a de tout temps possédé la notion du juste et du bien, qui fait régner la paix entre tous par le respect du droit de chacun. Mais quand on considère avec quelle violence se manifestent ses appétits inférieurs et avec quelle difficulté il pouvait les satisfaire lorsque les arts de la production étaient encore en enfance; quand on considère aussi que le sens moral qui fait discerner le juste de l'injuste, le bien du mal, n'a pas été distribué par portions égales entre tous les hommes, on conçoit que les attentats au droit d'autrui aient dû être particulièrement inévitables et fréquents dans l'enfance de l'humanité, et que la guerre ait été alors l'état général du monde.
Les conséquences de cette imperfection de notre nature, de cette insuffisance originaire de la notion du juste pour maintenir la paix entre les [308] hommes, sont curieuses à étudier. Nous avons essayé d'en donner un aperçu au mot Civilisation. Nous avons montré comment l'expérience des maux causés par la spoliation avait porté des familles à se réunir pour vivre en paix et se protéger contre des agressions extérieures; comment, sous l'empire de cet impérieux besoin de sécurité, ou, ce qui revient au même, de paix, les premiers États avaient été formés et les premiers gouvernements institués. Mais l'expérience des maux résultant de la spoliation ne pouvait cependant avoir de sitôt la vertu de mettre fin à la guerre. Pour une multitude de peuples dont la raison était peu développée , cette expérience demeurait comme non avenue. Ceux-ci ne voyaient que le bénéfice prochain qu'ils pouvaient retirer de la guerre, bénéfice d'autant plus attrayant que l'imperfection de leurs moyens de production les condamnait à des privations plus dures, et que la violence de leurs appétits matériels les rendait plus sensibles à ces privations. Il eût été impossible de persuader à ces barbares de respecter les richesses que leurs voisins plus industrieux avaient accumulées. C'étaient des forces brutes toujours prêtes à envahir le domaine de la civilisation , et aux-quelles les peuples civilisés étaient tenus, sous peine de périr, d'opposer d'autres forces. De là une situation sociale dont les nécessités n'ont pas toujours été bien comprises.
Il y a, de notre temps, deux manières opposées d'apprécier les institutions des peuples de l'antiquité. Selon les uns, l'organisation des sociétés anciennes est un idéal que les sociétés modernes doivent conserver toujours devant les yeux. C'est aux législateurs d'Athènes, de Sparte et de Rome que nous devons demander des modèles pour nos institutions; c'est aux citoyens de ces républiques guerrières que nous devons emprunter des exemples pour notre conduite. Selon les autres, au contraire, les sociétés anciennes ne méritent que notre animadversion et notre mépris. Les héros d'Athènes, de Sparte et de Rome n'ont été que des bandits, et les législateurs de ces fortes républiques de l'antiquité, des socialistes. Ces deux appréciations extrêmes nous paraissent également erronées, et nous allons essayer d'en montrer le vice, au moyen d'une simple hypothèse.
Supposons que, dans un millier d'années, l'Océan se sera retiré des rivages de la Hollande. Sera-t-il encore nécessaire de maintenir les digues qui empêchent aujourd'hui ce pays d'être envahi par les eaux.? L'emplacement que ces digues occupent et les capitaux que leur entretien absorbe ne pourront-ils pas être affectés à des destinations productives? Ne pourra-t-on pas effacer aussi de la législation toutes les dispositions établies pour prévenir la rupture des digues ou pour punir cet attentat contre la sûreté commune? Conserver intact l'ancien endiguement avec ses accessoires, ne serait-ce pas gaspiller sans profit une partie des ressources du pays? ne serait-ce pas soumettre ses habitants à des gènes superflues? Ceux-là qui voudraient conserver quand même les vieilles digues ne mériteraient-ils pas d'être qualifiés d'esprits rétrogrades et obstinés, qui ne tiennent aucun compte du changement survenu dans le niveau de l'Océan? Mais leurs adversaires montreraient-ils plus de lumières s'ils s'avisaient d'affirmer que l'endiguement des côtes a été de tout temps une opération folle et stérile? Ne serait-ce pas commettre une méprise singulière que d'envelopper dans un même anathème ceux qui ont établi les digues quand elles étaient indispensables, et ceux qui veulent les maintenir debout quand elles ne peuvent plus servir à rien?
Eh bien , ne commet-on pas une méprise analogue quand on juge les institutions de l'antiquité sans tenir compte des nécessités dont les sociétés anciennes subissaient l'inévitable pression, et des moyens dont elles disposaient pour y pourvoir? Ces sociétés, où se formèrent les premiers dépôts de la civilisation, étaient, il ne faut pas l'oublier, continuellement menacées d'une inondation de la barbarie. N'était-il pas indispensable qu'une digue fût élevée pour les préserver de l'atteinte de ce fléau destructeur? Si de puissantes institutions militaires n'avaient point été organisées pour les défendre, n'auraient-elles pas été promptement emportées par le torrent des invasions? Et à une époque où l'outillage de la guerre était encore en enfance, n'est-ce pas l'homme surtout qu'il importait de transformer en un redoutable instrument de destruction ? Pour mettre l'élite de la population qui était chargée du soin de la défense commune en état de résister à la multitude des barbares, ne fallait-il pas l'animer d'un esprit belliqueux, lui donner une éducation et des mœurs toutes guerrières? Lorsqu'on apprécie exactement ces nécessités de la situation des sociétés anciennes, les institutions mêmes de Lycurgue apparaissent comme utiles, et bien loin de flétrir comme un des pères du socialisme ce législateur militaire, — car Sparte ne fut jamais autre chose qu'un camp, — on le met au nombre des hommes qui ont le plus efficacement contribué à assurer la marche de la civilisation. Supposons, en effet, que les républiques guerrières de Sparte et d'Athènes n'eussent point existé ou que leur organisation militaire eût été moins efficace, moins puissante : la civilisation grecque n'eût-elle pas été promptement étouffée sous les invasions des Perses et des Scythes? Supposons de même que la forte et belliqueuse république de Rome n'eût point existé en Italie : la civilisation latine aurait-elle pu résister pendant tant de siècles aux invasions des races vigoureuses du Nord? Que nous serait-il resté des acquisitions de l'antiquité, si Marius, avec ses légions, n'avait point détruit ou repoussé les multitudes barbares des Teutons et des Cimbres?
La maxime fameuse des Romains, Si vis pacem, para bellum, était parfaitement appropriée à la situation des peuples de l'antiquité. Vainement aurait-on essayé d'endoctriner en faveur de la paix les multitudes barbares qui se pressaient aux abords des régions occupées et mises en valeur par les peuples civilisés; vainement aurait-on essayé de leur démontrer que la production leur serait à la longue plus avantageuse que la spoliation : on aurait perdu son temps et sa peine. Dans l'intérêt de la civilisation et de la paix même, que la prédominance de la civilisation pouvait seule assurer, il fallait donc déployer un formidable appareil de défense contre les barbares; il fallait même [309] parfois devancer leurs attaques pour se préserver plus sûrement de leurs incursions.
Mais peu à peu, et n'en déplaise aux conservateurs de vieilles digues, la situation du monde a changé : les grandes eaux de la barbarie ont cessé de battre avec furie les bases de l'édifice de la civilisation ; elles se sont retirées, en laissant à découvert de vastes et fertiles régions. En même temps, la civilisation a acquis des moyens de défense de plus en plus efficaces. L'outillage de la guerre a été transformé d'une manière progressive, et cette transformation a assuré la prépondérance définitive des peuples civilisés sur leurs antiques adversaires. Désormais la force des armées a consisté surtout dans la puissance des machines qu'elles mettaient en œuvre ; la vigueur et même le courage purement physiques n'ont plus joué dans les combats qu'un rôle secondaire. Or, pour fabriquer, entretenir et alimenter les machines de guerre du nouveau système, il a fallu une avance considérable de capital ; il a fallu encore des hommes intelligents et pourvus de connaissances d'un ordre élevé pour les diriger ; en conséquence de ce changement, la supériorité militaire, après avoir appartenu, dans les premiers âges du monde, aux nations les plus remarquables par leur vigueur et leur adresse, s'est fixée désormais et pour toujours chez les nations les plus riches et les plus industrieuses. C'est là ce que J.-B. Say a mis parfaitement en lumière dans le passage suivant de la troisième partie de son Traité :
« La guerre devenue un métier, dit-il, participe comme tous les autres arts aux progrès qui résultent de la division du travail. Elle met à contribution toutes les connaissances humaines. On ne peut y exceller, soit comme général, soit comme ingénieur, soit comme officier, soit même comme soldat, sans une instruction quelquefois fort longue et sans un exercice constant. Aussi, en exceptant les cas où l'on a eu à lutter contre l'enthousiasme d'une nation tout entière, l'avantage est-il toujours demeuré aux troupes les mieux aguerries, à celles dont la guerre était devenue le métier. Les Turcs, malgré leur mépris pour les arts des chrétiens, sont obligés d'être leurs écoliers dans l'art de la guerre, sous peine d'être exterminés. Toutes les armées de l'Europe ont été forcées d'imiter la tactique des Prussiens; et lorsque le mouvement imprimé aux esprits par la révolution française a perfectionné dans les armées de la république l'application des sciences aux opérations militaires, les ennemis des Français se sont vus dans la nécessité de s'approprier les mêmes avantages.
« Tous ces progrès, ce déploiement de moyens, cette consommation de ressources, ont rendu la guerre bien plus dispendieuse qu'elle ne l'était autrefois. Il a fallu pourvoir d'avance les armées d'armes, de munitions de guerre et de bouche, d'attirails de toute espèce. L'invention de la poudre à canon a rendu les armes bien plus compliquées et plus coûteuses, et leur transport, surtout celui des canons et des mortiers, plus difficile. Enfin les étonnants progrès de la tactique navale , le nombre de vaisseaux de tous les rangs, pour chacun desquels il a fallu mettre en jeu toutes les ressources de l'industrie humaine; les chantiers, les bassins, les usines, les magasins, etc., ont forcé les nations qui font la guerre, non-seulement h faire pendant la paix à peu près la même consommation que pendant les hostilités, non-seulement à y dépenser une partie de leur revenu, mais à y placer une portion considérable de leurs capitaux.
« ... Il en est résulté que la richesse est devenue aussi indispensable pour faire la guerre que la bravoure, et qu'une nation pauvre ne peut plus résister à une nation riche Or, comme la richesse ne s'acquiert que par l'industrie et l'épargne, on peut prévoir que toute nation qui ruinera, par de mauvaises lois ou par des impôts trop pesants, son agriculture, ses manufactures et son commerce, sera nécessairement dominée par d'autres nations plus prévoyantes. Il en résulte aussi que la force sera probablement à l'avenir du côté de la civilisation et des lumières ; car les nations civilisées sont les seules qui puissent avoir assez de produits pour entretenir des forces militaires imposantes; ce qui éloigne pour l'avenir la probabilité de ces grands bouleversements dont l'histoire est pleine, et où les peuples civilisés sont devenus victimes des peuples barbares. » [157]
On pourrait même se montrer plus affirmatif que ne l'a été J.-B. Say, et dire qu'à l'avenir la force sera certainement toujours du côté de la civilisation. Ne voyons-nous pas, en effet, l'avantage demeurer aux peuples civilisés chaque fois qu'ils engagent une lutte avec des barbares? Les Anglais n'ont-ils pas asservi, de nos jours, les vieux conquérants de l'Inde? les Français ceux de l'Algérie? Un nouveau débordement de la barbarie sur la civilisation n'est-il pas devenu matériellement impossible?
Que résulte-t-il delà? C'est que, en laissant de côté les incursions des peuplades sauvages de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, incursions que quelques milliers d'hommes suffisent pour prévenir ou pour repousser, la question de la paix ou de la guerre n'est plus qu'une affaire à débattre entre des peuples civilisés , c'est-à-dire entre des peuples qui commencent à se laisser guider par les lumières de la raison et à rechercher quel est, en toutes choses, leur intérêt bien entendu? Or n'est-il pas permis d'espérer que ces peuples finiront un jour par s'apercevoir combien la guerre leur coûte cher, même lorsqu'elle demeure à l'état de simple risque, et par aviser sérieusement aux moyens de conserver quand même la paix partout et toujours? Alors le désarmement, qui eût été une utopie dans l'antiquité, ne pourra-t-il pas devenir une réalité?
III.
Si les nations européennes veulent savoir à quel point elles sont intéressées à la consolidation de la paix, elles n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur le compte des frais de leur appareil militaire pendant les trente dernières années. L'estimable statisticien M. de Reden a donné un aperçu de cette dépense, dans une lettre adressée au congrès de la paix de Francfort.
« L'effectif militaire actuel de l'Europe (et sous cette dénomination nous comprenons tout ce qui est payé sur les fonds consacrés à l'entretien des [310] forces de terre et de mer) se compose, dit-il, de 4 millions d'individus environ, soit à peu près 1/2 pour 100 de la population totale, qui doit s'élever aujourd'hui à 2G7 millions d'âmes.
« La valeur du travail annuel d'un adulte mâle ne saurait être évaluée à moins de 222 fr. 50 ; en Angleterre, elle est en moyenne de 556 fr. 60, et en France de 296 fr. 80. Il en résulte qu'en enlevant aux arts utiles de la paix 4 millions de jeunes gens, on sacrifie une valeur annuelle d'au moins 890 millions de fr.; c'est à peu près la moitié de la somme que l'Europe consacre au service des intérêts de sa dette.
« Les dépenses ordinaires du personnel et du matériel des forces de terre et de mer figurent actuellement au budget des États européens pour un surplus de 2 milliards de fr.; cette dépense, jointe à la perte résultant de renvoi annuel sous les drapeaux de 4 millions de jeunes gens, forme une somme de près de 3 milliards. Les frais d'entretien des forces militaires des divers États de l'Europe forment 30,24 pour 100 de la totalité de leurs dépenses ordinaires ; ils s'élèvent à un peu plus de 7 fr. 42 par tête d'habitant, et à 504 fr. 56 par tête de combattant.
« La dépense totale pour cet objet pendant les trente dernières années a été de 60 milliards. » [158]
Et cependant, dans les trente années auxquelles s'appliquent les évaluations de M. de Reden, la paix a été maintenue à peu près sans interruption. Or la dépense est naturellement beaucoup plus élevée en temps de guerre. Elle s'augmente alors sous l'impulsion de trois causes : en premier lieu, parce que les armées, décimées dans les combats, les marches forcées, etc., doivent être plus souvent renouvelées, et qu'elles le sont aux dépens de la population laborieuse; en second lieu, parce que la consommation des appareils et des munitions de guerre s'accroît dans une proportion considérable ; en troisième lieu, parce que des armées en campagne commettent des déprédations presque inévitables, et que d'un autre côté la rupture de la paix est toujours signalée par une crise qui resserre le crédit et ralentit la production.
On a cherché à évaluer les pertes que les guerres de la révolution et de l'empire ont causées à l'Europe. D'après les estimations les plus dignes de foi, la somme ne s'élèverait pas à moins de 26 milliards pour l'Angleterre seulement, en dépenses directes; et la perte totale en hommes pour l’Europe serait de 2 millions 100 mille individus. Sans vouloir garantir l'exactitude de ces chiffres, nous croyons qu'ils n'ont rien d'exagéré. [159] Une remarque essentielle à faire, c'est que les dépenses occasionnées par les guerres de la révolution et de l'empire n'ont pas pesé seulement sur le passé, mais qu'elles ont imposé encore d'accablantes charges à l'avenir. Personne n'ignore, en effet, que cette dépense n'a pas été prélevée exclusivement sur les budgets ordinaires ou extraordinaires des peuples pendant la période de 1793 à 1816, mais qu'il y a été pourvu, en grande partie, au moyen des emprunts. Sur les 26 milliards formant la quote-part de l'Angleterre par exemple, 17 milliards environ ont été empruntés. Qu'en est-il [311] résulté? C'est que les gouvernements, obligés de faire honneur à leurs engagements, sous peine de perdre leur crédit, ont dû maintenir an retour de la paix à peu près les mêmes taxes qui existaient pendant la guerre; c'est que les nations de l'Europe continuent à être taxées, et qu'elles le seront longtemps encore, pour subvenir aux frais des guerres de 1793 à 1815. Au moins si elles avaient obtenu quelque compensation pour les maux dont ces guerres néfastes n'ont point encore cessé de les accabler ! Mais chacun sait qu'elles se sont retrouvées, à l'issue de la lutte, presque également affaiblies et appauvries ; chacun sait aussi que l'industrie, les sciences et les arts, sources de toute richesse, ont subi un funeste temps d'arrêt dans cette lamentable période de conflagration.
Un jour viendra peut-être où, la solidarité qui unit les générations dans le mal comme dans le bien étant mieux connue, des limites plus rigoureuses seront Imposées à leur responsabilité; où, comme le conseillait Jefferson, l'héritage du passé ne sera plus accepté que sous bénéfice d'inventaire ; où l'avenir refusera d'acquitter les lettres de change que l'on aura tirées sur lui pour exécuter de folles et ruineuses entreprises ; où, par conséquent, ceux qui gaspilleront les ressources de la génération existante ne pourront plus escompter, à un taux usuraire, celles des générations futures.
En attendant, les peuples de l'Europe ont à supporter à la fois le fardeau de leurs dépenses militaires actuelles et une bonne partie des frais des guerres passées. C'est ainsi que la folie ou les passions mauvaises des gouvernements et des peuples ont transformé le merveilleux instrument du crédit en un agent de dévastation, et que la condition de l'humanité a été aggravée par l'emploi malfaisant d'un des véhicules qui peuvent le plus efficacement contribuer à l'augmentation de son bien-être.
IV.
Cependant, pour intéressés que soient les peuples civilisés à ne point recommencer les désastreuses expériences de la guerre, peuvent-ils dès à présent assurer entre eux d'une manière permanente le maintien de la paix ? Existe-t-il quelque panacée dont l'application leur permette d'obtenir, du jour au lendemain, ce résultat si souhaitable?
Des esprits pressés d'arriver au bien ont cru à la possibilité d'établir la paix perpétuelle en organisant des tribunaux d'arbitrage qui rempliraient en quelque sorte l'office de justices de paix internationales. Sully avait conçu un projet de ce genre, projet dont on a attribué l'honneur à Henri IV. L'abbé de Saint-Pierre, de philanthropique mémoire, reprit plus tard en sous-œuvre le plan de Sully, et il le développa dans ses volumineuses élucubrations. Enfin, de nos jours, la plupart des écoles socialistes ont imaginé des plans, naturellement infaillibles, d'organisation de la paix. Nous ne croyons point, pour notre part, que la permanence de la paix puisse surgir d'une organisation artificielle, et nous n'avons qu'une bien faible confiance dans l'efficacité des justices de paix internationales. Quand les nations, même les plus belliqueuses, croient avoir intérêt à maintenir la paix, ne les voit-on pas vider leurs différends à l'amiable, soit par l'intermédiaire d'un arbitre, soit de toute autre manières? L'absence d'un tribunal organisé les empêche-t-elle de donner une issue pacifique à leurs procès? Que si, au contraire, elles étaient résolues à faire la guerre, le tribunal organisé aurait-il le pouvoir de les en empêcher? Le souille des passions en conflit n'emporterait-il pas cette institution fragile, comme l'ouragan emporte un fétu de paille? Que si, enfin, on voulait fortifier le tribunal arbitral en mettant un pouvoir executif à son service, l'inconvénient ne serait-il pas plus sérieux encore? Le refus d'obtempérer aux décisions de ce tribunal souverain n'amènerait-il pas infailliblement la guerre? Les peuples qui assumeraient sur eux l'obligation de faire exécuter ses verdicts ne devraient-ils pas, en tout cas, demeurer continuellement l'arme au pied? Beau moyen d'assurer la paix universelle !
La permanence de la paix ne saurait donc être le fruit d'une organisation artificielle ; elle ne peut être que le produit naturel de l'affaiblissement successif du risque de guerre. Si l'on veut avoir une idée des éléments dont se compose ce risque, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les causes principales qui ont jusqu'à nos jours suscité la guerre.
La société de la paix du Massachussetts a dressé une enquête qui peut fournir à cet égard des indications utiles. Elle a recherché les causes des guerres qui ont affligé le monde civilisé depuis le règne de Constantin. Ces guerres sont au nombre de 286, non compris les insurrections, les luttes partielles, ni les guerres engagées contre les peuples sauvages. Voici en quelles catégories elles se distribuent :
- 44 guerres engagées pour obtenir un accroissement de territoire.
- 22 — pour lever des tributs, etc.
- 24 — de représailles.
- 8 — entreprises pour décider quelques questions d'honneur ou de prérogative.
- 6 — provenant de contestations relatives à la possession d'un territoire.
- 41 — provenant de prétentions à une couronne, guerres de succession, etc.
- 30 — commencées sous le prétexte d'assister un allié.
- 23 — provenant d'une rivalité d'influences.
- 5 — — de querelles commerciales.
- 55 — civiles.
- 28 — de religion, en y comprenant les croisades contre les Turcs et les hérétiques.
Ce relevé a le défaut de manquer de précision. Il nous semble aussi que ses auteurs n'ont pas accordé une part assez large aux guerres occasionnées par des rivalités commerciales. Pour avoir été souvent déguisée, cette cause ne se trouve pas moins au fond de beaucoup de luttes internationales. Malgré ses imperfections, le tableau dressé par la société de la paix du Massachussetts peut néanmoins être consulté avec fruit.
Les guerres qui s'y trouvent énumérées peuvent être, en dernière analyse, ramenées aux quatre catégories suivantes :
- Guerres religieuses.
- — commerciales.
- — politiques.
- — civiles.
[312]
Que si l'on prend à part chacune de ces catégories, on apercevra au fond l'esprit de monopole agissant pour susciter la guerre, et l'esprit de liberté s'élevant, au contraire, pour rétablir la paix et la consolider.
D'où sont provenues, par exemple, toutes les guerres religieuses? De ce que certains hommes qui professaient la religion A ne voulaient pas souffrir que d'autres hommes professassent la religion B. D'abord ils recouraient à la persuasion pour les convertir, et, la persuasion venant à échouer, ils employaient la force. Les sectateurs de A torturaient, pendaient, rôtissaient les sectateurs de B, dans le dessein louable de sauver leurs âmes. Ils ne manquaient guère non plus de confisquer leurs biens. Lorsque les sectateurs de B se sentaient assez forts pour résister ouvertement à leurs convertisseurs, ils se levaient en armes et la guerre religieuse commençait. Animés pour l'ordinaire d'un fanatisme égal à celui de leurs persécuteurs, ils imitaient volontiers leur intolérance. L'écrasement de l'une ou de l'autre secte pouvait seul mettre fin à la lutte. Chacun sait quelles guerres sanglantes et quels forfaits abominables la religion, ainsi mise au service de l'esprit de monopole, a suscités dans le monde. Heureusement l'esprit de liberté finit par intervenir. On s'aperçut à la fin que les sectateurs de A n'avaient, en réalité, nul intérêt à obliger les sectateurs de B à partager leur façon de croire, et réciproquement; et la liberté religieuse mit un terme aux guerres de religion.
D'où sont provenues toutes les guerres commerciales.? Encore de l'esprit de monopole. Certains peuples ont voulu s'attribuer, d'une manière exclusive, l'exploitation de certains marchés, et, dans ce but, ils ont établi des prohibitions, conquis des colonies, conclu des alliances commerciales. De là d'innombrables occasions de querelles et des guerres interminables. Heureusement le même esprit de liberté, qui commençait à pacifier l'arène religieuse, gagna aussi le domaine des intérêts matériels. Un jour, des hommes imbus de cet esprit de liberté et de paix dirent aux peuples qui disputaient, les armes à la main, des débouchés :
« Pourquoi verser votre sang et dépenser votre argent pour acquérir la possession exclusive d'un marché? Il y a mieux à faire. Au lieu de vous disputer un monopole qui, selon toute apparence, coûtera plus au vainqueur qu'il ne lui rapportera jamais , tolérez-vous mutuellement sur le marché en litige ; mettez-y vos marchandises en concurrence. Celui d'entre vous qui offrira la meilleure denrée, et au prix le plus bas, l'emportera infailliblement sur ses rivaux. Le plus souvent même il n'y aura, au bout de cette lutte pacifique, ni vainqueur ni vaincu. Chacun de vous, ayant ses aptitudes particulières, son capital matériel et moral sui generis, trouvera un débouché dans le marché disputé. Chacun y placera les choses qu'il est le plus apte à produire. Grâce à cette combinaison si simple et d'un caractère si fraternel, les hommes industrieux pourront s'adonner sur toute la surface du globe au genre de production qui convient le mieux a leurs aptitudes, les consommateurs seront mieux servis, et les frais des guerres commerciales seront économisés au grand avantage de tous. »
Ce bon conseil commence à être suivi, et, quoique la liberté du commerce soit encore à son aurore, elle a déjà rendu presque impossibles les guerres commerciales.
Le même esprit de monopole se retrouve au fond de toutes les guerres politiques et civiles. Comme dans les cas précédents, il a encore pour infaillible antidote l'esprit de liberté. S'agit-il, par exemple, de contestations relatives à la possession d'un territoire ou d'une couronne? Laissez les hommes adopter librement le gouvernement qu'ils préfèrent, au lieu de disposer d'eux sans les consulter, comme s'il s'agissait de vils troupeaux, et la principale cause des guerres politiques cessera d'exister. De même, qu'au sein des États la liberté devienne de plus en plus la base des institutions politiques, religieuses et économiques, et les occasions de conflits intérieurs disparaîtront peu à peu. La liberté amènera la paix entre les partis comme entre les nations.
A mesure donc que l'esprit et les institutions des peuples progressent dans le sens de la liberté, le risque de guerre devient moindre, et la prime destinée à le couvrir peut être abaissée. C'est, ne l'oublions pas, l'existence du risque qui rend nécessaire le maintien de la prime, et il serait peu sage de supprimer celle-ci aussi longtemps que celui-là demeure debout. Sans doute la prime a été souvent hors de proportion avec le risque. Dans la longue période de paix qui s'est écoulée depuis 1815 par exemple, les peuples civilisés ont maintenu un appareil militaire beaucoup plus imposant que cela n'était nécessaire. Ce mauvais emploi d'une portion considérable des deniers publics a tenu, d'un côté, à ce que la plupart des gouvernements se trouvaient soumis à l'influence de corps aristocratiques intéressés au maintien d'un gros budget ; d'un autre côté, à ce que les classes industrieuses, qui en supportaient principalement le fardeau, ignoraient à quel point l'exagération des dépenses militaires leur était préjudiciable. Cependant, si elles n'apercevaient point les causes du malaise dont elles souffraient, elles n'en ressentaient pas moins ce malaise, et l'exagération des dépenses militaires de 1816 à 1848 doit figurer certainement au nombre des erreurs funestes qui ont amené nos derniers bouleversements révolutionnaires. Les armements, qui ne sont qu'un effet du risque de guerre, peuvent, par leur exagération, contribuer à développer ce risque, et l'effet passe ainsi à l'état de cause.
En attendant que les conquêtes de l'esprit de liberté aient complètement anéanti le risque de guerre que la barbarie des anciens âges a légué au monde moderne, les nations civilisées continueront de subir la dure obligation de consacrer une bonne partie de leurs revenus aux frais d'entretien de leur appareil militaire. Car si l'excès du développement de cet appareil engendre le malaise dans le présent et augmente les périls de l'avenir, son insuffisance peut causer d'irréparables dommages, en mettant des nations industrieuses et libres à la discrétion d'un despotisme ou d'une aristocratie militaire. Il faut, en un mot, que la prime prélevée pour l'entretien de l'appareil militaire soit proportionnée, aussi [313] exactement que possible, ini risque de guerre.
V.
Mais si, comme nous avons essayé de le démontrer plus haut, la permanence de la paix ne peut être « organisée » d'une manière artificielle, est-il indispensable, pour qu'elle s'établisse, que les hommes se soient complètement dépouillés de ces passions aveugles et spoliatrices qui engendrent le monopole, et, avec le monopole, la guerre? Non ! il suffit que la somme des intérêts enrôlés sous la bannière de la liberté dépasse celle des intérêts et des passions que l'esprit de monopole peut soulever. Pour éclaircir ceci par un exemple, supposons que la liberté du commerce ait uni en un seul faisceau les intérêts des différents peuples : aussitôt la guerre ne de-viendra-t-elle pas presque impossible? Plutôt que d'interrompre des relations à la conservation desquelles leur existence même serait attachée, les peuples ne refuseraient-ils pas de céder à l'entraînement de leurs passions de guerre? Que l'esprit de liberté réalise assez de progrès pour faire pencher de son côté la balance des forces qui déterminent la conduite des peuples, et la permanence de la paix ne sera-t-elle pas assurée?
Malheureusement, il faut le dire, les classes industrieuses, dont les intérêts sont, d'une manière immédiate, engagés dans la paix, n'exercent pas toujours sur la direction des affaires publiques une influence proportionnée à leur importance. Trop souvent, même au temps où nous sommes, les influences administratives et militaires prédominent dans les conseils des gouvernements. Or celles-ci ne se signalent pas précisément par leurs tendances pacifiques, et cela se conçoit. S'agit-il de l'administration? Tandis que la guerre rétrécit les débouchés des industriels et des négociants en augmentant leurs charges, les emplois et les salaires administratifs ne demeurent-ils pas, en temps de guerre, ce qu'ils étaient en temps de paix? La perspective des conquêtes, chez un peuple doué à un haut degré des aptitudes militaires, ne présente-t-elle pas, en outre, à l'administration l'appât séducteur d'une augmentation de débouché? S'agit-il de l'armée? Celle-ci peut-elle éprouver un bien vif amour pour la paix? N'est-ce pas la guerre qui lui fournit, avec le plus d'abondance, les récompenses et les honneurs ? Les campagnes ne comptent-elles pas double dans les états de services militaires? Lors donc que les influences de l'administration et de l'armée viennent, dans un grand État, à l'emporter sur celles des classes industrieuses, on voit inévitablement s'élever le risque de guerre, et se développer d'une manière parallèle l'effectif militaire des nations voisines. Si un tel état de choses pouvait subsister, si encore les emplois de l'administration prenaient de plus en plus la place de ceux de la production libre, le risque de guerre acquerrait de jour en jour plus d'intensité et l'appareil militaire plus de volume et de poids. Le despotisme, qui fait prévaloir dans le gouvernement des États les influences administratives et militaires, et le socialisme, qui augmente les attributions de l'administration aux dépens de la production libre, sont essentiellement hostiles à la paix. Mais il y a peu d'apparence que l'avenir appartienne au despotisme et au socialisme. Telle est la force naturelle d'expansion de la production libre, que les intérêts dont elle est le foyer finiront certainement par prédominer au sein de l'organisation politique des États. Alors le risque de guerre s'abaissera de plus en plus, et de larges réductions pourront être opérées dans l'effectif militaire des peuples civilisés.
Au surplus, même lorsque les classes immédiatement intéressées au maintien de la paix sont privées de toute participation à la direction des affaires publiques, leur opinion peut encore agir pour empêcher la guerre. Elle peut agir, par exemple, en déversant un opprobre mérité sur les hommes dont l'ambition malfaisante compromet la paix du monde, comme aussi en refusant de décerner la flatteuse récompense de la « gloire » aux héros d'une guerre entreprise contre les intérêts de la civilisation. Remarquons, à ce propos, qu'aucune gloire n'est durable qu'autant qu'elle se fonde sur des services rendus à l'humanité. Pourquoi la gloire des héros de l'antiquité et du moyen âge est-elle impérissable? Parce qu'ils ont préservé la civilisation d'un retour à la barbarie, en lui faisant un rempart de leurs corps. Voilà pourquoi la postérité reconnaissante a conservé leur mémoire. Mais des hommes qui feraient reculer, de nos jours, les peuples civilisés vers la barbarie, en les plongeant, sans nécessité aucune, dans les horreurs de la guerre, obtiendraient-ils la même récompense? Ces inintelligents plagiaires ne s'exposeraient-ils pas à de cruels mécomptes? Au lieu d'être glorifiés, ne seraient-ils pas exécrés et honnis? Ne voyons-nous point déjà, en dépit de l'ignorance et des préjugés des masses, l'auréole de la gloire se fixer au front des hommes qui, aux dépens même de leur popularité, ont travaillé à maintenir la paix, tandis que les simples gagneurs de batailles éprouvent chaque jour plus de difficulté à recueillir « les sourires de la renommée? » Mais si la guerre cesse de procurer, d'une manière infaillible, la récompense si enviée de la gloire, ne perdra-t-elle pas la plus grande partie de son attrait? Ne verra-t-on pas les hommes qui, par leur position élevée ou leurs facultés d'élite, exercent le plus d'influence sur la direction des affaires publiques, se mettre, de préférence, au service de la paix?
Sans doute, la guerre n'a point cessé de menacer la sécurité et le bien-être du genre humain ; sans doute, elle étendra plus d'une fois encore ses ravages sur le monde : car c'est tout au plus s'il commence à poindre à l'horizon, cet âge de paix entrevu par le poëte :
Humanité, règne.! voici ton âge
Que nie en vain la voix des vieux échos.
Déjà les vents au bord le plus sauvage
De la pensée ont semé quelques mots.
Paix au travail ! paix au sol qu'il féconde!
Que par l'amour les hommes soient unis.
Plus près des cieux qu'ils replacent le monde;Que Dieu nous dise : Enfants, je vous bénis ! [160]
Mais si l'on ne peut sans imprudence et sans folie croire que l'humanité ait atteint déjà cet âge fortuné, en revanche, lorsqu'on considère [314] d'un œil attentif le merveilleux développement de la production, lorsqu'on considère la masse croissante d'intérêts que le progrès jette chaque jour du côté de la paix, on se laisse moins épouvanter par le fracas des passions guerrières, et l'on acquiert la conviction que la paix finira par s'imposer aux sociétés modernes d'une façon aussi irrésistible que la guerre s'imposait aux sociétés anciennes.
G. de Molinari.
Endnotes to Paix
[157] J.-B. Say. Traité d'Economie politique, livre III, chap. vii.
[158] Lettre au congrès de la paix (août 1850). Reproduite dans l’Annuaire de l'Economie politique et de la statistique pour 1851, page411.
[159] Les pertes en hommes ont été souvent évaluées beaucoup plus haut. Ici Francis d'Ivernois, par exemple, ne les porte pas à moins de 1 million 500 mille individus pour la France seulement, jusqu'en 1799. On trouvera dans son Tableau des perles que la révolution et les guerres ont causées au peuple français, les bases sur lesquelles il établit son évaluation. En même temps, cet écrivain remarque avec raison que les réquisitions et la conscription amenèrent à l'abattoir des champs de bataille des hommes qui avaient bien une autre valeur que ceux dont les recruteurs de l'ancien régime remplissaient les armées.
« Il ne faut pas perdre de vue, dit-il, que jusqu'ici, dans les guerres modernes, les hommes qui se vouaient à l'état de soldat étaient, pour la plupart, tirés de la classe la plus vagabonde, la plus paresseuse et la plus dissipée de la société, et déjà tellement appauvrie que le célibat lui est en quelque sorte imposé par sa pauvreté même. Mais la population guerrière que les Français ont sacrifiée depuis sept ans sur les champs de bataille a été tirée indistinctement de toutes les classes, sans égard pour la classe aisée, qui avait le plus de penchant vers l'état du mariage, et le plus de moyens pour subvenir aux frais et à l'éducation d'une nombreuse famille. Les aveugles réquisitions ont traîné de force aux armées cette classe précieuse qui y a péri par milliers, et le plus souvent dans les rangs des simples soldats. C'était à elle surtout à réparer les brèches que la guerre faisait à la population, et elle a été fauchée dans sa fleur, dans l'âge de force et de vigueur, entre 18 et 35 ans, à l'époque de la vie la plus propre à la propagation. » (Note: Tableau des pertes que ta révolution et la guerre ont causées au peuple français, tome 1er, page 28.)
Sans parler du vide que cette effroyable consommation d'hommes utiles a laissé dans les industries particulières, la race en a été tellement affaiblie, que la proportion des réformes pour défaut de taille et infirmités s'est élevée en un demi-siècle, selon M. Putigny, de 29 1/2 à 54 pour 100. D'autres causes ont pu, sans doute, concourir à ce même résultat; mais n'est-il pas évident que les réquisitions et la conscription, en moissonnant pendant 25 ans l'élite de la jeunesse, ont dû y contribuer pour une large part?
Citons encore, au sujet des pertes que la guerre occasionne en hommes et en richesses, ces observations judicieuses de J.-B. Say:
« Une grande perte d'hommes faits, dit-il, est une grande perte de richesse acquise; car tout homme adulte est un capital accumulé qui représente toutes les avances qu'il a fallu faire pendant plusieurs années pour le mettre au point où il est. Un marmot d'un jour ne remplace pas un homme de vingt ans, et le mot du prince de Condé sur le champ de bataille de Senef est aussi absurde qu'il est barbare : Une nuit de Paris réparera tout cela. Il faut une nuit plus vingt années de soins et de dépenses pour faire un homme que le canon moissonne en un instant, et les destructions d'hommes que cause la guerre vont bien plus loin qu'on ne l'Imagine communément : des champs ravagés, le pillage des habitations, des établissements industriels détruits, des capitaux consommés, etc., en tarissant des moyens de subsistance, font périr bien du monde hors du champ de bataille. On peut se faire une idée du nombre prodigieux de personnes plongées dans la misère par les guerres de Bonaparte, d'après le tableau des secours donnés par les bureaux de bienfaisance de Paris : de 1804 à 1810, le nombre des femmes secourues, à Paris seulement, s'est graduellement élevé de 21 mille à 38 mille. En 1810, le nombre des enfants qui recevaient à Paris des secours de la charité publique n'était pas moins que 53 mille. La mortalité était effrayante dans ces deux classes. » (J.-B. Say, Traité d'Économie politique, t. Il, c. xi.)
[160] Béranger. Les quatre âges historiques.
Paix (Société et Congrès de la Paix)↩
Source
"Paix (Société et Congrès de la Paix)"", DEP, T. 2, pp. 314-15.
[314]
De tous temps la propagande de la paix a été faite par des apôtres éclairés et bienveillants de la religion et de la philosophie; mais c'est seulement à une époque récente que des associations ont été instituées spécialement pour cet objet. C'est à la fin de la guerre qui a désolé le monde au commencement de notre siècle, que la première société de la paix a été fondée aux États-Unis. L'idée en fut suggérée d'abord dans un pamphlet intitulée : « Solemn review of the custom of war » (Revue solennelle de la pratique de la guerre; 1814). Ce pamphlet, qui parut sous le voile de l'anonyme, avait pour auteur le docteur Noah Worcester. En août 1815, la « société des Amis de la Paix de New-York » fut instituée par un petit nombre d'hommes bienveillants, appartenant à la secte des quakers. Dans le mois de décembre suivant, la société de la paix de l'Ohio et celle du Massachussetts virent successivement le jour. En 1816, le mouvement qui venait de prendre naissance chez les dignes quakers de l'Union américaine se propagea en Angleterre. Le 14 juillet de cette année, la « Société pour l'établissement de la paix permanente et universelle » était fondée à Londres.
Ces diverses associations se proposèrent principalement pour objet
« de répandre des petits livres (tracts) et des adresses démontrant que la guerre est inconciliable avec l'esprit du christianisme et les vrais intérêts de l'humanité, et indiquant les moyens les plus efficaces pour maintenir une paix permanente et universelle sur la base des principes chrétiens. »
Nous citons les termes mêmes de leurs programmes. Les ressources de la société de Londres s'élevèrent, pendant la première année de son existence, à 212 liv st. Dans la même année, son comité fit répandre 32 mille tracts et l4 mille adresses; elle se mit aussi en communication régulière avec les sociétés de New-York et du Massachussetts. L'année suivante, les imprimés répandus atteignirent le nombre de 100 mille; plusieurs de ces imprimés furent traduits en français, en espagnol et en allemand, et distribués sur le continent. La société du Massachussetts fit également pénétrer des milliers de tracts en France, en Russie, dans l’Inde et aux iles Sandwich. En 1820, celle-ci ne comptait pas moins de 12 succursales, et 15 associations semblables fonctionnant aux États-Unis. En 1821, la Société de la morale chrétienne fut instituée à Paris, en partie pour propager l'idée de la paix. En 1830, le comte de Sellon établit une société de la paix à Genève, laquelle entreprit la publication d'un journal intitulé : les Archives de la société de la paix à Genève. Depuis plusieurs années déjà, l'association de Londres publiait le Herald of peace. La propagande de l'idée de la paix se faisait ainsi peu à peu, mais sans acquérir une grande notoriété, lorsqu'en 1843 les sociétés de la paix des deux mondes résolurent de tenir à Londres une convention universelle, pour donner plus d'unité au mouvement et lui procurer une publicité plus étendue. Cette convention, formée des délégués des sociétés de la paix, se réunit au mois de juillet 1843, sous la présidence de M. Charles Hindley; M. de La Rochefoucauld-Liancourt, président de la Société de la morale chrétienne, y assistait. Les membres de la convention décidèrent qu'une adresse serait envoyée à tous les gouvernements civilisés, pour leur persuader d'introduire dans leurs traités de paix ou d'alliance une clause par laquelle ils s'engageraient, en cas de dissentiment, à accepter la médiation d'un tiers désintéressé. Cette adresse fut présentée au roi Louis-Philippe, qui fit un excellent accueil aux délégués du congrès. « La paix, leur dit-il, est le besoin de tous les peuples, et, grâce à Dieu, la guerre coûte beaucoup trop aujourd'hui pour qu'on s'y engage souvent, et je suis persuadé que le jour viendra où, dans le monde civilisé, on ne la fera plus. » Au mois de janvier 1848, la même adresse fut présentée au président des États-Unis par M. Beckewith, secrétaire de la société centrale de la paix d'Amérique. Le président lit remarquer aux délégués que la tendance naturelle des gouvernements populaires était de maintenir la paix. « Que le peuple soit instruit, dit-il, et qu'il jouisse de ses droits, et il demandera la paix, comme indispensable à sa prospérité. »
En 1848 (20, 21 et 22 septembre), une seconde convention, qui prit cette fois le nom de Congrès de la Paix, eut lieu à Bruxelles sous la présidence de M. Aug. Visschers. Diverses résolutions relatives à l'arbitrage, à l'établissement d'un congrès des nations, etc., furent adoptées par le congrès de Bruxelles. Ces résolutions furent présentées le 30 octobre suivant à lord John Russell, alors premier ministre. Lord John Russell applaudit beaucoup à la pensée qui avait présidé à la formation du congrès de la paix, et il déclara que, dans le cas d'un différend avec une nation étrangère, si celle-ci proposait à la Grande-Bretagne d'en référer à un arbitrage, le gouvernement croirait toujours de son devoir de prendre en considération une semblable demande. Les membres du congrès de Bruxelles s'étaient donné rendez-vous l'année suivante à Paris. Dans l'intervalle, M. Richard Cobden présenta au parlement britannique (séance du 12 juin 1849) une motion tendant à introduire le principe de l'arbitrage dans les traités qui seraient conclus à l'avenir entre l'Angleterre et les autres nations. Cette motion obtint une minorité de 79 voix sur 288. Le congrès qui eut lieu à Paris, au mois d'août suivant (22, 23 et 24 août 1849 ), sous la présidence de M. Victor Hugo, et qui fut en grande partie organisé par les soins de M. Joseph Garnier, l'un des secrétaires, fut des plus brillants ; plus de 500 Anglais, une cinquantaine d'Américains, dont quelques-uns appartenaient aux États les plus reculés de l'ouest, sans parler des autres étrangers et d'un nombreux public français, y assistaient. MM. Victor Hugo, Richard Cobden, Em. de Girardin, Henri Vincent de Londres et plusieurs autres orateurs d'élite s'y firent [315] entendre. En 1850, les amis de la paix se réunirent de nouveau à Francfort sous la présidence de M. le conseiller Jaup. Enfin le dernier congrès, organisé par deux apôtres infatigables de la paix, MM. Elihu Burritt et Henri Richard, a été tenu à Londres sous la présidence de l'illustre docteur Brewster. Ce congrès a en lieu les 22,23 et 24 juillet 1851, en même temps que l'exposition universelle, cet autre congrès de la paix ! Vingt-deux membres du parlement britannique, plusieurs membres de l'assemblée législative et du conseil d'État de France y figuraient, soit personnellement, soit par leurs adhésions; six corporations religieuses importantes et deux corporations municipales y étaient officiellement représentées; trente et un délégués des sociétés de paix d'Amérique, sans parler des visiteurs, avaient traversé l'Océan pour y assister. Plus de trois mille auditeurs remplissaient, pendant ses séances, la vaste salle d'Exeter-Hall. Nous reproduisons les résolutions qui furent adoptées dans ce dernier congrès des amis de la paix universelle; elles donneront une idée succincte du but qu'ils poursuivent, et des moyens qu'ils mettent en œuvre pour l'atteindre :
« 1° Il est du devoir de tous les ministres des cultes, des instituteurs de la jeunesse, des écrivains et des publicistes, d'employer toute leur influence à propager les principes de paix, et à déraciner du cœur des hommes les haines héréditaires, les jalousies politiques et commerciales qui ont été la source de tant de guerres désastreuses;
« 2° En cas de differends que l'on ne parviendrait pas à terminer à l'amiable, il est du devoir des gouvernements de se soumettre à l'arbitrage de juges compétents et impartiaux ;
« 3° Les armées permanentes qui, au milieu des démonstrations de paix et d'amitié, placent les différents peuples en un état continuel d'inquiétude et d'irritation, ont été la cause de guerres injustes, de souffrances des populations, d'embarras dans les finances des États : le congrès insiste sur la nécessité d'entrer dans une voie de désarmement ;
« 4° Le congrès réprouve les emprunts dont l'objet est de servir à faire la guerre ou à entretenir des armements militaires ruineux;
« 5° Le congrès désapprouve toute intervention par la force des armes ou par voie de menaces que des gouvernements tenteraient d'opérer dans les affaires intérieures d'États étrangers, chaque peuple devant rester libre de régler ses propres affaires ;
« 6° Le congrès recommande à tous les amis de la paix de préparer l'opinion publique dans leurs pays respectifs, afin de parvenir au développement et à l'amélioration du droit public international ;
« 7° Le congrès réprouve le système d'agressions et de violences employé par des peuples civilisés à l'égard des tribus à demi sauvages, ces actes de violences étant en même temps contraires à la religion, à la civilisation et aux intérêts du commerce ;
« 8° Le meilleur moyen d'assurer la paix étant d'augmenter et de faciliter les relations d'amitié entre les peuples, le congrès exprime sa profonde sympathie pour la grande idée qui a donné naissance à l'exposition universelle des produits de l'industrie. »
La plupart de ces résolutions ne peuvent qu'elle approuvées. Peut-être quelques-uns des promoteurs de l'agitation en faveur de la paix attribuent-ils une efficacité exagérée à l'institution d'un congrès des nations, d'un tribunal d'arbitrage, etc. ; mais tous ont compris qu'ils doivent s'appliquer surtout à convertir l'opinion. Montrer aux hommes, sous une forme claire, intelligible, populaire, que la guerre est une opération qui coûte toujours plus qu'elle ne rapporte, tel est le but qu'ils poursuivent avec une infatigable persévérance. Et si l'on songe aux préjugés qui règnent encore dans toutes les classes de la société au sujet de la prétendue utilité de la guerre, si l'on songe que les uns n'ont pas cessé de demander la guerre dans l'intérêt de la démocratie, les autres au profit de l'absolutisme, on se convaincra que l'œuvre de propagande des amis de la paix n'est nullement superflue. Assurément elle ne saurait avoir l'efficacité de mettre fin à la guerre; car la consolidation de la paix est œuvre complexe, qui dépend d'une multitude de progrès, et non d'un seul. Mais, alors même que les amis de la paix ne contribueraient que dans une faible mesure à avancer ce résultat si souhaitable, leurs efforts ne mériteraient-ils pas d'être encouragés et bénis? Comme le faisait remarquer spirituellement M. Thomas Carlyle dans une lettre d'adhésion adressée au congrès de Londres, « une seule bataille épargnée au monde ne suffirait-elle pas pour couvrir les frais de bien des congrès de la paix? »
G. de M.
Propriété littéraire et artistique↩
Source
“Propriété littéraire et artistique,” DEP, T. 2, pp. 473-78
[473]
I. Sa nature. Est-elle une propriété ou un privilège?
La propriété des œuvres littéraires et artistiques doit-elle être mise au même rang que celle des autres fruits de l'industrie humaine, ou bien doit-elle être placée à un rang inférieur et soumise à un régime particulier? Telle est la question qui se présente d'abord, et cette question divise, comme on sait, les légistes et même les économistes. Les uns sont d'avis que la propriété littéraire et artistique doit être pleinement assimilée à la propriété ordinaire; les autres pensent, au contraire, qu'elle doit être classée à part et assujettie à des restrictions spéciales. Ceux-là prétendent qu'il est équitable et utile de la garantir d'une manière absolue dans l'espace et dans le temps; ceux-ci affirment qu'il est équitable et utile de la restreindre plus ou moins dans l'espace et dans le temps; c'est-à-dire de ne la point reconnaître en dehors de certaines limites territoriales comme aussi au delà d'un certain laps de temps fixé d'une manière arbitraire.
Ces deux opinions opposées peuvent se résumer en deux mots : selon la première, la propriété littéraire et artistique est une propriété; selon la seconde, la propriété littéraire et artistique n'est qu'un simple privilège.
Recherchons donc avant tout si la propriété littéraire et artistique est une propriété ou un privilège.
Toute propriété a sa source dans l'application de l'industrie humaine à la production. Toute propriété implique un travail productif accompli par le propriétaire ou par l'individu qui lui a cédé l'objet approprié. Il n'en est pas ainsi d'un privilège. L'existence d'un privilège n'implique aucunement l'idée d'un travail productif accompli par le privilégié. On peut jouir d'un privilège sans avoir exécuté le moindre travail productif, sans s’être donné la moindre peine. Un privilège n'est, en réalité, autre chose qu'une délégation arbitraire et abusive sur la propriété d'autrui.
Or le plus léger examen suffit, croyons-nous, pour démontrer qu'en reconnaissant à un écrivain ou à un artiste le droit exclusif de jouir de son œuvre et d'en céder la jouissance, on ne lui confère aucun privilège. La production littéraire et artistique exige, aussi bien que la production industrielle ou agricole, la mise en œuvre d'une certaine quantité de capital et de travail. Comme tout autre producteur, plus que tout autre même, le littérateur, le savant ou l'artiste est obligé de faire les frais d'un apprentissage professionnel et il ne produit qu'à la sueur de son visage. Lui garantir la jouissance exclusive de ses œuvres, ce n'est donc, en aucun cas, lui conférer un privilège aux dépens du travail d'autrui, c'est tout simplement reconnaître une propriété qu'il a acquise par son travail.
Ou la propriété littéraire et artistique est une propriété, ou la Propriété n'existe pas, car il n'y a aucune diffèrence originaire entre le droit de l'écrivain ou de l'artiste sur son œuvre et le droit de l'appropriateur de terre, de l'industriel ou du négociant sur la sienne. Dans l'un comme dans l'autre cas, la propriété est un résultat de l'application des facultés de l'homme et de son capital acquis à la production.
La propriété littéraire et artistique est donc bien une propriété. Il s'agit maintenant de savoir en quoi cette propriété consiste et quelles sont ses limites naturelles.
C'est là un deuxième point que nous allons examiner.
Un homme applique ses facultés naturelles et ses connaissances acquises, plus un certain capital matériel d'avances productives, à la confection d'un poëme, d'une pièce de théâtre, d'un traité d'Économie politique, ou bien encore d'une statue, d'un tableau, d'un air de musique. Il crée ainsi une propriété littéraire ou artistique. En quoi consiste cette propriété et jusqu'où s'étend-elle ? Elle consiste d'abord dans l'objet matériel qui vient d'être façonné, manuscrit, tableau ou statue, et, jusque-là, elle ne se différencie point des autres propriétés mobilières. La loi la range, du reste, dans la même catégorie que celles-ci. Un homme de lettres ou un compositeur de musique peut disposer, comme bon lui semble, de son manuscrit, un peintre de son tableau, un sculpteur de sa statue ; il peut conserver son œuvre, la léguer à perpétuité à sa famille, la donner ou la vendre. Mais voici la particularité qui distingue d'une manière essentielle la propriété littéraire et artistique de la propriété agricole, industrielle ou commerciale , c'est qu'il est dans la nature des œuvres littéraires et musicales et des objets d'art, que l'on en puisse reproduire, avec plus ou moins de perfection , la substance immatérielle, et en étendre , en multiplier ainsi l'usage.
De là, le droit de copie, c'est-à-dire le droit de multiplier par un procédé quelconque de reproduction ou d'exécution, l'usage d'une œuvre littéraire ou artistique. Ce droit de copie peut-il être détaché de la propriété de l'œuvre originale, manuscrit, tableau ou statue, et soumis à des règles particulières, ou bien en doit-il être considéré comme une portion intégrante et nécessaire?
Que l'on nous permette de nous copier [474] nous-mêmes pour éclaircir cette question, dont la solution renferme, comme on va le voir, la négation on l'affirmation de la propriété littéraire et artistique :
« Est-il équitable et utile de séparer le droit de copie de la propriété de l'œuvre originale?
« Si l'on séparait entièrement ces deux droits, si l'on déniait absolument à l'auteur d'une œuvre littéraire, le droit exclusif de la faire copier, que se passerait-il? On verrait se produire un phénomène assez curieux ; on verrait la valeur de l'œuvre originale disparaître, se fondre en quelque sorte entre les mains de son propriétaire ; on verrait ce propriétaire réduit à une situation beaucoup plus mauvaise que s'il n'était pas dans la nature de son œuvre de pouvoir être reproduite, copiée.
« En effet, si une œuvre littéraire ne se différenciait en rien des œuvres purement matérielles, si sa substance ne pouvait être multipliée au moyen de la copie ; cette œuvre à un seul exemplaire pourrait acquérir une valeur considérable. Un riche amateur payerait un beau livre aussi cher, plus cher peut-être, qu'un bijou précieux, une perle, un diamant. Mais il n'en est pas ainsi. En vertu de sa nature particulière, le bijou littéraire peut-être indéfiniment reproduit par la copie. Qui donc se souciera de payer chèrement l'original, s'il peut se procurer à vil prix une copie qui lui fasse le même usage? Supposons qu'on trouve un moyen de tirer le fameux diamant le Ko-i-noor à un nombre indéfini d'exemplaires, en répandant dans chaque copie sa substance précieuse, qui se souciera encore de donner des millions pour acheter la propriété du Ko-i-noor? Le propriétaire du diamant original n'en perdra-t-il pas à peu près toute la valeur, à moins qu'il ne conserve seul le droit d'en tirer des copies?
« Séparer absolument le droit de copier une œuvre littéraire de la propriété de l'œuvre originale, ce serait donc altérer, détruire en grande partie la valeur de celle-ci ; ce serait placer, sous le rapport de la propriété, l'écrivain dans une situation tout à fait inférieure à celle des autres producteurs.
« La situation de l'artiste ne serait pas aussi mauvaise que celle de l'écrivain si on lui refusait le droit exclusif de faire reproduire ses œuvres; car si l'on peut reproduire une œuvre littéraire de telle sorte que la copie tienne lieu de l'original, qu'elle soit même préférable, on ne peut copier avec la même perfection les œuvres d'art. Il est bien rare que la copie peinte d'un tableau vaille l'original. Quant à la gravure et à la lithographie, elles ne le reproduisent que d'une manière fort incomplète. Aussi un peintre de mérite continuerait-il à tirer un bon prix de ses tableaux, alors même que tout le monde aurait le droit d'en multiplier les copies. Mais supposons, —et la chose peut arriver, — qu'on réussisse par un procédé quelconque, à copier les tableaux avec une exactitude et une perfection telles que les copies produisent, aux yeux des plus fins connaisseurs, absolument le même effet que les originaux, qu'elles satisfassent au même degré le sentiment du beau. Si ces copies peuvent être répandues à vil prix, les originaux ne perdront-ils pas la plus grande partie de leur valeur? Qui se souciera encore de payer un original, 10 mille, 20 mille, 30 mille, 100 mille francs, tandis qu'il pourra s'en procurer une copie aussi belle pour 2 ou 3 francs? Si cette hypothèse devenait un jour une réalité, les peintres ne seraient-ils pas ruinés, à moins qu'ils ne conservassent le droit exclusif de copier ou de faire copier leurs tableaux?
« Telle serait dès à présent la situation des écrivains, si le droit de copie se trouvait complètement séparé de la propriété de l'œuvre originale, si ces deux droits ne demeuraient pas réunis, au moins pendant quelque temps, entre les mains de l'écrivain. » [161]
Ainsi donc, l'examen de la nature du droit de copie démontre qu'aussitôt que ce droit vient à être séparé de la propriété de l'œuvre originale, celle-ci perd la plus grande partie de sa valeur, sinon toute sa valeur; que la condition des propriétaires dont l'œuvre peut être multipliée par copie devient alors plus mauvaise que celle des propriétaires dont l'œuvre ne comporte qu'un usage unique; en un mot, que le droit de copie détruit la propriété de l'œuvre originale, lorsqu'il n'est point reconnu et garanti au propriétaire.
Ce caractère et ces effets du droit de copie étant bien constatés, il ne s'agit plus que de savoir s'il est équitable et utile que la propriété littéraire et artistique soit détruite, en tout ou en partie, par la scission de ce droit; s'il est équitable et utile que l'écrivain ou l'artiste soit victime de cette qualité purement physique de son œuvre, qui permet d'en multiplier l'usage par la reproduction ou la copie.
Cette question, M. Louis Blanc et avec lui tout le troupeau des communistes ne manquent pas de la résoudre d'une manière affirmative :
« Non-seulement, dit M. Louis Blanc, il est absurde de déclarer l'écrivain propriétaire de son œuvre, mais il est absurde de lui proposer comme récompense une rétribution matérielle, Rousseau copiait de la musique pour vivre et faisait des livres pour instruire les hommes. Telle doit être l'existence de tout homme de lettres digne de ce nom. S'il est riche, qu'il s'adonne au culte de la pensée : il le peut; s'il est pauvre, qu'il sache combiner avec ses travaux littéraires l'exercice d'une profession qui subvienne à ses besoins. » [162]
En tenant ce langage, M. Louis Blanc se montre conséquent avec le reste de sa doctrine. Seulement il ne s'aperçoit point qu'en privant ainsi l'écrivain ou l'artiste de la rémunération due à son industrie, il fait de la culture des lettres, des sciences et des arts, le monopole de la richesse. Rousseau ne tirait, à la vérité, qu'un faible produit de ses œuvres, et il copiait de la musique pour vivre. Mais si Rousseau avait pu obtenir de ses ouvrages un produit assez élevé pour subsister honorablement et élever lui-même sa famille, où donc aurait été le mal? Rousseau, propriétaire et bon père de famille, n'aurait-il pas mieux vécu et donné un meilleur exemple que Rousseau vivant d'aumônes plus ou moins déguisées et mettant ses enfants à la charge du public?
[475]
Ceux-là qui n'admettent point que la société puisse trouver un avantage à ce que l’homme de lettres ou l'artiste soit, par destination, un mendiant et un pourvoyeur de l’hospice des enfants trouvés, ceux-là résoudront évidemment la question autrement que ne la résout M. Louis Blanc. Mais, d'abord, il importe de savoir comment elle a été résolue dans la pratique.
Elle l'a été par un mezzo termine. Les législateurs ont généralement compris la nécessité de reconnaître, dans une mesure plus ou moins large, le droit de copie ; ils ont compris qu'à défaut de cette garantie, la carrière des lettres et des arts demeurerait fermée aux hommes qui sont obligés de travailler pour vivre, c'est-à-dire à l'immense majorité des hommes disposés à travailler. En conséquence, le droit de copie et de reproduction a été reconnu et garanti aux écrivains et aux artistes, mais il ne l'a pas été d'une manière absolue. Il a été limité, plus ou moins, dans le temps et dans l'espace. Au bout d'une certaine période fixée, d'après la fantaisie du législateur, le droit de copie et de reproduction tombe dans le domaine public. Il y tombe aussi au delà des frontières du plus grand nombre des nations.
Nous allons passer brièvement en revue les législations qui régissent la propriété littéraire et artistique dans les principaux États civilisés ; nous rechercherons ensuite quels sont les résultats de la limitation légale du droit de copie, et nous trouverons dans ces résultats les éléments d'une solution économique de la question.
II. Aperçu des législations qui régissent la propriété littéraire et artistique.
Partout, comme nous l'avons remarqué plus haut, la propriété des œuvres originales a été reconnue sans restriction de temps ni de lieu ; partout la propriété d'un manuscrit, d'un tableau, d'une statue a été assimilée à celle des autres objets mobiliers ; mais il en a été autrement pour le droit de copie.
En France, le droit de copie était jadis reconnu et garanti à perpétuité ou à temps, selon le bon plaisir du souverain. L'ordonnance de Moulins de 1566, une déclaration de Charles IX en 1671 et des lettres patentes de Henri III constituent à cet égard la législation de l'ancien régime. Le roi demeurait toujours le maitre de reconnaître et de garantir le droit de copie, ou de s'y refuser, comme aussi de subordonner sa reconnaissance et sa garantie aux conditions qu'il jugeait convenable d'imposer. Ordinairement, aucune limitation n'était fixée. C'est ainsi que nous trouvons, sous la date du 14 septembre 1761, un arrêt da conseil qui continue aux petits-fils de La Fontaine, le privilège de leur aïeul, soixante-six ans après sa mort. Toutefois, l'auteur n'était investi à perpétuité de la propriété de son œuvre qu'à la condition de ne la point céder à un libraire; en cas de cession, le droit de copie tombait dans le domaine public à la mort de l'auteur. [163] Le règlement de 1618, l'arrêt de 1665, celui de 1682, l’édit de 1686 et le règlement du 28 février 1723, art. 109, assurent la garantie du droit de copie en établissant des peines corporelles ou pécuniaires contre les contrefacteurs. La contrefaçon qui avait pris, dès l'introduction de l'imprimerie, un développement considérable fut graduellement expulsée du royaume et elle alla s'établir en Hollande et en Suisse. [164]
La révolution de 1789 modifia ce régime; mais il serait difficile de dire si ce fut pour l'améliorer ou le rendre pire. Désormais, le droit de copie fut reconnu en vertu d'une loi et déclaré transmissible sans restriction; en revanche il fut limité arbitrairement dans sa durée, par la loi même qui le proclamait.
Voici, au surplus, quel est actuellement l'état de la législation des principaux pays de l'Europe, en ce qui concerne la durée du droit de copie.
En France, le droit de copie est garanti aux auteurs et à leurs veuves pendant leur vie, à leurs enfants pendant vingt ans, et, s'ils n'en laissent point, aux autres héritiers pendant dix ans seulement. [165]
En Angleterre, le droit de copie est garanti à l'auteur pendant quarante-deux ans, à dater de la publication de l'ouvrage. Une prolongation de sept années peut encore être accordée aux héritiers , à partir du décès de l'auteur, dans le cas où les quarante-deux ans auraient expiré pendant sa vie. [166]
En Belgique et en Hollande, la loi française sur la propriété littéraire est en vigueur depuis 1817. Avant la réunion des deux pays, le droit de copie était garanti à perpétuité en Hollande.
Le Zoll-verein a adopté la loi prussienne sur la propriété littéraire. En vertu de cette loi, le droit de copie appartient à l'auteur pendant toute sa vie et à ses héritiers pendant trente ans, à partir de sa mort. [167]
La même durée a été adoptée en Autriche. [168]
En Russie, le droit de copie est garanti à l'auteur pendant sa vie et à ses héritiers pendant vingt-cinq ans. Il peut être, en outre, prolongé de dix années si les héritiers ou les cessionnaires [476] publient une nouvelle édition cinq années avant son expiration. [169]
En Sardaigne, le droit de copie est garanti aux auteurs pendant quinze années seulement. [170] A la suite de la convention conclue avec la France, le 22 avril 1846, les garanties stipulées par la législation française ont été adoptées au profit des auteurs des deux nations contractantes.
En Portugal, le droit de copie est garanti, comme en Allemagne, pendant la vie de l'auteur, et pendant une période de trente années après sa mort. [171]
En Espagne, le droit de copie pouvait être autrefois concédé comme un privilège exclusif et illimité ; et il l'était en effet ordinairement. Mais ce privilège n'était pas toujours attribué à l'auteur ; souvent on l'accordait à des communautés religieuses au détriment des légitimes propriétaires. Après avoir été l'objet de réformes successives, la législation espagnole garantit actuellement le droit de copie pendant la vie des auteurs, et à leurs héritiers ou ayants-cause pendant une période de cinquante années. [172]
Le droit de représentation des œuvres dramatiques, de reproduction des œuvres d'art, tableaux, statues, dessins et modèles, d'exécution des œuvres musicales, qui tous participent de la nature du droit de copie, se trouve soumis de même à une limitation plus ou moins étroite dans leur durée.
Le droit de copie a été plus limité encore dans l'espace, car, jusque dans ces derniers temps, aucune nation n'a consenti à le reconnaître aux auteurs des œuvres publiées à l'étranger, et partout la contrefaçon littéraire a été pratiquée sans scrupule, La contrefaçon des livres français, qui au dix-septième et au dix-huitième siècles avait ses principaux sièges en Hollande et en Suisse, s'est transportée ensuite en Belgique où elle a pris, dans les vingt dernières années, une extension considérable ; la France , à son tour, a contrefait les ouvrages anglais, allemands, italiens, etc. Les États-Unis se sont emparés des ouvrages anglais, et l'Angleterre a pris sa revanche en s'appropriant les ouvrages américains ; bref, le pillage a été universel. C'est en 1837 seulement que la Prusse a entrepris la première de mettre fin à ce communisme international, en insérant dans sa loi constitutive de la propriété littéraire une clause relative à la réciprocité. Par cette clause, la Prusse s'engageait à faire respecter chez elle le droit de copie des auteurs appartenant aux nations qui garantiraient celui des auteurs prussiens. En 1838, l'Angleterre suivit l'exemple de la Prusse en offrant aux auteurs étrangers de protéger leur droit de copie (copy-right), pourvu que leurs gouvernements respectifs accordassent le bénéfice de la réciprocité dans la même mesure aux auteurs anglais. [173] Des conventions littéraires furent alors conclues successivement entre différents États, entre l'Autriche, la Sardaigne et le canton du Tessin en 1840; entre la Prusse et l'Angleterre, le 13 mai 1846; entre la France, la Sardaigne, le Hanovre, l'Angleterre et le Portugal en 1846, 1850, 1861, etc., etc. Enfin, la France a donné récemment un louable exemple aux autres nations en interdisant sur son territoire la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques publiées à l’étranger sans exiger aucune réciprocité. [174]
Tel est l'état actuel des législations qui régissent le droit de copie chez les principaux peuples civilisés. Le trait caractéristique de cette situation, c'est une extrême inégalité. Dans le temps, les écrivains et les artistes anglais, allemands et espagnols , par exemple, jouissent d'un droit de copie ou de reproduction plus étendu que leurs confrères français, belges ou sardes. Dans l'espace, l'inégalité n'est pas moindre. Les écrivains et les artistes appartenant aux nations qui se sont abstenues de conclure des conventions littéraires et artistiques ne peuvent compter que sur le marché national, et, depuis le décret du 28 mars 1852, sur le marché français. Ailleurs le marché est plus ou moins étendu selon le nombre et l'importance des conventions littéraires et artistiques.
III. Effets de la limitation légale du droit de copie.
On peut affirmer, d'une manière générale, que « toute limitation légale du droit de copie dans le temps et dans l'espace a pour résultat d'abaisser et de restreindre, au double point de vue de la qualité et de la quantité, la production des œuvres littéraires et artistiques ; qu'elle décourage notamment la production des œuvres supérieures pour encourager celle des œuvres inférieures. » Examinons quelles sont les « limites naturelles » du droit de copie et cette proposition se démontrera d'elle-même.
Toutes les œuvres littéraires et artistiques ne bénéficient pas également du droit de copie. Les unes sont plus reproduites dans le temps et dans l'espace; les autres le sont moins. Chaque œuvre a un débouché plus ou moins durable et étendu, selon son mérite et selon la nature et l'intensité du besoin auquel elle répond.
Ce débouché est généralement assez limité dans le temps. Chacun sait combien est faible la proportion des livres que l'on réimprime, des pièces de théâtre que l'on représente et des objets d'art que l'on reproduit après la mort de leurs auteurs. Dans la masse de la production littéraire et artistique, cette proportion n'atteint probablement pas 5 pour 100. Mais ce capital intellectuel que chaque génération lègue aux générations suivantes se compose presque entièrement d'œuvres d'élite. Des œuvres inférieures par la pensée et le style peuvent obtenir, à leur apparition, un succès d'engouement ou de réclames, mais le temps ne manque jamais d'en faire justice. Le temps est sans pitié pour la médiocrité et pour l'improvisation ; il ne respecte que le génie et le travail.
Lors donc qu'on limite dans le temps le droit de copie, on ne cause aucun dommage à la médiocrité et à l'improvisation, car leurs œuvres meurent naturellement de leur belle mort au bout d'un court délai. La propriété des auteurs médiocres et des improvisateurs n'est aucunement [477] atteinte par la loi qui limite le droit de copie dans le temps. En est-il de même de celle des auteurs d'élite? Oh! non, la loi tombe dru sur celle-ci et l'écourte sans pitié. Vous avez, par exemple, consacré la plus grande partie de votre vie à l'édification d'un monument littéraire ou artistique dont vous pouvez dire, au témoignage des contemporains eux-mêmes :
Exegi monumentum aere perennius.
Que fait la loi pour récompenser votre assiduité laborieuse? Elle raccourcit votre droit de copie à sa mesure de vingt ans ou de trente ans, et elle vous prive en conséquence de tout le bénéfice que vous auriez pu retirer du surplus. C'est une véritable amende qu'elle vous inflige pour avoir eu trop de génie et vous être donné trop de peine; c'est une amende, car il est évident que vous auriez pu céder à de meilleures conditions l'exploitation de votre droit de copie, si la durée en était demeurée illimitée; et cette amende, elle est d'autant plus forte, que votre œuvre est plus durable, c'est-à-dire que vous avez déployé plus de génie et que vous vous êtes donné plus de peine. Quoi de plus choquant et en même temps quoi de plus funeste ! Sans doute, un homme de génie ne deviendra point médiocre parce qu'on aura limité son droit de copie. Mais ne sera-t-il pas excité, dans une certaine mesure, à travailler moins ses œuvres, à les multiplier davantage aux dépens de leur durée? Ne verra-t-on point le génie descendre trop souvent, faute de l'auxiliaire du travail, jusqu'à la médiocrité, au lieu de voir la médiocrité s'élever, par le travail, jusqu'au génie?
Le débouché de chaque œuvre littéraire ou artistique a encore ses limites naturelles dans l'espace. En général, les œuvres médiocres ne dépassent pas un rayon assez court. Les œuvres remarquables par la pensée ou le style seules pénètrent au loin. Que le rayon dans lequel le droit de copie est reconnu et garanti soit limité d'une manière artificielle, et ne verra-t-on point, comme dans le cas précédent, le génie et le travail punis, la médiocrité et l'improvisation encouragées? Ne verra-t-on pas aussi les œuvres légères se multiplier aux dépens des œuvres sérieuses , l'imagination prendre le pas sur la science? Tandis, en effet, que les œuvres légères s'adressent à la foule, les œuvres sérieuses ne vont qu'à un petit nombre d'esprits d'élite. Le marché de chaque nation est, en conséquence, plus étendu pour les unes que pour les autres. Seulement il y a une circonstance qui rétablit un peu l'équilibre : c'est que les œuvres sérieuses trouvent un débouché au dehors, tandis que les œuvres légères qui s'adressent au goût particulier d'un peuple ne dépassent que par exception sa frontière. Mais si le droit de copie est limité dans l'espace, l'équilibre ne sera-t il pas rompu de nouveau? Lorsqu'une œuvre sérieuse aura du succès au dehors, la contrefaçon ne se hâtera-t-elle point de s'en emparer? L'éditeur ne pourra donc compter que sur le marché national, et, comme ce marché est naturellement resserré pour ce genre d'ouvrages, il n'en achètera qu'à vil prix le droit de copie, si toutefois il l'achète. A moins que l'auteur ne jouisse de quelque fortune, ne sera-t-il pas obligé de se retirer de l'arène ou de s'adonner à la littérature légère?
Que l'on considère, au surplus, la production littéraire et artistique de notre temps, et l'on pourra constater sans peine combien la limitation du droit de copie contribue à rabaisser la qualité des œuvres.
Elle en diminue aussi la quantité en amoindrissant d'une manière artificielle le fonds de rémunération où s'alimente la production littéraire et artistique. On dédommage, à la vérité, les écrivains et les artistes de la confiscation partielle de leur droit de copie, en leur accordant des subventions, des pensions et d'autres récompenses; mais il est douteux que ces indemnités, si onéreuses qu'elles soient pour la communauté, fournissent aux producteurs de la littérature et de l'art un équivalent réel. Le fonds naturel de la rémunération de l'industrie littéraire et artistique se trouve donc amoindri par la limitation légale du droit de copie. Qu'en résulte-t-il? C'est que, d'une part, beaucoup d'hommes pourvus d'aptitudes littéraires et artistiques sont obligés d'adopter d'autres professions auxquelles ils sont moins propres, et qu'ils subissent, en conséquence, un dommage comparable à celui que le régime prohibitif inflige aux propriétaires de vignobles, lorsqu'il les contraint à arracher leurs ceps pour mettre à la place des céréales ou des pommes de terre. C'est que, d'une autre part, la société subit un dommage non moindre en ce qu'elle ne peut avoir à son service pour satisfaire ses appétits littéraires et artistiques qu'un petit nombre d'écrivains et d'artistes, intéressés à multiplier leurs œuvres à toute vapeur, au lieu d'en avoir un grand nombre, intéressés autant que possible à produire des œuvres d'élite.
On peut donc affirmer que la limitation égalitaire du droit de copie amoindrit la production littéraire et artistique, au double point de vue de la qualité et de la quantité combinées, et comme une dernière conséquence, qu'elle rend cette production plus chère.
Cela étant, l'intérêt de la société commande évidemment de reconnaître et de garantir le droit de copie dans ses « limites naturelles. » Telle est la solution économique de la question. Mais peut-on espérer que cette solution économique finisse par se substituer à la transaction mi-propriétaire, mi-communiste qui prévaut actuellement? La solution communiste n'a-t-elle pas plus de chances d'avenir? Voilà un dernier point qu'il importe d'examiner.
IV. Conclusion.
On a remarqué avec raison, et cette remarque a une importance capitale, que les sociétés, à mesure qu'elles s'éclairent et se civilisent davantage, accordent une part de plus en plus large à la propriété. Dans les premiers âges de l'humanité, la propriété apparaît comme essentiellement restreinte et précaire : l'absorption de la propriété individuelle dans le domaine commun ou, ce qui revient au même, le communisme, est le fait dominant; quant aux atteintes à la propriété, elles ne sont considérées comme nuisibles et condamnables que dans un rayon borné. En dehors de ce rayon, elles sont le plus souvent [478] considérées comme utiles, récompensées et honorées. La notion de la propriété semble être encore confuse, mal délimitée et mal définie. Nul ne s'avise de penser, par exemple, que la loi doive avoir uniquement pour objet de reconnaître la propriété, de la décrire et de la garantir dans les limites que la nature lui a assignées. On est généralement convaincu que la propriété est instituée, créée par la loi, et qu'il dépend, en conséquence, des législateurs de lui assigner des limites arbitraires. Aussi voit-on, en tous lieux, des monopoles et des privilèges rétrécir la propriété des uns pour agrandir celle des autres. Ce n'est que peu à peu, à mesure que l'expérience signale les maux qui résultent des atteintes portées à la propriété, soit que ces atteintes aient été commises en violation de la loi ou en vertu même de la loi, que la notion de la propriété se débrouille, se précise, s'éclaircit. C'est alors que l'esclavage commence à disparaître, et la propriété mobilière et immobilière à être débarrassée des privilèges qui la grèvent ou des entraves qui l'enchaînent. C'est alors que la libre disposition de la propriété par le don, le prêt ou l'échange, est érigée en principe, et la propriété légale confondue de plus en plus avec la propriété naturelle.
A la vérité ce progrès n'a rien de régulier, et il se trouve parfois brusquement interrompu : des perturbations se produisent qui font rétrograder du jour au lendemain la société vers le communisme de la primitive barbarie ; mais comme toute atteinte portée à la propriété engendre inévitablement un mal, une réaction se produit aussitôt, et le principe qui a été menacé ou compromis ne tarde pas à se raffermir, souvent même à s'étendre. Ainsi, par exemple, la grande perturbation de 1848 a été, en définitive, favorable à l'extension du principe de la propriété. Pour ne nous occuper que de la propriété littéraire et artistique, c'est principalement depuis 1848 que le droit de copie a gagné du terrain dans la législation internationale, et l'opinion se montre de plus en plus disposée aujourd'hui à l'étendre, soit dans l'espace, soit dans le temps. Il est donc permis d'espérer, n'en déplaise à M. Louis Blanc et à son école, que la propriété littéraire et artistique finira tôt ou tard par être pleinement reconnue et garantie dans ses limites naturelles.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
Traité des droits d'auteurs, par M. A.-C. Renouard. Paris, J. Renouard et comp., 2 vol. in-8.
Organon de la propriété intellectuelle, par Jobard, directeur du musée de l'industrie belge (voyez ce nom). Paris, Mathias; Bruxelles, Decq, 1851,1 vol. gr. in-18 de 350 pages. M. Jubard s'est fait, depuis plus de vingt ans, l'avocat assidu de la propriété littéraire et artistique; il a publie, pour la défendre, une multitude de brochures, de tracts, d'articles de journaux, etc. Malheureusement, M. Jobard a eu le tort d'attaquer la liberté industrielle en défendant la propriété intellectuelle, et cet écart a beaucoup nui à sa propagande.
De la propriété littéraire et artistique, au point du vue international, aperçu sur les législations étrangères et sur les traités relatifs à la repression de la contrefaçon, suivi d'un appendice, par Alfred Villefort, docteur en droit, attache au département des affaires étrangères. Paris, 1851, broch. in-8.
Législation de la propriété littéraire collationnée sur les textes officiels, avec notes interprétatives, par Jules Delalain, imprimeur de l'Université. Paris, 1852, brochure in-8.
Le Travail intellectuel, journal des intérêts scientifiques, littéraires et artistiques (mensuel), publie à Pans en 1847, par M. Hippolyte Castille, avec la collaboration de M. G. de Molinari, et l'adhésion de MM. Frédéric Bastiat, Dunoyer, Horace Say, Michel Chevalier, Joseph Garnier, etc., etc. Ce journal avait été fondé spécialement eu vue d'agiter la question de l'affranchissement de la propriété littéraire ut artistique. La publication en a été interrompue en 1848. Il en a paru 7 numéros.
De la propriété littéraire internationale, de la contrefaçon et de la liberté de la presse, par Charles Muquardt. Bruxelles, Muquardt, 1851. Réponse pleine d'aperçus neufs et ingénieux aux défenseurs de la contrefaçon belge.
La réimpression. Étude sur cette question considérée principalement au point de vue des intérêts belges et français, avec cette épigraphe : La propriété littéraire n'est pas une propriété Bruxelles, 1851, in-18.
De la réimpression en Belgique, par A. Hauman. Bruxelles, 1852, broch. in-8. Ces deux brochures ont été publiées pour la défense de la contrefaçon belge.
Endnotes to Propriété littéraire
[161] De la propriété littéraire et de la contrefaçon belge. (Journal des Économistes, tome XXXI, page 255.)
[162] Organisation du travail, 5e édition, page 223.
[163] Discours sur la propriété littéraire, par Hippolyte Castille. (Journal le Travail intellectuel, n° du 15 octobre 1847.)
[164] Voir à ce sujet un intéressant mémoire de M. Charles Hen : De la réimpression, page 17.
[165] Loi du 19 juillet 1793, et décret du 5 février 1810.
Le droit de propriété littéraire, dit l'auteur d'un savant aperçu sur cette législation, M. Alfred Villefort, se réduit, en France, à ceci : les auteurs d'écrits en tous genres jouissent, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre ou faire vendre leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Après eux, leurs enfants en jouissent pendant vingt ans, et la veuve pendant sa vie, si ses conventions matrimoniales lui en donnent le droit. Toutefois, s'il s'agit d'une pièce de théâtre, la veuve n'a, comme les enfants, le droit exclusif d'en autoriser la représentation que pendant vingt ans. Enfin, si l'auteur laisse pour héritiers non des enfants, mais des ascendants ou des collatéraux, la jouissance est réduite à dix ans. Quant au cessionnaire des droits de l'auteur ou de ses héritiers, il en jouit pendant tout le temps concède à l'auteur, à la veuve ou aux héritiers, à moins que l'acte de cession n'ait fixé un terme plus court à la jouissance. Les propriétaires des ouvrages posthumes sont assimilés en droits aux auteurs. — (De la propriété littéraire et artistique, par Alfred Villefort, page 6.)
[166] Acte de 1842.
[167] Loi du 11 juin 1837.
[168] Loi du 19 octobre 1846.
[169] Règlements du 8 au 20 janvier 1830.
[170] Loi du 20 février 1826.
[171] Loi du 8 juillet 1851.
[172] Loi du 10 juin 1847.
[173] De la propriété littéraire et artistique*, par Alfred Villefort, page 53.
[174] Par un décret présidentiel du 28 mars 1852.
Servage↩
Source
"Servage", DEP, T. 2, pp. 610-13
[610]
SERVAGE. Le servage a été le plus souvent une modification de l'esclavage (voyez ce mot), modification amenée par la force même des choses. Ainsi, quand le régime des grandes exploitations agricoles, mises en activité par des légions d'esclaves ( latifundia ), eut épuisé le sol de l’Italie; quand, d'un autre côté, l'affaiblissement de l'empire romain, occasionné en grande partie par l'esclavage, eut rendu plus difficile le maintien de la sécurité intérieure et extérieure, le mode de culture dut être changé. Sous peine de ruine, les propriétaires fonciers furent obligés de morceler leurs domaines et de transformer leurs esclaves en serfs ou en colons pour en exploiter les parcelles. De là un progrès notable dans la condition de cette classe inférieure de la société. L'esclave était complètement la chose de celui qui le possédait : tout le produit de son travail, déduction faite de ses frais d'entretien nécessaires et du pécule qui lui était quelquefois laissé pour stimuler son activité, revenait au maître. La condition du serf fut incontestablement meilleure : on lui donna à cultiver un morceau de terre sous des conditions à la vérité fort dures, mais qui lui laissaient du moins une part de liberté et de propriété. Tantôt il était assujetti à une redevance en produits du sol, tantôt à une redevance en travail (la corvée) ou en argent. Cette redevance lui était imposée d'autorité; il n'était pas le maître d'en débattre les conditions; il ne pouvait pas non plus s'y soustraire, car il n'avait pas la liberté de changer de lieu ; il était [611] attaché à la glèbe. Enfin il était obligé de subir, en une multitude de circonstances, le bon plaisir du seigneur ; il ne pouvait se marier, par exemple, sans la permission de son seigneur, et cette permission était fréquemment subordonnée à l'exercice d'un droit qui ne prouve pas beaucoup en faveur de la moralité du bon vieux temps. En revanche, lorsque le serf avait payé sa redevance en produits du sol, en travail ou en argent, et satisfait à ses autres obligations, il demeurait le maître de disposer, comme bon lui semblait, du surplus de sa production.
Sans doute, il arriva souvent que le seigneur ne se fit point scrupule de mettre la main sur la propriété légitimement acquise par les serfs de son domaine; mais, à la longue, les seigneurs s'aperçurent qu'ils étaient intéressés eux-mêmes à respecter, dans une certaine mesure, la propriété et la liberté de leurs serfs. L'expérience démontra, par exemple, qu'en laissant le serf exposé au risque d'être arraché à son morceau de terre pour être vendu comme esclave, on ôtait tout stimulant à son activité ; on le décourageait de labourer et d'ensemencer un champ dont un autre pourrait être appelé à recueillir les fruits. En conséquence, la coutume s'établit peu à peu de ne plus vendre le serf qu'avec la terre, et la loi finit par consacrer cette coutume fondée sur l'intérêt bien entendu du seigneur comme sur celui du serf. L'expérience démontra encore qu'en imposant au serf une redevance trop lourde, eu égard à la nature du sol et aux circonstances du temps ; qu'en mettant la main sur la part de propriété qui lui demeurait, sa redevance payée, on affaiblissait aussi, d'une manière dommageable pour les deux parties, les mobiles de son activité. On lui accorda donc, non par humanité ou philanthropie, mais par intérêt, des garanties de plus en plus étendues et de plus en plus assurées pour sa personne et sa propriété. (Voyez Noblesse .) Le résultat fut que les serfs purent accumuler une certaine épargne, à l'aide de laquelle ils rachetèrent successivement, dans le cours des siècles, les redevances qui leur avaient été imposées, en sorte qu'au dix-huitième siècle, le nombre des serfs, chez les nations industrieuses et intelligentes de l'Europe occidentale, était devenu presque insignifiant. En France, il n'y en avait plus guère que dans la Franche-Comté, et l'on connaît les éloquentes requêtes au roi que Voltaire écrivit en leur faveur. [175] Différents édits furent rendus, depuis le moyen âge, pour améliorer la condition des serfs et faciliter leur affranchissement. On peut citer notamment le fameux édit de Louis X dit le Hutin, en date de 1315, par lequel ce monarque déclare que « chacun de ses sujets doit naitre franc ; que son royaume est le royaume des Francs, et qu'il veut que la chose soit accordante au nom. » Mais il ne faudrait point attribuer à ces édits plus d'influence qu'ils n'en ont eu en réalité. S’ils ont pu faciliter l'abolition du servage, ils ne l'ont point déterminée. Dans l'édit de Louis le Hutin, par exemple, il est question simplement d'autoriser les serfs et les colons de la couronne à racheter leurs redevances et leurs servitudes. C'était pour le monarque un moyen comme un autre de battre monnaie . « Ce n'était pas, remarque avec raison M. Guizot, dans des vues désintéressées que Louis le Hutin proclamait le principe de l'affranchissement des serfs. Il n'entendait point donner la franchise aux colons : il la leur vendait à bonnes et convenables conditions ; mais il n'en est pas moins certain, en principe, que le roi croyait devoir la leur vendre; en fait, qu'ils étaient capables de l'acheter. C'était là, à coup sûr, entre le onzième et le quatorzième siècle, une immense différence et un immense progrès. » [176] Et ce progrès, à quoi était-il dû? Aux épargnes que les populations asservies avaient pu réaliser dans l'intervalle, épargnes qu'elles consacraient maintenant au rachat de leur liberté comme au meilleur des placements. Si ces épargnes n'avaient point existé, à quoi aurait servi l'ordonnance de Louis le Hutin ? L'abolition du servage a donc été un fait purement économique ; elle s'est opérée d'elle-même, graduellement, par la force même des choses, et les dispositions législatives, les édits et ordonnances des monarques n'ont fait que la constater ou tout au plus l'encourager.
Nous avons dit en commençant que le servage avait été le plus souvent une modification de l'esclavage. Il est arrivé aussi, surtout dans les premiers temps du moyen âge, que des hommes libres ont accepté volontairement les liens du servage, en vue de s'assurer une protection au milieu de l'anarchie universelle . « Dans le commencement de la première race, dit Montesquieu, on voit un nombre infini d'hommes libres, soit parmi les Francs, soit parmi les Romains; mais le nombre des serfs augmenta tellement qu'au commencement de la troisième, tous les laboureurs et presque tous les habitants des villes se trouvèrent serfs. » [177] M. Guizot, à son tour, cite un passage de Salvien, où la cause de cette transformation volontaire des hommes libres en serfs ou colons se trouve clairement indiquée : «Hors d'état de conserver leur propriété et la dignité de leur origine, dit Salvien, ces hommes libres se soumettent à l'humble condition de colon : réduits ainsi à cette extrémité que les exacteurs les dépouillent non-seulement de leurs biens, mais de leur état ; non-seulement de ce qui est à eux, mais d'eux-mêmes, qu'ils se perdent eux-mêmes en même temps que ce qui est à eux, n'ont plus de propriété et renoncent au droit de la liberté. » [178] Ces hommes libres, qui consentaient à descendre à la condition de serfs pour s'assurer une protection , s'efforçaient naturellement de n'aliéner de leur liberté que la moindre part possible. Aussi le servage n'était-il point un état uniforme; il y [612] avait des serfs d'un grand nombre de catégories, formant comme une série de chaînons entre la condition de l'esclave et celle de l'homme libre.
De nos jours, le servage n'existe plus guère, sur une échelle étendue, que dans l'empire russe ; encore y est-il en voie de transformation et de décroissance. Le servage, tel qu'il se manifeste en Russie, présente quelques particularités dignes d'être mentionnées. Les serfs russes sont assujettis, les uns à la corvée, les autres à une redevance en argent connue sous le nom d’ obroc . La corvée a été limitée à un maximum de trois jours par semaine, en vertu d'un ukase de l'empereur Paul, de l'année 1797. Toutefois la loi admet ou tolère d'autres arrangements, tant qu'il n'y a pas de plaintes de la part des paysans. L'obroc varie d'importance selon la fertilité de la terre, les facilités d'écoulement, les prix courants moyens des produits agricoles, et encore plus selon les capacités morales et industrielles des paysans.
« Une chose digne de remarque, dit l'auteur d'un savant traité sur la richesse nationale de la Russie, M. Alexandre Boutowski, c'est que le travail des paysans à la corvée est généralement le moins productif. Cela s'explique par le peu d'intérêt qu'ils ont à bien employer les trois journées dues aux propriétaires, par les habitudes de paresse et de négligence qu'ils y contractent et qui influent d'une manière fâcheuse sur leurs propres exploitations. Les exceptions sont rares et s'expliquent presque toujours par la présence du seigneur dans ses terres et par une part active et éclairée qu'il prend dans la conduite de ses biens. Dans ces conditions, quelques seigneurs sont parvenus à vaincre l'inertie de leurs serfs à la corvée, à les intéresser au succès des travaux, et par suite à augmenter leur propre revenu, tout en améliorant notablement la position de leurs paysans. Les seigneurs qui, au contraire, abandonnent la gestion de leurs biens à des intendants peu consciencieux, très souvent serfs eux-mêmes, voient dépérir leurs revenus et la valeur de leurs biens, par suite des mauvaises habitudes morales et surtout de l'ivrognerie, qui s'emparent de leurs paysans. Les serfs à l’ obroc jouissent d'une liberté beaucoup plus grande que les corvéables ; et quoique l’ obroc soit, dans beaucoup de circonstances, plus lourd à acquitter que la corvée, généralement les paysans assujettis à ce mode de redevance sont dans un plus grand bien-être. C'est du sein de cette classe que sortent les industriels entreprenants et laborieux , qui, tout en restant dans la dépendance du seigneur, quant à la terre pour laquelle ils payent l’ obroc , se livrent au commerce et à l'industrie manufacturière. C'est ainsi qu'en Russie se sont formés des districts manufacturiers de campagne, où diverses industries sont exercées avec le plus grand succès par des serfs à l’ obroc ; on peut citer la coutellerie à Pawlowo et Vorsma, le moulinage des soies à Bogorodsk et Vokhna , le tissage des cotonnades et la fabrication des indiennes à Ivanowo. Les lois ne s'opposent pas à ce que l'es serfs à l’ obroc quittent leur village pour aller exercer divers métiers dans les villes : nos capitales , nos villes sont construites en grande partie par des maçons et des charpentiers à l'obroc. Cette classe fournit également une grande partie de nos ouvriers de fabrique, des apprentis d'artisans, des domestiques. En outre, les serfs à l’ obroc peuvent s'inscrire dans la classe des bourgeois et faire le commerce en gros et en détail. Parmi eux, il y a des exemples de grandes fortunes acquises dans l'industrie ou le commerce. » [179]
En échange de la corvée ou de l'obroc, les paysans reçoivent de leur seigneur une portion de terre plus ou moins considérable qu'ils exploitent pour leur compte. Cette portion de terre, le seigneur la concède, non point à chaque paysan individuellement, mais à la commune dont le paysan fait partie, et qui est rendue solidairement responsable des redevances imposées à chacun de ses membres. La commune partage la terre entre les familles ou foyers ( tïaglo ) qui la composent. « L'étendue des lots, dit M. de Tégoborski dans ses Études sur les forces productives de la Russie , est proportionnée au nombre des membres de chaque famille et aux bras dont elle peut disposer pour la culture des terrains qui lui tombent en partage. Cette possession est essentiellement précaire : selon qu'une famille devient plus ou moins nombreuse, on augmente ou l'on diminue son lot. En outre, au bout d'une certaine période plus ou moins longue, la commune reprend toutes les terres pour en faire un nouveau partage.
Ce système de partage proportionne, comme on le voit, le lot de chaque famille à la redevance qu'elle est tenue d'acquitter, et en cela il est aussi équitable que possible. En revanche, il est peu favorable aux progrès de l'agriculture, ainsi que le fait observer avec raison M. de Tégoborski ; car l'incertitude de conserver longtemps et de laisser en héritage à ses enfants le terrain qu'il cultive rend le paysan indifférent à toute amélioration dont il ne pourrait tirer profit que dans un temps plus ou moins éloigné. Aussi est-il probable que les rachats de la corvée et de l'obroc ou leur transformation en une rente toujours rachetable deviendront de plus en plus fréquents à mesure que la richesse se développera davantage. [180] Alors le système de partage en vigueur dans la commune russe, système qui n'est que la conséquence du servage, perdra complétement sa raison d'être.
Voici comment se répartissaient, en 1838, les serfs de la Russie entre les propriétaires de ce vaste empire. Il s'agit de la population masculine.
[613]
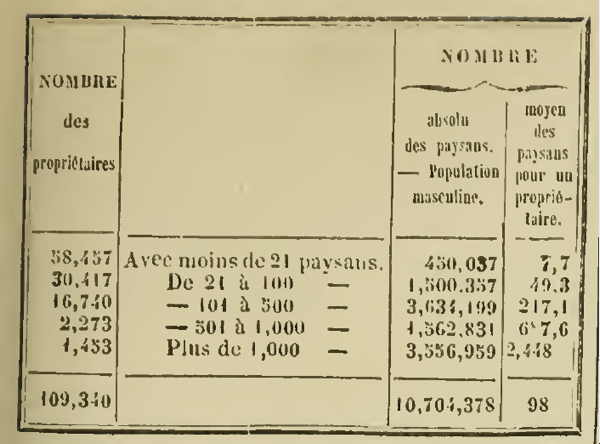
En 1848, le nombre des paysans, serfs des particuliers, était évalué à 11,938,182 ; à la même époque, le nombre des paysans censitaires des domaines de la couronne était de 9,209,200 (population masculine); on comptait, en outre, 2,091,640 paysans appartenant à des catégories plus ou moins libres. [181]
En résumé, si l'on considère le servage au point de vue économique, on trouve, d'une part, que le serf doit donner plus et de meilleur travail que l'esclave, parce qu'il jouit d'une portion de propriété et de liberté plus considérable; on trouve, d'une autre part, que c'est un état essentiellement transitoire ; car, aussitôt que le serf éprouve vivement le besoin d'être libre, il ne manque point d'appliquer à son rachat l'épargne que les progrès naturels de la sécurité et de la richesse lui ont permis d'accumuler. C'est à l'épargne plus qu'à aucune autre cause qu'est due l'abolition successive du servage dans l'Europe occidentale, et il y a apparence que ce vestige d'une époque de barbarie disparaîtra, sous l'influence de la même cause, dans le reste du monde civilisé.
Endnotes to Servage
[175] Au roi en son conseil, pour les sujets du roi qui réclament la liberté en France, contre des moines bénédictins devenus chanoines de Saint-Claude en Franche-Comté. — Supplique des serfs de Saint-Claude à monsieur le chancelier. — Requête au roi pour les serfs de Saint-Claude. — Extrait d'un mémoire pour l'entière abolition de la servitude en France, etc. Dans les Mélanges de politique et de législation .
[176] Cours d'histoire moderne. Histoire de la civilisation en France , t. iv, p. 281.
[177] Esprit des lois , liv. XXX, chap. xi.
[178] De gubern. Dei , par Salvien. Liv. V.
[179] Essai sur la richesse nationale et sur les principes de l'Economie politique , par Alexandre Boutowski (en langue russe). Voir le compte rendu de cet ouvrage dans le Journal des Economistes , t. XXVI, p. 247.
[180] Si l'artisan russe, dit M. de Haxthausen, est rangé et qu'il gagne quelque chose, il profite de la bienveillance ou d'un embarras du seigneur pour se racheter. Le prix du rachat varie de 200 à 2,000 roubles assignats (le rouble assignat vaut 1 fr. 15 c). Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale it les institutions rurales de la Russie, par le baron Aug. de Haxthausen. T. 11, p. 449.
[181] Études sur les forces productives de la Russie , par L. de Tegoborski. T. I, p. 320.
Tarifs de douane↩
Source
"Tarifs de douane", DEP, T. 2, pp. 712-16.
[712]
Les tarifs de douane ont été établis dans deux vues différentes, on pourrait même dire opposées : 1° afin de donner un revenu au fisc ; 2° afin de protéger l'industrie nationale contre la concurrence de l'industrie étrangère. A l'exception peut-être du tarif turc, qui est établi uniquement en vue du revenu, [182] [713] fous les tarifs du monde ont à la fois le caractère de la fiscalité et de la protection. Seulement les uns, parmi lesquels nous citerons les tarifs de la France, de l'Autriche, de la Russie et de l'Espagne, ont principalement le caractère protecteur; les autres, tels que ceux de l'Angleterre et des États-Unis, ont plutôt le caractère fiscal. En Angleterre même, la protection n'est plus qu'accidentelle, en ce sens que l'impôt est devenu en principe l'objet du tarif.
A l'origine, les tarifs de douane semblent n'avoir été considérés partout que comme des machines fiscales. On trouvera sur ce point les renseignements les plus détaillés au mot Douane. Nous nous bornerons à y ajouter quelques données sur les transformations que le tarif français a subies et sur son état actuel.
On sait qu'avant la révolution de 1789, le tarif français n'était point uniforme. La France était partagée alors en trois grandes régions douanières. Il y avait d'abord les provinces des cinq grosses fermes, comprenant la plus grande partie de la région du nord, depuis la Picardie et la Champagne jusqu'au Poitou, au Berry et au Bourbonnais. Ces provinces n'étaient point séparées par des barrières intérieures ; elles formaient une véritable union douanière, et c'était à elles que s'appliquait le tarif protecteur de Colbert. Venaient ensuite les provinces réputées étrangères, qui se composaient en premier lieu de la région méridionale , en suivant une ligne horizontale depuis La Rochelle ; en second lieu , de la Bretagne à l'ouest, de la Franche Comté à l'est, et, dans le nord, de la Flandre, de l'Artois et du Hainaut réunis. Les provinces réputées étrangères avaient des tarifs distincts de ceux des provinces des cinq grosses fermes, dont elles étaient séparées par des barrières douanières. Il y avait cependant un certain nombre de droits qui leur étaient communs. En outre, les marchandises provenant des provinces des cinq grosses fermes pouvaient entrer dans les autres sans payer autre chose que leurs propres droits de sortie, etc. (Voyez Douane.) Venaient enfin les provinces d'étranger effectif et les ports francs. Les provinces d'étranger effectif étaient les gouvernements d'Alsace et de Lorraine; les ports francs, Marseille, Bayonne, Lorient et Dunkerque; ces provinces et ces ports étaient considérés comme faisant partie du territoire étranger : réunis politiquement au reste du royaume, ils en demeuraient séparés commercialement.
Cette ancienne législation, qui avait le défaut grave de n'être point uniforme, avait, en revanche, le mérite de n'être point uniformément prohibitionniste. Dans les provinces réputées étrangères et d'étranger effectif, les droits étaient généralement fort modérés. On conçoit donc que ces provinces aient résisté avec énergie aux prétentions de Colbert, qui voulait leur appliquer son tarif protecteur, car les avantages qu'elles auraient retirés de la suppression des barrières intérieures n'auraient point compensé, selon toute apparence, le dommage que leur aurait causé la généralisation de la protection. Leurs résistances à l'établissement d'un régime uniformément protecteur étaient beaucoup plus justifiables qu'on n'a coutume de l'admettre. Ces résistances, l'assemblée constituante réussit à les surmonter, en ayant égard à ce qu'elles avaient de fondé, c'est-à-dire en remplaçant les tarifs particuliers des différentes provinces par un tarif général assez modéré. Si la politique commerciale de l'assemblée constituante avait continué de prévaloir, la France n'aurait eu certes qu'à s'applaudir de la suppression de ses barrières intérieures. Malheureusement il n'en fut pas ainsi : les gouvernements de la république et de l'empire s'aperçurent qu'ils pouvaient se servir du tarif uniformisé comme d'un instrument de guerre, et ils ne manquèrent point d'en essayer l'efficacité. La convention et le directoire prohibèrent les marchandises des nations avec lesquelles la France était en guerre, notamment les marchandises anglaises, et Napoléon imagina la gigantesque folie du blocus continental (voyez ce mot). Ces aberrations déplorables n'auraient pu évidemment se produire si le morcellement douanier de l'ancien régime avait continué de subsister. C'est ainsi que les réformes les plus salutaires peuvent devenir des causes de retard, des véhicules de barbarie, lorsqu'elles se trouvent improvisées dans un pays qui n'est pas suffisamment préparé à les recevoir.
Encore, si le régime prohibitif inauguré par la révolution française n'avait point survécu à la guerre continentale, on pourrait soutenir avec raison que les maux causés par ce régime ont été rachetés, et au delà, par les avantages résultant de l'uniformisation du tarif. Mais le mal a sa logique comme le bien. Des industries artificielles s'étaient établies sous la protection des obstacles que la guerre avait suscités au commerce international. Ces industries artificielles se trouvèrent sérieusement menacées dans leur existence, au rétablissement de la paix. Les intérêts qui y étaient engagés s'émurent, et comme ces intérêts avaient la prépondérance dans la nouvelle organisation politique du pays, le système prohibitif fut non-seulement maintenu, mais encore aggravé.
« On effaça des lois, dit M. Michel Chevalier, les brutalités qui proscrivaient les denrées coloniales et les matières premières des régions tropicales ; de toutes parts on s'en plaignait, personne n'en bénéficiait, personne n'en demandait le [714] maintien. On cessa de brûler les marchandises anglaises; c'était un spectacle offensant, et même sons l’empire, on ne l'avait donné aux populations que dans de rares circonstances où l'on avait supposé que c'était propre à exciter les sentiments belliqueux. Mais tout ce qui constituait un privilège en faveur des manufacturiers, un instant atténué dans le printemps de 1814, fut restauré avec aggravation dès la même année par la loi du 17 décembre, et puis aggravé encore; on maintint de même, sans en rien rabattre, les moyens exorbitants qui avaient été adoptés sous la république et sous l'empire pour l'observation à tout prix des prohibitions décrétées contre les marchandises fabriquées chez l'ennemi. Ainsi les visites domiciliaires, la dénonciation soldée, la confiscation préventive, les visites à corps restèrent dans l'arsenal de la douane, et on ne se fit faute de s'en servir. En somme, sauf des modifications sur les cotons bruts, les denrées coloniales et les autres matières propres aux régions équinoxiales, le tarif de la restauration fut plus rigoureux, plus exclusif, plus contraire à la liberté que celui de l'empire, et il le fut sans excuse. » [183]
Peut-être M. Michel Chevalier se montre-t-il trop sévère à l'égard du gouvernement de la restauration. Sans les folies prohibitionnistes de la république et de l'empire, et les créations artificielles qu'elles suscitèrent, ce gouvernement ne se serait point engagé aussi avant dans la mauvaise voie du régime prohibitif. C'est, d'ailleurs, une justice à lui rendre, qu'il alla moins avant dans cette voie que les intéressés n'auraient voulu l'y pousser. La discussion de la loi de douanes de 1822 en fait foi. Quoi qu'il en soit, le tarif français fut dès lors établi uniquement en vue de la protection, à laquelle les intérêts du Trésor furent sacrifiés d'une manière systématique. Dans une série de maximes qui méritent d'être reproduites, le rapporteur de la loi de 1822, M. de Bourrienne, élevait cette mauvaise pratique à la hauteur d'un principe.
« Un pays, disait-il, où les droits de douane ne seraient qu'un objet de fiscalité, marcherait à grands pas vers sa décadence; si l’intérêt du fisc l'emportait sur l'intérêt général, il n'en résulterait qu'un avantage momentané que l'on payerait cher un jour.
« Un pays peut jouir d'une grande prospérité et avoir peu de produits de douane; il pourrait avoir de grandes recettes de douanes et être dans un état de gêne et de dépérissement- Peut-être pourrait-on prouver que l'un est la conséquence de l'autre.
« Les droits de douane ne sont pas un impôt; c'est une prime d'encouragement pour l'agriculture, le commerce et l'industrie; et les lois qui les établissent doivent être des lois quelquefois de politique, toujours de protection, jamais d'intérêt fiscal.
« Les douanes (avec la distinction que je viens d'établir) ne devant pas être dans l'intérêt du fisc, l'impôt qui résulte du droit n'est qu'accessoire.
« Une preuve que l'impôt en fait de douane n'est qu'accessoire, c'est que le droit à l'exportation est presque nul, et que le législateur, en frappant d'un droit à l'importation certains objets, a pour but qu'il n'en entre point ou le moins possible. L'augmentation ou la diminution du produit ne doit jamais l'arrêter.
« ... Si la loi qui vous est soumise amène une diminution dans le produit des douanes, vous devez vous en féliciter. Ce sera la preuve que vous aurez atteint le but que vous vous proposez, de ralentir des importations dangereuses et de favoriser des exportations utiles. »
Faut-il donc s'étonner si le tarif français, construit conformément aux maximes de M. de Bourrienne, donne un revenu beaucoup moindre en proportion que le tarif fiscal de l'Angleterre? (Voyez Douane). Ce résultat, auquel les prohibitionnistes ont visé, ils l'ont obtenu en effet, mais les gouvernements et les contribuables doivent-ils vraiment s'en féliciter?
Depuis la restauration, le tarif français n'a subi que des modifications peu importantes, en sorte qu'il demeure aujourd'hui l'un des plus élevés et des plus compliqués de l'Europe. Ainsi il contient encore cinquante-trois prohibitions, dont quarante-huit à l'entrée, portant sur les peaux préparées et les ouvrages en peau, la tabletterie, la coutellerie, la sellerie, la plupart des fils et tissus de coton, de laine, de crin, etc., etc. Les droits prohibitifs sont, en outre, extrêmement nombreux. Quelques-uns, tels que les droits sur les aciers, atteignent un taux presque fabuleux.
Les marchandises soumises au tarif se comptent par centaines, et cependant les sept huitièmes des droits sont perçus sur une vingtaine d'articles M. Joseph Garnier en a fait le relevé pour l'année 1844, dans son excellente Analyse du tarif français. [184] 131 millions sur un total de 152 avaient été le produit de vingt articles, tels que les sucres, les cafés, les cotons, les laines, les huiles d'olive, les fils de lin et de chanvre, etc. Dans la même année, 234 articles n’avaient rapporté qu'une somme de 767 mille francs. Qu’un tarif si élevé et si compliqué oppose un obstacle sérieux au développement des relations commerciales de la France, cela n'a pas besoin d'être démontré. Le mal s'aggrave encore, par suite des droits différentiels et des traités de commerce qui ajoutent leurs complications à celles qui résultent de la multiplicité des droits, comme aussi d'une spécification arbitraire et souvent fautive des produits.
« Les droits, dit M. Joseph Garnier, varient selon les provenances de chaque produit, selon les nuances de son aspect, de sa couleur, ou conformément à dix autres circonstances dont la constatation est prescrite. Tantôt le négociant a intérêt à confondre, tantôt c'est par ignorance ou par mégarde qu'il étiquette ses colis sans exactitude. Alors le douanier intervient avec son code inextricable ; il juge et commente ici justement, là-bas légèrement, et plus loin complètement à rebours. Aujourd'hui, dans tel bureau, sous telle [715] inspiration, les mots ont tel sens; demain, dans le bureau voisin, sous une autre inspiration, la même langue a une tout autre signification. Le commerçant est obligé de faire une étude de toutes ces tendances; il est obligé de savoir les tolérances et les rigueur» du Havre, les tolérances et les rigueurs de Bordeaux, les tolérances et les rigueurs de Marseille. Finalement il est obligé de savoir tant de choses qu'il renonce à acquérir cette science, et qu'il circonscrit son activité sur un petit nombre de produits, perdant ainsi les occasions nouvelles qu’amène le progrès de la civilisation. On va chercher bien loin les causes de notre infériorité commerciale, de notre peu d'aptitude aux spéculations, de la longueur des affaires et de la pauvreté de notre marine; et on ne s'aperçoit pas qu'à force de jeter des pierres et des entraves dans la route, on a fini par décourager les voyageurs, et que, pour ramener la circulation dans la voie obstruée, il n'y a d'autre moyen que celui de la débarrasser des obstacles qu'on y a amoncelés. » [185]
Malheureusement des intérêts coalisés veillent avec un soin attentif et jaloux à ce que la voie demeure obstruée, et, malgré les efforts des partisans de la liberté du commerce, le tarif français est demeuré, jusqu'au moment où nous écrivons, en parfaite harmonie avec les fameuses maximes de M. de Bourrienne.
Le régime prohibitif prédomine encore en Espagne, en Autriche, en Russie et dans quelques autres pays de moindre importance. Cependant, en Espagne et en Autriche, une réaction s'opère contre ce système, et des brèches assez considérables ont déjà été pratiquées au tarif. En Russie même, on commence à se demander s'il n'aurait pas mieux valu laisser le capital encore peu abondant de la nation féconder l'agriculture, les industries de la laine et du lin, et les autres productions naturelles du pays, plutôt que de l'attirer, à grands renforts de prohibitions, vers les industries plus ou moins factices du coton, de la soie, du sucre de betterave, etc. On s'y aperçoit un peu tard que les industries naturelles sont retardées dans leur développement faute de capitaux, tandis que les industries artificielles, pour lesquelles de si grands sacrifices ont été faits, demeurant hors d'état de lutter avec la concurrence étrangère. M. de Tégoborski démontre fort bien que le régime prohibitif a dû causer plus de maux en Russie qu'ailleurs, à cause de l'insuffisance du capital national.
« Les capitaux et le crédit, dit-il, sont les deux grands leviers de l'industrie ; là où l'un ou l'autre de ces leviers manque, l'industrie ne peut se maintenir que dans une situation précaire. C'est un fait qui ne pourrait être et qui n'a jamais été contesté. Or, si même dans les pays qui abondent en capitaux, et où le crédit est dans une situation très satisfaisante, il serait mal avisé d'entreprendre et d'exciter, par des moyens forcés toutes les branches d'industrie à la fois , l'inconvénient serait encore plus palpable dans un pays où les capitaux sont rares et les ressources du crédit particulier très limitées ; et c'est le cas où se trouve la Russie, comme tous les pays qui sont encore dans les premières phases du développement de leurs forces productives. Beaucoup de nos fabricants, né possédant pas assez de capitaux pour suffire aux revirements de leurs établissements, travaillent avec des matières premières, achetées à 12 ou 15 pour 100 plus cher qu’au comptant, ce qui rend , indépendamment d'autres causes, nos articles manufacturés très chers, et les sacrifices que leur consommation exige plus sensibles. A l'exception de quelques articles, tels que les draps ordinaires, certaines qualités de toiles et quelques espèces de soieries, on peut admettre sans la moindre exagération que, dans tous les achats qu'on fait à Saint-Pétersbourg et à Moscou, le rouble, argent remplace exactement le florin, monnaie de convention, comparativement au prix de ces objets en Allemagne, ce qui fait une différence de 60 à 100, et il y a beaucoup d'articles qui se payent 80 pour 100, et souvent même le double plus cher. » [186]
Le même auteur n'évalue pas à moins de 4 millions 110 mille roubles (16 à 17 millions de francs) le sacrifice annuel que la protection du sucre indigène impose au trésor public, sans parler de la charge supplémentaire qu'elle fait peser sur les consommateurs. Enfin il signale la cherté du fer, provenant en grande partie de la même cause, comme l'un des obstacles qui contribuent le plus à entraver les progrès de l'agriculture.
« Nos fers, dit-il, sont excellents et propres à tous les usages, mais d'un prix très élevé et inaccessible aux classes pauvres de la population, et pour les usages ordinaires ... Cet article de première nécessité, dont le bas prix est une des conditions principales des progrès de l'industrie, est, pour nos populations agricoles, presque un objet de luxe. On peut admettre sans la moindre exagération qu'en Russie comme en Pologne, plus des neuf dixièmes des roues de charrettes et voitures de transport de toute espèce ne sont pas ferrées, et que, sauf ceux des équipages de luxe, tous les essieux sont en bois, ce qui ajoute beaucoup à la difficulté de nos transports et de nos moyens de communication, sans parler des autres inconvénients, très graves au point de vue technique et agricole, qui se rattachent à la cherté du fer. » [187]
Le régime prohibitif a donc échoué partout. Aussi est-il permis d'espérer que toutes les nations qui en ont fait la désastreuse expérience ne tarderont plus longtemps à substituer à leurs tarifs protecteurs des tarifs purement fiscaux.
L'Angleterre et les Etats-Unis ont donné le bon exemple à cet égard, et les résultats de leurs expériences sont de nature à provoquer l'imitation. (Voyez Peel et Liberté du commerce.) En Angleterre, on marche chaque jour plus avant dans la voie des réformes douanières, et chaque jour aussi le succès de la politique nouvelle devient plus éclatant. Le chancelier de l'Échiquier, M. Gladstone a complété cette année (1853), ou à peu de chose près, l'œuvre d'Huskisson et de Robert Peel. Plus de 260 articles du tarif ont été [716] encore supprimés ou réduits par lui. Les principes d'après lesquels il s'est dirigé en opérant ce complément de réformes sont les mêmes qui ont si heureusement servi de boussole à sir Robert Peel. Il a voulu, lisons-nous dans son exposé financier, 1° abolir autant que possible les droits sur les articles à peu près improductifs qui encombrent inutilement le tarif; 2° établir comme droit maximum général sur les articles manufacturés le taux de 10 pour 100; 3° supprimer les droits différentiels établis en faveur des produits des possessions britanniques, en abaissant au même niveau les droits sur les produits étrangers; 4° abolir autant que possible les droits ad valorem, qui compliquent la perception des droits et la rendent arbitraire, pour les remplacer par des droits fixes. Ces principes, sur lesquels reposera désormais la législation douanière de l'Angleterre, ne valent-ils pas bien les maximes économiques de M. de Bourrienne?
Lorsque l'expérience du régime prohibitif d'une part, de la liberté commerciale de l'autre, aura prononcé de manière à rendre toute hésitation impossible entre les deux régimes, lorsque les tarifs fiscaux auront partout pris la place des tarifs protecteurs, les voies du commerce international seront débarrassées du principal obstacle qui les obstrue encore, et la prospérité des nations s'en trouvera favorisée, comme elle l'est chaque fois qu'un progrès nouveau intervient pour faciliter le rapprochement des hommes et l'échange de leurs produits.
G. de Molinari.
Endnotes to Tarif
[182] Le tarif turc est extrêmement libéral. Les prohibitions et les droits prohibitifs sont inconnus en Turquie; les marchandises étrangères y sont soumises, depuis 1838, à un droit uniforme de 5 pour 100 qui se décompose ainsi : 3 pour 100 pour le droit d'entrée proprement dit, et 2 pour de droit supplémentaire au sortir de la douane, en remplacement des anciens droits de circulation à l'intérieur. Les produits nationaux payent à la sortie un droit de 12 pour 100, dont 9 pour 100 à l'arrivée des marchandises à l'échelle où elles doivent être embarquées, et 3 pour 100 lors de l'embarquement. Ces 12 pour 100, dit M. Ubicini (Lettres sur la Turquie), sont destinés à remplacer d'abord l'impôt foncier, qui n'existe pas en Turquie, ensuite les droits multiples et sans cesse variables auxquels les marchandises étaient soumises autrefois, quand le monopole n'en interdisait pas absolument l'achat et l'exportation. Le commerce européen n'a pas manqué de profiler largement d'un régime si libéral. Ainsi les exportations de l'Angleterre dans l'empire Ottoman, qui n'étaient que de 1,440,592 livres en 1840, se sont élevées à 3,548,959 livres en 1851, c'est-à-dire aune somme triple de celle de ses exportations en Russie (1,372,000 livres), et de quatre à cinq fois plus considérable que celle de ses exportations en Autriche (812,942 livres). La Turquie est aujourd'hui, grâce au libéralisme éclairé de sa législation douanière, un marché de premier ordre pour les autres nations.
[183] Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur,* 2e édition, p. 171 et 172.
[184] Annuaire de l’Économie politique et de la statistique pour 1847, page 307.
[185] Jos. Garnier, Annuaire de l'Économie politique, page 308.
[186] Études sur les forces productives de la Russie, par M. L. de Tégoborski, conseiller privé et membre du conseil de l'empire de Russie. T. 11, p. 198.
[187] Ibid. T. I, p. 299.
Théâtres↩
Source
“Théâtres,” DEP, T. 2, pp. 731-33.
[731]
Nous n'avons à nous occuper des théâtres qu'au point de vue de la réglementation particulière à laquelle ils se trouvent soumis. Cette réglementation est des plus compliquées. En France, elle peut se résumer de la manière suivante : 1° Le nombre des entreprises dramatiques est limité ; il faut un privilège pour établir un théâtre ; 2° des subventions sont accordées à certaines entreprises dramatiques, soit aux frais des contribuables, soit aux dépens des autres entreprises de même nature; 3° un impôt spécial est prélevé sur les théâtres; 4° les pièces de théâtre sont soumises à la censure.
Ce régime ultra-réglementaire date en France de l'origine même des théâtres, mais c'est sous Louis XIV qu'il s'est régularisé et qu'il a pris ses allures les plus tyranniques. Ainsi Louis XIV, ayant réuni, sous le titre de Comédie-Française, les deux troupes qui étaient sorties de l'Hôtel de Bourgogne, accorda à cette entreprise, privilégiée en quelque sorte, un droit de vie et de mort sur les entreprises rivales. Celles-ci furent obligées de soumettre leurs pièces à sa censure, et la Comédie-Française, considérant combien la concurrence était chose pernicieuse, ne manqua point d'user et d'abuser du pouvoir autocratique dont on l'avait gratifiée. Elle alla jusqu'il interdire la parole à ses concurrents, en ne leur laissant que la pantomime. Mais les théâtres qu'elle opprimait inventèrent mille ruses plus ingénieuses les [732] unes que les autres pour éluder ses défenses. Tantôt on écrivait sur des paravents mobiles le dialogue que les acteurs ne pouvaient débiter; tantôt on chargeait le parterre lui-même de réciter la prose et de chanter les couplets, pendant que les acteurs faisaient les gestes. Le public accourait en foule, et l'entreprise privilégiée ne recueillait aucun fruit de son système de petites vexations.
L'Opéra, dont le privilège fut concédé au musicien Lulli, ne fut guère moins favorisé que la Comédie-Française. On lui accorda non seulement le privilège exclusif de jouer des opéras et des ballets, mais encore le privilège bien plus exorbitant de taxer les autres théâtres à son profit. En outre, il put s'emparer d'autorité des acteurs de ces théâtres. La puissance paternelle même dut céder devant un engagement contracté avec l'Opéra par un mineur.
Ce régime oppressif dura jusqu'à la révolution française. Une loi des 13-19 janvier 1791 établit alors la liberté des théâtres; mais cette liberté, après avoir provoqué la formation d'un grand nombre d'entreprises dramatiques, en dépit de la crise révolutionnaire, fut de nouveau supprimée sous l'empire. Le 8 juin 1806, un décret fut rendu par lequel le régime du privilège était substitué à la liberté des théâtres et la censure rétablie. Un autre décret réduisit à huit le nombre des théâtres de Paris, et organisa à peu près sur le modèle des escouades de gendarmerie les troupes des départements. « Tous les théâtres non autorisés, y lisons-nous, seront fermés avant le 15 août. En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce sur d'autres théâtres dans notre bonne ville de Paris que ceux désignés, sous aucun prétexte, ni y admettre le public, même gratuitement, faire aucune affiche, etc. » Le décret portait encore qu'aucune salle nouvelle ne pourrait être construite, aucun déplacement de troupe opéré dans Paris sans l'autorisation spéciale de Sa Majesté Impériale. Chaque théâtre eut son genre particulier dans les limites duquel il se trouva rigoureusement confiné. Le Théâtre-Français, par exemple, eut le privilège exclusif des pièces en vers nobles ou alexandrins. Les ballets sérieux furent attribués à l'Opéra, les ballets légers à la Porte-Saint-Martin. L'Opéra partagea encore avec l'Opéra-Comique le privilège de faire entendre des airs nouveaux ; les scènes de second ordre durent se contenter des airs connus. Ce régime, complété en 1812 par un décret daté de Moscou, qui donnait à la Comédie-Française une charte particulière, s'est maintenu, avec de légères modifications, jusqu'à nos jours. Examinons quels en ont été les résultats au double point de vue du producteur et du consommateur.
Sans doute, la limitation du nombre des entreprises dramatiques peut être, dans une certaine mesure, avantageuse aux entrepreneurs privilégiés; mais cet avantage a été rendu à peu près illusoire par la multiplication du nombre des privilèges et par des charges dont on a accablé les concessionnaires. A Paris, le nombre des théâtres, après avoir été réduit à huit en 1806, est remonté à vingt-cinq dans ces dernières années. La situation des entrepreneurs est donc devenue de moins en moins favorable, et cependant ils ont continué de subir des conditions fort onéreuses pour obtenir ou conserver leurs privilèges. L'état de dépendance où ils se trouvent vis-à-vis de l'administration les a obligés à multiplier les billets de faveur, c'est-à-dire à céder gratis une partie de leurs marchandises aux personnes dont l'influence peut leur être utile. La délimitation des genres, l'obligation de ne jouer que des pièces d'une certaine catégorie, et de les jouer en toute saison, même pendant la canicule, ont contribué encore à diminuer leurs chances de bénéfices. Tout compte fait, la liberté pure et simple leur serait évidemment plus profitable Si l’on veut, du reste, en avoir la preuve, on n'a qu'à consulter les archives du tribunal de commerce. On y trouvera qu'aucune industrie de concurrence ne compte autant de faillites que l'industrie privilégiée des théâtres. Au point de vue des intérêts du public consommateur, le régime du privilège est moins avantageux encore. Sans parler du renchérissement artificiel du plaisir du spectacle, qui est la conséquence de ce régime, les entraves apportées à la liberté des théâtres retardent les progrès de l'art dramatique, comme les entraves des corporations et des jurandes faisaient obstacle jadis aux progrès de l'industrie.
Les subventions accordées à certaines entreprises dramatiques sont de diverses sortes. Tantôt on alloue à un théâtre une subvention prise dans le trésor public; tantôt on lui accorde gratuitement l'usage d'une salle de spectacle ; tantôt enfin on taxe à son profit des entreprises du même genre. On a coutume de justifier ces subventions en prétendant que le gouvernement est tenu d'encourager les beaux-arts et d'en maintenir les bonnes traditions. On affirme que le goût public ne manquerait pas de se corrompre, si le gouvernement négligeait de subventionner certains établissements dramatiques, nécessaires, assure-t-on, pour conserver ce goût essentiellement corruptible. Mais, s'il en était ainsi, la tâche du gouvernement ne devrait-elle pas être singulièrement étendue? Ce n'est pas seulement le théâtre qui exerce une influence sur le goût public, c'est l'ensemble des beaux-arts et des industries dites d'art, telles que celles qui pourvoient à l'ameublement, aux vêtements, etc. Les ameublements et les costumes se modifient sans cesse, et quelquefois c'est d'une manière peu conforme aux règles de l'esthétique. Ainsi, par exemple, les ameublements et les costumes de l'époque du directoire et de l'empire sont d'un goût moins pur que ceux du siècle de Louis XIV. Le gouvernement, conservateur du goût public, n'aurait-il pas dû intervenir aussi pour empêcher cette dégénérescence de la mode? N'aurait-il pas dû subventionner des tailleurs et des modistes, voire même des fabricants de perruques, pour perpétuer, en dépit des écarts du goût, la saine tradition des modes du grand siècle? Eût-ce été plus déraisonnable que de subventionner un théâtre pour jouer trop souvent pour les banquettes des pièces de cette époque?
Mais peut-on admettre que le goût du gouvernement vaille mieux que celui du reste de la société? L'administration se compose-t-elle d’êtres [733] d’une essence supérieure, dont les arrêts soient infaillibles en matière de goût comme en toute autre matière? Non, les partisans les plus fanatiques du principe d’autorité eux-mêmes n'oseraient l'affirmer. Cependant, si cette infaillibilité n'existe point, si l'administration n'a point l’aptitude nécessaire pour diriger le goût public à l’avantage de la communauté, en quoi le régime des subventions peut-il se justifier? En quoi peut-il être juste de taxer les paysans de la Bretagne et de la Gascogne pour subventionner les théâtres de Paris? Quels services ces dignes campagnards qui de leur vie ne mettent les pieds dans une salle de spectacle reçoivent-ils en échange de cette portion de leurs charges? Dans les villes où les municipalités prelèvent sur le produit de l'octroi et des autres impôts locaux la subvention du théâtre, l'injustice n'est-elle pas tout aussi flagrante? N'impose-t-on pas le nécessaire de tous pour satisfaire un besoin de luxe de la classe la plus aisée? Enfin est-il bien équitable de taxer certaines entreprises dramatiques, les spectacles forains, par exemple, au profit des entrepreneurs privilégiés des grandes villes? N'est-ce pas comme si l'on taxait les fabricants de faïence et de poterie commune, au profit de la manufacture de Sèvres et des fabriques de porcelaine superfine? N'est-ce pas, pour tout dire, de la spoliation pure?
Tandis que l'on privilégie et que l'on subventionne, d'une main, les entreprises dramatiques, apparemment pour aider à leur prospérité, on appesantit sur elles, de l'autre main, le fardeau de l’impôt. Eu France, l'impôt sur les théâtres est fixé au dixième de la recette brute, et il est perçu au profit des hospices. On taxe donc les contribuables par les subventions, et le public par les privilèges, pour finir par taxer les théâtres eux-mêmes. Cette cascade d'impôts est-elle bien conforme aux lois d'une saine économie?
Une dernière entrave à la liberté des théâtres résulte de l'établissement de la censure. Cette institution ayant principalement un caractère moral et politique, nous n'avons pas à l'apprécier ici. Cependant, qu'il s'agisse de théâtre ou de tout autre industrie, la police répressive n'est-elle pas préférable à la police préventive? Si l'administration s'avisait d'obliger les industriels et les négociants à soumettre leurs marchandises à son examen ; si elle les conservait dans ses magasins pendant des mois entiers; si encore elle refusait son visa à certains aliments et à certains vêtements , sous le prétexte qu'ils sont, ceux-là trop épicés, ceux-ci en désaccord avec les modes établies, ne trouverait-on pas insupportable cette police préventive? Les industries qui auraient à subir ses lenteurs et ses caprices ne tomberaient-elles pas dans une irrémédiable langueur? Or n'est-ce point là le sort qui est fait à l'industrie des auteurs dramatiques? Au simple point de vue économique, une police répressive qui leur épargnerait les lenteurs et les caprices de la censure, tout en faisant justice des œuvres dangereuses et malsaines, ne serait-elle pas préférable?
Le résultat définitif de la réglementation compliquée à laquelle on soumet encore à peu près partout l'industrie des théâtres, des charges dont on l'accable et des laveurs dont on la gratifie, c’est de ralentir son développement naturel. Le plaisir du spectacle est généralement devenu de plus en plus cher au lieu de baisser de prix, et, quoique le théâtre ait à son service, plus qu'aucune branche de la production, des intelligences ouvertes et actives, il n'est aucune industrie dont les transformations progressives soient plus lentes. C'est qu'en toutes choses le privilège engendre la cherté et la routine, tandis que la concurrence amène le bon marché et le progrès.
G. de Molinari.
BIBLIOGRAPHIE.
De la législation des théâtres, par MM, Vivien et Ed. Blanc. 1 vol. in-8.
Études administratives, par M. Vivien. 2 vol. gr. in-18.
Enquête sur les théâtres, dressée en1849 par le conseil d'État. 1 vol. in-4.
La question de la liberté des théâtres était alors agitée, et un projet de loi soumis au conseil d'État. La commission, formée au sein du conseil pour examiner ce projet de loi, voulut connaître l'opinion des intéressés. Six séances furent consacrées par elle à entendre trente et une personnes, parmi lesquelles on comptait onze auteurs dramatiques ou compositeurs, trois critiques, huit artistes dramatiques, sept directeurs de théâtres, deux anciens censeurs. Nous citerons parmi les personnes entendues MM. J. Janin, Théophile Gautier, Rolle, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Nestor Roqueplan, Hostein, Provost, Régnier, Bocage. Deux questions leur furent principalement soumises, celle de la liberté des théâtres et celle de la censure. Les opinions restrictives et interventionnistes eurent le dessus. M. Hoslein, directeur du Théâtre-Historique et de la Gaîté, défendit presque seul, par de bons arguments, la cause de la liberté des théâtres. Journal des Economistes. Trois articles de M. G. de Molinari, sur l'industrie des théâtres, t, XXIV, p. 12 et p. 342; t XXVI, p. 130; et deux articles sur l'Histoire et la statistique des théâtres de Paris, par M. Natalis Rondot, t. XXXI, p. 271 et 386. Ces deux derniers articles résument et complètent les renseignements sur les théâtres contenus dans la grande statistique de l'industrie à Paris, dressée par les soins de la chambre de commerce.
Travail↩
Source
“Travail” DEP, T. 2, pp. 761-64.
[761]
Le travail consiste dans l'application des facultés de l’homme à la production. J.-B. Say le définit ainsi ;
« L’action suivie à laquelle on se livre pour exécuter une des opérations de l'industrie, ou seulement une partie de ces opérations.—Quelle que soit, ajoute-t-il, celle des opérations à laquelle le travail s'applique, il est productif, puisqu'il concourt à la création d'un produit. Ainsi le travail du savant qui fait des expériences et des livres est productif; le travail de l'entrepreneur, bien qu'il ne mette pas immédiatement la main à l'œuvre , est productif ; enfin le travail du manouvrier, depuis le journalier qui bêche la terre jusqu'au matelot qui manœuvre un navire, est encore productif. » [188]
Toutes les opérations de la production exigent, dans une proportion plus ou moins considérable, le concours du travail. II importe donc de bien examiner quelle est la nature de cet agent indispensable, à quelles conditions il peut être mis au service de la production, et dans quelles circonstances il possède un maximum d’efficacité.
La nature du travail est essentiellement diverse. Chaque industrie exige de la part du travailleur la mise en œuvre de facultés particulières. Le manœuvre et le portefaix ne déploient point en travaillant les mêmes facultés que le savant et l'artiste. Ceux-là ne se servent guère que de leur force physique, tandis que ceux-ci travaillent principalement avec leur intelligence. La même diversité s'observe encore dans les fonctions entre lesquelles se partage chaque branche de la production. Dans une manufacture de coton, par exemple, l'ouvrier fileur ou tisserand n'a pas à déployer les mêmes facultés que le mécanicien , le contre-maître ou le directeur. Dans une armée, le soldat n'a pas non plus à déployer les mêmes facultés que le général, etc. En un mot, le travail a sa hiérarchie naturelle. Les fonctions qui lui sont dévolues s'échelonnent, se superposent, se hiérarchisent, en raison du nombre, de l'espèce et de l'étendue des facultés dont elles exigent le concours.
Toutefois cette hiérarchie naturelle du travail n'a rien de fixe. Le progrès industriel agit tous les jours pour la modifier. Voici comment. Le progrès industriel substitue communément à l'emploi de la force physique du travailleur celui d'une force mécanique moins coûteuse et plus puissante. Dans les industries que le progrès transforme, on voit, en conséquence, le travail humain changer successivement de nature : de purement physique à l'origine, du moins dans les fonctions inférieures, il devient de plus en plus intellectuel. Si nous examinons, par exemple, l'industrie de la locomotion à ses différentes périodes de développement, nous serons surpris de l'étendue et de la portée des transformations que le travail dont elle exige le concours a subies sous l'influence du progrès. A l'origine, c'est l'homme lui-même qui transporte les fardeaux en mettant en œuvre sa force musculaire. Il en est encore ainsi dans certaines parties de l'Inde, où les bras et les épaules des coulis sont les seuls véhicules en usage pour transporter les voyageurs aussi bien que les marchandises. Mais l'industrie de la locomotion vient à progresser. L’homme dompte le cheval, l'âne, le chameau, l'éléphant, et il les assujettit à porter des fardeaux; il invente encore la charrette, la voiture et le navire. Aussitôt la nature du travail recquis pour le transport des hommes et des marchandises se modifie. La force musculaire ne suffît plus, elle ne joue même plus qu'un rôle secondaire dans l'industrie des transports; le premier rôle appartient désormais à l'adresse et à l'intelligence. Il faut plus d'adresse et d'intelligence que de force musculaire pour guider un cheval, un âne, un chameau, un éléphant, pour conduire une voiture ou une charrette, pour diriger un navire. Survient enfin un dernier progrès. La vapeur est appliquée à la locomotion. La locomotive, avec ses longues files de wagons, se substitue au cheval, à la charrette, à la diligence; le bateau à vapeur prend la place du navire à voiles. La fonction du travailleur dans l'industrie des transports acquiert, par suite de cette nouvelle transformation, un caractère intellectuel plus prononcé. Les employés des chemins de fer ont à déployer plus d'intelligence et moins de forcé physique que les voituriers , messagers, etc., qu'ils ont remplacés. Dans l'industrie des transports par eau, l'intervention de la vapeur supprime l'outillage humain qui était employé à manœuvrer l'appareil moteur des navires, les mâts, les voiles, les cordages, etc. A cet appareil, qui nécessitait encore l'application d'une certaine quantité de force musculaire, la vapeur substitue une machine dont les servants, chauffeurs ou mécaniciens, n'ont guère à faire œuvre que de leur intelligence.
En examinant donc l'industrie de la locomotion à son point de départ et à son dernier point d'arrivée, on s'aperçoit que la proportion dans laquelle elle réclame le concours de la force musculaire et de la force intellectuelle de l'homme s'est progressivement modifiée, et que la dernière a fini par s'y substituer presque entièrement à la première. On obtient le même résultat en étudiant l'action du progrès industriel sur les autres branches de la production, et l'on arrive ainsi à cette conclusion importante, que l'industrie moderne exige dans une proportion moindre que celle des premiers âges du monde l'intervention de la force musculaire de l'homme, mais qu'elle réclame, en revanche, à un bien plus haut degré le concours de ses facultés intellectuelles et morales.
Or la nature du travail exerce une influence déterminante sur les conditions auxquelles il peut être mis au service de l'industrie. Ainsi, par exemple, la rémunération du simple manœuvre, qui ne déploie guère que de la force musculaire, et qui n'a pas besoin d'en déployer d'autre, figura au bas de l'échelle des salaires, parce que l'entretien nécessaire du manœuvre se réduit à fort peu de chose. Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'une fonction qui exige le concours des facultés intellectuelles du travailleur, les frais d'entretien nécessaires de celui-ci, en d'autres termes les frais de production de son travail, s'élèvent beaucoup plus haut. Il lui faut une alimentation plus [762] raffinée, un entretien plus complet, sinon les facultés qu'il met en œuvre ne tardent point à dépérir. Les anciens avaient bien compris cette nécessité, et ils s'y conformaient dans la manière dont ils traitaient leurs esclaves : ils nourrissaient, habillaient et logeaient mieux ceux qui avaient des occupations intellectuelles que ceux qui étaient voués au labeur matériel ; ils leur imposaient aussi des tâches moins lourdes, quoique les lois, les mœurs et l'opinion n'établissent aucune distinction entre les diverses catégories d'esclaves : c'est que l'expérience leur avait appris qu'un esclave ne pouvait faire œuvre de son intelligence d'une manière régulière et continue, à moins d'être mieux entretenu et plus ménagé que s'il avait eu à déployer seulement de la forcé musculaire.
Cette inégalité s’augmente encore de celle des frais de renouvellement des travailleurs, selon les professions qu'ils sont appelés à exercer. Les frais d'éducation et d'apprentissage, qui sont à peu près nuls pour les travailleurs voués au labeur physique, s'élèvent, en revanche, fort haut pour les avocats, lés médecins, les prêtres, les administrateurs, les magistrats, les ingénieurs, etc. Le métier d'avocat, par exemple, exige un apprentissage long et coûteux. On a beau être pourvu d'une dose convenable d'éloquence naturelle et des autres facultés nécessaires pour réussir au barreau, cela ne suffit point. Ces dispositions naturelles, il faut d'abord les développer d'une manière générale; il faut ensuite s'assimiler les connaissances et les pratiques du métier ; il faut étudier la jurisprudence et la manière de s'en servir. Sans doute le programme de ces études préliminaires a été chargé outre mesure : on oblige l'étudiant en droit à encombrer son intelligence d'une foule de connaissances inutiles. Mais en admettant même que les frais d'apprentissage de l'avocat fussent ramenés aux proportions du strict nécessaire, ils n'en demeureraient pas moins plus élevés que ceux du tailleur ou du maçon, et, à plus forte raison, que ceux du portefaix ou du valet de charrue.
Ainsi donc les conditions auxquelles le travail peut être appliqué à la production se différencient, premièrement, en raison de la diversité et de l'inégalité des forces ou facultés requises dans les différentes opérations de l'industrie et des réparations qu'elles exigent ; secondement, en raison de la diversité et de l'inégalité des frais de renouvellement des travailleurs.
Si l'homme était immortel, ces frais d'élève et d'apprentissage des travailleurs n'exerceraient évidemment qu'une influencé inappréciable sur la rémunération du travail, repartis, comme ils le seraient, sur une période d’une étendue infinie. Mais il n'en est pas ainsi : le matériel humain de la production doit être régulièrement renouvelé, et la période de son renouvellement varie selon les industries et selon les pays. Dans les Industries malsaines, par exemple, l'outillage humain doit être renouvelé beaucoup plus fréquemment que dans les autres. La fabrication du blanc de céruse, pour né citer que celle-là, consomme en un siècle deux ou trois générations de plus que les industries ordinaires ; d'où il résulte que la rémunération de ses travailleurs doit comprendre les frais d'élève et d'apprentissage de ces générations supplémentaires. La même observation s'applique à l'ensemble des industries d'un pays malsain. Les contrées où les maladies contagieuses, la peste, la fièvre jaune, la malaria, étendent habituellement leurs ravages, se trouvent, sous l'influence de cette cause, dans des conditions de production peu favorables. Non-seulement le matériel humain doit y être renouvelé très fréquemment, mais encore ce matériel se trouve chaque jour entamé, décomplété dans ses parties essentielles, sans qu'il soit possible de combler immédiatement les vides causés par la contagion.
Les progrès qui améliorent les conditions hygiéniques de la production, qui préviennent les accidents auxquels les travailleurs sont exposés, etc., ont, en conséquence, une grande importance économique. On attache avec raison beaucoup de prix aux procédés qui augmentent la durée des outils, des machines, des bâtiments; qui préservent des maladies contagieuses et des autres causes accidentelles de destruction les animaux et les végétaux utiles ; mais ceux qui augmentent la durée de l’homme considéré comme agent de la production, permettant ainsi aux générations existantes d'économiser une partie des frais d'élève et d'apprentissage des générations nécessaires pour les remplacer, ceux-là ne méritent point, certes, à un degré moindre l'attention de l'Économiste.
D'autres causes agissent encore pour rendre diverses et inégales les conditions auxquelles le travail peut être appliqué à la production. On les trouvera énumérées au mot Salaire. Mais celles que nous avons exposées suffisent déjà, croyons-nous, pour démontrer toute l'absurdité de la théorie communiste qui établit l’égalité dans la rémunération du travail. Cette égalité ne serait possible qu'aux deux conditions suivantes : l° si toutes les opérations de la production exigeaient l'application de forces de même nature et parfaitement égales; 2° si le matériel humain avait toujours et partout la même durée. Alors on concevrait que les travailleurs pussent être soumis au régime de l'égalité des salaires, de même que l'on conçoit que des machines de tout point semblables soient soumises à celui de l'égalité des frais d'entretien. Mais si, comme l'observation l'atteste, les fonctions de la production sont essentiellement diverses et inégales; si les unes peuvent être accomplies à l'aide d'un outil humain simple et grossier, tandis que les autres exigent l'emploi d'un outil humain compliqué et perfectionné, l'égalité des salaires n'est-elle pas en opposition avec la nature même des choses? Vouloir donner à un portefaix et à un directeur de chemin de fer, par exemple, une rémunération égale, ne serait-ce pas aussi absurde, aussi contraire à la nature des choses, que de vouloir consacrer la même somme aux frais d'entretien et de renouvellement de la locomotive et à ceux du cheval de trait?
A la vérité, il y a dans le progrès industriel une certaine tendance à l'égalité. Le progrès industriel élève, ainsi que nous l'avons remarqué, le niveau général des fonctions de la production, et par conséquent diminue la distance qui existe [763] entre les plus hautes et les plus basses ; mais la hiérarchie des fonctions ne s’efface point pour cela. Il y a toujours, dans les industries les plus perfectionnées, des fonctions qui évident des facultés supérieures; il y en a toujours aussi qui usent plus promptement que les autres les travailleurs ainsi que les machines, et ces inégalités, qui tiennent à la nature des choses, doivent nécessairement se reproduire dans les salaires. Il n'en est pas moins consolant de penser que tout progrès industriel implique une modification progressive dans la nature des forces humaines dont le concours est exigé pour la production, et que cette modification en amène une autre qui correspond à celle-là dans le niveau de la rémunération du travail.
Maintenant que nous avons examiné à quelles conditions le travail peut être mis d'une manière régulière et continue au service de la production; que nous avons constaté que ces conditions sont essentiellement diverses et qu'elles se modifient chaque jour sous l'influence du progrès, recherchons dans quelles circonstances le travail a le plus d'efficacité ou de puissance.
La situation la plus favorable à cet égard est celle dans laquelle le travailleur peut toujours choisir librement une occupation conforme à ses aptitudes ; dans laquelle aussi il a un maximum d'intérêt à bien travailler. Cette situation ne se rencontre point, par exemple, sous le régime des castes ou des professions privilégiées. Le travailleur n'ayant point, sous ce régime, la liberté de choisir la profession qui convient le mieux à ses aptitudes, il arrive fréquemment que les fonctions les plus importantes de la société sont mal remplies, tandis que des facultés précieuses demeurent inactives dans la masse de la population. Le même fait se produit sous le régime de l'esclavage et du servage. Cependant les propriétaires d'esclaves ou de serfs, ayant intérêt à exploiter ce capital humain de la manière la plus profitable, s'attachent parfois à reconnaître les aptitudes de leurs esclaves ou de leurs serfs, à les cultiver et à les appliquer à la destination la plus conforme à leur nature, afin d'augmenter le revenu qu'ils en tirent. C'est ainsi que, dans l'antiquité, on voyait des maîtres faire donner à ceux de leurs esclaves qui montraient le plus d'intelligence une éducation artistique ou littéraire, afin d'en tirer parti ensuite comme peintres, grammairiens, etc. C'est ainsi encore qu'en Russie les seigneurs laissent communément leurs serfs libres d'embrasser la profession qu'ils sont le plus aptes à remplir, en vue d'obtenir d'eux un maximum d'obroc (voyez Servage). Quelquefois même, ils s'appliquent à découvrir leurs aptitudes naturelles comme on fait pour un sol vierge, et ils leur avancent les sommes nécessaires pour les développer et les faire valoir. M. de Haxthausen cite plusieurs exemples intéressants de cette bonne pratique économique, dans ses Études sur la Russie. [189]
Il semble donc que l’esclavage et Ie servage entravent à un moindre degré que le régime des castes ou des professions privilégiées la distribution utile du travail.
Au point de vue du stimulant nécessaire au travailleur pour développer toute son activité, l'un et l'autre régime apparaissent comme également vicieux, mais par des causes différentes. Sous le régime des castes et des professions privilégiées, le travailleur s'abandonne volontiers à la paresse et à l'incurie, faute du stimulant de la concurrence; sous le régime de l'esclavage et du servage, il ne travaille qu'avec répugnance faute du stimulant de l'intérêt, à moins que le [764] maître ne consente à lui laisser une large part des fruits de son labeur.
C'est seulement lorsque le travailleur se trouve placé sous l'aiguillon de la concurrence, et qu'il peut disposer pour lui même de tout le produit de son travail, qu'il est excité à fournir la plus grande quantité et la meilleure qualité de travail. Or cette situation ne peut se présenter que sous un régime d'entière liberté du travail et du commerce (voyez ces mots); c'est donc à la liberté qu'il faut recourir, ainsi que M. Dunoyer l'a démontré d'une manière si remarquable, pour donner au travail son maximum d'efficacité ou de puissance.
La production du travail et sa distribution utile, dans l'immense arène ouverte à l'activité humaine, peuvent donner lieu encore à des considérations intéressantes. Le travail est une matière première nécessaire à toutes les industries, mais dans de certaines proportions déterminées par la nature des choses. Cette matière première ne peut, en conséquence, être produite en quantité illimitée, puisque le concours des autres agents productifs, capitaux et agents naturels appropriés, est indispensable pour l'utiliser. De là la nécessité de limiter la population, afin de ne pas encombrer le marché de travail (voyez Population). De là encore la nécessité de laisser la distribution du travail s'opérer librement, de manière à pourvoir le mieux possible aux besoins de la production (voyez Émigration).
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les gouvernements n'ont pas plus à intervenir dans le placement de cette matière première que dans celui de toute autre denrée, et il a été démontré ailleurs qu'ils poursuivent la plus coûteuse et la plus décevante des chimères en s'efforçant de protéger le travail national (voyez Liberté du Commerce).
G. de Molinari.
Endnotes to Travail
[188] Traité d'Economie politique, liv. l, chap. vii.
[189] Nous en citerons deux qui ont un certain cachet d’originalité, l'un concernant la troupe des comédiens de Nijni-Novgorod, l'autre un barbier de la ville de Pensa.
« Je ne pus me défendre d'une extrême surprise en apprenant à Nijni-Novgorod (dit M. Haxthausen) que tout le personnel du théâtre, acteurs, chanteurs et chanteuses, étaient des serfs appartenant à un seigneur. Je ne saurais dire quelle impression bizarre firent sur moi ces paroles. La prima donna, actrice choyée du public, habituée aux applaudissements et aux triomphes, était fille d'un pauvre paysan soumis à l'autorité d'un maître; les acteurs qui avaient rempli le rôle de prince, de boyard et de héros, étaient également de pauvres hères, fils de serfs attachés à la glèbe seigneuriale. Quel singulier contraste ne devaient-ils pus trouver entre ce rôle momentané et leur situation habituelle, entre l'oubli produit par l'inspiration artistique et le sentiment de leur véritable condition? Pour avoir le droit d'être acteurs, pour exercer le plus libre, le plus indépendant de tous les arts, ils étaient obligés de payer à leur seigneur un obroc, comme on l'exige pour, un métier, d'acquitter ponctuellement une, dîme prélevée sur l'intelligence.
« Voici l'histoire du théâtre de Nijni-Novgorod. Il y a quelques années, un seigneur célibataire fit construire dans sa terre une salle de spectacle, et fit parmi ses serfs choix d'un certain nombre d'individus propres à devenir musiciens ou acteurs. Plus tard, lorsque leur éducation fut terminée, il fit monter plusieurs opéras et finit par venir s'établir à Nijni-Novgorod, où il fit aussi bâtir un théâtre. Au commencement, il n'engagea, au moyen des cartes d'invitation, que ses amis et ses connaissances; mais plus tard, quand l'état déplorable de sa fortune entamée par ses grandes dépenses l'obligea à mettre plus d'ordre dans ses affaires, il se décida à se faire payer les billets d'entrée et à devenir simplement entrepreneur ou directeur d'une troupe de comédiens. Après sa mort, il fut remplacé par un autre directeur, et actuellement, comme on me l’a assuré, c’est encore un seigneur qui se trouve à la tête de cette entreprise. »
Voici l'autre exemple :
« ... Étant retourné à l'hôtel où j'étais descendu, à Pensa, je dis au maître de la maison, un Allemand, de m’enyoyer un barbier. Quelques minutes après, je vois entrer un jeune homme bien mis, d'une tournure convenable, et qui me rasa avec une aisance toute française. C'était toutefois un paysan russe à qui le seigneur de son village avait fait apprendre le métier de Figaro, en payant, outre la nourriture, 350 roubles pour trois années d'apprentissage. Après ce temps, il l'avait mis à l'obroc. Le jeune homme s'en trouve bien. Il gagne, et au delà, les 175 roubles qu'il doit payer en obroc, puis il s'amuse, va au théâtre et joue au dandy ni mieux ni plus mal qu'un de ses frères du boulevard des Italiens. »
Études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie, par le baron Aug. de Haxthausen. T. l, p. 271; et t. II, p. 65.
Dans l'un et l'autre cas, la redevance ou l'obroc payé par le serf comprenait, outre l'impôt ordinaire, un intérêt avec amortissement pour le capital que le seigneur avait consacré au développement des aptitudes du serf.
Union douanière↩
Source
“Union douanière”, DEP, T. 2, p. 788-89.
[788]
Les unions douanières sont, ainsi que leur nom l'indique, des associations qui réunissent sous un tarif commun, en supprimant toute barrière intermédiaire, des provinces ou des pays auparavant soumis à des tarifs particuliers. Les motifs qui déterminent leur formation sont politiques, économiques ou financiers. Nous n'avons pas à nous occuper ici des premiers. Au point de vue économique, l'avantage des unions douanières réside surtout dans l'agrandissement du marché. Cet avantage a acquis une importance notable depuis que les progrès de la locomotion, s'ajoutant à ceux de la sécurité, ont permis de transporter au loin les denrées les plus lourdes et les plus encombrantes, depuis encore que la transformation progressive de l'outillage industriel a nécessité une extension correspondante dans les débouchés de la production. Il peut arriver cependant qu'une union douanière ne constitue point un progrès économique. Si, par exemple, en réunissant commercialement deux pays dont l'un jouit d'une législation douanière libérale, tandis que l'autre est assujetti aux entraves de la prohibition, on fait prédominer le régime prohibitif dans le tarif commun, il se pourra que l'augmentation du niveau des droits balance et au delà l'extension des limites douanières. Mieux aurait valu alors, dans l'intérêt même du développement de la production, ne point conclure d'union.
Au point de vue financier, les unions douanières ont communément pour avantage d'accroître les recettes du fisc tout en allégeant le fardeau des contribuables. Ce résultat s'explique aisément. Les barrières douanières trop multipliées font obstacle au développement des échanges. En outre, elles nécessitent des frais de perception considérables. Il se peut donc qu'en diminuant l'étendue des lignes douanières, on multiplie les échanges et l'on réduise les frais de perception de manière à retrouver, et au delà, le produit des lignes supprimées. Ou ne saurait affirmer toutefois qu'une union douanière doive être nécessairement une bonne affaire, au point de vue financier. De même que le fisc perd à la trop grande multiplication des lignes douanières, il peut perdre à une trop grande réduction de leur nombre. Supposons , par exemple, que l'Europe entière ne forme puisqu'une union douanière, il est évident que les recettes qui seront perçues à ses frontières n'équivaudront point à celles qui sont prélevées sous le régime actuel, malgré l'imperfection de ce régime. Comme il y a un taux fiscal auquel il faut fixer le droit pour en obtenir un maximum de produits, il y a aussi une limite fiscale où il faut poser la barrière douanière, en vue du même résultat. Ce taux et cette limite ne peuvent guère être découverts que par la voie de l'expérience. Mais on conçoit que les limites politiques des États n'en soient point ou n'en soient que par hasard et par exception les limites fiscales. En effet, comme nous l'avons remarqué ailleurs (voyez Liberté du commerce), les convenances économiques et financières des peuples ont été rarement consultées dans la grande affaire de la délimitation des États. On a eu bien plutôt égard aux convenances des familles princières ou à l'influence dont elles jouissaient. Les alliances matrimoniales et les hasards de la guerre ont encore contribué pour une large part à l'établissement des délimitations actuelles. Si donc les limites politiques de certains États se confondaient avec leurs limites fiscales, ce serait un pur hasard, et il n'est pas probable que ce hasard se soit rencontré souvent. Cela étant, il y a lieu évidemment de corriger par des associations douanières ce que les délimitations politiques ont de défectueux au point de vue des intérêts économiques et financiers des nations.
Plusieurs unions douanières ont été constituées depuis la fin du siècle dernier. Sans parler de la réunion douanière des provinces de France , accomplie par l'assemblée constituante, et dont il a été fait mention ailleurs (voyez Douane et Tarif), on peut citer l'union de l'Angleterre avec l'Irlande, l'association des douanes allemandes et l'union toute récente de la Russie avec la Pologne.
L'union douanière de l'Angleterre et de l'Irlande a été commencée en 1782, mais elle n'a été complétée que vers 1820, après avoir rencontré les résistances les plus opiniâtres de la part des manufacturiers et des agriculteurs anglais. « Une réforme qui mettrait l'Angleterre et l'Irlande sur le pied de l'égalité, disaient les prohibitionnistes du temps, serait fatale aux manufactures et au commerce de l'Angleterre ... Nos manufacturiers, nos négociants, nos armateurs, nos propriétaires de terres ont pris l'alarme, car tous comprennent qu'ils seront infailliblement ruinés si nous les exposons à la concurrence d'un pays à peu près sans dettes. » Des pétitions contre l'union arrivaient de tous les points du royaume. Les négociants de Glascow suppliaient le parlement de n'accorder à l'Irlande, soit dans le présent, soit dans l'avenir, aucun avantage qui pût tourner au détriment do la Grande-Bretagne. Manchester réprouvait énergiquement les concessions proposées, et Liverpool n'hésitait pas à [789] déclarer que, si ces concessions étaient accordées, son port ne tarderait pas à être réduit à sa primitive insignifiance. L'union s'opéra cependant, et Glascow, Manchester et Liverpool ne cessèrent point de voir s'accroître leur prospérité. [190]
L'association des douanes allemandes s'est formée par agrégations successives. (Voyez Zoll-Verein.)
Enfin l'union douanière de la Pologne avec la Russie a été accomplie à dater du 1er janvier 1851. Un nouveau tarif (commun pour les deux États) a été promulgué en même temps. Ce tarif a introduit des réductions assez importantes sur certains droits du tarif russe, et augmenté, en revanche, quelques-uns des droits du tarif polonais.
Avant la révolution de février 1848, la suppression des barrières intérieures se trouvait à l'ordre du jour en Italie. En vertu d'un traité daté du 3 novembre 1847, une union douanière avait été même arrêtée en principe entre les États du saint-siége, le royaume de Sardaigne, la Toscane et Lucques. Des négociations devaient être ouvertes ultérieurement avec le royaume de Naples et le duché de Modène, pour les engager à en faire partie. Malheureusement les événements politiques empêchèrent la réalisation de ce projet si important pour la prospérité future de l'Italie.
Il a été question aussi à diverses reprises, notamment en 1840, d'une union douanière entre la France et la Belgique; mais les influences prohibitionnistes, si actives et si puissantes en France, ont réussi à la faire échouer.
Enfin un plan remarquable de confédération douanière a été proposé par M. Léon Faucher, dans son ouvrage intitulé : l'Union du Midi. Voici un aperçu motivé de ce plan, que nous empruntons à un article de l’Annuaire de l'Économie politique:
« En 1815, les arbitres de l’Europe furent des souverains absolus qui l’organisèrent au gré de leurs passions et selon leurs caprices. Ils partagèrent les peuples comme de vils troupeaux. Le sabre, et non pas le droit, traça les limites. Des lignes de démarcation imaginaires s'élevèrent entre des populations dont l'origine était la même, et entre lesquelles tout était commun. On mit, pour ainsi dire, les montagnes à la place des vallées et les vallées à la place des montagnes. Cet échafaudage contre nature ne pouvait pas être à l'épreuve du temps. La révolution de 1830 a fait une première trouée ; les associations de douanes feront le reste.
« L'Europe sera infailliblement partagée entre plusieurs groupes commerciaux, grandes et puissantes confédérations qui remplaceront les divisions par races. L'Angleterre, la Suède et la Russie, soit à cause de leur position insulaire, soit par l'étendue même de leur territoire, soit par la nature toute spéciale de leur gouvernement, sont condamnées à s'isoler et à se suffire. Les races slaves, qui occupent la Pologne proprement dite, le duché de Posen, la Gallicie, la VoIhynie et la Podolie, sont appelées à combiner leurs intérêts dans une vaste association, à laquelle les convient la communauté de religion, ainsi que l’identité de mœurs et de langage, et qui ne fera que ranimer pour elles le passé de ses cendres. Un autre groupe se formera évidemment sous la direction de l'Autriche, pour embrasser l'Autriche, la Bohème, la Hongrie, la Transylvanie, l’Illyrie, la Moldavie et la Valachie. La Servie, l'Albanie, la Macédoine, l'Épire et la Grèce, y compris les îles, sont destinées à un troisième groupe, que l'esprit entreprenant de la race grecque aura bientôt fait sortir de son obscurité. L'union germanique, déjà forte de 28 millions d'hommes, ne peut pas tarder à s'adjoindre le Danemark, le Hanovre et les villes anséatiques. L'accession ultérieure de la Lombardie et des États vénitiens portera les limites de l'union italienne jusqu'aux Alpes du Tyrol et jusqu'au Tagliamento. Enfin la France est un centre d'attraction autour duquel se grouperont tôt ou tard, simultanément ou successivement, la Hollande, la Belgique, les provinces rhénanes, la Suisse et l'Espagne. » [191]
Nous ignorons si ces diverses associations douanières sont destinées à se constituer un jour; mais en admettant, chose assez probable, que les douanes continuent de subsister pendant longtemps encore, sinon comme un instrument de protection, du moins comme une ressource fiscale, il y a apparence que les gouvernements s'attacheront de plus en plus à résoudre le problème que nous avons indiqué plus haut, savoir de faire rendre à cet impôt un maximum de produits, tout en imposant à l'industrie un minimum de gènes et à la masse des consommateurs un minimum de charges. Or c'est seulement en découvrant le taux fiscal des droits et les limites fiscales de la douane qu'ils réussiront à résoudre ce problème. De là la nécessité pour eux de conclure des unions douanières qui substituent ce qu'on pourrait appeler des frontières économiques aux anciennes frontières politiques des nations.
G. de Molinari.
Endnotes to Union
[190] Journal des Économistes. L'Irlande. Tome XVI, page 314.
[191] Annuaire de l’Économie politique et de la statistique pour 1848. De l’union des douanes italiennes, par M. Léon Faucher. Page 345.
Usure↩
Source
“Usure,” DEP, T. 2, pp. 790-95.
[790]
I. Définition.
L'usure est un délit plus ou moins imaginaire qui consiste, selon certains jurisconsultes et certains théologiens, dans la perception d'un taux d'intérêt supérieur au taux spécifié par la loi ; selon d'autres jurisconsultes et théologiens, auxquels viennent maintenant s'adjoindre des socialistes, dans la perception d'un taux d'intérêt quelconque. Un usurier, selon les premiers, c'est un capitaliste qui prête au-dessus du taux légal; selon les seconds, c'est un capitaliste qui exige un intérêt gros ou mince, qui refuse en un mot de prêter gratis.
II. Historique.
L'histoire du délit ou du péché d'usure et des plus intéressantes. Elle a déjà été esquissée en partie, au mot Intérêt, par l'un de nos savants collaborateurs. Nous nous bornerons à la compléter, en nous abstenant, autant que possible, de rentrer dans le fond de la question, afin d'éviter les redites.
L'opinion hostile au prêt à intérêt remonte à la plus haute antiquité. Moise défendit aux Juifs de tirer aucun intérêt de l'argent qu'ils prêtaient à leurs concitoyens pauvres. Le roi David et les prophètes, parmi lesquels il faut citer Ézéchiel, fulminèrent à diverses reprises l'anathème contre les usuriers. La même opinion hostile au prêt à intérêt se retrouve chez le plus grand nombre des législateurs et des philosophes de l’antiquité païenne. Aristote, par exemple, pose en principe que l'intérêt est une chose contre nature. Caton, Cicéron, Sénèque, Plutarque sont du même avis. Quelqu'un ayant demandé à Caton ce qu'il pensait du prêt à intérêt, il répondit qu'à ses yeux c'était à peu près le même crime de prêter à intérêt et de tuer un homme : Quid fœnerari? Quid hominem occidere. Le christianisme adopta cette opinion, qui était celle des esprits les plus éminents de l'antiquité.
Dans un passage de l'évangile selon saint Luc, Jésus-Christ s'exprime ainsi : « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque service, quel gré vous en saura-t-on, puisque les pécheurs mêmes se prêtent les uns aux autres pour recevoir un pareil avantage?... Prêtez, sans en rien espérer (mutuum date, nihil indè sperantes), et alors votre récompense sera très grande, et vous serez les enfants du Très-Haut. » Selon toute apparence, ce n'était là qu'un simple précepte de charité; mais dès l'origine, il fut interprété d'une manière beaucoup plus rigoureuse. L'Église interdit d'une manière formelle le prêt à intérêt, même à un bas intérêt. Selon ses Pères et ses docteurs, notamment selon saint Thomas, qui s’est beaucoup occupé de cette matière, celui-là est un usurier, et, comme tel, passible de toutes les censures de l'Église, qui exige quelque chose en sus du sort principal, c'est-à-dire de la somme prêtée. Saint Ambroise, Tertullien, saint Basile, saint Jérôme, saint Chrysostome, toutes les grandes autorités de la primitive Église avaient exprimé à cet égard la même opinion que saint Thomas. Les conciles défendirent en outre à diverses reprises le prêt à intérêt en le flétrissant du nom d'usure.
Pendant toute la durée du moyen âge, la prohibition canonique du prêt à intérêt paraît avoir été maintenue sans soulever une bien vive opposition. Ce fut seulement vers l'époque de la renaissance qu'une réaction commença à se produire contre la doctrine établie. Cette réaction fut provoquée par les changements qui s'étaient opérés peu à peu dans la situation économique de l'Europe. L'anarchie qui régnait naguère dans l'intérieur de chaque État avait commencé à faire place à l'ordre ; les guerres étaient devenues moins fréquentes, les communications plus faciles. Toutes les branches de la production s'étaient rapidement développées en conséquence de ces changements, et elles exigeaient des quantités de capitaux de plus en plus considérables. Les capitalistes eussent été fort charmés de leur en fournir; mais ils étaient intimidés par la menace de la damnation éternelle, que l'Église fulminait contre les usuriers. La prohibition canonique de l'intérêt fut alors soumise à un nouvel examen et vigoureusement battue en brèche par les intérêts de plus en plus nombreux qu'elle lésait. Deux camps se formèrent dans l'Église et dans la magistrature : les esprits routiniers et infatués du principe d'autorité soutinrent la vieille doctrine ; les esprits avancés, les partisans du libre examen adoptèrent la nouvelle. Les promoteurs de la réformation se prononcèrent pour la plupart en faveur de la légitimité de l'intérêt, et ce fait, comme le remarque avec raison M. Léon Faucher, donne en partie l'explication de la supériorité industrielle et commerciale des nations protestantes.
Ainsi Calvin déclarait :
« 1° Que, s'il y a de l'usure et une espèce de cruauté d'exiger des intérêts lorsqu'on prête aux pauvres, il n'y en a pas lorsqu'on prête aux riches; 2° que l'usure n'est mauvaise et condamnable entre les riches que quand on tire du prêt des intérêts excessifs. »
Des théologiens catholiques, parmi lesquels nous citerons Major, Navarro, Launoy, des jurisconsultes, tels que Charles Dumoulin et Grotius, soutinrent hardiment la légitimité du prêt à intérêt ; mais leur opinion fut condamnée par la plupart des assemblées générales du clergé. Bossuet écrivit pour la réfuter un Traité de l'usure. Cependant la réaction en faveur du prêt à intérêt ne s'en poursuivit pas moins : au dix-huitième siècle, Turgot et les Économistes démontrèrent avec une clarté irrésistible l'utilité de la liberté du prêt. Bentham leur vint en aide dans son admirable Défense de l'usure. L'Église catholique sentit alors la nécessité de mettre sa doctrine sur le prêt à intérêt un peu plus en harmonie avec les exigences du temps. Elle continua de prohiber [791] d'une manière générale le prêt à intérêt, en invoquant le précepte de l'Évangile : « Mutuum date, nihil indè sperantes, prêtez sans en rien espérer;» mais elle admit deux circonstances dans lesquelles le préteur pouvait percevoir, à titre de dédommagement, une indemnité de l'emprunteur : ces deux circonstances étaient celles du dommage naissant et du lucre cessant. Par dommage naissant, on entendait le préjudice que le préteur pouvait éprouver en se dessaisissant de son capital. Ainsi par exemple disait-on : « Celui qui, ayant de l'argent pour faire les réparations nécessaires dans sa maison, est assez obligeant pour le prêter à une personne qui le lui demande, ne peut faire de réparation à sa maison et ne peut la louer à cause qu'elle menace ruine : il est juste qu'il reçoive quelque chose au-dessus du principal, pour le dédommager de la perte qu'il fait faute de louer sa maison » [192] Voilà ce que l'Église, suivant en cela la définition des jurisconsultes, entendait par dommage naissant. Le lucre cessant consistait dans la privation d'un gain. Si, par exemple, disaient les casuistes, un négociant prête une somme d'argent dont il aurait retiré un bénéfice assuré on l'employant dans son commerce, il peut légitimement réclamer, à titre de lucre cessant, un dédommagement pour le gain qu'il a manqué de réaliser. Toutefois l'Église mettait au dédommagement pour cause de lucre cessant des conditions assez rigoureuses.
« Ce n'est pas assez que le lucre cessant soit possible, disaient les théologiens orthodoxes, ce n'est pas assez, parce qu'il n'y aurait plus d'usure de prêter à intérêt. Tout le monde pourrait alléguer qu'il pouvait faire profiter l'argent qu'il a prêté, et ce serait s'abuser ; ainsi il est absolument nécessaire que le lucre cessant soit prochain, probable, et comme dit le droit, moralement certain et assuré. Tel est le lucre cessant des marchands qui, ayant résolu de mettre leur argent dans le commerce, se privent d'un gain prochain, probable et moralement certain, quand ils prêtent à un ami qui les en sollicite. » [193]
Malgré ces restrictions, l'Église, en admettant les circonstances du dommage naissant et du lucre cessant, allait droit à la réhabilitation du prêt à intérêt. Aussi, à l'époque où le bénéfice de ces deux circonstances fut accordé aux prêteurs, c'est-à-dire, en France, vers la fin du dix-septième siècle, vit-on une partie du clergé protester contre une innovation si pernicieuse. C'étaient les docteurs de Sorbonne qui avaient admis le dommage naissant et le lucre cessant. [194] Les docteurs de province, qui demeuraient plus en dehors du mouvement du siècle, repoussèrent avec indignation une doctrine qu'ils n'hésitèrent pas à qualifier d'infidèle à la tradition de l'Église. Le lucre cessant lut surtout en butte à leurs attaques. Ils prétendirent qu'en légitimant cette circonstance, les docteurs de Sorbonne avaient suivi les errements des casuistes relâchés : « Ni Moïse, écrivaient-ils dans un mémoire, ni David, ni Ézéchiel, ni les autres prophètes, ni même Jésus-Christ dans l'Écriture, ni les saints Pères, ni le droit canon ou civil n'ont jamais parlé du lucre cessant : il faut donc le rejeter. » En même temps ils invoquaient l'autorité de plusieurs grands docteurs, tels que saint Thomas, saint Raymond, saint Antonin, qui s'étaient prononcés d'une manière formelle contre le lucre cessant. Les docteurs de Sorbonne ne manquèrent pas de répliquer ; ils s'efforcèrent de démontrer que rien dans les Écritures ni dans les Pères de l'Église ne s'opposait à l'adoption du lucre cessant; qu'il était inexact de prétendre que saint Thomas l'eût condamné, et, de plus, que ce grand docteur avait admis le dommage naissant. (Réplique des douze docteurs de Sorbonne, du 7 mai 1672.) Mieux en harmonie avec les besoins du siècle, la doctrine soutenue par les docteurs de Sorbonne a prévalu dans l'Église. Cette doctrine ne légitime toutefois l'intérêt qu'en partie, et elle laisse une ample carrière ouverte au péché d'usure. Sous les titres de dommage naissant et de lucre cessant, l'Église admet une compensation pour la privation du capital ; en revanche, elle se refuse à considérer comme légitime la prime destinée à couvrir le risque du prêt. Ceci est d'autant plus bizarre que l'Église ne fait aucune difficulté à reconnaître la légitimité des bénéfices, souvent énormes, que l'on réalise en prêtant à la grosse aventure, c'est-à-dire en fournissant une partie de la cargaison d'un navire, en vue de participer aux chances de l'entreprise.
Au moment où nous écrivons, la question n'est pas encore résolue canoniquement. Il y a encore au sein de l'Église catholique des adversaires du prêt à intérêt. Le 18 août 1830, la cour de Rome rendit un arrêt portant que les confesseurs ne devaient pas inquiéter les prêteurs, mais laissant la question pendante quant au fond. Cet arrêt souleva un nouvel orage au sein du clergé. On vit se reproduire en France la vieille querelle des docteurs de province et des docteurs de Sorbonne. Plusieurs membres du clergé, parmi lesquels nous citerons l'abbé Laborde, vicaire de la métropole d'Auch, et l'abbé Denavit, professeur de théologie à Lyon, protestèrent contre l'arrêt de la pénitencerie romaine, « Je refuse l'absolution, écrivait notamment l'abbé Denavit, à ceux qui prennent des intérêts, et aux prêtres qui prétendent que la loi civile est un titre suffisant. » La majorité du clergé finit toutefois par accepter cet arrêt, et l'Église se borne aujourd'hui généralement à condamner comme usuriers les prêteurs qui exigent un intérêt supérieur au taux légal.
Malheureusement, il faut le dire, les erreurs des légistes en cette matière continuent à venir en aide à celles des théologiens. Non-seulement les lois limitatives du taux de l'intérêt ont été conservées dans le plus grand nombre des pays de l'Europe, mais, en France par exemple, ces lois ont été aggravées en 1850 (voyez Intérêt). Condamné comme un péché par la puissance spirituelle, l'usure continue à être punie comme un délit par la puissance temporelle.
[792]
III. Arguments employés contre l'usure. — Origine probable du préjugé qui la condamne.
Qu'il soit répréhensible de retirer un intérêt de l'argent ou des marchandises que l'on a prêtées , tandis qu'il ne l'est point de retirer un loyer de la maison que l'on a louée, une rente de la terre que l'on a affermée, ou bien encore un profit de l'argent ou des marchandises que l'on a fait valoir soi-même ; que l'on commette un délit et un péché dans le premier cas, tandis qu'on use d'un droit légitime dans les deux autres, voilà ce qui semble difficile à démontrer. Cette difficulté n'a pas arrêté cependant les adversaires du prêt à intérêt. Ils ont entassé volumes sur volumes pour la surmonter, et, grâce à l'ignorance universelle, ils ont pu avoir raison pendant des siècles contre le sens commun. Nous nous bornerons à reproduire quelques-uns des sophismes dont ils ont fait le plus fréquent usage.
Voici d'abord comment ils justifiaient la différence qu'ils établissaient entre l'intérêt et le loyer.
« Quand je loue une maison, une terre, un outil, un cheval ou un âne, disaient-ils, je puis séparer de la chose même l'usage que j'en fais, et il est juste que je vous fasse payer cet usage. Car lorsque vous me restituez ma maison, ma terre, mon outil, mon cheval, mon âne, vous me les avez plus ou moins usés, détériorés. Or n'est-il pas équitable que vous me fournissiez une compensation, une indemnité pour la dépréciation que vous avez fait subir à ma chose en vous en servant? Cette compensation, cette indemnité, c'est le prix du loyer.
« Il y a, en revanche, une autre catégorie d'objets dont l'usage ne saurait être séparé de la chose même, car on ne peut s'en servir sans qu'ils ne se consomment ou ne disparaissent des mains de celui qui s'en sert. Ce sont les objets fongibles. Tels sont l'argent, le blé, le vin , l'huile, les matières premières nécessaires à l'industrie , etc. Quand je vous prête une somme d'argent, un sac de blé, un tonneau de vin, un baril d'huile, vous ne pouvez me restituer ces choses après vous en être servi comme vous me restituez ma maison, ma terre, mon outil, mon cheval, mon âne. Vous ne le pouvez, parce qu'il est dans la nature de ces choses de se consommer par l'usage. Vous me restituez donc d'autre argent , d'autre blé, d'autre vin, d'autre huile. Mais serait-il juste que vous m'en rendissiez plus que vous n'en avez reçu? On conçoit qu'en restituant la maison, la terre, l'outil, le cheval ou l'âne, vous y ajoutiez une indemnité pour compenser la détérioration, l'usure. Mais si vous remplacez intégralement le capital fongible que je vous ai prêté, puis-je rien exiger de plus? Ne reçois-je pas sinon la chose prêtée elle-même, du moins une chose équivalente? Le prêt des objets fongibles ne doit-il pas être gratuit en vertu de la nature même des choses ? »
S'agissait-il de justifier la différence qu'ils établissaient entre le profit résultant de l'emploi d'un capital fongible et l'intérêt provenant du prêt de ce même capital, les adversaires de l'usure prétendaient que dans le premier cas l'on courait des risques, tandis que dans le second on n'en courait point. « En faisant valoir soir même son capital, disaient-ils, on court risque de faire de mauvaises opérations et de perdre son capital en tout on en partie, tandis qu'en le prêtant , soit que l'emprunteur fasse de bonnes ou de mauvaises affaires, on reçoit toujours le même intérêt. »
Rien de plus faible, de plus puéril même que ces arguments des adversaires de l'usure. N'était-il pas visible, en effet, que le loyer des maisons, des terres, etc., comprenait autre chose que l'indemnité nécessaire pour les maintenir en bon état? que le profit provenant de l'emploi des capitaux fongibles surpassait de beaucoup l'indemnité nécessaire pour couvrir les risques de cet emploi? enfin, qu'en prêtant un capital or n'était pas « toujours sûr de recevoir le mémo intérêt ; » qu'on n'était pas même toujours sûr de recevoir un intérêt quelconque ou même de récupérer son capital? On aurait pu aisément démontrer aux adversaires de l'usure qu'ils devaient, sous peine de se montrer illogiques, condamner comme usure tout ce qui, dans le loyer d'une maison, d'une terre, d'un outil, d'un cheval, d'un âne, dépassait l'indemnité nécessaire pour compenser la détérioration de la chose louée; tout ce qui, dans le profit d'un capital employé par son propriétaire, excédait la prime du risque. Ils auraient été conduits ainsi à cette conséquence d'une absurdité palpable qu'un fermier, par exemple, qui restituait une terre après l'avoir améliorée, non-seulement ne devait aucun fermage au propriétaire, mais encore qu'il pouvait, en bonne justice, exiger de lui une indemnité.
Un troisième argument, qui surpassait encore ceux-là en puérilité, était tiré de la prétendue stérilité de l'argent et des autres métaux précieux servant de monnaie. C'est une chose contre nature, disait Aristote ou lui faisaient dire ses interprètes , que l'argent produise de l'argent. Saint Basile, qui avait adopté pleinement l'opinion attribuée au philosophe grec, rappelait aux fidèles que le cuivre, l'or et les métaux ne produisent rien ; qu’ils ne portent aucun fruit en vertu de leur nature même. Un autre Père de l'Église, saint Grégoire de Nysse, faisait remarquer que le Créateur n'a dit qu'aux créatures animées : Croissez et multipliez; qu'il n'a rien dit de semblable aux créatures inanimées, telles que l'argent. Bentham réfute d'une manière originale cet argument attribué à Aristote et répété par la plupart des Pères et des docteurs de l'Église ainsi que par un bon nombre de jurisconsultes. [195]
« il arriva, dit-il, que ce grand philosophe, avec tout son talent et toute sa pénétration, et malgré le nombre de pièces d'argent qui avaient passé par ses mains (nombre plus grand peut-être que celui qui ait jamais passé avant ou depuis dans les mains d'aucun philosophe), et malgré les peines toutes particulières qu'il s'était données pour éclaircir le question de la génération, ne put jamais parvenir à découvrir dans aucune pièce de monnaie quelque organe qui la rendit propre à en engendrer une autre. Enhardi par une preuve négative de cette force, il s'aventura à donner au monde le résultat de ses observations sous la forme de cette proposition universelle, que, de sa nature, tout argent est stérile. Vous, mon ami, sur qui la saine raison a beaucoup plus d'empire que l'ancienne philosophie, vous aurez déjà remarqué, sans doute, que ce que l'on aurait dû conclure de cette observation spécieuse, s'il y avait lieu d'en conclure de quelque chose, c'est qu’on essayerait en vain de tirer 5 pour100 de son argent, et non pas qu'on ferait mal si on parvenait à en tirer ce profit. Mais ce fut autrement que les sages de l'époque en jugèrent.
« Une considération qui ne s'est point présentée à l'esprit de ce grand philosophe, et qui, si elle s'y fût présentée, n'aurait point été tout à fait indigne de son attention, c'est que, bien qu'une darique (monnaie grecque) fût aussi incapable d'engendrer une autre darique que d'engendrer un bélier ou une brebis, un homme cependant, avec une darique empruntée, pouvait acheter un bélier et deux brebis qui, laissés ensemble, devaient probablement, au bout de l'année, produire deux ou trois agneaux ; en sorte que cet homme, venant, à l'expiration de ce terme, à vendre son bélier et ses deux brebis pour rembourser la darique, et donnant en outre un de ses agneaux pour l'usage de cette somme, devait encore se trouver de deux agneaux, ou d'un au moins, plus riche que s'il n'avait point fait ce marché. » [196]
L'erreur d'Aristote et de ses disciples provenait, comme on voit, de ce qu'ils se méprenaient sur la signification économique des mots stérilité, productivité. L'argent est stérile en ce sens que deux pièces d'argent juxtaposées n'en engendreront jamais une troisième ; mais les maisons, les navires, les machines et les outils de toute sorte ne sont-ils pas affectés du même genre de stérilité ? N'est-il donc pas tout autant « contre nature » d'en tirer un loyer?
C'est donc à grand renfort de sophismes que l'opinion contraire au prêt à intérêt a été soutenue. Il n'en est que plus intéressant de rechercher quelles circonstances lui uni donné naissance et lui ont permis de subsister jusqu’à nos jours, malgré la faiblesse vraiment puérile des arguments employés pour la soutenir. Ces circonstances peuvent se résumer en un seul mot : le monopole.
La concurrence qui nivelle aujourd’hui les prix de toutes choses avait autrefois bien rarement une sphère d'action suffisamment étendue. Les monopoles naturels et artificiels, qui sont devenus maintenant l’exception, étaient alors la règle. L'imperfection des voies de communication, l'absence de sécurité, sans parler de beaucoup d'autres obstacles, limitaient étroitement l'étendue des marchés. Il en résultait pour les agriculteurs, les industriels, les marchands, les capitalistes, les ouvriers mêmes qui se trouvaient en possession de ces marchés, autant de petits monopoles. Le moyen le plus efficace de détruire ces monopoles, c'eût été sans doute de rendre les communications plus promptes, plus économiques et plus sûres, comme aussi de supprimer les obstacles qui entravaient la liberté des professions; c'eût été, en un mot, d'élargir la sphère d'action de la concurrence. Mais eût-on été convaincu de l'efficacité du procédé, et l'on n'en avait aucune idée, on n'aurait pu toujours l'employer aisément. On s'efforçait généralement d'y suppléer au moyen de la réglementation. Quand un monopole devenait trop oppressif, on limitait ou l'on essayait de limiter le pouvoir de ses détenteurs en leur imposant un tarif maximum. De là les tarifs établis, particulièrement dans les villes, pour la plupart des objets de consommation ; de là encore des lois qui fixaient un maximum pour le prix du travail. La taxe du pain et celle de la viande demeurent dans beaucoup d'endroits comme des vestiges surannés de cet ancien état de choses. Selon toute apparence, la limitation du taux de l'intérêt n'eut pas d'autre origine.
Dans les sociétés anciennes, le prêt des capitaux constituait généralement un véritable monopole, et ce monopole, né des institutions et des circonstances du temps, engendrait à son tour une oppression odieuse. Dans la république militaire de Rome, par exemple, les capitaux étaient rares et ils se trouvaient concentrés dans un petit nombre de mains. Les prêteurs pouvaient dicter en conséquence leurs conditions aux emprunteurs, et, lorsque ces conditions n'étaient point remplies avec ponctualité , le débiteur tombait sous le coup de la plus cruelle des peines : l'esclavage. Or, à Rome comme dans la plupart des autres sociétés de l'antiquité, la guerre contraignait incessamment une classe nombreuse de la population à recourir aux emprunts. On n'avait point encore adopté le système des armées permanentes. Lorsqu'une guerre survenait, tous les citoyens valides pouvaient être requis d'y prendre part. Le petit propriétaire, par exemple, qui cultivait lui-même son champ avec un ou deux esclaves, était obligé de partir pour l'armée. Pendant son absence, sa propriété demeurait à l'abandon. A son retour, il trouvait son petit capital entamé, ses réserves détruites. Il était obligé d'emprunter la somme nécessaire pour subsister [794] jusqu'à la récolte suivante, et il allait frapper à la porte du riche patricien, qui se trouvait, lui, dans une situation bien différente ; car le patricien avait de nombreux esclaves, disciplinés comme une armée et dirigés par des contre-maîtres dont il stimulait le zèle en leur offrant la perspective de l'affranchissement. Quand il allait à la guerre, sa terre continuait d'être cultivée, ses ateliers ne chômaient point; en outre, la guerre était bien plus profitable pour les patriciens, qui occupaient les principaux grades de l'armée, qu'elle ne l'était pour les plébéiens. Les chefs ne manquaient point de s'adjuger la grosse part des dépouilles des vaincus; souvent même ils ne laissaient rien aux simples soldats, leurs compagnons de périls et de gloire.
De retour à Rome, la campagne finie, le patricien se retrouvait riche, — riche des dépouilles qu'il avait ravies à l'ennemi, riche aussi des profits que lui avaient rapportés ses terres ou ses ateliers pendant son absence. Le malheureux plébéien, au contraire, ne retrouvait chez lui que la misère, il empruntait pour se refaire; il empruntait au riche patricien, sous la condition de rembourser à une échéance plus ou moins prochaine. Mais souvent, aux approches de l'échéance, une nouvelle guerre éclatait. Obligé encore une fois d'abandonner son champ ou son atelier, le plébéien ne pouvait acquitter sa dette. Alors il était impitoyablement saisi à la requête de son créancier, et ce vétéran glorieux, ce vainqueur des nations, était vendu à l'encan et attaché à la même chaîne que les ennemis qu'il avait vaincus. On conçoit combien une destinée si cruelle devait émouvoir les masses au sein desquelles se rencontraient tant de débiteurs menacés d'un sort semblable. Les victimes de la rigueur des créanciers rappelaient bien haut les services qu'ils avaient rendus à la république; ils énuméraient leurs actions d'éclat, ils montraient les cicatrices dont ils étaient couverts, et parfois le peuple, indigné, brisait leurs chaînes. De là des troubles continuels et des plaintes véhémentes dont les échos ont traversé les siècles; de là aussi ce sentiment de commisération pour le débiteur et de répulsion pour le créancier qui remplissait les âmes, et qui n'est pas encore complètement effacé; de là enfin le préjugé des masses contre le prêt à intérêt et leur haine contre les usuriers. Car les masses remontent rarement jusqu'à la source du mal qu'elles endurent. Elles s'en tiennent communément à la cause apparente. La guerre et l'esclavage, voilà quelles étaient, dans l'antiquité, les causes premières des maux qui accablaient les classes plébéiennes. Mais l'opinion populaire était favorable à la guerre, et l'esclavage était considéré comme une institution indispensable. On s'en prenait donc à l'usure, et les philanthropes du temps demandaient, soit la limitation du taux de l'intérêt, soit même la gratuité du prêt.
Au moyen âge, la situation n'avait guère changé. Les capitaux étaient tout aussi rares que dans l'antiquité, sinon davantage, et les marchés aussi resserrés. Le prêt des capitaux continuait d'être à peu près partout le monopole d'un petit nombre d'individus. Une circonstance particulière contribuait même à rendre ce monopole plus oppressif et plus odieux que jamais. L'Église ayant jeté l'anathème sur l'usure, le plus grand nombre dus capitalistes chrétiens, intimidés par la menace de la damnation éternelle, s'abstinrent de prêter. Les juifs, qui n'éprouvaient pas les mêmes appréhensions, accaparèrent alors ce commerce, dont l'Église leur livrait le riche monopole sans le savoir, et surtout sans le vouloir. La condition des emprunteurs en devint naturellement plus mauvaise, et la haine que l'on avait vouée aux usuriers s'accrut encore de toute l'horreur que l'on ressentait pour les juifs.
L'opinion contraire au prêt à intérêt provenait donc de ce que les circonstances et les institutions se joignaient communément pour conférer aux capitalistes un monopole qui leur permettait de prêter à un taux excessif. Et comme les moyens que l'on employait pour combattre les effets de ce monopole demeuraient le plus souvent inefficaces, comme ils aggravaient même parfois le mal qu'on voulait détruire, on se persuadait que le prêt à intérêt était entaché d'un vice irrémédiable. On lui imputait les maux provenant de l'usure, au lieu de les ramener à leur véritable source qui était le monopole, et on le frappait d'anathème; puis, faute de bonnes raisons pour motiver cet anathème, on avait recours à des sophismes.
IV. Ce qu'il faut penser de l'usure. — Le remède qu'elle comporte.
Si l'on entend par usure toute rémunération allouée pour le prêt d'un capital fongible, selon l'expression des casuistes, il est évident que l'usure est légitime et nécessaire au même degré que le loyer, le profit ou le salaire. Si l'on restreint davantage la signification du mot, si l'on entend seulement par usure le prix de monopole de l'intérêt, le taux auquel l'intérêt est porté en l'absence d'une concurrence suffisante , soit que la concurrence se trouve restreinte par des obstacles naturels ou par des obstacles artificiels, sans aucun doute l'usure est un mal; mais, comme nous l'avons vu plus haut, ce mal a sa source dans le monopole et non point dans le prêt. Dans sa polémique contre Bastiat, au sujet de la gratuité du crédit, M. Proudhon met en scène un naufragé qui est jeté dans l'ile de Robinson et a qui cet infâme propriétaire ne se fait point scrupule de prêter des outils, des matières premières et des provisions au taux de 99%. Laissant soigneusement dans l'ombre la circonstance capitale du monopole, qui permet au préteur de faire la loi à l'emprunteur et de tirer de lui une usure formidable, M. Proudhon ne manque pas de présenter son exemple comme un argument décisif contre l'intérêt. Mais qui ne voit, et Bastiat l'a fort bien remarqué, que le profit et le salaire pourraient être condamnés aussi à l'aide d'arguments pareils? L'usure du Robinson-capitaliste de M. Proudhon est, en effet, de la même nature que celle du négociant qui profite de son isolement sur un marché pour porter le prix de sa marchandise au-dessus du taux ordinaire de la concurrence; elle est de la même nature encore que celle du travailleur qui surélève le prix de son travail quand il possède un talent extraordinaire, ou simplement même quand les bras sont rares. Ces trois cas ne présentent aucune différence essentielle. Le marchand monopoleur et [795] l'ouvrier monopoleur sont aussi bien des usuriers que le capitaliste monopoleur de M. Proudhon: si celui-ci prête à usure, ceux-là vendent et travaillent à usure. Serait-on fondé cependant à en conclure que le profit et le salaire sont illégitimes?
Il reste maintenant à savoir si les trois usuriers dont il vient d'être question sont, oui ou non, condamnables; s'ils peuvent, oui ou non, user légitimement du pouvoir que leur confère la situation du marché. C'est là évidemment une question dont la solution peut varier selon les circonstances. Comme elle est du ressort de la morale plutôt que de celui de l'Économie politique , nous ne l'examinerons point ici. Nous nous bornerons à dire que le meilleur moyen d'empêcher l'usure, au moins dans l'état de civilisation où nous sommes, c'est de s'abstenir de réglementer et de maximer l'intérêt; c'est de laisser agir le niveau régulateur de la concurrence. Aussitôt, en effet, que les capitaux deviennent rares dans une localité, le taux de l'intérêt hausse, et cette hausse, si elle n'est point entravée ou masquée par un maximum, attire immédiatement les capitaux de toutes les autres parties du marché général. Alors le vide se comble, le taux de l'intérêt baisse et l'usure disparaît.
— (Voyez, pour la Bibliographie de Usure, l'article Intérêt.)
G. de Molinari.
Endnotes to Usure
[192] Conférences ecclésiastiques de Paris sur l'usure el la restitution, établies et imprimées par ordre de Mgr le cardinal de Noailles, archevêque de Paris. I756, t. 1, p. 261.
[193] Conférences*. T. 1, p. 271.
[194] Assemblées des docteurs de Sorbonne, du 4 octobre 1665 et, du 17 février 1666.
[195] Sans parler des poëtes. Dans le Marchand de Venise de Shakespeare, la question de la légitimité de l'intérêt donne lieu à une discussion des plus curieuses entre le juif Shylock et le marchand chrétien Antonio. Le juif Shylock, qui plaide pro domo suâ en défendant l'usure, cite à l’appui de sa thèse les profits que Jacob faisait sur ses brebis. Son adversaire lui demande ironiquement si l'or et l'argent sont des brebis? Le juif ne trouve rien à répondre à un argument si péremptoire. Cela ne l'empêche pas de prêter ensuite au marchand de Venise une somme de 3 mille sequins, en stipulant que, si celle somme ne lui est pas restituée à l’échéance, il aura le droit de couper une livre de chair dans telle portion du corps de son débiteur qu'il lui plaira de choisir. Antonio, qui a consenti à se soumettre à cette usure de cannibale, n'est pas en mesure de rembourser à l'échéance la somme empruntée. Shyllock réclame impitoyablement son dû en invoquant la justice et la bonne foi. Le marchand de Venise est sur le point de devenir sa victime, lorsque la jeune et belle héroïne Porcia, déguisée en homme de loi, le tire d'affaire en remarquant que « le sang n'est pas entré dans le marche. » Shyllock peut donc prendre sa livre de chair, à titre d'intérêt ou d'usure, mais sans une goutte de sang, ceci sous peine de mort. Le marchand de Venise est sauvé. Cette fable, dont le génie de Shakespeare a tiré un parti si merveilleux, n'est-elle pas un spécimen curieux de l'ignorance du temps?
[196] Défense de l'usure, par Jerémie Bentham. Lettre X.
Villes↩
Source
“Villes,” DEP, T. 2, pp. 833-38.
[833]
I. Comment les villes se fondent. Circonstances qui déterminent le choix de leur emplacement et qui provoquent leur déplacement.
Les villes sont des agglomérations de population et d'industrie qui se forment d'elles-mêmes , sous l'impulsion naturelle de certains besoins , et dont le développement n'a rien d'arbitraire. Quelquefois des princes ont eu l'illusion de croire qu'il leur suffisait de prononcer un fiat majestueux pour faire surgir du sol une cité nouvelle et la rendre florissante ; mais l'expérience a manqué rarement de leur prouver qu'ils avaient trop présumé de leur puissance. Sans doute, un monarque peut, en déplaçant le siège de son empire, comme fit Pierre le Grand, par exemple, créer un centre de population et de richesse. Les fonctionnaires de tous grades et les aspirants fonctionnaires qui sont obligés de vivre et de dépenser, les uns leurs appointements, les autres leurs revenus dans la capitale, attirent nécessairement autour d'eux une population de fournisseurs, d'artisans et de domestiques; mais, à moins que la cité nouvelle ne présente un emplacement avantageux à un certain nombre de branches de la production, et dans ce cas il n'est pas nécessaire que le gouvernement intervienne pour la fonder, elle ne pourra prendre un développement bien considérable. Il y a cependant ici une exception à faire. Si le gouvernement augmente continuellement le nombre de ses attributions, s'il fait de la centralisation et du communisme aux dépens des libertés du pays, s'il multiplie en conséquence le nombre de ses employés, la ville où il aura établi le siège de son pouvoir ne manquera pas de s'accroître et de s'enrichir; mais il et douteux que le pays ait à se féliciter, en ce cas, de la prospérité de sa capitale. Si, an contraire , le gouvernement ne possède que des attributions restreintes, s'il ne dispose que d'un personnel peu nombreux, sa capitale, en admettant qu'aucune autre industrie ne puisse s'y fixer avec avantage, demeurera condamnée à une condition des plus modestes, en comparaison de celle des foyers de la production manufacturière ou commerciale. Tel est le cas de la ville de Washington, capitale de l'Union américaine. J.-B. Say a fait parfaitement ressortir dans son Traité cette impuissance des gouvernements à fonder des villes et à les faire prospérer :
« Il ne suffit pas, dit-il, de tracer le plan d'une ville et de lui donner un nom; il faut, pour qu'elle existe véritablement, la fournir par degrés de talents industriels, d'ustensiles, de matières premières; de tout ce qui est nécessaire pour entretenir les industrieux jusqu'à la parfaite confection et à la vente de leurs produits: autrement, au lieu de fonder une ville, on n'élève qu'une décoration de théâtre, qui ne tarde pas à tomber, parce que rien ne la soutient. C'est ce qui est arrivé d’Ékatherinoslaw, dans la Tauride, et ce que faisait pressentir l'empereur Joseph II, lorsque, après avoir été invité à poser en cérémonie la seconde pierre de cette ville, il dit à ceux qui l'entouraient : J'ai fini une grande affaire en un jour avec l'impératrice de Russie : elle a posé la première pierre d'une ville, et moi la dernière.
« Des capitaux ne suffisent même pas pour établir une grande industrie et l'active production qui sont nécessaires pour former et agrandir une ville; il faut encore une localité et des institutions nationales qui favorisent cet accroissement. Les circonstances locales sont peut-être ce qui manque à la cité de Washington pour devenir une grande capitale, car ses progrès sont bien lents en comparaison de ceux que font les États-Unis en général ; tandis que la seule situation de Palmyre, autrefois, l'avait rendue populeuse et riche malgré les déserts de sable dont elle est entourée, et seulement parce qu'elle était devenue l'entrepôt du commerce de l'Orient avec l'Europe. La même raison avait fait la prospérité d'Alexandrie et plus anciennement encore dé la Thèbes d'Egypte. La seule volonté de ses princes n'aurait pas suffi pour en faire une ville à cent portes et aussi populeuse que nous la représente Hérodote. Il faut chercher dans sa position entre la mer Rouge et le Nil, entre l'Inde et l'Europe, l'explication de son importance. » [197]
[834]
Essayons maintenant de donner une idée sommaire des nécessités qui ont déterminé la fondation des villes et le choix de leur emplacement. La nécessité de pourvoir à leur sécurité a dû, plus qu'aucune autre cause, pousser originairement les hommes à fonder des villes. Ils comprirent qu'en se réunissant dans des enceintes fortifiées , ils seraient plus en sûreté qu'en demeurant disséminés sur une vaste étendue de territoire. A cette nécessité qui se fit sentir dès les premiers âges de l'humanité se joignirent les convenances particulières de l'industrie et du commerce. Tandis que la production agricole se déploie, en vertu de sa nature même, sur une surface considérable, la plupart des branches de la production industrielle et commerciale exigent, au contraire, une certaine concentration. Qu'on les examine dans les différents pays civilisés, et l'on trouvera qu'elles se sont concentrées d'elles mêmes successivement dans un petit nombre de foyers. Ainsi, en France, l'industrie de la soie a ses sièges principaux à Lyon et à Saint-Étienne, l'industrie cotonnière à Lille, Rouen et Mulhouse, l'industrie lainière à Reims. Elbeuf, Sedan, etc., l'industrie des articles de mode à Paris. Quelles causes particulières ont déterminé une industrie, a s'établir dans telle localité plutôt que dans telle autre, voilà ce qu'il est encore intéressant de rechercher. Tantôt c'est le voisinage de la matière première ou du débouché, tantôt ce sont les aptitudes spéciales des populations, tantôt enfin c'est la réunion de ces diverses circonstances.
La localisation des industries ne s'arrête pas là : dans les villes où elles établissent leur siège, on les voit se concentrer de préférence dans certains quartiers et dans certaines rues. Cette sous-localisation par quartiers et par rues est notamment très visible a Paris, et l'on en trouve un aperçu curieux dans l'enquête sur l'industrie parisienne dressée par les soins de la chambre de commerce. [198] Le même fait s'observe au sein des civilisations qui ont le moins d'analogie avec la nôtre. Pour n'en citer qu'un seul exemple, un voyageur espagnol, don Rodrigo de Vivéro, qui a donné, en 1608, une description curieuse de Jeddo, capitale du Japon, signale cette distribution des industries par quartiers et par rues comme le trait le plus saillant qui eût frappé ses regards. « Toutes les rues, dit-il, ont des galeries couvertes et elles sont occupées chacune, par des personnes de la même profession. Ainsi les charpentiers ont une rue, les tailleurs une autre, les bijoutiers une autre, etc. Les marchands sont distribués de la même manière. Les provisions sont aussi vendues dans des endroits appropriés pour chaque sorte. Enfin les nobles et les personnages importants habitent un quartier à part. Ce quartier se distingue par les armoiries, sculptées ou peintes, qui sont placées sur les portes des maisons » [199] A quelques légères différences près, cette description n'est-e'le pas applicable à la plupart des capitales de l'Europe? C'est ainsi que les mêmes nécessités économiques se font sentir au sein des civilisations les plus diverses et qu'elles les marquent d'une empreinte commune.
Cependant des causes nombreuses agissent incessamment pour déplacer les industries, et par la même les centres de population que ces industries alimentent. Tout progrès industriel ou commercial a pour résultat ordinaire de déplacer la production. Lorsque la route du cap de Bonne-Espérance a été découverte, Venise a perdu une grande partie de son importance. Plus tard, l'invention des machines a filer et a tisser le coton a édifié la prospérité de Manchester aux dépens de celle de Bénarès et des autres villes de l'Inde, où la fabrication du colon avait auparavant son principal foyer. Nous voyons aujourd'hui, de même, la locomotion à la vapeur faire surgir des villes nouvelles ou imprimer une impulsion soudaine à d'anciennes villes qui demeuraient stationnaires. La ville de Southampton, par exemple, a acquis en peu d'années une importance considérable, parce que son port a été reconnu propre a servir de foyer à quelques-unes des lignes de navigation à la vapeur de l'Océan. Qu'un [835] nouveau système de navigation apparaisse, et peut-être Southampton sera-t-il abandonné pour un autre port dont la situation se trouvera mieux en harmonie avec les convenances particulières de ce nouveau système. C'est ainsi cine les villes subissent, tantôt à leur avantage, tantôt à leur détriment, l’influence des causes qui modifient chaque jour les conditions d'existence de la production. Nous disions plus haut que les gouvernements n'ont que dans une bien faible mesure le pouvoir de créer des villes nouvelles et surtout de les rendre prospères ; nous pourrions ajouter qu'ils ne possèdent pas à un plus haut degré le pouvoir de détruire ou de déplacer les villes existantes. Vainement des vainqueurs barbares ont promené le fer et la flamme dans les cités qu'ils avaient conquises; vainement ils ont fait passer le soc de la charrue sur l'emplacement de ces cités proscrites et ils y ont semé du sel : comme il n'était pas en leur pouvoir d'anéantir les avantages naturels qui avaient déterminé les populations à s'y agglomérer, au bout de quelques années le désastre était réparé et la vie circulait plus abondante que jamais dans les lieux mêmes qu'une orgueilleuse folie avait voués à une éternelle solitude. Les entraves apportées à la circulation des hommes et des choses ont été malheureusement plus efficaces que les projectiles ou les torches incendiaires pour ruiner des foyers de population et de richesse : des villes florissantes ont été transformées en de véritables nécropoles par des restrictions qui les privaient du débouché de leur industrie ou de leur commerce. Au dix-septième siècle notamment, les Hollandais, jaloux de la prospérité d'Anvers , réussirent à obtenir la fermeture de l'Escaut (par le traité de Munster, en 1648), et cette mesure barbare, qui fut maintenue pendant deux siècles, porta un coup mortel au commerce d'Anvers et à l'industrie des Flandres, dont les négociants anversois étaient les intermédiaires actifs et intelligents. A une époque plus récente, on a vu le régime prohibitif faire déserter le port de Bordeaux , auparavant l'un des plus fréquentés de France.
La population et la richesse ne se déplacent pas seulement en se portant d'une ville dans une autre; elles se déplacent encore dans la même localité. De nouveaux quartiers s'élèvent dans l'intérieur des villes ou aux environs de leur enceinte, tandis que les anciens sont abandonnés et tombent en ruine. Ces déplacements locaux sont amenés par des causes visibles ou latentes dont l'action modifie à la longue les nécessités ou les convenances qui avaient déterminé le choix des emplacements primitifs. Le progrès général de la sécurité doit être signalé comme la plus importante de ces causes. Arrêtons-nous-y un instant.
Les anciennes villes de l'Europe sont bâties pour la plupart sur des plateaux élevés ou sur des collines plus ou moins escarpées; en sorte que leurs habitants sont continuellement occupés à monter ou à descendre, ce qui occasionne dans les transports journaliers une déperdition du forces considérable. En outre elles sont communément resserrées dans une enceinte étroite ; les habitations y sont pressées les unes contre les autres comme les alvéoles dans une ruche. Comment se fait-il que nos ancêtres se soient logés d'une manière si peu économique, si incommode et parfois si malsaine? Pour avoir l'explication de ce fait bizarre, il est nécessaire de se rendre compte de la situation de l'Europe après l'Invasion des barbares. L'insécurité était alors universelle. Les conquérants s'étaient bâti des repaires dans les lieux les plus inaccessibles, et Ils s'élançaient de ces nids de vautours sur les contrées avoisinantes pour les piller ou les rançonner. Trop faibles pour leur résister, les anciens habitants du pays, victimes de leurs déprédations, composèrent avec eux, comme on compose avec les bandits dans les pays où le gouvernement est sans force. Ils s'assurèrent de la protection des bandes les plus puissantes moyennant un tribut régulier, et ils allèrent se loger aussi près que possible de leurs protecteurs. Ils s'établirent généralement au-dessous des châteaux forts, afin de pouvoir s'y réfugier en cas d'alerte. Les premières maisons prenaient place immédiatement au-dessous du château, et les autres s'échelonnaient successivement plus bas comme en amphithéâtre. Aussitôt que les habitants se trouvaient réunis en nombre suffisant, ils environnaient leur cité de murailles et de tourelles pour compléter leur système de défense. C'est ainsi qu'ont été bâties la plupart des villes dont l'origine remonte au moyen âge.
Quand on envisage les nécessités dii temps, on s'explique aussi pourquoi les rues étaient si étroites. C'est que les fortifications avaient été élevées dans un périmètre aussi resserré que possible, afin d'en rendre la défense plus facile et moins coûteuse. Lorsque la population venait à s'augmenter, on était obligé en conséquence d'exhausser les maisons et de diminuer la largeur des rues pour la faire tenir dans l'emplacement primitif. Quelquefois, à la vérité, on reculait les murs d'enceinte; mais ce n'était jamais qu'à la dernière extrémité qu'on se résignait à prendre une mesure si coûteuse.
Mais peu à peu la sécurité générale s'est accrue. La féodalité a disparu, et avec elle ont cessé les guerres intérieures. Alors a commencé le mouvement de déplacement de la population urbaine. Des hauteurs où le soin de sa sûreté l'avait obligée à se confiner, elle est descendue dans les plaines où elle pouvait se loger plus commodément et à moins de frais. Les faubourgs doivent leur origine à ce progrès de la sécurité qui a permis aux hommes industrieux et paisibles de vivre désormais en dehors d'une enceinte fortifiée. [200] Accéléré encore par une autre cause dont nous aurons à nous occuper plus loin, ce déplacement de la population urbaine est devenu de jour en jour plus général : partout on voit les habitants des anciennes villes quitter leurs gîtes séculaires pour aller en habiter de nouveaux, moins chers, plus commodes et plus sains.
II. De la proportion entre la population des villes et celle des campagnes. — Causes qui la déterminent et la modifient.
La fondation et le choix de l'emplacement des villes sont déterminés, comme on vient de le voir, par l'état de la civilisation et des arts de la production. Il en est de même de la proportion entre la population et la richesse des villes et celles des campagnes. Cette proportion est essentiellement diverse et mobile : elle diffère selon les pays et selon les époques. Lorsque la production est peu avancée, lorsque les hommes sont obligés, en conséquence, d'employer la plus grande partie des forces productives dont ils disposent à se procurer les objets de première nécessité, les industries qui pourvoient à des besoins moins urgents ne peuvent se développer faute de consommateurs. Les villes où ces industries se concentrent en vertu de leur nature et de leurs convenances particulières ne progressent alors qu'avec une extrême lenteur. C'est dans les pays et aux époques où la production, et en première ligne la production agricole, ont réalisé le plus de progrès que la population urbaine doit être et qu'elle est effectivement la plus nombreuse.
Prenons pour exemples deux pays qui se trouvent placés fort inégalement dans l'échelle de la production, l'Angleterre et la Russie. En Angleterre où la population urbaine dépasse de beaucoup la population des campagnes, le nombre des familles employées à l'agriculture n'était évalué en 1840 qu'à 901,134 tandis que celui des familles employées par l'industrie, le commerce, etc, était de 2,453,041
Les 901,134 familles employées à l'agriculture fournissaient 1,055,982 travailleurs effectifs qui produisaient assez d'aliments pour nourrir la plus grande partie de la population britannique. Dans les pays où l'agriculture est moins avancée, elle exige, proportion gardée, deux ou trois fois plus de bras pour donner un produit équivalent, et il en résulte naturellement que la population urbaine ne peut y être aussi nombreuse. Tel est le cas de la France ; tel est surtout le cas de la Russie, où la production agricole exercée par des serfs est demeurée en enfance. On n'y compte, selon de M. de Tégoborski, que 733 villes ayant une population de 5,350,000 habitants sur une population totale d'environ 60 millions, tandis qu'en Autriche ou compte 773 villes; en Prusse, 979; en France, 901, pour des populations numériquement inférieures. L'état arriéré de l'agriculture russe est certainement la première cause du peu de développement de la population urbaine en Russie. L'organisation particulière que l'industrie y a reçut est aussi pour quelque chose dans ce résultat.
« La petite industrie, dit M. de Tégoborski, celle des métiers, réside, en Russie, plutôt dans les campagnes que dans les villes ; elle s'exerce en communauté dans les villages, qui portent aux foires le produit de leur travail : voilà pourquoi aussi les foires ont, en Russie, une plus grande importance que dans d'autres pays. Ailleurs ce sont, pour la plupart, les ouvriers des villes qui fournissent aux besoins de la campagne; chez nous, c'est souvent le contraire, et ce sont les cordonniers, les menuisiers et les serruriers des villages qui pourvoient aux besoins des villes... On peut se convaincre d'une manière plus sensible de ce manque d'artisans en Russie, dans la plupart de nos villes, en compulsant la statistique des métiers des autres pays et en prenant pour point de comparaison quelques-unes des professions les plus répandues. Ainsi, par exemple, en Prusse, les métiers des cordonniers, gantiers, menuisiers, charrons, vitriers, forgerons, serruriers et chaudronniers comptaient, en 1843, 322,700 maîtres et compagnons pour une population de 15,471,765 habitants, ce qui donnait 21 ouvriers sur 1,000 habitants; et lorsqu'on prend la statistique des villes, cette proportion monte, pour les grandes villes, jusqu'à 40 ouvriers, maîtres et compagnons, appartenant à ces différentes professions, sur 1,000 habitants du total de la population urbaine, ce qui fait le triple, le quadruple, et même au delà de la proportion qu'on trouve dans les villes en Russie. » [201]
De nos jours, les progrès qui transforment économiquement la production ont pour résultat d'accroître avec rapidité la population urbaine. Par ce que nous avons dit plus haut, on conçoit qu'il en soit ainsi.
« En France, par exemple, dit M. Alf. Legoyt, la population s'est accrue, de 1836 à 1851, de 6,68 0/0 pour la période entière, soit 0,44 0/0 par an. Dans 100 villes ayant 10,000 âmes et au-dessus, l'accroissement, dans le même intervalle, a été de 24,24 100, soit 1,016 par an. En dix ans, l'accroissement de la population urbaine est donc de 10 individus pour 0/0, tandis que celui de la population totale est de 6 seulement. » [202]
Un fait analogue s'observe en Angleterre. D'après les tableaux du dernier recensement, la population urbaine de la Grande-Bretagne (l'Angleterre et l’Écosse), qui n'était en 1801 que de 3,046,371 individus, a atteint en 1851 le chiffre de 8,410 021. C'est un accroissement de 176 0/0, tandis que l'accroissement total de la population, dans la même période, n'a été que de 98 0/0. Que si l'on recherche dans quelles villes l'augmentation a été la plus considérable, on verra figurer en première ligne les grandes villes manufacturières et les ports de commerce. Tandis que la population des villes de comtés ne s'est accrue que de 122 0/0, celle des villes manufacturières s'est augmentée de 224 0/0, [837] et celle des ports de mer, Londres excepté, de 195 0/0. Dans les villes où l'on fabrique spécialement le fer, l'augmentation a été de 289 0/0, et dans celles où se trouve concentrée la fabrication du coton, de 282 0/0.
Tout progrès des arts de la production ne peut qu'accélérer ce mouvement d'accroissement de la population urbaine. Faut-il s'en affliger ou s'en réjouir? C'est là une question qui est assez vivement controversée , mais que les Économistes s'accordent à résoudre à l'avantage des villes. Adam Smith et J.-B. Say prouvent notamment que la multiplication et l'agrandissement des villes sont souhaitables au point de vue même de l'intérêt des campagnes. Adam Smith, qui a examiné ce sujet avec sa pénétration accoutumée, trouve que les campagnes ont retiré trois avantages principaux du développement des villes industrielles et commerçantes.
« 1° Par la commodité d'un marché considérable et à portée qu'elles fournissaient à la campagne pour la vente de son produit brut. Cet avantage ne se bornait même pas aux campagnes où ces villes étaient situées ; il s'étendait à toutes celles qui avaient quelque commerce avec elles.
« 2° Les habitants des villes employaient souvent les richesses qu'ils avaient acquises à l'achat des terres qui étaient à vendre, et qui la plupart du temps n'étaient pas cultivées. Les marchands ont communément l'ambition de posséder un bien de campagne, et, quand ils ont une terre, ils sont généralement les plus propres à la faire valoir. Un marchand est accoutumé à mettre la plus grande partie de son argent à des projets utiles, au lieu qu'un simple gentilhomme campagnard est accoutumé à dépenser le sien, etc.
3° En dernier lieu, le commerce et les manufactures introduisirent par degrés l'ordre et le bon gouvernement, et avec eux la liberté et la sûreté des individus, parmi les habitants des campagnes, qui auparavant avaient vécu dans un état de guerre presque continuel avec leurs voisins, et dans une dépendance servile à l'égard de leurs supérieur. » [203]
Le développement de la population urbaine n est donc pas un fait dont on doive s'affliger. Sans doute, les tentations sont plus vives et les mauvais exemples plus nombreux dans les villes que dans les campagnes-, mais combien, d'un autre côté, les moyens d'éclairer et de moraliser les populations y sont plus abondants et plus à la portée de tous! La statistique de la justice criminelle atteste d'ailleurs que la population urbaine ne fournit point, proportion gardée, un contingent de crimes plus considérable que la population des campagnes, et cependant, il est bon de remarquer que la police est en général mieux faite dans les villes qu'elle ne peut l'être dans le reste du pays. [204]
Les mêmes progrès qui multiplient la population urbaine agissent du reste pour améliorer ses demeures. Sous l’influence des progrès de la sécurité, nous avons vu les villes descendre du sommet des plateaux et du flanc des collines dans les plaines; nous les verrons, selon toute apparence, s'étendre sur une surface de plus en plus vaste, à mesure que les communications deviendront plus économiques et plus rapides. De grandes améliorations ont déjà été réalisées dans ce sens, aussi bien que dans celui de la propreté et du bon entretien des rues, du confort intérieur des habitations et de leur aménagement économique. Qui pourrait prédire celles que l'avenir nous réserve encore?
III. De l'administration des villes. Ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être.
Les villes ont communément une administration particulière. Quelquefois même chacun de leurs quartiers a la sienne. Tantôt cette administration est nommée par l'autorité supérieure ; tantôt elle émane des membres de la cité eux-mêmes. Ce dernier mode de nomination, qui oblige les administrateurs à répondre de leurs actes devant les administrés, est ordinairement le meilleur. Quant aux errements à suivre pour bien gouverner une ville, ils ne diffèrent pas de ceux qui doivent être suivis dans le gouvernement d'une nation. L'administration de la cité comme celle de la nation doit s'attribuer uniquement les fonctions qui, par leur nature, ne peuvent être abandonnées à la concurrence des particuliers. Or ces fonctions sont peu nombreuses, et elles le deviennent de moins en moins, à mesure que le progrès fait disparaître les obstacles qui empêchent ou qui entravent l'action de la concurrence. En effet, quel que soit le zèle et le dévouement d'une administration municipale, il n'est pas dans la nature des choses que les services qui se trouvent organisés en commun dans la cité valent ceux qui sont abandonnés aux particuliers. Sans doute le désir de [838] mériter la considération publique doit pousser les administrateurs à bien faire; mais ce mobile égale-t-il jamais en puissance celui de l'intérêt qui sert de stimulant à l'industrie privée? On peut préférer l’intervention des municipalités à celle du gouvernement pour l'organisation de certains services, l'établissement et l'observation de certains règlements d'utilité publique, mais il est bon de se passer autant que possible de l'une et de l'autre.
Malheureusement les administrations municipales ont le travers de tous les gouvernements : elles aiment a se donner de l'importance et elles augmentent incessamment, dans cette vue, le nombre de leurs attributions, partant le chiffre de leurs dépenses. De notre temps, elles sont possédées surtout de la manie des travaux publics et des bâtisses, sans parler d'un goût immodéré pour les fêtes. Elles paraissent convaincues qu'en bouleversant de fond en comble les vieux quartiers aux dépens des nouveaux, en élevant édifices sur édifices, en donnant, sous le moindre prétexte, des bals, des concerts et des feux d'artifice monstres, elles contribuent efficacement à la prospérité et à la grandeur de leurs cités. Avons-nous besoin de dire qu'elles vont à l'opposé même du but qu'elles veulent atteindre? Ces travaux publics , ces bâtisses, ces fêtes somptueuses, en effet, coûtent cher, et c'est toujours, en définitive, à l'impôt qu'il faut recourir pour en couvrir les irais. On taxe donc la multitude des choses qui servent a nourrir, à vêtir, à héberger, à chauffer la population an sein de laquelle se rencontre une classe, malheureusement la plus nombreuse, qui possède a peine de quoi subvenir a ses besoins de première nécessité; on renchérit, en un mot, d'une manière artificielle, la vie dans l'enceinte de la cité. Qu'en résulte-t-il? C'est que la population et l'industrie s'écartent autant qu'elles le peuvent d'une localité où des administrateurs prodigues ont établi la cherté en permanence; c'est qu'elles vont se fixer de préférence en dehors de l'enceinte où sévit cette peste économique. Et, chose bonne à signaler encore, ce déplacement si funeste pour les propriétaires des anciennes villes, est devenu de plus en plus facile. Lorsque le manque de sécurité obligeait les populations à se concentrer dans des localités que la nature avait fortifiées, et dans lesquelles l'art venait encore en aide à la nature; lorsque, d'une autre part, la difficulté dé construire des voies de communication artificielles et de les maintenir en bon état rendait plus précieuses les voies naturelles, telles que les rivières navigables, le nombre des emplacements propres à recevoir des foyers de population était fort restreint. En même temps, la lenteur avec laquelle se bâtissaient les habitations privées et les édifices publics (on mettait quelquefois des années pour construire une maison, et des siècles pour édifier une cathédrale) condamnait la population qui se déplaçait à des privations et à des incommodités sans fin. Ces circonstances réunies attribuaient aux villes existantes, considérées comme lieux d'habitation, un véritable monopole naturel. Mais, sous l'influence des progrès que nous avons déjà signalés, ce monopole s’efface de plus en plus, et il en résulte que les populations peuvent chaque jour plus aisément se soustraire au fardeau que leur impose une mauvaise administration. Elles ne manquent point de le faire, et on les voit abandonner les villes où la vie est trop chère, en commençant par les quartiers les moins favorablement situés, pour aller grossir les faubourgs ou créer plus loin de nouveaux centres d'activité et de richesse C'est ainsi qu'en puisant magnifiquement dans la bourse des contribuables et en tirant sans scrupule force lettres de change sur les générations à venir, les administrateurs prodigues, loin d'ajouter à la prospérité de leurs cités, finissent par les précipiter dans une inévitable décadence. L'économie dans les dépenses, voilà donc quelle doit être la règle suprême du gouvernement des villes, aussi bien que du gouvernement des nations. C'est en observant cette règle, bien mieux qu'en multipliant les démolitions, les bâtisses et les fêtes, que les administrations municipales peuvent acquérir des titres sérieux et durables à la reconnaissance publique.
G. de Molinari
Endnotes to Villes
[197] Traité d'Économie politique, parJ.-B. Say. Livre 11, chap. xi.
[198] « Lorsque les industries sont destinées à pourvoir à une consommation journalière, lisons-nous dans l’Enquête, elles se posent à la portée des consommateurs; lorsqu'elles fournissent leurs produits au commerce, elles se placent en prenant surtout en considération les moyens de production. Les industries qui fournissent à l'alimentation sont presque toutes dans le premier cas; celles qui se livrent à la fabrication des articles connus dans le commerce sous le nom d'articles de Paris, sont dans le second. Il y a aussi pour les industries de l'ameublement certaines professions dont le travail est offert directement aux consommateurs, et d'autres qui sont plus particulièrement appliquées à la fabrication. C'est ainsi que l'on trouve des tapissiers sur tous les points de la ville, et que la fabrication des meubles est assise, au contraire, presque exclusivement dans le 8e arrondissement, comme la fabrication des bronzes est posée dans les 6e et 7e arrondissements.
« Sur 1,915 ébénistes, faisant pour 27,982.950 fr. d'affaires, 1,093 avec 19,679,835 fr. sont dans le 8e arrondissement.
« Et sur 2S7 fabricants de fauteuils, faisant pour 5,061,540 d'affaires, 197 avec 3,373,950 fr. sont aussi dans le 8e arrondissement.
« Le même arrondissement revendique encore la préparation des peaux et cuirs. Les tanneries et mégisseries sont presque toutes placées dans le quartier des Gobelins, sur les bords de la petite rivière qui prend ce nom en entrant dans Paris... Les produits chimiques sont peu fabriqués à l'intérieur de Paris, mais ceux qui s'y font et réclament de l'espace, de l'eau et de l'air, viennent des 8e et 12e arrondissements. De ce nombre sont l'amidon et la fécule, les bougies et chandelles; c'est là qu'un trouve également la fabrication des poteries. Le travail des métaux, la construction des machines se trouvent surtout dans les 8e, 6e et 5e arrondissements.
« Quant à la fabrication de ce qu'un appelle le plus généralement les articles de Paris, elle s'étend dans toute une partie importante de la ville, sur la rive droite de la Seine, au nord des rues des Francs-Bourgeois et Saint-Merry, et dans la zone comprise entre les rues Montorgueil et Poissonnière à l'ouest,, la place des Vosgeset la rue de la Roquette à l’est. C'est là que se font l'orfèvrerie, la bijouterie fine et fausse, que se fabriquent les nécessaires, la brosserie, la bimbeloterie, les fleurs artificielles, les parapluies, les eventails, la tabletteries, les peignes, les portefeuilles et cette multitude d'articles divers de la petite fabrique en général.» (Statistique de l'industrie à Paris, Introduction, p. 43 et 44.)
[199] Memorials o[ the empire of Japon in the XVI and XVII centuries, edited by Thomas Rundall.
[200] Ce progrès ne s'est point encore réalisé partout. Les paysans des Calabres, par exemple, au lieu de se loger dans ta campagne, sont obligés de demeurer dans les villes pour se préserver des bandits qui infestent le pays. Nous recueillons ce fait dans la correspondance de Paul-Louis Courier :
« Dans la Calabre actuelle, dit-il, ce sont des bois d'orangers, des forêts d'oliviers, des haies de citronniers. Tout cela sur la cote et seulement près des villes. Pas un village, pas une maison dans la campagne; elle est inhabitable, faute de police et de lois. Mais ccomment cuutive-t-on, direz-vous? Le paysan loge en ville et laboure la banlieue; partant lard le matin, il rentre avant le soir. Comment oserait-on coucher dans une maison des champs? On y serait égorge dès la première nuit. » Paul-Louis Courier, Correspondance. Lettre à M. de Sainte-Croix, datée de Miléto, 12 septembre 1806.
[201] Études sur les forces productives de la Russie. Tome I, p. 140.
[202] Mouvement de la population de la France pendant l'année 1850, par Alf. Legoyt. (Annuaire de l'Economie politique et de la statistique pour 1852.)
[203] De la richesse des nations, par A. Smith. Livre III, chap. IV. Comment le commerce des villes a contribué à l’amélioration des campagnes.
[204] Voici quels ont été, à cet égard, les résultats statistiques de l'administration de la justice criminelle en France, de 1826 à 1850 :
« Plus des trois cinquièmes des accusés avaient un domicile : 612 sur 1,000 habitaient des communes rurales, 388 habitaient des communes urbaines. Dans l'ensemble de la population, le nombre proportionnel des habitants des villes n'est pas parfaitement constaté; mais des évaluations approximatives le fixent à un cinquième seulement du nombre total de la population. Les proportions précédentes diffèrent suivant la nature des crimes; sur 1,000 accusés de crimes contre les personnes, on compte, année moyenne, 706 habitants de la campagne et 294 habitants des villes. Sur 1,000 accusés de crimes contre les propriétés, il n'y a plus que 566 habitants des communes rurales; 434 sont ries habitants des villes. Si l'on descend aux diverses espèces de crimes, on trouve des variations plus grandes encore.
« C'est parmi les accusés de crimes d'incendie que se présente le nombre proportionnel le plus élevé d'habitants des campagnes; ensuite viennent les accusés d'empoisonnement, d'infanticide, de faux témoignage, de parricide, d'extorsion avec, violence de titres et de signatures. Ce sont probablement les seuls crimes dans lesquels les habitants des campagnes ont une part plus large que celle qu'ils devraient avoir, eu égard à leur nombre total dans l'ensemble de la population. La proportion des accusés de la campagne est, au contraire, très faible relativement parmi les accusés de crimes politiques, d'avortement, de vols qualifiés, de faux, de fausse monnaie, de viol et d'attentat à la pudeur des enfants. » Rapport du ministre de la justice. (Annuaire de l'Economie politique et de la statistique pour 1853. Page 108.
Voyages↩
Source
"Voyages", DEP, T. 2, pp. 858-60.
[858]
Les voyages peuvent être divisés en deux grandes catégories : les voyages d'affaires et les voyages de plaisir. Les premiers, qui l'emportent infiniment quant au nombre et à l'importance sur les seconds, jouent dans la production un rôle assez considérable. Les voyages de découverte ou d'exploration, par exemple, préparent de nouveaux débouchés à l'industrie, parfois aussi de nouvelles demeures à une population surabondante. Les voyages de Christophe Colomb et des autres hardis navigateurs qui ont révélé aux peuples de l'Europe l'existence d'un nouveau monde peuvent être rangés évidemment au nombre des entreprises qui ont le plus contribué à l'accroissement de la richesse et de la civilisation générales.
Ces voyages qui servent soit à agrandir le cercle des relations internationales, soit à mettre à la disposition des peuples civilisés un supplément de terres et d'autres agents naturels non encore appropriés, ont attiré d'une manière spéciale l'attention des gouvernements. On les a encouragés et subventionnés. Sans doute, on pourrait faire un plus mauvais emploi des deniers publics : cependant l'intervention des gouvernements ne nous semble pas plus indispensable en cette matière qu'en beaucoup d'autres. De deux choses l'une, en effet. Ou la population possède l'esprit d'entreprise et les capitaux nécessaires pour s'ouvrir des débouchés au dehors et faire des expéditions lointaines, ou elle ne les possède point. Dans le premier cas, le gouvernement n'aura pas besoin d'intervenir pour encourager des entreprises vers lesquelles la population se tourne d'elle-même, guidée par ses aptitudes et son intérêt. Dans le second cas, son intervention sera plus nuisible qu'utile; car si un peuple ne possède ni les aptitudes ni les capitaux nécessaires pour fonder des établissements lointains, ce sera lui rendre un mauvais service que de l'exciter à porter son activité dans cette direction. S'il s'agit simplement de voyages destinés à concourir à l'avancement des sciences, de l'histoire naturelle, de la géologie, de la botanique, etc., l'intervention de l'État présentera moins d'inconvénients, surtout dans les pays où le gouvernement s'est attribué le monopole de l'enseignement, où, par conséquent, il a empêché plus ou moins la formation des sociétés qui auraient eu pour mission d'encourager les explorations de cette nature. Ajoutons toutefois que les sciences doivent bien moins aux voyages entrepris sous les auspices des gouvernements qu'à ceux qui ont été accomplis aux frais et risques des particuliers.
Les besoins de la production déterminent encore une multitude de voyages. La vente d'un grand nombre de marchandises s'opère par l'entremise de voyageurs de profession ; il en est de même de l'achat des matières premières nécessaires à l'industrie ou des marchandises en gros pour la revente en détail. Viennent ensuite les voyages des travailleurs qui vont porter leurs facultés industrielles ou artistiques dans les marchés les plus avantageux, ceux des apprentis, des étudiants, des artistes qui vont compléter leur éducation dans les foyers de l'industrie, de la science ou des beaux-arts, etc., etc. En comparaison de ces voyages d'affaires, ceux qui ont pour objet la distraction, le plaisir, méritent à peine d'être mentionnés. Jusqu'à une époque encore bien récente, ceux-ci ont été un luxe exclusivement réservé aux classes aisées ; mais, grâce aux progrès de la locomotion, ils commencent à être mis à la portée de tout le monde. Déjà les trains de plaisir des chemins de fer transportent au loin des masses d'individus qui naguère ne franchissaient jamais le cercle borné où les [859] retenaient leurs occupations. Rien de plus propre que cette facilité et ce bon marché des voyages à détruire les vieux préjugés qui séparent encore les peuples. Ces préjugés surannés subsistent, en effet, surtout dans la partie de la population qui se déplace le moins, c'est-à-dire qui se trouve le moins souvent en contact avec ces étrangers qu'elle déteste. Que les voyages se multiplient, que les peuples se lient de plus en plus par des relations d'affaires et de plaisirs, et les haines nationales, dont l'origine remonte aux époques où les peuples ne se connaissaient que par la guerre, c'est-à-dire par le mal qu'ils se faisaient réciproquement; ces haines désormais sans motif auront bientôt fait place à une sympathie bienveillante. Pourquoi les peuples continueraient-ils de se hair? S'ils diffèrent par la langue, les habitudes, les mœurs, les institutions, en appartiennent-ils moins à la même espèce? Et la Providence n'a-t-elle pas ordonné les choses de manière qu'ils ne puissent développer leurs facultés, satisfaire leurs besoins sans communiquer en paix, les uns avec les autres, sans échanger leurs idées et leurs produits? N'a-t-elle pas intéressé chacun à la prospérité de tous?
Mais si l'on doit s'applaudir des progrès qui permettent aux peuples de se visiter plus aisément, ce n'est pas une raison pour approuver les dépenses de luxe que font certains gouvernements et certaines administrations municipales en vue d'attirer les voyageurs étrangers. Aucune spéculation n'est plus fausse que celle-là ; aucune cependant n'est plus encouragée par les préjugés populaires. Laissons à J.-B. Say le soin de la combattre :
« Lorsqu'un voyageur étranger arrive en France, et qu'il y dépense dix mille francs, il ne faut pas croire que la France gagne dix mille francs. Elle donne à l'étranger des produits pour la somme qu'elle reçoit de lui. Elle fait avec lui un échange qui peut être avantageux pour elle ; c'est un commerce où elle rentre plus promptement peut-être dans ses avances que de toute autre manière; mais ce n'est rien autre chose qu'un commerce, même lorsqu'on lui donne de l'or.
« On n'a pas.jusqu'à présent, considéré la chose sous ce point de vue. Partant toujours de ce principe que la seule valeur réelle est celle qui se montre sous la forme d'un métal, on voyait à l'arrivée d'un voyageur une valeur de dix mille francs apportée en or ou en argent, et l'on appelait cela un gain de dix mille francs ; comme si le tailleur qui habillait l'étranger, le bijoutier qui le décorait, le traiteur qui le nourrissait, ne lui fournissaient aucune valeur en échange de son argent, et faisaient un profit égal au montant de leurs mémoires!
« L'avantage qu'un étranger procure est celui qu'on retire de toute espèce d'échange, c'est-à-dire de produire les valeurs qu'on reçoit en retour, par des procédés plus avantageux que si on les produisait directement. Il n'est point à dédaigner; mais il est bon de le réduire à sa juste valeur, pour se préserver des folles profusions au prix desquelles on s'est imaginé qu'on devait l'acheter. Un des auteurs les plus vantés pour les matières commerciales dit « que les spectacles ne sauraient être trop grands, trop magnifiques et trop multipliés; que c'est un commerce où la France reçoit toujours sans donner : » ce qui est à peu près le contraire de la vérité ; car la France donne, c'est-à-dire perd la totalité des frais de spectacles qui n'ont d'autre avantage que le plaisir qu'ils procurent , et qui ne fournissent, en remplacement des valeurs qu'ils consomment, aucune autre valeur. Ce peuvent être des choses fort agréables Comme amusements, mais ce sont assurément des combinaisons fort ridicules comme calcul. Que penserait-on d'un marchand qui ouvrirait un bal dans sa boutique, payerait des bateleurs, et distribuerait des rafraîchissements, pour faire aller son commerce?
« D'ailleurs, ajoute avec non moins de raison l'illustre Économiste, est-il bien sûr qu'une fête, un spectacle, quelque magnifiques qu'on les suppose, amènent beaucoup d'étrangers du dehors? Les étrangers ne sont-ils pas plutôt attirés, ou par le commerce, ou par de riches trésors d'antiquités, ou par de nombreux chefs-d'œuvre des arts qui ne se trouvent nulle part ailleurs, ou par un climat, des eaux singulièrement favorables à la santé, ou bien encore par le désir de visiter des lieux illustrés par de grands événements et d'apprendre une langue fort répandue? Je serais assez tenté de croire que la jouissance de quelques plaisirs futiles n'a jamais attiré de bien loin beaucoup de monde. Un spectacle, une fête font faire quelques lieues, mais rarement font entreprendre un voyage. Il n'est pas vraisemblable que l'envie de voir l'Opéra de Paris soit le motif pour lequel tant d'Allemands, de Russes, d'Anglais, d'Italiens, viennent visiter en temps de paix cette grande capitale, qui heureusement a de bien plus justes droits à la curiosité générale. Les Espagnols regardent leurs combats de taureaux comme excessivement curieux; cependant je ne pense pas que beaucoup de Français aient fait le voyage de Madrid pour en avoir le divertissement. Ces sortes de jeux sont fréquentés par les étrangers qui sont attirés dans le pays pour d'autres causes, mais ce n'est pas celle-là qui détermine leur déplacement. » [205]
Il faut donc se contenter des attractions naturelles que l'on peut offrir aux voyageurs étrangers et ne point les gratifier d'une prime sous forme de fêtes et de spectacles dont les frais retombent sur les contribuables. Les gouvernements ont, du reste, à leur disposition un moyen beaucoup plus simple et moins coûteux d'attirer les voyageurs étrangers : c'est de supprimer ou de simplifier les formalités gênantes et onéreuses des passeports et des visites douanières : c'est de n'apporter à la liberté de la circulation que les entraves rigoureusement nécessaires pour sauvegarder les intérêts du trésor et ceux de la sécurité publique.
Certains voyageurs ou touristes publient les récits de leurs pérégrinations, surtout lorsqu'ils visitent des contrées peu connues. Les voyages forment une branche intéressante et utile de la production littéraire. Malheureusement ils sont [860] trop souvent écrits avec légèreté et sans bonne foi ; quelquefois même le touriste qui raconte ses « impressions de voyage » ne s'est pas donné la peine de sortir de son cabinet. Mais quand le voyageur est un observateur attentif, judicieux et honnête, son livre devient une mine de renseignements précieux pour l'Économiste. Les Voyages d'Arthur Young peuvent être, à cet égard , cités comme des modèles.
G. de Molinari.
Endnotes to Voyages
[205] Traité d'Economie politique, par J.-B. Say. Liv. 1er, chap. XX. Des voyages et de l'expatriation par rapport à la richesse nationale. Guillaumin 1841, pp. 236-38.