
Vilfredo Pareto, TraitÉ de sociologie gÉnÉrale, vol. 2b (notes) (1919)
 |
 |
| Vilfredo Pareto (1848-1923) |
[Created: 31 Aug. 2022]
[Updated: November 30, 2022 ] |
Source
Pareto's Treatise was originally published in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.
Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).
Editor's note: Because of the text's length and complexity I have split it into 5 separate files (see the main page for details):
- vol. 1 (1917) in facs. PDF and HTML [vol. 1a text only and vol. 1b endnotes]
- vol. 2 (1919) in facs. PDF and HTML [vol. 2a text only and vol. 2b endnotes]
- my vol. 3 - tables and supplementary material
Table des matières
Volume 2a (le texte) [a separate file]
TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME
Les chapitres
- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
Volume 2b (les notes) [this file]
- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886 ↩
[FN: § 1397-1]
BENTHAM-DUMONT; Tact. des assembl. législ., Traité des sophismes politiques, t. II. L'auteur blâme l'orateur politique qui fait usage de raisonnements sophistiques, et ajoute: « (p. 129) Heureusement toutefois un orateur de ce caractère, de quelque talent qu'il brille, ne figurera jamais en première ligne dans une assemblée ; il peut éblouir, il peut surprendre, il peut avoir un succès passager, mais il n'inspire aucune confiance, même à ceux qu'il défend ; et plus on a l'expérience des assemblées politiques, plus on sent combien Cicéron est fondé à définir l'orateur : un homme de bien versé dans l'art de la parole : Vir bonus dicendi peritus ». Si, comme il le semble, tout cela tend à affirmer que seul l'orateur sincère, loyal, honnête, obtient du succès, on a une proposition mille fois démentie par l'expérience, et l'exemple même de Cicéron, donné par l'auteur, peut être cité à ce propos. Dans une note, Fox est vivement loué, justement pour les qualités indiquées, que doit avoir l'orateur ; et comme il est incontestable qu'il arriva à Fox d'avoir le dessous au parlement anglais, voilà un nouvel exemple qui dément l'affirmation. Après cela, si cette affirmation vise l'estime que certaines personnes, appelées les honnêtes gens, peuvent avoir pour un orateur, cela peut être vrai ou non, suivant le sens que l'on donne à ce terme honnêtes gens. En outre, on dévierait de la question, qui était le succès politique. Ailleurs Bentham blâme ceux qui luttent contre les ministres en s'opposant à des mesures dont eux-mêmes reconnaissent l'innocuité, et qui s'excusent en disant qu'ils font cela pour faire tomber du pouvoir des personnes qu'ils tiennent pour nuisibles au pays. « (p. 213) Si ceux que vous combattez sont tels que vous les supposez, ils ne tarderont pas à vous fournir des occasions de les combattre sans aucun préjudice de votre sincérité. Si ces occasions légitimes vous manquent, l'imputation d'incapacité ou de malversation paraît être ou fausse ou prématurée. Si, parmi ces mesures, il en est plus de mauvaises que de bonnes, l'opinion publique doit tourner nécessairement en votre faveur [qu'elle est belle, mais éloignée de la réalité, cette opinion publique !] Car on ne saurait douter qu'une mauvaise mesure ne soit beaucoup plus facile à attaquer qu'une bonne ». C'est peut-être vrai dans un monde idéal, où tout est pour le mieux ; mais cela ne semble vraiment pas être vérifié par l'expérience, dans notre monde réel. Bentham écrit un traité entier sur les sophismes politiques, et ne s'aperçoit pas qu'à chaque instant, involontairement il emploie celui qui consiste à donner l'expression de ses sentiments et de ses désirs pour le fruit de l'expérience. On nous dit, dans l'introduction: « (p. 3) Les sophismes fournissent une présomption légitime contre ceux qui s'en servent. Ce n'est qu'à défaut de bons arguments qu'on peut avoir recours à ceux-là ». Ici, il y a cette proposition implicite, que les arguments de bonne logique persuadent mieux les hommes que les arguments sophistiques. Or l'expérience est bien loin de confirmer cette proposition. « Par rapport à de bonnes mesures ils sont inutiles : du moins, ils ne peuvent pas être nécessaires ». Là aussi, la proposition indiquée tout à l'heure est, implicite, et là aussi on peut observer que l'expérience ne concorde nullement avec cette affirmation. « Ils supposent de la part de ceux qui les emploient ou qui les adoptent, un défaut de sincérité ou un défaut d'intelligence ». Ici est implicite la proposition suivant laquelle celui qui emploie un sophisme s'en rend compte (défaut de sincérité), ou s'il ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'il manque d'intelligence. Au contraire, un grand nombre de sophismes qui ont cours dans une société sont répétés avec une parfaite sincérité par des hommes très intelligents, qui expriment de cette façon des sentiments qu'ils estiment utiles à la société. Il y a, une autre proposition implicite suggérée par l'affirmation de notre auteur : c'est que le défaut de sincérité ou le défaut d'intelligence sont toujours nuisibles à la société. Bien au contraire, il y a un grand nombre de cas, ne serait-ce que dans la diplomatie, où trop de sincérité peut nuire, et d'autres dans lesquels l'homme très intelligent qui se trompe de route peut, en imposant certaines actions logiques, être nuisible à la société, à laquelle est au contraire utile l'ignorant qui continue à accomplir des actions non-logiques conseillées par une longue expérience.
[FN: § 1407-1]
ARIST., Reth., II, 21, 6 : ![]() .
.
[FN: § 1408-1]
ARIST. ; Rhet., 1, 2, 7.
[FN: § 1408-2]
ARIST. ; Rhet., II, 21, 3.
[FN: § 1409-1]
ARIST. ; Rhet., I, 2, 7.
[FN: § 1410-1]
MILL ; Logique, V, 1, 3.
[FN: § 1415-1]
BAYLE ; Dict. hist., 1, s. r. Augustin, p. 393: « Il est si manifeste à tout homme qui examine les choses sans préjugé, et avec les lumières nécessaires, que la doctrine de St. Augustin et celle de Jansenius Évêque d'Ipres sont une seule et même doctrine, qu'on ne peut voir sans indignation que la Cour de Rome se soit vantée d'avoir condamné Jansenius, et d'avoir néanmoins conservé à Saint Augustin toute sa gloire. Ce sont deux choses tout-à-fait incompatibles. Bien plus : le Concile de Trente, en condamnant la doctrine de Calvin sur le franc arbitre, a nécessairement condamné celle de Saint Augustin... » « ... Il y a des gens, pour qui c'est un grand bonheur, que le peuple ne se soucie point de se faire rendre compte sur la doctrine, et qu'il n'en soit pas même capable. Il se mutineroit plus souvent contre les Docteurs, que contre les Maltotiers. Si vous ne connoissez pas, leur diroit-on, que vous nous trompez, votre stupidité mérite qu'on vous envoie labourer la terre ; et si vous le connoissez, votre méchanceté mérite qu'on vous mette entre quatre murailles au pain et à l'eau. » Bayle se trompe. On peut êre très intelligent et accepter de bonne foi des dérivations contradictoires. Cela a lieu tous les jours, par exemple à propos du « libre arbitre ». Puis Bayle ajoute avec raison : « Mais on n'a rien à craindre : les peuples ne demandent qu'à être menez selon le train accoutumé ; et, s'ils en demandoient davantage, ils ne seroient pas capables d'entrer en discussion : leurs affaires ne leur ont pas permis d'acquérir une aussi, grande capacité ».
[FN: § 1416-1]
C'est là un cas particulier de la théorie générale de l'action réciproque des résidus et des dérivations, action dont nous parlerons aux § 1735 et sv.
[FN: § 1425-1]
SENEC., Epist., XCIV traite de l'utilité des préceptes. Nous n'avons pas à en parler ici ; mais une partie de ses observations s'applique à la nature et aux effets des affirmations. Adiice nunc, quod aperta quoque apertiora fieri solent. « Ajoutez que les choses évidentes deviennent encore plus évidentes ». On lui objecte que si les préceptes sont douteux, on devra les démontrer, et que par conséquent c'est la démonstration et non le précepte qui sera utile. Il répond : Quid quod, etiam sine probationibus, ipsa monentis auctoritas prodest ? sic quomodo iurisconsultorum valent responsa, etiam si ratio non redditur. Praeterea ipsa, quae praecipiuntur, per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt, aut prosa oratione in sententiam coarctata ; sicut illa Catoniana : « Emas, non quod opus est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse carum est ». Qualia saut illa, aut reddita oraculo, aut similia : « Tempori parce ! Te nosci ! » Numquid rationem exiges, cum tibi aliquis hos dixerit versus :
Iniuriarum remedium est oblivio.
Audentes fortuna iuvat.
Piger ipse sibi obstat.
Advocatum ista non quaerunt ; affectus ipsos tangunt, et natura vim suam exercente proficiunt. Omnium honestarum rerum semina animi gerunt, quae admonitione excitantur ; non aliter quam scintilla, flatu levi adiuta, ignem suum explicat. Il est nécessaire de modifier quelque peu cette dernière partie. Sénèque dit : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de toute chose honnête, germes que l'avertissement développe tout comme une étincelle, aidée par un souffle léger, communique son feu ». On doit dire au contraire : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile, par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de certaines choses ; les affirmations les développent, tout comme une étincelle, etc. ». Sénèque ajoute ensuite : Praeterea quaedam sunt quidem in animo, sed parum prompta ; quae incipiunt in expedito esse, cum dicta sunt. Quaedam diversis locis iacent sparsa, quae contrahere inexercitata mens non potest. Itaque in unum couferenda sunt et iungenda, ut plus valeant, animumque magis allevent. « En outre, certaines choses se trouvent dans l'esprit, mais sont informes ; elles prennent forme quand on les dit. Certaines choses gisent éparses en divers lieux ; un esprit inexpérimenté ne peut les rassembler. C'est pourquoi il faut les rassembler et les unir, pour qu'elles aient plus de valeur et qu'elles profitent davantage à l'esprit ». C'est bien cela, et les effets des affirmations sont bien décrits.
[FN: § 1426-1]
Par exemple, Levit., XTX, 3 : ![]()
![]() . (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.
. (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.
NOTE DU TRADUCTEUR.] LAO-TSEU ; Le livre de la Voie et de la Vertu : « (Chap. XXI, p. 75). Voici quelle est la nature du Tao [Vérité, Voie, Absolu, etc.]. Il est vague, il est confus. Qu'il est confus, qu'il est vague ! Au dedans de lui il y a des images. Qu'il est vague, qu’il est confus ! Au dedans de lui il y a des êtres. Qu'il est profond, qu'il est obscur ! » – La poésie donne toutes sortes de formes à cette affirmation de renfort. La ballade notamment fournit de nombreux exemples dans le refrain de ses couplets. Ainsi la Ballade que feit Villon à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame : « En ceste foy je vueil vivre et mourir ». Cependant tous les refrains de ballade ne sont pas de simples affirmations de renfort. Ainsi, dans la Ballade des dames du temps jadis : « Mais où sont les neiges d'antan ? », le refrain n'est pas une affirmation indépendante de l'enchaînement logique des idées exprimées par le contexte ; c'est plutôt une conclusion répétée et en vue de laquelle sont faits les couplets.
[FN: § 1431-1]
Journal des Goncourt, 2e série, 2d vol., tome V, 1872-1877, p. 9 : « Aujourd'hui, chez le français, le journal a remplacé le catéchisme. Un premier Paris de Machin ou de Chose devient un article de foi, que l'abonné accepte avec la même absence de libre examen que chez le catholique d'autrefois trouvait le mystère de la Trinité [sic] ».
[FN: § 1435-1]
BENTHAM-DUMONT, loc. cit., § 1397-1 émet une opinion entièrement erronée. « (p. 23) C'est par l'autorité que se soutiennent depuis tant de siècles les systèmes les plus discordans, les opinions les plus monstrueuses [ces opinions se soutiennent grâce aux résidus, et sont expliquées au moyen des dérivations, parmi lesquelles se trouve celle de l'autorité]. Les religions (p. 24) des Brames, de Foë, de Mahomet, n'ont pas d'autre appui [ce n'est pas du tout cela ; l'autorité n'est qu'une des nombreuses dérivations employées pour expliquer ces persistances d'agrégats]. Si l'autorité a une force imprescriptible, le genre humain, dans ces vastes contrées, n'a pas l'espoir de sortir jamais des ténèbres ». Là, il y a d'abord l'erreur habituelle de supposer logiques toutes les actions humaines, et d'admettre que les croyances sont imposées par le raisonnement, tandis qu'elles sont au contraire dictées par le sentiment. Ensuite, il est implicitement établi une opposition entre la religion du Progrès, acceptée par l'auteur, et la « superstition » de l'autorité, superstition qu'il combat. Accepter cette dernière signifierait renoncer à toute espérance de progrès pour les peuples indiqués par l'auteur ; et comme on ne peut renoncer à cette espérance, on doit repousser la superstition. Ainsi, comme d'habitude, on confond l'utilité d'une doctrine et son accord avec les faits expérimentaux.
[FN: § 1435-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] On trouve un mélange de cette considération logico-expérimentale avec d'autres considérations logiques et le résidu de la vénération, dans la fameuse loi des citations, en droit romain ; loi par laquelle les empereurs Théodose II et Valentinien III graduèrent l'autorité des jurisconsultes les plus éminents. On trouve un mélange semblable dans la doctrine théologique des opinions probables. entre lesquelles elle est expérimentalement valide (§ 1881-1). En tout temps on a pu répéter : Sutor, ne ultra crepidam.
[FN: § 1436-1]
C'étaient là en grande partie des actions logiques, parce qu'on croyait alors que M. Roosevelt serait de nouveau président des États-Unis, et l'on avait en vue d'obtenir de lui quelques avantages. En opposition avec ces flatteries, il convient de rappeler que le pape ne reçut pas M. Roosevelt; qu'un patricien gênois lui refusa l'accès de son palais, et que Maximilien Harden écrivit un article où il tournait en dérision les adulateurs de M. Roosevelt en Allemagne.
[FN: § 1436-2]
ANDREW LANG; La Jeanne d'Arc de M. Anatole France. Le chapitre IX a pour titre : La forêt des erreurs. A. France affirmait que « (p. 94) l'impôt prélevé... sur le peuple de Domrémy ne montait pas à moins de deux-cent-vingt écus d'or », Lang démontra, antérieurement à la publication de son livre, que « pour que vraiment l'impôt atteignît une telle somme, nous aurions à supposer que la population de Domrémy égalait au moins celle d'Orléans ». Et il ajoute : « J'avais déjà signalé l'erreur : elle est restée intacte dans l'édition „ corrigée “. (p. 95) Obstinément, M. France maintient qu'une certaine jeune femme, dont le fils était le filleul de Jeanne, „ blasonnait celle-ci à cause de sa dévotion “ : de quoi il nous donne pour preuve le témoignage de cette femme. Or il n'y a pas un mot de cela dans le témoignage qu'il invoque ; et je ne suis pas le seul à le lui avoir rappelé. C'est ainsi qu'il va, „ puisant aux meilleures sources “, suivant l'expression de sa nouvelle préface, et les interprétant „ avec la sagacité critique d'un véritable érudit “, à en croire le bienveillant M. Gabriel Monod ». Lang relève aussi des erreurs de moindre importance, mais qui montrent que A. France en prenait un peu à son aise en écrivant son livre. « (p. 97) Dans un petit passage de l'écrit célèbre de Gerson, on pourrait dire que chaque phrase traduite est un contresens. Un vers proverbial de Caton : Arbitrii nostri non est quod quisque loquatur † devient chez M. France : „ Nos arbitres, ce n'est pas ce que chacun dit “. Gerson écrit, à propos des faux bruits qui courent sur la Pucelle : Si multi multa loquantur pro garrulitate sua et levitate, aut dolositate, aut alio sinistro favore vel odio... ; ce que M. France interprète ainsi : „ Si plusieurs apportent divers témoignages sur le caquet de Jeanne, sa légèreté, son astuce... “. Dans la phrase suivante, Gerson rappelle le mot de l'apôtre : Non oportet servum dei litigare ; et M. France traduit : „ On ne doit pas mettre en cause le serviteur de Dieu “». L'auteur cite une grave erreur d'A. France et ajoute : « (p. 102) Que M. France, en même temps qu'il découvrait dans le témoignage de Dunois certaines choses qui n'y étaient point, ait négligé de découvrir ailleurs que d'Aulon faisait partie du Conseil Royal, et avait été appelé par le roi, avec les autres conseillers, à examiner la première requête de Jeanne, c'est ce qui désormais doit nous paraître tout naturel. Mais que, après avoir été averti sur ce point par „ les louables scrupules de M. Andrew Lang “, il ait répété son invention dans son édition „ corrigée “ il y a là un procédé vraiment regrettable ».
Bien que S. REINACH se montre très favorable à A. France, il est obligé de reconnaître les erreurs de l'écrivain. Cultes, mythes et religions, t. IV: « p. 311) M. Lang, je veux le dire tout de suite, a souvent raison contre M. France, bien (p. 312) qu'il lui arrive d'attribuer beaucoup d'importance à des vétilles ». Plus loin, il reconnaît que, dans la 28e édition de son livre, A. France a maintenu des erreurs qui lui avaient été indiquées. « (p. 320) Malgré les améliorations ainsi apportées par l'auteur, l'ouvrage reste fort incorrect... Peut-être faut-il penser qu'il a divisé sa tâche, qu'il a employé ce qu'on appelle „ un nègre “ et que ce nègre, par malheur, n'était pas un bon nègre ».
† A. France ne s'est pas rappelé que dans les Dicta Calonis, si connus et admirés aux siècles passés, il est écrit, III. 2 :
Cum recte vivas, ne cures verba malorum :
Arbitrii non est nostri, quid quisque loquatur.
« Quand tu vis droitement, ne prends pas garde aux paroles des méchants : nous ne sommes pas maîtres de ce que chacun dit ».
[FN: § 1437-1]
MAIMBOURG ; Hist. de l'Arian., t. 1 (p. 17) Je sçay bien qu'on n'est pas toûjours obligé de croire ces sortes de choses qui sont si extraordinaires, et qu'on appelle visions, particulièrement quand elles n'ont pas pour garant quelque Auteur célèbre, dont le nom seul puisse servir de preuve authentique. Mais je n'ignore pas aussi que l'Histoire, en laissant la liberté d'en croire ce que l'on voudra, ne peut, sans un peu trop de délicatesse, et même sans quelque sorte de malignité, supprimer celles qui ont esté (p. 18.) receùës, depuis tant de siècles, par des gens qu'on ne sçauroit accuser de foiblesse, sans se ruiner de réputation ».
[FN: § 1438-2]
Loc. cit., § 1438, : (c. 5, 1) Non itaque pergo per plurima quae mandata sunt litteris [dérivation explicite d'autorité], non gesta atque transacta sed in locis quibusque manentia ; quo si quisquam ire voluerit et potuerit, utrum vera sint, explorabit, sed pauca commemoro. C'est là une dérivation implicite d'autorité. Dire que n'importe qui pouvait aller voir que ces faits étaient vrais, revient à dire que l'on croyait cette vérification possible ; mais, en réalité celui qui serait effectivement allé n'aurait pu voir des faits qui n'existaient pas.
[FN: § 1438-1]
D. AUG.; De civ. Dei, XXI, c. 2. D'abord, l'auteur affirme qu'il se placera dans le domaine expérimental : (3) Nolunt enim hoc ad Omnipotentis nos referre potentiam, sed aliquo exemplo persuadere sibi flagitant. « Car ils [les incrédules] ne veulent pas que nous rapportions cela à la puissance du Tout-Puissant, mais demandent qu'on les persuade par quelque exemple ». Et il se met en devoir de le faire. Mais les incrédules sont si obstinés et pervers, qu'ils veulent avoir les preuves de ses affirmations. « Si nous leur répondons qu'il y a des animaux certainement corruptibles, parce que mortels, et qui néanmoins vivent au milieu du feu, et qu'il se trouve aussi un genre de vers dans les fontaines chaudes dont personne ne peut impunément supporter la chaleur, tandis que non seulement ces vers y vivent sans en souffrir, mais qu'ils ne peuvent vivre ailleurs, ou bien ils [les incrédules] ne veulent pas nous croire, si nous ne sommes pas en mesure de leur faire voir ces choses [quels obstinés !] : ou bien, si nous pouvons les leur mettre sous les yeux ou en donner la preuve par des témoins dignes de foi, cela ne suffit pas à les arracher à leur incrédulité, et ils objectent que ces animaux ne vivent pas toujours et qu'ils vivent sans souffrir, dans cette chaleur... ». Si vraiment cette objection a été, faite au saint, il a raison de la repousser; mais reste à prouver le fait de ces animaux ! L'autorité vient à son secours : « (c. 4, l) Donc si, comme l'ont écrit des auteurs qui étudièrent plus curieusement la nature des animaux, la salamandre vit dans les flammes,... », et si l'âme peut souffrir sans périr, on conclut qu'en vérité les damnés peuvent souffrir éternellement dans le feu de la géhenne. On ajoute que Dieu peut bien donner à la chair la propriété de ne pas se consumer dans le feu puisqu'il a donné à la chair du paon la propriété de ne pas se corrompre. Là-dessus. le saint fit aussi une expérience ! Il mit de côté un morceau de la poitrine d'un paon cuit. Au bout d'un certain temps, tel que toute autre chair cuite aurait été putréfiée, ce morceau lui fut présenté, et son odorat ne fut en rien offusqué. Au bout de trente jours, le morceau de chair fut trouvé dans le même état ; de même après un an, seulement il était alors un peu sec et ratatiné : nisi quod aliquantum corpulentiae siccioris et contractioris fuit. Une autre merveille est celle du diamant, qui résiste au fer, au feu, à n'importe quelle force, excepté au sang de bouc. Quand on met un diamant auprès d'une magnétite, celle-ci n'attire plus le fer. Ensuite, l'auteur observe que les incrédules insistent et veulent connaître la raison des faits miraculeux qu'il affirme : (c. 5, 1) Verumtamen homines infideles, qui cum divina vel praeterita, vel future, miracula praedicamus, quae illis experienda non valemus ostendere, rationem a nobis earum flagitant rerum ; quam quoniam non possumus reddere (excedunt enim vires mentis humanae), existimant falsa esse quae dicimus : ipsi de tot mirabilibus rebus, quas vel yidere possumus, vel videmus, debent reddere rationem. Jusque là, le saint a raison. Ne pas connaître la cause d'un fait ne prouve rien contre sa réalité. Mais reste toujours à prouver directement le fait, et c'est en quoi Saint Augustin est en défaut. Presque tous les faits qu'il donne pour certains sont fantaisistes. 1° Le sel d'Agrigente, en Sicile, se dissout dans le feu comme dans l'eau ; dans l'eau, il crépite comme dans le feu : cum fuerit admotus igni, velut in aqua fluescere : cum vero ipsi aquae, velut in igne crepitare. PLINE. XXXI, 41, 2, diffère un peu : Agrigentinus ignium patiens, ex aqua exsilit. 2° Chez les Garamantes, il y a une fontaine dont les eaux sont si froides, de jour, qu'on ne peut les boire, si chaudes, de nuit, qu'on ne peut les toucher (PLIN.; V, 5, 6 : itemque Debris, afiaso fonte, a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus, totidemque horis ad medium diem rigentibus). 3° En Épire, il y a une fontaine où, comme dans les autres fontaines, les torches allumées s'éteignent, mais où, contrairement à ce qui a lieu dans les autres fontaines, les torches s'allument si elles sont éteintes. (POMP. MELA, 11, 3 : PLIN., II, 106, 7 : LUCR., De rer. nat., VI, 880 et sv., veut expliquer un fait analogue). 4° L'asbeste est une pierre d'Arcadie, ainsi nommée, parce qu'une fois allumée. elle ne peut jamais plus s'éteindre (PLIN., XXXVII. 54, 7, dit seulement que c'est une pierre d'Arcadie : SOLIN., 13, ajoute : accensus semel, extingui nequit). 5° En Égypte, le bois d'un figuier ne flotte pas sur l'eau : il va au fond, et au bout d'un certain temps, il revient à la surface (PLIN., XIII, 14, 2). 6° Au pays de Sodome, il y a des fruits qui, lorsqu'ils semblent mûrs, s'évanouissent en fumée et en cendres si on les touche avec la bouche ou avec la main (SOLIN., 38 ; IOSEPH., De bello iud., IV. 8, 4 (27). 7° En Perse, il y a une pierre qui brûle si on la presse fortement avec la main. et qui, de ce fait. porte le nom de pyrite (PLIN., XXXVII, 73, 1). 8° En Perse aussi, il y a une pierre nommée sélénite, dont la blancheur intérieure augmente et diminue avec la lune (PLIN., XXXVII, 67, 1). 9° En Cappadoce, les cavales conçoivent des œuvres du vent, mais leurs poulains ne vivent pas plus de trois ans (§ 927-3). 10° L'île de Tilo, aux Indes, est préférée à toutes les autres, parce que les arbres n'y perdent pas leurs feuilles. Ce dernier fait est le seul qui ait une lointaine apparence de réalité, pourvu qu'on ne l'applique pas à une île, mais à toute la région tropicale.
[FN: § 1438-3]
Loc. cit. § 1438-1, XXI, c. 6, 1 : « À cela, ils répondront peut-être sans autre que ces choses [celles dont il est question au § 1438-1] n'existent pas ; qu'ils n'y croient pas, qu'on en parle et qu'on en écrit faussement, et, ayant recours au raisonnement, ils ajouteront que s'il faut croire ces choses, vous devez, vous aussi, croire ce qui est rapporté dans les mêmes ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a eu ou qu'il y a un certain temple de Vénus, où existe un candélabre avec une lampe à ciel ouvert, qu'aucune tempête, aucune pluie ne peuvent éteindre ». Ainsi, on voulait placer Saint Augustin dans l'alternative, ou de nier cela, et par conséquent de refuser créance aux témoignages dont il se prévalait pour les autres faits, ou d'admettre l'existence des dieux du paganisme. Mais il s’en tire en observant qu'il n'est pas obligé de croire tout ce qui se trouve dans les histoires des païens – non habemus necesse omnia credere quae continet historia gentium – parce que, comme le dit Varron, sur de nombreux faits, ils ne sont pas d'accord. Nous croyons, dit-il, à ceux sur lesquels ils ne sont pas en désaccord – quae non adversantur libris – et que nous pouvons prouver par de bons témoins. Pourtant, ces témoins, il ne les nomme pas, de même que les fidèles de la Sainte Science ne les nomment pas, quand ils affirment que tous les hommes sont égaux ou solidaires. Puis Saint Augustin reprend l'offensive. À la lampe de Vénus, il ajoute tous les miracles de la magie, lesquels on ne saurait nier sans aller à l'encontre des Saintes Écritures : « Donc, ou bien cette lumière est machinée par l'art humain, avec l’asbeste, ou bien ce qu'on voit dans le temple est l'œuvre de la magie, ou bien, sous le nom de Vénus, un démon s'est manifesté avec tant d'efficace, que ce prodige est apparu à tous les hommes et a duré ». Il conclut (c. 6, 2) que si les magiciens ont tant de pouvoir, on doit à plus forte raison croire que Dieu, qui est tellement plus puissant qu'eux, peut faire bien d'autres miracles : – quanto magis Deus potens est facere quae infidelibus sunt incredibilia, sed illius facilia potestati ; quandoquidem ipse lapidum aliarumque vim rerum et hominum ingenia, qui es miris utuntur modis, angelicasque naturas omnibus terrenis potentiores animantibus condidit. – Il faut observer ici le raisonnement en cercle, qui manque rarement aux dérivations concrètes du genre de celles de Saint Augustin. Opposer les Saintes Écritures à qui en nie l'autorité, les miracles du démon Vénus à qui nie les miracles, la puissance du Dieu des chrétiens à qui nie l'existence de ce Dieu, c'est proprement prendre la conclusion pour les prémisses.
[FN: § 1438-4]
Loc. cit. § 1438-1 : (c. 7, 2) Nam nec ego volo temere credi cuncta quae posui, quia nec a me ipso ita creduntur tanquam nulla de illis sit in mea cogitatione dubitatio, exceptis his quae vel ipse sum expertus, et cuivis facile est experiri. Excellente intention, à laquelle malheureusement l'auteur ne reste guère fidèle. Outre des faits en partie vrais, il excepte justement deux des récits les moins croyables : celui de la fontaine d'Épire où s'allument les torches, et celui des fruits du pays de Sodome. Il avoue n'avoir pas connu de témoins oculaires de la fontaine d'Épire, mais il en a connu qui avaient vu une fontaine semblable à Gratianopolis (Grenoble). « Quant aux fruits des arbres de Sodome, non seulement des lettres dignes de foi en ont fait mention, mais de plus, ceux qui en parlent pour les avoir vus sont si nombreux que je ne puis douter du fait – ut hinc dubitare non possim ». Remarquez cette façon de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, procédé habituel en beaucoup de ces dérivations, et qui naît du besoin d'agir sur le sentiment, sans se soucier des contradictions qui apparaîtraient dans un raisonnement logico-expérimental. Saint Augustin commence par nous donner pour certaines les merveilles qu'il a racontées ; il dit même que quiconque veut peut les voir. Il appelle aussi comme témoins du fait du diamant les joailliers de son pays, puis, quand l'effet désiré est produit, il émet quelque doute, pour ménager la chèvre et le chou. De même, les admirateurs de la solidarité commencent par invoquer la solidarité-fait, et quand ils s'en sont bien servis, ils daignent reconnaître qu'elle est l'opposé de la solidarité-devoir (§ 450-1).
[FN: § 1439-1]
LUC.; Philopseudes. L'incrédule Tykhiadès dit ironiquement : « Oh, comment ne pas croire, dis-je à Eucratès fils de Dinon, homme d'un si grand âge, et qui, en sa maison, parle avec autorité de ce qui lui plaît ? » Plus loin : « Comme Arignôtos, qui était un savant célèbre et inspiré, avait dit cela, il n'y eut personne de la compagnie qui ne me traitât de fou, parce que je ne croyais pas à ces choses, dites par un Arignôtos. Mais moi, sans respect pour sa grande chevelure ni sa grande renommée : „ Et comment, Arignôtos, lui dis-je, toi aussi tu es un homme qui fais espérer la vérité, et puis tu donnes de la fumée et de vaines apparences ? Tu confirmes le proverbe : „ Nous cherchons un trésor et nous trouvons des charbons “. – „ Eh bien, répondit Arignôtos, si tu ne crois ni à mes paroles, ni à Dinomakos, ni à Kléodèmos, ni à Eukratès lui-même, eh bien cite un homme de plus grande autorité, qui dise le contraire de nous “. Et moi je répondis : „ Si, par Zeus, cet admirable homme de Démocrite d'Abdère “... ».
[FN: § 1439-2]
Après avoir cité une infinité d'exemples d'hommes devenus loups et redevenus hommes, Bodin s'étonne qu'on puisse douter d'une chose qui a pour elle le consentement universel. BODIN; De la démonomanie des sorciers, II, 6 : « (p. 99)... Nous lisons aussi en l'histoire de Ian Tritesme, que l'an neuf-cens LXX, il y auoit vn Iuif nommé Baian, fils de Simeon, qui se transformoit en loup, quand il vouloit, et se rendoit inuisible quand il vouloit. Or c'est chose bien estrange : Mais ie trouue encores plus estrange, que plusieurs ne le peuuent croire, veu que tous peuples de la terre, et toute l'antiquité en demeure d'accord. Car non seulement Herodote l'a escript il y a deux mil deux cens ans, et quatre cens ans au parauant Homere : ains aussi Pomponius Mela, Solin, Strabo, Dionysius Afer, Marc Varron, Virgile, Ouide, et infinis autres ». Le Père Le Brun veut se tenir dans un juste milieu entre la crédulité et l'incrédulité. Certes, on ne doit pas tout croire, «(p. 118) mais une obstination à ne croire, vient ordinairement d'un orgueil excessif qui porte à se mettre au-dessus des autorités les plus respectables et à préférer ses lumières à celles des plus grands hommes et des Philosophes les plus judicieux » (LE BRUN ; Hist. crit. des prat. superst., t. I). Dom Calmet, suivant ces principes, observe que « (p. 63) Plutarque dont on connoît la gravité et la sagesse, parle souvent de Spectres et d'apparitions, il dit par exemple que dans la fameuse bataille de Marathon contre les Perses, plusieurs soldats virent le phantome de Thésée qui combattoit pour les Grecs contre les ennemis » (DOM CALMET ; Dissert. sur les apparitions).
[FN: § 1440-1]
Collection A. Aulard. – Morale, par A. BAYET, Cours moyen. – Ce M. Aulard est le même qui reprochait à Taine de n'ètre pas assez rigoureux et précis. Il faut remarquer que la loi proposée à la Chambre, pour « la défense de l'école laïque » punit ceux qui ont l'audace de détourner les jeunes gens d'ajouter foi à de si belles doctrines.
[FN: § 1440-2]
Journal de Genève, 29 avril 1909 : « En collaboration avec plus de cent médecins de Suisse et de l'étranger [voilà l'autorité qui doit s'imposer à tout le monde] il a examiné 2051 familles. Sur la foi d'un matériel considérable, il a conclu ce qui suit : „ Lorsque le père est un buveur, la fille perd la faculté d'allaiter son enfant, et cette faculté est irrémédiablement perdue pour les générations suivantes il ne peut avoir connaissance du passé, mais peut-être connaît-il l'avenir par une somnambule]. De même chez les buveurs modérés (moins d'un litre de vin ou deux litres de bière par jour) l'alcoolisation du père est la cause principale de l'impuissance de la femme à allaiter ses enfants “ ». En Allemagne, les femmes qui peuvent allaiter doivent être bien rares, car peu nombreux sont les hommes des classes aisées qui ne boivent pas au moins deux litres de bière par jour. Comme d'habitude, les dérivations servent à démontrer aussi bien le pour que le contre. Quand on veut engager les mères à allaiter leurs bébés, le discours change, et la statistique complaisante démontre également bien que les mères ont ou qu'elles n'ont pas la faculté d'allaiter. – Journal de Genève, 27 octobre 1910 : « ... Mlle Louise-Hedwige Kettler, a fait plus de 1700 observations à la maternité et elle aboutit à d'intéressantes conclusions. Nous nous garderons d'entrer dans le détail. Qu'il nous suffise de dire que l'impossibilité absolue pour la mère de nourrir son enfant doit être considérée comme très rare, que le 93,42 % des femmes observées pendant ces trois dernières années étaient capables de remplir leurs devoirs, et que les raisons physiques empêchant l'allaitement sont en somme peu nombreuses. Que les mères y prennent garde, en recourant à l'alimentation artificielle elles risquent de créer une génération incapable d'allaiter ». Il suffit de connaître même très superficiellement Genève, pour être certain que le 93 % des femmes ne sont pas filles de parents qui ne boivent ni vin ni autres boissons alcooliques. Mais, dans la logique des dérivations, deux propositions contradictoires peuvent être vraies en même temps.
[FN: § 1441-1]
Le Journal de Genève rapporte en ces termes une conférence faite par un médecin de la ville : « Sérieusement documenté, et se basant sur les recherches de l'École de Heidelberg …, le Dr, Audéoud a démontré que la quantité d'alcool absolu contenu dans un demi-litre de vin ou deux litres de bière environ suffisait à faire diminuer de 25 à 40 % la capacité de travail cérébral. Cette déperdition est due à l'influence paralysante et stupéfiante de l'alcool, influence qui se fait sentir plusieurs jours encore après l'absorption du poison... Ce résultat est le fruit d'années entières de laborieuses expériences et scrupuleuses observations ».
[FN: § 1441-2]
BUSCH.; Les mém. de Bism., t. I, p. 43: « Il y avait sur la table du COGnac, du bordeaux et un petit vin mousseux de Mayence. Quelqu'un regretta qu'il n'y eût pas de bière. „ Il n'y a pas de mal ! “ s'écria M. de Bismarck. „ Une consommation excessive de bière est déplorable à tous les points de vue. Cela rend les hommes stupides, paresseux et propres à rien. C'est la bière qui est responsable de toutes les idioties démocratiques que l'on débite autour des tables de cabaret. Croyez-moi, un bon verre d'eau-de-vie vaut bien mieux ! “ » T. II, p. 307. Tombé du pouvoir, Bismarck se retire à Friedrichsruh. Il charge Busch d'y transporter ses effets : « „ Tenez “, fit-il, „ ce sont des cartes de géographie. Mettez les lettres entre les cartes et roulez le tout... Cela partira avec le reste dans le déménagement. J'ai près de 300 caisses ou malles et plus de 13 000 bouteilles de vin “. Il me raconta qu'il avait beaucoup de bon sherry qu'il avait acheté, quand il était riche... ». – PALAMENGHI-CRISPI ; Carteggi,.. di Francesco Crispi : « (p. 446) Ottone di Bismarck a Crispi. Friedrichisruh, le 7 janvier 1890. Cher ami et collègue, J'ai été vivement touché de la nouvelle preuve de Votre amitié en apprenant que Vous m'avez fait expédier une caisse de Votre excellent vin d'Italie, que j'apprécie d'autant plus que la qualité supérieure du vin de l'année dernière m'en fait anticiper les avantages. Les bons vins ne sont jamais sans influence sur la qualité de la politique du buveur ». Pauvre Bismarck, combien peu de capacité de « travail intellectuel » il devait avoir !
[FN: § 1442-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] L'argument d'autorité joue un grand rôle dans la vulgarisation de la science, laquelle dissimule souvent des visées pratiques ou de propagande. Voici ce qu'on raconte, sous l'autorité de la Science, à certaines populations, éclairées. La Terre vaudoise, journal agricole... 18 septembre 1915. Utilisons nos fruits (signé E. P.). « On peut dire que l'acide urique, résidu fatal de l'excès alimentaire des viandes, est le plus grand ennemi de l'humanité ; c'est lui qui engendre les arthritismes, les maladies de Bright, les néphrites, la goutte, les maladies du foie, le rhumatisme, l'alcoolisme, le cancer, les affections de l'estomac... Le sucre aliment devrait tuer l'alcool poison. Les mangeurs de fruits n'ont jamais soif. Dans lus fruits frais, les frugivores trouvent à la fois boisson et nourriture solide, satisfaisant ainsi les deux besoins de l'organisme ».
[FN: § 1447-1]
À ce genre appartiennent les 4e, 5e, 6e et 7e, dérivations de l'exemple suivant. Nous avons vu (§ 1266-5) qu'Ovide rapporte les usages suivis pour les purifications, aux fêtes Palilies. Il veut trouver leur « origine », les expliquer; c'est-à-dire qu'il cherche des dérivations, et il n'en trouve pas moins de sept (Fast., IV, 783-806). En peu de mots, elles sont les suivantes : « 1° Le feu purifie tout. 2° L'eau et le feu sont les principes contraires de toutes les choses. 3° Les principes de la vie sont dans ces éléments. 4° Le feu et l'eau rappellent Phaéton et le déluge de Deucalion. 5° Les bergers découvrirent le feu grâce à la pierre à feu. 6° Énée s'enfuit à travers les flammes, qui ne-le brûlèrent pas. 7° Un souvenir de la fondation de Rome, quand les cabanes où les Romains habitaient primitivement furent brûlées. Et Ovide préfère cette dernière explication. Les trois premières dérivations puisent leur force dans certains sentiments métaphysiques (genre III-epsilon) ; les quatre dernières, dans la tradition (genre II-β). Il est évident qu'on pourrait encore trouver d'autres dérivations analogues : c'est la partie variable du phénomène. Le besoin de purification (résidus V-γ) et l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe) constituent la partie constante et de majeure importance, puisque c'est d'elle que la partie variable tire ensuite son origine. Notez que dans cette partie constante, le besoin de purification est un élément principal, tandis que les combinaisons en vue de le satisfaire sont subordonnées. Nous avons donc, dans l'ensemble : 1° les résidus, constitués par (a) des résidus principaux (purification), (b) des résidus secondaires (combinaisons) ; 2° les dérivations qui visent à expliquer cet ensemble de résidus, et qui sont en général destinées à « expliquer » les résidus (b).
[FN: § 1454-1]
L. GAUTIER ; Introd. à l'anc. Test. L'auteur a écrit un livre rempli de science et de critique historique. Dans la conclusion, il répond à ceux qui le blâment sur plusieurs points; t. II : « (p. 507) Enfin je veux relever encore une dernière phrase, qui revient avec insistance dans les polémiques actuelles : La critique, dit-on, „ attaque et ruine l'autorité des Écritures “. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il s'agit avant tout de s'entendre sur le sens du mot „ autorité “. S'il est question de l'autorité extérieure [euphémisme pour indiquer des propositions objectives] l'assertion ci-dessus est fondée ; mais si l'autorité en cause est du domaine intérieur [euphémisme pour indiquer des propositions subjectives ; de cette façon, on dissimule la pétition de principe que fait le croyant, en acceptant de la Bible ce qu'il y met lui-même, ce qui est déjà dans son esprit] et de l'ordre spirituel, on peut hardiment affirmer qu'elle n'est compromise en rien [très juste : une tautologie n'est jamais fausse]. Le tout c'est d'être au clair sur ce point fondamental : l'autorité en matière religieuse, c'est celle de Dieu, et sur le terrain plus spécial de la vérité évangélique, c'est celle du Christ [très juste ; mais il faut nous apprendre comment on parvient à connaître ces volontés ; si nous les connaissons par des critères qui nous sont extrinsèques, elles peuvent être indépendantes de nous ; si nous ne les connaissons que par des critères qui nous sont intrinsèques, nous baptisons notre volonté du nom de volonté divine]. Cette autorité s'exerce sur le cœur et sur la conscience, tout en faisant appel à l'ensemble de nos facultés, en vertu même de l'unité de notre être. Elle est au-dessus des discussions de l'ordre littéraire et historique ; elle ne saurait être ébranlée, ni consolidée, par des arguments purement intellectuels [très juste, mais seulement dans ce sens que les résidus sont indépendants de la logique ; resterait ensuite à démontrer que ces résidus sont divins ; et s'il y en avait de diaboliques, comme le veulent certains hérétiques ?]. Elle n'est point atteinte par le fait que, sur des questions d'authenticité et d'historicité, on aboutit à des solutions autres que les données traditionnelles ».
[FN: § 1456-1]
Il est vraiment singulier de voir l'importance que les « libres-penseurs », adorateurs de la déesse Science, donnent à cet argument. On comprend que pour qui croit à la mission divine de Jeanne d'Arc, chaque détail de sa vie soit de la plus haute importance ; de même pour qui en fait une sainte de la religion patriotique ; mais pour qui prétend cultiver uniquement la science expérimentale, le fait de Jeanne d'Arc est un fait historique semblable à tant d'autres, et les problèmes posés à propos des plus menus détails ont une importance minime.
[FN: § 1459-1]
Summ. Theol., Suppl., quaes., I, Sed attritionis principium est timor servilis,contritionis autem timor filialis.– Can. et dec. Conc.Tridentini, sessio XIV, c. IV : Contritio... animi dolor se detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero... Illam vero contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse et Spiritus sancti impulsum,... quo poenitens adiutus viam sibi ad iustitiam parat. – GURY ; Casus consc., II : (p. 182) Albertus, peracta confessione, interrogatur a Confessario quonam motivo ad dolendum de peccatis moveatur. Respondet poenitens : «Doleo de peccatis, quia timeo ne Deus me puniat in hac vita aerumnis, vel morte subitanea, et post mortem aeternis cruciatibus. – Numquid, mi bone, ait Confessarius, eodem modo doluisti de peccatis in antecessum, quando ad confitendum accedebas ? » Affirmat Albertus. Quapropter iudicat Confessarius invalidas fuisse illius confessiones, utpote amore divino destitutas et solo timore peractas... Hinc : Quaer. 1° An attritio sufficiat ?... (p 183), 405, – R. ad Im Quaes. Attritio sufficit, nec requiritur contritio perfecta ad iustificationem in Sacramento Poenitentiae. – Menag., IV, p. 157 : « M. Boileau Despréaux était un jour chez feu M. le Premier Président à Basville. Il y avoit là des Casuistes qui soûtenoient hardiment qu'un certain Auteur connu, avoit eu raison de faire un livre exprès pour prouver que nous n'étions point obligez d'aimer Dieu, et que ceux qui soûtenoient le contraire, avoient tort et imposoient un joug insupportable au Chrétien, dont Dieu l'avoit affranchi par la nouvelle Loi. Comme la dispute sur ce sujet s'échauffoit, M. Despréaux qui avoit gardé jusqu'alors un profond silence : Ah ! la belle chose, s'écria-t-il en se levant, que ce sera au jour du dernier Jugement, lorsque notre Seigneur dira à ses Elûs : Venez, les bien-aimez de mon Pere, parce que vous ne m'avez jamais aimé de votre vie, que vous avez toûjours défendu de m'aimer, et que vous vous êtes toûjours fortement opposez à ces hérétiques, qui vouloient obliger les Chrétiens de m'aimer. Et vous au contraire, allez au Diable et en Enfer, vous les maudits de mon Pere, parce que vous m'avez aimé, de tout votre cœur, et que vous avez sollicité et pressé tout le monde de m'aimer .... ». – BOILEAU ; Épître, s. XII, Sur l'amour de Dieu.
[FN: § 1462-1]
TACIT. ; Germ., 14 : Si civitas in qua orti sunt longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes quae tum bellum aliquod gerunt. – MICHAUD ; Hist. des Crois., t. I : « (p. 117) L'assurance de l'impunité, l'espoir d'un meilleur sort, l'amour même de la licence et l'envie de secouer les chaînes les plus sacrées, firent accourir la multitude sous les bannières de la croisade. (p. 119) L'ambition ne fut peut-être pas étrangère à leur dévouement pour la cause de Jésus-Christ. Si la religion promettait ses récompenses à ceux qui allaient combattre pour elle, la fortune leur promettait [aux chevaliers] aussi les richesses et les trônes de la terre. Ceux qui revenaient d'Orient parlaient avec enthousiasme des merveilles qu'ils avaient vues, des (p. 120) riches provinces qu'ils avaient traversées. On savait que deux ou trois cents pèlerins normands avaient conquis la Pouille et la Sicile sur les Sarrasins ». En note : « Robert-le-Frison, second fils des comtes de Flandre, ne pouvant avoir de part dans les biens de sa maison, dit à son père : „ Donnez-moi des hommes et des vaisseaux, et j'irai conquérir un état chez les Sarrasins d'Espagne “. Cette interpellation se rencontre souvent dans les romans du moyen-âge, expression fidèle des mœurs contemporaines : „ Beau sire, baillez-moi hommes suffisans, pour me faire téat ou royaume. – Beau fils, aurez ce que vous demandez “ ».
[FN: § 1463-1]
Gazette de Lausanne, 29 mars 1912 : « Du Figaro [sous la signature de ÉMILE DE SAINT-AUBAN]. Un instituteur, qui donne une claque à un morveux, paraît aujourd'hui un sauvage ; il a violé les droits du mioche et du citoyen : il pèche contre le type admis de civilisation ; il encourt un blâme plus sérieux que celui de ses collègues qui nie, en pleine école, la Patrie. Mais l'écraseur qui, au mépris du piéton négligeable, cultive le cent-quarante, ne commet qu'une peccadille ; on absout, ou peu s'en faut, l'auto dont les péchés ne sont mortels que pour les braves gens qu'ils tuent. J'ai noté l'exploit d'un terrible autobus qui zigzaguait comme un pochard, rue Notre-Dame-de-Victoires, et malmena deux gamins ; des passants se fâchèrent ; un monsieur s'étonna : „ Ce n'est pas la faute du wattman ! observa-t-il ; cet homme apprend à conduire ! ... “ L'autobus faisait ses études ! L'autobus jetait sa gourme ! On s'amusa de la réponse ; un souriant fait divers retint l'explication. Quel religieux souci de la vie humaine ! »
[FN: § 1463-2]
Le Parlement italien a le plus grand soin des intérêts des industriels et des trusts ;c'est pourquoi, en 1912, il approuva une loi qui supprime le peu de protection accordée jusqu'alors aux piétons contre les conducteurs et les propriétaires d'automobiles.
[FN: § 1470-1]
GOUSSET ; théol.dogmat., t. I p. 325 : « Toutes les nations ont conservé une idée plus ou moins distincte de l'unité de Dieu. „ Il faut, dit Bergier, ou que cette idée ait été gravée dans tous les esprits par le Créateur lui-même, ou que ce soit un reste de tradition qui remonte jusqu'à l'origine du genre humain, puisqu'on la trouve dans tous les temps aussi bien que dans tous les pays du monde “ (Dictionnaire de Théologie, art. Dieu) ». – Idem. Ibidem : « (p. 309) Les prophéties sont possibles... les juifs et les chrétiens ont toujours cru aux prophéties : les patriarches et les gentils ont eu la même croyance ; tous les peuples ont conservé quelque souvenir des prédictions qui annonçaient un Libérateur, qui a été l'attente des nations... Il faut donc admettre la possibilité des prophéties. Il en est des prophéties comme des miracles ; jamais les peuples ne se seraient accordés à les croire possibles, si cette croyance n'était fondée sur la tradition, sur l'expérience, et sur la raison ». – Idem, Ibidem, t. I : « (p. 342) La croyance de, l'immortalité de l'âme remonte jusqu'au premier âge du monde... l'immortalité de l'âme a toujours été un dogme fondamental de la religion chez les chrétiens, les hébreux et les patriarches. On trouve la même croyance chez les autres peuples, même chez les peuples les plus barbares... (p. 343) Et cette croyance s'est transmise aux peuples modernes : lorsque les voyageurs européens ont découvert l'Amérique et d'autres pays lointains, ils n'ont trouvé aucune nation qui frit privée de la notion d'un état à venir».
[FN: § 1470-2]
SEXT. EMP. : IX, Adv. phys., p. 565 (60) : ![]()
![]()
![]() . « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE :
. « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE : ![]()
![]() . «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit :
. «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit : ![]()
![]() « Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.
« Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.
[FN: § 1470-3]
MAX. TYR. ; Dissert., XVII. Suivant PLUTARQ.; De plac. philosoph I, 6, 9, nous tenons de trois sources la notion du culte des dieux : des philosophes par la nature, des poètes par la poésie, du consentement des lois des cités.
[FN: § 1471-1]
Ce procédé est aujourd'hui encore d'un usage fréquent. Il y en a des exemples tant qu'on en veut. TOLSTOÏ ; Les quatre Évangiles. « (p. 10) J'ai trouvé de braves gens non dans une seule religion mais dans différentes, et chez tous la vie était basée sur la doctrine du Christ ». Reste à savoir ce que Tolstoï entend par le terme « braves gens ». S'il lui donne le sens qu'il a ordinairement, il ne peut ignorer qu'il y a des « braves gens » qui ne pensent pas du tout comme lui, et qui, par exemple, refusent de donner leur consentement à ses doctrines condamnant toutes les guerres, incitant à refuser de faire le service militaire, et voulant, sous prétexte de ne pas « résister au mal », qu'on laisse le champ libre aux malfaiteurs. Comme il prétend que ses idées ont pour fondement la doctrine du Christ, il devient évident qu'on ne peut affirmer que tous ceux qui portent le nom de « braves gens » vivent selon la doctrine du Christ. Il faut donc changer le sens de ce terme, si l'on veut conserver la proposition de Tolstoï. Pour qu'elle ait un sens, il faut qu'on nous donne la définition de cette catégorie qui porte le nom de « braves gens », et, en outre, il est nécessaire que cette définition soit indépendante de l'acceptation ou du rejet de cette doctrine ; parce que si l'on fait entrer dans la définition, d'une manière ou d'une autre, même implicitement, la condition que les « braves gens » sont ceux qui vivent selon la doctrine du Christ, telle que l'interprète Tolstoï, il est vrai qu'il ne sera pas difficile de démontrer que tous ceux qui rentrent dans la catégorie des « braves gens » vivent suivant cette doctrine ; mais il n'est pas moins vrai que ce sera là une simple tautologie. En réalité, Tolstoï et ses admirateurs ne se soucient pas de tout cela : chez eux, le sentiment supplée à l'observation des faits et à la logique. Ils ont certaines conceptions de ce qui leur paraît « bon ». D'une part, ils excluent naturellement de la catégorie des « braves gens » ceux qui ont des conceptions différentes, lesquelles leur paraissent nécessairement « mauvaises ». D'autre part, ils croient, ils s'imaginent tenir ces conceptions de la doctrine d'un homme qu'ils révèrent, aiment, admirent : tandis qu'en réalité ils façonnent cette doctrine suivant leurs propres conceptions. Dans le cas de Tolstoï et de ses adeptes, cet homme est le Christ ; mais ce pourrait être un autre, sans la moindre difficulté ; par exemple Bouddha, Mahomet, Socrate, etc. La proposition de Tolstoï signifie donc simplement : « J'appelle braves gens ceux qui suivent des doctrines où il me semble retrouver celle du Christ, telle qu'il me plait de l'imaginer ».
[FN: § 1471-2]
MAX. TYR. ; Diss., XVII, 5. Platon aussi s'en tire en injuriant ses adversaires. – PLAT.; De leg., X, p. 887. Il dit de ceux qui, niant les dieux, le mettent dans la nécessité d'en prouver l'existence, qu'on ne peut les tolérer et qu'il faut les haïr. Il est plein de colère contre eux ; pourtant il contient son indignation, et tâche d'amener la discussion sur ces individus corrompus par la volupté et privés d'intelligence : ![]() (p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?
(p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?
[FN: § 1471-3]
BAYLE, Cont. des pens. div. , t. 1, § XVIII, p. 65, cite le Père RAPIN, Comp. de Platon et dAristote, ch. dernier, n. 11, p. m. 425, qui dit ; « Ce consentement si général de tous les peuples, dont il ne s'est jamais trouvé aucun sans la creance d'un Dieu, est un instinct de la nature qui ne peut-être faux, estant si universel. Et ce seroit une sottise d'ecouter sur cela le sentiment de deux ou trois libertins tout au plus, qui ont nié la Divinité dans chaque siecle, pour vivre plus tranquillement dans le desordre ». Un peu plus haut il avait dit : « Cette verité... n'est contestée que par des esprits corrompus par la sensualité, la presomption et l'ignorance... Il n'y a rien de plus monstrueux dans la nature que l'atheisme : c'est un déreglement d'esprit conceu dans le libertinage : ce ne sera point un homme sage, reglé, raisonnable, qui s'avisera de douter de la Religion ». Dans le Journal de Genève, 11 juin 1913, on lit, à propos du prix décerné par l'Académie française à Romain Rolland : « L'adversaire le plus intraitable de M. Romain Rolland aurait été, dit-on, un académicien qui eut jadis une des intelligences les plus souples et les plus libres de son temps, et qui, en avançant en âge, est devenu à tel point sectaire qu'il ne voit plus dans Tolstoï qu'un malheureux ayant abouti à une faillite morale et digne, tout au plus, de pitié ». Nous sommes donc, enfermés dans le dilemme, ou d'accepter les raisonnements de Tolstoï, estimés cependant peu sensés par beaucoup de personnes, ou d'être déclarés sectaires. Mais pourquoi se trouve-t-il des gens pour employer cette artillerie de carton ? Évidemment parce qu'il y a des personnes qui la craignent comme si elle était sérieuse, et qui, entendant ses coups, dignes tout au plus de provoquer le rire, se tâtent les côtes pour savoir s'ils sont blessés.
[FN: § 1472-1]
CIC. ; De nat. deor., I, 23, 62. Gotta répond à Velleius qui avait donné le consentement général pour preuve de l'existence des dieux : Quod enim omnium gentium generumque hominibus ita viderelur, id satis magnum esse argumentum dixisti, cur esse Deos confiteremur. Quod cum leve per se, tum etiam falsum est. Primum enim unde notae tibi sunt opiniones nationum ? Equidem arbitror multas esse gentes sic immanite efferatas, ut apud eas nulla suspicio deorum sit. (63) Quid ? Diagoras, atheos qui dictus est, posteaque Theodorus, nonne aperte deorum naturam sustulerunt ? – DIOD. SIC., III, 9, affirme qu'une partie des Éthiopiens nient l'existence des dieux. – Dans ses notes à la traduction de DIODORE DE SICILE, MIOT observe à ce propos : « Les anciens étaient persuadés qu'il n'y avait, sur la surface de la terre, aucune nation qui fit profession d'athéisme : et c'est sur ce consentement unanime de tous les peuples, qu'une des principales preuves de l'existence de Dieu a toujours été établie ». Le livre a été publié en 1833 ! – En deux passages, STRABON cite des peuples sans religion : III, c. 4, 16, p. 164, 250. ![]() « Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177.
« Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177. ![]()
![]() . « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative :
. « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative : ![]() –
– ![]() ; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.
; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.
[FN: § 1475-1]
CIC., De nat. deor., emploie les deux procédés. Velleius dit :(I, 17,44) De quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est. « Ce à quoi tout le monde consent naturellement est vrai nécessairement ». Cela pourrait suffire ; et puisqu'il a commencé par dire que tous les hommes ont la notion des dieux, il en résulte la conclusion que : Esse igitur Deos confitendum est. « Il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux ». Mais Velleius n'est pas satisfait : il veut encore expliquer comment et pourquoi les hommes ont cette notion. Il loue Épicure d'avoir démontré l'existence des dieux par un moyen expérimental, opposé aux vains songes des autres philosophes : (I, 16, 43) Solus enim vidit primum esse Deos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset ipsa natura. Notez qu'il exprimerait la même chose, en disant simplement que cette notion est dans tous les esprits ; mais il appelle à son aide madame Nature, parce que cette entité métaphysique confère de l'autorité au raisonnement. Cela ne suffit pas ; cette notion est même une prénotion : (I, 16, 43) Quae est enim gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quamdam Deorum ? quam appellat ![]() Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.
Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.
[FN: § 1479-1]
Ici, nous envisageons exclusivement sous l'aspect des dérivations un cas particulier d'une théorie générale qui sera exposée plus loin (§ 1897 et sv.).
[FN: § 1481-1]
Les Européens sont souvent induits en erreur, et prennent le tabou pour une conséquence de l'intervention divine, tandis qu'au contraire, c'est celle-ci qui est la conséquence de celui-là. – DE RIENZI : Océanie, t. I : « (p. 53) Plus que tout autre habitant de la Polynésie, le Zeelandais est aveuglément soumis aux superstitions du tapou [tabou], et cela sans avoir conservé en aucune façon l'idée du principe de morale sur lequel cette pratique était fondée ». Il ne l'a pas conservée, parce qu'elle n'a jamais existé en lui. « Il croit seulement que le tapou est agréable à l'atoua (Dieu), et cela lui suffit comme motif déterminant [dérivation ajoutée au tabou] : en outre il est convaincu que tout objet, soit être vivant, soit matière inanimée, frappé d'un tapou par un prêtre, se trouve dès lors au pouvoir immédiat de la divinité, et par là même interdit à tout profane contact ». Là apparaît le préjugé religieux de l'Européen ; il parle d'un prêtre, et peu après nous apprend que tout chef peut imposer le tabou : « (p. 54) On sent bien que le tapou sera d'autant plus solennel et plus respectable qu'il émanera d'un personnage plus important. L'homme du peuple, sujet à tous les tapous des divers chefs de la tribu, n'a guère d'autre pouvoir que de se l'imposer à lui-même ». Puis : « (p. 54) Il est bien entendu que les chefs et les arikis, ou prêtres, savent toujours se concerter ensemble pour assurer aux tapous toute leur inviolabilité. D'ailleurs les chefs sont le plus souvent arikis eux-mêmes, ou du moins les arikis tiennent de très près aux chefs par les liens du sang ou des alliances ».
[FN: § 1482-1]
S. REINACH : Cultes, mythes et religions, t. I.
[FN: § 1483-1]
Collection A. Aulard. Morale, par A. BAYET, p. 57 : « Pour être heureux, il faut aimer tous les hommes. Mais avant tout il faut aimer ses parents ». Notez bien que c'est une morale laïque et scientifique, qu'on dit très supérieure à la morale religieuse ; et notez aussi que la morale de ce bon M. Aulard ne plagie jamais la morale biblique.
[FN: § 1484-1]
DE RIENZI ; Océanie, t. II : « (p. 89) L'abolition définitive de l'idolâtrie et du tabou fut... l'œuvre de Rio-Rio, fils et successeur du grand Tamea-Mea... (p. 40) L'abolition du tabou, cet antique symbole d'inviolabilité, demanda à Rio-Rio encore plus d'adresse. Il s'adressa d'abord au grand-prêtre... et il fut assez heureux pour le mettre dans son parti. Pour accomplir cette innovation, le tabou qui pesait sur les femmes fut frappé le premier. Le roi attendit un jour de grande fête, où les indigènes venaient en foule entourer le palais et assister au royal festin. Les nattes ayant été disposées, et les mets destinés aux hommes mis sur une natte, et ceux des femmes sur d'autres nattes, le roi arriva, choisit parmi ses aliments plusieurs mets interdits aux femmes, passa de leur côté, se mit à en manger et à leur en faire manger. Aussitôt le peuple de pousser des cris d'horreur et de crier : „ Tabou ! Tabou ! “ Mais Rio-Rio, ne tenant nul compte de leurs cris continua à manger. Les prêtres, prévenus par la foule, accoururent du moraï, et simulèrent d'abord une grande indignation. „ Voilà, en effet, dirent-ils une violation manifeste au tabou ; mais pourquoi les dieux offensés ne s'en vengent-ils pas eux-mêmes ?... Ce sont donc des dieux impuissants ou des faux dieux “. Venez, habitants d'Haouaï (s'écria le grand-prêtre), débarrassons-nous d'un culte incommode, absurde et barbare “. Et, armé d'un flambeau, il mit lui-même le feu au moraï principal ». Les missionnaires applaudissaient ; mais étaient-ils certains que leurs tabous à eux auraient mieux supporté l'épreuve ? – DRAPER ; Les conf. de la science et de la relig. Après les victoires d'Héraclée : « (p. 55) Quoique l'Empire romain eût relevé l'honneur de ses armes et reconquis son territoire, il y eut une chose qu'il ne put reconquérir. La foi religieuse était irréparablement perdue. Le magisme avait insulté le christianisme à la face du monde, en profanant ses sanctuaires – Bethléem, Gethsémani, le calvaire – en brûlant la sépulture du Christ... en enlevant, au milieu de cris de triomphe, la croix du Sauveur. Les miracles avaient autrefois abondé en Syrie, en Égypte, en Asie Mineure. Il s'en était fait dans les occasions les moins importantes et pour les objets les plus insignifiants ; et pourtant, dans ce moment suprême, aucun miracle ne s'était accompli ! Les populations chrétiennes de l'Orient furent remplies d'étonnement quand elles virent les sacrilèges des Perses, perpétrés avec impunité... Dans la terre classique du miracle, l'étonnement fut suivi de la consternation et la consternation s'éteignit dans le doute ».
[FN: § 1486-1]
BENTHAM-DUMONT : traités de lég. civ. et pén., t. I. Plus loin : « (p. 317) Il est absurde de raisonner sur le bonheur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations : il est absurde de vouloir démontrer par des calculs, qu'un homme doit se trouver heureux, lorsqu'il se trouve malheureux... » Et pourtant c'est justement ce que fait l'auteur. – BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. II : « (p. 113) Chacun est le meilleur juge de la valeur de ses plaisirs et de ses peines ».
[FN: § 1488-1]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 103)... il pourrait arriver que l'acte qui nous promet un plaisir actuel fût préjudiciable à ceux qui font partie de la société à laquelle nous appartenons : et ceux-ci, ayant éprouvé un dommage de notre part, se trouveraient portés par le sentiment seul de la conservation personnelle, à chercher les moyens de se venger de nous, en nous infligeant une somme de peine égale ou supérieure à la somme de plaisir que nous aurions goûtée ». Le sophisme gît dans la conséquence supposée : 1° il ne suffit pas d'être disposé à se venger ; il faut encore pouvoir. L'auteur ramène les deux choses à une seule. 2° Qui lui a dit que « la somme de peine » que peuvent infliger ceux que nous avons offensés, sera « égale ou supérieure » à la «somme de plaisir que nous aurions goûtée ? ». Que fait-il du cas où cette somme serait moindre ? 3° Et si quelqu'un disait : « Le plaisir présent que me procure l'acte que vous voulez me persuader de ne pas accomplir est, à mon avis, plus grand que la peine future et seulement probable qui en sera la conséquence ; donc, suivant votre principe même, il est absurde de vouloir m'en priver, en raisonnant sur mon bonheur autrement que par mes propres désirs et mes propres sensations ». Que pourrait opposer Bentham, sans tomber en contradiction avec lui-même ?
[FN: § 1488-2]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 143) Timothée et Walter sont deux apprentis. Le premier est imprudent et étourdi ; l'autre est prudent et sage. Le premier se livre au vice de l'ivrognerie ; le second s'en abstient. Voyons maintenant les conséquences : 1° Sanction physique. Un mal de tête punit T. de chaque excès nouveau. Pour se refaire, il se met au lit jusqu'au lendemain ; sa constitution s'énerve par ce relâchement ; et, quand il retourne au travail, son ouvrage a cessé d'être pour lui une source de satisfaction ». Au contraire, W., dont la santé était faible, la fortifie ; il est heureux : « 2° Sanction sociale. T. a une sœur qui prend un vif intérêt à son bonheur. Elle lui fait d'abord des reproches, puis le néglige, puis l'abandonne. Elle était pour lui une source de bonheur. Cette source, il la perd ». Et s'il n'avait pas de sœur ? Et si, ayant une sœur, elle restait avec lui ? Et si c'était une de ces personnes qu'il vaut mieux perdre que trouver ? W. a, au contraire, un frère qui d'abord s'occupait peu de lui, et qui devient ensuite son meilleur ami. « (p. 1411) 30 Sanction populaire. T. était membre d'un club riche et respecté. Un jour il s'y rend en état d'ivresse ; il insulte le secrétaire, et est expulsé par un vote unanime. Les habitudes régulières de W. avaient attiré l'attention de son maître. Il dit un jour à son banquier : Ce jeune homme est fait pour quelque chose de plus élevé. Le banquier s'en (p. 145) souvient, et à la première occasion, il l’emploie dans sa maison. Son avancement est rapide : sa position devient de plus en plus brillante ; et des hommes riches et influents le consultent sur des affaires de la plus haute importance ». L'auteur devait vivre dans le pays de Cocagne, où tous ceux qui avaient une conduite régulière étaient récompenses de cette façon. « 4° Sanction légale ». T. est condamné à la déportation : W. devient magistrat. Bentham vivait vraiment dans un bien beau pays, où le vice était ainsi puni et la vertu récompensée. Il y a d'autres pays, où les choses ne vont pas si facilement ; « 5° Sanction religieuse ». T. craint la vie future. W. la considère avec des sentiments d'espérance et de paix.
[FN: § 1489-1]
BENTHAM-LAROCHE: Déontologie, t. I : « (p. 66) Nul doute qu'accidentellement la bonne renommée ne puisse tomber en partage à l'homme déméritant, et la mauvaise à l'homme méritant. Mais si ce funeste état de chose est possible, si on en est quelquefois témoin, il est rare qu'il dure longtemps ; cet argument, fût-il même plus vrai, sied mal à un moraliste... ». Donc, même s'il est vrai, il ne faut pas le dire. Cela peut être : mais il faut que Bentham choisisse son but. Veut-il faire un prêche ou exposer un théorème scientifique ?
[FN: § 1489-2]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. 1. Bowring, qui recueillit et publia les théories de Bentham, met à la fin du premier volume un essai sur le principe « du plus grand bonheur ». « Coup d'œil sur le principe de la maximisation du bonheur, son origine et son développement. (p. 355) Le docteur Priestley publia, en 1768, son Essai sur le Gouvernement. C'est dans cet ouvrage qu'il désigna en italiques, „ le plus grand bonheur du plus grand nombre “, comme le seul but juste et raisonnable d'un bon gouvernement ». On remarquera que les épithètes juste, raisonnable, bon gouvernement, nous font rentrer dans cette métaphysique dont Bentham avait cru s'échapper. « (p. 355) Cette formule laissait bien loin derrière elle tout ce qui l'avait précédé. Ce n'est pas seulement le bonheur qu'elle proclamait, mais encore sa diffusion ; elle l'associait à la majorité, au grand nombre ». Comment elle l'associait ! Elle le remplaçait ; puisque ce second principe, en de nombreux cas, s'oppose manifestement au premier. « (p. 379) Ce fut en 1882 dans son Projet de codification, que Bentham fit usage pour la première fois de cette formule „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “. Tout ce qui est proposé dans cet ouvrage y est subordonné à une nécessité fondamentale, „ le plus grand bonheur du plus grand nombre “ ». C'est très bien ; mais, dans ce cas, pourquoi vient-on nous dire que chaque homme est seul juge de son bonheur, ou bien : « (II, p. 16) Qu'on fasse retentir tant qu'on voudra des mots sonores et vides de sens, ils n'auront (p. 17) aucune action sur l'esprit de l'homme, rien ne saurait agir sur lui, si ce n'est l'appréhension du plaisir et de la peine » ? Pourtant, il semble que Bentham n'était pas entièrement satisfait de sa formule : « (I, p. 388) Bentham, dans les dernières années de sa vie, après avoir soumis à un examen plus approfondi cette formule : „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “, crut ne pas y trouver cette clarté et cette exactitude qui l'avaient d'abord recommandée à son attention... (p. 391) Bien que cette formule : „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “ ne satisfît pas Bentham, on peut douter cependant qu'il N ait réellement des raisons suffisantes pour la rejeter ».
[FN: § 1490-1]
BENTHAM-DUMONT ; Traité de lég. civ. et pén., t. I. Il avait dit d'abord « (p. 318) Quoi qu'il en soit, si l'esclavage étoit établi dans une telle proportion qu'il n'y eût qu'un seul esclave pour chaque maître, j'hésiterois peut-être, avant de prononcer, sur la balance entre l'avantage de l'un et le désavantage de l'autre. Il seroit possible qu'à tout prendre, la somme du bien, dans cet arrangement, fût presque égale à celle du mal. Ce n'est pas ainsi que les choses vont. Dès que l'esclavage est établi, il devient le lot du plus grand nombre... L'avantage est du côté d'un seul, les désavantages sont du côté de la multitude ». Au nom de ce principe, on devrait approuver l'anthropophagie du plus grand nombre, parce qu'elle ferait le malheur de peu de gens et le bonheur de beaucoup.
[FN: § 1490-2]
BENTHAM-DUMONT ; Traités de lég. civ. et pén., t. I. L'auteur proscrit le « principe arbitraire » de la sympathie ou de l'antipathie. Il blâme ceux qui invoquent (p. 11) la « conscience ou sens moral », le « sens commun ». En 1789, quand il publia son Introduction aux principes de la morale et de la législation, Bentham admettait les principes de sympathie et d'antipathie ; mais ensuite il changea d'avis et les exclut.
[FN: § 1491-1]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. II (Préface de BOWRING.) « (p. 3) Il n'y a, à proprement parler, que deux partis en morale ou en politique, de même (p. 4) qu'en religion. L'un pour, l'autre contre l'exercice illimité de la raison. Je l'avoue, j'appartiens au premier de ces partis ».
[FN: § 1492-1]
BENTHAM-LAROCHE : Déontologie, t. I, p. 20-22. – JOHN STUART MILL Logique, trad. PEISSE, 1. VI, c. 12, § 7. – Voir Manuel, I, 29, p. 56-57, pour une théorie de Spencer, qui tend à confondre le principe égoïste avec le principe altruiste.
[FN: § 1493-1]
B. DE SPINOZA ; Opera, Eth., IV, Prop. XVIII, Scholium : Si enim duo ex. gr. eiusdem prorsus naturae individua invicem iunguntur, individuum componunt singulo duplo potentius. Homini igitur nihil homine utilius ; nihil, inquam, homines praestantius ad suum esse conservandum optare possunt, quam quod omnes in omnibus ita conveniant... ex quibus sequitur, homines, qui Ratione gubernantur, hoc est homines, qui ex ductu Rationis suum utile quaerunt, nihil sibi appetere, quod reliquis hominibus non cupiant, atque adeo eosdem iustos, gidos, atque honestos esse.
[FN: § 1493-2]
B. DE SPINOZA : loc. cit. 1493-1 traduct. de CH.. APPUHN.
[FN: § 1493-3]
D'HOLBACH ; Syst. de la nat., t. II. Le vrai sens du système de la nature, c. IX : « (p. 436) Le but de l'homme de se conserver et de rendre son existence heureuse. L'expérience lui apprend que les autres lui sont nécessaires. Elle lui indique la façon de les faire concourir à ses desseins. Il voit ce qui est approuvé, et ce qui déplaît : ces expériences lui donnent l'idée du juste. La vertu comme le vice ne sont point fondés sur des conventions, mais sur les rapports qui sont entre les êtres de l'espèce humaine. Les devoirs des hommes entre eux dérivent de la nécessité d'employer les moyens qui tendent à la fin que leur nature se propose. C'est en concourant au bonheur d'autrui, que nous l'engageons à faire le nôtre ».
[FN: § 1494-1]
BURLAMAQUI : Élém.du dr. nat. I, c. VI : « (p. 322) La première remarque que l'on peut faire... c'est que l'observation exacte des lois naturelles est ordinairement accompagnée de plusieurs avantages très considérables, tels que sont la force et la santé du corps, la perfection et la tranquillité de l'esprit, l'amour et la bienveillance des autres hommes. Au contraire, la violation de ces mêmes lois est pour (p. 323) l'ordinaire suivie de plusieurs maux, comme le sont la faiblesse, les maladies, les préjugés les erreurs, le mépris et la haine des hommes. Cependant ces peines et ces récompenses naturelles ne paraissent pas suffisantes pour bien établir la sanction des lois naturelles ; car 1° les maux qui accompagnent ordinairement la violation des lois naturelles ne sont pas toujours assez considérables pour retenir les hommes dans le devoir. 2° Il arrive souvent que les gens de bien sont malheureux dans cette vie, et que les méchants jouissent tranquillement du fruit de leur crime. 3° Enfin il y a même des occasions où l'homme vertueux ne saurait s'acquitter de son devoir et satisfaire aux lois naturelles sans s'exposer au plus grand des maux naturels, je veux dire à la mort ». L'auteur démontre longuement l'immortalité de l’âme, la nécessité d'admettre que Dieu récompense les bons et punit les méchants ; il conclut : « (p. 327) Concluons donc que tout ce que nous connaissons de la nature de l'homme, de la nature de Dieu, et des vues qu'il s'est proposées en créant le genre humain [qui donc a révélé ces vues à notre auteur ?], concourt (p. 328) également à prouver la réalité des lois naturelles, leur sanction et la certitude d'une vie à venir, dans laquelle cette sanction se manifestera par des peines et des récompenses ».
[FN: § 1495-1]
NOVICOW ; La morale et l'intérêt : « (p. 20) La base fondamentale de la morale est le respect absolu des droits du prochain. Mais ce n'est nullement par amour du prochain qu'il faut respecter ses droits, c'est uniquement par amour de soi ». L'auteur dit : « (p. 49) L'idée qu'on s'enrichit plus vite en spoliant le voisin qu'en travaillant, idée qui paraît vraie n'est pas vraie en réalité. Le fait justement opposé, qu'on s'enrichit le plus vite possible, en respectant scrupuleusement les droits du voisin, est seul conforme à la réalité des choses ». Donc, on n'a jamais vu quelqu'un s'enrichir par des moyens qui ne fussent tout à fait moraux ! « (p. 50) Toutes les fois qu'un ouvrier use de la violence pour se faire payer un salaire supérieur au prix naturel du marché [que peut bien être ce prix naturel ?], il se vole lui-même. Toutes les fois qu'un patron emploie la violence pour payer à l'ouvrier un salaire inférieur au prix naturel du marché, il se vole lui-même. (p. 51) Essayons de nous représenter ce que serait le monde si les hommes, ne trouvant plus conforme à leurs intérêts de spolier le voisin, s'abstenaient de le faire sous n'importe quelle forme. Immédiatement il n'y aurait plus ni serrures, ni coffres-forts, ni forteresses, ni cuirassés. Il n'y aurait non plus ni gardiens, ni avocats, ni juges, ni police, ni soldats, ni marins militaires. [En note : « Bien entendu pour les causes civiles, car les crimes passionnels continueraient à se produire »]. Dans cette société, il ne se ferait ni procès, ni grèves, ni sabotages, ni lock-outs, ni spéculations véreuses... (p. 51) En un mot, dans la société antispoliatrice, la production serait la plus grande et la plus rapide qui (p. 52) puisse se réaliser sur le globe ; donc la richesse atteindrait son point culminant. Maintenant, richesse, bien-être, bonheur et intérêt sont des termes synonymes. D'autre part, respect absolu des droits du prochain et morale sont aussi des notions identiques. Lors donc que notre intérêt sera le mieux satisfait lorsque nous nous conduirons de la façon la plus morale, comment peut-on contester l'identité de la morale et de l'intérêt ? » Le sophisme du raisonnement général apparaît mieux encore en un cas particulier. « (p. 56) Un juge a-t-il véritablement intérêt à se vendre ? Certes non, et, quand il se vend, c'est faute de comprendre qu'il n'a aucun avantage à le faire... l'expérience montre que les juges ont les traitements les plus élevés, précisément dans les pays où ils ne vendent pas leur conscience. L'incorruptibilité des juges contribue, dans une forte mesure, à augmenter la richesse sociale, et, plus la richesse sociale est considérable, mieux peuvent être payés les fonctionnaires publics. Ainsi un juge mal informé croit qu'il aura plus de revenu en vendant la justice ; un juge bien informé sait que c'est le contraire. Mais un juge qui sait qu'il gagnera plus en restant incorruptible comprend qu'il est conforme à son intérêt de rester incorruptible ». Supposons vraie l'affirmation quelque peu arbitraire suivant laquelle les juges sont mieux payés quand ils sont incorruptibles, et occupons-nous uniquement des erreurs de logique. l° Le dilemme posé par l'auteur n'existe pas : il n'y a pas à choisir uniquement entre un état où tous les juges sont corruptibles, et un autre état où. ils sont tous incorruptibles. Il y a les états intermédiaires. Par exemple, si tous sont incorruptibles moins un, celui-ci jouit de l'avantage général supposé par l'auteur, et en outre, de l'utilité particulière qu'il obtient en se laissant corrompre. Si tous sont corruptibles moins un, celui-ci souffre du mal général, et il a en plus son mal particulier, en refusant les avantages de la corruption. 2° Il ne suffit pas de prouver que les juges incorruptibles sont mieux payés que les juges corruptibles ; il faut encore démontrer que quantitativement cet avantage général dépasse l'utilité particulière de la corruption. Par exemple, les juges incorruptibles reçoivent 30 000 fr. par année ; les corruptibles 6 000 fr. On offre à l'un de ces derniers 100 000 fr. pour le corrompre ; il ferait une perte, s'il refusait dans l'espérance lointaine, très lointaine et incertaine, de recevoir à l'avenir 30 000 fr. par an.
[FN: § 1496-1]
Une plaisanterie qui a pris diverses formes, selon les différents auteurs, est ainsi racontée par POGGE ; (éd. LISEUX, t. II) : « (p. 61), 158. Un religieux de grande autorité, et qui prêchait continuellement au peuple, était souvent exhorté par un usurier vicentin, à flétrir énergiquement les usuriers, et à condamner fortement ce grand vice, qui sévissait particulièrement dans la ville ; et l'usurier insistait au point d'ennuyer le religieux. Surpris de ce qu'il insistait continuellement pour faire châtier le métier qu'il exerçait lui-même, quelqu'un lui demanda la raison de tant de sollicitude. „ Ceux qui exercent le métier d'usurier sont si nombreux en cette contrée, dit-il, qu'il me vient très peu de clients ; en sorte que je ne gagne rien. Mais si les autres usuriers étaient dissuadés d'exercer leur métier, c'est à moi que reviendraient tous leurs gains “ ».
[FN: § 1497-1]
Pour plus détails, voir Systèmes socialistes , t. II, p. 225 et sv.
[FN: § 1501-1]
Dict. SAGLIO, s. r. Noxalis actio : « (p. 114). Le propriétaire est, dans certains cas, responsable du dommage causé par ses animaux. D'après les Douze Tables, il faut que l'animal soit un quadrupède... La jurisprudence étendit plus tard cette règle aux dommages causés par les bipèdes. La victime est autorisée à poursuivre le propriétaire de l'animal par une action spéciale appelée de pauperie. Le propriétaire a le choix entre deux partis : faire l'abandon de l'animal ou réparer le dommage. En lui donnant la faculté de faire un abandon noxal, on applique le principe d'après lequel le propriétaire d'une chose qui a causé un dommage à autrui ne saurait être obligé au delà de la valeur de cette chose ». – GIRARD ; Mon. él. de dr. rom., remarque excellemment comment, au moyen des dérivations, les jurisconsultes se sont efforcés de remédier à certaines conséquences, tenues pour nuisibles, de cette persistance d'agrégats : « (p. 395, note 1) Il est piquant de relever les efforts infructueux faits par les jurisconsultes de la fin de la République pour accommoder ces vieilles actions à la notion moderne de l'imputabilité, en décidant que le dommage doit avoir été causé par l'animal contra naturam... et en appliquant aux batailles des animaux le principe de la légitime défense ». L'abandon de l'animal se trouve aussi dans la Lex Burgundionum, XVIII, 1 : Ita ut si de animalibus subito caballus caballum occiderit, atit bos bovem percusserit, aut canis momorderit, ut debilitetur, ipsum animal aut canis, per quem damnum videtur admissum, tradatur illi, qui damnam pertulit.
[FN: § 1501-2]
BEAUCHET ; Hist. du dr. pr. de la rép. ath., t. IV : « (p. 391) ... à Athènes, l'action [![]() qui correspond à l'action de pauperie des XII tables] paraît plutôt donnée contre l'animal que contre le maître, et dans le but de permettre à la victime du dommage l'exercice de la vindicta privata sur l'animal lui-même ». Les Athéniens attribuaient à Solon la loi qui prescrivait de consigner à la partie lésée l'animal coupable. – PLUTARCHI. ; Sol., 24, 3, où il est parlé d'un chien qui mord.
qui correspond à l'action de pauperie des XII tables] paraît plutôt donnée contre l'animal que contre le maître, et dans le but de permettre à la victime du dommage l'exercice de la vindicta privata sur l'animal lui-même ». Les Athéniens attribuaient à Solon la loi qui prescrivait de consigner à la partie lésée l'animal coupable. – PLUTARCHI. ; Sol., 24, 3, où il est parlé d'un chien qui mord.
[FN: § 1501-3]
DEM. ; c. Aristocr. , 76, p. 645 : ![]()
![]() « Si donc les choses inanimées et ne jouissant pas de la raison sont sujettes à cette accusation [d'homicide], il n'est pas permis de priver d'un jugement... »
« Si donc les choses inanimées et ne jouissant pas de la raison sont sujettes à cette accusation [d'homicide], il n'est pas permis de priver d'un jugement... »
[FN: § 1501-4]
AESCH. ; In Ctesiph., p. 88, 244. – Schol. veter. AESCH.; Septem ad. Th., v. 197. PAUS.; VI, Eliac., II, 11. – SUID.; s. r. ![]() . Les causes de ce genre, étant archaïques, avaient un caractère religieux et se jugeaient au Prytanée. – DEMOSTH C. Aristocr., 76, p. 645. – PAUS. – I, Att., 28. L'auteur observe qu'on dit que des choses inanimées punirent automatiquement certains délits. – POLLUX, VIII, 9, 90, et 10, 120.
. Les causes de ce genre, étant archaïques, avaient un caractère religieux et se jugeaient au Prytanée. – DEMOSTH C. Aristocr., 76, p. 645. – PAUS. – I, Att., 28. L'auteur observe qu'on dit que des choses inanimées punirent automatiquement certains délits. – POLLUX, VIII, 9, 90, et 10, 120.
[FN: § 1501-5]
PLAT. De leg., IX, p. 873.
[FN: § 1501-6]
PAUS. VI, Eliac. II, 11. - SUID., s. r. ![]() , substitue ce nom à celui de
, substitue ce nom à celui de ![]() – EUSEB ; Praep. evang., V, 34, p. 230-231.
– EUSEB ; Praep. evang., V, 34, p. 230-231.
[FN: § 1501-7]
C'était une cérémonie appelée ![]() . Sur ce sujet, nous avons d'abondants renseignements dans PORPHYR. ; De abstinentia ab esu animalium, II, 29-30. D'autres auteurs en parlent aussi. En peu de mots, un bœuf mangeait des offrandes déposées sur l'autel. On tuait le bœuf, puis l'on faisait un procès devant le tribunal qui jugeait les homicides occasionnés par des objets inanimés. Chacun des acteurs du drame rejetait successivement sur un autre la faute du fait, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que la hache avec laquelle le bœuf avait été tué. Cette hache était condamnée et jetée à la mer. PAUSANIAS, 1, 24, dit qu'il ne rapportera pas quelle cause on attribue à ce fait. On a voulu deviner cette cause, et plusieurs explications ont vu le jour, parmi lesquelles celle du totémisme. À vrai dire, on ne peut rien savoir de certain ou même seulement de très probable. Chercher à deviner les combinaisons qui ont donné naissance à une dérivation est une entreprise sans espoir de succès, quand des renseignements directs font défaut, et très difficile encore, si l'on en possède quelques-uns. Pour nous, il suffit ici de remarquer le procès que l'on faisait autrefois à des hommes et à une hache.
. Sur ce sujet, nous avons d'abondants renseignements dans PORPHYR. ; De abstinentia ab esu animalium, II, 29-30. D'autres auteurs en parlent aussi. En peu de mots, un bœuf mangeait des offrandes déposées sur l'autel. On tuait le bœuf, puis l'on faisait un procès devant le tribunal qui jugeait les homicides occasionnés par des objets inanimés. Chacun des acteurs du drame rejetait successivement sur un autre la faute du fait, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que la hache avec laquelle le bœuf avait été tué. Cette hache était condamnée et jetée à la mer. PAUSANIAS, 1, 24, dit qu'il ne rapportera pas quelle cause on attribue à ce fait. On a voulu deviner cette cause, et plusieurs explications ont vu le jour, parmi lesquelles celle du totémisme. À vrai dire, on ne peut rien savoir de certain ou même seulement de très probable. Chercher à deviner les combinaisons qui ont donné naissance à une dérivation est une entreprise sans espoir de succès, quand des renseignements directs font défaut, et très difficile encore, si l'on en possède quelques-uns. Pour nous, il suffit ici de remarquer le procès que l'on faisait autrefois à des hommes et à une hache.
[FN: § 1501-8]
PLIN. : Nat. hist., VIII, 18, 2 : Polybias Aemiliani comes, in senecta hominem appeti ab iis refert... Tunc obsidere Africae urbes : eaque de causa crucifixos vidisse se cum Scipione, quia caeteri metu poenae similis absterrerentur eadem noxa.
[FN: § 1501-8]
PLIN. : Nat. hist., VIII, 18, 2 : Polybias Aemiliani comes, in senecta hominem appeti ab iis refert... Tunc obsidere Africae urbes : eaque de causa crucifixos vidisse se cum Scipione, quia caeteri metu poenae similis absterrerentur eadem noxa.
[FN: § 1501-9]
Gen., IX, 5. (Vulg.) Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum ; et de manu hominis, de manu viri et fratris eius, requiram animam hominis. (Sept.) ![]()
![]() . Ex., XXI, 28. L'inculpation de l'animal est entièrement séparée de celle du maître : l'animal homicide est coupable et puni comme tel ; le maître est innocent. (Vulg.) Si bos corna percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur, et non comedentur carnes eius, dominus quoque bovis innocens erit. – Lev., XX, 15 (Vulg.) Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur ; pecus quoque orcidite. (Sept
. Ex., XXI, 28. L'inculpation de l'animal est entièrement séparée de celle du maître : l'animal homicide est coupable et puni comme tel ; le maître est innocent. (Vulg.) Si bos corna percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur, et non comedentur carnes eius, dominus quoque bovis innocens erit. – Lev., XX, 15 (Vulg.) Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur ; pecus quoque orcidite. (Sept ![]()
![]() (seg. : avec une bête),
(seg. : avec une bête), ![]() (16) Mulier, quae succubuerit cuilibet iumento, simul interficietur cum eo ; sanguis eorum sit super eos. (Seg.) « leur sang retombera sur eux ». Donc, sur la femme et sur l'animal. – Cet excellent PHILON LE JUIF a trouvé une belle dérivation. Il s'imagine qu'on tue l'animal pour qu'il n'en naisse pas une progéniture monstrueuse, comme il en naquit une de l'union de Pasiphaé avec le taureau ! De spec. leg., 8, p. 73-74, t. 5, Rich., p. 783-784, P. (p. 784) Proinde sive vir ineat quadrupedem, sive mulier eam admittat, necabuntur et homines et quadrupedes : illi quia per intemperantiam transgressi sunt praescriptos terminos comminiscendo nova genera libidinum, et voluptatem insuavem captando e rebus etiam dictu turpissimis : hae vero quia se praebuerunt probris talibus, et ne pariant abominandum aliquid, qualia nasci solent ex huiusmodi piaculis detestabilibus...
(16) Mulier, quae succubuerit cuilibet iumento, simul interficietur cum eo ; sanguis eorum sit super eos. (Seg.) « leur sang retombera sur eux ». Donc, sur la femme et sur l'animal. – Cet excellent PHILON LE JUIF a trouvé une belle dérivation. Il s'imagine qu'on tue l'animal pour qu'il n'en naisse pas une progéniture monstrueuse, comme il en naquit une de l'union de Pasiphaé avec le taureau ! De spec. leg., 8, p. 73-74, t. 5, Rich., p. 783-784, P. (p. 784) Proinde sive vir ineat quadrupedem, sive mulier eam admittat, necabuntur et homines et quadrupedes : illi quia per intemperantiam transgressi sunt praescriptos terminos comminiscendo nova genera libidinum, et voluptatem insuavem captando e rebus etiam dictu turpissimis : hae vero quia se praebuerunt probris talibus, et ne pariant abominandum aliquid, qualia nasci solent ex huiusmodi piaculis detestabilibus...
[FN: § 1501-10]
GREGOROVIUS ; Storia della città di Roma (Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter), t. III.
[FN: § 1502-1]
Mémoires de la société des antiquaires de France. Rapport et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux. Il serait trop long et peu utile de reproduire ici tout le catalogue: nous en transcrivons seulement le commencement et la fin :
Années. |
Animaux |
Pays. |
1120 |
Mulots et chenilles. |
Laon. |
1121 |
Mouches. |
Foigny, près Laon. |
1166 |
Porc. |
Fontenay, près Paris. |
1314 |
Taureau. |
Comté de Valois. |
1386 |
Truie. |
Falaise. |
1389 |
Cheval. |
Dijon. |
1394 |
Porc. |
Mortain. |
.....................................................................……….. |
||
1633 |
Jument. |
Bellac. |
1647 |
Id. |
Parlement de Paris. |
| .....................................................................……….. | ||
1679 |
Jument |
Parlement d’Aix. |
| .....................................................................……….. | ||
1690 |
Chenilles. |
Auvergne. |
1692 |
Jument. |
Moulins. |
17e siècle (fin) |
Tourterelles. |
Canada |
1741 |
Vache. |
Poitou |
Au total, 92 procès. |
||
[FN: § 1502-2]
CABANÈS ; Les indiscrétions de l'histoire, 5e série : « (p. 34) Il était procédé contre l'animal par voie criminelle, et voici quelle était la marche de la procédure mise en usage : dès qu'un méfait était signalé, l'animal délinquant était saisi et conduit à la prison du siège de la justice criminelle où le procès devait (p. 35) être instruit. Des procès-verbaux étaient dressés et l'on procédait... à une enquête minutieuse. Le fait étant établi sans conteste, le procureur, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions de ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après avoir ouï les témoins, et sur leurs dépositions affirmatives, le procureur faisait des réquisitions, sur lesquelles le juge rendait sa sentence, déclarant l'animal coupable d'homicide et le condamnant à être étranglé et pendu, par les deux pieds de derrière, à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays... Telle était, en certains endroits, la rigueur apportée dans l'observation des formalités en matière de procédure criminelle, que la sentence n'était exécutée qu'après que signification en avait été faite à l'animal lui-même dans sa prison ». – BEAUMANOIR ; Coutumes de Beauvaisis, édit. Beugnot, LXIX, 6 ; édit. Salmon, t. II, 1944 : « (p. 481) Li aucun qui ont justices en leur terres si font justices de bestes quant eles metent aucun a mort : si comme se une truie tue un enfant, il la pendent et trainent, ou une autre beste. Mes c'est nient a fere, car bestes mues n'ont pas entendement qu'est biens ne quest maus, et pour ce est ce justice perdue ». – C. TRUMELET ; Les saints de l’Islam : « (p. 132 note) On raconte... qu'un jour le khalife Omar-ben-El-Koththab, cousin au troisième degré de Mahomet, ayant trouvé un scorpion sur le tapis qui lui servait de couche, fut pris de scrupule relativement à son droit de tuer une créature de Dieu. Dans le doute et pour se mettre d'accord avec sa conscience, il alla consulter le Prophète, son parent, à qui il exposa son cas. Après avoir réfléchi pendant quelques instants, Mahomet lui répondit qu'il ne pouvait s'arroger le droit de destruction qu'à la troisième désobéissance de l'insecte, c'est-à-dire après les trois sommations d'avoir à se retirer ».
[FN: § 1502-3]
ETIENNE DE, BOURBON ; Anecdotes historiques (§ 303, p. 255) Sentenciam excommunicacionis docent timere et cavere animalia, exemplo et divino miraculo hoc agente. Audivi quod, cum papa Gregorius nonus esset ante papatum legatus sedis apostolice in Lumbardia, et invenisset in quadam civitate quosdam maiores compugnantes, qui processum eius impediebant, ... cum excommunicasset capitaneum illius dissensionis, qui solus pacem impediebat, et ille excommunicacionem contempneret, ciconie multe, que nidificaverant super turres et caminos domus eius, a domo eius recesserunt, et nidos suos transtulerunt, ad domum alterius capitanei dicte guerre, qui paratus erat stare mandato dicti legati ; quod videns ille contumax, humiliavit cor suum ad absolucionem procurandam et ad voluntatem dicti legati faciendam. Dans ce cas, les animaux innocents fuient l'homme excommunié ; dans les cas suivants, les animaux sont eux-mêmes excommuniés. (§ 304, p. 255) Item audivi quod in ecclesia Sancti Vincencii Matisconensis... multi passeres solebant intrare et (p. 256) ecclesiam fedare et officium impedire. Cum autem non possent excludi, episcopus illius loci... eas excommunicavit, mortem comminans si ecclesiam ulterius intrarent ; que, ab ecclesia recedentes, nunquam postea eamdem ecclesiam intraverunt. [Ainsi, les pauvres petits moineaux furent, sans procès, frappés d'excommunication ; et comme témoin oculaire de l'efficacité de cette condamnation, nous avons l'auteur]. Ego autem vidi multitudinem earum circa ecclesiam nidificantes, et super dictam ecclesiam volantes et manentes ; nullam autem earum vidi in dicta ecclesia. Est eciam ibi communis opinio quod, si aliquis unam capiat et eam in dicta eeclesia violenter intromittat, quam cito intromittitur, moritur. Non moins merveilleux que l'effet de cette excommunication, est celui du contrat social de Rousseau, qui continue à avoir des croyants, bien que tout témoignage oculaire fasse défaut. (§ 305, p. 256) Item audivi a pluribus fratribus nostris quod, cum quidam episcopus Lausanensis haberet piscatores in lacu, cum quadam nocte misisset eos piscari ad anguillas, proicientes recia sua in lacu, ceperunt serpentes cum anguillis. Quidam autem eorum caput dentibus attrivit, credens anguillas, ... in mane autem, cum vidisset quod erant serpentes, ita abhorruit, quod pre abominacione mortuus est. Quod audiens episcopus, excommunicavit dictas anguillas si de cetero in dicto lacu morarentur. Omnibus autem inde recedentibus, postea, ut dicitur, in dicto lacu non remanserunt.
[FN: § 1502-4]
L. MENABREA : De l'origine, de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen âge contre les animaux. Chambéry, 1846. Dans ce livre, l'auteur publie une procédure instruite en 1587, contre un certain insecte (Rynchites auratus) qui détruisait les vignes de Saint-Julien, près Saint Jean de Maurienne. Cette, procédure est reproduite en partie et résumée dans le livre : Curiosités des traditions, des mœurs et des légendes. Je cite aussi ce livre, dont les pages seront désignées par la lettre C, pour faciliter le lecteur, parce qu’il est difficile de se procurer le livre de Menabrea, dont les pages seront désignées par la lettre M. « (p. 429-431 C ; p. 7 M) Ces vignobles [de St. Julien] ... sont sujets à être dévastés, à de certains intervalles par un charançon de couleur verte à qui les naturalistes donnent le nom de Rynchites auratus, et le vulgaire celui d'amblevin ou de verpillon ». (p. 8 M) Les actes du procès de 1587 « nous apprennent que déjà 42 ans auparavant, c'est-à-dire en 1545, une instance semblable avait existé, entre les mêmes parties, et que les insectes destructeurs ayant disparu, les demandeurs ne s'étaient pas souciés de la poursuivre. On y voit qu'alors une première comparution eut lieu, à fins conciliatoires, devant spectable François Bonnivard, docteur en droit : le procureur Pierre Falcon représentait les insectes, et l'avocat Claude Morel leur prêtait son ministère. L'inutilité de cette tentative d'accommodement fit que les syndics de St. Julien se pourvurent à l'Official de St. Jean de Maurienne, et engagèrent une contestation en forme ». On fit une tentative. La cause fut débattue, « (p. 8 M) l'Official rendit une ordonnance, dans laquelle, écartant provisoirement les conclusions des habitants de (p. 9 M) St. Julien, qui requéraient que les pyrales fussent excommuniées, il se borna à prescrire des prières publiques... (p. 10 M) L'instance de 1545, restée en suspens pendant plus de 40 ans par suite de la retraite des insectes dévastateurs, fut reprise en 1587, lorsque ces malheureux coléoptères eurent fait sur les vignobles de la commune, une nouvelle irruption plus alarmante peut-être que les précédentes. Ce second procès... est intitulé : De actis Scindicorum, communitatis Sancti Julliani agentium contra Animalia brula ad formam muscarum volantia coloris viridis communi voce appellata Verpillions seu Amblevins ». Les syndics de Saint Julien demandent que « (p. 11 M) il plaise au révérend Official constituer aux insectes un nouveau procureur en remplacement de l'ancien, passé de vie à trépas, députer préparatoirement un commissaire idoine pour visiter les vignes (p. 12 M) endommagées, partie adverse sommée d'assister à l'expertise, si bon lui semble [sic !] ; après quoi il sera progressé à l'expulsion des animaux susdits par voie d'excommunication ou interdit, et de toute autre due censure ecclésiastique ; étant eux syndics, prêts à relâcher à ces mêmes animaux, au nom de la Commune, un local où ils aient à l'avenir pâture suffisante... ». La cause suit son cours ; les avocats présentent leurs mémoires ; il y a répliques et dupliques ; enfin, « (p. 19 M) il fallait que les syndics de St. Julien n'eussent pas grande confiance en la bonté de la cause qu'ils poursuivaient, puisqu'ils jugèrent à propos d'adopter d'une manière principale le mezzo termine qu'ils n'avaient proposé au commencement de l'instance que par mode (p. 20 M) subsidiaire ». Ils convoquent les habitants de la Commune, « à l'effet de réaliser les offres précédemment faites, en relâchant aux amblevins un local où ces bestioles pussent trouver à subsister... Chacun des assistants ayant manifesté son opinion, tous furent d'avis d'offrir aux amblevins une pièce de terre située au-dessus du village de Claret... contenant environ cinquante sétérées, et de la quelle les sieurs advocat et procureur d'iceulx animaulx se veuillent comptenter... ladicte pièce de terre peuplée de plusieurs espesses de boès, plantes et feulliages, comme foulx. allagniers, cyrisiers, chesnes... oultre l’erbe et pasture qui y est en assez (p. 21 M) bonne quantité... En faisant cette offre, les habitants de St. Julien crurent devoir se réserver le droit de passer par la localité dont il s'agit, tant pour parvenir sur des fonds plus éloignés, sans causer touttefoys aulcung préjudice à la pasture desdict-animaulx, que pour l'exploitation de certaines mynes de colleur, c'est-à-dire d'ocre, qui existaient non loin de là. Et parce que, ajoutent-ils, ce lieu est une seure retraicte en temps de guerre, vu qu'il est garny de fontaynes qui aussi serviront aux animaulx susdicts, ils se réservent encore la faculté de s'y réfugier en cas de nécessité, promettant à ces conditions, de faire dresser en faveur des insectes ci-dessus nommés, contrat de la pièce de terre en question, en bonne forme et vallable à perpetuyté. Le 24 juillet, Petremand Bertrand, procureur des demandeurs, produisit une expédition du procès-verbal de la délibération prise... ». Il demande que, si les défendeurs n'acceptent pas, « il plût an révérend juge lui adjuger ses conclusions, tendantes à ce que lesdits défendeurs soient déclarés tenus de déguerpir les vignobles de la Commune, avec inhibition de s'y introduire à l'avenir, sous les peines du droit ». Le procès continue, et, le 3 septembre, « (p. 22 M) Antoine Filliol, procureur des insectes, déclara ne pas vouloir accepter au nom de ses clients l'offre faite par les demandeurs, attendu que la localité offerte était stérile et ne produisait absolument rien, cum sit locus sterilis et nuilius redditus... (p 23 M) De son côté, Petremand Bertrand fit observer, que, loin d'être de nul produit, le lieu en question abondait en buissons et en petits arbres très propres à la nourriture des défendeurs... Sur quoi l'Official ordonne le dépôt des pièces. Une portion du feuillet sur lequel se trouvait écrite la sentence... est devenue la proie du temps... ce qui en reste suffit néanmoins pour faire voir que l'Official, avant de prononcer en définitive, nomma des experts aux fins de vérifier l'état du local offert aux insectes... » L'idée d'abandonner aux insectes un lieu où ils puissent vivre n'est pas particulière au présent procès. On en a d'autres exemples. Hemmerlein, cité par Menabrea, raconte comment, après un procès régulier, les habitants de Coire pourvurent certaines cantharides d'un lieu où elles pussent vivre. « (p. 93) Et aujourd'hui encore, ajoute Hemmerlein, les habitants de ce canton passent chaque année un bon contrat avec les cantharides susdites, et abandonnent à ces insectes une certaine étendue de terrain : si bien que les scarabées s'en contentent, et ne cherchent point à sortir des limites convenues ».
[FN: § 1503-1]
D. THOM.; Summ. theol., IIa IIae, q. 76, art. 2 : Conclusio. Creaturis irrationalibus maledicere, ut Dei creaturae sunt, ad rationalem creaturam ordinatae, blasphemia est : eis autem maledicere, ut in seipsis sunt, illicitum est, cum sit hoc, otiosum. et vanum. – Corp. iuris can. ; decr. Grat., pars sec., caus. XV, q. 1, c. 4 : Non propter culpam, sed propter memoriam facti pecus occiditur, ad quod mulier accesserit. Unde Augustinus super Leviticum ad c. 20, q. 74..., § 1. Quaeritur, quomodo sit reum pecus : cum sit irrationale, nec ullo modo legis capax. Et infra : Pecora inde credendum est iussa interfici, quia tali fiagitio contaminata indignam refricant facti memoriam. Menabrea a reproduit, dans son livre, le Discours des Monitoires, avec un plaidoyer contre les insectes, de l'avocat GASPARD BALLY de Chambéry, qui vivait dans la seconde moitié du XVIIe siècle. On y peut lire des modèles de plaidoyers contre les insectes et en leur faveur, ainsi que des conclusions du procureur de l'évêque et de la sentence du juge ecclésiastique. Le procureur des insectes produit de nombreuses citations de textes divins et légaux, et conclut : « (p. 138) Par les quelles raisons on voit, que ces animaux sont en nous absolutoires, et doivent estre mis hors de Cour et de Procès, à quoy on conclud ». Mais le procureur des habitants réplique : « (p. 138) Le principal motif qu'on a rapporté pour la deffense de ces animaux, est qu'estans privés de l'usage de la raison, ils ne sont soumis, à aucunes Loix, ainsi que le dit le Chapitre cum mulier 1, 5, q. 1. la l. congruit in fin et la Loix suivante. ff. de off. Praesid. sensu enim carens non subiicitur rigori Iuris Civilis. Toutesfois, on fera voir que telles Loys ne peuvent militer au fait qui se présente maintenant à juger ; car on ne dispute pas de la punition d'un delict commis ; Mais on tasche d'empescher qu'ils n'en commettent par cy-après... ». Il continue avec de copieuses citations de tout genre ; « (p. 141) Et pour responce à ce qu'escrit S. Thomas qu'il n'est loisible de maudire tels animaux, si on les considere en eux mesmes, on dit qu'en l'espece qu'on traitte, on ne les considere pas comme animaux simplement : mais comme apportans, du mal aux Hommes, mangeans et détruisans les fruits qui servent à son soutient, et nourriture. Mais à quoy, nous arrestons-nous depuis qu'on voit par des exemples infinis que quantité de saints Personnages, ont Excommunié des animaux apportans du dommage aux Hommes ... ». La sentence du juge ecclésiastique conclut : « (p. 147) In nomine, et virtute Dei Omnipotentis, Patris, et Filij, a Monitione in vini sententiae huius, a vineis, et territoriis huius loci discedant, nullum ulterius ibidem, nec alibi nocumentum, praestitara, quod si infra praedictos dies, iam dicta animalia, huic nostrae admonitioni non paruerint, cum effectu. Ipsis sex diebus elapsis, virtute et auctoritate praefatis, illa et Spiritus sancti... Authoritateque Beatorum Apostolorum, Petri et Pauli, necnon ea qua fungimur in hac parte, praedictos Bronchos, et Erucas, et animalia praedicta quocunque nomine censeantur, monemus in his scriptis, sub poenis Maledictionis, ac Anathematisationis, ut infra sex dies, in his scriptis, Anathematizamus, et maledicimus ». Notez que l'auteur nous dit avoir obtenu du Sénat de Savoie l'autorisation de faire imprimer son travail, « (p. 121) ayant esté veu et examiné par les seigneurs de ce célèbre corps qui en ont fait leur rapport avec éloge».
[FN: § 1503-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Cela n'empêche pas non plus que tant de juristes débattent encore, dans des discussions ou des ouvrages juridiques, des questions telles que celles-ci : l'homme a-t-il le droit d'infliger la peine de mort à son semblable ? Quelle est la véritable conception de l'État ? etc.
[FN: § 1505-1]
Essai d'une phil. de la Solidarité. L. BOURGEOIS dit de la solidarité : « (p. 46) Alors, va-t-on dire, c'est le contrat social ? – Je le veux bien et je conserve le mot [il a raison ; ce ne sont là que des variations sur le même thème musical], à la condition toutefois qu'on ne confonde pas ce contrat social avec celui dont Rousseau a exposé la théorie. L'hypothèse de Rousseau – car dans sa pensée il ne s'agit que de cela et non d'un fait historique, – place le contrat à l'origine des choses, tandis que nous le plaçons au terme ».
[FN: § 1508-1]
Les fidèles du dieu Progrès voulaient nous faire croire que les temps étaient désormais passés, où, comme en 1815, les congrès européens disposaient du sort des peuples. Précisément, en 1913, un congrès à Londres dispose du sort des peuples balkaniques, interdit à la Serbie l'accès de l'Adriatique, oblige le Monténégro à abandonner Scutari qu'il avait conquis, dispose du sort des malheureux habitants des Îles de l'Égée, et ainsi de suite. Si le Monténégro avait été plus fort que l'Autriche, c’eût été non pas celle-ci qui eût obligé le Monténégro d'abandonner des territoires, mais le Monténégro qui eût obligé l'Autriche. Quelle règle peut-on imaginer, qui puisse également bien démontrer que l'Autriche a le « droit » d'occuper la Bosnie et l'Erzégovine, et que le Monténégro n'a pas le droit d'occuper Scutari ? La vénérable théorie de l' « équilibre », invoquée jadis pour maintenir l'Italie divisée et sujette, sert de même à la nouvelle Italie, avec la complicité de l'ancien oppresseur, pour maintenir divisés et sujets les peuples des Balkans. Par quel miraculeux sophisme peut-on démontrer que l'Italie a aujourd'hui le « droit », pour maintenir « l'équilibre de l'Adriatique », de défendre à la Grèce d'occuper des territoires de nationalité grecque, tandis qu'en vertu de la même règle de « droit », la Grèce n'avait pas « le droit », pour maintenir ce vénérable équilibre, de défendre l'occupation de Tarente et de Brindisi par les troupes piémontaises, et de s'opposer à la constitution du royaume d'Italie ? Il n'y a qu'un seul motif pour expliquer les faits : la force. Si la Grèce avait été plus forte que l'Italie et que les États qui protégeaient le nouveau royaume, elle aurait maintenu à son avantage « l'équilibre » de l'Adriatique, de môme que l'Italie, étant aujourd'hui plus forte que la Grèce, maintient cet équilibre à son avantage. Parce qu'un souverain puissant entendit « le cri de douleur qui arrive vers nous de toute l'Italie [FN*]», et parce que la fortune favorisa ses armes, l'Italie fat délivrée du joug autrichien ; et ce n'est pas à cause d'une différence de « droit » ; mais seulement parce qu'aucun souverain puissant n'entendit le cri de douleur des Balkans et de l'Égée, qu'il ne fut pas donné à ces nations d'avoir un sort semblable à celui de l'Italie. Le poète Leopardi a chanté, dans la langue de Dante, les hauts faits des « crabes » autrichiens occupés à maintenir « l'équilibre» en Italie [FN**] ; et maintenant, un poète grec pourrait chanter, dans la langue d'Homère, les hauts faits non moins admirables des « crabes » austro-italiens occupés à maintenir « l'équilibre » de l'Adriatique et d'autres régions. Celui qui juge les faits avec des sentiments nationalistes dit, s'il est Italien, que l'Italie a « raison » et que la Grèce a « tort » ; s'il est Grec, il retourne ce jugement. Celui qui juge les faits avec des sentiments internationalistes ou pacifistes donne tort à celui qu'il estime être l'agresseur, raison à celui qu'il croit être l'attaqué. Celui qui, au contraire, veut rester dans le domaine objectif, voit simplement, dans les faits, de nouveaux exemples de ces conflits qui se produisirent toujours entre les peuples ; et il voit dans les jugements la manière habituelle de traduire par l'expression « il a raison », le fait que certaines choses s'accordent avec le sentiment de celui qui juge, et par l'expression « il a tort », le fait que certaines choses répugnent à ce sentiment. C'est-à-dire qu'il y a là uniquement des résidus et des dérivations.
[FN*] Paroles de l'empereur Napoléon III.
[FN**] Paralipomeni della Batracomiemachia, II, st. 30 à 39.
[FN: § 1510-1]
On peut aussi joindre la tradition religieuse à la tradition métaphysique poussée à l'extrême. Par exemple, on pourrait définir la Christian Science (§ 1695-1) un hégélianisme biblique.
[FN: § 1511-1]
A. WEBER ; L'enseignement de la prévoyance, Paris, 1911. Parlant de certaines gens qui s'occupent de sociétés de secours, de coopératives, de caisses mutuelles, il dit : « (p. 101) ... pour eux – comme pour l'immense majorité de leurs affiliés – la Mutualité et la Prévoyance sont des dogmes qu'on ne doit même pas chercher à comprendre, des choses qui ont des vertus spéciales, des vertus en soi et qui sont douées d'un pouvoir mystérieux pour la guérison des misères humaines ! Ils estiment, en quelque sorte, qu'il importe surtout à leur sujet d'être un adepte et un croyant : après quoi il suffit d'apporter aux Œuvres une offrande, une maigre contribution personnelle pour obtenir des résultats extraordinaires : la Retraite gratuite ou l'Assurance à un taux dérisoire, par exemple ».
[FN: § 1514-1]
E. KANT ; La métaph. des mœurs (Édit. J. Tissot). L'auteur nous avertit que : « (p. 58) Dans cet impératif catégorique ou loi de la moralité (p. 59), la raison de la difficulté (d'en apercevoir la possibilité) est, en second lieu, très grande. C'est un principe a priori synthétiquement pratique ; et comme il est si difficile, dans la connaissance théorique, d'apercevoir la possibilité des principes de cette espèce, on pense bien qu'elle n'est pas moins difficile à connaître dans la connaissance pratique. Nous rechercherons d'abord, dans ce problème, si la simple notion d'un impératif catégorique n'en fournit pas aussi la formule [bien sûr qu'elle la fournit ! La simple notion de la Chimère en fournit aussi la formule !], contenant la proposition qui peut seule être un impératif catégorique ; ... Quand je conçois un impératif hypothétique en général, je ne sais pas encore ce qu'il contiendra, jusqu'à (p. 60) ce que la condition me soit donnée. Mais si je conçois un impératif catégorique, je sais ce qu'il contient [et si j'imagine un hippogriphe, je sais comment il est fait]. Car l'impératif ne renferme, outre la loi, que la nécessité de la maxime d'être conforme à cette loi. Mais la loi ne contient aucune condition à laquelle elle soit subordonnée ; en sorte qu'il ne reste que l'universalité d'une loi en général, à laquelle doit être conforme la maxime de l'action. Or cette conformité seule présente l'impératif proprement comme nécessaire. Il n'y a donc qu'un seul impératif catégorique, celui-ci : N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Texte allemand : « Zweitens ist bei diesem kategorischen Imperativ oder Gesetze der Sittlichkeit der Grund der Schwierigkeit (die Möglichkeit desselben einzusehen) auch sehr gross. Er ist ein synthetisch-praktischer Satz a Priori, und da die Möglichkeit der Sätze dieser Art einzusehen so viel Schwierigkeit im theoretischen Erkentnisse hat, so lässt sich leicht abnehmen, dass sie im praktischen nicht weniger haben werde. Bei dieser Aufgabe wollen wir zuerst versuchen, ob nicht vielleicht der blosse Begriff eines kategorischen Imperativs auch die Formel desselben an die Hand gebe, die den Satz enthält, der allein ein kategorischer Imperativ sein kann : denn wie ein solches absolutes Gebot möglich sei, wird noch besondere und schwere Bemühung erfordern, die wir aber zum letzten Abschnitte aussetzen.
Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiss ich nicht zum voraus was er enthalten werde : bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiss ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ ausser dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäss zu sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt, war, so bleibt nichts, als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlang gemäss sein soll, und welche Gemässheit allein den Imperativ eigentlich als nothwendig vorstellt. Der kategorische Imperativ ist also ein einziger, und zwar dieser : handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde ».
[FN: § 1517-1]
E. KANT ; loc. cit., § 1514-1 « (p. 61) Un homme réduit au désespoir et au dégoût de la vie par une série d'infortunes, possède encore assez de raison pour pouvoir se demander s'il n'est pas contraire au devoir de s'ôter l'existence. Or, il examine si la maxime de son action peut être une loi universelle de la nature ». Texte allemand : « Einer, der durch eine Reihe von Uebeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Ueberdruss am Leben empfindet, ist noch so weit im. Besitze seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er : ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne ». Si l'on admet des conditions, la réponse devrait être affirmative. On dirait en effet : « Tous ceux des hommes – et c'est de beaucoup le plus grand nombre – qui préfèrent la vie à la mort, s'efforceront de rester en vie aussi longtemps qu'ils le pourront; et le petit nombre de ceux qui préfèrent la mort à la vie se tueront. Qu'est-ce qui empêche que ce soit une loi universelle ? Si peu de chose, que c'est ce qui arrive et ce qui est toujours arrivé. Kant résout négativement la question, parce qu'il ne sépare pas ces deux classes d'hommes. Il continue : « Mais sa maxime est de se faire, par amour pour soi, un principe d'abréger sa vie, si elle est menacée, dans sa courte durée, de plus de maux qu'elle ne promet de biens. Il s'agit donc uniquement de savoir si ce principe de l'amour de soi peut être une loi universelle de la nature. Or on aperçoit bientôt qu'une nature dont la loi serait d'inciter par la sensation même, dont la destination est l'utilité et la durée de la vie, à la destruction de la vie même, serait contradictoire, et ne subsisterait par conséquent pas comme nature ; qu'en conséquence, la maxime en question n'est point possible comme loi universelle de la nature, entièrement opposée qu'elle est au principe suprême de tout devoir ». Texte allemand : « Seine Maxime aber ist : ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner längern Frist mehr Uebel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen. Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, dass eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne, und folglich dem obersten Prinzip gänzlich widerstreite ». Il y a lieu de remarquer d'abord cette manière impersonnelle de s'exprimer, habituelle à qui veut engendrer la confusion. De plus, pour celui qui veut se suicider, il ne s'agit pas de la vie en général, mais de sa vie en particulier. Ensuite, on voit que pour rendre valable ce raisonnement, il faut supprimer toute condition ; car ce sentiment pourrait avoir pour « destination d'inciter au développement de la vie ». quand elle « promet plus de biens que de maux », et pas autrement. La contradiction en laquelle, selon Kant, la Nature tomberait, n'existe que s'il n'y a pas de conditions ; elle disparaît si l'on admet qu'il peut y avoir des conditions. Malgré l'admirable discours de Kant, celui qui voudra se tuer, tirera sa révérence à notre cher, illustre et non moins impuissant Impératif catégorique,... et s'ôtera la vie.
[FN: § 1519-1]
Texte, allemand : « Ein Dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst einiger Kultur ihn zu einem in allerlei Absicht brauchbaren Menschen machen könnte. Er sieht sich aber in bequemen Umständen, und zieht vor, lieber dem Vergnügen nachzuhängen, als sich mit Erweiterung und Verbesserung seiner glücklichen Naturanlagen zu bemühen ».
[FN: § 1519-2]
Texte allemand : « Da sieht er nun, dass zwar eine Natur nach einem solchen allgemeinen Gesetze immer noch bestehen könne, obgleich der Mensch (sowie der Südsee-Einwohner) sein Talent rosten liesse und sein Leben bloss auf Müssiggang, Ergötzlichkeit, Fortpflanzung, mit einem Wort, auf Genuss zu verwenden bedacht wäre... » .
[FN: § 1519-3]
Texte allemand. « ... allein er kann unmöglich wollen, dass dieses ein allgemeines Naturgesetz werde oder als ein solches in uns durch Naturinstinkt gelegt sei. Denn als ein vernünftiges Wesen will er nothwendig, dass alle Vermögen in ihm entwickelt werden, weil sie ihm doch zu allerlei möglichen Absichten dienlich und gegeben sind ».
[FN: § 1521-1]
Quand les métaphysiciens éprouvent le besoin de disserter sur les sciences naturelles, ils devraient se souvenir du proverbe : la parole est d'argent, mais le silence est d'or, et ils feraient bien de rester dans leur domaine, sans envahir celui d’autrui. YVES DELAGE ; La struct. du prot. et les théor. de l'héréd., p. 827, note : « Il est probable que bon nombre des dispositions qui nous paraissent inutiles ou mauvaises ne nous semblent telles que par notre ignorance de leur utilité ; mais il est probable aussi que leur inutilité ou leurs inconvénients sont quelquefois réels. En tout cas, c'est à ceux qui sont d'avis contraire à prouver leur dire ». Bien entendu, s'ils sont naturalistes, parce que les métaphysiciens ont le privilège d'affirmer sans preuve. « p. 830) C'est ainsi [tant bien que mal], en effet, que vivent la plupart des espèces, bien loin d'être, comme on le dit, un rouage admirablement travaillé et adapté à sa place dans le grand mécanisme de la nature. Les unes ont la chance que les variations qui les ont formées leur ont créé peu d'embarras. Telle est la Mouche, par exemple, qui n'a qu'à voler, se reposer, se brosser les ailes et les antennes, et trouve partout les résidus sans nom où elle pompe aisément le peu qu'il lui faut pour vivre. Aux autres, ces mêmes variations aveugles ont créé une vie hérissée de difficultés : telle est l'Araignée, toujours aux prises avec ces terribles dilemmes, pas d'aliment sans toile et pas de toile sans aliments, aller à la lumière que recherche l'Insecte, fuir la lumière par peur de l'Oiseau. Comment s'étonner que, dans de pareilles conditions, soit né chez elle l'instinct absurde qui pousse la femelle à dévorer son mâle après l'accouplement, sinon même avant [excellente Nature kantienne, quelles erreurs commets-tu donc ?], instinct que, par parenthèse, la Sélection de l'utile à l'espèce serait fort embarrassée d'expliquer ». Cet excellent Saint Augustin aussi, se mêlant de parler d'entomologie, dit, après plusieurs autres philosophes, que beaucoup d'insectes naissent de la putréfaction : Nam pleraque eorum, aut de vivorum corporum vitiis, vel purgamentis, exhalationibus, aut cadaverunt tabe gignuntur; quaedam etiam de corruptione lignorum et herbarum... , et il recherche comment ils ont bien pu être créés : (23) Cetera vero quae de animalium gignuntur corporibus, et maxime mortuorum, absurdissimum est dicere tunc creata, uni animalia ipsa creata sunt... (De Genesi ad litteram, III, 14, 22).
[FN: § 1521-2]
Texte allemand : In den Naturanlagen eines organisirten, d.i. zweckmässig zum Leben eingerichteten Wesens nehmen wir es als Grundsatzen, dass kein Werkzeug zu irgend einem Zwecke in demselben angetroffen werde, als was auch zu demselben das schicklichste und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhallung, sein Wohlergehen, mit einem. Worte seine Glückseligkeit der eigentliche Zweck der Natur, so hätte sic ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfs zur Ausrichterin dieser ihrer Absicht, zu ersehen. L'auteur continue et nous donne les motifs de cette affirmation : « (p. 15) car toutes les actions qu'elle exécuterait dans cette intention et toutes les règles de sa conduite ne vaudraient certainement pas l'instinct [Kant le sait ; mais il ne nous apprend pas comment il le sait, et il supprime la démonstration], et ce but pourrait être bien plus sûrement atteint par l'impulsion instinctive qu'il ne peut l'être jamais par la raison. Et si la raison devait être donnée par surcroît à une créature déjà privilégiée, elle n'aurait dût lui servir qu'à contempler les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s’en réjouir, et en rendre grâce à la cause bienfaisante [autre belle entité] de son être... En un mot, la nature [qui, paraît-il, s'appelle aussi Cause bienfaisante] aurait empêché que la raison ne trébuchât dans l'usage pratique,…. Aussi trouvons-nous dans le fait, que plus une raison cultivée s'applique à la jouissance de la vie et du bonheur plus l'homme s'éloigne de la vraie satisfaction [attention à ce vraie ; grâce à ce terme, Kant choisit la « satisfaction » qui lui plaît ; l'autre est fausse] ». Texte allemand : Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens würden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet und jener Zweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden können, als es jemals durch Vernunft geschehen kann ; und sollte diese ja obenein dem begünstigten Geschöpf ertheilt worden sein, so würde sic ihm nur dazu haben dienen müssen, uni über die glückliche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu bewundern, sich ihrer zu erfreuen und der wohlthätigen Ursache dafür dankbar zu. sein... mit einem Worte, sic [die Natur] würde verhütet haben, dass Vernunft nicht in praktischen Gebrauch ausschlüge... In der That finden wir auch, dass, jemehr eine kültivirte Vernunft sich mit der Absicht auf den Genuss des Lebens und der Glückseligkeit abgiebt, desto weiter der Mensch von der wahren Zufriedenheit abkomme .. » L’auteur nous apprend ensuite que si ceux qui font le plus usage de la raison calculent les avantages des arts et même des sciences, « (p. 16) ils trouvent, en effet, qu'ils ont eu par là plus d'embarras et de peine que de bonheur, et sont enfin plus portés à envier qu'à mépriser cette manière de vivre toute commune des hommes qui se rapproche davantage de la direction purement instinctive de la nature, et qui donne peu d'influence à la raison sur l'inconduite ». Texte allemand : « den noch finden, dass sic sich in der That nur mehr Mühseligkeit auf den Hals gezogen, ais an Glückseligkeit gewonnen haben, und darüber endlich den gemeineren Schlag der Menschen, welcher der Leitung des blossen Naturinstinkts näher ist und der seiner Vernunft nicht viel Einfluss auf sein Thun und Lassen verstattet, eher beneiden, als geringschätzen ». Comment Kant a-t-il jamais pu faire cette statistique ? Cette partie de la dérivation sert à contenter les nombreuses personnes qui, au temps où écrivait Kant, admiraient l'homme naturel et déclamaient contre la civilisation. Les dérivations visent le sentiment, non pas les faits et la logique. « (p. 16) En effet, bien que la raison ne soit pas assez habile pour guider plus sûrement la volonté, par rapport à ses objets et à la satisfaction de tous nos besoins..., que ne pourrait le faire l'instinct mis en nous par la nature pour cette fin ; cependant, comme faculté pratique, c'est-à-dire, en tant qu'elle doit avoir de l'influence sur la volonté, et puisqu'elle nous a été donnée en partage, sa véritable destination [remarquez l'épithète véritable. Il y a une fausse destination, qui est celle qui ne plaît pas à Kant] doit être de produire une volonté bonne en soi, et non une volonté bonne comme moyen par rapport à d'autres fins ». Texte allemand : « Denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, uni den Willen in Ansehung der Gegenstände desselben und der Befriedigung aller unserer Bedürfnisse... sicher zu leiten, als zu. welchem Zwecke ein eingepflanzter Naturinstinkt viel gewisser geführt haben würde, gleichwohl aber uns Vernunft als praktisches Vermögen, d. i. als ein solches, das Einfluss auf den Willen haben soll, dennoch zugetheilt ist; so muss die wahre Bestimmung derselben sein, einem nicht etwa in anderer Absicht als Mittel, sondern an sich selbst guten Willen hervorzubringen ».
[FN: § 1524-1]
Le 24 janvier 1913, à la Chambre française, M. Briand, président du Conseil, dit : « Le problème le plus urgent est celui de la réforme électorale. À aucun moment je n'ai jeté l'anathème au scrutin d'arrondissement. J'ai reconnu les services du scrutin d'arrondissement, mais j'ai ajouté que c'était un instrument faussé. Je ne considère pas que la réforme électorale procède d'une question de principe, c'est une question de tactique. Le parti au pouvoir doit chercher à y rester dans l'intérêt du pays et de la nation qui l'ont envoyé au pouvoir (mouvements sur divers bancs.) C'est par ses propres moyens que le parti au pouvoir doit réaliser l'instrument de justice et d'équité ».
[FN: § 1536-1]
A. COMTE ; Cours de philosophie positive, t. V. « (p. 14) Néanmoins, il reste encore à ce sujet une incertitude secondaire, que je dois d'abord dissiper rapidement, et provenant de la progression nécessairement inégale de ces différents ordres de pensées, qui, n'ayant pu marcher du même pas... ont dû faire jusqu'ici [remarquez cette façon de s'exprimer du prophète qui vient de régénérer le monde] fréquemment coexister, par exemple, l'état métaphysique d'une certaine catégorie intellectuelle, avec l'état théologique d'une catégorie postérieure, moins générale et plus arriérée, ou avec l'état positif d'une autre antérieure, moins complexe et plus avancée, malgré la tendance continue de l'esprit humain à l'unité de méthode et à l'homogénéité de doctrine. Cette apparente confusion [lui-même vient de faire voir qu'elle n'est pas apparente, mais réelle] doit, en effet, produire, chez ceux qui n'en ont pas bien saisi le principe [lisez : qui n'acceptent pas comme article de foi les élucubrations de Comte] une fâcheuse hésitation sur le vrai caractère philosophique des temps correspondants. Mais, afin de la prévenir ou de la dissiper entièrement, il suffit ici (p. 15) de discerner, en général, d'après quelle catégorie intellectuelle doit être surtout jugé le véritable état spéculatif d'une époque quelconque ». Et maintenant nous galopons en dehors du domaine expérimental. Laissons de côté les petites imperfections. Il appelle « fâcheuse » l' « hésitation ». Pourquoi donc faut-il la déplorer ? Il nomme « vrai » le « caractère philosophique », « véritable » l'« état spéculatif ». Quelqu'un voudra-t-il nous dire comment on les distingue de ceux qui sont « faux » ? Mais il est une observation plus importante. Notre auteur suppose précisément ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire qu'il y a un état spéculatif unique pour une époque, car s'il en était plusieurs de coexistants, on ne voit pas pourquoi l'un devrait être appelé « véritable » plutôt que l'autre.
[FN: § 1536-2]
Loc. cit., § 1536-1. Dans le passage suivant, c'est nous qui soulignons : (p. 15) Or tous les motifs essentiels concourent spontanément, à cet égard, pour indiquer avec une pleine évidence [c'est lui qui le dit et cela suffit], l'ordre de notions fondamentales, le plus spécial et le plus compliqué, c'est-à-dire celui des idées morales et sociales, comme devant toujours fournir la base prépondérante d'une telle décision : non seulement en vertu de leur propre importance, nécessairement très supérieure dans le système mental de presque tous les hommes [mais si c'est justement ce qu'il faut démontrer !], mais aussi chez les philosophes eux-mêmes, par suite de leur position rationnelle à l'extrémité de la vraie hiérarchie encyclopédique, établie au début de ce traité ».
[FN: § 1537-1]
A. COMTE ; Cours de phil. posit., t. I. Dans le passage suivant, c'est A. comte qui souligne : Avertissement. « (p. XIII) Je me bornerai donc... à déclarer que j'emploie le mot philosophie, dans l'acception que lui donnaient les anciens, et particulièrement Aristote, comme désignant le système général des conceptions humaines ; et, en ajoutant le mot positive, j'annonce que je considère cette manière spéciale de philosopher qui consiste à envisager les théories, dans quelque ordre d'idées que ce soit, comme ayant pour objet la coordination des faits observés [ce serait donc proprement la méthode logico-expérimentale], ce qui constitue le troisième et dernier état de la philosophie générale, primitivement théologique et ensuite métaphysique ». Qu’on y ajoute les passages suivants : « (p. 3) Enfin, dans l'état positif, l'esprit humain reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, et à connaître les causes intimes des phénomènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude ». Telle est la définition de la méthode logico-expérimentale. Peut-être y aurait-il lieu d'observer que si l'on veut pousser la rigueur à l'extrême, au lieu de dire « par l'usage du raisonnement et de l'observation », il vaudrait mieux dire : « par l'usage de l'observation et du raisonnement » ; et il serait bon de biffer l'épithète d' « invariables » aux relations. Mais si c'est là le point de départ, le point où l'on arrive, dans le même Cours, pour ne pas parler des autres ouvrages, est celui d'une foi qui, au fond, diffère peu ou pas du tout des autres croyances. Voir, par exemple, t. VI : « (p. 530) Une saine appréciation de notre nature où d'abord prédominent nécessairement les penchants vicieux ou abusifs [qui détermine ceux qui sont tels ? Le sentiment de l'auteur] rendra vulgaire l'obligation [imposée par qui ? D'où sort cet impératif ? Ce n'est certes pas une relation expérimentale] unanime d'exercer, sur nos diverses inclinations une sage discipline contenue, destinée à les stimuler et à les contenir selon leurs tendances respectives. Enfin la conception fondamentale, à la fois scientifique et morale [morale est ici ajouté à la recherche exclusivement scientifique du premier passage cité], de la vraie situation générale [que peut bien être cette entité ?], comme chef spontané de l'économie réelle, fera toujours nettement ressortir la nécessité de développer sans cesse, par un judicieux exercice, les nobles attributs, non moins affectifs qu'intellectuels, qui nous placent à la tête de la hiérarchie vivante ». [Les mots soulignés le sont par nous]. Ce bavardage sera tout ce qu'on voudra, hormis la recherche d'une uniformité expérimentale.
[FN: § 1537-2]
A. COMTE ; Cours de philosophie positive, t. VI. Par exemple, traitant des recherches mathématiques, il dit : « (p. 286) Ce premier exercice scientifique des sentiments abstraits de l'évidence et de l'harmonie, (p. 287) quelque limité qu'en dût être d'abord le domaine, suffit pour déterminer une importante réaction philosophique, qui, immédiatement favorable à la seule métaphysique, n'en devait pas moins annoncer de loin l'inévitable avènement de la philosophie positive, en assurant la prochaine élimination de la théologie prépondérante ». Ici l'auteur pense évidemment à Newton et à ses continuateurs ; il oublie l'époque de scepticisme religieux de la fin de la République romaine. Les observations contenues dans le De natura deorum de Cicéron ou le De rerum natura de Lucrèce ne sont nullement issues de recherches mathématiques, et pourtant elles tendent à détruire le polythéisme et toute religion. Sextus Empiricus écrit en même temps contre les mathématiciens et contre les polythéistes. Mais laissons cela de côté ; c'est une erreur de faits. D'où l'auteur a-t-il tiré que l'« avènement » de la philosophie positive était « inévitable » ? Si cela n'est pas une simple tautologie pour exprimer que ce qui arrive devait arriver, c'est-à-dire du pur déterminisme, cela veut dire que l'auteur soumet les faits à certains dogmes. Il continue. « (p. 287) Par là se trouve irrévocablement rompue l'antique unité de notre système mental, jusqu'alors uniformément théologique... » Laissons de côté les erreurs habituelles déjà relevées ; mais de quelle « coordination de faits » l'auteur peut-il déduire que la rupture de cette uniformité est irrévocable ? Lucrèce aussi le croyait, et il attribuait le mérite de la destruction de la religion à Épicure. Pourtant la religion ressuscita – à supposer, par hypothèse invraisemblable, qu'elle fût morte – et elle recommença à prospérer. Pourquoi A. Comte doit-il être meilleur prophète que Lucrèce ? Et puis la distinction que A. Comte essaie de faire entre la foi théologique et la foi positiviste est imaginaire : « (p. 331) La foi théologique, toujours liée à une révélation quelconque [erreur de faits ; l'auteur pense uniquement à la théologie judéo-chrétienne ou à une autre semblable], à laquelle le croyant ne saurait participer, est assurément d'une tout autre espèce que la foi positive, toujours subordonnée à une véritable démonstration, dont l'examen est permis à chacun sous des conditions déterminées [admirez cette restriction ; mais l'Église catholique aussi permet un semblable examen, sous les conditions déterminées par elle], quoique l'un et l'autre résultent également de cette universelle aptitude à la confiance [autorité ; A. Comte veut substituer la sienne à celle du pape, tout simplement] sans laquelle aucune société réelle ne saurait subsister ». C'est bien ; pourtant cela doit uniquement s'entendre en ce sens que les actions non-logiques dont est issue l'autorité sont utiles, indispensables dans une société ; mais il n'est nullement démontré qu'elles donnent des théories en accord avec les faits. La foi positiviste peut être plus ou moins utile à la société que l'autre foi, à laquelle seule A. Comte octroie le nom de théologique ; c'est une chose à voir ; mais toutes deux sont en dehors du domaine logico-expérimental.
[FN: § 1538-1]
Iliad., 1, 5 et passim.
[FN: § 1541-1]
D. AUG. : De Genesi ad litteram, II, 1, 2.
[FN: § 1542-1]
Les innombrables objections « scientifiques » contre la religion appartiennent à ce genre. La seule conclusion qu'on en puisse tirer est que le contenu de la Bible et la réalité expérimentale sont des choses qu'on ne doit pas confondre. – Abbé E. LEFRANC ; Les conflits de la science et de la Bible, Paris, 1906 [nous citons ce livre seulement à cause de la date de sa publication] : « (p. 143) Si Dieu a évoqué du néant les espèces vivantes en pleine activité, avec leurs organismes actuels, demeurés essentiellement invariables, la création a dû être foudroyante et complète du premier coup [on ne sait pas ce qu'est la création, et l'on sait comment elle doit avoir eu lieu !] . Dixit et facta sunt. Deus creavit omnia simul. On ne conçoit pas [il y a tant de choses qu'on ne conçoit pas !]que le Tout Puissant se soit d'abord timidement essayé [qui lui dit qu'il y eut de timides essais, et non pas l'exécution d'un sage dessein ? Notre auteur était donc présent à la création ?] à construire de simples ébauches très humbles d'aspect et de structure, et qu'il ait procédé par une suite ininterrompue de brusques coups de force, remettant sans cesse son œuvre sur le métier, s'y reprenant mille et mille fois pour la perfectionner au jour le jour, tel un ouvrier malhabile à réaliser ses conceptions, – créant et recréant à jet continu jusqu'à 600 000 types divers, pour le seul règne animal, l'un après l'autre, pendant (p. 144) des siècles et des siècles. Ce, système enfantin porte en lui-même sa propre réfutation ».
[FN: § 1542-2]
Le 31 décembre 1912, dans une séance du Conseil communal de Milan, un conseiller socialiste attaqua vivement l'enseignement de la doctrine chrétienne, qui, disait-il, contient « des assertions absurdes démenties par la science ». Parmi ces assertions, il cita que la lumière fut d'abord et le soleil ensuite. Il apparaît de là qu'il sait qu'au contraire le soleil exista d'abord, et qu'ensuite vint la lumière ; par conséquent, le soleil doit avoir été créé avant toutes les autres étoiles. Cela peut bien être, mais qui le lui a dit ? Toutefois, supposons qu'en nommant le soleil, il ait entendu nommer toutes les étoiles, tous les corps lumineux. Il semble, en effet, naturel qu'il y ait eu d'abord les corps lumineux et qu'ensuite soit venue la lumière ; mais, à vrai dire. nous n'en savons absolument rien. Nous ignorons ce que sont les « corps » et ce qu'est la « lumière », et nous connaissons encore moins le rapport qui peut avoir existé à l' « origine » entre ces deux entité. La « science » chrétienne donne une solution ; la « science » socialiste en donne une autre, à ce qu'il paraît ; la science logico-expérimentale ignore l'une et l'autre.
Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009 ↩
[FN: § 1550-1]
CIC ; Acad. quaest., II – ULP. ; De verborum significatione, 177 : Natura cavillationis, quam Graeci ![]() appellaverunt haec est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt, perducatur. – Bien connu est le passage d'Horace, Epist., II, 1, où, par le moyen de ce sophisme, l'auteur montre qu’on ne peut fixer la limite entre ancien et moderne, et que, sans qu'il y paraisse, on prive un cheval de toute sa queue en lui enlevant un crin à la fois. Le scoliaste (Pseudoacron.) dit en note : (45) Crisippi sillogismi sunt seu dominos (leg. pseudomenos) et sorites...
appellaverunt haec est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt, perducatur. – Bien connu est le passage d'Horace, Epist., II, 1, où, par le moyen de ce sophisme, l'auteur montre qu’on ne peut fixer la limite entre ancien et moderne, et que, sans qu'il y paraisse, on prive un cheval de toute sa queue en lui enlevant un crin à la fois. Le scoliaste (Pseudoacron.) dit en note : (45) Crisippi sillogismi sunt seu dominos (leg. pseudomenos) et sorites...
[FN: § 1550-2]
CIC. ; Acad. quaest., II, 29, 92.
[FN: § 1550-3]
SEXT. EMPIR. Pyrrh. hypot., II, c. 22, § 253 : « Donc, quand on nous proposera ainsi un argument, à chaque proposition nous tiendrons en suspens notre consentement. Ensuite, tout l'argument ayant été proposé, nous objecterons ce qui nous semblera à propos. Car si les sectateurs dogmatiques de Chrysippe, quand on leur propose le sorite, disent, au cours du raisonnement, qu'ils doivent s'arrêter pour ne pas tomber dans l'absurde ; à plus forte raison, à nous qui sommes sectateurs du scepticisme et craignons les absurdités, convient-il de ne pas nous laisser prendre aux interrogations des prémisses, mais de demeurer en suspens à chacune d'elles, jusqu'à ce qu'on nous ait, proposé tout le raisonnement ».
[FN: § 1550-4]
SEXT. EMP. : Adv. math., IX (adv. physicos), 190, (p. 593).
[FN: § 1551-1]
Systèmes, t. I, c. VI, p. 338 à 340.
[FN: § 1552-1]
ARIST., Rhet., III, 2, (p. 1405).
[FN: § 1552-2]
Dans la guerre italo-turque de 1912, les Arabes qui fournissaient aux Italiens des renseignements du camp turco-arabe étaient appelés informateurs ; ceux qui fournissaient aux Turco-Arabes des renseignements du camp italien étaient appelés espions. BENTHAM-DUMONT ; Tact. des ass. lég. suivie d'un traité des soph. polit., t. II : « (p. 178) Le mot persécution n'est pas dans le dictionnaire des persécuteurs. Ils ne parlent que de zèle pour la religion. Lorsque l'abbé Terray faisait une banqueroute aux créanciers publics, il lui donnait le nom de retenue ». En Italie, la réduction au 4 % de l'intérêt du 5 % de la dette publique fut dissimulée sous le nom d'impôt de la richesse mobilière. « (p. 163) Dans la nomenclature des êtres moraux, il est des dénominations qui présentent l'objet pur et simple, sans y ajouter aucun sentiment (p. 164) d'approbation ou de désapprobation. Par exemple : désir, disposition, habitude... J'appelle ces termes, neutres. Il en est d'autres qui, à l'idée principale, joignent une idée générale d'approbation : Honneur, piété... D'autres joignent à l'idée principale une idée habituelle de désapprobation : Libertinage, avarice, luxe... (p. 165) En parlant de la conduite, ou des penchants, ou (p. 166) des motifs de tel individu, vous est-il indifférent ? vous employez le terme neutre. Voulez-vous lui concilier la faveur de ceux qui vous écoutent ? vous avez recours au terme qui emporte un accessoire d'approbation. Voulez-vous le rendre méprisable ou odieux ? vous usez de celui qui emporte un accessoire de blâme ». « (p. 175) Celui qui parle du bon ordre, qu'entend-il par là ? rien de plus qu'un arrangement de choses auquel il donne son approbation et dont il se déclare le partisan ». Mais après que tant d'auteurs, d'Aristote à Bentham, ont mis en lumière les erreurs de ces sophismes, comment se peut-il qu'on persiste à en faire un si abondant usage ? Parce que – vérité banale – leur force ne réside pas dans le raisonnement, mais dans les sentiments qu'ils suscitent. Si l'on démontre qu'un théorème de géométrie est faux, la question est tranchée, on n'en parle plus. Au contraire, si l'on démontre qu'un raisonnement portant sur des matières sociales est absurde, cela n'a aucun effet : on continue à s'en servir abondamment. Le motif de cette différence consiste en ce que, dans le premier cas, c'est la raison qui agit, tandis que dans le second, c’est le sentiment, auquel s'ajoutent presque toujours différents intérêts. Par conséquent, au point de vue social, ces sophismes doivent être jugés, non pas d'après leur valeur logique, mais suivant les effets probables des sentiments et des intérêts qu'ils recouvrent.
[FN: § 1552-3]
Les discours de M. le prince de Bismarck, t. I, p. 233 – Séance du 22 janvier 1864.
[FN: § 1552-4]
Le Congrès national de la Libre-Pensée, assemblé à Paris, en octobre 1911, approuva une résolution qui dit : « Le Congrès des libres-penseurs, fidèle à l'idéal international de progrès et de justice [c'est là une foi ; elle est peut-être bonne et les autres mauvaises, mais c'est toujours une foi, qui n'a rien à faire avec la liberté de la pensée] invite toutes les sociétés de libre pensée à réclamer constamment l'application intégrale des conventions internationales signées à la Haye [quel rapport peuvent bien avoir ces conventions avec la liberté de la pensée ? Une pensée libre devrait pouvoir être favorable ou opposée à ces conventions, suivant ce qu'elle juge le mieux]. Les sociétés de libre pensée devront inviter les élus républicains à demander au gouvernement de la République de prendre l'initiative de négociations tendant à la conclusion de conventions nouvelles pour limiter les budgets militaires et navals et assurer le désarmement ». En attendant, voilà un beau lien imposé au nom de la liberté. Celui dont la pensée est libre doit vouloir le désarmement ; et si, au contraire, il croit le désarmement nuisible à son pays, son esprit est esclave. Ce sont là de telles absurdités qu'elles dispensent de toute réfutation. Et pourtant, il y a des gens qui s'y laissent prendre. Comment cela ? Simplement parce qu'on a changé le sens des mots, qui agissent non par leur sens propre, mais par les sentiments qu'ils suscitent. Les mots libre pensée suscitent les sentiments d'une pensée liée à une foi humanitaire et anti-catholique ; c'est pourquoi ils servent d'étiquette aux théories de cette religion.
[FN: § 1553-1]
En 1912, le patriarche de Venise, suivant la doctrine des Pères de l'Église, blâma vertement les femmes qui s'habillaient d'une façon qu'il jugeait immodeste et effrontée, annonça qu'il ne les admettrait pas à tenir les enfants sur les fonts baptismaux, ni à la communion ; et, eu effet, il repoussa de celle-ci une dame qui se présentait avec une robe qu'il jugea trop décolletée. Il y eut alors des journaux qui le comparèrent au sénateur Bérenger. Au contraire, les cas sont entièrement différents, et font partie de catégories qui ne peuvent être confondues. Pour que la confusion soit possible, il faudrait que les pouvoirs publics obligeassent les femmes à exercer les fonctions religieuses auxquelles préside le patriarche de Venise. Mais il n'en est rien. Y prend part qui veut, et le patriarche n'a pas le moindre pouvoir sur qui ne se soucie pas de lui. Au contraire, le sénateur Bérenger fait mettre en prison ou condamner à l'amende ou fait saisir les livres et les journaux des gens qui ne se soucient pas de lui. En somme, ce sont deux choses différentes que dire : « Si vous voulez que je fasse A, vous devez faire B, ou bien : « Que vous le vouliez ou non, je vous oblige par la force à faire B ». Le sentiment ne s'arrête pas à de telles analyses, et voit la chose synthétiquement. L'anticlérical blâme l'« intolérance » du patriarche de Venise, et admire le sénateur Bérenger. C'est là une dérivation qui signifie simplement que le premier déplaît à l’anti-clérical, et que le second lui plaît.
[FN: § 1553-2]
En Allemagne, le pasteur Jatho, qui professe un christianisme tout à fait spécial, a fait sur Goethe une série de sermons qui ont scandalisé les croyants. Le consistoire de la province du Rhin et le conseil supérieur de l'Église évangélique sont intervenus. Journal de Genève, 23 février 1911 : « Le Consistoire a demandé à M. Jatho de déclarer que ses sermons incriminés ont été inexactement rapportés et de prendre l'engagement qu'il ne songeait pas à en faire entendre à l'avenir de semblables. Le pasteur a refusé cette double déclaration. Il affirme être la victime d'une dénonciation anonyme et se retranche derrière l'incorrection de ce procédé pour se dérober à toute concession. À la suite de ces faits une procédure a été introduite contre lui devant le Conseil supérieur de l'Église Évangélique ... Une coïncidence, malheureusement, encore complique le cas. Tous les protestants ont cru devoir prendre vigoureusement parti contre le serment antimoderniste. M. Jatho et ses organes n'ont pas manqué de dire qu'on exigeait de lui un serment antimoderniste, et ils ont voulu obtenir de la presse évangélique qu'elle décernât au pasteur de Cologne les mêmes éloges démesurés dont elle couvre la demi-douzaine de prêtres réfractaires au serment moderniste. Il va sans dire que les journaux protestants se sont dérobés ; qu'ils ont cherché et trouvé des différences ». Qui cherche trouve et, en des cas semblables, trouve toujours toutes les différences qu'il peut désirer.
[FN: § 1554-1]
LA FONTAINE ; VIII, 2, Le savetier et le financier. Le pauvre savetier se plaint qu'on l'oblige à ne pas travailler :
… le mal est que toujours
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes),
Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours
Qu’il faut chômer ; on nous ruine en fêtes ;
L'une fait tort à l'autre ; et monsieur le curé
De quelque nouveau saint charge toujours son prône.
À Milan, quand on imposa le « repos hebdomadaire », qui n'est autre que le repos dominical, un pauvre savetier, chassé de sa boutique, mit sur ses épaules une ficelle avec des savates, et alla de ci de là, pour trouver les clients, disant : « Je mange le dimanche comme les autres jours ». Au temps passé, le gouvernement et les prêtres imposaient le chômage ; aujourd'hui, c'est le gouvernement et les associations de divers genres qui l'imposent ; et, aux jours de chômage imposés par la loi s'ajoutent ceux qui sont imposés par la force aux renards, les grèves politiques, « de protestation », de « solidarité » et autres. Il y a cette différence qu'aujourd'hui un individu est contraint d'agir contrairement à sa volonté, au nom de la « liberté », qui acquiert ainsi un sens exactement opposé à celui qu'il avait auparavant.
[FN: § 1554-2]
P. L. COURIER ; Œuvres complètes. Pétition à la Chambre des députés pour les villageois que l'on empêche de danser : « (p. 84) Messieurs ; ceux qui haïssent tant le travail du dimanche veulent des traitements, envoient des garnisaires, augmentent le budget. Nous devons chaque année, selon eux, payer plus et travailler moins ».
[FN: § 1554-3]
E. OLLIVIER ; L'Empire libéral, t. IV.
[FN: § 1554-4]
Si l'on voulait montrer, au moyen de la réduction à l'absurde, la vanité, d'un tel raisonnement, on pourrait observer qu'il s'applique dans tous les cas où les facultés qu'ont plusieurs individus de faire quelque chose sont en conflit. Par exemple, « l'État » devrait obliger les professeurs de violon à donner des leçons gratis, parce qu'en se faisant payer, ils « lèsent » la liberté de ceux qui veulent apprendre à jouer du violon et n'ont pas de quoi payer les leçons. C'est donc à l'État qu'il appartient de créer cette liberté d'apprendre à jouer du violon. De même, si une femme refuse de se donner à celui qui l'en sollicite, elle enlève la faculté de faire l'amour avec elle à cet homme dont elle lèse la « liberté » : et il faut, pour créer la liberté des amoureux, que l'État s'empresse d'obliger la femme de se donner à celui qui la désirs. Mais, objectera-t-on, de telles « libertés » ne sont pas respectables comme celle de ceux qui ne veulent pas travailler certains jours, et qui devraient le faire si d'autres travaillaient. Très bien ; mais cette réponse nous, entraîne à examiner s'il est utile, en vue de certaines fins déterminées, ou si nous voulons, pour un motif quelconque, favoriser la faculté de faire – ou de ne pas faire – des uns ou des autres ; et nous sortons entièrement du domaine où se trouve celui qui parle d'« offenses à la liberté » ou de « création de la liberté ».
[FN: § 1555-1]
Parmi les belles métamorphoses du terme libéralisme, remarquable est celle qu'on observe dans un discours du ministre Salandra. Le 6 avril 1,914, exposant à la Chambre le programme de son gouvernement, il dit : « À mon avis, libéralisme, en Italie, signifie patriotisme (vives approbations) ». C'est là une adjonction à faire à un futur dictionnaire des synonymes. Mais le ministre a peut-être seulement voulu dire que libéral et patriote étaient des termes employés pour désigner un certain parti, et, en ce cas, il ne s'écartait pas trop de la vérité : ce sont, en effet, des euphémismes dont le parti des « spéculateurs », en Italie, se complaît à tirer son nom (§ 2235).
[FN: § 1556-1]
La tradition pythagoricienne paraît avoir donné pour règle morale de s'efforcer d'être semblable aux dieux, (THEMIST. ; Orat. ; XV, p. 192). C'est là que HIEROCL. ; Comm. in aur. car., XXVII, Didot, p. .188, place la perfection. STOB. ; Eglog., II, 8, p. 66, rapporte comme étant une parole de Pythagore : « ![]() : « Suis dieu ». Si ce dieu était celui du vulgaire, la règle précédente ajouterait quelque chose à la simple affirmation d'un précepte : elle exprimerait que celui-ci est d'accord avec la nation que le vulgaire a du dieu. De même, si l'on connaissait la volonté de ce dieu par des livres sacrés, par la tradition ou d'une autre manière analogue, quelque chose serait aussi ajouté à la simple affirmation du précepte. Mais quand l'auteur même du précepte détermine aussi la nature et la volonté du dieu, invoquer ce dieu n'a d'autre effet que d'allonger la voie qui mène au but. Que l'auteur affirme directement le précepte, ou qu'il affirme indirectement qu'il tire son origine d'une similitude ou d'une volonté par lui déterminée, c'est exactement la même chose. La tradition pythagoricienne établit précisément une différence entre les dieux du vulgaire et ceux de Pythagore. Dans DIOGÈNE, VIII, 1, 21, Hiéronyme rapporte que Pythagore vit aux Enfers, « l'âme d'Hésiode enchaînée à une colonne de bronze et grinçant des dents, et celle d'Homère attachée à un arbre, entourée de serpents, à cause des choses qu'ils avaient dites au sujet des dieux ». De même, Platon corrige à sa manière la notion que le vulgaire, les poètes, d'autres auteurs, ont de dieu ; et dans le livre III de la République, il repousse et condamne plusieurs des opinions qui avaient cours au sujet des dieux ; il blâme les récits de certains faits, contenus dans Homère, et conclut : « (p. 388) Si donc, ami Adimante, les jeunes gens écoutaient attentivement de tels faits et ne s'en moquaient pas, comme de choses dites d'une manière indigne, quelqu'un d'entre eux, étant homme, les estimera difficilement indignes de lui et les blâmera ». Puis, dans le livre IV des Lois, p. 716, il dit que le semblable plaît à son semblable, et que par conséquent, pour se faire aimer de dieu, il faut que l'homme s'efforce de lui ressembler ; « et selon cette maxime, l'homme tempérant est ami de dieu, parce qu'il lui est semblable ; l'homme intempérant ne lui est pas semblable, et il est injuste ». Mais à quel dieu l'homme doit-il être semblable ? Pas au dieu d'Homère ; mais au dieu tel qu'il plaît à Platon de se le façonner. Le Zeus d'Homère n'est certes pas tempérant lorsque, au chant XIV de l'Iliade, il veut avoir commerce avec Héra, sur le mont Ida, sans se retirer dans son palais. C'est uniquement parce que Platon rejette, condamne le récit de ces aventures et d'autres semblables de Zeus, qu'il peut dire ce dieu tempérant. En sorte que son raisonnement est du type suivant : « L'homme doit faire cela, parce qu'il doit être semblable au dieu que j'imagine faire cela ». La valeur logico-expérimentale de ce raisonnement n'est pas du tout supérieure à la simple affirmation : « L'homme doit faire cela ». Il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment, pour lequel il est utile d'allonger autant que possible la dérivation, afin d'éveiller un grand nombre de sentiments ; de même que dans une œuvre musicale on fait de nombreuses variations sur un même motif. Voici, par exemple, STOBÉE ; loc. cit., p. 66, qui, après avoir cité Homère qu'il est bon d'avoir de son côté, quand on peut, ajoute : « Ainsi, Pythagore aussi a dit : suis dieu, ; évidemment pas avec la vue et comme guide, mais avec l'esprit et en harmonie avec la belle ordonnance du monde. Cela est exposé par Platon, selon les trois parties de la philosophie : dans le Timée physiquement.... dans la République éthiquement, dans le Théétète logiquement ». Ainsi, on satisfait tous les désirs.
: « Suis dieu ». Si ce dieu était celui du vulgaire, la règle précédente ajouterait quelque chose à la simple affirmation d'un précepte : elle exprimerait que celui-ci est d'accord avec la nation que le vulgaire a du dieu. De même, si l'on connaissait la volonté de ce dieu par des livres sacrés, par la tradition ou d'une autre manière analogue, quelque chose serait aussi ajouté à la simple affirmation du précepte. Mais quand l'auteur même du précepte détermine aussi la nature et la volonté du dieu, invoquer ce dieu n'a d'autre effet que d'allonger la voie qui mène au but. Que l'auteur affirme directement le précepte, ou qu'il affirme indirectement qu'il tire son origine d'une similitude ou d'une volonté par lui déterminée, c'est exactement la même chose. La tradition pythagoricienne établit précisément une différence entre les dieux du vulgaire et ceux de Pythagore. Dans DIOGÈNE, VIII, 1, 21, Hiéronyme rapporte que Pythagore vit aux Enfers, « l'âme d'Hésiode enchaînée à une colonne de bronze et grinçant des dents, et celle d'Homère attachée à un arbre, entourée de serpents, à cause des choses qu'ils avaient dites au sujet des dieux ». De même, Platon corrige à sa manière la notion que le vulgaire, les poètes, d'autres auteurs, ont de dieu ; et dans le livre III de la République, il repousse et condamne plusieurs des opinions qui avaient cours au sujet des dieux ; il blâme les récits de certains faits, contenus dans Homère, et conclut : « (p. 388) Si donc, ami Adimante, les jeunes gens écoutaient attentivement de tels faits et ne s'en moquaient pas, comme de choses dites d'une manière indigne, quelqu'un d'entre eux, étant homme, les estimera difficilement indignes de lui et les blâmera ». Puis, dans le livre IV des Lois, p. 716, il dit que le semblable plaît à son semblable, et que par conséquent, pour se faire aimer de dieu, il faut que l'homme s'efforce de lui ressembler ; « et selon cette maxime, l'homme tempérant est ami de dieu, parce qu'il lui est semblable ; l'homme intempérant ne lui est pas semblable, et il est injuste ». Mais à quel dieu l'homme doit-il être semblable ? Pas au dieu d'Homère ; mais au dieu tel qu'il plaît à Platon de se le façonner. Le Zeus d'Homère n'est certes pas tempérant lorsque, au chant XIV de l'Iliade, il veut avoir commerce avec Héra, sur le mont Ida, sans se retirer dans son palais. C'est uniquement parce que Platon rejette, condamne le récit de ces aventures et d'autres semblables de Zeus, qu'il peut dire ce dieu tempérant. En sorte que son raisonnement est du type suivant : « L'homme doit faire cela, parce qu'il doit être semblable au dieu que j'imagine faire cela ». La valeur logico-expérimentale de ce raisonnement n'est pas du tout supérieure à la simple affirmation : « L'homme doit faire cela ». Il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment, pour lequel il est utile d'allonger autant que possible la dérivation, afin d'éveiller un grand nombre de sentiments ; de même que dans une œuvre musicale on fait de nombreuses variations sur un même motif. Voici, par exemple, STOBÉE ; loc. cit., p. 66, qui, après avoir cité Homère qu'il est bon d'avoir de son côté, quand on peut, ajoute : « Ainsi, Pythagore aussi a dit : suis dieu, ; évidemment pas avec la vue et comme guide, mais avec l'esprit et en harmonie avec la belle ordonnance du monde. Cela est exposé par Platon, selon les trois parties de la philosophie : dans le Timée physiquement.... dans la République éthiquement, dans le Théétète logiquement ». Ainsi, on satisfait tous les désirs.
[FN: § 1557-1]
Essai d'une philosophie de la Solidarité.
[FN: § 1557-2]
M. Croiset continue : « (p. VI) La solidarité dont parlent couramment aujourd'hui les moralistes et les politiques est une chose assez différente, ou du moins c'est une chose plus complexe ». Ces malins le disent maintenant, mais pendant un certain temps, ils ont cherché à maintenir la confusion. À présent que cela ne leur réussit plus, ils changent l'air de la chanson. « (p. VII) Lorsqu'on parle, comme M. Léon Bourgeois, de la dette sociale des individus, il ne s'agit pas d'une dette commune envers un débiteur étranger, mais d'une dette réciproque des associés, ce qui est tout différent ». Parfait ; mais longtemps messieurs les solidaristes voulaient nous faire croire que les deux choses étaient identiques. « Et lorsqu'on invoque l'exemple de la solidarité biologique, on se garde d'en conclure que, dans la société, les individus sont soumis, comme les cellules d'un organisme vivant, à une sorte de fatalité extérieure et naturelle qu'il suffise de constater [mais que deviennent, ainsi, ces beaux discours sur la solidarité universelle des animaux avec les végétaux, et de ceux-ci avec les minéraux ?] En réalité, on envisage l'idée de solidarité comme un principe d'action, et d'action morale ; comme un moyen de provoquer chez les individus le souci d'une justice plus haute [Dieu sait comment on mesure, en mètres et centimètres, la hauteur de la justice ?], et comme une règle propre à leur permettre d'y atteindre ». Que de choses, dans ce seul mot de solidarité ! C'est vraiment un terme magique ; et encore M. Croiset a-t-il oublié une partie de son contenu, car en celui-ci se trouve aussi le désir des politiciens d'acquérir des partisans, et les adulations des métaphysiciens démocrates à la plèbe. L'auteur conclut, et il a bien raison : « Il est donc évident que le mot de solidarité a pris ici un sens tout nouveau, et que la solidarité morale diffère profondément, malgré l'identité des termes, de la solidarité biologique ou juridique ». Lesquelles, nous venons de le voir, sont des choses différentes.
[FN: § 1557-3]
Loc. cit. 1557-1 « (p. X) Le mot de « solidarité », emprunté à la biologie, répondait merveilleusement à ce besoin-obscur et profond [l'union des individus en un tout : (p. IX)]. Je ne parle pas d'« altruisme », trop barbare pour avoir jamais pénétré dans le langage courant [il y a un autre motif. c'est qu'avec altruisme il n'est pas possible de faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire de faire passer la théorie de la solidarité pour une théorie scientifique]. Comme le terme de « solidarité » était d'ailleurs assez vague, étant transporté d'un domaine où il avait un sens précis à un autre domaine où il s'agissait justement de l'acclimater, on restait libre de faire entrer peu à peu dans sa signification toutes les idées encore flottantes que les vieux mots, rendus trop précis par l’usage se prêtaient mal à exprimer ».
[FN: § 1559-1]
Au congrès de la paix, à Genève, en septembre 1912, quelques pacifistes français voulaient que l'emploi des aéroplanes en temps de guerre fût admis, tandis que les pacifistes d'autres pays voulaient qu'il fût interdit. Par une coïncidence qui pourrait ne pas être fortuite, la France était alors justement le pays que l'on disait être le mieux préparé à la guerre aérienne. Les pacifistes anglais qui réprouvaient la conquête de la Libye, faite par l'Italie, s'indignèrent profondément, parce que le congrès exprima le vœu de voir l'Angleterre se retirer de l'Égypte. Quel logicien sera assez subtil pour nous expliquer, à nous autres simples mortels, pourquoi la conquête de l'Égypte est « selon le droit », et celle de la Libye contraire au droit ? Les pacifistes belliqueux de 1911 avaient prêché ou simplement cru que Jules-César, Napoléon Ier et autres conquérants, étaient de simples « assassins » ; qu'il n'y avait pas de guerres « justes », sauf, peut-être, pour la défense de la patrie ; et puis, un beau jour, ils tournèrent casaque, et voulurent qu'on admirât comme des héros d’autres conquérants, qu'on acceptât comme « justes » des guerres de conquête ; cela sans nous apprendre comment on peut et l'on doit distinguer les conquérants et les guerres blâmables, des conquérants et des guerres louables. Au lieu d'instruire les dissidents, ils les injurient. Au moins notre Sainte Mère l'Église catholique instruisait-elle les hérétiques par le catéchisme, avant de les brûler. Les pacifistes belliqueux italiens s'indignèrent contre leurs concitoyens pacifistes-pacifiste à tel point que, s'ils l'avaient pu, ils leur auraient fait une guerre à mort. Ils faisaient cela, disaient-ils, pour défendre l'honneur de leur pays. Mais n'est-ce pas là justement la cause d'un très grand nombre des guerres qu'ils blâmaient auparavant ? – ÉMILE OLLIVIER écrit, pour justifier la guerre de 1870 (L'Emp. lib., t. XIV) : « Placés entre une guerre, douteuse et une paix déshonorée, bellum anceps an pax inhonesta, nous étions obligés de nous prononcer pour la guerre : nec dubitatum de bello.„ Pour les peuples comme pour les individus, il y a des circonstances où la voix de l'honneur doit parler plus haut que celle de la prudence “ (Cavour à Arese, 28 février 1860). Les gouvernements ne succombent pas seulement aux revers ; le déshonneur les détruit aussi. (p. 559) Un désastre militaire est un accident qui se répare. La perte acceptée de l'honneur est une mort dont on ne revient pas ». Pourquoi cet auteur, si haï des pacifistes, avait-il tort ? et pourquoi ceux-ci ont-ils raison, quand il leur devient avantageux de répéter exactement ses paroles ? En somme, peut-on savoir si Rome avait tort ou raison de faire la guerre aux nations qui occupaient les rives africaines de la Méditerranée, et de conquérir ces contrées ? Si elle avait raison, qu'en est-il de la belle doctrine du pacifisme, et comment est-il désormais possible de la distinguer de celle qui n'est pas pacifiste ? Si elle avait tort, comment donc se peut-il qu'aujourd'hui ceux qui essaient de faire précisément la même chose aient raison ? Répondre par des vivats ou en injuriant ses adversaires est peut-être un bon moyen d'exciter les sentiments, mais n'a pas moindre valeur logique, ni même vaguement raisonnable.
[FN: § 1562-1]
CICÉRON déjà, Acad. quaest., II, 46, 142, note plusieurs sens du terme vrai, et, depuis ce temps-là, le nombre de ces sens est allé toujours croissant. Aliud iudicitim. Protagorae est, qui putet id cuique verum esse, quod culque videatur : aliud Cyrenaicorum, qui praeter permotiones intimas, nihil putant esse iudicii : aliad Epicuri, qui omme iudicium in sensibus, et in rerum notitiis, et in voluptate constituit. Plato autem omne iudicium veritatis, veritatemque ipsam, adductam ab opinionibus et a sensibus, cogitationis ipsitis et mentis esse voluit...
[FN: § 1564-1]
D. AUGUST. ; Serm. 327 : In natali Martyrum, III. (4) Omnes haeretici etiam pro falsitate patiuntur, non pro veritate : quia mentiuntur contra ipsum Christum. Omnes pagani, impii quaecumque patiuntur, pro falsitate patiuntur. Mais comment distingue-t-on les vrais martyrs ? D'une façon très simple : À ce qu'ils sont morts pour la vérité : (2) Ergo ostendamus illos veraces. Iam ipsi se ostenderunt, quando pro veritate etiam mori voluerunt. De cette manière, les martyrs prouvent la vérité de la foi, ils en sont les témoins ; et la foi prouve la vérité des martyrs.
[FN: § 1564-2]
BAYLE ; Comm. philosoph., t. II : « (p. 85) On ne fait Mal, quand on force, que quand on force ceux qui sont dans la Vérité à passer dans l'Erreur. Or nous n'avons pas forcé ceux qui étaient dans la Vérité à passer dans l’Erreur ; (car, nous, qui sommes Orthodoxes, vous avons forcez, vous, qui étiez Schismatiques, ou Hérétiques, à passer dans notre Parti). Donc, nous n'avons pas mal fait. Et ce seroit vous seulement qui feriez Mal, si vous nous forciez. N'est-ce point là le Sophisme qu'on appelle Petitio Principii ? auquel en cette rencontre, il n'y a point de meilleure Réponse à faire, que de convertir la Mineure, de Négative en Affirmative, et de conclure directement contre celui qui s'en est servi ».
[FN: § 1564-3]
Les socialistes excluent de leur parti, et par conséquent excommunient ceux qui ne se conforment pas à la doctrine du parti. En vérité cela leur est indispensable, comme à toutes les personnes qui veulent constituer un parti. Mais ensuite il en est parmi eux qui veulent exclure de l'enseignement les prêtres catholiques, parce qu'ils ne sont pas « libres » de penser ce qu'ils croient, mais « doivent » suivre les enseignements de l'Église. Ce « devoir » du prêtre catholique est identique à celui du socialiste. Tous deux « doivent » suivre la doctrine de la collectivité à laquelle ils appartiennent, sous peine d'être exclus de cette collectivité. Si donc ce « devoir » est en opposition avec l'efficacité de l'enseignement, pour accroître cette efficacité, il est utile d'exclure à la fois le prêtre et le socialiste ; et si cette opposition n'existe pas, il est utile d'admettre à la fois le prêtre et le socialiste. Mais le sentiment fait une distinction. Ceux qui sont amis des prêtres et ennemis des socialistes, disent qu'on doit admettre les premiers, exclure les seconds. C'est ce qui arrive plus ou moins en Allemagne. Ceux qui sont ennemis des prêtres et amis des socialistes disent qu'on doit exclure les premiers, admettre les seconds. C'est ce qu'on veut faire en France. Aux naïfs, aux niais, aux pauvres d'esprit, on raconte que tout cela se fait par amour de « l'État éthique » ou de dame « Liberté ».
[FN: § 1567-1]
Les personnes qui ont la foi religieuse ou métaphysique disent que la vérité » qui se trouve à cet extrême est « supérieure » à celle qui se trouve à l'autre. C’est une conséquence logique de leur croyance que la religion, la métaphysique, la « science » des Hégéliens (§ 19 et sv.) sont « supérieures » à l'expérience. Les matérialistes invertissent cette proposition; mais leur « expérience » n'est qu'un genre de religion. Ils comparent en réalité deux « vérités » du second extrême.
[FN: § 1567-2]
Voici un exemple entre tant d'autres : MERLE D'AUBIGNÉ : Histoire de la Réformation, Genève, 1860, t. I : « (p. 17) Le monde (a), affaibli, chancelait sur ses bases quand le christianisme parut (b). Les religions nationales, qui avaient suffi aux pères, ne satisfaisaient plus les enfants... (c). Les dieux de toutes les nations, transportés dans Rome, y avaient perdu leurs oracles (d), comme les peuples y avaient perdu leur liberté... (e). (p. 18) Bientôt les étroites nationalités tombèrent avec leurs dieux. Les peuples se fondirent les ans dans les autres (f). En Europe, en Asie, en Afrique, il n'y eut plus qu'un empire (g). Le genre humain (h) commença à sentir son universalité et son unité ». Si l'on fixe son attention sur la réalité historique, les observations suivantes surgissent spontanément : (a) Qu'entend cet auteur par le terme tout le monde ? Parfois il semble qu'il entende le monde romain, c'est-à-dire la région méditerranéenne ; parfois il semble qu'il fasse allusion au globe terrestre. Quand il dit que le monde était affaibli, il est probable qu'il pense au monde romain, car il ne semble pas possible qu'il pense à la Chine, au Japon, à la Germanie et à tant d'autres pays. (b) Affaibli, pourquoi ? Le christianisme parut en un temps où l'empire romain était prospère et très fort. C'est plutôt après le triomphe du christianisme que l'empire s'affaiblit. Nombre d'empereurs païens imposèrent par le fer la paix aux Barbares ; nombre d'empereurs chrétiens l'achetèrent à prix d'or. (c) L'auteur oublie que si le christianisme voulait, en effet, ne pas être une religion nationale, en fait, il l'est devenu. Au contraire, l'islamisme est proprement sans nationalité, même de notre temps. De lui, mieux que du christianisme, on peut dire qu'il parut quand le monde (romain) était affaibli. (d) L'oracle de Delphes était très célèbre dans l'antiquité. Mais a-t-il vraiment disparu, parce que son dieu avait été transporté à Rome ? Où l'auteur peut-il bien avoir trouvé mention de ce transport ? (e) L'auteur veut faire une belle phrase, littérairement parlant, en mettant d'un côté les oracles des dieux et de l'autre la liberté des peuples. Il ne se soucie pas plus que cela de la réalité historique. (f) Quels peuples ? L'auteur ne pense probablement qu'aux peuples vaincus et subjugués par les Romains , il oublie les Barbares, les Chinois, les Japonais, les Hindous, les Africains, les Américains : une misère, quoi ! (g) Ici, l'auteur nomme certainement la partie pour le tout : il ne peut ignorer que l'empire romain était bien loin de s'étendre sur toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Afrique. (h) Mais si l'observation précédente est exacte, comment peut-il bien lui venir maintenant à l'idée de nommer le genre humain ? Et si ce que nous avons supposé dans l'observation précédente n'est pas exact, c'est-à-dire si l'auteur a vraiment voulu faire allusion à toute l'Europe, à toute l'Asie, à toute l'Afrique, – négligeons l'Amérique et l'Océanie – il est vrai qu'à la rigueur il peut tant bien que mal parler du « genre humain », mais il est non moins vrai qu'il a dit une chose fantaisiste. Celui qui lit cette histoire et partage la foi de l'auteur, n'aperçoit pas ces flagrantes contradictions avec la réalité ; de même que l'amoureux n'aperçoit pas les défauts de la femme qu'il aime. À leur sujet, LUCRÈCE, (IV, 1156. 1136, 1160, selon les éditions) écrivait déjà :
(1156) Nigra
; est, immunda ac fetida,
Caesia, [nervosa et lignea,

Parvola, pumilio,tota merum sal ;
...
(1166) Cetera de genere hoc, longum est, si dicere coner.
Molière a imité ces vers, Le misanthrope, acte II, scène VI. Il dit des amoureux :
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de favorables noms.
La pâle est au jasmin en blancheur comparable ;
La noire à faire peur, une brune adorable ;
etc.
[FN: § 1569-1]
Pourtant il blâme (XII, 25 m) l'usage trop abondant que Timée fait des discours, et, au fond (XII, 25 n), il semble que pour lui cet usage soit admissible uniquement comme moyen de faire connaître les sentiments et les mœurs. Comp. Thucyd I, 22.
[FN: § 1570-1]
JEAN RÉVILLE ; Le quatr. Évang. : « (p. 114 note). M. Loisy, à la fin de son étude sur Le Prologue du IVe évangile, p. 266 (Rev. d'hist. et de litt. rel., 1897), dit de l'évangéliste : „ Il n'écrit pas une histoire de Jésus, mais plutôt un traité de la connaissance de Jésus “. Je maintiens qu'il se propose bien d'écrire une histoire mais telle que la comprend un alexandrin, ce qui diffère du tout an tout de l'histoire telle que nous l'entendons ».
[FN: § 1570-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. LAO-TSEU ; Le Livre de la Voie et de la Vertu : « (Ch. XLVII – p. 174) Sans sortir de ma maison, je connais l'univers ; sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus l'on s'éloigne et moins l'on apprend. C'est pourquoi le sage arrive (où il veut) sans marcher ; il nomme les objets sans les voir ; sans agir, il accomplit de grandes choses ».
[FN: § 1571-1]
A. Loisy ; Études sur la religion chaldéo-assyrienne, dans la Revue des Religions, 1892. – On trouve une dérivation semblable dans un autre ouvrage de notre auteur. A. Loisy; Études bibliques : (« p. 131) Il ne faut pas dire néanmoins que la Bible contient des erreurs astronomiques. Ce serait à la fois une injustice et une naïveté. Pour qu'on fût en droit de reprocher à la Bible une erreur de ce genre, il faudrait que, dans un passage quelconque, un auteur inspiré manifestât l'intention d'imposer à son lecteur, comme vérité certaine [autre genre de vérité ! qu'ils sont donc nombreux !], telle ou telle conception sur le système du monde. Mais aucun des écrivains (p. 132) sacrés n'a laissé entrevoir la volonté d'écrire une leçn d'astronomie ». L'auteur ne veut pas que les sentiments défavorables entraînés par le mot erreur, puissent être éveillés, quand on parle de l'Écriture Sainte. C'est pourquoi il fait une dérivation, en confondant l'erreur objective et l'erreur subjective, et en donnant un seul nom à ces choses différentes. S'il avait voulu s'exprimer clairement, il aurait dû dire : « Parce qu'il y a dans la Bible des affirmations qui ne correspondent pas aux faits, c'est-à-dire des erreurs objectives, il n'est pas permis d'en conclure que l'écrivain ait voulu nous faire croire que ces affirmations correspondissent aux faits, ni qu'il en fût lui-même persuadé (erreur subjective) ». Mais ainsi on admet l'existence des erreurs objectives, ce qu'au fond A. Loisy ne veut pas nier ; pourtant il ne veut pas non plus se servir du terme erreur. La proposition de A. Loisy, laquelle est en somme celle de nombreux exégètes modernes, n'est, en vérité, pas très probable ; mais si l'on veut être très rigoureux, on ne peut la contester. Supposez un naturaliste qui discute avec sa femme du menu d'un dîner, et qui dise : « Comme poisson, au lieu de rouget, je propose de mettre une langouste ». Il y a, dans cette proposition, une erreur objective, parce que la langouste n'est pas un poisson ; il n'y a pas d'erreur subjective, parce que le naturaliste le sait fort bien ; mais il ferait rire sa femme s'il disait en pédant : « Comme plat de poisson, au lieu du poisson rouget, nous mettrons le crustacé langouste ». Pourtant, cela étant admis, il n'en demeure pas moins que dans la première proposition il y a une erreur objective.
[FN: § 1571-2]
X. ROUSSELOT ; Étude sur la philosoph. dans le moyen-âge, II : « (p. 111) En ces temps où apparut le christianisme, le sentiment chez les peuples était étouffé ou vicié ; ... Vint enfin le christianisme avec tous ses bienfaits, qui réchauffa les âmes, et fit résonner la (p. 15) corde religieuse devant laquelle se turent les deux autres ; mais le vrai ne pouvant être que dans une réalité complète [proposition inintelligible], le moment arriva où l'intelligence et aussi la volonté, après avoir, pour ainsi dire, expié leurs fautes, par une longue soumission, demandèrent à reprendre la place qui leur appartient ». En conséquence, parce que le vrai ne peut être que dans une réalité complète, il s'en suit que l'intelligence et la volonté demandent une certaine place qui leur appartient ! « (p. 15) Alors se forma chez les nouveaux penseurs, le nominalisme d'abord, cette manifestation première de l'intelligence indépendante, on sait ce qu'il en faut penser ; puis le réalisme, manifestation plus haute et plus digne [pourquoi plus haute ? quant à la dignité, qui en est juge ?], mais également exclusive, et qui, par conséquent, ne pouvait pas donner une formule exacte de la vérité, car celle-ci veut l'harmonie, et il n'y avait alors qu'antagonisme ». Mais quand et où la vénérable dame Vérité a-t-elle exprimé qu'elle voulait l'harmonie ? Et que peut bien signifier cela ?
[FN: § 1572-1]
L. DUCHESNE ; Hist. anc. de l'Église, t. III.
[FN: § 1575-1]
D. AUGUST. ; Epist., 93, Vicentii, c. 1, 2.
[FN: § 1575-2]
idem ; Ibidem : (c. 2, 5) Putas neminem debere cogi ad iustitiam.
[FN: § 1575-3]
Idem ; Ibidem : (c. 3, 10) ... ut coercitione exsiliorum atque damnorum admoneantur considerare quid, quare patiantur, et discant praeponere rumoribus et calumniis hominum Scriptura quas legunt.
[FN: § 1575-4]
Idem ; Ibidem : (10) Et hoc quidem, vel de omnibus haereticis, qui Christianis sacramentis imbuuntur, et a Christi veritate, sive unitate dissentiunt, vel Donatistis omnibus dixerim. Le saint dit ensuite que l'on ne doit pas rechercher si l'on est ou non contraint, mais bien si l'on est contraint au bien ou au mal : (c. 5, 16) ... sed quale sit illud quo cogitur, utrum bonum an malum. C'est toujours la même histoire. Je veux vous contraindre à faire ce qui me plaît : j'appelle bien ce qui me plaît, mal ce qui vous plaît, et je dis ensuite que vous ne devez pas vous plaindre si je vous contrains au bien. – Cfr. Epist., 175, 185. Il est plaisant de lire que saint Augustin, après avoir exposé un grand nombre de considérations théologiques sur le baptême, ajoute : (Epist., 89, 6). Et tamen cum tam perspicua veritas [c'est ainsi que le saint homme appelle ses divagations] aures et corda hominum feriat, tanta quosdam malae consuetudinis vorago submersit, ut omnibus auctoritatibus rationibusque resistere, quam consentire malint. Resistunt autem duobus modis, aut saeviendo aut pigrescendo. C'est pourtant bien clair ; et cependant on veut nous faire croire que les catholiques ne faisaient que se défendre ! Il faut un certain courage pour prétendre que celui qui résiste « pigrescendo », attaque autrui !
[FN: § 1575-5]
BAYLE ; Comment. philosoph., t. II : « (p. 11) Examinons donc les deux Lettres de cePère [de Saint Augustin], que l'Archevêque de Paris a fait imprimer à part, selon la nouvelle Version Françoise... (p. 12) Tout le Livre est intitulé, Conformité de la Conduite de l'Église de France, pour ramener les protestans, avec celle de l'Église d’Afrique, pour ramener les Donatistes à l'Église Catholique ». Aujourd'hui, M. Combes aurait pu faire imprimer un autre livre, en ajoutant à ces deux « conformités » celle de l'œuvre des anti-cléricaux, tendant à ramener les catholiques à l'église radicale-socialiste. Les admirateurs de Saint Augustin ne doivent pas oublier le proverbe : on récolte ce qu'on a semé. Pourtant le saint ne voulait pas la mort du pécheur. Epist., 100 : Augustinus Donato proconsuli Africae, ut Donatistas coerceat, non occidat. Ses successeurs ne furent pas si doux. Lui-même ne s'émeut pas si les donatistes se donnent la mort pour fuir la persécution qu'il a approuvée et suscitée. Epist., 185, c. 3 : (14) Si autem seipsos occidere voluerint, ne illi qui liberandi sunt liberentur [c'est-à-dire pour nous empêcher de persécuter les autres]... Quid agit ergo fraterna dilectio ; utrum dum paucis transitorios ignes metuit caminorum, dimittit omnes acternis ignibus gehennarum. Ces quelques mots contiennent tout le programme de l'Inquisition. Cfr. Contra Gaudentium, 1. I. c. 24 et sv.
[FN: § 1576-1]
D. AUGUST. ; Epist., 85, c. 9 : (35) Quod autem nobis obiiciunt, quod res eorum concupiscamus et auferamus... (36) Quidquid ergo nomine ecclesiarum partis Donati possidebatur, Christiani Imperatores legibus religiosis cum ipsis ecclesiis ad Catholicam transire iusserunt. C'est ainsi que, de nos jours, en France, les biens des congrégations passèrent au gouvernement... et aussi, paraît-il, en grande partie aux liquidateurs et aux politiciens, leurs complices. Il y a un aveu indirect des spoliations, dans ce que dit le saint, après avoir cité un exemple biblique. « Au jour du jugement : (c. 9, 41) Eodem modo non stabit paganus adversus Christianum, qui abstulit labores eius, quando idolorum exspoliata vol diruta sunt templa; sed stabit Christianus adversus paganum, qui abstulit labores eius, quando Martyrum strata sunt corpora [quelle remarquable puissance on trouve dans cette métaphore, pour s'approprier le bien d'autrui!]. Sic ergo non stabit haereticus adversus catholicum, qui abstulit labores eius, quando praevaluerunt leges catholicorum Imperatorum; sed stabit catholicus adversus haereticum, qui abstulit labores eius, quando furores praevalebant impiorum Circumcellionum. L'évêque donatiste Gaudentius dit des catholiques ; (Contra Gaud., 1. I, c. 36, 46) Sed hoc non sciunt, inquit, alienarum rerum incubatores... Dans sa réponse, le saint ne nie pas le fait, mais insiste seulement sur ce point : que les donatistes ne sont pas les justes de l'Écriture. Il dit : (c. 28, 51) De iustitia certamen est, non de pecunia. Oui, mais en attendant ils leur prenaient leur argent ! et il paraît que les donatistes devaient en être contents, parce qu'il est écrit : Labores impiorum iusti edent (Sap., X, 19), et parce que les catholiques étaient poussés par le désir de dissiper l'erreur, et non par la cupidité. In talibus quippe omnibus factis, non rapina concupiscitur, sed error evertitur. Ensuite, les catholiques ont pris les biens des hérétiques, pour les leur restituer... lorsqu'ils seront convertis.
[FN: § 1576-2]
D. AUGUST. ; Epist., 98, c. 5, 19 : Ita sane huic provisioni contradicere debui, ne res quas dicitis vestras, perderetis, et securi Christum proscriberetis : ut iure Romano testamenta, conderetis, et iure divino patribus conditum Testamentum, ubi scriptum est : « In semine tuo benedicentur omnes gentes (Gen., XXVI, 4) », calumniosis criminationibus rumperetis : ut in emptionibus et venditionibus liberos contractus haberetis, et vobis dividere quod Christus emit venditus auderetis...
[FN: § 1578-1]
RENAN ; Vie de Jésus, p. XXX.
[FN: § 1578-2]
RENAN ; Vie de Jésus : « (p. XLVII) Dans presque toutes les histoires anciennes, même dans celles qui sont bien moins légendaires que celles-ci, le détail prête à des doutes infinis. Quand nous avons deux récits d'un même fait, il est extrêmement rare que les deux récits soient d'accord. N'est-ce pas une raison, quand on n'en a qu'un seul, de concevoir bien des perplexités? On peut dire que parmi les anecdotes, les discours, les mots célèbres rapportés par les historiens, il n'y en a pas un de rigoureusement authentique. Y avait-il des sténographes pour fixer ces paroles rapides ? Y avait-il un annaliste toujours présent pour noter les gestes, les allures, les sentiments des acteurs ? Qu'on essaye d'arriver au vrai sur la manière dont s'est passé tel ou tel fait contemporain ; on n'y réussira pas. Deux récits d'un même événement faits par des témoins oculaires diffèrent (p. XLVIII) essentiellement. Faut-il pour cela renoncer à toute la couleur des récits et se borner à l'énoncé des faits d'ensemble ? Ce serait supprimer l'histoire ».
[FN: § 1578-3]
Il y a tant d'autres belles vérités ! Par exemple, ANTONIO Fogazzaro, dans le Corriere della Sera, 21 novembre 1910, parlant de Tolstoï, dit : « Il créa des vérités et ne sembla jamais se soucier de créer des beautés. Il sembla presque dédaigner l'art, comme inférieur, comme humain et non divin. Mais de l'entière Vérité, il fut presque la voix et la flamme. Non de la seule vérité qui, palpitante, poursuit l'artiste, mais bien aussi de la vérité morale resplendissant dans la conscience qui s'en est pénétrée. Vrai et Bien furent un pour lui. Certes, tout ce qui lui parut Bien et Vrai ne me parait pas Bien et Vrai, à moi, à une infinité d'autres qui ont la passion du Bien et du Vrai ». Le mot vrai est écrit tantôt avec une majuscule initiale, tantôt avec une minuscule ; mais on ne voit pas très clairement si les deux choses sont différentes ni quelle serait cette différence. Dame Vérité possède une voix et une flamme, ce qui doit lui être bien agréable, mais est quelque peu obscur pour nous. Il existe une certaine vérité morale « resplendissant dans la conscience qui en est pénétrée ». On le comprend, parce qu'il semble à chacun que ce dont il est pénétré resplendit ; mais le malheur est que chacun n'est pas pénétré ! Que veut dire « créer des vérités » ? Habituellement, on les découvre, on les affirme, on les fait connaître, tandis qu'on crée facilement des fables et des sornettes. On pourrait objecter que nos critiques ne s'adressent pas avec raison à ce qu'écrit ici Fogazzaro. parce que nous examinons au point de vue logico-expérimental des expressions qui ont pour but unique d'agir sur le sentiment. Cela est vrai ; mais précisément notre critique n'a d'autre but que de démontrer cette dernière proposition. Des écrits de ce genre sont ridicules, au point de vue logico-expérimental, tandis qu'ils peuvent être très efficaces pour éveiller les sentiments. C'est là que gît la valeur des dérivations.
[FN: § 1579-1]
Abbé DE BROGLIE ; Les prophètes et la prophétie d'après les travaux de Kuenen dans Revue des Religions, 1895).
[FN: § 1579-2]
GOUSSET ; Théol. dog., t. I, commence par dire (p. 312) Mais pour qu'une prophétie fasse preuve, il faut, premièrement, qu'elle ait désigné l'événement prédit d'une manière nette et précise ; en sorte que l'application de la prophétie ne soit pas arbitraire ». Parfait ; c'est raisonner suivant la méthode logico-expérimentale. Mais, hélas, on ne tardera pas à nous retirer la concession qu'on nous avait faite. « (p. 313) Toutefois il n'est pas nécessaire que la prophétie soit de la plus grande clarté ; il suffit qu’elle soit assez claire pour exciter l'attention des hommes, et pour être comprise lorsqu'elle est accomplie ».
[FN: § 1579-3]
Histoire des ducs de Normandie par GUILLAUME DE JUMIÈGE, publiée par GUIZOT ; Caen, 1826. On demande à un homme mystérieux si la descendance du comte Rollon durerait longtemps « (p. 313) Il ne voulut rien répondre, et se mit seulement à tracer des espèces de sillons sur les cendres du foyer avec un petit morceau de bois qu'il tenait à la main. L'hôte alors ayant voulu très obstinément lui faire dire ce qui arriverait après la septième génération, l'autre, avec le petit morceau de bois qu'il tenait toujours à la main, se mit à effacer les sillons qu'il avait faits sur la cendre. Par où l'on pensa qu'après la septième génération le duché serait détruit, ou bien qu'il aurait à souffrir de grandes querelles et tribulations : choses que nous voyons déjà accomplies en grande partie, nous qui avons survécu à ce roi Henri, lequel a été, comme nous pouvons le montrer, le septième au rang dans cette lignée ». – PAULIN PARIS ; Les romans de la table ronde, II. Le magicien Merlin dit que « (p. 56) à l'avenir il ne fera plus que des prédictions dont on ne reconnaîtra le sens qu'après leur accomplissement.„ Je ne parlerai plus devant le (p. 57) peuple ne en cort, se obscurément non ; que il ne sauront que je dirai devant que il le verront “. Merlin a tenu parfaitement sa parole, et tous les devins, ses devanciers ou successeurs, ont imité son exemple ». En effet, c'est une excellente précaution qu'on peut, en toute sécurité, recommander à messieurs les devins et aux prophètes.
[FN: § 1579-4]
GUYNAUD) ; La concordance des prophéties de Nostradamus avec l'histoire depuis Henry II jusqu'à Louis le Grand, Paris, 1712. Voici, au hasard, une des vérifications de notre auteur (p. 115). Centurie III, Quatrin 91.
L'arbre qu'avoit par long temps mort seiché,
Dans une nuit viendra à reverdir :
Chron. Roi malade : Prince pied attaché,
Craint d'ennemis fera voiles bondir.
« Explication : Les Historiens sont bien d'accord de la vérité du sujet de cette Prophetie (p. 116) mais ils ne conviennent pas du jour ni du mois qu'elle s'est accomplie. Favin... rapporte que le lendemain de la Saint Barthelemi, 25 Août 1572. ... un vieux arbre qu'on appelloit l'Aubespine, qui étoit tout sec et mort depuis longtemps, se trouva dans l'intervale de la nuit du Dimanche au lundi tout verd le matin... C'est ce qui justifie aujourd'hui la verité des deux premiers Vers : L’arbre qu'avoit par longtemps mort seché; dans une nuit viendra à reverdir. Cependant Janus Gallicus dit que cela n'arriva qu'en Septembre de la môme année 1572... Mais que ce prodige soit arrivé le lendemain de la saint Barthelemi, ou qu'il ne soit arrivé que sept ou huit jours après, il n'importe aujourd'hui ; il suffit que Nostradamus l'avoit prédit. Les deux (p. 117) Vers poitent : Chron. Roi malade; Prince pied attaché: Craint d'ennemis fera voiles bondir. C'est encore ici les signes ordinaires de la vérité des prédictions de Nostradamus ; en ce que Charles IX, quelque temps après que ce prodige fut arrivé, se trouva indisposé... d'une maladie chronique, c'est-à-dire d'une espèce de fievre quarte. Prince pied attaché : cela vouloit dire que M. le Duc d'Anjou s'attacheroit, comme il fit, aussi environ ce même temps là, au pied des murailles de la Rochelle,... et que par la crainte des ennemis de la France, le Roi mettroit aussi une Armée Navale sur pied, suivant ce dernier Vers : Craint d'ennemis fera voiles bondir ». Voir aussi CHARLES NICOULAUD ; Nostradamus et ses prophéties, 1914, Paris, Boussus. Swift plaisante agréablement ces faiseurs de prophéties. Il feint, sous le nom de Bickerstaff, de faire plusieurs prédictions ; entre autres il annonce, pour des jours indiqués, la mort du faiseur d'almanachs Partridge et celle du cardinal de Noailles. Il suppose qu'on conteste que ces prophéties se soient avérées, et il répond. Opuscules humoristiques de SWIFT, traduits par LÉON DE WAILLY – Paris, 1859 : (p. 219) En dépit de tous mes efforts, je n'ai pas pu découvrir plus de deux objections contre l'exactitude de mes prophéties de l'année dernière : la première est celle d'un Français à qui il a plu de faire savoir au monde, « que le cardinal de Noailles était encore en vie, malgré la prétendue prophétie de (p. 220) M. Biquerstaffe (sic) » : mais jusqu’à quel point un Français, un papiste et un ennemi, est croyable dans sa propre cause, contre un protestant anglais, fidèle au gouvernement, j'en ferai juge le lecteur candide et impartial [des arguments de ce genre ont continué à être très sérieusement employés]. L'autre objection... a trait à l’article de mes prédictions qui annonça la mort de M. Partridge pour le 29 mars 1708. Il lui plaît de contredire formellement ceci dans l'almanach qu'il a publié pour la présente année... Sans entrer dans des critiques de chronologie au sujet de l'heure de sa mort, je me bornerai à prouver que M. Partridge n'est pas en vie ». Suivent des arguments qui sont des parodies de ceux en usage en pareilles occasions. Entre autres : « (p. 221) Deuxièmement, la mort est définie, par tous les philosophes, une séparation de l'âme et du corps. Or il est certain que sa pauvre femme, qui doit le savoir mieux que personne va depuis quelque temps de ruelle en ruelle dans son voisinage, jurant à ses commères que son mari est un corps sans âme. C'est pourquoi, si un ignorant cadavre continue d'errer parmi nous, et qu'il lui plaise de s'appeler Partridge, M. Bickerstaff ne s'en croit aucunement responsable ». Au sujet du moment précis de la mort de Partridge, « (p. 228) plusieurs de mes amis... m'assurèrent que j'étais resté en deçà d'une demi-heure : ce qui (j'exprime ma propre opinion) est une erreur de trop peu d'importance pour qu'il y ait lieu à se tant récrier ». C'est à peu près ce que dit Guynaud à propos de l'arbre mort.
Ce fut aussi après l'événement que l'on comprit le sens de l'oracle d'Apollon : Aio, te, Aeacida, Romanos vincere posse. Pyrrhus croyait vaincre les Romains, et, au contraire, ce fut lui qui fat vaincu ; tout cela parce qu'en latin la proposition infinitive a deux accusatifs : celui du sujet et celui du complément direct. Mais ces maudits sceptiques, qui ignorent le caractère des vrais oracles, objectent que la Pythie n'a jamais parlé latin dans ses oracles : Primum latine Apollo nunquam locutus est. Deinde ista sors inaudita Graecis est. Praeterea Pyrrhi temporibus iam Apollo versus facere desierat. Postremo, quanquam semper fuit, ut apud Ennium est,
… Stolidum genus Aeacidarum,
Bellipotentes sunt magi', quam sapientipotentes :
tamen hanc amphiboliam versus intelligere potuisset, « vincere te Romanos », nihilo magis in se, quam in Romanos valere (CIC.; De div., 11, 56, 116).
[FN: § 1579-5]
ABBÉ DE BROGLIE ; loc. cit. § 1579-1 : « p. 121) Kuenen fait une constatation plus étrange encore. Quand il arrive aux auteurs du Nouveau Testament de se servir d'un texte de l'Ancien dans un sens contraire au sens naturel des termes, ils ne craignent pas d'altérer le texte et de supprimer les phrases, les incises et les mots qui fixaient le sens de l'original ». L'auteur cite un exemple où Saint Paul a certainement altéré un texte biblique : « (p. 122) Ce passage est extrêmement étrange et embarrassant. Il semble que Saint Paul déclare que Moïse ait dit une (p. 123) chose qu'il n'a évidemment pas dite. Néanmoins en examinant la chose avec attention, la difficulté diminue ». Suivent des explications fort subtiles, pour prouver qu'en somme Saint Paul a raison. Pourtant, l'auteur n'est pas satisfait. « (p. 124) Malgré ces explications il reste toujours une difficulté. La manière dont Saint Paul cite l'Ancien Testament est certainement d'une étrange liberté et il est clair qu'il donne un enseignement dogmatique et non un commentaire grammatical du texte ». Loin d'être un « commentaire grammatical », c'est un texte faux qu'on nous présente. L'auteur dit qu'on peut chercher des solutions à cette difficulté ; cependant « (p. 124) si ces solutions nous paraissent imparfaites, nous avons une ressource que le Pape lui-même nous indique, c'est de suspendre notre jugement cunctandum a sententia. Nous nous demandons même si ce dernier parti n'est pas le plus sage en présence du texte cité plus haut ».
[FN: § 1580-1]
Le maréchal de Moltke a écrit l'histoire de la guerre de 1870, et dans la préface, on nous donne son avis sur le but qu'il s'est proposé en écrivant cet ouvrage. DE MOLTKE ; La guerre de 1870 : « (p. II) Ce qu'on publie dans une histoire militaire reçoit toujours un apprêt, selon le succès plus ou moins grand qui a été obtenu, mais le loyalisme et l'amour de la patrie nous imposent l'obligation de ne pas détruire certains prestiges dont les victoires de nos armées ont revêtu telle ou telle personne ». Parfaitement. On déclare ainsi le but, qui est d'exposer les faits, mais en tenant compte de l'utilité sociale que peut avoir ce récit.
[FN: § 1580-2]
Manuel I, 40.
[FN: § 1580-3]
Bien que cela puisse paraître étrange, il est pourtant certain qu'en un même pays il peut y avoir en même temps des histoires de différents genres. Par exemple, l'histoire du Risorgimento qu'on enseigne dans les écoles Italiennes diffère sur plusieurs points de l'histoire réelle, qui est bien connue. En février 1913, l'empereur allemand fit un discours, à l'Aula de l'université de Berlin, et dit : « Il a été donné au peuple prussien de se relever des malheurs, grâce à sa foi. Aujourd'hui, on ne veut croire que ce qu'on peut voir et toucher ; et l'on veut susciter toujours de nouvelles difficultés à la religion. Or, peu après le règne de Frédéric le Grand [Frédéric II], la Prusse ayant perdu la foi, la catastrophe de 1806 eut lieu. Il faut y voir la main de Dieu et non celle des hommes. De cette crise est née la nation allemande. Dieu a montré qu'il protégeait l'Allemagne. Que notre jeunesse forge ses armes au feu de la foi ; et avec de telles armes, nous pourrons aller de l'avant, pleins de confiance en la puissance divine ». Le Berliner Tageblatt observe : « L'empereur a dit que la Prusse perdit la foi peu après la mort de Frédéric II et que c'est pour cette raison qu'elle fut vaincue en 1806. Il faut remarquer que le victorieux Frédéric Il ne fut certainement pas un héros en matière de foi, et que la Prusse fut défaite sous le règne d'un prince très pieux. Il est vraiment difficile d'employer le compas de la religion pour les faits historiques ». Au point de vue des faits expérimentaux, c'est bien, mais non s'il s'agit de donner de la force aux sentiments d'un pays ; et c'est ce dernier but que visait exclusivement l'empereur. Au point de vue des faits expérimentaux, le discours impérial est si étrange, qu'il rappelle une poésie de Fucini, dans laquelle une aurore boréale est nommée « le doigt du Tout Puissant ». Mais quel poids aura, dans la balance, la vérité expérimentale, le jour où les armées iront au-devant de la mort ? Il faut ajouter que là où l'on croit à tort faire usage de cette vérité expérimentale, en réalité, on a simplement une autre religion ; et celle de l'empereur allemand semble meilleure que beaucoup d'autres, en cela qu'elle fortifie, au lieu de déprimer, les sentiments qui sont utiles à celui qui tombera sur le champ de bataille. Voici, par exemple, les fidèles de la religion « dreyfusarde », en France, qui se croient, mais bien à tort, des fidèles de la science expérimentale. M. Millerand était incontestablement le meilleur ministre de la guerre que la France avait eu depuis nombre d'années. De tout son pouvoir, il s'efforçait de préparer la victoire, de même que le général André préparait la défaite. Mais M. Millerand offensa la sacro-sainte religion dreyfusarde, en nommant M. du Paty de Clam à un poste d'officier de réserve. Au point de vue expérimental, ce fait compte vraiment pour zéro dans la préparation à la guerre. Mais au point de vue de la religion des intellectuels, c'est un délit très grave ; et pour l'expier, M. Millerand dut donner sa démission de ministre. Donc, d'une façon générale, que tout ministre de la guerre sache qu'il peut ou non s'occuper de la défense du pays, on n'y attachera pas beaucoup d'importance, et, de fait, le général André demeura longtemps ministre ; mais il ne doit pas toucher aux dogmes sublimes de la sacro-sainte religion dreyfusarde, ni de la religion humanitaire. En somme, l'histoire officielle de ces intellectuels ne se rapproche pas beaucoup plus de la vérité expérimentale que l'histoire de l'empereur allemand. La Liberté, 2 février 1913, écrit à propos de l'incident du Paty de Clam (§ 1749-3) et de la discussion qui eut lieu, sur ce sujet, à la Chambre : « Comment nous nous préparons. Encore une journée de perdue... Nous défions qu'on trouve une bonne raison pour justifier le débat d'hier qui a si fort excité la Chambre. Il s'agissait de savoir si tel officier de la territoriale resterait affecté en cas de guerre à la garde d'une petite gare de banlieue. Voilà à quoi nos six cents représentants se sont amusés, tandis que restent en suspens des projets du plus haut intérêt pour la défense nationale. Le gouvernement allemand presse l'organisation nouvelle et formidable de son armée ; chez nous on s'attarde sur le cas intime de M. du Paty de Clam. L'affaire est pourtant bien simple. M. Millerand l'a exposée, à la tribune, avec une entière franchise. La mesure qu'il a prise était une simple mesure administrative préparée par son prédécesseur ; il a cru qu'il était de son devoir de tenir un engagement pris par celui-ci. C'est tout ». L'histoire officielle des intellectuels qui donnent en ces travers et celle de l'empereur allemand, égales au point de vue expérimental, diffèrent uniquement en ce que la première nuit à la défense de la patrie, et que la seconde y est utile.
[FN: § 1584-1]
CIC. ; Acad. quaest., II, 43, 132, dit qu'il faut se décider sur ce qu'est le souverain bien, « parce que toute règle de la vie est contenue dans la définition du souverain bien : ceux qui sont en désaccord avec elle sont en désaccord avec toute règle de la vie ». De telle sorte que nous voilà maintenant dans une belle situation, si nous voulons connaître les règles de la vie ! Il y a environ deux mille ans que Cicéron exposait ses doutes, et ils ne sont pas encore dissipés ! Qui sait s'ils le seront dans deux autres mille ans ? En attendant, il faut pourtant vivre, et les hommes vivent sans trop se soucier du souverain bien, qui demeure une belle entité à l'usage des métaphysiciens.
[FN: § 1585-1]
En général, les commentateurs des philosophes pourraient répéter ce que, suivant CICÉRON, Clitomaque disait de Carnéade. Acad. quaest., II, 45, 140 : Quamquam Clitomachus affirmabat, nunquam se intelligere potuisse, quid Carneadi probaretur.
[FN: § 1594-1]
L'Anthologie grecque contient une épigramme à laquelle CIC. ; Tusc., V, 35, 101, fait allusion, en ajoutant : Quid aliud, inquit Aristoteles, in bovis, non in regis sepulcro inscriberes ? On feint que ce qui suit est l'épigramme funéraire de Sardanapale : (Epigr. sepulcr., 325) « Je possède ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait d'excès, et les charmantes choses que j'ai connues avec les Amours. Tout le reste, y compris les choses heureuses, est perdu ». À cela, Cratès le Thébain répond : (Epigr. sepulcr., 326) « Je possède ce que j'ai appris, ce que j'ai médité, et les vénérables choses que j'ai connues avec les Muses. Tout le reste, y compris les choses heureuses, s'est envolé en fumée ». Polyarque (apud ATH., XII, c. 64, p. 545), discutant avec Archytas, disait qu'il lui semblait que la doctrine de celui-ci s'écartait beaucoup de la nature. « Car la nature, lorsqu'elle peut faire entendre sa voix, nous enjoint de céder à la volupté, et nous dit que c’est le fait des hommes sages ».
[FN: § 1595-1]
Il est difficile de savoir, par les différents témoignages que nous possédons, quelle était précisément l'opinion d'Aristippe ; mais il est incontestable que les auteurs anciens admettaient l'existence d'une opinion philosophique qui mettait le souverain bien dans le plaisir présent ; que ce fût là l'opinion d'Aristippe ou d'un autre, peu importe, étant donné notre but. AELIAN. ; Var. hist ., XIV, 6, dit aussi clairement que possible qu'Aristippe conseillait de s'occuper uniquement du présent, sans se soucier du passé ni de l'avenir. Ce qu'était ce présent, ATHEN. ; XII, p. 544, nous le fait connaître en parlant d'Aristippe, « lequel, approuvant la vie voluptueuse, dit qu'elle est le but et qu'en elle on trouve la vie bienheureuse », et il ajoute qu'Aristippe connaissait uniquement la volupté du présent. – DIOC,. LAERT. ; II. 87, dit que suivant les cyrénaïques, « le but est une volupté particulière, le bonheur est l'union de plaisirs particuliers ». Il ajoute que, selon Hippobotos : « (88) la volupté est un bien môme si elle tire son origine de choses très honteuses ». Et Aristippe disait : « (93) Rien n'est juste, honnête ou honteux selon la nature, mais bien suivant les lois et les mœurs ».
[FN: § 1595-2]
ATHEN. ; XII, 6, 3, (p. 514) : ![]() DIOG. LAERT. ; II, 75 :
DIOG. LAERT. ; II, 75 : ![]() . Ménage subtilise en voulant entendre
. Ménage subtilise en voulant entendre ![]() dans le sens de
dans le sens de ![]() « vaincre » ; Hoc igitur dicit Aristippus, ipsius pecunia superatam Laidem, ad quam scimus fuisse aditum difficillimum... sui corporis ipsi fecisse copiam : se vero a voluptatibus non esse superatum : quod accidere solet
« vaincre » ; Hoc igitur dicit Aristippus, ipsius pecunia superatam Laidem, ad quam scimus fuisse aditum difficillimum... sui corporis ipsi fecisse copiam : se vero a voluptatibus non esse superatum : quod accidere solet ![]() (aux intempérants). Le sens est, au contraire, très clair. En grec,
(aux intempérants). Le sens est, au contraire, très clair. En grec, ![]() veut dire posséder, dans le double sens que ce mot a aussi en français et en italien, d’être maître, d'occuper, et d'avoir des rapports charnels avec une femme, de l'avoir pour épouse, pour amante. Le passif
veut dire posséder, dans le double sens que ce mot a aussi en français et en italien, d’être maître, d'occuper, et d'avoir des rapports charnels avec une femme, de l'avoir pour épouse, pour amante. Le passif ![]() a les sens correspondants de l'actif ; et Platon, De Rep., III, p. 390, l'emploie justement au sens qu'il a dans les paroles d'Aristippe. Platon admoneste Homère, parce qu'il nous montre Zeus, brûlant de s'unir à sa femme, « et disant qu'il était plus possédé par la passion qu'il ne l'avait jamais été précédemment, lorsqu'ils s'unirent „ à l'insu de leurs chers parents “ » (Il., XIV, 296) :
a les sens correspondants de l'actif ; et Platon, De Rep., III, p. 390, l'emploie justement au sens qu'il a dans les paroles d'Aristippe. Platon admoneste Homère, parce qu'il nous montre Zeus, brûlant de s'unir à sa femme, « et disant qu'il était plus possédé par la passion qu'il ne l'avait jamais été précédemment, lorsqu'ils s'unirent „ à l'insu de leurs chers parents “ » (Il., XIV, 296) : ![]()
![]() . Donc Aristippe n'était pas possédé de cette façon par la passion pour Laïs. – LACTANCE (III, 15, 15) cite le mot d'Aristippe, mais n'y a rien compris. – CIC. Epist. ad famil., IX, 26 : Audi reliqua. Infra Eutrapelum Cytheris accabuit. In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille... Non, meher. cule, suspicatus sum illam affore : sed tamen Aristippus quidem ille Socraticus non erubuit, cum esset obiectum, habere eum Laida : « Habeo, inquit, non habeor a Laide ». Graece hoc melius. – DIOG. LAERT., II, 69. « Entrant [Aristippe] dans la maison d'une courtisane, et l'un des jeunes gens qui étaient avec lui ayant rougi : « Ce n'est pas d'entrer, dit Aristippe, qui est honteux, mais de ne pas pouvoir en sortir ». – PERS., V, appelle aussi libre l'homme qui sort de chez une courtisane intact et n'y retourne pas :
. Donc Aristippe n'était pas possédé de cette façon par la passion pour Laïs. – LACTANCE (III, 15, 15) cite le mot d'Aristippe, mais n'y a rien compris. – CIC. Epist. ad famil., IX, 26 : Audi reliqua. Infra Eutrapelum Cytheris accabuit. In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille... Non, meher. cule, suspicatus sum illam affore : sed tamen Aristippus quidem ille Socraticus non erubuit, cum esset obiectum, habere eum Laida : « Habeo, inquit, non habeor a Laide ». Graece hoc melius. – DIOG. LAERT., II, 69. « Entrant [Aristippe] dans la maison d'une courtisane, et l'un des jeunes gens qui étaient avec lui ayant rougi : « Ce n'est pas d'entrer, dit Aristippe, qui est honteux, mais de ne pas pouvoir en sortir ». – PERS., V, appelle aussi libre l'homme qui sort de chez une courtisane intact et n'y retourne pas :
(173) ... Si totus et integer illinc
Exieras, ...
[FN: § 1595-3]
DIOG. LAERT. ; II, 93. Néanmoins, cela contredit ce qu'il répondit, dit-on, à celui qui lui demandait ce que les philosophes avaient de bon : « Si toutes les lois étaient supprimées, ils vivraient de la même manière » (Idem, ibidem, II, 68). Mais ici nous ne recherchons pas ce que pensait vraiment Aristippe ; nous examinons certaines dérivations ; qu'elles soient de lui ou d'un autre, peu importe.
[FN: § 1596-1]
CIC. ; De fin. bon. et mal.
[FN: § 1596-2]
CIC. ; De fin. bon. et mal . II, 8, 24 : Hos ego asotos bene quidem vivere aut beate, nunquam dixerim. Ex quo efficitur, non ut voluptas ne sit voluptas, sed ut voluptas non sit summum bonum (édit. Verbugius).
[FN: § 1596-3]
Il y a cinq parties dans l'argumentation de Cicéron. 1° Une question philologique. Il dit (II, 4, 13) que ![]() doit être rendu en latin parle terme voluptas. « Dans ce terme, tous ceux, où qu'ils soient, qui savent le latin, comprennent deux choses : une joie dans l'âme et une sensation suave d'agrément dans le corps ». Sur ce point, il semble effectivement qu'il a raison, et que les termes
doit être rendu en latin parle terme voluptas. « Dans ce terme, tous ceux, où qu'ils soient, qui savent le latin, comprennent deux choses : une joie dans l'âme et une sensation suave d'agrément dans le corps ». Sur ce point, il semble effectivement qu'il a raison, et que les termes ![]() , en grec, voluptas, en latin, ont cette signification. 2° Une question concernant la manière de s'exprimer d'Épicure. Celui-ci emploie le terme
, en grec, voluptas, en latin, ont cette signification. 2° Une question concernant la manière de s'exprimer d'Épicure. Celui-ci emploie le terme ![]() en un sens différent de celui indiqué tout à l'heure (II, 5, 15) ex quo efficitur, non ut nos non intelligamus, quae vis sit istius verbi, sed ut ille suo more loquatur, nostrum negligat ». Sur ce point encore, Cicéron a raison ; mais il a même trop raison pour sa thèse, car le défaut d'Épicure est celui de tous les métaphysiciens, y compris Cicéron, qui, lui aussi suo more loquitur, nostrum negligit, lorsque par notre manière on entend celle des gens dissolus. 3° Une question de rapports de sentiments suscités chez certaines personnes par certains termes. Les sentiments suscités par les deux termes : volupté, souverain bien, ne coïncident pas chez Cicéron ; sur ce point, son affirmation suffit. Ils ne coïncident pas non plus chez certaines personnes ; c'est là un fait que l'expérience vérifie. Donc, en cela aussi Cicéron a raison. 4° Une question de rapport de sentiments de tous les hommes, ou bien de choses. Cicéron passe du contingent à l'absolu, non pas explicitement, mais implicitement, à la manière d'un grand nombre de métaphysiciens. Pour la même raison que l'affirmation de Cicéron suffit à établir qu'en lui les termes volupté et souverain bien n'éveillent pas des sensations identiques, l'affirmation d'une personne qui est d'un autre avis doit suffire pour établir qu'en elle ces deux termes suscitent des sensations égales ; et de la même façon que l'observation nous fait connaître que beaucoup de personnes pensent comme Cicéron, elle nous fait connaître aussi que bon nombre pensent différemment. Cicéron a donc tort de donner une valeur universelle, absolue, à une proposition qui n'a qu'une valeur particulière, contingente. 5° Une argumentation sophistique pour exclure les personnes d'un autre avis et revenir du contingent à l'absolu. Là aussi, le raisonnement est plein de sous-entendus, comme c'est l'usage général des métaphysiciens. On insinue qu'il y a des choses auxquelles on a donné le nom de volupté, souverain bien ; nous devons les connaître par le témoignage du plus grand nombre de gens ; et s'il est quelque mauvaise tête qui les nie, nous n'avons pas à tenir compte de son affirmation, de même que nous ne tiendrions pas compte de l'affirmation d'un esprit bizarre auquel il prendrait fantaisie de nier l'existence de Carthage. En d'autres termes, on insinue l'universalité de la proposition en recherchant ce qu'on dit. Ce on désigne tout le monde ; et quand tous parlent de la même façon, la chose doit être de cette façon, comme quand tout le monde dit que le soleil réchauffe. On ajoute enfin autant de considérations accessoires que la rhétorique en peut fournir. Donc, ici Cicéron a tort, mais ni plus ni moins que les autres métaphysiciens.
en un sens différent de celui indiqué tout à l'heure (II, 5, 15) ex quo efficitur, non ut nos non intelligamus, quae vis sit istius verbi, sed ut ille suo more loquatur, nostrum negligat ». Sur ce point encore, Cicéron a raison ; mais il a même trop raison pour sa thèse, car le défaut d'Épicure est celui de tous les métaphysiciens, y compris Cicéron, qui, lui aussi suo more loquitur, nostrum negligit, lorsque par notre manière on entend celle des gens dissolus. 3° Une question de rapports de sentiments suscités chez certaines personnes par certains termes. Les sentiments suscités par les deux termes : volupté, souverain bien, ne coïncident pas chez Cicéron ; sur ce point, son affirmation suffit. Ils ne coïncident pas non plus chez certaines personnes ; c'est là un fait que l'expérience vérifie. Donc, en cela aussi Cicéron a raison. 4° Une question de rapport de sentiments de tous les hommes, ou bien de choses. Cicéron passe du contingent à l'absolu, non pas explicitement, mais implicitement, à la manière d'un grand nombre de métaphysiciens. Pour la même raison que l'affirmation de Cicéron suffit à établir qu'en lui les termes volupté et souverain bien n'éveillent pas des sensations identiques, l'affirmation d'une personne qui est d'un autre avis doit suffire pour établir qu'en elle ces deux termes suscitent des sensations égales ; et de la même façon que l'observation nous fait connaître que beaucoup de personnes pensent comme Cicéron, elle nous fait connaître aussi que bon nombre pensent différemment. Cicéron a donc tort de donner une valeur universelle, absolue, à une proposition qui n'a qu'une valeur particulière, contingente. 5° Une argumentation sophistique pour exclure les personnes d'un autre avis et revenir du contingent à l'absolu. Là aussi, le raisonnement est plein de sous-entendus, comme c'est l'usage général des métaphysiciens. On insinue qu'il y a des choses auxquelles on a donné le nom de volupté, souverain bien ; nous devons les connaître par le témoignage du plus grand nombre de gens ; et s'il est quelque mauvaise tête qui les nie, nous n'avons pas à tenir compte de son affirmation, de même que nous ne tiendrions pas compte de l'affirmation d'un esprit bizarre auquel il prendrait fantaisie de nier l'existence de Carthage. En d'autres termes, on insinue l'universalité de la proposition en recherchant ce qu'on dit. Ce on désigne tout le monde ; et quand tous parlent de la même façon, la chose doit être de cette façon, comme quand tout le monde dit que le soleil réchauffe. On ajoute enfin autant de considérations accessoires que la rhétorique en peut fournir. Donc, ici Cicéron a tort, mais ni plus ni moins que les autres métaphysiciens.
[FN: § 1599-1]
CIC. ; De fin. bon. et malorum.
[FN: § 1600-1]
D. AUGUST. ; De civ. dei, XIX, c. 1 et sv. : (c. 4) Si ergo quaeratur a nobis, quid civitas Dei de his singulis interrogata respondeat, ac primum de finibus bonorum malorumque quid sentiat, respondebit aeternam vitam esse summum bonum, aeternam vero mortem summum malum. – D. THOM. ; Summ. theol., 2a, 2ae, XXVII, 6: ... quia ultimum bonum hominis consistit in hoc quod anima Deo inhaereat...
[FN: § 1602-1]
D. AUGUST., Retractationum I, 10, 3, Observe que sa Proposition : il n'y a pas de mal naturel : nullum esse malum naturale pourrait être mal interprétée par les pélagiens. Mais le terme naturel se rapportait à la nature qui a été créée sans péché. Donc cette nature est dite : vraie et propre nature de l'homme : ipsa enim ivere ac proprie natura hominis dicitur. Par analogie, nous employons aussi ce terme pour désigner la nature qu'a l'homme en naissant.
[FN: § 1602-2]
CLEMENTIS epistola ad Corinthios, I, 20 : ![]()
![]() . « Et les plus petits animaux s'associent dans la paix et la concorde ».
. « Et les plus petits animaux s'associent dans la paix et la concorde ».
[FN: § 1602-3]
Très connu est le passage des Géorgiques , IV, dans lequel VIRGILE dit des abeilles :
(67) Sin autem ad pugnam exierint ; (nam saepe duobus
Regibus incessit magno discordia motu),
Continuoque animos volgi et trepidantia bello
Corda licet longe praesciscere ;
Etc.
[FN: § 1603-1] Œuvres... de Cicéron, édit. NISARD, t. IV, p. 411.
[FN: § 1604-1]
ARIST. ; Natur. Auscult., II (p. 192-193 Bekk.). Nous n'avons pas à rechercher ici si ce traité est authentique ou non. Nous le mettons sous le nom d'Aristote, parce qu'on fait ainsi dans les éditions ; mais, au lieu d'Aristote, qu'on mette un X quelconque, et notre raisonnement demeure également, car il ne porte que sur la dérivation objectivement. – PLUTARCH., De plac. phil., I, 1, 1, commence par observer judicieusement qu'il serait absurde de disserter sur la Nature, si l'on n'expliquait pas auparavant ce que signifie ce mot. Pour faire cela, il dit : (2) ![]()
![]() La Nature, suivant Aristote, est donc le principe du mouvement et du repos, dans les corps où il se trouve primitivement et non par accident ». Nous voilà bien renseignés : maintenant nous savons ce qu'est la Nature ! Mais ensuite, le même auteur, dans le même traité, nous donne d'autres définitions. « (I, 30, 1) Empédocle dit que la Nature n'est pas autre chose que mélange et séparation d'éléments... (2) De même, Anaxagore dit que la Nature est combinaison et dissolution, c'est-à-dire naissance et destruction ».
La Nature, suivant Aristote, est donc le principe du mouvement et du repos, dans les corps où il se trouve primitivement et non par accident ». Nous voilà bien renseignés : maintenant nous savons ce qu'est la Nature ! Mais ensuite, le même auteur, dans le même traité, nous donne d'autres définitions. « (I, 30, 1) Empédocle dit que la Nature n'est pas autre chose que mélange et séparation d'éléments... (2) De même, Anaxagore dit que la Nature est combinaison et dissolution, c'est-à-dire naissance et destruction ».
[FN: § 1604-2]
ARIST. ; Natur. Auscult., II, 1, 10 : ![]()
![]() . Il n'est pas facile de comprendre ce que cela veut dire. Au fond, il semble qu'on discute pour savoir si la « nature » est la matière ou la forme, et il semble qu'on conclut qu'elle est la forme « (I, 1, 15) Donc la forme est la nature –
. Il n'est pas facile de comprendre ce que cela veut dire. Au fond, il semble qu'on discute pour savoir si la « nature » est la matière ou la forme, et il semble qu'on conclut qu'elle est la forme « (I, 1, 15) Donc la forme est la nature – ![]() . Pourtant on ne tarde pas à ajouter que forme et nature ont deux sens, car la privation est une certaine forme. Tout cela est du pur verbiage. D. THOM., Summ. theol., la 2 ae, q. XXXI, 7, explique Aristote : « Respondeo dicendum quod naturale dicitur „ quod est secundum naturam “, ut dicitur (Physic. lib. II, text. 4 et 5). Natura autem in homine dupliciter sumi potest. Uno modo, prout intellectus et ratio est potissima hominis natura, quia secundum eam homo in specie constituitur ; et secundum hoc naturales delectationes hominum dici possunt quae sunt in eo quod convenit homini secundum rationem ; sicut delectari in contemplatione veritatis et in actibus virtuum est naturale homini [il est regrettable que les malfaiteurs ne l'entendent pas ainsi]. Alio modo potest sumi natura in homine secundum quod condividitur rationi, scilicet id quod est commune homini et aliis, praecipue quod rationi non obedit... Donc natura veut dire blanc et noir ; cela ne suffit pas encore. Des deux espèces de plaisirs, une partie sont naturels en un sens, mais pas naturels en un autre : Secundum utrasque autem delectationes contiligit aliquas esse innaturales, simpliciter loquendo, sed connaturales secundum quid. On ne peut vraiment rien faire de plus pour ôter toute précision à ce terme. Il faut savoir se contenter. Saint Thomas aussi a eu ses commentateurs. En voici un : FR. ANTOINE GOUDIN ; Phil. suiv. les princ. de Saint Thomas, trad. TH. BOURARD, t. II : « (p. 198) Le mot nature peut donc se comprendre de quatre manières : 1e dans le sens de nativité, ainsi le premier-né est le chef de ses frères par nature, c'est-à-dire par l'ordre même de la naissance, et l'Apôtre dit que par nature nous sommes fils de colère, c'est-à-dire d'après la conception et la nativité, dont nous tirons le péché ; 2e dans le sens de matière et de forme, ainsi l'homme est dit se composer de deux natures partielles ; 3e dans le sens de l'essence de la chose : ainsi nous disons que la nature ou l'essence angélique est supérieure à la nature humaine ; 4e enfin, en Physique, la nature est prise pour le principe intrinsèque du mouvement et du repos dans les choses qui sont près de nous... » Il ne vient à l'idée d'aucun de ces auteurs que donner le même nom à des choses si diverses, est le meilleur moyen de ne pas se faire comprendre.
. Pourtant on ne tarde pas à ajouter que forme et nature ont deux sens, car la privation est une certaine forme. Tout cela est du pur verbiage. D. THOM., Summ. theol., la 2 ae, q. XXXI, 7, explique Aristote : « Respondeo dicendum quod naturale dicitur „ quod est secundum naturam “, ut dicitur (Physic. lib. II, text. 4 et 5). Natura autem in homine dupliciter sumi potest. Uno modo, prout intellectus et ratio est potissima hominis natura, quia secundum eam homo in specie constituitur ; et secundum hoc naturales delectationes hominum dici possunt quae sunt in eo quod convenit homini secundum rationem ; sicut delectari in contemplatione veritatis et in actibus virtuum est naturale homini [il est regrettable que les malfaiteurs ne l'entendent pas ainsi]. Alio modo potest sumi natura in homine secundum quod condividitur rationi, scilicet id quod est commune homini et aliis, praecipue quod rationi non obedit... Donc natura veut dire blanc et noir ; cela ne suffit pas encore. Des deux espèces de plaisirs, une partie sont naturels en un sens, mais pas naturels en un autre : Secundum utrasque autem delectationes contiligit aliquas esse innaturales, simpliciter loquendo, sed connaturales secundum quid. On ne peut vraiment rien faire de plus pour ôter toute précision à ce terme. Il faut savoir se contenter. Saint Thomas aussi a eu ses commentateurs. En voici un : FR. ANTOINE GOUDIN ; Phil. suiv. les princ. de Saint Thomas, trad. TH. BOURARD, t. II : « (p. 198) Le mot nature peut donc se comprendre de quatre manières : 1e dans le sens de nativité, ainsi le premier-né est le chef de ses frères par nature, c'est-à-dire par l'ordre même de la naissance, et l'Apôtre dit que par nature nous sommes fils de colère, c'est-à-dire d'après la conception et la nativité, dont nous tirons le péché ; 2e dans le sens de matière et de forme, ainsi l'homme est dit se composer de deux natures partielles ; 3e dans le sens de l'essence de la chose : ainsi nous disons que la nature ou l'essence angélique est supérieure à la nature humaine ; 4e enfin, en Physique, la nature est prise pour le principe intrinsèque du mouvement et du repos dans les choses qui sont près de nous... » Il ne vient à l'idée d'aucun de ces auteurs que donner le même nom à des choses si diverses, est le meilleur moyen de ne pas se faire comprendre.
[FN: § 1604-3]
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE ; Physique d'Aristote, t. I. Peu avant il avait dit : « (p. III) La théorie du mouvement est si bien l'antécédent obligé de la physique, que, quand à la fin du XVIIe siècle, Newton pose les principes mathématiques de la philosophie naturelle, il ne fait dans son livre immortel qu'une théorie du mouvement [en note : Newton le dit lui-même dans sa Préface à la première édition des Principes... ]. Descartes, dans les Principes de la Philosophie, avait également placé l'étude du mouvement en tête de la Science de la nature. Ainsi, deux mille ans passés avant Descartes et Newton, Aristote a procédé tout comme eux ; et si l'on veut considérer équitablement son œuvre, on verra qu'elle est de la même famille, et qu'à plus d'un égard, elle n'a rien à redouter de la comparaison ». Passe pour Descartes, mais quant à Newton, ses Principia sont à la Physique d'Aristote, ce que le jour est à la nuit. Par malheur, par ci par là dans les Principia, apparaît un peu de métaphysique. C'est comme la roche stérile qui renferme l'or expérimental. On comprend que les métaphysiciens s'emparent de la roche et laissent l'or. Dans la préface, Newton dit : Cum autem artes Manuales in corporibus movendis praecipue versentur, fit ut Geometria ad magnitudinem, Mechanica ad motum vulgo referatur. Quo sensu Mechanica rationalis erit Scientia Motuum qui ex viribus quibuscunque resultant, et Virium quae ad motus quoscunque requiruntur, accurate proposita ac demonstrata. Aristote ne parle de rien de cela, mais bien de tout autre chose.
[FN: § 1605-1]
STOB. ; Egl., II, 7, p. 132-134 : ![]()
![]() . Le mot
. Le mot ![]() signifie proprement : convenablement, harmoniquement, d'une manière concordante, conforme. Il est par conséquent quelque peu indéterminé, si l'on n'ajoute pas la chose avec laquelle existe la convenance, l'harmonie, etc. La sentence de Zénon serait donc : vivre convenablement, harmoniquement, etc. ; et peut-être pourrait-on dire aussi : vivre régulièrement, d'une manière réglée.
signifie proprement : convenablement, harmoniquement, d'une manière concordante, conforme. Il est par conséquent quelque peu indéterminé, si l'on n'ajoute pas la chose avec laquelle existe la convenance, l'harmonie, etc. La sentence de Zénon serait donc : vivre convenablement, harmoniquement, etc. ; et peut-être pourrait-on dire aussi : vivre régulièrement, d'une manière réglée.
[FN: § 1605-2]
Idem, Ibidem, p. 134. ![]()
![]() .
.
[FN: § 1606-1]
DIOG. LAERT. : VII, 88, trad. L. LECHI. Clément d'Alexandrie s'imagine que la nature des stoïciens c'est Dieu. – CLEM. ALEX. ; Strom., II, c. 19, p. 483, Potter, 404 Paris : ![]()
![]() « En conséquence, remplaçant convenablement le nom de nature par celui de Dieu, les stoïciens jugent que la fin, c'est vivre selon la nature ».
« En conséquence, remplaçant convenablement le nom de nature par celui de Dieu, les stoïciens jugent que la fin, c'est vivre selon la nature ».
[FN: § 1608-1]
J. J. ROUSSEAU ; Le contrat social. Après avoir dit comment s'établit le contrat social, l'auteur ajoute (1. II, c. 1) : « La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ». Comment cela ? « (c. IV) Si l'État ou la Cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au Corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir, qui, dirigé par la volonté générale, porte... le nom de souveraineté. – (c. IV) Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? » Voilà qu'est établie la proposition générale X = A, c'est-à-dire que la volonté générale X est toujours droite, A. Remarquez qu'avec le procédé habituel et cher au métaphysicien, on affirme une propriété de la volonté générale, avant de savoir ce qu'est précisément cette entité. Maintenant procédons à la modification de X. (l. II, c. III) : « Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique : mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal [remarquez la modification du sens d'erreur ; nous en parlerons incessamment]. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous [une des formes de X, et la volonté générale [autre forme de X] : celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières : [attention à la muscade, qui passe d'un gobelet dans l'autre] mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entredétruisent, [pour cela, il serait nécessaire que les moins fussent égaux aux plus, sinon il reste un résidu ; mais le divin Rousseau ne s'arrête pas à ces vétilles], reste pour la somme des différences la volonté générale ». Voilà que la muscade a passé du gobelet de droite dans celui de gauche. Attention, vous allez voir un nouveau et plus beau tour de passe-passe. On décrit un état réel B, pour en faire l'égal de l'une des abstractions indéterminées X, indiquées tout à l’heure. « Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communication entre eux [comment peuvent-ils être informés, sans avoir de communication ? Ce doit être une communication interne et spontanée], du grand nombre de petites différences [qui lui a dit qu'elles étaient petites ?] résulterait toujours la volonté générale X, et la délibération serait toujours bonne [même quand le peuple délibère de brûler les sorcières ?] Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État... Enfin quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier ». Une personne sait ce qui lui est agréable ou désagréable, mais peut se tromper par ignorance. On pourvoit à l'élimination de ce cas en demandant qu'on ne trompe pas le peuple, et qu'il soit suffisamment informé. L'erreur vient ainsi toujours du dehors. Si les citoyens n'étaient pas induits en erreur, ils jugeraient toujours sainement ; mais le plus grand nombre est dans l'erreur parce qu’il est incapable de discerner le vrai. Il suffit qu'ils soient informés pour qu'ils comprennent. Des gens qui ne comprennent pas, il n'en existe pas dans la cité de Rousseau. Ayant ainsi démontré : 1° que la volonté générale est toujours droite, 2° qu'elle est exprimée par le vote des citoyens bien informés et sans communication entre eux, on conclut logiquement que cette délibération est toujours droite.
[FN: § 1610-1]
FLEURY ; Hist. ecclés., 1. 69, t. 14, p. 619-620.
[FN: § 1612-1]
PLUTARCH. ; De def. orac., 15, p. 417 : ![]()
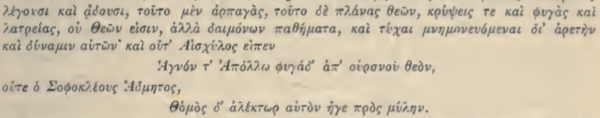
« Et assurément tout ce que l'on raconte et l'on chante, dans les mythes et dans les hymnes : les enlèvements, les courses errantes des dieux, le fait de se cacher et d'aller en exil et d'être esclave, ne sont pas choses qui arrivèrent aux dieux, mais aux démons ; et on les rapporte pour montrer la vertu et la puissance de ceux-ci. C'est pourquoi Eschyle ne devait pas dire :
Chaste Apollon, dieu exilé du ciel ;
ni l'Admète de Sophocle :
Mon coq [mari] l'a traîné [le dieu] au moulin. »
Ce dernier passage de Plutarque est certainement altéré ; ce ne peut être Admète, ce doit être Alceste, sa femme, qui parle.
[FN: § 1613-1]
GROTE ; Hist. de la Grèce, t. II : « (p. 153) Cette distinction entre les dieux et les démons semblait sauver à un haut degré et la vérité des vieilles légendes et la dignité des dieux. Elle obviait à la nécessité de prononcer ou que les dieux étaient indignes, ou les légendes mensongères. Cependant, bien qu'imaginée dans le but de satisfaire une sensibilité religieuse plus scrupuleuse, elle fut trouvée incommode dans la suite, quand il s'éleva des adversaires contre le paganisme en général. En effet, tandis qu'elle abandonnait comme insoutenable une grande portion de ce qui avait été jadis une foi sincère, elle conservait encore le même mot démons avec une signification entièrement altérée. (p. 154) Les écrivains chrétiens dans leurs controverses trouvaient d'abondantes raisons chez les anciens auteurs païens pour regarder tous les dieux comme des démons, et des raisons non moins abondantes chez les païens postérieurs pour dénoncer les démons en général comme des êtres méchants ».
[FN: § 1613-2]
MINUC. FELIX, 26: ... quid Plato, qui invenire Deum negotium credidit, nonne et angelos sine negotio narrat et daemonas ? et in Symposio etiam suam naturam daemonum exprimere conititur ? vult enim esse substantiam inter mortalem immortalemque, ici est inter corpus et spiritum mediam, terreni ponderis et caelestis levitatis admixtione concretam, ex qua monet etiam nos procupidinem amoris, et dicit informari et inlabi pectoribus humanis et sensum movere et adfectus fingere et ardorem cupiditatis infundere. 27. Isti igitur impuri spiritus, daemones, ut ostensum a magis, a philosophis et a Platone, sub statuis et imaginibus consecratis delitescunt ed adflatu suo auctoritatem quasi praesentis numinis consequuntur, dura inspirant interim vates, dum fanis inmorantur, dura nonnumquam extorum fibras animant, avium volatus gubernant, sortes regunt, oracula efficiunt, falsis pluribus involuta.
[FN: § 1613-3]
LACT. ; Div. instit., IV, De vera sapientia, 27 : Si nobis credendum esse non putant, credant Homero, qui summum ilium Iovem daemonibus aggregavit : sed et aliis poetis ac philosophis, qui eosdem modo daemonas, modo deo s nuncupant : quorum alterum verum, alterum falsum est.
[FN: § 1613-4]
TATIANI ; Orat. ad Graec., 8 : ![]()
![]()
[FN: § 1617-1]
FLEURY ; Hist. Eccl., 1. 69, t. 14 : « (p. 581) Cette allégorie des deux glaives, si célèbre dans la suite, avait déjà été marquée dans un écrit de Geoffroi abbé de Vendôme. Saint Bernard l'étend ici davantage... ». – Le passage de la lettre de Saint Bernard, auquel on fait allusion, est le suivant : D. BERN. ; Epist., 256, Ad Dominum Papam Eugenium :... Exserendus est nunc uterque gladius in passione Domini, Christo denuo patiente, ubi et altera vice passus est. Per quem autem nisi per vos ? Petri uterque est : alter suo nutu, alter sua manu, quoties necesse est, evaginandus. Et quidem de quo minus videbatur, de ipso ad Petrum dictum. est : « Converte gladium tuum in vaginam ». Ergo suus erat et ille, sed non sua manu utique educendus. – Saint Bernard exhorte le pape à se servir de l'épée matérielle : D. BERN. ; De consideratione ad Eugenium, Pontificem maximum, 1. IV, 3, tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel iussus es reponere in vaginam ? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbam Domini dicentis : Converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis : Ecce gladii duo hic; non respondisset Dominus : satis est : sed : nimis est. Uterque ergo Ecclesiae, et spiritalis scilicet gladius, et materialis ; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus : ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et iussum Imperaratoris.
[FN: § 1617-2]
FLEURY ; Hist. Eccl., 1, 65), t. 14, p. 76.
[FN: § 1617-3]
J. ZELLER : Hist. d’Allem. ; t. III, p. 321.
[FN: § 1617-4]
YVES CARNOT. ; Epist. ad Henric. Angliae reg. ...Sicut enim sensus animalis subditus debeat esse rationi; ita potestas terrena subdita esse debet Ecclesiastico regimini. Et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas nisi informetur et regatur Ecelesiastica disciplina. – D. THOM.; De reg. princ., III, 10. Il bataille contre qui voudrait que les paroles du Christ qui donnent à Pierre la faculté de lier et de délier, ne s'appliquassent qu'au spirituel. Quod si dicatur ad solam referri spiritualem potestatem, hoc esse non polest, quia corporale et temporale ex spirituali et perpetuo dependet, sicut corporis operatio ex virtute animae.
[FN: § 1618-1]
G. PHILLIPS ; Dit dr. eccl., t. II (p. 473) Dans ces derniers temps, on a fréquemment assimilé la position de l'Église et de l'État à l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. Cette comparaison présente certainement des aperçus nombreux et parfaitement justes... seulement il faut se garder de prendre le change, ce qui ne manquerait pas d'arriver si, trompé par l'analogie des mots... on considérait l'Église comme l'élément féminin, et l’État comme l'élément masculin, tandis que c'est précisément le contraire qui doit avoir lieu ». La création de la femme correspond à la formation de l'ordre temporel. L'ordre divin « n'apparaît d'abord que dans l'arrière-scène et comme endormi [voilà une belle métaphore]. Pendant son sommeil, l'ordre temporel est tiré de lui. (p. 474) Le genre humain se réveille dans le nouvel Adam, et l'ordre divin salue l'ordre temporel comme la chair de sa chair et l'os de ses os. Dès lors, tous les deux, unis l'un à l'autre, comme l'épouse à l'époux, doivent régner ensemble sur le monde ». Mais quel pouvoir a la métaphore ! Voilà pourquoi, messieurs les hérétiques, vous devez être brûlés ou du moins emprisonnés. Suit, avec ces métaphores, la description de l'histoire des rapports de l'Église et de l'État. D'abord, l'Église demande à l'État de s'unir à elle : « (p. 474) c'est en quelque sorte le temps de la demande en mariage ». Dans la seconde période, Église et État sont unis et vivent en bon accord. « (p. 474) il peut y avoir, comme dans le mariage, des malentendus passagers ; ... mais, les deux conjoints ayant l'intention sincère de rester unis en Jésus-Christ, ces malentendus sont bientôt dissipés. Enfin le pouvoir temporel se détache de la foi de l'Église et de l'obéissance qu'il lui doit dans les choses divines : c'est la troisième phase, c'est l'état de séparation ». On distingue trois cas : « (p. 474) 1e L'épouse s'affranchit entièrement de la dépendance de son mari, en brisant de son côté le lien conjugal. 2e Elle rompt le mariage en convolant à de secondes (p. 475) noces, en élevant son nouveau mari à l'autorité domestique et en opprimant, avec son secours, l'époux légitime. 3e Elle ne veut plus de l'autorité absolue de celui qui l'a détachée de son époux, mais elle reste indifférente pour ce dernier, ou bien, si elle se rapproche de lui, elle exige la reconnaissance de l'autre au même titre ». C'est un cas de polyandrie.
[FN: § 1618-2]
PHILIPS ; Du Droit ecclés., t. I : « (p. 58) Cette parole Tu es Pierre, a fait de Simon le fondement de l'Église, le roc qui sert de pierre angulaire à l'édifice divin... ». Malheureusement cette métaphore a donné lieu à de nombreuses discussions. « (p. 54)... à combien d'interprétations diverses n'ont pas donné lieu les mots Petrus et Petra, dont s'est servie la traduction grecque pour rendre celui de Céphas, seul employé dans l'original syriaque, ainsi que dans les traductions que nous fournissent le persan, l'arménien et le copte ! Cette différence tient à ce que dans le grec le mot ![]() , du genre féminin, ne pouvant être appliqué à un homme, le traducteur s'est trouvé forcé, par le génie de sa langue, à changer la physionomie du mot pour l'approprier à l'usage qu'il était obligé d'en faire ; de là
, du genre féminin, ne pouvant être appliqué à un homme, le traducteur s'est trouvé forcé, par le génie de sa langue, à changer la physionomie du mot pour l'approprier à l'usage qu'il était obligé d'en faire ; de là ![]() , au lieu de
, au lieu de ![]() , deux fois répété. Cette explication, si plausible en elle-même, a été admise même par les plus acharnés adversaires de la primauté, de saint Pierre. Quelle induction donc peut-on tirer d'une différence purement syllabique et matérielle ? (p. 55) Dira-t-on, pour la faire pénétrer dans le sens même des mots, que
, deux fois répété. Cette explication, si plausible en elle-même, a été admise même par les plus acharnés adversaires de la primauté, de saint Pierre. Quelle induction donc peut-on tirer d'une différence purement syllabique et matérielle ? (p. 55) Dira-t-on, pour la faire pénétrer dans le sens même des mots, que ![]() signifie un gros roc, tandis que
signifie un gros roc, tandis que ![]() n'éveille que l'idée d'une petite pierre ? Cette interprétation, adoptée par de récents lexicographes est... dénuée de tout fondement. Nous l'admettrons cependant, si l'on veut, mais sous la réserve d'une condition que l'on ne peut nous contester : c’est que si
n'éveille que l'idée d'une petite pierre ? Cette interprétation, adoptée par de récents lexicographes est... dénuée de tout fondement. Nous l'admettrons cependant, si l'on veut, mais sous la réserve d'une condition que l'on ne peut nous contester : c’est que si![]() signifie une petite pierre, cette petite pierre devient, par la transmutation que lui fait subir Jésus-Christ en la convertissant en
signifie une petite pierre, cette petite pierre devient, par la transmutation que lui fait subir Jésus-Christ en la convertissant en ![]() , un roc volumineux et solide... ».
, un roc volumineux et solide... ».
[FN: § 1619-1]
VAN DEN BERG ; Principes du Droit musulman : « (p. 3) Le Coran ou „ le livre “ (al-Kitâb) est, pour les Musulmans, la loi suprême, la loi fondamentale... Les principes fondamentaux du droit ont dû être déduits par les juristes des décisions relativement peu nombreuses que renferme le Coran. Ces décisions, toujours rendues pour un cas spécial, conduiraient souvent à des conséquences absurdes, si la rigueur des déductions n'était éludée par toutes les subtilités de la casuistique [dérivations]. L'on ne peut se faire une idée des bizarreries, des absurdités auxquelles se heurtent ceux qui s'en tiennent à la lettre du Coran, au lieu de chercher l'esprit de tel ou tel passage... (p. 4) Le Coran n'est pas seulement un livre inspiré par Allâh : c'est le livre, comme Allâh lui-même, incréé et éternel, et dont il n'a été révélé au Prophète qu'une copie [en note : c'est Allâh lui-même qui est réputé parler dans le Coran ...] D'où cette conséquence que non seulement le fond, mais aussi la forme est sacrée et infaillible, et que toute critique en est interdite. Cette doctrine a rencontré, il est vrai, depuis longtemps déjà des adversaires dans I'Islâm même [en note : La secte des Mo'tazilites... ]. Elle est, néanmoins, généralement admise aujourd'hui, et engendre naturellement d'étranges conséquences ».
[FN: § 1622-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Beaucoup de francs-maçons sont libres-penseurs et se rient des métaphores, des allégories, des symboles de toute religion. Pourtant, sous ce rapport, le catéchisme et les rites maçonniques ne le cèdent en rien au catéchisme ni aux rites d'une autre religion. Instructions du XXXe grade, Lausanne, 1899 : « (Catéchisme, p. 9) Demande : Es-tu Chev. · . Kad. · . ? [Chevalier Kadosch]. – Réponse : Tu l'as dit. Son nom fut autre et le même pourtant. – D : Je te comprends, frère. Quel âge as-tu ? – R : Un siècle au plus. D : Que cherches-tu ? – R : Lumière. – D : Quelle lumière et pourquoi ? R : Celle de la liberté pour ceux qui n'en abuseront pas. – D : Cherches-tu autre chose ? – R :Vengeance. – D : Contre qui ? – R : Contre tous les tyrans temporels et spirituels. – D : Où t'es-tu prosterné en versant des larmes ? R : Devant le tombeau d'un innocent assassiné. – D : Qu'ont foulé tes pieds ? – R : Des couronnes royales et des tiares papales. – Pourquoi faire sommes-nous Kadosch ? – R : Pour combattre à outrance et sans cesse toute injustice et toute oppression, qu'elles procèdent de Dieu, du Roi ou du Peuple. – D : En vertu de quel droit ? R : Mischor. – D : Que veux-tu dire ? – R : En vertu de notre droit de maîtres par excellence. – D : Où as-tu acquis ce droit ? – R : En montant et en descendant l'échelle mystérieuse ». – Pour être initié au grade de Chev. · . Kad. · ., il faut passer par quatre chambres. La 1re est noire, la 2e blanche, la 3e bleue, la 4e rouge. Afin d'abréger, nous ne citerons que la description de la 1e chambre. Ibidem, p. 2: « La 1re est la chambre noire ; une lampe sépulcrale l’éclaire seule : au centre, un sépulcre ; sur ce sépulcre un cercueil : dans ce cercueil un Chev. · . dans son linceul ; aux pieds, trois têtes de morts ; celle du milieu représentant celle du G. · . M. · . [Grand Maître] Jacques de Molay est couronnée d'immortelles et de lauriers et repose sur un coussin en velours noir. Celle de droite porte la couronne royale fleurdelysée de Philippe-le-Bel, celle de gauche la tiare de Bertrand de Goth Pape Clément V. Tout cela symbolise les victimes du despotisme civil et militaire et de l'intolérance religieuse. A angle droit avec le sépulcre se trouve un banc pour le candidat : en face, un transparent avec les mots : „ Celui qui saura surmonter les terreurs de la mort s'élèvera au-dessus de la sphère terrestre et aura droit à être initié aux plus grands mystères “ ».
[FN: § 1623-1]
D. AUGUST. ; Retractationum, 1, 28 : Cum de Genesi duos libros contra Manichaeos condidissem, quoniam secundum allegoricam significationem Scripturae verba tractaveram, non ausus naturalium rerum tanta secreta ad litteram. exponere... – Idem, Ibidem, II, 24, ... Titulus eorum librorum inscribitur de Genesi ad litteram : id est non secundum allegoricas significationes, sed secundum rerum gestarum proprietatem.
[FN: § 1623-2]
D. AUGUST. ; De Genesi ad litteram.
[FN: § 1624-1]
D. AUGUST. ; Sermo XCVIII – De verbis Evangelii Lucae, VII, et de tribus mortuis, quos Dominus suscitavit.
[FN: § 1624-2]
Parmi tant d'exemples qu'on pourrait citer, le suivant suffira. Dans le livre Le violier des histoires romaines, se trouvent mélangés des fables et des faits que l'auteur estime historiques, et il donne l'interprétation allégorique des unes et des autres, sous le titre : L'exposition moralle sur le propos. Par exemple, c. 22, il dit que, selon Saint Augustin, il advint que le cœur du cadavre d'un empereur romain ne put être consumé par le bûcher, parce que l'empereur était mort empoisonné. « (p. 74) Lors le peuple tira le cueur du feu et mist dessus du triacle. Par ce moyen fut le poison chassé, et dès aussitost que de rechief le cueur fut mis au feu, il fut bruslé ». Pour l'auteur, c'est un fait historique. Il continue : « L'exposition moralle sur le propos. Quant à parler morallement, les cueurs des pecheurs de peché mortel empoisonnez ne peuvent estre du feu du Sainct Esperit esprins et illuminez, fors que par le triaele, qui est penitence ».
[FN: § 1625-1]
ROCQUAN ; Notes et fragm. d'hist. – Du style révolutionnaire. L'auteur parle des écrits des hommes de la. révolution de 1789 « (p. 128) Par les qualificatifs qu'il ajoute ordinairement aux termes dont il se sert, il donne à ceux-ci un caractère, un signe qui les représente d'une manière plus frappante à l'esprit. Parle-t-on du devoir ? Il est sacré ; de l'égoïsme, il est aveugle ; de la perfidie, elle est noire ; du patriotisme, il est brûlant... (p. 129) Par un effet de la même tendance, pour exprimer un état quelconque de l'esprit, on choisit toujours les mots les plus forts... De là à donner la vie aux mots, ou, pour mieux dire, à rendre vivantes les idées qu'ils traduisent, il n'y a qu'un pas. Ce pas est franchi à tout instant dans les écrits. C'est ainsi qu'en se servant de l'expression „ corps politique, corps social “ empruntée par la Révolution aux temps qui l'ont précédée, on ne se contente pas de la froide dénomination que représentent ces deux termes assemblés. Le (p. 130) corps social vit ; il a „ des artères, des veines “, dans lesquelles circule lin sang vigoureux ou impur... On fait plus que donner la vie aux idoles ; on les personnifie. Les termes abstraits, dont j'ai constaté l'usage alors si fréquent, tels que la justice, la liberté, la raison, et d'autres termes du même genre, désignent des êtres qui vivent, regardent, parlent et agissent... (p. 131) Ce n'est pas uniquement à des abstractions de ce genre, et qui sont comme les emblèmes divins de la Révolution qu'est attribuée la personnalité. À ce moment où la France, en proie à la guerre étrangère, est encore déchirée par les discordes civiles, la patrie est souvent évoquée et se montre dans les écrits avec toutes les apparences de la vie... On comprend (p. 132) d'ailleurs que, sous l'influence de tant de passions qui l'agitent, la Révolution personnifie ce qu'elle hait, aussi bien que ce qu'elle aime. – „ Le Fanatisme est là, écrit le Comité de salut public en parlant des prêtres réfractaires qu'il accuse de soulever l'opinion ; il est là, il veille la palme du martyre à la main ; il attend ses crédules victimes “. J'ajoute que le fanatisme, le fédéralisme et d'autres objets de la haine révolutionnaire apparaissent ordinairement comme des „ monstres “ ; ces monstres habitent des „ repaires “, et c'est dans ces repaires que la Révolution, telle que l'Hercule moderne, doit aller les saisir et les abattre. De cette propension à vivifier, à personnifier les idées, il résulte que les écrits offrent, non pas seulement des tableaux, mais de véritables scènes animées ».
[FN: § 1626-1]
En voici exemple. A COMTE ; Synthèse subjective : « (p. 8) Ne devant jamais aspirer aux notions absolues, nous pouvons instituer la conception relative des corps extérieurs en douant chacun d'eux des facultés de sentir et d'agir, pourvu que nous leur ôtions la pensée, en sorte que leurs volontés soient toujours aveugles ». Ensuite, sous le prétexte de notre ignorance de l'absolu, mettons ensemble la fiction et la réalité. L'auteur continue : « (p. 8) Bornée au Grand-Être, assisté de ses dignes serviteurs et de leurs libres auxiliaires, l'intelligence, poussée par le sentiment, (p. 9) guide l'activité de manière à modifier graduellement une fatalité dont tous les agents tendent constamment au bien sans pouvoir en connaître les conditions. En dissipant les préjugés théologiques qui représentaient la matière comme essentiellement inerte, la science tendit à lui rendre l'activité que le fétichisme avait spontanément consacrée ». Ainsi, la fiction se confond avec la réalité. Pour justifier cela, l'auteur ajoute : « (p. 9) On ne saurait jamais prouver qu'un corps quelconque ne sent pas les impressions qu'il subit et ne veut pas les actions qu'il exerce, quoiqu'il se montre dépourvu de la faculté de modifier sa conduite suivant sa situation, principal caractère de l'intelligence ». Ainsi, la métaphore devient réalité, parce qu'on ne peut prouver qu'elle n'est pas réalité ! On ne peut démontrer que Zeus n'existe pas ; donc Zeus existe. Que peuvent bien être la sensation qu'un corps éprouve des impressions, sa volonté, sa conduite ? On ne peut démontrer que la mer ne sent pas l'impression d'un navire, ni que la mer ne veut pas les actions qu'elle exerce sur ce navire, simplement parce qu'il est impossible de démontrer l'incompréhensible et l'absurde. Lancé sur cette voie, A. Comte y galope, et parle d'une manière moins poétique, mais tout aussi mythologique qu'Hésiode : « (p. 10) Obligée de subir constamment les lois fondamentales de la vie planétaire [que peut bien être cette vie ?], la Terre, quand elle était intelligente [c'était peut-être au temps où les bêtes parlaient], pouvait développer son activité physico-chimique de manière à perfectionner l'ordre astronomique en changeant ses principaux coefficients. Notre planète put ainsi rendre son orbite moins excentrique, et dès lors plus habitable, en concertant une longue suite d'explosions analogues à celles d'où proviennent les comètes, suivant la meilleure hypothèse. Reproduites avec sagesse, les mêmes secousses, secondées par la mobilité végétative [que peut bien être cette autre merveille ?], purent aussi rendre l'inclinaison de l'axe terrestre mieux conforme (p. 11) aux futurs besoins du Grand Être ». Et l'auteur continue à divaguer ainsi, durant des pages et des pages.
[FN: § 1627-1]
L. GAUTIER ; Intr. à l’anc. Test., t. II : « (p. 126)... Cantique des Cantiques veut dire le plus beau, le plus parfait des cantiques, le cantique par excellence. C'est donc un hommage rendu à la supériorité de ce poème sur les autres ».
[FN: § 1627-2]
Gautier est protestant. Écoutons aussi un auteur catholique. Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Cantique des Cantiques, t. 3 : « (p. 508) ...on explique le Cantique des cantiques, soit littéralement, soit typiquement, soit allégoriquement ». L'auteur, on le comprend, repousse les deux premières interprétations. « (p. 508) Théodore de Mopsueste a le premier mis en avant l'explication littérale : mais Théodoret l'en blâme, et son explication (p. 509) a été rejetée par le second concile de Constantinople... L'interprétation typique, qui consiste à conserver le texte littéral et sensible, mais à considérer et à interpréter les événements décrits comme symboles de vérités plus hautes, n'a pas été tentée pour la première fois par Hugo Grotius... elle se trouve déjà dans Honorius d'Autun, appliquant littéralement le cantique à la fille de Pharaon et allégoriquement à l'Église chrétienne. Grotius considère l'amour de Salomon pour la fille du roi d'Égypte comme le sujet accidentel du Cantique, mais en même temps comme le type de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël ». L'auteur démontre qu'on ne peut accepter cela. « (p. 509) Il ne reste donc que le sens allégorique. Mais les défenseurs de l'interprétation allégorique, suivent de leur côté des voies diverses. Les uns trouvent dans le Cantique l'amour de Salomon pour la sagesse, les autres son amour pour le peuple d'Israël, d'autres encore le désir d'Ezéchias de voir la réconciliation des royaumes séparés ; les anciens interprètes juifs, l'amour de Jéhova pour Israël, et les plus anciens commentateurs chrétiens, presque unanimement, l'amour du Christ pour son Église ». – D. AUGUST : Speculum – De Cantico Canticorum : Restat ille liber Salomonis, cuius inscriptio est : Canticum Canticorum. Sed de illo in hoc opus quid transferre possumus, cum totus amores sanctos Christi et Ecclesiae figurata locutione commendet, et prophetica pronuatiet altitudine ?
[FN: § 1627-3]
GAUTIER examine aussi les interprétations qui voient dans le Cantique un drame, et conclut : « (p. 138) ...cette reconstruction dramatique du Cantique des Cantiques me parait inacceptable. Je ne crois pas qu'on puisse jamais tirer de ce poème, d'une façon quelque peu vraisemblable, ce que les partisans du drame prétendent y trouver ». Il remarque, à propos des partisans de cette interprétation : « (p. 138) À défaut du sens allégorique, de plus en plus abandonné, ils se demandent si l'on ne peut pas discerner dans le Cantique, interprété comme un drame, une tendance sinon religieuse, du moins morale. Glorification de l'amour vrai, opposition aux passions sensuelles et aux jouissances vulgaires, supériorité de la monogamie sur la polygamie, éloge du mariage, de la constance en amour, de la fidélité conjugale, triomphe d'un sentiment sincère et profond sur les attraits de la richesse et de la pompe royale, voilà autant de thèmes qui ont paru dignes d'être célébrés, et que l’on a indiqués comme ayant inspiré le poète du Cantique ». L'auteur est favorable à la solution qui voit dans le Cantique des cantiques une collection de chants nuptiaux. Cette solution a pour elle un argument de grand poids, puisqu'elle est obtenue par la méthode comparative (§ 547, 548), en expliquant le passé par les usages observés aujourd'hui. Pourtant un point demeure douteux : a-t-on vraiment deviné l'origine et le caractère de ce morceau de littérature ? Heureusement l'humanité peut vivre sans éclaircir ce doute.
[FN: § 1627-4]
RENAN ; Le Cant. des Cant. : « (p. XI) Je sais que plusieurs passages de la (p. XII) traduction paraîtront un peu choquants à deux classes de personnes, d'abord à celles qui n'admirent de l'antiquité que ce qui ressemble plus ou moins aux formes du goût français ; en second lieu, à celles qui n'ont connu le Cantique qu'à travers le voile mystique dont la conscience religieuse des siècles l'a entouré. Ces dernières sont naturellement celles dont il me coûte le plus de froisser les habitudes. Ce n'est jamais sans crainte que l'on porte la main sur ces textes sacrés qui ont fondé ou soutenu les espérances de l'éternité... » Ce sont là quelque peu des larmes de crocodile. Renan a de ces égards à profusion. Plus loin, il n'ose même pas citer la Bible ! « (p. 43) Sulem ou Sunem était un village de la tribu d'Issachar, patrie d'une certaine Abisag la Sunamite, dont les aventures racontées (Vulg., III) Reg., I, 3; II, 17 et sv., ne sont pas sans analogie avec celles qui forment le canevas de notre poëme. Nous lisons, en effet, au premier des passages précités, que les gens de David, dans une circonstance trop éloignée de nos mœurs pour être rapportée ici, firent chercher dans toutes les tribus d'Israël la plus belle jeune fille... » Nous voilà bien lotis, si les historiens ne rapportent que les circonstances qui ne s'écartent pas trop de nos mœurs ! Il est plaisant que Renan taise ce que tout le monde sait. Segond n'a pas de ces scrupules de littérateur élégant, et traduit : « Rois I, 1, 2) Ses serviteurs [de David] lui dirent : Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans ton sein et mon seigneur le roi se réchauffera ». Quelquefois Renan pousse plus loin : G. SOREL ; Le syst. hist. de Renan, I : « (p. 118) Il y a quelques années, M. Pascal, professeur à Catane, a fait connaître un curieux exemple des traductions artificieuses de Renan (Carlo Pascal, L'incendie de Rome et les premiers chrétiens, p. 30) ». Il s'agit d'une série d'équivoques voulues par Renan, sur les termes domus transitoria, qui désignent certains édifices de Néron.
[FN: § 1627-5]
PIEPENBRING ; Hist. du peuple d'Isr. « (p. 704 note) Wildboer, p. 488. Comp. Cornill, p. 256 ». Pourtant Piepenbring conclut : « (p. 705) Nous reconnaissons sans peine que notre recueil ne renferme rien d'immoral ni même d'indécent... Nous croyons néanmoins que ceux-là ont raison qui, parmi les anciens et les modernes, ont pensé ou pensent encore que cet opuscule est déplacé dans un recueil sacré, dans un livre d'édification ». En notre temps moral – en paroles – et démocratique, les interprétations morales et démocratiques devaient naturellement être en faveur. Piepenbring cite (p. 703) Reuss, qui dit : « Enfin, pour ce qui est de la morale prêchée au public, l'auteur [du Cantique des cantiques] a voulu proscrire la polygamie ; il a voulu faire l'éloge de la fidélité conjugale ; il a voulu faire admirer la vertu, victorieuse de la séduction ; il a voulu se rendre l'organe de l'indignation démocratique en face de la corruption de la cour ». Que de belles choses on trouve dans ce texte ! Pourquoi n'y pas ajouter les louanges du suffrage universel et de l'antimilitarisme ? Pour une autre composition, qui fait partie de la Bible, le livre de Ruth, notre auteur, à la suite d'autres auteurs, veut montrer qu'il doit y avoir un but moral. Ces auteurs cherchent donc une voie pour passer du texte à ce but, c'est-à-dire une dérivation ; et puisque qui cherche ces dérivations les trouve toujours, ils découvrent aisément que le livre de Ruth tend à une religion humaine et universelle. Piepenbring commence par dire : « (p. 606) Le vrai but du livre de Ruth n'a été compris que de nos jours ». En note : « (p. 607) Le but et le sens du livre de Ruth n'ont même pas été compris par nombre d'exégètes modernes qui suivent la méthode strictement grammaticale et historique. Reuss en particulier a complètement fait fausse route à cet égard et appliqué à ce livre une interprétation tout à fait artificielle. L'explication que nous en avons donnée et la date de composition que nous lui assignons, sont fort bien justifiées dans les ouvrages spécieux déjà fréquemment cités de Kuenen, Cornill et Wildeboer ». Sans doute, ce livre a peut-être tous les mérites possibles ; mais il doit lui manquer celui de la clarté, s'il a fallu environ deux mille ans pour savoir ce qu'il signifiait ! Maintenant enfin, il nous est donné de connaître le sens de cet écrit. « (p. 606) C'est en réalité un complément fort précieux de la réforme d'Esdras. Il montre que le monde juif tout entier ne se laissa pas entraîner par l'esprit intolérant et exclusif de ce scribe... Nous apprenons par là que les mariages mixtes, combattus en bloc et avec acharnement par Esdras et ses collaborateurs, furent justifiés, non seulement du point de vue de la passion ou des intérêts, mais aussi de celui de la justice et de l'équité. L'auteur de notre livre plaçait au fond les liens spirituels de la religion au-dessus de ceux du sang ; il accordait plus d'importance à une conduite vraiment pieuse qu'à une généalogie correcte ; il devança le point de (p. 607) vue évangélique, en vertu duquel il n'est pas nécessaire de descendre d'Abraham pour être un vrai fidèle ». Ce n'est peut-être pas le hasard seul qui a fait que ce sens ait été découvert justement en un temps comme le nôtre, d'humanitarisme et de démocratie. – GAUTIER (loc. cit. 1627-1, dit avec beaucoup de bon sens : « (p. 152) Pour discerner la raison d'être et le but du livre de Ruth, il n'est donc point nécessaire de recourir à des suppositions ingénieuses et quelque peu lointaines. Il suffit de se rappeler le goût des Orientaux pour les histoires dramatiques, piquantes ou touchantes, qu'on se raconte d'une génération à l'autre ». Mais c'est une chose trop simple pour messieurs les interprètes.
[FN: § 1629-1]
D. BERNARDI In cantica sermo 28, 13 : Adiiciens siquidem, Filii matris meae pugnaverunt contra me ; persecutionem passam se esse aperte significat. – Serm. 29, 1: Filii matris meae pugnaverunt contra me. Annas et Caiphas et Iudas Iscarioth, filii synagogae fuerunt et hi contra Ecclesiam, aeque synagogae filiam, in ipso exortu ipsius acerbissime pugnaverunt, suspendentes in ligno collectorem ipsius Iesum. Iam tunc siquidem Deus implevit per eos, quod olim praesignaverat per Prophetam, dicens : „ Percutiam pastorem, et dispergentur oves “... De his ergo et aliis, qui de illa gente Christiano nomini contradixisse sciuntur, puta dictum a sponsa : Filii matris meae pugnaverunt contra me.
[FN: § 1629-2]
Dans l'introduction à la traduction de l'Eclésiastique (La sagesse de Jésus fils de Sirach) publiée par la Société biblique de Paris, on lit : « (p. 391)... le fils de Sirach n'est pas exempt d'égoïsme. Ses conseils de prudence, si abondants dans son livre, dénotent une préoccupation trop absorbante de l'intérêt personnel. Même l'amour du plaisir trouve quelque écho dans son cœur, et il s'exprime en maints endroits comme un disciple d'Épicure... (p. 892) Il ne faudrait pourtant pas exagérer ces taches. Dans l'ensemble, notre livre est rempli de bon sens, de droiture, de charité et de piété » (Les livres apocryphes de l'Ancien Testament).
[FN: § 1629-3]
D. HIERONYM. comment. in Ecclesiasien, IX, 7 (t. V, p. 23). Vade et comede in laetitia panem tuum, et bibe in corde bono vinum tuum... Et haec, inquit, aliquis loquatur Epicurus, et Aristippus, et Cyrenaici, et ceteri pecudes philosophorum. Ego autem mecum diligenter retractans, invenio, non ut quidam aestimant male, omnia fortuito geri, et variam in rebus humanis fortunam ludere, sed cuncta iudicio Dei fieri.
[FN: § 1629-4]
D. HIERONYN. comment. in Ecclesiasten, VIII, 15 [trad. SEGOND : « J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir »]. D. HIERONYM. (t. V, p. 22) Et laudavi ego laetitiam : quia non est bonum homini sub sole nisi comedere, et bibere, et laetari...] Hoc plenius supra interpretati sumus, et nunc strictim dicimus : licet brevem et cito finiendam praeferre eum vescendi et bibendi voluptatem angustiis sacculi, ... Verum haec interpretatio ieiunantes, esurientes, sitientes, atque lugentes quos beatos in evangelio dominus vocat, si accipitur, ut scriptum est, miseros approbabit. Et cibum itaque et potum spiritualiter aceipiamus... – Idem, ibidem, p. 9, III, 11-13 : ... Porro quia caro domini, verus est cibus, et sanguis eius, Verus et potus...
[FN: § 1629-5]
D. HIERONYM. ; loc. cit. § 1629-1. Eccl., III, 5 [trad. SEGOND « (1) Il y a un temps pour tout... (5) un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements »]. D. HIERONYM. (p. 8) : Tempus amplexandi, et tempus longe fieri ab amplexu. Iuxta simplicem intelligentiam manifestus est sensus (Apostolo in eadem verba congruent : nolite fraudare invicem ...) liberis dandam operam, et rursus continentiae. [Puis vient une autre explication encore plus étrange] Vel quod tempus fuerit amplexandi, quando vigebat illa sententia : Crescite et multiplicamini, et replete terram. Et tempus procul a complexu fieri, quando successit. [Mais voici mieux encore] Si autem voluerimus ad altiora conscendere, videbimus sapientiam amplexari amatores suos... intraque ulnas suas et gremium strictiori tenebit complexu.
[FN: § 1630-1]
Il Programma dei Modernisti. Risposta all' Enciclica di Pio X „ Pascendi Dominici gregis “ : « (p. 121) Les modernistes, comme nous l'avons déjà dit, en plein accord avec la psychologie contemporaine, distinguent nettement la science de la foi. Les procédés de l'esprit, qui aboutissent à l'une et à l'autre, apparaissent aux modernistes comme tout à fait étrangers et indépendants entre eux ». Parfaitement. Mais comment concilier cela avec la peine énorme que se donnent les modernistes pour mettre d'accord la science et la foi ? L'un des principaux chefs des modernistes, l'abbé Loisy, dit clairement : « (L’Évang. et l'Égl., p. XXXIII). La conscience pourra-t-elle garder bien longtemps un Dieu que la science ignore, et la science respectera-t-elle toujours un Dieu qu'elle ne connaît pas ? »
[FN: § 1630-2]
Loc. cit., § 1630-1 Ils disent de l’Église : « p. 123) Quelle popularité peuvent lui donner ces oligarchies nobiliaires, petites et décrépites, qui, en échange d'un peu de faste, lui imposent des habitudes en contraste manifeste avec les tendances du monde ? Nous comprenons cela, et nous le disons franchement. Nous sommes las de voir l’Église réduite à une bureaucratie jalouse des pouvoirs qui lui restent et avide de regagner ceux qu'elle a perdus... (p. 124) L’Église doit éprouver la nostalgie de ces courants, encore inconsciemment religieux, qui alimentent l'ascension de la démocratie ; elle doit trouver la manière de se fondre avec celle-ci, pour la rendre vraiment capable de succès, par le moyen de la force des freins et l'aiguillon de son ministère moral, qui, seul sait donner des leçons d'abnégation et d'altruisme. L’Église doit reconnaître loyalement que dans la démocratie se prépare précisément une affirmation plus haute de sa catholicité. Alors, la démocratie aussi éprouvera la nostalgie de l’Église, qui contient la continuation de ce message chrétien dont elle, démocratie, tire ses origines reculées mais authentiques ». Et l'on peut ajouter : alors la démocratie récompensera largement les déserteurs de l’Église catholique. Pourtant les curés français qui, en un dessein analogue, s'unirent au Tiers État, pour constituer l'Assemblée Nationale, et qui préparèrent ainsi la Révolution, furent entièrement déçus. Plusieurs de ces braves gens n'eurent pas même les trente deniers de Juda, mais l'exil, la prison, la guillotine furent leur unique récompense.
[FN: § 1630-3]
A. Loisy ; Autour d'un petit livre : « p. 93) Ce Christ, sans doute, n'est pas une abstraction métaphysique, car il est vivant dans l'âme de l'évangéliste. Mais ce Christ de la foi, tout spirituel et mystique, c'est le Christ immortel qui échappe aux conditions du temps et de l'existence terrestre... Les récits de Jean ne sont pas une histoire, mais une contemplation mystique de l’Évangile ; ses discours sont des méditations théologiques sur le mystère du salut... (p. 94) L’Église chrétienne, qui allégorisait l'Ancien Testament, ne se défendait pas d'allégoriser les récits évangéliques... (p. 95) On ne doit donc pas être surpris que l'exégèse critique découvre des allégories dans le quatrième Évangile... L'allégorie n'était-elle pas, pour Philon d'Alexandrie, la clef de l'Ancien Testament, la forme naturelle de la révélation divine, et l'influence du philonisme sur Jean n'est-elle pas incontestable ? ».
[FN: § 1630-4]
A. Loisy ; Simples réflexions sur le décret du Saint-Office, Lamentabili sane exitu, et sur l'Encyclique Pascendi Dominici gregis.
[FN: § 1630-5]
Acta pontificia, oct. 1907. De Modernistarum doctrinis... Pascendi dominici gregis. (p. 379) Atque haec... de modernista ut philosopho. – Iam si, ad credentem progressus, nosse quis velit unde hic in modernistis a philosopho distinguatur, illud advertere necesse est etsi philosophus realitatem divini ut fidei obiectum admittat, hanc tamen ab illo realitatem non alibi reperiri nisi in credentis animo, in obiectum sensus est et affirmationis atque ideo phaenomenorum ambitum non excedit : utrum porro in se illa extra sensum existat quae affirmationem huiusmodi, praeterit philosophus ac negligit. « Et jusqu'ici,... [il a été question] du moderniste considéré, comme philosophe. – Si maintenant, venant à le considérer dans sa qualité de croyant, on veut connaître de quelle façon, chez les modernistes, le croyant se distingue du philosophe, il est nécessaire d'observer que, bien que le philosophe admette la réalité divine comme objet de la foi, il ne trouve cependant cette réalité nulle part ailleurs que dans l'esprit du croyant, comme objet du sentiment et de l'affirmation, sans que pour cela il dépasse le cercle des phénomènes [naturels] ; mais que cette réalité existe ou non en elle-même, hors du sentiment et de l'affirmation, cela importe peu au philosophe ». Ainsi l'attitude de celui qui veut demeurer dans le domaine de la science logico-expérimentale est fort bien expliquée, excepté cette allusion à la réalité divine, qui dépasse l'expérience. Mais le moderniste ne peut demeurer dans le domaine expérimental, car il n'y rencontrerait pas la sainte Démocratie tant désirée : elle ne se promène pas en ces contrées. C'est pourquoi le moderniste est croyant, et l'encyclique expose comment le moderniste oppose le croyant au « philosophe ». Et contra modernistae credenti ratum ac certum est, realitatem divini reapse in se ipsam existere nec prorsus a credente pendere. Quod si postules, in quo tandem haec credentis assertio nitatur ; reponent : in privata culusque hominis experientia. – In qua affirmatione, dum equidem hi a rationalistis dissident, in protestantium tamen ac pseudo-mysticorum opinionent discendunt. « Au contraire, le croyant moderniste estime et tient pour certain que la réalité divine existe bien en elle-même, et qu'elle ne dépend en rien du croyant. Que si l'on demande sur quoi enfin s'appuie cette assertion du croyant, ils [les modernistes] répondront : sur l'expérience particulière de chaque homme. – Mais en cette affirmation, tandis qu'ils s'écartent certainement des rationalistes, ils tombent toutefois dans l'opinion des protestants et des pseudo-mystiques ». Selon M. Loisy, il semble qu'en cela l'encyclique se trompe, et qu'elle ne donne pas l'opinion des modernistes ; mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'est réellement cette opinion, si M. Loisy ne s'explique pas un peu plus clairement, en ôtant les voiles qui enveloppent la « science en elle-même, le travail scientifique en tant qu'émanant d'un être moral », et beaucoup d'autres entités semblables. L'encyclique ajoute que la science doit être soumise à la foi. Comme cette affirmation est claire, claire aussi peut-être la réponse de qui voulant demeurer dans le domaine de la science logico-expérimentale, déclare ne se soucier en aucune façon de ce que voudrait lui prescrire, toujours dans ce domaine, la foi catholique, protestante, musulmane, humanitaire, démocratique, ou toute autre foi, quel que soit son nom. Pourtant, cela ne signifie pas du tout qu'en certaines circonstances, il ne puisse être utile de croire que la science doit être subordonnée à la foi.
[FN: § 1631-1]
Essai d'une philosophie de la Solidarité. M. L. BOURGEOIS « (p. 65) Il faut expressément reconnaître que l'homme ne peut se libérer définitivement, pour l'avenir aussi bien que pour le passé. Il se doit acquitter sans cesse. Au jour le jour il contracte une dette nouvelle qu'au jour le jour il doit payer. C'est à chaque instant que l'individu se doit libérer et c'est ainsi qu'à chaque instant il reconquiert sa liberté ». Une personne désignée dans le texte par X fut prise de la crainte que si ses « débiteurs » se libéraient, elle n'en pourrait plus rien obtenir ; ce qui irait directement à l'encontre du but pratique de la solidarité ; et elle objecta : « (p. 77) L'idée du rachat de la dette sociale ne conduit-elle pas, ou ne risque-t-elle pas de conduire, au point de vue moral, à l'égoïsme ? Quand j'aurai payé cette dette, je serai libéré ; mais ne le serais-je pas surtout à l'égard de la charité, de la bonté ? Cette conviction ne produira-t-elle pas surtout une certaine sécheresse de cœur ? ». Rassurez-vous, bonnes gens. La dette de vos débiteurs est d'une nature si merveilleuse que s'ils payaient autant de millions qu'il y a de grains de sable dans les mers, ils ne pourraient jamais, jamais se libérer. M. L. BOURGEOIS : (p. 77) Il en pourrait être ainsi si la libération devait jamais être obtenue totalement et pour toujours [le lecteur voudra bien observer qu'il n'y a ici aucune restriction de somme, petite ou grande]. Mais, je l'ai dit, nul être n'est définitivement libéré ; par cela même qu'il continue de vivre, il devient de nouveau débiteur, et toujours doit renaître en lui le sentiment qu'il est obligé envers ses semblables, qu'il a en eux des créanciers ». C'est déjà quelque chose, que cette dette ne subsiste pas au-delà de la mort qui, en ce cas, peut bien être qualifiée de libératrice ! Et si le débiteur ne voulait pas payer et envoyait promener la sainte Démocratie et ses prophètes ? On emploierait la force. Mais alors pourquoi n'y pas recourir immédiatement, et faire de si longs détours ? Est-ce peut-être que la fraude est plus facile à employer que la force ?
[FN: § 1632-1]
TERTULL. ; De baptismo, 1 : Atque adeo nuper conversata istic quaedam de Gaiana haeresi vipera venenatissima doctrina sua plerosque rapuit [l'hérésie est venimeuse ; la vipère est venimeuse ; donc l'hérétique est une vipère], imprimis baptismum destruens. Plane secundum naturam [la femme, égalée à la vipère, agit comme la vipère]. Nam fere viperae et aspides ipsique reguli serpentes arida et inaquosa sectantur. [Expressions plus efficaces que s'il avait nommé la vipère seule. Grâce aux sentiments accessoires (IV-β), l'adjonction de l'aspic et d'autres serpents à la vipère, suggère qu’on doit y ajouter aussi le serpent hérétique]. Sed nos pisciculi [pour le baptême]. Le même auteur dit, De resurr. carnis, 52 : Alia caro volatilium, id est martyrum, qui ad superiora conantur, alia piscium, id est quibus aqua baptismatis sufficit] secundum IXOYN nostrum. Iesum Christum in aqua nascimur [l'eau nous fait chrétiens, nous fait naître spirituellement], nec aliter quant in tiqua permanendo salvi sumus [autre métaphore : « demeurer dans l'eau » veut dire demeurer dans l'état de grâce conféré par le baptême]. Itaque illa monstrosissima, cui nec integre quidem docendi ius erat, optime norat pisciculos necare de aqua auferens [conclusion des raisonnements métaphoriques].
[FN: § 1633-1]
TERTULL. ; De bapt., II. Plus loin, V, il revient sur le même sujet, mais remarque que les eaux des Gentils n'ont pas l'efficacité de celles des chrétiens (§ 1292). L'autorité sert donc à établir qu'en général les eaux sont efficaces, mais qu'en particulier, toutes n'ont pas cette efficacité.
[FN: § 1633-2]
Pourtant, peu après, il ne peut résister au plaisir de relever d'autres nobles caractères de l'eau, et fait remarquer, IX, que « l'eau était d'un grand prix auprès de Dieu et de son Christ ». L'eau sert au baptême du Christ ; celui-ci change l'eau en vin ; il dit à ses disciples de se désaltérer à l'eau éternelle ; il met parmi les œuvres de charité le fait de donner le calice d'eau au pauvre, etc.
[FN: §1633- 3]
TERTULL. ; De bapt., III.
[FN: § 1638-1]
ANATOLE FRANCE ; Opinions sociales, II, La justice civile et militaire : « (p. 196) ...je réprouve à ce point le vol et l'assassinat, que je n'en puis souffrir même la copie régularisée par les lois, et il m'est pénible de voir que les juges n'ont rien trouvé de mieux, pour châtier les larrons et les homicides, que de les imiter [ici, il y a aussi une dérivation du genre (IV-γ)] ; car, de bonne foi, Tournebroche, mon fils, qu'est-ce que l'amende et la peine de mort, sinon le vol et l'assassinat perpétrés avec une auguste exactitude ? Et ne voyez-vous point que notre justice ne tend, dans toute sa superbe, qu'à cette honte de venger un mal par un mal, une misère par une misère, et de doubler, pour l'équilibre et la symétrie les délits et les crimes ». L'auteur suppose qu'il répond au reproche qu'on lui adresse « (p. 196) d'être du parti des voleurs et des assassins » ; et là commence déjà la dérivation. Il importe peu au public que A. France et ses amis humanitaires veuillent être de tel ou tel parti ; mais il lui importe beaucoup que les dits larrons et assassins n'aient pas, grâce à l'indulgence de ces messieurs, la faculté de se promener. Plus loin, A. France exprime ses opinions par la bouche d'un directeur de prison, et reproduit les axiomes répétés déjà un nombre de fois infini par les humanitaires. Il nous apprend ainsi que « (p. 209) plus je vis, plus je m'aperçois qu'il n'y a pas de coupables et qu'il n'y a que des malheureux ». Cela peut être vrai ; mais il faudrait savoir ce que l'auteur entend par coupable et par malheureux. Supposons un individu qui veuille laisser courir librement les chiens enragés et les rats pestiférés, qui feigne, comme A. France, qu'on l'accuse de tenir le parti de ces bêtes. Il répond : « Je réprouve à ce point la mort donnée par le chien enragé ou le rat pestiféré, qu'il m'est pénible de voir que les hommes n'ont rien trouvé de mieux, pour se mettre en sûreté, que d'imiter les chiens enragés et les rats pestiférés en donnant la mort à ces animaux ». Ensuite il conclut : « Plus je vis plus je m'aperçois qu'il n'y a pas d'animaux coupables et qu'il n'y a que des animaux malheureux ». Appelez tant qu'il vous plaira coupables ou malheureux les chiens enragés et les rats pestiférés, pourvu que vous nous laissiez nous en débarrasser; alors nous sommes d'accord. Donnez le nom que vous voudrez à messieurs les larrons et à messieurs les assassins; dites que ce sont des innocents; pourvu que vous nous permettiez de ne pas vivre en compagnie de ces innocents, nous ne vous demandons pas autre chose. Il suffit d'ouvrir un journal pour y trouver la description des louables exploits de ces malheureux, pour lesquels A. France a tant de bienveillance. Voici un exemple pris au hasard : La Liberté, 14 janvier 1913 : « Une gamine sert de cible à des apaches. Au numéro 42 de l'avenue des Batignolles, à Saint-Ouen, s'ouvre un étroit passage, bordé de masures habitées par des ménages de modestes travailleurs chargés de famille. La famille Pache est une des plus intéressantes, car le père, victime d'un accident du travail, ne peut faire que de menus travaux. Cependant, il fait vivre sa famille, quatre enfants, et il a réussi à se construire une maisonnette sur un minuscule terrain, tout au fond de l'impasse. L'aînée des enfants, Marcelle, qui vient d'atteindre sa quinzième année, réalise en tout point le type de la „ petite maman “ que l'on rencontre fréquemment dans les familles pauvres et nombreuses. Levée dès la pointe du jour, elle prépare le déjeuner des bambins ; puis elle les conduit, bien propres, à l'école maternelle ; ensuite, elle se rend à l'atelier où elle travaille toute la journée ; enfin, elle rentre à la maison et prépare le dîner de toute la famille. Hier soir, la „ petite mère “ se rendit, à 7 heures, au bout de l'allée pour y prendre de l'eau à la fontaine. À ce moment, plusieurs jeunes gens s'arrêtèrent à quelques pas du groupe que la jeune Marcelle formait avec les gosses. – Attention, dit l’un des apaches... Ce fut là un signal ; coup sur coup, plusieurs détonations retentirent... „ Petite mère “ atteinte au milieu du front par une balle s'affaissa en poussant un grand cri... Les rôdeurs l'avaient choisie comme cible pour essayer leurs revolvers. Des voisins accoururent. On releva la pauvre petite qui perdait le sang abondamment. Tandis que les uns relevaient la victime de cet odieux attentat, d'autres allaient prévenir le docteur Perraudeau... Le médecin déclara que l'état de la malheureuse enfant était grave et il la fit conduire à l'hôpital Bichat, où elle fut admise ». Il faut bien comprendre que, d'après la théorie de A. France, ce n'est pas la fillette presque tuée qui est malheureuse ; ce sont ses agresseurs qui sont malheureux. Il n'est pas nécessaire que les gens se préoccupent de cette enfant, et moins encore qu'ils prennent des mesures pour que des faits semblables ne se renouvellent pas ; seuls les agresseurs doivent jouir des tendres attentions de la « société ».
[FN: § 1639-1]
BAYLE, s. r. Tanaquil, t. IV, p. 317, cite un passage de Pline (VIII, 74, 1) : « M. Varron rapporte, comme témoin oculaire, que de la laine sur la quenouille et le fuseau de Tanaquil, qui fut aussi appelée Caïa Caecilia, se voyait encore de son temps dans le temple de Sangus ; et dans le temple de la Fortune une robe royale ondée qu'elle avait faite, et que Servius Tullius avait portée. C'est pour cela que les jeunes filles qui se marient ont avec elles une quenouille garnie et un fuseau chargé. Tanaquil trouva l'art de faire une tunique droite (tissée de haut en bas), telle que celle que les jeunes gens et les nouvelles mariées prennent avec la toge sans bordure ». [Trad. LITTRÉ]. Bayle rappelle incidemment un passage de PLUTARQUE (Quaest. rom., XXX), qui, proposant une seconde réponse à la question : «Pourquoi, introduisant la fiancée, lui impose-t-on de dire : „ Où tu seras Gaïus, je serai Gaïa “ ? », dit : « Est-ce parce que Gaïa Caecilia, femme d'un des fils de Tarquin, fut belle et sage ? Sa statue d'airain a été placée dans le temple de Santus [ce nom a différentes orthographes] ; anciennement il y avait aussi ses sandales et ses fuseaux : celles-là étaient le symbole de ses habitudes casanières ; ceux-ci, de son activité industrieuse ». Après avoir traité d'autre chose, Bayle dit : « Un Auteur François, qui vivoit au XVIe siècle, débite une chose qu'il n'eût su prouver. Les Tarquins, dit-il, * avoient fait ériger une statue au milieu de leur logis qui avoit des souliers de chambre seulement, une quenouille et son fuseau, afin que ceus qui suivroient leur famille imitassent leur assidue assiduité en mesnageant sans partir de la maison. Voilà l'état où l'on a réduit ce que j'ai cité de* Pline touchant la Statue de Tanaquil. Chacun se mêle de changer quelque circonstance dans ce qu'il cite : par ce moien les faits se gâtent, et se pervertissent bientôt entre les mains de ceux qui les citent ».
* Franc. Tillier, Tourangeois, dans son Philogame, pag. 120. Edit. de Paris, 1578.
[FN: § 1641-1]
RENAN ; Hist. du peup. d'Israël, t. V, p. 70 : « Des ressemblances ne sont pas des preuves d'imitation voulue. Le cercle de l'imagination religieuse n'est pas fort étendu ; les croisements s'y produisent par la force des choses ; un même résultat peut avoir des causes tout à fait différentes. Toutes les règles monastiques se ressemblent. Le cycle des créations pieuses offre peu de variété ». Ce que Renan dit ici des institutions religieuses, on peut le répéter des autres institutions.
[FN: § 1641-2]
Employons, comme d'habitude, la méthode indiquée au § 547. Journal de Genève, 26 février 1913 : « Les chroniqueurs littéraires de la Suisse allemande Viennent de livrer une grande bataille... contre des moulins à vent ! Ils ont été victimes d'un mystificateur, M. Loosli, qui avait déclaré gravement, dans un long article de revue, que le véritable auteur des œuvres de Jérémias Gotthelf n'était pas Albert Bitzius, mais son ami J.-U. Geissbühler. Cette affirmation avait causé une vive agitation parmi les critiques les plus autorisés, et la « question Gotthelf » était devenue un sujet de discussions passionnées dans les journaux. Dans le dernier numéro de Heimat und Fremde, M. Loosli raconte que l'idée de sa supercherie lui est venue au cours d'une conversation avec un ami. L'entretien avait roulé sur l'hypothèse Bacon Shakespeare, et M. Loosli avait fait remarquer à son compagnon combien il était facile de contester l'authenticité de l'œuvre littéraire de n'importe quel écrivain mort depuis cinquante ans. Il suffisait de lancer d'un air d'augure n'importe quelle affirmation absurde pour que le monde de pontifes littéraires s'en emparât et la discutât avec une gravité imperturbable. Comme l'interlocuteur de M. Loosli restait sceptique, celui-ci fit la gageure de mettre son idée à exécution et envoya, en plein carnaval, à la revue bernoise, l'article qui a mis en branle toute la presse suisse. Il prit la précaution, avant de publier son article, de déposer chez un notaire, sous enveloppe scellée, la déclaration suivante : „ Bümplitz, le 4 janvier 1913. Sous le titre Jérémias Gotthelf, une énigme littéraire, j'ai rédigé aujourd'hui une esquisse que j'ai l'intention de publier, et dans laquelle je fais la preuve que le véritable auteur des œuvres de Jérémias Gotthelf n'est pas Albert Bitzius, mais son contemporain et ami J.-U. Geissbühler. J'ai agi dans l'intention de prouver, par un exemple pratique, combien il est facile, dans le domaine de la philologie, de faire des hypothèses qui sont invraisemblables, et afin de me procurer le plaisir de rire aux dépens des savants qui attaqueront mon article. Je veux donner une leçon aux philologues, parce que j'estime qu'ils trahissent l'art et la poésie. Je dépose aujourd'hui cette explication chez M. le notaire Gfeller, à Bümplitz, et la publierai quand le temps en sera venu. Je le fais afin d'éviter que ma façon d'agir soit mal comprise, et pour protéger la mémoire d'Albert Bitzius contre des philologues trop zélés. C.-A. LOOSLI “. À cette pièce en est jointe une autre, que voici : „ Le soussigné certifie que cet écrit est resté consigné sous scellé dans mon bureau, du 4 janvier 1913 jusqu'à aujourd'hui. Bümplitz, 15 février 1913, Bureau du notaire Gfeller : LUTHI, notaire “. L'hypothèse émise par l'un des mystifiés, que M. Loosli s'était trompé et avait, après coup, afin de masquer sa défaite, prétendu qu'il n'avait voulu faire qu'une farce, doit donc être écartée. Dans son nouvel article, l'auteur de la mystification s'ébaudit aux dépens de ses victimes. „ Mon article humoristique, écrit-il, contenait autant d'absurdités que de mots. Il est incapable de supporter l'examen et d'être pris au sérieux par un homme sensé. Toute personne qui n'est pas complètement bornée devait reconnaître de suite qu'il s'agissait d'une mystification. En dépit de tout cela, j'ai devant moi des articles contenant les appréciations suivantes : – L'auteur émet l'hypothèse, qui n'est pas invraisemblable... etc. (Gazette de Francfort). Peut-être Bitzius comme homme ne sera-t-il pas atteint par les assertions de M. Loosli ; le poète le sera certainement, car de même qu'Homère n'était pas celui qui.... etc. (National Zeitung). – La Nouvelle Gazette de Zurich et le Bund, poursuit M. Loosli, ont naturellement consacré des feuilletons entiers à cette farce et la question a été longuement commentée dans toute la presse suisse et même à l'étranger. Le public en a eu pour ses besoins sensationnels et le nom de Gotthelf, dont en temps ordinaire il se soucie comme d'une guigne, est aujourd'hui dans toutes les bouches. Comme je l'avais prévu, la vanité nationale s'est rebiffée et un nombre imposant de connaisseurs tout spéciaux de Gotthelf ont eu l'occasion de montrer leur profond savoir dans cette bataille contre un fantôme “ ».
[FN: § 1644-1]
IL BUONAIUTI ; Lo gnosticismo, c. IV : Gli gnostici nella leggenda : (« p. 124) Le gnosticisme est un immense phénomène de psychologie religieuse exaltée d'une façon morbide [c'est-à-dire qu'il montre en de plus grandes proportions les idées qu'on trouve en beaucoup d'autres manifestations religieuses], et qui, partant d'humbles origines, a pris peu à peu des proportions alarmantes, dans un milieu aussi favorable que l'atmosphère intellectuelle romaine du IIe et du IIIe siècles. Il est par conséquent inutile de le fractionner, de le sectionner, de l'analyser dans ses éléments : c'est un phénomène complexe, qui tire ses éléments de mille sources, qui jette ses tentacules insinuantes en mille dispositions psychologiques diverses ».
[FN: § 1644-2]
Idem.
[FN: § 1645-1]
Nous connaissons les doctrines gnostiques presque exclusivement par ce qu'en rapportent leurs adversaires chrétiens. Mais, par le peu qu'il est possible de tirer d'autres documents, il semble qu'en gros, ces adversaires ont été des interprètes fidèles. Cela est du moins confirmé par les récentes découvertes de fragments gnostiques. Nous n'entendons nullement ici nous occuper des questions difficiles et en partie actuellement insolubles qui se posent à l'égard de la Gnose et des gnostiques : nous cherchons seulement des exemples de dérivations ; nous ne faisons pas l'histoire d'une doctrine. – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford : « (p. 39) La publication de ces deux traités me semble donc de tout point importante : nous y possédons deux œuvres gnostiques du second siècle, deux œuvres authentiques malgré l'absence du nom de l'auteur et quelle que soit la solution qu'on adopte ; nous pouvons y étudier le gnosticisme sur lui-même, contrôler les assertions des Pères, voir qu'ils ont été le plus souvent des abréviateurs intelligents et toujours de bonne foi ; mais que souvent aussi ils n'ont pas saisi les idées des gnostiques et les ont parfois détournées de leur sens, sans parti pris, par simple erreur de jugement... ». On peut remarquer que les Pères ont donné un aspect plus raisonnable, ou mieux moins absurde, aux divagations qu'on lit dans les documents publiés par Amélineau. Par exemple : « (p. 9) Or de quoi s'agit-il dans tout ce second traité ? Il s'agit tout d'abord de l'initiation que Jésus donne à ses disciples pour les rendre parfaits dans la possession de la Gnose, et des mots de passe qu'il leur apprend pour pouvoir traverser chaque monde et arriver au dernier, où réside le Père de toute Paternité, le Dieu de vérité. Le mot mystère doit ici s'entendre soit des mystères de l'initiation, soit de chaque Æon qui est composé de plusieurs régions mystérieuses, lesquelles sont elles-mêmes habitées par une foule de puissances, toutes plus mystérieuses les unes que les autres... ici le mot Logos doit s'entendre, non pas de l'Æon Logos, mais des mots de passe, des grands et mystérieux mots de passe que le Verbe donne aux gnostiques pour arriver jusqu'au séjour du Dieu de vérité, après avoir passé à travers tous les aeons, sans avoir eu le moins du monde à souffrir de la conduite de leurs habitants. Il y a tout simplement dans le titre de ce second traité un de ces jeux de mots si chers aux Égyptiens ».
[FN: § 1645-2]
Le sens principal de ![]() parait être un grand, un immense espace de temps, de l'éternité. Nous disons le sens principal et non le sens primitif, parce qu'ici nous classons ; nous ne cherchons pas les origines. HES. ; Theog., 609,
parait être un grand, un immense espace de temps, de l'éternité. Nous disons le sens principal et non le sens primitif, parce qu'ici nous classons ; nous ne cherchons pas les origines. HES. ; Theog., 609, ![]() , « depuis les temps les plus reculés ». – PLATON, dans le Timée, dit que Dieu créa le ciel pour en faire une image mobile de l'éternité : (p. 37) « Il décida de faire une image mobile de l'éternité ». ARIST. ; De caelo, I, 9, 11 (p. 279) : ...
, « depuis les temps les plus reculés ». – PLATON, dans le Timée, dit que Dieu créa le ciel pour en faire une image mobile de l'éternité : (p. 37) « Il décida de faire une image mobile de l'éternité ». ARIST. ; De caelo, I, 9, 11 (p. 279) : ... ![]()
![]() « ... il est aeon, ayant pris ce nom du fait d'être toujours ». On trouve des sens abstraits analogues à des expressions signifiant de longs espaces de temps, d'un siècle, de la vie de l'homme. Dans un chapitre
« ... il est aeon, ayant pris ce nom du fait d'être toujours ». On trouve des sens abstraits analogues à des expressions signifiant de longs espaces de temps, d'un siècle, de la vie de l'homme. Dans un chapitre ![]() , SAINT JEAN DAMAS. CÈNE note ces divers sens. On trouve une légère trace de personnification, dans EURIPIDE, Heraclid., 895 (900), où
, SAINT JEAN DAMAS. CÈNE note ces divers sens. On trouve une légère trace de personnification, dans EURIPIDE, Heraclid., 895 (900), où ![]() est appelé « fils de Saturne » ; et l'on peut aussi entendre : « la suite des âges qui naissent du temps : (898)
est appelé « fils de Saturne » ; et l'on peut aussi entendre : « la suite des âges qui naissent du temps : (898) ![]() (899)
(899) ![]() (900)
(900) ![]() . « Car la Parque qui-mène-à-la-fin – et l'âge, fils de Kronos, enfantent beaucoup de choses ». C'est là une personnification poétique, semblable à celles dont use CLAUDIEN, dans l'Éloge de Stilicon, II :
. « Car la Parque qui-mène-à-la-fin – et l'âge, fils de Kronos, enfantent beaucoup de choses ». C'est là une personnification poétique, semblable à celles dont use CLAUDIEN, dans l'Éloge de Stilicon, II :
(424) Est ignota procul, nostraeque impervia menti,
Vix adeunda Deis, annorum squalida mater,
Immensi spelunea aevi, quae tempora vasto
Suppeditat revocalque sinu...
Sous le nom d'aeon, ARRIEN semble entendre un être immortel Epicteti dissertationes II, 5, 13 : ![]() . « Car je ne suis pas un immortel, mais je suis un homme ». – TATIEN mentionne les
. « Car je ne suis pas un immortel, mais je suis un homme ». – TATIEN mentionne les ![]() de telle façon qu'on ne sait pas bien de quoi il veut parler ; mais en tout cas, il semble que ce soit des mondes, des régions. Orat. ad Graecos, 20, p. 35 ; « Car le ciel n'est pas infini, ô homme, mais fini et circonscrit. Au-dessus de lui sont les Æons, meilleurs, n'ayant pas les changements de saison, changements qui engendrent les diverses maladies, jouissant entièrement d'un climat agréablement tempéré, ayant des jours perpétuels : et une lumière inaccessible aux hommes d'ici ». Nous avons deux types de traduction. Par exemple : A. PUECH ; Le disc. de Tatien... : « (p. 134) Le ciel n'est pas infini, ô homme, il est fini et a des limites. Au-dessus de lui, ce sont les mondes [en note : Le mot dont se sert Tatien
de telle façon qu'on ne sait pas bien de quoi il veut parler ; mais en tout cas, il semble que ce soit des mondes, des régions. Orat. ad Graecos, 20, p. 35 ; « Car le ciel n'est pas infini, ô homme, mais fini et circonscrit. Au-dessus de lui sont les Æons, meilleurs, n'ayant pas les changements de saison, changements qui engendrent les diverses maladies, jouissant entièrement d'un climat agréablement tempéré, ayant des jours perpétuels : et une lumière inaccessible aux hommes d'ici ». Nous avons deux types de traduction. Par exemple : A. PUECH ; Le disc. de Tatien... : « (p. 134) Le ciel n'est pas infini, ô homme, il est fini et a des limites. Au-dessus de lui, ce sont les mondes [en note : Le mot dont se sert Tatien ![]() (siècles, mondes) est un de ceux qu'il a en commun avec les Gnostiques... ] ». – L'autre type de traduction accepte le sens de siècles ; par exemple, OTTO : (p. 91) Non enim infinitum est coelum, o homo, sed finitum et terminis circumscriptum ; quae autem supra eum sunt, saecula, praestantiora... Dans l'édition Migne, on traduit aussi saecula praestantiora, et l'on ajoute en note : Agit enim hic de paradiso, quem in terra longe praestantiore, quam haec nostra est, situm fuisse pronuntiat. C'est pourquoi, même si l'on traduit saecula, on peut entendre une région. Chez les gnostiques, les aeons deviennent des personnes et des régions, et sont aussi considérés sous divers aspects. – TERTULL. ; Adversus Valentinianos, 7 (édit. OEHLER, II, p. 389), dit du dieu des valentiniens : Hunc substantialiter quidem
(siècles, mondes) est un de ceux qu'il a en commun avec les Gnostiques... ] ». – L'autre type de traduction accepte le sens de siècles ; par exemple, OTTO : (p. 91) Non enim infinitum est coelum, o homo, sed finitum et terminis circumscriptum ; quae autem supra eum sunt, saecula, praestantiora... Dans l'édition Migne, on traduit aussi saecula praestantiora, et l'on ajoute en note : Agit enim hic de paradiso, quem in terra longe praestantiore, quam haec nostra est, situm fuisse pronuntiat. C'est pourquoi, même si l'on traduit saecula, on peut entendre une région. Chez les gnostiques, les aeons deviennent des personnes et des régions, et sont aussi considérés sous divers aspects. – TERTULL. ; Adversus Valentinianos, 7 (édit. OEHLER, II, p. 389), dit du dieu des valentiniens : Hunc substantialiter quidem ![]() appellant, personaliter vero
appellant, personaliter vero ![]() et
et ![]()
![]() , etiam Bython, quod in sublimibus habitanti minime congruebat. « Considéré en sa substance, ils l'appellent aeon parfait, en sa personnalité, : premier principe, le principe, et abîme, nom qui ne convenait nullement à qui habitait des régions sublimes ». – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford. Jésus enseigne à ses disciples comment, après la mort, ils traverseront les aeons : « (p. 23) Ici... nous avons les chiffres qui correspondent à chaque monde des sceaux, c'est-à-dire les amulettes qu’il faut avoir et connaître pour entrer dans chaque aeon. …Nous avons en outre les apologies que l'on devait réciter, c'est-à-dire les mots de passe qu'il fallait prononcer pour convaincre les aeons que la possession du chiffre et du sceau n'était pas subreptice... L'emploi de ce chiffre, de ce talisman avait un effet merveilleux : lorsque l'âme se présentait dans un monde, aussitôt accouraient à elle tous les Archons de l'aeon, toutes les Puissances, tous les habitants en un mot, prêts à lui faire tout le mal qu'aurait encouru sa témérité : elle disait le chiffre, montrait le talisman, récitait la formule, et tout d'un coup, Archons, Puissances, habitants de l'aeon, tous lui faisaient place et s'enfuyaient à l'Occident ». – AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce, texte et traduction... : « (p. 194) Jésus dit à ses disciples : « Je vous donnerai l'apologie de tous ces lieux dont je vous ai donné le mystère et les baptêmes... (p. 195) Lorsque vous serez sortis du corps et que vous ferez ces mystères à tous les aeons et à tous ceux qui sont en eux, ils s'écarteront (devant vous) jusqu'à ce que vous arriviez à ces six grands aeons. Ils s'enfuiront à l'Occident, à gauche, avec tous leurs archons et tous ceux qui sont en eux ». En conclusion, chez les gnostiques, ce terme d'aeons paraît avoir trois significations : 1° une signification métaphysique concernant l'éternité ; 2° une signification qui les fait ressembler à des personnes ; 3° une signification qui les fait ressembler à des lieux. Mais ces significations ne demeurent pas distinctes : le caractère métaphysique s'étend aux personnes et aux lieux ; les personnes ressemblent aux lieux, et les lieux agissent comme des personnes.
, etiam Bython, quod in sublimibus habitanti minime congruebat. « Considéré en sa substance, ils l'appellent aeon parfait, en sa personnalité, : premier principe, le principe, et abîme, nom qui ne convenait nullement à qui habitait des régions sublimes ». – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford. Jésus enseigne à ses disciples comment, après la mort, ils traverseront les aeons : « (p. 23) Ici... nous avons les chiffres qui correspondent à chaque monde des sceaux, c'est-à-dire les amulettes qu’il faut avoir et connaître pour entrer dans chaque aeon. …Nous avons en outre les apologies que l'on devait réciter, c'est-à-dire les mots de passe qu'il fallait prononcer pour convaincre les aeons que la possession du chiffre et du sceau n'était pas subreptice... L'emploi de ce chiffre, de ce talisman avait un effet merveilleux : lorsque l'âme se présentait dans un monde, aussitôt accouraient à elle tous les Archons de l'aeon, toutes les Puissances, tous les habitants en un mot, prêts à lui faire tout le mal qu'aurait encouru sa témérité : elle disait le chiffre, montrait le talisman, récitait la formule, et tout d'un coup, Archons, Puissances, habitants de l'aeon, tous lui faisaient place et s'enfuyaient à l'Occident ». – AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce, texte et traduction... : « (p. 194) Jésus dit à ses disciples : « Je vous donnerai l'apologie de tous ces lieux dont je vous ai donné le mystère et les baptêmes... (p. 195) Lorsque vous serez sortis du corps et que vous ferez ces mystères à tous les aeons et à tous ceux qui sont en eux, ils s'écarteront (devant vous) jusqu'à ce que vous arriviez à ces six grands aeons. Ils s'enfuiront à l'Occident, à gauche, avec tous leurs archons et tous ceux qui sont en eux ». En conclusion, chez les gnostiques, ce terme d'aeons paraît avoir trois significations : 1° une signification métaphysique concernant l'éternité ; 2° une signification qui les fait ressembler à des personnes ; 3° une signification qui les fait ressembler à des lieux. Mais ces significations ne demeurent pas distinctes : le caractère métaphysique s'étend aux personnes et aux lieux ; les personnes ressemblent aux lieux, et les lieux agissent comme des personnes.
Les caractères vagues et flottants du terme aeons sont analogues à ceux des termes justice (celle-ci a été aussi personnifiée, comme les aeons), vérité, liberté, bien, mal, etc. L'analogie n'est pas fortuite ; elle provient de ce que tous ces termes sont des créations du sentiment. C'est ce qui, d'une part, éloigne ces termes de la réalité expérimentale, et, de l'autre, assure leur influence sur l'esprit humain.
[FN: § 1646-1]
IRENAEUS ; Contra Haereses, I, 1, p. 5, éd. Massuet. ![]()
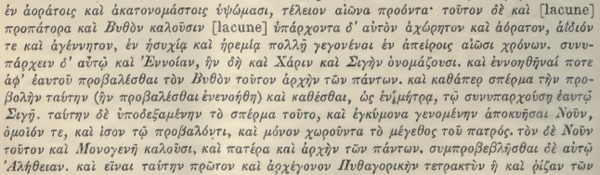
![]() – GRABE note :
– GRABE note : ![]() Synesius, Episcopus Ptolernaïdis, sicut in Hymnis Poetica licentia abusus, omnem fere Valentinianorum mataeologiam verae Theologiae adaptavit, ac haeretica voce orthodoxam cecinit fidem ; ita haec duo quoque nomina vero Deo Patri attribuit. Sie Hymno, II, 27 :
Synesius, Episcopus Ptolernaïdis, sicut in Hymnis Poetica licentia abusus, omnem fere Valentinianorum mataeologiam verae Theologiae adaptavit, ac haeretica voce orthodoxam cecinit fidem ; ita haec duo quoque nomina vero Deo Patri attribuit. Sie Hymno, II, 27 : ![]() , Profundum paternum. Hymno, III, 47 :
, Profundum paternum. Hymno, III, 47 : ![]() , Primus pater, sine patre. Hymno IV, 69 :
, Primus pater, sine patre. Hymno IV, 69 : ![]() , Immensa pulchritudo. Il est bon de comparer cette description avec celle du papyrus de Bruce. AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce… : « (p. 89) C'est le premier père de toutes choses, c'est le premier éternel (?), c'est le roi de ceux que l'on ne peut toucher,... (p. 90) c'est l'abîme de toutes choses... ils ne l'ont point nommé parce qu'il est innommable et qu'on ne peut le penser... Le second lieu est celui qu'on appelle Démiurge, Père, Logos, Source, Nous, Homme, Éternel, Infini. C'est la colonne ; c'est le surveillant, c'est le père de toutes choses... (p. 91) C'est l'Ennéade qui est sortie du Père, sans commencement, qui seul a été son propre (p. 92) père et sa mère, celui dont le Plérôme entoure les douze abîmes. Le premier abîme, c'est la Source universelle, dont toutes les sources sont sorties. Le second abîme, c'est la Sagesse universelle, dont toutes les sagesses sont sorties... ». Et ainsi de suite, on nomme les autres abîmes : le Mystère universel, la Gnose universelle, la Pureté universelle, le Silence, l'Universelle Essence avant (toute essence), le Propator, le Pantopator ou l'Autopator, la Toute-Puissance, l'Invisible, la Vérité. – Voilà une nouvelle vérité, qu'il faut ajouter à toutes celles que nous avons déjà trouvées.
, Immensa pulchritudo. Il est bon de comparer cette description avec celle du papyrus de Bruce. AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce… : « (p. 89) C'est le premier père de toutes choses, c'est le premier éternel (?), c'est le roi de ceux que l'on ne peut toucher,... (p. 90) c'est l'abîme de toutes choses... ils ne l'ont point nommé parce qu'il est innommable et qu'on ne peut le penser... Le second lieu est celui qu'on appelle Démiurge, Père, Logos, Source, Nous, Homme, Éternel, Infini. C'est la colonne ; c'est le surveillant, c'est le père de toutes choses... (p. 91) C'est l'Ennéade qui est sortie du Père, sans commencement, qui seul a été son propre (p. 92) père et sa mère, celui dont le Plérôme entoure les douze abîmes. Le premier abîme, c'est la Source universelle, dont toutes les sources sont sorties. Le second abîme, c'est la Sagesse universelle, dont toutes les sagesses sont sorties... ». Et ainsi de suite, on nomme les autres abîmes : le Mystère universel, la Gnose universelle, la Pureté universelle, le Silence, l'Universelle Essence avant (toute essence), le Propator, le Pantopator ou l'Autopator, la Toute-Puissance, l'Invisible, la Vérité. – Voilà une nouvelle vérité, qu'il faut ajouter à toutes celles que nous avons déjà trouvées.
[FN: § 1646-2]
Dans les manuscrits de Bruce, AMÉLINEAU croit pouvoir reconnaître trois plérômes différents. Les traités gnostiques d'Oxford : « (p. 24) Ce mot Plérôme a, je crois, trois sens fort différents : il en a tout au moins deux qui sont certains. Je crois tout d'abord qu'il désigne l'ensemble des mondes y compris notre terre, mais que seulement il s'applique sur notre terre aux psychiques qui peuvent être admis à jouir d'une partie des prérogatives du vrai gnostique et aux pneumatiques qui jouissent de toutes ces prérogatives par essence : les hyliques n'en font pas partie, parce qu'ils appartiennent à la mauvaise création, sont essence de gauche, selon le terme employé, et doivent être détruits, anéantis. Je ne veux pas affirmer cette compréhension du mot Plérôme ; elle n'est pas péremptoirement établie, mais elle semble bien ressortir des textes, surtout de ces deux traités. Quoi qu'il en soit, il est certain (p. 25) que le mot Plérôme désigne le monde du milieu et le monde supérieur dans leur ensemble, c'est-à-dire tous les aeons intermédiaires entre notre terre et le Plérôme supérieur, avec les aeons de ce Plérôme lui-même. Enfin le mot Plérôme est souvent employé pour désigner seulement le monde supé rieur. Or ce monde supérieur est appelé ici l'aeon du Trésor, et ce trésor, comme tous les trésors, contient plusieurs pièces précieuses : dans l'espèce il contient soixante aeons ».
[FN: § 1646-3]
Philosophumena ; VI, 2, 30. C'était le dernier des 28 Aeons, « étant du genre féminin et dénommé Sophia ». – ![]() . Ici l'attribution du sexe ne laisse aucun doute.
. Ici l'attribution du sexe ne laisse aucun doute.
[FN: § 1646-4]
Philosophumena : VI, 2, 30. D'autres récits diffèrent de celui-ci et sont beaucoup plus allégoriques. Irénée, et Tertullien, qui le suit, nous disent que la Sophia voulait comprendre l'immensité de son Père ; et comme elle ne pouvait atteindre son but, elle se consumait et aurait disparu si la Limite ![]() ne l'avait arrêtée. Quelques valentiniens disent que dans cette recherche pénible elle enfanta la Réflexion (ou la Passion :
ne l'avait arrêtée. Quelques valentiniens disent que dans cette recherche pénible elle enfanta la Réflexion (ou la Passion : ![]() ). D'autres lui font mettre au monde la matière informe, qui est un être féminin (IRAEN. ; I, 2, 3).
). D'autres lui font mettre au monde la matière informe, qui est un être féminin (IRAEN. ; I, 2, 3).
Il y avait encore – paraît-il – des Gnostiques au XIXe siècle. JULES BOIS ; Les petites religions de Paris. L'auteur fait parler ainsi un Gnostique, Jules Doinel : « (p. 176) Savez-vous pourquoi nous souffrons et sommes mauvais si souvent ? m'a dit l’Apôtre ; le Démiurge – non pas Dieu lui-même – créa le monde : ce Démiurge, mauvais ouvrier au service de la Sophia, l'âme de l'univers déchue par son noble désir de trop connaître, nous fabriqua à sa propre image trop peu belle ; mais Sophia eut pitié. Par sa volonté, une larme d'elle-même et du ciel habita notre argile. Démiurge s'en vengea en liant l’homme à la chair, dont il ne se délivrera que par la connaissance de sa destinée, par la Gnose ».
[FN: § 1646-5]
Philosophum. ; VI, 2, 30.
[FN: § 1647-1]
Tertullien compare les mystères des valentiniens aux mystères d'Éleusis. TERTULL. ; Adv. Valent., 1 : ... Eleusinia Valentiniani fecerunt lenocinia.
[FN: § 1647-2]
Dans le papyrus de Bruce, il y a de comiques détails de personnification. AMÉLINEAU ; loc. cit. 1846-1. On dit de la personnification qui y est mentionnée : « (p. 91) La lumière de ses yeux pénètre jusqu'aux lieux du Plérôme extérieur et le Verbe sort de sa bouche... Les cheveux de sa tête sont en nombre égal aux mondes cachés ; les traits (?) de son visage sont le type des aeons, les poils de sa barbe sont en nombre égal à celui des mondes extérieurs... ». Tous les noms deviennent des choses. « (p. 97) Il y a aussi un autre lieu que l'on nomme abîme, où il y a trois Paternités... dans la seconde Paternité il y a cinq arbres, au milieu desquels est une table. Un verbe Monogénès se tient sur cette table, ayant les douze visages du Nous de toutes choses ; et les prières de tous les êtres, on les place devant lui... (p. 99) Et ce Christ porte douze visages... Chaque Paternité a trois visages... » – Cfr. BUONAIUTI ; Lo Gnosticismo, p. 211.
[FN: § 1648-1]
L'une des théogonies orphiques a quelques points de ressemblance avec celles des gnostiques ; mais cela ne suffit pas pour savoir si et jusqu'à quel point elle fut imitée. Dict. DAREMB. SAGLIO ; s. r. Orphici, p. 249 : « La rédaction définitive de cet ouvrage [la Théogonie des Rhapsodes] paraît être d'époque assez basse. Mais les éléments essentiels du système peuvent être fort anciens et remonter en partie jusqu'au VIe siècle. Voici l'analyse sommaire de la Théogonie des Rhapsodes... À l'origine était Chronos ou le Temps. Il produisit l'Ether et le Chaos, dont l'union eut pour résultat l'apparition de l'œuf cosmique, un œuf énorme en argent. De l'œuf sortit un dieu, qui avait de nombreuses têtes d'animaux : à la fois mâle et femelle, il contenait le germe de tout. Ce dieu était Phanès ; mais on lui donne aussi d'autres noms : Protogonos, Ericapaeos, Mêtis, Éros. Quand le dieu fut né, la partie supérieure de l'œuf cosmique devint le ciel ; la partie inférieure devint la terre... ».
[FN: § 1648-2]
Aristobule, philosophe hébreux, cité par EUSEB., Praep. evang., XIII, 12, dit que Platon a évidemment suivi les livres de la loi hébraïque. – JUSTIN, Apol., I, 59, 60, cite les enseignements que Platon tira de la Bible. IUST., Cohort., 14, croit que, par l'intermédiaire des Égyptiens, Orphée, Homère, Solon, Pythagore et Platon tirèrent parti des histoires de Moïse. Cet Aristobule était un grand faussaire. Il cite les auteurs à sa façon, et pousse l'impudence jusqu'à altérer un vers d'Homère. Ce poète, dans l'Odyssée, V, raconte comment les préparatifs d'Ulysse pour quitter l'île de Calypso furent terminés le quatrième jour :
(262)
« C'était le quatrième jour, et par lui tout avait été terminé ». Aristobule, qui veut démontrer que même les païens sanctifiaient le septième jour, remplace avec désinvolture ![]() par
par ![]() , et il fait dire ainsi à Homère que le septième jour tout était terminé. Cette bonne âme d'Eusèbe, qui cite l'ouvrage d'Aristobule, fait semblant de ne pas s'apercevoir de la falsification. Aristobule fait mieux encore. Il invente entièrement des vers qui lui sont utiles, et Eusèbe les rapporte sans sourciller. N'oublions pas que ces gens parlaient sans cesse de « morale ».
, et il fait dire ainsi à Homère que le septième jour tout était terminé. Cette bonne âme d'Eusèbe, qui cite l'ouvrage d'Aristobule, fait semblant de ne pas s'apercevoir de la falsification. Aristobule fait mieux encore. Il invente entièrement des vers qui lui sont utiles, et Eusèbe les rapporte sans sourciller. N'oublions pas que ces gens parlaient sans cesse de « morale ».
[FN: § 1649-1]
D. EPIPHANII adversus haereses, 1. I. Ex Valentiniano libro, V, p. 168-169. L'auteur rapporte un fragment de Valentin, qui, parlant d'un mâle et d'une femelle aeons, dit : « ... et eux s'unirent par une copulation non corrompue et un mélange impérissable » :![]() . Peu avant, parlant d'une autre union, il dit :
. Peu avant, parlant d'une autre union, il dit : ![]() : « et celle-ci s'unit avec lui ». Le verbe
: « et celle-ci s'unit avec lui ». Le verbe ![]() est celui qu'on emploie pour exprimer que l'homme a commerce avec la femme. Dans un opuscule intitulé : Adversus omnes haereses, qu'à tort on supposa être de Tertullien, on lit, c. 1 : Hic [Nicolaus] dicit tenebras in concupiscentia luminis et quidem foeda et obscoena fuisse ; ex hac permixtione pudor est dicere quae foetida et immunda. Sunt et cetera obscoena. Aeones enim refert quosdam turpitudinis natos, et complexus et permixtiones exsecrabiles obscoenasque coniunctas, et quaedam ex ipsis adhuc turpiora.
est celui qu'on emploie pour exprimer que l'homme a commerce avec la femme. Dans un opuscule intitulé : Adversus omnes haereses, qu'à tort on supposa être de Tertullien, on lit, c. 1 : Hic [Nicolaus] dicit tenebras in concupiscentia luminis et quidem foeda et obscoena fuisse ; ex hac permixtione pudor est dicere quae foetida et immunda. Sunt et cetera obscoena. Aeones enim refert quosdam turpitudinis natos, et complexus et permixtiones exsecrabiles obscoenasque coniunctas, et quaedam ex ipsis adhuc turpiora.
[FN: § 1649-2]
Dict. DAREMB-SAGLIO ; s. r. Orphici, p. 250 : « Non contents de transformer les mythes en symboles, les Orphiques inventèrent et adoptèrent des dieux tout abstraits, sans légende, sans figure, sans personnalité, simples expressions métaphysiques de leurs conceptions cosmogoniques. De ce nombre étaient quelques-uns de leurs dieux les plus vénérés : l'Eros cosmique, Protogonos, ... Mêtis, Misé, Mnémosyne, Phanès. Il suffit de considérer l'étymologie de tous ces noms, pour s'apercevoir que ce sont de purs symboles, sans consistance ni réalité concrète. On a simplement divinisé des termes de métaphysique ».
[FN: § 1650-1]
Philosophumena, V, 4, 26. « Il y a trois principes de tout, non engendrés, deux mâles et un qui est femelle. Des mâles, l'un est appelé Bon ; lui seul est ainsi nommé et prescient de tout. L'autre, père de toutes les choses engendrées, lequel ne prévoit pas [est imprévoyant] ne sait pas, ne voit pas. La femelle est imprévoyante, irascible, trompeuse [double], de corps biforme, en tout semblable au monstre d'Hérodote †, fille jusqu'au pubis, serpent au-dessous, comme le dit Justin. Cette jeune fille est appelée Edem et Israël. Tels sont, dit-il, les principes de tout, racine et source, dont naquirent toutes les choses ; il n'y a rien d'autre. Le Père imprévoyant voyant la semi-jeune fille, se prit à la désirer ardemment ; Eloïm – dit-il – est appelé le Père, et Edem aussi s'éprit d'un désir de lui, non moins grand. Le désir les unit en un seul commerce amoureux. De cette union avec Edem, le Père engendra pour lui douze anges. Les noms des anges paternels sont... Les noms des anges maternels dont Edem se fit également des sujets, sont... ». Sachez aussi que les arbres du Paradis de la Bible sont des allégories de ces anges. L'arbre de vie est Baruch, troisième des anges paternels ; l'arbre de la science du bien et du mal est Naas, troisième des anges maternels. Eloïm et Edem produisirent toute chose : les hommes sont nés de la partie humaine de Edem, au-dessus de l'aine ; les animaux et le reste, de la partie bestiale, au-dessous de l'aine.
† HEROD.; IV, 8 et s.v.
[FN: § 1650-2]
HESIOD. ; Theog., 116 et sv. : « Donc d'abord fut le Chaos, ensuite la Terre à la large poitrine, toujours siège sûr de tout ††, et le Tartare ténébreux, dans les profondeurs de la Terre spacieuse, et l'Amour qui est très beau parmi les dieux immortels, qui dissipe les soucis [ou délie les membres], et qui dompte dans la poitrine l'esprit de tous les dieux et des hommes... Du Chaos et de l'Érèbe naquit la Nuit noire ; puis, de la Nuit l'Éther et le Jour sont nés, enfantés par la Nuit enceinte après s'être unie avec l'Érèbe. Certes, la Terre enfanta d'abord, afin qu'il l'enveloppât, Ouranos [le Ciel] étoilé, égal à elle... S'étant unie avec Ouranos, elle enfanta l'Océan aux gouffres profonds, et Kœos, Kreios, Hypérion, Iapétos, Théia, Rhéa, Thémis et Mnèmosynè, Phœbè à la couronne d'or, et l'aimable Thétis... ».
Ces vers ont taillé beaucoup d'ouvrage aux interprètes d'Hésiode et aux philosophes. Diogène Laërce nous dit (X, 2) qu'Épicure s'appliqua à la philosophie parce que ni les sophistes ni les grammairiens n'avaient su lui expliquer ce qu'était le chaos d'Hésiode. Sextus Empiricus (adv. math.), X, 18, p. 636) rapporte le même fait, en ajoutant quelques détails. Selon lui, Hésiode nomme chaos le lieu qui contient toute chose. L'ancien scoliaste d'Hésiode rapporte plusieurs opinions à propos de ce chaos : entre autres une interprétation étymologique qui le fait dériver de ![]() (s'amasser, s'accumuler, se répandre) :
(s'amasser, s'accumuler, se répandre) : ![]() . Une interprétation, donnée comme étant de Zénodote, suppose que le chaos est l'atmosphère
. Une interprétation, donnée comme étant de Zénodote, suppose que le chaos est l'atmosphère ![]() . Venons à des commentateurs plus récents. Guietus note : «
. Venons à des commentateurs plus récents. Guietus note : « ![]() ] Hoc est coelum, aer, aeris vastitas, immensitas quaqua versum, spatium universum. Deux autres auteurs, qui ont la manie de lire Hésiode la Bible à la main, ont un débat à propos de ce chaos. A-t-il été créé, ou est-il incréé ? Clericus penche pour la seconde opinion, car, si l'on adoptait la première, on pourrait demander au poète : par qui le chaos a-t-il été créé ? « Clementinarum Homiliarum Scriptor interpretatur quidem
] Hoc est coelum, aer, aeris vastitas, immensitas quaqua versum, spatium universum. Deux autres auteurs, qui ont la manie de lire Hésiode la Bible à la main, ont un débat à propos de ce chaos. A-t-il été créé, ou est-il incréé ? Clericus penche pour la seconde opinion, car, si l'on adoptait la première, on pourrait demander au poète : par qui le chaos a-t-il été créé ? « Clementinarum Homiliarum Scriptor interpretatur quidem ![]() , quasi dixisset Hesiodus
, quasi dixisset Hesiodus ![]() , genitum est Chaos, sed est inanis argutia. Allato hoc Hesiodi loco, ita loquitur Homil. Vl, § 3 ... „ factum fuit clarum est significare elementa, ut genita, ortum habuisse, non semper fuisse ut ingenita “. Sed si hoc cogitasset Poeta, causam aliquam commentus esset, a qua genitum Chaos dixisset. Dicenti enim factum est, illico obiicitur, a quo ? Nihil enim fit, sine factore ». Mais Th. Robinson est d'un avis contraire. Il note : «
, genitum est Chaos, sed est inanis argutia. Allato hoc Hesiodi loco, ita loquitur Homil. Vl, § 3 ... „ factum fuit clarum est significare elementa, ut genita, ortum habuisse, non semper fuisse ut ingenita “. Sed si hoc cogitasset Poeta, causam aliquam commentus esset, a qua genitum Chaos dixisset. Dicenti enim factum est, illico obiicitur, a quo ? Nihil enim fit, sine factore ». Mais Th. Robinson est d'un avis contraire. Il note : « ![]()
![]() ] Verte, Primum quidem Chaos genitum est, ut infra 137, 930. Ita enim Veteres hunc locum intellexerunt, non ut Clericus, fuit ». Là-dessus il cite des auteurs et conclut : « En de telles ténèbres s'agitent ceux qui, la cause de toute chose étant exclue, entreprennent, par d'autres hypothèses, d'expliquer l'origine du monde. La même question doit nécessairement se reproduire à perpétuité : „ Par quoi cela a-t-il été produit ? “ jusqu'à ce qu'on arrive à quelque cause suprême et incréée ». Nous rions de ces vaines subtilités, dissipées maintenant par les sciences expérimentales. Si jamais le domaine de ces sciences vient à s'étendre sur la « Sociologie » et l'«Économie politique », on rira de même de bien des élucubrations métaphysiques, éthiques, humanitaires, patriotiques, etc., que l'on trouve actuellement en ces genres de littérature.
] Verte, Primum quidem Chaos genitum est, ut infra 137, 930. Ita enim Veteres hunc locum intellexerunt, non ut Clericus, fuit ». Là-dessus il cite des auteurs et conclut : « En de telles ténèbres s'agitent ceux qui, la cause de toute chose étant exclue, entreprennent, par d'autres hypothèses, d'expliquer l'origine du monde. La même question doit nécessairement se reproduire à perpétuité : „ Par quoi cela a-t-il été produit ? “ jusqu'à ce qu'on arrive à quelque cause suprême et incréée ». Nous rions de ces vaines subtilités, dissipées maintenant par les sciences expérimentales. Si jamais le domaine de ces sciences vient à s'étendre sur la « Sociologie » et l'«Économie politique », on rira de même de bien des élucubrations métaphysiques, éthiques, humanitaires, patriotiques, etc., que l'on trouve actuellement en ces genres de littérature.
†† Un vers interpolé ajoute : « des immortels qui possèdent les cimes neigeuses de l'Olympe »
[FN: § 1650-3]
CH. FOURIER ; Traité de l'association domestique-agricole, t. I « (p. 521) Les planètes étant androgynes comme les plantes, copulent avec elles-mêmes et avec les autres planètes. Ainsi la terre, par copulation avec elle-même, par fusion de ses deux arômes typiques, le masculin versé du pôle nord, et le féminin versé du pôle sud, engendra le Cerisier, fruit sous-pivotal des fruits rouges, et accompagné de 5 fruits de gamme ; savoir : La terre copulant avec Mercure, son principal et 5e satellite, engendra la fraise, – avec Pallas, son 4e satellite, la groseille noire ou cassis – avec Cérès, son 3e satellite, la groseille épineuse... » Voici les qualités de ces créations. « (p. 525) La cerise, fruit sous-pivotal de cette modulation est créée par la terre copulant avec elle-même – de pôle nord, en arôme masculin – avec pôle sud, en arôme féminin. La cerise, image des goûts de l'enfance, est le premier fruit de la belle saison. Elle est dans l'ordre des récoltes ce que l'enfance est dans l'ordre des âges... (p. 526) La fraise, donnée par Mercure, est le plus précieux des fruits rouges, elle nous peint l'enfant élevé dans l'Harmonie, dans les groupes industriels... La groseille épineuse à fruits isolés, est un produit de Cérès. Elle dépeint l'enfant contraint, privé de plaisir, harcelé de morale, et élevé isolément aux études... (p. 527) La groseille noire, dite cassis, est donnée par Pallas ou Esculape, qui module toujours en arômes amers. La plante représente les enfants pauvres et grossiers ; aussi son fruit noir, emblématique de la pauvreté, est-il d'une saveur amère et désagréable... ».
[FN: § 1651-1]
Ouvrages inédits d'ABÉLARD... publ. par V. Cousin. PETRI ABAELARDI de gencribus et speciebus : (p. 513) Diversi diversa sentiunt... Alii vero quasdam essentias universales fingunt, quas in singulis individuis totas essentialiter esse credunt... (p. 524) Unumquodque individuum ex materia et forma compositum est, ut Socrates ex homine materia et Socratitate forma ; sic Plato, ex simili materia, scilicet homine, et forma diversa, scilicet Platonitate, componitur ; sic et singuli homines. Et sicut Socratitas, quae forrnaliter constituit Socratem, nusquam est extra Socratem, sic illa hominis essentia, quae Socratitatem sustinet in Socrate, nusquam est nisi in Socrate. Ita de singulis. Speciem igitur dico esse non illam essentiam hominis solum quae est in Socrate, vel quae est in aliquo alio individuorum, sed totam illam collectionem ex singulis aliis (p. 525) huius naturae conjunctam. Quae tota collectio, quamvis essentialiter multa sit, ab auctoritatibus tamen una species, unum universale, una natura appellatur, sicut populus, quamvis ex multis personis collectus sit, unus dicitur. –Abélard explique une opinion réaliste : « (p. 513) D'autres supposent des essences universelles qu'ils croient exister toutes essentiellement chez les divers individus ». C'est la doctrine des universaux, dont sont formés les individus. « (p. 524) Chaque individu est composé de matière et de forme, comme Socrate, de la matière homme et de la forme socratite ; ainsi Platon est composé d'une semblable matière, c'est-à-dire de [matière] homme, et d'une forme différente, c'est-à-dire platonicienne ; de même chaque homme en particulier. Et de même que la socratité qui constitue formellement Socrate, ne se trouve en aucun lieu en dehors de Socrate, ainsi cette essence d'homme que régit la socratité chez Socrate, ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Socrate. Il en est ainsi de chacun. Je dis donc que l'espèce n'est pas seulement cette essence d'homme qui est en Socrate, ou qui se trouve en n'importe quel autre individu, mais toute cette masse de chaque individu de même nature, mise ensemble. Bien que cette masse soit essentiellement multiple, toutefois, elle est d'autorité appelée une espèce, un des universaux, une nature ; de même que le peuple est dit un, bien qu'il soit formé d'un grand nombre de personnes. »
[FN: § 1652-1]
HAURÉAU ; De la phil. scol., t. I : « (p. 234) ...nous plaçons Guillaume de Champeaux au nombre des docteurs scolastiques qui ont manifesté le goût le plus vif pour les abstractions réalisées. Alors même que l'on pose au-delà des êtres vrais un ou plusieurs êtres problématiques, (p. 235) ou fictifs, on peut n'être encore qu'un réaliste modéré ; mais ce qui est l'excès le plus grave, la thèse la plus absolue, la plus intempérante du réalisme, c'est de refuser les conditions de l'être à tout ce qui est, pour les attribuer uniquement à ce qui n'est pas. Et Guillaume de Champeaux n'a fait, à notre avis, rien moins que cela... (p. 243) Au dire des nominalistes, les universaux in re ne sont que les attributs plus ou moins généraux des choses individuelles : ce qu'il y a de semblable entre les substances est la manière d'être de ces substances... Au dire de Guillaume, l'universel in re, considéré comme ce qu'il y a de plus général, est la substance ou l'essence première, unique, qui ne contient pas en elle-même le principe de distinction, mais qui reçoit, comme accidents extrinsèques, les formes individuelles ». Que peut bien être l'essence première ? Serait-ce un quid simile de l'Abîme des gnostiques ? – ROUSSELOT ; Étud. sur la phil. dans le m. âge, t. 1 « (p. 253) Rappelons, en deux mots, la thèse du nominalisme. Roscelin avait dit : Les individus seuls sont des réalités, et constituent l'essence des choses, le reste n'est qu'une abstraction, un jeu de langage, un son de voix, flatus vocis. Choqué, à bon droit, de cette proposition, Guillaume de Champeaux... combat cette doctrine, et lui en substitue une autre entièrement opposée et tout aussi exclusive. …(p. 255) L'universel par excellence, l'universel absolu [qu'est-ce que cela peut bien être ?], qu'on me permette cette expression, est une réalité substantielle [qu'on trouve dans le monde comme le monstre moitié jeune fille, moitié serpent, de Justin], car, avec Guillaume de Champeaux, il ne faut pas séparer l'idée de substance de celle de réalité [avant de savoir si elles sont unies ou séparées, il serait nécessaire de savoir ce qu'elles sont], et c'est du haut de ce principe ontologique qu'il proclame la réalité des universaux, et qu'il nie celle de l'individu ». Il y a aujourd'hui encore des gens qui raisonnent de cette manière.
[FN: § 1652-2]
DIOG. LAERC. ; VI, 53 : « Platon discutant des idées et nommant la ![]() [essence de la table, qualité d'être une table, table en soi] et la
[essence de la table, qualité d'être une table, table en soi] et la ![]() [essence de la tasse, qualité d'être une tasse, tasse en soi] „ Moi, ô Platon – dit [Diogène] – je vois la table et la tasse ; mais nullement la
[essence de la tasse, qualité d'être une tasse, tasse en soi] „ Moi, ô Platon – dit [Diogène] – je vois la table et la tasse ; mais nullement la ![]() et la
et la ![]() “.
Sur ce, Platon : „ Avec raison, dit-il, car tu as les yeux avec lesquels on voit la table et la tasse, mais tu n'as pas ceux avec lesquels on voit la
“.
Sur ce, Platon : „ Avec raison, dit-il, car tu as les yeux avec lesquels on voit la table et la tasse, mais tu n'as pas ceux avec lesquels on voit la ![]() et la
et la ![]() Tous deux avaient raison. Que les disciples de Platon voient ce qu'ils veulent : leurs discours seront utiles comme dérivations ; ils sont vains et absurdes pour tout ce qui concerne la science expérimentale.
Tous deux avaient raison. Que les disciples de Platon voient ce qu'ils veulent : leurs discours seront utiles comme dérivations ; ils sont vains et absurdes pour tout ce qui concerne la science expérimentale.
[FN: § 1653-1]
P. DHORME ; Choix de textes rel. Assyro-Babyloniens : « (p. X) Comment et par qui le monde a-t-il été fait ? Les diverses cosmogonies répondent à cette question. L'on reconnaît dans chacune d'elles l'influence du milieu où elle a pris naissance. L'intervention de la divinité est revêtue de traits plus ou moins mystiques qui servent à fixer la conception théologique dans les imaginations populaires [en vérité, c'est le contraire]. Le Poème de la création qui ouvre la série de nos textes est, à ce point de vue, d'intérêt majeur. Non content de rechercher la genèse du ciel et de la terre, il remonte au moment où „ aucun des dieux n'était créé “ et nous fait assister à une véritable théogonie. Par couples successifs [la personnification mâle et femelle fait rarement défaut] les dieux sortiront d'un couple primitif constitué par Apsou, l'océan qui entoure notre sol, et Tiâmat, la mer „ tumultueuse “, dont „ les eaux se confondaient en un “. (p. XI) ... si le „ Poème de la création “ est tout imprégné d'idées mythologiques et populaires, la „ Cosmogonie chaldéenne “ présente un récit de la création plus abstrait et théologique. Le monde sort encore de la mer, mais nous n’assistons pas à la naissance des dieux... (p. XII) Si, pour les Babyloniens, le dieu national Mardouk, est considéré comme l'auteur du monde et des hommes, il est tout naturel que les Assyriens aient confié ce rôle à Assour, leur dieu... Qu'il existât d'autres légendes relatives à la création, c'est ce que prouve le fragment sur la „ Création des êtres animés “, où nous voyons les dieux collaborer ensemble à la formation du ciel et de la terre. À côté de ces cosmogonies savantes et traditionnelles circulaient d'autres hypothèses sur les origines du monde. Il en est qui rentrent dans le folklore général... ».
[FN: § 1656-1]
FOURIER ; Théor. des quatre mouv. : « (p. 57) C'est pour Dieu une jouissance que de créer, et il va de son intérêt de la prolonger ». C'est là simplement un récit dépourvu de métaphores ; mais ensuite, il suscite une analogie à l'esprit : « Si les temps de conception, gestation et enfantement d'un homme, emploient une durée de neuf mois, Dieu dut employer un espace de temps proportionnel pour créer les trois règnes ». Suit un récit arbitraire : « La théorie évalue ce temps à la cent quatre-vingt-douzième partie de la carrière sociale, ce qui donne approximativement quatre cent cinquante ans pour la durée de la première création ». Puis vient un passage où s'entremêlent métaphores, analogies, récits, sans que l'auteur paraisse le moins du monde distinguer ces choses différentes. (p. 57) Toute création s'opère par la conjonction d'un fluide boréal, qui est mâle, avec un fluide austral, qui est femelle. [En note : ,, L'astre peut copuler : 1° avec lui-même de pôles nord et sud, comme les végétaux ; 2° avec un autre astre par versements tirés de pôles contrastés ; 3° avec intermédiaire : La Tubéreuse est engendrée de trois arômes : Terre-Sud, Herschel-Nord et Soleil-Sud “]. Une planète est un être qui a deux âmes et deux sexes, et qui procrée comme l'animal ou végétal par la réunion de deux substances génératrices. Le procédé est le même dans toute la nature... »
[FN: § 1659-1]
Relig. Saint-Simonienne, Réunion générale de la famille : (p. 69) Lorsque Eugène et moi, nous jetâmes les premières bases du dogme trinaire, sous sa forme théologique, nous n'avions pas compris encore combien ce dogme avait été profondément SENTI par SAINT-SIMON dans le NOUVEAU CHRISTIANISME. Votre père RODRIGUES était le seul qui nous répétât sans cesse que ce livre renfermait l'enseignement le plus élevé qu'il fût donné à l'homme de recevoir. Et nous, conduits par nos travaux à faire des recherches sur la constitution scientifique du dogme trinaire chrétien, sur celle des dogmes anciens, nous justifiâmes bientôt à nos propres yeux ce problème de la trinité, comme étant le plus élevé que l'homme puisse se poser. L'un de nous laissa échapper cette phrase, qui fut depuis répétée dans les Lettres d'Eugène : Qui ne comprend pas la Trinité ne comprend pas Dieu. Ce mot fut une vraie révélation pour la doctrine. Tous ceux qui l'entendirent, et en particulier votre père RESSÉGUIER, eurent peine à en comprendre la portée. C'est alors seulement qu'en relisant le NOUVEAU CHRISTIANISME, nous reconnûmes que l'idée de la Trinité y était reproduite à toutes les pages, sous une foule de formes différentes, telles que celles-ci : MORALE, Dogme, Culte ; BEAUX-ARTS, Science, Industrie. Nous nous étonnions d'avoir passé si longtemps devant ce problème éternel de l'humanité, sans nous être aperçus qu'il devait être résolu par nous : en même temps toutes les phrases, toutes les indications qui ne nous avaient pas (p. 70) frappés à l'époque du Producteur, nous affermissaient, Eugène et moi, dans la croyance que notre formule du dogme panthéiste trinaire était la vraie formule Saint Simonienne ». Les termes soulignés le sont ainsi dans le texte.
[FN: § 1660-1]
EINHARDI historia translationis beatorum Christi martyrum Marcellini et Petri, c. IV. Eginhard raconte comment, parti de la basilique où reposaient les cendres des saints Marcellin et Pierre, il se mit en route pour se rendre à la Cour. Parvenu en un certain lieu, près du Rhin, il lui arriva l'aventure suivante : « (44) Après le souper, qui avait pris une partie de la nuit, je m'étais retiré avec mes gens dans la chambre où je devais me reposer, lorsque le serviteur qui nous versait habituellement à boire, entra tout à coup, comme s'il avait à raconter quelque nouvelle. L'ayant regardé : „ Qu'as-tu à raconter, dis-je ? car tu me sembles avoir je ne sais quoi à nous annoncer “. – Alors : „ Deux miracles – dit-il – ont été faits devant nous ; c'est pour vous les rapporter que je suis venu “. Et comme je lui demandai de dire ce qu'il voulait : „ Lorsque ayant quitté le repas, dit-il, tu entras dans la chambre, moi, je descendis avec mes compagnons au garde-manger qui est sous la salle à manger. Là, tandis que nous nous mettions à donner de la bière aux serviteurs qui nous en demandaient, survint un serviteur envoyé par l'un de nos compagnons, et apportant une cruche qu'il priait de remplir. Quand ce fut fait, il demanda qu'on lui donnât, à lui aussi, un peu de cette bière, pour la boire. On lui en donna dans un vase qui se trouvait, par hasard, vide, sur le tonneau où était la bière. Mais comme il l'approchait de ses lèvres pour boire, il s'écria, avec une grande surprise, que c'était du vin et non de la bière. Et comme celui qui avait rempli la cruche et qui avait tiré du même robinet ce qui avait été donné au domestique, se mit à l'accuser de mensonge : „ Prends, dit-il, et goûte ; tu verras alors que je n'ai pas dit ce qui est faux, mais bien ce qui est vrai. “ L'autre prit alors, goûta et témoigna de même que ce liquide avait le goût de vin, non de bière. Alors un troisième et un quatrième et les autres qui étaient là chacun goûtant et s'étonnant, ils burent tout ce qui était dans le tonneau. Chacun de ceux qui goûtèrent attesta que le goût était celui du vin et non de la bière “ ». Suit le récit d'un autre miracle : celui d'un cierge qui, tombé d'abord sans que personne ne le touchât, et éteint, se ralluma de lui-même ensuite spontanément, une fois qu'on eut invoqué les saints Marcellin et Pierre. Puis, l'auteur dit : « (45) J'ordonnai à celui qui m'avait raconté ces choses de se retirer dans sa chambre. Quant à moi, m'étant mis au lit pour me reposer, je commençai, en roulant une foule de pensées dans ma tête, à rechercher tout en m'émerveillant, ce que signifiait ou pouvait présager cette transformation de bière en vin, c'est-à-dire d'un liquide inférieur en un autre, meilleur ; ou bien pourquoi ce prodige s'était accompli de cette façon, en ce lieu, c'est-à-dire dans une maison royale, plutôt que là où reposaient les très saints corps des saints martyrs qui avaient opéré ces miracles par la vertu du Christ. Mais bien que je le recherchasse longuement et soigneusement, il ne me fut pas donné de résoudre la question avec certitude ; toutefois je tins, et je tiendrai toujours pour certain, que cette divine et suprême vertu, grâce à laquelle, on l'admet, ces miracles et d'autres semblables se produisent, ne fait jamais rien ou qu'elle ne permet pas qu'il se produise quoi que ce soit sans cause, dans les créatures qui, je n'en doute pas, sont confiées à sa providence et à son gouvernement ».
[FN: § 1662-1]
D. CYPRIAN. ; Ad. Caecilium, De sacramento Domini calicis : ...Christus autem docens et ostendens gentium populum succedere, et in locum quem Iudaei perdiderant, nos postmodum merito fidei pervenire, de aqua vinum fecit, id est, quod ad nuptias Christi et Ecclesiae, Iudaeis cessantibus, plebs magis gentium conflueret, et conveniret, ostendit.
[FN: § 1664-1]
D. CYPRIAN. ; De unitate ecclesiae: Idcirco et in columba venit Spiritus sanctus. Simplex animal et laetum est, non felle amarum, non morsibus saevum, non unguium laceratione violentum : hospitia humana diligere, unius domus consortium nosse, cum generant simul filios edere, eum commeant volatibus invicem cohaerere, etc. – D. AUGUST. ; De symbolo, sermo ad catechumenos, X, 20 : Ita et Spiritus in columba apparuit, sed non columba erat Spiritus. Ainsi, on ménage la chèvre et le chou ; c'était et ce n'était pas une colombe. Ensuite, on peut pousser plus avant, et voir dans la colombe une simple allégorie.
[FN: § 1670-1]
Le texte grec est donné dans la note 1646-1. L'ancien traducteur latin l'interprète ainsi : (Iraen., I, 1) Prolationem hanc praemitti volunt, et eam deposuisse quasi in vulva eius quae cum eo erat Sige. Hanc autem suscepisse semen hoc, et praegnantem [comment donc une abstraction pourrait-elle bien devenir enceinte ? Tous ces termes se rapportent à la femme] factam generasse Nan... – TERTULL. ; Adt. Valent., VII : Hoc vice seminis in Sigae suae veluti genitalibus vulvae locis collocat. Suscipit illa statim et praegnans efficitur et parit... Il paraît que tous les valentiniens n'étaient pas tous du même avis. – Philosoph. ; VI, 2, 29 : On trouve beaucoup de différences entre eux. Afin de conserver intact en toutes ses parties le dogme pythagoricien de Valentin, quelques-uns d'entre eux estiment que le Père est sans sexe, sans conjoint et seul. D'autres, estimant impossible que toutes les choses engendrées tirent leur origine d'un mâle seul, donnent nécessairement Sigè (le Silence, f) comme épouse au Père de toute chose, afin qu'il puisse engendrer ».
[FN: § 1672-1]
PIEPENBR. ; Théol. de l'anc. test. : (p. 129) 4° Le maleach de Dieu. Si le Dieu révélé est identifié avec la gloire, le nom ou la face de Dieu, il l'est également avec le maleach, c'est-à-dire, d'après la traduction ordinaire, avec l'ange de Dieu ou de Jéhova. ...Il est facile de se convaincre qu'il existe une grande analogie entre le maleach de Dieu et sa face... (p. 120) L'analogie qui existe entre le maleach de Dieu et sa face explique parfaitement l'identification du maleach avec Dieu lui-même... Il existe pourtant des passages où Dieu et son maleach sont distingués l'un de l'autre, comme s'ils étaient deux personnes différentes. L'identification et la distinction se trouvent une fois dans le même récit. Un ange de Jéhova, appelé aussi homme de Dieu, apparaît aux parents de Samson (Jug., 13, 3, 6 et sv.) ; il est nettement distingué de Jéhova (V, 8 et sv., 16, 18 et sv.) ; et cependant, après sa disparition, Manoha dit à sa femme : Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu (V, 22). Les théologiens se sont beaucoup occupés de la question de savoir ce qu'est en réalité le maleach de Dieu ; mais ils sont arrivés à des résultats très divergents. » Il ne peut en être autrement, lorsqu'on cherche une chose objective là où il y en a seulement beaucoup de subjectives. – DUGAS-MONTBEL, Obs. sur l'Iliade, III, 105-6, observe qu'Homère dit : « Amenez la force de Priam pour : amenez Priam. C'est ainsi qu'Homère dit, la force herculéenne, ![]() pour Hercule. Cette tournure est fréquente dans Homère. Plusieurs autres poètes l'ont imitée de lui... Les Latins ont des tournures analogues ; c'est-à-dire qu'ils employaient une qualité distinctive de la personne pour exprimer la personne elle-même... C'est de là que nous sont venues sans doute ces manières de parler usitées dans nos langues modernes : sa majesté, son éminence, sa grâce, son altesse, etc. »
pour Hercule. Cette tournure est fréquente dans Homère. Plusieurs autres poètes l'ont imitée de lui... Les Latins ont des tournures analogues ; c'est-à-dire qu'ils employaient une qualité distinctive de la personne pour exprimer la personne elle-même... C'est de là que nous sont venues sans doute ces manières de parler usitées dans nos langues modernes : sa majesté, son éminence, sa grâce, son altesse, etc. »
[FN: § 1673-1]
Essai d'une Philosoph. de la Solid., p. 38 : « Je le répète, nous ne changeons rien à ces principes généraux de la morale et du droit ; mais, suivant un terme que j'ai retenu et qui exprime admirablement ce qui est dans notre pensée, les notions que nous avons tirées de la constatation de l'interdépendance entre les hommes, remplissent – c'est le mot employé par M. Darlu – remplissent d'un contenu tout nouveau l'idée morale ». Donc, on ne change rien aux principes généraux de la morale, et cependant l'idée morale est remplie d'un contenu tout nouveau. S'il est nouveau, il semblerait que l'ancien doit avoir été changé ; et s'il n'est pas changé, comment peut-il être nouveau ? Bien malin qui y comprend quelque chose. L'auteur explique ensuite : « Il y a dans ces faits quelque chose qui précise et qui étend les anciennes notions du droit, du devoir, de la justice ». Donc on dit que rien n'y a été changé, et voilà un changement, qui consiste justement dans la dite extension.
[FN: § 1676-1]
Ce parce que et les suivants doivent s'entendre comme désignant des causes importantes, mais non exclusives. Cette manière elliptique de s'exprimer et d'autres semblables sont indispensables pour éviter des longueurs fastidieuses ; mais elles ne peuvent jamais être très précises. On ne court pas le danger de tomber dans l'erreur, si l'on garde toujours présent à l'esprit le fait de la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux.
[FN: § 1683-1]
Pourtant il en reste encore quelques traces, dues à ce que les personnes qui s'occupent des sciences naturelles, vivant dans le même milieu que les autres hommes, ne peuvent se soustraire entièrement à l'influence des oscillations qui agitent ce milieu. Ainsi, actuellement, on observe, dans les théories de la mécanique, un retour offensif de la métaphysique. La théorie dite du principe de relativité en est entachée. Elle peut être un instrument de recherches, elle n'est certes pas un moyen de démonstration. Voir, par exemple, LÉMERAY ; Le principe de relativité, Paris, 1916. L'auteur expose un cas hypothétique de deux observateurs en mouvement, échangeant des signaux au moyen de pigeons voyageurs, et il ajoute : « (p. 28) Or, ce que nous venons de conclure pour les pigeons, le principe se refuse de l'admettre pour la lumière [il ne reste donc qu'à se soumettre à la volonté de monsieur le principe]. En effet, les deux relations (1) nous font connaître T1, et T2 en fonction de T et de v ; nous pourrions décider lequel des observateurs serait en repos par rapport à l'espace, ce qui n'aurait aucun sens [C’est précisément ce qu'on disait autrefois de plusieurs phénomènes qu'on connaît aujourd'hui], de même que dans le cas des pigeons, les relations (1) nous font savoir quel est l'observateur immobile par rapport à la terre... » Ce raisonnement est du même genre que celui de bien d'autres raisonnements métaphysiques dont nous avons cité quelques exemples (§ 492 à 506) ; on y a seulement ajouté des développements mathématiques ; mais ceux-ci ne peuvent pas, à eux seuls, donner de la réalité aux hypothèses qui en manquent. Parmi les conséquences du principe de relativité, nous trouvons « (p. 31) que différents observateurs d'un système [un des deux systèmes en mouvement] voyant passer un même observateur de l'autre système le verront vieillir moins vite qu'eux ; et un observateur voyant passer successivement les différents observateurs de l'autre, les verra vieillir plus vite ». Le système où l'on est vu vieillir moins vite sera fréquenté surtout par les dames : il y aura encombrement. Il est évident que lorsque l'on se permet de telles excursions en dehors du monde expérimental, on peut démontrer tout ce que l'on veut.
[FN: § 1684-1]
SINNETT ; Le bouddh. ésot. : « (p. 71) Quel instinct prophétique inspirait Shakespeare, lorsqu'il prit le nombre sept comme celui qui convenait le mieux à sa fantastique classification des âges de l'homme ? C'est, en effet, par périodes de sept que se partage l'Évolution des races humaines, et le nombre actuel de mondes, qui constitue notre système, est également de sept. N'oublions pas que la Science occulte est aussi sûre de ce fait, que la science physique est sûre des sept couleurs du spectre solaire et des sept notes ou tons de la gamme. Il y a sept règnes dans la nature, et non pas trois, comme l'enseigne à tort la science moderne... (p. 72) ...il faut sept rondes pour que les destinées de notre monde soient accomplies. La Ronde dont nous faisons partie actuellement est la quatrième... Une monade individuelle, arrivant pour la première fois, sur une planète, pendant le cours d'une Ronde, doit travailler à la rude besogne de la Vie, dans sept races, sur cette même planète, avant de passer sur une planète voisine, et chacune de ces races dure un temps considérable ». Que ces messieurs savent de belles choses ! Mais les néo-hégéliens nous disent qu'il « n'existe pas de pensée qui soit une erreur » (§ 1686-1) ; donc, la « pensée » de ces bouddhistes ne peut être une erreur. Et si quelqu'un affirmait, au contraire, qu'une telle « pensée » est erronée, et voulait la remplacer par la pensée néo-hégélienne, qui donc pourrait trancher la question ?
[FN: § 1685-1]
RENAN ; L'Egl. chr. :« (p. 175) Il y a sûrement quelque chose de grand dans ces mythes étranges [au lieu de cette assertion objective, on devait dire : il y a des gens qui trouvent quelque chose de grand dans ces mythes, et ceux qui les tiennent pour de vaines absurdités doivent pourtant tenir compte de cette opinion]. Quand il s'agit de l'infini, de choses qu'on ne peut savoir que partiellement et à le dérobée, qu'on ne peut exprimer sans les fausser [divagation pour faire semblant de revenir au domaine expérimental, tandis qu'on demeure en dehors], le pathos même a son charme [oui pour certaines personnes ; non pour d'autres] ; on s'y plaît comme à ces poésies un peu malsaines, dont on blâme le goût, mais qu'on ne peut se défendre d'aimer [c'est peut-être vrai pour Renan et pour qui pense comme lui ; c'est faux pour Lucien, par exemple, et pour qui pense comme lui ; c'est l'erreur habituelle de donner pour objectif ce qui est subjectif]. L'histoire du monde, conçue comme l'agitation d'un embryon qui cherche la vie, qui atteint péniblement la conscience, qui trouble tout par ses agitations, ces agitations elles-mêmes devenant la cause du progrès et aboutissant à la pleine réalisation des vagues instincts de l'idéal, voilà des images peu éloignées de celles que nous choisissons par moments pour exprimer nos vues sur le développement de l'infini ». Qui est ce nous ? Certainement pas tous les hommes : il y en a tant qui ne se soucient pas du « développement de l'infini » ; tant d'autres qui ne savent pas ce que peut bien être ce monstre ; tant d'autres qui rient rien qu'à l'entendre nommer.
[FN: § 1686-1]
La Voce, 28 gennaio 1914. V. FAZIO-ALLMAYER écrit une analyse de l'ouvrage La Riforma della dialettica hegeliana, de GIOVANNI GENTILE « (p. 41) Sa philosophie [de Gentile] est une philosophie vivante ; c'est une vision éthique du monde ; c'est pourquoi il n'a pas même éprouvé le besoin d'éclaircir cette signification de l'identité de l'histoire et de la philosophie. La philosophie qui est identique à l'histoire est la philosophie qui est vie, et la vie est la vie éthique, et la vie éthique est la réalisation de la liberté, et la liberté est l'affirmation du réel comme auto-conscience. (p. 42) La thèse fondamentale, en cette nouvelle histoire, est que la pensée est acte, c'est-à-dire concrétisation, et que par ce fait il n'existe pas une pensée qui soit erreur ni une nature qui ne soit pas pensée. La pensée acte, actualité de la pensée, idéalisme actuel, sont désormais des termes que chacun croit comprendre facilement [oh non ! il y a tant de gens auxquels il semble vraiment impossible de rien comprendre à tous ces termes mis ensemble], mais qui malheureusement se trouvent épars et privés de sens dans le monde philosophique d'aujourd'hui. La facilité avec laquelle on croit les avoir critiqués en est un signe ».
[FN: § 1686-2]
Histoire ou fable, on raconte qu'un jour l'académicien Népomucène Lemercier répondit à une dame de la halle qui l'injuriait : « Tais-toi, vieille catachrèse » À l'ouïe de ce mot si terrible, la mégère resta interdite et ne sut que répondre.
[FN: § 1686-3]
Un seul exemple suffira, parmi un très grand nombre qu'on pourrait citer. V. FAZIO-ALLMAYER, dans La Voce, 19 déc. 1912 « (p. 960) Hegel a distingué : la logique, l'histoire de la philosophie, la philosophie de l'histoire. Il a ainsi distingué Dieu, l'esprit humain, le monde des nations. Ainsi, l'immanence et la liberté ne sont pas vraiment conquises, parce qu'elles se conquièrent seulement si le monde des nations et le monde humain dans leur développement, c'est-à-dire dans leur autocréation, sont la création de Dieu même, l'être absolument existant, la liberté ». Jusqu'ici, c'est un discours incompréhensible. La suite se comprend : « Et Hegel voulait démontrer proprement cela. S'il n'y a pas réussi, cela ne veut pas dire que l'entreprise soit à abandonner ; cela signifie simplement qu'il faut y travailler encore. Et nous devons y travailler, nous autres Italiens ». Ici apparaît le caractère habituel des dérivations métaphysiques : on connaît le point auquel la démonstration doit aboutir, et l'on ne cherche que cette démonstration. On ne voit pas bien comment l'auteur fait pour savoir que sa proposition subsiste, si ni Hegel ni d'autres ne l'ont démontrée jusqu'à présent. Serait-ce un article de foi ?
[FN: § 1686-4]
Dans La Voce, 19 décembre 1912, G. NATOLI écrit « (p. 963) Peu d'auteurs ont autant que Croce provoqué, si tôt après la publication de leurs ouvrages, en même temps que l'admiration, un sentiment indéfini de mécontentement et une vague, une presque abstraite volonté de dépassement (superamenio). Et en faveur de Croce, lui-même, ces considérations sur le dépassement (superamento), qu'il nous donna, il y a quelque temps, dans La Voce, ainsi que peut le faire un auteur d'un si grand talent, trouveraient leur application très à propos contre l'attitude de ses dépasseurs (superatori) ». Ces beaux termes : dépasseurs, dépassement, ont tout autant de sens que le « funiculi, funicula » de la chanson napolitaine ; mais la chanson est plus agréable.
[FN: § 1686-5]
G. PLATON, dans L'Indépendance, février 1913 : « (p. 85) Que M. Sabatier s'exalte au spectacle de l'histoire : qu'il s'écrie, tout plein de contentement et tout plein de lui-même (SABATIER ; L'orientation religieuse de la France actuelle) : „ (p. 153 *) Nous avons introduit la notion de la Vie dans l'histoire et cette simple introduction de la Vie dans l’Histoire la socialise dans toutes les directions, fait d'elle une philosophie, une morale, une religion [encore une chose qui n'a pas de sens], la base par excellence de l'éducation individuelle et de l'éducation politique ; “ ou encore : „ (p. 156*) Nous sommes de la Vérité, de la Vie, de la Révélation, ou : „ (p. 159 *) L'Église nous avait parlé de la tradition et de sa valeur dans l'enseignement religieux ; la vie nous en découvre la puissance dans tous les domaines ; et, en nous montrant ce que nous sommes, nous suggère ce que nous devons et ce que nous pouvons devenir “. Que M. Sabatier s'exalte, nous n'y trouvons pas à redire : c'est de l'esthétisme ! Qu'il prétende faire „ de l'histoire une philosophie, une morale, une religion “, c'est une autre affaire, et c'est justement la question qui s'agite entre lui et la papauté. La thèse (p. 86) de cette dernière c'est justement que c'est l'histoire qui a besoin d'une philosophie, d'une morale, d'une religion, pour être une histoire acceptable ; une histoire digne de l'homme et de l'humanité ». La science logico-expérimentale demeure entièrement étrangère à cette controverse, ne serait-ce que parce qu'il manque un juge qui la tranche (§ 17 et sv.). Outre les deux genres d'histoire indiqués tout à l'heure, il en est un troisième, dont la science expérimentale s'occupe uniquement, et qui a pour but exclusif de décrire les faits et d'en rechercher les uniformités. Prenons bien garde que notre but est de séparer, non pas de comparer. Nous ne disons nullement que ce troisième genre soit meilleur que les deux autres ; pour nous, cette proposition n'aurait même aucun sens. Nous disons seulement qu'il nous plaît de nous occuper de ce troisième genre. Si quelqu'un d'autre a aussi ce dessein, il peut faire route avec nous, et s'il n'a pas ce dessein, qu'il cherche une autre compagnie, et allons chacun de notre côté. Le lecteur observera que Vie est écrit avec une lettre parfois majuscule, parfois minuscule. Les choses auxquelles correspondent ces deux termes pourraient donc être différentes. Mais quelle est cette différence, je ne saurais le dire... et peut-être l'auteur qui emploie ces termes ne le sait-il pas non plus. Mais je suppose que la Vie à laquelle on fait l'honneur d'une, majuscule, doit être meilleure que la vie qui est privée de cette majuscule. Peut-être y a-t-il une différence analogue entre Histoire et histoire. Quant à la Vérité, c'est pour nous une vieille connaissance ; nous l'avons souvent rencontrée en ces dernières pages. C'est une entité qui n'a rien de commun avec la vérité expérimentale, mais qui est d'une nature si sublime que sa beauté surpasse toute chose.
* Les nombres indiqués avec cet astérisque sont ceux des pages du livre de Sabatier, cité dans le texte de l'Indépendance.
[FN: § 1686-6]
RABELAIS ; édit. Jacob, Paris, 1854, p. 110 à 113.
[FN: § 1686-7]
Par exemple, on pourrait supposer le dialogue suivant : « Deux et deux font cinq. – Pardon, je croyais que cela faisait quatre. – Désormais, cette théorie est dépassée. C'est une doctrine „ renfermée dans la formule chimique de la préparation solidifiante et congelante “. – Je ne comprends pas. – Cela ne fait rien. Vous avez mécanisé, matérialisé l'addition, et vous vous contentez d'un mesquin formalisme de calcul. – Excusez-moi, j'y comprends encore moins qu'avant. –Je m'explique mieux. L'addition de deux et deux qui font quatre est morte : elle gît dans la stase de la pensée ; nous voulons une addition vivante qui avec la dynamique, s’élève à l'œuvre plus haute de la pensée humaine “ ; et „ pour typiser (tipizzare) un peu l'histoire “… » – Dieu nous soit en aide, si maintenant ce typiser vient à la rescousse !
Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305 ↩
[FN: § 1689-1]
Pour justifier l'interdiction signifiée au Monténégro d'occuper Scutari, un communiqué officiel du gouvernement russe s'exprime ainsi : « Du reste, la population de Scutari est en majorité albanaise et cette ville est le siège d'un évêché catholique. Il faut remarquer aussi à ce propos que les Monténégrins ont été incapables d'assimiler plusieurs milliers d'Albanais catholiques ou musulmans qui sont établis sur les frontières du Monténégro ». Remplacez, dans ce raisonnement, Monténégro par Russie, Albanie par Pologne, et il conservera toute sa valeur. La Russie est orthodoxe, la Pologne catholique. La Russie a été, incapable de s'assimiler les Polonais. Mais bien que le raisonnement soit identique, les conclusions changent : le Monténégro n'a pas le « droit » d'occuper Scutari ; la Russie a le « droit » d'occuper la Pologne.
[FN: § 1689-2]
C'est cela seul que nous voulons exprimer, quand nous disons que le « droit naturel », n'existe pas. En d'autres termes, nous voulons dire que cette entité ne peut pas faire partie de raisonnements d'une façon semblable à celle dont en font partie le chlorure de sodium ou d'autres choses analogues. Mais nous n'entendons nullement faire nôtres, comme étant équivalentes à cette assertion, ou comme en étant la conséquence, les propositions suivantes : La notion de droit naturel n'existe pas dans l'esprit de certains hommes. Cette notion ne joue aucun rôle dans la détermination de la forme de la société. Il serait utile aux hommes de s'en débarrasser, parce que c'est une notion de chose vaine et insaisissable. Nous estimons, au contraire, que des propositions opposées à celles-ci concordent avec les faits. C'est-à-dire : la notion de droit naturel existe (se trouve), bien qu'indéterminée, dans l'esprit de certains hommes. Cette notion (ou mieux : le fait que cette notion se trouve dans l'esprit de certains hommes) joue un rôle dans la détermination de la forme de la société. En beaucoup de cas, le fait que cette notion se trouve dans l'esprit de certains hommes a été utile à la société. Nous ajoutons que la croyance en l'existence du droit naturel (ou la croyance qu'il peut jouer dans le raisonnement un rôle identique à celui que jouent des notions semblables à celles du chlorure de sodium) a été souvent utile à la société, bien qu'elle soit en complet désaccord avec les faits.
[FN: § 1689-3]
Les métaphysiciens et les économistes littéraires ont découvert une belle dérivation pour répondre aux objections de cette sorte. Ils disent que les « lois » économiques, morales, sociales, diffèrent des « lois naturelles », en ce que les premières souffrent des exceptions, et que les dernières n'en ont pas. Ne nous arrêtons pas à cette considération qu'une « loi » à exceptions, c'est-à-dire une uniformité non uniforme, n'a pas de sens (§101), et ne prêtons notre attention qu'à la force du raisonnement. Il faut reconnaître que, dans la forme, elle l'emporte. En effet, si l'on accorde à celui qui énonce une loi que celle-ci peut avoir des exceptions, à chaque fait qu'on lui opposera, il pourra toujours répondre que c'est une « exception » ; et il sera impossible de le prendre en faute. C'est bien ainsi que les économistes littéraires, les moralistes, les métaphysiciens, énoncent des « lois », dont ils font ensuite ce qu'ils veulent, les pliant à leur volonté et à leur caprice, grâce à l'indétermination des termes, aux exceptions et à d'autres subterfuges. Malheureusement pour leur thèse, de cette façon ils ont même trop raison : une loi de ce genre ne signifie rien, et il est inutile de la connaître. Quelqu'un peut dire qu'il pleut seulement les jours de date paire, et objecter aux observations contraires que ce sont des exceptions. Quelqu'un d'autre peut affirmer qu’il ne pleut, au contraire, que les jours de date impaire, et répondre de la même manière aux objections. En raisonnant de cette façon, tous deux ont raison, et aucun d'eux ne nous apprend quoi que ce soit. Pour que nous apprenions quelque chose, il faut qu'il y ait quelque obstacle, quelque restriction à la libre adaptation de ces « lois » ; qu'on affirme, par exemple, que les faits contraires sont en beaucoup plus petit nombre que les faits favorables ; que l'énoncé ait quelque précision, en sorte qu'il puisse être interprété par d'autres personnes que par l'auteur ; que les conditions réputées nécessaires à la vérification de la loi soient au moins mentionnées, et ainsi de suite.
[FN: § 1690-1].
De même, l'économie pure emploie le terme ophélimité, la mécanique le terme force, qui, dans leurs rapports avec l'équilibre économique ou avec l'équilibre mécanique, correspondent au terme sentiment (résidu) dans ses rapports avec l'équilibre social. La théorie des choix, donnée dans le Manuel, correspond aux observations faites tout à l'heure, pour éliminer le terme sentiment (§2404).
[FN: § 1690-2]
Entre les expressions D et les actes A, il peut y avoir un rapport direct DA, et c'est même le seul que supposent ceux qui réduisent tout phénomène social à des actions logiques. Mais en réalité, le rapport est habituellement différent ; c'est à-dire qu'il provient d'une origine O commune aux expressions et aux actes. À cette commune origine, qui nous est généralement inconnue, on peut donner le nom de « sentiment », d' « état psychique » ou un autre analogue. Mais attribuer un nom à une chose inconnue ne sert nullement à nous la faire connaître. On pourrait encore supposer que D sont les résidus, A les dérivations, et répéter les observations précédentes. Résidus et dérivations ont une commune origine O, qui nous est inconnue. Pour trouver les résidus, nous avons établi théoriquement un rapport AD ; puis, pour déduire des résidus les dérivations, nous avons établi de la même manière le rapport DA ; mais le rapport effectif est OD, OA. Revenant aux analogies indiquées précédemment (§879) de la langue avec les autres faits sociaux, nous pouvons supposer que D sont les racines et A les mots de la langue. D'une manière semblable à ce qui a été dit pour les résidus et les dérivations, le philologue pose théoriquement un rapport AD, en déduisant des mots les racines, puis, de la même manière, un rapport DA, en déduisant des racines les mots. Mais, en pratique, les langues n'ont pas été constituées en déduisant des racines les mots ; en revanche, quand elles sont constituées, cela peut arriver quelquefois par le fait des grammairiens ou des hommes de science. En général, les mots sont nés spontanément dans le peuple, et la même force qui les produisait faisait naître en même temps les racines ; c'est-à-dire qu'on avait effectivement le rapport OA, OD. Parfois, comme dans le cas des onomatopées, nous réussissons à avoir quelque idée de l'origine O d'une famille de mots A et de sa racine D ; mais, dans le plus grand nombre des cas, cette origine nous est parfaitement inconnue ; nous connaissons seulement la famille de mots, et les philologues en tirent la racine. On a fait des études sur l'« origine » des langues, études qui visaient à découvrir O, mais jusqu'à présent, elles n'ont servi à rien, ni à la grammaire ni au vocabulaire, qui ont au contraire tiré profit de la connaissance des racines. Par exemple, dans la langue grecque, la grammaire et le vocabulaire s'arrêtent aux racines, et n'auraient pas même pu être constitués scientifiquement si, pour ce faire, on avait voulu attendre de connaître les « origines ». De même, en sociologie, il peut y avoir des cas où nous acquérons une connaissance, peut-être lointaine et imparfaite, de l'origine O, tant des résidus D que des dérivations ou des actes A ; mais, dans le plus grand nombre des cas, nos connaissances sont semblables à celles du philologue : nous ne connaissons que les dérivations ou les actes A. Théoriquement, nous en déduisons les résidus D ; puis, réciproquement, des résidus D nous déduisons les dérivations et les actes ; c'est-à-dire que nous attachons notre esprit aux rapports AD et DA ; mais, effectivement, le rapport est OA, OD. Un très grand nombre d'études de sociologie sont semblables à celles qui ont été faites pour déceler les « origines » des langues, c'est-à-dire qu'elles eurent en vue de trouver l'« origine » des phénomènes sociaux, et profitèrent peu à la science. Tâchons maintenant de constituer celle-ci, en nous arrêtant aux résidus, de même que le philologue s'arrête aux racines, de même que le chimiste s'arrête aux corps simples ; de même, que celui qui étudie la mécanique céleste s'arrête à l'attraction universelle, etc. Quant à la manière de nous exprimer, lorsque nous disons elliptiquement que les résidus déterminent les actes, nous substituons, pour faciliter l'exposé, le rapport DA, qui n'est que théorique, au rapport pratique OA, OD. Nous opérons comme le philologue quand il dit qu'une famille de mots A tire son origine d'une racine D, ou quand il dit que certains temps des verbes se forment du radical de l'indicatif, certains autres du radical de l'aoriste, etc. Personne n'a jamais entendu cela au sens que les Grecs s'étaient assemblés, un jour, pour fixer certains radicaux des aoristes, et avaient ensuite déduit de ces radicaux les formes verbales des aoristes. On ne doit pas davantage tirer une conséquence semblable de la proposition suivant laquelle les résidus déterminent les actes.
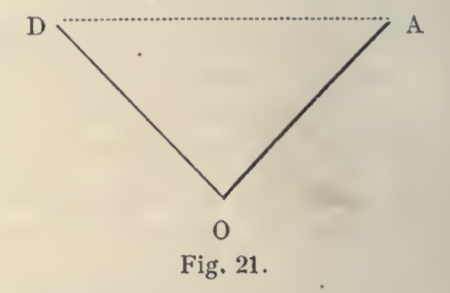
Figure 21
Si l'on avait suivi la voie déductive, la matière traitée en cette note aurait dû faire partie du texte et se trouver au commencement de l'ouvrage. Mais à cette place, elle aurait été difficilement comprise, à cause de sa nouveauté. La voie déductive convient spécialement à des doctrines déjà en partie vulgarisées et connues ; lorsqu'il s'agit de sujets entièrement nouveaux, seule la voie inductive permet de préparer le lecteur à les bien saisir et comprendre. C'est pour cela que l'on trouve la voie inductive employée en des traités tels que la Politique d'Aristote, les œuvres politiques de Machiavelli, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations de Adam Smith, et autres ouvrages analogues de tous genres.
[FN: 1691-1].
La difficulté provient de l'ambiguïté du terme fort, qui peut qualifier l'intensité d'un résidu, chez un individu, comparée à celle des autres résidus du même individu, ou bien comparée à l'intensité du même résidu, chez d'autres individus.
[FN: § 1695-1]
Nous en avons déjà cité de nombreux exemples. En voici un autre, qui peut servir de type à une classe très étendue et dans lequel nous voyons employer des dérivations qui s'appliquent à une infinité de cas, en général. En Suisse, l'usage de l'absinthe a été prohibé. Les fanatiques de la tempérance récriminaient parce que les magistrats ne se montraient pas très sévères dans la répression des contraventions. Un journal écrit à ce propos : « Sous le régime de la monarchie absolue, la volonté d'un seul est imposée à une nation tout entière. Cette volonté unique peut froisser le sentiment du peuple ; elle peut heurter des traditions et des habitudes légitimes ; elle peut être arriérée ou au contraire en avance sur l'époque à laquelle elle se manifeste. Lorsqu'une divergence de vues existe entre un monarque et son peuple, l'application de la loi est difficile. Il en est tout autrement dans une république. Le souverain, c'est le peuple. Ses magistrats ne lui sont pas imposés : il les choisit lui-même. Et, sous le régime de la démocratie directe, qui est le nôtre, les citoyens décident eux-mêmes les principes constitutionnels qui régissent le pays. La Constitution ne peut-être modifiée sans l'assentiment de la majorité des électeurs, qui sont toujours consultés à ce sujet. Les lois elles-mêmes, élaborées par les corps législatifs après des débats publics et dans les limites de la Constitution, ne deviennent obligatoires que si le peuple les a approuvées, tacitement ou formellement : il peut user de son droit de referendum. Il possède même le droit d'initiative législative. Toutes les dispositions de droit qui règlent les conditions de la vie sociale sont ainsi soumises au crible de la discussion publique. Seules prennent force de loi celles qui répondent à la volonté du peuple à l'époque où elles sont proposées. Les conceptions vieillies sont écartées; les réformes prématurées sont différées ; seuls sont imposés au respect de tous les principes constitutionnels et les lois qui ont trouvé grâce devant la majorité des électeurs ». Il faut observer ici différentes choses. 1° La négligence habituelle avec laquelle les religions considèrent les faits expérimentaux. Acceptons, pour un moment, la comparaison que l'on établit entre les mauvaises lois, c'est-à-dire les lois qui « froissent les sentiments du peuple, qui heurtent les traditions, etc. », qui sont propres aux monarchies absolues, à ce qu'il paraît, et les bonnes lois, c'est-à-dire les lois qui ne froissent pas les sentiments, qui ne heurtent pas les traditions, etc., qui, suivant l'auteur de cet article, sont propres aux démocraties. Il suit de là que le droit romain, tel qu'on le trouve dans les constitutions impériales, doit être très inférieur au droit athénien. Mais en est-il vraiment ainsi ? En France, la loi de 1790, établissant la constitution civile du clergé, ne pouvait donc pas froisser les sentiments du « peuple », ni heurter des traditions et des habitudes (légitimes), ni être en avance sur son époque. On apprend tous les jours quelque chose ; mais la révolte qui, sur une partie considérable du territoire, accueillit cette loi demeure inexplicable. Il faut pourtant remarquer que traditions et habitudes sont caractérisées par l'épithète : légitimes. Celle-ci, comme celle de vrai (§1562), sert de parachute. Si on ne peut nier que des traditions et des habitudes ont été heurtées, on en est quitte pour déclarer qu'elles ne sont pas légitimes ; et il est alors évident que les traditions et les habitudes légitimes ne peuvent pas être « heurtées ». 2° Le sophisme très usité, qui confond le « peuple » avec la « majorité du peuple », et pis encore avec la « majorité des votants ». En fait, la prohibition de l'absinthe n'a pas été votée par la majorité du peuple suisse, mais bien par la majorité d'une petite fraction de ce peuple, qui seule prit part à la votation. Comment ce nombre, bien moindre que la majorité du « peuple », devient-il égal à cette majorité. C'est là un mystère qui peut aller de pair avec celui de la très sainte Trinité. Comment la volonté de ce petit nombre se confond-elle avec la « volonté » du « peuple » entier, c'est là un autre mystère qui, tout en étant moins insondable que le précédent, demeure pourtant remarquable. On peut dire que ceux qui n'ont pas pris part à la votation ont eu tort. Cela se peut ; mais ce n'est pas la question. Qu'ils soient coupables tant qu'on voudra, et qu'il y ait d'excellentes raisons légales pour qu'on ne tienne pas compte de leur volonté : tout cela ne change pas une minorité du « peuple » en une majorité, et ne nous fait pas connaître non plus quel était effectivement la volonté de ceux qui ne l'ont pas exprimée, quel que fût leur tort. 3° La dérivation qui suppose que celui qui fait partie d'une collectivité peut être opprimé uniquement par un souverain absolu, et jamais par une majorité à laquelle il n'appartient pas. On ne peut trouver la raison de cette distinction qu'en un droit divin de la majorité, ou en quelque chose de semblable. Si un individu répugne absolument à faire une certaine chose, et si l'on fait abstraction des sentiments de révérence grâce auxquels il soumet sa volonté à celle d'autrui, que lui importe si cette chose lui est imposée par un empereur romain, par un roi du moyen âge, par un parlement ou par une autre autorité ? « Lorsqu'une divergence de vues existe entre un monarque et son peuple [sophisme habituel, par lequel on considère le peuple comme une unité] l'application de la loi est difficile ». Et quand cette divergence existe entre la majorité et la minorité ? « Il en est tout autrement dans une république » : les maux qui viennent d'être notés n'y existent pas. Vraiment ? Dans la république athénienne et dans la république romaine, l'histoire nous dit au contraire que de semblables maux ont été observés. C'est peut-être l'histoire qui a tort, de même que c'était la géologie qui avait tort contre la Bible. « Le souverain c'est le peuple ». Ne serait-ce pas plutôt sans parler des abus – la majorité des votants ? « Ses magistrats ne lui sont pas imposés : il les choisit lui-même ». Dans l'article, ce pronom il se rapporte, au peuple ; dans la réalité – toujours sans parler des abus – à la majorité souvent assez faible, des votants. 4° La dérivation d'après laquelle celui qui est contraint d'agir selon la volonté, de la majorité – si toutefois nous admettons que c'est elle qui fait les lois – agit selon sa volonté à lui, parce que cette volonté est celle du peuple dont il fait partie. Soit une collectivité de 21 individus ; 11 d'entre eux décident de manger les 10 autres. (Il s'est passé des faits semblables dans les naufrages.) Dirons-nous que cette décision « répond à la volonté du peuple » ? que le peuple est autophage, et que chacun des individus mangés devra aussi dire cela avant d'être mis à mort, et devra penser que la « volonté » du peuple est sa « propre volonté » ? 5° Dans le cas que nous examinons, et plus encore en un grand nombre d'autres, on voit apparaître une théorie semblable à celle de la contrition et de l'attrition (§1459) : c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le citoyen se soumette à la volonté de la majorité, par crainte des châtiments que celle-ci peut lui infliger : il doit aussi adorer cette divine volonté. – Comme d'habitude, pour éviter des équivoques, ajoutons que tout cela n'a rien à voir avec le problème essentiellement différent, qui recherche s'il peut être utile à la collectivité de faire croire au public que ces droits divins existent, et s'il est utile que le public en soit persuadé.
[FN: § 1695-2]
La Christian Science est une belle théorie, qui guérit peut-être toutes les maladies, et a certainement enrichi sa fondatrice, Mary Baker Eddy. Nous mettons sous les yeux du lecteur l' »explication » de la doctrine, que donne un auteur qui lui est favorable. Ainsi, nous évitons le danger de la travestir. – CHARLES BYSE : La science chrétienne : « (p. 22) Nous avons tous affaire à trois ennemis principaux : le péché, la souffrance et la mort. Non seulement ils nous menacent incessamment et parfois nous accablent, mais leur existence même est une énigme pour notre raison et un scandale pour notre foi. Comment, sous ces trois formes, le mal qui règne dans le monde peut-il remonter à la création ? Comment le concilier avec un Dieu tout bon et tout puissant ? Toutes les hypothèses auxquelles on a recouru pour résoudre cet angoissant problème montrent l'embarras des penseurs plus qu'elles ne satisfont l'intelligence. Survient Mme Eddy qui, d'un seul coup d'épée, tranche le nœud gordien. Ces adversaires formidables sont des fantômes. Pour les voir disparaître, comme un nuage, il suffit de leur arracher leur masque effrayant, de dire à chacun d'eux : „ Tu n'existes pas “ ». Suit une longue divagation théologique. Passons et voyons ce qui a lieu dans le monde réel. « (p. 26) Les guérisons de la Christian Science se comptent par centaines ou par milliers, pour ne pas dire par dizaines de mille... Leur authenticité a d'ailleurs pour elle toutes les garanties qu'on peut raisonnablement demander. [Tout aussi nombreuses et authentiques étaient les œuvres des sorcières, de la magie, des fantômes, etc.] Aussi ne provoquent-elles, dans les pays anglo-saxons, ni la raillerie, ni l'incrédulité... Cependant, depuis le troisième siècle, la chrétienté a négligé son droit et son devoir à l'égard de la maladie. Il s'agit de nous réveiller. Aussi Science and Health [le chef d'œuvre de cette dame Eddy] porte-t-il sur sa couverture l'inscription suivante autour d'une couronne que traverse une croix : „ Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons “. Mme Eddy a pris au sérieux cet ordre surprenant et se voit récompensée de sa fidélité. Elle guérit, à l'instar de son Maître, „ toutes sortes de maladies et d'infirmités “, et ses (p. 27) étudiants ont appris à faire de même ». Pourtant elle n'apprit pas bien cet art pour elle-même, et mourut bel et bien ! Medice, cura te ipsum. Certains de ses disciples, plus naïfs ou plus logiques que d'autres, dirent qu'elle ne pouvait pas être morte, car cela eût été un démenti à sa doctrine, qui nie l'existence de la mort. Ils attendaient donc qu'elle ressuscitât. Inutile d'ajouter qu'ils attendent encore. Peut-être par crainte de la concurrence, William James n'était pas favorable à. Mme Eddy. Notre auteur le reprend « (p. 35) Je suis fâché de le dire, le célèbre psychologue traite ce vaste et délicat sujet d'une manière superficielle... » Peut-être par crainte de l'esprit railleur des peuples latins, M. Byse ne nous donne pas de détails sur la manière dont se guérissent les maladies. Il nous faut donc recourir à d'autres auteurs. Un correspondant du Resto del Carlino (XXVe année, n° 330) a vu à Berlin les fidèles de la nouvelle science : gens qui croient à des contes bleus de ce genre-ci : « Tu dis qu'une tumeur te fait éprouver de grandes douleurs. La tumeur révèle uniquement ta croyance en des douleurs provoquées par l'inflammation et par l'enflure, et cette croyance-là, tu l'appelles tumeur ». Cette dame Eddy était une parfaite hégélienne, mais seulement pour les maladies, non pour l’argent : Figure-toi donc que tu n'es pas malade, mais paie en monnaie non « figurée ». – A. MAYOR ; Mary Baker Eddy : « (p. 123) Le traitement, qui a pour but de détruire la fausse croyance du malade, doit donc être purement mental, en partie silencieux, et il peut même se faire à distance (en note : On cite, le cas de malades qui ont été guéris sans même se douter qu'ils étaient en traitement)… (p. 124) Mais le guérisseur n'évoque la maladie que pour la nier, n'a d'autre but que de réaliser son irréalité... (p. 126) [citation de ce qu'écrit Mme Eddy] tumeurs, ulcères, inflammations, tubercules, articulations déformées, souffrances de toutes espèces ne sont que de sombres images créées par l'esprit de mort et dissipées par l'Esprit divin »... Autre citation : « (p. 127) Appelé pour la naissance d'un enfant, c'est-à-dire d'une idée (p. 128) divine, on s'efforcera d'écarter les notions matérielles, afin que tout se passe d'une manière naturelle... Né de l'Esprit, né de Dieu, l'enfant ne peut faire souffrir sa mère ». Mme Eddy donne largement des idées. Voyons ce qu'elle reçoit. « (p. 224) Tous ces ouvrages se vendent à des prix qui sembleront d'autant plus élevés que les frais de publication sont réduits à leur minimum, ...(p. 225) la presse [qui auparavant n'était pas favorable] a d'ailleurs changé de ton et se montre en général pleine de déférence pour la Mère des Scientistes, qui sait de son côté récompenser les services qu'on lui rend... (p. 228) ...le produit brut de la vente du Livre „ donné aux affamés “ [c'est ainsi que Mme Eddy appelle ses dupes] peut-être évalué actuellement à 10,000,000 de francs environ, le bénéfice de l'auteur à 5,000,000, celui de l'Église à 3 ou 4,000,000... (p. 229) il n'est sans doute pas d'auteur qui ait réalisé des bénéfices aussi élevés que la Prophétesse de l'ascétisme idéaliste ». Elle a plus d'habileté ou plus de chance que tant de somnambules qui guérissent aussi toutes sortes de maladies, plus de chance que le pauvre Cagliostro et que tant d'autres aventuriers. Bien des siècles se sont écoulés depuis que Lucien a écrit son Faux Prophète ; pourtant c'est une histoire toujours actuelle, toujours vraie, bien que les fidèles du dieu Progrès veuillent nous faire croire que leur divinité, a détruit la « superstition ».
[FN: § 1696-1]
Nous ne pouvons parler de toutes ; il suffira d'en rappeler une encore. La Liberté, 27 octobre 1913 : « Le culte Antoiniste. Le „ Père “ Antoine était un ,, guérisseur “ dans le genre du zouave Jacob. Il opérait des cures prodigieuses. Il mourut l'an dernier à Jemmapes-lez-Liége, en Belgique. De ses cendres est née une religion. Le culte „ Antoiniste “ a ses desservants et ses adeptes, de plus en plus nombreux. La „ Mère “, veuve du „ Père“ Antoine, a hérité des vertus curatives de son mari et continue son commerce, secondée par un homme chevelu et barbu qui s'est fait une tête de prophète. C'est le père. Il est chargé d'évangéliser les masses, car la „ Mère “ se contente de faire des gestes. Les Antoinistes ont construit à Paris, à l'angle des rues Vergniaud et Wurtz, quartier de la Maison-Blanche, un petit temple. Les vitraux y sont remplacés par des carreaux blancs. Il n'y a ni croix, ni statues, ni tableaux, ni symboles religieux d'aucune sorte. À l'extérieur comme à l'intérieur, les murs sont nus, On y lit des inscriptions comme celles-ci. Sur la façade : „ 1919. Culte Antoiniste “. Dans le temple, à l’entrée, et mise là comme une enseigne, cette autre : « Le père Antoine, le grand guérisseur de l'humanité, pour celui qui a la foi“. Dans le fond, cette pensée philosophique : „ Un seul remède peut guérir l'humanité : la foi. C'est de la foi que naît l'amour. L'amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même. Ne pas aimer ses ennemis, c'est ne pas aimer Dieu, car c'est l'amour que nous avons pour nos ennemis qui nous rend dignes de le servir ; c'est le seul amour qui nous fait vraiment aimer, parce qu'il est pur et de vérité “. Il n'y a point d'autels dans ce temple. Au fond, s'élève une chaire en bois très simple. Cloué au panneau de face, un cadre renferme sous vitrine, peint en blanc, un petit arbre semblable à un arbre japonais. Une inscription en lettres blanches avertit que c'est „ l'arbre de la science de la vie et du mal “, unique symbole du culte antoiniste. Cet arbre reparaît, découpé sur une plaque d'acier ajustée à une hampe que tient à deux mains un desservant, faisant office de bedeau. Les desservants ont un uniforme complètement noir : longue redingote austèrement boutonnée jusqu'au menton, chapeau demi haute-forme à bords plats : il a à peu près la forme de ce petit chapeau illustré par M. Alexandre Duval, avec le chic en moins. Ce matin, il y avait un grand nombre de curieux pour l'inauguration du temple, d'autant plus que la „ Mère“ devait opérer des guérisons. Une vieille femme, soutenue par deux de ses amies, se dirige vers la place destinée aux malades au pied de la chaire. Chaque pas qu'elle fait lui coûte un effort et lui arrache une plainte. Ses yeux brillent d'un éclat fiévreux. Elle marche le corps plié. On l'installe sur une chaise. Un desservant donne trois coups de sonnette espacés comme à la messe à l'élévation. Une porte s'ouvre et la „ Mère “ paraît, vieille dame toute vêtue de noir, propre et décente. À son chapeau est épinglé le voile des veuves. Elle monte, les mains jointes, l'escalier qui conduit à la chaire. Là, elle se raidit dans une pose extatique. Puis, lentement, ses bras se lèvent et s'écartent, tandis que ses lèvres murmurent des mots incompréhensibles. Elle joint les mains, les porte à droite puis à gauche ; enfin elle se prosterne. C'est fini. Reprenant sa figure normale, la Mère descend l'escalier de la chaire et sort. Suivie du père qui, pendant cette consultation mystique, s'était immobilisé auprès de la chaire dans une attitude inspirée, elle va s'enfermer dans une baraque en planches placée derrière le temple et pareille à ces baraques où les terrassiers de la Ville rangent leurs outils. La malade s'est levée dans un effort de toute sa volonté. Mais cette ardeur s'est éteinte aussitôt et elle part comme elle est venue, soutenue par ses compagnes. Une jeune femme prend sa place. Elle tient dans ses bras une fillette de 4 à 5 ans, d'une maigreur douloureuse. Toute la vie semble s'être réfugiée dans les yeux. Ses bras et ses jambes pendent inertes. Le corps, plié sur le bras gauche de la mère, a la souplesse d'une étoffe. Indifférente à ce qui se passe autour d'elle, elle tient ses regards fixés vers le cintre. Le trouble de la jeune femme apparaît à la pâleur cireuse du visage. À tout moment, elle essuie avec son mouchoir la sueur froide qui perle à son front. La même cérémonie se reproduit : coups de sonnette du desservant, apparition de la vieille dame, même jeu de scène sans la moindre modification. Il s'applique à tous les cas. La mère remporte son enfant qui a gardé son aspect de loque vivante. Dans l'assistance, pas la moindre manifestation. On regarde tout cela avec stupeur. L'impression d'angoisse qu'on éprouve de ce spectacle arrête l'ironie. Dehors, des groupes se forment. J'écoute un gros homme dont l'haleine fleure le rhum dire à un desservant : „ Pourquoi qu'on n'irait pas, si on a la foi ?“. Passant son bras sous le sien il ajoute : „ Allons prendre un verre, ça nous remettra “. SÉRIS ». De temps à autre se produit quelque cas qui montre la vanité de ces croyances. Par exemple, en décembre 1913, mourut à Berlin l'actrice Nuscha Butze-Beermann. Corriere della Sera, 13 décembre 1913 : « La Nuscha souffrait de diabète depuis l'été dernier. Elle suivit le traitement d'un médecin, et observait le régime prescrit ; puis elle tomba entre les mains d'une gesundbeterin, c'est-à-dire d'une de ces guérisseuses qui traitent les maladies par la prière. L'actrice négligea le traitement médical, et s'en remit à la force de la volonté et de la prière. Ainsi, le mal alla en s'aggravant, et quelques jours plus tard la Nuscha se sentit si faible qu'elle ne put se rendre au théâtre. Néanmoins, la guérisseuse lui dit de ne pas se laisser abattre ainsi, et de penser toujours que l'intelligence ne connaît pas de douleurs. Elle devait simplement prier et aller à la représentation. L'actrice y alla, mais elle perdit connaissance sur la scène et ne revint plus à elle ».
[FN: 1697-1].
Il y avait et il y a toujours des prêtres, de même que des médecins, dignes de toute estime, de toute considération et de tout respect. Ils sont parmi ceux qui donnent leurs conseils à qui les leur demandent, et qui ne cherchent pas à imposer leur volonté, par la force ou des artifices, à ceux qui ne sont pas de leur avis. Ce que nous disons des morticoles ne doit en aucune façon être appliqué aux bons et braves docteurs qui, modestement, avec science, diligence et honnêteté, soignent les malades et atténuent les maux de l'humanité souffrante.
[FN: 1697-2].
Voir, par exemple : Dr BOURGET, prof. à l'Univ. de Lausanne ; Quelques erreurs et tromperies de la science médicale moderne. Cet auteur, réelleme nt scientifique, relève la superstition du public. BOURGET ; Beaux dimanches : « (p. 178) Le bon public croit le pouvoir du médecin beaucoup plus étendu qu'il ne l'est en réalité, et voilà pourquoi il demande des choses impossibles à ce médecin qu'il est bien près de considérer comme un sorcier. Pour les personnes ayant réellement la foi religieuse, il serait plus logique de demander une (p. 179) telle guérison au Dieu qu'elles adorent, au pouvoir duquel, je suppose, elles doivent croire aveuglément, car dans un bon nombre de maladies des organes, la guérison réelle ne pourrait dépendre que d'un miracle. Le médecin, lui, est incapable de faire des miracles ; demandons-lui donc seulement ce qu'il est capable de faire ». – Parmi beaucoup d'exagérations, il y a aussi plusieurs vérités dans CHARLES SOLLER ET Louis GASTINE ; Défends ta peau contre ton médecin.
[FN: § 1697-3]
On peut appliquer, mutatis mutandis, à l'hypocrisie de nos morticoles humanitaires et thaumaturges la nouvelle de Boccace, dans laquelle « un honnête homme confond par un bon mot la méchante hypocrisie des religieux ». L'Académie de médecine de Paris demande une loi qui interdise au pharmacien d'exécuter plus d'une fois une même ordonnance. Les malins qui approuvent cette mesure disent qu'ils veulent « protéger l'hygiène » ; ils veulent plutôt protéger la bourse des thaumaturges. Ceux-ci se feront payer ainsi une visite chaque fois que le malade aura besoin de refaire usage de l'ordonnance. Pour gagner de l'argent, il n'est sorte de malice qu'ils n'inventent. En Italie, une loi de 1913 permet aux pharmaciens d'exploiter les malades ; et ce fut un ministre qui eut le front de dire qu'on faisait cela afin d'assurer aux malades des remèdes de bonne qualité, entre autres les « spécialités étrangères », qui sont mauvaises, paraît-il, si elles sont vendues par les droguistes, excellentes, si elles sont vendues par les pharmaciens. N'importe qui peut s'assurer qu'à Genève, par exemple, le coût des produits pharmaceutiques est de 20 à 50 % plus bas qu'en Italie ; et à qui fera-t-on croire que la qualité en est moins bonne ? De telles affirmations si évidemment contraires à la vérité sont bien à leur place dans la bouche d'un ministre, chef de « spéculateurs » ; elles sont dignes d'être crues par un vulgaire superstitieux ; mais à vrai dire, en tout cela on voit renaître, sous des dehors nouveaux, de vieilles superstitions au moyen desquelles on soutire de l'argent aux naïfs.
[FN: 1697-4]
Nombre de bons et braves docteurs savent et disent ce qu'il y a d'incertain dans leur art, et ils suivent des principes rigoureusement scientifiques. Mais il est remarquable que plusieurs d'entre eux n'osent pas s'opposer à leurs confrères qui veulent imposer cet incertain. Cela a lieu parce que le culte du dieu État, non seulement est accepté par les fidèles, mais aussi toléré par les indifférents.
[FN: § 1697-5]
En certains pays où sévit la législation anti-alcoolique, les morticoles trouvent une source abondante de bénéfices dans les ordonnances de boissons alcooliques prescrites sous un prétexte médicinal. C'est là un des motifs pour lesquels tant de morticoles sont anti-alcoolistes. – FELICE FERRERO, dans le Corriere della Sera, 2 juin 1913. L'auteur parle des États-Unis d'Amérique. « La persévérance des buveurs d'eau est si agressive, et la mauvaise réputation qu'ils ont su créer à l'alcool est si profondément enracinée, que tout le pays en est pénétré [exactement comme de l'hypocrisie religieuse autrefois ; la réaction se produira, mais le moment n'est pas encore venu, et aucun Molière n'a encore écrit le Tartufe de l'anti-alcoolisme]. Cela ne veut pas dire qu'aux États-Unis on ne boit pas de produits alcooliques. Bien au contraire. On y boit, et l'on y boit beaucoup plus que cela n'est à conseiller, même à qui ne saurait admettre que l'alcool soit un poison. Mais ceux qui boivent s'entendent toujours appeler à donner des explications et presque à présenter des excuses, quand ils se préparent à perpétrer l'acte criminel. Il n'est pas un individu sur mille, hors de l'intimité des clubs où, entre quatre murs amis, on commet nombre de choses qu'on n'ose pas commettre au grand jour, il n'est pas un individu sur mille – disais-je – qui ait le courage de dire franchement comme Anacréon „ Que les amis ne m'ennuient pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent ; moi, je bois “ y a des gens qui boivent parce que „ le médecin le leur a ordonné “ ; de ceux qui ne refusent pas un petit verre, „ pour tenir compagnie “, et de ceux qui boivent „ une gorgée de sept en quatorze “ mais apparemment il n'est personne qui trinque pour la raison la plus plausible de toutes... parce que cela lui plaît ».
[FN: § 1698-1]
Les théosophes sont assez nombreux en Europe ; ils ont une abondante littérature. Beaucoup de gens croient aux esprits, au dédoublement de la personne, etc. – J. DARLÈS ; Glossaire raisonné de la Théosophie, s. r. Extériorisation : « (p. 93) Le corps de l'homme comporte une sorte d'enveloppe subtile, dénommée périsprit par les spirites et fluide aithérique par les occultistes, lequel fluide relie pendant la vie le corps à l'âme. Après la mort, (p. 94) quand le corps matériel, le corps physique est dissous, désagrégé, oxydé, l'individualité possède un corps aithéré que les occultistes dénomment double aithérique. C'est aussi la force extériorisée. Quand nous dormons d'un profond sommeil, notre astral (le fluide aithérique) se dégage et va où le pousse notre désir, notre volonté. Ce dégagement s'accomplit chez tous les hommes d'une façon inconsciente ; seulement certains hommes ne s'en doutent point et ne se le rappellent pas, par conséquent, tandis que certains se le rappellent et considèrent comme un rêve les scènes, les travaux ou les promenades accomplis en astral, car l'homme vit sur le plan astral comme sur le plan physique. „ Des sensitifs, des médiums avancés, des psychomètres, des occultistes, nous dit Ernest (p. 95) Bose (dans Dictionnaire d'orientalisme, d'occultisme et de psychologie), peuvent même éveillés, dégager leur astral (leur double aithérique) de leur corps physique et ceux, parmi les adeptes ou initiés de l'occultisme, qui sont avancés, peuvent même à l'aide du fluide aithérique, matérialiser leur corps physique passer du plan sthulique au plan astral) et se montrer fort loin de leur corps à des amis, à des connaissances, à des étrangers “ ». Ajoutons un brin d'explication pour ceux qui ignorent ce que sont ces plans : « (p. 220) Sthula ou Sthule – La matière – Le Plan Sthulique est le Plan Physique. (p. 192) Le Kosmos se compose de sept Plans, divisés chacun en sept sous-plans ». Il serait trop long de les indiquer tous ; le lecteur qui voudra les connaître peut recourir aux ouvrages spéciaux. Il nous suffit de noter ce qu'est le plan astral : « (p. 192) Le Plan Astral, qu'on dénomme aussi (p. 198) plan formatif, duquel l'homme tire son corps astral ; c'est sur ce plan que se trouve le Kamaloka ou le lieu des passions ou des désirs, c'est sur ce plan que va l'homme, après sa mort : il correspond au purgatoire des catholiques ». À côté de ces nouvelles formes de divagations persistent aussi çà et là quelques formes anciennes ; et à chaque instant on lit dans les journaux des histoires de sorcières, de charlatans, et autres semblables. Par exemple, Corriere della Sera, 31 août 1913 : « Une mystérieuse pluie de cailloux arrêtée par l'holocauste de deux chats. À Termo d'Arcola, près de la Spezia, s'est manifesté, ces jours derniers. un phénomène étrange, qui a fait beaucoup parler ces bons villageois. Le 21 juillet écoulé, une certaine Irma Dal Padulo, âgée de onze ans, sortait de l'école pour rentrer à la maison, lorsqu'elle vit tomber autour d'elle, le long du chemin rural tout à fait désert, des cailloux qui avaient l'étrange particularité d'être très chauds. Toutefois, le matin suivant le fait se répéta, à peine la fillette se fut-elle levée, et, malgré la vigilance de ses parents et d'autres voisins, il dura presque toute la journée. Partout où la fillette passait, des cailloux toujours chauds tombaient autour d'elle, sans toutefois la frapper. Durant plusieurs jours le phénomène se répéta... et même diverses personnes étaient accourues pour constater le phénomène : parmi elles, le conseiller communal de Vezzano Ligure, M. Luigi Parioli, deux femmes et un frère d'Irma... » On dirait un récit du Malleus maleficarum ; mais avec les années le démon s'est retiré et a fait place aux esprits : « Quelqu'un conseilla de recourir aux exorcismes du prêtre [c'était peut-être un clérical], mais sans résultat [pauvre démon, quelle décadence !] et la famille ne savait plus à quel saint se vouer, lorsqu'un habitant de l'endroit [c'était peut-être un anticlérical, ou tout au moins une personne qui avait le sens de la modernité] conseilla de tenir une assemblée spirite, dans la maison de Dal Padulo. Le conseil fut suivi, et la table aurait parlé en son langage, exigeant le sacrifice de deux chats et leur enfouissement en un lieu indiqué ; ce qui fut fait, et alors le phénomène cessa ».
[FN: 1701-1].
[NOTE DU TRADUCTEUR]. HENRI-F. SECRÉTAN ; La population et les mœurs, p. 204 : « ils [les chrétiens] remplacèrent par des anges les divinités poliades si chères aux anciens, tant le polythéisme, qui est toujours vivant, que rajeunissent même quelques penseurs contemporains, est l'expression naturelle de la métaphysique populaire ».
[FN: § 1702-1]
Pour beaucoup de fidèles de cette religion, le Christ, auquel ils enlèvent tout caractère divin, n'est plus à admirer que comme un chef socialiste et humanitaire. Il y a des gens qui vont même plus loin. En novembre 1912, tandis que se déchaînait la guerre balkanique, par laquelle les chrétiens de la Turquie cherchaient à s'affranchir de l'oppression des musulmans, un congrès socialiste international se réunit à Bâle pour condamner sévèrement cette guerre. Jaurès y fut très écouté. Il avait publié déjà divers articles pour défendre la Turquie. Le conseil de paroisse mit à la disposition des défenseurs du croissant contre la croix... la cathédrale de Bâle. Sans doute, la lâcheté bourgeoise joua un rôle en ce fait : elle qui poussé beaucoup de gens à se prosterner devant les socialistes et à les aduler. Mais on ne peut l'admettre comme cause unique, surtout si l'on prend garde à l'approbation avec laquelle un grand nombre de personnes accueillirent cette mesure. Un correspondant de Bâle écrit à son journal : « Ce qui caractérisera le Congrès socialiste de Bâle, ce ne sera pas l'humanité extérieure de ses résolutions ; ce sera l'assemblée de la cathédrale ; ce sera ce geste noble et confiant de notre communauté politique et religieuse adressé aux partisans de la paix... il a symbolisé l'attachement... non pas à l'Internationale révolutionnaire, mais à la paix internationale et à la paix sociale entre les classes des divers États » (Journal de Genève, 27 novembre 1912). On remarquera que les congressistes de la cathédrale de Bâle sont des partisans de la « lutte des classes », qui pour eux est un dogme, et les favoriser nous est donné comme un symbole « d'attachement à la paix sociale » ! Parmi les nombreuses dérivations absurdes qu'il nous est arrivé de remarquer, celle-ci ne tient certainement pas le dernier rang. Les Arméniens chrétiens, qui subirent d'abord les massacres d'Abdul-Hamid, puis ceux des « Jeunes Turcs », trouveront peut-être que la paix des Turcs, prêchée dans la cathédrale encore chrétienne de Bâle, ne diffère pas beaucoup de celle des Romains, dont Galgacus disait : ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (TACIT. ; Agric., 30).
[FN: § 1702-2]
On pouvait prévoir ce fait, précisément à cause du peu de variabilité de toute une classe de résidus. Systèmes socialistes, t. 11, p. 419 : « Il se pourrait, par exemple, qu'en certain pays, les nationalistes, les impérialistes, les agrariens, fassent les seuls partis capables de s'opposer au socialisme, et vice versa ; le choix serait alors restreint à ces partis ».
[FN: § 1702-3]
Par ce terme, il faut entendre la doctrine de l'ancien parti libéral, qui visait à restreindre le nombre des liens de l'individu, et non celle du parti libéral moderne, qui veut l'augmenter, et qui, sous l'ancien nom, professe une doctrine entièrement nouvelle, en comparaison de celle qui, naguère, se disait libérale.
[FN: § 1702-4]
On peut lire, en quatrième page des journaux, de coûteux avis de magiciens, d'astrologues, et de gens qui prétendent être en mesure d'indiquer les numéros qui sortiront au tirage de la loterie, en Italie. Comme il est d'ailleurs certain que ces personnes ne continueraient pas à faire de tels frais, si elles n'en retiraient un bénéfice, il apparaît clairement que beaucoup de gens mordent à l'hameçon. On publie des catalogues spéciaux de livres de magie et d'astrologie, et chaque jour de nouveaux livres de ce genre s'ajoutent aux anciens. Voici, parmi tant d'autres, un exemple de publication psychique : « Conseils infaillibles à la portée de tous pour semer l'amour et la sympathie autour de soi; pour obtenir le bonheur et le propager. – Cabinet psychique, 98, rue Blanche. –Paris, 1e édition, 25 000 exemplaires. (p. 2) Les moyens que nous voulons dévoiler à nos lecteurs pour acquérir amour et bonheur, sont obtenus par les Parfums magiques et les Pierres astrologiques... Les principaux parfums magiques sont au nombre de sept. Chacun d'eux correspond à un astre essentiel... Soleil : Héliotrope – Lune : Iris – Mercure : Genièvre – ...Nos lecteurs et nos lectrices savent déjà de quelle importance il est pour eux de faire usage du parfum même de l'astre qui a sur leur destinée une influence dominante. Le temps n'est plus où la science astrologique était dédaignée et méprisée. Notre époque a vu se produire dans cette branche de la connaissance de l'occulte, comme dans toutes les autres, une magnifique renaissance. Personne à présent ne s'aviserait de (p. 3) mettre en doute l'influence des planètes sur la terre, sur ses habitants, sur tout ce qu'elle porte et sur tout ce qu'elle contient ». Cette dérivation est semblable à celle de Hegel, qui voulait que les comètes eussent une influence sur la vendange (§510). « Qu'il soit question de la reproduction des animaux, de la floraison des plantes ou de certaines maladies de l'homme, on est forcé de reconnaître l'influence du soleil. Qui songerait à mettre en doute le pouvoir de la lune sur les marées [ce brave homme doit avoir là-dessus une notion semblable à celle des Chinois et de Hegel] sur les indispositions périodiques de la femme, sur certaines maladies mentales, et l'effet néfaste de la lune rousse sur les pousses des jeunes plantes ? » C'est là le raisonnement habituel des métaphysiciens, qui cherchent dans le « moi » les rapports expérimentaux des faits. « Nous entendons souvent des personnes attribuer au hasard leurs préférences. Elles diront par exemple : C'est singulier, mais pourquoi je déteste la couleur blanche. Pourquoi la fleur que je préfère est-elle la rose ? Pourquoi mon parfum de prédilection est-il la verveine ? Il n'y a là aucun hasard, c'est que ces personnes se rendent compte d'une façon obscure et instinctive de ce qui leur convient le mieux. Une voix mystérieuse les avertit de ce qui leur convient le mieux ». Ce raisonnement semble imité de ceux par lesquels Bergson veut retrouver le « moi instinctif » ; il parle d'une manière plus obscure, mais expérimentalement identique à celle de notre auteur. « (p. 7) Ce que nous avons dit au sujet des parfums s'applique également aux pierres précieuses. De toutes les substances terrestres il n'en est pas qui aient plus de sympathies pour les substances sidérales que les véritables pierres précieuses. Tout le monde sait que la pierre aimantée est despotiquement influencée par l'étoile polaire ». Voilà Hegel « dépassé » (§1686) dans ses divagations sur le diamant (§ 5011). – Les pratiques magiques de la magicienne de Théocrite se reproduisent jusqu'à nos jours. Voir, par exemple, PAPUS ; Peut-on envoûter ? Paris, 1893.
[FN: § 1703-1]
À propos du congrès d'Iéna, en septembre 1913, on lit dans le Giornale d'Italia, 15 septembre 1913, sous la signature G. CABASINO-RENDA : « Le parti socialiste allemand est en décadence. La Direction le constate franchement dans le rapport long et détaillé qu'elle présente aujourd'hui au Congrès, et qui est empreint d'un profond pessimisme. L'inscription de nouveaux prosélytes est stagnante, ce qui n'était jamais arrivé depuis que le parti existe. L'an dernier, il n'a eu que 12 000 nouveaux inscrits, chiffre relativement dérisoire, puisque les nouveaux inscrits ont toujours dépassé les 130 000. Il faut considérer une autre circonstance assez intéressante : c'est que des 12 000 nouveaux inscrits de cette année, 10 000 sont des femmes. Cela remplira d'un orgueil légitime les féministes, mais enthousiasme assez peu la Direction du parti, laquelle ne trouve ainsi parmi ces nouveaux prosélytes, que deux mille individus d'utilisables, du moins au sens électoral du mot. En beaucoup de districts – plus de cent – le nombre des inscrits a nettement diminué. Le phénomène s'est manifesté dans toute l'Allemagne, mais particulièrement en Prusse. Les chefs socialistes cherchent à donner des explications réconfortantes de ce phénomène très grave, et disent qu'il est peut-être attribuable à la crise économique traversée cette année par l'Allemagne. Mais le raisonnement est un peu tiré par les cheveux, car, tout à l'opposé, l'histoire du parti socialiste prouve exactement le contraire ; c'est-à-dire qu'en temps de crises économiques, le nombre des socialistes croît en raison directe du malaise et du mécontentement. Ils disent aussi : ,, La propagande de la presse du parti est négligée “. Mais vice versa, dans une autre partie du même rapport, on affirme que les frais de propagande ont été cette année bien plus élevés que les années précédentes. En ce qui concerne les journaux socialistes, il se manifeste un autre phénomène, qui est en parfaite harmonie avec la stagnation dans l'inscription des membres : les abonnés diminuent sensiblement. À lui seul, le Vorwaerts en a perdu 8400, dans les neuf derniers mois. Les journaux de moindre importance en ont perdu plus de 5000. Un autre phénomène complète la démonstration du recul du parti socialiste allemand : le nombre des votes pour ses candidats aux élections politiques a sensiblement diminué. Tandis que dans les années passées le nombre de ces votes était en augmentation continue (jusqu'à atteindre presque le chiffre fabuleux de quatre millions : votes de sympathie, car le parti compte moins d'un million de membres inscrits), dans les treize élections partielles de cette année-ci, les socialistes ont eu, sauf un cas isolé, beaucoup moins de suffrages que les années passées. En effet, ils ont été presque toujours battus. Déduire de tout cela que le parti socialiste allemand soit en décomposition, serait sans doute une grave erreur ; mais on peut affirmer avec assurance qu'après avoir atteint l'apogée de sa puissance aux élections de 1911, la parabole commence à descendre. Pour excuser leur vote favorable aux mesures financières en vue des armements, les chefs socialistes disent que « s'ils avaient renforcé de leurs votes l'opposition, les projets gouvernementaux eussent été menacés d'un rejet, et que ce rejet aurait provoqué la dissolution immédiate du Reichstag ». Donc, les socialistes n'ont pas voulu la dissolution du Reichstag ; ils n'ont pas voulu les élections générales sur une plate-forme qui, logiquement, devait leur être favorable : un milliard de nouvelles dépenses militaires ! On ne pourrait avoir une démonstration plus évidente du niveau élevé atteint actuellement par l'esprit national allemand et de la situation du parti socialiste, qui sent que même en des circonstances exceptionnellement favorables, il ne pourrait, dans un nouveau conflit, maintenir la position conquise aux dernières élections générales, grâce à un concours de circonstances qui ne se représenteront jamais plus ». C'est ce qu'on ne peut savoir ; tout dépendra des circonstances de l'évolution sociale.
[FN: § 1703-2]
DE LA MAZELIÈRE ; Le Japon, t. 5 : « (p. 7) Dans ce pays où un moment tout sembla s'écrouler, une seule institution subsistait, grandie de l'écroulement de tout le reste, la monarchie, fortifiée par la haine del'étranger, les passions révolutionnaires, qui avaient identifié sa cause avec celle des réformes démocratiques, le caractère mystique qu'avait pris la Restauration. Ces trente millions d'hommes, qui n'avaient plus de religion et qui en voulaient une, adoraient leur empereur... (p. 8) Ainsi l'amour de l'empereur se fortifiait de tous les autres amours, l'adoration de l'empereur se fortifiait de toutes les autres adorations... (p. 9) Et c'est ainsi qu'au milieu des déchirements et des haines suscités par les discordes et les guerres civiles, le culte de l'empereur devint le seul sentiment où pussent s'unir tous les Japonais... (p. 10) Les officiers étrangers qui ont vu monter à l'assaut les soldats de Nogi devant Port-Arthur, les soldats d'Oku devant Liao-yang se servent de la même expression : c'était du fanatisme ». L'auteur écrivait en 1910. Deux ans plus tard, en se tuant ensuite de la mort du Mikado, le général Nogi ajoutait une nouvelle confirmation à ces observations.
[FN: § 1704-1]
Corriere della Sera, 25 février 1912 : « À l'appel nominal, il y eut 38 votes contraires, dont exactement 33 des socialistes, deux des constitutionnels... trois des républicains... Au scrutin secret, il y eut seulement 9 votes contraires, bien qu'y eussent participé, d'après ce qui résulte du compte-rendu officiel de la séance, 22 des députés qui, à l'appel nominal, s'étaient prononcés contre le projet. On ne connaît naturellement pas les noms des neuf qui ont voté contre ; mais il est évident que treize de ceux qui s'étaient d'abord montrés opposés, ont changé d'opinion, et ont approuvé le projet, dans le secret de l'urne, libres de tout contrôle de groupe qui liât leur conscience ». Ailleurs, dans le même journal : « Le fait est singulier, sans précédent ; il est l'indice d'un état d'esprit extraordinairement significatif. Il est évident que ces treize n'eurent pas le courage d'exprimer leur véritable opinion... Le groupe exigeait qu'ils se montrassent contraires, et, en apparence, ils sacrifièrent leurs convictions. Dans le secret de l'urne, ils pouvaient être sincères, et alors seulement ils furent sincères [qui sait ? ils auraient pu aussi ne pas prendre part à la votation ; en réalité ils tournaient comme des girouettes] ; le masque maintenu sur le visage, par un artifice fut levé. Mais que d'humiliation, dans ce courage caché ! Quel aveu de faiblesse, dans cet acte de sincérité ! » Après les élections de 1913, une vague de foi vint, comme d'habitude, du peuple, et les nouveaux députés se montrèrent de violents défenseurs de leur parti.
[FN: § 1705-1]
Plus tard, en 1912, les pacifistes italiens demandaient au ministre de l'instruction publique que « pour la fête de la paix qu'on célèbre le 22 février, il invitât le personnel enseignant à montrer, ce jour-là, comment le sentiment de la paix peut et doit concorder avec le sentiment de la patrie » (Corriere della Sera, 3 février 1912). Le ministre comprit combien il eût été étrange de vouloir faire célébrer la guerre... au nom de la paix ! Peut-être fut-il retenu aussi par le sentiment de l'atteinte qu'il aurait portée à la liberté de pensée du personnel enseignant, en voulant le contraindre à parler à ses élèves d'une manière si sophistique. Enfin, il répondit ainsi au prof. De Gubernatis : « Certainement, le noble idéal de la paix entre les peuples – paix honorable et juste, cela s'entend – sourit à notre esprit, maintenant aussi que l'Italie doit protéger par la force des armes ses intérêts vitaux et en même temps ceux de la civilisation [c'est ainsi « qu'il souriait » aux Romains, tandis qu'ils conquéraient le monde méditerranéen, et à Napoléon Ier, quand ses armées parcouraient toute l'Europe]. Mais il ne peut échapper à votre esprit sagace qu'une manifestation publique faite en ce moment pour la paix, se prêterait, malgré toute réserve, à des interprétations inexactes et nuisibles ». C'est ainsi que le ministre repousse la dérivation du professeur ; mais ensuite il en fait une pour son propre compte : « Les Romains fermaient le temple de Janus, seulement quand les ennemis étaient vaincus [peut-être le ministre est-il ici quelque peu ironique ? il rappelle la phrase de Tacite : ubi solitudinem faciunt, pacem appellant] nous célébrerons de nouveau la fête de la paix, dès que le sang de nos soldats, fleur de la jeunesse d'Italie, aura apporté à la patrie la reconnaissance de son bon droit et le respect de tout le monde. Ce sera une fête sincère et sentie par tous ». Dépouillée de ses fioritures de rhétorique, l'idée du ministre est, au fond, qu'on louera la paix quand la guerre aura rapporté tout ce qu'on en désire et qu'on en espère. C'est une idée d'ailleurs très juste ; mais elle est vieille comme le monde, familière même a des peuples très belliqueux, et il était vraiment inutile d'invoquer les belles théories du pacifisme pour nous la révéler.
[FN: § 1705-2]
Parmi ceux qui gardèrent fidélité à leur doctrine et ne se laissèrent pas emporter comme la feuille au vent, par la bourrasque des enthousiasmes belliqueux, il faut rappeler, à leur honneur, le prof. Napoleone Colajanni, l'avocat Edoardo Giretti et le prof. Arcangelo Ghisleri.
[FN: § 1708-1]
On pourrait encore remonter plus haut. Dans la Grèce ancienne, on disait que les Hellènes ne devaient pas se faire la guerre entre eux, mais la faire seulement aux Barbares.
[FN: § 1710-1]
En 1912, le gouvernement italien refusa l'exequatur à Mgr. Caron, nommé par le pape archevêque de Gênes. Il paraît que cette affaire a des dessous. On soupçonna Mgr. Caron d'avoir contribué à faire éloigner de Gênes le Père Semeria, qui avait une légère teinte de modernisme, et était protégé en haut lieu ; mais comme nous n'avons pas de preuves de ce dernier fait, nous ne devons pas en tenir compte. Arrêtons-nous seulement aux raisons que, pour justifier le refus de l'exequatur, le ministre Finocchiaro-Aprile donna à la séance de la Chambre, le 10 février 1913. Il fit allusion à des journaux qui étaient favorables au pouvoir temporel du pape, accusa, mais sans trop en donner des preuves, Mgr. Caron d'être leur complice, et conclut qu' « en présence de circonstances comme celles dont on a parlé aujourd'hui, ce qui devait prévaloir sur tout et sur tous, c'était la suprême raison d'État, en vertu de laquelle l'État ne peut accorder une autorisation civile à qui, espérant des restaurations impossibles, ne rend pas à l'État l'hommage qui est dû à l'État ». Voilà un principe général, et si on l'avait entendu de la bouche d'un ministre prussien, il n'y aurait rien à ajouter, car en Prusse, le gouvernement exclut des fonctions publiques, y compris celles de professeur d'université, tous ceux qui « ne rendent pas à l'État l'hommage qui est dû à l'État ». Mais il est impossible qu'un ministre italien ignore que l’État italien a, parmi ses employés, des socialistes qui déclarent et répètent publiquement qu'ils veulent détruire l'État bourgeois ; et s'ils ne « rêvent pas des restaurations », ils rêvent au contraire des destructions. Le ministre a donc dit une chose qui n'est pas très véridique, en affirmant que ses actes étaient déterminés par ce principe général. Quand ce principe lui est politiquement utile, il s'en souvient ; quand il lui est nuisible, il l'oublie.
[FN: § 1712-1]
Les partis adversaires de la « bourgeoisie » publient continuellement dans des livres, des opuscules, des journaux, qu'ils veulent l'anéantir, la détruire. Or il n'y a aucun « bourgeois » qui oserait répondre, pas même dans un moment de colère, ni seulement pour plaisanter : « Vous dites que vous voulez nous détruire ? Venez-y donc. C'est nous qui vous détruirons ». Le Dieu des chrétiens a des blasphémateurs parmi ses fidèles ; le dieu du Peuple n'a aucun blasphémateur, non seulement parmi ses fidèles, mais encore parmi ceux qui n'ont pas foi en lui. L'Humanité a ses misanthropes. Le peuple n'a pas de ![]() ; il n'a personne qui ose manifester de la haine contre lui, ou seulement de la répugnance, ni même de l'indifférence. Tout cela semble si commun, si naturel, que personne n'y fait attention, et le rappeler semble aussi inutile que de dire que l'homme marche sur deux pieds.
; il n'a personne qui ose manifester de la haine contre lui, ou seulement de la répugnance, ni même de l'indifférence. Tout cela semble si commun, si naturel, que personne n'y fait attention, et le rappeler semble aussi inutile que de dire que l'homme marche sur deux pieds.
[FN: § 1713-1]
R. MICHELS ; Les partis politiques, chap. IV. Le besoin de vénération chez les masses ; « (p. 42) ...L'adoration des militants pour leurs chefs demeure généralement latente. Elle se révèle par des symptômes à peine perceptibles, tels que l'accent de vénération avec lequel on prononce le nom du chef... (p. 43) En 1864 les habitants de la région rhénane ont accueilli Lassalle comme un dieu... Lorsque les Fasci, ces premières organisations des ouvriers agricoles, se furent formées en Italie (1892), hommes et femmes avaient dans les chefs du (p. 44) mouvement une foi presque surnaturelle. Confondant, dans leur naïveté, la question sociale avec les coutumes religieuses, ils portaient souvent dans leurs cortèges le crucifix à côté du drapeau rouge et de pancartes sur lesquelles étaient inscrites des sentences empruntées aux ouvrages de Marx... (p. 45) En Hollande, l'honorable Domela Nieuwenhuis, en sortant de prison, reçut du peuple, d'après ce qu'il raconte lui-même, des honneurs comme jamais souverain n'en avait reçu de pareils... Et une pareille attitude de la masse ne s'observe pas seulement dans les pays dits „ arriérés “... Nous n'en voulons pour preuve que l'idolâtrie dont la personne du prophète marxiste Jules Guesde est l'objet dans le Nord, c'est-à-dire dans la région la plus industrielle de la France. Même dans les districts ouvriers de l'Angleterre, il arrive encore de nos jours que les masses font à leurs chefs un accueil qui rappelle le temps de Lassalle. La vénération des chefs persiste après leur mort. Les plus grands d'entre eux sont tout simplement sanctifiés... Karl Marx lui-même n'a pas échappé à cette sorte de canonisation socialiste, et le zèle fanatique avec lequel certains marxistes le défendent encore aujourd'hui (p. 46) se rapproche beaucoup de l'idolâtrie dont Lassalle a été l'objet dans le passé ».
[FN: § 1713-2]
MAURICE SPRONCK ; dans La Liberté, 17 novembre 1912. En France, les instituteurs se révoltent contre les politiciens : ceux-ci ont réchauffé un serpent dans leur sein. À propos d'une séance de la Chambre où l'on a parlé de cette crise, l'auteur écrit : « De la plaidoirie éloquente, mais légèrement obscure de M. Paul-Boncour, un point cependant se dégage qui nous paraît d'une vérité frappante ; et nous, prendrons volontiers à notre compte tout ce qu'a dit l'orateur sur les auteurs responsables de la présente crise scolaire. „ Ces groupements d'instituteurs (déclara-t-il) sont nés non seulement sous la surveillance du pouvoir, mais avec sa pleine approbation ; et l'époque n'est pas loin où leurs fêtes annuelles se déroulaient sous la présidence des plus hautes personnalités républicaines “. Rien de plus rigoureusement exact. Et ces hautes personnalités républicaines non seulement toléraient, non seulement encourageaient la transformation du vieux et brave maître d'école en courtier politique, mais elles le faisaient encore en des termes qui excusent dans une certaine mesure, on doit le reconnaître, les pires aberrations et les plus absurdes désordres des pauvres gens qu'on voudrait aujourd'hui ramener au bon sens et à la discipline. Jamais souverains des plus lointaines régions de l'ancienne Asie n'ont été flattés, courtisés, encensés, flagornés comme le furent les malheureux garçons qui, pour le plus grand dommage de leur hygiène cérébrale, avaient choisi l'honorable profession d'éducateurs des enfants, et devant lesquels s'aplatissaient en permanence les innombrables politiciens ou aspirants politiciens. Pour gagner leurs services électoraux, on a littéralement rampé à leurs pieds : remarquez du reste que ces mœurs se continuent et que, en ce moment même où se manifestent pourtant quelques velléités de réagir contre un intolérable état de choses, on nous prépare une loi qui, sous le fallacieux prétexte de défendre l'école laïque, érige ses desservants en une espèce de caste sacerdotale, sacro-sainte et intangible ». Dans cette séance de la Chambre, un député socialiste reprocha au gouvernement de ne pas avoir continué à aduler les instituteurs : « M. Compère-Morel. Tant que les instituteurs ont servi le parti radical, vous les avez couverts de fleurs. Aujourd'hui qu'ils vous abandonnent, vous les traitez en ennemis (bruit, applaudissements) ». En Italie, le gouvernement paie par des faveurs pécuniaires aux coopératives socialistes les votes de plusieurs députés de ce parti ; et à Rome, un député socialiste est élu grâce aux votes des employés de la Maison Royale. – Journal des GONCOURT, t. VIII « (p. 22) Je lis ce soir [28 février 1889] dans le Temps, cette phrase adressée aux ouvriers par le président Carnot... „ Je vous remercie profondément de l'accueil que vous venez de faire à ma personne, mes chers amis, car vous êtes des amis puisque vous êtes des ouvriers “ [on sait que Carnot fut assassiné par un « ouvrier », qui n’était pas un « ami », à ce qu'il paraît]. Je demande, s'il existe en aucun temps de ce monde, une phrase de courtisan de roi ou d'empereur qui ait l'humilité de cette phrase de courtisan du peuple ».
[FN: § 1713-3]
PAUL Louis COURIER ; Simple discours... à l'occasion d'une souscription... pour l'acquisition de Chambord : « (p. 49) ...La Chambre, l'antichambre et la galerie répétèrent : Maître, tout est à vous, qui, dans la langue des courtisans, voulait dire tout est pour nous, car la cour donne tout aux princes, comme les prêtres tout à Dieu... » Aujourd'hui, les politiciens, descendants légitimes des courtisans, disent au Peuple les mêmes choses que le roi a jadis entendues ; et l'on peut dire avec Courier : « La Chambre, le Sénat, la Presse, répétèrent : Maître, tout est à vous, qui, dans la langue des politiciens, voulait dire tout est pour nous, car les politiciens donnent tout au Peuple, comme les anciens courtisans tout aux princes et comme les prêtres tout à Dieu ».
[FN: § 1713-4]
Montecitorio. Noterelle di uno che c'è stato [E. CICCOTTI] « (p. 56) Mais la bourgeoisie italienne [l’auteur, étant socialiste, attribue à la bourgeoisie ce qui est le fait de tous], dont provient la majeure partie des députés, comme classe et comme émanation... ne ressent pas le besoin, et n'a peut-être pas la possibilité de développer en elle-même ces tendances et ces exigences qui la diviseraient en partis ; et si elle le fait, elle vit dans un état de torpeur politique, à l'ombre de divisions plus nominales que réelles... Dans cette condition de vie politique et sociale et avec cette disposition d'esprit, étant donné la nécessité de se trouver un centre, on le cherche et on le trouve naturellement dans le pouvoir constitué, dans le gouvernement, qui existe inévitablement... et qui, ayant la haute main sur tout un engrenage d'intérêts, a la possibilité de (p. 57) satisfaire des appétits, de flatter des ambitions, et de façonner des majorités. Mais chercher un centre hors de soi-même signifie se créer une condition de servitude, telle qu'on la trouve précisément dans les majorités de Montecitorio, chez les ministres qui semblent créés par elles et, à leur tour, les créent et les dominent. La très nombreuse catégorie des ministériels avec tous les ministres... vit dans l'oubli plus ou moins complet de la politique (ce mot étant entendu dans son sens de bon et utile au pays), confiante en le Ministère et dévouée à lui, par un ensemble de reconnaissance, d'espérances, de craintes, de préoccupations de ses propres affaires... » Voir aussi ETTORE CICGOTTI ; Come divenni e conte cessai di essere deputato di Vicaria.– ROBERTO MARVASI : Cosi parlo Fabroni. L'auteur raconte comment Naples fut livrée aux camorristes par le gouvernement : « (p. 10) ...dans le but d'empêcher que le collège de Vicaria ne confirmât dans (p. 11) sa charge de député Ettore Ciccotti... Un grand nombre de camorristes furent autorisés à ne pas se conformer aux obligations qui leur étaient imposées par la « surveillance spéciale » dont ils étaient l'objet. D'autres se virent octroyer le port d'armes et des licences commerciales ; d'autres enfin furent extraits de prison avec la liberté conditionnelle, ou même quelques grâces. Ce furent là les soldats qui livrèrent la bataille que l'on dit avoir été donnée pour la défense des institutions... Pour l'inavouable entreprise, les malandrins se confondirent avec les soldats d'infanterie et de cavalerie : celle-ci, ayant déferré ses chevaux, bivouaqua dans les rues et sur les places et chargea les électeurs suspects... (p, 13) Une „ camorra d'État “ est certainement une chose originale, et un État qui s'associe aux délinquants par un contrat régulier, et leur ordonne... une partie de délits [c'est l'auteur qui souligne], est certainement un phénomène qui cause la stupéfaction ». L'auteur conclut : « (p. 283) J'avoue avoir voulu dénoncer la situation actuelle du pays, en rapport avec le système capitaliste et la constitution politique qui le ronge ». Ici, il confond deux choses entièrement distinctes : 1° la description des faits, qui semble être exacte et bonne, au moins en grande partie ; 2° la cause des faits, qu'il trouve dans le « système capitaliste » ; c'est là une affirmation qui n'est pas appuyée par des preuves scientifiques, et qui ne peut prendre place que dans la théologie socialiste. – Innombrables sont les faits qui montrent comment, pour un grand nombre de gens de la classe gouvernante, la politique est simplement l'art de pourvoir aux intérêts de certains électeurs et de leurs élus. Les résidus de la Ie classe prédominent absolument, et ceux de la IIe s'affaiblissent. Beaucoup de députés se disent anticléricaux et se font élire par les votes des cléricaux. Voici un fait qui peut servir de type d'une nombreuse catégorie. En février 1913, un député fit un discours férocement anticlérical à la Chambre italienne, et l'on découvrit qu'il avait été élu par les votes des cléricaux. À ce propos, le Giornale d'Italia, 18 février 1913, écrit : « Le Président de l'Union électorale catholique, comte Gentiloni, a maintenant révélé ce fait curieux : que l'honorable ***, élu à **** surtout par les votes des catholiques et la faveur de l'évêque, faisait à Rome l'anticlérical, par des accords spéciaux précisément avec Ernest Nathan, et, en homme de bon sens qu'il est, le comte Gentiloni avertissait l'évêque de mettre plus de diligence à surveiller la conduite de son député. Cette semonce du Comte Gentiloni a provoqué, entre cléricaux, une dispute dont il est inutile de s'occuper. Ce qui intéresse, c'est le fait du député de ****, parce qu'il n'est autre chose qu'un des épisodes quotidiens auxquels nous fait assister l'attitude politique de quelques députés changeant de personnalité dans le train qui les conduit du chef-lieu de leur collège à Rome. Ces gens sont, en province, tout ce qu'il y a de plus obséquieux envers les catholiques, les programmes catholiques et les autorités catholiques. Mais à peine débouchent-ils de la gare de Rome sur la Piazza Termini, qu'ils se sentent enflammés du plus pur anticléricalisme, et, tout en continuant à recommander, s'il le faut, au Ministère tous les curés du collège qui ont quelque chose à demander à l'Administration des cultes ou à la Minerva [ministère de l'instruction publique], ils s'associent politiquement à toute manifestation anticléricale, surtout – cela s'entend – si elle n'est qu'oratoire... Car une autre spécialité des anticléricaux de profession est exactement la suivante : d'exterminer les cléricaux... en paroles ; mais de bien se garder de faire quelque chose qui puisse vraiment nuire à leur œuvre et à leur propagande. Par exemple, l’anticléricalisme de l’honorable Finocchiaro est aussi fait de la sorte : ses discours sont nombreux, impétueux et féroces ; mais des faits administratifs – et législatifs, en particulier – on n'en voit point ; à moins que se présente la bonne occasion de faire de l'anticléricalisme en refusant l'exequatur à Mgr. Caron, et en faisant ainsi plaisir à la grande majorité des catholiques gênois... et italiens... Le Président de l'„ Union électorale catholique “ voudrait donc, à ce qu'il paraît, ramener un peu de sincérité et de loyauté dans nos coutumes électorales, et je le loue. Mais je ne crois pas qu'il y réussisse. L'équivoque convient trop, tant aux députés qu'aux cléricaux. Aux premiers, parce qu'ils s'assurent les votes, aux derniers parce qu'ils s'assurent la tranquillité ». À ces faits généraux, chacun cherche une cause particulière, et la trouve selon ses sentiments. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens, en France, accusent du mal l'élection par la simple majorité des députés, et estiment que la représentation proportionnelle est un remède efficace. – G. BERTHOULAT, dans La Liberté, 18 février 1913, après avoir remarqué que la Chambre ne réussit jamais à approuver le budget à temps, écrit : « Quel réquisitoire dressé contre elle-même par l'assemblée du petit scrutin ! Ainsi, elle n'est pas capable en huit mois de bâcler un mauvais budget ? Il est vrai qu'il s'agit du budget des dépenses, celui des recettes n'étant même pas encore abordé, et que, pour les députés d'arrondissement, réclamer encore et toujours plus de dépenses afin de gaver leur clientèle, c'est toute la politique... Cependant, l'essentielle et permanente raison d'être du Parlement, n'est-ce pas celle des anciens États-Généraux, qui avaient, eux, le mandat intermittent de défendre les contribuables contre les exigences d'argent du Prince ? Or, par suite de l'étrange et lamentable confusion des pouvoirs que consacre le présent régime, les députés sont devenus les princes. Aussi ont-ils le constant souci de desserrer les cordons de notre bourse pour y puiser mieux. Le maintien de leurs principautés étant au contraire, grâce aux mœurs du scrutin pourri, lié aux plus saines traditions du pillage organisé, ils travaillent infatigablement à piller. C'est ainsi que, depuis l'été dernier, le gouvernement ayant pris la précaution de déposer son budget de très bonne heure, les hommes des mares siègent pour dépecer la France. Et comme presque tous en veulent un morceau pour leur meute particulière, comme il faut à chacun des Chevaliers bannerets de la féodalité électorale de quoi alimenter son ban, tous, interminablement, défilent à la tribune afin de participer à la curée de cinq milliards et demi ». L'ouvrage de M. CICCOTTI serait à transcrire presque en entier, tant il est plein d'observations qui sont excellentes pour la science expérimentale. Les limites de cet ouvrage nous obligent à nous borner aux passages suivants : « (p. 58) Mais à travers ces crises ministérielles plus fréquentes on trouve l'homme le plus rusé, le plus énergique ou le plus fourbe, qui met à profit les inépuisables ressources du gouvernement ; qui se crée de plus fortes attaches dans la presse, avec un plus savant emploi des fonds secrets ; qui se montre plus arrangeant et plus expert pour organiser la chaîne de clientèles ; qui va du ministre au député, du député aux collèges électoraux, enregistre, collectionne, forme des dossiers des tares (p. 59) d'adversaires et d'amis, de manière à pouvoir les dominer et même les faire chanter à l'occasion ; qui plante des jalons à la Cour ; et qui réussit ainsi à se montrer habile, omnipotent, indispensable, et à se constituer une raison de domination presque absolue, laquelle, sous une forme de dictature plus ou moins dissimulée, se prolonge pendant des années, sous son nom et sous celui de ses substituts... En attendant, tout ce qui peut et doit venir à la lumière dans ce jeu de combinaisons et d'expédients, la forme visible que doivent prendre ces démêlés et ces embûches pour se concrétiser, s'expliquer et se dissimuler, la façon dont les divers intérêts doivent se colorer, se combattre et s'accorder aux yeux du public, tout cela est donné par le débat parlementaire, par l'usage qu'on y fait de la parole... La parole est le moyen de capter la faveur du public [d’une façon générale, la dérivation est le moyen d'émouvoir les sentiments] et d'attirer comme de distraire l'attention, et encore plus le moyen de simuler et de dissimuler, de blesser et de défendre. Tout cela, avec la conscience ou la semi-conscience que ce tournoi est au fond comme une cérémonie et une représentation. À les interroger, tous disent que les discours ne changeront pas une situation [ils reconnaissent pratiquement ce que nous avons exposé théoriquement dans le présent ouvrage], et qu'ils ne déplaceront pas un vote et ne tireront pas de l'huile d'un mur. Pourtant on fait des discours et parfois des discours intéressants [depuis que le monde existe, on fait usage des dérivations]. Les naïfs peuvent, quelquefois aussi, se faire illusion sur leur effet immédiat, tandis que les hommes de foi s'illusionnent ou se réconfortent en pensant que tout finit, dans la forme où il se manifeste (p. 60) ; mais en définitive, rien ne se perd... Mais la grande majorité des orateurs parlementaires sentent, consciemment ou non, qu'ils font leurs discours à la Chambre, comme l'acteur joue son rôle au théâtre... » N'oublions pas le ministre Rouvier qui, aux accusations qu'on lui adressait, à propos de l'argent extorqué à la compagnie du Panama pour un usage politique, répondit aux députés : « Si je n'avais pas fait cela, vous ne seriez pas ici ». On sait assez qu'en France, les grandes banques sont obligées de contribuer aux dépenses électorales du parti qui est au pouvoir. Quelques-unes donnent aussi de l'argent au parti d'opposition qu'on estime près d'arriver au pouvoir. Elles ont pour cela certains fonds secrets, ce qui leur permet de nier quand les journaux dénoncent les faits.
[FN: § 1713-5]
SALLUST. ; Bell. Iugurth., 35 : Urbem venalem, et mature perituram, si emptorem invenerit. – La Liberté, 16 février 1913 « M. Colly, qui ne mâche pas ses mots, disait hier à ses collègues de la Chambre „ Ah ! nous ne sommes guère bien notés dans le pays. Mais quand les électeurs me disent que la Chambre est pourrie et que les députés sont des viveurs et des jouisseurs, je leur réponds : Si les députés ne valent rien, c'est que les électeurs qui les nomment ne valent pas davantage “ ». Ainsi que nous l'avons souvent remarqué, ces formules littéraires employées pour décrire un phénomène ont l’avantage d'en donner une image vive, qui toutefois n'est pas précise et dépasse les limites de la vérité expérimentale.
[FN: § 1713-6]
Voir, par exemple : TOMASSO PALAMENGHI CRISPI ; Giolitti. Saggio Storico-biografico. En France, le ministre Rouvier redevint ministre après le Panama, et put dire aux députés que s'il n'avait pas fait ce qu'il fit après le Panama, eux n'auraient pas été à la Chambre. En Angleterre, Lloyd George reste ministre, après l'enquête sur les spéculations de bourse effectuées et niées par lui, de sorte qu’il dut reconnaître lui-même n'avoir pas dit la vérité.
[FN: § 1713-7]
Parfois aussi cela se passe ouvertement. Aux accusations portées par Cavallotti à Crispi, la Chambre italienne objecta qu'« elle n'avait pas à s'occuper de la question morale ». Aux accusations lancées contre Lloyd George, la Chambre anglaise objecta, en recouvrant à peine son intention du voile de la dissimulation, que frapper ce ministre eût été faire du tort au parti qui gouvernait le pays.
[FN: § 1714-1]
On sait assez que plusieurs collèges électoraux du midi de l'Italie sont de véritables fiefs. Un phénomène semblable se remarque en France. Gazette de Lausanne, 22 novembre 1912 (F. C.) : « Le procès qui vient de se dérouler devant les assises de l'Yonne jette un jour lamentable sur nos mœurs politiques départementales... Dans le petit chef-lieu de canton de Coursons-les-Carrières, deux listes sont en présence à l'occasion des dernières élections municipales : celle du maire sortant, M. Bouquet, conseiller général, et celle de M. Jobier père, conservateur des hypothèques à Paris. La veille du scrutin, M. Jobier est allé tenir une réunion dans un hameau de la commune, il rentre chez lui, croise dans la nuit des groupes plus ou moins menaçants, s'écarte un instant de ses amis, et reçoit traîtreusement un coup de gourdin qui l'étend à terre, gravement blessé. Son fils se précipite, le trouve ensanglanté, poursuit les malfaiteurs et décharge dans l'obscurité un revolver qu'il portait sur lui. Un ouvrier boulanger, qui répond au nom de Saligot, est tué net. Les jurés de l'Yonne ont acquitté le fils Jobier, qui avait passé plusieurs mois en prison préventive. ...Dans tous les domaines, c'est la même chose. Hier, au conseil municipal, un membre de la droite a mis en cause la discussion de l'Assistance publique à propos des agissements du médecin des enfants assistés de la commune d'Étang-sur-Arroux (bon nom pour une mare stagnante). Il a été établi que ce médecin avait exercé une pression sur les électeurs, en les menaçant de leur retirer les enfants qui lui étaient confiés, s'ils votaient mal. Cela a été tellement établi que le conseil de préfecture a dû casser l'élection, quoique ce ne soit pas beaucoup dans ses habitudes. Naturellement, quand M. Billard a porté ces faits à la tribune, les membres de la gauche ont crié à la calomnie. Malheureusement pour eux, un socialiste, qui se trouvait par hasard originaire de la commune en question, s'est levé de son banc et a déclaré que les faits déclarés étaient rigoureusement exacts. M. Mesureur a dû battre en retraite, plaidailler, demander qu'on ne généralisât pas ces faits exceptionnels, affirmer que la plupart des médecins étaient rigoureusement fidèles à leurs devoirs professionnels. Ce n'est pas exact. Le placement des enfants assistés est un procédé connu, cyniquement pratiqué, souvent avoué, de pression électorale : et l'Assistance publique, dirigée par un des grands francs-maçons de l'époque, est devenue une simple officine politique... Ce jeune homme a agi dans l'un de ces moments où l'on ne discute pas, où on laisse parler l'instinct, dans ce qu'il a parfois de plus spontané et de plus respectable. Dans une circonstance analogue, je crois bien que tout le monde aurait agi comme lui. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, et il y a des conclusions à tirer de ce drame. Les débats ont révélé que les passions politiques étaient poussées jusqu'à leur paroxysme. Il a été établi que les partisans du conseiller général chantaient des chansons dans lesquelles le père Jobier était traité de choléra, que plusieurs d'entre eux ne se gênaient pas pour dire : „ Il faut tuer les Jobier “. D'autre part, le procureur de la République a représenté le chef de cette dynastie comme un assez vilain merle, comme un vieillard tyrannique et dévoré d'ambition. Pourquoi donc tous ces gens-là luttaient-ils avec tant d'acharnement ? Pour des opinions ? Pas du tout ; ils avaient la même ! Ils étaient radicaux-socialistes les uns et les autres, et il parait même que le plus à gauche était le conservateur... des hypothèques. Ils luttaient tout simplement pour la possession du pouvoir, pour la possession de la mairie. Mais c'est une corvée, la mairie ! C'est entendu ; mais, dans un régime qui a été façonné de telle sorte qu'il faut être tyran ou tyrannisé, la mairie, c'est aussi la forteresse d'où l'on exerce avec sécurité ses déprédations. C'est le burg féodal où l'on case ses vassaux et où l'on entasse ses rapines. C'est l'arche sainte du clan et de la tribu. L'avoir ou ne pas l'avoir, c'est être ou ne pas être ». Ces deux faits ne sont que des types de milliers et de milliers d'autres semblables, qu'on observe en France et en Italie.
[FN: § 1714-2]
Le Giornale d'Italia, 10 octobre 1913, donne la liste des revenus professionnels des députés, empruntée à la Riforma Sociale. Il y a 22 avocats avec un revenu de 10 000 fr. et plus ; le plus gros revenu est de 30 000 fr... Viennent ensuite 42 avocats, qui gagnent de 5000 à 9000 fr. 42 autres avocats gagnent de 2000 à 4800 fr. 21 autres avocats ne gagnent que 700 à 1900 fr. (pauvres gens !). 7 autres ne figurent pas aux rôles de la fortune mobilière. Il y a 17 médecins. « Les autres revenus n'y sont pas représentés. Un seul touche 10 000 fr. ; trois autres atteignent 6000 et plus. De là, on descend tout à coup au-dessous de 4000, jusqu'à un minimum de 1000 fr. ». Ingénieurs et architectes : « Ils sont peu nombreux, et parmi eux un seul a un revenu important (25 000 fr.) ». Plusieurs des députés mentionnés dans la liste sont très connus, et tout le monde sait qu'ils retirent de leur profession beaucoup plus que la somme déclarée : le double, le triple et peut-être même le quintuple. On peut faire des observations analogues pour les sénateurs. Comment se fait-il donc que les parlementaires puissent faire accepter la déclaration de ces revenus pour le paiement de l'impôt ? Un correspondant du même journal (12 octobre 1913) va nous le dire : « À propos de la reproduction que nous avons donnée des résultats de l'intéressante enquête que la Riforma sociale publiera dans son prochain numéro, M. Antonio Corvini, président du Comité provincial de Rome des employés aux contributions directes, écrit une lettre dont nous donnons les passages importants. La voici : „ Les agents des contributions, dans l'accomplissement de leur tâche difficile, n'ont eu et n'ont pas de faiblesses ou de craintes révérencielles pour les députés et les sénateurs. Si donc, pour beaucoup d'entre eux, il faut regretter une taxation trop basse, c'est en divers systèmes et chez d'autres personnes qu'il faut rechercher et déplorer la faute. Il faut savoir, en effet, que si l'agent propose la détermination du revenu dans une mesure donnée, le contribuable peut recourir à des commissions spéciales, qui sont les juges de la controverse, lesquels ne sont pas toujours dépourvus de passions ni désintéressés. Malheureusement, en Italie, ces commissions communales et provinciales émanent directement des partis locaux, lesquels, à leur tour, ne sont que l'expression de monsieur le député, ou de monsieur le sénateur, qui, par ce fait, même sans l'angélique bonté de l'agent des contributions, obtiennent tout ce qu'ils veulent ou croient être justice à leur égard. C'est là un défaut commun à toute l'organisation administrative de notre pays : l'autorité politique qui s'impose et se superpose aux organes du pouvoir exécutif “... ». À la Chambre, dans la séance du 25 juin 1914, l'honorable E. Chiesa rappela que plusieurs députés payaient l'impôt de fortune mobilière sur un revenu évidemment inférieur à la vérité. On lui répondit par des propos malveillants ou des observations entièrement étrangères au sujet, mais personne n'osa nier, ou seulement mettre en doute la vérité des faits.
[FN: § 1715-1]
En Italie, en 1910, le commandeur Calabrese, substitut du procureur du roi et rapporteur d'une sous-commission chargée de préparer un projet de loi sur la presse, proposait d'exiger une caution de 500 fr. à 10 000 fr. de quiconque voudrait publier un journal. Le directeur du journal devait avoir la licence gymnasiale. Enfin, il devait y avoir des commissions de surveillance chargées de surveiller les journaux, afin qu'ils n'imprimassent rien de « contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à l'éducation civique et familiale ». Ces commissions auraient notifié, par l'intermédiaire d'huissiers, leurs décisions aux directeurs et aux gérants du journal, lesquels auraient dû insérer ces décisions dans le numéro suivant du même journal, sous peine de 200 fr. d'amende. Le commandeur Calabrese se donnait même la peine d'enseigner à ces commissions leur métier, et écrivait : « Au lieu d'exercer une influence calmante sur le public, au lieu d'en être le modérateur, le journal spécule sur l'émotivité des lecteurs. Ainsi, il me semble qu'il donne un relief excessif à tout ce qui est dramatique, passionnel, romantique, aux procès, aux assassinats, même s'ils ont lieu à l'intérieur de la Chine ou de la Patagonie ». On pourrait observer qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et qu'il n'y a pas lieu de faire cas des fantaisies qui peuvent passer par la tête d'un esprit bizarre. Mais à l'occasion de ces plaisantes inventions du commandeur Calabrese, une enquête fut faite par le Corriere d'Italia, et beaucoup de personnes d'autorité, tout en divergeant d'opinion d'avec le commandeur Calabrese sur les moyens, partageaient son avis sur le but à atteindre. Les hirondelles étaient donc tout un vol. Pour ne pas trop allonger cette note, nous nous bornerons à citer l'opinion du sénateur Filomussi Guelfi, professeur de philosophie du droit : « Mon œuvre de philosophe et de juriste s'inspire de cette conception fondamentale que le droit a sa base dans la morale, et que, par conséquent, il est logique que tout attentat à la moralité doive être réprimé par le droit. Et comme la presse ne néglige, de nos jours, aucune occasion ni aucun prétexte de violer les règles des mœurs, l'œuvre de la presse doit être soumise aussi à une sanction nouvelle et plus efficace. La censure a un passé odieux, une tradition ingrate pour nous autres Italiens. Elle nous rappelle de vieilles erreurs, de vieilles oppressions, de vieilles et curieuses intempérances ; elle évoque à nouveau pour nous l'Espagne et le régime espagnol ; en un mot, elle a une efficacité toujours discutable. Il s'agirait au contraire, à mon avis, d'imaginer de plus énergiques mesures répressives : d'infliger, dans les cas les plus caractéristiques d'attentat aux règles et aux lois tutélaires de la moralité, des punitions et des condamnations exemplaires. À mon avis, on devrait exercer une action éminemment répressive, qui ensuite, par la nature même du facteur juridique, deviendrait naturellement et spontanément préventive ». En juin 1914, un journal républicain d'Ancône publia un article dans lequel il paraît qu'il offensait la mémoire de Victor-Emmanuel II, dont vraiment la vie appartient maintenant à l'histoire. Si l'on prenait l'article pour ce qu'il était, c'est-à-dire politique, on ne pouvait saisir le journal ; et si on voulait le poursuivre, il fallait le traduire en Cour d'assises, où, selon toute probabilité, il aurait été acquitté. Par un tour de passe-passe, le gouvernement voulut considérer l'article comme coupable d'« offense à la pudeur », changeant ainsi pour le moins l'accessoire en principal. De la sorte, il put saisir le journal, le faire condamner par ses juges, et par-dessus le marché faire le procès à huis clos. Il faut prendre garde au fait que, dans des conditions analogues, la Restauration, en France, n'osa pas faire à huis clos le procès de P.-L. Courier, accusé lui aussi d'« offense à la morale publique », pour un opuscule évidemment politique.
[FN: § 1715-2]
Il y a trois rapports de la censure, qui concluent à l'interdiction de la représentation, laquelle fut ensuite accordée par le ministre Morny. – La censure sous Napoléon III. La Dame aux Camélias. Premier rapport : « (p. 10) …Cette analyse, quoique fort incomplète sous le double rapport des incidents et des détails scandaleux qui animent l'action, suffira néanmoins pour indiquer tout ce que cette pièce a de choquant au point de vue de la morale et de la pudeur publiques. C'est un tableau dans lequel le choix des personnages et la crudité des couleurs dépassent les limites les plus avancées de la tolérance théâtrale ». Et pourtant, aujourd'hui, on joue ce drame partout sans le moindre inconvénient. L'histoire de la Dame aux Camélias est un exemple remarquable des efforts que tentent parfois les gouvernements pour agir sur les mœurs en s'attaquant aux dérivations, et de la parfaite inanité de cette oeuvre (§1883). HALLAYS-DABOT ; loc. cit. §1749-1 : « (p. 15) La Dame aux Camélias fut longtemps interdite. Elle ne put être représentée qu'à la faveur d'une révolution. Le coup d'État du 2 décembre et l'avènement de M. de Morny au ministère décidèrent de son sort. Aujourd'hui [en 1871] le public est familiarisé avec le spectacle du monde interlope qui, depuis dix-huit ans, a envahi et, pour ainsi dire, absorbé le théâtre... Mais il y a vingt ans le vice avait des allures moins effrontées et plus casanières ; il gardait jusqu'à un certain point la pudeur de sa dégradation. Les réhabilitations sans nombre du drame et du roman ne lui avaient point fait un piédestal ». Il faudrait dire, en intervertissant les termes, que les changements des mœurs avaient provoqué l'éclosion des drames et des romans. L'auteur nous en donne lui-même des preuves dans son ouvrage cité §1747-1. Après thermidor « (p. 196) la censure laisse s'opérer dans les spectacles un mouvement de réaction des plus prononcé. Le théâtre, suivant toutes les fluctuations de l'opinion et tous les revirements de la politique, sera tantôt royaliste, tantôt républicain, selon le parti qui tiendra le pouvoir. » « (p. 220) La censure, sous l'Empire [de Napoléon 1er], était secondée par le public dans son travail d'épuration morale des théâtres. Il s'était fait une singulière réaction. Après toutes les débauches d'imagination, après tous les dévergondages d'esprit qui s'étaient produits sur les théâtres parisiens pendant plus de dix années, la lassitude et le dégoût s'étaient emparés des spectateurs ; se laissant emporter rapidement sur une pente contraire, ils en étaient arrivés à une pudibonderie intolérante [comme les vertuistes de nos jours]. Les gens éclairés gardaient toutes leurs admirations pour les grandes douleurs tragiques, le peuple n'avait d'oreilles que pour les lourds et larmoyants mélodrames. On ne voulait plus rire. Il est curieux de voir les censeurs s'inquiéter de cette pruderie des spectateurs ». La Dame aux Camélias a été la bête noire de bon nombre d'auteurs, qui s'imaginent que la morale peut être imposée par la suppression de certaines dérivations. – Mémoires du comte HORACE DE VIEL CASTEL, t. II, mercredi 11 février [1852] : « (p. 311) J'ai assisté hier à la représentation d'un drame d'Alexandre Dumas fils, joué au Vaudeville. Les théâtres sont soumis à la censure établie pour les forcer à respecter la morale, la pudeur publique, les bonnes mœurs [dans ses mémoires, Viel Castel décrit ces bonnes mœurs de son temps comme fort mauvaises]. La Dame aux Camélias, le drame d'Alexandre Dumas fils, est une insulte à tout ce que la censure devrait faire respecter. Cette pièce est une honte pour l'époque qui la supporte [c'est ce que répètent, pour d'autres productions, nos vertuistes contemporains], (p. 35) pour le gouvernement qui la tolère, pour le public qui l'applaudit [on a dit cela aussi du public qui applaudit le Phalène et d'autres semblables productions dramatiques] ...Toute cette pièce sur le vice et la débauche ; tous les acteurs en sont monstrueux, ceux-mêmes sur lesquels l'auteur a voulu répandre de l'intérêt sont ignobles... Il n'y a, pas à analyser une telle turpitude, c'est ignoble, mais le spectacle que présente la salle l'est encore plus... (p. 86) La police, le gouvernement tolèrent tous ces scandales, ils semblent ignorer que c'est ainsi qu'on achève la démoralisation d'un peuple ». En 1913, l'Académie française refusa de prendre part à la fête du bicentenaire de Diderot. Rendons-lui grâce de ce qu'elle ne réclame pas qu'on brûle les oeuvres de cet écrivain, et qu'on mette en prison quiconque les préfère aux ouvrages insipides de plusieurs académiciens.
[FN: § 1715-3]
Il est remarquable que les hommes pratiques, lorsqu'il ne s'agit pas de leur propre foi, voient à l'occasion très clairement ces phénomènes. BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : « (p. 183) Dans la politique comme sur le terrain de la foi religieuse, il ne peut jamais être opposé d'autre (p. 184) argument par le conservateur au libéral, par le royaliste au républicain, par le croyant à l'incrédule que ce thème rebattu dans les mille variations de l'éloquence [il y a, dans cette observation, le germe de toute la théorie des résidus et des dérivations] „ Mes convictions politiques sont justes et les tiennes sont fausses ; ma croyance est agréable à Dieu, ton incrédulité mène à la damnation “. Il est donc explicable que des guerres de religion sortent des divergences d'opinions religieuses et que les luttes politiques des partis, si toutefois elles ne se vident pas par la guerre civile, aboutissent du moins à la suppression des bornes que maintiennent dans la vie sociale, étrangère à la politique, la décence et l'honneur des gens de bonne compagnie ». Bismarck ne pensait qu'à la politique, mais son observation s'applique à la religion, à la morale, etc. Il conclut fort bien : « Mais, dès que devant sa conscience et devant le groupe on peut alléguer qu'on agit dans l'intérêt du parti [ou de sa propre foi, d'une façon générale], toute infamie passe pour permise ou du moins pour excusable ».
[FN: § 1716-1a]
Un livre excellent sur le sujet traité ici a été publié après que ces lignes ont été écrites. Voir : DANIEL BELLET ; Le mépris des lois et ses conséquences sociales, Paris, Flammarion éditeur, 1918.
[FN: § 1716-1]
Qu'on examine un catalogue de livres et d'opuscules de notre temps : on en trouvera un très grand nombre qui cherchent le moyen d'être utiles aux délinquants ; de réaliser leur « relèvement moral », d'inventer de nouvelles mesures en leur faveur, telles que la « loi du pardon », la condamnation conditionnelle, la libération conditionnelle, la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire, et ainsi de suite. Qu'on cherche ensuite les livres et les opuscules ayant pour but de sauvegarder les honnêtes gens des assassinats, des vols et d'autres délits, et l'on n'en trouvera que peu, très peu. La non-inscription de la condamnation au casier judiciaire est un excellent moyen d'induire en erreur l'honnête homme, qui prendra chez lui l'honorable malfaiteur ou l'emploiera d'une façon quelconque, et lui permettra ainsi de renouveler ses louables exploits. Mais cela importe peu : le désir d'être utile au malfaiteur, d'en protéger l'intégrité personnelle, domine toute autre considération. – Union Suisse pour la sauvegarde des Crédits, à Genève. Rapport du 233 février 1910 : « (p. 34) Nous avons eu plusieurs fois déjà à signaler dans nos rapports la position difficile qui nous est faite au sujet des antécédents judiciaires. Les négociants qui sont sur le point d'entrer en relations avec quelqu'un pour de l'emploi ou pour autre chose exigeant qu'on puisse avoir entière confiance, veulent savoir à qui ils ont affaire. D'autre part, les juristes écrivant sur la question prétendent que les méfaits ne doivent plus leur être rappelés, et leur point de vue est admis aussi par des personnes généralement en dehors des affaires, qui s'occupent de sociologie et de patronage. Il n'y a guère moyen de s'entendre, les uns, les commerçants, étant exposés à souffrir en donnant sans le savoir la préférence au candidat qui a des antécédents ; tandis que les autres, généralement des gens de profession libérale, ne sont jamais appelés à prendre les intéressés à leur propre service ».
[FN: § 1716-2]
A. BAYET ; Leçons de Morale, dans la collection AULARD : « (p. 114) Certaines personnes prétendent qu'il est permis de voler les gens très riches qui possèdent une grande fortune, bien qu'ils n'aient jamais travaillé... Ceux qui parlent ainsi ont tort. Sans doute il N'EST PAS JUSTE [ces termes et les suivants sont soulignés par l'auteur] qu'on puisse être riche sans travailler ; il n'est pas juste non plus que ceux qui travaillent soient pauvres, et tout le monde doit désirer que cela change. Mais pour que cela change, il suffit d'élire des députés et des sénateurs qui soient les amis des travailleurs pauvres ; et ces députés feront des lois pour que chacun soit plus ou moins riche, selon son travail. En attendant, il ne faut pas voler les gens riches ». On prendra bien garde que le motif qui doit détourner de faire cela est uniquement d'opportunité : il ne convient pas de faire maintenant et directement ce qu'on pourra bientôt obtenir de la loi. L'opinion exprimée dans le manuel de Bayet est importante, parce que ce manuel est généralement en usage dans les écoles primaires, en France, et parce qu'on a proposé une loi pour punir d'une peine de six jours à un mois de prison et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. ceux qui oseraient blâmer trop ouvertement l'enseignement de l'école laïque. – G. BERTHOULAT, dans La Liberté, 10 novembre 1912, dit en parlant de cette loi proposée par le ministre Viviani : « En somme, M. Viviani, fougueux libertaire, supprime froidement, sous prétexte de défense laïque, la liberté d'écrire, de parler et de penser. Il y aurait désormais un Syllabus primaire duquel il sera interdit de mal parler, ainsi que de ses pontifes, sous peine d'avoir affaire aux gendarmes ». Nous n'avons pas à rechercher ici si cela est utile ou nuisible à la société. Nous rappelons ces faits uniquement comme preuve de l'intensité de certains sentiments.
[FN: § 1716-3]
La plus grande partie des experts médecins – ou psychiatres, comme ils veulent qu'on les appelle – nommés par la défense, dans les procès criminels, s'évertuent à accuser la « Société », qui n'a pas eu tous les égards voulus envers le pauvre délinquant. Ces braves gens confondent l'étude des aliénés avec celle des conditions des sociétés humaines. Comme type de ce genre d'élucubrations, voici, selon le Giornale d'Italia, 18 mai 1913, comment parla devant les assises l'expert de la défense de la Farneris (Yvonne de Villespreux), laquelle avait tué son amant : « Suivez-la un peu dans son jeune âge : son enfance n’a été éclairée par aucune affection de famille, par aucune éducation, par aucun sentiment élevé. Le professeur P. a dit que le sens moral lui fait défaut. Et comment l'aurait-elle ? Elle ne peut posséder ce sens, si elle manque de tous les éléments qui sont nécessaires a le développer et à le faire évoluer. Dans la vie, elle a trouvé toujours des obstacles à tout ce qui était ses sentiments intimes mais non encore développés, et par conséquent elle n'a connu que l'idéal (sic) de la société, mais non l'amour. Elle est tombée comme tombent toutes les femmes et tous les hommes qui ont vécu comme elle. Il existe en elle un grand nombre de signes anthropologiques de dégénérescence ; ils ont une valeur limitée. Il est très probable cependant, qu'ils ont une part dans le genre de vie de la Villespreux ; et son impulsivité est précisément en rapport avec ce faible développement du sens moral, qui est la meilleure expression du (sic) sentiment. Le sens moral implique pourtant un grand respect envers la société et un grand amour. Quel respect et quel amour pouvait avoir la Villespreux pour la société ? Qu'avait-elle eu de celle-ci ? Généralement, le sens moral fait défaut toujours (sic) par la faute de la société, c'est-à-dire par un effet biologique. On sent en elle aussi l'hystérie, et précisément en ce sens large, comme dit le professeur P., qu'elle la rend changeante en toutes ses idées, parce qu'il n'y a pas d'organisation, et que ses produits mentaux sont précisément le résultat de cette désorganisation ». Donc, c'est entendu : chaque fois que le sens moral fait défaut à quelque délinquant, c'est la « faute » de dame « Société » ; mais est-ce aussi sa faute, si le sens scientifique fait défaut dans les discours des experts ? (§1766-1). L'expert de l'accusation, lui aussi, parlait de tout autre chose que de science médicale, tant et si bien qu'il fut remis à l'ordre par le président : « J'aurais voulu ne pas prendre part à cette discussion ; mais puisque je n'ai pu obtenir d'en être dispensé, je suis contraint de vous faire préalablement un tableau qui fasse ressortir la figure morale de cette malheureuse, et qui mette dans sa vraie lumière l'ambiance dans laquelle elle a vécu. Vous avez entendu comment elle a été, élevée par une certaine Giordano, qui la gardait en sa maison et lui tenait lieu de marâtre. Cette femme n'avait aucune des tendresses maternelles, et souvent, la pauvre Farneris souffrait de jeûnes et de mauvais traitements de tout genre, sentant la honte ignominieuse de n'être qu'une bâtarde. – Président. Mais, prof. P ., vous ne pouvez continuer ainsi, parce que vous devez nous dire de quelles preuves vous avez tiré ces éléments. – Prof. P. Mais, monsieur le Président... – Prés. Non, non, vous ne pouvez continuer ainsi. Vous devez nous dire sur quels faits vous vous fondez. – Prof. P. Mais ces faits sont résultés des débats. Il m'importe que vous ayez un tableau complet de l'accusée. – Prés. Mais cela ne peut être permis que sur la base de faits assurés. – Prof. P. Bien, laissons de côté les premières années. Nous savons qu'à treize ans, elle se trouva désemparée, et tout secours et tout guide lui fit défaut sur le chemin de la vie. Elle se trouva ainsi seule au milieu de la société, et dès le premier jour, elle se recommanda à une amie, pour qu'elle la fît aller en France, à la recherche d'un oncle maternel. Mais cela, elle ne put l'obtenir. Elle se rendit, au contraire, à Turin où elle trouva de l'emploi comme femme de chambre. Mais la Farneris n'avait rien de la femme de chambre. – Prés. Mais ces choses, qui vous les a dites ? – Prof. P. La Farneris. – Prés. Bien. – Prof. P. (continuant). La patronne était très violente. Un jour, elle jeta un chandelier contre la Farneris. Celle-ci s'échappa de la maison, et rencontra un homme dans l'escalier. – Prés. Mais cela, vous ne pouvez pas le dire. Comment continuer ainsi ? » – Reste ensuite à savoir pourquoi il doit être permis à ces gens, auxquels, par la « faute » de la « Société », le sens moral fait défaut, de se promener librement par le monde, et de tuer qui bon leur semble, faisant ainsi payer à un seul la « faute » qui est celle de tous les membres de la « Société ». Si du moins messieurs les humanitaires voulaient permettre que ces excellentes personnes, auxquelles, par la « faute » de la « Société », le sens moral fait défaut, fussent contraintes de porter quelque insigne bien visible sur leur vêtement, les gens pourraient les éviter, quand ils les verraient venir. Le fait raconté tout à l'heure a un épilogue. La « Société » si coupable envers la Farneris, racheta sa faute, au moins en partie, en la pourvoyant d'experts qui surent si bien la défendre, et de jurés qui, pour faire justice, l'acquittèrent entièrement. De plus, le président du tribunal lui fit, après l'acquittement, une belle allocution paternelle, l'exhortant a se « racheter par le travail ». Afin de lui donner le moyen de le faire, d'excellentes dames du beau monde vinrent la prendre en automobile, pour la conduire dans un refuge. Il est de pauvres mères de famille qui préfèrent élever honnêtement leurs enfants, au lieu de s'adonner à la vie joyeuse en accusant la « Société ». Si quelqu'une d'entre elles a entendu et vu tout cela, elle a peut-être pensé que dans les « fautes » de la « Société », à quelque chose malheur est bon : et si elle a entendu et vu la suite, elle a peut-être compris que si jadis le pécheur qui se convertissait pouvait être préféré au juste, aujourd'hui, grâce a la religion nouvelle du dieu Progrès, la conversion n'est même plus nécessaire. En effet, voici comment le Giornale d'Italia cité, enregistre la fin du drame : « Naples, 30 mai. – Les lecteurs se souviendront des paroles par lesquelles le président de la Cour d'assise, immédiatement après le verdict d'acquittement, exhortait la Villespreux à commencer une vie de travail qui puisse la racheter. Ils se souviendront aussi qu'un comité de nobles dames s'était intéressé à ce que la Farneris fût admise dans l'hospice qui reçoit les détenues libérées. Ce jour-là, après avoir prononcé quelques paroles de remerciements, la Villespreux s'excusa, disant qu'elle devait aller à la prison pour y prendre ses vêtements. Mais au retour de la prison, elle ne voulut plus suivre ces messieurs du patronat, et s'en alla sans qu'on n'eût plus de nouvelles d'elle. Le lendemain, on sut qu'elle était retournée via Chiaia, dans la maison contiguë à celle où fut tué Ettore Turdò, et précisément dans la maison de ce témoin qui, à l'audience, dit que Yvonne était une bonne fille, et qu'elle allait toujours chez lui, en venant à Naples, après les voyages qu'elle faisait en fille joyeuse. Elle est revenue dans cette maison, après avoir été acquittée d'un délit, et après avoir pleuré, comme elle disait, durant trente-huit mois la mort du pauvre Turdò. Et pourquoi tout cela devrait-il être un mal, ou mieux pourquoi tout cela devrait-il l'exprimer ? La Farneris a encore du temps pour se livrer au travail, et pour commencer sa vie de rédemption, peut-être dans la maison même où elle aurait dû terminer celle du déshonneur. Mais nous manquerions à l'un de nos devoirs, si nous n'enregistrions pas ce dernier acte du drame, de même que nous avons enregistré tout ce qui put absoudre cette femme. La nouvelle répandue en ville a causé une grande surprise ». Ceux qui ont été si surpris étaient probablement très humanitaires ou un peu naïfs. Il se peut aussi que ces deux caractères se trouvassent réunis en eux.
[FN: § 1716-4]
On observe des faits semblables dans d'autres pays aussi. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§1638), beaucoup de gens cherchent un condamné à « réhabiliter », dans le but de se faire connaître et de gagner de l'argent. À propos de la « réhabilitation » tentée en faveur de la Lafarge, MAURICE SPRONCK écrit dans La Liberté, 5 février 1913 : « Dans les pays musulmans, il existe ainsi des moines, les derviches hurleurs et tourneurs, dont l'occupation principale consiste, en certaines occasions, à pivoter de plus en plus rapidement sur eux-mêmes comme des toupies en poussant des cris éperdus de : Allah ou ! Allah ou ! Dans un délai plus ou moins long, ceux qui se livrent à ces exercices rotatifs et tumultueux tombent en un pieux délire ; ils voient les jardins et les sources fraîches du paradis de Mahomet et les houris qui attendent les fidèles. Chacun peut se rendre compte, en effet, que, après avoir suffisamment tourné et hurlé, on doit voir à peu près tout ce qu'on veut. De même, quand on a abondamment trépidé et crié à propos d'un procès quelconque, sur lequel on ne possède que des notions vagues, il semble infiniment probable qu'on se trouve dans un état de béatitude où toutes les hallucinations sont possibles ; la Justice et la Vérité descendent sur les nuages ; la Lumière se met en marche ; c'est la forme laïque de l'extase, la seule qui convienne à des esprits scientifiques et émancipés de toutes superstitions surannées. L'unique question intéressante serait maintenant de savoir si Mme Lafarge constitue un bon sujet pour la culture des crises extatiques. Nous n'en sommes pas sûrs. D'abord, elle est morte depuis longtemps ; on possède d'elle à peine quelques portraits qui nous la montrent habillée selon des modes désuètes ; et puis, il sera difficile de déchaîner, à propos de ses aventures, de profondes passions politiques ou religieuses ; elle était fâcheusement cléricale, savez-vous, si nous en croyons sa correspondance avec des curés, que vient de publier une de nos revues littéraires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une femme qui n'est pas même une victime des jésuites ? Un examen sérieux de son affaire aurait pu éveiller l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire des mœurs et aux études de psychologie. C'était déjà là un groupe restreint. La révision de son procès, menée à coups de meetings, n'attirera plus que quelques intellectuels de l'anarchisme, – mince phalange ; d'autant plus mince que ces intellectuels ont vraiment, dans les faits de notre vie quotidienne, d'autres occasions autrement palpitantes d'exercer leurs facultés et de s'échauffer le tempérament. En ce moment même, quelques-uns d'entre eux ont déjà fondé une association qui a pour but d'accorder à tout citoyen le droit de transformer son habitation en lieu d'asile pour les assassins et les cambrioleurs, dès l'instant où ceux-ci font profession d'anarchie. Par le temps qui court, avec la parfaite sécurité dans les rues que nous a value l'énervement de la répression pénale, il n'y a évidemment pas d'idée plus opportune ; il est excellent que les protecteurs et amis des plus redoutables escarpes sachent que la loi les protège et qu'ils ne peuvent être inquiétés par la police. Et, comme un de ces philanthropes au moins se trouve actuellement sur les bancs de la cour d'assises, sous prévention de complicité dans un assassinat, on comprend, si le jury le déclare coupable, à quel point ce sera une besogne plus urgente de réhabiliter ce sympathique personnage, que de s'occuper de Mme Lafarge et de discuter la quantité d'arsenic contenue dans les viscères de son mari ! »
[FN: § 1716-5]
Les faits qu'on pourrait citer sont en nombre infini. En voici deux comme types : le premier d'un délinquant particulier, le second d'une collectivité : « La Liberté, 29 mars 1913. Creil. – La gendarmerie de Creil vient d'arrêter un individu dont l'odyssée est loin d'être banale, André Pavier, jeune homme de 27 ans, qui, en 1911, s'évada du pénitencier de Douera (Algérie). Pavier est originaire de Saint-Denis. À l'âge de la conscription, il fut incorporé dans l'infanterie coloniale, commit des frasques qui le conduisirent en conseil de guerre, gifla le colonel qui présidait la séance, fut condamné à mort, bénéficia d'une commutation de la peine en 5 ans de prison et fut envoyé au pénitencier de Douera. Il n'avait plus que deux années à faire, lorsqu'un jour, profitant d'un moment d'inattention du sergent, il assomma le soldat indigène préposé à la garde des prisonniers, s'enfuit vers le rivage, sauta dans la chaloupe du poste et gagna la haute mer sans être atteint par les projectiles qui lui étaient destinés. Des pêcheurs espagnols le recueillirent deux jours après, plus mort que vif, et le déposèrent sur la côte près de Valence. Pavier vécut alors de vols et de rapines. Il ne tarda pas à passer la frontière, traversa la France en évitant avec soin Saint-Denis et arriva à Lille vers juin 1912.
Il fut arrêté en cette ville sous l'inculpation de filouterie d'aliments et condamné à six jours de prison, mais on ignora tout de son passé. Depuis trois mois Pavier s'était fixé à Villers-Saint-Paul, près de Creil. Il y travaillait dans une usine voisine située sur la ligne de Creil à Compiègne. C'est à Villers qu'il a été arrêté. Il y a quelques jours – Pavier se flatte d'avoir de hautes relations – il écrivit à un député, lui demandant si une amnistie n'avait pas été votée intéressant les gens dans son cas. Très complaisamment, le député lui répondit qu'aucune amnistie n'était intervenue et termina sa lettre en conseillant très vivement à son correspondant de redoubler de précautions s'il ne voulait pas se faire arrêter. La lettre du député parvint aux mains de la police et c'est ainsi que Pavier fut découvert ». – La Liberté, 6 avril 1912 : La grâce des émeutiers de la Marne. L'article est trop long pour que nous le transcrivions en entier, ce qui pourtant serait utile pour faire connaître les caractères généraux de ces faits, qu'on observe souvent, non seulement en France, mais aussi en Italie et en d'autres pays. Nous supprimons les noms propres, parce que la principale erreur, en cette matière, consiste précisément à rendre un homme responsable de ce qui est l'effet d'organisations sociales. On dit, en parlant d'un ministre : « Après avoir surveillé la marche de l'instruction judiciaire, après avoir rétréci le cercle des sévérités pénales autour de quelques têtes qui avaient surgi en trop évidente clarté dans la flambée des châteaux et des celliers, il lui restait à sauver les derniers soldats de l'émeute condamnés par les tribunaux de la Marne et la Cour d'Assises de Douai. C'est fait. Plus un éventreur de tonneaux, plus un pillard n'est enfermé dans les geôles de la République. M. le sénateur *** a payé aux émeutiers la dette de sa reconnaissance politique... Ce fut un douloureux calvaire judiciaire que l'instruction de ces troubles et de ces crimes. Par ordre, la procédure fut communiquée le 20 mai 1911 à M. le garde des sceaux, qui était alors M. Perrier ; les pièces ne retournèrent au parquet que huit ou dix jours après, puisque l'ordonnance du juge d'instruction n'a été rendue que le 3 juin. En quel état le dossier fit-il retour au greffe du parquet de Reims ? Le gouvernement, qui avait empêché, plusieurs documents importants d'arriver au cabinet du juge d'instruction pendant l'enquête, ne prit-il pas ses sûretés en ce qui concerne la preuve des responsabilités politiques engagées dans l'affaire ? Quoi qu'il en soit, en dépit des manœuvres de M. Vallé et de la pression gouvernementale qui en répercutait l'écho aux portes de l'instruction, quelques douzaines d'émeutiers furent renvoyés en Cour d'Assises ou traduits devant les tribunaux correctionnels. Sept furent condamnés par la Cour d'Assises de Douai à des peines variant entre 4 ans et un mois de prison. De son côté, la Cour d'Appel confirma treize condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de la Marne et pour sept d'entre elles éleva la peine de 10 mois à 18 mois... Que faut-il penser des actes qui amenèrent leurs auteurs devant la justice criminelle ? Les arrêts de renvoi en Cour d'Assises et l'acte d'accusation concernant les émeutiers condamnés vont nous le rappeler. Le premier est accusé d'avoir volontairement mis le feu à la maison Gallois et d'avoir commis le crime de pillage dans la maison Bissinger. On le voit sur le toit de la maison Gallois ; il enlève les tuiles et jette à l'intérieur des sarments enflammés [c'est l'auteur qui souligne ce passage et les suivants]. Le feu s'est déclaré aussitôt et la maison a été consumée. Le second est accusé du crime de pillage dans les maisons... Le drapeau rouge à la main, il guide les émeutiers vers les portes de ces maisons qui sont enfoncées. Le troisième s'acharna pendant deux heures à la destruction du coffre-fort de la maison Bissinger. Après l'avoir défoncé à l'aide d'une pince en fer, il brûla les titres, les pièces de comptabilité et tous les papiers de commerce. Le quatrième a également pris part au sac de la maison Bissinger. Le cinquième sonne le tocsin pour donner le signal du pillage de la maison Ayala et de la maison Deutz. Il brise une palissade pour pénétrer dans la maison... Les décrets de grâce sont rendus le 9 février. Le 15 on signale des sabotages à Pommery ; le 21, le 22 et le 25, d'autres sabotages sont commis à Hautvilliers, à Cumières, etc. ». C'est là la monnaie dont les politiciens paient leurs électeurs, précisément comme autrefois les chefs de bandes payaient leurs hommes.
[FN: § 1716-6]
Laissons de côté certains procès comme celui de la Steinheil, où l'accusée jouit de hautes protections ou de complicités politiques. Ceux-là sont étrangers aux sujets. Mais en d'autres procès, où ces protections ou complicités n'existent pas, on voit l'accusé le prendre de haut avec le président de la Cour d'assises. Parmi beaucoup d'exemples, le suivant suffira. En février 1913, eut lieu, devant la Cour d'assises de la Seine, le procès de la bande de malfaiteurs connue sous le nom de bande Bonnot et Garnier. Voici quelques fragments de l'interrogatoire des accusés : D. (Président) Vous êtes poursuivi dans votre pays à l'occasion de vos idées. – R. (Callemin, dit Raymond la Science). Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas ici d'un procès politique, et vous ne parlez que de politique et d'anarchie. – D. Vous voulez dire que je manque de logique. Cela m'est égal. Je conduis mon interrogatoire comme il me plaît. – R. Eh bien, je ne vous répondrai pas, quand cela me plaira, voilà tout ! – D. C'est votre affaire. – En fait, Callemin laisse passer quelques questions sans fournir de réponse ». Suivent d'autres demandes, auxquelles l'accusé répond avec l'insolence habituelle, et après l'une d'elles, « comme le président conteste la véracité de cette explication, Callemin s'emporte. Le Président. Je fais mon devoir ! – Callemin. Pas de la bonne façon. Un individu a écrit : „ J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon “. Vous agissez, vous, avec la plus entière mauvaise foi. – Président. Vos injures ne m'atteignent pas. Continuons ». En d'autres temps, on aurait procédé séance tenante à la répression des injures aux magistrats. À un certain point de l'interrogatoire d’un autre accusé, l'avocat intervient aussi pour remettre à l'ordre ce pauvre président. « Comme dans la salle se font entendre quelques rumeurs dont il est impossible de préciser le sens, M. le président Coninaud s'élève contre cette manifestation : „ Je ne veux pas qu'on manifeste contre les accusés “. „ C'est contre vous qu'on manifeste “, réplique M. de Moro-Giafferi. Nous avons un public d'une générosité [sic, non pas imbécillité] admirable. – „ Je ne veux pas “, reprend M. Coninaud, „ qu'on manifeste ni pour moi, ni pour ni contre vous “ ». La vérité nous oblige d'ajouter que le président ne fut pas conduit en prison par les gendarmes.
[FN: § 1718-1]
Manuel, VII, 47, p. 397.
[FN: § 1718-2]
On peut souvent pousser plus loin les recherches, et séparer les diverses parties d'un phénomène. Un grand nombre de phénomènes sont constitués par des variations de diverses entités. Par exemple, si le phénomène concret est figuré par mnpqrstv, on observe : 1° que cette ligne oscille autour de la ligne ondulée MNPQ ; 2° que cette ligne oscille, à son tour, autour de la ligne AB. En d'autres termes, il y a des oscillations d'ampleur différente ; soit : 1° des oscillations de courte durée indiquées par la ligne mnpqrstv ; 2° des oscillations d'ampleur moyenne, indiquées par la ligne MNPQ ; 3° des oscillations de plus grande ampleur, indiquées par la ligne AB ; et ainsi de suite. L'interpolation nous permet de séparer ces diverses espèces d'oscillations. V. PARETO ; Quelques exemples d'application des méthodes d'interpolation à la statistique, dans Journal de la Société de Statistique de Paris, novembre 1897 : « Lorsqu'on applique cette formule aux chiffres que donne la statistique, on observe, en général, que les courbes simples qu'on obtient successivement ne vont pas en se rapprochant d'une manière uniforme de la courbe réelle, la précision commence d'abord par augmenter rapidement ; ensuite il y a une période où elle augmente lentement, de nouveau elle augmente rapidement, et ainsi de suite. Ces périodes pendant lesquelles la précision augmente lentement séparent les grands groupes de sinuosités dont nous avons parlé ; en d'autres termes elles séparent les groupes d'influences de plus en plus particulières qui s'exercent sur le phénomène ». Suit un exemple, qui est celui de la population de l'Angleterre, et l'on conclut : « On voit que les indices de précision croissent rapidement jusqu'à celui qui correspond ![]() ; ensuite ils croissent beaucoup plus lentement. Dans le cas que nous examinons, on trouve donc que sur la population agit un premier groupe de forces, qui donnent au phénomène la forme indiquée par les quatre premiers termes de la formule (2) : les autres termes représentent des perturbations, des irrégularités ». On trouvera d'autres exemples dans la suite (§2213 et sv.).
; ensuite ils croissent beaucoup plus lentement. Dans le cas que nous examinons, on trouve donc que sur la population agit un premier groupe de forces, qui donnent au phénomène la forme indiquée par les quatre premiers termes de la formule (2) : les autres termes représentent des perturbations, des irrégularités ». On trouvera d'autres exemples dans la suite (§2213 et sv.).
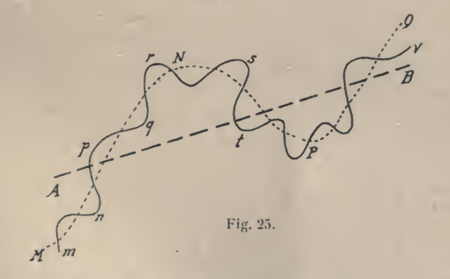
Figure 25
[FN: § 1719 bis-1]
Ces sentences ont donné lieu à beaucoup de paradoxes et de fantaisies littéraires ; souvent elles ont été entendues dans le sens qu'il n'y a pas de faits nouveaux, ce qui est faux. C'est là le défaut et le danger de ces sortes d'assertions qui manquent de précision : on en peut, tirer tout ce que l'on veut(§1558 et sv.,1797 et sv.). Comme exemple de paradoxes, on peut citer les deux volumes : Le vieux-neuf. Histoire ancienne des inventions et découvertes modernes par ÉDOUARD FOURNIER – Paris – 1859. L'auteur, par des rapprochements forcés et des analogies lointaines, souvent imaginaires, démontre que « p. 1) Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié ». Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, de fantaisies littéraires, le suivant suffira. ÉMILE BERGERAT ; Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance– Paris – 1879 : « (p. 118) ...[Bergerat] La langue du XVIe siècle vous parait-elle suffisante à tout exprimer ? En un mot, admettez-vous les néologismes ? – [Gautier] Veux-tu parler de la nécessité de dénommer les soi-disant inventions et les prétendues découvertes modernes ? Oui, on dit cela : „ à choses nouvelles, mots nouveaux “. Tu connais mon avis là-dessus. Il n'y a pas de choses nouvelles. Ce qu'on appelle un progrès n'est que la remise en lumière de quelque lieu commun délaissé. J'imagine qu'Aristote en savait aussi long que Voltaire, et Platon que M. Cousin. Archimède avait très certainement trouvé l'application de la vapeur à la locomotion bien avant Fulton et Salomon de Caus. Si les Grecs ont dédaigné de s'en servir, c'est qu'ils avaient leurs raisons pour cela... »
[FN: § 1719 bis-2]
DUGAS MONTBEL ; Obs. Sur l'Iliade d'Hom., t. I : « (p. 70 – chant II, v. 38) ...Ici j'observerai que presque toujours le poète latin [Virgile] prend le mouvement de la phrase homérique, parce que c'est là qu'est l'expression de l'âme, qui ne change jamais. Les mœurs, les usages, les habitudes des hommes, sont sans cesse modifiés par la civilisation ; mais les passions ne varient pas selon les siècles, et la voix du cœur est la même dans tous les temps.
Il en est ainsi de tous les poètes. Lorsque Racine imite Homère, il suit aussi le même mouvement de phrase, quoique sa poésie soit empreinte (p. 71) des mœurs de son siècle, et qu'on y retrouve toutes les idées d'une société différente ». À propos des vers 116-117 du Ve chant, l'auteur cite des imitations de Virgile et de Boileau, et il ajoute : « (p. 280) Virgile et Boileau ne parlent point des cuisses des brebis et des chèvres, ni de la graisse qui les recouvre; leurs idées sont celles de leur siècle. Mais ils prennent à Homère tout ce qui tient à l'expression de l'âme ; voilà la véritable imitation, la seule que se permette le génie ». Plus loin : « (p. 296 – chant VI, v. 303) ...J'ai déjà fait observer bien souvent que si les imitateurs d'Homère diffèrent de lui pour les détails de mœurs, de coutumes, d'usages, ils s’attachent à le suivre avec une heureuse fidélité dans tout ce qui tient à l'expression des sentiments, expression qui ne peut varier, parce que le fond du cœur humain est toujours le même ».
[FN: § 1719-bis3]
Les utopistes qui veulent donner la « nature » de l'homme comme fondement à leurs études sur la société et sur les réformes suggérées par leur fertile imagination, cherchent, sans parfois s'en rendre bien compte, une partie constante que l'instinct les pousse à reconnaître dans les phénomènes sociaux : un terrain solide pour y développer leurs rêveries. Mais ils atteignent ce but à peu près comme l'homme qui s'imagine que le soleil se plonge chaque soir dans l'Océan, arrive à se rendre compte du mouvement des corps célestes.
[FN: § 1726-1]
CAT. : De re rust. – EURIP. ; Orest. L'auteur oppose aux politiciens, peste de la cité, un brave agriculteur. « (918) Il n'est pas de belle apparence, mais c'est un homme viril (919), qui fréquente peu la ville et le cercle de la place publique, (920) un de ces paysans qui seuls sauvent leur pays... ». Aristote aussi parle longuement d'un semblable sujet.
[FN: § 1728-1]
D. CYRILL. ; Contra Iulianum, 1, IV : « (p. 148) c'est pourquoi nous disions donc que si Dieu n'avait pas assigné à chaque peuple un gouverneur qui fût son sujet [à Dieu], ange ou démon, préposé à la réglementation et à la protection d'un genre particulier d'âmes, de façon à pouvoir établir des différences dans les lois et les mœurs, en ce cas il faudrait nous expliquer de quelle autre cause cela peut tirer son origine ». L'empereur discute avec ceux qui voulaient expliquer par la confusion des langues, survenue après la construction de la tour de Babel, la diversité des lois et des mœurs. Il dit qu'on voit aussi de semblables différences dans les corps ; « si l'on observe combien les Germains et les Scythes diffèrent des Libyens et des Éthiopiens, peut-on attribuer cela à un simple ordre, sans que ni l'air, ni la situation de la terre et les dispositions du ciel y aient part ? » Saint Cyrille répond que les chrétiens attribuent comme causes à la différence de la vie et des mœurs, des tendances de la volonté et les enseignements des ancêtres.
[FN: § 1731-1]
PH. HATT ; Des marées : « (p. 9) Newton a donné la première explication précise de la cause des marées : les considérations qu'il a développées sont de deux sortes. En concevant un canal circulaire entourant toute la terre, il analyse sommairement le mouvement horizontal des molécules qui s'y trouvent contenues sous l'influence des attractions des astres et observe qu'il doit entraîner une élévation et un abaissement successifs du niveau. Mais il envisage la question de plus haut pour arriver (p. 10) à la théorie analytique du phénomène ; sans se préoccuper du mouvement des molécules, Newton cherche la figure momentanée d'équilibre que prendrait la masse des eaux sous l'influence de la force attractive d'un astre et détermine la forme et la dimension de la surface, qui serait celle d'un ellipsoïde dont le grand axe serait constamment dirigé vers l'astre ; par suite du mouvement de la terre, la déformation en fait le tour en 24 heures ; le niveau monte donc et descend en chaque point deux fois par jour. Mais l'hypothèse sur laquelle repose la théorie de Newton est inconciliable avec la rapidité de ce mouvement [ce qui n'a pas été un motif pour repousser les théories mathématiques des marées, mais a été au contraire un motif de les perfectionner] ; les molécules liquides, sollicitées à chaque instant vers une nouvelle position d'équilibre, ont évidemment une tendance à la dépasser et à accomplir des oscillations régies par les lois de la dynamique. Le problème des marées exige donc l'intervention de la théorie du mouvement des liquides sur laquelle repose l'analyse de Laplace [c'est ainsi qu'en économie mathématique, on est passé de la théorie de Cournot aux théories modernes, et qu'on passera de celles-ci aux théories futures]. Le livre IV de la Mécanique Céleste est tout entier consacré à l'étude théorique, et pratique des oscillations de la mer, et l'on peut dire que la théorie pure n'a pas subi de modifications sensibles depuis qu'elle a été établie sur ses bases par le grand analyste ; la (p. 11) solution générale de ce difficile problème est encore à découvrir. Malgré tous les efforts des géomètres, la théorie a été jusqu'à présent impuissante non seulement à se plier à l'infinie variété des conditions terrestres, mais même à aborder la question autrement que dans les conditions très simples d'un sphéroïde entièrement recouvert d'eau. Mais si nous envisageons le point de vue pratique, l'analyse a été d'une extraordinaire fécondité. Le principe général de correspondance entre les forces périodiques et le mouvement de la mer qu'il a mis en lumière [en économie mathématique : le principe de la mutuelle dépendance, que nous étendons ici aux phénomènes sociologiques] a servi de point de départ pour l'étude des marées de Brest, à laquelle est consacrée la fin du quatrième livre et la presque totalité du treizième livre de Mécanique Céleste. C'est sur ce même principe qu'a été fondée en Angleterre, par sir William Thomson, la méthode de l'analyse harmonique, aussi remarquable par sa simplicité que par son inflexible logique, et qui paraît devoir servir de couronnement à l'édifice de l'étude empirique de la marée, en offrant le plus puissant moyen d'investigation pour la décomposition en ses éléments du mouvement complexe de la mer ».
[FN: § 1731-2]
Un même auteur peut développer la théorie dans les deux sens. LAPLACE ; Traité de mécanique céleste, Paris, an VII – t. II, 1. IV. Après avoir établi la formule abstraite des marées, en de certaines hypothèses, l'auteur fait la remarque suivante à propos d'une des conséquences de cette formule : « (p. 216) ...or nous verrons dans la suite, que ce résultat est contraire aux observations ; ainsi quelque étendue que soit la formule précédente, elle ne satisfait pas encore à tous les phénomènes observés. L'irrégularité de la profondeur de l'océan, la manière dont il est répandu sur la terre, la position et la pente des rivages, leurs rapports avec les côtes qui les avoisinent, les résistances que les eaux éprouvent, toutes ces causes qu'il est impossible de soumettre au calcul, modifient les oscillations de cette grande masse fluide. Nous ne pouvons donc qu'analyser les phénomènes généraux qui doivent résulter des attractions du soleil et de la lune, et tirer des observations, les données dont la connaissance est indispensable, pour compléter dans chaque port, la théorie du flux et du reflux de la mer... » Plus loin, après avoir établi ses formules : « (p. 241) Comparons les formules précédentes aux observations. Au commencement de ce siècle, et sur l'invitation de l'Académie des Sciences, on fit dans nos ports, un grand nombre d'observations du flux et du reflux de la mer : elles furent continuées chaque jour à Brest, pendant six années consécutives, et quoiqu'elles laissent à désirer encore, elles forment par leur nombre, et par la grandeur et la régularité des marées dans ce port, le recueil le plus complet et le plus utile que nous ayons en ce genre. C'est aux observations de ce recueil, que nous allons comparer nos formules ». Nous avons là un exemple de la méthode à suivre : ajouter, perfectionner, et non détruire (§1732).
[FN: § 1731-3]
Par exemple, les dérivations protectionnistes se prêtant beaucoup mieux que les théories scientifiques de l'Économie, à la défense du système protecteur, il y a un excellent motif subjectif pour que les personnes tirant ou espérant tirer quelques avantages directs ou indirects de ce régime donnent la préférence aux dérivations ; mais un tel motif n'existe pas pour qui se place simplement au point de vue objectif de la recherche des rapports qu'ont entre eux les faits.
[FN: § 1732-1]
Très souvent, l'ordre chronologique des trois procédés est différent de celui indiqué tout à l'heure, dans lequel, partant du plus erroné on va au plus parfait. L'ordre chronologique se rapproche de l'ordre (1), (2b), (2a). On a pu l'observer en économie. L'ancienne économie employait le procédé (1) ; puis on fit un saut jusqu'au procédé (2b), avec l'économie mathématique ; et maintenant, grâce aux enseignements de celle-ci, on peut employer le procédé (2a). Deux ouvrages d'économie dans lesquels on fait usage de considérations de cause à effet peuvent différer entièrement. Si ces considérations ne s'achèvent pas par celles de la mutuelle dépendance, si l'on ne fait pas suivre l'étude des actions de celle des réactions, et surtout si l'on ne sépare pas celles qui sont principales de celles qui sont secondaires, on a une étude suivant le procédé (l) : elle est donc presque toujours entachée de graves erreurs. Si, au contraire, instruit par les résultats de l'économie mathématique (2b), on raisonne néanmoins en se servant de considérations de cause à effet, mais en tenant compte de la mutuelle dépendance, grâce à l'étude des actions et des réactions, et en séparant les principales des secondaires, on a une étude suivant le procédé (2a), étude qui peut se rapprocher beaucoup de la réalité.
[FN: § 1732-2]
Manuel, III, 217, 218, p. 233-234. Plusieurs économistes sont tombés dans l'erreur de supposer que les théories de l'économie pure pouvaient s'appliquer directement au phénomène concret, et Walras croyait pouvoir réformer ainsi la société. À ce propos, voir : P. BOVEN ; Les applications mathématiques à l'économie politique.
[FN: § 1732-3]
Manuel, III, 228 « (p. 247) La principale utilité que l'on retire des théories de l'économie pure est qu'elle nous donne une notion synthétique de l'équilibre économique, et pour le moment nous n'avons pas d'autre moyen pour arriver à cette fin. Mais le phénomène qu'étudie l'économie pure diffère parfois un peu, parfois beaucoup du phénomène concret ; c'est à l'économie appliquée à étudier ces divergences. Il serait peu raisonnable de prétendre régler les phénomènes économiques par les seules théories de l'économie pure ». Très souvent, aux théories de l'économie appliquée il faut ajouter celles de la sociologie. « 217 (p. 233) Les conditions que nous avons énumérées pour l'équilibre économique nous donnent une notion générale de cet équilibre... pour savoir ce qu'était l'équilibre économique, nous avons dû rechercher comment il était déterminé. Remarquons d'ailleurs que cette détermination n'a nullement pour but d'arriver à un calcul numérique des prix. Faisons l'hypothèse la plus favorable à un tel calcul ; supposons que nous ayons triomphé de toutes les difficultés pour arriver à connaître les données dit problème... C'est là déjà une hypothèse absurde, et pourtant elle ne nous donne pas encore la possibilité pratique de résoudre ce problème… si l'on pouvait vraiment connaître toutes ces équations [de l'équilibre], le seul moyen accessible aux forces humaines pour les résoudre, ce serait d'observer la solution pratique que donne le marché ».
Comme nous l'avons fait voir (Encyclopédie des sciences mathématiques), une infinité de fonctions-indices sont propres à faire voir comment est déterminé l’équilibre économique. Le choix qu'on en fait est une simple question d'opportunité. En particulier, le choix des lignes d'indifférence n'a pas le moins du monde pour but de mesurer pratiquement l'ophélimité ; son but est seulement de mettre en rapport, avec les conditions de l'équilibre et les prix, certaines quantités, que l'on peut supposer théoriquement mesurables.
Des observations analogues doivent être faites au sujet de la sociologie. Celle-ci n'a nullement pour but de nous dévoiler le détail des événements futurs ; elle n'a pas repris la suite des affaires de l'oracle de Delphes et ne fait aucune concurrence aux prophètes, sibylles, devins et voyantes ; elle vise seulement à connaître, en général, les uniformités qui ont existé par le passé, et celles qui ont quelque probabilité d'exister dans l'avenir, ainsi que les caractères généraux et les rapports de toutes ces uniformités.
[FN: § 1732-4]
Ces erreurs sont très bien mises en lumière dans l'ouvrage de G. SENSINI La Teoria della Rendita.
[FN: § 1732-5]
V. PARETO ; Le mie idee, dans Il Divenire Sociale, 16 juillet 1910 : « (p. 195) ...l'économie pure n'est qu'une espèce de comptabilité ; et la comptabilité d'un commerce ne peut nous donner la physionomie véritable de ce commerce... L'économie est une petite partie de la sociologie, et l'économie pure est une petite partie de l'économie. Par conséquent, l'économie pure seule ne peut nous donner de normes pour régler pratiquement un phénomène concret ; elle ne peut pas non plus nous faire connaître entièrement la nature de ce phénomène ».
[FN: § 1737-1]
BAYLE ; Dict. hist., s. r. Lubienietzki, rem. (E). L'auteur parle d'une persécution religieuse. «Je ne sai s'il y eut jamais de matiere plus féconde que celle-ci en repliques et en dupliques : on la peut tourner plusieurs fois de chaque sens : et de là vient qu'un même Auteur vous soutiendra aujourd'hui que la vérité n'a qu'à se montrer pour confondre Mérésie, et demain que si l'on souffroit, à l'Hérésie d'étaler ses subtilitez, elle corromproit bientôt tous les habitans. [Le premier groupe de résidus est constitué principalement par l'autorité de la religion du sujet, par la vénération que celui-ci a pour elle ; le second, par le besoin d'uniformité.] Un jour on vous représentera la vérité comme un roc inébranlable ; un autre jour on vous dira qu'il ne faut point la commettre au hazard de la Dispute, et que c'est un choc où elle se briseroit par rapport aux auditeurs ».
[FN: § 1744-1]
Cette erreur était coutumière chez les gouvernements du passé, et l'on peut encore la remarquer en des temps plus rapprochés des nôtres, en France, comme propre au gouvernement de la Restauration et à celui du Second Empire. À cette erreur s'en joint habituellement une autre : celle de croire qu'en usant de la force et en condamnant les dissidents, on peut faire naître le sentiment religieux là où il n'existe pas, et le fortifier là où il existe. Souvent, il s'y ajoute encore une autre erreur, qui consiste à confondre le sentiment religieux en général avec le sentiment d'une certaine religion particulière. C'est pourquoi les gouvernements épuisent leurs forces à vouloir imposer à leurs sujets la religion X ; et, en supposant même qu'ils obtiennent quelque effet, c'est uniquement celui d'imposer l'hypocrisie et de favoriser par conséquent les nombreux vices qu'elle entraîne. Mais quand bien même on obtiendrait en partie l'effet désiré, cela serait peu ou pas du tout utile, étant donné le but qu'on se proposait en voulant imposer la religion X : faire croître l'honnêteté des mœurs et la fidélité des sujets. Cela n'empêche pas que, lorsque ce sentiment religieux est une manifestation spontanée de l'honnêteté des mœurs et de la fidélité des sujets, il convient de ne pas l'offusquer, si l'on veut favoriser cette honnêteté et cette fidélité (§1753). Les gouvernements modernes qui suivent la religion du Progrès repoussent dédaigneusement tout appui de l'ancienne religion a, pour régler la vie civile ; mais ils lui substituent d'autres religions. Beaucoup d'entre eux sont portés à faire jouer ce rôle à la religion sexuelle f, renouvelant ainsi une erreur commise aussi par les gouvernements passés. On peut remarquer, en effet, que celui qui est honnête et modéré dans les diverses manifestations de son activité, l'est aussi en celles de l'activité sexuelle : par conséquent, il n'est pas difficile de montrer qu'en général, pour le plus grand nombre, l'observation des règles de la religion sexuelle f est liée à l'observation des règles d'une religion a, de l'honnêteté b, des bonnes mœurs c, de l'honorabilité d, etc. De là provient l'erreur de considérer f comme la cause, au moins partielle, de a, b, c, d... C'est justement parce que cette erreur est très commune, que nous avons nombre de fois apporté des preuves pour démontrer que f n'est nullement la cause, même partielle, de a, b, c, d... À cette erreur, on en ajoute une autre, plus grande, et qui en est proprement la conséquence. On admet qu'en agissant sur f, on agit de ce fait aussi sur a, b, c, d. et l'on atteint un extrême où, lorsqu'on s'imagine, qu'en imposant par la loi
l'hypocrisie sexuelle, on atteint le but d'avoir de bons, d'honnêtes et sages citoyens. Les très nombreux et très évidents démentis donnés par l'expérience historique sont impuissants à ôter aux sectaires et vulgaire cette opinion entièrement fausse.
[FN: § 1747-1]
On peut trouver des exemples tant qu'on en veut. En voici un typique. Une même pièce de théâtre, La Partie de chasse de Henri IV, de Collé, fut interprétée, selon les époques, par les sentiments, en des sens directement contraires. VICTOR HALLAYS-DABOT ; Histoire de la censure théâtrale en France, Paris, 1862 : « (p. 85) Il est une mesure rigoureuse que l'on ne saurait comprendre, si l'on ne se pénétrait bien de l'état des esprits à la fin du règne de Louis XV et de la marche pénible du gouvernement : c'est l'interdiction de la Partie de chasse de Henri IV. La pièce de Collé est inoffensive entre toutes. Cette comédie, à peine soumise à l'examen, devient une affaire des plus graves. Chacun s'en préoccupe ; on trouve inconvenant de mettre à la scène un aïeul du roi, un souverain, dont on n'est séparé (p. 86) que par un espace de cinquante ans ». Voilà donc la pièce jugée anti-monarchique. En outre elle est estimée contraire au gouvernement de ce temps. « (p. 87) L'effet produit par les vers de Théagène et Chariclée trahit l'état d'animation et d'hostilité de la ville. Une sorte de succès avait naguère encore entouré une tragédie médiocre, mais pleine de déclamations contre les rois, le Manco-Capac, de Leblanc, et, pour être jouée à la cour, la pièce avait dû être allégée de près de quatre cents vers [Remarquez le fait d'une cour qui veut entendre une pièce dirigée contre les rois. Quand un fort courant de sentiments se dessine, il est général et entraîne même les gens qui ont tout à en redouter.] Le gouvernement, éclairé par ces précédents, vit dans la pièce de Collé ce que le public y chercherait, une allusion par contraste, un prétexte à manifestation. Henri IV était alors ce qu'il a été plus tard, un drapeau, emblème de la royauté débonnaire, libérale, démocratique. Henri IV deviendra le roi du théâtre à trois époques différentes : au début du règne de Louis XVI, au lendemain de la prise de la Bastille et du serment constitutionnel, à la rentrée des Bourbons en 1814. À ces époques, on saluera en lui le souverain que rêve et qu'espère l'imagination populaire. En d'autres temps, au contraire, sous Louis XV, par exemple, au lieu d'être une flatterie, la personnalité d'Henri IV sera une épigramme : on opposera ses idées aux idées du jour, et l'enthousiasme pour le Béarnais ne sera qu'une machine de guerre de l'opposition. Là seulement il faut chercher la vraie cause du grand succès de la Partie de chasse, et en même temps le motif de son interdiction ». Sous l'Empire, « (p. 222) maintes fois (p. 223) on voulut reprendre Édouard, et surtout la Partie de chasse de Henri IV. Henri IV, pendant les dernières années du règne de Louis XV, servait, nous l'avons vu, de masque monarchique aux philosophes, qui méditaient le renversement de la monarchie. Aujourd'hui, Henri IV, sur une scène de Paris, ç'aurait été le drapeau blanc, autour duquel se seraient pressés tous les mécontents ». H. WELSCHINGER ; La censure sous le premier Empire. – Paris, 1882 : « (p. 226) De près comme de loin, Napoléon veillait sur le théâtre. Il écrivait de Mayence, le 3 octobre 1804, à Fouché : „ Je vois qu'on a joué à Nantes la Partie de chasse de Henri IV. Je ne vois pas à quoi cela aboutit. “ La pièce séditieuse fut immédiatement interdite ». Mais vint la Restauration, et, nous dit HALLAYS-DABOT, loc. cit., on reprit « avec solennité » la Partie de chasse de Henri IV. « (p. 235) Toutes les pièces défendues naguère, les États de Blois, Henri IV et d'Aubigné, les comédies sur le Béarnais doivent être autorisées aujourd'hui. Il serait difficile de dire combien de fois, à cette époque, Henri IV a été mis au théâtre. Tous les soirs, il paraissait sur quelque scène. De la Comédie Française à Franconi, c'était un concert d'adulations, dont les événements nous ont déjà révélé le secret. Henri IV, c'était le drapeau de la monarchie ; de plus, il avait eu à subir les rigueurs du précédent gouvernement ». Ensuite le public se fatigue. « (p. 239) le 30 mai 1814, avait lieu la représentation des États de Blois. La tragédie de Raynouard n'obtint qu'un demi-succès... On en était déjà à une période moins enthousiaste. Les lois sur la presse se préparaient ; de plus le public, commençait à se fatiguer des dithyrambes qui, depuis le mois d'avril, se déclamaient, se chantaient, se dansaient, se mimaient sur tous les théâtres de Paris ». (§1749). Voici le règne de Louis-Philippe : « (p. 291) Napoléon devient pour les théâtres ce qu'Henri IV avait été en 1755, en 1790, en 1814 et en 1815. On le retrouve simultanément sur toutes les scènes, et, comme jadis le panache blanc du Béarnais, la redingote grise de l'Empereur soulève les passions populaires ». Parlant de la Veuve du Malabar, représentée sous Louis XVI, l'auteur dit : « (p. 123) Jadis on n'avait vu dans cette tragédie qu'une peinture assez ennuyeuse des mœurs indiennes. On n'avait pas cherché les prêtres catholiques sous le masque des brahmines. Maintenant que les esprits surexcités sont à l'affût de chaque mot, de chaque trait qu'ils puissent saisir, tout devient allusion. Le clergé s'émeut et M. de Beaumont va trouver le roi... »
[FN: § 1748-1]
VICTOR HALLAYS-DABOT ; loc. cit., §1747-1. « (p. 275) De cette époque [vers 1827] date une suppression [faite par la censure] que, d'année en année, on voit maintes petites feuilles raconter avec bonheur, comme le modèle de l'ineptie innée des censeurs. Il paraîtrait que dans un vaudeville où il était question de salade en vogue, l'auteur avait mis de la barbe de capucin ; la censure aurait demandé qu'il fût question de toute autre salade et aurait impitoyablement rayé la barbe de capucin. L'histoire est plaisante ; mais si minutieuse que soit cette coupure, nous avouerons ne l'avoir jamais trouvée aussi ridicule que l'on se plaît à le dire. Voyons ce qu'est (p. 276) la guerre d'épigrammes, de mots à double entente, de piqûres d'aiguilles, de plaisanteries niaises, qui s'engage à certains jours entre l'autorité et l'opposition et dont cette époque de la Restauration est restée comme un des exemples les plus complets ; songeons que chaque matin dix journaux déclamaient contre les capucinades de la cour de Charles X, c'était le mot en usage, et demandons-nous si l'auteur était aussi innocent que l'on veut bien le dire, de toute pensée hostile en citant la barbe de capucin, comme la salade à la mode ; demandons-nous si le ministre, en approuvant cette coupure, qui, vue en soi, est puérile, avait tort de se méfier d'un public, qui, dans le simple énoncé du quai Voltaire, trouvait le prétexte d'une manifestation bruyante ». L'auteur parvient ainsi à justifier le ministre du reproche d'imbécillité ; reste celui de défaut d'habileté : et l'auteur aurait dû se rappeler ce que, précisément à propos du quai Voltaire, il disait sur l'effet de semblables prohibitions. LAS CASES ; Mémorial de Sainte-Hélène – Paris 1840, t. II : « (p. 107) En parlant des ouvrages cartonnés ou défendus par la police, sous son règne, l'Empereur disait que, n'ayant rien à faire à l'île d'Elbe, il s'y était amusé à parcourir quelques-uns de ces ouvrages, et souvent il ne concevait pas les motifs que la police avait eus dans la plupart des prohibitions qu'elle avait ordonnées. De là il est passé à discuter la liberté ou la limitation de la presse. C'est, selon lui, une question interminable et qui n'admet point de demi-mesures.
Ce n'est pas le principe en lui-même, dit-il, qui apporte la grande difficulté, mais bien les circonstances sur lesquelles on aura à faire l'application de ce principe pris dans le sens abstrait. L'Empereur serait même par nature, disait-il, pour la liberté illimitée ». Ce n'est pas un fait isolé. Beaucoup d'hommes pratiques, quand ils regardent les choses d'un peu haut, s'aperçoivent de la vanité de la chasse aux dérivations, ce qui ne les empêche pas de la pratiquer lorsqu'ils sont entraînés par la passion du moment. WELSCHINGER ; loc. cit., §1747-1 :« (p. 235) Il est curieux de constater que le théâtre préoccupait Napoléon presque autant que la politique. Quels sujets, d'ailleurs, n'embrassait pas cet esprit universel et à quels moindres détails ne s'arrêtait pas, détails qui feraient (p. 236) peut-être encore aujourd'hui sourire nos hommes d'État ? Ainsi, par une lettre de Potsdam, en date du 25 octobre 1806, il approuve le relevé, de la dépense du ballet Le Retour d'Ulysse ; il prescrit à Fouché de se faire rendre un compte minutieux de ce divertissement, et d'assister à la première représentation pour s'assurer qu'il ne s'y trouve rien de mauvais ». Voilà de belles occupations pour un Empereur et son ministre ! Notre auteur, parlant des vers de Marie-Joseph Chénier, dans lesquels Tacite est nommé, dit : « (p. 149) Tacite !... Ce nom avait, en effet, le don d'irriter l'Empereur. La désapprobation donnée publiquement par lui à la traduction de Dureau de Lamalle, l'interdiction de la tragédie de Tibère, indiquaient assez l'antipathie de Napoléon pour l'historien romain ». Napoléon voulait faire mettre en prison Chénier ; Fouché l'en dissuada, en lui disant : « (p. 149) „ Tout Paris va travailler à le faire sortir. On ne l'aime pas, mais on le plaindra quand on le verra en prison. Sire, ne rendons pas nos ennemis intéressants...“ ». Les classiques n'étaient pas ménagés par la censure impériale. « (p. 223) On fit faire, dit Bourienne, par des poètes à gages d'étranges changements aux pièces de nos grands maîtres, et Héraclius ne parut plus que mutilé ». « (p. 231) Le censeur Lemontey disait à l'un de ses amis venu pour le visiter : „ Irez-vous ce soir an Théâtre Français entendre Racine corrigé par Lemontey ? “ Ce n'était pas une spirituelle boutade, c'était l'exacte vérité. Le grand poète de Louis XIV avait subi, comme les petits poètes de l'Empire, les atteintes de la Censure. Un exemplaire d'Athalie, qui figure aujourd'hui dans la bibliothèque du souffleur de la Comédie française, en porte les traces les plus évidentes, et nous laisse à penser quelles coupures ont dû être faites dans les autres tragédies de Racine ». L'auteur cite plusieurs exemples de ces coupures. Mais il y a pis. Le censeur remplace par ses vers ceux de Racine ! « (p. 232) ...Le censeur biffe ces quatre vers [Athalie, acte II, sc. VII, v. 116-119] dans la crainte d'une (p. 233) allusion au prétendant ; puis pour relier ce passage avec ce qui suit, il supprime l'hémistiche : „ Que Dieu voit et nous juge “ et le remplace par cet hémistiche de sa composition : „ Je connais votre attente “ ; de telle sorte qu'Athalie peut s'écrier au vers suivant :
Mais nous nous reverrons. Adieu ! Je sors contente ».
Plus loin : « (p. 233) Vingt-cinq vers [acte IV, sc. III] tombent sous les ciseaux du censeur. Mais comme il n'y a plus de rime pour marcher avec ce vers :
Prêtres saints, c'est à vous de prévenir sa rage,
le censeur invente ce vers qui suivra le précédent : (p. 234)
De proclamer Joas pour signal du carnage »
Le temps qu'employait Napoléon à surveiller le théâtre, la presse et Mme de Staël, aurait été certes mieux employé à s'occuper de son empire. Mais le travers en lequel il donnait est celui de beaucoup d'autres hommes d'État, qui ne savent pas que l'art de gouverner consiste à savoir employer les résidus existants, et non à les vouloir changer. Si, écartant leurs préjugés, ils daignaient tenir compte de l'histoire, ils verraient qu'à donner la chasse aux dérivations pour modifier les résidus, les gouvernements ont dépensé des sommes énormes d'énergie, infligé de grandes souffrances à leurs sujets, compromis leur puissance, le tout pour n'obtenir que des résultats fort insignifiants.
[FN: § 1749-1a]
Carpenteriana, Paris 1741 : « (p. 237). La Mothe-le-Vayer aïant fait un Livre de dur débit, son Libraire vint lui en faire ses plaintes, et le prier d'y remedier par quelque autre Ouvrage. Il lui dit de ne se point mettre en peine ; qu'il avoit assez de pouvoir à la Cour pour faire défendre son Livre ; et qu'étant défendu, il en vendroit autant qu'il voudroit. Lorsqu'il l'eut fait défendre, ce qu'il prédît arriva ; chacun courut acheter ce Livre, et le Libraire (p. 338) fut obligé de le réimprimer promptement, pour pouvoir en fournir à tout le monde ».
[FN: § 1749-1]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. VI. L'auteur parle des vives attaques du clergé contre la Vie de Jésus, de Renan « (p. 346) L'effet qu'ils obtinrent [les évêques] ne fut pas celui qu'ils souhaitaient. Lesseps m'a raconté que le chiffre le plus élevé de la note des frais de sa propagande [c'est là un euphémisme] en Angleterre en faveur du Canal de Suez était celui des sommes payées pour se faire attaquer [c'est Ollivier qui souligne]. Il se récria. – „ Vous avez tort“, lui répondit-on, „ les attaques seules sollicitent l'attention ; on les oublie et il n'en reste que le souvenir du nom ou de l'acte attaqué “. – Chaque mandement [des évêques] augmenta la diffusion de l'ouvrage et plus d'un, qui n'y eût pris garde, de dire : Décidément, si ce livre est si mauvais, je le lirai ! Loin d'éteindre le flambeau incendiaire, ils l'avaient attisé ».
Procès faits aux chansons de P.-J. Béranger. – Paris, 1828. Plaidoirie du défenseur DUPIN. « (p. 74) On veut arrêter le cours d'un recueil de chansons, et (p. 75) l'on excite au plus haut point la curiosité publique ! On voudrait effacer des traits qu'on regarde comme injurieux, et, de passagers qu'ils étaient par leur nature, on les rend éternels comme l'histoire à laquelle on les associe... Si l'on pouvait en douter, il serait facile d'interroger l'expérience : elle attesterait que toutes les poursuites de ce genre ont produit un résultat contraire à celui qu'on s'en était promis. M. de Lauraguais écrivait au Parlement de Paris : Honneur aux livres brûlés ! Il aurait dû ajouter, profits aux auteurs et aux libraires ! Un seul trait suffira pour le prouver. En 1715, on avait publié contre le chancelier Maupeou des couplets satiriques... (76) Faire une chanson contre un chancelier, ou même contre un garde-des-sceaux, c'est un fait grave. Maupeou, piqué au vif, fulminait contre l'auteur, et le menaçait de tout son courroux s'il était découvert. Pour se mettre à l'abri de la colère ministérielle, le rimeur se retira en Angleterre, et de là il écrivit à M. de Maupeou, en lui envoyant une nouvelle pièce de vers : „ Monseigneur, je n'ai jamais désiré que 3000 francs de revenu. Ma première chanson, qui vous a tant déplu, m'a procuré, uniquement parce qu'elle vous avait déplu, un capital de 30 000 francs, qui, placé à cinq pour cent, fait la moitié de ma somme. De grâce, montrez le même courroux contre la nouvelle satire que je vous envoie ; cela complétera le revenu auquel j'aspire, et je vous promets que je n'écrirai plus. “ » J. P. BELIN ; Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789 – Paris, 1913 : « (p. 109) Il était facile de constater que proscrire un „ ouvrage, c'était le faire connaître, que la défense réveillait la curiosité et ne servait qu'à multiplier les éditions furtives, dangereuses par les conséquences qu'on tirait du mystère “. Ainsi, une petite brochure intitulée Tant mieux pour elle, que Choiseul hésita quelques jours à condamner, se vendit sous le manteau à quatre mille exemplaires pendant les premiers quinze jours, mais cessa de faire du bruit dès qu'on eut permis de l'exposer publiquement en vente (Favart à Durazzo, 1760, I, 99). De même les Mémoires secrets disaient en 1780 : „ On recherche beaucoup une brochure intitulée Essai sur le jugement qu’on peut porter sur Voltaire depuis qu'elle a été supprimée par arrêt du Conseil “(XVI, 4). Voltaire avait bien raison de dire : „ Une censure de ces messieurs fait seulement acheter un livre. Les libraires devraient les payer pour faire brûler tout ce qu'on imprime. “ (À Voisenon, 211 juillet 1756). „ La brûlure, était pour un livre ce qu’était le titre d'académicien pour un homme de lettres “ (Extrait du Pot pourri. Étrennes aux gens de lettres, cité par Métra, IV, 293) „ Plus la proscription était sévère, plus elle (p. 110) haussait le prix du livre, plus elle excitait la curiosité de le lire, plus il était acheté, plus il était lu, ...Combien de fois le libraire et l'auteur d'un ouvrage privilégié, s'ils l'avaient osé, n'auraient-ils pas dit aux magistrats : Messieurs, de grâce, un petit arrêt qui me condamne à être lacéré et brûlé au pied de votre grand escalier ? Quand on criait la sentence d'un livre, les ouvriers de l'imprimerie disaient : Bon, encore une édition “. (Did., Lettre sur le commerce de la librairie, p. 66). » VICTOR HALLAYS-DABOT ; La censure dramatique et le théâtre. Histoire des Vingt dernières années. (1850-1870) – Paris 1871. Parlant d'un drame de M. Claretie : Les Gueux, l'auteur dit : « ... (p. 61) La censure jugea le drame inoffensif. Cette pièce, autour de laquelle une partie de la presse avait fait grand bruit à l'avance, dut donc se présenter devant le public sans être entourée de la sympathie préventive qui accompagne les victimes de la censure. D'ailleurs elle réussit peu ». Il a suffi de la suppression de quelques vers de Marion Delorme pour rendre populaires des vers qu'on supposait les résumer. Nous disons : « qu'on supposait », parce que les vers populaires sont :
De l’autre Marion rien en moi n'est resté,
Ton amour m'a refait une virginité.
tandis que le poète, en une note, (acte V, scène II) dit ; « ... il y avait dans le manuscrit de l'auteur quatre vers qui ont été supprimés à la représentation, et que nous croyons devoir reproduire ici ; Marion aux odieuses propositions de Laffemas, se tournait sans lui répondre vers la prison de Didier.
…………………………………………………………
Mon Didier ! près de toi rien de moi n'est resté,
Et ton amour m’a fait une virginité ! »
Il est probable que, si l'on n'avait pas supprimé ces vers, personne ne s'en serait souvenu.
[FN: § 1749-2]
Par exemple, aux siècles passés, beaucoup de libertins étaient plus excités, s'ils avaient des relations avec une religieuse qu'avec une femme laïque ; si bien qu'il arrivait parfois que l'amant faisait porter à la femme laïque, sa maîtresse, des habits de religieuse. Aujourd'hui, en Angleterre, on cite des faits singuliers, où la perversité est un puissant stimulant pour se soustraire à certaines règles que la loi veut imposer, et qui seraient peut-être respectées, en l'absence de la prohibition.
[FN: § 1749-3]
En beaucoup de religions, on a pour règle de taire les faits qui pourraient provoquer un scandale. Inutile d'en donner des exemples pour les religions chrétiennes et autres semblables, parce qu'ils sont trop connus. En voici un pour la religion dreyfusarde de certains intellectuels. Au sujet de Du Paty de Clam, réintégré par le ministre Millerand dans l'armée territoriale (§1580-3), le correspondant de la Gazette de Lausanne, 3 février 1913, écrit : « ...la vérité est qu'on avait brocanté la promesse faite à M. Du Paty de le réintégrer, contre l'engagement pris par lui de se désister d'un pourvoi qui était gênant, parce qu'il reposait sur une allégation exacte. M. Jaurès s'est écrié avec fougue, aux acclamations de la gauche, qu'il ne fallait pas faire cette négociation, qu'il fallait dire à M. Du Paty : „ Vous ferez votre preuve comme vous l'entendrez ! “– Distinguons : Qu'il ne fallût pas faire cette négociation, c'est très possible, et le trafic auquel on s'est livré n'avait rien de reluisant ; mais qu'il fallût laisser à M. Du Paty le soin de „ faire sa preuve “, non, non et non ! Il suffisait d'une minute pour savoir si oui ou non M. Du Paty avait été frappé grâce à la production d'un document falsifié ; et si c'était oui, – et c'était oui – il fallait lui faire rendre justice. L'esprit se refuse à admettre que les hommes qui se sont honorés par leur attitude dans une campagne tragique n'aient pas compris qu'il n'était pas plus tolérable que M. Du Paty de Clam fût victime de la production d'une pièce falsifiée, qu'il n'avait été tolérable que le capitaine Dreyfus eût été victime de la production secrète de documents apocryphes et criminels ». Qu'on lise aujourd'hui les correspondances faites en ce temps là par un grand nombre de journaux appartenant à la foi dreyfusarde ou humanitaire, et l'on verra qu'en général elles passent scrupuleusement sous silence le fait du document falsifié. Elles pouvaient contester qu'il le fût ; elles pouvaient le déclarer parfaitement authentique : pour défendre sa foi, tout est permis ; elles préférèrent se taire. Voici, en un genre entièrement différent, un exemple qui est le type d'un très grand nombre de faits. Dans les années 1912 et 1913, on estima patriotique, en Italie, de faire apparaître au budget un excédent qui, en réalité, n'existait pas. Plusieurs grands journaux étrangers reproduisirent avec soin les assertions des ministres, au sujet de cet excédent, et les illustrèrent copieusement par des correspondances de gens de bourse, qui chantaient les louanges de finances si prospères. Ces journaux gardèrent le silence, lorsque des savants comme MM. Giretti et Einaudi (§2306-1) démontrèrent que cet excédent était fictif, et firent voir qu'il y avait au contraire un déficit. Jusque-là, passe encore : ces études pouvaient avoir échappé aux journalistes. Mais, soit en raison de l'autorité de l'homme, soit en raison du lieu où elles étaient exprimées, les critiques convaincantes faites à la Chambre par le député Sonnino ne pouvaient leur échapper ! et pourtant, même celles-là furent passées sous silence. Mais voyez donc quelle étrange coïncidence ! on dit qu'à ces journaux sont intéressés des « spéculateurs » qui avaient ainsi un intérêt de Bourse à ce que le silence fût gardé.
[FN: § 1749-4]
E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. V : « (p. 138) Le rabâchage doit être un des démons familiers de l'homme qui veut agir sur une foule distraite ou indifférente. Une idée ne commence, je ne dis pas à être comprise, mais perçue, que lorsqu'elle a été répétée des milliers de fois. Alors un jour arrive où le bon Panurge démocratique, ayant enfin entendu et compris, exulte, vous félicite d'avoir si bien deviné, exprime ce qu'il pense, et vous voilà populaire. Le journaliste qui connaît son métier refait pendant des années le même article ; l'orateur de parti doit agir de même ».
[FN: § 1749-5]
Cela a lieu aussi pour les critiques d'ouvrages de science sociale ou économique, écrites par des personnes qui ignorent entièrement les éléments de ces sciences, et dont bon nombre ont aussi usurpé la réputation d'y être compétents. Elles usent de certains types de dérivations, toujours les mêmes, qui conviennent bien à leur ignorance et à celle des gens qu'elles peuvent persuader. Voici quelques-uns de ces types : 1° L'ouvrage est mal écrit. Il est facile de trouver, en toute langue, un cas douteux de l'emploi d'un mot, et de le baptiser erreur. Même si c'est manifestement vrai, quel rapport cela a-t-il avec la valeur logico-experimentale d'une proposition ? Un théorème d'Euclide écrit en langue barbare cesse-t-il peut-être d'être vrai ? Non, mais pour l'attaquer, il faut connaître la géométrie, et pour dire que la langue est barbare, il suffit... d'être un pauvre en esprit. 2° L'ouvrage ne contient rien de nouveau. Dans la forme extrême de la dérivation, on accuse l'auteur de plagiat. Il serait difficile de trouver un auteur de quelque mérite et de quelque renommée contre lequel on n'ait pas porté cette accusation. Même Dante a été accusé d'avoir imité, d'un auteur très obscur, son immortel poème. Dans la nouvelle de Boccace, messire Erminio de Grimaldi voudrait que Guglielmo Borsiere lui enseignât « une chose qui n'eût jamais été vue » et qu'il pût faire peindre. À quoi Borsiere répond : « Une chose qui n'eût jamais été vue, je ne crois pas que je pourrais vous l'enseigner, à moins que ce ne fût des éternuements ou des choses semblables à celles-là ; mais si vous le désirez, je vous en enseignerai bien une, que vous, je le crois, vous n'avez jamais vue ». On pourrait donner une réponse analogue à un grand nombre de ces critiques. La chose qui, en cette occasion, leur fait défaut est le bon sens et parfois la bonne foi. 3° Il y a beaucoup d'erreurs ; et l'on a soin de ne pas dire lesquelles, dans l'idée que les gens croiront à l'affirmation, et ne la vérifieront pas. D'autres fois, on indique de prétendues erreurs, et lorsque quelqu'un démontre qu'elles n'existent pas, on se tait avec l'espoir que les gens ignoreront la rectification ou n'y prendront pas garde. C'est ce qui arriva à cet excellent M. AULARD. Dans son livre Taine historien de la révolution française, il accuse Taine d'innombrables erreurs. M. AUGUSTIN COCHIN, dans son livre La Crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard, montre que c'est, au contraire, « l'historiographe officiel » de la révolution qui se trompe dans la plupart de ses accusations ; ce qui permet à M. Cochin de conclure : « (p. 18) Ainsi le bloc de faits et de témoignages assemblés par Taine reste entier. Ce qu'il raconte est vrai ». M. Aulard se tait, dans l'espoir que les sectaires ne liront pas le livre de M. Cochin, et que, même parmi ceux qui ne sont pas sectaires, beaucoup ne prendront pas garde à ce livre. 4° Attaques personnelles à l'auteur, critiques de choses qui n'ont rien et voir avec la question qu'on examine, et autres divagations semblables. 5° Intromission, en matière scientifique, de considérations sentimentales d'ordre politique, ou d'autres du même genre. Un tel, qui se croit « économiste », se montrait adversaire de l'économie mathématique, parce qu'il était convaincu qu'elle ne pourrait jamais devenir « démocratique ». Un autre repoussait une certaine manière de l'exposer, parce que, de cette manière, elle n'était pas en mesure d'apporter « un peu plus de justice dans le monde ». Un autre, qui semble passablement étranger à la matière dont il traite, invente une école d'économie mathématique, qui part de considérations « individuelles » [c'est le démon, pour ces gens-là], et l'oppose à une autre, qu'il imagine, et qui part de considérations « collectives ». 6° L'auteur n'a pas tout dit : il a omis de citer certains ouvrages, certains faits. Comme nous l'avons déjà observé, la critique serait excellente, si ces ouvrages et ces faits étaient de nature à modifier les conclusions ; elle est vaine lorsqu'ils sont peu ou pas du tout importants pour les conclusions. Les gens qui n'ont pas l'habitude des recherches scientifiques n'arrivent pas à comprendre qu'une grande quantité de détails peut nuire, au lieu d'être utile, pour trouver la forme générale, moyenne, des phénomènes, qui est la seule dont s'occupent les sciences sociales (§537 et sv.) 7° On fait dire à l'auteur ce qu'il n'a jamais eu l'idée de dire, parce qu'on interprète dans un sens sentimental, de parti politique, de prêche éthique, etc., ce qu'il a dit seulement dans un sens scientifique. Chacun est porté à juger les autres par soi-même, et celui qui n'a pas l'habitude des raisonnements scientifiques n'arrive pas a comprendre que d'autres personnes puissent en tenir.
[FN: § 1751-1]
On en a un très grand nombre d'exemples en tout temps. TACITE déjà Ann., XIV, 50, en cite un. F. Veientus avait composé une satire contre les sénateurs et les pontifes. Il fut jugé par Néron « et Veientus, convaincu fut exilé d'Italie, et l'on ordonna que ses livres fussent brûlés ; ceux-ci, recherchés et lus souvent, lorsqu'il y avait du danger à les acquérir, tombèrent dans l'oubli, sitôt qu'on eut la permission de les posséder ». (§1330-1). VICTOR HALLAYS-DABOT : loc. cit. §1747-1. Sous la Restauration « p. 265) le gouvernement... s'était laissé entraîner à interdire d'une façon absolue le personnage de Voltaire. Ses œuvres ne devaient jamais être nommées... Une exclusion aussi radicale était fâcheuse : bien plus, elle n'était pas habile. Qu'arriva-t-il ? On avait passé quatre années à surveiller avec grand soin l'ennemi signalé, on avait couru sus à la moindre allusion. Un jour à l'Odéon en 1826, on laisse ces mots dans la bouche d'un valet traçant un itinéraire :
Le pont Royal. Fort bien !...
D'un écrivain fameux voici le domicile :
De Voltaire ! À ce nom, le monde entier... Mais chut ! La maison de Voltaire est loin de l'Institut.
Le voici !
Voltaire ! la maison de Voltaire ! ces deux mots suffisent pour mettre le feu aux poudres. Le parterre tapageur bondit : la pièce est interrompue par des salves d'applaudissements ».
[FN: § 1751-2]
Le premier numéro de La Lanterne de Rochefort commence ainsi : « La France contient, dit l'Almanach impérial, trente-six millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement ». Ce calembour devint populaire, et fut répété en France par tout le monde. Aujourd'hui, qui prendrait garde à une plaisanterie semblable lancée contre le gouvernement français ? On sait que La Lanterne avait des admirateurs même parmi les gens de l'entourage du souverain. –DE GONCOURT ; Journal, année 1878 : « (p. 11) Flaubert, parlant de l'engouement de tout le monde impérial, à Fontainebleau, pour la Lanterne de Rochefort, racontait un mot de Feuillet. Après avoir vu un chacun, porteur du pamphlet, et apercevant, au moment du départ pour la chasse, un officier de la vénerie, en montant à cheval, fourrer dans la poche de son habit la brochurette, Flaubert, un peu agacé, demanda à Feuillet : „ Est-ce que vraiment vous trouvez du talent à Rochefort ? “ Le romancier de l'Impératrice, après avoir regardé à gauche, à droite, répondit : „ Moi, je le trouve très médiocre, mais je serais désolé qu'on m'entendit, on me croirait jaloux de lui ! “ »
[FN: § 1755-1a] Au commencement du mois d'octobre 1918, on put lire dans les journaux la note suivante : « Le grand organe libéral anglais le Daily Chronicle a été acheté par sir Henry Dalziel et quelques sociétaires pour la somme de 87 millions de francs... Le nouveau propriétaire, M. Dalziel, est un journaliste riche et député libéral, qui est surtout connu comme l'ami intime et le fidèle appui de M. Lloyd George tant au Parlement que dans la presse. En cela consiste principalement la signification politique de l'achat du Daily Chronicle, lequel paraissait récemment peu enclin à appuyer Lloyd George et penchait davantage vers les tendances du parti libéral, qui accepte Asquith comme chef. On annonce que la politique du journal ne changera pas, mais il est probable que sous le nouveau propriétaire il soutiendra vigoureusement Lloyd George ».
[FN: § 1755-1]
ROBERT DE JOUVENEL : La république des camarades : « (p. 248) Ce sont, dit-on, les journaux qui font l'opinion publique. La réciproque n'est pas moins vraie. Le lecteur est tout prêt à accepter l'opinion de son journal. Mais le journal choisit l'opinion qui lui semble la mieux faite pour plaire à son lecteur. (p. 252) Heureusement les questions sur lesquelles le public se prononce sont rares. Les lecteurs peuvent avoir des opinions très arrêtées, mais ils en ont très peu. Du moment qu'on ne heurte jamais celles-là, on peut aisément les guider dans toutes les autres ».
[FN: § 1755-2]
Bismarck était fort habile en l'art de se servir des journaux nationaux et étrangers. – ÉMILE OLLIVIER ; L'emp. lib., t. XIV. L'auteur veut justifier son ministère de n'avoir pas su se servir des journaux : « (p. 49) Bismarck y avait bien plus d'influence, puisque, dans chaque journal, il comptait au moins un écrivain soldé tout à ses ordres. Comme nous savions le nom de quelques-uns d'entre eux, ce nous était un moyen de connaître les intentions de leur soudoyeur. [Ollivier est fort naïf. Les intentions de Bismarck pouvaient être entièrement différentes de ce qu'il faisait dire aux gens qui étaient dans sa dépendance.] De plus, Bismarck tenait dans sa main, non seulement presque toute la presse prussienne, mais une grande partie de la presse allemande et de la presse autrichienne, et il avait ainsi, plus que nous, les moyens de déterminer, soit en France, soit en Europe, le mouvement d'opinion qui lui plaisait ». – Idem ; loc. cit., t. XII : « (p. 304) Le système de Bismarck était des plus ingénieux ; le gouvernement français avait eu parfois à l'étranger un journal à sa solde ; il en avait tiré peu de profit ; on ne tardait pas à savoir la vénalité de la feuille achetée, et on n'attachait plus d'importance à ce qui y était contenu [c'étaient d'autres temps ; aujourd'hui, cela ne discrédite pas un journal]. Bismarck n'achetait pas un journal, mais il achetait un ou des journalistes dans chaque journal important, le rédacteur en chef, lorsque c'était possible [aujourd'hui, on ne les achète pas directement : on agit indirectement, par l'intermédiaire des financiers qui détiennent les actions de la société anonyme possédant le journal], ou, à défaut, un simple rédacteur dont nul ne soupçonnait les attaches. Ce vendu se signalait par le caractère farouche (p. 305) de son patriotisme [remarquez ce fait : il est l'équivalent de l'opposition du journal, dans la politique intérieure] ; très opportunément suivant qu'il convenait à la politique prussienne, il calmait ou excitait l'opinion [on trouve une organisation semblable pour la politique intérieure] : le système était beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique... Je connais les noms des malheureux employés par eux [des agents de Bismarck], je préfère ne pas les divulguer ». Ces opérations par le moyen des journaux continuèrent aussi après 1870. – M. BUSCH ; Les Mém. de Bismarck, t. II : « (p. 57) 120 février [1873] Il résulte d'un rapport D'Arnim du 17 du mois dernier qu'il a engagé un certain L. pour lui fournir des rapports détaillés sur la presse française. Dans une dépêche du 8 courant, l'ambassadeur dit que L. a demandé à ne pas renoncer à la collaboration de B... Arnim soutient cette demande uniquement „ dans l'intérêt du service “, L., dit-il, devant avoir à sa disposition quelqu'un qui s'occuperait de la partie la plus compromettante de cet emploi. Mais ni L. ni aucun autre fonctionnaire de l'ambassade ne paraissent être en état de faire face à cette masse de matériaux, de fournir des rapports détaillés et bien informés sur la (p. 58) presse et en même temps d'écrire des articles pour les journaux allemands, italiens et russes ». Bismarck refusa d'employer ce moyen, ce qui signifie simplement qu'il en préférait un autre. Avec sa manière rude, Bismarck ne dissimule pas les dépenses qu'il faisait pour la presse française. – BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II. Parlant de D'Arnim et du procès qu'on fit à celui-ci, l'auteur dit : « (p. 195) Je n'ai jamais fait mention au cours des débats judiciaires, que certaines sommes destinées à faire défendre notre politique dans la presse française, et qui s'élevaient à 6000 ou 7000 thalers, étaient employées par lui à attaquer notre politique et ma situation dans la presse allemande ». Celle-ci apparaît aussi vénale qu'une partie de la presse française. Ces aveux d'hommes politiques éminents sont précieux, parce qu'ils confirment des faits qui, autrement, demeurent toujours douteux tant qu'ils ne sont connus que sous forme de bruits qui courent. Par exemple, en 1913-1914, on disait avec insistance que le gouvernement allemand payait largement certaines attaques des journaux français contre les lois militaires de leur pays ; mais nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'il y a là de vrai. Peut-être le saura-t-on, dans plusieurs années, s'il se fait des publications semblables à celles que nous possédons maintenant d'Ollivier et de Bismarck, et quand on les aura. – Busch nous donne des détails sur la manière dont Bismarck savait se servir de la presse. Busch ; loc. cit., t. II. Bismarck parle du journal de l'empereur Frédéric : « (p. 209) Personnellement, je crois encore plus que vous à l'authenticité du journal... L'empereur Frédéric était loin d'être aussi habile que son père, et son père était déjà loin d'être un politicien de première force. C'est ce qui fait que pas une minute je n'ai douté de l'authenticité du journal publié. Mais ça ne fait rien, il faut le traiter comme un faux !... (p. 215) En ce qui concernait la publication de la Deutsche Rundschau, le chancelier a maintenu son premier plan de campagne. „ Vous direz d'abord que c'est un faux “, m'a-t-il répété, „ et que vous êtes indigné de voir attribuer de pareilles calomnies au noble défunt... Puis, si on vous prouve que le journal était authentique, vous réfuterez les erreurs et les absurdités qu'il contient... “ ».
[FN: § 1755-3]
M. BUSCH ; Les Mém. de Bismarck, t. II. L'auteur cite une lettre (8 avril 1866) du roi Guillaume Ier à Bismarck, dans laquelle le souverain se plaint d'un article contre le duc de Cobourg, publié dans la Gazette de la Croix. Bismarck répond : « (p. 235) ...j'avoue franchement que la majeure partie de cet article a été écrite sous mon inspiration, parce que si je n'ai aucune influence sur la Gazette de la Croix pour empêcher de passer certains entrefilets qui me déplaisent, j'en ai assez pour faire insérer certains articles qui me conviennent ». – En France, le Siècle, qui était l'un des deux journaux républicains tolérés après le coup d'État de 1851, obtenait protection et subsides de l'empereur Napoléon III. E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. IV : « (p. 17) Le Siècle n'appartenait pas à un homme d'affaires, mais il constituait une affaire importante donnant de gros bénéfices. Cela imposait à son directeur le souci perpétuel, en faisant une opposition qui était sa raison d'être, d'éviter la suspension qui serait la ruine de ses actionnaires ». Aujourd'hui les journaux ne craignent pas la suspension, mais bien la suppression des subsides indirects et directs qu'ils reçoivent des puissances financières, et la diminution de la vente, s'ils vont contre les passions du public. L'auteur continue : « M. Havin était créé pour cette manœuvre difficile. nullement irréconciliable avec l'empire. ». En 1858 « (t. IV, p. 69) le Siècle ne fut sauvé que par une démarche d'Havin auprès de l'empereur. (t. XI, p. 122) Havin était un esprit très avisé. en rapports presque amicaux avec les ministres, ne faisant l'anticlérical que pour se dispenser d'être antidynastique. » (1755 4).
[FN: § 1755-4]
Je préfère des exemples du passé, parce qu'ils sont moins aptes que ceux du présent à émouvoir les sentiments des lecteurs contemporains. – E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. VI : « (p. 212) Ils [les commissaires du gouvernement, au Corps législatif] eurent moins beau jeu pour réfuter l'accusation portée contre les agiotages que, d'accord avec le Crédit mobilier, la Compagnie du Midi avait opérés sur ses propres actions ». Vient ensuite la description de cette fraude, qu'il n'y a pas lieu de rapporter ici. « (p. 213) Je dénonçai ce coup de Jarnac financier... Le commissaire du gouvernement, Dubois, fort honnête homme, se noya dans des explications confuses qui n'expliquèrent rien et continrent, au contraire, l'aveu de la plupart des faits révélés... Les administrateurs de la Compagnie du Midi eurent le crédit d'empêcher tous les journaux de Paris, sans exception, de reproduire le compte rendu analytique de cette séance ».
[FN: § 1755-5]
HENRY DE BRUCHARD [1896-1901] ; Petits mémoires du temps de la Ligue. L'auteur parle de certains journaux démocrates, défenseurs de Dreyfus. Nous supprimons les noms, parce que nous traitons ici de phénomènes sociaux et non de personnes. L'une des plus grandes erreurs, en cette matière, consiste justement à accuser certaines personnes de ce qui est un fait général. L'auteur dit donc de ceux qui, de bonne foi, écrivaient dans ces journaux : « (p. 209) Je pense qu'ils ont aussi le sentiment de la façon dont ils furent dupes et de leur imprudence. Ils ont pu en tout cas éprouver, ces mandarins de lettres, ce que la dignité de leur condition pesait peu auprès de leurs maîtres anonymes. À ces fiers indépendants demandez qui dirigeait [le journal], et pourquoi ils s'avisèrent si tard que le directeur en était toujours choisi sans qu'ils aient connaissance de ceux qui faisaient ce choix. Ils savent aujourd'hui que le (p. 210) fondateur et bailleur de fonds était M. L., ancien chef de la sûreté, et organisateur de la ligue de défense des juifs. Et dire que certains se prétendaient encore révolutionnaires ! Mais ils avaient là leur pain ; d'autres éprouvaient le besoin d'écrire, la maladie de mettre leur nom au bas d'un article : C’est une forme de cabotinisme ; et on subissait tout. On admettait la direction d'un M. P... M. P. est un des gros porteurs d'actions de l'Humanité. Représente-t-il encore L. et ses héritiers ? Question qui ne fut pas posée au dernier (p. 211) congrès socialiste ; c'était cependant la vraie question à poser ». À quoi bon ? Si ce n'est l'un, c'est l'autre. L'organisation subsistant, les individus ne manqueront jamais. En 1913, Jaurès, président d'une commission, fit tous ses efforts pour sauver le ploutocrate et démagogue Caillaux du blâme mérité à la suite des pressions exercées sur la magistrature, par l'intermédiaire de son compère Monis, et qui avaient pour but de favoriser Rochette. Tous les partis se servent des journaux à leurs fins particulières ; et de la sorte obtiennent des faveurs, en menaçant les ministres ou en promettant de les défendre. Celui qui veut avoir un journal dans sa manche doit supporter d'énormes dépenses, qui constitueraient une perte brute, s'il n'obtenait ensuite des compensations : en honneurs seulement, comme c'est le cas d'un très petit nombre d'hommes politiques ; en argent plus les honneurs, comme c'est le cas de la plupart des politiciens, des financiers politiques, des membres des trusts, des avocats politiques, des « spéculateurs ». – T. PALAMENGHI-CRISPI ; Giolitti : « (p. 76 note) Crispi fut singulier parmi les hommes politiques de son temps, en ceci aussi. Attribuant au journal la grande importance qu'il a dans la vie moderne, il voulut toujours en avoir un où il pût manifester ses idées ; mais au lieu d'en faire payer les frais à des hommes d'affaires, (p. 77) comme tant d'autres ont fait (il serait facile de citer des noms), il paya toujours de sa poche ; rarement un ami l'aida. Il arriva ainsi que souvent il se trouva en présence de dettes qu'il avait peine à payer, et qu'ainsi il dut parfois recourir à l'escompte en banque d'effets de change, qu'il acquitta cependant toujours. Tout le monde sait ce que coûtent les journaux exclusivement politiques. La Riforma seule, journal de la Gauche historique, qui défendit les idées et les hommes du parti libéral durant une trentaine d'années, absorba environ un million deux cent mille francs des revenus du labeur acharné de Crispi [cette épithète est peut-être exagérée] ». – Giornale d'Italia, 23 novembre 1913 : « Une autre nomination [en qualité de sénateur] dont on parle, – nous ne savons sur quels fondements et si elle ferait plaisir aux réformistes, – serait celle du banquier milanais Della Torre, lequel fut et reste magna pars finanziaria de journaux socialistes ou démocratiques, à la manière réformiste. Della Torre est en somme le dieu de la haute banque blocarde, et pourra se dire un jour un précurseur, lorsque la haute banque, ayant pris le vent, se mettra du côté du bloc, à l'instar de ce que fit sa sœur aînée française ». Della Torre fut effectivement nommé sénateur, avec deux autres socialistes, et le Corriere della Sera. 25 novembre 1913, écrit : « L'honorable Giolitti ouvre aujourd'hui les portes du Sénat à Karl Marx, qui faisait un peu trop de tapage au grenier [Giolitti avait dit à la Chambre que désormais les socialistes « avaient relégué Marx au grenier »], et devenait menaçant pour la tranquillité de ceux qui croyaient avoir opéré un judicieux séquestre de personnes... Trois socialistes ne sont, au fond, pas un groupe puissant... et ne causeront pas de gros ennuis au gouvernement, envers lequel ils ont de si grandes obligations de reconnaissance [et vice versa], ni à la bourgeoisie... Le Sénat étant une institution législative, doit avoir, lui aussi, des représentants de tous les courants politiques ; et il n'est pas dommage que, les radicaux y étant déjà suffisamment nombreux, les socialistes y aient aussi leur place ; au moins les socialistes de cette fraction qui connaît déjà les marches du Quirinal, et qui se montre en pratique disposée à « traiter ». Il est vraiment regrettable qu'on ne puisse aussi introduire au Sénat un brin de république ; mais heureusement les républicains ne font pas peur, et malheureusement ils sont obstinés dans leur chasteté préjudicielle † [et c'est pourquoi ils ne réussissent pas à avoir un journal : parce qu'ils veulent le payer eux-mêmes]... Il faut rajeunir le Sénat. Disons plus clairement : il faut se servir aussi du Sénat ; ce qui est l'expression la plus juste, celle qui répond le mieux à la réalité des choses [très vrai]. Si l'on voulait vraiment, d'une conscience honnêtement démocratique, donner au Sénat aussi le caractère de représentant des courants d'idées nationales, il n'y aurait qu'une conséquence logique : affronter le problème du Sénat électif... Il est vrai qu'en ce cas l'entrée des socialistes au Palais Madame [siège du Sénat] serait plus large, et que la munificence du gouvernement n'aurait plus à affirmer ses sympathies intéressées pour les partis extrêmes ».
† En Italie, les républicains posent la question préjudicielle de la forme du gouvernement.
[FN: § 1755-6]
La C. G. T.. comme on l'appelle en France, réunit un congrès à Paris, le 24 novembre 1912, pour s'opposer à la guerre. On y décida ce qui suit : « Le congrès, reconnaissant qu'il faut à tout prix paralyser la mobilisation, déclare qu'il est nécessaire d'essayer les moyens les plus efficaces pour atteindre ce but Le Congrès décide : ... 3° Pour empêcher le travail nocif de la presse bourgeoise, il engage les imprimeurs et les ouvriers à détruire les rotatives des journaux, à moins qu'elles ne puissent être utilisées pour notre cause ».
[FN: § 1755-7]
En mai 1913, un journal de Florence, qui cessait ses publications, raconta comment en trente-trois ans de vie il avait été soutenu par les différents gouvernements qui s'étaient alors succédé. Presque tous les grands journaux italiens gardèrent un silence pudique et sacré sur ce fait, qui aurait pu cependant intéresser les lecteurs beaucoup plus qu'un grand nombre de faits divers insignifiants. Mais peut-être plusieurs de ces journaux se sont-ils souvenus opportunément de la parole : de te fabula narratur. – Le gouvernement belge a publié une liste des journaux qui reçurent un subside du roi Léopold, pour louer son administration au Congo, ou du moins en taire les méfaits. L'historien futur qui étudiera le régime ploutocratique présent des peuples civilisés pourra en tirer d'utiles renseignements.
[FN: § 1755-8]
En Italie, on s'en rendit fort bien compte pour la presse étrangère qui était contraire à l'Italie ; mais naturellement, on ne mentionna pas celle qui était favorable. Les motifs d'agir étaient pourtant identiques dans les deux cas.
[FN: § 1756-1]
Souvent, on dit aussi : « Un tel, qui aujourd'hui adopte la proposition A, y était naguère opposé » ; et l'on croit ainsi avoir démontré qu'il ne faut pas accepter la proposition A. Négligeons le fait que l'homme peut honnêtement changer suivant les circonstances. À ce propos, Bonghi avait coutume de remarquer que seul l'animal ne change jamais. Mais encore s’il était démontré que le changement de celui qui propose A a lieu, non en vertu de la valeur intrinsèque de A, mais seulement pour quelque avantage qu'en peut espérer celui qui le propose, on n'en pourrait rien conclure contre A ; et l'on reviendrait simplement à la dérivation indiquée dans le texte. Le fait que ces dérivations ne sont d'aucune importance pour le jugement qu'on doit porter sur A, constitue ce qu'il y avait de vrai dans la défense de Caillaux, faite par ses amis, contre les attaques du Figaro. Il est certain que l'utilité ou le dommage, pour une société donnée, de l'impôt sur le revenu, n'a rien, absolument rien à faire avec les qualités familiales, morales, ni même politiques de celui qui propose cet impôt. Mais il faut ajouter qu'infliger la peine de mort à qui emploie ces dérivations erronées, semble quelque peu excessif ; et si cela devenait une règle générale qu'il serait permis à chaque citoyen de mettre en pratique, peu de journalistes et même peu d'autres écrivains resteraient en vie.
[FN: § 1757-1]
Sorberiana : « (p. 18) Anabaptistes. On raconte des Anabaptistes, qui sont (p. 19) pourtant de bonnes gens, mile choses extravagantes, même dans la Hollande, comme entre autres qu'il y en a qui s'assemblent de nuit et à la faveur des ténèbres se mêlent indiferemment. Ce qui est entièrement faux, et n'a de fondement que sur l'histoire de Jean de Leyde, Roi de Munster, et sur la folie de quelques-uns, qui cent ans y a s'imaginèrent qu'il faloit pour être sauvé, aler tout nud, comme faisoit Adam en l'état d'innocence, d'où ils furent nommez Adamistes... (p. 21) Je ne sçache point que depuis ce temps-là il y ait eu rien de pareil, et les gens d'esprit à Amsterdam se moquent des bourdes qu'on a semé (sic). Cependant il me souvient qu'à Paris un certain Soubeyran disoit, qu'en une de ces assemblées nocturnes où il assistoit, il avoit jouï de la fille de son hôte, qui lui refusa après à la maison ce qu'alors elle lui avoit accordé charitablement. Ce n'est pas merveille qu'il se trouvent quelques personnes qui mentent impudemment : mais il y a de quoi s'étonner qu'une imposture s'étende si aisément dans la créance de tout un peuple, comme il arrive en cette affaire-ci, et en la fable de la (p. 22) fille qui avoit un groin de pourceau, de laquelle à Paris et en Hollande tous les Cordoniers ont acheté la planche, et de laquelle à Amsterdam on disoit en général que la maison étoit au Reysser-graft ; mais personne ne l’osoit indiquer ce qui en marquoit la fausseté ».
[FN: § 1760-1]
Prof. L. EINAUDi, dans La Riforma Sociale, décembre 1913. L'auteur parle des journaux protectionnistes anglais : « (p. 856) Ils peuvent d'écrire ainsi l'agriculture anglaise d'aujourd'hui,... le Times, malheureusement tombé aux mains du même grand journaliste jaune, qui est à la tête du Daily Mail et du trust des journaux impérialistes et protectionnistes, le Ridder Haggard, journaliste sensationnel du genre de ceux qui, en Italie, décrivirent les merveilles agricoles de la Libye, avant la guerre et dans ses premiers temps... »
[FN: § 1760-2]
ROBERT DE JOUVENEL ; La république des camarades « (p. 201) Le directeur d'un journal est rarement un journaliste [cela dépasse peut-être un peu la vérité] ; ce n'est presque jamais un homme politique ; c’est, le plus souvent, un entrepreneur de travaux publics ; c'est toujours un industriel ». Ainsi que nous l'avons souvent remarqué d'une manière générale, il y a du vrai sous ces formes un peu paradoxales. « Quelquefois le journalisme constitue sa seule industrie, quelquefois il ne constitue que la branche annexe d'une industrie principale. Mais, dans l'un ou l'autre, le journalisme implique l'exploitation d'une grosse maison de commerce [cela est conforme à la vérité pour les grands pays où domine la ploutocratie]. Le chiffre d'affaires de certains journaux dépasse trente millions de francs. Une feuille quotidienne de troisième ordre exige un déplacement de fonds de quinze (p. 202) cent mille francs par an. On conçoit que, pour administrer de pareils budgets, il ne suffise pas d'avoir de la fantaisie, de l'esprit, ni même du talent... En 1830, un journal paraissait sur quatre petites pages de papier à chandelles (p. 203) ; il contenait quelques articles peu ou point payés, pas de dépêches, pas d'informations coûteuses, pas d'illustrations. Il coûtait cinq sous. Aujourd'hui la plupart des journaux paraissent sur six, huit, dix et douze pages. Ils sont illustrés de clichés onéreux ; ils publient les articles chèrement payés ou de personnalités en renom, des colonnes de dépêches dont certaines au tarif de plusieurs francs le mot – et ils sont vendus trois centimes et demi aux entrepositaires. Comment vivent-ils donc ? Ils vivent de leur publicité – à moins, bien entendu, qu'ils ne vivent de leurs trafics. Un journal peut se passer de journalistes, il peut même se passer de paraître [paradoxe expliqué dans une note : „ Il existe quelque part une nécropole des journaux qui ne paraissent plus. Un industriel ingénieux, qui en détient les titres, les fait inscrire de temps en temps en tête des colonnes d'une autre feuille et touche le montant d'anciens traités de publicité. Son industrie prospère “]. Il ne peut se passer de publicité. ...(p. 205) Avant de prendre une détermination quelconque, le directeur responsable d'un journal – fût-il un saint – est contraint d'envisager ces deux termes : 1° Ne pas froisser ceux qui détiennent les informations, c'est-à-dire toutes les puissances politiques et administratives ; 2° Ne pas heurter ceux qui détiennent la publicité, c'est-à-dire toutes les puissances commerciales et financières [pas toutes, à vrai dire, mais seulement celles dont dépend le journal]... (p. 209) On appelle les journaux gouvernementaux quand ils sont serviles. On les appelle indépendants quand ils ne sont que gouvernementaux. On appelle journaux d'opposition ceux qui sont en coquetterie avec le pouvoir. Il existe encore quelques rares organes qui ne sont reliés au Gouvernement par rien, par personne. Mais il est entendu qu'on ne doit pas les prendre au sérieux ».
[FN: § 1766-1]
Il y a quelques siècles, presque toutes les dérivations en matière sociale ou pseudo-scientifique, étaient unies à des considérations de théologie chrétienne. Aujourd'hui, elles se lient avec des considérations de théologie humanitaire. Les considérations de théologie chrétienne nous semblent souvent absurdes ; celles de la théologie humanitaire le sembleront aux hommes des temps futurs, où une autre théologie aura pris la place de la théologie humanitaire. Il y a quelques siècles, on expliquait tout par « le péché originel » ; aujourd'hui, on l'explique par la « faute de la société » (§1716-3-) ; dans l'avenir, on aura quelque autre explication, également théologique et vide de sens, au point de vue expérimental.
[FN: § 1767-1]
RENAN ; Hist. du peupl. d'Isr., t. V. : « (p. 349) Comment avec cela Philon reste-t-il Juif ? C'est ce qu'il serait assez difficile de dire, s'il n'était notoire que, dans ces questions de religion maternelle, le cœur a des sophismes touchants pour concilier des choses qui n'ont aucun rapport entre elles [ce n'est pas un cas particulier, ainsi que l'auteur semble le croire : cela se produit d'une façon générale : laissons touchants de côté] Platon aime à éclairer ses philosophèmes par les mythes, les plus gracieux du génie grec, Proclus et Malebranche se croient dans la religion de leurs pères, le premier en faisant des hymnes philosophiques à Vénus, le second en disant la messe. La contradiction, en pareille matière, est un acte de piété. Plutôt que de renoncer à des croyances chères, il n'y a pas de fausse identification, de biais complaisant qu'on n'admette. Moïse Maimonide, au XIIe siècle, pratiquera la même méthode, affirmant tour à tour la Thora et Aristote, la Thora entendue à la façon des talmudistes, et Aristote entendu à la façon matérialiste d'Ibn-Roschd. L'histoire de l'esprit humain est pleine de ces pieux contresens. Ce que faisait Philon il y a dix-neuf cents ans, c'est ce que font de nos jours tant d'esprits honnêtes, dominés par le parti pris de ne pas abdiquer les croyances qui se présentent à (p. 350) eux comme ayant un caractère ancestral [l’auteur présente encore comme particulier ce qui est général pour toutes sortes de dérivations]. On risque les tours de prestidigitation les plus périlleux pour concilier la raison et la foi [d'une manière générale : des dérivations de résidus hétérogènes]. Après avoir obstinément nié les résultats de la science, quand on est forcé par l'évidence, on fait volte-face et l'on dit avec désinvolture : Nous le savions avant vous ».
[FN: § 1775-1]
Un ensemble de dérivations a la prétention de pouvoir résoudre cette question en la transformant en un problème des « droits » de l'individu. en rapport avec les « droits » de l'« État ». Cette solution ressemble, à celle qui expliquait l’ascension de l'eau dans les pompes par l'horreur de la Nature pour le vide. C'est-à-dire qu'elle explique les faits, non par d'autres faits, mais par des entités fantaisistes. Ce qu'est cet « État », personne ne peut le dire avec précision ; moins encore ce que peuvent bien être ses « droits » et ceux de l'individu. L'obscurité et le mystère augmentent, si l'on recherche le rapport de ces « droits » avec les diverses utilités. Enfin, la question supposée résolue dans les termes indiqués, personne ne peut dire comment on pourra appliquer la solution théorique dans le domaine concret. Cette solution théorique apparaît donc seulement comme l'expression d'un pieux désir de son auteur, qui pouvait vraiment nous la donner immédiatement, sans faire tant de détours et invoquer ces belles mais fort obscures entités.
[FN: § 1776-1]
EUSTATHII commentarii in Dionysium periegetes, p. 245, Didot, v. 157 : « Il faut savoir que comme l'Euxin est assimilé à un arc, ainsi d'autres lieux nombreux sont aussi figures diversement par quelque ressemblance. Ainsi l'histoire dit que le delta égyptien est triangulaire... Ainsi Alexandrie est représentée par une chlamyde militaire ; l'Italie par le lierre : l'Espagne par une peau de bœuf ; l’île de Naxos par une feuille de vigne ; le Péloponèse par une feuille de platane ; la Sardaigne par la trace d'un pied humain ; Chypre par une peau de mouton ; la Libye par un trapèze ; et les anciens représentent d'autres [contrées] autrement ».
[FN: § 1778-1]
Cette conclusion expérimentale se rapproche, dans la forme, de celle de certains métaphysiciens qui, pour connaître la « vérité », se servent de l'intuition avec ou sans l'intellect ; mais la conclusion expérimentale diffère de l'autre quant au fond. 1° D'abord, il y a divergence au sujet du terme « vérité ». Pour le métaphysicien il désigne quelque chose d'indépendant de l'expérience, au delà de l'expérience. Pour l'adepte des sciences expérimentales, il désigne seulement un accord avec l'expérience. Pour mieux faire voir la chose, recourons à une image grossière mais expressive. L'individu est comme une plaque photographique qui, exposée en un lieu donné, en reçoit l'impression de choses et de faits ; les dérivations par lesquelles l'individu exprime cette impression correspondent à l'opération qu'on appelle développement de la plaque photographique. Le métaphysicien veut que cette opération fasse apparaître des choses et des faits qui n'existaient pas dans le lieu où la plaque a été exposée, et qui sont également « réels » ; certains disent même qu'ils constituent seuls la « réalité ». L'adepte des sciences expérimentales n'attend de cette opération que l'apparition de choses et de faits existant dans le lieu où la plaque a été exposée. 2° Ensuite, il y a la divergence habituelle entre l'absolu métaphysique et le relatif expérimental. Le métaphysicien estime que ses opérations intuitives le conduisent à la « vérité absolue » ; l'adepte des sciences expérimentales les accepte seulement comme un indice de ce que peut être la réalité ; indice qu'il appartient à l'expérience seule de confirmer ou de rejeter. Pour revenir à l'image dont nous nous sommes servis tout à l'heure le métaphysicien, quand la plaque est développée, considère comme parfaite la correspondance avec la réalité ; l'adepte des sciences expérimentales sait qu'il y a une infinité de divergences. Laissons de côté celles qui proviennent du fait que la plaque reproduit sur un plan ce qui existe dans l'espace, les objets colorés sans couleurs, et autres divergences semblables ; mais il y en a d'autres, plus spéciales : par exemple si un être vivant a bougé, si une feuille a été agitée par le vent, tandis que la plaque, était découverte. Notons comme coïncidence tout à fait singulière, qu'il y a un fait réel correspondant précisément à la comparaison que nous avons établie uniquement pour nous faire comprendre. Plusieurs personnes crurent avoir photographié le « double astral » d'hommes et d'animaux. Ils montraient la photographie d'un homme avec une tache à côté, celle d'un faisan avec une autre tache, et disaient : « Voilà le double astral de l'homme et du faisan ». Le prof. Kronecker, de Zurich, remarqua que ces photographies sont celles que font tous les commençants, lorsqu'ils ne savent pas encore reproduire et développer sans taches le sujet qu'ils veulent photographier. Combien de ces taches ont été prises pour réalité par les métaphysiciens et par les théologiens !
[FN: § 1793-1] « C'est à l'idéologie, à cette ténébreuse métaphysique, qui, en recherchant avec subtilité les causes premières, veut sur ces bases fonder la législation des peuples, au lieu d'approprier les lois à la connaissance du cœur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les malheurs qu'a éprouvés notre belle France. Ces erreurs devaient et ont effectivement amené le régime des hommes de sang. En effet, qui a proclamé le principe d'insurrection comme un devoir ? Qui a adulé le peuple en le proclamant à une souveraineté qu'il était incapable d'exercer ? Qui a détruit la sainteté et le respect des lois, en les faisant dépendre non des principes sacrés de la justice, de la nature des choses et de la justice civile, mais seulement de la volonté d'une assemblée, composée d'hommes étrangers à la connaissance des lois civiles, criminelles, administratives, politiques et militaires ? Lorsqu'on est appelé à régénérer un État, ce sont des principes constamment opposés qu'il faut suivre. L'histoire peint le cœur humain ; c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les avantages et les inconvénients des différentes législations ».
[FN: § 1794-1]
TAINE ; L'ancien régime.
[FN: § 1794-2]
Taine ne distingue pas entre une « donnée simple » tirée de l'expérience, et une « donnée simple » tirée du sentiment. Et pourtant cette distinction est indispensable, parce qu'elle fixe la limite qui sépare les sciences logico-expérimentales de la littérature sentimentale, de la métaphysique, de la théologie (§55, 56). Adam Smith et Rousseau tirent tous deux des conséquences de principes simples ; mais le premier emploie des principes qui, ne fût-ce qu'en une faible mesure, résument l'expérience ; le second, de propos délibéré (§821-1), les maintient étrangers à l'expérience. Il suit de là que les déductions qu'on peut tirer des principes dont s'est servi Adam Smith, ont avec l'expérience une partie, petite ou grande, qui est commune : et les déductions que l'on tire des principes de Rousseau appartiennent à de nébuleuses régions sentimentales, éloignées du domaine de l'expérience. On doit faire une observation identique pour d'autres principes que certains auteurs veulent faire passer pour expérimentaux, tandis qu'ils ne le sont pas.
[FN: § 1798-1]
Ils objectent parfois à leurs adversaires que ceux-ci ne raisonnent pas suivant les règles de la métaphysique. De la même façon, les astrologues pourraient objecter aux astronomes qu'ils ne raisonnent pas suivant les règles de l'astrologie. Celui qui admet l'existence d'une science donnée S, et veut seulement en changer certaines conclusions, doit évidemment raisonner suivant les règles de cette science S. Mais celui qui, au contraire, l'estime non-concluante, vaine, fantaisiste, doit non moins évidemment s'abstenir de raisonner suivant les règles qu'il a ainsi repoussées ; et il est puéril de l'accuser de les ignorer, parce qu'il ne s'en sert pas. On comprend que celui qui défend des théories fantaisistes ait avantage à prétendre qu'on ne peut les combattre si l'on n'en accepte pas les règles et les principes, parce qu'ainsi, il se met dans une position inexpugnable. Mais le choix des moyens de combattre appartient à qui les emploie, et non pas à celui contre lequel ils sont dirigés. Évidemment, il conviendrait à messieurs les astrologues qu'on ne puisse les combattre qu'en employant les règles et les principes de l'astrologie ; mais il est nécessaire qu’ils se résignent à ce qu'on fasse voir la vanité de leur pseudo-expérience, de ses règles, de ses principes, en en comparant les résultats avec les faits expérimentaux.
[FN: § 1799-1]
La religion chrétienne était à l'origine une religion de pauvres, d'imprévoyants, de gens qui méprisaient les biens matériels, de pacifistes. Puis elle s'adapta très bien à des sociétés où il y avait des riches, des prévoyants, des gens avides de biens matériels, des guerriers. Cela fut obtenu grâce aux dérivations. Mais celles-ci eurent aussi quelque effet sur le fond des phénomènes, et en produisirent de nouveaux : par exemple celui de l'Inquisition et de plusieurs persécutions religieuses. Nous manquons encore d'une bonne histoire de ces événements, faite sans intentions polémiques pour ou contre la religion chrétienne ou l'une de ses sectes, et sans avoir pour but de louer ou de blâmer certaines institutions sociales et morales. La religion marxiste condamne absolument l'intérêt du capital ; mais cette condamnation n’a pas un effet pratique beaucoup plus grand que celle fulminée déjà par la religion chrétienne. Dans l'une de ces religions comme dans l'autre, il y a des personnes qui, vivant loin du monde, gardent la foi aux dogmes ; mais les gens qui prennent part au gouvernement de la chose publique savent très bien concilier ces dogmes avec les nécessités de la pratique. Aussi bien que les princes catholiques, les papes se firent prêter de l'argent et en payèrent l'intérêt ; et aujourd'hui, dans les pays où les socialistes prennent une part petite ou grande au gouvernement dd la chose publique, ils ne s'opposent nullement à des augmentations souvent énormes de la dette publique. Il ne manque pas de communes administrées par des socialistes, et qui contractent des dettes dont elles paient l'intérêt. Dans l’un et l'autre cas, les dérivations viennent à l'aide, pour justifier les transgressions des dogmes. Les catholiques ont imaginé la très ingénieuse dérivation des trois contrats. Les socialistes, moins ingénieux ou plus modestes, se contentent de dire qu'ils ne peuvent renoncer aux emprunts, tant que l'abolition de l'intérêt de l'argent n'est pas générale ; et, avec cette excuse commode, ils peuvent aller jusqu'au jugement dernier. La religion humanitaire amènerait directement la destruction des sociétés humaines, si ses dogmes étaient suivis à la lettre ; mais lorsque messieurs les humanitaires prennent part au gouvernement, ils savent les oublier d'une manière opportune. Par exemple, ils détruisent sans le moindre scrupule les peuples qu'ils appellent barbares, ou les tiennent dans un dur servage, plus dur souvent que celui qui porta le nom d'esclavage. Mais le dieu Progrès veut ses victimes, comme les voulurent déjà les dieux qui le précédèrent dans le panthéon des peuples civilisés. Si l'égalité, qui est un dogme de la moderne religion démocratique, était effective, il est probable que les sociétés humaines retourneraient à l'état sauvage. Mais l'égalité demeure parmi les dérivations, où elle règne, tandis que, dans la pratique, il y a des inégalités très grandes et non moindres, fût-ce sous une autre forme, que celles qu'on a observées dans le passé.
[FN: § 1800-1]
MATTH. Il y a plusieurs variantes, mais qui ne changent pas foncièrement le sens. « Trad. SEGOND (VI, 19) Ne vous amassez pas des trésors † sur la terre, où la teigne et la rouille †† détruisent, et où les voleurs percent et dérobent... (25) C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? (26) Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?... (28) Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent... (31) Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? (32) Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin... (34) Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine ».
† Le terme ![]() a un sens plus large que thésauriser, en français. Il signifie proprement amasser pour conserver. Théophraste l'emploie pour le blé, Hist. plant., VIII, 11, 6. On pourrait citer d'autres exemples semblables.
a un sens plus large que thésauriser, en français. Il signifie proprement amasser pour conserver. Théophraste l'emploie pour le blé, Hist. plant., VIII, 11, 6. On pourrait citer d'autres exemples semblables.
†† ![]() « Proprement,
« Proprement, ![]() « est la teigne qui détruit les habits. HESYCH. s. r. Quant à
« est la teigne qui détruit les habits. HESYCH. s. r. Quant à ![]() , presque tout le monde traduit par rouille. Cela peut aller pourvu qu'on prenne ce terme, non au sens restreint de la rouille du fer, mais comme signifiant tout ce qui ronge et qui consume. RILLIET, Les livres du Nouveau Testament, traduit : « (p. 19) ...où la teigne et la vermoulure détruisent ». Ainsi cela va bien.
, presque tout le monde traduit par rouille. Cela peut aller pourvu qu'on prenne ce terme, non au sens restreint de la rouille du fer, mais comme signifiant tout ce qui ronge et qui consume. RILLIET, Les livres du Nouveau Testament, traduit : « (p. 19) ...où la teigne et la vermoulure détruisent ». Ainsi cela va bien.
[FN: § 1800-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Les fictions juridiques ont précisément pour but de corriger par des interprétations certaines règles légales. Au fur et à mesure que de nouvelles nécessités écartent la pratique de la théorie, le législateur éprouve le besoin d'opérer un raccordement, pour maintenir la correspondance entre le fait et la lettre. La jurisprudence tout entière est une adaptation perpétuelle et mobile d'un texte qui demeure à des circonstances et des sentiments qui changent. On sait assez que, fréquemment, d'un même texte, les juristes tirent des conclusions très différentes, quelquefois opposées, suivant le temps et les lieux. Tandis que les uns déclarent s'en tenir strictement à la lettre, les autres soutiennent, chacun pour leur compte, que leurs thèses sont conformes à l'esprit de la loi. Ce que l'on entend par esprit de la loi, c'est tantôt l'intention présumée du législateur, tantôt l'opinion courante ou celle de qui l'invoque ; mais le but est toujours le même : atténuer la rigueur du précepte juridique par rapport à certaines fins que poursuit l'interprète. Pour cela, il est bon d'avoir recours à des dérivations quelque peu indéterminées, afin de laisser du jeu à l'interprétation et de ménager une certaine réserve d'arguments nouveaux. (Voir §229 et 834 à 836.)
[FN: § 1801-1]
D. HIERONY.; In Matth., c. VI, t. VI : « (p. 9) Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi aerugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur... Ideo a) dico vobis : Ne soliciti sitis animae vestrae, quid manducetis : neque corpori vestro, quid induamini. Nonne b) anima plus est quam esca, et corpus plus est quam vestimentum ? Respicite c) volatilia coeli : quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et pater vester coelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis, illis d) ... Considerate lilia agri quo modo crescunt : non laborant neque nent. ...Nolite e) ergo soliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur ? Haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim pater vester, quia his omnibus indigetis... Nolite ergo soliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies solicitus erit sibi ipsi. Sufficit f) diei malitia sua ».
a) In nonnullis codicibus additum est : neque quid bibatis. Ergo quod omnibus natura tribuit, et iumentis ac bestiis, hominibusque commune est, huius cura non penitus liberamur. Sed praecipitur nobis ne soliciti simus quid comedamus : quia in sudore vultus praeparamus nobis panem. Labor exercendus est : solicitudo tollenda. Hoc quod dicitur : Ne soliciti sitis animae vestrae quid comedatis : neque corpori vestro quid induamini, de carnali cibo et vestimenio accipiamus. Caeterum de spiritualibus cibis et vestimentis semper debemus esse soliciti.
b) Qond dicit istiusmodi est : Qui maiora praestitit, utique et minora praestabit.
c) Apostolus praecipit, ne plus sapiamus, quam oportet sapere. Istud testimonium et in praesenti capitulo conservandum est. Suut enim quidam, qui volunt terminus patrum excedere, et ad alta volitare, in ima merguntur : volatilia dicentes caeli angelos esse, caeterasque in Dei ministerio fortitudines. quae absque cura sui, Dei alantur providentia. Si hoc ita est, ut intelligi volunt, quo modo sequitur dictum ad homines: Nonne vos magis pluris estis illis ? Simpliciter ergo accipiendum : quod si volatilia absque cura et aerumnis, Dei aluntur providentia : quae bodie sunt, et cras non erunt : quorum anima mortalis est, et cum esse cessaverint, semper non erunt quanto magis homines quibus aeternitas promittitur, Dei reguntur arbitrio ?
d) Sicut animam plus esse quam cibum, comparutione avium demonstravit : sic corpus plus esse quam vestem, ex consequentibus rebus ostendit dicens...
e) De presentibus ergo concessit debere esse solicitos qui futura probibet cogitare. Unde et Apostolus (I Thess., II, 9) : Nocte et die, inquit, manibus nostris operantes : ne quem vestrum gravaremus. Cras in scripturis futurum tempus intelligitur...
f) Hic et malitiam non contrariam virtuti posuit, sed laborem et afflictionem, et angustias saeculi... Sufficit ergo nobis praesentis temporis cogitatio : futurorum curam, quae incerta est, relinquamus.
[FN: § 1803-1]
D. AUGUST. ; De sermone Domini in monte secundum Matthaeum, II, 17, 57. Après avoir montré que Saint Paul s'est préoccupé de l'avenir, et avoir cité les paroles de l'apôtre, Saint Augustin ajoute : Male intelligentibus non videtur servare praeceptum Domini, quo ait : « Respicite volatilia coeli, quoniam non serunt neque metunt, neque congregant in horrea » ; et : « Considerate lilia agri quomodo crescunt, non laborant neque nent ». Cum istis praecipit ut laborent, operantes manibus suis, ita ut habeant quod etiam aliis possint tribuere (I Thess., II, 9). Et quod saepe de seipso dicit, quod manibus suis operatus sit, ne quem gravaret (II Thess., III, 8) : et de illo scriptum est, quod coniunxerit se Aquilae propter artis similitudinem, ut simul operarentur unde victum transigerent (Act., XVIII, 3), non videtur imitatus aves coeli et lilia agri. À vrai dire, cela paraît tout à fait évident ; et pourtant, il n'en est pas ainsi ! His et huiusmodi Scripturarum locis, satis apparet Dominum nostrum non hoc improbare, si quis humano more ista procuret : sed si quis propter ista Deo militet, ut in operibus suis non regnum Dei, sed istorum acquisitionem intueatur. C'est-à-dire : « Il apparaît suffisamment par ces passages et par d'autres semblables des Écritures que notre Seigneur ne réprouve pas cela, si quelqu'un recherche ces choses par des moyens humains ; mais bien si quelqu'un sert Dieu en vue de ces choses, de telle sorte qu'il tende par ses œuvres, non au règne de Dieu, mais à l'acquisition de ces choses ». Si Saint Matthieu a vraiment voulu dire cela, il faut reconnaître, que tout en ayant de beaux talents, il n'avait pas celui d'exprimer clairement sa pensée.
[FN: § 1803-2]
D. AUGUST. ; Retractat., II, 21 : La nécessité me contraignit d'écrire le livre Du travail des moines, parce que lorsque les monastères commencèrent à exister à Carthage, les uns se subvenaient par les travaux manuels, obéissant à l'apôtre, les autres voulaient vivre des oblations des gens religieux, en ne faisant rien pour se procurer ou compléter leur nécessaire, estimant mieux pratiquer, et s'en vantant, le précepte évangélique où le Seigneur dit (Matth., VI, 26) : Respicite volatilia coeli et lilia agri. C'est pourquoi, même parmi les simples laïques, mais qui étaient animés d'une foi fervente, des disputes tumultueuses commencèrent à se produire, qui troublaient l'Église... » – D. AUGUST. ; De opere monachorum, 23, 27. Le saint dit : « En vérité, ils invoquent maintenant l'Évangile du Christ contre l'apôtre du Christ. Elles sont surprenantes les actions de ces paresseux, qui veulent faire au nom de l'Évangile un obstacle de ce que l’apôtre prescrivit et fit précisément afin que l'Évangile même n'eût pas d'obstacles. Et pourtant, si nous voulions les contraindre à vivre suivant les paroles mêmes de l'Évangile, telles qu'ils les comprennent, ils seraient les premiers à tâcher de nous persuader qu'elles ne doivent pas être comprises comme ils les comprennent. Ils disent, en effet, ne pas devoir travailler parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, eux que le Seigneur nous donna comme exemple, afin que nous ne nous inquiétions pas de ces choses nécessaires. Pourquoi ne font-ils pas attention à ce qui suit ? car il n'est pas dit seulement : parce qu'„ ils ne sèment ni ne moissonnent, “ mais il est ajouté „ et ils n'amassent pas dans les greniers “. Ces greniers peuvent être des greniers proprement dits ou des crédences. Pourquoi donc ces gens veulent-ils avoir les mains oisives et les crédences pleines ? Pourquoi ce qu'ils recueillent grâce au travail d'autrui l'amassent-ils et le conservent-ils pour leurs besoins journaliers ? Pourquoi moulent-ils et cuisent-ils ? Vraiment, les oiseaux ne font pas cela ».
[FN: § 1803-3]
D. AUGUST. ; De sermone Domini in monte sepundum Matthaeum, II 17, 58. Un sermon de Saint Augustin, qui paraît apocryphe, se rapproche un peu plus du sens littéral. Le précepte évangélique est entendu en ce sens qu'il condamne seulement l'avarice, et qu'il promet que Dieu aura soin de procurer les biens matériels aux fidèles. – Serm. CCCX (alias XLVII ex 50 homil.), Eleemosinae efficacia – Inanis est avarorum providentia, 3. ...Fac misericordiam. Quid dubitas ? Non te deserit, qui te praerogatorem constituit. Ipsitis est enim vox in Evangelio arguentis incredulos et dicentis : « Considerate volatilia caeli, quoniam rien seminant neque metunt », quibus non sunt cellaria ; « et Pater vester caelestis pascit illa ». C'est possible, mais quand la neige recouvre la terre, les pauvres oiseaux souffrent de la faim, et beaucoup meurent. Ceux qui vivent près des habitations des hommes sont bien contents d'être nourris de ce que la prévoyance humaine a mis en réserve.
[FN: § 1803-4]
D. ANSELMI ; Enarrationum in Evangelium Matthaei, c. VI : [Ideo dico vobis : Ne soliciti sitis, etc.] Et quia non potestis Deo servire et mammonae, ideo nolite esse soliciti de divitiis temporalibus causa vietus et vestitus. Duae enim sunt sollicitudines, alia est rerum, alia vitio hominum. Ex rebus ipsis oritur sollicitudo, quia panem habere non possumus nisi seminemus, laboremus et similia. Hanc sollicitudinem non prohibet quia Dominus ait : In sudore vultus tui vesceris pane tuo. – Cela prouve qu'il y a des passages contradictoires dans l'ancien et dans le nouveau Testament, mais ils ne détruisent pas le sens de SaintMatthieu. – Conceditur ergo nobis providentia et labor. Sed est quaedam sollicitudo ex vitio hominum superflua, quando ipsi desperantes de, bonitate Dei frumentum, plusquam est necessarium, et pecuniam reservant, et dimissis spiritualibus, illis intenti sunt hoc prohibetur. – Saint Anselme fait cette distinction : mais on n'en voit pas trace dans les paroles de Matthieu. – Saint Jean Chrysostôme s'en lire aussi d'une manière semblable. D. IOANN. CHRYS. ; hom. XXI in c. Matth., VI. Après avoir rappelé que le Seigneur dit des oiseaux qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. Saint Jean Chrysostôme ajoute : « (3) Quoi donc ? Dit-il qu'on ne doit pas semer ? Il ne dit pas qu'on ne doit pas semer, mais qu'on ne doit pas s'inquiéter, ni qu’on ne doit pas travailler, mais qu'il ne faut pas se décourager ni se rendre malheureux en se tourmentant ».
[FN: § 1803-5]
D. THOM. ; Summa theol., IIa IIae, q. 55, art. 7. Conclusio. Oportet hominem tempore congruenti atque opportuno, non autem extra illud tempus, de futuris esse sollicitum.
[FN: § 1804-1]
D. EPIPHANII. ; adversus haereses : haeresis LXXX, 1 : ![]()
![]() ... « mais étant seulement des Grecs ». (2) Ensuite, ils prirent le nom de chrétiens.
... « mais étant seulement des Grecs ». (2) Ensuite, ils prirent le nom de chrétiens.
[FN: § 1804-2]
THEODORET. : Eccles. hist., IV, 11. – IOAN. DAMASC. ; De haeresibus « Ils fuient tout travail manuel, comme non convenable à un chrétien, et indigne de lui ». – THEODORET. ; Hacret. fab., IV., 11. – D. AUGUST. ; De haeres., 57 : Dicuntur Euchitae opinari, monachis non licere sustentandae vitae suae causa aliquid operari, atque ita se ipsos monachos profiteri, ut omnino ab operibus vacent.
[FN: § 1807-1]
F. TOCCO ; L'eresia nel medio evo. Parlant des franciscains intransigeants, l'auteur dit : « (p. 518) Sous ces prétextes mesquins, les intransigeants visaient bien plus haut : à déclarer que la vie prescrite par la règle ne diffère pas de la vie évangélique, et que Jésus et les apôtres s'y sont conformé ; que par conséquent non seulement les Frères mineurs, mais tous les chrétiens qui doivent faire de l'Évangile la règle de leur vie, devraient s'y conformer ; ce qui revient à dire que non seulement le clergé, mais toute la chrétienté devrait se transformer en un vaste couvent franciscain ».
[FN: § 1810-1]
Nous avons une longue lettre de Jean XXII, dans laquelle il se plaint vivement de l'œuvre perverse des Minorites, et leur reproche de vouloir se soustraire à l'autorité du Saint-Siège. – BARIONIUS (RAYNALDO) ; Ann. eccl., ann. 1318, XLV. Il transcrit la lettre de Jean XXII : ... Verum quia sic sunt casus mentis, ut primo quidem infelix animus per superbiam intumescat, et inde in contentionem, de contentione in schisma, de schisinate in haeresim, et de haeresi in blasphemias infelici gradatione, immo praecipiti ruina descendat ;...
[FN: § 1812-1]
F. Tocco ; L'eresia nel medio evo. – FLEURY ; Hist. eccl., t. XX. L'auteur dit des franciscains : « (p. XII) Il eût été, ce semble, plus utile à l'église que les évêques et les papes se fussent appliquez sérieusement à réformer le clergé séculier, et le rétablir sur le pied des quatre premiers siècles, sans appeller au secours ces troupes étrangeres ; en sorte qu'il n'y eût que deux genres de personnes consacrées à Dieu, des clercs destinez à l'instruction et à la conduite des (p. XIII) fidèles et parfaitement soumis aux évêques ; et des moines entièrement séparez du monde, et appliquez uniquement à prier et travailler en silence. Au treizième siècle l'idée de cette perfection étoit oubliée, et l'on étoit touché des désordres que l'on avoit devant les yeux : l'avarice du clergé, son luxe, sa vie molle et voluptueuse, qui avoit aussi gagné les monasteres rentez ».
[FN: § 1813-1]
Prêcher le retour à la « pauvreté évangélique » fut toujours l'arme préférée des ennemis de la papauté. Frédéric II, lui-même, s'en servit. F. TOCCO ; L'eres. nel med. evo, p. 447, remarque : « À l'égard du clergé séculaire, le langage de Frédéric II n'est pas différent de celui des franciscains intransigeants. Voyez la lettre au roi d'Angleterre, dans Bréholles, III, 37-38, p. 50 : In paupertate quidem et simplicitate fundata erat Ecclesia primitiva, cum, sanctus, quos catalogus sanctorum commemorat, fecunda parturiret : sed (p. 448) olim fundamentum. nemo potest ponere praeter illud quod positum est a Domino et stabilitum. Porro quia in divitiis navigant, in divitiis volutantur, in divitiis aedificant, timendum ne paries inclinetur Ecclesiae, ne maceria depuisa ruina subsequatur ». – Pour combattre Frédéric II, Grégoire IX favorisa le parti intransigeant des franciscains. F. TOCCO ; loc. cit. : « (p. 445)
Je crois probable que le pape rompit avec le général franciscain pour des motifs politiques. Nous avons dit déjà que celui-ci était également bien vu de Grégoire et de Frédéric, et Salimbene nous dit qu'il jouait souvent le rôle de médiateur entre eux. Peut-être, dans ces négociations se montra-t-il plus favorable à la cause impériale... Pour ces raisons, Grégoire déclara cette cause liée à celle du parti intransigeant, et non seulement il déposa le malencontreux (p. 446) général, mais l'ayant fait expulser de l'ordre, il l'excommunia solennellement ; et il lui serait certainement arrivé pis, si Frédéric ne l'eût pris sous sa protection. L'avisé empereur, accusé d'hérésie, tirait grand avantage d'avoir de son côté le compagnon de saint François, qui, peu d'années auparavant, jouissait d'un grand respect de la part du pape lui-même ».
[FN: § 1814-1]
Plus tard, en 1311, on trouve définie une différence analogue, dans une bulle de Clément V. CLEMENT., V, 11, De verborum significatione, 1, Exivi de paradiso... Ex praemissis auteni succrevit non parum scrupulosa quaestio inter fratres : videlicet utrum ex suae professione regulae obligentur ad arctum, et tenuem, sive pauperem usum rerum : quibusdam ex ipsis credentibus, et dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam ; ita ipsis quoad usum arctitudo maxima, et exilitas est indicta. Aliis in contrarium asserentibus, quod ex professione sua ad nullum usum pauperem, qui non exprimatur in regula, obligantur : licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et magis ex concedenti, quam ceteri Christiani.
[FN: § 1814-2]
F. TOCCO ; I, p. 500, note : Liber sententiarum inquis. tholos., p. 326 : Dixit tamen quod audivit ab aliquibus fratribus minoribus de illis vocatis spiritualibus de Narbona et ita fore credidit quod ordo fratrum minorum debebat dividi in tres partes, scilicet in communitate ordinis, quae vult habere granaria et cellaria, et in fratissellis et fratribus, qui sunt in Sicilia sub fratre Henrico de Ceva, et fratribus vocatis spiritualibus vel pauperibus et etiam beguinis. Et dicebant quod prime due partes, quia non observant regulam beati Francisci debebant cadere et cassari, sed tercia pars quia observabat regulam evangelicam debebat remanere usque ad finem mundi...
[FN: § 1814-3]
FLEURY ; Hist. eccl., t. XVIII « (p. 535) Ceux d'entre les frères mineurs qui se pretendoient les plus zélés pour l'étroite observance, ne manquèrent pas de profiter de la disposition favorable du pape (p. 536) Célestin pour l'austérité et la réforme. Ils lui envoyèrent donc frère Libérat et frère Pierre de Macérata... Ils vinrent le trouver... et lui demandèrent que sous son autorité, à laquelle personne n'oseroit s'opposer, il leur fût permis de vivre selon la pureté de leur règle et l'intention de saint François : ce qu'ils obtinrent facilement. Mais de plus le pape leur accorda la faculté de demeurer ensemble partout où il leur plairoit, pour y pratiquer en liberté la rigueur de leur observance... il voulut qu'ils ne s'appellassent plus frères Mineurs, mais les pauvres hermites, et on les appela ensuite les hermites du pape Célestin... (p. 537) Ainsi, quoique les intentions de Célestin fussent très pures, la simplicité dans laquelle il avoit passé sa vie, le défaut d'expérience, la foiblesse de l'âge, lui firent commettre bien des fautes... (p. 543) Boniface commença son pontificat par la révocation des grâces accordées par Célestin, de la simplicité duquel on avoit abusé... ».
[FN: § 1817-1]
Sexti decret., V, 12, De verborum significatione, 3, Exiit qui seminat. Il continue ainsi : Ne talium rerum sub incerto videatur esse dominium, cum patri filius suo modo, servus domino, et monachus monasterio res sibi oblatas, concessas, vel donatas acquirant, omnium ustensilium, et librorum, ac eorum mobilium praesentium, et futurorum, quae, et quorum usumfructum scilicet Ordinibus, vel fratribus ipsis licet habere, proprietatem, et dominiurn (quod et fel. record. Innoc. Papa IV praedec. noster fecisse dignoscitur) in nos, et Romanam Ecclesiam plene, et libere pertinere hac praesenti constitutione in perpetuum valitura sancimus.
[FN: § 1817-2]
Clementinarum, V, 11, De verborum significatione, 1 : Exivi de paradiso... Rursus cum praedictus sanctus [Franciscus] tam in exemplis vitae, quam verbis regulae ostenderit se velle, quod fratres sui, et filii divinae providentiae innitentes suos in Deum iacerent cogitatus, qui volucres caeli pascit, quae non congregant in horrea, nec seminant, nec metunt : non est verisimile voluisse ipsum eos habere granaria, vel cellaria, ubi quotidianis mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam.
[FN: § 1817-3]
Extravag. Ioan. XXII, 14, De verborum significatione, : Quorundam exigit. La constitution fut répétée : c'est pourquoi elle a différentes dates postérieures à 1317. Nosque nihilominus praefatorum ministrorum, custodum, et gardaniorum iudicio praesentium auctoritate committimus, determinare videlicet, arbitrari, atque praecipere, cuuas longitudinis, et latitudinis, grossitiei, et subtilitatis, formae, sive figurae, alque similium accidentium esse debeant tam habitus, ipsorumque caputia, quam interiores tunicae, quibus fratres omnes Minores dicti ordinis induuntur, ...Nos de praedictorum fratrum nostrorum consilio eorumdem ministrorum, et custodum sub eadem forma iudicio praesentium auctoritate committimus, determinare videlicet, arbitrari, atque praecipere eo casu qualiter, ubi, et quando, et quoties granum, panem, et vinum pro vitae fratrum necessariis fratres ipsi quaerere debeant, conservare, sive reponere, etiamsi reponenda sint in praedictis granariis, et cellariis conservanda. Religio namque perimitur, si a meritoria subditi obedientia subtrahantur : magna quidem paupertas, sed maior integritas, bonum est obedientia maximum, si custodiatur illaesa : nam prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur, et animo quos velut eflraenes, et liberos ditioni alterius, humilis iugo propriae voluntatis adstringit.
[FN: § 1817-4]
En 1318, à Marseille quatre frères Mineurs préférèrent se laisser brûler, plutôt que d'obéir au pape. Dans la sentence de condamnation, il est dit de ces Frères : Asseraerunt quod sanctissimus Pater Iohannes XXII non habuit nec habet potestatem faciendi quosdam declarationes, commissiones et praecepta contenta in quadam constitutione sive decretali... quae incipit Quorundam, et quod ipsi Domino Papae non tenebantur obedire. Et insuper corarn nobis constituti protestati sunt verbo et in scriptis quod stabant et stare intendunt usque in diem iudicii in protestationibus... videlicet quod illud quod est contra regulae fratrum minorum observantiam et intelligentiam est per consequens contra evangelium et fidem, alias non esset penitus quod regula evangelica, et quod nullus mortalis potest eos cogere ad deponendum ipsos habitos curtos et strictos (Citat. de Tocco, loc. cit., p. 516). – Extravag. Ioann. XXII, XIV, De verborum significatione,5 : Quia quorundam mentes. Le pape réprouve et condamne l'opinion de ceux qui n'acceptaient pas sa constitution Quorundam exigit, et dit des Mineurs : Ad impugnandas autem constitationes praedictas suprascripta ratione, tam verbo, quam scripto usi sunt publice, sicut fertur : illud, inquiunt, quod per clavem scientiae in fide, ac moribus semel definierunt Romani Pontifices, adeo immutabile perseverat, quod illud successori revocare non licet in dubium, nec contrarium affirmare licet de iis, quae per clavem potestatis ordinaverint, asserant secus esse. In confirmatione autem regulae ordinis fratrum Minorum Honorii tertii, Gregorii noni, Innocentii quarti, Alexandri quarti, Nicolai quarti, praedecessorum nostrorum summorum Pontificum haec verba asserunt contineri : Haec est regula Evangelica Christi, et Apostolorum imitatrix, quae nihil in hoc mundo habet proprium, vel commune ; sed in rebus, quibus utuntur, habent simplicem usum facti ; his addere praesumentes praefatos summos Pontifices, et multa Concilia generalia per clavem scientiae definisse, paupertatem Christi, et Apostolorum constitisse perfecte in expropriatione cuiuslibet temporalis dominii civilis, et mundani, et sustentationem eorum in solo, et nudo usu facti etiam constitisse : ex quibus nituntur concludere, non licuisse, nec licere ipsorum successoribus contra praemissa aliquid immutare...
[FN: § 1817-5]
Extravag. Ioan. XXII, XIV, 3, Ad conditorem canonum. Dans les Inst. iur. canon., on donne ce sommaire de la constitution : Dominium rerum, quae perveniebant ad fratres Minores, retentum ab Ecclesia Romana, simplici usu facti fratribus ipsis reservato in c. Exiit qui seminat eod. tit., 1. 6, summus Pontifex refutat : multiplici ratione probans eos non posse habere in re aliqua simplicem usum facti ; et statuit, quod de cetero nullum ius, nullumque dominium habeat Ecclesia Romana in huiusmodi rebus, quae in posterum conferentur, vel offerentur ipsis fratribus. Sur les genres d'objpts de consommation, le pape dit : Quis enim sanae mentis credere poterit quod intentio fuerit tanti patris unius ovi, seu casei, aut frusti panis, et aliorum usa consuratibilium, quae saepe fratribus ipsis ad consumendum e vestigio conferuntur, dominium Romanae Ecclesiae, et usum fratribus retinere ?
[FN: § 1817-6]
Extravag. Ioan. XXII, XIV, 3. Ad conditorem canonum. Le pape dit qu'il veut revenir à la vérité, des faits, et laisser de côté les simulations, qui pourraient obscurcir la gloire de l'Église. Il conclut, par conséquent : De fratrum, nostrorum consilio hoc edicto in perpetuum valituro sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur, vel offerentur, aut alias quomodolibet obvenire continget fratribus, seu ordini supradicti (exceptis Ecclesiis, oratoriis, officinis, et habitationibus, ne vasis, libris et vestimentis divinis officiis dedicatis, vel dedicandis, quae ad ipsos obvenient in futurum, ad quae se non extendunt adeo inconvenentia supradicta, propter quod constitutionem istam ad illa extendi nolumus) nullum ius, seu dominium aliquod occasione ordinationis praedictae, seu cuiusvis alterius a quocumque praedecessorum nostrorum super hoc specialiter editae, Romanae Ecclesiae acquiratur ; sed quoad hoc habeantur prorsus ordinationes huiusmodi pro non factis. Il y eut, sur ce point, une longue et âpre polémique entre le pape et les franciscains, soutenus par Louis de Bavière ; car, sous les dérivations, se dissimulait, comme d'habitude, une discussion de fond qui, dans le présent cas, était celle divisant la papauté et l'Empire. Le pape déposa Michel de Cesena, général des franciscains, et l'excommunia. Il publia ensuite la célèbre bulle Quia vir reprobus, où il réfute longuement et subtilement les critiques de Michel de Cesena. Cette bulle apparaît comme un traité complet de la matière. Il est remarquable que le pape ait vu la vanité du droit naturel ou des gens, comme fondement du droit ; mais comme il voulait pourtant conserver ce droit naturel, il se mit à la recherche d'une dérivation propre à faire atteindre ce but, et, ainsi qu'il arrive toujours, il la trouva aisément. Il fit du droit humain une conséquence du droit divin : Adhuc quod nullo iure humano, sed solum divino dominium rerum temporalium potuit dari hominibus, patet ; constat enim, quod rem aliquam aliquis dare non potest nisi cuius est, vel alias eius voluntate : nec dubium quin Deus omnium temporalium vel iure creationis, quia illa de nihilo creaverat, vel iure factionis, quia de sua materia illa fecerat, dominus esset. Ergo nulus Rex de illarum dominio, nisi de voluntate Dei potuit ordinare. Si l'on admet les prémisses, le syllogisme est parfait ; et si la logique pouvait avoir sa place en ces matières, il serait nécessaire de reconnaître que le raisonnement du pape ne fait pas un pli. Unde patet, quod nec iure naturali primaevo, si ponatur pro illo iure, quod omnibus animantibus est commune ; cum illud ius nihil statuat, sed inclinat, seu dirigit ad aliqua omnibus animantibus communia facienda. Nec iure gentium, nec iure Regum, seu Imperatorum fuit dominium rertim temporalium introductum ; sed per Deum, qui est et erat earum rerum dominus, fuit collatum primis parentibus...
[FN: § 1818-1]
Voir : YVES GUYOT ; La question de l'alcool. Allégations et réalités. Paris, F. Alcan, 1917. Ce livre expose fort bien la question et renferme un grand nombre de documents précieux.
[FN: § 1819-1] « Rien de nouveau sous le soleil ». Ce type se retrouve chez les dévots de tout temps et de tout pays. Les dévots des siècles passés et nos humanitaires sont de la même trempe. – Sorberiana : « p. 96) Dévot Il n'y a rien plus à craindre qu'un dévot irrité ; c’est un animal fort colérique et vindicatif, parce qu'il estime que Dieu lui doit de retour, que la Religion est blessée en sa personne et que ses fureurs sont divines ».
[FN: § 1820-1]
EUSEBII ; Evang. praep., XIV, 7 (p. 736).
[FN: § 1821-1]
BAYLE ; Dict. hist.,s. r. Gedicus, (A) : « L'auteur de la dissertation n'en veut point principalement aux femmes ; ce n’est que par accident et fort indirectement qu'il les maltraite : son principal but est de tourner en ridicule le Système des Sociniens, et leur méthode de se jouer des textes les plus formels de la parole de Dieu touchant la Divinité du Verbe. Il y a longtemps qu'un journaliste l'a remarqué. Voici ses paroles : „ Pourquoi ne pas permettre à tout le monde de se convaincre que les Sociniens ne payent que de chicaneries si méchantes, qu'on leur a fait voir qu'avec leurs Gloses on éluderoit tous les passages de l’Écriture qui prouvent que les femmes sont des creatures humaines, je veux dire de même espece que les hommes. Ce fut le sujet d'un petit livre qui parut sur la fin du dernier siècle : mulieres homines non esse, auquel un nommé Simon Gediccus, Ministre du pais de Brandebourg repondit fort serieusement, n'ayant pas pris garde au but de l'Auteur, qui étoit de faire une Satire violente contre les Sociniens ; car en effet que peut imaginer de plus propre à les tourner en ridicule, ou de plus mortifiant, que de leur montrer, que les Gloses, avec lesquelles ils combattent la consubstantialité du Fils de Dieu, sont capables d’empêcher qu'on ne prouve par l’Écriture que les femmes sont des creatures humaines ? " a). Cochleus employa la même machine, mais fort inutilement contre Luther ; il fit des livres où en se servant de la méthode Luthérienne, il prouvoit par des passages de l'Ecriture que Jésus-Christ n'est point Dieu, que Dieu doit obéir au Diable, et que la Sainte Vierge ne garda point sa virginité ». Bayle ajoute que : Theoph. Raynaudus « venoit de donner un grand exemple du pouvoir de la chicane : il avoit montré qu'en se servant des principes de certains Censeurs, le Symbole des Apôtres ne contenoit aucun article que l'on ne pût fulminer ».
a) Nouvelles de la République des lettres, mois de juillet 1685, page 802.
[FN: § 1823-1]
T. MARTELLO ; dans le Journal des Économistes, mai 1913 : « (p. 491) J'ai dit que le jeu du loto est le jeu de la spoliation. Je ne l'ai pas dit par métaphore. Il en est réellement ainsi. C'est un jeu de spoliation, parce qu'il ne règle pas les numéros sortants comme le fait la roulette, (jeu de pur hasard), mais qu'il garde à son propre avantage 85 numéros sur 90 qu'il met dans l’urne. À la roulette, celui qui met un écu sur une couleur, gagne un écu ; sur 6 numéros, il en gagne 5 et retire le sien ; sur la douzaine ou la colonne (12 numéros) il en gagne 11 et retire le sien. Celui qui joue un écu en plein, ou qui met un écu sur l'un quelconque des 36 numéros, en gagne 35 et retire le sien. Celui qui veut faire le jeu de la banque met sur zéro. Au contraire, le loto royal paie 10 fois et demi la mise à celui qui gagne l'extrait simple. S'il procédait comme la roulette, il devrait en payer 18, soit autant de mises en plus qu'il y a de probabilités favorables en plus (17 + 1). À celui qui gagne l'extrait déterminé, le loto royal paie 52 fois et demi sa mise, au lieu de 90 fois (spoliation 41,67 %). Ensuite, la spoliation continue en proportions énormes. À celui qui gagne l'ambe, il paie 250 fois sa mise au lieu de 400,50 (spoliation 37,58%) ; au gagnant du terne, il paie 4250 fois sa mise, au lieu de 11 748 (spoliation 63,82 %) ; il paie 60 000 fois la mise au gagnant du quaterne (p. 492) au lieu de 511 038 (spoliation 88,26 %)... Mais on remarquera encore que, quelle que puisse être la mise du jeu (terne, quaterne, quine), le loto royal ne paie pas plus de 400 000 francs au même billet : Ainsi celui qui mettrait 100 francs sur un quaterne devrait avoir 511 038 fois sa mise, soit 51 103 800 ; mais le quaterne n'étant payé qu'à raison de 60 000 fois la mise, il devrait avoir 6 000 000 de francs ; et, au contraire, à cause de la limite sus-indiquée, il ne retirerait que 400 000 francs, et la spoliation atteindrait, par conséquent, 93,33 %. Ce n'est pas tout : le loto royal ne paie pas plus de six millions de francs pour chaque tirage sur tous les jeux de tous les bureaux du royaume ; et si, au total, les jeux gagnants emportaient, pour le loto royal, une dépense supérieure aux six millions, le gain de tous les jeux serait réduit en proportion correspondante, et, en ce cas, la spoliation n'a pas de pour cent fixe, mais oscille au delà des pour cent sus-indiqués, suivant le chiffre plus ou moins haut, au delà de la limite des six millions. Par ces artifices, l'État prélève sur les maigres ressources des gens les plus nombreux et les moins fortunés du royaume, plus de quatre-vingt-dix millions de francs par an... ». C'est là l'« État éthique » ou de « droit » des théoriciens.
[FN: § 1824-1]
Manuale, p. 75 : « Sembat. Vous avez parlé, vous aussi, monsieur le procureur général, de l'intérêt supérieur. Il y a donc une raison d'État devant laquelle un magistrat est obligé, de s'incliner ? – Bulot. Sous peine d'être révoqué, évidemment (rires) ». En 1914, une commission d'enquête parlementaire révéla qu'un procureur général et un président de Cour d’appel s'étaient inclinés devant « la raison d'État », à eux manifestée par le ministre Monis, et avaient, contre leur volonté favorisé Rochette. Il y eut alors un grand nombre de gens qui s'étonnèrent, d'autres qui s'indignèrent de voir mettre ainsi en pratique une théorie formulée tant d'années auparavant par Bulot, théorie bien connue d'eux, et qui est appliquée à chaque instant par les partis qui sont au gouvernement.
[FN: § 1832-1]
Des observations analogues abondent dans la littérature. Elles rappellent les vers bien connus :
class="poem"
[FN: § 1833-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Exode, I, 11-12 « Et l'on établit sur lui [Israël] des chefs de corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l’on prit en aversion les enfants d'Israël ». Il est facile, de trouver un grand nombre d'exemples analogues : il suffit de songer à l'enthousiasme frénétique des martyrs de toute religion, au patriotisme farouche de plusieurs peuples opprimés, à l'énergie croissante de telle ou telle classe sociale tenue en servitude ou en dépendance.
[FN: § 1839-1]
Voici deux exemples se rapportant l'un à la France, l'autre à l'Italie. Dans le premier de ces pays, en 1911, le plus grand nombre de ceux qui étaient adultes, au temps de la guerre de 1870, avaient disparu. Cela fut, au moins en partie, la cause du réveil de nationalisme en France. Dans le second de ces pays, en 1913, la plus grande partie de ceux qui avaient souffert au temps de la domination autrichienne sur l'Italie avaient disparu. Cela rendit plus facile l'œuvre du gouvernement, qui traitait de « rebelles » les Arabes défendant leur pays, et qui, pour maintenir « l'équilibre de l'Adriatique », voulaient que les Grecs de l'Épire fussent soumis à la domination albanaise, exactement comme les Italiens du Lombard-Vénitien étaient soumis jadis à la domination autrichienne.
[FN: § 1843-1]
LEFEBVRE DE BÉHAINE ; Léon XIII et le prince de Bismarck. En 1871, quand apparaît, en Bavière, la secte des « vieux catholiques », et que le ministre bavarois Lutz commence les hostilités contre la cour de Rome : « (p. 19) Quoique, depuis, le prince de Bismarck eût en maintes circonstances décliné la responsabilité de cette politique agressive, il est bien difficile d'admettre qu'il ait éprouvé quelque déplaisir de la voir inaugurée par le ministre des cultes du plus important des pays catholiques d'Allemagne... (p. 48) Dès 1874, c'est-à-dire avant la fin de la troisième année où avait commencé la campagne contre Rome, les observateurs attentifs prévoyaient que le résultat de cette campagne devenait douteux, et on constatait que le prince de Bismarck marquait moins de zèle pour soutenir l'idée d'une Église nationale allemande... (p. 51) Cette situation violente [le conflit entre le gouvernement allemand et Rome] devait durer plusieurs années, et il fallut des circonstances que n'avaient pas prévues les nationaux-libéraux pour détacher complètement le prince de Bismarck d'un programme qui avait d'abord séduit son esprit, mais dont l'insuccès était devenu certain depuis que les populations catholiques de l'Empire avaient répondu aux menaces dont elles étaient l'objet en se faisant représenter au Reichstag par une minorité qui avait pris, sous le nom de fraction du centre, une grande importance, tandis qu'au contraire les nationaux-libéraux étaient chaque jour combattus avec plus d'ardeur par les progressistes et les socialistes ». – BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : «(p. 366) Qu'on se rappelle l'époque où le Centre, fort de l'appui des jésuites plus que de celui du pape, soutenu par les Guelfes (et pas uniquement par ceux de Hanovre), par les Polonais, les Alsaciens francophiles, le parti démocratique radical, les démocrates socialistes, les libéraux et les particularistes, tous unis dans un seul et même sentiment d'hostilité contre l'empire et sa dynastie, possédait, sous la direction de ce même Windthorst, qui avant et après sa mort est devenu un saint national, une majorité sûre et impérieuse faisant échec à l'empereur et aux gouvernements confédérés ».
[FN: § 1843-2]
À vrai dire, l'erreur de Bismarck paraît avoir été de tactique politique plutôt que d'évaluation de la force des résidus ou de l'art de s'en servir. En effet, avant et après le Kulturkampf, il fit voir qu'il savait se servir des résidus sans le moindre scrupule. Les « intellectuels » fanatiques du Kulturkampf croyaient que Bismarck était partisan de leurs croyances, tandis qu'il se servait de ces bonnes gens, uniquement comme d'instruments. – BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I En octobre 1870, on parlait du départ de Rome, du pape : « p. 189) Mais, observa Hatzfeldt, ce serait pourtant l'intérêt des Italiens qu'il restât à Rome. (p. 190) Parfaitement, répliqua le chancelier. Mais il peut tout de même être obligé de s'en aller. Et, alors, où ira-t-il ? En France ? Il y a Garibaldi qui y est en ce moment. En Autriche ? Ça ne lui dit guère ! Il ne lui reste que la Belgique... ou l'Allemagne. Et, de fait, il m'a déjà demandé si nous consentirions à lui accorder asile. Je n'y ai pas d'objection : nous avons Cologne ou Fulda. Ce serait peut-être bizarre, mais, après tout, pas si inexplicable ! Et quel profit ! Nous montrerions aux catholiques que nous sommes les seuls capables de protéger le chef de leur Église. Stofflet et Charette, avec leurs zouaves, pourraient retourner à leurs affaires. Nous aurions pour nous les Polonais ; l'opposition des ultramontains cesserait aussitôt en Bavière [Voilà l'homme d'État qui sait se servir des résidus]... Seulement il y a le roi ! Il ne voudra jamais y consentir. Il a une peur du diable ! Il croit que toute la Prusse va être pervertie et que lui-même va être obligé de se faire catholique... Je lui ai expliqué que non... (p. 191) Et puis, quand bien même quelques personnes se feraient catholiques (vous pouvez être sûr que ce ne sera pas moi !) où serait le mal ? Ce qui importe, ce n'est pas la secte : c'est la croyance ! Il faut être plus tolérant que cela ! » Il faut remarquer cette opinion d'un homme pratique : elle est rigoureusement scientifique ! (1851) « Et, après s'être égayé encore quelque temps à la pensée de l'émigration du pape et de ses cardinaux vers Fulda, M. de Bismarck conclut : Évidemment le roi ne veut pas voir le côté humoristique de l'affaire ! Mais si seulement le pape me reste fidèle, je me charge bien de Sa Majesté... ». – 30 janvier 1871 : « (p. 295) Il paraît que, entre autres choses, le chancelier a dit aux Français que c'était une faute d'être trop conséquent en politique. Il faut savoir se modifier selon les événements et les circonstances... et non pas en suivant ses propres opinions... Un véritable homme d'État ne doit pas imposer ses préférences à son pays ». – LEFEBVRE DE BÉHAINE ; Léon XIII et le prince de Bismarck. L'auteur raconte le début du Kulturkampf : « (p. 25) L'heure n'était-elle pas propice pour commencer à Berlin le Culturcampf, dont les premières lignes venaient d'être tracées par M. Lutz ? Rome ainsi avertie n'allait-elle pas reculer ? Tout porte à croire que tel était, au début de l'année 1872, l'espoir du prince de Bismarck. Cette pensée se fit jour dans les discours qu'il prononça les 30 et 31 janvier à la Chambre des députés de Prusse lors des débats sur le budget du ministère des cultes. À côté du reproche adressé au parti clérical d'avoir travaillé à la mobilisation du groupe du centre en vue de mieux faire la guerre au nouvel état de choses [voilà le motif réel de la guerre que Bismarck est sur le point de faire] à côté aussi des anathèmes habituels à l'adresse de l'ancienne confédération du Rhin, certaines paroles du chancelier purent être interprétées comme l'indice d'une disposition à entrer en pourparlers avec le Vatican ». Le pape ne se montra pas assez conciliant, et Bismarck essaya de le combattre. Mais, en homme sage et pratique, il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait mieux à faire que de se perdre en absurdes disputes théologiques. En 1885, il déférait au pape l'arbitrage, dans le conflit avec l'Espagne, au sujet des îles Carolines. « (p. 198) Le 21 mai 1886, le roi de Prusse décrétait une loi en quinze articles qui abrogeait un certain nombre de dispositions des lois antérieures, dites Maigesetze, et datant pour la plupart des années 1813, 1874, 1875... (p. 220) Aujourd'hui, l'Église catholique jouit en Allemagne d'une paix profonde, libre dans ses enseignements, dégagée de toutes les entraves qu'elle avait été si sérieusement menacée de subir, il y a vingt-cinq ans... »
[FN: § 1843-3]
En cela aussi, Bismarck semble avoir eu, à un moment donné, des idées justes. BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I : « (p. 237) Vous n'avez aucune idée, déclara le chancelier, du plaisir qu'ils [les Polonais] éprouvent à voir qu'on connaît leur langue maternelle. Dernièrement à l'hôpital, j'ai rencontré comme cela quelques pauvres diables. Lorsque je leur ai parlé polonais, j'ai vu immédiatement leur face blême s'éclairer d'un sourire. C'est dommage que leur général en chef ne connaisse pas leur langue. Ce reproche indirect s'adressait au Kronprinz (p. 238) en personne qui avait les troupes polonaises sous ses ordres. Il releva, en riant, la pointe du chancelier : „ Je vous reconnais bien là, Bismarck, fit-il, vous en revenez toujours au même point. Mais je crois vous avoir dit pourtant plusieurs fois que je n'aime pas cette langue et que je ne veux pas l'apprendre “. – „ Les Polonais sont pourtant de bons soldats, Monseigneur, répliqua M. de Bismarck, et de bons garçons...“ – ». Les grands capitaines, par exemple César et Napoléon, étaient passés maîtres dans l’art d'utiliser les sentiments de leurs soldats.
[FN: § 1847-1]
En vertu de l'omertà, un membre de la Maffia ou d'autres semblables associations doit assistance et fidélité à ses coassociés. S'ils ont des démêlés avec l'autorité ou avec la justice, il ne doit rien faire qui puisse leur nuire ; encore moins demander aux tribunaux de trancher les différends qu'il peut avoir avec eux. Même victime d'une tentative d'assassinat, il s'en vengera si c'est possible, mais ne la dénoncera en aucun cas à l'autorité.
[FN: § 1850-1]
C'est ce qu'ignorait ou négligeait le gouvernement de la république actuelle, en France, lorsqu'en agissant contre certains sentiments religieux considérés par lui comme nuisibles, il frappait, sans le vouloir, les autres sentiments du même groupe, parmi lesquels celui du patriotisme, qu'il n'avait, à coup sûr, nullement l'intention de détruire. Lorsqu'en 1912 les instituteurs, assemblés à Chambéry, manifestèrent des sentiments hostiles au patriotisme, un grand nombre de politiciens s'étonnèrent d'une chose qu'ils auraient facilement pu prévoir, en tenant compte de l'action qu'eux-mêmes avaient accomplie. Mais si le bacille inoculé par les « intellectuels » trouva un terrain de culture favorable chez nombre d'instituteurs, il tomba au contraire dans un terrain défavorable à son développement, chez une grande partie de la population, spécialement parmi les classes populaires, où les sentiments religieux se conservent plus longtemps, sous des formes diverses. C'est de ces classes que nous voyons à chaque instant, dans l'histoire, partir la marée de religiosité qui envahit les classes supérieures ; et c'est précisément ce qui arriva, en France, pour les sentiments de patriotisme, dans les années 1911 et 1912.
[FN: § 1851-1]
On peut se rendre compte de la déformation subie par l'esprit religieux, à Rome, vers 1830, en lisant : I sonetti romaneschi di G. G. BELLI, pubblicati... ,a cura di LUIGI MORANDI. Città di Castello, 1896.
[FN: § 1853-1]
C'est là un phénomène dépendant des résidus de la IIIe classe. Les hommes, comme les animaux, éprouvent le besoin de manifester leurs sentiments par des actes qu'il est impossible d'unir par un lien logique ou raisonnable aux sentiments mêmes. Le chien qui retrouve son maître remue la queue ; mais il est impossible de fixer un lien logique entre ces mouvements de queue et l'affection du chien pour son maître. Si les chiens avaient des moralistes, ceux-ci démontreraient peut être par de belles homélies que ces mouvements de queue sont ridicules ; mais les chiens laisseraient dire et continueraient à témoigner à leur manière leur affection pour leur maître. Les hommes agissent d'une façon analogue.
[FN: § 1853-2]
Par exemple, les manifestations des pangermanistes allemands sont souvent insensées et ridicules au delà de toute expression. Les Allemands de bon sens peuvent désirer que la liaison qui unit ces démonstrations au patriotisme devienne plus lâche, de manière que le patriotisme demeure tout aussi fort, et que ces démonstrations diminuent ou disparaissent. Mais tant que cette liaison subsiste, celui qui veut le patriotisme doit se résigner à voir subsister aussi ces démonstrations. En France, le réveil du patriotisme, qu'on observa en 1912, et qui dure encore (mai 1914) est accompagné de bruyantes démonstrations littéraires et théâtrales. Plusieurs moralistes s'en scandalisent, et s'élèvent contre ce « patriotisme bruyant », supposant ainsi que parce que les manifestations sont de vains discours, les sentiments qui leur donnent naissance sont de même vains. C'est là une erreur digne de ces personnes qui se montrent à chaque instant ignorantes des rapports entre les faits sociaux. Il est certes permis de désirer que, les sentiments puissants ne s'accompagnent pas de manifestations non rigoureusement raisonnables, et que par conséquent les sentiments manifestés par les résidus de la IIIe classe s'affaiblissent ; mais tant que ces sentiments conservent la même force, celui qui veut les sentiments doit se résigner à accueillir aussi les manifestations. il est vrai qu'un grand nombre de ces moralistes sont aussi des humanitaires qui ne veulent pas ces sentiments. Ils n'osent pas le dire, parce qu'ils craignent le blâme du public, mais dans leur for intérieur ils repoussent le patriotisme, parfois consciemment, parfois sans trop s'en apercevoir, et ils rêvent à la fraternité universelle. Ne pouvant combattre trop ouvertement les sentiments de patriotisme, ils se contentent d'en combattre les manifestations.
[FN: § 1858-1]
Par exemple, cela est arrivé en Italie, aux élections de 1913. Un cas caractéristique est celui de Rome, où le socialiste transformiste Bissolati fut élu député, grâce à l'appui du gouvernement et au vote des gens de la Maison royale, contre le révolutionnaire Cipriani. Bissolati avait déjà eu les mêmes suffrages, à l'élection précédente, contre Santini, qui était conservateur.
[FN: § 1859-1]
G. BOISSIER : La fin du paganisme, t. II. L'auteur observe que l'on demeure surpris à voir que Macrobe ne parle nullement du christianisme alors envahissant. « (p. 243) Notre surprise redouble quand nous retrouvons le même silence chez presque tous les écrivains païens de ce temps, chez les grammairiens, chez les orateurs, chez les poètes, et même chez les historiens, quoiqu'il paraisse bien singulier qu'on puisse omettre, dans le récit du passé, un événement comme le triomphe de l’Église. Ni Aurelius Victor ni Eutrope ne mentionnent la conversion de Constantin, et il semble, à les lire, que tous les princes du IVe, siècle persistent à pratiquer l'ancien culte. Ce n'est certainement pas un hasard qui les amène tous à ne pas prononcer le nom d'une religion qu'ils détestent : c'est une entente, un parti pris, dont la signification ne pouvait échapper à personne. Ce silence, un silence hautain et insolent, est devenu pour eux la dernière protestation du culte proscrit. Du reste, cette façon d'agir n'était pas à Rome une nouveauté. La haute société, dès le premier jour, y avait pris l'habitude de combattre le christianisme par le (p. 244) mépris... »
[FN: § 1861-1]
Nous avons cité (§1716 6) l'un des si nombreux cas où les sentiments d'humanitarisme permettent aux malfaiteurs d'injurier les magistrats qui les jugent, et à leurs défenseurs d'admonester le président de la cour d'assises. Voici le contre-pied, en un temps où ces sentiments n'agissaient pas sur les magistrats. DE GONCOURT, Journal, t. I, rapporte comment son frère et lui furent accusés et traduits devant le tribunal, pour avoir reproduit dans un journal des vers imprimés impunément dans un livre couronné par l'Académie : « (p. 42) Enfin on appela notre cause. Le président dit un passez au banc qui fit une certaine impression dans le public. Le banc c'était le banc des voleurs. Jamais un procès de presse, même en Cour d'assises, n'avait valu à un journaliste de passer au banc... (p.43) Le substitut prit la parole... pris d'une espèce de furie d'éloquence, nous représenta comme des gens sans foi ni loi, comme des sacripants sans famille, sans mère, sans sœur, sans respect pour la femme, et, pour péroraison dernière de son réquisitoire – comme des apôtres de l'amour physique ». Les vers qui excitaient pareillement la furie de ce personnage étaient les suivants (p. 35) :
Croisant ses beaux membres nus
Sur son Adonis qu'elle baise ;
Et lui pressant le doux flanc ;
Son cou douillettement blanc, Mordille de trop grand aise.
C'est bien autrement grave que les crimes de la bande Bonnot, Garnier et Cie ! « (p. 43) Alors notre avocat se leva. Il fut complètement le défenseur que nous attendions. Il se garda bien de répéter ce qu'avait osé dire Paillard de Villeneuve, l'avocat de Karr [autre prévenu d'un délit de presse] demandant au tribunal comment on osait requérir contre nous, à propos d'un article non incriminé, et dont l'auteur n'était pas avec nous sur le banc des accusés. Il gémit, il pleura sur notre crime, nous peignit comme de bons jeunes gens, un peu faibles d'esprit, un peu toqués… » La conclusion fut que le tribunal blâma l'article, mais acquitta les prévenus, parce qu'ils n'avaient pas eu « (p. 45) l'intention d'outrager la morale publique et les bonnes mœurs ». De Goncourt ajoute : « (p. 45) En dépit de tout ce qu'on écrira, de tout ce qu'on dira, il est indéniable que nous avons été poursuivis en police correctionnelle, assis entre les gendarmes, pour une citation de cinq vers de Tahureau imprimés dans le Tableau historique et critique de la poésie Française par Sainte Beuve, couronné par l'Académie ». Les personnes du genre de celles qui se réunissent dans les sociétés pour le relèvement de la morale peuvent tenir la publication de ces vers ou le meurtre et le pillage pour des crimes d'égale gravité, mais on ne peut vraiment l'admettre au point de vue de l'utilité sociale. Voici maintenant un exemple en matière politique : ÉMILE OLLIVIER ; L'Empire libéral, t. IV. L'auteur défend Vacherot, accusé d'avoir excité la haine et le mépris contre le gouvernement, dans son livre La Démocratie : « (p. 373) Je commençai ma réponse [au ministère public] par ces mots : „ Messieurs, dans les affaires de cette nature, la première condition est une modération extrême. Aussi ne répondrai-je pas aux parties irritantes du réquisitoire. Cet appel aux passions est mauvais. En entrant dans cette enceinte, vous qui nous jugez, comme nous qui avons à défendre le livre à juger, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que les organes, les interprètes de la loi “. Le président m'interrompt : „ Maître Ollivier, vous venez de dire une inconvenance, rétractez-la “. Je répondis du ton le plus calme et le plus surpris : „ Monsieur le président, je n'ai rien dit d'inconvenant j'étais sous l'impression des paroles que je venais d'entendre “. Le président reprit : „ Maître (p. 347) Ollivier, vous avez dit que le ministère public a fait un appel aux passions. C'est une inconvenance, rétractez-la... “. Le tribunal se retira et revint quelques instants après... » On redemande à Maître Ollivier de rétracter ce qu'il a dit. Il refuse, et alors : « Sans même se lever de son siège, le tribunal me condamna à trois mois de suspension et remit à huitaine Vacherot pour qu'il pût se choisir un défenseur ». Si l'on ne peut obtenir que les faits tenus pour crimes uniquement par le fanatisme sectaire et la servilité, des magistrats soient séparés de ceux que tient pour tels le désir qu'a tout homme de n'être pas assassiné ni saccagé ni volé, il se peut, en de nombreux cas, que l'indulgence de l'humanitarisme envers les uns et les autres soit un moindre mal.
[FN: § 1868-1]
Georges SOREL ; Réflexions sur la violence : « (p. 164) L'expérience nous prouve que des constructions d'un avenir indéterminé dans les temps peuvent avoir une grande efficacité et n'avoir que bien peu d'inconvénients, lorsqu'elles sont d'une certaine nature ; cela a lieu quand il s'agit de mythes dans lesquels se retrouvent les tendances les plus fortes d'un peuple, d'un parti ou d'une classe, tendances qui viennent se présenter à l'esprit avec l'insistance d'instincts dans toutes les circonstances de la vie et qui donnent un aspect de pleine réalité à des espoirs d'action prochaine sur lesquels se fonde la réforme de la volonté. Nous savons que ces mythes sociaux (p. 165) n'empêchent d'ailleurs nullement l'homme de savoir tirer profit de toutes les observations qu'il fait au cours de sa vie et ne font point obstacle à ce qu'il remplisse ses occupations normales [composition des forces sociales]. C'est ce qu'on peut montrer par de nombreux exemples. Les premiers chrétiens attendaient le retour du Christ et la ruine totale du monde païen, avec l'instauration du royaume des saints, pour la fin de la première génération. La catastrophe ne se produisit pas, mais la pensée chrétienne tira un tel parti du mythe apocalyptique que certains savants contemporains voudraient que toute la prédication de Jésus eût porté sur ce sujet unique... On peut reconnaître facilement (p. 166) que les vrais développements de la Révolution ne ressemblent nullement aux tableaux enchanteurs qui avaient enthousiasmé ses premiers adeptes : mais sans ces tableaux la Révolution aurait-elle pu vaincre ?… (p. 167) Il faut juger les mythes comme des moyens d'agir sur le présent et toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l'histoire est dépourvue de sens ».
[FN: § 1876-1]
Ces problèmes seront considérés ici qualitativement (§144 1). Les considérations quantitatives seront introduites au chapitre suivant (§2121 et sv.). C'est aussi dans ce chapitre-là que se trouvera la définition du terme utilité, qu'il suffira en attendant, de considérer comme indiquant une certaine entité en rapport avec les autres faits sociaux, et qui peut croître et diminuer. Si l'on voulait suivre la voie déductive et passer du général au particulier, on devrait commencer par les considérations du chapitre XII, pour traiter ensuite les sujets que nous allons exposer. Mais cette voie n'est pas la meilleure pour bien comprendre la matière. Dans le monde concret, ce sont les problèmes qualitatifs qui, en cette matière, se présentent à nous, et ce sont même les seuls qui furent envisagés par le passé, et qui continuent à l'être chez presque tous les auteurs. De même, la notion d'utilité se présente à nous d'une manière quelque peu incertaine et confuse, ainsi qu'il arrive pour toutes les notions de ce genre ; et, jusqu'à il y a peu de temps, les auteurs n'éprouvaient pas le besoin d'une précision plus grande. Pour une utilité spéciale, celle que considère l'économie politique, ce besoin fut ressenti il n'y a qu'un petit nombre d'années, et donna naissance aux théories de l'économie pure. Nous étendons ici une précision analogue aux autres utilités, et nous le faisons d'une manière semblable à celle adoptée pour l'économie, c'est-à-dire en passant du plus connu au moins connu, du plus imparfait au moins imparfait, du moins défini au plus défini. Cette exposition est moins élégante que celle de la déduction, qui parcourt la voie en sens inverse ; mais elle est beaucoup plus aisée, facile, avantageuse à qui veut s'initier à la matière.
[FN: § 1881-1]
Un chimiste ou un physicien riraient d'un amateur qui, sans avoir jamais spécialement étudié la chimie ou la physique, voudrait porter des jugements sur l'une de ces sciences. Pourtant, sans avoir jamais étudié les sciences sociales, de tels savants entreprennent d'en trancher les questions les plus difficiles (§1435 et sv.). En voici un, par exemple, qui proclame avec une grande assurance que ce serait un malheur extrême pour l'humanité, si l'Allemagne ne dominait pas sur l'Europe, en faisant prévaloir sa « civilisation » sur la barbarie « russe ». Ce brave homme ne paraît pas même soupçonner, que connaître les effets de la domination de l'Allemagne ou de la Russie sur l'évolution de l'humanité est aussi difficile que connaître la constitution de la matière. Cette attitude provient du fait que le savant, qui emploie la méthode objective en chimie ou en physique, se laisse inconsciemment entraîner par la méthode subjective dans les sciences sociales. Lorsqu'il nous parle de la constitution de l'atome, il nous rapporte ce que l'expérience lui a enseigné, et fait abstraction de ses sentiments. Lorsqu'il tranche des questions sur le socialisme, sur l'impérialisme, sur la « civilisation » germanique et la « barbarie » russe, il exprime seulement les sentiments que lui font éprouver ces concepts, et il se soucie peu ou point de l'expérience (observation historique et autre) qu'en réalité il ignore presque toujours. Ce contraste apparaît encore davantage, quand on voit des littérateurs, des poètes et des dramaturges prononcer des jugements avec une grande autorité, sur les matières économiques et sociales qu'ils ignorent absolument. Quel rapport peut-il bien y avoir entre le fait d'avoir écrit des drames ou des comédies qui obtiennent la faveur du public, et le fait de résoudre objectivement des questions de sciences sociales ? Mais le rapport existe au point de vue des sentiments, car on exprime sur ces sciences des notions expérimentalement absurdes, stupides et vaines, lesquelles néanmoins plairont au public admirateur des pièces de théâtre. Ce public est la plupart du temps incapable de comprendre des raisonnements logico-expérimentaux, et se repaît de discours sentimentaux convenant à sa mentalité. Le monde est ainsi fait, et l'on ne voit pas comment ni quand il pourrait changer.
[FN: § 1883-1]
Voyons un exemple, qui peut servir de type à un très grand nombre de ces raisonnements. Le 20 janvier 1914, le ministère français proposait aux Chambres et faisait approuver un crédit de 20 000 francs pour les funérailles nationales du général Picquart. Un sénateur demanda quels services ce général avait rendus au pays. À quoi le président du Conseil, Doumergue, répondit : « Vous avez demandé quels services a rendus le général Picquart : il a cru à la justice et à la vérité immanentes ». Qu'est-ce que la « justice et la vérité immanentes » ? Personne ne le sait précisément, et peut-être le ministre Doumergue moins que d'autres ; mais il existe tant d'espèces de vérités, que parmi elles peut bien se trouver une belle vérité immanente. Ne nous arrêtons pas à ces questions subtiles. Admettons sans autre l'existence des respectables entités qui portent le nom de « justice et de vérité immanentes », et voyons les sens que comporte l'affirmation du ministre Doumergue. Nous pouvons les classer à peu près comme suit. (a) Il existe implicitement un principe dont on peut déduire que l'on obtiendra une utilité réelle, soit la prospérité, de la nation. – (a-I) L'utilité consiste à remporter la victoire en cas de guerre. – (a-I 1) Un général qui croit à la « justice et à la vérité immanentes » est plus capable qu'un autre d'exercer sa fonction, qui est de conduire ses soldats à la victoire. Le général Picquart avait cette croyance ; par conséquent il aurait contribué à assurer la victoire à sa patrie, en cas de guerre. On remarquera que le ministre Doumergue ne mentionna nullement cette croyance comme s'ajoutant aux mérites militaires du général Picquart. Il se tut au sujet de ces mérites, et il fit bien, car ce qu'on en pourrait dire de plus favorable est peu de chose, en vérité. Le correspondant de la Gazette de Lausanne, 21 janvier 1914, qui est pourtant très bienveillant envers le général Picquart, écrit : « On peut se demander – et la question a été discutée avec passion – si le héros de l'affaire Dreyfus a été aussi bien inspiré en acceptant les compensations que la brusque évolution des événements lui a offertes. Le prestige d'une nature particulière qui entourait cette séduisante et un peu énigmatique figure n'a pas pu ne pas subir quelque atteinte, lorsque l'homme a accepté de devenir un ministre comme un autre, et de subir, au moins dans une certaine mesure, les servitudes qu'impose aux hommes le fait d'être enrôlé dans un parti politique. Cependant ceux qui ont suivi de près l'activité du général Picquart au ministère de la guerre savent que son passage à la rue Saint-Dominique fut pour lui l'occasion d'une sorte de perpétuel confit, où l'indépendance naturelle de son caractère vint plus d'une fois à bout des mots d'ordre de l'esprit de parti. Il faudrait, pour apprécier complètement et équitablement son rôle à cette époque, faire un départ exact entre ce qu'il a dû céder aux exigences de ses amis, notamment la déplorable réduction des périodes d'instruction des réservistes, et les services qu'il a rendus à l'armée, et dont le plus signalé a été l'extrême décision dont il a fait preuve dans la discussion de la loi sur le matériel d'artillerie. Il apparaît, d'autre part, qu'il n'a pas complètement réussi dans l'exercice du grand commandement qui lui était confié. Il lui avait manqué, par le fait des circonstances, d'avoir exercé des commandements intermédiaires, et il s'est brusquement trouvé de plain-pied avec des difficultés auxquelles il n'était pas rompu. Il était d'ailleurs, par sa science technique et par la prodigieuse information de son esprit, beaucoup plus fait pour diriger certains des services de l'état-major que pour exercer la direction de grandes unités. Ce galant homme, dont le sourire était si fin et la pensée si ornée, avait plutôt les allures d'un savant que celles d'un soldat. Et l'on avait, à le voir, l'impression que la destinée sur laquelle son courage moral a jeté tant d'éclat n'était pas tout à fait celle pour laquelle il était fait ». Il semblerait donc que la croyance à « la justice et à la vérité immanentes » soit le mérite principal d'un général. Est-ce parce qu'ils avaient cette croyance, que Philippe de Macédoine vainquit les Athéniens à Chéronée, qu'Alexandre le Grand défit les Perses, qu'Annibal fut victorieux à Cannes ? Si Annibal fut ensuite défait à Zama, c'était peut-être qu'il avait perdu cette foi ; mais de Moltke l'avait à un degré éminent ; c'est pourquoi il remporta la victoire de Sedan. Tout cela paraît un peu difficile à admettre. Alors le fondement expérimental de notre raisonnement tombe. (a-I 2) On peut présenter comme plus générale et moins personnelle l'influence de la croyance en la justice et la vérité immanentes. Ces dignes entités prennent alors la place des dieux qui protègent un peuple. Enfin, si les Israëlites furent protégés par leur Dieu, si Rome dut la victoire à ses dieux, si le Dieu des chrétiens protégea ses fidèles contre les musulmans, et si le Dieu de Mahomet protégea ceux-ci contre ceux-là, on peut aussi admettre que les déesses Justice Immanente et Vérité Immanente puissent, elles aussi, protéger un peuple. Pourtant, il ne semble pas que cette conception de l'intervention divine ait pu trouver place explicitement parmi les théories athées du ministre Doumergue. (a-I 3) La croyance en ces entités peut pousser les hommes à accomplir des actes qui assurent la victoire. Cela a lieu effectivement pour des croyances analogues, mais il ne semble vraiment pas que celle-là puisse être rangée parmi celles-ci ; elle apparaît seulement comme une croyance du domaine de la rhétorique des littérateurs. En tout cas, ce n'est certainement pas ce que voulait dire Doumergue. Ne pouvant obtenir une démonstration d'une utilité pour remporter la victoire, cherchons une autre utilité. (a-II) L'utilité qu'obtient le pays est autre que l'utilité guerrière. (a-II 1) Il est plus utile de suivre certains principes « moraux » que de tendre à la prospérité matérielle. (a-II 2) Utilité d'une certaine forme de gouvernement, supérieure à l'utilité de la victoire à la guerre. Ces deux principes peuvent avoir trouvé place dans l'esprit du ministre Doumergue et de ceux qui l'applaudissaient; mais il eût été difficile d'obtenir qu'ils les exprimassent avec précision. En passant à un autre genre de conceptions, on peut faire disparaître les difficultés qui s'opposent à la démonstration de l'utilité du principe : (β) l'observation du principe posé et sa propre fin, indépendamment de tout autre genre d'utilité. (β 1) Nous ne devons nous occuper que de satisfaire « la justice et la vérité immanentes ». Fais ce que dois, advienne que pourra. En somme, c’est la règle de toute foi très vive ; c'était la règle des martyrs chrétiens ; mais il ne semble pas que le ministre Doumergue et ses amis leur ressemblent beaucoup. (β 2) Nous ne devons pas nous occuper de la guerre, qui ne viendra pas de si tôt : par conséquent, il importe peu d'avoir des généraux qui soient de bons capitaines ; il importe au contraire d'en avoir qui suivent les principes « moraux » du parti dominant. À un habile général, on doit préférer un croyant en la « justice et en la vérité immanentes » ; à un Napoléon 1er, on doit préférer, pour commander l'armée, un Saint François d'Assise du parti radical. Quelque conception semblable peut avoir trouvé place dans l'esprit des amis du ministre Doumergue. Il faut, en effet, rappeler qu'ils voulurent comme ministre de la guerre le général André, et comme ministre de la marine M. Pelletan, qui désorganisèrent entièrement la défense nationale. En outre, le parti du ministre Doumergue s'opposait à la loi dont le but était de prolonger le service militaire jusqu'à trois ans, et en tout cas, il se montrait opposé à l'armée. Ainsi, nous nous approchons des réalités recouvertes par la dérivation que nous examinons: (γ) La justice et la vérité immanentes sont un simple euphémisme pour désigner les intérêts d'une collectivité de politiciens et de « spéculateurs » (§2235). Ceux-ci trouvèrent dans l'affaire Dreyfus un moyen d'acquérir pouvoir, argent, honneurs, aidés par un petit nombre « d'intellectuels » qui mordirent à l'hameçon qu'on leur tendait, et qui prirent pour des réalités les euphémismes employés. Ainsi la dérivation indiquée doit se traduire de la façon suivante : « Le général Picquart a servi nos intérêts. Nous l'honorons afin d'engager d'autres personnes à nous servir également. Nous ne nous soucions guère de la défense de la patrie. Advienne que pourra : nous nous préoccupons de notre avantage personnel et de celui de notre parti ».
[FN: § 1884-1]
Au XIXe siècle, nous avons eu une abondante moisson de ces dérivations, nées du conflit entre les « travailleurs » et les « capitalistes » qui, en réalité, sont des entrepreneurs. La partie fondamentale du phénomène est la lutte habituelle qu'on observe entre deux concurrents, en matière économique ; c'est-à-dire que chacun tâche d'amener l'eau à son moulin, chacun s'efforce d'agrandir sa part. Tels sont les buts m auxquels on vise. Mais en apparence on a dit, on dit encore, et beaucoup de gens ont cru et croient encore viser à des buts idéaux T. Du côté des entrepreneurs, il n'y eut pas trop de raisonnements subtils. Ces personnes invoquèrent le soin qu'elles prenaient du bien-être des ouvriers, la rémunération « légitime » due à qui, par l'art des combinaisons, faisait prospérer l'entreprise, l'utilité de la liberté économique, dont elles se souvenaient pour fixer les salaires, et qu'elles oubliaient pour fixer les prix des produits. Du côté des ouvriers, il y eut un débordement de théories subtiles, produites par les « intellectuels », et acceptées, sans les bien comprendre, par les ouvriers, avec une foi aveugle. Des utopies socialistes au marxisme, au radicalisme démocratique ou socialiste, on a des doctrines en très grand nombre, qui toutes revêtent de voiles aux couleurs variées cette conception très simple : « Nous voulons avoir une part plus grande à la production économique ». Mais dire cela sans autre affaiblit les demandes, parce que cela leur enlève la force qui vient de l'idéalité de la fin, et les prive de l'alliance des braves gens qui se laissent prendre à la glu de ces théories. – Dans les dérivations, comme d'habitude, nous ferons appel aux sentiments. Nous nommerons donc « revendications » les demandes des ouvriers, afin d'insinuer qu'ils demandent uniquement ce qui leur appartient. Ainsi nous profiterons de l'appoint des résidus de la Ve classe. Pourtant, une suggestion si simple ne suffit pas. Il conviendra d'utiliser les résidus (I ε). Aussi ferons-nous des théories sur le « produit intégral du travail », sur la « plus value », sur la nécessité d'avoir « un peu plus de justice dans le monde », et d'autres semblables. Plus toutes ces théories seront longues et abstruses, plus nous conférerons d'idéalité à la fin que nous disons vouloir atteindre. – Mais si, voulant comprendre les faits, on néglige la forme vide de sens des raisonnements pour s'attacher au fond, on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il a été avantageux aux ouvriers de viser ainsi à des fins imaginaires ; car, grâce à l'œuvre tenace qu'autrement ils n'auraient peut-être pas accomplie, et grâce à l'appui efficace des auxiliaires que leur a procurés l’idéalité des fins, les ouvriers ont obtenu, au XIXe, siècle, de grandes améliorations de leur sort. Quant à la nation entière, il est beaucoup plus difficile de dire si cette œuvre a été avantageuse ou non. Une réponse affirmative paraît plus probable ; mais pour la démontrer, il faut considérer synthétiquement le problème de l'évolution économique et sociale ; ce que nous pourrons faire seulement au chapitre suivant.
[FN: § 1890-1]
On sait assez qu'il y a des femmes mariées, jouissant de gros revenus, qui se vendent pourtant, afin d'ajouter au luxe dont elles jouissent déjà. On répond que la misère et l'opulence, produites par le capitalisme, ont le même effet. Cela pourrait être. Voyons un peu. Si cette explication est valable, le, phénomène ne devrait pas se produire chez les gens qui jouissent seulement d'une modeste aisance. Malheureusement il n'en est pas ainsi. La petite bourgeoise se vend pour avoir un chapeau à la mode, comme la grande dame se vend pour avoir un splendide collier de perles ; mais elles se vendent également. Il est donc probable que si toutes les personnes d'une collectivité avaient exactement les mêmes revenus, il y aurait encore des femmes qui consentiraient à être les maîtresses des hommes disposés à leur donner ce qu'elles peuvent bien désirer. Il est vrai qu'on objecte que notre société est corrompue, parce que le capitalisme y existe. À cela, on ne peut rien répondre, parce que c'est un article de foi, et que la foi dépasse l'expérience. D'autres fanatiques, comme ceux qui s'assemblent dans les ligues contre la pornographie, contre la « traite des blanches », pour « le relèvement moral », ferment volontairement les yeux à la lumière de semblables faits. Par exemple, pour ces braves gens, c'est un article de foi que seul l'homme séduit la femme, qui doit donc être seule protégée. Pourtant, quiconque veut bien prendre la peine de lire les faits divers des journaux, et de suivre les procès qui se déroulent devant les tribunaux, trouvera plus nombreux les cas dans lesquels c'est la femme qui séduit l'homme. Partout, dans les cas de l'employé infidèle, du caissier qui dérobe, du financier qui escroque, de l'officier qui espionne, et ainsi de suite, on trouve la femme, et l'on vérifie la règle donnée par un magistrat : « Cherchez la femme ». Les besoins de ces femmes ne sont nullement ceux d'une vie honnête et modeste, mais bien ceux du luxe et du faste ; et c'est pour satisfaire ces besoins que beaucoup d'hommes volent, trahissent, et parfois tuent. Si l'on a la manie de protéger, pourquoi s'occuper uniquement des femmes séduites, et négliger les hommes séduits ? Pourquoi n'invente-t-on pas quelque autre expression absurde, comme celle de « traite des blanches », qui s'appliquerait aussi aux « blancs » ? Il faut avoir l'esprit malade et puéril pour croire que seuls les besoins matériels de la vie poussent les femmes à la prostitution. Pour beaucoup de femmes, c'est la vanité, le besoin du luxe ; pour bon nombre d'autres, c'est la paresse qui leur fait préférer ce métier ; et dans la haute prostitution, il ne manque pas de femmes qui aiment leur métier comme le chasseur aime la chasse, et le pêcheur la pêche. Là encore, les faits ne manquent pas à qui veut bien les voir. Combien de prostituées que de bons naïfs avaient voulu relever, et auxquelles ils assuraient une vie honnête et aisée, n'ont pas tardé à abandonner leurs protecteurs, pour reprendre le métier accoutumé, dont elles avaient la nostalgie ? Mais un grand nombre de gens ne veulent pas voir ces faits-là ni d'autres semblables, parce qu'ils ne disent pas la vérité lorsqu'ils affirment vouloir combattre la prostitution afin d'être utiles aux femmes, afin de détruire la « traite des blanches », afin d'être utiles aux « blanches ». En réalité, ils ne sont animés que d'une haine théologique contre les plaisirs des sens.
[FN: § 1897-1]
Il faut répéter ici les considérations de la note 1876-1.
[FN: § 1897-2]
Souvent on s'efforce de confondre les deux genres de solutions, parce qu'on ne veut pas que le devoir flotte ainsi en l'air, sans aucun rapport avec le monde réel. Les solutions (B 2), ( B 3), ( B4) du §1902 ont précisément pour but de faire naître cette confusion.
[FN: § 1905-1]
DIOG. LAERT. ; VII, 101-102 : ![]()
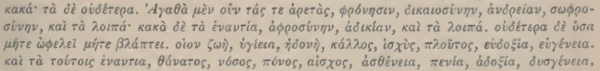
![]() – CIC., De fin. bon. et mal., III, 8, 27, expose la doctrine des stoïciens comme suit : Concluduntur igitur eorum argumenta sic : Quod est bonum, omne laudabile est : quod autemk laudabile est, omne honestum est. Bonum igitur quod est, honestum est. Satisne hoc conclusam videtur ?... (28) Deinde quaero, quis aut de misera vita possit gloriari, aut non de beata ? De sota igitur beata. Ex quo efficitur, gloratione, ut ita dicam, dignam esse beatam vitam : quod non possit quidem nisi honestae vitae iure contingere. Ita fit, ut honesta vita beata vita sit. – TACIT. ; Hist., IV, 5 : [Helvidius Priscus] doctores sapientiae secutus est, qui sola bona quae honesta, mala tantum quae turpia ; potentiam, nobilitatem, ceteraque extra animum, neque bonis neque malis annumerant. – PLUTARCH ; De Stoicorum repugnantis, XIII, II Il cite Chrysippe, qui dit : « Le bon est désirable ; le désirable est agréable ; l'agréable est louable ; le louable est beau [honnête] ».
– CIC., De fin. bon. et mal., III, 8, 27, expose la doctrine des stoïciens comme suit : Concluduntur igitur eorum argumenta sic : Quod est bonum, omne laudabile est : quod autemk laudabile est, omne honestum est. Bonum igitur quod est, honestum est. Satisne hoc conclusam videtur ?... (28) Deinde quaero, quis aut de misera vita possit gloriari, aut non de beata ? De sota igitur beata. Ex quo efficitur, gloratione, ut ita dicam, dignam esse beatam vitam : quod non possit quidem nisi honestae vitae iure contingere. Ita fit, ut honesta vita beata vita sit. – TACIT. ; Hist., IV, 5 : [Helvidius Priscus] doctores sapientiae secutus est, qui sola bona quae honesta, mala tantum quae turpia ; potentiam, nobilitatem, ceteraque extra animum, neque bonis neque malis annumerant. – PLUTARCH ; De Stoicorum repugnantis, XIII, II Il cite Chrysippe, qui dit : « Le bon est désirable ; le désirable est agréable ; l'agréable est louable ; le louable est beau [honnête] ». ![]()
![]() . Le raisonnement tire sa force des nombreux sens du terme
. Le raisonnement tire sa force des nombreux sens du terme ![]() , qui signifie en même temps : beau, noble, honnête, honorable, glorieux. Plutarque ajoute une autre citation, qui se rapporte aux solutions verbales (A). Il dit : « Le bien est réjouissant, le réjouissant est digne d'honneur, ce qui est digne d'honneur est beau ».
, qui signifie en même temps : beau, noble, honnête, honorable, glorieux. Plutarque ajoute une autre citation, qui se rapporte aux solutions verbales (A). Il dit : « Le bien est réjouissant, le réjouissant est digne d'honneur, ce qui est digne d'honneur est beau ». ![]() . Là encore les sens accessoires des termes qu'on emploie servent au raisonnement.
. Là encore les sens accessoires des termes qu'on emploie servent au raisonnement. ![]() est tout ce dont on est ou l'on doit être content ; et l'on suppose que personne n'osera nier qu'on doive être content du bien ;
est tout ce dont on est ou l'on doit être content ; et l'on suppose que personne n'osera nier qu'on doive être content du bien ; ![]() a un sens qui, de vénérable, honorable, digne d'honneur, passe à magnifique, très beau. Qui serait assez insensé pour nier que ce qui est magnifique, célèbre
a un sens qui, de vénérable, honorable, digne d'honneur, passe à magnifique, très beau. Qui serait assez insensé pour nier que ce qui est magnifique, célèbre ![]() est beau
est beau ![]() ?
?
[FN: § 1907-1]
ATHEN. ; III, p. 104. C'est un dialogue où l'un des interlocuteurs dit que les richesses ne sont rien, et l'autre le plaint d'avoir de telles idées, et lui dit entre autres :
[FN: § 1907-2]
HORAT. ; Sat., I, 8 :
(124) Si dives, qui sapiens est,
Et sutor bouus, et solus formosus, et es rex,
Cur optas, quod habes ?
(133) Vellunt tibi barbam
Lascivi pueri, quos tu nisi fuste coerces,
Urgeris turba circum te stante, miserque
Rumperis et latras, magnorum maxime regum !
« Si celui qui est sage est riche, et bon cordonnier et seul beau, et encore roi, pourquoi recherches-tu ce que tu as ? » Horace se fait répondre que le sage est bon cordonnier comme le chanteur, quand il se tait est aussi bon chanteur, c'est-à-dire que le sage possède l'état latent toutes les meilleures qualités. Et de rechef : « Les polissons te tirent la barbe, si tu ne les chasses pas avec ton bâton, ils t'assaillent en t'entourant, et comme un malheureux, tu pousses des cris et des hurlements, ô très grand parmi les rois ! » Il ajoute qu’il va se baigner pour le vil prix d'un quart d'as.
[FN: § 1911-1]
EPICT. ; Manuel, c. 1.
[FN: § 1915-1]
CIC. ; De fin., II, 16,51 : Itaque, Torquate, cum diceres, clamare Epicurum, non posse iucunde vivi, nisi honeste et sapienter et iuste viveretur, tu ipse mihi gloriari, videbare. Tanta vis inerat in verbis, propter earum rerum, quae significabantur his verbis, dignitatem, ut altior fieres... (53) Sunt enim levia et perinfirma, quae dicebantur a te, animi conscientia improbos excruciari, tum etiam poenae timore ; qua aut afficiantur, aut semper sint in metu ne afficiantur aliquando. Non oportet timidum, aut imbecillo animo fingi : non bonum illum virum, qui, quidquid fecerit, ipse se cruciet, omniaque formidet : sed omnia callide referentem ad utilitatem, acutum, versutum, veteratorem, facile ut excogitet, quo occulte, sine teste, sine ullo conscio, fallat.
[FN: § 1919-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Parlant de l'impôt progressif, dans son Traité de la Science des finances, PAUL LEROY-BEAULIEU veut justifier les moyens employés par les contribuables pour se soustraire à l'effet de la progression, ou du moins pour en atténuer la rigueur. Il est partagé entre sa répulsion pour la fraude et son aversion pour le régime progressif. Afin de concilier ces deux sentiments en conflit, il a naturellement recours aux dérivations ; il interprète les règles de la morale courante, et juge qu'elles ne s'appliquent pas au cas qui le gêne, Tome I, p. 219 : « L'impôt progressif n'oblige pas la conscience : tout contribuable a le droit moral de se soustraire à la progression et n'est tenu de supporter que la proportionnalité »
[FN: § 1920-1]
MOMMSEN ; Hist. rom., trad. franc., t. IV. Les Romains assiégeaient Numance : « (p. 303) Sur une simple et fausse rumeur que les Cantabres et les Vaccéens marchaient au secours de Numance, l'armée évacua ses campements durant la nuit, sans en avoir reçu l'ordre, et alla se cacher derrière les lignes que Nobilior avait construites seize ans avant. Aussitôt les Numantins, avertis de cette fuite, se lancent après les Romains qu'ils enveloppent ; il ne reste plus à ceux-ci qu'à s'ouvrir la route l'épée au poing, ou à conclure la paix aux conditions dictées aujourd'hui par l'ennemi. Le consul était un honnête homme, faible de caractère et de nom obscur ; heureusement Tiberius Gracchus était questeur à l'armée. Digne héritier de l'influence de son père, l'ancien et sage ordonnateur de la province de l'Èbre, il pesa sur les Celtibères, et, persuadés par eux, les Numantins se tinrent pour satisfaits d'une paix équitable que jurèrent tous les hauts officiers des légions. Mais le Sénat de rappeler aussitôt son général, et de porter devant le peuple, après un long délibéré, la motion qu'il convenait d'agir comme à l'époque du traité des Fourches Caudines. La ratification sera refusée, et la responsabilité du traité sera rejetée sur ceux qui l'ont souscrit. Dans la règle du droit, tout le corps des officiers, sans exception, aurait dû être frappé : mais grâce à leurs relations, Gracchus et les autres sont épargnés ; Mancinus qui, malheureusement pour lui, ne tenait point à la haute aristocratie est seul désigné et paye pour sa faute et pour la faute commune. On vit en ce jour un consulaire romain dépouillé de ses insignes et traîné jusqu'aux avant-postes ennemis ; et comme (p. 304) les Numantins ne voulaient pas le recevoir (c'eût été admettre la nullité du traité), le général dégradé resta tout un jour, nu et les mains attachées derrière le dos, devant les portes de la ville ». – Rappelant les Numantins, qui pouvaient détruire l'armée romaine, FLORUS dit, II, 18 Foedus tamen maluerunt, cum debellare potuissent. Hostilium deinde Mancinum : hunc quoque assiduis caedibus ita subegerunt, ut ne oculos quidem aut vocem Numantini viri quisquam sustineret. Tamen cum hoc quoque foedus maluere, contenti armorum manubiis, cum ad internecionem saevire potuissent. Sed non minus Nurnantini, quam Caudini illius foederis flagrans ignominia ac pudore populus Romanus, dedecus quidem praesentis flagitii deditione Mancini expiavit... L'auteur est tellement persuadé de l’honnêteté de ce procédé, qu'il ajoute aussitôt.
(19) Hactenus populus Romanus pulcher, egregius, pius, sanctus, atque magnificus... En vérité, s’il est permis d'interpréter de façon semblable les règles du juste et de l'honnête, il est évident que jamais on ne pourra causer le moindre préjudice à la prospérité matérielle d'un peuple en les observant. –VELL. PATERC. : II, 1 : Haec urbs [Numantia]... vel ferocia ingenii, vel inseitia nostrorum ducum, vel fortunae indulgentia, cum alios duces, tum Pompeium, magni nominis virum, ad turpissinia deduxit foedera (hic primus e Pompeiis consul fuit), nec minus turpia ac detestabilia Mancinum Hostilium consulem. Sed Pompeium gratia impunitum habuit, Mancinum verecundia ; quippe non recusando perduxit huc, ut per Feciales nudus, ac post tergum religatis manibus, dederetur hostibus, quem illi recipere se negaverunt, sicut quondam Caudini fecerunt, dicentes, publicam violationem fidei non debere unius Iui sanguine.
Il faut avouer que vraiment ces gens ne faisaient pas usage de la casuistique !
[FN: § 1920-2]
DIGEST. : L, 7, 17 (18).
[FN: § 1921-1]
E. PAIS ; Storia di Roma, v. I, p. II. L'auteur estime faux le document, cité par Tite-Live, de la paix des Fourches Caudines. « (p. 498) Il fut inventé pour atténuer la responsabilité morale des Romains, accusés plus tard d'avoir manqué à cette traditionnelle bonne foi dont ils avaient l'habitude de se vanter. Le long récit de Tite-Live n'est que l'un des nombreux ornements de la rhétorique ou de la pseudo-pragmatique des annalistes, par lesquels on s'efforça de rendre moins déshonorantes, d'abord la défaite, puis la mauvaise foi romaine... (p. 449) Mais il est inutile d'insister pour démontrer que le récit de ces tractations n'est pas historique, car, à notre époque, un critique savant et sagace a remarqué que tous ces détails furent empruntés à l'histoire (p. 500) postérieure, surtout à la paix conclue par le consul Hostilius Mancinus avec les Numantins (137 av. C.) ».
[FN: § 1921-2]
CIC : De off., III, 30, 109. Il parle des consuls. T. Veturius et Sp. Postumius et des tribuns livrés aux Samnites. « ... dediti saut, ut pax Samnitium repudiaretur. Atque huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor fuit. Quod idem multis annis post C. Mancinus : qui, ut Numantinis, quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, rogationem suasit eam, quam P. Furius, Sex. Atilius ex senatus consulto ferebant : qua accepta est hostibus deditus. Honestius hic, quam Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante accepta lex non est. On croyait pouvoir justifier cette interprétation par des analogies juridiques. – CIC ; Pro A. Caec., 34, 99 : Ut religione civitas solvatur, civis Romanus traditur : qui cu est acceptus, est eorum, quibus est deditus ; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis.
[FN: § 1922-1]
WELSCHINGER ; La guerre de 1870, t. I. Bismarck apparaît comme un homme de forte volonté et de vues étendues, lorsqu'il se glorifie d'avoir accommodé la dépêche, de manière à rendre la guerre inévitable. Sans le vouloir, Welschinger fait la louange de Bismarck, lorsqu'il écrit : « (p. 124) Les Nouvelles de Bambourg, journal du prince, reconnaissaient hautement que Bismarck, en modifiant la dépêche, avait contraint la France à prendre l'initiative et la responsabilité de la guerre et qu'il avait ainsi bien mérité de la patrie. S'il eût agi autrement, la guerre n'eût pas eu lieu. „ Cette guerre était indispensable pour fonder l'unité allemande. Si on avait laissé échapper cette occasion, on aurait été obligé de trouver un autre prétexte, moins adroit peut-être, qui aurait aliéné à l'Allemagne les sympathies de l'Europe “. C'était le mot de Bismarck à un journaliste qui s'étonnait de son expédient : „ Ah ! si celui-là avait raté, on en eût trouvé un autre ! “ (p. 121) Bénie soit, dit Hans Delbrück, la main qui a falsifié la dépêche d'Ems ! » – DE HOHENLOHE ; Mémoires, t. II, 6 mai 1874 « (p. 267) À table, Bismarck rappela des souvenirs de 1870, sa discussion avec Roon et Moltke, que la renonciation du prince de Hohenzollern et la condescendance du roi mettaient hors d'eux-mêmes. Puis la dépêche d'Abeken, et la publication abrégée que lui, Bismarck, en avait faite et qui rendait la guerre inévitable ». Mais les rhéteurs, les sophistes, les casuistes, sont utiles parce qu'ils cuisent un pain fait exprès pour les dents d'une grande partie de la population.
[FN:§ 1922-2]
Cet historien doit être plein d'indulgence pour les restrictions mentales.
[FN: § 1923-1]
Parmi ces personnes, il faut noter le grand nombre de celles qui croient, implicitement peut-être, que les dieux de l'éthique vengent les injures comme les dieux de la théologie. Pour autant que les dérivations peuvent produire quelque effet, l'influence de ces personnes est nuisible à leur parti, à leur nation, dans la mesure où les dites personnes entravent une préparation convenable à l'usage de la force, laquelle, en fin de compte, est toujours l’ultima ratio, dans ces luttes, et pour autant qu'elles gaspillent en bavardages l'énergie qui devrait être dépensée en action. Malheur au parti qui compte sur l'éthique pour être respecté de ses adversaires ! Malheur surtout à la nation qui se fie au droit des gens plus qu'à ses armes pour défendre son indépendance ! Persuader aux gens que dans les luttes civiles ou internationales on l'emporte seulement par la vertu et non par le dol, c'est les entraîner à la ruine, en les empêchant de se mettre à l'abri du dol et de pourvoir à la longue et laborieuse préparation qui seule petit mener à la victoire. En un mot, c'est une œuvre semblable à celle de celui qui persuaderait à une armée d'employer des canons de bois peints, au lieu de canons d'acier. Mais les « intellectuels » se complaisent à ces vains discours, parce qu'ils ne sont producteurs que de canons de bois peints, et non de canons d'acier.
[FN: § 1925-1]
Aeneid., II :
(390) ... Dolus, an virtus, quis in hoste requirat ?
SERVIUS : Videtur deesse aliquid, ut puta : Dolus an Virtus in bello proficiat, quis in hoste requirat ?
[FN: § 1926-1]
PLUTARCH. : Agésil., 23 (Trad. E TALBOT) « Quand Phébidas eut commis l'acte odieux de s'emparer de la Cadmée, au mépris des conventions et de la paix, tous les Grecs s'indignèrent, les Spartiates mêmes en furent peinés, et particulièrement les adversaires d'Agésilas. Ils demandaient avec colère à Phébidas par quel ordre il avait agi, voulant faire tomber le soupçon sur Agésilas. Agésilas n'hésita point à venir ouvertement en aide à Phébidas, disant qu'il fallait examiner dans ce fait s'il était utile, vu que tout ce qui est avantageux à Lacédémone, il est beau de le faire spontanément, même sans ordre. Malgré cela, dans tous ses discours, il ne cessait de proclamer la justice la première des vertus, le courage n'étant d'aucune utilité sans la justice... Non content d'avoir sauvé Phébidas, il décida sa patrie à prendre sur elle l'injustice du fait, à garder pour elle la Cadmée... (24) Cela fit soupçonner tout d'abord que, si Phébidas avait exécuté la chose, c'était Agésilas qui l'avait conseillée... ». – XÉNOPH. ; Hell.,, V, 22, 32 : « Toutefois Agésilas disait que si quelqu'un faisait une chose qui fût nuisible à Lacédémone, il serait condamné à juste titre ; et que, si cette chose était bonne [pour Lacédémone], c'était une loi des ancêtres qu'il la fît spontanément ». – Et pourtant, le même auteur dit qu'Agésilas était le type de l'homme vertueux. XÉNOPH. ; Agesil., 10, 2 : ... ![]()
![]()
![]() . « Il me semble que la vertu d'Agésilas est un excellent modèle pour ceux qui veulent être vertueux ; car, qui, imitant l'homme pieux, serait impie, [imitant] le juste, [serait] injuste... ? » – Dans les affaires privées aussi, Agésilas faisait bon marché des scrupules. PLUTARCH. ; Agesil,. 13 (Tract. TALBOT) : « Dans tout le reste, en effet, il se montrait scrupuleux et esclave de la loi ; mais il pensait que, dans les relations amicales, trop de justice n'est qu'un prétexte. On cite, à ce propos, un billet adressé par lui à Hidriée de Carie ; le voici : „ Si Nicias n'est point coupable, relâche-le ; s'il est coupable, relâche-le pour l'amour de nous ; dans tous les cas, relâche-le ! “ »
. « Il me semble que la vertu d'Agésilas est un excellent modèle pour ceux qui veulent être vertueux ; car, qui, imitant l'homme pieux, serait impie, [imitant] le juste, [serait] injuste... ? » – Dans les affaires privées aussi, Agésilas faisait bon marché des scrupules. PLUTARCH. ; Agesil,. 13 (Tract. TALBOT) : « Dans tout le reste, en effet, il se montrait scrupuleux et esclave de la loi ; mais il pensait que, dans les relations amicales, trop de justice n'est qu'un prétexte. On cite, à ce propos, un billet adressé par lui à Hidriée de Carie ; le voici : „ Si Nicias n'est point coupable, relâche-le ; s'il est coupable, relâche-le pour l'amour de nous ; dans tous les cas, relâche-le ! “ »
[FN: § 1926-2]
Judith, IX. Elle prie Dieu : ... (10) ![]()
![]() ... « Frappe par le mensonge de mes lèvres l'esclave avec le maître, le chef avec son serviteur...» (13)
... « Frappe par le mensonge de mes lèvres l'esclave avec le maître, le chef avec son serviteur...» (13) ![]()
![]() ... « et donne à mon discours de tromper pour les blesser et leur nuire ». Pourquoi ce livre ne doit-il pas avoir sa place parmi ceux où se trouve l'expérience du chrétien ? Il y a tant de gens qui, en guerre, pensent de cette façon !
... « et donne à mon discours de tromper pour les blesser et leur nuire ». Pourquoi ce livre ne doit-il pas avoir sa place parmi ceux où se trouve l'expérience du chrétien ? Il y a tant de gens qui, en guerre, pensent de cette façon !
[FN: § 1927-1]
Récits de Conon (dans Photius), narr. XXXIX. – Voir aussi Scholia in Acharnenses, 146. Scholia in Pacem, 890. SUIDAS ; s. r. ![]() . Harpocr. ; s.r.
. Harpocr. ; s.r. ![]() . POLYAEN. ; Strateg., I, 19. – PAUS., II, 33, parle d'un temple d'Athéna trompeuse, érigé par Etra qui, trompée par la déesse, eut commerce avec Poséidon. – STRAB. : XI, p. 495, fait allusion à un temple d'Aphrodite Trompeuse. Les géants voulaient faire violence à la déesse. Celle-ci appela à son aide Héraclès ; elle le cacha dans une grotte où elle promit aux géants de se donner à eux, tour à leur, et au fur et à mesure que l'un entrait dans la grotte, Héraclès le tuait par fraude
. POLYAEN. ; Strateg., I, 19. – PAUS., II, 33, parle d'un temple d'Athéna trompeuse, érigé par Etra qui, trompée par la déesse, eut commerce avec Poséidon. – STRAB. : XI, p. 495, fait allusion à un temple d'Aphrodite Trompeuse. Les géants voulaient faire violence à la déesse. Celle-ci appela à son aide Héraclès ; elle le cacha dans une grotte où elle promit aux géants de se donner à eux, tour à leur, et au fur et à mesure que l'un entrait dans la grotte, Héraclès le tuait par fraude ![]() .
.
[FN: § 1928-1]
Odyss., XIII, 291-299.
[FN: § 1928-2]
MONTAIGNE ; Essais, II, 12 : « (p. 262) Les uns font accroire au monde qu'ils croyent ce qu'ils ne croyent pas ; les aultres, en plus grand nombre, se le font accroire à eux-mesmes, ne scachants pas penetrer que c'est que croire : et nous trouvons estrange si, aux guerres qui pressent à cette heure nostre estat, nous voyons flotter les evenements et diversifier d'une maniere commune et ordinaire ; c'est que nous n'y apportons (p. 263) rien que le nostre. La iustice, qui est en l'un des partis, elle n'y est que pour ornement et couverture : elle y est bien alleguee : mais elle n'y est ni receue, ni logee ni espousee : elle y est comme en la bouche de l'advocat, non comme dans le cœur et affection de la partie... Ceulx qui l'ont prinse [la religion] à gauche, ceulx qui l'ont prinse à droicte, ceulx qui en disent le noir, ceulx qui en disent le blanc, l'employent si pareillement à leurs violentes et ambitieuses entreprinses, s'y conduisent d'un progrez si conforme en desbordement et iniustice, qu'ils rendent doubteuse et malaysée à croire la diversité qu'ils pretendent de leurs opinions... Voyez l'horrible impudence de quoy nous pelotons les raisons divines ; et combien irreligieusement nous les avons et reiectees, et reprinses, selon que la fortune nous a changé de place en ces orages publicques. Cette proposition si solenne, „ S'il est permis au subiect de se rebeller et armer contre son prince pour la deffense de la religion “ : souvienne vous en quelles bouches, cette annee passee, l'affirmative d'icelle estoit l'arc boutant (p. 264) d'un party ; la negative, de quel autre party c'estoit l'arc boutant : et oyez à present de quel quartier vient la voix et instruction de l'une et de l'autre : et si les armes bruyent moins pour cette cause que pour celle là. Et nous bruslons les gens qui disent qu'il fault faire souffrir à la Verité le ioug de notre besoing : et de combien faict la France pis que de le dire ? »
[FN: § 1929-1]
MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, 1. III, Cfr. §1975-2.
[FN: § 1929-2]
Aujourd'hui, on peut le dire des Allemands.
[FN: § 1931-1]
Maïmonide exprime assez bien la différence de diverses doctrines, telles qu'il les connaissait. – MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, trad. S. MUNK, IIIe part. XVII, t. III : « (p. 125) Voici donc le résumé succinct de ces différentes opinions : Toutes les conditions variées dans lesquelles nous voyons les individus humains, Aristote n'y reconnaît que le pur hasard ; les Ascharites y voient l'effet de la seule volonté divine) ; les Mo'tazales, l'effet de la sagesse (divine), et nous autres (Israélites), nous y voyons l'effet de ce que l'individu a mérité selon ses œuvres. C'est pourquoi il se pourrait, selon les Ascharites, que Dieu fît souffrir l'homme bon et vertueux dans ce bas monde et le condamnât pour toujours à ce feu qu'on dit être dans l'autre monde ; car, dirait-on, Dieu l'a voulu ainsi. Mais les Mo'tazales pensent que ce serait là une injustice, et que l'être qui a souffert, fût-ce même une fourmi, comme je l'ai dit [voir citation 1967 1], aura une compensation ; car c'est la sagesse divine qui a fait qu'il souffrît, afin qu'il eût une compensation. Nous autres enfin, etc. » [voir la suite § 917 1]. La théorie des causes finales entreprend de faire disparaître de telles contradictions. Appliquée aux actions de l'individu, elle affirme que ces actions ont toujours pour but, que l'individu s'en rende compte ou non, le « bien » de l'individu, ou de la communauté ; et par des raisonnements parfois ingénieux, souvent absurdes et puérils, elle découvre ce « bien » là où il n'existe nullement. Il est clair que, de la sorte, il est aisé de démontrer que, puisque toutes les actions visent à un seul et même but, elles ne peuvent jamais être contradictoires.
Cette théorie a la vie dure. Détruite sur un point, elle reparaît sur un autre et prend les formes les plus diverses. Le Darwinisme a dégénéré – ainsi qu'on l'a souvent remarqué – en une application de la théorie des causes finales aux formes des êtres vivants. Les métaphysiciens font un usage aussi étendu que varié de cette théorie, appliquée aux actes (§1521), et les théologiens sont loin de la dédaigner. Pour l'employer, des auteurs modernes ont imaginé d'avoir recours à l' « excogitation », ou ont inventé d'autres beaux artifices.
[FN: § 1932-1]
Il convient de prendre garde que le problème n'est ici résolu que qualitativement (§1876-1, 1897-1]. Les considérations quantitatives seront introduites au chapitre XII.
[FN: § 1932-2]
Nous avons souvent montré la vanité logico-expérimentale, l'absurdité même de certaines dérivations ; mais nous avons aussi mis en garde le lecteur sur le fait que par là nous ne n’entendions point infirmer l'utilité sociale des résidus dont elles étaient la manifestation. Cette utilité demeure intacte, lorsqu'on fait voir l'inconvénient qu'il y a à vouloir imposer certaines dérivations. Par exemple, ce que nous avons dit de la vanité expérimentale des dérivations de certaines religions et des inconvénients qu'il y a à vouloir imposer certaines de ces dérivations, ne doit nullement être entendu, comme c'est ordinairement le cas, en ce sens que les persistances d'agrégats qui se trouvent dans ces religions seraient, non pas utiles, mais nuisibles. Parmi ces religions, nous rangeons aussi la religion sexuelle, dont nous avons dû souvent nous occuper, à propos de dérivations absurdes et nuisibles.
[FN: § 1934-1]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, trad. S. MUNK, IIIe, part., c. XVII, t. III : « (p. 125) Nous autres [les Israélites] enfin, nous admettons que tout ce qui arrive à l'homme est l'effet (p. 126) de ce qu'il a mérité, que Dieu est au-dessus de l'injustice et qu'il ne châtie que celui d'entre nous qui a mérité le châtiment. C'est là ce que dit textuellement la loi de Moïse, notre maître, (à savoir) que tout dépend du mérite ; et c'est aussi conformément à cette opinion que s'expriment généralement nos docteurs. Ceux-ci, en effet, disent expressément : „ Pas de mort sans péché, pas de châtiment sans crime “† ; et ils disent encore : „ On mesure à l'homme selon la mesure qu'il a employée lui-même “, ce qui est le texte de la Mischnâ. Partout ils disent clairement que, pour Dieu, la justice est une chose absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il récompense l'homme pieux pour tous ses actes de piété et de droiture, quand même ils ne lui auraient pas été commandés par un prophète, et qu'il (p. 127) punit chaque mauvaise action qu'un individu a commise, quand même elle ne lui aurait pas été défendue par un prophète... ». – IUSTI LIPSIUS ; Politicorum, 1. I, c. 3, p. 35. L'auteur cite en l'approuvant un passage de Tite-Live, qui dit : Omnia prospera eveniunt colentibus deos, adversa spernentibus. On trouve de semblables idées chez un très grand nombre d'auteurs du passé. Que ce fût là ou non leur opinion, ils estimaient opportun et utile de la manifester. Le passage de TITE-LIVE se trouve : V, 51 : une vérification expérimentale y est ajoutée. Lipsius l'a passée sous silence. Camille parle aux Romains et dit : Intuemini enim horum deinceps annorum vel secundas res, vel adversas ; invenietis omnia prospere evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus. « Considérez donc ensuite les événements favorables ou contraires de ces années-ci. Vous trouverez que tout a été prospère, quand on obéissait aux dieux, contraire quand on les négligeait ». Il continue en citant la guerre de Véies et l'invasion des Gaulois, et il dit que la première fut heureuse, parce que les Romains furent attentifs aux enseignements des dieux, la seconde malheureuse, parce qu'ils négligèrent ces enseignements.
† (Note de S. MUNK : « ... Le commentateur Schem-Tob fait observer avec raison que cette opinion est réfutée au même endroit par le Talmud lui-même, et qu'il s'agit ici d'une doctrine populaire enseignée au vulgaire, mais que les Talmudistes ne prétendaient pas donner pour une vérité incontestable... ».
[FN: § 1937-1]
Nous avons déjà cité un grand nombre d'exemples de semblables dissertations. Ajoutons-en encore un, qui se rattache à un type extrêmement répandu.
Les Grandes Chroniques de France, publiées par PAULIN PARIS, Paris 1837, t. II. On y rapporte une légende au sujet de Charlemaines (Charlemagne). Un certain Agoulant vient chez Charlemaines pour se faire baptiser. « (p. 232) Lendemain, en droit l’eure de tierce, vint Agoulant à Charlemaines pour recevoir baptesme. A l’eure qu'il vint estoit Charlemaines assis a mangier luy et sa gent... „ Ceulx –– dit Charlemaines – que tu vois vestus de drap de soie et d'une couleur sont les évesques et les prestres de notre loy qui nous preschent et exposent les commands nostre Seigneur : ceux nous absolvent de nos péchiés et nous donnent la bénéiçons nostre Seigneur. Ceulx que tu vois en noir habit, ce sont moines et abbés ... Ceulx que tu vois après qui sont en blanc habit, il sont appellés chanoines réglés ... “ Entre autre chose regarda Agoulant d'autre part, et vit trèze povres vestus de povres draps, qui mengeoient à terre sans nappe et sans table, si avoient pou à manger et pou à boire. Lors demanda à Charlemaines quels gens c'estoient. „ Ce sont – dist-il – les gens Dieu, messages nostre sire Jhésu-Crist, que nous paissons chaque jour en l'onneur des douze apostres. “ Lors respondit Agoulant : „ Ceulx qui sont autour toy sont beneurés, et largement (p. 233) mengent et boivent, et sont bien vestus et noblement; et ceulx que tu dis qui sont messages de ton Dieu. pourquoy souffres-tu qu'ils aient faim et mesaise, et qu'ils soient si povrement vestus et si loing de toy assis né si laidement traitiés ? Mauvaisement sert son Seigneur qui ses messages reçoit si laidement. Grant honte fait à son Seigneur qui ainsi ses messages sert. Ta loy que tu disoies qui estoit si bonne monstre bien, par ce, qu'elle soit faulse. “ Après ces paroles se départit de Charlemaines, et s'en retourna à sa gent, et refusa le saint baptesme qu'il vouloit recevoir. Lendemain manda bataille à Charlemaines. Lors entendit bien l'empereur qu'il eut baptesmes refusé pour les povres qu'il vit si laidement traités. Pour ce commanda Charlemaines que les povres de l’ost feussent honnourablement vestus et suffisamment repeus de vins et de viandes ».
Du contraste entre la pureté évangélique et les mauvaises mœurs de la Cour de Rome, Boccace (I, 2) tire la conclusion que la foi chrétienne doit être vraiment divine, puisqu'elle résiste à ces causes de dissolution. Le juif qui était allé à Rome et qui avait observé ces contradictions entre la foi chrétienne et les mœurs, prend un parti contraire à celui qu'avait adopté Agoulant, et demande le saint baptême.
Ce sont là des légendes et des contes ; mais celui qui serait tenté de croire que le fond révélé par ces formes n'existe plus de nos jours, n'a qu'à regarder autour de lui, et il trouvera aisément des contradictions de ce genre. Les noms seuls ont changé. Du crépuscule des dieux anciens surgissent les nouvelles divinités : le radieux soleil de la Science, du Progrès, de la Démocratie ; les brillantes planètes qui se nomment Vérité, Justice, Droit, Patriotisme exalté, et autres semblables : les lumineux satellites qui tirent leurs noms de l'Organisation, de la Civilisation, du Nationalisme, de l'Impérialisme, de la Xénophobie, de la Solidarité, de l'Humanitarisme, etc. ; et ces nouvelles religions abondent en contradictions tout autant que les anciennes.
[FN: § 1942-1]
Op. et dies. Vient un vers qui parait être une glose introduite dans le texte et qui dit : « (273) Mais je ne pense pas que ce soit la volonté de Zeus fulminant ». Que ce soit ou non la volonté de Zeus, le fait relevé par l'auteur subsiste toujours. D'autres vers se contredisent. En de nombreux endroits, l'auteur insiste en disant que celui qui commet une injustice n'échappe pas au châtiment mérité, et que celui qui est juste est récompensé ; tandis qu'en décrivant l'âge de fer où nous vivons, il dit : « (190-193) L'homme fidèle à son serment, ni le juste, ni le bon ne trouveront plus grâce ; mais on honorera plutôt l'homme coupable de maléfices et d'injure. De justice et de pudeur, il n'y en aura plus ».
[FN: § 1943-1]
Société biblique de Paris ; Les livres apocryphes de l'Ancien Testament, La, sagesse de Jésus fils de Sirach, (L'Ecclésiastique) : « (p. 406) I, 16. La plénitude de la sagesse appartient à ceux qui craignent le Seigneur ; elle les rassasie (litt. les enivre ; les, ce sont ceux qui craignent le Seigneur). – 17. Elle remplit toute leur maison de choses désirables et leurs greniers de ses produits ». – « (p. 434), XI, 1. La sagesse du pauvre (de l'humble, c'est-à-dire de celui qui est d'humble condition) le relève (litt. : relève sa tête) et le fait asseoir parmi les grands. Le texte grec dit : ![]()
[FN: § 1944-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'Anc. Test. : « (p. 208) Il ressort clairement de ce qui précède et de tous les documents des deux premières périodes que les Israélites ne croyaient qu'à une rémunération terrestre des actions humaines. Il n'y a pas la moindre trace chez les prophètes, où le châtiment du péché, d'un côté, et l'espérance du salut futur, de l'autre, jouent un si grand rôle, de l'idée que le péché pourrait être châtié et la vertu récompensée dans une autre vie. D'après l'opinion générale des Hébreux, Dieu récompense le bien et punit le mal dans ce monde; tout malheur est un châtiment divin, attiré par l'infidélité, et toute bénédiction une récompense divine, méritée par la fidélité; en un mot, il y a une relation exacte entre le malheur et la culpabilité, entre le bonheur et le mérite ». Voir le reste de la citation à la note 1976-1.
[FN: § 1944-2]
RENAN ; Vie de Jésus « (p. 180) Les prophètes, vrais tribuns (p. 181) et en un sens les plus hardis tribuns, avaient tonné sans cesse contre les grands et établi une étroite relation d'une part entre les mots de riche, impie, violent, méchant, de l'autre entre les mots de pauvre, deux, humble, pieux ».
[FN: § 1944-3]
BAYLE ; Dict. hist., s. r. Malherbe, rem. (C). L'auteur cite RACAN ; Vie de Malherbe, p. 15 : « Quand les pauvres luy disoient qu'ils prieroient Dieu pour luy, il leur répondoit qu'il ne croyoit pas qu'ils eussent grand credit au Ciel, veu le mauvais estat auquel il les laissoit en ce monde ; et qu'il eust mieux aimé que Monsieur de Luyne, ou quelqu'autre favory, luy eust fait la mesme promesse ».
[FN: § 1947-1]
GUILLAUME DE TYR, dans GUIZOT, Collection de mém., t. III : « (p. 10) …Il semblait en effet que la ville ne pût manquer de tomber promptement au pouvoir du peuple chrétien, moyennant la protection de la Divinité. Mais celui qui est terrible (p. 11) dans ses desseins sur les fils des hommes (Psaume 65, 4) en avait autrement décidé. Je viens de dire que la ville était serrée de très près, et que les citoyens avaient perdu tout espoir de défense et de salut... lorsqu'en punition de nos péchés ils en vinrent à fonder quelque espérance sur la cupidité des nôtres... (p. 17) Cependant l'empereur Conrad, voyant que le Seigneur lui avait retiré sa grâce et qu'il était hors d’état de rien faire pour l'avantage de notre royaume, fit préparer ses navires, prit congé de Jérusalem et retourna dans ses propres États ». Du côté des musulmans, le Livre des Jardins dit : « (p. 59) La population musulmane témoigna une joie très vive du succès que Dieu venait de lui accorder ; elle rendit de nombreuses actions de grâce au ciel qui avait accueilli avec faveur les prières qu'elle lui avait adressées durant ces jours d'épreuves. Dieu soit loué et béni ! Peu de temps après cette marque de la protection divine, Nour ed-Dîn vint au secours de Mo'in ed-Dîn et le rejoignit dans un bourg des environs de Damas ».
[FN: § 1948-1]
DRAPER ; Les confl. de la sc. et de la rel. Parlant de la conquête de Jérusalem, faite par Kosroès, l'auteur dit : « (p. 55) Le magisme avait insulté le christianisme à la face du monde, en profanant ses sanctuaires – Bethléem, Gethsémani, le Calvaire – en brûlant le sépulcre du Christ, en dépouillant et détruisant ses églises, en jetant ses reliques au vent, en enlevant, au milieu de cris de triomphe, la croix du Sauveur. Les miracles avaient autrefois abondé en Syrie, en Égypte, en Asie Mineure. Il s'en était fait dans les occasions les moins importantes et pour les objets les plus insignifiants ; et pourtant, dans ce moment suprême, aucun miracle ne s'était accompli ! Les populations chrétiennes de l'Orient furent remplies d'étonnement quand elles virent les sacrilèges des Perses, perpétrés avec impunité. Le soleil aurait dû rebrousser sa marche, la terre entrouvrir ses abîmes, l’épée du Tout-Puissant lancer ses éclairs et le sort de Sennachérib eût dû être celui de l'envahisseur. Cependant il n'en avait rien été ». Plus loin, parlant de la conquête de Jérusalem, faite par les Sarrasins : « (p. 65) La chute de Jérusalem ! la perte de la métropole chrétienne ! Dans les idées du temps, les deux religions avaient passé par l'ordalie des armes ; elles avaient subi le jugement de Dieu ! La victoire avait adjugé au mahométisme Jérusalem le prix du combat (1) Et malgré les succès temporaires des croisés, après mille ans écoulés, elle est encore dans ses mains ! » L'auteur se trompe en croyant qu'on ait conclu de cette victoire que le mahométisme fut jugé meilleur que le christianisme, parce qu'il avait remporté la victoire. Jamais, jamais les hommes n'ont fait usage de tant de logique. – BAYLE ; Dict. hist, s. r. Mahomet, rem. (P) : « Iis [Bellarmin et d'autres controversistes] ont eu même l'imprudence de mettre la prospérité entre les marques de la vraie Église. Il étoit facile de prévoir qu'on leur répondroit, qu'à ces deux marques l'Église Mahométane passera plus justement que la Chrétienne pour la vraie Église ». – A. BAYET ; Collect. Aulard ; Morale. Probablement pour discréditer la religion chrétienne, l'auteur cite des données statistiques qui ont vraiment peu de rapports avec un traité de morale. « (p. 156) La religion qui a le plus grand nombre de fidèles est le bouddhisme : il y a environ 500 millions de bouddhistes. [Vraiment ? M. Bayet les a-t-il pu compter ?] Puis vient le christianisme qui est divisé en trois branches... il y a 217 millions de catholiques et 127 millions de protestants ; enfin, il y a 120 millions d'hommes qui font partie de l'église russe ».– BAYLE ; Dict. hist., s. r. Mahomet II, rem. (D) : « J'ai marqué qu'en matière de triomphes l'étoile du Mahométisme a prévalu sur l'étoile du Christianisme [aujourd’hui on ne pourrait plus dire cela], et que s'il faloit juger (le la bonté de ces Religions par la gloire des bons succès temporels, la Mahométane passeroit pour la meilleure. Les Mahométans sont si certains de cela, qu'ils n'allèguent point de plus forte preuve de la justice de leur cause, que les prospéritez éclatantes dont Dieu l'a favorisée... ». L'auteur cite ensuite HOTTINGER, Hist. Oriental, p. 338, qui dit : « L'heureux succès des armes de ces Infidèles est un autre argument dont ils se servent pour appuyer la vérité de leur Religion. Car comme ils croyent que Dieu est l'auteur de tous les bons évenemens, ils concluent, que plus ils réussissent dans leurs guerres, et plus aussi Dieu fait paroître qu'il approuve leur zèle et leur Religion ».
[FN: § 1949-1]
BAYLE. ; Dict. hist., s. r. Guise (Charles de Lorraine, duc de), rem. (F).
[FN: § 1950-1]
M. BUSCH ; Les mémoires de Bismarck, édit. franç., t. I, p. 64 : « Le comte de Waldersee, lui, souhaita de „ voir cette Babel [Paris] entièrement détruite “. Le Chancelier intervint : Cela. ne serait, en effet, pas une mauvaise chose du tout, mais cela est impossible pour beaucoup de raisons. La principale est qu'un trop grand nombre d'Allemands de Cologne et de Francfort y ont placé des fonds considérables ! ». « (p. 67) Un peu après Saint-Aubin, je [Busch] remarquai sur le bord une borne kilométrique avec ces mots : „ Paris, 241 kilomètres “. Nous n'étions donc déjà plus qu'à cette distance de la Babel gigantesque ! ». « (p. 172) Elle [la comtesse de Bismarck] se porte tout à fait bien maintenant, a répondu le ministre [Bismarck]. Elle souffre pourtant encore de sa haine féroce contre les Gaulois. Elle voudrait (p. 173) les voir tous morts, jusqu'aux enfants en bas âge, qui ne peuvent pourtant s'empêcher d'avoir d'aussi abominables parents ». Il ne faut pas oublier que la comtesse de Bismarck et son mari se croyaient et étaient peut-être de bons chrétiens.
[FN: § 1951-1]
ÉMILE OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. I. On remarquera que cet ouvrage fait partie d'une histoire en seize [ensuite dix-sept] volumes, qui a la prétention d'être scientifique, et qui est par conséquent d'un genre entièrement différent de celui des proclamations mentionnées tout à l'heure, de Guillaume 1er et de Napoléon III, ou d'autres semblables écrits qui visent, non pas à une étude scientifique, mais seulement à émouvoir les sentiments populaires et à les diriger dans la voie qu'on estime convenable.
[FN: § 1951-2]
Bismarck part d'autres principes pour juger les actions de Napoléon III. BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. I : « (p. 30) Sa politique [de Napoléon III a toujours été stupide. La guerre de Crimée était diamétralement opposée aux intérêts de la France, qui réclamait une alliance ou, tout au moins, une bonne entente avec la Russie. il en (p. 31) est de même de la guerre pour l'Italie. Il s'est créé là un rival dans la Méditerranée, le nord de l'Afrique, la Tunisie, etc. [on remarquera qu'il disait cela en 1870 : Bismarck voyait loin et juste], qui, un jour, sera peut-être dangereux. La guerre du Mexique et l'attitude qu'a prise la France en 1866 sont encore des fautes, et nul doute que, dans la tempête qui éclate aujourd'hui, les Français ne sentent eux-mêmes qu'ils sont en train de commettre une dernière faute ». Bismarck avait raison, mais il négligeait certaines circonstances qui peuvent expliquer ces faits et les atténuer. Il est très juste que la guerre de Crimée était une erreur de politique extérieure, mais elle était très avantageuse à la politique intérieure : elle donnait au gouvernement de Napoléon III l'auréole de gloire qui manquait à celle de Louis-Philippe, et l'erreur de politique extérieure pouvait aisément être corrigée par une alliance après la victoire. La guerre d'Italie eut pour origine une combinaison entre les sentiments humanitaires de Napoléon III et les intérêts des « spéculateurs » internationaux, qui donnèrent alors naissance à des entreprises aujourd'hui si étendues et si puissantes. La guerre du Mexique fut principalement une manifestation d'humanitarisme pathologique. L'attitude de Napoléon III en 1866 n'a aucune excuse. Comme d'habitude, c'est celle d'un humanitaire de peu de bon sens. Ensuite, les événements se précipitent, et la France semble un navire sans direction, dans une mer en fureur. La République eut une politique extérieure bien meilleure que celle de Napoléon III, précisément parce qu'elle se rangea à la politique réaliste de Bismarck. Cela suffirait pour faire préférer, et de beaucoup, en France, la République à l'Empire. La politique intérieure de la République ne va pas de pair avec la politique extérieure. De là le danger que celle-ci soit affaiblie par celle-là. Mais si la République néglige la préparation militaire, l'Empire la négligea plus encore, et sa faute fut plus grande, car il pouvait imposer ce que des républicains clairvoyants comme Poincaré ne peuvent obtenir.
[FN: § 1951-3]
H. WELSCHINGER ; La guerre de 1870, t. II.
[FN: § 1952-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., trad. SADOUS. t. XV.
[FN: § 1955-1]
PIEPENBRING ; Hist. du peuple d'Isr. : « (p. 245) Jahvé fait en réalité grâce ou miséricorde à qui il veut, par suite de son pouvoir suprême, à la manière des anciens souverains despotiques de l'Orient, qui se plaisaient aussi à manifester leur pouvoir... »
[FN: § 1956-1]
A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr. ant., t. III. Les vers 1621-1622 du Chœur d'Ion s'expriment ainsi : « Car à la fin les bons obtiennent ce dont ils sont dignes ; les méchants, comme il est naturel, ne peuvent jamais être heureux ». Maury cite aussi les vers 882-887 du Chœur des Bacchantes : « La force des dieux vient, lente mais sûre; elle châtie les hommes qui honorent l'iniquité et qui, en insensés, ne vénèrent pas les dieux ». Là encore, il s’agit en somme de ceux qui savent obtenir la faveur des dieux ou qui tombent sous leur colère ; mais on ne voit pas clairement si c'est par vertu ou par vice.
[FN: § 1958-1]
Helen., 1137-1143. « Lequel des mortels, ayant scruté l'ultime fin des événements, peut affirmer y avoir trouvé quelque chose qui soit dieu, non-dieu ou être intermédiaire [démon], en considérant que les desseins des dieux s'orientent tantôt ici, tantôt là, et sont de nouveau contraires, apparaissant dans des événements inespérés ? »
[FN: § 1958-2]
Hercul. fur. Aux vers 655-668, il dit que les bons devraient avoir une double jeunesse et renaître après leur mort, tandis que les méchants vivraient une fois seulement. Puis il ajoute, 669-670 « Or, par aucun signe des dieux on ne distingue les méchants des bons ».
![]()
[FN: § 1961-1]
Hipp., 47-50.
[FN: § 1963-1]
SCHŒMANN ; Ant. grecq., trad. GALUSKI, t. II.
[FN: § 1964-1]
P. DECHARME ; La crit. des trad. relig. chez les Grecs.
[FN: § 1965-1]
ÆSCH. ; Eum., 658-666. Suivant Apollon, la mère n'est que la nourrice de l'enfant ; celui qui l'engendre véritablement, c'est le père. Apollon donne pour preuve de cette affirmation un argument mythologique : qu'on peut être père sans avoir besoin d'une femme, puisqu'Athéna est née de Zeus sans avoir été nourrie dans une matrice.
[FN: § 1966-1]
AESCH. ; Agam., 1475-1480.
[FN: § 1966-2]
AESCH. ; Coeph., 48 : ![]() .
.
[FN: § 1966-3]
AESCH. ; Agam., 1562 : ![]() .
.
[FN: § 1966-4]
AESCH. ; Coeph., 119-121 :
(121)
[FN: § 1966-5]
AESCH. ; Agam. 750-760. Le chœur continue en paraphrasant ce qui précède.
[FN: § 1966-6]
AESCH. ; Eum., 430 : ![]() .
.
[FN: § 1966-7]
Eum. :
(445)
« Je ne suis pas souillé d'un délit ; mes mains ne sont pas tachées, tandis que je suis assis auprès de ta statue » : et il le prouve : (417) « Je te donnerai un témoignage important de ces choses ». En somme, ce témoinage est le suivant : (448-452) La loi impose le silence à qui ne s'est pas purifié, et lui a été purifié par le sang et par l'eau. Il s'agit exclusivement d'une action mécanique des victimes expiatoires et de l'eau.
[FN: § 1967-1]
AESCH. ; Coeph., 59-64.
[FN: § 1967-2]
AESCH. ; Eum., 313 820. – Idem. ; Suppl. :
(732)
« Au temps et au jour fixés, le mortel, contempteur des dieux, subira le châtiment ». – EUR. Bacch., 882-890, déjà cité §1856 SOLON ; XIII (IV), (§1980-6).
[FN: § 1968-1]
AESCH. ; Agam., 338-340.
[FN: § 1968-2]
Dans un fragment de la Niobé d'ESCHYLE (NAUCK, 151), il est dit que : « Dieu met de mauvaises pensées dans l'esprit des hommes, quand il veut détruire entièrement une maison ».
[FN: § 1969-1]
AESCH. ; Agam., 946-947.
[FN: § 1969-2]
AESCH. ; Agam., 1001-1007.
[FN: § 1970-1]
Odyss., I, 32-41 : « Car ils disent que les maux viennent de nous ; et d'autre part eux-mêmes, par leur folie, ont des maux contrairement au destin. Ainsi, maintenant encore Égisthe, contrairement au destin, s'est uni à la femme légitime de l'Atride [Agamemnon] et a tué celui-ci de retour ; tout en connaissant la terrible ruine [qui l'attendait]. Pourtant, lui ayant envoyé Hermès, le clairvoyant meurtrier d'Argus, nous l'avions averti de ne pas tuer Agamemnon et de ne pas rechercher l'épouse de celui-ci, car il se serait ainsi exposé à la vengeance de l'Atride Oreste, quand celui-ci, devenu adulte, aurait désiré revoir son pays ». Dans ce discours, il y a une contradiction formelle ; mais elle disparaît, si l'on adopte le sens : « Car ils disent que tous les maux viennent de nous ; tandis qu'eux aussi, par leur folie, ont des maux contrairement au destin ». Ainsi disparaît la contradiction entre cette affirmation et celle qui attribue l'origine des malheurs d'Ulysse à la colère de Poséidon ; mais elle subsiste quant au fond ; car enfin, même si ce n'est qu'une partie des maux des hommes qui viennent des dieux, cela n'empêche pas que, pour cette partie, les hommes aient raison de se plaindre des dieux. Cfr. Iliad., XXIV, 527-532, et les observations de PLATON à ce sujet, De Rep., II, p. 379. Cet auteur conclut (p. 380) qu'on ne doit pas laisser dire que Zeus est l'auteur des maux qui accablent les mortels ; que s'il en est l'auteur, il n'a rien fait que de juste et de bon, corrigeant les hommes pour leur faire du bien : on ne doit permettre à aucun poète de dire que quiconque est ainsi puni est malheureux. Chez Platon, la métaphysique se superpose à la théologie. et Zeus n'est que l'exécuteur des sentences de la métaphysique.
[FN: § 1970-2]
Odyss.. I, 45-62.
[FN: § 1970-3]
Odyss., I, 63-75.
[FN: § 1971-1]
J. Girard ; Le sent. relig. en Grèce.
[FN: § 1971-2]
EUSTATH. ; Comm. in Odyss., I, v. 34, p. 15 Basil., p. 1387 Rom. Il cite comme exemple de maux indépendants de l'action humaine : « Hippolyte qui souffrit injustement des maux par le fait de Cypris : Héraclès persécuté par la colère d'Héra » ; Bellérophon, Eukhènôr, Ulysse. Comme exemples d'hommes qui s'attirèrent à eux-mêmes des maux, il cite Égisthe, les compagnons d'Ulysse, qui se nourrirent des bœufs du Soleil ; Achille, qui avait le choix entre vieillir à Phthia ou mourir jeune devant Troie ; Alexandre (Pâris), qui négligea Oenone pour enlever Hélène ; Elpénor qui, gorgé de vin, se tua [on tombant du toit de la demeure de Circé].Tous ces gens souffrirent par leur imprudence ou leur folie : ![]()
![]() . Il convient de remarquer qu'Eustathe met ensemble des délinquants comme Égisthe et Pâris, de simples imprudents, comme Elpénor, et même des ambitieux, comme Achille.
. Il convient de remarquer qu'Eustathe met ensemble des délinquants comme Égisthe et Pâris, de simples imprudents, comme Elpénor, et même des ambitieux, comme Achille.
[FN: § 1973-1]
IULIANUS apud CYRILL. ; V (p. 160) : ![]()
![]() ; « Quoi de plus futile que la cause pour laquelle Dieu se met en colère, ainsi que le rapporte faussement l’écrivain ? » Il s'agit du fait raconté, Nombr., 25, où Dieu fait mourir plusieurs milliers d'Israélites, parce que quelques-uns d'entre eux s'étaient unis aux femmes moabites, et avaient adoré les dieux de ces femmes.
; « Quoi de plus futile que la cause pour laquelle Dieu se met en colère, ainsi que le rapporte faussement l’écrivain ? » Il s'agit du fait raconté, Nombr., 25, où Dieu fait mourir plusieurs milliers d'Israélites, parce que quelques-uns d'entre eux s'étaient unis aux femmes moabites, et avaient adoré les dieux de ces femmes.
[FN: § 1974-1]
A. BAYET ; Leçons de morale, p. 1. Les passages soulignés ici le sont aussi dans le texte de l'auteur. Il nous enseigne – suivant Hésiode, dit-il – que « (p. 6) ceux qui écoutent ce que dit la morale sont toujours heureux. La paix règne dans leur pays. Ils n'ont pas à supporter les maux effroyables de la guerre [donc aucun peuple moral n'a jamais subi l'agression d'un autre état]... la terre leur fournit une nourriture abondante : les abeilles leur donnent le miel ; les moutons leur donnent la laine : ils sont toujours riches et sans chagrins [il semble vraiment que la Sainte Science fait ici une concurrence déloyale à l'ancienne superstition (§1984)]. Mais quand les hommes n'écoutent pas la morale, le malheur vient les frapper... ». Plus loin, p. 163, il d’écrit les malheurs des protestants sous le règne de Louis XIV. Si l'on admet que « ceux qui écoutent ce que dit la morale sont toujours heureux », il en résulte nécessairement que les protestants, qui étaient malheureux, n'avaient pas écouté ce que dit la morale. Les contradictions formelles ne manquent pas non plus. Ainsi, on lit dans la même page : « (p. 146) ON SE DÉVOUE lorsqu'on accepte d'être malheureux pour que les autres soient heureux... En se dévouant, on ne rend pas seulement les autres hommes heureux : ON SE REND HEUREUX SOI-MÊME ». Donc, le même homme est à la fois heureux et malheureux.
[FN: § 1975-1]
Dans l'Anti-Machiavel, qui est attribué à Frédéric II de Prusse, on affirme que l'histoire ne devrait pas parler des mauvais princes. L'Antimachiavelli ou Examen du Prince de Machiavel ; Avant-Propos : « (p. VIII) On ne devroit conserver dans l'histoire que les noms des bons Princes, et laisser (p. IX) mourir à jamais ceux des autres, avec leur indolence, leurs injustices et leurs crimes. Les livres d'histoire diminueroient à la vérité de beaucoup, mais l'humanité y profiteroit, et l'honneur de vivre dans l'histoire, de voir son nom passer des siècles futurs jusqu'à l'éternité, ne seroit que la recompense de la vertu : Le Livre de Machiavel n'infecteroit plus les Ecoles de Politique, on mépriseroit les contradictions dans lesquelles il est toujours avec lui-même ; et le monde se persuaderoit que la véritable politique des Rois, fondée uniquement sur la justice, la prudence et la bonté, est préferable en tout sens au sistème décousu et plein d'horreur que Machiavel a en l'impudence de présenter au Publicq ». En effet, supprimer la connaissance des faits contraires à une thèse est un bon moyen de la défendre. –BAYLE ; Dict. hist., s. r. Machiavel, t. III, note E « (p. 246) Boccalin prétend, que puis qu'on permet, et qu'on recommande la lecture de l'Histoire, on a tort de condamner la lecture de Machiavel. C'est dire que l'on apprend dans l'Histoire les mêmes Maximes que dans le Prince de cet Auteur. On les voit là mises en pratique : elles ne sont ici que conseillées. C'est peut-être sur ce fondement que des personnes d'esprit jugent, qu'il seroit à souhaiter qu'on n'écrivit point d'Histoire (Voiez Mascardi, de Arte Historica) ». En effet, si l'on supprime le terme de comparaison de la réalité avec la théorie, on peut construire celle-ci à volonté. « Prenez garde qu'on accuse notre Florentin de s'être enrichi des dépouilles d'Aristote... Gentillet l'accuse d'être le Plagiaire de Bartole. Je m'étonne qu'on ne dise pas qu'il a dérobé ses Maximes au Docteur Angélique le grand Saint Thomas d'Aquin. Voiez dans les Coups d'Etat de Naudé un long passage du commentaire de Thomas d'Aquin sur le V Livre de la Politique d'Aristote. Mgr Amelot prouve que Machiavel n'est que le Disciple ou l'Interprete de Tacite... ».
[FN: § 1975-2]
Parmi les nombreux passages qui se rapportent à notre cas, rappelons tout d'abord les deux fragments de MACHIAVEL, cités ait §1929. Voir aussi l'ARIOSTE dans le Roland furieux :
IV (1 Quantunque il simular sia le più volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pur in molte cose e molte
Aver fatti evidenti benefici
E danni e biasmi e morti aver già tolte ;
Che non conversiam sempre con gli aimici
In questa assai più oscura che serena
Vita mortal, tutta d'invidia piena.
Puis nous avons encore dans MACHIAVEL ; Disc. sur la pr. déc. de T. L., 1. II, c. 13 (Trad. PÉRIÈS) : « Rien à mon avis n'est plus vrai que les hommes s'élèvent rarement d'une basse fortune au premier rang, si cela même est arrivé quelquefois, sans employer la force ou la fourberie, à moins que ce rang, auquel un autre est parvenu, ne leur soit donné ou laissé par héritage. Je ne crois pas que jamais la force seule ait suffi, tandis que la seule fraude a cent fois réussi... Les actions auxquelles les princes sont contraints dans les commencements de leur élévation sont également imposées aux républiques, jusqu'à ce qu'elles soient devenues puissantes et que la force leur suffise : ... On voit donc que les Romains eux-mêmes, dès, les premiers degrés de leur élévation, ne s'abstinrent pas de la fourberie : elle fut toujours indispensable à ceux qui, du plus bas degré, veulent monter au rang le plus élevé ; mais plus cette fraude se dérobe aux regards, comme celle qu'employèrent les Romains, moins elle mérite le blâme ». – Le Prince, c. 15 (trad. PÉRIÈS) : « Mais, dans le dessein que j'ai d'écrire des choses utiles pour celui qui me lira, il m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à de vaines spéculations. Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés telles qu'on n'en a jamais vu ni connu. Mais à quoi servent ces imaginations ? Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu'en n'étudiant que cette dernière on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver ; et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants ». À cela l'Anti-Machiavel, loc. cit. §1975 I, répond : « (p. 167) Machiavel avance qu'il n'est pas possible d'être tout à fait bon dans ce monde, aussi scélérat et aussi corrompu que l'est le genre humain, sans que l'on périsse. Et moi je dis, que pour ne point périr il faut être bon et prudent. Les hommes ne sont d'ordinaire ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants [l'auteur ignore ou feint d'ignorer que c'est précisément ce que dit MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, 1. I, c. 27 : « Les hommes savent très rarement être ou tout mauvais ou tout bons »] ; mais et méchants, et bons, et médiocres s'accorderont tous à ménager un Prince puissant, (p. 168) juste et habile. J'aimerais mieux faire la guerre à un Tiran qu'à un bon Roi, à un Louis onze qu'à un Louis douze, à un Domitien qu'à un Trajan ; car le bon Roi sera bien servi, et les sujets du Tiran se joindront à mes troupes... Jamais Roy bon et sage n'a été détrôné en Angleterre par de grandes Armées, et tous les mauvais Rois ont succombé (p. 169) sous des compétiteurs qui n'ont pas commencé la guerre avec quatre mille hommes de troupes réglées. Ne sois donc point méchant avec les méchants, mais sois vertueux et intrépide avec eux, tu rendras ton peuple vertueux comme toy, tes voisins voudront t'imiter et les méchants trembleront ».
[FN: § 1975-2-bis]
Il Principe, c. II : Io lascevô indietro il ragionare delle repubbliche, perchè altre volte ne ragionai a lungo. Volterommi solo ai principale, e anderô ritessendo gli ordini sopra descritti, e disputerô come questi principati si possano, governare e mantenere. « Je ne m'occuperai pas des républiques, parce qu'en d'autres occasions j'en ai parlé longuement. Je tournerai mon attention seulement vers les principautés, et je rappellerai leur manière d'être, et je discuterai comment ces principautés peuvent être gouvernées et conservées ». Il est impossible de s'exprimer plus clairement ; mais cela n'empêche pas les perroquets de répéter indéfiniment que Machiavel est un ennemi de la liberté du peuple, et qu'il donne des préceptes aux despotes pour la détruire. À ce titre, on pourrait dire aussi que les chimistes donnent des préceptes aux empoisonneurs.
[FN: § 1975-3]
En voici quelques-uns. Nous répétons que nous ne discutons pas les affirmations d'Ollivier. Nous les admettons sans autre, afin de les envisager à titre d'hypothèses. E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t. V « (p. 61) Napoléon III était revenu d'Italie se croyant obligé à un acte de grande vigueur et d'importance capitale, la réorganisation de son armée. Il y avait urgence à corriger les défectuosités que le prestige de la victoire cachait au public, et qu'il avait en quelque sorte touchées de la main. C'était un rude labeur. Le laisser aller dans la tenue dû aux habitudes africaines était facile à remédier... L'augmentation de l'effectif pour le cas de guerre offrait bien plus de difficultés ». L'auteur explique les tentatives faites en ce sens, et dit qu'on avait songé à une excellente réorganisation de l'armée. « (p. 63) Mais pour opérer cette réforme fondamentale, (p. 64) il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Or le ministre des Finances, la commission du budget, le Corps législatif recommandaient l'économie... Si l'Empereur était venu demander de nouveaux crédits considérables, il y aurait eu un tolle, et non seulement sur les bancs de l'opposition. Il eût retrouvé dans le Corps législatif une résistance aussi acharnée que celle qui commençait en Prusse contre le projet de réorganisation militaire du Régent tendant au même but que celui de Randon [le ministre français qui avait préparé la réorganisation projetée de l'armée]. Il y avait dans les situations cette seule différence qu'en Prusse la résistance disposait de plus de forces qu'en France : il fallait un effort long et puissant, dont le succès était incertain pour venir à bout du soulèvement des députés du Landtag. L'Empereur, au contraire, sans grande peine pouvait mater le mauvais vouloir du Corps législatif : il eût crié, mais fini par voter. Cependant, tandis que le Régent de Prusse se jetait tête baissée, à tout risque dans le combat parlementaire, l'Empereur s'arrêta tout court devant la seule perspective de s'engager. Le pourquoi de cette différence de conduite contient le secret des événements futurs ». Ces événements futurs furent incontestablement favorables à la Prusse, nuisibles au plus haut point à la France. Il est donc évident qu'il eût été avantageux à la France que les rôles fussent intervertis, c'est-à-dire que ses gouvernants eussent agi comme le Régent de Prusse, et les gouvernants prussiens comme l'Empereur des Français. Ollivier nous apprend ensuite quelles furent, selon lui, les causes de cette différence dans la manière d'agir. « (p. 65) Guillaume préparait la guerre qu'il désirait pour établir la suprématie de la Prusse en Allemagne. Napoléon III ne croyait pas qu'une guerre nouvelle lui fût nécessaire pour maintenir en Europe sa suprématie morale [sic], la seule qu'il désirât ». Ce fut vraiment un malheur pour la France que son souverain oubliât à tel point la force pour ne penser qu'à la « morale ». « (p. 65) De quelque côté qu'il regardât, l'Empereur n'entrevoyait pas de cause de guerre... (p. 66) L'Allemagne était malveillante mais impuissante [bel homme d'État, qui ne sait pas qu'il faut se fier, non à la faiblesse présumée de ses ennemis, mais à sa propre force !] Lui seul pouvait créer une cause de guerre en essayant de prendre la Belgique ou le Rhin. S'il avait nourri cette arrière-pensée, il eût certainement bravé les résistances du Corps législatif à une réorganisation dispendieuse de l'armée. Mais moins que jamais il pensait à des agrandissements ou à des agressions [mais d'autres y pensaient, et n'en pas tenir compte peut être très moral, mais est aussi très imprévoyant]. Il exprimait le fond même de sa pensée dans son discours au Corps législatif : „ Je veux sincèrement la paix et ne négligerai rien pour la maintenir “ ». Quel dommage qu'un député ne l'ait pas alors interrompu en lui criant : Si vis pacem, para bellum ! Dans son exposé, Ollivier se montre homme privé excellent et homme d'État détestable. Ses affirmations font la louange du premier et condamnent le second (§2376. Ce n'est pas tout. Voici l'expédition du Mexique. Ollivier lave l'empereur de l'accusation d'avoir décidé l'expédition pour des motifs financiers, et il ajoute « (p. 257) Aucun motif ambitieux non plus » Pas même l'influence de l'impératrice ; « (p. 257) L'influence de l'Impératrice a été, plus spécieusement alléguée... (p. 258) Son imagination tournée au chevaleresque s'enflamma à ces perspectives de gloire et d'honneur ; elle employa sa force d'éloquence et de séduction à convaincre l'Empereur. Celui ci, d'autant plus accessible à son ascendant qu'il avait des torts intimes à se faire pardonner [ce remords est louable ; ce qui l'est moins, c'est de faire payer le rachat de ses fautes à son pays. Henri IV aimait aussi les femmes, mais cela ne l'empêchait pas d'être un bon politique et un bon général], ne le subissait toutefois pas aveuglement, pas plus que celui de qui que ce soit ». Mais voici enfin, suivant Ollivier, le pourquoi de l'expédition. « (p. 258) Son véritable motif est autre, Inconsolable de n'avoir pas réalisé son programme „ des Alpes à l'Adriatique “ et de n'avoir pas effacé de l'histoire de sa race la tache de Campo-Formio [quelle conscience timorée ! Il ne lui suffit pas d'avoir du remords à cause de ses propres fautes ; il en a aussi à cause des fautes de ses ancêtres, et en fait pénitence, ou plutôt non, il en fait faire pénitence au pays sur lequel il règne], résolu cependant à ne plus (p. 259) redescendre en Italie, il était en quête de moyens pour obtenir ce qu'il ne songeait plus à arracher [quel homme bon et doux, mais quel imbécile !]. Il avait proposé au cabinet anglais de conseiller de concert avec lui la vente de la Vénétie... Dans l'octroi d'un trône à l'archiduc Maximilien, Napoléon III entrevit un acheminement inattendu à l'affranchissement de la province captive. Il espéra que, satisfait du don qu'il offrait à sa famille, François-Joseph consentirait peut-être plus tard à lâcher la Vénétie en échange d'un agrandissement sur le Danube. „ Le spectre de Venise erre dans la salle des Tuileries “, écrivait Nigra à Ricasoli. „ C'est ce spectre qui a pris la main de Napoléon III et lui a fait signer (p. 260) l'ordre de renverser Juarez pour faire place à l'archiduc autrichien “ ». Ce spectre doit lui avoir dit : „ Au revoir à Philippe “, c'est-à-dire à Sedan. Bismarck connaissait l'art très profitable, pour les peuples qu'il gouvernait, de conjurer ces sortes de spectres. Cela ne suffit pas encore. Survient la guerre de 1866, et Napoléon III y reste neutre ; de la sorte il laisse la puissance prussienne devenir formidable. Il avait oublié l'avertissement donné par MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, c. 22 (trad. PÉRIÈS) : « Cependant le pape [Léon X] ne voulut point se rendre aux désirs du roi ; mais ses conseillers lui persuadèrent, à ce qu'on dit, de demeurer neutre, et lui firent voir que ce parti seul promettait la victoire, parce qu'il était de l'intérêt de l'Église de n'avoir pour maître en Italie ni le roi ni les Suisses ; mais que, s'il voulait rendre à cette contrée son antique liberté, il était nécessaire de la délivrer et de l'un et de l'autre... Il était impossible de trouver une occasion plus favorable que celle qui se présentait : les deux rivaux étaient en campagne ; le pape, avec son armée, se trouvait en mesure de se transporter sur les frontières de la Lombardie, ... il y avait lieu de croire que cette bataille serait sanglante pour chacun, et laisserait le vainqueur tellement affaibli, qu'il serait aisé au pape de l'attaquer et de le battre. Ainsi, le pape devait demeurer glorieusement le maître de la Lombardie et l'arbitre de toute 1'Italie. L'événement fit voir combien cette opinion était erronée. Les Suisses furent défaits après une bataille opiniâtre, et les troupes du pape ni celles d'Espagne n'osèrent assaillir le vainqueur : loin de là, elles se disposèrent à la fuite... » (§2389). À propos des événements de 1866, Ollivier a quelque lueur de la réalité ; il écrit, t. VIII « (p. 189) Après la déconvenue qui avait succédé au programme retentissant de la guerre d'Italie, il semblait au moins imprudent de régler aussi bruyamment d'avance les résultats d'une guerre à laquelle on ne participerait pas ». Mais aussitôt il retombe dans la nuit et se remet à rêver. Il cite un de ses articles où il expose des conceptions qu'il conserva toujours dans la suite. « (p. 189) Le droit est manifeste. En Italie, il est avec l'armée qui s'avance pour délivrer Venise. En Allemagne, il est avec l'armée qui, guidée par l'Autriche, s'avance pour protéger Francfort et délivrer Dresde. Le Droit ne nous permet pas de mettre la main sur les provinces rhénanes ; il interdit à la Prusse de s'emparer du Hanovre, de la Hesse et des Duchés, et à l'Autriche de garder Venise ». Que de contrées où ce vénérable Droit se promenait ! Mais il disparut ensuite, quand tonna le canon de Sedan, de Metz et de Paris ; et comme personne ne s'était soucié de ses « interdictions » au sujet du Hanovre et d'autres pays, il laissa se consommer sans autre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à ajouter ici ; mais cette note est déjà trop longue, et il convient d'y mettre un terme. Plus loin (§2374 et sv.), nous retrouverons les faits mentionnés ici, et nous les étudierons sous un autre aspect.
[FN: § 1975-4]
Le même Ollivier montre qu'en un grand nombre d’occasions l'empereur fut dépourvu de toute prévoyance. E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. V : « (p. 67) Tenant néanmoins à réaliser cette décentralisation militaire qui hantait sa pensée depuis la guerre de Crimée, et qui seule pouvait amener le passage rapide du pied de paix au pied de guerre, Napoléon III prescrivit à Randon de l'opérer sans aucune augmentation de crédit et, comme dans ces termes c'était impossible, c'était en réalité y renoncer. Et, en effet, à partir de ce moment ni empereur ni ministre ne s'en occupèrent plus ». C'est le fait d'un homme privé de bon sens d'estimer une chose indispensable, et de prescrire de l'exécuter dans des conditions que l'on sait être impossibles. Pourtant Napoléon III était un homme intelligent ; mais s'il voyait son avantage, il agissait en sens contraire, mû par les sentiments existant chez lui, et qui correspondaient aux résidus de la IIe classe (§2370-1].
[FN: § 1976-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'anc. Test. Suite de la citation faite au §1944 1 « (p. 208) Pendant longtemps, ces conceptions semblent n'avoir soulevé aucune objection sérieuse ; car on n'en rencontre pas dans les plus anciens documents. Mais, à mesure qu'on observait mieux les événements de la vie individuelle et de l'histoire et qu'on y réfléchissait davantage [c'est moins l'observation des faits que la réflexion, qui faisait défaut ; l'auteur ne devrait pas employer le pronom indéfini on : ceux qui réfléchissaient et ceux qui ne réfléchissaient pas étaient différents], on s'apercevait que l'expérience démentait à chaque instant cette théorie de la rémunération, que beaucoup de méchants étaient heureux et beaucoup de justes malheureux. De là un grand embarras pour celui qui ne fermait pas les yeux à l'évidence [voilà la distinction qu'il faut faire], un piège qui pouvait faire broncher les (p. 209) croyants et les jeter dans le doute. Cette difficulté se faisait surtout sentir à partir de l'exil. Aussi fit-on dès lors les efforts les plus sérieux pour la surmonter ». Voir la suite de la citation dans la note 1979 1. Après avoir cité de nombreux exemples, CIC., De nat. deor., III, 32, 81, ajoute : Dies deficiat, si velim numerare quibus bonis male evenerit : nec minus, si commemorem, quibus improbis optime. Dans son traité Sur la vengeance tardive de la divinité, PLUTARQUE accumule des dérivations pour montrer que l'œuvre de la divinité est toujours juste, et il n'oublie pas (IV, p. 549-550) cette échappatoire : que les voies de Dieu sont insondables (B 4).
[FN: § 1979-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'anc. Test. Suite de la citation de la note 1976 1 : « (p. 209) Peut-être que plus anciennement déjà on avait entrevu la difficulté et qu'on cherchait à la lever en disant que Dieu punit les fautes des pères sur les enfants et qu'il récompense les enfants pour la fidélité des ancêtres ». Remarquons la tentative de justification qui suit : « Il faut dire que ce principe est en partie fondé sur la loi de la solidarité et de l'hérédité, constatée par l'expérience de chaque jour : les enfants pâtissent souvent des fautes de leurs parents ou benéficient de leurs vertus ». Piepenbring ne s'aperçoit pas que ce qu'il démontre n'est pas du tout ce qu'il voudrait démontrer. Il démontre qu'il existe un rapport entre l'état de l'enfant et les actes du père, tandis qu'il voudrait démontrer que ce rapport est d'un certain genre déterminé. Nous pouvons admettre que les vices et les vertus des pères ont des conséquences pour les enfants, mais il n'est nullement, vrai que les vices des pères aient toujours des conséquences fâcheuses pour leurs enfants. Par exemple, un père usurier ou délinquant peut laisser son enfant dans la richesse. Il n'est pas vrai non plus que les vertus des pères aient des conséquences heureuses pour leurs enfants. Par exemple, un père bienveillant, qui se sacrifie pour le bien d'autrui, peut laisser son enfant dans la misère. Pour démontrer que les fautes des pères sont punies sur les enfants, les vertus récompensées de même, il faudrait exclure ces derniers cas, ce dont notre auteur n’a cure. Il donne ainsi un nouvel exemple du défaut de logique en ces matières. Il continue : « p. 209) Mais ce principe, relativement ancien, soulevait lui aussi des objections et donnait lieu au proverbe sarcastique, „ les pères ont mangé du verjus et les dents des fils ont été agacées “ (Jér., 31, 29 ; Ez., 18, 2). On lui opposait la pensée que chacun portait la peine de son propre péché (Jér., 31, 29 ; Ez., 18, 2 ss). C'était maintenir le point de vue traditionnel et écarter une explication qui atténuait au moins la difficulté qu'il soulève. Mais comment dès lors résoudre cette difficulté ? On faisait entendre que l'homme n'a pas le droit de contester avec Dieu, la créature avec le créateur, l'ouvrage avec celui qui l'a fait (Es., 29, 16 ; 45, 9 s. Jér., 18, 6) [B 4] ; on déclarait que loin d'être juste, l'homme est en réalité coupable (Ez., 18, 29 ss. ; 33, 17 ss. ; Es., 58, 3 ss.) [A] ; ou bien on soutenait que le bonheur des méchants n'est que passager et aboutit toujours à une fin (p. 210) malheureuse, tandis que l'infortune des justes ne peut être que momentanée (Ps., 73, 16-24 ; 9, 18 s. ; 37 ; 49, 55, 23 s. ; 64 ; 94, 8-23 ; Prov., 23, 17 s.) [B 2] ; dans quelques passages, on s'élevait [on remarquera cette considération éthique : on s'élevait, étrangère au domaine expérimental] même à l'idée que le malheur a un effet salutaire pour l'homme, comme la correction est salutaire pour l'enfant (Prov., 3, 11, s. ; Deut., 8, 2-5 ; Lam., 2, 27-30) [B 2] ; dans le second Esaïe, enfin, se trouve la pensée que les justes peuvent être appelés à souffrir pour les coupables et à leur épargner ainsi les châtiments mérités Es., 53) [B 2]... Le problème dont nous parlons préoccupait et embarrassait tellement les penseurs israélites que l'un d'eux sentit le besoin de le traiter à fond et d'en faire le sujet de tout un livre, celui de Job [B 4] ». Dans une si grande diversité de dérivations, on voit un cas de la recherche d'une voie permettant d'arriver à un point préventivement fixé (§1414, 1628).
[FN: § 1980-1]
HÉROD. ; I, 91.
[FN: § 1980-2]
VAL. MAX. ; I, I, Externa exempla, 3. – HORAT., Carm., I, 28, fait parler un mort nommé Archytas, qui demande à un marin de recouvrir ses restes d'un peu de sable, et lui dit que s'il refuse, il laissera à ses enfants un crime à expier :
(30) Negligis immeritis nocituram Postmodo te natis fraudem committere forsan.
Note de Pseudacron : Fraudem committere. Seu studio commercandi fraudem, quae redundet in posteros, capiat, seu certe inhumanitatis piaculum eius filios laedat, aut, ne longum putaret, etiam ipsum delicti subiturum poenas minatur. Un autre scoliaste, Porphyrion, dit : Neglegis immeritis nocituram. Ordo est : neglegis fraudem committere. Sensus autem est : neglegis me et fraudem in me committere facile esse putas : atqui haec expetet in eos, qui ex te nati sunt, id est in filios tuos. Il n'y aucun doute sur le fait que le châtiment peut frapper les enfants.
[FN: § 1980-3]
SENEC. ; Cons. ad Marc., 12 : A felicissimo incipiam. L. Sulla filium amisit, nec ea res aut militiam eius, et acerrimam virtutem in hostes civesque contudit, aut effecit, ut cognomen illud usurpasse salvo videretur, quod amisso filio assumpsit : nec odia hominum veritus, quorum malis illius nimis secundae res constabant nec invidiam deorum, quorum illud crimen erat, Sulla tam felix. – PLIN. : Nat. hist., VII. 44 : Unus hominum ad hoc, aevi, Felicis sibi cognomen asseruit L. Sulla, civili nempe sanguine, ac patriae oppugnatione adoptatum. Pourtant Pline ajoute qu'il mourut malheureux, à cause de la haine de ses concitoyens et des souffrances de sa dernière maladie. – DURUY tourne autour du pot, Hist. des Rom., II : « (p. 712) Dans les affaires humaines, la justice saute parfois une génération [voilà une belle uniformité, que l'auteur oublie de prouver]. C'est trente ans plus tard [après la mort de Sulla, à Pharsale, que la noblesse expia les proscriptions de Sylla ». Ces déclamations éthiques continuent à porter le nom d'histoire. Duruy se préoccupe aussi des remords que Sulla aurait du avoir, mais que, paraît-il, il n'eut pas. Duruy observe que pour les Romains le succès justifiait tout, et il ajoute : « (p. 715) Voilà pourquoi le terrible dictateur mourait sans remords ; il en sera ainsi de tous ceux qui, entre leur conscience et leurs actes, mettront un faux principe ». La conséquence, – que certes Duruy ne veut pas tirer – serait que pour être heureux, il est avantageux d'avoir de «faux principe ». Mais le problème à résoudre n'est pas de savoir si l’homme est heureux grâce a de « faux principes », mais bien de savoir si, nonobstant ses mauvaises actions, il peut être heureux, laissant payer le prix de ses fautes à d'autres personnes de sa famille, de sa caste, de sa nation, peut être même à l'humanité entière.
[FN: § 1980-4]
PLIN. ; Nat. Hist., XXXIII, 24.
[FN: § 1980-5]
HEROD. ; I, 91. LARCHER met en note à sa traduction de ce passage l'observation de Cicéron (De nat. deor., III, 38) : Dicitis eam vim Deorum esse, ut etiam si quis morte poenas sceleris effugerit, expetanLur eae poenae a liberis, a nepotibus, a posteris. O miram acquitatem Deorum ! ferretne civitas ulla latorem istiusmodi legis, ut condemnaretur filius aut nepos si pater aut avus deliquisset ? Larcher ajoute : « Le philosophe Bion (PLUTARCH. ; De sera num. vind.) avait mieux aimé tourner cela en ridicule : „ Le dieu, dit-il, qui puniroit les enfans pour les crimes de leur père, seroit plus ridicule qu'un médecin qui donneroit un remède à quelqu'un pour la maladie de son père ou de son grand-père.“ On n'avait pas encore du temps de notre Historien, des idées saines de la divinité. On n'en trouve que chez les Juifs ». Il cite Deut., XXIV, 16 ; Ezech., XVIII, 20, mais oublie un grand nombre d'autres passages en sens contraire ; par exemple : Exod., XX. 5 : « ...car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent... » Voilà un nouvel exemple de la façon dont un sentiment prédominant induit en erreur les auteurs. Larcher connaissait certainement ce passage et d’autres semblables de la Bible, mais, égaré par le sentiment, il les néglige.
[FN: § 1980-6]
SOLON ; XIII (IV), 27-32 : « Celui qui a un cœur malfaisant ne demeure pas indéfiniment caché : enfin il se découvre. L'un subit le châtiment mérité plus tôt, l'autre plus tard. Si quelques-uns paraissent échapper et n'être pas atteints par le destin imminent des dieux, ils en sont finalement frappés. Ce sont leurs enfants innocents, ou plus tard leurs petits-enfants, qui paient le tribut de leurs actions.
[FN: § 1982-1]
PLUTARCH. ; De sera numinis vindicta, XV et XVI, p. 559.
[FN: § 1983-1]
GLOTZ : La solidar. de la fam. en Grèce : « (p. 563) Qu'une ville soit châtiée sans retard pour la faute d'un citoyen ou d'un roi, cela n'est que juste et se conçoit aisément. L'État, responsable devant les dieux, n'avait qu'à se libérer (p. 564) par une mesure de salut public, un abandon noxal par la mort ou l'exil ».
[FN: § 1983-2]
II., I, 117 :
Dugas-Montbel note, à propos de ce vers : « (p. 23) Zénodote supprimait ce vers comme n'exprimant qu'une idée trop commune ; mais, en la liant avec ce qui précède, cette pensée est relevée par le sacrifice que fait Agamemnon, puisqu'il ne consent à renvoyer sa captive qu'en faveur de son peuple. Je ne crois point qu'on doive souscrire à la critique de Zénodote, qui n'est admise par aucun des éditeurs modernes ». Ces considérations d'idées trop communes ou d'idées élevées sont étrangères aux temps homériques. Agamemnon ne pouvait pas parler autrement : il dit pourquoi il fait ce que personne ne pouvait l'obliger à faire.
[FN: § 1983-3]
SOPH. ; Oed. rex, 96-98 : « Le roi Phoibos nous ordonne de repousser et de ne pas conserver, tant qu'elle est inexpiable, une souillure ![]() que cette terre recèle ».
que cette terre recèle ».
[FN: § 1984-1]
HES. ; Op. et dies :
(260)
Un auteur, Élie Reclus, qui ne comprend pas grand'chose à l'antiquité, s'imagine que le roi grec était comme le roi nègre, qui, par des opérations magiques, procure à ses sujets la pluie et toutes sortes de biens. Il dit : « (p. 271) Les hommes ne demanderaient [selon certains auteurs anciens] qu'à se vautrer dans les excès et à rouler dans le crime, n'étaient les monarques pour réprimer cupidités et violences, pour imposer aux nations le frein des lois. Dans ces conceptions-là, il n'est pas toujours facile de distinguer entre le dieu qui délègue ses pouvoirs à l'homme, et l'homme qui reçoit du dieu ses pouvoirs. Voilà pourquoi la doctrine indoue enseignait qu'Indra ne pleut point dans un royaume qui a perdu son roi. Ulysse, le prudent Ulysse, expliquait à la sage Pénélope : „ Sous un prince vertueux, la terre porte orge et froment en abondance, les arbres se chargent de fruits, les brebis ont plusieurs portées, et la mer s'emplit de poissons. Un bon dirigeant nous vaut tout (p. 272) cela (Odyssée, XIX, 108) “ ». (Les Primitifs). Si notre auteur avait regardé, ou compris, le texte qu'il cite, il aurait vu qu'il ne dit pas « un bon dirigeant nous vaut tout cela », mais qu'il attribue pour origine à ces biens : ![]()
![]() ce qui veut dire incontestablement : « grâce à un bon gouvernement ». D'abord le texte explique que ce roi « gouverne avec justice » :
ce qui veut dire incontestablement : « grâce à un bon gouvernement ». D'abord le texte explique que ce roi « gouverne avec justice » : ![]() ; et c'est pourquoi «les peuples prospèrent sous lui » :
; et c'est pourquoi «les peuples prospèrent sous lui » : ![]() .
.
[FN: § 1985-1]
CIC. ; De nat. deor., III, 37 : Ideinque [Diagoras], cum ei naviganti vectores adversa tempestate timidi et perterriti dicerent, non iniuria sibi illud accidere, qui illum in eamdem navem recepissent : ostendit eis in eodem cursu multas alias laborantes ; quaesivitque, num etiam iis navibus Diagoram vehi crederent. – HORAT. ; Carm., III, 2 :
(29) ……… Saepe Diespiter
Neglectus, incesto addidit integrum
Baro antecedentem scelestum
Deseruit pede Poena claudo.
[FN: § 1986-1]
PLUTARCH. ; De Herodot. malign., XV, p. 858.
[FN: § 1986-2]
PLUTARCH ; Aemilius Paulus (Trad. TALBOT). Plutarque rapporte que Paul-Émile parlant au peuple romain après avoir exposé comment la fortune leur avait été extrêmement favorable, à lui et à l'armée, dans la guerre contre Persée, et jusqu'à leur retour dans leur patrie, il ajouta : « (36) J'arrive cependant sain et sauf parmi vous, je vois la ville remplie de joie, de fêtes et de sacrifices ; mais je n'en soupçonne pas moins la fortune, sachant qu'elle n'accorde aux hommes aucune grande faveur qui soit sincère et sans arrière-pensée. Mon âme n'a donc été délivrée de cette crainte, qui la faisait souffrir et envisager avec terreur l'avenir de Rome, que quand ce coup de foudre est venu frapper ma maison, lorsque deux fils, ma plus belle espérance, que je m'étais gardés pour uniques héritiers, ont été, l'un après l'autre, ensevelis de mes mains durant ces jours sacrés ».
[FN: § 1987-1]
Comme d'habitude (§587), par les dérivations, on prouve également bien le pour et le contre. Chez PLUTARQUE, De se num. vind., XVI, p. 559, les vices du père nuisent au fils dont ils justifient la punition, parce que – dit l'auteur – les fils héritent plus ou moins du tempérament du père. Chez les humanitaires modernes, les vices du père profitent au fils : ils lui procurent, s'il a commis un crime, une diminution de peine ou le complet acquittement, parce que – disent les humanitaires – ces vices diminuent la « responsabilité » du fils.
[FN: § 1987-2]
Le cas classique est celui de l'affamé qui dérobe un pain. On comprend qu'on l'acquitte, mais on comprend moins bien pourquoi la dette de la « société », qui a le devoir de ne pas laisser mourir de faim ce malheureux, doit être payée par un boulanger pris au hasard, et non par la société entière. La solution logique semblerait devoir être que l'affamé soit acquitté, et que la société paye le pain dérobé au boulanger. Il est arrivé parfois qu'une femme ait tiré sur son amant, lequel n'a pas été atteint, tandis qu'un tiers, totalement étranger à ce conflit, était frappé : et la femme a été acquittée par des jurés pitoyables. Admettons qu'on la juge excusable parce qu'elle aurait été poussée au crime par les mauvaises actions de son amant. Mais pourquoi le tribut de ces mauvaises actions doit il être payé par un tiers tout à fait innocent ? Afin de satisfaire des sentiments de pitié absurdes, des législateurs humanitaires approuvent la « loi du pardon », grâce à laquelle celui qui a commis un premier vol est aussitôt mis en mesure d'en commettre un second. Pourquoi ce luxe de pitié humanitaire doit-il être payé précisément par la malheureuse victime du second vol, et non par la société entière ? D'une manière générale, à supposer que le crime soit le fait de la société plus que du criminel, comme le prétendent certaines personnes, il est compréhensible qu'on en tire pour conséquence l'acquittement du criminel, ou sa condamnation à une peine très légère ; mais le même raisonnement a aussi pour conséquence que la victime du crime doit être dédommagée, dans les limites du possible, par la société. Au contraire, on ne songe qu'au criminel, et personne ne se soucie de la victime du crime.
[FN: § 1991-1]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, t. III : « (p. 122) Si un homme est infirme de naissance, quoiqu'il n'ait pas encore péché, ils disent que cela est l'effet de la sagesse divine et qu’il vaut mieux pour cet individu d'être ainsi fait plutôt que d'être bien constitué [B 2, §1968]. Nous ignorons en quoi consiste ce bienfait [B 4], quoique cela lui soit arrivé, non pas pour le punir, mais pour lui faire le bien [B 2]. Ils répondent de même, lorsque l'homme vertueux périt, que c'est afin que sa récompense soit d'autant plus grande dans l'autre monde [B 3]. Ils sont même allés plus loin : quand on leur a demandé pourquoi Dieu est juste envers l'homme sans l'être aussi envers d'autres créatures, et pour quel péché tel animal est égorgé, ils ont eu recours à cette réponse absurde, (p. 123) que cela vaut mieux pour lui (l'animal), afin que Dieu le récompense dans une autre vie [B 3]. Oui (disent-ils), même la puce et le pou qui ont été tués doivent trouver pour cela une récompense auprès de Dieu, et de même, si cette souris qui est innocente, a été déchirée par un chat ou par un milan, c'est la sagesse divine, disent-ils, qui a exigé qu'il en fût ainsi de cette souris, et Dieu la récompensera dans une autre vie pour ce qui lui est arrivé » (§ 1934-1).
[FN: § 1993-1]
ETIENNE DE BOURBON ; A necd. hist., §396, p. 346-349. L'éditeur (A. LECOY DE LA MARCHE) note : « (p. 349) Une variante de cet apologue célèbre a été publiée par Thomas Wright d'après des manuscrits anglais (Latin stories, etc., n. 7. On le retrouve encore dans les Gesta Romanorum, recueil du XIVe siècle (chap. 80), dans les Fabliaux et contes édités par Méon (II, 216), dans les sermons d'Albert de Padoue, orateur du XIVe, siècle, dans les poésies anglaises de Thomas Parnell, et dans le Magnum speculum exemplorum, édité à Douai en 1605 (I, 152). Il a fourni le sujet d'un épisode de Zadig, conte de Voltaire, qui a remplacé l'ange par un hermite. M. Victor Le Clerc croit pouvoir en rattacher l'origine aux anciennes vies des Pères du désert (Hist. litt., XXIII, 128 et av.) : Il paraît en effet venu de l'Orient, car on le rencontre dans plusieurs recueils orientaux, et jusque dans le Koran (XVII, I, 64). V. aussi Luzel, Légendes chrétiennes de la Bretagne (Saint-Brieuc, 1874), p. 14 ».
[FN: § 1995-1]
DANTE ; Parad., XIX :
(79) Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna
Per giudicar da lungi mille miglia,
Con la veduta corta d'una spanna ?
[FN: § 1995-2]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés. trad. S. MUNK, IIIe partie, C. XVII, t. III : « (p. 121) Les gens de cette secte [la secte musulmane des Ascharites] prétendent qu'il a plu à Dieu d'envoyer des prophètes, d'ordonner, de défendre, d'inspirer la terreur, de faire espérer ou craindre, quoique nous n'ayons aucun pouvoir d'agir ; il peut donc nous imposer même des choses impossibles, et il se peut que, tout en obéissant au commandement, nous soyons punis, ou que, tout en désobéissant, nous soyons récompensés. Enfin, il s'ensuit de cette opinion que les actions de Dieu n'ont pas de but final. Ils supportent le fardeau de toutes ces absurdités pour sauvegarder cette opinion, et ils vont jusqu'à soutenir que, si nous voyons un individu né aveugle ou lépreux, à qui nous ne pouvons attribuer aucun péché antérieur par lequel il ait pu mériter cela, nous devons dire : „ Dieu l'a voulu ainsi “, et il n'y a en cela aucune injustice ; car, selon eux, il est permis à Dieu d'infliger des peines à celui qui n'a point péché et de faire du bien au pécheur ».
[FN: § 1995-3]
Dans toutes les œuvres de Saint Augustin, c'est un perpétuel louvoiement entre l'affirmation que les voies du Seigneur sont insondables, et la prétention de les connaître. D. AUG. ; Contra adversarium legis et profetarum, I, 21, 45 : Apostolus clamat (Rom. XI, 33-34) O altitude divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam inscrutabilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius. Quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius eins fuit ? De civ. dei, XX, 2. Tout le chapitre expose que les voies du Seigneur sont insondables. Le saint commence par observer que les bons comme les méchants participent aux biens terrestres. Il ajoute que « nous ignorons vraiment par quel jugement de Dieu ce bon-ci est pauvre, et ce méchant-là est riche, celui-ci est heureux, alors qu'il nous semblerait devoir être tourmenté, à cause de ses mœurs débauchées, celui-là est affligé, alors qu'il semblerait devoir être heureux à cause de sa vie louable... » Il continue en citant un grand nombre d'autres cas semblables. Il dit que si cela arrivait toujours, et que tous les méchants fussent heureux, et tous les bons malheureux, on pourrait supposer que la cause en est un juste jugement de Dieu, qui compense les biens et les maux terrestres par les biens et les maux éternels ; mais comme il arrive aussi que les bons ont des biens terrestres, et les méchants des maux, « les jugements de Dieu sont plus inscrutables encore, et ses voies plus insondables ». Cela dit, ce devrait être suffisant, et le saint ne devrait plus chercher à connaître les desseins de Dieu. Au contraire, dans tout l'ouvrage, il les scrute et les sonde, comme s'il pouvait les connaître. Déjà à la fin du chapitre cité, il fait sienne l'une des solutions (B 3), et dit qu'au jour du jugement dernier, nous reconnaîtrons combien justes sont les jugements de Dieu, même ceux dont la justice nous échappe aujourd'hui. – Remarquables sont les efforts de Saint Augustin pour trouver des justifications au fait que les invasions barbares avaient frappé les bons comme les méchants. D'abord il recourt à l'une des solutions (B 2) ; il dit (I, 1) que les maux « sont attribuables à la divine Providence, qui corrige et réprime habituellement par la guerre les mœurs corrompues des hommes ». Aussitôt après, il ajoute une autre solution (B 3), en disant que la Providence afflige parfois les justes, afin de les faire passer dans un monde meilleur, ou bien afin de les faire demeurer sur la terre et de les garder pour un autre usage. (B 4). Il expose longuement que les temples païens ne sauvèrent pas leurs fidèles, tandis qu'au contraire les temples chrétiens sauvèrent les leurs. Ainsi nous sortons complètement des rapports entre les bonnes ou les mauvaises actions et les récompenses ou les châtiments : les temples semblent produire un effet par leur vertu propre, comme le feraient des paratonnerres, dont les uns ne sont pas et les autres sont efficaces. Ensuite il revient au problème difficile des biens aux méchants et des maux aux bons, et il dit : « (I, 8) Il plut à la divine Providence de préparer dans l'avenir aux bons des biens dont ne jouiront pas les impies, et aux impies des maux dont les justes seront exempts (B 3). Il n'abandonne pas entièrement les solutions (B 1), et dit qu'enfin les bons ne sont pas exempts de tout péché : « Ils sont frappés avec les méchants, non parce qu'ils mènent également une mauvaise vie, mais parce qu'ils aiment également la vie temporelle ». Il montre, en outre, (I, 10) que les saints ne perdent rien à perdre les biens temporels (A 1), et que les bons chrétiens ne peuvent se plaindre de cette perte, sans manifester la tendance au péché. Les païens observaient que même des femmes consacrées à Dieu avaient été violées par les barbares. Le saint en traite longuement, louvoyant, comme d'habitude, entre les différentes solutions de notre problème.
Il distingue (I, 26) entre la virginité matérielle et la virginité spirituelle (A 1). La première seule a pu être affectée par les barbares ; la seconde non. Saint Augustin se demande (I, 28) pourquoi Dieu a permis un tel outrage des saintes femmes. Il commence par une solution (B 4), et dit que les « jugements de Dieu sont inscrutables, et ses voies insondables ». Cela ne l'empêche d'ailleurs nullement de scruter et de sonder. En cherchant, il trouve aussitôt une solution (B 1). Il demande aux saintes femmes si elles n'ont pas péché par orgueil de leur virginité. Verumtamen interrogate fideliter animas vestras, ne forte de isto integritatis et continentiae vel pudicitiae bono vos inflatius extulistis, et humanis laudibus delectatae in hoc etiam aliquibus invidistis. Ensuite, que celles qui n'ont pas péché considèrent que parfois Dieu permet le mal pour le punir au jour du jugement universel (B 3). Mais peut-être n'est-il pas entièrement persuadé par cette réponse, car il revient à l'une des solutions (B 1), et dit que peut-être les femmes qui se glorifiaient de leur chasteté ont eu quelque faiblesse secrète dont aurait pu naître de la vaine gloire, si, dans les calamités, elles avaient échappé à l'humiliation qu'elles éprouvèrent. En louvoyant ainsi entre diverses solutions, sans jamais trouver moyen de s'attacher à quelque notion, si peu précise soit-elle, Saint Augustin nous présente un modèle dont nous trouvons une infinité de copies, jusqu'à notre temps. D'autres copies ne feront certainement pas défaut à l’avenir. – Nous avons donné (§1951) une citation d'E. OLLIVIER, qui veut que tôt ou tard l'ingratitude soit punie. Cette théorie est claire et précise : tu ne dois pas être ingrat, parce que tu seras puni. Si, nonobstant l'ingratitude, tu as aujourd'hui du succès, ne t'y fie pas ; Dieu – ou quelque entité métaphysique – te l'accorde pour te punir demain. Nous avons ainsi une solution du genre (B 2). À part les différences existant entre celui qui est récompensé pour ses propres actions, et celui qui est puni pour les actions d'autrui (§1975), cette solution a le mérite de justifier des divergences éventuelles entre les bonnes actions et la réalisation du bonheur. Mais plus tard, l'auteur change de solution. Il dit, t. III : « (p. 590) De même que le mai est quelquefois couronné d'un succès insultant à la justice, parfois aussi le bien ne conduit qu'aux revers immérités. Il y a là une prédestination providentielle dont le motif se dérobe à notre raison ». C'est là une solution du genre (B 4). Donc, lorsque cela lui convient, l'auteur connaît les desseins de la Providence, et sait qu'elle punit toujours tôt on tard. Quand cela lui convient autrement, il dit ignorer les desseins de la Providence. S'il les ignore, comment sait-il qu'elle punira dans l'avenir ? S'il sait qu'elle punira, pourquoi dit-il qu'il ignore ses desseins ?
[FN: § 1999-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Ainsi de LA ROCHEFOUCAULD, dont l'éthique paraît se résumer en cette parole bien connue de ses Réflexions ou Sentences et Maximes morales : « Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés ».
[FN: § 2002-1]
XENOPH. ; Mem., I, 1, 11.
[FN: § 2004-1]
Aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, on voyait partout l'influence de Satan. S'il grêlait, si un être humain ou un animal tombaient malades, ou, qui pis est, mouraient en des circonstances réputées étranges, quelque sorcière ou quelque sorcier ne devait pas y être étranger. Celui qui avait chez lui un chien ou un chat noir était l'hôte du diable. Si par malheur il avait un crapaud, on ne pouvait émettre aucun doute raisonnable sur ses pratiques magiques. Aujourd'hui, on entend encore des sornettes de ce genre. Après le procès Eulenbourg, en Allemagne, si deux hommes se promenaient ensemble, on les soupçonnait d'avoir des relations illicites. En Italie, après le procès Paternô, tout homme qui faisait la cour à une dame risquait de passer pour un exploiteur de femme, Un procès qui eut lieu à Milan, en 1913, nous fait voir des officiers qui, sous l'empire de cette idée, accusaient un de leurs camarades de faits dont le procès démontra l'inanité absolue. S'ils avaient vécu au XVIe siècle, ils l'auraient accusé, avec une conviction et une raison égales, d'avoir reçu de l'argent de Satan. Un suicide qui s'est produit en août 1913 a donné lieu à des considérations du Giornale d'Italia, qui montrent assez bien les fluctuations de l'opinion publique. Nous les reproduisons ici en supprimant, comme d'habitude, les noms, parce que nous voulons considérer uniquement les faits à un point de vue abstrait. – Giornale d’Italia, 27 août 1913 : « Ce ne fut pas un suicide passionnel... Ce qui est arrivé à cette occasion mérite vraiment l'attention de ceux qui étudient la psychologie des foules. Au début, tout le monde fut pris d'une pitié profonde, autant envers la femme qui avait ainsi brisé tragiquement son existence, qu'envers l'homme qui restait pour la pleurer. Le drame intime exhalait un parfum de poésie qui excitait l'âme sensible du public, et suscitait son émotivité. Puis, le bruit courut que X [le dernier amant] s'était montré indifférent au départ violent de l'objet aimé, et un véritable revirement se manifesta dans l'opinion publique : toutes les sympathies se concentrèrent sur la femme, tous les soupçons tombèrent sur le jeune homme. On commença à se demander pourquoi Z [la femme qui s'était suicidée] s'était donne la mort, et l'on en accusa X qui, par sa cruelle indifférence, l'aurait poussée au suicide, peut-être pour se débarrasser d'elle. Puis on alla plus loin, et l'on insinua, fût-ce sous une forme voilée, qu'il avait exploité la pauvre défunte, et l'on se livra aux conjectures les plus étranges et les plus inattendues. Pour augmenter la confusion, survint l'intervention du représentant de la famille Z. Il jouit pendant quelques jours d'une véritable popularité, et fut l'objet de chaleureuses démonstrations de sympathie, dont lui-même se montra surpris. Mais la vérité commença à se faire jour : les lettres de Z qu'on découvrit firent voir que la cause du suicide n'avait pas été l'amour, parce que peu de jours avant de se décider à faire le pas fatal, elle-même déclarait n'aimer personne. On pensa alors qu'il s'agissait de questions d'intérêt ; mais des renseignements positifs donnés par la famille X et l'accord conclu avec [le représentant de la famille Z] ont encore démontré l'inanité de cette hypothèse. De quoi s'agit-il donc ? Du caprice d'une femme hystérique, avide de plaisirs, de luxe et d'une vie changeante et aventureuse, qui n'a pas su résister à un moment de découragement non fondé. Toutes les recherches de l'autorité judiciaire n'aboutiront à rien, et il restera seulement à la charge de X cet acte de faiblesse : de n'avoir pas enlevé à temps l'arme homicide des mains de cette femme qui avait l'âme et l'intelligence d'une fillette ».
[FN: § 2008-1]
Nous avons tenu compte de cette observation dans le Manuel, en considérant pour chaque phénomène un aspect objectif et un aspect subjectif.
[FN: § 2022-1]
Nous avons ici un des nombreux cas où le langage mathématique permet d'atteindre une précision et une rigueur qui sont refusées au langage ordinaire.
Soient x, y, ... s, u, v,... des indices de la grandeur de A, B, C,... ; les rapports (ainsi que nous les nommons dans le texte) entre A, B, C nous sont donnés par certaines équations :
(1) rho 1(x, y, ... ) = 0, rho2 (x, y…) = 0,…
Toutes ces quantités x, y,. peuvent être fonction du temps t, lequel peut en outre figurer
explicitement dans le système d'équations (1). Ce système, si nous supposons le temps variable, représente les rapports de A, B, C,. , et l'évolution de ces rapports. Ce n'est que la
connaissance, même très vague, très imparfaite, du système (1) d'équations qui nous permet d'avoir une connaissance quelconque des rapports et de leur évolution. La plupart des auteurs ne s'en rendent pas compte, ignorent jusqu'à l'existence de ce système, mais cela n'empêche pas que leurs raisonnements aient ce système comme prémisses, sans qu'ils en aient conscience.
Si l'on suppose que les équations du système (1) soient en nombre égal à celui des inconnues, celles-ci sont toutes déterminées. Si l'on suppose qu'elles soient en moindre nombre, ce qui revient à supprimer par hypothèse quelques-unes des conditions (§130) qui existent réellement, on peut prendre comme variables indépendantes s, u, v,.... en nombre égal à celui des équations supprimées, et supposer que x, y,.., sont fonction de ces variables indépendantes. Si nous différentions les équations (1) par rapport aux variables indépendantes, nous aurons le système :
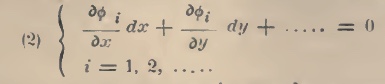
Les différentielles totales dx, dy,... représentent des mouvements virtuels, lesquels ont lieu lorsqu'on suppose que les variables indépendantes s, u, v,... se changent en s + ds, u + du,... Ces mouvements virtuels sont déterminés par les équations (2).
Au point de vue mathématique, les systèmes (1) et (2), ou ceux en lesquels on peut les supposer transformés, sont équivalents. On passe du premier au second par la différentiation, du second u premier par l'intégration. Très souvent le second système est plus facile à établir directement que le premier.
Qui tout ignore de l'un et de l'autre de ces deux systèmes, ignore aussi tout des rapports que peuvent avoir A, B, C,... Qui connaît quelque chose de ces rapports, connaît, par là même, quelque chose des systèmes (1) et (2). Qui établit ces rapports par la considération, non de ce qui est, mais de ce qui « doit » être, substitue aux systèmes (1) et (2) donnés par l'expérience, le produit de son imagination, et bâtit sur les nuages.
S'il n'y a qu'une seule variable indépendante, s, celle-ci, très généralement, est nommée la cause des effets x, y,.... et c'est son accroissement ds qui est dit la cause des mouvements virtuels dx, dy,... Lorsqu'on ne considère que des rapports de cause à effet, on opère, au point de vue mathématique, en réduisant les systèmes (1) et (2) aux suivants ou à d'autres équivalents :
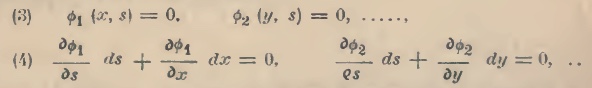
Ces deux systèmes d'équations sont bien plus faciles à traiter que les systèmes (1) et (2), soit par le langage vulgaire, soit même par les mathématiques (§2092 1). Il est donc bon, toutes les fois que cela est possible, de les substituer aux systèmes (1) et (2). Il est des cas où l'on a ainsi une solution au moins grossièrement approchée du problème que l'on s'est posé ; il en est d'autres où cela est impossible, et alors la substitution des systèmes (3) et (4) aux systèmes (1) et (2) ne peut pas s'effectuer, car elle ne donnerait que des résultats n'ayant rien à voir avec la réalité.
Au point de vue mathématique, on sait que l'intégration du système (2) ne reproduit pas seulement le système (1), mais qu'elle donne des solutions beaucoup plus étendues, parmi lesquelles se trouve compris le système (1). Pour déterminer entièrement celui-ci, il faut donc ajouter d'autres considérations. De même L’intégration du système (4) ne reproduit pas seulement le système (3), mais elle introduit des constantes arbitraires, qu'il faut déterminer par d'autres considérations. C'est d'ailleurs un fait très général dans l'application des mathématiques aux faits concrets. Même dans les tout premiers éléments de l’algèbre, quand la solution d'un problème est donnée par une équation du second degré, il y a fort souvent une racine qui convient au problème, et l'autre qui n'y convient pas et qui doit être rejetée. Cette observation est faite ici à cause de l'objection inepte d'un auteur qui s'imagine que des équations du type (2) ne peuvent pas représenter la solution d'un problème économique parce qu'elles donnent des solutions multiples, tandis que la solution réelle ne peut être qu'unique.
Pour mieux comprendre la théorie très générale que nous venons d'exposer, on peut en étudier un cas particulier, qui est celui de la détermination de l'équilibre économique, au moyen d'un système du type (2). On le trouvera exposé dans l'Appendice du Manuel et dans l'article déjà cité de l'Encyclopédie des sciences mathématiques.
Au point de vue exclusivement mathématique, on peut changer la variable indépendante en (3) et (4), et prendre, par exemple, pour variable indépendante x, au lieu de s. En ce cas, la terminologie du langage vulgaire ferait correspondre s à l'effet et x à la cause. Un tel changement parfois est admissible et parfois ne l'est pas, car cause, dans le langage vulgaire, a d'autres caractères outre celui d'être variable indépendante ; par exemple, elle doit nécessairement être antérieure à son effet. Ainsi on peut considérer le prix de vente comme effet, et le coût de production comme cause ; ou bien invertir ce rapport et considérer le coût de production comme effet, et le prix de vente comme cause ; car en ce cas il y a une suite d'actions et de réactions, qui permettent de supposer, à volonté, que l'offre du produit précède la demande, ou que la demande précède l'offre (§2092 1). En réalité il y a une mutuelle dépendance entre l'offre et la demande ; et cette mutuelle dépendance peut, à un certain point de vue théorique, être exprimée par les équations de l'économie pure. On ne pourrait pas, au point de vue de la terminologie, invertir d'une manière analogue le rapport selon lequel on nomme cause le gel de l'eau et effet la rupture du tuyau qui la renferme, et dire que cette rupture est la cause du gel. Mais si, mettant à part la terminologie, on s'occupe seulement du rapport expérimental entre ces deux faits, supposés isolés de tous les autres, on peut parfaitement déduire l'existence de la rupture, de celle du gel, ou vice versa. En réalité, il y a une mutuelle dépendance entre la température qui fait passer l'eau à l'état solide, et la résistance du vase qui la contient. La thermodynamique, grâce au langage mathématique, exprime cette mutuelle dépendance d'une manière rigoureuse ; le langage vulgaire l'exprime d'une manière imparfaite.
[FN: § 2022-2]
Si de nombreux « économistes » ont reproduit et reproduisent encore la théorie de la monnaie-signe (Cours, §276), ce n'est pas tant à cause de leur ignorance de la science économique, que parce qu'ils sont entraînés par le désir de plaire aux gouvernements et aux partis qui font de l'émission de la monnaie un moyen subreptice de lever des impôts.
[FN: § 2022-3]
Très souvent, ils défendent leur opinion au moyen du sophisme dit de l’ignoratio elenchi. Si l'on émet des doutes sur la réalité des rapports qu'ils prétendent établir entre A et B, C, .... ils répondent que ces doutes sont le fait d'hérétiques de la religion dominante : autrefois de la religion chrétienne, de la foi monarchique, actuellement de la religion du progrès, de la foi démocratique ; ou bien le fait de mauvais citoyens, de mauvais patriotes, d'hommes immoraux, malhonnêtes, etc. Or la question n'est nullement de savoir de qui ces doutes sont le fait, mais bien de connaître si l'expérience les accepte ou les rejette.
Le sophisme disparaîtrait si l'on admettait l'identité de la réalité expérimentale et des croyances des nombreuses religions, des non moins nombreuses morales, des différents patriotismes, croyances qui souvent sont nécessairement contradictoires, des conceptions variées que les hommes ont de l'honnêteté, etc. Mais une proposition de ce genre n'est pas toujours énoncée, et quand elle l'est, on n'en donne et n'en peut donner aucune preuve expérimentale ; tandis que des preuves semblables abondent pour la proposition contraire.
[FN: § 2022-4]
Un savant de beaucoup de mérite, G. DE MOLINARI, rédacteur en chef du Journal des Économistes, ne cessait de répéter à ses collaborateurs : « Surtout, pas de politique ! »
[FN: § 2022-5]
L'auteur de ces lignes est tombé autrefois en cette erreur et doit réciter son mea culpa; mais au moins il a tâché de ne pas persévérer : errare humanum est, perseverare diabolicum.
[FN: § 2025-1]
Une première et imparfaite ébauche de la théorie qui va être exposé a été publiée par l'auteur dans ses Systèmes socialistes.
[FN: § 2025-2]
Même si l'on pouvait faire cela, il serait bon de ne pas étendre les recherches au-delà d'une certaine limite ; cela pour les motifs indiqués déjà (§540). Quand plusieurs éléments A, B, C,... P, Q, R, S, … agissent sur un phénomène, il faut d'abord avoir une idée, fût-elle grossièrement approximative, de l'action quantitative de ces éléments, puis considérer uniquement les éléments A, B,... P dont l'action est considérable, en négligeant les autres éléments Q, R,... On a ainsi une première approximation, à laquelle d'autres peuvent faire suite, s'il est quelqu'un qui veuille, qui sache, qui puisse les réaliser. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Leur ignorance a plusieurs causes, parmi lesquelles il est utile de noter les suivantes. 1° L'habitude de considérations absolues, métaphysiques, de dérivations verbales semblables à celles mentionnées, dans le cours de cet ouvrage, à propos du droit naturel ou d'autres matières similaires. Ces considérations et ces dérivations sont entièrement étrangères aux notions quantitatives des sciences expérimentales. 2° La tendance à rechercher dans l'histoire surtout l'anecdote et le jugement éthique. Un élément Q, qui a un effet presque nul sur le phénomène que l'on veut étudier, peut avoir un indice quantitatif considérable, au point de vue anecdotique ou éthique. Par exemple, à l'origine, le protestantisme a des indices anecdotiques, moraux, théologiques, considérables ; mais il eut, sur l'élite gouvernementale, un effet presque nul en France, et considérable en Prusse. On doit donc le laisser de côté, dans une étude sur l'élite gouvernementale en France, tandis qu'on en devrait tenir compte dans une étude de cette classe en Prusse. Il est des gens qui vont plus loin dans cette voie erronée, et qui font aller de pair, dans une étude de science historique ou sociale, une aventure scandaleuse de César et sa campagne des Gaules, les mauvaises mœurs, prétendues ou réelles, de Napoléon Ier et son génie militaire. Ces gens sont précisément ceux qui, durant tant de siècles, ont voulu faire croire que les grands et profonds changements sociaux avaient souvent pour origine le caprice d'un souverain, d'une favorite, ou autres semblables futilités presque ou entièrement dépourvues d'importance. Au XIXe siècle, il semblait que ces gens eussent perdu leur crédit. Aujourd'hui, ils recommencent à se manifester : et sous leur grandiloquence, ils dissimulent le vide de leurs dérivations. 3° Le préjugé d'après lequel, pour avoir la théorie d'un phénomène, il est nécessaire d'en connaître tous les détails les plus infimes. Si cela était vrai, il n'y aurait pas lieu de faire des distinctions dans la série A, B,... P, Q,... ; et ces éléments devraient tous être mis au même niveau. Une autre conséquence serait qu'aucune science naturelle n'existerait, car toutes sont dans un perpétuel devenir, et se sont constituées alors qu'on ignorait une infinité de termes de la série établie, dont tous les termes ne sont pas connus aujourd'hui et ne le seront jamais. On peut admettre ce préjugé chez les hégéliens, qui refusent le nom de science à l'astronomie de Newton ; au contraire ce préjugé devient quelque peu ridicule chez ceux qui reconnaissent la qualité de science à l'astronomie, et qui devraient savoir, ou qui devraient apprendre avant d'en parler, s'ils l'ignorent, que Newton fonda l'astronomie moderne précisément en un temps où, parmi un très grand nombre de choses alors inconnues et aujourd'hui connues, il n'y avait rien de moins que l'existence d'une grande planète, Neptune, et de beaucoup de petites. Mais les gens qui ignorent ou qui oublient les principes des sciences expérimentales lorsqu'ils traitent de sciences sociales, ont beaucoup de difficulté à comprendre ces considérations. Ainsi que nous l'avons annoncé déjà (§20), notre but est ici de constituer la sociologie sur le modèle des sciences expérimentales, et non sur celui de la science de Hegel, de Vera, ou d'autres métaphysiciens, dont nous voulons, au contraire, nous tenir aussi éloignés que possible. 4° Enfin la paresse intellectuelle, qui induit à parcourir la voie la moins rude et la moins fatigante. La fatigue qu'il faut pour rattacher à une théorie les faits importants A, B, ...P, ou même seulement pour en reconnaître l'importance, est déjà beaucoup plus grande que celle qu'exige la découverte de l'un de ces faits. Elle est aussi beaucoup, beaucoup plus grande que celle dont on a besoin pour découvrir l'un des faits Q, R,... de moindre importance. Il est même tels de ces faits que l'on connaît d'autant plus facilement qu'ils ont moins d'influence sur le phénomène considéré. Pour ajouter une observation à celles dont se servit Kepler, dans son étude sur la planète Mars, nous avons besoin d'infiniment moins de fatigue intellectuelle et de talent que pour découvrir, comme le fit Kepler, la forme approximative de l'orbite de Mars. Au temps de Newton, pour ajouter une nouvelle observation à toutes celles qu’on possédait des corps célestes, assez peu d'effort était nécessaire. Pour découvrir la théorie de la gravitation universelle, il fallait le génie d'un Newton. On endure peu de fatigue pour découvrir, en sciences sociales, quelque détail négligé par un auteur. Des encyclopédies commodes viennent en aide au vulgaire, – et nombre de personnes qui, en d'autres matières, sont des savants, en celle-ci se rattachent au vulgaire, – les textes originaux servent aux rats de bibliothèque. Celui qui étudie l'histoire suivant les principes d'une éthique dictée par son propre sentiment, et qui critique ceux qui ne suivent pas cette voie, n'endure pas beaucoup plus de fatigue. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de découvrir une théorie expérimentale qui, dans une première approximation, relie les faits les plus importants A, B,... P. Celui qui est incapable de faire cela s'occupe de quelque chose de plus facile.
[FN: § 2025-3]
On trouvera une théorie générale, dont celle-ci n'est qu'un cas particulier, dans GUIDO SENSINI ; Teoria dell' equilibrio di composizione delle classi sociali, dans Rivista italiana di Sociologia, settembre-décembre 1913.
[FN: § 2026-1]
M. KOLABINSKA ; La circulation des élites en France : « (p. 5) La notion principale du terme élite est celle de supériorité ; c'est la seule que je retiens ; je laisse entièrement de côté les notions accessoires d'appréciation et d'utilité de cette supériorité. Je ne recherche pas ici ce qui est désirable ; je fais une simple étude de ce qui existe. En un sens large j'entends par élite d'une société les gens qui ont à un degré remarquable des qualités d'intelligence, de caractère, d'adresse, de capacité clé tout genre... Par contre j'exclus entièrement toute appréciation sur les mérites et l'utilité de ces classes ».
[FN: § 2032-1]
M. KOLABINSKA ; loc. cit. §2026-1 : « (p. 6) Nous venons d'énumérer différentes catégories des individus composant l'élite ; on peut encore les classer de bien d'autres manières. Pour le but que je me propose en cette étude, il convient de diviser l'élite en deux parties : une, que j'appellerai M, contiendra les individus de l'élite qui ont part au gouvernement de l'État, qui constituent ce que l'on nomme plus ou moins vaguement, „ la classe gouvernante “; l'autre partie N sera constituée par ce qui reste de l'élite, lorsqu'on en a séparé la partie M ».
[FN: § 2044-1]
M. KOLABINSKA ; loc. cit. §2026-1 : « (p. 10) L'insuffisance du recrutement de l'élite ne résulte pas d'une simple proportion numérique entre le nombre des membres nouveaux et celui des anciens ; mais il faut faire entrer en ligne de compte le nombre de personnes ayant les qualités requises pour faire partie de l'élite gouvernementale et qui en sont repoussées ; ou bien, en un sens opposé, le nombre de nouveaux membres dont aurait besoin l'élite et qui lui font défaut. Par exemple, dans le premier sens, la production de personnes ayant des qualités remarquables d'instruction peut dépasser de beaucoup le nombre de ces personnes pouvant trouver place dans l'élite, et l'on a alors la formation de ce qu'on a appelé un prolétariat intellectuel ».
[FN: § 2048-1]
2048 1 Plusieurs auteurs, faute d'avoir cette conception générale, tombent souvent en des contradictions : tantôt l'évidence des faits s'impose à eux ; tantôt des préjugés obscurcissent leur vue. Voyez, par exemple, TAINE. Dans L'ancien régime, il note très bien (chap. III) comment l'esprit du peuple est dominé par les préjugés : en d'autres termes, comment il est sous l'empire des résidus de la IIe classe. Cela posé, il n'y a qu'à conclure que la Révolution française n'a été qu'un cas particulier des révolutions religieuses, lesquelles nous montrent la foi populaire submergeant le scepticisme des hautes classes. Mais, soit volontairement, soit à son insu, Taine cède à l'influence du principe qui fait des hommes des hautes classes les éducateurs du peuple. Il met donc, l'incrédulité, l'impiété des nobles, du tiers et du haut clergé, parmi les causes principales de la Révolution. Il note, à ce sujet, la différence entre la France et l'Angleterre, et ne paraît pas loin d'attribuer, au moins en partie, à cette circonstance, le fait que la révolution qui s'est produite en France n'a pu avoir lieu en Angleterre. « (p. 363) En Angleterre, elle [la haute classe] s'aperçoit très vite du danger. La philosophie a beau y être précoce et indigène ; elle ne s'y acclimate pas. En 1729, Montesquieu écrivait sur son carnet de voyage : „ Point de religion en Angleterre... Si quelqu'un parle de religion, tout le monde se met à rire... “ Cinquante ans plus tard, l'esprit public s'est retourné ; „ tous ceux qui ont sur leur tête un bon toit et sur leur dos un bon habit “ [en note : Mot de Macaulay] ont vu la portée des nouvelles doctrines. En tout cas, ils sentent que des spéculations de cabinet ne doivent pas devenir des prédications de carrefour [donc eux et notre auteur croient à l'efficacité de ces prédications]. L'impiété leur semble une indiscrétion ; ils considèrent la religion comme le ciment de l'ordre public. C'est qu'ils sont eux-mêmes des hommes publics, engagés dans l'action, ayant part au gouvernement, instruits par l'expérience quotidienne et personnelle ». Pourtant, quelques lignes plus haut, Taine s'était réfuté lui-même. « (p. 362) Quand vous parlez à des hommes de religion ou de politique, presque toujours leur opinion est faite : leurs préjugés, leurs intérêts, leur situation les ont engagés d'avance ; ils ne vous écoutent que si vous leur dites tout haut ce qu'ils pensent tout bas ». S'il en est ainsi, les « prédications de carrefour » dont parle Taine ne doivent pas avoir beaucoup d'efficacité ; et si elles en ont, on ne peut pas dire que les gens « ne vous écoutent que si vous leur dites tout haut ce qu'ils pensent tout bas ». En réalité, ce sont précisément ces hypothèses qui se rapprochent le plus de l'expérience. L'état d'esprit du peuple français a été très peu atteint, vers la fin du XVIIIe siècle, par l'impiété des hautes classes, pas plus que l'état d'esprit romain n'avait été atteint par l'impiété des contemporains de Lucrèce, de Cicéron, de César ; pas plus que l'état d'esprit des peuples européens, au temps de la Réforme, n'avait été atteint par l'impiété du haut clergé et d'une partie de la noblesse. J. P. BELIN ; Le commerce des livres prohibés, à Paris de 1750 à 1789 : « (p. 104) Mais on peut affirmer que les ouvrages philosophiques n'atteignirent pas directement le peuple ni la petite bourgeoisie. Les artisans, les ouvriers ne connurent Voltaire et Rousseau qu'au moment de la Révolution, quand leurs tribuns les leur commentèrent dans des discours enflammés ou réduisirent leurs maximes en textes de lois. Au moment de leur apparition, ils ignorèrent certainement les grands ouvrages du siècle, encore qu'ils n'aient pas pu être complètement indifférents au bruit des querelles littéraires les plus retentissantes. Mais les véritables disciples des philosophes, les clients fidèles des colporteurs clandestins, ce furent les nobles, les abbés, les privilégiés, mondains désœuvrés qui, en quête de distractions pour tromper leur ennui implacable, se jetèrent avec passion dans les discussions philosophiques et se laissèrent vite gagner par l'esprit nouveau [tout cela concorde avec l'expérience, ce qui suit, moins], sans voir les conséquences dernières des prémisses qu'ils adoptaient avec tant d'enthousiasme ». Notre auteur observe avec raison que : « (p. 105) Ils [les privilégiés] étaient d'ailleurs les seuls à pouvoir se permettre les dépenses excessives auxquelles était contraint tout amateur de livres prohibés ».
[FN: § 2049-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] HENRI-F. SECRÉTAN ; La population et les mœurs : « (p. 206) Une nouvelle religion ne peut naître que dans les masses, qui l'imposent à l’élite du lendemain ».
Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600 ↩
[FN: § 2062-1]
Resterait la difficulté pratique de la résolution de ces équations. Elle est si grande qu'on peut bien la qualifier d’insurmontable, si l'on veut considérer le problème dans toute son étendue. Dans le Manuel, III, § 217-218, nous avons déjà relevé le fait pour le phénomène économique, qui n'est qu'une petite partie du phénomène social. Donc, au point de vue de la résolution complète et générale du problème de la position d'équilibre, ou d'un autre problème analogue, la connaissance de ces équations ne servirait à rien. Au contraire, elle serait très utile à d'autres problèmes particuliers, comme elle l'a déjà été à l'économie pure. En d'autres termes, une connaissance même imparfaite de ces équations nous permettrait d'avoir au moins quelque idée de la solution des problèmes suivants. 1° Connaître certaines propriétés du système social, comme nous avons pu déjà connaître certaines propriétés du système économique. 2° Connaître les variations de certains éléments, à proximité d'un point réel auquel on connaît à peu près les équations du système. En somme, ce sont là les problèmes que nous nous proposons de résoudre dans ce chapitre ; et à la connaissance précise qui nous manque des équations, nous substituons la connaissance que nous pouvons avoir de leur nature et des rapports qu'elles établissent entre les éléments du système social.
[FN: § 2067-1]
Depuis que l'économie pure a considéré un état d'équilibre, beaucoup d'auteurs parlent de cet équilibre sans en avoir la moindre idée précise. Comme ils sont accoutumés à ne pas définir rigoureusement les termes qu'ils emploient, on comprend qu'ils n'éprouvent pas non plus le besoin d'une définition rigoureuse pour ce nouveau terme. Pire encore est l'attitude de ceux qui s'imaginent pouvoir apprendre par le sentiment ce qu’est cet équilibre; ils rangent ainsi ce terme dans la classe des expressions métaphysiques, où trônent le bon, le vrai, le beau, etc. De cette façon surgissent des conceptions étranges et ridicules. Inutile d'ajouter que nous employons ici ce terme uniquement comme une étiquette destinée à désigner certaines choses que nous définirons rigoureusement.
[FN: § 2068-1]
Il est des changements analogues aux changements artificiels ; ce sont les changements accidentels d'un élément qui surgit, agit pour peu de temps sur un système, y produisant une légère déviation de l'état d'équilibre, puis disparaît. Par exemple, les guerres courtes pour un pays riche, les épidémies, les inondations, les tremblements de terre et autres semblables calamités, etc. Les statisticiens avaient déjà remarqué que ces événements interrompaient pour peu de temps seulement le cours de la vie économique et sociale ; mais nombre de savants auxquels faisait défaut la notion d'équilibre, se mirent à la recherche de causes imaginaires. C'est ce qui arriva à Stuart Mill recherchant pourquoi un pays éprouvé pour peu de temps par la guerre, ne tarde pas à revenir à son état primitif. Au contraire, d'autres, comme Levasseur, invoquèrent une mystérieuse « loi de compensation » (Manuel, VII, § 79). L'équilibre d'un système social est semblable à celui d'un organisme vivant. Or, depuis des temps reculés, on a observé dans l'organisme vivant le rétablissement de l'équilibre accidentellement et légèrement troublé. Comme d'habitude, on a voulu donner une teinte métaphysique à ce phénomène, en invoquant la vis medicatrix naturae.
[FN: § 2069-1]
C'est le cas du troc entre deux individus dont l'un possède zéro de vin et une quantité donnée de pain, tandis que l'autre a zéro de pain et une quantité donnée de vin. Ce problème élémentaire a donné naissance aux théories de l'économie pure. Nous le considérons ici uniquement pour faciliter l'exposé ; mais ce que nous disons peut facilement être étendu aux problèmes beaucoup plus complexes qu'étudie l'économie pure.
[FN: § 2069-2]
Plusieurs des économistes qui commencèrent l'étude de l'économie pure se préoccupèrent seulement de déterminer la ligne aX1, sans même avertir qu'elle ne devait être considérée que dans l'unité de temps. Il ne faut pas leur en faire un reproche, parce que c'est un phénomène général dans l'évolution de toute science, que l'on commence par considérer les parties principales du phénomène, et qu'ensuite on complète les raisonnements et on leur donne plus de rigueur.
[FN: § 2069-3]
Dans l'exemple choisi, l'individu parcourt successivement les espaces aX1, bX2, ..., mais on pourrait trouver d’autres exemples où il parcourrait effectivement les espaces GX1 , X1 , X2 , X2 X3, de la ligne MP. Celle-ci serait alors, non plus la ligne qui unit les points extrêmes X1 , X2 , X3,…, qu'atteint l'individu au terme de chaque unité de temps, mais bien la ligne effectivement parcourue par l’individu. Mais, en matière économique et sociale, les phénomènes ont généralement lieu d'une manière analogue à celle des exemples indiqués dans le texte.
[FN: § 2072-1]
C'est ce que n'a pas compris ce brave homme qui, on ne sait trop pourquoi, s'imagina que l'équilibre économique était un état d'immobilité, par conséquent condamnable pour tout fidèle du dieu Progrès. Nombre de gens dissertent de même au hasard, lorsqu'ils se mettent en tête de juger les théories de l'économie pure. Le motif en est qu'ils ne se donnent pas la peine d'étudier la matière dont ils veulent traiter, et qu'ils croient pouvoir la comprendre, rien qu'en lisant à la hâte et négligemment des livres qu'ils comprennent à rebours, parce qu'ils ont l'esprit bourré de préjugés, et parce qu'ils n'appliquent pas leur attention aux froides recherches scientifiques, mais n'ont souci que de favoriser leur foi sociale. De cette façon, ils perdent d'excellentes occasions de se taire, et de ne pas révéler leur insuffisance. Plusieurs livres, opuscules, préfaces, articles, publiés depuis un certain temps sur l'économie pure, ne méritent même pas d'être lus.
[FN: § 2073-2]
Cet équilibre est évidemment un équilibre dynamique. Si la biologie était aussi arriérée que les sciences sociales, quelque savant personnage pourrait écrire un traité de biologie positive, où il exprimerait son étonnement et sa désapprobation, parce que l'on considère un état d'équilibre, c'est-à-dire d'immobilité, alors que la vie est mouvement.
[FN: § 2073-1]
Cette matière n'est pas facile. Je crois donc devoir ajouter que j'estime indispensable au lecteur désireux d'acquérir une idée claire des états sociologiques X1 , X2 , ..., et des façons possibles de les déterminer, qu'il étudie d'abord le phénomène semblable considéré par les théories de l'économie pure. Il faut procéder toujours du moins difficile au plus difficile, du plus connu au moins connu.
[FN: § 2078-1]
Il y a des auteurs qui considèrent l'économie comme une branche de la psychologie. Il y en a qui, au contraire, veulent exclure de l'économie la psychologie « individuelle », qu'ils estiment être une espèce de métaphysique, et n'entendent porter leur attention que sur les faits « collectifs » du troc et de la production. Cette question porte généralement plus sur des mots que sur des faits. Toute action de l'homme est une action psychologique : par conséquent, à ce point de vue, non seulement l'étude de l'économie, mais aussi celle de toute autre branche de l'activité humaine est une étude psychologique, et les faits de toutes ces branches d'activité, sont des faits psychologiques. La distinction que l'on veut faire pour le troc économique, entre le fait « individuel » et le fait « collectif », est puérile. Chaque être humain consomme du pain pour son propre compte, et il est ridicule d'imaginer que cent individus mangent « collectivement » du pain et s'en rassasient, tandis qu'aucun d'eux ne mange de pain et ne s'en rassasie « individuellement ». D'autre part, toutes les études de l'activité humaine, qu'on les appelle psychologiques ou non, sont des études de faits, puisque seuls les faits nous sont connus ; et la psychologie d'un être humain nous demeure inconnue tant qu'elle ne se manifeste pas par des faits. Les principes de la psychologie économique, ou de n'importe quelle autre psychologie, ne peuvent qu'être déduits des faits, comme en sont également déduits les principes de la physique, de la chimie, de l'attraction universelle, etc. Les principes une fois obtenus de cette manière, ou aussi seulement par voie d'hypothèses, on cherche leurs conséquences ; et si elles sont vérifiées par les faits, les principes sont confirmés (§ 2397 et sv.). Une vue très générale de faits usuels et communs a donné aux auteurs anglais la notion du degré final d'utilité, et à Walras celle de la rareté. Les conséquences tirées de ces principes se sont trouvées concorder à peu près avec les faits, en de certaines circonstances ; par conséquent les principes ont été estimés acceptables, entre certaines limites expérimentales. De la notion du degré final d'utilité, le prof. Edgeworth a tiré la considération des lignes d'indifférence, qui représentent de simples faits économiques. Nous-mêmes avons inverti le problème ; et de la considération des lignes d'indifférence, nous avons tiré les notions qui correspondent au degré final d'utilité, à la rareté, à l'ophélimité. Nous avons eu soin de rappeler qu'au lieu des lignes d'indifférence, on pouvait considérer d'autres faits économiques, tels que les lois de l'offre et de la demande, et en tirer la notion de l'ophélimité, dont on pouvait aussi supposer que ces faits sont des conséquences. Mais en ces déductions réciproques il faut beaucoup de précautions, que nous avons indiquées, et que semblent ignorer entièrement un grand nombre de personnes qui dissertent de cette matière, dont elles n'ont qu'une très vague connaissance. Les résidus et les dérivations que nous avons étudiés en sociologie doivent être considérés, au moins en partie, comme des notions analogues à celle de l'ophélimité en économie. L'examen des faits nous a conduits, par induction, à établir ces notions. Ensuite, parcourant la voie inverse, de ces notions nous avons tiré des conséquences. C'est parce qu'elles se sont trouvées concorder approximativement avec les faits, que les notions dont elles étaient déduites ont été confirmées.
[FN: § 2079-1]
C'est précisément pour démontrer cela que nous avons dû nous livrer à une longue étude des résidus et des dérivations. Peut-être, en la lisant, quelqu'un l'a-t-il trouvée superflue ? Elle était, au contraire, indispensable, parce que la conclusion à laquelle elle nous a conduits est aussi un fondement indispensable de la théorie que nous sommes en train d'exposer, au sujet de la forme générale de la société. En outre, comme cette conclusion diverge en nombre de points de celle qui est généralement reçue, il était nécessaire de l'étayer par un très grand nombre de faits.
[FN: § 2092-1]

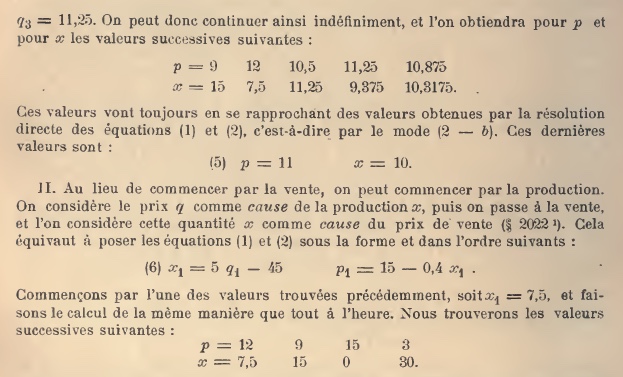
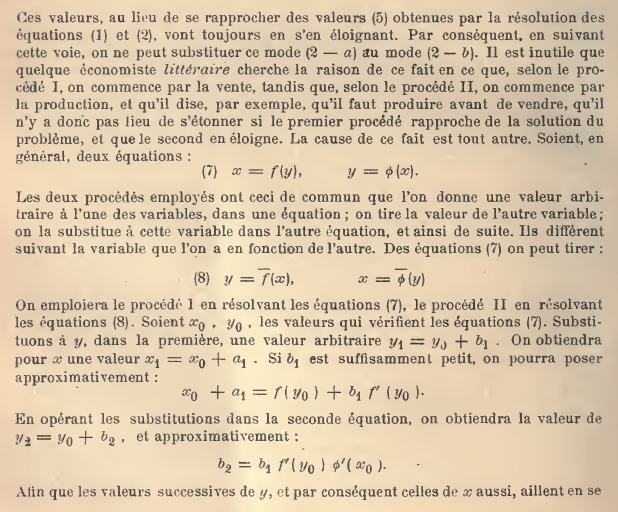
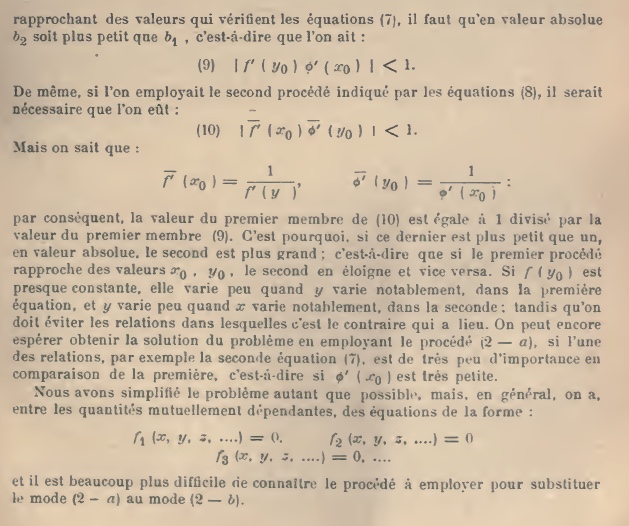
[FN: § 2096-1]
N'importe quelle proposition de modifier d'une manière quelconque l'organisation sociale existante, est en somme une proposition de modifier certaines des conditions qui déterminent cette organisation, et les recherches sur la possibilité de cette modification de l'organisation sociale sont des recherches sur la possibilité de modifier les conditions qui la déterminent. Celui qui prêche vise à modifier les résidus. On n'atteint jamais ou presque jamais ce but : mais on en atteint assez facilement un autre, qui est celui de modifier les manifestations de résidus existants. Soit une collectivité profondément mécontente de son gouvernement ; mais le mécontentement est indistinct et se manifeste de différentes façons qui, souvent, se contrecarrent. Surgit un prédicateur qui donne une forme distincte et précise à ce résidu, et qui en concentre les manifestations sur un point. De cette façon, les liaisons et les conditions sont changées, et l'organisation est formée par les nouvelles liaisons et les nouvelles conditions. Ceux qui légifèrent et font exécuter les lois se proposent parfois de modifier les résidus. En cela, ils font souvent œuvre entièrement vaine. S’ils disposent de la force, ils peuvent modifier certaines liaisons et en imposer d'autres, mais seulement en de certaines limites. Même le despote les rencontre. Il doit tout d'abord faire en sorte que ses mesures soient acceptées de ceux qui le soutiennent par la force : autrement il n'est pas obéi, ou bien il est détrôné. Pas plus qu'un gouvernement libre, un gouvernement despotique ne peut imposer des mesures qui heurtent trop les résidus existants chez ses sujets. Il ne suffit pas d'édicter une loi ; il faut la faire exécuter, et l'observation montre qu'il y a beaucoup de lois qu'on n'exécute pas, parce que la résistance qu'elles rencontrent est plus forte que la volonté de la faire exécuter. À ce point de vue, un despote a souvent beaucoup moins de pouvoir qu'un gouvernement libre, car les mesures édictées par celui-ci sont, habituellement, l'expression de la volonté d'un parti ; et par conséquent, elles trouvent beaucoup de partisans qui en surveillent l'exécution, tandis que les mesures du despote peuvent avoir peu, très peu de partisans. En certains cas particuliers, grâce à une énorme dépense d'activité et d'énergie, le despote peut bien imposer sa volonté : mais il ne peut pas le faire en des cas trop nombreux, parce que c'est une œuvre qui dépasse de beaucoup les forces d'un seul homme. C'est pourquoi, autour de lui, les gens s'inclinent, mais n'obéissent pas, et ses prescriptions demeurent lettre morte. C'est aussi ce qui arrive, en de beaucoup moindres proportions, dans les relations d'un ministre et de ses fonctionnaires. Voici un exemple qui peut servir de type. Di PERSANO ; Diario, 3e partie. Nous sommes en octobre 1860. Persano est reçu en audience par Cavour. Le dialogue suivant a lieu : « (p. 88) [Cavour] Je voudrais que vous vinssiez aujourd'hui à la Chambre. Il pourrait y avoir des interpellations, et il serait bon que vous y fussiez ; mais par votre promotion, vous avez cessé d'être député. C'est là un contretemps qui m'ennuie. – [Persano] Quelle promotion, Excellence? – Celle à vice-amiral. – Mais je n'en ai jamais été informé. – Jamais ? – Non, jamais, Excellence. – Nous ne pouvions vraiment pas nous expliquer votre silence à cet égard, et le fait que vous signiez toujours contre-amiral. Mais comment les choses se sont-elles passées depuis que nous vous avons annoncé votre promotion, lorsque vous étiez encore à Naples ? – Eh! Excellence. Ce sont les manèges habituels des subalternes ». Cavour sut tirer parti du contretemps : ce qui est précisément le fait d'un homme d'État avisé et habile. « (p. 90) [Cavour] J'ai écrit à Lanza [le président de la Chambre] de ne pas annoncer votre promotion, puisque vous ne l'avez pas reçue : ainsi vous viendrez aujourd'hui à la Chambre : on peut avoir besoin de donner quelques, explications ; il est bon que vous soyez là ». On remarquera que l'homme qui n'avait pas été obéi était Cavour, et c'était au temps où, grâce à son œuvre, le royaume d'Italie se constituait. À toutes ces liaisons, si nombreuses, si variées, si diverses, si compliquées, les adorateurs de la déesse Raison en substituent une, seule et unique : l'état des connaissances et leurs conséquences logiques. Ils s'imaginent donc que c'est par le raisonnement que se déterminent les modes et les, formes de la société, ce qui plaît beaucoup aux intellectuels, car ils sont producteurs de raisonnements, et tout producteur vante et loue sa marchandise. Ils tombent ainsi dans une erreur vraiment puérile. Négligeons le fait que d'habitude ces raisonnements sont des dérivations, et que, de ce fait, le peu d'efficacité qu'ils peuvent avoir est dû exclusivement aux résidus qui servent à dériver. Mais, quand bien même ces dérivations seraient de bons raisonnements logico-expérimentaux, elles seraient presque ou tout à fait impuissantes à modifier les formes sociales, qui sont en rapport avec bien d'autres faits beaucoup plus importants.
[FN: §2097-1]
C'est ce que font implicitement les réformateurs qui imaginent des utopies. Celui qui petit disposer à son gré des sentiments humains, peut aussi, entre les limites déterminées par les autres conditions, disposer de la forme de la société.
[FN: § 2110-1]
Dans sa préoccupation de rechercher quelle était la « meilleure république », ARISTOTE s'aperçut fort bien qu'il y avait là de tels problèmes à résoudre. Polit., VII, 2, 1 : « Il nous reste à savoir si l'on doit attribuer la même félicité à un homme qu'à la Cité, ou non. Mais évidemment chaque homme avoue qu'elle est la même. Quiconque veut qu'un particulier soit heureux, s'il est riche, admet aussi que la Cité soit heureuse, quand elle est opulente ; et celui qui vante comme heureuse la vie tyrannique, tiendra de même pour bienheureuse la Cité qui règne sur le plus grand nombre de peuples ; et s'il est quelqu'un qui veuille dire heureux un seul homme, s'il est vertueux, le même dira extrêmement heureuse la Cité, si elle est vertueuse ». Nous nous arrêtons sur ce point, c'est-à-dire que nous notons ces opinions et d'autres semblables, touchant l'état vers lequel on veut acheminer la cité, et que nous étudions des caractères communs à tous ces états. Aristote va plus loin : il détermine l'état qu'on doit préférer : (VII, 1, 1) ![]()
![]()
![]() . « Qui veut se mettre à rechercher convenablement quelle est la meilleure république doit d'abord déterminer quelle est la meilleure vie ». Ainsi, l'on sort du domaine du relatif expérimental, pour aller vagabonder dans le domaine de l'absolu métaphysique. En réalité, Aristote ne détermine pas cet absolu, parce que c'est impossible. Il ne trouve d'autre solution au problème que celle qui concorde le mieux avec ses sentiments et avec ceux des gens qui pensent comme lui ; cela avec l'adjonction habituelle, plus ou moins implicite dans les dérivations, que tout le monde pense comme lui, ou du moins devrait penser de cette façon, et de plus la tautologie suivant laquelle un homme respectable pense ainsi, car celui qui que pense pas ainsi n'est pas respectable. Mais chez Aristote, outre le métaphysicien, il y a aussi l'homme de science qui tient compte de l'expérience. Aussi, au livre IV, revient-il du domaine de l'absolu dans celui du relatif. Il remarque (IV, 1, 2) que la plupart des peuples ne peuvent pas s'organiser selon la meilleure république, et qu'il est nécessaire de trouver la forme de gouvernement adaptée aux peuples qui existent en réalité. Ensuite il ajoute excellemment (IV, 1, 3)
. « Qui veut se mettre à rechercher convenablement quelle est la meilleure république doit d'abord déterminer quelle est la meilleure vie ». Ainsi, l'on sort du domaine du relatif expérimental, pour aller vagabonder dans le domaine de l'absolu métaphysique. En réalité, Aristote ne détermine pas cet absolu, parce que c'est impossible. Il ne trouve d'autre solution au problème que celle qui concorde le mieux avec ses sentiments et avec ceux des gens qui pensent comme lui ; cela avec l'adjonction habituelle, plus ou moins implicite dans les dérivations, que tout le monde pense comme lui, ou du moins devrait penser de cette façon, et de plus la tautologie suivant laquelle un homme respectable pense ainsi, car celui qui que pense pas ainsi n'est pas respectable. Mais chez Aristote, outre le métaphysicien, il y a aussi l'homme de science qui tient compte de l'expérience. Aussi, au livre IV, revient-il du domaine de l'absolu dans celui du relatif. Il remarque (IV, 1, 2) que la plupart des peuples ne peuvent pas s'organiser selon la meilleure république, et qu'il est nécessaire de trouver la forme de gouvernement adaptée aux peuples qui existent en réalité. Ensuite il ajoute excellemment (IV, 1, 3) ![]()
![]() . « Car on ne doit pas seulement rechercher théoriquement la meilleure [république], mais aussi celle qui est possible, et qui, de même, peut être commune à toutes [les Cités]. » Il voit aussi qu'il ne suffit pas d'imaginer la meilleure république, mais qu'il faut encore trouver moyen de faire accepter la forme que l'on propose (IV, 1, 4). Pourtant il dévie aussitôt, pour la cause habituelle : il donne la prédominance aux actions logiques, et s'imagine qu'un législateur peut modeler une république à son gré. Toutefois ensuite la pratique qu'il avait de la vie politique l'oblige à ajouter « que corriger une république n'est pas une œuvre moins importante qu'en fonder une nouvelle » (IV, 1, 4).
. « Car on ne doit pas seulement rechercher théoriquement la meilleure [république], mais aussi celle qui est possible, et qui, de même, peut être commune à toutes [les Cités]. » Il voit aussi qu'il ne suffit pas d'imaginer la meilleure république, mais qu'il faut encore trouver moyen de faire accepter la forme que l'on propose (IV, 1, 4). Pourtant il dévie aussitôt, pour la cause habituelle : il donne la prédominance aux actions logiques, et s'imagine qu'un législateur peut modeler une république à son gré. Toutefois ensuite la pratique qu'il avait de la vie politique l'oblige à ajouter « que corriger une république n'est pas une œuvre moins importante qu'en fonder une nouvelle » (IV, 1, 4).
[FN: § 2111-1]
Si l'on pouvait savoir ce que les métaphysiciens veulent désigner, lorsqu'ils parlent de la « fin » d'un être humain, on pourrait prendre cette « fin » pour l'un des états X. Ensuite, toujours par analogie, on pourrait substituer à la lettre X le nom de « fin », et dire que l'état X est la « fin » vers laquelle tendent ou « doivent » tendre les individus et les collectivités. Cette « fin » peut être absolue, comme l'estiment habituellement les métaphysiciens ; mais elle pourrait aussi être relative, si on laisse au jugement de certaines personnes le soin de la déterminer. Un état qui se rapproche davantage de cette « fin » aurait un indice plus élevé qu'un autre état, qui s'en rapproche moins.
[FN: § 2113-1]
L'auteur a peut-être eu tort. Il se peut que toute conciliation soit impossible entre la manière littéraire et la manière scientifique d'étudier la sociologie. Du moment que l'on se propose d'édifier celle-ci sur le modèle de la physique, de la chimie et d'autres sciences semblables, il vaut peut-être mieux accepter franchement la terminologie que l'expérience a démontrée nécessaire en de telles sciences. Toute personne qui veut se livrer à leur étude doit se familiariser avec une foule de néologismes. Par exemple, elle doit connaître le système de mesures qui s'y emploie et savoir ce que sont les unités nommées : dyne, barye, erg, Joule, Gauss, Poncelet, etc. ; ce qui est bien autrement compliqué que de se rappeler en quel sens on emploie les termes : résidus et dérivations. Même en de simples études littéraires, il est sage de ne pas imiter les auteurs dont parle Boileau, lesquels blâment
… la métaphore et la métonymie,
Grands mots que Pradon croit des termes de chymie. (Epître X.)
Il ne faut pas confondre l'énergie mécanique avec l'énergie du langage vulgaire, ni s'imaginer que la force vive mécanique est une force qui est vivante. Pour savoir ce qu'est l'entropie, il est bon d'ouvrir un traité de thermodynamique. Quant à la chimie, c'est par centaines qu'elle emploie de nouveaux termes, et parfois on est obligé de leur donner des synonymes pour l'usage courant. C'est ainsi que le nom harmonieux d'Hexamethylenetramine est remplacé, dans les pharmacies, par le terme d'Eurotropine, qui a au moins le mérite d'être plus court. Pour étudier la chimie, il faut avoir recours à un traité de chimie ; se laisser guider par le bon sens et l'étymologie des termes ne sert absolument de rien. C'est malheureux, mais il en est ainsi. La race des chimistes littéraires n'existe pas. Pour étudier la sociologie, il faut avoir recours à un traité de cette science, et se résigner à ne pas se fier à l'étymologie ni au simple bon sens. C'est malheureux, et cela empêche la très nombreuse race des économistes et des sociologues littéraires de comprendre la science. D'ailleurs cette race se perpétuera longtemps encore, car son existence répond à une certaine utilité sociale (§ 2400 1).
[FN: § 2128-1]

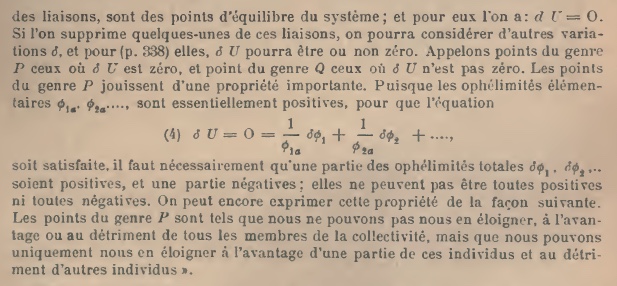
[FN: § 2129-1]
Le fait d'avoir confondu le maximum d'ophélimité pour la collectivité avec le maximum d'ophélimité de chaque individu de la collectivité, a été la cause de l'accusation de raisonnement en cercle, portée contre les démonstrations des théorèmes sur le maximum d'ophélimité pour la collectivité. En effet, dans le cas de la libre concurrence, les équations de l'équilibre économique s'obtiennent en posant la condition que chaque individu obtienne le maximum d'ophélimité ; par conséquent, si, après cela, on voulait déduire de ces équations que chaque individu obtient le maximum d'ophélimité, on ferait évidemment un raisonnement en cercle. Mais au contraire, si l'on affirme que l'équilibre déterminé par ces équations jouit de la propriété de correspondre à un point d'équilibre pour la collectivité, C'est-à-dire à l'un des points que nous avons désignés tout à l'heure par P, on énonce un théorème qui doit être démontré. Nous avons donné cette démonstration d'abord dans le Cours, puis dans le Manuel. Il faut reconnaître que l'erreur de ceux qui supposaient un raisonnement en cercle a sa source dans les œuvres de Walras, qui, en effet, n'a jamais parlé du maximum d'ophélimité pour la collectivité, mais a toujours considéré exclusivement le maximum d'ophélimité pour chaque individu. – PIERRE BOVEN ; Les applications mathématiques à l'économie politique : « (p. 111) ... Walras développe ce qu'il appelle le Théorème de l'utilité maxima des marchandises. Cette soi-disant démonstration est un illustre exemple de cercle vicieux. Qu'on en juge. Il s'agit de savoir dans quelles conditions les deux échangeurs obtiendront la satisfaction maxima de leurs besoins. Et voici d'où nous partons : „ En supposant qu'il opère l'échange de manière à satisfaire la plus grande somme totale de besoins possibles, il est certain que pa étant donné, da est déterminé par la condition que l'ensemble des deux surfaces... soit maximum. Et cette condition est que le rapport des intensités ra1 , rb1 ,des derniers besoins satisfaits par les quantités da et y, ou des raretés après l'échange, soit égal au prix pa.« Supposons-la remplie...“ Etc. (p. 77, WALRAS, Éléments). S'il est certain que cette équation s'impose, et si on l'admet comme hypothèse, il est parfaitement inutile de couvrir quatre pages de calculs, pour découvrir que : „ Deux marchandises étant données sur un marché, la satisfaction maxima des besoins, ou le maximum d'utilité effective, a lieu, pour chaque porteur, lorsque le rapport des intensités des derniers besoins satisfaits, ou le rapport des raretés est égal au prix “. (p. 112) Sans doute, il n'y a rien de faux, dans cette discussion, rien qui sape la théorie, puisque la solution trouvée est précisément l'hypothèse d'où l'on est parti ; mais il est extraordinaire que Walras ait été dupe d'une pareille illusion. On serait tenté de croire que c'est par inadvertance. Il n'en est rien. La tautologie que nous relevons a été signalée plusieurs fois à son auteur, et par les critiques les plus bienveillants ; mais Walras n'a jamais rien voulu entendre. Nous touchons ici à un fait intéressant : la violence des sentiments qui poussaient l'illustre économiste à prêcher une doctrine pratique. Il voulait à tout prix que l'intérêt de la société fût démontré mathématiquement. Il tenait à prouver que la libre concurrence était bonne et le monopole mauvais... » Ces observations n'enlèvent rien au grand mérite qu'eut Walras d'avoir, le premier, donné les équations de l'équilibre économique en un cas particulier ; de même que les critiques que l'on peut faire quant à la théorie de la lumière de Newton, ou mieux encore, à ses commentaires sur l'Apocalypse, n'enlèvent rien à l'admiration que l'on doit à l'immortel créateur de la mécanique céleste. C'est ce que ne comprennent pas ceux qui confondent le prophète avec l'homme de science. Bien entendu, les dogmes d'une religion étant réputés absolus, ils ne changent pas avec le cours des années. Au contraire, les doctrines scientifiques sont dans un perpétuel devenir, et parfois leur auteur lui-même, ensuite toujours d'autres auteurs, les modifient, les augmentent, leur donnent une forme nouvelle et même un fond nouveau. Ceux qui croient à l'Apocalypse peuvent vouloir accorder une place parmi eux à Newton; ceux qui croient à la religion humanitaire ou socialiste peuvent se démener pour faire leur profit du nom de Walras. Ces prétentions n'atteignent ni l'un ni l'autre de ces savants.
[FN: § 2131-1]
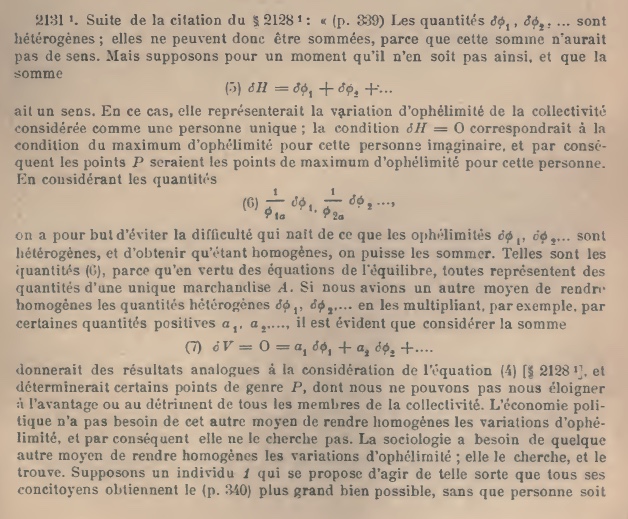
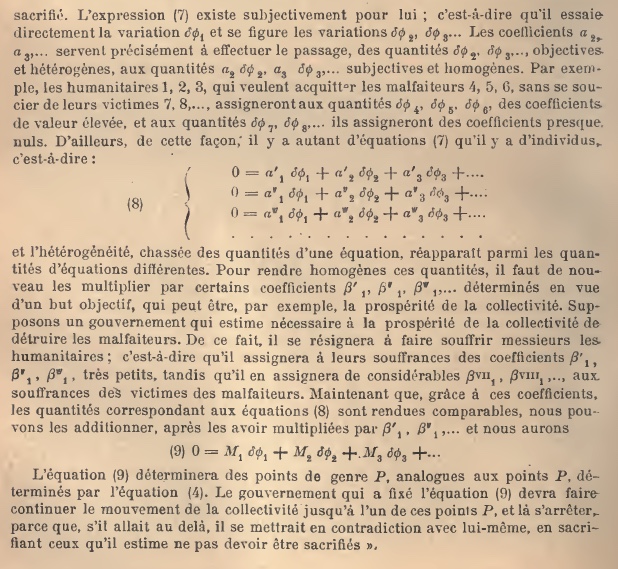
[FN: § 2131-2]
Comme d'habitude, on fait cette comparaison au moyen de dérivations, en opposant des buts idéaux plutôt que des positions réelles. Pour faire pencher la balance du côté des honnêtes gens, on dira, par exemple, que « le criminel ne mérite pas la pitié », par quoi l'on exprime, en somme, qu'il convient d'assigner à ses souffrances un coefficient nul ou presque nul. Vice versa, pour faire pencher la balance du côté du criminel, on dira que « tout comprendre serait tout pardonner », que « la société est plus responsable du crime que le délinquant » ; par quoi l'on néglige, en somme, les souffrances des honnêtes gens, en assignant à ces souffrances un coefficient voisin de zéro, et l'on fait prévaloir, au moyen d'un coefficient élevé, les souffrances du délinquant. On peut traduire d'une manière analogue un très grand nombre de dérivations dont on fait habituellement usage, en traitant de matières sociales.
[FN: § 2134-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Le fait n’a pas échappé à Malthus, et c'est l'un des motifs pour lesquels beaucoup de personnes ont porté contre lui des accusations analogues à celles dont Machiavel a été l'objet. Bien que Malthus n'eût pas encore une vue générale du problème de l'utilité en sociologie, il se rendit assez bien compte de la distinction à établir entre l'utilité de et l'utilité pour la collectivité. Une des idées maîtresses de l'Essai sur le principe de population est précisément la distinction, et parfois l'opposition de ces deux genres d'utilité, en ce qui concerne le problème de la population. Malthus s'est efforcé de montrer qu'une augmentation de la population n'est pas utile d'une façon absolue, mais qu'il y a différents points de vue à considérer, et qu'en certains cas une diminution de population peut être utile pour la collectivité.
[FN: § 2138-1]
Dans les cas de transgressions aux règles de la morale, si les transgressions sont le fait des gouvernants, il peut se présenter de nombreux cas où, pour la position des points q, t, la réalité ressemble à la figure. Si les transgressions sont le fait des gouvernés, nombreux sont les cas où la position des points q, t, est inverse de celle de la figure, c'est-à-dire que le point q est plus proche de B que le point t.
[FN: § 2142-1]
Il existe de nombreuses études concernant le darwinisme social, soit en faveur, soit contre cette doctrine, qui parfois, sans même être nommée, a inspiré des ouvrages importants, tels que ceux de G. de Molinari. Les critiques que nous adressons ici au darwinisme social ne tendent pas le moins du monde à en méconnaître l'importance. C'est d'ailleurs une obser- vation qu'il faut répéter à propos de beaucoup d'autres théories dont nous avons l'occasion de nous occuper ici (§ 41).
Ce Traité de sociologie générale n'est pas un exposé ni une histoire des doctrines sociolo- giques, philosophiques, scientifiques, ou autres quelconques. Nous ne nous en occupons qu'occasionnellement quand nous avons besoin d'exemples nous permettant de séparer les dérivations et la réalité expérimentale, ou d'éclaircir quelque point d'une recherche scientifique. Nous n'aurions nul besoin de faire cette observation si l'étude de la sociologie avait atteint le niveau des études des autres sciences logico-expérimentales. Celui qui lit Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, de H. POINCARRÉ, ne s'attend pas à y trouver un exposé ou une histoire des théories de l'astronomie, depuis le temps d'Hipparque jusqu'à notre époque ; et celui qui lit les Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne, de PAUL TANNERY, ne s'attend pas à y trouver un traité de mécanique céleste.
Dans notre essai sur Les systèmes socialistes, nous avons tâché de faire une étude des dérivations connues sous le nom de ces systèmes. Un critique a observé que l'auteur s'était arrêté à la forme, sans arriver jusqu'au fond ; il est parti de là pour adresser un blâme sévère à l'ouvrage. L'observation est juste, le blâme est mérité, tout autant que celui qu'on pourrait adresser à Paul Tannery, pour ne pas avoir mis un traité de mécanique céleste dans son livre que nous venons de citer. L'imperfection des Systèmes socialistes est d'un tout autre genre que celui visé par ce blâme ; elle est surtout la conséquence du fait que l'auteur ne possédait pas alors la théorie des dérivations, théorie qu'il a développée dans le présent Traité ; il l'a appliquée par anticipation, sans en avoir encore une conception bien rigoureuse, et il en est résulté un certain flottement. On devrait maintenant refondre cette étude, en tenant compte des théories plus précises que nous venons d'exposer. Il serait très utile d'avoir d'autres études de ce genre, sur les doctrines politiques, philosophiques et autres, en somme sur les diverses manifestations de l'activité intellectuelle des hommes, lesquelles, avec les doctrines des systèmes socialistes, constituent le vaste ensemble des doctrines sociales. Ici, c'est de propos délibéré que nous ne nous en sommes pas occupé.
De ce fait, il ne faudrait pas tirer la conclusion que nous avons l'absurde présomption de ne rien devoir à ces doctrines telles qu'on les a exposées jusqu'à présent (§ 41) ; autant vaudrait dire qu'un homme de l'âge de la pierre était en mesure de disserter sur un sujet scientifique, tout aussi bien qu'un homme cultivé vivant dans une société intellectuellement aussi avancée que la nôtre. L'influence d'une doctrine sur une autre ne se fait pas seulement sentir dans les concordances, elle apparaît aussi dans les divergences. Aristote doit quelque chose à Platon, même lorsqu'il le critique ; sans la géométrie euclidienne, nous n'aurions probablement pas eu les géométries non-euclidiennes. La théorie de Newton, sur l'attraction universelle, n'aurait probablement pas existé, sans les théories antérieures qu'elle contredit. Quelle a été sur l'esprit de Newton l'influence de ces théories, et quelle a été celle de l'expérience directe ? Nous l'ignorons, et Newton n'en savait pas plus que nous ; peut-être en savait-il moins. Bien fin serait celui qui saurait faire la part des influences extrêmement nombreuses et variées qui agissent sur un auteur : même et surtout celui-ci ne s'en rend pas bien compte. Ce sont là d'ailleurs des recherches qui peuvent être intéressantes au point de vue psychologique ou anecdotique, mais qui n'ont que peu d'importance pour l'étude logico- expérimentale des lois des phénomènes sociaux.
[FN: § 2145-1]
Ajoutons qu'en envisageant uniquement le point de vue objectif, le terme meilleur a besoin de définition (§ 2110-1), c'est-à-dire qu'il faut énoncer ce que signifie précisément ce nom. Cela revient à fixer quel état on veut exactement considérer parmi tous ceux que désigne X au § 2111. L'équivoque signalée tout à l'heure, des réformateurs, et un grand nombre d'autres semblables proviennent du fait que l'on croit à l'existence d'un état unique X, tandis qu'il y en a un nombre infini.
[FN: § 2147-1]
BASTIAT ; Oeuvres complètes, t. V, p 43-63. Le rabot. On suppose deux menuisiers, nommés Jacques et Guillaume. Jacques fait un rabot : Guillaume le lui emprunte, et, en échange de ce « service », consent à lui donner l'une des planches faites avec le rabot.
[FN: § 2147-2]
BASTIAT ; Œuvres compl., t. V. Gratuité du crédit, lettre de Bastiat : (« p. 119) Voilà un homme qui veut faire des planches. Il n'en fera pas une dans l'année, car il n'a que ses dix doigts. Je lui prête une scie et un rabot, – deux instruments, ne le perdez pas de vue, qui sont le fruit de mon travail et dont je pourrais tirer parti pour moi-même. – Au lieu d'une planche, il en fait cent et m'en donne cinq. Je l'ai donc mis à même, en me privant de ma chose, d'avoir (p. 120) quatre-vingt-quinze planches au lieu d'une, – et vous venez dire que je l'opprime et le vole ! Quoi ! grâce à une scie et à un rabot que j'ai fabriqués à la sueur de mon front, une production centuple est, pour ainsi dire, sortie du néant, la société entre en possession d'une jouissance centuple, un ouvrier qui ne pouvait pas faire une planche en a fait cent : et parce qu'il me cède librement et volontairement, un vingtième de son excédent, vous me représentez comme un tyran et un voleur ! »
[FN: § 2147-3]
Loc. cit., § 2147 2 : « (p. 133) Bastiat à Proudhon. Monsieur, vous me posez sept questions. Veuillez vous rappeler qu'entre nous il ne s'agit en ce moment que d'une seule : „ L'intérêt du capital est-il légitime ? “ (p. 148) Proudhon à Bastiat. Vous demandez : „ L'intérêt du capital est-il légitime oui ou non ? Répondez à cela. sans antinomie et sans antithèse “. Je réponds : „ Distinguons, S'il vous plaît. Oui, l'intérêt du capital a pu être considéré comme légitime dans un temps : non, il ne peut plus l'être dans un autre “ ».
[FN: § 2147-4]
La polémique avait lieu en 1849, en un temps d'effervescence républicaine. Loc. cit. § 2147-1. Proudhon à Bastiat : « (p. 120) La révolution de Février a pour but, dans l'ordre politique (p. 121) et dans l'ordre économique, de fonder la liberté absolue de l'homme et du citoyen. La formule de cette Révolution est, dans l'ordre politique, l'organisation du suffrage universel, soit l'absorption du pouvoir dans la société ; – dans l'ordre économique, l'organisation de la circulation et du crédit, soit encore l'absorption de la qualité de capitaliste dans celle de travailleur. Sans doute, cette formule ne donne pas, à elle seule, l'intelligence complète du système : elle n'en est que le point de départ, l'aphorisme. Mais elle suffit pour expliquer la Révolution dans son actualité et son immédiateté ; elle nous autorise, par conséquent, [cette conséquence vaut un Pérou], à dire que la Révolution n'est et ne peut être autre chose que cela ».
[FN: § 2147-5]
Loc. cit. § 2147-1. Proudhon à Bastiat : « (p. 125) D'un côté, il est très vrai, ainsi que vous l'établissez vous-même péremptoirement, que le prêt est un service. Et comme tout service est une valeur [que veut dire cela ?], conséquemment comme il est de la nature [affirmation gratuite] de tout service d'être rémunéré, il s'ensuit que le prêt doit avoir son prix, ou, pour employer le mot technique, qu'il doit porter intérêt ».
[FN: § 2147-6]
Cela se voit bien dans tous les ouvrages, tant de Bastiat que de Proudhon. Pour le pre- mier, la citation suivante suffira. BASTIAT ; Œuvr. compl., t. VI. Harmonies économiques. Richesse : « (p. 201) Il faut d'abord reconnaître que le mobile qui nous pousse vers elle [vers la richesse] est dans la nature [bravo ! Et le motif qui pousse au crime n'est-il pas aussi dans la nature ?] ; il est de création providentielle [qu'est-ce que cela ?] et par conséquent moral. Il réside dans ce dénuement primitif et général, qui serait notre lot à tous, s'il ne créait en nous le désir de nous en affranchir. – Il faut reconnaître, en second lieu, que les efforts que font les hommes pour sortir de ce dénuement primitif, pourvu qu'ils restent dans les limites de la justice [mais c'est précisément sur ces limites qu'il y a discussion entre ceux qui affirment, et ceux qui nient que le capitaliste qui reçoit une partie du produit dépasse ces limites] sont respectables et estimables, puisqu'ils sont universellement estimés et respectés [dérivations de la IIe classe]. Il n'est personne d'ailleurs qui ne convienne que le travail porte en lui-même un caractère moral... Il faut reconnaître, en troisième lieu, que l'aspiration vers la richesse devient immorale quand elle est portée au point de nous faire sortir des bornes de la justice [mais qui les fixe ? elles sont évidemment différentes pour qui affirme que la propriété c'est le vol, et pour qui dit que la propriété est légitime]... Tel est le jugement porté, non par quelques philosophes, mais par l'universalité des hommes [ceux qui ne sont pas de l'avis de Bastiat ne sont donc pas des hommes ?], et je m'y tiens ». Que de discours pour arriver à exprimer son sentiment ! Il pouvait le manifester sans autre, et voilà tout.
[FN: § 2147-7]
C'est le but de toute l'œuvre de Bastiat. Il y vise surtout dans les Harmonies économiques. Beaucoup d'autres auteurs ont aussi écrit pour démontrer l'identité des conclusions de l'économie et de la « morale ». Proudhon démontre que ses conceptions économiques sont une conséquence de la « justice ». Chez presque tous les auteurs, cette identité s'établit non entre l'économie et la morale du monde réel, mais entre une économie et une morale futures, telles qu'elles se réaliseront suivant les idées de l'auteur, ou telles qu'elles seront déterminées par l'évolution et au terme, fort peu connu, il est vrai, de cette évolution. Habituellement, l'identité obtenue de cette façon paraît évidente, car on suppose implicitement que l'économie et la morale doivent être ou seront des conséquences logiques de certaines prémisses, et il est incontestable que les diverses conséquences logiques des mêmes prémisses ne peuvent être en désaccord. Les théories de l'organisation providentielle de la société, des causes finales, du darwinisme social et autres semblables, aboutissent aux mêmes conclusions.
[FN: § 2147-8]
Loc. cit. § 2147-1 : « p. 46) J'affirme d'abord que le Sac de blé [autre exemple analogue à celui du rabot] et le rabot sont ici le type, le modèle, la représentation fidèle, le symbole de tout Capital, comme les cinq litres de blé et la planche sont le type, le modèle, la représentation, le symbole de tout intérêt ».
[FN: § 2147-9]
Parfois l'on croit résoudre le problème, au point de vue de l'utilité, en disant : « L'héritage est utile, parce qu'il pousse les hommes à être économes et à ne pas dilapider leur patrimoine ». Même si l'on accepte cette affirmation à titre d'hypothèse, le problème est résolu qualitativement et non quantitativement. Il reste, en effet, à considérer toutes les autres utilités, et à voir quelle est la résultante. De plus, en pratique, les droits fiscaux toujours plus lourds que l'on impose aux successions vont à l'encontre du principe énoncé tout à l'heure. Et là nous nous trouvons en présence d'une autre séparation de phénomènes, que veulent effectuer un grand nombre d'économistes, en mettant à part et en dehors de leur raisonnement les droits fiscaux ; par quoi l'on aboutit à une simple question de mots. Pourvu que l'hérédité subsiste de nom, si les droits fiscaux la suppriment presque en entier de fait, l'économiste s'incline avec respect et ne dit rien. De même, un grand nombre sont opposés à un droit protecteur sur les grains, et n'ont rien à objecter à un droit dit fiscal dont l'effet est en réalité identique. Ces dérivations sont favorisées par le désir qu'ont beaucoup d'économistes de ne pas se mettre en opposition avec leur gouvernement. Ils acceptent avec révérence ses décisions fiscales et politiques, demandant seulement de pouvoir argumenter sur leurs théories abstraites. Les socialistes échappent à cette cause d'erreurs, grâce à leurs démêlés avec les gouvernements ; ils refusent dédaigneusement de séparer des parties sociales, politiques, fiscales, la partie économique des phénomènes ; et, en cela, ils se rapprochent de la réalité plus que les économistes mentionnés tout à l'heure.
[FN: § 2147-10]
Il est nécessaire de rappeler ici l'observation faite au § 75. Dans un écrit où l'on fait usage de dérivations, on peut bien supposer implicites les propositions qui s'y trouvent habituellement sous cette forme ; c'est pourquoi si l'auteur démontre qu'il est absurde de tirer une conclusion Q des prémisses P, il est permis, en de très nombreux cas, d'admettre qu'il juge absurde aussi la conclusion Q. il n'en est pas ainsi dans un écrit qui vise à être exclusivement scientifique : il n'y a rien à supposer ; il n'y a pas à aller au-delà de l'affirmation que le raisonnement qui unit P à Q ne se soutient pas, puisque Q peut exister indépendamment de ce raisonnement. Si quelqu'un disait : « La circonférence du cercle ne peut avoir de commune mesure avec son diamètre, parce qu'elle n'a pas d'angles », et si quelqu'un d'autre observait que cette démonstration ne tient pas debout, il ne faudrait nullement croire que cette personne affirme ainsi que la circonférence a une commune mesure avec son diamètre. On peut donner une démonstration fausse d'un théorème vrai.
[FN: § 2147-11]
En outre, dans l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme et le sémitisme jouèrent certainement un rôle considérable, mais beaucoup moins qu'il ne paraît à première vue et qu'un grand nombre de personnes le croient encore, car, en plusieurs cas antisémitisme et sémitisme n'étaient que le voile d'autres sentiments et d'intérêts. En effet, on remarquera que l'antisémitisme et le sémitisme n'étaient vraiment pour rien dans les faits de Saverne : ils leur étaient absolument étrangers ; pourtant tous les journaux dreyfusards, d'un commun accord, se montrèrent hostiles aux autorités militaires allemandes. Cela prouve avec, évidence qu'outre le sentiment qui, pouvait exister chez quelques-uns d'entre eux, à l'égard de Dreyfus en tant que sémite, il y avait aussi d'autres sentiments, d'autres intérêts, communs à eux tous, et qui les poussaient à prendre le parti de Dreyfus, de même qu'ils les poussèrent à se montrer hostiles aux autorités militaires, dans les faits de Saverne. C'est là ce qu'il y a de commun entre l'affaire Dreyfus et les faits de Saverne. Voyons maintenant les différences, qui proviennent surtout des diverses organisations sociales et politiques de la France et de l'Allemagne. Ces différences sont bien exprimées dans l'article suivant de la Gazette de Lausanne, 26 janvier 1911 : « Quand éclata l’affaire de Saverne, il se trouva dans toute l'Europe des journaux libéraux pour annoncer que l'Allemagne allait avoir son „ affaire Dreyfus “. C'était bien mal connaître l’Allemagne. De longtemps, „ une affaire Dreyfus “ est impossible en Allemagne, bien que le militarisme y soit autrement puissant et envahissant qu'il n'était en France dans les dernières années du siècle dernier. C'est la Chambre des députés française qui naguère amorça l'affaire. Or, le Reichstag le voudrait-il que les pouvoirs lui manquent pour provoquer autour des jugements de Strasbourg l'agitation révisionniste qui naguère aboutit si complètement en France. An surplus, la majorité du Reichstag paraît déjà fatiguée de son attitude opposante. Nationaux-libéraux et membres du centre ne demandent qu'à revenir du côté du manche. Demain, ce sera chose faite. Devant la débandade des partis bourgeois jetant leurs fusils, le Vorvœrts écrivait très justement samedi dernier : „ Force et lutte, voilà deux mots qui n'existent pas dans le dictionnaire de la bourgeoisie allemande “. Cette classe, docile entre toutes, respectueuse et timide, ne demande au fond qu'à se laisser mener par les dépositaires de la force, par ceux que Guillaume II appelle „ les meilleurs de la nation “. Telle la femme de Sganarelle, la bourgeoisie d'outre-Rhin trouve douces les violences qui lui viennent de son supérieur hiérarchique. Il faut la funeste puissance d'illusion d'un Jaurès, il faut se repaître de chimères comme fait le directeur de l'Humanité, cet internationaliste aveuglé sur les questions internationales, pour croire à la mission du Reichstag, à son influence sur les destinées allemandes. Saluer dans les événements dont l'Allemagne vient d'être le théâtre un gage de paix entre la France et l'Allemagne, c'est sacrifier à une dangereuse erreur. Nombre de socialistes français, encore imbus de l'esprit de la Révolution de quarante-huit, partagent cette illusion. Elle peut devenir funeste non seulement à la France, mais à toute l'Europe ». Au contraire, un bon dreyfusard écrivait de Paris à son journal ; « Naturellement on suit ici avec un intérêt extrêmement vif les événements politiques allemands. On se réjouit de constater que l’immense majorité de l'opinion s'insurge contre un militarisme brutal. Peut-être même d'aucuns s'exagèrent-ils un peu les conséquences heureuses qui pourraient résulter, en ce qui concerne les relations franco- allemandes, de ce conflit entre ce que le Temps appelle les deux Allemagne ». Bien plus qu'« exagéré », l'effet de l' « immense majorité de l’opinion allemande » fut à peu près nul.
[FN: § 2147-12]
Ce fait est absolument nié dans les dérivations auxquelles l'affaire Dreyfus continue à donner lieu. Les dreyfusards accusent leurs adversaires d'avoir été mus exclusivement par le désir de faire condamner un innocent. À leur tour les anti-dreyfusards accusent leurs adversaires d'avoir été mus exclusivement par le désir de sauver un traître. Passons sur le fait que, d'une manière implicite, on suppose ainsi résolue précisément la question sur laquelle on discute. En effet, parmi les anti-dreyfusards, il y avait certainement des personnes qui tenaient Dreyfus pour un traître, et l'on pouvait bien les accuser d'avoir une opinion fausse, mais non de vouloir faire condamner un innocent ; et vice versa pour les dreyfusards. Mais, dans ces accusations, on néglige un fait beaucoup plus important, au point de vue scientifique : on ignore on l'on feint d'ignorer que, tant parmi les dreyfusards que parmi les anti-dreyfusards, il y avait des personnes qui laissaient de côté la question de savoir si Dreyfus était innocent ou coupable. Elles raisonnaient à peu près ainsi : « Le procès Dreyfus est désormais devenu une bannière, laquelle guide vers un but qui, si on l'atteint, sera nuisible, disaient les anti-dreyfusards, – utile, disaient les dreyfusards, – au pays, ou seulement à notre parti. S'opposer à ces raisonnements au nom de la légalité, du respect de la chose jugée ou de quelque autre principe, suppose résolus les très graves problèmes auxquels il est fait allusion, § 1876 et sv. Les croire résolus, seulement par l'indignation que provoque la condamnation d'un « innocent » est puéril, à moins que l'on ne veuille atteindre à l'extrême de l'ascétisme, et se refuser à toute défense de sa patrie, parce que la guerre envoie à la mort des milliers et des milliers d' « innocents ».
[FN: § 2147-13]
Bismarck tourne fort bien en dérision l'usage de semblables entités en politique. BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. II : « (p. 196) En 1877, quand la guerre russo-turque était imminente, l'Angleterre nous poussait à nous servir de notre influence à Saint-Pétersbourg pour empêcher les hostilités. Le Times nous démontrait que c'était dans l'intérêt de l'humanité ! La reine Victoria tâchait de poser sur le vieil empereur : elle lui écrivait une lettre qu'elle lui faisait remettre par Augusta ; elle m'écrivait à moi [Bismarck], deux lettres coup sur coup pour me conjurer d'intervenir. L'humanité, la paix, la liberté, voilà les mots qu'ils ont à la bouche et qui leur servent de prétextes quand ils n'ont pas affaire à des peuplades sauvages et qu'ils ne peuvent pas invoquer les bienfaits de la civilisation. [C'est pour avoir ajouté foi à ces belles phrases que Napoléon III, E. Ollivier, J. Favre, J. Simon, etc., ont causé la ruine de leur pays ; c'est pour n'y avoir prêté aucune attention que Bismarck a rendu le sien grand et puissant.] C'est au nom de l'humanité que la reine Victoria voulait nous faire prendre en main les intérêts de l'Angleterre, qui n'avaient rien de commun avec les nôtres. C’est au nom de la paix qu'elle cherchait à nous brouiller avec la Russie ! »
[FN: § 2147-14]
BUSCH : Les mém. de Bismarck, t. 1 « (p. 78) Il [Bismarck] me fit ensuite observer que, lorsque les officiers saluaient notre voiture, je n'avais pas, moi [Busch], à leur rendre leur salut. (p. 79) Moi-même, ce n'est pas comme ministre ou comme chancelier qu'on me salue, mais bien comme officier général. Sachez donc que des soldats pourraient s'offenser à bon droit qu'un civil prenne leur salut pour lui ».
[FN: § 2147-15]
On peut voir cela aux dérivations dont on fait usage dans les parlements latins, en toute occasion où a éclaté un conflit entre la force publique et des grévistes ou des manifestants (§ 2147-18) ; c'est le vrai moyen de ceux qui veulent faire et ne pas dire. Au contraire, les syndicalistes mettent d'accord les faits et les paroles, et se rapprochent ainsi beaucoup plus de la réalité. Ils disent qu'ils veulent faire emploi de la force, parce qu'ils sont en guerre avec la bourgeoisie. En vérité, à cet emploi de la force, il n'y a qu'à opposer un autre emploi de la force en sens inverse, et non des argumentations vaines et non concluantes comme font les « spéculateurs ». Ceux-ci, du domaine où l'on fait usage de la force et où ils savent être ou craignent d'être inférieurs à leurs adversaires, s'obstinent à vouloir les attirer dans le domaine où l'on fait usage de la ruse, et dans lequel ils savent de toute certitude que personne ne peut se mesurer avec eux.
[FN: § 2147-16]
Après les incidents de Saverne et les discussions auxquelles ils donnèrent lieu au Reichstag, une ligue se constitua, à Berlin, pour défendre l'organisation prussienne. Journal de Genève, 21 janvier 1914 : La nouvelle Ligue prussienne (Preussenbund) a tenu hier à Berlin sa première assemblée. Cette association se propose de maintenir et d'assurer dans l'empire l'hégémonie de la Prusse et surtout la prépondérance en Allemagne des aspirations prussiennes, des méthodes prussiennes et des manières de penser prussiennes. Sa tendance est essentiellement conservatrice. Son but est la réaction contre la démocratisation lente de l'empire. L'affaire de Saverne a réussi, entre autres conséquences indirectes, à mettre en opposition la Prusse et l'empire. La Ligue prussienne est sortie de ce conflit. Les adhérents se recrutent parmi les hauts fonctionnaires, les officiers, les députés conservateurs et les membres de la Ligue des agriculteurs. Bien des symptômes se sont manifestés au cours des dernières semaines, qui permettent de penser qu'en haut lieu on regarde d'un œil favorable la constitution de la Ligue prussienne : „ Les discours prononcés à l'assemblée d'hier méritent d'être lus avec attention. Ils sont fort caractéristiques, dit le Temps, d'un certain état d'esprit qui règne à cette heure dans les plus hautes sphères du pouvoir “. M. Rocke, président de la chambre de commerce de Hanovre, prononça l'allocution d'ouverture : „ La Prusse, dit-il, est le rempart de l'empire. Cet empire ne doit donc pas se développer aux dépens de la Prusse “. M. de Heydebrandt prit ensuite la parole : „ Bien des gens, dit-il, se demandent si le moment n'est pas venu de défendre en Allemagne la Prusse, son esprit, ses manières d'être. Quel est le trait caractéristique du Prussien ? C'est l'esprit d'ordre, le sentiment du devoir, l'amour de son armée, la fidélité, envers la dynastie. Ce serait une catastrophe sans lendemain si cet esprit prussien cessait de dominer “. Le général de Wrochen fait l’éloge du colonel de Reuter : „ Le rôle du colonel de Reuter a été pour tous un réconfort. Il s'est conduit en Prussien de vieille roche. Nous aurons de tels hommes tant que l'armée continuera d'être monarchiste. Le jugement du 10 janvier fut un soufflet bien mérité à ceux qui avaient parlé trop haut “. Le général de Rogge lui succéda à la tribune. Il déplora les tendances démocratiques de l'empire : „ La mission de la Prusse, dit-il, n'est pas terminée. Il est nécessaire d'infuser au sang allemand une bonne dose de fer prussien “. Un surintendant ecclésiastique, M. de Rodenbeck, a déclaré que la mission de la Prusse comme tutrice de l'Allemagne était voulue par la Providence. Il s'est répandu ensuite en reproches contre les gens du bord du Rhin, „ à qui le vin donne trop d'esprit “. À la fin de la séance, l'assemblée accepta à l'unanimité la résolution suivante : „ La première assemblée de la Ligue prussienne estime que certaines tendances de notre temps cherchent à affaiblir par une démocratisation croissante de nos institutions les fondements de la monarchie. La Prusse ne peut accomplir sa mission allemande que si elle est forte et que si elle est libre de toutes entraves que pourrait lui imposer une trop étroite union avec l'empire. On doit repousser avec énergie tous les assauts de la démocratie contre la Prusse et contre l'indépendance des États confédérés. Il est donc impérieusement nécessaire que tous ceux qui veulent défendre la Prusse contre les attaques de la démocratie s'unissent et travaillent d'un commun accord “ ».
[FN: § 2147-17]
Le 4 décembre 1913, le Reichstag, après discussion sur les incidents de Saverne, approuvait par 293 voix contre 5 un ordre du jour de blâme au chancelier de l'Empire. Celui- ci ne se le tint nullement pour dit et resta à son poste ; l'organisation de l'armée n'éprouva pas la moindre, la plus légère secousse. Le 2 décembre, la Chambre française rejetait par 290 voix contre 265 la proposition Delpierre, acceptée par le ministre, d'inscrire sur les titres de rente à émettre l'immunité fiscale de la rente, et le ministère tomba. La véritable cause de sa chute était qu'il avait voulu renforcer l'armée, et qu'il avait fait approuver la loi qui, de deux ans, portait à trois ans le service militaire. C'est pourquoi, à l'annonce du résultat de la votation, le député Vaillant, illustre antimilitariste, put crier : « À bas les trois ans ! » Voici comment la Gazette de Lausanne, 3 décembre 1913, résume les opinions des journaux français, à re sujet : « La Petite République écrit : „ En saluant le départ des ministres du cri de À bas les trois ans ! M. Vaillant a souligné d'une façon bien humiliante pour plusieurs la signification du vote “. – L'Éclair dit qu'une partie de la Chambre a voulu se venger du vote de la loi de trois ans en refusant l'argent sans lequel l'effort de reconstitution militaire est irréalisable. – Le Matin dit que les adversaires de M. Barthou lui rendront cette justice que sur la question du crédit de la France, il est tombé avec honneur. Le Matin prévoit que le nouveau cabinet sera un ministère d'entente et d'union républicaine. – Le Gaulois dit que la victoire de M. Caillaux, c'est la revanche du bloc sur le congrès de Versailles. Demain peut- être ce sera sa revanche contre l'élu de ce congrès. – La République française réprouve le cri de À bas les trois ans ! Mais, dit-elle, il est logique que ceux qui n'ont pas craint d'exposer la France à la ruine, la désarment devant l'invasion. – L'Action se demande combien de temps durera la coalition de la démagogie révolutionnaire avec la ploutocratie radicale qui vient de renverser M. Barthou aux cris de À bas les trois ans ! – L'Écho de Paris dit que ce n'est pas seulement contre le crédit public que les radicaux ont commis une faute impardonnable en marchant la main dans la main avec les unifiés, c'est encore contre la force nationale. S'il est vrai qu'une nouvelle majorité doit se former, c'est contre la France qu'elle se formera. – Le Journal remarque que les adversaires de la loi de trois ans se sont retrouvés groupés contre la réforme électorale et contre l'immunité de la rente. – La Libre Parole dit que le partage des dépouilles est l'unique souci de la majorité d'hier. Aux chefs on offre les portefeuilles ; aux uns la réforme électorale est jetée en pâture, aux autres la loi de trois ans. – L'Homme libre écrit : ,, Toute faute se paie. Une longue série de défaillances politiques a causé des difficultés financières qui ne peuvent être résolues que si tous les républicains reviennent à la discipline et à l'abnégation “ ». La conséquence fut que l'armée et la marine retombèrent sous la direction de ministres qui cherchaient beaucoup plus à contenter une clientèle démagogique qu'à préparer la défense de la patrie.
[FN: § 2147-18]
Un autre exemple de dérivations très usitées est le suivant. Le but de chacun des partis aux prises est d'obtenir des avantages et de soigner ses intérêts, même en agissant à l'encontre des règles généralement acceptées, que l'on veut feindre de respecter. Voici comment on s'y prend. – Du côté des révolutionnaires : Premier acte. Tandis que se produit le conflit entre eux et la force publique. Celle-ci ne doit pas faire usage de ses armes ; elle doit laisser faire le « peuple », les grévistes, les rebelles. Si jamais – par hypothèse – il arrive aux révolutionnaires de commettre des délits, il y a des tribunaux pour les juger. La force publique doit uniquement les conduire devant le tribunal ; il ne lui est pas permis de faire autre chose En tout cas, ces délits, ou du moins la majeure partie d'entre eux, ne méritent certainement pas la peine de mort, laquelle serait, au contraire, infligée à celui qui aurait été frappé par les armes de la force publique. À qui jette des pierres, on ne peut opposer des coups de fusil. [On a vu, en Italie, des gendarmes auxquels il était défendu de faire usage de leurs armes, ramasser les pierres que leur avaient jetées les grévistes, et s'en servir pour se défendre de la lapidation.] En somme, la force publique ne peut qu'opposer une résistance patiente et passive. Avec de telles dérivations s'affaiblissent les sentiments de ceux qui supporteraient difficilement l'impunité totale des grévistes ou d'autres révolutionnaires qui frappent, parfois tuent et saccagent. Deuxième acte. Après le conflit. Désormais, ce qui est fait, est fait. Une amnistie est nécessaire (la grâce est trop peu de chose), pour effacer tout souvenir de discordes civiles, pour pacifier les esprits, par amour pour la patrie. La mémoire du public n'est pas longue ; il a bientôt oublié les crimes commis ; celui qui est mort, est mort, et celui qui est vivant fait à sa guise ; il tâche d'avoir la paix, et mieux encore de gagner de l'argent, sans trop se soucier du passé ni de l'avenir ; aussi se contente-t-il de ces dérivations, qu'il fait siennes à l'occasion. – Troisième acte. Les conséquences. Les délits n'ont pas été, empêchés ni réprimés par la force, parce que la répression « devait » être effectué par les tribunaux. Ceux-ci ne l'ont pas accomplie, grâce à l'amnistie. Reste uniquement l'impunité pour le passé et une promesse d'impunité semblable pour l'avenir. Tel était précisément le but auquel on tendait par les dérivations. – Du côté des gouvernants. Premier acte. Tandis qu'on veut imposer quelque chose par la force. Ce n'est pas le moment de décider si cette chose est légale ou non, juste ou injuste. Que le citoyen obéisse, et ensuite, s'il croit avoir raison, qu'il s'adresse aux tribunaux. Cette dérivation et d'autres semblables satisfont le sentiment de ceux auxquels il répugnerait trop de consentir à des actes arbitraires et des injustices au détriment des citoyens. Il ne peut y avoir d'arbitraire ni d'injustices, puisque enfin les tribunaux demeurent juges du fait. – Second acte. Après le fait accompli. Si quelque naïf suit le conseil qu'on lui a donné et s'adresse aux tribunaux, il s'entend répondre qu'ils ne sont pas compétents, et qu'il doit recourir à l'autorité, laquelle est seule juge des faits et gestes de ses agents. Et s'il pousse la naïveté jusqu'à suivre cette voie, il apprend à ses dépens que les loups ne se mangent pas entre eux, et tout est dit. Il en doit être ainsi pour sauvegarder la majesté du gouvernement, le respect de la loi, l'ordre public. La raison d'État doit l'emporter, de droit ou de force, sur les intérêts particuliers. Ces dérivations sont acceptées par le sentiment de ceux qui estiment que le pouvoir public ne doit pas être entravé par le caprice de quelques citoyens, et par ceux qui savent combien il importe, à l'utilité sociale que l'ordre soit maintenu. – Troisième acte. Les conséquences. La classe gouvernante a pu commettre impunément actes arbitraires et injustices ; elle pourra les renouveler quand bon lui semblera. Tel était le but des dérivations. – Le lecteur prendra garde, pourtant, que dans ce cas comme dans le précédent, les dérivations ne sont pas la cause principale des phénomènes, mais qu'elles ne sont en très grande partie que le voile sous lequel agissent les forces qui produisent les phénomènes.
[FN: § 2147-19]
Celui qui croit cela peut raisonner de la façon suivante : « Si le chancelier était tombé du pouvoir, comme conséquence du vote de blâme du Reichstag, l'Allemagne se serait engagée dans une voie qui inévitablement ou seulement même très probablement conduit à avoir un ministre comme Lloyd George, en Angleterre, et pis encore, à confier l'armée et la marine à des ministres qui les désorganisent, tels André et Pelletan, en France : ce qui exposerait l'Allemagne a être vaincue et détruite, dans une guerre avec ses ennemis. À cette effrayante catastrophe, nous préférons le petit mal qui consiste à laisser impunis quelques actes arbitraires de certains militaires. Nous ne voulons pas entrer dans une voie qui mène aux désastres : principiis obsta ». Le point faible de ce raisonnement ne peut se trouver que dans l'affirmation inévitablement, très probablement. En d'autres termes, il faut que les adversaires démontrent par de bonnes raisons que l'analogie entre un mouvement possible en Allemagne et les mouvements effectivement observés, en Angleterre et en France, n'existe pas, et que l'Allemagne, entrée dans la voie de l'omnipotence du Reichstag, ne continuera pas jusqu'à l'état de choses latin, mais s'arrêtera en un point intermédiaire entre le présent état de choses latin et le présent état de choses germanique. Mais opposer à ce raisonnement des principes abstraits d'une foi quelconque est, au point de vue scientifique, aussi vain que recourir à l’oracle de Delphes.
[FN: § 2154-1]
Par exemple, beaucoup de médecins ont la tendance de réduire la société en un troupeau de moutons dont ils seraient les bergers bien payés et très vénérés. Les oppositions raisonnées à cette oppression et à cette exploitation demeurent souvent vaines, parce que les gens s'effraient des discours absurdes de certains médecins, comme le Malade imaginaire de Molière tremblait aux menaces du docteur Purgon. On peut, au contraire, parfois opposer avec efficacité à ces discours absurdes d'autres discours absurdes, tels que ceux de la christian science ou de la médecine naturelle. En 1913, afin de ramener à l'obéissance les cantons suisses qui s'obstinaient à faire preuve d'indépendance, les médecins et leurs partisans proposèrent une adjonction à la constitution fédérale, pour donner à l'autorité fédérale le pouvoir d'édicter des lois sur un très grand nombre de maladies, même non contagieuses. À la votation populaire, la presque unique opposition efficace fut celle des fidèles de la médecine naturelle. – Journal de Genève, 8 mai 1913 : « L'article constitutionnel sur les „ maladies fédérales “ s'est heurté de même que dans la Suisse orientale à une opposition silencieuse mais décidée. Deux ou trois districts du canton de Zurich l'ont rejeté. C'est que le nombre est grand, dans cette région de notre pays, des partisans des méthodes thérapeutiques naturelles, auxquels la science médicale officielle ne dit rien qui vaille et qui en redoutent les empiétements. Ils craignent que la nouvelle modification constitutionnelle n'ouvre la porte à des contraintes dont ils ne veulent pas entendre parler, telles que la vaccination obligatoire ». Il se peut que ceux qui sont opposés à la vaccination aient tort ; mais lorsqu'on voit, en Italie, les partisans de la vaccination aller jusqu'à faire un procès à un homme de science qui expose honnêtement sur ce sujet une opinion scientifique, on est tenté de conclure que les antivaccinistes accomplissent une oeuvre sociale utile, en s'opposant à l'œuvre de ceux qui voudraient imposer par le code pénal une science officielle.
[FN: § 2160-1]
FUSTEL DE COULANGES ; Questions historiques. – Paris 1893 : « (p. 8) Si vous cherchez quel est le principe qui donne cette unité et cette vie à l'érudition allemande, vous remarquerez que c'est l'amour de l'Allemagne. Nous professons en France que la science n'a pas de patrie [cela n'est pas si vrai] ; les Allemands soutiennent sans détour la thèse opposée : Il est faux [abus habituel des termes faux, vrai, dont on ne comprend pas la signification] dit M. de Giesebrecht, que la science n'ait point de patrie et qu'elle plane au-dessus des frontières la science ne doit pas être cosmopolite [autre abus du terme doit ; que signifie-t-il et si quelqu'un fait fi du devoir que lui impose le très respectable M. Giesebrecht, qu'arrivera-t- il ?], elle doit être nationale, elle doit être allemande “. Les Allemands ont tous le culte de la patrie, et ils entendent le mot patrie dans le sens vrai [salut à l'épithète vrai!] : c'est le vaterland, la terra patrum, la terre des ancêtres, c'est le pays tel que les ancêtres l'ont eu et l'ont fait. Ils n'en parlent que comme on parle d'une chose sainte ». C'est ainsi que les Athéniens parlaient du soleil, et ils furent pris d'une grande indignation contre l'impiété d'Anaxagore, qui disait que le soleil était une pierre incandescente. « (p. 9) L'érudition en France est libérale ; en Allemagne, elle est patriote ». L'une et l'autre peuvent être utiles ou nuisibles au pays, mais elles sont également différentes d'une érudition qui serait exclusivement expérimentale. Sous l'impression de la guerre de 1870, Fustel de Coulanges écrit : « (p. 16) Mais nous vivons aujourd'hui dans une époque de guerre. Il est presque impossible que la science conserve sa sérénité d'autrefois ». Heureusement pour l'histoire scientifique, Fustel de Coulanges fit preuve de cette sérénité dans beaucoup de ses ouvrages, qui, de cette façon, se rapprochent assez de l'histoire expérimentale ; et nonobstant l'émotion qu'il éprouve, il a assez de force de caractère pour s'écrier : « (p. 16) Nous continuons à professer, en dépit des Allemands, que l'érudition n'a pas de patrie ». Du reste, pour être exact, il faudrait dire « l'érudition scientifique », afin de faire bien ressortir la différence entre cette érudition et celle qui a un but d'utilité sociale.
[FN: § 2163-1]
K. WALISZEWSKI ; Le roman d'une impératrice : Catherine II. L'auteur observe que l'on se demande si l'empereur Pierre fut tué par Orlof ou par Tieplof : « (p. 190) Orlof ou Tieplof, la question peut paraître secondaire et de mince importance. Elle ne l'est pas. Si Tieplof a été l'instigateur du crime, c'est que Catherine en a été la suprême inspiratrice. Car, comment admettre qu'il ait agi sans son consentement ? Il en va autrement pour Orlof. Lui et son frère Grégoire étaient, devaient rester quelque temps encore maîtres jusqu'à un certain point d'une situation qu'ils avaient faite... Ils n'avaient pas pris l'avis de Catherine pour commencer le coup d'État ; ils peuvent bien ne pas l'avoir consulté cette fois encore ». Il importe beaucoup de résoudre ce problème pour porter un jugement éthique sur Catherine. Cela n'importe pas le moins du monde, pour porter un jugement sur l'utilité sociale des faits. Que le problème soit résolu dans un sens ou dans un autre, on ne voit pas que cela puisse avoir le moindre rapport avec la prospérité de la Russie.
[FN: § 2164-1]
Voir, à ce propos, AUGUSTIN COCHIN ; La crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard : « (p. 16) Résumons cet inventaire [des erreurs de Taine] : sur plus de 550 références données dans les 140 pages de l'Anarchie spontanée, M. Aulard relève 28 erreurs matérielles, qu'il faut réduire à 15,6 erreurs de copie, 4 erreurs de page, 2 de dates et 3 coquilles d'imprimerie – moyenne honorable, en somme, et que M. Aulard lui-même, au moins dans son livre sur Taine, est fort loin d'atteindre, puisqu'il se trompe, dans ses rectifications, à peu près une fois sur deux... (p. 17) Il [Taine] ouvrit le premier les cartons des archives, se trouva dans une forêt vierge, prit à brassée les faits et les textes. Il n'eut pas le temps d'être pédant, ni d'être complet. – Eut-il celui d'être exact ? Ses amis n'osaient trop en jurer. Ses adversaires le niaient d'abondance, par exemple M. Seignobos [lequel ne sait pas distinguer de l'histoire scientifique les divagations de sa théologie démocratique] : „ Taine, dit-il, est probablement le plus inexact des historiens de ce siècle “. Le livre de M. Aulard donne un démenti à M. Seignobos. L'œuvre de Taine a cette rare fortune de recevoir d'un adversaire aussi partial que savant [M. Cochin veut faire preuve de grande courtoisie] le baptême du feu. Elle y gagne la seule consécration qui lui manque : celle des trente ans d'érudition de M. Aulard. Chaque fait avancé par Taine aura désormais deux garants : la science de l'auteur qui l'affirme, la passion du critique qui ne le conteste pas ».
[FN: § 2165-1]
A. COCHIN ; La crise de l’hist. révol. : « (p. 99) Verrons-nous la fin de cette crise [ de l'histoire de la révolution] ? Je le crois, mais à deux conditions : La première est de nous mieux garder du fléau de toute curiosité, l'indignation... (p. 100) La seconde condition est que la critique nous débarrasse enfin du fétiche révolutionnaire, le Peuple ; qu'elle le renvoie à la politique, comme la Providence à la théologie, et donne à l'histoire de défense, dans le musée des mythes religieux, la place dont elle n'aurait pas dû sortir. Si nos historiens ne l'ont pas fait encore, c'est que, l'anthropomorphisme du peuple est plus récent, plus spécieux aussi que celui de la Providence. Il en imposait encore du temps où l'on distinguait mal, au revers des „ principes “ le jeu de la machine sociale, et les lois de la démocratie pratique. Taine, et M. Aulard sont des historiens de ce temps-là, des historiens d'ancien régime ».
[FN: § 2166-1]
Nous pouvons voir, à chaque instant, en de beaucoup moindres proportions, des faits et des jugements analogues, lorsqu'un conflit a lieu entre la force publique et des grévistes, et qu'il y a des morts ou des blessés. Ceux qui défendent la force publique disent que cela est arrivé par la faute des grévistes, qui voulaient se livrer à des actes que la force publique interdisait. Ceux qui défendent les grévistes disent que cela est arrivé par la faute de la force publique, qui a manqué de patience, et qui a voulu s'opposer aux grévistes. Pour savoir qui a raison ou tort, il est nécessaire de connaître quel sens on veut donner au terme faute. Si l'on admet que les ordres de la force publique doivent toujours être respectés, et que quiconque ose y désobéir le fait à ses risques et périls, c'est le défenseur de la force publique qui a raison. Si l'on admet que la force publique doit toujours respecter les grévistes, et que quiconque ose leur faire violence commet un crime, c'est le défenseur des grévistes qui a raison. Mais ainsi nous avons résolu un problème éthique, non pas un problème concernant les rapports des phénomènes sociaux, et il nous reste à connaître par quels sentiments, par quels intérêts sont mus les partis en lutte, et quelles seront les conséquences des différentes solutions que l'on peut donner à la discussion, eu égard à l'organisation sociale et aux diverses utilités. La force publique est employée dans tous les pays, pour imposer des mesures que l'on peut diviser en deux catégories : (A) Mesures favorables ou au moins indifférentes à la collectivité : (B) mesures nuisibles à cette collectivité. Quiconque admet que la résistance à la force publique est toujours nuisible à la collectivité, admet par ce fait que l'un des deux cas suivants se réalise : 1° que (A) ne peut jamais être séparé de (B), et que l'utilité de (A) l'emporte sur le dommage de (B) ; 2° que (A) peut toujours être séparé de (B) autrement que par la résistance à la force publique. Cette dernière proposition est contredite par l'histoire. Un grand nombre de transformations utiles ou très utiles aux sociétés humaines ont été obtenues seulement par la résistance à la force publique, à laquelle on a opposé une autre force. Vice versa, quiconque envisage favorablement, dans tous les cas, la résistance à la force publique, admet : 1° que (A) ne peut être en aucune façon séparé de (B), et que le dommage de (B) l'emporte sur l'utilité de (A) ; 2° que (A) ne peut jamais être séparé de (B autrement que par la résistance à la force publique. Même cette dernière proposition est contredite par l'histoire, qui nous montre qu'un grand nombre de transformations utiles ou très utiles aux sociétés humaines ont été obtenues autrement que par la résistance à la force publique. Il suit donc de là que ces problèmes ne peuvent être résolus a priori en un sens ou en l'autre, mais qu'il est nécessaire d'examiner quantitativement, en chaque cas particulier, de quel côté se trouve l'utilité ou le dommage. C'est précisément un caractère des dérivations éthiques, de substituer a priori, en ces cas, une solution unique et qualitative aux solutions multiples et quantitatives que l'expérience donne a posteriori. C'est pourquoi les solutions éthiques ont, auprès du vulgaire, plus de succès que celles de l'expérience, car elles sont plus simples et plus faciles à comprendre sans une longue et fatigante étude d'un grand nombre de faits (§ 2147-18).
[FN: § 2169-1]
Beaucoup de personnes ont dit et répété ce qu'exprime BARRAS dans Ses Mémoires, II: « (p. 446) ... telle est l'illusion des passions, qu'en s'occupant le plus d'un intérêt particulier, elles s'imaginent souvent qu'elles ne travaillent que pour l'intérêt public ».
[FN: § 2174-1]
Voir G. SOREL ; Réflexions sur la violence. Paris, 1910.
[FN: § 2174-2]
Par exemple, les mêmes journaux se montraient profondément indignés des « actes arbitraires » des militaires, à Saverne (§ 2147), et très indulgents envers les actes arbitraires et de sabotage commis exactement au même moment par des ouvriers grévistes. Vice versa, ceux qui approuvaient l’emploi de la force à Saverne, étaient profondément indignés si leurs adversaires usaient de la force.
[FN: § 2180-1]
Les exemples du passé sont trop nombreux et trop connus, pour être cités ici. Relevons seulement un exemple tout récent. En 1913, à Orgosolo, en Sardaigne, certains citoyens substituèrent leur action à celle de la justice, laquelle faisait défaut. Le fait mérite d'être rapporté, parce qu'il est typique pour le passé, et démontre comment, avec d'autres moyens et sous d'autres formes, il peut en être à l'avenir. Deux familles, celle des Succu et celle des Corraine, étaient en conflit, dans cette contrée, pour des raisons particulières. La première sut se concilier la faveur du gouvernement, et par conséquent celle de la justice. La seconde, s'estimant de ce fait opprimée, recourut aux armes. – Giornale d'Italia, 5 octobre 1913 : « Orgosolo, 3 octobre. La bande de brigands qui infeste le territoire d'Orgosolo a commis un nouveau crime atroce. En effet, on a retrouvé aujourd'hui, dans la région de La Mela, les cadavres de deux messieurs et de leur domestique, tués par la bande. Les trois personnes assassinées sont Succu Giuseppe, Succu Giovanni et leur domestique, Michele Picconi. Les trois cadavres sont criblés de coups et horriblement mutilés. Picconi a une oreille coupée. Giovanni Corraine tient ses promesses : an fur et à mesure que s'acharnent contre lui les efforts des soldats et des gendarmes lancés à sa poursuite, il donne une nouvelle preuve de sa force et de sa vengeance. Le crime d'aujourd'hui était prévu dans le pays : dans l'une de mes entrevues avec Piredda Egidio, l'un des principaux persécutés, celui-ci m'avouait en tremblant que chacun d'eux se levait le matin avec la frayeur de ne pas voir le soir ; et il ajoutait, en présence des fonctionnaires qui assistaient à la conversation, que, nonobstant la protection que la force publique accordait aux persécutés en les faisant escorter par les gendarmes, chaque fois qu'ils faisaient un pas hors de chez eux, ils s'étaient tous préparés à mourir. Et sur le visage de cet homme se lisait l'angoisse de celui qui vit sous une menace invincible, de celui qui comprend l'inutilité de la lutte contre une force diabolique absolument supérieure. Piredda avait raison. La nuit où les gendarmes fondirent sur sa maison et arrêtèrent sa mère et sa sœur, fleur admirable de jeunesse, Giovanni Corraine était à quelques mètres d'elles, dissimulé dans l’ombre, et, serrant son fusil, il jurait de se venger. On le sait, le frère de Giovanni Corraine me l'a avoué, le jour où, avec sa face malingre et pâle d'enfant, il me déclarait d'une voix ferme qu'on ferait justice à ceux qui cachaient au fond de la prison deux femmes innocentes, en se servant d'amitiés supérieures. Car, telle est l'opinion arrêtée des bandits et de tous les habitants d'Orgosolo, qu'ils sacrifieraient leur sang et leur liberté pour les aider ; que les Cossu, ennemis jurés des Corraine, réussissent à commettre leurs exactions et leurs injustices, en se prévalant des protections qu'ils ont en « haut lieu », et que, suivant la mentalité des opprimés, ils empêchent l'application sereine de la justice. C'est ce qu'ils pensèrent, le jour où les jurés d'Oristano acquittèrent l'assassin de l'un des frères Corraine ; c'est ce qu'ils pensèrent, la nuit où la police secrète, espérant couper les vivres aux bandits par une arrestation en masse de la faction Corraine, traîna aux prisons de Nuoro tous les représentants les plus en vue de cette faction. Et quand, devant la maison des Cossu, Medda Corraine, la plus belle enfant d'Orgosolo, passait menottée entre les gendarmes, son imprécation contenait l'avertissement féroce et tragique qui a aujourd'hui son épilogue sanglant : „ Dieu vous maudira pour le mal que vous faites à notre famille, et il ne vous permettra pas de jouir de cette vie d'infamie... “ Et elle agitait, dans un geste inhumain d'imprécation, ses poignets serrés par les menottes. Aujourd'hui, son frère recueille cette imprécation et tue. Les assassins d'aujourd'hui sont les deux frères Giuseppe et Giovanni Succu, de cette malheureuse famille qui peuple de dizaines de croix funéraires le petit cimetière tranquille d'Orgosolo. Ils disparurent tous un à un, sous le plomb infaillible des bandits. Le pays regarde en silence le carnage, et continue à envoyer du pain, des munitions et de l'argent aux abili, comme on les appelle, à ceux qui vivent en sauvages dans le bois, respirant la vengeance ». Peu de temps après, le même journal (9 octobre 1913) publie une conversation avec un « haut personnage » ; elle explique bien le phénomène : « La haine profonde qui divise les familles connues d'Orgosolo, et qui fut déjà cause de tant de crimes, provient d'un ensemble de causes. Pour être clair, commençons par spécifier que les familles « menacées » sont les familles Cossu, Pinedda, Podda et Pisano, et que celles auxquelles appartiennent et que favorisent les défaillants, sont les familles Succo, Corraine, Moro, De Vaddis. [Ces noms ne correspondent pas précisément à ceux qui sont indiqués plus haut, mais cela n'a que faire avec le fond des faits, qui seul nous importe.] Et les causes qui ont vraiment et immédiatement déterminé les crimes ? – Voici. La cause première et la plus reculée doit être cherchée dans une obscure question d'héritage, au sujet de laquelle il est désormais trop difficile de se retrouver. Mais une cause grave et moins lointaine fut la suivante. Une demande en mariage faite au nom d'une jeune fille des Cossu fut refusée par les Corraine. Peu de temps après, l'affront était rendu ; un jeune homme du „ second groupe “ de familles, lequel avait demandé la main d'une jeune fille du „ premier groupe “, fut également refusé. La haine commença à s'allumer violente. Mais peu de temps après, ce fut pis : l'un des Corraine fut trouvé noyé dans un puits. Ensuite d'une instruction dans les formes, la police secrète et la police judiciaire admirent d'une manière concordante que Corraine s'était suicidé ; mais les Corraine et leurs partisans estimèrent et estiment encore que leur parent avait été assassiné par leurs ennemis, et que l'autorité, pour protéger les Cossu, avait inventé la petite histoire du suicide. – Tristes suggestions de la passion ! – Mais il est une autre suggestion, je ne dis pas plus triste, mais encore plus étrange. Dans un conflit entre les gendarmes et les détaillants, un De Vaddis fut tué. Eh bien, les De Vaddis et leurs partisans estimèrent et estiment encore que leur parent fut tué par le „ groupe “ des Cossu, et que l'autorité, toujours pour protéger les Cossu, avait inventé cette fois le conflit avec les gendarmes. – Mais pourquoi, même dans l'idée erronée des Corraine et des autres, l'autorité protégerait-elle les Cossu ? – Parce que les Cossu étaient la plus vieille et la plus riche famille d'Orgosolo. Je dis « étaient », parce que maintenant la famille est détruite, hommes et biens, et que le vieil Antonio Cossu a dû se réfugier à Nuoro où, pour le protéger, sa maison est constamment gardée par des gendarmes de planton. Continuons. Le „ groupe “ des Corraine avait donc désormais à venger, outre les offenses anciennes, deux offenses nouvelles : ses deux morts ; car aucune force de persuasion n'arrivera jamais à ôter de la tête aux Corraine que leurs deux parents n'ont pas été assassinés par leurs ennemis. Alors commença la terrible œuvre de vengeance : les écuries et les bois brûlés, le bétail dérobé et coupé aux jarrets, les enfants séquestrés, les hommes tués. – Et les défaillants ?... – Justement. Il y a environ un mois, la police secrète, outre qu'elle poursuivait sans trêve les défaillants, arrêta leurs complices ; et il y eut, entre hommes et femmes, trente personnes. Le groupe des Corraine frémit, et crut à une nouvelle machination de l'autorité, parce que tous les gens arrêtés étaient des siens. Et en cela non plus, personne ne réussit à les persuader que les complices des méfaits commis par eux ne pouvaient certainement pas être recherchés dans le groupe des familles ennemies, qui, désormais terrorisées, n'osaient plus sortir de chez elles. – Et les arrestations turent-elles maintenues ? – Oui. L'autorité judiciaire, après une longue et minutieuse instruction, conclut à les renvoyer en jugement pour « association en vue de commettre un crime ». Ce fut le coup final qui déchaîna la fureur. Les deux mois que dura l'instruction furent deux mois de trêve : on n'entendit pas parler des défaillants, aucun attentat ni aucun vol ne furent commis dans la campagne. Évidemment, le groupe qui était à la tête des gens arrêtés espérait que les arrestations ne seraient pas maintenues, et ne voulait pas indisposer les juges. Mais à peine eut-on connaissance du renvoi en tribunal, que la tempête éclata... – Et malheureusement, depuis quinze jours, les crimes succèdent aux crimes... – Et la force publique est impuissante à les empêcher ou à les réprimer. – Et cette impuissance dérive ? – De nombreuses causes ; mais surtout de celle-ci : que toute la population du territoire d'Orgosolo, je dis toute, est favorable aux défaillants. – Et pourquoi ? – Parce que la persuasion est répandue qu'à l'origine eux ou leurs familles n'ont pas obtenu justice, et qu'ils ne sont donc pas des criminels, mais des opprimés qui se font justice eux- mêmes. En Sardaigne aussi, et spécialement dans la circonscription de Nuoro „ se faire justice soi-même “ par n'importe quel moyen et à n'importe quel prix ne passe jamais pour déshonorer personne. C'est pourquoi, „ dans toute la population de la circonscription “ où surabondent pourtant les honnêtes gens, les gendarmes ne trouvent pas le moindre appui ou la moindre information sur les mouvements des défaillants ; tandis que ceux-ci sont parfaitement et rapidement informés de tout mouvement de la force publique, et que le ravitaillement en vivres et en munitions ne leur fait pas défaut. Vous, qui connaissez le territoire de Nuoro, ne fût-ce que pour l'avoir vu en passant, vous devez comprendre que la force publique se trouve e n présence de difficultés vraiment insurmontables ». Et maintenant écoutons ce que disent, non plus des populations pauvres et ignorantes, mais les magistrats mêmes auxquels est confié l'exercice de la justice. Le Giornale d'Italia, 2 septembre 1913, renferme le compte-rendu suivant du congrès de Naples des magistrats judiciaires italiens : « Le magistrat Giulio Caggiano poursuit ainsi son rapport sur le déni de justice. L'histoire enseigne que le défaut et la faiblesse des organes juridictionnels est un retour, lent peut-être, à des époques reculées de barbarie ; que la teppa, la camorra, la maffia, le brigandage, sont des formes de criminalité, collective, tirant précisément leur origine de la méfiance envers la justice officielle. Les lois les meilleures deviennent des sornettes, comme les fameuses „ grida “ du temps de don Rodrigo [allusion aux Promessi sposi de Manzoni], si les organes pour en imposer le respect et l'exécution font défaut. Et il ne faut pas oublier une autre face de la question ; elle concerne plus directement la dignité de notre ordre : si une partie du public est capable de comprendre que ce n'est pas par incapacité ou par inactivité des juges que se développe le germe funeste du déni de justice, la majorité n'hésite pas à l'attribuer généralement à la paresse, à l'incompétence ou au mauvais vouloir des personnes ». Le public croit aussi, et avec raison, que souvent l'intromission des politiciens et du gouvernement qui les protège, enlève aux sentences des tribunaux tout caractère de droit et de justice. Dans les cas très graves, les fiers et énergiques habitants de la Sardaigne et de la Sicile s'arment d'un fusil, tandis qu'en des cas semblables, les populations plus douces du continent courbent la tête. C'est ainsi que même parmi des populations très civilisées, la justice privée commence à se substituer à la justice publique. – La Liberté, 8 novembre 1913 : « Le geste fatal. C'était à prévoir ; un jour ou l'autre, un acte violent devait répondre à une de ces extraordinaires fantaisies par quoi, depuis un certain nombre d'années, se signale le jury. Le geste fatal a été accompli en pleine cour d'assises : un individu était accusé par ses deux fils d'avoir tué leur mère, dont on avait trouvé le cadavre dans un puits avec une corde au cou ; le jury venait de déclarer l'accuse non coupable et la cour de prononcer son acquittement, lorsque le plus jeune des fils accusateurs se précipite vers son père et le blesse d'un coup de revolver en s'écriant : „ La Justice peut acquitter ce coquin, moi, jamais ! “ Cris, tumulte ; les assistants se jettent sur le justicier volontaire et s'apprêtent à le lyncher ; les gardes parviennent à l'arracher aux mains de la foule et le conduisent en prison, tandis que l'acquitté, dont la blessure est légère, va signer la levée d'écrou et est remis en liberté. En plein prétoire, un individu s'est cru le droit de se substituer à la justice défaillante pour réformer son arrêt, tandis que la foule se croyait pareillement le droit de se substituer à la justice pour la répression de l'attentat. Voici ce qui s'est passé, il y a quelques jours, à la cour d'assises du Cher ; l'événement est trop grave pour ne pas attirer l'attention de tous les honnêtes gens qui s'imaginent encore vivre dans une société organisée. N'hésitons pas à le dire : si de pareils faits sont possibles, la faute en est sans contestation aux innombrables acquittements que prononce le jury dans des cas où une répression s'impose. Nombre de ces acquittements ont fait scandale et donné une singulière valeur à la parole de cet avocat qui, résumant une longue expérience, déclarait que, „ coupable, il ne voudrait pas d'autre juridiction que le jury “ ». L'auteur n'a raison qu'en partie. La « faille » – nous dirons mieux la cause – de ces faits ne doit pas être recherchée uniquement dans le jury. Souvent les magistrats font encore pis. Elle ne doit pas non plus être recherchée exclusivement dans l'organisation judiciaire, laquelle vaut ce que valent les hommes qui la mettent en œuvre. Elle dépend principalement de ce que, par un concours de nombreuses circonstances, l'autorité publique abandonne son office d'assurer la justice.
[FN: § 2180-2]
APPIANI lib. I, de bellis civil., 104, raconte qu'après avoir abdiqué la dictature, respecté encore par tout le monde, à cause de la crainte qu'il continuait à inspirer, Sulla ne fut insulté que par un jeune homme auquel il dit : « que cet adolescent empêcherait un autre homme qui aurait le pouvoir [de la dictature], de le déposer. Peu de temps après, il en advint ainsi aux Romains, lorsque Caius César ne voulut pas déposer le commandement ». L'anecdote a été probablement inventée pour expliquer ce dernier fait ; mais ceux qui l'inventèrent et ceux qui l’acceptèrent avaient bien vu où l'œuvre de Sulla était en défaut. En effet, sitôt qu'il fut mort, les Romains retournèrent à leurs dissensions habituelles, et les deux consuls s'attaquèrent l'un l'autre avec acharnement. C'est le phénomène habituel, qui nous montre que là où la force publique faiblit, la force des factions ou des particuliers s'y substitue.
[FN: § 2180-3]
Les humanitaires se complaisent à répéter ce mot : « On peut tout faire, avec des baïonnettes, excepté s'asseoir dessus » ; mais ils ne nous disent pas si, à leur avis, le pouvoir d'Auguste et de ses successeurs ne reposait pas, au moins en partie, sur la force des prétoriens et des légionnaires. Il est vrai que tous ces soldats se servaient d'épées et non de baïonnettes; mais l'un vaut l'autre.
[FN: § 2180-4]
AULARD ; Hist. pol. de la rév. franç. : « (p. 177) Le 29 novembre [1791], l'Assemblée législative décréta, entre autres mesures, que les ecclésiastiques qui avaient refusé d'accepter la constitution civile seraient tenus de prêter, dans la huitaine, le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, ou serment civique... Le roi ne voulut pas donner sa sanction à ce décret... De même, le veto royal s'était opposé à un décret du 9 novembre, par lequel étaient menacés de la peine de mort les émigrés qui ne rentreraient pas et continueraient à conspirer contre la patrie... Une subtile politique d'attente, d'intrigue au dedans et au dehors, était masquée par un ministère sans cohésion, sans programme, où il y (p. 178) avait des intrigants, des contre-révolutionnaires décidés... (p. 179) Le roi se résigna à licencier sa garde, mais il refusa sa sanction aux décrets sur les prêtres et sur le camp... ». Sulla avait une autre politique. Il se souciait peu d'offenser les dieux des temples, qu'il dépouillait pour entretenir ses soldats, et n'obéissait pas au Sénat, qui voulait lui enlever les légions. Duruy observe avec justesse que lorsque Sulla marcha sur Rome, « (t. II, p. 576) du moment qu'il se décidait à tirer l'épée contre des gens qui n'avaient qu'un plébiscite pour se défendre, le succès était certain », Plus tard, Jules César aussi s'en remit à l'épée contre les décrets du Sénat, et eut la victoire. M. Aulard, qui certes ne peut être suspecté de favoriser la monarchie, avoue qu'après la manifestation du 20 juin 1792, « (p. 187) il y eut dans la classe bourgeoise et dans une partie de la France une recrudescence de royalisme. Vingt mille pétitionnaires et un grand nombre d'administrations départementales protestèrent contre l'insulte faite à la majesté royale, insulte que l'on présenta comme une tentative d'assassinat ». Il fallait autre chose que des pétitions ! C'était des armes qui étaient nécessaires. Mais messieurs les humanitaires ont-ils donc l'esprit si obtus qu'ils ne comprennent rien à l'histoire ? Puis M. Aulard nous rapporte l'histoire du célèbre « baiser Lamourette » (7 juillet 1792), et conclut « (p. 188) Ainsi tous les défenseurs du système bourgeois se trouvaient groupés et d'accord pour défendre le trône, pour empêcher le retour des scènes du 20 juin et pour en punir les auteurs ». Belle défense, de discours et d'intrigues ! Il ne manquait à ces bravos gens que la foi en leur force : l'énergie pour combattre, le courage de tomber dans la bataille, les armes à la main... rien d'autre. « (p. 189) On a vu qu'elle [l’assemblée législative] avait dissous la garde du roi, et le roi avait sanctionné ce décret. Après avoir ôté au roi ses moyens de défense contre une insurrection populaire, elle avait elle-même cherché à former une force militaire pour déjouer les projets du roi ou de la cour ». Ensuite il arriva ce qui est toujours arrivé : celui qui savait faire usage de la force vainquit celui qui ne savait pas s'en servir : et ce fut alors un bonheur pour la France, ainsi qu'il en avait été pour d'autres pays par le passé ; car la domination des forts est généralement meilleure que celle des faibles.
[FN: § 2187-1]
Par exemple, en Italie, il est admis que le gouvernement doit payer aux industriels qui fournissent du matériel aux chemins de fer un prix tel qu'il soit égal au coût plus un modeste surplus. Il est donc évident que si, par suite de grèves, le coût devient plus grand, ce sont les contribuables qui ont à payer l'augmentation, et les industriels qui continuent à toucher leur bénéfice. On a vu plusieurs fois ces industriels et d'autres, parmi lesquels les constructeurs de navires, provoquer eux-mêmes une grève de leurs ouvriers, ou du moins en faire la menace, pour exercer une pression sur le gouvernement et en obtenir des commandes aux prix qui leur convenaient. Les coopératives qui se chargent de travaux publics procèdent d'une manière analogue, eu se passant de la médiation des patrons.
[FN: § 2190-1]
Presque toujours, le fait d'avoir étudié ces phénomènes au point de vue éthique a empêché les auteurs de voir les uniformités que ces phénomènes présentent pourtant d'une manière évidente. Quand un historien raconte une révolution, son principal souci est de rechercher si elle est « juste » ou « injuste » ; et comme ces termes ne sont pas définis, cette recherche se confond avec celle de l'impression que l'auteur éprouve de la connaissance des faits. Dans l'hypothèse la plus favorable, si l'auteur n'a aucun préjugé auquel il subordonne délibérément l'histoire, il se laisse guider par certaines conceptions métaphysiques au sujet du « juste » et de l'« injuste », et il décide suivant ces conceptions. Mais plus souvent, il a une foi qui ne laisse aucune place au doute. S'il est favorable à la monarchie ou à l'oligarchie, il donne toujours « tort » au peuple qui s'insurge ; et vice versa, s'il est « démocrate », il donne toujours « raison » au peuple qui s'insurge. Quand il lui vient à l'idée de rechercher les causes de l'insurrection, ce qui n'arrive pas toujours, on peut être certain qu'il s'arrête aux causes éthiques. S'il est opposé au peuple, il dira que celui-ci est poussé à s'insurger par les machinations des démagogues ; s'il est favorable au peuple, il dira qu'il est mu par l'oppression intolérable de la classe gouvernante. Que de papier et d'encre n'a-t-on pas employés à répéter sans fin ces inutiles billevesées !
[FN: § 2191-1]
Les détracteurs de la révolution française l'accusent d'avoir fait largement emploi de la force ; ses admirateurs s'efforcent d'excuser cet emploi. Les uns et les autres ont raison, s'ils cherchent à trouver des dérivations, lesquelles agissent sur les gens qui éprouvent une répugnance instinctive, et non raisonnée, pour les souffrances (résidus IV-γ 2). Ils se trompent, s'ils ont objectivement en vue les conditions de l'utilité de la société : et, à ce point de vue, il faut reconnaître que l'emploi de la force fut le principal mérite de la Révolution, et non une faute.
[FN: § 2193-1]
Georges SOREL, Réflexions sur la violence, a fort bien montré la vanité de ces dérivations : « (p. 91) On éprouve beaucoup de peine à comprendre la violence prolétarienne quand on essaie de raisonner au moyen des idées que la philosophie bourgeoise a répandues dans le monde : suivant cette philosophie, la violence serait un reste de la barbarie et elle serait appelée à disparaître sous l'influence du progrès des lumières... (p. 92) Les socialistes parlementaires ne peuvent comprendre les fins que poursuit la nouvelle école ; ils se figurent que tout le socialisme se ramène à la recherche des moyens d'arriver au pouvoir ». Ces socialistes-là sont en train de s'assimiler à la classe gouvernante, et le nom de transformistes qu'ils prennent quelquefois correspond assez bien au fond du phénomène. « (p. 93) Une agitation, savamment canalisée, est extrêmement utile aux socialistes parlementaires, qui se vantent, auprès du gouvernement et de la riche bourgeoisie, de savoir modérer la révolution ; ils peuvent ainsi faire réussir les affaires financières auxquelles ils (p. 94) s'intéressent, faire obtenir de menues faveurs à beaucoup d'électeurs influents [et en Italie, faire distribuer de l'argent aux coopératives]... (p. 271) La férocité ancienne tend à être remplacée par la ruse, et beaucoup de sociologues estiment que c'est là un progrès sérieux ; quelques philosophes qui n'ont pas l'habitude de suivre les opinions du troupeau, ne voient pas très bien en quoi cela constitue un progrès au point de vue de la morale.(p. 83) Il ne manque pas d'ouvriers qui comprennent parfaitement que tout le fatras de la littérature parlementaire ne sert qu'à dissimuler les véritables motifs qui dirigent les gouvernements [ce sont des dérivations]. Les protectionnistes réussissent en subventionnant quelques gros chefs de parti [et même des petits, non seulement avec de l'argent, mais aussi en leur procurant des satisfactions d'amour propre, des éloges dans les journaux, des honneurs, le pouvoir] en entretenant des journaux qui soutiennent la politique de ces chefs de parti : les ouvriers n'ont pas d'argent, mais ils ont à leur disposition un moyen d'action bien plus efficace : ils peuvent faire peur... ».
[FN: § 2193-2]
Un très grand mérite de G. SOREL a été d'abandonner ces billevesées, dans son livre Réflexions sur la violence, pour s'élever aux régions de la science. Il n'a pas été bien compris de ceux qui cherchaient des dérivations là où il y a des raisonnements logico-expérimentaux. Certains « universitaires », qui confondent la science avec la pédanterie (§ 1749 5), et qui, dans une théorie, s'arrêtent à des détails insignifiants ou à d'autres absurdités semblables, manquent entièrement des capacités intellectuelles nécessaires à la compréhension de l'ouvrage d'un savant tel que Sorel.
[FN: § 2200-1]
Ces trois hommes étaient ennemis, mais chacun d'eux disposait de légions ; le Sénat n'en avait pas. Par conséquent les triumvirs se persuadèrent facilement qu'il leur était avantageux de se mettre d'accord, et de faire payer les frais de l'accord aux partisans du Sénat. À ce propos, Duruy remarque : DURUY ; Hist. des Rom., t. III : « p. 458) Par cette inexorable fatalité des expiations historiques que nous avons si souvent signalée dans le cours de ces récits, le parti sénatorial allait subir la loi qu'il avait faite au parti contraire [L'auteur passe prudemment sous silence les proscriptions de Marius]. Les proscriptions et les confiscations de Sylla vont recommencer, mais c'est la noblesse qui payera de sa tête et de sa fortune le crime des ides de mars et le souvenir des flots de sang dont, quarante années auparavant, l'oligarchie avait inondé Rome et l'Italie ». Si Duruy était un fidèle de Iuppiter optimus maximus, on comprendrait facilement à qui il confie le soin de réaliser cette « inexorable fatalité » ; mais comme il ne recourt pas à des considérations théologiques de cette sorte, il faut croire que cette « fatalité » est une entité métaphysique, laquelle, à vrai dire, semble fort mystérieuse, en elle-même et dans ses manifestations. Toutefois, les personnes qui désireraient en avoir quelque notion la trouveront chez les auteurs anciens qui racontent les faits dont parle Duruy. APPIAN. ; De bellis civ., IV, 3. Après avoir conclu le pacte entre eux, les triumvirs décidèrent « de promettre aux soldats, comme prix de la victoire, outre les cadeaux, dix-huit villes italiennes à occuper comme colonies, qui seraient excellentes par leur opulence, leur sol, leurs édifices, et qui seraient partagées entre les soldats, fonds ruraux et édifices, comme si elles avaient été conquises à la guerre ». Cfr. DIO CASS. ; XLVI, 56. – TAC. ; Ann., I, 10. – PATERC. ; II, .64. – FLOR. ; IV, 6. Ne serait-ce pas le cas d'expliquer ainsi quelle est la belle entité de Duruy : payer, acheter ceux qui constituent la force, et s'en servir à son propre avantage ? Cette entité doit avoir enfanté, car celle qui protège nos politiciens, lorsqu'ils s'assurent le pouvoir en achetant les électeurs, semble bien être une de ses descendantes.
[FN: § 2201-1]
E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t, XVI : « (p. 1) L'étude des faits dans l'Histoire m'a amené à cette conviction expérimentale qu'aucun gouvernement n'a été anéanti par ses ennemis ; les ennemis sont comme les arcsboutants des églises gothiques : ils soutiennent l'édifice. Il n'y a pour les gouvernements qu'une manière de périr : le suicide ». C'est un peu trop absolu. Il y a des gouvernements qui peuvent succomber en présence d'une force qui l'emporte. C'est ce qui arriva à Pompée, à Charles Ier d'Angleterre, à tant d'autres qu'il est inutile de rappeler. « Depuis 1789, tous les pouvoirs se sont détruits eux-mêmes : les Constituants s'excluent de leur œuvre ; les Girondins se livrent ; les Jacobins s'anéantissent entre eux ; les principaux Directeurs mettent leur République aux enchères ; Napoléon Ier abdique deux fois ; Charles X abdique et s'en va ; Louis-Philippe abdique et s'enfuit ».
[FN: § 2207-1]
Nombre d'économistes littéraires sont portés à considérer exclusivement le cycle (b), (c) – (c), (b). De l'étude des intérêts (b), dont s'occupe leur science, ils tirent certaines conclusions (c), et croient ensuite que par la diffusion des doctrines (c), on pourra modifier l'activité économique (b). Un exemple très important est celui du libre échange. De l'étude du phénomène économique (b), on tire la démonstration (c) de l'utilité du libre échange. Cette doctrine (c), étant ensuite répandue, doit modifier le phénomène économique (b), et faire instituer réellement le libre échange. En général, quand les économistes se trouvent en présence de quelque sentiment (a) qu'ils doivent considérer, ils ont coutume de supposer que ce sentiment existe par vertu propre, sans rapport avec (b). Par exemple le « juste » et l'« injuste » sont absolus, et non en rapport avec (b). Marx se rapprocha beaucoup de la science logico-expérimentale, en remarquant le rapport entre (a) et (b) ; mais il se trompa en croyant que ce rapport était entre la cause (b) et l'effet (a), tandis que si (b) agit sur (a), cet élément réagit, à son tour, sur (b). Parmi les nombreuses causes pour lesquelles la combi- naison IV est très souvent négligée, il faut ranger celle-ci : on considère des sentiments, des intérêts, des dérivations, d'une manière absolue, indépendamment des individus. On a ainsi des abstractions, et non des propriétés de certains individus. C'est pourquoi l'on croit qu'il n'est pas nécessaire de considérer comment varient les différentes classes de ces individus.
[FN: § 2208-1]
Les dérivations suivantes ont aussi été très en usage. Se plaçant dans le domaine de l'éthique, les libre-échangistes disaient : la protection est un mal, parce qu'elle dépouille les non-protégés en faveur des protégés. Les protectionnistes répliquaient : On peut supprimer le mal en protégeant également tout le monde. À quoi les libre-échangistes opposaient que protéger également tout le monde revient à ne protéger personne. Ainsi, l'on admet la possibilité de deux positions d'équilibre identiques avec des prix différents (§ 2207 1). Aussi bien les libre-échangistes que les protectionnistes substituaient, volontairement ou non, des dérivations aux considérations sur la réalité. Pour rester dans le domaine logico-expéri- mental, les libre-échangistes auraient dû dire : « Grâce à une destruction de richesse, la protection transporte une certaine quantité de richesse de certains individus à certains autres. Ce transport est précisément l'effet auquel vous visez, vous autres protectionnistes : par conséquent, vous vous contredisez, si vous parlez de protection égale pour tout le monde. Si elle était possible, la cause pour laquelle vous êtes protectionnistes disparaîtrait. Quand vous parlez de protection égale pour tout le monde, vous entendez, bien que vous ne le disiez pas, une protection égale, non pas pour tous les citoyens, parmi lesquels se trouvent les simples possesseurs d'épargne, mais pour toute une classe de citoyens, laquelle sera composée d'un nombre plus ou moins considérable de producteurs industriels et agricoles. C'est précisément cela que nous estimons nuisible au pays ». À quoi les protectionnistes auraient dû répliquer : « Les faits sont bien tels que vous les décrivez : nous visons précisément à transporter la richesse, d'une partie des citoyens à une autre partie. Nous savons que cette opération coûte une certaine destruction de richesse ; cependant nous l'estimons utile au pays ». Après cela, l'expérience, l'expérience seule, pouvait établir qui se rapprochait le plus de la réalité. Mais encore, avant de pouvoir procéder à cette investigation, il faudrait savoir avec une plus grande précision ce qu'indiquaient les termes « nuisible » et « utile », employés tantôt.
[FN: § 2208-2]
Cette démonstration, ainsi qu'une autre, plus générale, ont été données pour la première fois dans le Cours, § 862 et sv., § 730. Cfr. l'Appendice du Manuel.
[FN: § 2208-3]
Le Cours contient, au moins implicitement, des erreurs de cette sorte. Dans le Manuale, l'auteur s'est efforcé de les éviter. Dans la préface du Manuale, on lit : « (p. VII) .. Il se trouve par-ci par-là dans le Cours des procédés erronés. Ces erreurs proviennent de deux sources principales. La première est une synthèse incomplète, ayant pour but de revenir de l'analyse scientifique à la doctrine concrète [c'est précisément pour avoir reconnu la nécessité d'une synthèse moins incomplète, que l'auteur a été amené à entreprendre le long travail dont les résultats sont exposés dans le présent ouvrage]. L'auteur a remarqué la nécessité de cette synthèse complète ; mais ensuite, sans s'en apercevoir, il l'a parfois négligée [dans le Cours] en partie, sinon explicitement, du moins implicitement. Il suffit de citer l'exemple du libre- échange et de la protection. On peut démontrer scientifiquement que la protection provoque d'habitude une destruction de richesse. L'étude des faits passés et présents démontre que la protection est instituée en grande partie grâce à l'influence de ceux qui en profitent pour s'approprier le bien d'autrui. Mais cela suffit-il à condamner la protection dans le monde concret ? Assurément pas ; il faut prendre garde à d'autres conséquences sociales de cette organisation [mais pour cela, il était nécessaire d'avoir une théorie du genre de celle que nous exposons ici], et ne se décider qu'après avoir accompli cette étude. Je crois que l'auteur du Cours aurait aussi donné cette réponse. L'erreur n'est donc pas proprement explicite ; mais l'auteur s'exprime souvent comme si, en réalité, le libre-échange était bon dans tous les cas, et la protection dans tous les cas mauvaise. Ces affirmations supposent que l'on part de quelque proposition entachée de l'erreur indiquée ».
[FN: § 2214-1]
Lorsqu'on se place exclusivement au point de vue de la correspondance des théories avec les faits, on peut dire que, dans l'étude indiquée, un grand nombre d'économistes ont eu le malheur de ne pas comprendre qu'en un état de libre concurrence, les entrepreneurs ne font, en moyenne, ni gain ni perte, si l'on tient compte du revenu des capitaux et du salaire de l'entrepreneur. Au contraire, lorsque les entrepreneurs bénéficient d'un monopole, ils peuvent faire en moyenne un gain qui s'ajoute à ce revenu et à ce salaire. De même aussi un grand nombre de socialistes ont eu le malheur de confondre le revenu du capital avec le gain de l'entrepreneur ; gain qui n'existe, en moyenne, que dans les états de monopole temporaires ou permanents. Ainsi plusieurs observations des socialistes, exactes à cet égard, deviennent fausses, si on les étend au revenu du capital. Ils ont eu le malheur encore de ne pas distinguer les deux catégories de personnes (§ 2231 et sv.) confondues par eux sous le nom de « capitalistes ».
[FN: § 2218-1]
En Prusse, il existe une classe nombreuse de petits propriétaires nobles. C'est de cette classe que viennent en grande partie les employés du gouvernement et les officiers de l'armée. C'est la cause principale de la grande honnêteté de la bureaucratie prussienne, et de la solidité de l'armée. Quelque chose de semblable existait au Piémont avant la constitution du royaume d'Italie ; et l'on observait des effets analogues, qui se sont en tout cas beaucoup évanouis, en même temps que s'évanouissait la cause dans le nouveau royaume. Il suit de là que la protection agricole favorable à ces classes de propriétaires, a des effets bien différents en Allemagne et en Italie, car il manque, en Italie, une classe correspondant à celle des Junker prussiens.
[FN: § 2221-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] JEAN CRUET : La Vie du Droit et l'impuissance des lois. Dans un paragraphe intitulé : Théorie juridique des révolutions et des coups d'États, l'auteur traite en sous-titre de la tradition française : la Révolution comme mode normal d'abrogation des Constitutions : « (p. 108) C'est en vérité plus qu'une tradition française, c'est une tradition latine. Chacun songe à l'Espagne, terre classique des pronunciamentos, au Portugal, où la dictature vient périodiquement rétablir l'ordre compromis par l'application même d'une Constitution mal adaptée au tempérament national, aux Républiques sud-américaines enfin, où l'on pouvait, en 1894, sur dix-sept Présidents, en compter onze issus d'une révolution ou d'un coup d'État ».
[FN: § 2227-1]
Il arrive souvent que la classe gouvernante provoque elle-même sa propre ruine. Elle accueille volontiers dans son sein les hommes chez lesquels prédominent les résidus de l'instinct des combinaisons, et qui s'adonnent à des entreprises économiques et financières, parce que ces hommes produisent habituellement beaucoup de richesse, et augmentent, par conséquent, l'aisance de la classe gouvernante. Aux temps de la monarchie absolue, ils procuraient le luxe aux souverains ; aujourd'hui, ils procurent le luxe à la démocratie ; et souvent ils peuvent être utiles à tout le pays. Les premiers effets de leur arrivée au pouvoir sont donc utiles à un grand nombre de gens, et renforcent la classe gouvernante ; mais ensuite, peu à peu, ils agissent comme des vers rongeurs, détruisant dans cette classe les éléments riches en résidus de la persistance des agrégats et capables d'user de la force. C'est ainsi que les « spéculateurs » (§ 2235), en France, préparèrent le triomphe de la monarchie absolue, puis sa ruine (§ 2383 1). Aujourd'hui, en plusieurs pays, ils ont contribué au triomphe du régime qu'on appelle « démocratique », et qui s'appellerait plus proprement régime de ploutocratie démagogique ; maintenant, ils sont en train de préparer la ruine de ce régime.
[FN: § 2231-1]
Ces capitalistes et ces entrepreneurs du langage vulgaire ne sont nullement les capitalistes et les entrepreneurs que considère l'économie pure (Cours, § 87 et passim) ou, en général, l'économie scientifique. L'analyse scientifique sépare des mélanges que l'on observe dans les cas concrets.
[FN: § 2231-2]
C'est ce que comprirent les économistes qui opposèrent les consommateurs aux producteurs. Mais avec raison on leur objecta que, dans les cas concrets, ces deux qualités se confondent souvent, et que le plus grand nombre de personne, sont en même temps consommateurs et producteurs. La différence que les économistes avaient ainsi intuitivement aperçue existe, en réalité, entre ceux qui subissent tranquillement le mouvement économique, politique, social, et ceux qui s’en servent ingénieusement.
[FN: § 2232-1]
Si plusieurs économistes ne s'en sont pas aperçus, cela tient au fait qu'ils ont été induits en erreur par le désir de trouver un principe dont on pût logiquement déduire la théorie de l'épargne, et aussi au fait que, lancés sur cette voie, ils ont abandonné, le domaine des observations expérimentales, pour errer dans celui des spéculations théoriques. Il serait utile à la théorie que la quantité d'épargne produite dans l'unité de temps fût fonction, exclusi- vement, ou au moins principalement, du revenu qu'on peut obtenir de cette épargne. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi, et l'on ne peut, par amour pour la théorie, fermer les yeux sur l'évidence des faits, ni substituer à l'observation directe que chacun peut faire, des divagations théoriques sur les statistiques. Les statistiques de l'épargne sont très imparfaites. Non seulement elles ne peuvent pas tenir compte de la somme, au total assez considérable, que les petits industriels, les petits commerçants, les petits agriculteurs, emploient dans leur propre entreprise : mais encore elles ne peuvent apporter aucun renseignement quelque peu précis sur l'épargne nouvelle qu'on emploie en titres d'État ou en d'autres. Enfin, et c'est là le motif principal pour lequel des théories de ce genre peuvent induire en erreur sur le sujet dont nous traitons, elles se rapportent à un phénomène très compliqué, dans lequel de nombreuses causes agissent, outre la tendance des hommes à épargner. Quelle part avait en cette tendance le revenu qu'on aurait pu retirer de l'épargne, quand les gens épargnaient des monnaies d'or et d'argent, et les cachaient chez eux ? Quelle était cette part, au temps où, en France, on parlait toujours du bas de laine à propos de l'épargne des paysans ? Et aujourd'hui, interrogez les bonnes ménagères qui épargnent sou par sou le petit magot qu'elles porteront à la caisse d'épargne, et demandez-leur si elles épargneraient davantage, au cas où l'intérêt servi par la caisse d'épargne serait plus élevé. Si vous arrivez à vous faire comprendre, ce sera déjà beaucoup ; et si, par hasard, vous y arrivez, la bonne ménagère rira de votre naïveté. Il est ridicule d'appeler auto-observations celles que l'on fait ainsi sur d'autres personnes. Si ensuite, les statistiques savamment manipulées disent le contraire, cela signifie simplement, ou bien qu'elles sont erronées, ou bien qu'elles ont été mal manipulées, comme le seraient les statistiques qui nous diraient que les hommes marchent sur les mains, et non sur les pieds. L'avarice est l'excès de l'épargne. Des temps anciens à nos jours, le type de l'avare a souvent été décrit par les littérateurs. Mais lequel d'entre eux s'est jamais mis en tête d'établir un rapport entre l'épargne de l'avare et l'intérêt qu'il peut retirer de cette épargne ? On ne voit certainement pas cela chez Théophraste ni chez Molière. L'avare épargne tout ce qu'il peut, et se fait payer le plus possible d'intérêt pour ce qu'il prête. Ce sont deux maxima qui ne sont pas mis en rapport. Au temps de Théophraste, il n'y avait pas de statistiques. Par conséquent, elles ne peuvent pas nous apprendre avec certitude si les Athéniens mangeaient, buvaient et se vêtaient ; mais cela semble probable, de même que l'existence, parmi eux, de gens prévoyants et d'imprévoyants ; et les descriptions d'un excellent observateur tel que Théophraste valent plus et mieux que les nébuleuses dissertations de certains de nos statisticiens. En décrivant l'homme adonné aux épargnes sordides (Charact. X), Théophraste ne mentionne nullement que ces épargnes soient en rapport avec le revenu que l'on en pourra retirer. Il est évident que ce sont là des actes instinctifs qui manifestent la passion d'accumuler. Ils apparaissent aussi comme tels dans les conseils que donne Caton le Censeur, qui était passé maître en l'art d'épargner, et n'était pas novice en celui d'être avare. Nous avons déjà remarqué (Cours § 30) que l'épargne, différente en cela des autres biens écono- miques, n'a pas d'ophélimité élémentaire décroissant avec la quantité. Là aussi, l'observation directe montre que beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont pas d'épargne, n'éprouvent nullement le besoin d'épargner, tandis que ce besoin naît et augmente lorsqu'ils ont une certaine somme d'épargne. On sait assez que le fait de donner un livret de caisse d'épargne à un ouvrier qui ne possède pas d'épargne est souvent un moyen de l'engager à épargner. Mais il est inutile de continuer à rappeler des faits si connus, et que chacun, s'il le veut bien, peut aisément vérifier. Quiconque n'en veut pas tenir compte n'a qu'à garder son opinion, comme ce don Ferrante des Fiancés de Manzoni. Tandis que la peste sévissait à Milan, il démontrait par de savantes considérations théoriques que la peste n'existait pas, si ce n'était sous forme d'influence maligne des corps célestes. Il en mourut en s'en prenant aux étoiles. Cfr. Cours, § 419 ; Manuel ,VIII, 11, p. 438.
[FN: § 2232-2]
Deux savants d'une renommée aussi grande que méritée, Bodio, en Italie, et De Foville, en France, ont fait voir opportunément avec quelle prudence, quelle discrétion, et quelles précautions il faut faire usage des statistiques. Leurs enseignements ne doivent jamais être perdus de vue.
[FN: § 2232-3]
Parmi les faits les plus certains, où les actions logiques interviennent pour déterminer l'épargne, il y a celui de personnes qui cessent d'exercer leur profession, lorsqu'elles ont épargné ce qui est nécessaire pour pourvoir convenablement à leurs besoins pendant les années qui leur restent à vivre. Il est remarquable qu'en ce cas l'action logique est contraire à celle que l'on aurait si la quantité d'épargne croissait avec le revenu qu'on en peut retirer. On remarquera encore qu'en ce cas très simple aussi, le phénomène est compliqué. La somme d'épargne nécessaire pour pouvoir se retirer des affaires dépend non seulement de l'intérêt de l'épargne, mais aussi du prix de ce qui est nécessaire à la vie, et aussi du genre de vie en usage au moment où l'on abandonne sa profession. Viennent s’ajouter un grand nombre d'autres circonstances, qui se rapportent à l'état de famille, aux us et coutumes du temps. Enfin, tout cela se superpose aux actions non-logiques, et ne s'y substitue pas. L'imprévoyant n'a pas à se soucier de l'intérêt de l'épargne, parce qu'il n'en possède point. L'avare ne s'en soucie pas non plus, parce qu'il amasse tant qu'il peut. Aux degrés intermédiaires c'est en partie l'instinct et en partie le raisonnement qui agissent.
[FN: § 2233-1]
Elle a été mentionnée pour la première fois dans V. PARETO ; Rentiers et spéculateurs. (Voir l’Indépendance, 1er mai 1911.)
[FN: § 2234-1]
Des monographies du genre de celles de Le Play seraient fort utiles pour bien connaître la nature des personnes appartenant à la catégorie (S), et celle des personnes appartenant à la catégorie (R). En voici une qui nous est fournie par GIUSEPPE PREZZOLINI ; La Francia ed i Francesi del secolo XX osservati da un italiano, Milano, 1913. Nous la trouvons citée par E. CESARI, dans La vita italiana, 15 octobre 1917, p. 367-370. Il s'agit d'un parlemen- taire très connu. Comme d'habitude, nous supprimons les noms propres : ce n'est pas d'une personne, c'est d'un type qu'il s'agit. Les chiffres que donne M. Prezzolini sont ceux que le parlementaire en question a lui-même avoués publiquement.
Ses rentes fixes donnent un total de 17 500 francs ; soit : indemnité parlementaire : 15 000, intérêt de la dot de sa femme : 2500. Ceux-ci seulement peuvent appartenir à la catégorie (R) ; l'indemnité parlementaire appartient plutôt à la catégorie (S), car pour l'avoir il faut posséder l'habileté et la chance de se faire élire.
Les dépenses de notre parlementaire donnent un total de 64 200 fr., décomposé ainsi : dépenses pour la maison : 33 800 fr., pour le bureau : 22 550 fr., pour le collège électoral (dépenses avouables) : 7850 fr. Il y aurait donc un déficit de 45 700 fr., qui non seulement est comblé, mais se change en un boni, grâce aux revenus suivants : collaboration à des journaux et autres publications : 12 500 fr. ; honoraires d'agent général de la maison *** : 12 000 fr., plus un tant pour cent sur les ventes, 7500 fr. À ce propos, M. Prezzolini note : « Mais voilà que M. X, rapporteur du budget de la guerre, y inscrit 100 000 fr. pour des fournitures qui sont passées au même M. X, agent général de la maison *** », ce qui procure à M. X un tant pour cent. Enfin, notre parlementaire, grâce à l'influence dont il jouit, est appointé par un journal, et de ce chef il touche 18 000 fr. En tout, ces revenus, qui appartiennent manifes- tement à la catégorie (S), donnent un total de 50 000 fr. M. Prezzolini ajoute que ce parlementaire n'est « ni le seul ni le moindre » de son espèce, mais qu'il en est uniquement un type « mieux connu et plus sincère ».
[FN: § 2235-1]
Beaucoup de personnes jugent que de tels faits suffisent pour condamner notre organisa- tion sociale et lui attribuer la plupart des maux dont nous souffrons. D'autres personnes croient ne pouvoir défendre cette organisation qu'en niant les faits ou en leur enlevant toute importance. Les uns et les autres ont raison au point de vue éthique (§ 2162, 2262), tort au point de vue expérimental de l'utilité sociale (§ 2115).
Il est évident que si l'on pose comme axiome que les hommes doivent, quoi qu'il arrive, suivre certaines règles, il s'en suit nécessairement qu'il faut condamner ceux qui ne les suivent pas. Un tel raisonnement, si on veut lui donner une forme logique, a pour prémisses quelques propositions du genre de celles que nous avons déjà notées (§ § 1886, 1896, 1897). Si l'on ajoute que l'organisation condamnée est en somme nuisible à la société, il faut logiquement avoir recours à quelques prémisses du genre de celles qui confondent la morale et l'utilité § § 1495, 1903 à 1998). En revanche, si l'on admet de semblables prémisses et que l'on veuille néanmoins défendre, approuver l'organisation de nos sociétés, on n'a d'autre ressource que de nier les faits ou, du moins, de les supposer négligeables.
Le point de vue expérimental est entièrement différent. Qui s'y place n'admet pas d'axiomes indépendants de l'expérience, et se trouve, par conséquent, dans la nécessité de discuter les prémisses des raisonnements précédents. Ce faisant, il est conduit à reconnaître qu'il se trouve en présence de deux phénomènes, lesquels ont certains points communs, mais ne coïncident pas entièrement (§ 2001), et qu'il faut en chaque cas particulier demander à l'expérience de décider s'il s'agit d'un point de contact ou d'un point de divergence.
La moindre réflexion suffit à faire voir que celui qui accepte certaines conclusions adopte, par là même, les prémisses auxquelles elles sont liées indissolublement. Mais la force du sentiment et l'influence d'une manière habituelle de raisonner sont telles que l'on néglige entièrement la force de la logique, et que l'on établit les conclusions sans se soucier des prémisses, ou que, tout au plus, on les admet comme des axiomes qui sont soustraits à toute discussion. Cette puissance et cette influence ont aussi pour conséquence que, malgré l'avis donné et maintes fois répété (table III-III-m) il se trouvera presque certainement des personnes pour étendre au delà du sens rigoureusement limité les observations que l'on va lire au sujet des classes (R) et (S) : pour interpréter tout ce qui est signalé à la charge d'une de ces classes comme impliquant le jugement que l'action de cette classe est, dans son ensemble, nuisible à la société, et la classe elle-même « condamnable » : tout ce qui est dit en sa faveur, comme preuve que l'action de cette classe est, en général, utile à la société, et la classe elle- même digne de louanges. Nous n'avons ni le moyen, ni même le moindre désir d'empêcher de semblables interprétations de se produire ; il nous suffit de les noter comme un genre de dérivations (§ 1119 - I-β).
[FN: § 2235-2]
Comme d'habitude, il faut se rappeler qu'il n'y a rien à déduire du sens vulgaire ou de l'étymologie de ces noms, et que nous les emploierons exclusivement dans le sens défini aux § 2233-2234 auxquels il conviendra toujours de se reporter, chaque fois que l'on rencontrera ces noms dans la suite de l'ouvrage.
[FN: § 2236-1]
Comme d'habitude, nous pouvons nous demander : « Si ce phénomène social est si important, comment se peut-il que les gens ne s'en soient pas aperçus jusqu'à présent ? » Comme d'habitude aussi, la réponse est que les gens s'en sont aperçus, mais qu'ils l'ont recouvert du voile des dérivations. L'antisémitisme a pour substratum un mouvement contre les « spéculateurs ». On dit que les Sémites sont plus spéculateurs que les Ariens ; c'est pourquoi ils passent pour représenter la classe entière des spéculateurs. Qu'on prête attention, par exemple, à ce qui se passe avec les grands magasins, les bazars. Ils sont attaqués, spécialement en Allemagne, par les antisémites. Il est vrai que beaucoup de ces commerces sont dirigés par les Sémites ; mais ceux qui sont dirigés par des chrétiens ne font pas défaut. Les premiers comme les seconds sont nuisibles au petit commerce, que veulent protéger les antisémites, qui, en ce cas, sont simplement anti-spéculateurs. Il en est de même des syndicats financiers et des autres formes que prend la spéculation. Les socialistes s'en prennent aux « capitalistes », et théoriquement il est vrai que ceux-ci ne se confondent pas avec les « spéculateurs ». Mais pratiquement, les foules qui suivent les chefs socialistes n'ont jamais rien compris aux belles théories de Marx sur la plus-value. Elles sont mues exclusivement par l'instinct de s'approprier une partie au moins des richesses qui appartien- nent aux « spéculateurs ». Même les théoriciens, lorsqu'ils parlent du « capitalisme » dans l'histoire, le confondent, au moins en partie, avec le domaine des « spéculateurs ». Enfin, quiconque voudrait remonter plus haut dans l'histoire trouverait des traces abondantes d'observations et de doctrines où apparaît le conflit entre les « spéculateurs » et le reste de la population. À Athènes, les hommes du Pirée sont en conflit avec les agriculteurs, et Platon veut placer sa République loin de la mer, précisément afin de la soustraire à l'influence des « spéculateurs ». En cela, il est le précurseur de nos antisémites contemporains. Dans toute l'histoire, en tout temps, se manifeste l'influence des « spéculateurs ». Les formes sous lesquelles elle se manifeste varient ; les noms qu'on lui donne varient encore plus, ainsi que les dérivations qu'elle provoque ; mais le fond demeure.
[FN: § 2240-1]
Le meilleur gouvernement qui existe aujourd'hui, meilleur même que tous ceux qu'on a pu observer jusqu'ici, est celui de la Suisse ; spécialement sous la forme qu'il assume dans les petits cantons : la démocratie directe. C'est un gouvernement « démocratique »; mais il n'a que le nom de commun avec les gouvernements qui se disent aussi « démocratiques », dans d'autres pays. Tels ceux de la France et des États-Unis d'Amérique.
[FN: § 2247-1]
Souvent les hommes pratiques saisissent cela par intuition, mais ils sont empêchés de l'appliquer à cause de raisonnements pseudo-théoriques, ou bien par des obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. – BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. I. Il s'agit des territoires qu'il pouvait être avantageux à l'Allemagne de se faire céder par la France : « (p. 64) D'Alvensleben, lui, voulait qu'on gardât tout le pays jusqu'à la Marne. M. de Bismarck dit qu'il avait une autre idée, mais que, malheureusement, elle était impossible à réaliser. – Mon idéal aurait été, fit-il, une sorte de colonie allemande, un État neutre de huit ou dix millions d'habitants, exonérés de tout service militaire, mais dont les impôts, dès qu'ils n'auraient pas été appliqués aux besoins locaux, auraient été payés à l'Allemagne. La France aurait de la sorte perdu une province dont elle tirait ses meilleurs soldats et aurait été rendue inoffensive ». Que l'on compare cette vue large à l'oppression actuelle, tendant à changer à propos de futilités souvent insignifiantes les sentiments de la population sujette.
[FN: § 2253-1]
ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarades : « (p. 56) Sans doute, on s'obstine, probablement à cause d'une vieille tournure d'esprit, à (p. 57) avoir des programmes, mais on tient rarement à les faire aboutir... Et cela tient à ce que les programmes ne sont pas faits pour aboutir. Les principes de la bourgeoisie républicaine datent de 1789. Le socialisme de Marx date de 1848. Le programme radical date de 1869. Soyez assurés qu'ils serviront longtemps encore. La lutte entre ces diverses conceptions de tout repos n'en constitue pas moins ce qu'on appelle : „ la politique moderne “. (p. 58) Un programme qui aboutit cesse par là même d'exister... (p. 59) Presque toutes les lois importantes ont été soumises aux discussions du Parlement par des ministres qui n'y croyaient pas, ou qui même s'en étaient proclamés les adversaires irréductibles ». Mais comme ce sont aussi des gens intelligents et rusés, on est obligé de reconnaître qu'il doit y avoir une force puissante qui les pousse dans cette voie. On ne peut trouver cette force que dans l'organisation sociale qui a donné le gouvernement aux « spéculateurs ». L'auteur continue : « (§ 59) Lisez les confidences de Waldeck-Rousseau. Vous y verrez qu'après avoir poursuivi devant la Haute-Cour un complot dont il n'était pas très sûr, il a rendu nécessaires les retraites ouvrières dont il n'attendait rien et l'impôt sur le revenu dont il redoutait tout. „ Nous avons été condamnés, écrivait-il, à adopter comme une règle supérieure à tout le reste la nécessité de ne pas tomber. Nous avons dû faire des concessions de principe, tout en nous efforçant d'en éviter la réalisation “ » Mais pourquoi a- t-il fait tout cela ? Parce qu'il voulait réhabiliter Dreyfus. Et pourquoi voulait-il réhabiliter Dreyfus ? Parce qu'un mouvement intense avait envahi le pays, mouvement provoqué au moins en partie par une presse largement payée par des gens qui espéraient se récupérer ensuite de leurs dépenses. Les spéculateurs voulaient en tirer profit, de même qu’ils tirent profit de l'existence de mines, d'inventions, etc. Ce fut la source du courant qui entraîna Waldeck-Rousseau, déjà défenseur et ami des spéculateurs et ses collaborateurs. Il porta sur ses flots limoneux le vaisseau des nouveaux Argonautes, partant pour la conquête de la toison d'or ; et finalement, nos Argonautes obtinrent en abondance richesses, pouvoir, honneurs. – « (p. 60) Un président du Conseil qui ne croyait pas à la séparation des Églises et de l'État l'a rendue inévitable. Un autre l'a signée qui ne l'avait jamais voulue. La plupart des radicaux aujourd'hui sénateurs ont jadis lutté pour la suppression du Sénat et beaucoup de députés coloniaux se sont prononcés dans leur jeunesse contre la représentation coloniale. Le Sénat, qui fut à peu près tout entier hostile au rachat de l'Ouest et à l'impôt sur le revenu, a voté le rachat de l'Ouest et votera l'impôt sur le revenu ». C'est ainsi que l'on paie aux sentiments populaires la rançon des opérations lucratives qu'effectuent en attendant des financiers retors, des entrepreneurs et d'autres spéculateurs. En Italie, une Chambre qui était contraire à l'extension du droit de vote, qui repoussa la proposition très modérée du ministre Luzzatti, approuva la proposition beaucoup plus hardie de Giolitti, parce que cette Chambre ne pouvait s'opposer à qui était si expert dans l'art de protéger les trusts et les intrigues électorales. Quant à Giolitti, il voulut l'extension du droit de vote, afin de payer ainsi l'appui des socialistes transformistes et d'autres démocrates, et pour atténuer de la sorte l'opposition qu'ils auraient pu faire à ses entreprises, parmi lesquelles il faut ranger la guerre de Libye. Il ne la voulut pas, au début, mais elle lui fut imposée par les sentiments d'un grand nombre de citoyens.
[FN: § 2254-1]
Le phénomène est très bien décrit dans le discours que fit le ministre Briand à Saint- Étienne, le 20 décembre 1913. « il y a dans notre démocratie des impatiences fébriles, il y a des ploutocrates démagogues qui courent vers le progrès d'une course si frénétique que nous nous essoufflons à vouloir les suivre. Ils veulent, ceux-là, le tout ou le rien. Dans le moment même où ils s'enrichissent avec une facilité scandaleuse, dans ce moment même, ils ont le poing tourné vers la richesse, dans un geste si menaçant, si désordonné, si excessif, que nous avons le droit de nous demander si c'est bien pour l'atteindre, si ce n'est pas plutôt pour la protéger ». Mais les financiers auxquels le ministre Briand fait allusion laissent dire et continuent à gagner de l'argent.
Le phénomène est de tous les temps et de tous les pays où dominent les « spéculateurs ». – La Liberté, 14 avril 1913 : « Le banquier Carbonneau et ses amis politiques. Chaque fois que la police met la main au collet d'un financier véreux, elle fait sûrement de la peine à un député bloquard, qui, c'est une fatalité, est l'ami et l'avocat-conseil de tous les lanceurs d'affaires qui tournent mal. Ils sont un certain nombre qui ont cette spécialité. Un surtout, dont le nom vient spontanément à l'esprit dès qu'on arrête un Carbonneau quelconque. Lorsque les Duez, les Martin-Gauthier, les Rochelle, les Carbonneau ont besoin d'un bon avocat-conseil, c'est au député X..., qu'ils s'adressent spontanément, parce qu'ils sont assurés d'avance que comme conseilleur il ne les empêchera pas de tondre les payeurs ; et que, comme député, jouissant d'une grosse influence au Parlement et dans les Loges, il couvrira le bateau et les pilotes de son pavillon » (§ 2256 1).
[FN: § 2255-1]
M. PANTALEONI, dans le Giornale degli Economisti, septembre 1912 : « (p. 260) Le monopole attribué à l'Institut [des assurances sur la vie] a un double but. D'un côté, on confie à l'État l'exercice de l'Industrie des assurances sur la vie; de l'autre, on donne à l'État un Instrument qui lui procure la disponibilité de moyens financiers considérables... L'Instrument financier au moyen duquel l'État réussit à avoir pour un grand nombre d'années la disponibilité de capitaux considérables, qu'on forme avec les annuités que les assurés paient, et dont la restitution, sous forme de sommes assurées par les personnes qui contractent avec l'Institut, n'interviendra que d'ici à un grand nombre d'années [et que l'État paiera ou ne paiera pas, selon l'intérêt de ceux qui auront alors la haute main, et selon l'excédent de recettes au budget], cet Instrument financier a été dissimulé au Parlement et aux contribuables, comme de raison, car on n'avoue pas l'existence d'une dette hors budget [et même si on l'avait avouée, ç'aurait été la même chose ; la ploutocratie démagogique se soucie peu de l'avenir]... (p. 261) Le gouvernement parlementaire a d'innombrables mérites, mais aussi plusieurs défauts. Parmi ces défauts, il en est trois qui ressortent. D'un côté, la culture politique défectueuse de la grande masse des membres du Parlement est manifeste... D'un autre côté, c'est un phénomène universel que la division des Chambres en partis de niveau moral très bas. En raison de cette division, tout acte du gouvernement, destiné à surmonter quelque grave difficulté politique, n'est pas discuté à des points de vue généraux et embrassant des intérêts communs..., mais considéré comme une occasion propice et largement ouverte pour renverser ou racheter le gouvernement. En fin de compte, la publicité des discussions est une règle canonique... Ces caractères du régime parlementaire, qui n'entraînaient pas de graves inconvénients, tant que les Chambres avaient des fonctions de contrôle financier seulement … obligent le gouvernement à passer sous silence ou ne pas pouvoir dire clairement la moitié de ce qu'il veut obtenir à s'efforcer de masquer les moyens qu'on met en œuvre, et à payer, tantôt à ce groupe parlementaire, tantôt à cet autre, un droit de péage, ou, pour le dire sans euphémisme, la rançon ». D'autre part, l'auteur approuve l'opération parce qu'elle pourrait servir à procurer les fonds nécessaires à une guerre future. Mais il est bon de remarquer que si elle pouvait servir à cela, de fait, elle n'y servit point, et que l'argent alla aux clientèles de la classe dominante, tandis que flotte et armée demeurèrent aussi peu préparées que possible.
[FN: § 2256-1]
Les descriptions faites par des hommes du métier qui suivent les méthodes empiriques, sans s'embarrasser de théories, sont très utiles pour bien connaître les faits, car elles échappent au danger, toujours menaçant, de plier, même involontairement, la description des faits à la théorie. C'est pourquoi nous citons ici la description que The Financial Times, 27th March 1914, donne des phénomènes auxquels nous faisons allusion. Nous rappelons que cette description s'applique non seulement à la France, mais aussi à d'autres pays où dominent les « spéculateurs ». Par exemple, pour les États-Unis d'Amérique, il y aurait beaucoup à ajouter, plutôt que de retrancher quoi que ce soit à cette description : « Paris, 24th March. – We have heard a good deal of late about „ plutocratic democrats “ and „ democratic plutocrats “ by which is meant either a wealthy financier who becomes a demagogue for the sake of political influence rather than from any real conviction, or – and this is more widely the case in France – a demagogue who has no objection to become a wealthy financier if circumstances permit. M. Barthou, M. Briand and their friends have freely used the expression in connection with M. Caillaux, to whom they are politically opposed, and it is a fact that certain prominent Republican politicians belonging to all sections of the Republican party have of late years turned their political influence to considerable personal advantage ». Suit un long récit d'exploits accomplis par des hommes d'État d'accord avec les financiers. Nous le laissons de côté, non seulement en raison de son étendue, mais aussi parce que nous préférons ne pas citer des noms propres, car, en les citant, on détourne facilement l'attention des uniformités générales, pour l'amener à s'arrêter sur des considérations éthiques, de parti, de bienveillance ou de malveillance particulière. La conclusion de l'article nous ramène aux faits généraux, qui importent davantage à une étude scientifique. « Need of a political protector. – As a matter of fact, it bas long been the fashion with French financial and other companies to provide themselves with a „ paratonnerre “ or „ lightning rod “ in the shape of a person of political influence who can act more or less as a mediator in high places, and who, on occasion, can help to shield financiers who may be liable to get into trouble or protect interests that may be in danger from threatened legislation. As a rule politicians are very chary of being openly connected with any but concerns of very high reputation ; but there are others. Thus, there are many barristers who are both clever pleaders and brilliant politicians. Many are the concerns, which willingly pay huge annual fees to a political barrister in order to secure his services as „ legal adviser “. The legal adviser is paid quite as much for his political influence as for his legal advice, and he runs no risk, not being openly connected with the concern. It is natural, perhaps, in a country where kissing goes by favour – ad show me the country in which it does not ! – that people interested in important business schemes should endeavour to obtain a hearing with the powers that be by securing as influential a political intermediary as they can get, but the practice undoubtedly has its drawbacks » 2254-1).
[FN: § 2256-2]
GUGLIEMO EMANUEL ; dans le Corriere della Sera, 9 février 1914 : « L'épisode suivant est caractéristique du système [en Angleterre]. Je l'ai entendu raconter un soir, dans une conférence politique, par un homme du parti libéral. Étant décoré et député, il en savait certainement long. Avant les élections de 1906, qui donnèrent aux libéraux la majorité et le gouvernement, il discutait avec un ami, devenu ministre par la suite, le scandale de la « vente » de titres honorifiques à laquelle se livrait le ministère unioniste d'alors. Encore ingénu et ignorant des intrigues politiques, il soutenait chaudement : „ Quand nous serons au pouvoir, nous devrons mettre fin à cette indécence “. – „ En vérité, – répondit avec calme le futur ministre, – je crois, au contraire, que lorsque nous serons au pouvoir, il faudra vendre autant de titres honorifiques que possible, pour remplir le coffre-fort du parti. “ À en croire ce qu'affirment les journaux d'opposition, il paraît que le projet du ministre en herbe a été réalisé sans réticences. Les mauvaises langues disent qu'on a établi un tarif. On ne payerait pas moins de 125 000 francs, pour obtenir un knighthood, titre qui correspond à celui de chevalier. Une donation de 625 000 francs serait nécessaire pour posséder un baronetey, soit le titre de baronnet. Quant au titre de lord, ou pair du royaume, on ne payerait pas moins d'un million et demi... L'argent produit parles « ventes », est versé au « trésor de guerre ». C'est le Chiefwhip qui l'administre ». Telle est l'origine du gouvernement d'« un État éthique ou de droit », admiré par les naïfs. Dans d'autres pays, il se produit des faits analogues. En Autriche-Hongrie, le trafic des décorations et des titres nobiliaires est très actif. Dans tous les pays civilisés, le gouvernement dispose de subventions considérables, qui servent à des fins électorales. La Liberté, 10 mai 1914 : « Les naïfs s'imaginent que le gouvernement n'a, pour „ faire “ les élections, que la maigre ressource des douze cent mille francs inscrits au chapitre des fonds secrets. La caisse noire est infiniment plus abondante que cela. On cite un ministre de l'agriculture blocard qui disait : „ Je dispose de 30 millions par an que je puis distribuer à ma guise et sans contrôle pour les besoins de la politique gouvernementale “, sous prétexte de subventions agricoles. Il y a aussi le produit des jeux (cagnotte des cercles et pari mutuel des courses de chevaux). Le gouvernement a la libre disposition, hors budget, de cette véritable caisse noire. Or, le produit des jeux dans les casinos et au pari mutuel a permis d'effectuer, en 1912, un prélèvement pour les œuvres de bienfaisance supérieur à 24 millions de francs. Ce total s'est accru encore en 1913. Ces oeuvres de bienfaisance ont avant tout un caractère électoral. C'est ce qui permet à un X [nous supprimons le nom] de dire à ses électeurs : „ En huit ans, je vous ai fait accorder pour un million de subventions ! “ ».
[FN: § 2257-1]
Il reste à accomplir une étude de ces moyens, considérés techniquement, par rapport à leur efficacité et à leur coût, en laissant de côté les divagations éthiques, la recherche de « remèdes » et les prêches, qui sont aussi inutiles que si on les adressait au phylloxéra pour l'engager à ne pas dévaster les vignes. Nous ne pouvons nous en occuper ici. Le lecteur trouvera de précieux renseignements pour les collectivités anglo-saxonnes, dans l'ouvrage classique d'OSTROGORSKI, La démocratie et les partis politiques, et, pour l'Italie, dans l'excellent livre de GIRETTI, I trivellatori della nazione.
[FN: § 2257-2]
Le procédé consistant à payer directement le vote des électeurs fut un moyen largement employé partout, et continue à l'être encore, bien que peut-être en de moindres proportions. Celui qui est vaincu par ce moyen le condamne sévèrement, et souvent de bonne foi. Celui qui en profite feint parfois de le condamner, mais quelquefois aussi prend franchement la défense des avantages procurés aux électeurs. Voici un exemple. Parlant de l'élection qu'on préparait à Cuneo, la Rivista popolare, 15 juin 1913, rapporte un passage d'un journal gouvernemental, emprunté à l'Unità de G. SALVEMENI, 16 mai 1913 : « (p. 288) Indépendamment de l'idée de la corruption électorale que nous ne pouvons même concevoir (sic ! remarque la personne qui cite cette prose), c'est un fait que les élections générales mettent en circulation beaucoup d'argent [ce n'est pas de la corruption, mais c'est tout comme]. Et quand l'argent circule, il circule pour tout le monde. C'est pourquoi on veut faire durer le plaisir. Nous le comprenons, ce sont des sacrifices, et des sacrifices très lourds, parce qu'ils ont un caractère financier. Mais la noble ambition de servir son pays doit bien impliquer quelque sacrifice. D'autre part, aucune loi n'oblige nos hommes politiques à courir la chance des élections. S'ils n'ont pas (p. 284) d'argent et ne savent pas en trouver, s'ils en ont et ne veulent pas faire de dépenses, qu'ils restent chez eux. Nous le répétons, personne ne les oblige à se mettre sur les rangs. L'honorable Giolitti, d'accord avec le chef de l'État, fixera les nouvelles élections quand il le jugera opportun, et quoi qu'il fasse, il fera bien. Pour notre compte, interprètes sûrs de l'immense majorité [des habitants] du pays, nous désirons que la campagne électorale soit longue, très longue. On glosera beaucoup, mais beaucoup d'argent circulera aussi ; il descendra jusqu'aux dernières couches sociales. En sorte que, – pour conclure,– que les candidats anciens et nouveaux ne se préoccupent pas de la date précise des élections, mais qu'ils se souviennent de l'avertissement du Seigneur : Estote parati. Qu'ils soient prêts, car ils ne savent ni le jour ni l'heure du fameux décret. Qu'ils soient prêts c'est-à- dire munis de tout, spécialement de viatique ». Le journal aurait pu ajouter que ce viatique est fourni à ses maîtres par les contribuables, tandis que les adversaires doivent le tirer de leur poche. Un honnête homme, comme il en est encore plusieurs, fait cette dépense, et voilà tout. Un autre homme, moins honnête, et il en est un très grand nombre, considère cette dépense comme un capital qu'il fait fructifier, lorsqu'il est élu. Et parfois, dans ce but, il pactise avec ses adversaires de naguère.
[FN: § 2257-3]
Toutes ne se font pas avec de l'argent ; les plus économiques sont celles que l'on fait en accordant des faveurs honorifiques ou autres. Elles rapportent parfois même de l'argent, que l'on peut ensuite employer à d'autres corruptions. Un exemple qui peut servir de type est celui dont on eut connaissance en Autriche, en 1913, et que le correspondant du journal La Liberté décrit très bien. La Liberté, 26 décembre 1913 : « M. Stapinski, chef du parti populaire polonais, a reçu de M. de Dlugosz, membre du cabinet en qualité de ministre pour la Galicie, des sommes importantes pour la presse et pour les opérations électorales du parti. C'est M. de Dlugosz lui-même qui le lui a reproché. Mais il se trouve que M. Stapinski est infiniment moins blâmable qu'on ne le crut tout d'abord. M. de Dlugosz, qui est polonais comme lui, est ami politique de son parti et possesseur d'une fortune considérable. En s'adressant à lui pour les besoins du parti, le député agissait correctement, et les sommes qu'il a reçues, il a cru les recevoir du coreligionnaire politique, du Polonais riche, généreux et dévoué à la cause. Or, il n'en était pas ainsi. M. de Dlugosz a mis à profit sa situation de membre du cabinet pour se faire accorder ces sommes par le président du conseil. L'argent provenait des fonds secrets. M. Stapinski ne le savait pas, et il n'a pas su non plus que M. de Dlugosz lui versait moins qu'il ne se faisait donner par la caisse des fonds secrets... Le cas du président du conseil, bien que très limpide au point de vue de l'honorabilité personnelle, n'est guère moins fâcheux au point de vue de l'exercice correct de sa fonction : il a disposé des fonds secrets dans un but de corruption parlementaire. À vrai dire, on sait bien que le gouvernement a des disponibilités pour influer sur les députés ou sur des groupes, mais on le sait sans le savoir : tant pis pour le ministre qui laisse saisir manifestement sa main dans une opération de ce genre. Il ne lui reste qu'à disparaître. Cette affaire a donné lieu à de longs débats au cours desquels la Chambre a entendu de belles vérités. M. Daszynski, par exemple, certifie que, depuis sept ans, les élections de Galicie ont coûté quatre millions aux fonds secrets de l'intérieur. Or, l'intérieur ne dispose, sous ce titre, que de 200 000 couronnes par an, soit en sept ans 1 400 000 couronnes. Où a-t-il trouvé le surplus de 2 600 000 ? Un interrupteur a répondu – Et les dons pour but humanitaire ? – Voici ce que signifie cette observation : Dans les heures critiques de l'ancienne Rome, on nommait un dictateur ; ici, on crée des barons ; ce sont des financiers et des industriels richissimes ; le décret mentionne comme titres à la nomination : services à l'économie nationale, à l'industrie, au commerce, donations humanitaires. C'est une croyance solidement établie ici que les services les plus spécialement récompensés sont ceux dont le décret ne parle pas. Ainsi s'explique l'énorme disproportion qui existe entre les libéralités de la caisse des fonds secrets, soit du ministère de l'intérieur, soit des affaires étrangères, et la modicité de la dotation régulière de ces deux départements pour leurs opérations discrètes. N'a-t-on pas établi qu'un seul journal, la R., [nous supprimons le nom] coûtait à l'intérieur près de cent mille francs par an de plus que l'allocation totale des fonds secrets ? Je ne parle que de l'intérieur. Si nous nous occupions des opérations de l'autre département, la chose nous mènerait trop loin, puisqu'elle nous engagerait dans des excursions à l'intérieur [il faut probablement lire extérieur]. Le député Tusar a fait remarquer avec beaucoup d'à propos que, depuis quelque temps, on ne sortait pas des affaires vilaines : c'est vrai. Nous avons eu l'affaire Prohazka, l'affaire de la Société des jeux en Hongrie et maintes autres, mais surtout celle du Canadian Pacific, qui est un des scandales les plus surprenants dont on ait jamais eu le spectacle. Là, je dois le dire, le fonctionnarisme autrichien apparaît dans un rôle sympathique, honorable et presque touchant. Le ministère du commerce voit le port de Trieste boycotté et la navigation nationale étranglée par le puissant syndicat des compagnies allemandes qui travaillent pour Brême et Hambourg, et opèrent avec un sans-gêne aussi brutal que celui du sous-lieutenant Forstner et de son colonel. En conséquence, et afin de briser ce monopole, il s'entend avec une compagnie anglaise assez puissante pour soutenir la lutte, le Canadian Pacific, qui favorisera le port de Trieste en y dirigeant l'émigration. J'estime, disait avec émotion à, la commission d'enquête un chef de division de ce ministère, j'estime que le fonctionnarisme autrichien a bien le droit de servir les intérêts de l'Autriche ! Mais le puissant syndicat allemand met en mouvement un journal, la Reichspost, et des émissaires qui obtiennent l'aide de l'autorité militaire, et par ordre de celle-ci, tout le personnel du Canadian Pacific est arrêté, ses bureaux sont fermés et ses services suspendus. On a vu par conséquent des intérêts étrangers triompher des intérêts nationaux, et la direction de l'armée autrichienne se faire, à son insu sans doute, l'agent instrumentaire du syndicat allemand contre le gouvernement autrichien. Il a fallu l'intervention de la Chambre et l'enquête parlementaire pour ramener dans le droit chemin l'autorité militaire dévoyée par la Reichspost et les autres agents du grand syndicat allemand. Quelle fut dans ces rôles divers la part de l'inintelligence et celle de la vénalité ? Que ceux-là le disent qui le savent, mais tout n'est pas imputable à la maladresse ni à la simplicité, car le cas du candide député Stapinski, vendu sans le savoir, doit être une exception assez rare à notre époque peu naïve » (ACHILLE PLISTA). – En Angleterre, les élections faites par le ministre Asquith pour déposséder la Chambre des Lords coûtèrent des sommes énormes, fournies en grande partie par de riches industriels et commerçants. En Italie, et plus encore en France, la distribution des décorations est un moyen de gouvernement qui a le mérite de ne pas coûter de l'argent. L'invention du « mérite agricole », souvent décerné à qui ne sait pas même distinguer l'orge du froment, celle des « palmes académiques », souvent données à qui est en guerre avec la grammaire, et d'autres titres honorifiques, ont fait épargner des millions et des millions au pays. En Italie, le gouvernement se sert aussi de son pouvoir d'accorder ou de refuser le port d'armes. Il l'accorde à ses partisans, le refuse à ses adversaires. Surtout en temps d'élections, il arrive que là où la lutte est la plus vive, il l'accorde à la clique enrôlée, qui soutient le candidat du gouvernement par des procédés qui ne sont pas toujours licites, tandis qu'il le refuse au parfait honnête homme qui se montre favorable au candidat d'opposition. Depuis le temps où Aristophane étalait au grand jour, sur la scène, la corruption des politiciens athéniens, jusqu'au temps où l'enquête du Panama et d'autres semblables dévoilaient la corruption des politiciens contemporains, bien des siècles se sont écoulés, on a écrit force traités de morale et fait d'innombrables prêches dans le but de ramener les hommes à une conduite honnête et droite. Comme tout cela a été vain, il est évident que les théories éthiques et les prêches ont été absolument impuissants à faire disparaître, ou seulement à diminuer la corruption politique, et il est très probable qu'ils demeureront tels à l'avenir. Tout autres sont les faits avec lesquels le phénomène est en relation étroite. On remarquera encore que la connaissance désormais certaine et très étendue de tant de ces faits de corruption politique, est impuissante à ébranler la foi de certains intellectuels en « l'État éthique », et celle du vulgaire dans les gouvernements qui doivent, au moins en partie, leur existence et leur pouvoir à cette corruption. De même, au moyen âge, la simonie et les mauvaises mœurs de beaucoup de papes n'entamèrent nullement la foi catholique. Bien plus, dans une de ses nouvelles, Boccace montre par une belle dérivation qu'elles devaient la confirmer. À chaque pas, nous trouvons des faits semblables, qui font voir que, dans les populations, il existe deux courants : l'un de raisonnements logiques ou pseudo-logiques, l'autre de conceptions non- logiques, de croyances, de foi dont les hommes ne perçoivent pas les contradictions ; ou s’ils les perçoivent, aussitôt ils les repoussent comme chose importune, et les oublient. Ces deux courants coulent parallèlement, sans mêler leurs eaux, et sont, au moins en partie, indépendants.
[FN: § 2259-1]
Plusieurs gros volumes ne suffiraient pas pour citer ne fût-ce qu'une partie des faits très nombreux, observés à diverses époques et dans tous les pays. En Italie, parmi tant d'autres exemples, on peut citer celui de la construction du Palais de Justice, à Rome. Pour les détails, voir EUGENIO CHIESA ; La corruzione politica. L'inchiesta sul Palazzo di Giustizia, avec préface de NAPOLEONE COLAJANNI. Entre autres conclusions, la Commission d'enquête tire celle-ci : « 4. L'intromission de l'autorité politique dans la construction du Palais, très intense et nuisible même dans la période des travaux en régie, pour lesquels on dépensa 937 328 francs, nominalement pour des travaux de conservation et de préparation, en fait pour donner de l'ouvrage à 400 ouvriers appelés les tailleurs de pierre d'État, à cause de leur immutabilité et de leur maigre productivité. Il est intéressant de remarquer que cela est écrit sous un gouvernement dont c'était un artifice habituel que d'accorder des subsides à certaines coopératives, pour se concilier les bonnes grâces des socialistes. Aussi bien que les tailleurs de pierre, ces coopératives méritaient le nom de coopératives d'État (§ 2261 1) ». L'œuvre du ministre Branca avait été blâmée par la Commission. La veuve du ministre écrivit très justement au Giornale d'Italia (30 avril 1913) : « ... permettez-moi... de protester vivement contre ce que la dite Commission reproche à mon défunt mari, Ascanio Branca. Je me souviens très bien que lorsqu'il fut ministre des Travaux Publics, il dut donner suite à la convention en question sur les injonctions du ministre de l'intérieur d'alors, le marquis Di Rudini, lequel, préoccupé de responsabilités d'ordre public [quand on ne peut employer la force, il faut avoir recours à l'artifice], pour éviter une grève très grave, crut devoir régler de cette manière sa conduite politique ». De même, c'est en toute justice que le fils du défunt ministre Ferraris défendit efficacement son père, en citant et en prouvant les nombreuses pressions exercées sur celui-ci, qui était garde des sceaux, dans l'affaire du Palais de Justice. Entre autres lettres, remarquable est celle que le garde des sceaux écrivait le 11 juillet au Président du Conseil (Giornale d'Italia, 3 mai 1913) : « Avant de céder, comme vous dites – et c'est la vérité – qu'il me soit permis de dire ce que je pense de la question des travaux publics de Rome. Depuis 1879, le Gouvernement et la Commune se sont fait illusion ou ont voulu se faire illusion : ils ont certainement fait illusion au Parlement, au Pays [à vrai dire, ce ne fut pas une illusion, mais une conséquence d'un certain procédé de gouvernement]. Au lieu de prendre résolument sur lui aussi bien les frais que la direction des travaux nécessaires à la transformation de la capitale,... l'État les céda ou feignit d'en abandonner la charge à la Commune. Celle-ci s'en chargea, en partie sans savoir ce qui se faisait, et peut-être encore plus parce qu'elle acceptait, en attendant, le concours de l'État, sauf à régler les comptes plus tard. En tout cas, la Commune accepta le subside. Le Gouvernement, complice ou impuissant, la laissa faire... En attendant, la Commune fit tout de travers, et sera toujours dans l'impossibilité de bien faire, parce qu'elle n'a pas de traditions, parce que la politique s'en mêle [et dans le gouvernement ? La politique fait plus que de s'en mêler ! elle y domine !], parce que dans les élections ce ne sont pas les véritables intérêts communaux qui prédominent; enfin parce qu'elle est entraînée ou par connivence, ou par faiblesse, ou par incapacité [c'est exactement, précisément ce que l'Enquête a démontré être arrivé pour le gouvernement]. Le comble des erreurs fut la loi du 20 juillet 1890. Maintenant je vois que les mêmes erreurs se produisent avec cette loi par dessus le marché. Le Gouvernement veut se ménager la bienveillance de la Commune ; il veut éviter la crise municipale. Il n'a ni système ni courage pour trancher la question ouvrière [c'est toujours l'artifice qui remplace la force]. Il en résulte par conséquent que tous sont comme l'homme qui s'enfonce dans la fange [c'est dans la fange que les anguilles et les politiciens se trouvent bien] ; plus il s'agite, plus il s'enfonce. Pendant ce temps, Commune, Entreprise, agitateurs en profitent... Cela dit, moi qui suis d'une opinion contraire à celle que je vois l'emporter au Cabinet, je cède pour beaucoup, et même pour toutes les raisons ; mais vouloir que je choisisse comme représentant un magistrat romain, c'en est trop. Au sujet de la pression qu'on avait exercée sur moi [n'oublions pas que c'est le ministre chef de la magistrature qui écrit, et sur lequel on exerce des pressions ; mais alors quelles pressions doit-on exercer sur les simples magistrats, quand on veut obtenir d'eux des services politiques !], j'avais déjà donné des instructions au conseiller Gargiulo. Je le relèverai de cette fonction. Mais il ne fera pas d'autre désignation. À vous de m'indiquer qui je dois nommer, et je ferai la nomination en sachant que du moins je n'aurai aucune responsabilité de ce que fera ou ne fera pas mon délégué ». (La minute de la lettre est tout entière de la main de Ferraris.) Il est regrettable q ne nous n'ayons pas toutes les lettres que se sont écrites les ministres, en France et en Angleterre, à propos d'affaires : il y en aurait certainement de semblables. Il ne manque d'honnêtes gens dans aucun pays ; mais ils sont impuissants à résister aux artifices des politiciens. Ils sont broyés par cette puissante machine du régime politique. Parmi tant de documents qu'on pourrait citer, voir Atti della Commissione d'Inchiesta parlamentare sulle Banche, Roma 1894. Interrogatorii. Interrogatoire de Pietro Antonelli, p. 8 à 11. Interrogatoire de Carlo Cantoni, p. 38 à 39. En général, on voit les hommes politiques et les journalistes tournoyer autour des banques comme les mouches autour du miel.
[FN: § 2261-1]
À ce point de vue, entre beaucoup de partis il existe une différence de force plutôt que de programme. Il y en a des exemples à foison. L'Iniziativa, 19 avril 1913 : « Qui a oublié le concert de protestations qui s’élevèrent du camp socialiste – en première ligne celles de l'Avanti – lorsque quelqu'un éleva la voix contre la dégénérescence du mouvement ouvrier coopératiste socialiste ? On nia même ce qui était une vérité évidente : à savoir que grâce aux concessions des travaux publics, les coopératives socialistes étaient en train de préparer le vasselage des députés socialistes au gouvernement. De fait, aujourd'hui les liens entre le socialisme parlementaire et le gouvernement de Giolitti sont si étroits, et les rapports entre les coopératives socialistes et le ministère si intenses, qu'il sera absolument impossible de briser les uns et les autres. Naturellement, le ministère ne néglige aucune occasion de favoriser les coopératives socialistes contre toute règle de justice distributive. Vain aussi sera l’espoir que les députés socialistes – même ceux qui seront sur le point d'être élus par le suffrage universel – reviennent à un anti-ministérialisme sérieux et décidé. Relevant une récente déclaration de M. Nino Mazzoni, qui, une fois pourtant, a reconnu la dégénérescence des coopératives, que nous a préparée en Italie le socialisme officiel ou non officiel, l'Unità de Florence dit fort bien : „ Le dommage le plus funeste est causé par la nécessité où les coopératives mettent les députés ou les candidats députés, de monter ou de descendre continuellement les marches des ministères, avant d'obtenir qu'une œuvre publique soit discutée, puis que l'exécution en soit sollicitée, puis qu'elle soit effectivement confiée à telle coopérative, même contre l'avis des corps consultants, ensuite que, durant les travaux, on accorde toutes les facilités dont la nécessité se manifeste au jour le jour, et qui n'étaient pas prévues dans le contrat, et ainsi de suite (§ 2548). Un député contraint de suivre cette voie pourra-t-il jamais être sérieusement antiministériel ? Et la future Banque du travail ne sera-t- elle pas une source de corruption morale, d'asservissement des députés et des coopératives au gouvernement, et de ministérialisme chronique obligatoire ? Pour chaque prêt qu'il faudra obtenir, et pour chaque paiement qu'il faudra retarder, combien de fois les députés ne devront-ils pas s'humilier devant le président de la Banque, solliciter l'intervention du ministre ou du sous-secrétaire, et promettre tacitement quelque vilenie ? “ » – Corriere della Sera, 6 janvier 1914. La commission de la Chambre du Travail de Milan approuva l'ordre du jour suivant : « ... [la Chambre du Travail] proteste énergiquement contre la tentative de la Fédération milanaise des Coopératives de production et de travail, qui, au mépris de toute dignité syndicale, cherche à accaparer les travaux publics en Libye, fournis comme pot de vin par le gouvernement, après qu'il a donné le fallacieux prétexte de vouloir favoriser les coopératives ouvrières, dans l'unique but, au contraire, de compromettre et de briser la vive opposition de la classe laborieuse, à l'entreprise coloniale... ». Les provinces méridionales n'ont pas obtenu des faveurs aussi larges que les coopératives de la Romagne, dans le but d'apprivoiser le socialisme. C'est pourquoi leurs députés parlent sévèrement des dépenses faites en Romagne. Le député Tasca di Cutô, qui pourtant est socialiste, en fait mention à la séance de la Chambre du 4 mars 1914. Compte rendu du Giornale d'Italia : « Tasca... L'État ne peut, par suite de préoccupations de nature électorale et doctrinale, continuer à être un immense laboratoire d'instruments orthopédiques pour les divers rachitismes économiques qui ont besoin de son aide ; et l'on ne peut permettre qu'il protège et subventionne des privilégiés, que ceux-ci appartiennent à la haute banque, ou à certaines classes de travailleurs qui s'endorment déjà dans un coopératisme économique de bas étage ! Tandis que le nombre de nos émigrants croît d'une manière inquiétante, l'État subventionne des spéculations erronées, qu'elles soient parties de groupes d'ouvriers ou de groupes capitalistes qui aboutissent à la haute banque (très vives approbations ; commentaires ; protestations sur quelques bancs de l'extrême) ». Nous empruntons la suite au Corriere della Sera : « Marchesano s'adressant aux socialistes : „ Le gouvernement n'accorde des faveurs que contre des faveurs (commentaires). – Tasca. Ne serait-il pas temps de mettre un frein à ce système dans lequel les dépenses que nous appelons civiles vont prenant tout à fait l'aspect de celles que nous définissions tantôt comme improductives ? Je demande si nous devons persévérer en une politique de travaux qui est son propre but, et qui résulte de préoccupations électorales et d'ordre public ? ; en une politique qui, sous le prétexte de remédier au chômage, fait une culture intensive du chômage même (approbations très vives sur les bancs de la majorité ; très violentes protestations des socialistes) ». Peu avant, une séance tumultueuse avait eu lieu à la Chambre. Il s'agissait de savoir si le gouvernement était ou non engagé par la promesse du ministre Sacchi, d'accorder les « bonifications » de l'Italie Septentrionale, à raison de 30 à 40 millions par année, somme tirée de la Caisse de Dépôts et Prêts. Les dépenses pour les dites « bonifications » ont principalement pour but de bien payer les coopératives, et d'apprivoiser leurs protecteurs. En France, les dépenses faites dans des buts politiques analogues portent différents noms, mais ne sont pas moindres ; au contraire, elles sont plus grandes. Il suffira de rappeler l'exemple de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest-État ; elle a pour but principal de recruter des électeurs au parti radical-socialiste dominant. – La Liberté, mars 1914, emprunte au rapport du député Thomas l'indication des déficits de cette exploitation. ils sont, en millions de francs : 1909, 88 – 1910, 58 – 1911, 68 – 1912, 76 – 1913, (prévu) 84. Le journal ajoute : « Le système d'exploitation des chemins de fer de l'État aboutit nécessairement à la ruine par le gaspillage. Ce n'est assurément pas la faute des ingénieurs... Mais ils sont prisonniers d'un système qui n'est lui-même que l'expres- sion d'abus, d'erreurs et d'intérêts politiques. Dans ce système, le plus urgent bénéficiaire de l'exploitation n'est pas le public qu'il s'agit de servir, mais le personnel dont il importe de s'assurer les votes. Certes la Compagnie a le devoir de veiller au bien-être de ses agents... Mais à l'Ouest-État, ce ne sont pas les services du travail que l'on rémunère le plus, ce sont les dettes électorales des députés, à la fois protecteurs et obligés de celui-ci ou de celui-là, que l'on acquitte avec le plus de générosité ». En Italie, il est des causes semblables, parmi celles du mauvais fonctionnement des chemins de fer, des retards des trains, des fréquents accidents, des vols de marchandises et de bagages.
[FN: § 2262-1]
Pour avoir un exemple concret, reportons-nous à l'affaire Rochette, en France. Elle peut servir de type à une classe très étendue de faits. Il faut, pour cela, faire abstraction du pays où elle s'est déroulée – il s'en passe de semblables en d'autres pays ; – du régime politique – les monarchies et les républiques sont sur le même pied ; – des partis – ils n'agissent pas très différemment ; – des hommes – si ce n'étaient ceux dont il s'agit, d'autres accompliraient les mêmes actions, qui sont proprement la conséquence de l'organisation sociale. Afin de puiser nos renseignements à une source non suspecte, écoutons le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire. Journal officiel, Chambre des députés, 2e séance du 3 avril 1914 : « (p. 2282) Il est acquis qu'en mars 1911, entre le 22 et le 30 mars, – je déclare que pour moi les dates importent peu, le fait seul importe [réponse aux dérivations qui, en discutant l'accessoire, voulaient faire oublier le principal] – M. Monis, ministre de l'intérieur et président du conseil a, sur la demande de son collègue, M. Caillaux, fait appeler M. le procureur général Fabre. M. Monis, président du conseil et ministre de l'intérieur, étranger aux choses de la justice par la constitution même du ministère auquel il appartenait, a donné, appelez cela des ordres, appelez cela des instructions, appelez cela l'expression d'un désir, les nuances importent peu [réponse à une autre dérivation du genre de la précédente], il a donné à M. Fabre des indications lui faisant connaître que le Gouvernement voulait arriver à obtenir la remise de l'affaire Rochette, affaire qui durait déjà depuis quatre ans [durant lesquels, grâce à la protection des politiciens, Rochette Continuait à constituer des sociétés fictives et à empocher de l'argent, dont la majeure partie allait d'ailleurs à la presse et aux politiciens]… En 1911, qu'est-ce qu'on attaquait ? Qu'est-ce que l'on critiquait ? L'on blâmait la mainmise brutale et excessive de la police sur la personne de Rochette, à l'aide d'un témoin payé et fictif [les A contre les B ; dans le second acte du drame, on voit les B contre les A]. (p. 2283) M. Jules Delahaye : ...Oui, on a beaucoup reproché aux magistrats d'avoir été trop pressés, trop brutaux comme vous dites... Oui ou non, y avait-il eu des avis donnés à la bourse pour faire un coup de bourse sur les valeurs Rochette ? Oui ou non, avant que les magistrats arrêtassent Rochette, cinq jours avant, y avait-il eu avis de M. Y, D., par exemple, puisque certains boursiers ont été prévenus de l'arrestation ? ... M. le rapporteur... [Il lit le procès-verbal que Fabre fit de sa conversation avec le ministre Monis]. Le mercredi 22 mars 1911, j'ai été mandé par M. Monis, président du conseil. Il voulait me parler de l'affaire Rochette ; il me dit que le Gouvernement tenait à ce qu'elle ne vint pas devant la cour le 27 avril, date fixée depuis longtemps ; qu'elle pouvait créer des embarras au ministre des finances au moment où celui-ci avait déjà les affaires de liquidation des congrégations religieuses, celle du crédit foncier et autres du même genre [ce genre consiste simplement à s'approprier l'argent du public, grâce à l'appui bien rétribué des politiciens et de la presse]. Le président du conseil me donna l'ordre d'obtenir du président de la chambre correctionnelle la remise de cette affaire après les vacances judiciaires d'août-septembre. J'ai protesté avec énergie... Le président du conseil maintient ses ordres... Je sentais bien que c'étaient les amis de Rochette qui avaient monté ce coup invraisemblable... J'ai fait venir M. le président Bidault de l'Isle. Je lui ai exposé avec émotion la situation où je me trouvais. Finalement, M. Bidault de l'Isle a consenti, par affection pour moi, a la remise demandée. Le soir même, le jeudi 30 mars, je suis allé chez M. le président du conseil et je lui ai dit ce que j'avais fait. Il a paru fort content... Dans l'antichambre, j'avais vu M. du Mesnil, directeur du Rappel, journal favorable à Rochette et m'outrageant fréquemment ; il venait sans doute demander si je m'étais soumis ». Le rapporteur continue : « voilà la situation ; et j'ai le droit de dire que, quand on lit ce document, quand on voit les sentiments qui ont animé le procureur général lorsqu'il l'a rédigé, on a la pensée inévitable qu'il y a là un document exact, reproduisant les faits tels qu'ils se sont passés... M. Bidault de l'Isle... a cédé. Il a accordé la remise, et tout ce que vous savez s'en est suivi. Rochette a pu continuer ses opérations, il a pu exploiter l'épargne... depuis avril 1911 jusqu'à février 1912 et, plus généralement, jusqu'à l'époque de sa fuite à l'étranger. Voilà le fait brutal, le fait matériel qu'on a nié pendant si longtemps, quand on n'en avait pas encore la preuve, mais qui est aujourd'hui éclatant comme la lumière qui nous éclaire... À mes yeux, l'œuvre républicaine qui s'impose impérieusement à l'heure actuelle, je le dis nettement, moi républicain de gauche, c'est de rétablir l'indépendance de la magistrature ». C’est précisément ce qu'on n'a pas fait, pas même dans une mesure minime, parce qu'on ne peut le faire sans altérer profondément l'organisation sociale. Depuis le temps où le procureur général Baudoin proclamait que le magistrat devait s'incliner devant le « fait du prince » (§ 1824), on n'a rien, absolument rien fait pour que le magistrat puisse au contraire demeurer indépendant. Cela montre la puissance des forces qui s'y opposent. Briand disait très justement « (p. 2288) Ah ! la magistrature manque d'indépendance !... Mais d'où vient le mal, messieurs, comment voulez-vous qu'ils soient pleinement indépendants ces magistrats ? Leur nomination, leur avancement, leur déplacement, leur carrière, leur vie, tout cela est entre nos mains ! – M. Maurice Violette: Vous l'avez eu quelquefois, vous, le pouvoir [dérivation : les B ne sont pas meilleurs que les A] ». Le rapporteur indique les motifs pour lesquels la magistrature devait obéir aux politiciens poussés par les financiers, « (p. 2282) Mais voilà : tous les magistrats ne sont pas des héros ! J'ajoute même, pour être juste, que tous ne sont pas tenus de l'être et que certains, chargés de famille, peuvent se trouver dans la situation de ne pouvoir faire de l'héroïsme. M. Fabre s'est peut-être souvenu de la disgrâce de l'un de ses prédécesseurs, M. Bertrand, qui fut victime de sa courageuse résistance aux exigences gouvernementales. Et puis, ce n'était pas la première fois qu'on faisait pression sur lui. Il avait connu les mêmes difficultés, notamment à l'époque des troubles de Champagne (§ 1716-5). De son côté, M. Bidault de l'Isle, arrivé à la fin de sa carrière, n'a pas voulu se compromettre ni exposer la situation et l'avenir de M. le procureur général ». Après cela, on croirait que le rapporteur conclut que les faits blâmés par lui sont la conséquence de la faculté laissée au gouvernement de donner des ordres aux magistrats. Au contraire, il dit : « C’est encore un exemple, messieurs, des inconvénients de cette camara- derie qui existe partout... » Nous avons ainsi l'une des dérivations habituelles, où, pour faire dévier l'attention, on parle de l'accessoire et l'on passe sous silence le principal.
[FN: § 2262-2]
Parfois il se trouve quelqu'un pour faire un pas dans la voie qui conduirait à une solution scientifique, mais aussitôt il s'arrête, retenu par la crainte de heurter certains principes ou certains dogmes. Journal officiel, loc. cit., § 2262-1-. « (p. 2308) M. le président de la commis- sion [Jaurès]... j'ai le droit de dénoncer pour le pays l'universelle conspiration de silence et d'équivoque. Et c'est à elle que vous devez qu'au lieu d'avoir résolu à son heure et réglé par une commission d'enquête nommée par vous il y a deux ans, le mystère se soit traîné d'intrigue en intrigue. fournissant à ceux que le procureur général appelait les „ frères ennemis “ des moyens réciproques de négociations ou d'intimidation [c'est la lutte des A et des B, à laquelle Jaurès oublie d'ajouter que les socialistes prirent aussi part, soit tenant eux aussi les puissances financières]. Eh bien, messieurs, je dis que l'heure est venue, pour le pays, de sortir de ce régime des intrigues des groupes et des clientèles... l'heure est venue pour nous de voir en face le grand et formidable péril qui le menace ; une puissance non pas nouvelle, mais grandissante plane sur lui, la puissance de cette finance haute et basse [il faut ajouter les entrepreneurs, et prendre garde que cette puissance a de solides fondements dans les œuvres socialistes] ». Après avoir comparé cette puissance à celle de la féodalité, Jaurès dit : « La nouvelle puissance, elle est aussi subtile que formidable, elle conquiert sans faire de bruit [jusqu'à la presse et aux associations socialistes], elle entre dans les intérêts, dans les consciences [sans exclure celles des socialistes], et il arrive une heure où une nation qui se croit souveraine, et qui accomplit avec solennité le rite du vote [voici l'un des dogmes qui barrent la route à l'orateur] est soudainement menée en captivité par les puissances, d'argent. Cette puissance, elle triomphe dans la décomposition des partis [observation contredite par les faits] ; elle triomphe par le pullulement de cette presse qui, n'étant pas rattachée à des centres d'idées, ne peut vivre que par des subventions occultes [la presse de partis bien déterminés estime elle aussi utile et agréable d'avoir sa part des bénéfices des puissances financières et des politiciens]… » Ici, Jaurès s'arrête dans la recherche des causes expérimen- tales du phénomène : il quitte la terre et s'envole dans les nuées : « Non ! l'organisation de la démocratie doit [doit ! et si elle ne le fait pas ?] se dresser en face de l'organisation de la finance [pour le moment elle la sert, plutôt que de la combattre : comment et quand verrons- nous le contraire ?], mais il faut [toujours l'expression d'un désir, au lieu de la recherche des rapports entre les faits] que ce soit une organisation active, ayant pour centre une idée, peut- flamme une conviction et une foi, et pour force de ralliement une doctrine et un program- me ». Sunt verba et voces praetereaque nihil. Là où Jaurès fait allusion aux politiciens auxquels le procureur général donne le nom de « frères ennemis », il s'en réfère à la déposition du procureur général, devant la commission d'enquête. « J'ai servi treize ministres de la justice. Puisse ce treizième ne pas me porter malheur ! Croyez-vous que ce soit facile de vivre, de durer au milieu d'hommes politiques qui se déchirent ? [quand les A et les B sont aux prises, les autres en profitent]. Je me suis maintenu comme j'ai pu entre ces frères ennemis ». – La Liberté, 20 avril 1914 : « L'Association amicale de la magistrature, dans un Congrès auquel assistaient 400 délégués représentant 1900 membres participants, a adopté un certain nombre de vœux, parmi lesquels il faut signaler ceux qui ont rapport à la situation morale et matérielle du magistrat, et à la nécessité de protéger les magistrats contre les ingérences des politiciens dans l'administration de la justice. Au banquet qui clôtura le Congrès, 200 magistrats prirent part, groupés autour de MM. Bienvenu-Martin, garde des sceaux ... ... Au dessert, M. Braibant, dans une allocution très applaudie, a parlé de l'ingé- rence profondément regrettable des représentants du pouvoir législatif dans l'administration de la justice. Il a signalé aussi la légende qui court dans la magistrature et d'après laquelle, pour obtenir de l'avancement et pour arriver à une situation acceptable, il faut avoir de l'entregent, il faut s'entourer d'amitiés et ne pas craindre d'entrer dans la clientèle de hauts et puissants protecteurs : „ L'Association amicale des magistrats, s'est écrié M. Braibant, a été fondée justement dans le but d'assurer à nos collègues des garanties contre cette ingérence et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif “. M. Willm, député de la Seine, a rappelé lui aussi les incidents qui coûtèrent à M. Fabre son poste de procureur général : „ Il est parti, a-t- il dit, en emportant l'estime et le respect de tous ses collaborateurs “. M. Bienvenu-Martin interrompit alors l'orateur par ces mots : „ C'est une critique de ma politique personnelle “. M. Willm se défendit de toute critique à l'adresse du garde des sceaux et termina ainsi au milieu d'applaudissements répétés : „ La justice doit être hors de toute atteinte, en dehors et au-dessus de tous les partis, et le meilleur moyen de sauver la République, c'est encore de donner aux justiciables l'impression que la justice ne connaît aucune défaillance “ ». – ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarades : « (p. 178) D'ailleurs, si le magistrat a besoin du gouvernement le gouvernement a souvent besoin de la magistrature. Toute l'histoire scandaleuse de la troisième République est celle des compromissions et des conflits qui sont intervenus entre le pouvoir exécutif et l'autorité (p. 179) judiciaire (§ 2548). Le krach de l'Union générale, Panama, l'affaire Dreyfus, l'affaire Humbert, l'affaire Rochette ne sont que les épisodes de la vie du parquet de la Seine, depuis trente ans. Le ministre de la Justice, qui demande à un procureur général de lui désigner un juge d'instruction ou un président „ sûrs “, sait fort bien dans quel sens il sera entendu. Le magistrat qui vient d'être promu est généralement beaucoup moins „ sûr “ que celui qui attend un avancement. Celui qui vient d'atteindre l'âge de la retraite est plus indépendant que celui qui redoute une révocation sans pension ». En Italie le danger d'être déplacé d'une bonne résidence à une médiocre ou mauvaise agit puissamment sur l'esprit des juges qui ne sont pas des héros. Or, de tout temps les héros furent rares. « (p. 181) Il n'y a, pour ainsi dire, pas un dossier de magistrat qui ne contienne au moins dix recommandations politiques. C'est en pesant ces recommandations, que les ministres font les mouvements judiciaires ».
[FN: § 2262-3]
Ce fut de cette manière que le socialiste Sembat sauva ses amis radicaux compromis dans l'affaire Rochette. Gazette de Lausanne, 6 avril 1914. Le correspondant raconte la séance de la Chambre où fut approuvé l'ordre du jour sur l'affaire Rochette : « On y a substitué [aux conclusions de la commission d'enquête] un texte assez anodin, qui se bornait à „prendre acte des constatations “ de la commission, et à réprouver l'intervention de la politique dans la justice, intervention qui a été l'une des principales industries de la majorité qui éprouvait le besoin de la « réprouver » avant de s'en aller. Ce texte avait l'avantage de mettre hors de cause MM. Briand et Barthou, et de n'atteindre MM. Monis et Caillaux que dans les termes les plus impersonnels et les plus généraux. C'est ici que M. Sembat est intervenu avec une habileté supérieure. M. Sembat se rendait parfaitement compte du discrédit auquel s'exposait le parti socialiste en s'associant à la politique „ épongiste “ de M. Jaurès. Il a donc réclamé des poursuites judiciaires. Seulement, il les a réclamées à la fois contre MM. Caillaux, Monis, Briand et Barthou. C'était un moyen très sûr de ne les obtenir contre personne, et de pouvoir dire ensuite que le parti socialiste avait été seul à les vouloir. M. Sembat est un homme ingénieux et subtil ». En Angleterre, Lloyd George et lord Muray furent sauvés par l'indulgence des chefs du parti opposé, lesquels comptent naturellement sur une indulgence analogue en faveur de leurs amis.
[FN: § 2262-4]
Journal officiel, loc. cit., § 22621 : « (p. 2291) M. Maurice Barrès... Il y avait [dans la commission d'enquête de l'affaire Rochette] des hommes attachés, liés, dominés, commandés par leur amitié, par leur fidélité dans le malheur. Sur ceux-là je ne ferai aucun commentaire. D'autres jugeaient que M. Caillaux, en se faisant l'interprète du désir d'un avocat son ami... avait voulu être obligeant, avait donné un témoignage de bienveillance naturelle, une preuve de camaraderie, que M. Monis, d'autre part, en cédant au désir de M. Caillaux, était entré dans le même esprit de bienveillance, de camaraderie, de facilité. Mais les mêmes commissaires trouvaient, au contraire, que c'étaient de grands coupables, les Briand et les Barthou, que c'étaient eux les méchants qui s'acharnaient sur ces hommes véritablement bons et tombés dans l'embarras à cause de leur bonté même, les Caillaux et les Monis [dérivation de la contre-attaque des A contre les B]. Facilitons-nous la vie aux uns les autres, voilà le sentiment qui dominait les esprits dans la commission [non pas dans la commission seule, non pas dans un pays plus que dans un autre, mais chez tous ceux qui composent l'état-major de la spéculation, et partout où celle-ci est souveraine], et cela s'accorde singulièrement à la définition qu'Anatole France donne de notre régime, quand il écrit : „ C'est le régime de la facilité “... Le problème n'est pas un problème restreint, médiocre, vous n'aurez pas à juger des défaillances individuelles, vous aurez à vous prononcer et à dire si vous acceptez la défaillance même du régime. – M. Jules Guesde. Pas celle du régime républicain, puisque les mêmes faits se passent dans l'Angleterre monarchiste et dans l'Allemagne impérialiste. C'est le régime capitaliste qui en est cause ». Il y a du vrai dans cette observation de M. Guesde, pourvu qu'à l'organisation « capitaliste » on substitue l'organisation dans laquelle ce sont les « spéculateurs » qui gouvernent. Ceux-ci pourraient encore gouverner avec un régime socialiste ; ils agissent même déjà puissamment sur la presse socialiste et sur les chefs du parti.
[FN: § 2262-5]
Il n'est pas facile de connaître la somme d'argent que la presse prélève sur les financiers, et grâce à laquelle elle leur témoigne sa bienveillance, ainsi qu'aux politiciens leurs amis. L'aventure du Panama a montré que cette somme est parfois très grande, et beaucoup d'autres indices confirment que ce n'est point là un fait exceptionnel. Les frais dits « de publicité » sont, pour un grand nombre d'entreprises, très importants. Devant la commission d'enquête sur l'affaire Rochette, l'agent de publicité, M. Rousselle, a déposé. Il faut tenir compte de ce qu'il a dit, car c'est un des rares documents qui mettent en lumière des faits peu ou point connus du public. « M. de Folleville. Vous êtes agent de publicité. Vous avez spécialement été mêlé aux affaires Rochette. – M. Rousselle. J'ai fait de la publicité pour les affaires Rochette comme pour quantité d'autres banquiers. Quand un banquier désire faire une émission ou introduire des valeurs sur le marché, il est indispensable qu'il en fasse connaître les avantages comme s'il s'agissait d'une marchandise. Pour obtenir ce résultat, il a recours à la publicité des journaux. L'agent de publicité discute dans quelles conditions le concours des journaux sera donné, c'est-à-dire dans quelles conditions les renseignements seront publiés. Une rémunération est convenue en cours de publicité ; l'agent de publicité verse la somme convenue. Le mode de paiement varie suivant le crédit des banquiers. – M. de Folleville. À quel chiffre se sont élevées les dépenses de publicité de Rochette ? – M. Rousselle. Il y a un certain nombre d'affaires dites Rochelle qui sont postérieures à son arrestation. Pour les affaires qui sont réellement des affaires Rochette, c'est-à-dire qui sont antérieures à son arrestation, de façon approximative, j'ai distribué deux millions, je crois. Dans les affaires qui ont suivi, à peu près un million. – M. de Folleville. Teniez-vous une comptabilité de ces distributions ? – M. Rousselle. Dans les affaires de publicité financière, j'agis comme un mandataire. Quand l'affaire est terminée, je rends compte au banquier avec qui j'ai traité de l'emploi des sommes qui m'ont été confiées et je lui rends compte des documents afférant à l'affaire. – M. de Folleville. Conservez-vous une comptabilité susceptible d'établir l'emploi que vous avez fait ? – M. Rousselle. Ces affaires sont trop anciennes pour qu'il me soit possible actuellement de reconstituer le détail. Je pourrais reconstituer les totaux. Les bénéficiaires, je crois que c'est impossible. – M. Leboucq. Traitez-vous directement avec les directeurs de journaux ? – M. Rousselle. Je ne traite pas généralement avec le directeur politique du journal, mais avec un représentant. – M. Leboucq. Vous êtes agent de publicité pour votre compte ? Quand vous traitez avec un journal, comment procédez-vous ? – M. Rousselle. Certains journaux traitent directement. Certains sont affermés. Il y a une tendance actuelle à l'affermage. À l'époque Rochette, c'était plutôt l'exception. – M. Leboucq. Quand vous traitez, avez-vous un prorata établi d'avance pour chaque journal ? – M. Rouselle. Oui. – M. Leboucq. Dans les affaires Rochette avez-vous forcé le pourcentage d'un journal quelconque ? – M. Rousselle. Les prix ont été dans l'ensemble les mêmes que ceux que je donnais pour des affaires qui n'étaient pas des affaires Rochette. – M. Leboucq. Quel est le pourcentage des distributions que vous avez faites eu égard au chiffre global des affaires ? - M. Rousselle. Cela représente 3 %. - M. Delahaye. On a dit 10 %. - M. Rousselle. À côté de la publication dans les journaux, Rochette dépensait beaucoup d'argent en circulaires et en publications de journaux spéciaux. - M. Leboucq. Ne trouvez-vous pas que ce complément de 7 % est exagéré ? - M. Rousselle. Il faudrait voir les comptes. Rochette dans sa façon de placer le papier employait le procédé de publicité par lettres. - M. de Folleville. Avait-il beaucoup de démarcheurs ? - M. Rousselle. Je le crois. Il avait des succursales en province. Il avait à côté des banques qui travaillaient pour lui ». Le bon public paie tout cela, admire et encense ceux qui le tondent ainsi, accorde créance aux journaux qui les défendent, appelle « éthique » l'État qui les favorise.
[FN: § 2262-6]
Déposition de M. Barthou devant la Commission d'enquête sur l'affaire Rochette : « Je dis à M. Caillaux : „ Il se passe au Ministère de l'intérieur des choses qui m'étonnent. Le président du conseil a fait venir le procureur général pour lui dire de faire remettre l'affaire Rochette “. M. Caillaux me répondit que c'était lui qui était intervenu auprès de M. Monis pour demander la remise. Il me dit que Rochette avait la liste des frais d'émission relatifs à certaines de ses affaires antérieures, qu'il se proposait de les publier, que cette publication pourrait entraîner une grande émotion et qu'il était intervenu auprès de M. Monis pour lui dire d'empêcher cette révélation ». Déposition de M. Monis : « Il [M. Caillaux] ajouta ,, que si le renvoi était refusé, il [l'avocat] ferait une plaidoirie retentissante faisant allusion à des émissions ayant entraîné des pertes pour l'épargne qui n'avaient jamais été poursuivies “ ». Par conséquent, il y a un certain nombre de pirates, et celui qui devrait les détruire tous en sauve un, pour que les autres demeurent impunis. – Journal officiel. Chambre des députés, 2e séance du 3 avril 1914 : « (p. 2288) M. Aristide Briand... L'affaire Rochelle une fois terminée, mon intention était de faire venir le procureur général ; je l'aurais prié d'apporter l'original du document ; j'en aurais pris la copie et j'aurais brûlé les deux pièces sous mes yeux. Voilà ! On me dira : Vous auriez ainsi empêché la nation de connaître la vérité sur une affaire grave. Messieurs, cette affaire qui n'avait pas entraîné les conséquences juridiques que je redoutais, mais qui pouvait très bien, sans sanction possible, prendre les proportions d'un scandale, je me félicite de ne l'avoir pas éveillée (très bien très bien ! au centre et sur divers bancs à gauche). Je m'en félicite, et comme homme de gouvernement, et comme Français, et comme républicain. Je m'en félicite d'autant plus que, depuis j'ai lu les journaux de l'extérieur, et j'ai vu le cas qu'on peut faire au dehors de semblables affaires ». Ces sentiments étant ceux d'un grand nombre de personnes, nous pouvons conclure que seule une petite partie de faits analogues nous est connue, et que nous connaissons uniquement quelques types d'une classe nombreuse.
[FN: § 2262-7]
MACHIAV. ; La mandragola, acte IV, scène VI.
[FN: § 2264-1]
Diog. Laert., VI, 2, 45 : ![]()
![]() . Les
. Les ![]() étaient certains magistrats dont il est souvent fait mention, sous des noms différents.
étaient certains magistrats dont il est souvent fait mention, sous des noms différents.
[FN: § 2264-2]
En Italie, en 1913, l'enquête sur le Palais de Justice mit en lumière un document qui résume les règles que les entreprises contractant avec l'État doivent suivre, tant que subsistent les institutions actuelles. Ce document est cité de la façon suivante, dans la Rivista popolare, 15 mai 1913 : « (p. 233) L'intérêt de l'entreprise serait : 1° de continuer à supporter comme aujourd'hui ; 2° de poser en attendant les questions, pour les faire discuter ensuite ; 3° de s'acclimater au personnel. En avertissant le ministre, l'entreprise se prive de sa faveur, et fait un saut dans la nuit. Le ministre sera-t-il assez honnête, assez au-dessus de toute attaque, pour protéger l'entreprise contre toutes les éventualités indiquées plus haut, et contre les gens qui rôdent autour ?... Étudier : si l'affaire est menée comme aujourd'hui, quels en seront les résultats financiers, au cas où l'entreprise se soumettrait sans émettre de prétentions ? Avec le gouvernement, il ne peut y avoir d'entreprises de bonne foi, mais des entreprises de mauvaise foi, qui, fortes du dommage qu'elles causent, attendent et assistent aux exactions de la bureaucratie, e t puis vont discuter ». La Rivista ajoute : « La Commission d'enquête qualifia ce plan diabolique d'acte blâmable et peu correct [si la Commission ne savait pas que ce plan est celui que suivent et doivent suivre presque toutes les entreprises qui ont affaire avec l'État, elle faisait preuve d'une grande ignorance ; si elle le savait, elle témoignait une belle hypocrisie]. C'était le moins qu'elle pouvait dire [non : elle devait ajouter que la faute n'en était pas à qui écrivait dans ce plan des choses connues de tout le monde, mais aux institutions dont elle provenait nécessairement]. Mais dans sa propre défense, l'honorable Abignente affirma, avec un rare courage, qu'il suffit de le lire [le plan] pour en comprendre l'esprit et la corruption. Cette affirmation, nous le répétons, prouve la grande audace de son auteur [simplement audace de répéter publiquement ce que tout le monde dit en particulier]. Il est d'ailleurs dans le vrai, lorsqu'ayant terminé sa lecture, il ajoute : Ce trait est l'histoire de toutes les entreprises de travaux publics de notre État [c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité], toutes menées ainsi par la faute des institutions ; institutions dont le député Abignente dénonça la défectuosité à la Chambre, ainsi qu'il l'affirma, le 5 juin 1905 ». Il faut d'ailleurs ajouter qu'on ne peut changer ces institutions sans les remplacer par d'autres semblables, parce qu'elles sont nécessaires aux politiciens et à leurs partisans pour qu'ils en fassent leur profit Les électeurs du député Abignente comprirent bien qu'on ne pouvait rejeter sur un homme la faute qui provient des institutions. Comme il avait donné sa démission, ensuite du blâme de la Commission d'enquête et de la Chambre, ils le réélurent non seulement pour la même législature, mais encore pour la suivante, lorsqu'eurent lieu les élections générales de 1913.
[FN: § 2265-1]
En septembre 1918, recherchant comment et pourquoi de semblables faits se produisaient, l'Iniziativa écrivait : « Ce ne sont pas les députés qui sont mauvais ; ce sont les électeurs, et spécialement les grands électeurs, qui sont très mauvais. C'est la façon dont on choisit et dont on élit les députés qui est défectueuse. Un article de l'Avanti s'arrête quelque peu sur les critères d'après lesquels les candidatures sont préparées et proclamées en beaucoup d'endroits. „ Par exemple, écrit le journal socialiste, – chez les méridionaux, on est persuadé un peu partout (ou l'on agit comme si l'on était persuadé) que lors même qu'on ne demande pas la reconnaissance d'un droit par un bureau quelconque de l'État... l'appui du député, la recommandation du personnage influent est nécessaire (§ 2268 2). Naturellement, c'est là le système breveté pour la production des députés ministériels à outrance ! En effet, même si le député assumant la représentation d'un collège avait des intentions de correction et d'indépendance, il est obligé, au bout de quelque temps, de se livrer pieds et poings liés au gouvernement, dont ses électeurs eux-mêmes le rendent vassal, par la demande à jet continu d'appui et de recommandations. Je pourrais citer – dit l'auteur de l'article – les noms, très connus dans l'entourage de Montecitorio, de collèges dont les représentants électoraux sont venus à Rome pour chercher un candidat, auquel ils ne demandaient ni la foi politique, ni un programme, mais seulement... d'obtenir l'appui du gouvernement. D'autres collèges du Midi ont demandé au gouvernement... un candidat, besogne à laquelle il semble que se soit employé plusieurs fois le comm. Peano, l'alter ego du député Giolitti qui, avec raison, la jugeait une besogne à l'usage de consciences abjectes ! Il est naturel que dans la députation politique d'une région, qui recrute par ces procédés un grand nombre de ses représentants, il s'insinue des hommes sans scrupules et même de vulgaires forbans ! Mais on n'a pas le droit de s'en étonner et de s'en plaindre, surtout si l'on n'a rien fait pour l'empêcher, et si, au contraire, on a soi-même contribué volontairement à produire et à perpétuer le hideux phénomène “ ».
[FN: § 2267-1]
La corruption de la police de New-York est en partie la conséquence du fait qu'on veut stupidement imposer la vertu par la loi. Sans la bienveillance achetée d'une police qui sait fermer les yeux, la vie à New-York deviendrait impossible. Ce célèbre Gaynor, qui fit tant parler de lui, et certes pas à son avantage, ne voulait même plus laisser danser les habitants. La Liberté, 6 avril 1913 : « Une orgie de vulgarité, telle est, selon l'expression du maire de New-York, Mr. Gaynor, le mal dont souffre actuellement la haute société américaine. L'obsédant tango et le despotique turkey trot sévissent si furieusement cette saison chez les Transatlantiques que l'ordre de la ville en est gravement troublé ; et ce mal, de forme épidémique, est pour l'honorable magistrat un véritable cauchemar. La mode des soupers- tango, soupers qui généralement se prolongeaient jusqu'à l'aube, était devenue si rapidement dangereuse pour le maintien des bonnes mœurs, que Mr. Gaynor dut prendre récemment, pour enrayer le fléau, des mesures draconiennes. Il prescrivit la fermeture à minuit de tous les restaurants de nuit et appliqua ce décret avec une impitoyable rigueur. Il y a quelques jours, plusieurs fêtards des plus en vue ayant voulu narguer la loi furent expulsés manu militari au moment précis où sonnait l'heure de fermeture ; les policemen intraitables refusèrent même de leur laisser prendre leurs chapeaux et pardessus, qu'on leur apporta sur le trottoir. Les soupers devenus impossibles, les Américains – les Américaines surtout – se rabattent sur les five-o'clock. De cinq à sept, dans les établissements en vogue, on ferme soigneusement les rideaux, on allume l'électricité et, cet artifice donnant l'illusion de la nuit, on se livre aux douceurs du turkey trot ou du grizzly-bear. Mr. Gaynor a fait surveiller ces établissements par ses agents, et les rapports de police lui ont révélé, paraît-il, d'horribles détails. Estimant que cette désinvolture des mœurs n'est pas compatible avec le régime d'austérité démo- cratique inauguré par Mr. Wilson à la Maison-Blanche, Mr. Gaynor a présenté hier au corps législatif de l'État de New-York un projet de loi qui doit porter aux danses excentriques un coup mortel. À l'avenir, la danse sera formellement interdite dans tous les établissements publics. L'infortuné maire cependant n'est pas au bout de ses peines. Il est un dernier rempart où se réfugie le tango : le salon privé. Et on vient de lancer dans le plus mondain des salons de Washington une mode qui va le mettre au désespoir. L'électricité éteinte, on danse dans l'obscurité complète ; les couples, pour se guider, n'ont que la lueur d'une petite lampe de poche que tient le cavalier. C'est d'un effet très curieux, et c'est le tout dernier cri ».
[FN: § 2267-2]
Vers la fin de l'année 1912, Huerta était président du Mexique. Le gouvernement des États-Unis faisait preuve d'une grande hostilité à son égard, tandis que le gouvernement anglais avait commencé par le favoriser, puis l'avait abandonné, uniquement pour n'avoir pas de conflit avec les États-Unis. En somme, le conflit était d'ordre exclusivement financier. Porfirio Diaz, président du Mexique en 1900, avait alors accordé à Henry Clay Pierce des droits sur un grand territoire pour en extraire le pétrole. Ensuite il les vendit à la très puissante Standard Oil Cy. Mais surgit une société anglaise, la Eagle Oil Cy (Compania Mexicana de Petroleo Aguila), qui se mit à faire concurrence à la première. Le président Madeiro, qui avait succédé à Porfirio Diaz, favorisait, non sans profit, la société américaine, et avait médité de décréter que les concessions à la société anglaise étaient nulles. Huerta, au contraire, les confirma. C'est de là que naquit contre Huerta la colère de la Standard Oil, de ses clients et de ses amis. D'autres sociétés ou trusts américains s'unirent à eux, désireux d'exploiter le Mexique, avec l'aide du gouvernement des États-Unis. Le président des États- Unis, Wilson, ne souffla mot de tout cela, mais dit qu'il ne pouvait reconnaître Huerta, parce qu'il n'avait pas été „ régulièrement “ élu, et témoigna d'une grande indignation, parce qu'il s'était emparé du pouvoir ensuite d'une révolution, foulant ainsi aux pieds le dogme sacré de l'élection populaire. En somme, de cette façon, le président Wilson défendait les trusts à l'étranger, et dans le pays il disait en être l'adversaire. Ajoutons qu'en voulant intervenir au Mexique, lui qui s'était fait élire comme pacifiste et anti-impérialiste, il entrait dans la voie qui conduit à la guerre et à l'impérialisme, Il est impossible de savoir s'il était ou non conscient de la contradiction. D'une part, il est impossible d'admettre que lui seul ignore ce que tout le monde sait des visées cupides des trusts américains, au Mexique; et si ce n'est pas de l'impérialisme que de vouloir imposer, à un état indépendant comme le Mexique, le gouvernement qui plaît aux États-Unis, on ne sait vraiment pas ce que peut bien être l'impérialisme. D'autre part, nous avons déjà vu qu'il peut y avoir des pacificistes-belliqueux (§ 1705 et sv.) ; et il y a de nombreuses preuves que la foi de certains humanitaires- démocrates est assez grande pour leur faire fermer les yeux à la lumière de faits tout à fait évidents, et accepter des conceptions plus qu'absurdes et de véritables billevesées. Il se peut que le président Wilson soit l'une de ces personnes, mais le moyen de nous en assurer nous fait défaut. On remarquera d'ailleurs que ce problème peut bien présenter de l'importance pour les éthiques, mais qu'il n'en a vraiment aucune pour la recherche des uniformités des faits sociaux.
[FN: § 2268-1]
ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarade : « (p. 135) Il y a de graves ministres qui se croient des honnêtes gens, parce qu'ils n'ont jamais détourné un sou pour eux-mêmes, et qui ont pillé le budget au profit de leurs familles et de leurs familiers [il faut ajouter : de leurs électeurs, de la presse et des financiers leurs amis]. Circonstance touchante, la sympathie du (p. 136) public est le plus souvent avec eux. On leur sait presque également gré de n'avoir point volé personnellement et d'avoir prodigué la joie dans leur entourage. Cette indulgence a de fâcheuses conséquences : car les besoins des politiciens ont, malgré tout, des limites et nous connaissons, en Gascogne, des familles qui n'en ont pas. Ce serait une assez bonne loi que celle qui aurait pour conséquence de substituer d'une manière régulière la prévarication au népotisme... ».
[FN: § 2268-2]
Séance de la Chambre italienne, du 8 mars 1913. Compte-rendu du Giornale d'Italia. Partant de la Tripolitaine, le député BEVIONE dit : „...la population arabe est organisée d'une manière oligarchique, et même patriarcale. Elle obéit dévotement, presque superstitieusement à certains chefs... Les chefs prêtent main forte à leurs subordonnés, les soutiennent dans leurs rapports avec les autorités, leur accordent l'hospitalité, les présentent, en cas de voyage, par des lettres aux autres chefs, et reçoivent en échange hommage et obéissance aveugle “. Un peu plus loin, il ajoute : „ Les choses les plus simples, que l'on obtenait sous les Turcs par la recommandation d'un notable, ne s'obtiennent aujourd'hui qu'après des mois et des mois d'insistance et d'attente “. Nos honorables collègues observeront qu'en Tripolitaine, les notables remplissent, ou du moins remplissaient envers la bureaucratie locale, des fonctions d'intermédiaires, lesquelles sont identiques à celles que nos députés italiens remplissent dans les rapports du public avec la bureaucratie du Royaume. Cette comparaison de notre état social avec un état presque féodal est importante, parce qu'elle vient d'une personne qui décrit les faits sans se laisser entraîner par des préjugés et des théories (§ 2307 1).
[FN: § 2268-3]
Parfois les (B) se divisent en partis qui entrent en conflit. Quand cela se produit, leurs contestations jettent un jour sur quelques-uns de leurs artifices qui, autrement, demeureraient cachés. Chez nos contemporains, le nationalisme a produit l'une de ces divisions. G. PREZIOSI ; La Germania alla conquista dell' Italia. L'auteur décrit sous une forme particulière un phénomène qui est général. Après avoir fait allusion au grand nombre de sociétés industrielles qui, en Italie, dépendent de la Banque Commerciale, l'auteur dit : „ (p. 66) Si, outre la question économique, on considère aussi la question politique, on voit que toutes les sociétés sus indiquées et d'autres encore – dans lesquelles des établissements plus ou moins importants, éparpillés dans toute l'Italie, donnent du travail à des dizaines de mille ouvriers et employés – sont effectivement de colossales agences électorales, dont l'action se déroule en même temps que celle, indiquée déjà, des multiples agences disséminées dans tout le pays par les compagnies de navigation. Il est manifeste que l'influence de telles sociétés, sur les élections politiques et administratives, s'exerce conformément à leurs propres intérêts. Cela explique pourquoi un grand nombre d'hommes politiques et de représentants italiens peuvent, directement ou non, avoir des attaches avec, la „ Commerciale “ et indirectement avec la politique germanique. En Italie, comme en toute autre nation à régime parlementaire, les députés sont, saut quelques exceptions, les très humbles serviteurs de leurs électeurs, et ne peuvent se soustraire aux influences locales. Il est facile d'en déduire, par conséquent, quels efforts doivent faire, et à quels compromis doivent se prêter ces députés dont l'élection dépend de semblables institutions. Celles-ci, sachant que l'argent est aujourd'hui plus que jamais le nerf des luttes politiques, participent aux dépenses électorales, et se garantissent de la sorte la reconnaissance déférente des hommes parlementaires gratifiés “. L'auteur cite ensuite un passage du livre : Rivelazoni postume alle Memorie di un questore, publié en 1913, par l'ex-questeur de Milan, et il observe que la presse a gardé le silence sur ce passage, dont voici la teneur : ,, (p. 75) La Banque Commerciale... est connue pour l'influence inestimable qu'elle a toujours eue sur la vie politique, économique et financière de la nation. Grâce à l'œuvre assidue du défunt sénateur Luigi Rossi, depuis de longues années jusqu'à nos jours, elle a pu directement ou indirectement, selon les circonstances, mettre la main à la formation de divers ministères, ou pour le moins elle a passé pour les avoir tenus sous sa protection “. On remarque un état semblable de ploutocratie démagogique vers la fin de la République romaine. Nous en parlerons au chapitre XIII. Notre auteur dit encore : „ (p. 81) Malheureusement la presse aussi est à ce point-là asservie à l'œuvre de la Banque Commerciale. Une bonne partie du journalisme italien est tributaire de la „ Commerciale “ et des sociétés qui en dépendent. C'est une chose trop connue pour que de longues démonstrations soient nécessaires à cet égard. Qui ne sait que l'organe constamment fidèle à tous les gouvernements de toute couleur qui se succèdent au pouvoir, est à ce point inspiré par un avocat-prince [c'est ainsi qu'on appelle en Italie les avocats très renommés et très puissants] très connu, lequel est lié à la „ Commerciale “, aux sociétés de navigation et au (p. 82) trust ternaire... ? Ab uno disce omnes “ : La méthode de la „ Commerciale “est en définitive toujours la même. Chacune des sociétés dépendantes doit souscrire une part du capital d'un journal ou périodique déterminé. Celui-ci se trouve en conséquence lié, tant à l'égard de l'établissement qui est l'un de ses copropriétaires, qu'à l'égard de ceux qui ont une communauté d'intérêts avec l’établissement. Les journaux reçoivent en outre des subventions sous diverses formes, le plus souvent sous forme de contrats pour avis et insertions, en faveur des industries existant dans les régions où ils sont publiés et répandus... Quelques industries ont leurs journaux propres... “ Cfr. § 1755.
[FN: § 2272-1]
Les « spéculateurs » sont en général opposés aux libertés locales, à la diversité des lois, parce que la centralisation et l'uniformité de la législation leur rendent plus faciles l'emploi de leurs artifices et la possibilité de les imposer au pays. Mais ils n'expriment pas ce motif réel : ils y substituent des dérivations. Par exemple, si A et B sont deux partis d'un même pays, ils proclament simplement qu'on ne peut admettre des lois différentes en A et en B ; cela sans donner la raison de cette affirmation, et sans dire si on peut l'étendre à des pays différents, ce qui conduirait à une législation uniforme sur tout le globe terrestre. Actuellement, ils ont trouvé une autre belle dérivation ; ils disent : „ Aujourd'hui on vise principalement à l'économie des forces ; donc il ne faut pas parler aux citoyens de nouveaux devoirs politiques ; il faut mettre fin à toutes les complications politiques existant encore, et réduire l'État à un simple État commercial régi par des règles uniformes “.On croirait assister à une réunion de cambrioleurs de coffres-forts, où l'on dirait „ Aujourd'hui on vise principalement à l'économie des forces ; donc il ne faut pas entretenir des gardes ni des chiens pour surveiller les coffres-forts. Ceux-ci doivent être tous du même type, afin d'épargner de la fatigue aux pauvres diables qui veulent les forcer. De la sorte, quiconque a appris à en forcer un sait les forcer tous.“
[FN: § 2273-1]
M. PANTALEONI ; dans le Giornale degli Economisti, septembre 1912 : « (p. 262) Qui ne se rappelle le truc des Caisses-pensions ? ,, Le Gouvernement doit une rente annuelle aux pensionnés. Cette annuité, dans des finances bien ordonnées, est prise sur les recettes ordinaires du budget “. Voilà la première position dans laquelle se trouve le prestidigitateur politique. Vient la seconde : „ Comme l'annuité est à tout prendre toujours la même, ou encore, comme il est facile de dire quel en sera le montant total maximum tant que les organes ne changeront pas, capitalisons cette annuité, c'est-à-dire créons autant de rentes publiques qu'il en faut pour que (p. 263) le coupon annuel rapporte exactement cette annuité. L'annuité est alors consolidée “. Vient ensuite le troisième acte : „ Vendons cette rente ; le produit servira à des chemins de fer, à des routes, à des ports, à des fortifications, à retirer des bons du trésor qui, à leur tour, ont servi à cent choses diverses, et reportons l'annuité à la page des recettes ordinaires du budget, soit à leur poste naturel. “. Les trois actes de la comédie nécessitent, on le comprend, un certain espace de temps. Ce n'est pas le même gouvernement qui les joue, ni la même Chambre ; et la presse qui vantait naguère comme un financier éminent celui qui consolida l’annuité, vante aujourd'hui comme un financier plus grand encore celui qui fait l'opération inverse. – Mais ces opérations peuvent-elles vraiment se faire sans tous les faux frais que nécessitent les chemins détournés et secrets ? Il semble que non. Mundus vult decipi ».
[FN: § 2282-1]
On trouvera sur ce sujet une excellente étude dans RICCARDO BACHI ; Metodi di previsioni economiche, dans la Rivista delle scienze commerciali, fascic. 8-9.
[FN: § 2282-2]
On remarque ce fait en beaucoup de calculs techniques, et les ingénieurs savent qu'il est inutile d'avoir une approximation uniquement formelle. Supposons que l'on veuille connaître le diamètre d'un tronc d'arbre, et qu'on en mesure avec une ficelle le périmètre, que l'on suppose être celui d'un cercle parfait. Il serait vraiment ridicule de donner la valeur de pi avec 10 décimales. On peut prendre sans autre 22/7, et mieux encore, il suffit de diviser par 3 la longueur de la circonférence obtenue avec la ficelle.
[FN: § 2282-3]
On doit faire des observations analogues au sujet des prix des marchandises qui sont l'objet du commerce international. Négligeons le fait que l'évaluation de ces prix est imparfaite et incertaine. Si même elle était parfaite, on ne devrait pas diviser les totaux du commerce des marchandises par le prix de ces marchandises, lorsqu'on a en vue d'obtenir un indice de la prospérité économique. On sait assez que les périodes de prospérité industrielle sont aussi des périodes de prix élevés, et que vice-versa, dans les dépressions économiques, les prix sont bas. Il se présente des cas particuliers où ce rapport devient encore plus évident. Par exemple, si nous voulons avoir un indice de la prospérité du Brésil, il faut porter notre attention sur le prix total du café exporté. Si l'on divisait ce total par le prix de l'unité de poids du café, on aurait les quantités de café exporté, qui sont bien loin d'être, avec la prospérité du pays, dans le même rapport que le prix total du café exporté. De même, pour la prospérité des mines de diamant du Cap, il importe beaucoup plus de vendre des diamants à un prix total élevé, que de vendre beaucoup de diamants à un prix total bas. C'est pourquoi ces mines se sont groupées en un syndicat, et s'efforcent de vendre les diamants à un prix tel qu'il donne un total élevé. Il est à présumer qu'elles connaissent mieux les critères de leur prospérité économique que certains auteurs disposant des statistiques d'une manière peu judicieuse.
[FN: § 2292-1]
Cette étude est ici reproduite en partie de V. PARETO ; Alcune relazioni tra lo stato sociale e le variazioni della prosperità economica, dans la Rivista italiana di Sociologia, anno XVII, fasc. V-VI, settembre-dicembre 1913. Les extraits de cet article furent publiés précédemment, en septembre 1913, et antérieurement encore le Giornale d'Italia, 3 août 1913, en donna un résumé.
[FN: § 2293-1]
Tout ce qui se trouve ici jusqu'à la fin du paragraphe est contenu dans l'article de la Rivista italiana di Sociologia, cité au § 2292 1.
[FN: § 2294-1]
Depuis lors, de nouvelles et nombreuses vérifications ont été obtenues. Voir : Rivista di Scienza Bancaria – Roma, agosto-settembre 1917 : V. PARETO ; Forme di fenomeni economici e previsioni.
[FN: § 2300-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Voir à ce propos l'ouvrage remarquable de G. LE BON : La Révolution française et la Psychologie des Révolutions.
[FN: § 2306-1]
En Italie, ces artifices furent largement usités au temps OU M. MAGLIANI était ministre. L'usage en diminua dans la suite sans disparaître entièrement ; il augmenta de nouveau fortement au temps de la guerre de Libye. Le député EDOARDO GIRETTI a fait voir comment les dettes étaient transformées en recettes par un artifice de comptabilité. Le professeur LUIGI EINAUDI démontra clairement que le boni artificiel du budget correspondait à un déficit réel. Enfin, à la séance de la Chambre, du 14 février 1914, le député SIDNEY SONNINO démontra avec une admirable clarté les artifices du budget. Ce discours serait à citer in extenso, parce qu'il dépasse de beaucoup les cas particuliers, et nous montre les procédés généraux par lesquels on manipule les budgets ; mais, pour éviter des longueurs, citons ici uniquement quelques passages très importants. « ... Expliquons-nous clairement : Je n'entends pas agiter des questions de légalité ou d'illégalité ; je n'entends pas non plus examiner aujourd'hui si nous avons ou non un boni ou un déficit, ni pour quels chiffres : je m'occupe uniquement d'une question de clarté et de sincérité financière. Aujourd'hui, par une série d'articles qu'on a fait voter dans une quantité de lois spéciales disparates, et grâce à une interprétation de plus en plus élastique, en fait on en est arrivé à laisser à l'absolue discrétion du ministre du Trésor le soin d'engager de très nombreuses dépenses effectives, en les faisant figurer dans un exercice quelconque, et souvent même dans la catégorie qu'il préfère, et même de ne pas les porter en compte tels que le ministre les expose à la Chambre, dans le budget où ils ont été alloués. Dans son rapport financier, le ministre ne tient pas compte de ces dépenses, aux premières évaluations des résultats de l'exercice. Il peut ainsi toujours proclamer l'existence d'un gros boni effectif ; après cela il obère ce boni apparent d'une série d'autres dépenses nouvelles ou d'augmentations de dépenses ; et souvent même les unes et les autres sont déjà engagées et payées. Il arrive ainsi qu'au moyen d'un budget de l'exercice écoulé, lequel budget présente un déficit de 257 millions dans la catégorie I, et où l'on fait abstraction complète de tout chiffre pour la Libye, soit de plus de 7 millions, on continue à répandre dans le pays l'impression fausse que l'exercice 1912-1913 a produit un boni effectif de plus de 100 millions, et que le budget ordinaire a pu faire face, cette année-là, à plus de 49 millions de dépenses pour la Libye. Depuis trois ans, les artifices de comptabilité du budget se sont tellement multipliés qu'ils ont rendu fort malaisé au Parlement de se rendre clairement compte du véritable état de choses. En premier lieu, dans les budgets des divers dicastères, on voit apparaître aujourd'hui une série nombreuse de dépenses effectives, pour lesquelles le ministre est autorisé à recourir à des comptes-courants avec la Caisse des dépôts et avec des Instituts spéciaux ou des personnalités juridiques locales, ou bien à ce qu'on appelle des anticipations du Trésor ; et l'on alloue seulement une annuité fixe pour un nombre plus ou moins grand d'années, tandis que la dépense s'effectue entre des limites de temps bien inférieures à ce que permet le budget... Il y a ensuite diverses catégories importantes de dépenses extraordinaires, pour lesquelles, dans des lois spéciales (ou même dans quelque article furtif du budget, le ministre s'est réservé la faculté d'anticiper par décret ministériel la répartition, dans plusieurs exercices, de la dépense fixée par ces lois ou ces articles. Dans la loi du budget de la Marine pour 1914-1915, on arrive même à demander de pouvoir en faire autant pour le capital ordinaire de la Manutention de la flotte, jusqu'à concurrence de 20 millions par année, anticipant, jusqu'à 4 ans à l'avance, les répartitions fixées pour les exercices postérieurs. Peut- on sérieusement mettre à la charge d'un futur et éventuel boni du budget, une dépense déjà engagée et parfois même payée, au lieu de l'inscrire dans le budget de l'année où elle est engagée ou faite ? Que signifie le fait d'inscrire aux recettes de 1914-1915 une somme provenant d'un budget antérieur ? Et de la contrebalancer, aux dépenses, par une somme égale, provenant d'une avance fictive du Trésor, c'est-à-dire, en réalité, d'un déficit dissimulé ou d'un moindre boni réel d'un compte antérieur ? Absolument rien, étant données les conceptions qui sont à la base de nos institutions budgétaires. Ce sont des formes vides, des artifices capables seulement de troubler toute clarté d'écriture et de calcul. Le ministre Magliani inventa en son temps les dépenses ultra-extraordinaires pour les travaux publics, auxquelles on devait pourvoir par une augmentation de dettes. De cette manière, il soustrayait ces dépenses au compte des bonis et des déficits effectifs. Aujourd'hui tout cela semble primitif et suranné ; on recourt à des méthodes plus spécieuses et raffinées. On fait voter, dans une loi quelconque, voire budgétaire, ou bien l'on dispose par un décret-loi un article qui dise plus ou moins explicitement que l'on fera face à telles ou telles dépenses par prélèvements sur la Caisse, ou bien par les moyens ordinaires de la Trésorerie, ou moyennant un compte-courant avec la Caisse des Dépôts. Dès ce moment, on peut, si l'on veut, faire toutes ces dépenses sans en porter le chiffre en compte dans les résultats du budget d'après lequel elles sont engagées, telles qu'elles sont données dans les rapports financiers. On se met ainsi en mesure de déclarer un boni au budget, et puis, sur ce boni, on attribue à volonté une somme, soit à d'autres dépenses nouvelles, soit au remboursement du Trésor pour d'autres anticipations faites sous diverses formes. On rend ainsi plus aisé, le jeu du boni rotatif. Qu'on suppose une série d'exercices pour lesquels on autorise une dépense extraordinaire, par exemple de 150 millions pour des constructions navales, dépense à diviser en cinq versements égaux. La première année, supposons que le ministre du Trésor réussisse à faire apparaître, d'une façon ou d'une autre, un boni effectif de 30 millions. Après avoir- proclamé ce résultat, il anticipe l'inscription du versement de l'année suivante, en l'imputant sur ce premier boni. Ainsi le budget de la législature se trouve allégé de 30 millions; et si, par hypothèse, le budget s'était équilibré sans l'anticipation, il présenterait, an contraire, un excédent d'actif de 30 millions. Le ministre proclamera l'année suivante aussi, un second boni de 30 millions., pour anticiper ensuite le versement de l'année suivante. On continuera de même, d'année en année ; de telle sorte qu'ayant disponible un seul boni initial de 30 millions, le ministre peut proclamer dans ces rapports financiers cinq bonis successifs de 30 millions chacun, donnant l'illusion d'un budget du Trésor de 150 millions, tandis qu'en réalité il n’est que de 30 millions, au terme des cinq années, si toutefois le boni initial était réel. Dans le cas où l'on ne réussit pas à porter au compte d'un boni réel de la catégorie I la première anticipation de versements futurs, fixés par des lois spéciales, on peut également recourir avec avantage au jeu de ces anticipations ; cela en inscrivant au compte du premier exercice, dans la catégorie I, la quote-part anticipée, mais en la contrebalançant par une somme correspondante aux recettes, dans la catégorie III, à titre de prélèvement de la Caisse. On obtient ainsi plusieurs avantages, outre celui de contenter les personnes qui demandaient la dépense : 1° de ne pas altérer les résultats généraux de la gestion dans le compte du Trésor, en sommant les résultats des diverses catégories ; 2° de ne pas porter du tout en compte, dans le prochain rapport financier, cette dépense au préjudice du boni effectif, cela en argumentant spécieusement qu'il s'agit simplement d'une anticipation d'allocation ; 3° de pouvoir faire apparaître l'année suivante le poste correspondant, comme un remboursement au Trésor dans la catégorie III, c'est-à-dire comme une augmentation du patrimoine de l'État. En somme, cette dépense n'est jamais donnée pour ce qu'elle est, ni avant ni après, dans la mise en scène parlementaire... J'ai fini. Que l'on ne cherche pas more solito à fermer la bouche à toute critique, aussi pondérée soit-elle, en l'accusant de nuire au crédit de l'État à l'étranger... » Le ministre TEDESCO répondit, non pas en niant les faits, qui, à vrai dire, sont indéniables, mais en observant que depuis 1910, on avait employé des procédés analogues aux siens ; en quoi il n'avait pas tort : on ne pouvait discuter que du plus ou moins. Pour les parlementaires, le fait est important : il fournit un motif d'accuser ou d'encenser tels ou tels hommes. Cela importe peu ou point à la recherche des uniformités que seules nous avons maintenant en vue. En somme, la défense du ministre confirme l'existence de l'uniformité relevée. Parlant au Sénat français, le député RIBOT fit des reproches analogues au budget de son pays, et les ministres ne purent pas lui prouver le contraire. Mais tout cela est inutile, parce que ces faits ne sont pas uniquement le résultat de la faute de certains hommes politiques, mais surtout la conséquence des institutions ploutocratiques et démagogiques auxquelles on donne aujourd'hui le nom de démocraties. Le député RIBOT a cultivé avec amour et fait croître vivace la plante qui porte les fruits dont il s'étonne ensuite, on ne sait trop pourquoi.
[FN: § 2307-1]
A. DE PIETRI TONELLI ; Il socialismo democratico in Italia, p. 22 : „ Dans les régimes démocratiques modernes, on remarque uniformément que le pouvoir politique décisif est réparti de façons diverses entre les classes bureaucratiques, qui comprennent les employés, grands et petits, civils et militaires, et les politiciens de haut et de bas étage. Ces deux catégories de personnes sont liées entre elles et avec les affaristes de toute espèce, par des rapports de soutien mutuel, jusqu'à constituer une indissoluble trinité. La réussite et l'avancement dans les emplois sont presque toujours facilités par l'appui des hommes politiques (§ 2268 2). Le gouvernement, sous diverses formes d'appui, et les hommes d'affaires qui alimentent les dépenses du gouvernement, ont une grande influence sur l'issue des luttes électorales (§ 2268 3). Les politiciens sont d'autant plus influents qu'ils peuvent obtenir davantage des faveurs pour leurs électeurs, d'autant plus qu'ils sont plus épaulés par les gens d'affaires “. Plus loin, p. 24-25 : „ Du reste, là où les socialistes ou les représentants populaires ont le pouvoir dans les administrations locales, le favoritisme consistant à donner, voire à créer des emplois, n'a pas diminué. Seule la couleur des favoris a changé. Autrefois, ils étaient noirs ; aujourd'hui, ils sont rouges. Parfois, il faut le remarquer, ce sont les mêmes personnes qui ont changé de couleur, par raison d’opportunité, et parce qu'elles n'avaient jamais montré une couleur politique nette qui ne fût celle de ceux qui avaient le pouvoir. Qu'on ait créé partout des emplois, tant qu'on a pu, cela est hors de doute. À ce propos, le chef d'une administration populaire me faisait même naïvement observer, il n'y a pas longtemps, que s'il avait pu créer chaque année une vingtaine d'emplois à distribuer, il aurait certainement réussi à faire taire les partisans de l'opposition, non seulement amis, mais aussi ennemis “. En effet, c'est à peu près ainsi qu'on gouverne, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays. Seulement, pour suivre cette voie, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Un cas particulier, celui de la guerre, a été étudié par le prof. FEDERIGO FLORA, dans son ouvrage : Le finanze della guerra ; il conclut : „ Le Trésor la commence, l'emprunt la soutient, l'impôt la liquide “. Il est évident qu'il se produit des phénomènes différents, si cette liquidation a lieu dans une période de rapide accroissement de prospérité économique, ou bien dans une période d'accroissement lent, ou encore, ce qui est pire, dans une période de régression. Les gouvernements qui s'en remettraient trop aux liquidations futures pourraient se trouver un jour dans de grands embarras. – ROBERT MICHELS ; Les partis politiques : « (p. 189) Toutes les fois que le parti ouvrier fonde une coopérative ou une banque populaire qui (p. 190) offrent aux intellectuels le pain assuré et une situation influente, on voit s'y précipiter une foule d'individus dépourvus de tout sentiment socialiste et qui ne cherchent qu'une bonne affaire ». En Italie et dans d'autres pays, ces coopératives et ces banques populaires ont besoin de l'appui des politiciens pour prospérer ; par conséquent, non seulement ceux qui tirent avantage de ces institutions, mais aussi ceux qui espèrent en profiter, viennent s'ajouter à la clientèle des politiciens, les favorisent, les défendent, leur procurent honneurs et pouvoir, et en retirent des bénéfices en compensation. Cette organisation coûte beaucoup, parce que souvent, pour faire gagner un peu d'argent à ceux que l'on veut favoriser, il faut que l'État dépense de grosses sommes, qui sont en partie dilapidées.
[FN: § 2313-1]
On a aujourd'hui la tendance à ranger parmi ceux-ci les petits actionnaires des sociétés anonymes, lesquelles sont exploitées surtout par les conseillers d'administration et par un petit nombre de gros actionnaires. Ces administrateurs usent de divers artifices suivant les pays, naturellement toujours avec la complicité du législateur. En Angleterre, ils emploient beaucoup la „ reconstruction “, qui consiste en somme en ce que la société est dissoute et immédiatement reconstituée sous un autre nom, à la condition que les actionnaires de l'ancienne société reçoivent des actions de la nouvelle, pourvu qu'ils paient un tantième. Ainsi, ils se trouvent en présence du dilemme, ou de tout perdre, ou de faire de nouvelles dépenses ; et il n'est pas permis à l'actionnaire qui refuse de faire partie de la nouvelle société, de réclamer simplement sa part de l'actif de la société ancienne. Il y a des sociétés qui se ,, reconstruisent “ plusieurs fois de la sorte. Le conseil d'administration amène certains compères qui „ garantissent “ underwriting l'opération. Autrement dit, recevant en paiement une somme, souvent considérable, ils prennent l'engagement de retirer pour leur compte les nouvelles actions qui n'auraient pas été, acceptées par les anciens actionnaires. Il existe des sociétés qui n'ont jamais payé un sou de dividende à leurs actionnaires, et qui, tous les deux ou trois ans, procurent de cette façon de respectables bénéfices à leurs administrateurs. Dans un petit nombre de cas, l'opération peut être avantageuse pour les actionnaires aussi ; mais il ne leur est pas donné de distinguer ces cas des autres, car la loi n'accorde pas à chaque actionnaire en particulier le droit de se retirer en recevant sa part de l'actif. En Italie, le législateur avait commis l',, erreur “ d'accorder ce droit. Mais il la corrigea pour complaire à certains rois de la finance, amis des politiciens. – Avanti, 12 mars 1915 : Grosses spéculations de banques. Nous sommes informés que trois grandes banques ont fusionné ces jours derniers... Pour faciliter l'affaire, le gouvernement a fait, comme nous l'avons signalé, un accroc au code civil et au code commercial, en présentant un projet de loi qui suspend pour une année le droit de se retirer appartenant aux actionnaires des sociétés anonymes ,, . Il faut ajouter que, même quand les actionnaires ont ce droit, les difficultés et les dépenses nécessaires pour l'exercer sont si grandes, qu'il demeure presque toujours lettre morte. De cette façon, on s'efforce de barrer tous les chemins par lesquels le simple producteur ou possesseur d'épargne pourrait échapper à la poursuite des „ spéculateurs “. Le projet de loi auquel l'Avanti fait allusion fut approuvé par le Parlement et promulgué. – Giornale d'Italia, 1er avril 1914 „ Compte rendu de l'assemblée des actionnaires de la Banque de Rome. – L'actionnaire T.. L'année dernière, les conditions de la banque étaient florissantes. Où sont allés les millions dont on avoue maintenant la perte ? L'unique justification qu'il trouve est la perte occasionnée par la Libye. Mais est-ce une perte de cette année-ci ou des années précédentes ? Vous avez fait là-bas une œuvre patriotique, et comme Italien je vous en adresse mes plus vives félicitations. Mais je ne suis pas seulement italien : je suis aussi un modeste épargneur, et je demande quel usage vous avez fait de mes épargnes... Quand on parla de fusion entre des Instituts – dit [l'orateur] – il eut la grande espérance de pouvoir se servir du droit de retraite ; mais les modifications introduites dans le code commercial... [les points se trouvent dans l'original]. – Le Président. Je tiens à déclarer que la Banque de Rome n'a été pour rien dans les pratiques employées pour arriver à la modification du droit de retraite “.
[FN: § 2313-2]
Dans ce domaine, l'une des plus belles trouvailles des spéculateurs latins a été celle de l'anticléricalisme. Afin de distraire l'attention loin de leurs opérations lucratives, ils ont su se servir avec une grande habileté des sentiments opposés au clergé, sentiments qui existaient chez le peuple. Tandis que le bon public discutait à perdre haleine sur le pouvoir temporel des papes, sur l'infaillibilité du pape, sur les congrégations religieuses et sur d'autres semblables sujets, les spéculateurs remplissaient leurs poches. En cela ils furent aidés par la naïveté de leurs adversaires, qui leur opposèrent l'antisémitisme, sans s'apercevoir que de la sorte ils demeuraient précisément dans le domaine le plus avantageux aux spéculateurs, et qu'ils les aidaient à distraire de leurs exploits l'attention du public. Depuis tant d'années que les antisémites combattent avec, acharnement, qu'ont-ils obtenu ? Rien, absolument rien. Qu'ont obtenu leurs adversaires ? Pouvoir, argent, honneurs. – Parfois l'anticléricalisme n'est que le prétexte des bénéfices et des vengeances des politiciens. La Liberté, 13 mars 1915 : « „ Brimades, injustices, vexations, injures, souffrances ! “ M. Barrès résume ainsi le tableau des scandales auxquels donne lieu dans toute la France l'allocation des indemnités aux familles des mobilisés. Les haines locales, les rancunes politiques et les combinaisons électorales inspirent la plupart des fonctionnaires ou des délégués de la préfecture. „ La commission “, écrit une femme du département du Jura, „ m'a fait savoir que je ne recevrai rien parce que mon mari était un catholique pratiquant “. – „ On a rejeté ma demande parce que mon mari n'est pas du parti du maire “, écrit une femme de l'Ariège. „ Vous êtes pour les curés “, m'a-t-on répondu, écrit une femme du Lot. De son côté, un journal révolutionnaire publie ce matin des réclamations du même genre avec cette conclusion : „ Des libres- penseurs soutirent par la volonté des fonctionnaires cléricaux “. Cela prouve, en tout cas, que la distribution des allocations est, de tous côtés, l'occasion de scandales et de vives protestations ».
[FN: § 2313-3]
En France, au temps de l'affaire Dreyfus, les spéculateurs étaient presque tous dreyfusards. Le sémitisme leur rapportait beaucoup moins que le « dreyfusisme ». Il est remarquable que chez les anti-dreyfusards les sentiments de persistance des agrégats existaient en abondance, tandis que les instincts des combinaisons, l'habileté politique manquaient grandement. Ces gens engageaient la lutte dans des conditions telles que la victoire ne pouvait leur procurer que peu ou point d'avantages, et la défaite leur causer un très grave désastre ce qui effectivement arriva. De fait, en cas de victoire, ils obtenaient seulement de garder en prison un malheureux, peut-être innocent, et en cas de défaite, ils avaient à craindre l'oppression de leurs adversaires. On pourrait comprendre leur action, si l'affaire Dreyfus avait été un moyen de s'assurer l'appui de l'armée et de faire un coup d'État ; mais elle demeure inconcevable en tant que but. Il est manifeste que, par manque de courage, ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas faire un coup d'État ; aussi allaient-ils à tâtons dans l'obscurité. Ils ne surent pas non plus dépenser les millions des congrégations, et les gardèrent précieusement pour en faire profiter leurs ennemis. Les gens craintifs et respectueux de la légalité ne se lancent pas dans de semblables aventures. On voit bien l'influence de la persistance des agrégats chez ceux qui croyaient Dreyfus coupable, et qui, ne voulant rien entendre d’autre, affrontaient tous les dangers pour le faire demeurer en prison, sans penser que lorsque tant de coupables savent se soustraire au danger, il importe peu qu'un de plus ou de moins soit parmi ceux qui échappent. Chez leurs adversaires, il y avait aussi des personnes qui ne voyaient autre chose que l'innocence présumée de Dreyfus, et qui sacrifiaient tout pour sauver un innocent. La différence entre les deux partis consistait en ce que l'un d'eux savait mettre à profit cette innocence présumée. Du côté des anti-dreyfusards, on manquait de toute direction habile. Celle qu'ils avaient était bien loin de pouvoir aller de pair avec la direction très avisée dont les spéculateurs dotaient le parti dreyfusard. Pour citer un seul exemple, quel est le chef du parti anti-dreyfusard qui puisse être comparé en habileté à Waldeck-Rousseau ? Avocat retors auquel les moyens de se rendre utile à son client étaient indifférents, il donna la victoire au parti dreyfusard. Il est vraiment un type de chef des spéculateurs. Il avait toujours été l'adversaire des socialistes, et se fit leur allié. Il avait toujours été patriote, et confia l'armée de son pays à un André, et la marine à un Pelletan. Il avait toujours défendu la propriété, et livra comme butin à ses troupes le milliard des congrégations. Il avait toujours été conservateur, et se fit le chef des plus audacieux révolutionnaires. En vérité, ni les sentiments ni les scrupules ne l'embarrassaient, et ils ne l'empêchaient pas de travailler à son profit.
[FN: § 2313-4]
Les romans de GYP contiennent à ce propos de nombreuses et fines observations de faits. Par exemple, Cotoyan, dans Un mariage chic, est le type d'une classe très nombreuse d'individus.
[FN: § 2313-5]
ROBERT DE JOUVENEL : La rép. des camarades : « (p. 53) Au-dessus de toutes les coteries de partis [des députés], de toutes les brouilleries d'homme à homme, il y a une règle impérieuse et qui domine : respecter l'esprit de la maison et ne pas se nuire. Entre camarades, on se dispute, on ne se déteste pas ; on veut bien se battre, mais l'on n'aime pas à se faire de mal. Si fort qu'on soit fâché, on ne peut oublier qu'on est fâché contre un collègue [qui est souvent un complice]. Même lorsque la discussion cesse d'être courtoise, elle ne cesse point pour cela d'être confraternelle. Les circonstances, qui vous mettent aux prises aujourd'hui passeront et l'on sait (p. 54) bien que demain on aura encore besoin les uns des autres; alors, pourquoi prononcer des paroles irréparables ? ». Ailleurs l'auteur décrit les relations entre ministres et députés. Sa description s'applique à l'Italie comme à la France, comme à tout pays possédant un gouvernement parlementaire. « (p. 115) Lorsqu'un député a passé sa matinée à faire des démarches dans les cabinets ministériels, il emploie son après-midi à contrôler les actes des ministres. Pendant la moitié de la journée, il a demandé des services ; pendant l'autre moitié, il demande des garanties. S'il a obtenu beaucoup de garanties, il ne demande (p. 46) pas pour cela moins de services, mais quand il a obtenu beaucoup de services, il se montre quelquefois moins sévère pour les garanties – et c'est très humain ». – Avanti, 12 mars 1915 : « Le budget électoral. Il est naturellement du même genre que celui des Postes et que celui des Travaux publics. L'un des députés veut un pont, l'autre une route, un autre un chemin de fer, un autre encore une route à automobiles..., sauf à se plaindre plus tard parce que les dépenses croissent ainsi que les travaux inutiles, et cela sans avoir jamais la sincérité d'avouer que les profits de leur député croissent aussi aux yeux des électeurs naïfs. Ce député peut être un malfaiteur, mais il ne néglige pas les intérêts locaux » (§ 2562 1).
[FN: § 2314-1]
Parfois même ils s'en réjouissent. Tous ceux qui vendent des marchandises se plaignent si le prix de vente diminue. La seule exception est celle des producteurs d'épargne, qui se réjouissent si l'intérêt de l'argent diminue, c'est-à-dire le prix de l'usage de la marchandise qu'ils produisent. Les ouvriers dont on voudrait réduire le salaire de 4 fr. à 3 fr. 50 pousseraient les hauts cris, feraient grève se défendraient. Au contraire, les possesseurs d'épargne auxquels, grâce à la conversion de la rente, l'État paie seulement 3 fr. 50 au lieu de 4 fr., ne lèvent pas le petit doigt pour se défendre, et peu s'en faut qu'ils ne remercient celui qui les dépouille. Il faut relever encore une étrange illusion des producteurs d'épargne, lesquels se réjouissent quand haussent les prix des titres de la dette publique qu'ils achètent avec leur épargne, et se lamentent s'ils baissent ; tandis que celui qui achète les titres doit désirer les acheter au plus bas prix possible. Parmi les causes de cette illusion, il y a peut-être la suivante. Soit un producteur d'épargne qui possède déjà 20 000 fr. de titres de la dette publique, et qui épargne chaque année 2000 fr., avec lesquels il achète d'autres titres. Si le prix en bourse des titres de la dette publique monte de 10 %, les 20 000 fr. de notre individu deviennent 22 000 fr., et il s'imagine s'être enrichi de 2000 fr. Ce serait le cas, seulement s'il vendait les titres ; s'il les conserve, il n'a pas un sou de plus, et il reçoit la même rente annuelle. D'autre part, les 2000 fr. qu'il épargne chaque année, et qu'il emploie à acheter des titres de la dette publique, lui rapportent moins : il reçoit le 10 % de moins que ce qu'il aurait touché, si le prix des titres de la dette publique n'était pas monté. En conclusion, il est dans une moins bonne position qu'avant.
[FN: § 2316-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ ; Hist. de la div., t. III. Vers 590 av. J.-C., « (p. 158) l'oracle de Delphes est en train de devenir la plus grande banque du monde. Autour du temple s'élèvent de toutes parts des Trésors, remplis d'ex-voto envoyés par (p. 159) différents peuples, princes et cités, athlètes heureux, criminels repentis, riches bienfaiteurs du temple, vaniteux de toute espèce empressés de mettre leur nom en évidence. Avec le produit des biens-fonds, les dîmes, argent et esclaves, prélevées sur le butin de guerre, sur les colonies, avec les amendes imposées, les intérêts produits, tout cela constituait un capital énorme qu'une gestion intelligente accroissait rapidement. En outre, comme il n'y avait pas en Grèce de lieu plus sûr que Pytho, les États comme les individus apportaient là les documents précieux, testaments, contrats, créances, même de l'argent monnayé, dépôts que les prêtres se chargeaient de garder en récompensant même la confiance des déposants par des privilèges honorifiques... L'oracle tenait ainsi entre ses mains d'immenses intérêts et se montrait jaloux d'accroître cette nombreuse clientèle... Les moyens d'acquérir ne manquaient pas : mais comme il n'est pas moins important de conserver, on inspirait à ceux qui auraient été tentés de voler le dieu une terreur superstitieuse. Il était arrivé qu'un malfaiteur de cette espèce avait été indiqué aux prophètes – d'autres disaient dévoré – par un loup dont on montrait la statue à Delphes ». L'histoire des déprédations du temple commence par des légendes qui, probablement, ainsi que cela arrive d'habitude, projettent dans le passé des impressions du temps où ces légendes se sont formées. Parmi les ravisseurs, on trouve Hercule. Bouché-Leclercq rapporte (p. 109) la légende qui n'établit qu'une lutte entre Hercule et Apollon pour le trépied prophétique ; mais il en existait une autre, laquelle indiquait nettement le pillage. APOLLOD. II, 6, 2 : ... ![]()
![]() « ... et il commença à piller le temple ». Une légende, rapportée par le scholiaste de l'Iliade (XIII, 302), d'après Phérécyde, nous montre les Phlegyes,
« ... et il commença à piller le temple ». Une légende, rapportée par le scholiaste de l'Iliade (XIII, 302), d'après Phérécyde, nous montre les Phlegyes, ![]() incendiant le temple de Delphes, et, pour ce méfait, détruits par Apollon. Dans les temps historiques, la série des guerres sacrées, entreprises pour punir les atteintes au temple et aux propriétés du dieu, s'ouvre par la guerre contre les Criséens (600 à 590 avant J.-C.). La seconde guerre sacrée (355 à 346 av. J.-C.) fut dirigée contre les Phokiens. Leur chef, Philomélos, à la tête d'une troupe de mercenaires richement payés (DIOD. ; XVI, 28 et 30), s'empara de Delphes. Il commença à mettre à contribution les plus riches Delphiens ; ensuite, ces ressources ne lui suffisant plus, il étendit ses déprédations aux trésors du temple ; mais, peut-être de bonne foi, il prétendit que ce n'était là qu'un emprunt. Il se peut que, semblablement à ce qui s'observe de nos jours, il y ait eu des gens naïfs qui ont cru alors à ces belles promesses. À ce propos, Grote observe (XVII) : « (p. 68 note 2)... Une proposition semblable avait été émise par les envoyés corinthiens dans le congrès à Sparte, peu de temps avant la guerre du Péloponèse ; ils suggérèrent comme l'un de leurs moyens et l'une de leurs ressources un emprunt aux trésors de Delphes et d'Olympia, qui serait rendu plus tard (THUCYD. : I, 121). Périklès fit la même proposition dans l'assemblée athénienne ; „ dans des vues de sécurité “, on pouvait employer les richesses des temples pour défrayer les dépenses de la guerre, sous condition de rendre le tout après (... THUCYD. ; II, 13). Après le désastre subi devant Syracuse, et pendant les années de lutte qui s'écoulèrent depuis cet événement jusqu'à la fin de la guerre, les Athéniens furent forcés par des embarras financiers de s'approprier pour des desseins publics beaucoup de riches offrandes renfermées dans le Parthénon, objets qu'ils ne furent jamais plus tard en état de remettre ». La promesse faite par le gouvernement français de rembourser ses assignats, et une infinité d'autres promesses analogues, faites par d'autres gouvernements, eurent un sort semblable. CURTIUS ; t. V, c. 1, observe que la force de Philomélos reposait sur des mercenaires. « (p. 66) Dans ces circonstances, c'eût été un miracle si Philomélos avait pu observer la modération dont il s'était fait une loi publiquement proclamée. [Il en est de même pour les gouvernements modernes dont la force repose sur les avantages qu'ils procurent à leurs partisans.] La tentation était trop grande. On était le maître absolu du Trésor le plus riche de la Grèce : devait-on, faute d'argent, abandonner le pays à ses ennemis les plus acharnés ? À vrai dire, après être allé si loin, on n'avait plus le choix. On créa donc une Trésorerie (DIOD. ; XVI, 56), sous la responsabilité de laquelle on puisa dans la caisse du temple, d'abord, sans doute, sous la forme d'emprunt, mais ensuite on y mit toujours plus de hardiesse et moins de scrupules [comme, dans les temps modernes, pour les émissions de papier-monnaie et les emprunts publics]. Des objets qui depuis des siècles avaient reposé sous le « seuil » du temple, s'en allèrent aux quatre vents du ciel... On n'envoya pas seulement l'or à la Monnaie, mais on porta la main même sur les saintes reliques, et l'on vit des joyaux de l'âge héroïque (p. 67) briller au cou des femmes des officiers mercenaires. On dit que 10 000 talents (environ 58 940 600 fr.) furent ainsi mis en circulation. On n'employa pas cette somme seulement pour payer la solde de l'armée, mais on la fit servir à l'étranger pour gagner des personnages influents, comme Dinicha, l'épouse du roi de Sparte Archidamos (THÉOPOMPE, frag. 258, ap. PAUS. III, 3, accuse Archidamos et Dinicha de s'être laissé corrompre), et pour modifier favorablement l'opinion dans le camp des ennemis ».
incendiant le temple de Delphes, et, pour ce méfait, détruits par Apollon. Dans les temps historiques, la série des guerres sacrées, entreprises pour punir les atteintes au temple et aux propriétés du dieu, s'ouvre par la guerre contre les Criséens (600 à 590 avant J.-C.). La seconde guerre sacrée (355 à 346 av. J.-C.) fut dirigée contre les Phokiens. Leur chef, Philomélos, à la tête d'une troupe de mercenaires richement payés (DIOD. ; XVI, 28 et 30), s'empara de Delphes. Il commença à mettre à contribution les plus riches Delphiens ; ensuite, ces ressources ne lui suffisant plus, il étendit ses déprédations aux trésors du temple ; mais, peut-être de bonne foi, il prétendit que ce n'était là qu'un emprunt. Il se peut que, semblablement à ce qui s'observe de nos jours, il y ait eu des gens naïfs qui ont cru alors à ces belles promesses. À ce propos, Grote observe (XVII) : « (p. 68 note 2)... Une proposition semblable avait été émise par les envoyés corinthiens dans le congrès à Sparte, peu de temps avant la guerre du Péloponèse ; ils suggérèrent comme l'un de leurs moyens et l'une de leurs ressources un emprunt aux trésors de Delphes et d'Olympia, qui serait rendu plus tard (THUCYD. : I, 121). Périklès fit la même proposition dans l'assemblée athénienne ; „ dans des vues de sécurité “, on pouvait employer les richesses des temples pour défrayer les dépenses de la guerre, sous condition de rendre le tout après (... THUCYD. ; II, 13). Après le désastre subi devant Syracuse, et pendant les années de lutte qui s'écoulèrent depuis cet événement jusqu'à la fin de la guerre, les Athéniens furent forcés par des embarras financiers de s'approprier pour des desseins publics beaucoup de riches offrandes renfermées dans le Parthénon, objets qu'ils ne furent jamais plus tard en état de remettre ». La promesse faite par le gouvernement français de rembourser ses assignats, et une infinité d'autres promesses analogues, faites par d'autres gouvernements, eurent un sort semblable. CURTIUS ; t. V, c. 1, observe que la force de Philomélos reposait sur des mercenaires. « (p. 66) Dans ces circonstances, c'eût été un miracle si Philomélos avait pu observer la modération dont il s'était fait une loi publiquement proclamée. [Il en est de même pour les gouvernements modernes dont la force repose sur les avantages qu'ils procurent à leurs partisans.] La tentation était trop grande. On était le maître absolu du Trésor le plus riche de la Grèce : devait-on, faute d'argent, abandonner le pays à ses ennemis les plus acharnés ? À vrai dire, après être allé si loin, on n'avait plus le choix. On créa donc une Trésorerie (DIOD. ; XVI, 56), sous la responsabilité de laquelle on puisa dans la caisse du temple, d'abord, sans doute, sous la forme d'emprunt, mais ensuite on y mit toujours plus de hardiesse et moins de scrupules [comme, dans les temps modernes, pour les émissions de papier-monnaie et les emprunts publics]. Des objets qui depuis des siècles avaient reposé sous le « seuil » du temple, s'en allèrent aux quatre vents du ciel... On n'envoya pas seulement l'or à la Monnaie, mais on porta la main même sur les saintes reliques, et l'on vit des joyaux de l'âge héroïque (p. 67) briller au cou des femmes des officiers mercenaires. On dit que 10 000 talents (environ 58 940 600 fr.) furent ainsi mis en circulation. On n'employa pas cette somme seulement pour payer la solde de l'armée, mais on la fit servir à l'étranger pour gagner des personnages influents, comme Dinicha, l'épouse du roi de Sparte Archidamos (THÉOPOMPE, frag. 258, ap. PAUS. III, 3, accuse Archidamos et Dinicha de s'être laissé corrompre), et pour modifier favorablement l'opinion dans le camp des ennemis ».
Onomarchos et ensuite Phaylos, qui succédèrent à Philomélos, firent pis encore. Enfin les Phokiens, vaincus par Philippe de Macédoine, furent condamnés à payer annuellement une amende très considérable. La compensation entre le pillage et sa punition était ainsi établie au point de vue éthique, mais elle n'existait pas au point de vue économique ; car les mercenaires ne restituèrent pas l'argent de leur haute paye, et l'amende fut payée, en petite partie par des restitutions, mais en grande partie par de nouvelles atteintes à la propriété privée.
La troisième guerre sacrée (339-338 av. J.-C.) est en dehors de notre sujet. Nous n'avons guère de renseignements sur l'occupation de Delphes par les Locriens et les Étoliens, en 290 av. J.-C. En 278 av. J.-C. les Gaulois attaquèrent Delphes, en vain disait la tradition grecque, le dieu s'étant chargé de défendre son sanctuaire ; avec succès disait une autre tradition, rapportée par TITE-LIVE : (XXXVIII, 48) etiam Delphos quondam commune humani generis oraculum, umbilicum orbis terrarum, Galli spoliaverunt...
Après chaque nouveau pillage, le trésor de Delphes était reconstitué par la piété des fidèles (§ 2316 5). Sulla le trouva donc bien garni quand il s'en empara à son tour (PLUTARQUE ; Sulla, 12). Lors de sa campagne de Grèce, « (12,4) comme il fallait beaucoup d'argent pour la guerre, il viola les asiles sacrés de la Grèce et envoya chercher, à Épidaure et à Olympie, les plus belles et les plus riches offrandes. (5) Il écrivit aux Amphictyons, à Delphes, qu'on ferait bien de mettre en lieu sûr, auprès de lui, les trésors du dieu ; car il les garderait très sûrement, ou, s'il les employait, il les rendrait intégralement ». C'est ce que disent généralement les puissants quand ils font des emprunts, de gré ou de force. Parfois ils tiennent leurs promesses, parfois ils les oublient, ou bien ils payent en monnaie de singe. Sulla fit peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup. Après la bataille de Chéronée, « (19) il mit il part la moitié du territoire [des Thébains] et la consacra à Apollon Pythien et à Zeus Olympien, ordonnant d'employer les revenus pour rendre à ces dieux l'argent dont il s'était emparé ». BOUCHÉ-LECLERCQ, loc. cit., observe à ce propos : « (p. 197) Apollon savait ce que vaudrait, Sulla une fois parti, sa créance sur les Thébains ». Ces spoliations successives et continuelles finirent par appauvrir entièrement le temple. STRABON ; IX, 3, 8, p. 420. Le texte est corrompu. DE LA PORTE DU THEIL (p. 458) entend : « Objet de la cupidité, les richesses, même les plus sacrées, sont difficiles à conserver : aussi le temple de Delphes est-il maintenant fort pauvre ; car si le plus grand nombre des objets que l'on y avait successivement consacrés s'y trouve encore, tous ceux qui avaient une valeur réelle ont été enlevés. Mais jadis il (p. 459) fut très riche »., Dans la collection Didot, on traduit : Ceterum divitiae, quia invidiae sunt obnoxia, difficulter custodiuntur, etiamsi sacrae sint. Nunc quidem pauperrimum est Delphicum templum quod pecuniam attinet, donarium autem pars quidem sublata est, pars vero adhuc restat. Constantin consomma la ruine de l'oracle de Delphes en enlevant les objets d'art qui s'y trouvaient, dont il orna sa ville de Constantinople.
Bornons-nous à citer un seul exemple des très nombreuses opérations modernes Semblables à l’emprunt fait par Sulla au trésor de Delphes. RENÉ STOURM : Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, t. II : « (p. 338) Après avoir poursuivi jusqu'au retour de l'ordre l'histoire des banqueroutes partielles, pratiquées chaque semestre par le gouvernement de la Révolution sur les arrérages de rentes, nous arrivons à celle qu'il consomma d'une manière officielle et définitive sur le capital de la dette publique, en 1797. Combien il est pénible, en abordant cette faillite tristement célèbre du tiers consolidé de rappeler les fières déclarations de l'assemblée constituante, au début de la Révolution : la loi du 17 juin 1789 « mettant les créanciers de l'État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française ; celle du 13 juillet 1789 par laquelle, „ l'assemblée déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté française, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l’infâme mot banqueroute, nul pouvoir n'a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et quelque dénomination que ce puisse être “... (p. 341) La loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an VI), connue sous le nom de loi du tiers consolidé, votée par les deux conseils, raya définitivement du grand-livre les deux tiers des rentes. Elle stipula leur remboursement en bons des deux tiers mobilisés et maintint seulement un tiers du (p. 342) montant de chaque inscription. Rappelons que les arrérages de ce dernier tiers furent eux-mêmes payés en papier-monnaie jusqu'en 1801 ». C'est d'ailleurs là une pratique suivie par un grand nombre d'États modernes. On vous doit 100 fr., on vous donne un morceau de papier avec de jolies vignettes, sur lequel est inscrite cette somme ; qu'avez-vous à réclamer ? Les puissants aiment, tout en violant les lois de leur éthique, paraître les respecter, et il ne manque jamais d'auteurs complaisants qui leur fournissent, et enseignent du haut de la chaire, autant de dérivations que ces puissants en peuvent désirer pour leur justification.
[FN: § 2316-2]
Cours, § § 449 à 453, p. 324 à 332. L'auteur a eu le tort de ne pas se dégager entièrement des considérations éthiques. Par exemple : « (450) Il faut se débarrasser du préjugé qui porte à croire qu'un vol n'est plus un vol quand il s'exécute dans les formes légales ». (Dérivation I-β). Il s'était, au contraire, résolument écarté de telles considérations, lorsqu'il écrivait « (441) Il n'est presque pas d'économiste qui n'éprouve le besoin de décider si „ l'intérêt “ (le loyer de l'épargne) est juste, équitable, légitime, moral, naturel. Ce sont là des questions qui sortent du domaine de l'économie politique, et qui, d'ailleurs, n'ont aucune chance d'être résolues si l'on ne daigne pas auparavant définir les termes qu'on emploie ». En ces observations se trouve le germe du présent Traité de Sociologie.
[FN: § 2316-3]
Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Biens ecclésiastiques « (p. 124) Les Judéo-Chrétiens... ne voulaient pas, en tant que chrétiens, rester au-dessous de ce qu'ils faisaient autrefois par devoir comme Juifs. Ils vendirent ce qu'ils possédaient et en déposèrent le prix aux pieds des Apôtres. Les Pagano-Chrétiens s'empressaient d'imiter ce zèle dévoué, d'autant plus que les religions païennes elles-mêmes faisaient à leurs adeptes une loi d'offrir des sacrifices aux dieux et des présents aux prêtres ; et, comme parmi les nouveaux convertis il y en avait beaucoup de riches, des sommes considérables furent versées dans cette communauté de biens volontaire formée par les premiers chrétiens ». Maintenant ce sont les fidèles des différentes sectes humanitaires, impérialistes, patriotiques, qui imitent les adeptes des religions païennes et des chrétiennes.
[FN: § 2316-4]
Denys de Syracuse plaisantait agréablement les dieux qu'il dépouillait. CIC. ; De nat. deor., III, 34 ; entre autres : in quibus quod more veteris Graeciae inscriptum esset, bonorum deorum, uti se eorum bonitate velle dicebat. Selon JUSTIN, XXIV, 6, le chef des Gaulois justifiait le pillage du temple de Delphes en disant : « Il est bon que les dieux, étant riches, donnent aux hommes », et aussi : « Les dieux n'ont pas besoin de biens, puisqu'ils les prodiguent aux hommes ». Les spoliateurs modernes pensent probablement de même, mais, sauf exception, ils s'expriment avec moins de cynisme.
[FN: § 2316-5]
Ainsi, par exemple, depuis les temps légendaires jusqu'au temps présent, les spoliations des biens sacrés des païens se continuent très régulièrement par les spoliations des biens sacrés des chrétiens ; il est impossible de ne pas voir en ces phénomènes les effets d'une seule et même force, qui opère depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Biens ecclésiastiques : « (p. 126)... il est certain que l'Église possédait des propriétés immobilières vers l'an 300 ; car, en 802, Dioclétien s'en empara, et cinq ans après Maxence les restitua... L'édit de Licinius, promulgué d'accord avec Constantin, qui accorda toute liberté à la religion nouvelle (313), ordonna en même temps la restitution de tous les biens enlevés aux communautés chrétiennes. Les biens des temples païens furent attribués à l'Église en même temps que certaines contributions du fisc... Ce système bienveillant de l'empereur fut à plusieurs reprises interrompu ou troublé, notamment sous Julien l'Apostat, qui enleva tout à l'Église, jusqu'à ses vases sacrés ; mais le zèle des successeurs de Julien dédommagea l'Église des pertes qu'elle venait de faire ». Depuis lors, on trouve dans l'histoire une suite indéfinie de ces flux et reflux des biens ecclésiastiques, comme on voit se succéder les flux et reflux des marées de l'Océan.
MURATORI ; Antiq. ital., diss. LXXIII: De Monasteriis in beneficium concessis. (p. 301) Ad Ecclesias, sive ad eorum Prœsules ac Rectores, multam, ut supra vidimus, facultatum affluentiam detulit Christianorum pietas atque Religio : reliquum, opum atque potentiae ipsi Ecclesiastici viri quantis potuere viribus ac studiis in sacrorum locorum sibi commendatorum utilitatem, simulque propriam intenti sensim sibi peperere. Nunc addendum, contra fuisse et aliam Christifidelium partem, unoquoque Saeculo, cui nihil antiquius fuit, quam Ecclesiarum patrimonia aut expilare aut quibus poterant artibus sua efficere. Metebant iugi labore in Saecularium campis Clerici, ac praecipue Monachi ; vicissim vero et Saeulares nihil intentatum relinquebant, ut Messem ab Ecclesiasticis congestam, in horrea sua leviori interdum negotio deducerent... Caussas aliquot huiusce excidii in praecedenti Dissertatione aperui ; nunc unam, quae superfuit, tantum persequar, nonnullorum videlicet Regum impiam cousuetudinem, qui ut Magnatum animos in sua fide ac dilectione confirmarent, sive ut remuneratione quapiam Militares viros ad maiores in bello labores sustinendos accenderent, terras Ecclesiae, ac praecipue Monasteriorum, iis in Beneficium largiebantur, liberalitatis et grati animi famam facili rei alienae profusione captantes. C'est exactement ce que l'on voit encore de nos jours.
Les biens ecclésiastiques s'accroissent non seulement par la piété des fidèles, mais aussi par l'espoir que ceux-ci nourrissent d'être récompensés de leurs dons, dans cette vie ou dans une autre. Ce sentiment d'une sorte de contrat avec la divinité : do ut des, prépondérant chez les Romains, ne disparaît pas avec l'avènement du christianisme. FUSTEL DE COULANGES ; La monarchie franque : « (p. 566) Tout homme, à cette époque, était un croyant. La croyance, pour la masse des laïques, n'était ni très étendue ni très élevée, peu réfléchie, nullement abstraite ni métaphysique ; elle n'en avait que plus de force sur l'esprit et la volonté [des résidus et des intérêts, avec un minimum de dérivations]. Elle se résumait en ceci, que la plus grande affaire de chacun en ce monde était de se préparer une place dans un autre monde. Intérêts privés et intérêts publics, personnalité, famille, cité, État, tout s'inclinait et cédait devant cette conception de l'esprit [il y avait pourtant alors des exceptions, comme de nos jours pour la foi humanitaire ou patriotique ; de tout temps de rusés compères ont su tirer parti de la foi d'autrui] ». « (p. 598) La crédulité n'avait pas de limites. C'était trop peu de croire à Dieu et au Christ, on voulait croire aux saints... C'était une religion fort grossière et matérielle. Un jour, saint Colomban apprend qu'on a volé son bien dans le moment même où il était en prières au tombeau de saint Martin ; il retourne à ce tombeau et s'adressant au saint : „ Crois tu donc que je sois venu prier sur tes reliques pour qu'on me vole mon bien ? “ Et le saint se crut tenu de faire découvrir le voleur et de faire restituer les objets dérobés. Un vol avait été commis dans l'église de Sainte-Colombe à Paris ; Éloi court au sanctuaire et dit : „ Écoute bien ce que j'ai à te dire, sainte Colombe ; si tu ne fais pas rapporter ici ce qui a été volé, je ferai fermer la porte de ton église avec des tas d'épines, et il n'y aura plus de culte pour toi. “ Le lendemain, les objets volés étaient rapportés ». (§ 1321). De nos jours, C'est la « justice immanente », ou autre entité de ce genre, qui se charge de besognes analogues. « (p. 574) Les donations furent nombreuses. Elles avaient leur source dans l'état des esprits et des âmes... (p. 575) Dès que l'homme croyait fermement à un bonheur à venir qui devait être une récompense, l'idée lui venait spontanément d'employer tout ou partie de ses biens à se procurer ce bonheur. Le mourant calculait que le salut de son âme valait bien une terre. Il supputait ses fautes, et les payait d'une partie de sa fortune... Regardez en quel style sont rédigées presque toutes ces donations. Le donateur déclare qu'il veut „ racheter son âme “, qu'il donne une terre „ en vue de son salut“, „ pour la rémission de ses péchés “, ,, pour obtenir l’éternelle rétribution “. On voit par là que, dans la pensée de ces hommes, la donation n'était pas gratuite. Elle était un échange, un don contre un don ; donnez, était-il dit, et il vous sera donné, date et dabitur ». C'est ce que de nos jours pensent les souscripteurs à de chanceux emprunts publics.
Les fidèles donnaient, et les puissants prenaient. Cela commença dès les temps où la foi était profonde. D. GREG. ; Hist. eccl. franc., IV, 2, (trad. BORDIER). « Le roi Chlothachaire avait récemment ordonné que toutes les églises de son royaume payeraient au fisc le tiers de leurs revenus ; tous les évêques avaient, bien contre leur gré, consenti et souscrit le décret ; mais le bienheureux Injuriosus, s'en indignant, refusa courageusement de souscrire, et il disait : „ Si tu veux enlever ce qui est à Dieu, le Seigneur t'enlèvera bientôt ton royaume...“ Et, irrité contre le roi, il se retira sans lui dire adieu. Le roi ému, craignant d'ailleurs la puissance du bienheureux Martin, envoya après l'évêque avec des présents, lui demanda pardon, et le pria de supplier en sa faveur la puissance du bienheureux pontife Martin ».
Les Conciles s'évertuaient à fulminer des peines ecclésiastiques contre les usurpateurs des biens de l'Église. En l'au 504, un Concile fut tenu à Rome, principalement en cette intention. Il renouvela les règlements des Conciles précédents et décréta, en son can. I : Quicumque res Ecclesiae confiscare, aut competere, aut pervadere, periculosa aut sua infestatione praesumpserit, nisi se citissime per Ecclesiae, de qua agitur, satisfactionem correxerit, anathemate feriatur. Similiter et hi qui Ecclesiae, iussu, vel largitione principum, vel quorumdam potentum, aut quadam invasione, aut tyrannica potestate retinuerint, et filiis vel haeredibus suis quasi haereditarias relinquerint, nisi cite, res Dei, admoniti a Pontifice, agnita veritate reddiderint, perpetao anathemate feriantur. La malice des usurpateurs était grande ; ils avaient imaginé de se mettre en possession des biens de l'Église, sous prétexte de les conserver pendant les interrègnes. Le Concile les condamne. Les patrons aussi se servaient des biens ecclésiastiques, les abbayes étaient usurpées. En l'an 909 fut tenu un Concile à Troslé près de Soissons. FLEURY ; Hist. eccl., t. XI. Dans la préface des décrets de ce Concile on dit : « (p. 615) Les villes sont dépeuplées, les monastères ruinés ou brûlés, les campagnes réduites en solitudes... (p. 616) Dans la suite on décrit ainsi la décadence des monastères. Les uns ont été ruinés ou brûlés par les païens, les autres dépouillés de leurs biens, et presque réduits à rien : ceux dont il reste quelques vestiges ne gardent plus aucune forme de vie régulière... (p. 617) Le Concile s'étend ensuite sur le respect dû aux personnes ecclésiastiques, les mépris et les outrages auxquels ils étaient alors exposés, et le pillage des biens consacrés à Dieu ». Plus loin, t. XII, au 956 : « (p. 115) Nous avons encore un traité d'Atton de Verceil touchant les souffrances de l'église, divisé en trois parties... (p. 118) La troisième partie est touchant les biens des églises. Nous ne pouvons passer sous silence, dit l'auteur, qu'après la mort ou l'expulsion d'un évêque, les biens de l'église sont donnez au pillage-à des séculiers. Car qu'importe qu'on les pille de son vivant ou après sa mort ? et à quoi sert de garder le trésor de l'église, si on pille les granges, les celliers et tout le reste ? On dissipe tout ce qui se trouve en nature, on vend les fruits à recueillir sous le nom de l'évêque futur, on diffère son ordination jusqu'à ce que l'on ait tout consumé ; et enfin on donne l'évêché à celui qui en offre le plus. En sorte qu'il n'y a point de terres si souvent pillées et vendues que celles de l'église ». L'Église d'Orient n'était pas mieux partagée que celle d'Occident. Ibidem, t. XV, (an 1115) : (p. 17)... l'empereur Manuel Comnème fit une constitution par laquelle il renouvela la défense que son père avait faite de prendre les biens des évêchés vacants. Nous avons appris, dit-il, qu'à la mort des évêques, quelquefois même avant qu'ils soient enterrés, les officiers des lieux entrent dans leurs maisons, dont ils emportent tout ce qu'ils y trouvent, et se mettent en possession des immeubles de leurs églises... »
Si ce n'était pas seulement la piété qui poussait aux dons, ce n'était pas non plus la seule impiété qui poussait à la spoliation. Le besoin d'argent était souvent la cause principale. Il est fort probable que Sulla croyait en Apollon tout en dépouillant le temple. De pieux monarques chrétiens n'agirent pas différemment. De nos jours, de sincères humanitaires savent s'enrichir grâce à leur religion. Charles Martel était certes un prince pieux ; pourtant on l'accuse d'avoir dépouille l'Église. FRAN IN ; Annales du Moyen-Âge, t. VI : « (p. 455) Les capitaines de Charles furent donc les premiers vassaux ; et le nouveau fisc qu'il créa, si l’on peut parler ainsi, fut formé des biens des églises dont il leur livra la dépouille... Non seulement les biens des églises, mais les églises même, les monastères, les chaires, furent la proie de sa libéralité sacrilège. Il livra, dit un contemporain, les sièges épiscopaux aux laïcs et ne laissa aucun pouvoir aux évêques. Un de ses capitaines, après la victoire, reçut à lui seul pour récompense les sièges de Reims et de Trèves. Les monastères furent envahis, ruinés ou détruits ; les moines chassés, vivant sans discipline, et cherchant des asiles où ils pouvaient. Charles, dit un autre, détruisit par toute la France les petits tyrans qui s'arrogeaient l'empire ; après quoi voulant récompenser ses soldats, il attribua au fisc les biens des églises et leur en fit le partage. Cette violente usurpation du patrimoine ecclésiastique eut lieu dans toute la suite de ses longues guerres. „ Enfin, dit la chronique de Verdun, Charles dispensa avec une monstrueuse profusion, le patrimoine public à ses guerriers que l'on commença à appeler du nom de soldats ou (p. 456) soudoyés, et qui accouraient vers lui de toutes les parties du monde, attirés par l'appât du gain... Le pillage du trésor royal, le sac des villes, le ravage des royaumes étrangers, la spoliation des églises et des monastères, les tributs des provinces, suffirent à peine à sa convoitise. Ces ressources épuisées, il s'empara des terres des églises. Il donna les évêchés à ses capitaines, soit clercs, soit laïcs, et des sièges se virent plusieurs années sans pasteurs ».
La légende, qui s'était déjà chargée de la punition des spoliateurs du temple de Delphes, se chargea aussi de la punition de Charles. Les spoliateurs de Delphes eurent des peines terrestres, Charles, des peines en l'autre monde. Saint Eucher d'Orléans vit aux enfers l'âme de Charles Martel. Les évêques signalent le fait en une lettre adressée à Louis le Pieux. Dec. Grat., pars. sec., ca. 16, qu. 1, can. 59 : Quia vero Carolus Princeps, Pipini Regis Pater, qui primus inter omnes Francorum Reges, ac Principes res Ecclesiarum ab eis separavit, atque divisit, pro hoc solo maxime est aeternaliter perditus. Nam s. Eucherius Aurelianensis Episcopus, ...in oratione positus, ad alterum seculum raptus, et inter cetera, quae Domino sibi ostendente conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. L'ange qui le guidait en cette excursion lui dit que Charles souffrait cette peine à cause de ses rapines, et qu'il fallait distribuer ses biens aux églises et aux pauvres. Qui [s. Eucherius] in se reversus s. Bonifacium, et Fuldradum Abbatem monasterii s. Dionysii... ad se vocavit, eisque talia dicens in signum dedit, ut ad sepulcrum illius irent, et si corpus eius ibidem non reperissent, ea, quae dicebat, vera esse concrederent. Ipsi autem pergentes ad praedictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli humatum fuerat, sepulcrumque ipsius aperientes, visus est subito exiisse Draco, et totum illud sepulcrum interius inventum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos vidimus, qui usque ad nostram aetatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt, et nobis viva voce veraciter sunt testati quae audierunt, atque viderunt. Quod cognoscens filius eius Pipinus, synodum apud Liptinas congregari fecit... Nam et synodum ipsam habemus, et quantumcumque de rebus Ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, Ecclesiis reddere procuravit. Gratien ajoute : Huius historiae mentio etiam est in vita beati Eucherii... Qualis vero esset huiusmodi Ecclesiasticorum bonorum divisio, quani Carolus Martellus induxit, Pipinus autem, et Carolus Imperator prohibuerunt, eod. lib. primo Capitularium ante capitulum istud 83 sic exponitur : „ ... in Aquis fuit factura istud capitulum, propter hoc, quia Laici homines solebant dividere Episcopia, et monasteria ad illorum opus, et non remansisset ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissae, nisi tantum, ut velut Canonici, et Monachi viverent. “
Depuis lors, ces phénomènes se reproduisent jusqu'au temps présent, en lequel nous trouvons la suppression des corporations religieuses en Italie, et tout récemment en France. Les biens des églises furent distribués ostensiblement aux soldats de Charles Martel, le « milliard des congrégations » fondit et se dissipa entre les mains des partisans des politiciens. En l'un et l'autre cas, il se peut que l'opération ait eu, somme toute, un effet utile pour le pays, en assurant la stabilité d’un régime politique.
THOROLD ROGERS a fort bien décrit les prodigalités de Henri VIII, en Angleterre, et leurs conséquences. Interprétations économiques de l'histoire : « (p. 45) Jamais l'Angleterre n'eut de souverain aussi follement dépensier que Henri VIII. Grâce à l'esprit d'économie de son père, il avait hérité d'une fortune considérable pour l'époque. Il l'eut bientôt dissipée. Ses guerres, ses alliances et ses subsides à l'empereur d'Allemagne... lui coûtèrent gros sans rien lui rapporter ; même en temps de paix ses dépenses étaient prodigieuses... (p. 46) Sa méfiance et son goût pour l'apparat le poussaient à enrichir sa noblesse qu'il avait installée dans ses nombreux palais... S'il l'avait pu, il aurait dépensé toute la fortune particulière de ses sujets et essaya de tout pour s'en emparer. Cependant il fut populaire, car les prodigues sont toujours populaires, même lorsqu'ils gaspillent ce qui ne leur appartient pas [cette observation s'applique aussi aux politiciens de notre temps]. Il confisqua les biens des petits monastères et vit bientôt le bout de leurs richesses. Il épargna quelque temps les grands, déclarant qu'ils étaient les asiles de la piété, de la religion. Puis il s'engagea à ne plus frapper son peuple d'impôts nouveaux, même en cas de guerres légitimes, à condition que les dépouilles des monastères lui seraient attribuées. Prévoyant la tempête, les moines avaient loué leurs terres par baux à long terme, de sorte qu'une grosse part du butin ne lui revint que plus tard, mais les trésors accumulés pendant des siècles tombèrent dans ses griffes. Une longue file de chariots emporta l'or, l'argent et les pierres précieuses, que quatre siècles avaient amassés autour de la châsse de Becket, le sanctuaire le plus riche de l'Angleterre, peut-être de la chrétienté. Mais Wincester, Westminster, cent autres lieux consacrés étaient presque aussi riches... leurs trésors équivalaient probablement à toute la monnaie en circulation à l'époque et les terres des couvents occupaient, dit-on, le tiers de la superficie du royaume. Le tout s'évanouit comme neige (p. 47) en été... Après ces exploits, il semble n'avoir plus osé demander d'argent à son peuple. Toutefois il s'avisa d'un moyen sûr de s'attaquer à sa bourse et se mit à émettre de la monnaie altérée... »
Il est inutile de continuer, pour d'autres pays, cette analyse qui ne ferait que reproduire des faits analogues à ceux que nous venons de rappeler. En Allemagne, la guerre des Investitures, la Réforme, la sécularisation des principautés ecclésiastiques, au temps de la Révolution française ; en France les abbayes distribuées, aux abbés de cour, les expro- priations de la première république, celles de la troisième, sont de nouveaux exemples des grandes oscillations de la courbe des spoliations.
[FN: § 2316-6]
Cours, § § 344 à 363. Il faut écarter quelques considérations éthiques, qui apparaissent, au moins implicitement, çà et là.
[FN: § 2316-7]
ARISTOPH. : Equites, (1127-1130) Peuple « ... Je veux nourrir un démagogue [conducteur du peuple] voleur ; quand il est gorgé, je le frappe, lorsqu'il est porté en haut. ... (1147-1149)... je les force [les démagogues voleurs] à vomir ce qu'ils m'ont volé ». À Rome, vers la fin de la République, les provinces étaient livrées à des « spéculateurs », qui, par des largesses faites au peuple romain, acquéraient le droit de les pressurer. Les despotes asiatiques et les africains faisaient dépouiller leurs sujets par des agents qu'ils dépouillaient à leur tour. Les rois chrétiens laissaient les juifs, les usuriers, les banquiers s'enrichir, et, ensuite s'appropriaient leur argent. En France, la Régence laissa bon nombre de personnes s'enrichir par de scandaleuses spéculations qu'elle avait créées et favorisées, puis les força à rendre gorge, avec des exceptions plus scandaleuses encore. Voir sur la spéculation à laquelle donna lieu le système de Law : FERRARA : Della Moneta e dei suoi surrogati – Raccolta delle prefazioni... vol. II, parte I. Cet auteur conclut : « (p. 499) La simulation des Compagnies de commerce, la cabale financière, la banqueroute à laquelle lui [Law] et le Régent s'acheminaient, voilà tout le (p. 500) secret de Law ; et tous ces artifices n'ont rien à voir avec les institutions de crédit, et encore moins avec la liberté des banques ». Les admirateurs de l'État éthique et les défenseurs plus ou moins gratuits des « spéculateurs » ont tenté, de défendre le système de Law et le Régent. Les dérivations qu'ils ont produites sont de celles qui s'emploient généralement en de telles occasions. Le 26 janvier 1721, on soumit à un visa tous les détenteurs d'effets relatifs au Système, y compris les contrats de rente acquis avec des billets. Les contemporains des banqueroutes et des visas de 1716 et de 1721 se rendaient compte de la nature de ces spoliations. J. BUVAT : Journal de la Régence, édité par E. CAMPARDON, Paris 1865, t. I : « (p. 201) Le 10 [décembre 1716], on vit une médaille frappée à l'occasion de la recherche des gens d'affaires et des agioteurs, par la chambre de justice, sur laquelle était d'un côté le portrait du roi Louis XIV, au bas duquel était la légende : Esurientes implevit bonis, et de l'autre côté était celui du roi Louis XV, avec ces mots au bas : Divites dimisit inanes. Plus loin, t. II, à propos du visa de 1721 : « (p. 273) „ Ne parlez point de taxe, reprit le prince [le Duc de Bourbon] ; on sait trop les malversations qui se sont faites dans la dernière chambre de justice ; ainsi dans celle que l'on prétend créer de nouveau, il arrivera le même inconvénient. La moindre femme obtiendra ce qu'elle voudra de M. le duc d'Orléans, pour faire décharger ceux dont elle espérera récompense, afin de les favoriser. Ne croyez pas que je dise ceci parce qu'il n'est pas ici présent, je le soutiendrais à lui-même “ ». H. MARTIN, Hist. de Fr., t. XVII : « (p. 228) On établit des catégories qui perdirent du sixième aux dix-neuf vingtièmes [opération analogue à celle des impôts progressifs, de nos jours], immense travail par lequel on tâcha, comme en 1716, d'observer dans la (p. 229) violation de la foi publique une sorte de justice relative. Cinq cent onze mille personnes déposèrent pour deux milliards cinq cent vingt-et-un millions de papiers, qu'on réduisit de cinq cent-vingt-et-un millions ; restaient environ dix-sept cents millions, qu'on admit comme capital de rentes viagères et perpétuelles... Une très petite partie de la dette (quatre-vingt- deux millions et demi) fut acquittée en argent ». Cette banqueroute avait été précédée par une autre analogue, en 1715. H. Martin observe, à ce propos « (p. 161) L'histoire financière de l'ancien régime n'offre qu'une alternative de déprédations des financiers sur le peuple, et de violences du pouvoir sur les financiers ; c'était un cercle dont on ne pouvait sortir ». Il est singulier qu'un historien de valeur, comme l'était H. Martin, n'ait pas vu qu'il ne s'agissait là, en somme, que d'un cas particulier d'un phénomène général.
Les hommes pratiques ont souvent des vues plus justes que les théoriciens. Saint-Simon a bien vu que, pour interrompre le cycle des spoliations, il faudrait empêcher de se produire le flux d'argent qui fournit la matière des appropriations ; mais il s'est trompé sur l'efficacité des moyens. SAINT-SIMON ; Mémoires, édition in-18, t. VII, p. 403 à 407. Il propose la banqueroute pure et simple, et y voit l'avantage qu'on ne prêtera plus au gouvernement, et que celui-ci sera bien obligé de modérer ses dépenses. « (p. 404) Plus il [l'édit de la banqueroute] excitera de plaintes, de cris, de désespoirs par la ruine de tant de gens et de tant de familles, tant directement que par cascade, conséquemment de désordres et d'embarras dans les affaires de, tant de particuliers, plus il rendra sage chaque particulier pour l'avenir ». Saint-Simon se trompe. L'expérience faite en un grand nombre de siècles a démontré que la naïveté des épargneurs est tout aussi tenace que la passion du jeu. « De là deux effets d'un merveilleux avantage : impossibilité au roi de (p. 405) tirer ces sommes immenses pour exécuter tout ce qui lui plaît, et beaucoup plus souvent qu'il plaît à d'autres de lui mettre dans la tête pour leur intérêt particulier ; impossibilité qui le force à un gouvernement sage et modéré, qui ne fait pas de son règne un règne de sang et de brigandages et de guerres perpétuelles contre toute l'Europe bandée sans cesse contre lui, armée par la nécessité de se défendre... L'autre effet de cette impossibilité délivre la France d'un peuple ennemi, sans cesse appliqué à la dévorer par toutes les inventions que l'avarice peut imaginer et tourner en science fatale [ce qui est devenu la science des finances de notre époque] par cette foule de différents impôts [encore plus nombreux de nos jours], dont la régie, la perception et la diversité, plus funeste que le taux des impôts mêmes, pour ce peuple nombreux dérobé à toutes les fonctions utiles de la société, qui n'est occupé qu'à la détruire, à piller tous les particuliers, à intervertir commerce de toute espèce... » C'est un « rentier » qui parle : il voit une des faces de la médaille, un « spéculateur » aurait vu l'autre face.
[FN: § 2316-8]
Nous employons le terme nécessaire uniquement dans le sens expérimental, pour exprimer, sans adjonction d'aucune conception d'absolu métaphysique ou autre, le simple fait que, dans les limites d'espace et de temps à nous connues, un phénomène s'observe constamment uni à un autre.
[FN: § 2316-9]
Cours, t. I, § § 469 à 472, p. 340 à 343.
[FN: § 2316-10]
Pourquoi un même auteur s'est-il d'abord arrêté à ce point, et l'a-t-il ensuite dépassé ? S'il ne s'agissait là que d'un cas individuel, ce problème ne vaudrait pas la peine qu'on s'en occupât ; mais il est d'une portée bien plus générale, et peut nous fournir des considérations utiles pour l'étude des phénomènes sociaux.
L'auteur du Cours ayant insisté longuement sur la nécessité de tenir compte de la mutuelle dépendance des phénomènes, on ne saurait voir en un oubli général de cette mutuelle dépendance la source principale de son erreur. Pourtant on peut dire que, en particulier, la mutuelle dépendance des phénomènes économiques et des phénomènes sociaux est parfois un peu négligée par lui. Mais son erreur a surtout pour cause le fait qu'il ne tâche de soumettre que les phénomènes économiques à une rigoureuse analyse scientifique. Quand il s'agit des phénomènes sociaux, il accepte souvent les théories toutes faites que lui fournissent l'éthique courante et les jugements a priori de la société et du temps où il vit. C'est d'ailleurs là un principe qui a guidé et qui continue à guider le plus grand nombre des économistes, et c'est pour cela qu'il est utile d'en signaler l'erreur.
L'auteur du Cours paraît croire, au moins implicitement, que ce qui est contraire à l'éthique est nuisible à la société, et que ce qui est déclaré blâmable par les opinions courantes, qu'il fait siennes, doit être évité. On voit là d'abord l'influence des résidus et principalement de ceux du genre II-dzéta. Les résidus du genre IV-ε 3 interviennent aussi. L'auteur a étudié avec tout le soin possible les phénomènes économiques ; il croit, à tort ou à raison, avoir obtenu des démonstrations scientifiques, il a l'impression, lorsqu'il traite de ces phénomènes, d'être sur un terrain solide, ne se soucie nullement du blâme que peut lui infliger le sentiment, et n'a cure des opinions régnantes si elles ne sont pas justifiées par l'expérience. Mais, arrivé sur le terrain des phénomènes sociologiques, il comprend qu'il ne les a pas encore étudiés avec une rigoureuse analyse expérimentale, et qu'il se trouve sur un terrain mouvant ; il hésite à rompre en visière avec certaines opinions dont il ne se sent pas encore en mesure de démontrer la fausseté expérimentale, et soumet alors son jugement à celui des sentiments d'autrui ou des siens propres. On voit ensuite apparaître des dérivations du genre II-α. Par exemple, des économistes d'une renommée aussi grande que méritée voyaient dans la falsification des monnaies une simple fraude, œuvre d'un pouvoir malhonnête. L'auteur du Cours, à son insu peut-être, est sous l'influence de cette idée, que lui ont inculquée ses maîtres ; il cède à des dérivations du genre III-α, et probablement aussi du genre III-ε. Au point de vue de la seule logique, il y trouve d'ailleurs, à juste titre, une incontestable réfutation des rêveries des adulateurs de l'État éthique. C’est encore là un phénomène général : une dérivation erronée appelle une réfutation qui, parfaitement fondée sous l'aspect de la pure logique, paraît l'être aussi sous l'aspect expérimental. Marx donne une théorie absurde de la valeur, théorie qui exagère fortement l'erreur de celle de Ricardo ; on la réfute et on croit, par là, avoir réfuté son socialisme. C'est une erreur. La polémique au sujet des dérivations n'atteint pas la nature expérimentale des phénomènes.
Le changement qui s'observe dans la Sociologie provient principalement de ce que l'auteur a étendu la méthode expérimentale aux phénomènes sociaux ; qu'il a tâché, pour autant que sa connaissance et ses forces le lui permettaient, de ne plus rien admettre a priori, ou en se soumettant à l'autorité, aussi respectable fût-elle, de ne plus se fier en aucune manière au sentiment, que ce fût le sien propre ou celui d'autrui, de pourchasser, autant que faire se pourrait, toute intrusion de la métaphysique et des différentes théologies, et en somme de tout soumettre au critérium exclusif de l'expérience.
[FN: § 2316-11]
Cours, § § 466, 4711. La description du phénomène est telle que nous pouvions la donner alors que nous n'avions pas encore la théorie générale de la forme ondulée des phénomènes sociaux (§ § 1718, 2293, 2330). Elle a pourtant le mérite d'être opposée à la théorie optimiste de la diminution du taux de l'intérêt ; théorie qui régnait en ce temps, et que les faits qui se sont vérifiés depuis lors se sont chargés de réfuter.
[FN: § 2316-12]
Un exemple d'une de ces oscillations, en Angleterre, est indiqué dans Cours, § 471-1.
[FN: § 2316-13]
Les systèmes socialistes, t. I, chap. IV : Systèmes réels.
[FN: § 2317-1]
Journal de la Société de statistique de Paris, avril 1914, p. 191. Suivant M. A. NEYMARCK, il y avait, dans le monde, à la fin de l'année 1912, une somme de 850 milliards de valeurs mobilières : titres d'État, actions et obligations de sociétés industrielles, etc. En France, il y en avait 115 à 120 milliards, dont 80 milliards en titres français. Le passé ne nous appartient plus. Si l'on pouvait accomplir l'opération sans que les futurs producteurs d'épargne s'en aperçoivent, ou en somme, sans qu'ils aient des craintes pour eux-mêmes, on pourrait enlever ces 850 milliards à leurs possesseurs, sans altérer beaucoup la productivité économique du monde. On aurait simplement un transfert de richesse de certains individus à certains autres, avec les perturbations que peut produire dans la production la diversité des goûts et des besoins des possesseurs anciens et nouveaux. Il n'en serait pas ainsi, si l'opération effrayait les futurs producteurs d'épargne, lesquels pourraient alors cesser partiellement d'épargner, et, au demeurant, cacher les épargnes faites. Ils priveraient ainsi la production de ses moyens d'extension, et provoqueraient la ruine économique. Le problème que nos gouvernants ont eu à résoudre, particulièrement les gouvernants spéculateurs, consistait donc à trouver un moyen de dépouiller les producteurs actuels de l'épargne, sans effrayer les producteurs futurs. Ce problème a été résolu, non par la théorie, mais par empirisme, et, guidés par l'instinct, les gouvernants ont trouvé la meilleure solution du problème. Elle consiste à n'avancer que pas à pas, en donnant de temps en temps un petit coup de dent dans le gâteau. Ainsi, bien loin d'éveiller la crainte chez les futurs producteurs d'épargne, on les encourage ; car, au fur et à mesure que croissent les charges pesant sur l'épargne déjà existante, l'épargne future acquiert une plus grande valeur. Par exemple, en 1913, on parlait d'établir un impôt sur la rente française, ce qui fit baisser en bourse le prix de la rente. Dans un phénomène si compliqué, il est impossible de trouver un rapport précis entre le taux de l'impôt et le cours de la rente. Mais faisons une hypothèse, uniquement pour donner une forme concrète à des considérations abstraites. Supposons que l'impôt soit du 5 % sur le coupon, lequel par conséquent, au lieu de 3 fr. pour 100 de capital, sera seulement de 2,85 fr. Si le prix de la rente baisse précisément de 5 % comme le coupon, et si, du prix de 92, par exemple, elle descend à 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent une certaine somme ; les nouveaux producteurs ne perdent ni ne gagnent, et continuent à employer leur épargne avec le même intérêt qu'ils auraient, si la rente était demeurée à 92, sans impôt sur le coupon. Il y a deux autres cas: 1° si la rente demeure au-dessus de 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent moins et les nouveaux quelque peu ; il y a une baisse générale de l'intérêt du capital ; 2° si la rente tombe au-dessous de 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent davantage, et les nouveaux gagnent ; il y a une hausse générale de l'intérêt du capital. On remarque le premier cas assez généralement dans les périodes de stagnation, le second dans les périodes d'activité économique. D'une manière générale, dans ce second cas, les spéculateurs gagnent de deux façons : 1° ils s'approprient une partie de l'argent enlevé aux anciens possesseurs d'épargne; 2° ils reçoivent un intérêt du capital supérieur pour leurs épargnes. lesquelles sont faciles à amasser grâce à l'augmentation des bénéfices. Ce mouvement ne peut continuer indéfiniment, non par suite de la résistance de ceux auxquels on enlève leurs biens, mais à cause de la réduction de la production, par suite de l'accroissement de l'intérêt des capitaux ; en outre, parce que la facilité de gagner qu'ont les spéculateurs induit les gens à dépenser plus qu'à épargner. Il est facile de comprendre qu'avec la somme totale de 850 milliards de francs d'épargne existant dans le monde, cet effet ne peut être que très lent. Avant qu'il modifie profondément le phénomène, des forces d'un effet plus prompt peuvent intervenir, comme celle que produit la concurrence internationale, celle de l'usage que l'on fait de l'épargne, et celle de l'emploi de la force pour arracher leur proie aux spéculateurs.
[FN: § 2320-1]
Le phénomène est très connu, et les ouvrages qui le décrivent sont innombrables ; mais il ne doit pas être disjoint des autres phénomènes du régime politique actuel. Depuis une centaine d'années, on n'entend que lamentations sur l'accroissement de la bureaucratie, en nombre et en pouvoir ; et celle-ci, d'un mouvement toujours plus rapide, continue à croître en nombre et en pouvoir, et envahit des pays qu'elle avait jusqu'à présent épargnés, comme par exemple l'Angleterre. Il est donc évident qu'il existe des forces puissantes poussant dans cette voie, et brisant les résistances qui tenteraient d'empêcher qu'on ne la parcoure. Un fait contribue à rendre ces résistances inefficaces : les différents partis politiques blâment une augmentation générale de la bureaucratie, en nombre et en pouvoir, tandis qu’ils louent et invoquent une augmentation partielle de cette fraction de la bureaucratie qui sert à certaines de leurs fins politiques, et même personnelles, et qu'ils restreignent leurs blâmes à la fraction qui ne leur est pas utile. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, les gouvernements modernes sont irrésistiblement poussés à augmenter les dépenses pour leurs employés, afin d'acquérir la faveur de ceux qui profitent de ces dépenses et de leurs protecteurs. Dans l'Avanti du 29 mars 1915, CLAUDIO TREVES dit : « ... Savez-vous que le budget des colonies, 1915-1916, prévoit 7 577 900 fr. pour payer les employés : L'éléphantiasis bureaucratique trouve aux colonies son paradis. [Sic.] Cela explique bien des choses, entre autres l'indulgence démocratique pour l'impérialisme, sauveur, bienfaiteur des classes misérables de la petite bourgeoisie intellectuelle, satellite du gros capitalisme financier, auquel il procure des prébendes honorifiques, et qu'il empêche d'aller s'unir au prolétariat des usines ». On n'a qu'à généraliser ces observations, limitées aux intérêts d'un parti, et l'on aura la description du phénomène que l'on observe aujourd'hui dans presque tous les pays civilisés.
[FN: § 2326-1]
Au sujet de certains motifs sociaux qui attirent dans le parti socialiste ou dans le parti « démocratique » plusieurs personnes qui ne sont pas des spéculateurs, voir ROBERT MICHELS ; Les partis politiques : « (p. 186) Il est des personnes bonnes et charitables qui, pourvues en abondance de tout ce dont elles ont (p. 187) besoin, éprouvent parfois le besoin de se livrer à une propagande en rapport à leur situation spéciale... Dans les cerveaux malades de quelques personnes, dont la richesse n'égale que leur amour du paradoxe, est née cette croyance fantastique que, vu l'imminence de la révolution, elles ne pourront préserver leur fortune qu'en adhérant préventivement au parti ouvrier et en gagnant ainsi la puissante et utile amitié de ses chefs [ces personnes suivent, sans avantage direct, la même voie que parcourent les spéculateurs avec un gros avantage pour eux-mêmes]. D'autres encore, parmi les riches, crurent devoir s'inscrire au parti socialiste, parce qu'ils le considèrent comme un refuge contre l'exaspération des pauvres. Très souvent encore, l'homme riche est amené à se rapprocher du socialisme, parce qu'il éprouve la plus grande difficulté... à se procurer dorénavant de nouvelles jouissances... (p. 188). Mais il existe, parmi les socialistes d'origine bourgeoise, d'autres éléments... Il y a avant tout la phalange de ceux qui sont mécontents „ par principe “... Plus nombreux encore sont ceux dont le mécontentement tient à des raisons personnelles... Beaucoup détestent consciemment ou non, l'autorité de l'État, parce qu'elle leur est inaccessible... Il existe encore d'autres types qui se rapprochent de ceux que nous avons énumérés. Les excentriques d'abord... Mais il est des gens qui sont en haut et éprouvent un besoin irrésistible de descendre en bas... Qu'on ajoute encore à toutes ces catégories celle des déçus et des désenchantés... »
[FN: § 2326-2]
V. PARETO ; Rentiers et spéculateurs, dans L'Indépendance, 1er mai 1911 : « En France, les « progressistes » sont contraires à l'impôt progressif sur le revenu parce qu'ils savent que ce n'est pas à eux qu'ira le produit de cet impôt ; à Milan, les « libéraux » ont établi cet impôt, parce que, ayant le pouvoir, ce sont eux qui en dépensent le produit ; et que ce produit ira à eux et à leurs troupes. Les « libéraux » milanais ont un état-major composé principalement de personnes de la deuxième catégorie [spéculateurs] ; les « radicaux » s'appuient, en partie, sur des électeurs de la première catégorie [rentiers] ; il est donc naturel que, dans ces conditions, les « libéraux » soient favorables, et les « radicaux » contraires à un impôt progressif. En d'autres circonstances, par exemple, pour un impôt d'État, il pourrait ne pas en être de même ».
[FN: § 2328-1]
Il faut se rappeler ce que nous avons dit au § 2254 : que les spéculateurs ne doivent pas être considérés comme une seule et unique personne accomplissant des actions logiques en vue de desseins prémédités (§ 2542). Les faits sont une conséquence de l'organisation plus que de certaines volontés délibérées. En 1912, la guerre des Balkans n'était pas voulue par la plupart des financiers européens, mais elle avait été préparée par leur action qui, épuisant les forces de la Turquie, devait nécessairement faire de ce pays la proie de ceux qui l'attaqueraient. Parmi ceux-ci, les financiers italiens furent alors les premiers : en poussant à la guerre de Libye, ils préparèrent directement la guerre des Balkans, préparée indirectement par l'action de tous les financiers et spéculateurs européens. Ensuite, ils s'occupèrent et s'occupent encore (en 1913), de se partager économiquement la Turquie d'Asie. Ils préparent ainsi, indirectement peut-être et sans la vouloir, une nouvelle guerre dont le but sera de transformer le partage économique en un partage politique. Il se peut que cette guerre n'ait pas lieu ; mais si elle se produit, elle aura été préparée par les spéculateurs, bien qu'au moment où elle éclatera, un petit ou un grand nombre d'entre eux y soient peut-être opposés.
[FN: § 2330-1]
Cours, t. II, § 925 : « (p. 277) Les molécules dont l'ensemble représente l'agrégat social oscillent perpétuellement. Nous pouvons bien, dans un but d'analyse, considérer certains états économiques moyens, de la même manière que nous considérons le niveau moyen de l'océan ; mais ce ne sont là que de simples conceptions, qui, pas plus l'une que l'autre, n'ont d'existence réelle ».
[FN: § 2330-2]
Depuis le songe du Pharaon (Gen., 41), qui vit sept vaches grasses et sept vaches maigres, sept épis gras et beaux et sept épis maigres et brûlés, jusqu'à la théorie de Jevons mettant en rapport les crises économiques avec les périodes de stérilité aux Indes, on a une infinité de conceptions semblables. Il faut remarquer que le Pharaon voit les vaches maigres manger les grasses, les sept épis maigres manger les pleins, et non vice versa. De même, encore de nos jours, un grand nombre d'économistes réservent le nom de crise à la période descendante de l'ondulation économique, et ne paraissent pas se rendre compte que la période ascendante amène la période descendante, et vice versa.
[FN: § 2330-3]
La doctrine d'une série de créations et de destructions du monde paraît avoir été soutenue par Anaximandre, Anaximène et Héraclite, bien que l'on ait voulu interpréter différemment les passages qui nous restent de ces auteurs. L'un d'eux au moins était passablement obscur, même pour Cicéron, qui dit (De nat. deor., III, 14, 35) que, puisque Héraclite n'a pas voulu se rendre intelligible, on peut l'omettre.
Au fond, ces questions d'interprétation sont indifférentes pour les recherches que nous faisons en ce moment ; il nous suffit qu'il y ait des philosophes anciens ayant eu une semblable conception et cela résulte sûrement de passages tels que ceux d’ARISTOTE, De Coelo, I, 10, 2 ; Phys., I, 1 ; DIOG. LAERT., IX, 8. Ce dernier auteur attribue à Héraclite l'assertion que « le Monde est un ; il naît du feu, et de nouveau est incendié, selon certaines périodes, alternativement chaque siècle [ou : espace de temps]. Cela est déterminé par le destin ». EUSEB. Praep. evang., XIII, 18, p. 676. Les Stoïciens, qu'ils l'aient ou non empruntée à des philosophes antérieurs, avaient une doctrine analogue. EUSEB. ; Praep. evang., XV, 18; CIC. ; De nat. deor., II, p. 46, 118. On a ainsi l'un des extrêmes que nous avons indiqués dans le texte ; l'autre est fourni par HERBERT SPENCER. Dans la 2e partie des Premiers principes, l'auteur a tout un chapitre intitulé : Rythme du mouvement. Après avoir noté plusieurs exemples de ce rythme, il ne se contente pas de conclure, ainsi que le veut la science expérimentale, que c'est là une propriété assez générale ; sa métaphysique le porte à rechercher ce qui est absolu, nécessaire, et il conclut : « (p. 291) Ainsi donc le rythme est une propriété nécessaire de tout mouvement. Étant donnée la coexistence universelle de forces antagonistes, postulat nécessité comme nous l'avons vu par la forme de notre expérience, le rythme est un corollaire forcé de la persistance de la force ».
[FN: § 2330-4]
PLAT. : De rep., VIII, p. 546 : « Il est difficile que la cité [celle qu'il a imaginée] ainsi constituée change. Mais puisque toutes les choses qui naissent dépérissent, cette constitution ne pourra pas toujours durer : elle se dissoudra. La dissolution se fera ainsi. Non seulement pour les plantes qui naissent de la terre, mais aussi pour l'âme et le corps des animaux qui habitent la terre, il y a des périodes de fertilité, et de stérilité, lorsque les révolutions de chaque cercle s'accomplissent ; ces périodes sont courtes pour les espèces dont la vie est courte, longues pour celles dont la vie est longue ». Ensuite vient la phrase citée dans le texte.
[FN: § 2330-5]
ARISTOTE cite (Polit. V, 10, 1) la phrase de Platon, et paraît l'avoir comprise. Il reproche ensuite (V, 10, 2) à Platon de faire changer toutes les choses à la fois, même celles qui ne sont point nées ensemble ; mais c'est une critique formelle, qu'on peut lever facilement pour toutes les théories de ce genre, en substituant les variations continues réelles aux variations discontinues que considèrent les auteurs pour faciliter l'exposé de leurs doctrines. Il faut seulement tenir compte du fait, et ne pas prendre cet exposé à la lettre. FR. PAULHAN (Le nouveau mysticisme – Paris, 1891) parlant des transformations de sentiments qu'il avait sous les yeux, dit : « (p. 51) (Ce dernier esprit n'en sera pas moins une combinaison des dernières croyances régnantes et des anciennes croyances plus ou moins évincées, mais encore résistantes (p. 52), c’est cette synthèse qui lui donne son caractère de nouveauté... L'ancien état d'esprit ne revient pas ; il n'y a pas de complet retour à un état antérieur, pas plus dans la vie intellectuelle des sociétés que dans leur vie politique. L'enfance des vieillards ne ressemble pas à l'enfance des enfants, la restauration n'a pas été semblable à l'ancien régime, en même temps qu'une réaction se produisait contre l'œuvre révolutionnaire, une grande part de cette œuvre se consolidait et tirait une force nouvelle des anciennes idées auxquelles elle était associée ». Ces considérations conduisent à abandonner la conception des révolutions en cercle, à périodes discontinues, et nous rapprochent de la forme ondulée, à variations continues, que l'expérience nous révèle en certains phénomènes. G. FERRARI (Teoria dei periodi politici) ne se dissimule pas la difficulté « (p. 15) de séparer une génération de celle qui la précède » ; mais il croit pouvoir résoudre ce problème en considérant les changements de gouvernement, et il arrive « (p. 16) à la conséquence que chaque trente ans les générations se renouvellent avec les gouvernements ; chaque trente ans commence une nouvelle action, chaque trente ans un nouveau drame se présente avec de nouveaux personnages, enfin chaque trente ans s'élabore un nouvel événement ». Ces affirmations dépassent de beaucoup les résultats de l'expérience.
[FN: § 2330-6]
POLYB. ; VI, fr. III, 5. Plus loin, fr. VII, 57, il observe, pour expliquer les changements des républiques, que « toutes les choses qui existent sont sujettes à la corruption et au changement » ; mais il n'a pas nécessairement pris cette conception de Platon, car elle est générale et traduit les impressions que nous recevons des changements du monde où nous vivons.
[FN: § 2330-7]
G. B. VICO : Principi di Scienza Nuova, L'Ape, Milano, per Gaspare Truffi. Les volumes de cette édition seront indiqués par I et II, les pages par p. G. B. Vico ; La Scienza Nuova... a cura di Fausto Nicolini, Bari. 1911-1916. Les volumes seront indiqués par I*, II*, III*, les pages par p*. Le style de l'auteur n'est pas toujours clair et facile. Michelet a donné de cet ouvrage une traduction ou paraphrase française, dans laquelle la clarté est parfois achetée aux dépens de la fidélité. Au commencement du IVe livre, Vico résume la matière exposée dans les livres précédents, sur l'« histoire idéale éternelle » [nouveau genre d'histoire à ajouter aux très nombreux genres existants, dont nous avons noté une partie]. Il dit : « (II, p. 225 – III*, p. 785)... Nous ajouterons le cours que font les nations ; toutes leurs coutumes [« costumi » ; on peut traduire aussi mœurs], tellement variées et diverses, procédant avec une constante uniformité sur la division des trois âges que les Égyptiens disaient s'être écoulés (p. 226) avant dans (III, p.* 786) leur Monde : [c'est-à-dire] des Dieux, des Héros et des Hommes, car sur elle [,, essa “. Ce pronom se rapporte probablement à la division des trois âges. Vient ensuite l'expression : „ si vedranno reggere “, dans laquelle le verbe demande un sujet au pluriel. Si l'auteur écrivait franchement en latin, on pourrait peut-être trouver ce sujet, mais dans le texte italien, on en est réduit aux hypothèses. Il est probable qu'il faut entendre les trois âges] seront vus dominer avec un ordre constant et jamais interrompu de causes et d'effets, toujours allant [„ andante ”]dans les Nations, par trois espèces de Natures ; et [l'on verra que] de ces Natures sont issues trois espèces de coutumes [ou de mœurs] ; de ces coutumes ont été pratiquées trois espèces de Droits Naturels des Gens, et, en conséquence de ces Droits, ont été organisées trois espèces d'États Civilisés ou de Républiques. [Ensuite on verra que], pour que les hommes venus à la Société Humaine pussent se communiquer ces dites trois espèces de choses éminentes [„ massime “], se sont formées trois espèces de Langues et autant de Caractères ; et pour les justifier [les choses éminentes], [se sont formées] trois espèces de Jurisprudences, assistées par trois espèces d'Autorités, et par autant de Raisons, [« Ragioni »], en autant d'espèces de Jugements ; lesquelles Jurisprudences furent célébrées [„ si celebrarono “] en trois Périodes des Temps [„ tre Sette, dei Tempi “ : sectae temporum] que professent dans tout le Cours de leur vie les Nations. Ces trois unités spéciales, avec beaucoup d'autres qui viennent à leur suite, et qui seront aussi dénombrées en ce livre, aboutissent toutes à une Unité générale, qui est l'Unité de la Religion d'une Divinité Providentielle [,, Provvedente “], laquelle [Unité] est l'unité de l'esprit qui donne la forme [,, che informa “] et qui donne la vie à ce Monde des Nations. Ayant déjà parlé de ces choses séparément, on fait voir ici l'Ordre de leur Cours ». Les termes soulignés le sont par notre auteur. MICHELET ; Principes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la Scienza Nuova de J. B. Vico, Bruxelles, 1885 : « (p. 317)... nous allons dans ce quatrième livre esquisser l'histoire idéale indiquée dans les axiomes et exposer la marche que suivent éternellement les nations. Nous les verrons, malgré la variété infinie de leurs mœurs, tourner, sans en sortir jamais, dans ce cercle des trois âges, divin, héroïque et humain. Dans cet ordre immuable, qui nous offre un étroit enchaînement de causes et d'effets, nous distinguerons trois sortes de natures, desquelles dérivent trois sortes (p. 318) de mœurs ; de ces mœurs elles-mêmes découlent trois espèces de droits naturels, qui donnent lieu à autant de gouvernements. Pour que les hommes déjà entrés dans la société, pussent se communiquer les mœurs, droits et gouvernements dont nous venons de parler, il se forma trois sortes de langues et de caractères. Aux trois âges répondirent encore trois espèces de jurisprudences, appuyées d'autant d'autorités et de raisons diverses, donnant lieu à autant d'espèces de jugements, et suivies dans trois périodes (sectae temporum). Ces trois unités d'espèces, avec beaucoup d'autres qui en sont une suite, se rassemblent elles-mêmes dans une unité générale, celle de la religion honorant une Providence ; c'est là l'unité d'esprit qui donne la forme et la vie au monde social ». Notons en passant les trois espèces de mœurs ou de coutumes. « (l. IV-p.* 789-p. 228) Les premières coutumes [furent] toutes aspergées [„ aspersi “] de religion et de piété, comme on dit que [furent] celles de Deucalion et de Pyrrha, venus tout de suite après le Déluge. Les secondes furent colériques et pointilleuses, comme on nous les raconte d'Achille. Les troisièmes sont de devoirs [,, officiosi “] « enseignés pour le propre point des devoirs civils ». L'auteur, traitant des trois périodes des temps, explique que, „ sous les Empereurs, les écrivains latins nommèrent officium civile le devoir des sujets (p. 262-p.* 858) ». Les trois espèces de caractères sont (p. 231-p.* 799) : 1° Les caractères divins, que l'on nomma hiéroglyphes, dont, à leur origine, se servirent toutes les nations. 2° Les caractères héroïques. 3° Les caractères vulgaires, qui appartiennent aux langues vulgaires. Nous ferons grâce au lecteur d'autres élucubrations semblables, mais il serait regrettable d'omettre toute mention de la foi robuste qu'a notre auteur en l'histoire du déluge universel et en l'existence des géants. Il a même (1. II, Del dilavio universale e dei giganti) des preuves expérimentales de cette dernière, et il les trouve dans le fait « (I, p. 212-I*, p.* 208) des armes d'une grandeur démesurée des vieux héros, qu'Auguste, d'après Suétone, conservait dans son musée, avec les os et les crânes des anciens géants ». À vrai dire, Suétone (Oct., 72) s'exprime un peu différemment. Il parle des villas d'Auguste ; sua vero, quamvis modica, non tam statuarum tabularumque pictorum ornatuquam xystis et nemoribus excoluit, rebusque vetustate ac raritate notabilibus : qualia sunt Capreis immanium belluarum ferarumque membra praegrandia, quae dicuntur Gigantum ossa, et arma heroum. « ... tels que sont les ossements énormes des animaux féroces et des animaux sauvages que l'on trouve à Caprée et que l'on appelle des os de géants et des armes de héros ».
En fait de dérivations, il y a lieu de remarquer l'usage du nombre ternaire et ce qui se rapporte aux propriétés mystiques des nombres, chères aux métaphysiciens et aux théologiens (§ 1659 1).
Dans le Ve livre, Vico traite des « retours » [,, ricorsi “] des choses humaines, dans la « résurrection des nations ». Résumant et complétant ce qu'il en a dit dans les livres précédents, « (p. 321-p* 959):pour éclairer d'une plus vive lumière les Temps de la seconde barbarie [le moyen âge] qui gisaient plus obscurs que ceux de la première barbarie [de l'antiquité]... et pour démontrer aussi comment l'Excellent Très-Grand Dieu [ce doit être une réminiscence de Iuppiter optimus maximus] (p. 322) a fait servir les conseils de sa Providence, avec lesquels il a conduit les choses humaines de toutes les Nations,, aux ineffables décrets de sa Grâce. (p.* 960) Car ayant par des voies surhumaines éclairé et établi la Vérité de la Religion Chrétienne, avec la Vertu des Martyrs, (p.* 961) contre la Puissance Romaine, et avec la doctrine [,, dottrina “] des Pères et avec les miracles, contre la vaine Science Grecque, des nations armées devant ensuite surgir pour combattre de tous côtés la vraie Divinité de son Auteur ; [Dieu] permit la naissance d'un Nouvel Ordre d'Humanité parmi les nations, pour que, selon le Cours Naturel des mêmes choses humaines, elle [,, essa “ ; probablement la Vérité déjà nommée de la religion chrétienne] fût fermement établie. Par ce Conseil Éternel, il [Dieu] ramena les Temps vraiment Divins, dans lesquels, partout, les Rois Catholiques, pour défendre la Religion Chrétienne, dont ils sont les Protecteurs, revêtirent la dalmatique des Diacres (p.* 962) et consacrèrent leurs Personnes Royales... » On arrive enfin à la conclusion. « (p. 358-p.* 1036) Concluons donc cet ouvrage avec Platon, qui établit une quatrième espèce de République, dans laquelle les hommes honnêtes et sages sont les suprêmes seigneurs, et qui serait la vraie Aristocratie Naturelle. Cette République, qui fut comprise par Platon, fut ainsi guidée par la Providence dès les premiers commencements des Nations... » Notre métaphysicien s'imagine avoir de la sorte détruit les doctrines opposées à la sienne. Il dit : « (p. 371-p.* 1049) Donc sont en fait [„ di fatto “] réfutés Épicure, qui abandonne le monde au hasard, et ses disciples Hobbes et Machiavel... Au contraire, il est de fait confirmé, en faveur des Philosophes Politiques, dont est Prince le Divin Platon, que les choses humaines sont réglées par la Providence ». De telles élucubrations planent bien au-dessus des nuages, en des régions extrêmement élevées où l'on n'aperçoit plus distinctement les faits ; elles n'ont rien à faire avec d'humbles réalités terrestres et expérimentales, telles que la forme ondulée de certains phénomènes.
[FN: § 2330-8]
GIUSEPPE FERRARI ; Teoria dei periodi politici, Milano, 1874 « (p. 7) Pour nous, la génération sera le premier élément de chaque retour. Semblable au lever du soleil, elle demeure toujours la même, elle répète continuellement le même drame, dans toutes les époques, avec toutes les civilisations,... (p. 9) la durée moyenne de la vie individuelle n'est aucunement la durée moyenne de la génération politique [ou pensante]... On détermine la durée moyenne de la génération (p. 10) politique en prenant les hommes au moment de leur vraie naissance, quand ils s'emparent de la famille, du gouvernement, de l'armée... Alors commence la vie intellectuelle [pensante ou politique] et elle dure à peu près 30 ans... (p. 11) Les naissances varient, les uns se révèlent de 20 à 25 ans, ce sont les poètes, les peintres, les sculpteurs, les compositeurs de musique ; les autres arrivent plus tard ; tels sont les philosophes, les jurisconsultes, les historiens, mais ils ne demandent pas moins de 30 ans pour concevoir leurs desseins, multiplier les recherches, appliquer les idées, rectifier les erreurs inévitables, et enfin entraîner avec eux la génération qui doit les acclamer ». Des hommes exceptionnels ont deux vies. « (p. 75) Cela arriva à Voltaire, qui demeura sous les yeux du public depuis 1718, l'année où l'on représenta son Œdipe, jusqu'en 1778, l'année de sa mort; mais il a vécu deux vies, qui ne peuvent être confondues ». Les générations s'allongent (p. 105) ou se raccourcissent (p. 108) ; on en compte qui n'ont que 19 ans (p. 109). Il y a les générations des précurseurs (p. 113), les générations « révolutionnaires » (p. 184), les « réactionnaires » (p. 150), les « résolutives » (p. 167). Les périodes politiques ont lieu en quatre temps. « (p. 113) Chaque nouveau principe se sert de quatre générations qu'il domine en sorte de former un seul drame ; et puisque les principes succèdent toujours jours aux principes, les générations se suivent quatre à quatre, à des intervalles d'une durée moyenne de 125 ans. C'est pourquoi le christianisme s'établit en 115 ans, de l'avènement de Dioclétien, qui dégrade Rome, jusqu'à la mort de Théodose, qui confirme pour toujours la chute du monde païen. La France accorde quatre temps à la réforme, religieuse, de 1514 à 1620 ; quatre à rendre moderne l'aristocratie, de 1620 à 1750 ; quatre à la révolution proprement dite, qui s'épuise (p. 114) de nos jours ».
[FN: § 2330-6]
POLYB. ; VI, fr. III, 5. Plus loin, fr. VII, 57, il observe, pour expliquer les changements des républiques, que « toutes les choses qui existent sont sujettes à la corruption et au changement » ; mais il n'a pas nécessairement pris cette conception de Platon, car elle est générale et traduit les impressions que nous recevons des changements du monde où nous vivons.
[FN: § 2335-1]
Cours, t. II, § 926 : « (p. 278) À vrai dire, on réserve le plus souvent ce nom [de crise] à la période descendante de l'oscillation, quand les prix diminuent, mais, en réalité, cette période est étroitement liée à la période ascendante, quand les prix augmentent ; l'une ne peut subsister sans l'autre, et c'est à leur ensemble qu'il convient de réserver le nom de crise ».
[FN: § 2337-1]
Manuel, IX, 82 : « (p. 532) Les faits concomitants des crises ont été considérés comme les causes des crises. Pendant la période ascendante, quand tout est en voie de prospérité, la consommation augmente, les entrepreneurs accroissent la production ; pour cela ils transforment l'épargne en capitaux mobiliers et immobiliers, et ils font un large appel au crédit ; la circulation est plus rapide. Chacun de ces faits a été considéré comme la cause exclusive de la période descendante, à laquelle on donnait le nom de crise. Ce qui est vrai c'est simplement qu'on observe ces faits dans la période ascendante, qui précède toujours la période descendante ». « § 83, p. 533) C'est pure rêverie que de parler d'un excès permanent de la production. S'il en était ainsi, il devrait y avoir quelque part, comme nous l'avons déjà dit, des dépôts toujours croissants des marchandises dont la production dépasse la consommation : c'est ce qu'on ne constate nullement ».
[FN: § 2338-1]
Cours, t. II, § 926 : « (p. 278) Il ne faut pas se figurer une crise comme un accident qui vient interrompre un état de choses normal. Au contraire, ce qui est normal, c'est le mouvement ondulatoire ; la prospérité économique amenant la dépression, et la dépression ramenant la prospérité. L'économiste qui suppose que les crises économiques sont des phénomènes anormaux fait la même erreur qu'un physicien qui s'imaginerait que les nœuds et les internœuds d'une verge en vibration sont des accidents sans aucun rapport avec les vibrations des molécules de la verge ». Manuel, IX, 75 : « (p. 529) La crise n'est qu'un cas particulier de la grande loi du rythme, laquelle domine tous les phénomènes sociaux (Systèmes, t. I. p. 30). L'organisation sociale donne sa forme à la crise, mais n'agit pas sur le fond, qui dépend de la nature de l'homme et des problèmes économiques. Il y a des crises non seulement dans le commerce et dans l'industrie privée, mais aussi dans les entreprises publiques ».
[FN: § 2341-1]
Draper a eu des conceptions qui se rapprochent de cette doctrine. DRAPER ; Hist. du développ. intellect. de l'Europe, t. I « (p. 34) Le progrès intellectuel de l'Europe étant d'une nature analogue à celui de la Grèce, et ce dernier étant à son tour semblable à celui d'un individu, nous pouvons donc, pour faciliter nos recherches, le partager en périodes arbitraires et distinctes l'une de l'autre, bien que se perdant d'une manière imperceptible l'une dans l'autre. À ces périodes successives, j'appliquerai les désignations suivantes : 1. âge de crédulité ; 2. âge d'examen ; 3. âge de foi ; 4. âge de raison ; 5. âge de décrépitude... » L'auteur a saisi par intuition l'existence d'une ample oscillation ; mais il n'a pas vu qu'il y en a une suite indéfinie, ni que les plus grandes oscillations coexistent avec d'autres plus petites, en très grand nombre. Il s'est laissé induire en erreur par une analogie fausse entre la vie des nations et celle des individus. En outre, il est singulier qu'il fasse commencer à Socrate l'âge de la „ foi “ en Grèce, qui ferait suite à l'âge de l’ „ examen “. « (p. 209) Les sophistes avaient causé une véritable anarchie intellectuelle. Il n'est point dans la nature humaine de pouvoir se contenter d'un tel état de choses ; aussi, déçu dans les espérances qu'il avait mises en l'étude de la nature matérielle, l'esprit grec se tourna vers la morale. Dans le progrès de la vie, il n'y a qu'un pas de l'âge d'examen à l'âge de foi. Socrate, qui le premier s'avança dans cette voie, était né en 469 avant J.-C... » Les auteurs qui rangent Socrate parmi les sophistes se rapprochent beaucoup plus de la réalité.
[FN: § 2345-1]
À Athènes, durant la guerre médique, on croit encore communément à l'intervention directe des dieux.
[FN: § 2345-2]
ARISTOT. : ![]() , 25.
, 25.
[FN: § 2345-3]
Les Euménides, particulièrement, semblent écrites pour défendre l'Aréopage et la tradition contre les innovations.
[FN: § 2345-4]
IUST. ; II, 14 : ...nam victus Mardonius, veluti ex naufragio, cum paucis profugit. Castra referta regalis opulentiae capta : unde primum Graecos, diviso inter se auro persico, divitiarum luxuria cepit.
[FN: § 2345-5]
PLUTARCH. ; Pericl., 6. L'auteur dit que parmi les avantages qu'il retira de ses relations avec Anaxagore, il y eut „ celui-ci aussi : qu'il [Périclès] semble être devenu supérieur à la superstition “. THUCYDIDE, II, 53, voudrait accuser la peste du progrès de l'incrédulité à Athènes ; mais c'est l'une des erreurs habituelles des raisonnements éthiques. L'incrédulité avait commencé à se développer avant la peste, et continua à augmenter lorsque tout effet de la peste eut disparu.
[FN: § 2345-6]
La loi de Diopithe contre l'impiété (PLUTARCH. ; Pericl., 32, 2) est de ce temps. Elle frappe ceux qui, „ ne reconnaissent pas les dieux ou qui raisonnent des phénomènes célestes “. Elle apparaît comme la manifestation du sentiment populaire hostile à la prédominance des instincts des combinaisons qui poussaient à l'étude de la nature.
[FN: § 2345-7]
Le conflit politique aussi cessa bientôt. On ne le retrouve plus dans la comédie moyenne, et surtout pas dans la nouvelle ; mais déjà Aristophane avait eu à s'en abstenir. On a dit que c'était à cause des dispositions légales qui empêchaient d'attaquer sur scène les magistrats ou les citoyens ; mais cela n'est vrai qu'en partie, car l'auteur pouvait bel et bien parler de politique sans citer des noms d'hommes vivants. Au contraire, dans l'Assemblée des femmes, la simple plaisanterie remplace les virulentes invectives des Acharniens, des Chevaliers, des Nuées. Négligeons les Oiseaux (414 av. J.-C.) comme étant une exception ; mais ni dans les Grenouilles (406 av. J.-C.), ni dans Plutus (409 av. J.-C.), on ne trouve trace de l'âpre discussion qui apparaît dans les trois comédies nommées plus haut. Il semble que désormais le poète s'est résigné à ce qu'il ne peut empêcher, et qu'il rit des vainqueurs, comme plus tard les Grecs riront des Romains qui avaient conquis leur patrie, comme, dans les salons légitimistes, on riait de Napoléon III, comme dans les salons conservateurs, après la chute du parti conservateur, on riait de la République démocratique. Ce rire apparaît comme la consolation des vaincus.
[FN: § 2345-8]
Il faut lire dans Thucydide, V, 85-111, la longue conversation entre les Athéniens et les Méliens. En somme, les Athéniens insistent sur le fait que la raison du plus fort est toujours la meilleure, et que les dieux eux-mêmes la secondent. Les Athéniens observent (89) qu'il est connu des Méliens que, dans les conflits humains, on décide selon la justice, entre ceux qui sont de forces égales, mais que les puissants font ce qu'ils peuvent, et que les faibles s'y soumettent. C'est là une observation expérimentale, vraie en tout temps et en tout lieu ; et si depuis le temps de Thucydide jusqu'au nôtre, elle continue à être contestée par un grand nombre de dérivations, c'est parce que, comme nous l'avons tant de fois rappelé, on accepte des dérivations contredites absolument par l'expérience, si elles concordent avec certains sentiments. Parfois elles peuvent être utiles, parfois nuisibles. Dans le présent cas, elles concordent avec les sentiments dits de „ justice “, et ont souvent été utiles ; d'abord, parce qu'elles servirent à atténuer les souffrances de beaucoup de gens, en leur faisant espérer un avenir meilleur et en les faisant vivre en pensée dans un monde „ meilleur “ que le monde expérimental ; ensuite, parce que le fait d'exprimer les sentiments par les dérivations sert à les renforcer. Les sentiments dits de „ justice “ peuvent quelquefois pousser les hommes à atténuer, ne fût-ce que légèrement, les maux occasionnés par l' „ injustice “, bien que les premiers de ces sentiments soient facilement neutralisés par les intérêts et par d'autres sentiments ; tels, dans les circonstances dont nous parlons, les sentiments dépendant des résidus de la Ve classe, parmi lesquels il faut surtout relever le nationalisme. Les Athéniens emploient aussi un raisonnement (91) qui continue à être usité dans les conflits internationaux, surtout dans ceux d'ordre civil, pour persuader aux Méliens que s'ils étaient sujets des Athéniens, ce serait avantageux aux deux peuples. Les Méliens (94) demandent s'ils ne pourraient pas être acceptés comme neutres. Les Athéniens refusent (95) ; ils disent que cela leur nuirait. Là aussi nous avons une observation expérimentale, vraie en tout lieu et en tout temps, depuis celui de la conférence des Méliens jusqu'à celui du traité de Campo- Formio, observation qui s'applique non seulement aux conflits internationaux, mais aussi et surtout aux conflits civils. Nombreuses sont les dérivations qui la contredisent. Elles sont acceptées pour des motifs semblables à ceux que nous avons exposés tout à l'heure, mais sont habituellement nuisibles et souvent cause de ruine complète pour les États et pour les classes sociales, parce qu'elles écartent les uns et les autres de la seule chance de salut : préparer ses armes et savoir, vouloir, pouvoir faire usage de la force.
[FN: § 2345-9]
Le procès de Socrate est le plus connu d'une série qui eurent lieu vers ce temps, et qui indiquent une réaction populaire contre l'irréligion des classes intellectuelles. P. DECHARME ; La crit. des trad. relig. : « (p. 140) Aussi voit-on, à la fin du Ve siècle, se multiplier les procès d'impiété dont les âges précédents offrent à peine quelques traces. Ces procès, qui témoignent des progrès nouveaux de l'incrédulité, méritent que nous nous y arrêtions… » Ils ne témoignent pas seulement du progrès de l'incrédulité, mais aussi de l'intensité des sentiments populaires qui s'y opposent. Il faut noter que, dans ces procès, l'accusation d'impiété n'est pas la seule : il s'y ajoute des accusations politiques, privées, et généralement d'immoralité. Dans le livre des vertus et des vices, sur lequel on met le nom d'ARISTOTE, l'impiété, ![]() est définie de la façon suivante : (p. 1251 – Didot II, p. 246, VII, 2)
est définie de la façon suivante : (p. 1251 – Didot II, p. 246, VII, 2) ![]()
![]() . «
. « ![]() est le fait d'être coupable envers les dieux, envers les démons, ou aussi envers les morts, les parents, la patrie ». On pourrait donc dire que ce terme signifie : l'offense aux principales persistances d'agrégats.
est le fait d'être coupable envers les dieux, envers les démons, ou aussi envers les morts, les parents, la patrie ». On pourrait donc dire que ce terme signifie : l'offense aux principales persistances d'agrégats.
[FN: § 2349-1]
Un long passage de cette tragédie, dans lequel Sisyphe parle, nous a été conservé par SEXTUS EMPIRICUS ; Adversus physicos, IX, 54, p. 563-564. Il en résume bien le sens en ces termes : « Critias, l'un des tyrans d'Athènes, semble appartenir à la classe des athées, en disant que les anciens législateurs imaginèrent le dieu comme surveillant des œuvres vertueuses et des œuvres coupables des hommes, afin que personne n'offensât en secret son prochain, par crainte du châtiment des dieux ». Les deux derniers vers du discours de Sisyphe sont (NAUCK ; Trag. graec. frag., p. 599) : « Ainsi, à l'origine, je crois que quelqu'un persuada aux hommes de croire à la race des démons [dieux] ». Et avant : « (v. 24-26) En tenant ces discours, il enseigna très agréablement des règles, dissimulant la vérité sous le faux ». Maintenant écoutons PLATON ; De republ., II : « (p. 377) Adimante... Mais je ne comprends pas quelles sont les plus grandes [fables] que tu dis. Socrate. Celles qu'Hésiode et Homère nous racontaient, et aussi les autres poètes ; car, composant des mythes mensongers, ils les racontaient et les racontent encore aux hommes ». Mais, puisque la mythologie de ces poètes est aussi la mythologie populaire, le Socrate de la République est d'accord avec le Sisyphe de Critias, en la tenant pour fabuleuse. Il est d'accord aussi sur le but, qui est de faire en sorte que la mythologie soit utile aux hommes. Platon reprend les vers de l'Iliade où l'on dit que Zeus est dispensateur du bien et du mal (p. 379). Il vent qu'on dise que Zeus fait uniquement le bien, et que les maux qu'il inflige aux hommes sont pour leur bien. De cette façon il expose l'une des réponses affirmatives que nous avons relevées aux § 1903 et sv. (cfr. § 1970) ; mais, en bon métaphysicien, il s'abstient avec le plus grand soin d'apporter la moindre preuve de son affirmation, à laquelle nous devons donc croire seulement parce que les interlocuteurs dont Platon imagine les discours l'acceptent. En somme, il la tire de son « expérience du métaphysicien », comme nos contemporains tirent tant d'autres belles propositions de leur « expérience du chrétien ». Pourquoi « l'expérience de l'athée » ne peut- elle pas prendre place en si bonne compagnie ? Cela demeure un mystère impénétrable.
[FN: § 2350-1]
Il faut se garder de l'erreur que l'on commettrait en supposant que la conduite cruelle des Athéniens envers les Méliens fût en rapport avec la prédominance, chez les Athéniens, des résidus de la IIe classe. Au contraire, en un grand nombre d'autres occasions, les Athéniens se montrèrent plus humains que les Spartiates, chez lesquels prédominaient les résidus de la IIe classe. La différence réside surtout dans l'usage des dérivations, qui sont plus développées et mieux composées par les Athéniens, plus brèves et moins bien ordonnées, parfois même effrontément trompeuses, lorsqu'elles sont employées par les Spartiates. À ce point de vue, le massacre des habitants de Platée, raconté par Thucydide, est un fait remarquable. Les Platéens se rendirent aux Lacédémoniens qui leur promettaient que « (III, 52) quiconque était coupable serait puni ; personne d'autre contrairement à la justice ». Voici quelle fut la « justice » des Lacédémoniens. Ils demandèrent aux Platéens « si, dans la présente guerre, ils avaient fait quelque chose en faveur des Lacédémoniens et de leurs alliés ». Les Platéens s'étonnèrent de cette question, substituée au jugement promis. Ils discoururent longuement, furent réfutés non moins longuement par les Thébains, après quoi les Lacédémoniens (III, 52) répétèrent à chaque Platéens la même question, et comme ceux-ci ne pouvaient y répondre par oui, ils les égorgèrent sans autre. On peut ajouter cet exemple à une infinité d'autres qui montrent qu'en s'engageant à agir selon la « justice », on ne s'engage vraiment à rien, car la « justice » est comme le caoutchouc : on l'étire comme on veut.
[FN: § 2351-1]
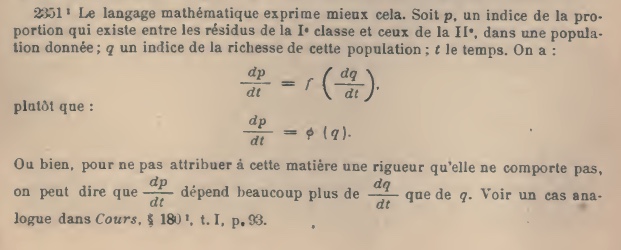
[FN: § 2354-1]
Polybe est notre meilleure autorité à ce propos, pourvu que nous nous arrêtions aux faits qu'il raconte, sans nous soucier des causes qu'il leur attribue. On peut résumer ces faits de la façon suivante. 1° Au temps où vivait Polybe, les persistances d'agrégats étaient encore beaucoup plus grandes à Rome qu'en Grèce. POLYB. ; VI, 56, passage capital déjà cité, § 239 ; VI, 46 ; XX, 6 ; XVIII, 37 ; XXIV, 5. – Cfr. PLUTARCH. ; Philop., 17. – POLYB. ; XXVIII, 9 ; XXXIII, 2 ; V, 106. – 2° On observe un rapide affaiblissement de ces persistances d'agrégats. POLYB. ; IX, 10, après le sac de Syracuse, an de Rome 542, 212 av. J.-C. ; XXXII, 11, après la conquête de la Macédoine, an de Rome 586, 168 av. J.-C. – Il s'y ajoute d'autres auteurs d'autorité diverse. VAL. MAx. ; IX, 1, 3 : Urbi autem nostrae secundi belli Punici finis, et Philippus rex Macedoniae devictus, licentioris vitae fiduciam dedit (an de Rome 558, 196 av. J.-C.). – PLIN. ; Nat. hist., XVII, 38 (25). L'auteur rappelle le cens de l'an 600 de Rome, et ajoute : A quo tempore pudicitiam subversam Piso gravis auctor prodidit. – Idem, ibidem, XXXIII, 53, trad. Littré : « En effet, L. Scipion dans son triomphe fit montre de mille quatre cent cinquante livres pesant d'argent ciselé et de quinze cents en vases d'or, l'an de Rome 565. Mais ce qui porta un coup encore plus rude aux mœurs, ce fut la donation qu'Attale fit de l'Asie : le legs de ce prince mort fut plus funeste que la victoire de Scipion ; car dès lors il n'y eut plus de retenue à Rome pour l'achat des objets de prix qui se vendirent à l'encan d'Attale. C'était l'an 622 ; et pendant les cinquante-sept années intermédiaires la ville s'était instruite à admirer, que dis-je ? à aimer les richesses étrangères. Les mœurs reçurent aussi un choc violent de la conquête de l'Achaïe, qui dans cet intervalle même, l'an de Rome 608, amena, afin que rien ne manquât, les statues et les tableaux. La même époque vit naître le luxe et périr Carthage ; et, par une coïncidence fatale, on eut à la fois et le goût et la possibilité de se précipiter dans le vice ». – FLORUS, III, 12. Non sans quelque exagération, l'auteur dit que les cent ans qui précédèrent le temps où les Romains traversèrent la mer par leurs conquêtes furent des années de vertu extraordinaire : Cuius aetatis superiores centum anni, sancti, pii, et, ut diximus, aurei, sine flagitio, sine scelere, dum sincera adhuc et innoxia pastoriae illius sectae integritas... Il ajoute que les cent années suivantes furent celles d'une grande prospérité militaire, mais aussi celles de grands maux intérieurs, et il émet des doutes sur l'utilité des conquêtes pour la république : Quae enim res alia furores civiles peperit, quam nimia felicitas ? Syria prima nos victa corrupit, mox Asiatica Pergameni regis hereditas. Illae opes atque divitiae afflixere saeculi mores, mersamque vitiis suis, quasi sentina rempublicam pessumdedere (§ 2548 5). Unde regnaret iudiciariislegibus divulsus a senatu, eques, nisi ex avaritia, ut vectigalia reipublicae, atque ipsa iudicia in quaestu haberentur ? – VELL. PATTERC. ; II, 1 : Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit. Quippe remoto Carthaginis metu, sublataque imperii aemula, non gradu, sed praecipiti cursu, a virtute descitum, ad vitia transcursum ; vetus disciplina deserta, nova inducta ; in somnum a vigiliis, ab armis ad voluptates, a negotiis in otium conversa civitas. – Cfr. DIO. CASS. ; fr. 227 Gros, t II. p. 27 ; 71 Reimar. – SALL, ; Iug., 41 (§ 2548 6) ; Cat., 10. – LIV. ; XXXIX, 6 : Luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu asiatico invecta in urbem est ;. – IUST. ; XXXVI, 4 : Sic Asia Romanorum facta, cum opibus suis vitia quoque Romam transmisit. Cfr. § 2548.
[FN: § 2356-1]
DURUY ; Hist. des Rom., t. II.
[FN: § 2356-2]
Ici Duruy est excusable, parce qu'il y a, en effet, un grand nombre d'« économistes » qui débitent ces absurdités. Telle que beaucoup l'enseignaient au temps de Duruy, et telle que beaucoup continuent à l'enseigner, l'économie politique s'écarte de la réalité expérimentale pour se confondre avec un genre de littérature éthique.
[FN: § 2356-3]
Duruy continue « (p. 225) L'Europe, à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, a vu une pareille inondation d'or provenant des placers d'Amérique et d'Australie. Mais ces capitaux produits par le travail lui servirent à refaire son outillage industriel, et il en résulta un énorme accroissement de la richesse publique, comme du bien-être de chacun ». Donc, ce fut avec l'or de l'Amérique et de l'Australie que l'on construisit les machines des industries européennes, les chemins de fer, etc. Belle transformation, en vérité ! Là Duruy est moins excusable que précédemment, car enfin, de son temps, peu, très peu d'« économistes » commettaient encore l’erreur du système mercantile, qui confond l'or avec la richesse, et l’or avec les capitaux. La plupart des « économistes » se rapprochaient un peu plus de la réalité. Mais un grand nombre d'historiens ignorent tout de la science économique, et connaissent assez peu l'économie littéraire qu'on enseigne usuellement. Ils croient suppléer à leur ignorance par des considérations éthiques ; aussi, lorsqu'ils veulent disserter en cette matière, ils se mettent à débiter les plus lourdes absurdités qu'on puisse imaginer. Duruy continue : « (p. 225) Ce fut, au contraire, par la guerre, le pillage et le vol que Rome passa subitement de la pauvreté à la fortune, et l'or de la conquête ne servit qu'au luxe stérile de ceux qui le possédaient ». La force de la persistance des agrégats éthiques est si grande qu'ici Duruy oublie des choses qu'il connaît très bien, et qu'il peut même enseigner à d'autres personnes. Il oublie que si la conquête était en effet l'une des sources principales de la richesse de Rome, celle du commerce n'était pas négligeable, et que les mercatores, les negotiatores romains apparaissent toujours dans l'histoire nombreux, actifs et riches. Il oublie les travaux publics des Romains, entre autres les routes, qui servirent aussi à accroître la richesse.
[FN: § 2360-1]
FRIEDLAENDER ; Civilis. et mœurs rom, t. IV : « (p. 156) Nous avons, pour la connaissance de la situation religieuse de l'antiquité, dans les premiers siècles de notre ère, deux sources, de nature très différente et souvent (p. 157) même contradictoires à bien des égards, l'une dans la littérature, l'autre dans les monuments, notamment dans les pierres portant des inscriptions ». La contradiction disparaît si l'on fait attention que la première de ces sources nous fait connaître spécialement les conceptions de la classe cultivée la plus élevée, et la seconde les sentiments de l'ensemble de la population ; par conséquent, surtout de la partie la plus nombreuse, qui est celle du peuple. « La littérature est principalement issue de cercles gagnés par l'incrédulité et l'indifférence, ou dans lesquels on s'appliquait à spiritualiser, à épurer et à transformer les croyances populaires, par la réflexion et l'interprétation. Les monuments, au contraire, proviennent, en grande partie du moins, des couches de la société le moins influencées par la littérature et les tendances qui y dominaient, d'un milieu dans lequel on n'éprouvait pas le besoin et l'on n'était souvent même pas en état de bien exprimer ses convictions en pareille matière ; aussi témoignent-ils, en majeure partie, d'une croyance positive aux divinités du polythéisme, d'une foi exempte de doute ainsi que de subtilité, c'est-à-dire toute naïve et irréfléchie ».
[FN: § 2361-1]
FRIEDLAENDER ; Civilis, et mœurs rom., t. IV « (p. 166) Ainsi, pas même au premier siècle, les personnes (p. 167) ayant reçu une éducation philosophique n'avaient pris une attitude absolument hostile à la religion nationale. Et, bien que dans la littérature de ce temps, comme dans celle du dix-huitième siècle, les dispositions et les tendances hostiles à la foi prédominent, elles ne conservèrent, en aucun cas, leur empire au-delà de la limite du premier siècle de notre ère. De même que le flux des tendances anti-chrétiennes du siècle dernier baissa rapidement, après avoir atteint son maximum d'élévation, et fut suivi d'un puissant reflux, qui entraîna, irrésistiblement aussi, une grande partie de la société instruite, de même nous voyons dans le monde gréco-romain, après les tendances qui avaient prédominé dans la littérature du premier siècle, une forte réaction vers la foi positive prendre le dessus et s'emparer, là aussi, des mêmes cercles, ainsi que la foi dégénérer, sous des rapports multiples, en superstition grossière, soit de miracles, piétisme et mysticisme ». La description des phénomènes est bonne. Il faut seulement ajouter que ce mouvement général n'a pas lieu d'une manière uniforme, mais qu'il est ondulatoire.
[FN: § 2366-1]
GUIZOT ; Hist. de la civil. en France, t. II « p. 1) En étudiant l'état intellectuel de la Gaule au IVe et Ve siècle, nous y avons trouvé deux littératures, l'une sacrée, l'autre profane. La distinction se marquait dans les personnes et dans les choses ; des laïques et (p. 2) des ecclésiastiques étudiaient, méditaient, écrivaient, et ils étudiaient, ils écrivaient, ils méditaient sur des sujets laïques et sur des sujets religieux. La littérature sacrée dominait de plus en plus, mais elle n'était pas seule : la littérature profane vivait encore. Du VIe, au VIIIe siècle, il n'y a plus de littérature profane, la littérature sacrée est seule ; les clercs seuls étudient ou écrivent ; et ils n'étudient, ils n'écrivent plus, sauf quelques exceptions rares, que sur des sujets religieux. Le caractère général de l'époque est la concentration du développement intellectuel dans la sphère religieuse ».
[FN: § 2367-1]
Saint Bernard a bien vu cette invasion de l'instinct des combinaisons. D. BERNARDI opera. Tractatus de erroribus Abaelardi ; Ad Innocentium II, pontificem, c. I, 1 : Habemus in Francia novum de veteri magistro Theologum, qui ab ineunte aetate sua in arte dialectica lusit, et nunc in Scripturis sanctis insanit. Olim damnata et sopita dogmata, tam sua videlicet, quam aliena, suscitare conatur, insuper et nova addit. Qui dum omnium quae sunt in coelo sursum, et quae in terra deorsum, nihil, praeter solum „ Nescio “ nescire dignatur... « Nous avons eu en France un homme qui, d'ancien magister, est devenu théologien nouveau. Dans sa jeunesse, il jouait à l'art de la dialectique, et maintenant, il débite des insanités sur les Saintes Écritures. Il ose préconiser des doctrines condamnées jadis et oubliées, à savoir des siennes ou de celles d'autrui, et en plus, il en ajoute de nouvelles. Tandis que de toutes les choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en bas sur la terre, il estime indigne d'en ignorer une seule excepté „ j'ignore “.. » Epist. 330 : Nova fides in Francia cuditur, de virtutibus et vitiis non moraliter, de Sacramentis non fideliter, de mysterio sanctae Trinitatis non simpliciter ac sobrie, sed praeter ut accepimus, dispatatur. « Une nouvelle foi est forgée en France : on ne dispute pas moralement des vertus et des vices, ni fidèlement des Sacrements, ni simplement et modérément du mystère de la sainte Trinité, mais contrairement à ce que nous admettons ». En somme, sous une autre forme, c'est précisément ce que l'on reprochait à Socrate.
[FN: § 2368-1]
D. ANSELM. ; ed. Gerberon: (p. 41) Illi utique nostri temporis dialectici, imo dialectice haeretici, qui non nisi flatum vocis putant esse universales substantias.
[FN: § 2371-1]
V. COUSIN ; Ouvrages inédits d'Abélard.
[FN: § 2372-1]
À regarder un thermomètre plongé dans un liquide nous pouvons connaître la température, l'état thermique, un caractère de ce liquide, le classer avec d'autres, semblables à ce point de vue. À entendre nommer des « universaux » ou des entités abstraites, par certains hommes, nous pouvons connaître les concepts, l'état psychique, un caractère de ces hommes, les classer avec d'autres, semblables à ce point de vue. Si l'on veut, on peut dire que l'expression « vingt degrés centigrades » est un vain « souffle de voix », de même que cette autre expression « justice ». Mais toutes deux sont des indices d'un certain état : la première est l'indice de l'état thermique d'un liquide ; la seconde, de l'état psychique de certains hommes. Ces indices diffèrent en ce que le premier est précis, semblable à un noyau défini, et que le second est en partie indéterminé, semblable à une nébuleuse. Le premier peut fournir des prémisses à des raisonnements rigoureux ; le second ne s'y prête pas. Si, au lieu de la température marquée par un thermomètre, on considérait l'entité abstraite « chaud », comme le faisaient les anciens philosophes, cette entité serait tout à fait analogue à celle qu'on appelle la « justice ». Toutes les deux sont en partie indéterminées. Semblables à des nébuleuses, et ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureux.
[FN: § 2377-1]
Saint-Bernard est délégué par le pape Innocent pour corriger les débordements des citoyens de Milan, de Pavie et de Crémone. Ayant obtenu peu ou point d'effet, il écrit au pape : « Les gens de Crémone se sont endurcis, et leur prospérité les perd. Les Milanais sont arrogants, et leur présomption les séduit. Mettant leur espérance dans les chars et les chevaux, ils ont trompé la mienne et rendu vain mon labeur ».. D. BERNARDI opera, epist. 314 : Cremonenses induruerunt, et prosperitas eorum perlit eos : Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum seducit eos. Hi in curribus et in equis spem sua ponentes, meam frustraverunt et laborem meura exinanierunt.
[FN: § 2379-1]
DECRET. GRAT. ; Pars prim., distinct., XXXII, c. 5 : Non audiatur Missa Presbyteri concubinam habentis. Nicolaus Papa II e omnibus Episcopis. Nullus Missam audiat Presbyteri, quem scit concubinam indubitanter habere, aut subintroductam mulierem. C'est là le canon 3 du concile romain XXIV, sous Nicolas II Cette prohibition est répétée par le pape Alexandre II, en 1063. BARONII annales eccl., t. XVII, p. 245 ; DECRET. GRAT., loc. cit., c. Vl. Gratien remarque à ce propos : Verum principia harum auctoritatum contraire videntur Hieronymo, et Augustino, et ceteris, qui Christi sacramenta neque in bono, neque in malo homine fugienda ostendunt, sicut subsequens causa Simoniacorum plenius demonstrat. Sed Urbanus II in epist. destinata praeposito sancti Iventii hanc contrarietatem determinat dicens. § I. Ad hoc I vero, quod subiungitur in eadem epistola, idest utrum sit utendum ordinationibus, et reliquis Sacramentis a criminosis exhibitis, ut ab adulteris, vel sanctimonialium violatoribus, vel huiusmodi. Ad hoc, inquam, ita, respondemus. Si schismate, vel haeresi ab Ecclesia non separantur, eorumdem ordinationes et reliqua Sacramenta, sancta, et veneranda non negamus, sequentes beatum Augustinum, etc. De même, les socialistes amis des ploutocrates pourraient répondre à un doute analogue : « Si le capitaliste ploutocrate n'est pas excommunié par nous, mais qu'il nous soutient et nous aide, nous ne nions pas que ses « opérations » soient bonnes et louables. MONETA ; Adversus Catharos et Valdenses, 1. V, c. III : (p. 1433) An mali Praelati possint Sacramenta ministrare, et praedicare, et eis sit obediendum... videamus, utrum mali Praelati possint conferre Sacramenta Ecclesiae, et utrum possint praedicare, et an eis obediendum sit. Quod autem non possint ministrare Sacramenta volunt probare haeretici, qui Cathari dicuntur, et etiam pauperes Lombardi his modis : ... L'auteur réfute longuement les preuves que les hérétiques croyaient pouvoir tirer de l'Écriture Sainte ; on arrive ainsi au chap. IV : (p. 436) Hic incipit pars quarta, in qua ostenditur, quod Praelati, quamvis mali sint, tamen et officium praedicandi, et ministerium Sacramentorum habent, et quod eis obediendum est. – BERNARDO GUIDONIS ; Practica inquisitionis heretice pravitatis. Il dit des Cathares : (p. 242) Item, confessionem factam sacerdotibus Ecclesie Romane dicunt nichil valere, quod cum sint peccatores, non possunt solvere nec ligare, et cum sint immundi, nallum alium possunt mundare.
[FN: § 2381-1]
BARONII annoles ecclesiastici, LXVIII : (p. 584) Sed haud ingratum erit Guntherum Ligurinum versibus ita canentem audire, huius temporis scriptorem eximium. Cuius origo mali, tantaeque voraginis auctor || Extitit Arnoldus, quem Brixia protulit ortu || Pestifero, tenui nutrivit Gallia sumptu, || Edocuitque diu : tandem natalibus oris || Redditus, assumpta sapientis fronte, diserto || Fallebat sermone rudes, Clerumque procaci || Insectans odio, monachorum acerrimus hostis, || Plebis adulator, gaudens popularibus auris, || Pontifices, ipsumque gravi corrodere lingua || Audebat Papam, scelerataque dogmata vulgo || Diffundens, variis implebat vocibus aures. || Nil proprium Cleri fundos et praedia, nullo || Iure sequi monachos, nulli Fiscalia iura || Pontificum, nulli curae popularis honorem || Abbatum, sacras referens concedere leges. || Omnia principibus terrenis subdita, tantum || Committenda viris popularibus atque regenda. || Illis primitias, et quae devotio plebis || Offerat, et decimas castos in corporis usus, || Non ad luxuriam, sive oblectamina carnis || Concedens, mollesque cibos, cultusque nitorem, || Illicitosque thoros, lascivaque gaudia Cleri, || Pontificum fastus, Abbatum denique laxos || Damnabat penitus mires, monachosque superbos. || L'auteur cite OTTO FRISINGENSIS qui dit (p. 583) ...Arnaldus iste ex Italia, civitate Brixia oriundus, eiusdemque Ecclesiae clericus, ac tantum Lector ordinatus. Petrara Abailardum olim praeceptorem habuerat : vir quidem naturae non hebetis plus tamen verborum profluvio, quam sententiarum pondere copiosus, singularitatis amator, novitatis cupidus, cuiusmodi hominum ingenia ad fabricandas haereses schismatumque perturbationes sunt prona. Is a studio a Galliis in italiam revertens, religiosum habitum quo amplius decipere posset, induit, omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens, clericorum ac Episcoporum derogator, monachorum persecutor, laicis tantum adulans. [Ici, on voit bien la forme populaire du mouvement, qui n'a vraiment rien à faire avec le problème de l'existence des universaux.] Dicebat enim nec clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec (p. 584) monachos possessiones habentes aliqua ratione posse salvari, cunctaque haec Principis esse, ab eiusque beneficentia in usum tantum laicorum cedere opportere. C'est la raison habituelle qui pousse les gouvernants à dépouiller les institutions religieuses. Elle a servi aux gouvernements païens puis aux gouvernements chrétiens, puis aux gouvernements révolutionnaires ; enfin, le très moral Waldeck-Rousseau l'a faite sienne.
[FN: § 2384-1]
Dans son histoire de la Réforme en Allemagne, Janssen voit les faits colorés par sa foi ; mais au fond il ne les décrit pas mal. Il résume l'état de l'Allemagne, lorsque le protestantisme était sur le point de naître. I. JANSSEN ; L'Allemagne et la Réforme, t. I ; L'Allemagne à la fin du moyen âge : « p. 571) L'état florissant de la culture des champs, des bois, des vignes ; l'essor extraordinaire de l'industrie ; les grandes richesses minières du sol ; un commerce prospère, dominant celui de presque toutes les nations chrétiennes [ici l'on va au delà de la vérité ; l'auteur oublie l'Italie] tout avait contribué à faire de l'Allemagne le pays le plus riche de l'Europe. Les journaliers cultivateurs et industriels des villes et des campagnes sont pour la plupart, au commencement du seizième siècle, dans une excellente situation matérielle. Mais, peu à peu, l'équilibre et l'action mutuelle des principaux groupes de travail s'ébranlent. Le commerce étouffe le travail productif de valeur [dérivation éthique qui exprime l'importance croissante des spéculateurs]. Les enchérissements, les accaparements, se produisent de toutes parts malgré les mesures prises par le gouvernement, et donnent lieu, sur une large échelle, à l'exploitation de la classe laborieuse par le capital [autre dérivation semblable à celle de tout-à-l'heure]. Des plaintes sur les monopoleurs, sur les accapareurs, sur les grands entrepreneurs et capitalistes [description au moyen de dérivations de la prédominance des spéculateurs], sur „ l’enchérissement de l'argent “, la hausse de prix des denrées de nécessité première [phénomènes que nous voyous se reproduire tous aujourd'hui], la falsification des produits alimentaires, en un mot la tyrannie exercée par ceux qui possèdent sur ceux qui ne possèdent pas [une des nombreuses formes sous lesquelles on exprime la prédominance des spéculateurs], se font entendre de tous côtés. Ces abus produisent un effet d'autant plus désastreux, que les riches étalent sous les yeux des malheureux un luxe effréné... D'autre part, les ouvriers, les cultivateurs, subissent l'influence mauvaise du luxe qui règne autour d'eux. (p. 572) La prospérité matérielle avait engendré le luxe et la volupté, le luxe et la volupté, à leur tour, développent une soif toujours plus ardente d'acquérir des bénéfices toujours plus beaux, et alimentent dans toutes les conditions la passion de posséder, de jouir [on croirait lire la description de ce que nous voyons se produire sous nos yeux : en somme, c'est le débordement de la spéculation] ». On observe les mêmes faits en France. IMBART DE LA, TOUR ; Les origines de la Réforme, t. I; La France moderne : « (p. 421)... Le marchand ne se borne pas à vendre sur place un produit déterminé ; il est l'intermédiaire qui se procure, qui débite les produits les plus divers... Il trafique sur tout... Dans ces conditions nulle entrave à ses progrès indéfinis. Grâce au développement des besoins, du bien-être, des échanges, il va capter (p. 422) à son profit toutes les sources de la richesse et sur les ruines des uns, la médiocrité des autres, les grandes fortunes commencent à s'établir... (p. 423) Aussi bien, la seconde moitié du siècle voit-elle éclore tous ces gros trafiquants, vrais spéculateurs et brasseurs d'affaires qui vont drainer toutes les richesses du travail et du sol [préjugé habituel des éthiques ; ces spéculateurs produisent des sources énormes de richesses]. Ce qui distingue le marchand de cette époque c'est qu'il est surtout, comme on l'appelle, „ l'accapareur “. Il opère sur des masses qu'il concentre entre ses mains... (p. 425) ...On achète pour revendre et on revend ce qu'on n'a pas [cela provoque les indignations des éthiques, mais est souvent très utile économiquement]. En 1517, le nombre de ces marchés fictifs est devenu d'un usage si général que l'échevinage d'Orléans demande aux pouvoirs publics d'intervenir. (p. 426) Ils interviennent en vain... (p. 427) Rien de plus remarquable, par exemple, que ces Barjots, naguère inconnus en Beaujolais, qui ont commencé leur fortune dans les mines de vitriol et qui deviennent „ marchans publicques... de blez et vins, et pour ladicte marchandise mieulx excercer... tiennent à tiltre de ferme et loyer plusieurs gros bénéfices tant séculiers que régulliers, plusieurs héritages de gentilzhommes du pais “. Ce cas n'est pas isolé. À plusieurs reprises les documents nous signalent ces spéculateurs qui font main basse sur ,, toutes les fermes d'un pays “ dénoncés par les rancunes et les jalousies exaspérées des populations... (p. 433) Négociant, spéculateur, fermier des revenus privés ou publics, agioteur, banquier, prêteur sur gages, habile à amasser l'argent comme à le faire valoir, le marchand en arrive ainsi à tourner à son profit cette force immense qui gouverne le monde ; le capital... (p. 446) Semblançay n'est pas seulement un exemple, mais un symbole. En lui, se résume l'histoire de ces parvenus prodigieux que les transformations sociales ont fait jaillir des profondeurs. Leur avènement fut sans doute l'œuvre personnelle de Louis XI qui aimait les contrastes, la récompense de leurs services, de leur aptitude professionnelle, de leur formation spéciale. Il fut surtout l'œuvre des circonstances qui poussaient alors au premier rôle l'homme d'argent, comme jadis, l'homme de guerre [c'est ce qui a lieu aujourd'hui encore]. Mais à son tour, ce progrès de leurs richesses ajoutait aux progrès de leur influence [comme aujourd'hui]. Leur prospérité privée importait à la prospérité publique. La royauté [aujourd'hui : la démocratie] avait en eux des bailleurs de fonds toujours nantis, et, dans l'embarras où se trouvait fréquemment le trésor [exactement comme aujourd'hui], toujours nécessaires », Les spéculateurs servaient alors la monarchie, comme ils servent aujourd'hui la démocratie, comme ils serviront demain le socialisme, et après demain l'anarchie, toujours prêts à servir quiconque leur fait gagner de l'argent. Ils sont poussés à ce manège par l'instinct des combinaisons et la faiblesse des résidus de la IIe classe. « (p. 461) Bourgeoisie et absolutisme [aujourd'hui : démocratie] s'étaient élevés ensemble. L'une agrandie par lui, comme l'autre s'est affermie par elle. Ils s'attachèrent (p. 462) d'autant plus à l'absolutisme [aujourd'hui à la démocratie], qu'en le servant, ils se servaient eux-mêmes [les Caillaux de ce temps-là] ». Les souverains qui donnèrent ce pouvoir aux spéculateurs préparèrent la révolution de 1789, et par conséquent la ruine de la monarchie (§ 2227 1).
[FN: § 2385-1]
J. A. PORRET, pasteur ; Le réveil religieux du XVIIIe siècle en Angleterre. Sous le voile de nombreuses dérivations théologiques et éthiques, les faits sont assez bien décrits. « (p. 11) Vers la fin du XVIIe siècle, le Christianisme raisonnable du philosophe Locke, déiste en théologie, et sensualiste en psychologie, régnait en Angleterre. L'Évangile n'était pris que comme une morale, et cette morale était abâtardie. L'évêque Koadly professait ouvertement le déisme. Selon le juge Blakstone, il n'y avait pas plus de christianisme dans les discours des prédicateurs les plus renommés de Londres, que dans les oraisons de Cicéron. Bien rentés, et dès lors ne tenant pas, comme certains de leurs prédécesseurs, de tavernes pour vivre, les pasteurs qui s'enivraient. „ sans scandale “ n'étaient point de rares exceptions. D'autres étaient simplement gens de plaisirs ; d'autres encore se vouaient à la culture des lettres, de la poésie surtout... Avec, plus de décence, les églises séparées ne possédaient guère plus de sève... (p. 12) Au témoignage d'Addison (1712), „ l'apparence même du christianisme avait disparu “. Selon Leibniz (1715), même „ la religion naturelle s'affaiblissait en Angleterre “... La haute société était pourrie. L'incrédulité s'y affichait, allant du rationalisme le plus radical à l'athéisme effronté. À l'incrédulité appartenaient les succès de librairie, puisque les discours contre les miracles, de Woolston, se vendirent à trente mille exemplaires. Le matérialisme de Hobbes comptait de nombreux adhérents... ».
[FN: § 2386-1]
J. A. PORRET ; loc. cit., § 2385 : « (p. 18).Edmond Burke... s'écriait vers 1790 : „ Aucun des hommes nés chez nous depuis 40 ans n'a lu un mot de Collins, de Toland (auteur du Christianisme sans mystère, mort en 1722), de Tindal (apôtre de la religion naturelle, vanté par Voltaire, mort en 1783), et de tout ce troupeau qui prenait le nom de libres penseurs. L'athéisme n'est pas seulement contre notre raison, il est contre nos instincts “. Quel changement d'orientation ! ... (p. 19) Cinquante ans avaient suffi pour amener cette incroyable volte-face. Quelles en furent les causes ?... Je ne conteste point qu'Addison, le fondateur de ce Spectator, qui se distribuait chaque semaine à 3000 exemplaires... ait exercé une influence heureuse au début du siècle. Berkeley, un penseur vigoureux, put, en professant l'idéalisme,... ruiner le matérialisme un temps triomphant... Plus tard, Samuel Johnson, ...ne doit pas être oublié ! Mais j'affirme qu’il serait chimérique d'attribuer à aucun d'eux, ou même à eux tous réunis, une influence déterminante... (p. 20) La transformation religieuse et morale de l'Angleterre, de 1735 à 1775, ne s'explique pas par quelques livres de noble inspiration. Elle suppose un fait, ou mieux un ensemble de faits, un mouvement puissant [très juste], qui, entraînant les âmes en grand nombre, les a comme arrachées à elles- mêmes, et enfantées à une vie nouvelle [dérivation éthique et théologique], celles qui demeuraient réfractaires ayant été, à défaut d'amour, obligées au respect. Cette transformation ne s'explique que par une action exercée dans la conscience religieuse et la conscience morale, centre de la personnalité humaine [dérivation éthique et théologique. .. Elle ne s'explique que par une œuvre du Dieu puissant et miséricordieux [dérivation de pure théologie] ». Il est remarquable que cet auteur ait perçu, sous les voiles de ses dérivations éthiques et théologiques, la puissance des actions non-logiques, dont proviennent les mouvements ondulatoires que nous avons observés.
[FN: § 2389-1]
Ensuite, le prince de Bismarck se ravisa. BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : « (p. 365) Vers 1878-1879, la conviction que je m'étais trompé, que je n'avais pas eu une haute idée du sentiment national des dynasties, que j'en avais eu une trop haute du sentiment national des électeurs allemands ou pour le moins du Reichstag, cette conviction n'avait pas encore pu s'imposer à moi, quelque grande que fût la mauvaise volonté que j'eus à combattre au Reichstag, à la cour dans le parti conservateur et chez ses „déclarants “. Aujourd'hui je dois faire amende honorable aux dynasties... »
[FN: § 2391-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] JEAN CRUET ; La Vie du Droit et l'impuissance des lois : « (p. 268) On se demande ce qu'il y a de plus remarquable dans les révolutions: l'intensité du bouleversement législatif, ou la médiocrité des transformations sociales. C'est à peine, en effet, si la permanence des mœurs et la continuité de leur évolution se trouvent affectées par l'amplitude de l'oscillation imprimée à tout l'appareil gouvernemental et juridique ; la révolution terminée, on s'aperçoit qu'elle a été surtout une grande émotion publique. Il est vrai que, dans l'histoire, les transformations sociales prennent la date, en quelque sorte symbolique, des révolutions politiques. Car rien ne ressemble plus à une société nouvelle, surgissant de toutes pièces, par l'action soudaine des lois, qu'une société préexistante faisant brusquement et violemment tomber en poussière les derniers liens politiques et juridiques du passé, pour traduire librement ses besoins et ses aspirations au grand jour d'une légalité entièrement refondue, sous un gouvernement renouvelé. Mais il est certain que les révolutions, en apparence les plus profondes, se passent en quelque manière à la surface de la société ».
[FN: § 2400-1]
JEAN PERRIN ; Les atomes, Paris, 1913. Après avoir fait mention d'une théorie qui, crue un moment fausse avait ensuite été reconnue vraie, l'auteur écrit : « (p. 173) J’ai compris par là combien est au fond limité le crédit que nous accordons aux théories, et que nous y voyons des instruments de découvertes plutôt que de véritables démonstrations ». C'est précisément ainsi que nous considérons les théories que nous avons exposées dans ce traité.
W. OSTWALD ; L'évolution d'une science. La Chimie, Paris, 1916 « (p. 147) En suivant jusqu'à nos jours le sort des théories chimiques, voici ce qu'on observe régulièrement. D'abord une théorie se développe pour représenter par des modifications d'un certain schéma la variété des combinaisons existantes. Naturellement on choisit un schéma qui s'accorde avec les faits connus, aussi toutes ces théories expriment-elles plus ou moins complètement l'état de la science à leur époque [cela est bon pour les sciences qui sont étudiées expérimentalement. Pour les sciences sociales, qui, jusqu'à présent, ont été étudiées surtout avec le sentiment, il faut dire : « L'état des sentiments et des intérêts, avec une adjonction plus ou moins grande d'expérience »]. Mais la science s'accroît sans cesse [pour les sciences sociales : « mais l'expérience gagne plus ou moins de terrain »], il se produit tôt ou tard un désaccord entre la multiplicité réelle des faits observés et la multiplicité artificielle de la théorie [pour les sciences sociales le désaccord apparaît surtout entre les faits et les déductions des sentiments]. La plupart du temps, on essaie d'abord de plier les faits si la théorie, dont il est plus facile d'embrasser d'un coup d'œil toutes les possibilités, ne peut plus rien céder. Mais les faits sont plus durables et plus résistants que toutes les théories, ou, tout au moins, que les hommes qui les défendent. Et ainsi, il devient nécessaire d'élargir convenablement la vieille doctrine ou de la remplacer par de nouvelles idées mieux adaptées ».
Plusieurs catégories de personnes ne peuvent pas comprendre ces choses ; entre autres : les personnes qui créent ou adoptent des théories pour défendre leurs intérêts : auro suadente, nil potest oratio ; les très nombreuses personnes qui se laissent guider par le sentiment, la foi, les croyances; les « intellectuels » qui enseignent une « science sociale », en ne sachant que peu ou point ce qu'est au juste une science expérimentale. Toutes ces personnes et d'autres encore peuvent être utiles au point de vue social ; elles ne comptent pas, lorsqu'il s'agit uniquement de la recherche de la réalité expérimentale (§ 2113 1).
[FN: § 2400-2]
JEAN PERRIN : loc. cit. 2400 1. Après avoir noté la concordance des résultats obtenus pour déterminer, en des circonstances très différentes, le nombre d'Avogadro N, l'auteur ajoute : « (p. 290) Pourtant, et si fortement que s'impose l'existence des molécules ou des atomes, nous devons toujours être en état d'exprimer la réalité visible sans faire appel à des éléments invisibles. Et cela est en effet très facile. Il nous suffirait d'éliminer l'invariant N entre les 13 équations qui ont servi à le déterminer pour obtenir 12 équations où ne figurent que des réalités sensibles, qui expriment des connexions profondes entre des phénomènes de prime abord aussi complètement indépendants que la viscosité des gaz, le mouvement brownien, le bleu du ciel, le spectre du corps noir ou la radioactivité... Mais, sous prétexte de rigueur, nous n'aurons pas la maladresse d'éviter l'intervention des éléments moléculaires dans l'énoncé des lois que (p. 291) nous n'aurions pas obtenues sans leur aide. Ce ne serait pas arracher un tuteur devenu inutile à une plante vivace, ce serait couper les racines qui la nourrissent et la font croître ».
Nous pouvons répéter des considérations semblables pour la théorie des résidus. Ceux-ci représentent une partie constante de phénomènes très nombreux et variés. Pourtant – dirons- nous – nous devons toujours être en état d'exprimer la réalité concrète, sans faire appel à des abstractions. C'est ce que nous pouvons faire, en éliminant les invariants nommés résidus entre les très nombreuses équations qui ont servi à les obtenir, et où ne figurent plus que des réalités concrètes. Mais nous n'aurons pas la maladresse d'éviter, sous prétexte de rigueur, l'intervention d'éléments abstraits dans l'énoncé de lois que nous avons obtenues grâce à leur aide. Il convient de ne pas renoncer aux services importants qu'ils peuvent encore nous rendre, jusqu'à ce que les progrès de la science les remplacent par d'autres, qui, à leur tour, devront être conservés tant qu'ils rendent des services ; et ainsi de suite, indéfiniment.
[FN: § 2408-1]
V. PARETO ; Économie mathématique, dans Encyclopédie des sciences mathématiques : « (p. 597) Au point de vue exclusivement mathématique, il est indifférent, pour la détermination de l'équilibre, de connaître les actions de l'individu au moyen des fonctions d'offre et de demande ou au moyen des fonctions-indices. (p. 596, note 9). Ce n'est que graduellement que, nous dégageant des conceptions de l'ancienne économie politique, nous avons substitué la notion des fonctions-indices à la notion d'ophélimité. Celle-ci est encore exclusivement employée dans V. PARETO, cours d'économie politique professé à l'université de Lausanne... ; elle est remplacée par la notion des indices d'ophélimité, dans V. PARETO, Manuale di economia politica ; et elle devient encore plus générale dans V. PARETO, Manuel d'économie politique. (p. 606) A. A. COURNOT a pris p F (p) comme fonction-indice ; il serait arrivé exactement au même résultat s'il avait pris F [p F (p)], F étant une fonction arbitraire. Il s'est servi de fonctions-indices sans s'en rendre compte. A. A. COURNOT a voulu étendre sa méthode au cas de la libre concurrence, mais il s'est complètement trompé dans ses déductions, et la considération des indices déduits des quantités qu'on échange à certains prix, a été abandonnée pour une autre méthode... Pourtant, en raisonnant correctement, nous pouvons... déduire les fonctions-indices de la considération des quantités échangées à certains prix ». V. PARETO ; Manuel. Après avoir indiqué (p. 542) une équation (9) qui pourrait résulter directement de l'expérience, et dans laquelle ne figurent que des quantités de marchandises, on ajoute : « L’équation (9) est la seule dont à proprement parler nous avons besoin pour établir la théorie de l’équilibre économique : or cette équation ne renferme rien qui (p. 543) corresponde à l'ophélimité, ou aux indices d'ophélimité : toute la théorie de l'équilibre économique est donc indépendante des notions d'utilité (économique), de valeur d'usage, d'ophélimité, elle n'a besoin que d'une chose, C'est- à-dire de connaître les limites des rapports
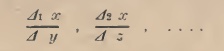
... On pourrait donc écrire tout un traité d'économie pure, en partant de l'équation (9) et d'autres équations analogues, et il se peut même qu'il convienne un jour de le faire. [En note „ C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles nos théories se séparent absolument de celles dites de l'École Autrichienne “. On peut ajouter qu'en cela elles diffèrent aussi des théories de Walras, que nous avons suivies de plus près dans le Cours, et qui ont pour fondement indispensable la notion de la rareté]. (p. 570) Au lieu de faire des expériences pour déterminer les lignes ou les variétés d'indifférence, faisons des expériences pour savoir quelles quantités de marchandises l'individu achètera à certains prix donnés ». Suit l'exposé mathématique des expériences à faire, et l'on conclut : « (p. 571) La difficulté plus ou moins grande, l'impossibilité même, qu'on peut trouver à réaliser pratiquement ces expériences, importe peu ; leur seule possibilité théorique suffit pour prouver, dans les cas que nous avons examinés, l'existence des indices de l'ophélimité, et pour nous en faire connaître certains caractères ». De la sorte, les indices d'ophélimité et les lois de l'offre et de la demande sont liés ensemble ; on peut aller des uns aux autres, ou vice versa : « (p. 571) On pourrait, des expériences qui viennent d'être indiquées, tirer directement la théorie de l'équilibre économique [par conséquent, sans faire usage des notions d'ophélimité, d'indices d'ophélimité ou d'autres analogues] ». Pour trouver les lois de l'offre et de la demande, le prof. Walras a considéré le troc de deux seules marchandises, et il a bien fait, parce que les difficultés sont résolues l'une après l'autre. Mais ensuite, il convient de pousser petit à petit les études, et de résoudre des problèmes nouveaux. C'est ce que nous avons fait en considérant le cas du troc de plusieurs marchandises ; en supposant d'abord la consommation de ces marchandises indépendantes (Giornale degli Economisti, août 1892), puis en supposant que les consommations sont dépendantes (Manuel et Encyclopédie des sciences mathématiques, loc. cit. p. 630-631).
[FN: § 2409-1]
V. PARETO ; L'écon. et la soc. au point de vue scient. « (p. 13) Cet équilibre [l'équilibre économique] ayant d'abord été étudié dans le cas de la libre concurrence, beaucoup de personnes se sont imaginé, que l'économie pure ne considérait que ce cas. Cette erreur est du genre de celle que pourrait faire une personne qui, ayant commencé par étudier, en dynamique, le mouvement d'un point matériel, s'imaginerait que la dynamique ne peut pas étudier les mouvements d'un système de points assujettis à des liaisons. L'économie pure peut étudier, et étudie, toutes sortes d'états économiques outre celui de la libre concurrence ; et par la rigueur de ses méthodes, elle donne une signification précise aux termes : libre concurrence, monopole, etc., employés jusqu'à présent d'une manière plus ou moins vague. Parmi les groupes d'équations qui déterminent l'équilibre économique, il en est un en lequel se trouvent les ophélimités des marchandises consommées. Cette circonstance a été l'origine d'une autre erreur. On s'est imaginé que les théories de l'économie pure étaient étroitement liées à la conception de l'ophélimité (rareté, marginal utility, etc.), et que par conséquent, celles-là ne pouvaient subsister sans celles-ci. Il n'en est rien. Si nous le désirons, nous pouvons, entre les équations données, éliminer les ophélimités, et nous aurons un nouveau système, qui déterminera également bien l'équilibre économique. Dans ce nouveau système, il y aura un groupe d'équations qui exprimera d'une manière précise la conception autrefois vague et parfois erronée, à laquelle on donnait le nom de loi de l'offre et de la demande ».
[FN: § 2409-2]
Manuale, IV, 11 : « (p. 253) Quelques-uns des auteurs qui ont constitué l'économie pure ont été amenés, pour rendre plus simples les problèmes qu'ils voulaient étudier, à admettre que l'ophélimité d'une marchandise ne dépendait que de la quantité de la marchandise à la disposition de l'individu. On ne peut pas les blâmer, parce qu'en somme il faut résoudre les questions les unes après les autres, et qu'il vaut mieux ne jamais se hâter. Mais il est temps maintenant de faire un pas en avant et de considérer aussi le cas dans lequel l'ophélimité d'une marchandise dépend des consommations de toutes les autres ». Le chapitre indiqué plus haut et l'Appendice mathématique traitent longuement de ce sujet. L'édition italienne du Manuel a été publiée en 1906 déjà. Le lecteur s'imaginera-t-il qu'un auteur reprocha aux théories de l'économie pure de ne considérer que les consommations indépendantes des marchandises ? Telle est la passion qui aveugle certaines personnes, telle est l'ignorance dont elles font preuve. – Au point de vue théorique, il faut prendre garde aussi à l'ordre des consommations. Une observation juste et avisée du prof. VITO VOLTERRA nous a déterminé à faire, sur ce sujet, une étude, publiée dans le Giornale degli Economisti, juillet 1906, et résumée dans le Manuel, p. 546-556.
[FN: § 2410-1]
C'est précisément en suivant ce principe et ceux de la sociologie scientifique en général, qu'a été écrit l'ouvrage que nous avons souvent cité, sur la circulation des élites en France : M. KOLABINSKA ; La circulation des élites en France...Si les rôles étaient renversés entre les classes des résidus et les dérivations presque constantes, toute l'évolution des sociétés humaines serait entièrement différente de ce qu'on observe en réalité ; les observations générales des historiens devraient prendre une autre et nouvelle forme, dans laquelle, parmi les éléments déterminants des phénomènes sociaux, les démonstrations occuperaient la place que tiennent aujourd'hui les sentiments et les intérêts. Les ouvrages des auteurs qui considèrent surtout ou exclusivement les actions logiques, et ceux des auteurs qui voient les faits à travers leur éthique absolue, prennent une forme analogue d'études historiques, qui écartent de la réalité, et parfois en éloignent beaucoup. En effet, cette éthique et la logique étant constantes, les dérivations auxquelles elles donnent naissance doivent aussi être considérées comme telles, et la variabilité des phénomènes devient presque ou entièrement dépendante de la variabilité supposée des résidus, et de celle des arts et des sciences, vérifiée par l'expérience (§ 356). Pourtant, on place d'habitude cette dernière variabilité dans la dépendance des résidus parmi lesquels se trouvent les sentiments qui empêchent l'homme de faire un usage convenable de sa raison.
[FN: § 2410-2]
À d'excellents ouvrages de sociologie on a reproché de ne pas tenir compte de tous les faits, ni de tous les détails des faits auxquels ils faisaient allusion. D'un mérite, on faisait ainsi un défaut. Pour que l'objection eût de la valeur, elle devait avoir la forme suivante : « Vous ne tenez pas compte de ce fait, qui exerce une grande influence sur la partie principale du phénomène dont vous recherchez les uniformités, ni de ces détails qui ont le même caractère ». En outre, eu égard au fond, il serait nécessaire de donner une démonstration adéquate de ces affirmations. Mais tout cela ne peut être compris que de ceux qui apportent dans les sciences sociales les méthodes qui ont été si utiles aux sciences expérimentales.
[FN: § 2411-1]
Il faut aussi se garder du désir, de la manie d'applications pratiques. V. PARETO ; loc. cit., § 2409-1: « (p. 21) La plupart des sociologies se sont annoncées comme une substitution du raisonnement scientifique, aux préjugés „ religieux et politiques “ et ont fini par constituer de nouvelles religions. Le fait est particulièrement remarquable pour Auguste Comte ; il s'observe aussi pour Herbert Spencer et pour le très grand nombre de sociologies humanitaires que chaque jour voit éclore [§ 6]. On tâche parfois de le dissimuler sous un vernis scientifique, mais ce vernis est transparent et laisse facilement apercevoir le dogme qu'on voulait dissimuler. ...Les sociologues qui n'en arrivent pas jusqu'à constituer un système religieux, veulent au moins tirer de leur ,, science “ des applications pratiques immédiates. Des applications pratiques seront possibles un jour, mais ce jour est encore loin. Nous commençons à peine à entrevoir les uniformités que présente la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux ; une somme énorme de travail est encore nécessaire avant que nous ayons acquis une connaissance de ces uniformités assez étendue pour nous permettre de prévoir, avec quelque probabilité, les effets sur les faits sociaux d'une modification apportée (p. 22) à une catégorie de ces faits. Jusqu'à ce que ce jour soit venu, l'empirisme synthétique des hommes d'États se trouve encore très supérieur, quant aux résultats pratiques, à la plus savante analyse sociologique qui soit à notre portée ». Ce qui précède était écrit en 1907 ; eh bien, il y a encore des personnes qui s'imaginent que les recherches scientifiques auxquelles nous nous livrons ont pour but de prophétiser, et de faire une concurrence déloyale à Mme de Thèbes. De même, dans le passé, il y avait des personnes qui supposaient que l'économie politique pouvait prédire le prix des marchandises. Une opinion analogue se manifesta de nouveau lorsque apparut l'économie mathématique. Il y eut alors des gens qui demandèrent : « Avec tous vos calculs, pouvez-vous prévoir le prix du blé l'année prochaine ? » Ces gens ne savent pas distinguer les mouvements virtuels des mouvements réels, un raisonnement logico-expérimental d"une dérivation, une proposition scientifique d'une prophétie. La forme d'un raisonnement logico-expérimental sur les mouvements virtuels est la suivante : « Si les circonstances A. B, C,... se réalisent, X se produira ». Le fond consiste en ce que A, B, C, … sont effectivement des faits expérimentaux, et que le raisonnement qui les unit à X est rigoureusement logique. Si, de l'observation du passé, on peut déduire avec une certaine probabilité que A, B, C,... existeront à l'avenir, on peut conclure avec la même probabilité qu'on observera aussi X. C'est là une prévision scientifique (§ 77), conséquence des uniformités qui unissent A, B, C,... à X, mais qui demeurent bien distinctes de cette uniformité ; à tel point qu'il peut arriver que l'uniformité subsiste, tandis que la prévision faite sur X ne se vérifie plus. Cela a lieu, non parce que le lien entre A, B,... et X disparaîtrait, mais parce que les prévisions sur la vérification de A, B,...., à l'avenir, sont erronées. On a des dérivations, si la forme du raisonnement que nous venons d'indiquer subsiste, mais que le fonds change, parce que A, B,... ne sont pas expérimentaux, ne fût-ce qu'en partie, ou bien que le raisonnement qui les unit à X n'est pas logico-expérimental. Ces dérivations n'ont aucune valeur démonstrative, et n'accroissent nullement la probabilité de la simple affirmation. « X se produira ». Si cette affirmation découle de l'induction non-logique d'un homme pratique, elle peut acquérir une probabilité notable en sa faveur. Si elle est la prophétie d'un croyant qui vit dans les nuages, ou d'une personne qui exploite la crédulité d'autrui, il est bon de ne pas s'y fier beaucoup ; il faut l'envoyer tenir compagnie aux prévisions de ces hommes remarquables qui devinent les numéros du loto. Si au prix de 81, la demande de titres de la dette publique est plus grande que l'offre, l'économiste peut vous dire que le prix montera. C'est là un cas particulier d'une uniformité étudiée par sa science. Si vous voulez savoir quel prix auront ces titres dans 15 jours, ne vous adressez pas à l'économiste : il ne peut rien vous dire à ce sujet. Adressez-vous à un homme d'État qui consente à vous faire part de renseignements ignorés du public, dont vous pourrez déduire, avec une probabilité plus ou moins grande, que la demande croîtra ou diminuera en regard de l'offre. Ou bien demandez conseil à un homme de bourse rompu aux affaires. Il se peut qu'il devine ; il se peut aussi qu'il se trompe. S'il a souvent gagné de l'argent en spéculant à la Bourse, la probabilité, du premier cas est plus grande que celle du second ; mais en font cas c'est une probabilité qui n'a rien à voir avec la science économique. Si vous vous adressez ensuite à une personne « confiante dans les destinées de la patrie », et qui en conclut que le prix des titres de la dette publique doit « nécessairement » monter, demandez-lui aussi les numéros du loto qu'elle a rêvé et qui vous porteront bonheur, et souvenez-vous que ces prophéties occupent un rang honorable parmi celles de Nostradamus et de Mme de Thèbes. Les affirmations d'un grand nombre de « sociologues » sont semblables à celles-là. Ils s'imaginent naïvement énoncer une uniformité sociologique en manifestant leurs désirs, leurs sentiments, les visions de leur religion humanitaire, patriotique, ou autre.
Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761 ↩
[FN: § 2415-1]
PAUL BOSQ ; Souvenirs de l'Assemblée nationale: « (p. 339, note) Dans le train qui, pour la dernière fois, ramenait à Paris les membres de l'Assemblée nationale, M. Laurier prononçait... l'oraison funèbre de cette majorité... „ Nous sommes flambés ! Ces gredins de républicains prendront nos sièges. Voilà ce que c'est de s'être toujours demandé au moment de prendre une décision : Qu'en dira la duchesse *** ? Et nous faisions une sottise “. Il aurait fallu répondre : Zut ! à la duchesse, et faire de la bonne politique. (p. 340) Nous n'en serions pas où nous sommes si nous nous étions moins préoccupés de l'opinion des salons ». On sait assez que les classes supérieures françaises préparèrent dans leurs salons la première Révolution, qui devait les détruire.
[FN: § 2420-1]
E. CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV : « (p. 68) La santé morale d'une cité hellénique tenait avant tout à la fidélité avec laquelle la génération présente s'attachait à la tradition du passé, à sa foi aux dieux de ses pères, à son dévouement à la chose publique, et à l'observation scrupuleuse de ce que la coutume et la législation avaient établi comme règle de la vie sociale ». Cela est vrai, pourvu qu'on l'entende, non pas des gouvernants et des gouvernés, mais principalement des gouvernés ; autrement, sous le gouvernement d'un Nicias, qui suivait précisément ce programme, les Athéniens auraient dû jouir d'une prospérité plus grande que sous le gouvernement d'un Périclès, qui ne se souciait guère de la tradition ni des dieux. On sait que ce fut le contraire qui arriva.
[FN: § 2421-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., t. X : « (p. 136) ... il parut au peuple athénien, – comme il aurait paru aux éphores à Sparte, ou aux chefs de toute ville oligarchique en Grèce, – que son premier, son impérieux devoir était d'en découvrir les auteurs et de les punir. Tant que ces derniers allaient librement inconnus et impunis, les temples étaient souillés par leur présence, et toute la ville regardée comme étant sous le coup du mécontentement des dieux, qui la frapperaient de graves malheurs publics ». C'est bien : si ces sentiments avaient été assez puissants chez le peuple athénien, il aurait renvoyé la discussion sur l'expédition en Sicile, ce qui l'aurait sauvé de terribles aventures.
[FN: § 2421-2]
THUCYD. ; VI, 29, 2 : ![]()
![]()
[FN: § 2421-3]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. III : « (p. 382) Ils [les Athéniens] se lancent dans une entreprise hasardeuse qui demandait un chef sans scrupules, déterminé, habile, et ils font du seul homme qui eût ces qualités un ennemi de la cité, acharné à la ruine de son propre ouvrage ; ils confient la continuation de la guerre à un général malade [un honnête homme, comme Napoléon III à Sedan], timoré et agissant à contre-cœur, et ils vont affronter un ennemi plus dangereux que tous les précédents... »
[FN: § 2422-1]
En décembre 1908, l'amiral Germinet disait publiquement : « La plupart des navires de l'escadre n'ont pas le stock nécessaire pour trois heures de combat ». Le gouvernement de ploutocrates démagogues qui avait réduit la marine à cet état n'entreprit pas d'augmenter les munitions, mais mit à disposition l'amiral Germinet.
[FN: § 2423-1]
Le 28 décembre 1913, le député radical-socialiste André Lefèvre dit sans qu'on puisse le démentir : « À la suite de l'incident de Tanger, nous avons dû subir une injonction parce que l'armée française n'avait pas plus de 700 coups par pièce. Il y a des économies qui coûtent cher. Si nous avions eu une armée et une marine répondant à notre politique étrangère, nous n'aurions pas été amenés à la situation où nous sommes ». Le président du Conseil, Caillaux, dit : « Il est malheureusement vrai qu'on n'a pas toujours fait l'effort qu'il fallait accomplir, et qu'il a fallu rattraper le temps perdu ». À propos de ce discours de Lefèvre, GEORGES BERTHOULAT écrit dans la Liberté, 30 novembre 1913 : « M. André Lefèvre n'est certes pas de nos amis politiques. Mais l'impartialité nous oblige à reconnaître que, lorsqu'il parle, c'est toujours pour dire quelque chose, compliment bien rare avec les parlementaires d'aujourd'hui. M. Lefèvre avait prononcé dans la discussion de la réforme militaire un discours hors de pair : celui d'hier n'est pas moins décisif, et il était aussi non moins opportun de prouver à la Chambre devant le pays que, si les ministres du Bloc n'avaient pas constamment traité la défense nationale par abandon, la France ne serait pas obligée de faire aujourd'hui un si grand effort financier et militaire. L'indignation effarée des jacobins en face de cette démonstration a été vraiment comique. Était-ce donc une révélation ?.Tout le monde ne sait-il pas qu'au moment d'Algésiras, M. Rouvier, éperdu, débarquait M. Delcassé sur les injonctions allemandes en disant dans les couloirs, à des députés dont j'étais, que, „ puisqu'il n’y a plus d'armée française grâce à André et à Pelletan, il fallait bien s'incliner “ ? N'est-ce pas aussi un fait historique, corroboré par M. Berteaux lui-même, qu'il fallut alors refaire fiévreusement les plus urgents des approvisionnements ruinés, et engager pour cela deux cents millions de dépenses occultes ? Les divulgations de M. Lefèvre n'étaient donc pas inédites. Mais c'est la première fois qu'on a le courage de les apporter à la tribune. Et les 700 coups seulement par pièce, ainsi révélés par un homme de gauche mettant son pays au-dessus de son parti, ont été un coup rude pour les survivants du „ régime abject “. Là-dessus, le Radical a un mot exquis : il rappelle M. Lefèvre „ aux convenances “. Quelles convenances ? Celles des coupables ? Un rappel à la vérité serait seul efficace. Mais M. Lefèvre a dressé un réquisitoire irréfutable. Et c'est évidemment l'homme que le journal exécutif appelle „ le chef du parti républicain “ qui doit en prendre sa grande part, attendu que M. Caillaux, chaque fois qu'il fut ministre des finances, a collaboré diligemment aux gaspillages de la politique alimentaire, mais ses seules économies furent réalisées au détriment de l'armée, c'est-à-dire celles qu'il n'aurait jamais dû faire et dont l'addition constitua en grande partie le présent déficit ». Cfr. § 2463-1.
[FN: § 2426-1]
HEROD. ; IX, 52. Cet auteur dit qu'Amopharétès était le chef de la localité de Pitana. Parlant des erreurs historiques qui sont usuelles, Thucydide (I, 20) observe qu'il n’a jamais existé une localité du nom de Pitana. Cela pourrait mettre en doute tout le récit d'Hérodote. Mais quand bien même il serait légendaire, en tout ou partie, cela importerait peu au but que nous nous proposons, lequel est uniquement de rechercher les sentiments des Spartiates. Il est en effet évident qu'une légende acceptée comme histoire doit concorder avec les sentiments qu'elle manifeste.
[FN: § 2427-1]
Sans avoir le moins du monde en vue notre théorie, CURTIUS, Hist. grecq., t. IV, nous donne un autre exemple, qui nous reporte aux Dix Mille guidés par Xénophon : « (p. 170). Chez ces hommes. l'inquiétude du présent entretenait une effervescence exaltée et avait détruit en eux l'amour de la terre natale [voilà certains résidus qui font défaut, mais d'autres les compensent] ; mais avec quelle fermeté ne restaient-ils pas attachés à leurs plus vieilles traditions ! Des (p. 171) rêves et des présages envoyés par les dieux dictent, comme dans le camp homérique, les plus graves résolutions (2440-1) ; c'est avec un zèle pieux qu'on chante les péans, qu'on allume le feu des sacrifices, qu'on dresse des autels aux dieux sauveurs et qu'on célèbre un tournoi quand à la fin l'aspect de la mer, de la mer tant désirée, vient ranimer les forces et le courage... La rivalité des tribus y est sensible, mais le sentiment de la communauté, la conscience de l'unité nationale garde la haute main, et la masse possède assez de raison [disons au contraire : de résidus de la IIe classe] et d'abnégation [bien : voilà le résidu] pour se soumettre à ceux que leur expérience, leur intelligence [voilà les résidus de la Ie classe] et leur force morale désignent comme propres au commandement. Et, chose merveilleuse [point merveilleuse du tout ; c'est la conséquence de l'existence des résidus remarquée par l'auteur] dans cette multitude bigarrée de Grecs, c'est un Athénien qui, par ses capacités, les dépasse tous et devient le véritable sauveur de l'armée entière [exactement comme Périclès à Athènes, Épaminondas à Thèbes, Philippe en Macédoine]. L'Athénien avait seul cette supériorité de culture nécessaire pour donner de l'ordre et de la tenue à ces colonnes de soldats assauvagis par l'égoïsme, pour leur servir, dans les circonstances les plus diverses, d'orateur, de général et de (p. 172) négociateur ; c'est à lui surtout qu'il faut savoir gré si, en dépit d'indicibles souffrances, au milieu de peuplades hostiles et de montagnes couvertes de neiges et désolées, huit mille Grecs pourtant touchèrent enfin à la côte, après avoir erré par de nombreux détours ». Plus précisément, on doit cela, ainsi qu'il ressort de l'exposé même de Curtius, à l'instinct des combinaisons de Xénophon, combiné avec l'existence, chez ses soldats, des sentiments de persistance des agrégats, fort bien notés par Curtius.
[FN: § 2428-1]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV : « (p. 379) L'art militaire des Spartiates, en dépit de quelques réformes isolées, avait toujours pour base l'ancienne disposition en lignes ; ils avaient leur ancienne phalange, c'est-à-dire la ligne de bataille rangée en profondeur égale, avec laquelle ils (p. 380) s'avançaient contre l'ennemi ».
[FN: § 2429-1]
Il paraît qu'à la bataille de Cannes, Annibal aurait été un précurseur des tacticiens allemands modernes. Voir SCHLIEFFEN ; Cannae. Les Romains inventaient peu, mais ils savaient se servir de l'expérience d'autrui ; c'est ce qu'ils firent pour l'art naval des Carthaginois.
[FN: § 2431-1]
XENOPH. ; Hellen., VI, 3, 20 : ... ![]()
![]()
![]() -- DIOD. ; XV, 51. « Les Lacédémoniens, donc, décidèrent d'attaquer les Thébains, ainsi abandonnés de tous, et de les réduire en servitude. Et parce qu'on savait que les Lacédémoniens faisaient des préparatifs énormes, et que personne ne se remuait pour les Thébains, chacun pensait
-- DIOD. ; XV, 51. « Les Lacédémoniens, donc, décidèrent d'attaquer les Thébains, ainsi abandonnés de tous, et de les réduire en servitude. Et parce qu'on savait que les Lacédémoniens faisaient des préparatifs énormes, et que personne ne se remuait pour les Thébains, chacun pensait ![]() , que ceux-ci auraient été défaits sans grandes difficultés. C'est pourquoi ceux qui leur étaient favorables, prévoyant les désastres au-devant desquels ils allaient, déploraient leur sort, et leurs ennemis jubilaient ».
, que ceux-ci auraient été défaits sans grandes difficultés. C'est pourquoi ceux qui leur étaient favorables, prévoyant les désastres au-devant desquels ils allaient, déploraient leur sort, et leurs ennemis jubilaient ».
[FN: § 2431-2]
PLUTARCH ; Pelop. 20.
[FN: § 2432-1]
DIOD. SIC ; XV, 50, 6 : ![]()
![]()
[FN: § 2432-2]
DIOD. SIC. ; loc. cit., § 2432-1.
[FN: § 2433-1]
GROTE ; Hist. de la Grèce, XV, c. 1, p. 5 : « Ce prince [Cléombrote] avec un degré de talent militaire rare dans les commandants spartiates, déjoua tous les calculs thébains. Au lieu de marcher par la route régulière de Phokis en Bœôtia, il tourna au sud par un chemin dans la montagne jugé à peine praticable, défit la division thébaine sous Chereas qui le gardait, et traversa la chaîne de l'Helikôn pour gagner le port bœôtien de Kreusis, sur le golfe Krissaen. Arrivant sur cette place par surprise, il l'enleva d'assaut, et captura douze trirèmes thébaines qui se trouvaient dans le port ».
[FN: § 2434-1]
XENOPH. ; Hell., IV, 5 – CORN. NEP. ; Iphicr. : Iphicrates, Atheniensis, non tam magnitudine rerum gestarum, quam disciplina militari nobilitatus est. Fuit enim talis dux, ut non solum aetatis suae cum primis compararetur, sed ne de maioribus natu quidem quisquam anteponeretur. Multum vero in bello est versatus ; saepe exercitibus praefuit ; nusquam culpa sua male rem gessit ; semper consilio vicit, tantumque eo valuit, ut multa in re militari partim nova attulerit, partim meliora fecerit... – GROTE, Hist. de la Gr., t. XIV, c. 1, croit pouvoir tirer de CORN. NEP. et de DIOD. SIC. la description suivante des perfectionnements introduits par Iphicrate : « (p. 67) Il allongea de moitié et la légère javeline et la courte épée, que les peltastes thraces portaient habituellement ; il inventa une espèce de grandes guêtres, connues plus tard sous le nom d’Iphicratides, et il combina ainsi, mieux qu'on ne l'avait jamais fait auparavant, des mouvements rapides, – le pouvoir d'agir sur un terrain difficile et en déployant les rangs, – une attaque efficace soit au moyen de traits, soit corps à corps, – et une retraite habile en cas de besoin ». Par conséquent « (p. 68) les succès de (p. 69) ses troupes légères furent remarquables. Attaquant Phlionte, il fit tomber les Phliasiens dans une embuscade, et leur infligea une défaite si destructive qu'ils furent obligés d'invoquer l'aide d'une garnison lacédaemonienne pour protéger leur cité. Il remporta une victoire près de Sikyôn, et poussa ses incursions sur toute l'Arkadia, jusqu'aux portes mêmes des villes ; faisant tant de mal aux hoplites arkadiens, qu'ils finirent par craindre de le rencontrer en rase campagne ».
[FN: § 2434-2]
XENOPH ; Hell., VI, 4, 12. Les Lacédémoniens avaient rangé les énomoties [compagnies de 25, 32 ou 36 hommes, selon les auteurs] sur trois files ; ce qui donnait au maximum douze hommes de profondeur, tandis que les Thébains avaient une profondeur d'au moins cinquante boucliers. – En un temps très postérieur, Végèce décrit, en le louant, un semblable ordre de bataille. VEG. ; III, 20 : Depugnationum septem sunt généra vel modi, cara infesta ex utraque parte signa confligunt. Una depugriatio est fronte longa, quadro exercitu, sicut etiam nunc et prope semper solet proelium fieri. Sed hoc genus depuguationis periti armorum non optimum iudicant... Secunda depugnatio est obliqua, quae plurimis melior : in qua si paucos strenuos loco idoneo ordinaveris, etiamsi multitudine hostium et virtute turberis, tamen poteris reportare victoriam. Huius talis est modus : Cum instructae acies ad congressum veniunt, tunc tu sinistram alam tuam a dextra adversarii longius separabis, ne vel missilia ad eam, vel sagittae perveniant : dextram autem alam tuam sinistrae alae illius iunge, et ibi primum inchoa proelium : ita, ut cum equitibus optimis, et probatissimis peditibus sinistram partem illius, ad quam te iunxeris, aggrediaris atque circumeas, et detrudendo atque supercurrendo ad hostium terga pervenias. Quod si semel adversarios exinde pellere coeperis, accedentibus tuis indubitatam victoriam consequeris, et pars exercitus tui, quam ab hoste submoveris, secura durabit.
[FN: § 2434-3]
DIOD. Sic. ; XV, 55.
[FN: § 2434-4]
POLYB. ; XII, 25 g , dit à propos de la bataille de Mantinée : ![]()
![]() ... « la bataille de Mantinée où l'on vit tant de variété et de science de commandement... ».
... « la bataille de Mantinée où l'on vit tant de variété et de science de commandement... ».
[FN: § 2436-1]
DIOD. SIC. ; XV, 52.
[FN: § 2436-2]
DIOD. SIC. ; XV, 52, 5.
[FN: § 2434-3]
DIOD. SIC. ; XV, 52, 7. L'auteur observe qu'en cela « Épaminondas ayant été instruit dans la philosophie, et mettant en pratique les sages leçons qu'il avait reçues dans sa jeunesse, s'attira le blâme de beaucoup de gens ». On voit ici que les préjugés existaient chez le vulgaire, mais qu'ils cédaient devant l'autorité d'Épaminondas. Cfr. PLUTARCH. ; Pélop., 3.
[FN: § 2436-4]
FRONT. ; Strateg., I, 12,5 : Épaminondas Thebanus, contristatis militibus, quod ex hasta eius ornamentum [circonstance un peu différente de celle que rapporte Diodore], infulae more dependens, ventus ablatum in sepulcrum Lacedaemonii cuiusdam depulerat : Nolite, inquit, milites, trepidare; Lacedaemoniis signifiratur interitus. Sepulcra enim funeribus ornantur. Il continue en rapportant deux autres cas semblables.
[FN: § 2436-5]
XENOPH. ; Hell., VI, 4, 7.
[FN: § 2436-6]
XENOPH. ; Hell., VI, 4, 7 : ![]()
![]() .
.
[FN: § 2436-7]
L'inverse se produisit pour le peuple athénien. On voit bien là combien est importante la considération de la quantité des résidus. D'abord, il fut nuisible au peuple athénien de posséder des résidus de la IIe classe en quantité trop petite pour qu'il fût attentif aux prudents conseils de Nicias, et qu'il s'abstînt de l'entreprise de Syracuse ; tandis qu'ils étaient en assez grande quantité pour faire de Nicias un des chefs de l'entreprise. Pour n'avoir pas fait cette distinction, GROTE, Hist. de la Grèce, t. X, commet une grave erreur. Après avoir rappelé le jugement bienveillant de Thucydide sur Nicias, il dit : « (p. 347) Thucydide est ici d'autant plus instructif qu'il représente exactement le sentiment du public athénien en général à (p. 348) l'égard de Nikias pendant qu'il vivait. Ses compatriotes ne pouvaient supporter l'idée de condamner un citoyen si respectable et si religieux, de se défier de lui, de le destituer et de se passer de ses services [résidus de la IIe classe] ». C'est bien cela, en ce qui concerne la seconde partie de l'activité de Nicias, c'est-à-dire pour le commandement de l'expédition de Sicile ; mais non pour la première partie, lorsqu'il conseillait au peuple de ne pas faire cette expédition, et qu'on n'y fut pas attentif. « (p. 348) Non seulement on considérait les qualités privées de Nikias comme lui donnant droit à l'explication la plus indulgente de ses fautes publiques [parmi celles-ci n'était certainement pas le conseil de s'abstenir d'aller en Sicile !], mais elles lui assuraient pour sa capacité politique et militaire un crédit complètement disproportionné à ses mérites [oui, si l'on ne s'attache qu'au commandement de l'expédition en Sicile ; non, si l'on envisage le conseil de ne pas la faire]... Jamais dans l'histoire politique d'Athènes le peuple ne se trompa aussi fatalement en plaçant sa confiance [il faut répéter ici l'observation précédente] ». Grote saisit l'occasion de ce fait pour justifier les démagogues : « (p. 349) Les artifices ou l'éloquence démagogiques n'auraient jamais créé dans le peuple une illusion aussi profondément établie que le caractère respectable et imposant de Nikias [Pourtant lui-même se dément, en racontant comment les artifices et l'éloquence d'Alcibiade créèrent précisément dans le peuple l'illusion de l'utilité de l'expédition de Sicile, contrairement à l'opinion de Nicias, qui la prévoyait malheureuse]. Or, c'était contre le présomptueux ascendant de cette incompétence bienséante et pieuse, aidée par la richesse et des avantages (p. 350) de famille, que l'éloquence des accusateurs démagogiques aurait dû servir comme obstacle et correctif naturel ». Il eût certainement été très utile que cela se produisît pour la seconde partie de l'activité de Nicias ; mais ce fut un grand malheur pour Athènes que cela soit, au contraire, arrivé pour la première. Le même Grote dit : « (p. 117) La position de Nikias, par rapport à la mesure, est remarquable. (p. 118) Comme conseiller disposé à avertir et à dissuader, il s'en fit une idée juste ; mais en cette qualité il ne put entraîner le peuple avec lui ». Il est vrai que Grote affirme que l'expédition de Sicile aurait été utile à Athènes si elle avait été bien conduite ; mais les preuves de ces hypothèses font défaut. Ensuite, en ce qui concerne la foi aux présages, elle peut être avantageuse si elle sert à un chef avisé pour déterminer le vulgaire à accomplir une action utile ; elle peut être nuisible, si le chef a les mêmes préjugés que le vulgaire, et si les présages sont acceptés en vertu d'un prétendu mérite intrinsèque, au lieu d'être employés comme moyen. Les présages furent favorables, quand on préparait l'expédition de Sicile. Les Athéniens le déplorèrent amèrement, lorsque celle-ci tourna mal. – THUC. ; VIII, 1. – EURIP. ; Helena, 744-760, se fait l'interprète des sentiments de scepticisme et de mépris à l'égard des prophéties. Il conclut : ![]() . « Prudence et bon conseil sont le meilleur présage ». Nicias ne put peut-être pas, il ne voulut certainement pas tourner, par une interprétation opportune, ces oracles et ces prophéties en faveur du conseil qu'il donnait, de s'abstenir de l'expédition. Il l'aurait fait, s'il avait été comme Épaminondas ; et les Athéniens auraient pu lui accorder créance, s'ils avaient été comme les Thébains. De nouveau se manifestent les présages, lorsqu'il s'agit de décider si la flotte athénienne quitterait le port de Syracuse (§ 2440-1), et de nouveau se manifeste le désavantage de la foi que Nicias avait en eux.
. « Prudence et bon conseil sont le meilleur présage ». Nicias ne put peut-être pas, il ne voulut certainement pas tourner, par une interprétation opportune, ces oracles et ces prophéties en faveur du conseil qu'il donnait, de s'abstenir de l'expédition. Il l'aurait fait, s'il avait été comme Épaminondas ; et les Athéniens auraient pu lui accorder créance, s'ils avaient été comme les Thébains. De nouveau se manifestent les présages, lorsqu'il s'agit de décider si la flotte athénienne quitterait le port de Syracuse (§ 2440-1), et de nouveau se manifeste le désavantage de la foi que Nicias avait en eux.
[FN: § 2437-1]
POLYAEN., Strateg ., II 3, 8, mentionne clairement l'artifice. Après avoir dit que les Thébains étaient effrayés, il ajoute : ![]()
![]() . « Épaminondas leur donna du courage par deux artifices ». Il parle d'un message de Trophônios, qui promettait la victoire à qui commencerait la bataille, et il raconte qu'Épaminondas alla avec ses soldats dans le temple d'Héraclès où, suivant l'ordre qu'il avait donné, le prêtre avait fourbi les armes et laissé le temple ouvert, ce qui passa pour un présage de victoire. Cfr. FRONT. ; I, 11, 16.
. « Épaminondas leur donna du courage par deux artifices ». Il parle d'un message de Trophônios, qui promettait la victoire à qui commencerait la bataille, et il raconte qu'Épaminondas alla avec ses soldats dans le temple d'Héraclès où, suivant l'ordre qu'il avait donné, le prêtre avait fourbi les armes et laissé le temple ouvert, ce qui passa pour un présage de victoire. Cfr. FRONT. ; I, 11, 16.
[FN: § 2437-2]
DIOD. SIC. ; XV, 53.
[FN: § 2437-3]
DIOD. SIC. ; XV, 54.
[FN: § 2437-4]
PLUTARQUE ; Pélop. (trad. TALBOT), 20 : « Dans la plaine de Leuctres se trouvent les tombeaux des filles de Skédasus, que l'on appelle, à cause du lieu, les Leuctrides [récit légèrement différent de celui de Diodore, mais concordant avec celui de Pausanias]... Depuis lors, des oracles et des prédictions ne cessaient de recommander aux Spartiates de se garantir et de se garder de la vengeance de Leuctres : avertissement que le peuple ne comprenait pas bien et qui laissait des doutes sur le lieu. Il y a, en effet, dans la Laconie, près de la mer, une petite ville nommée Leuctres, et prés de Mégalopolis, en Arcadie, un autre endroit du même nom... (21) Pélopidas dormait dans le camp, lorsqu'il croit voir les filles de Skédasus se lamenter autour de leurs tombeaux, en lançant des imprécations contre les Spartiates, puis Skédasus, qui lui ordonne d'immoler à ses filles une vierge rousse s'il veut vaincre les ennemis ». Il communiqua les choses aux devins et aux chefs. Une partie d'entre eux voulaient que la prescription fût exécutée à la lettre, et rappelaient de nombreux exemples de tels sacrifices. « Ceux d'un avis opposé soutenaient qu'un sacrifice aussi barbare, aussi contraire aux lois de l'humanité, ne pouvait être agréable à aucun des êtres supérieurs qui nous gouvernent... (22) Tandis que ces conversations ont lieu entre les chefs et que Pélopidas, surtout, est dans le plus grand embarras, une jeune cavale, échappée d'un troupeau, passe en galopant à travers les armes, arrive auprès d'eux et s'arrête tout court. Tous les regards sont attirés par la couleur de sa crinière, d'un rouge très-vif,... Le devin Théocrite, par une heureuse conjecture, crie à Pélopidas : „ Voici votre victime, heureux mortel ! N'attendons pas d'autre vierge, mais prenez et immolez celle que le dieu nous donne “. On saisit la cavale, on la conduit aux tombeaux des jeunes filles, on invoque les dieux après l'avoir couronnée de guirlandes, on immole joyeusement la victime, et l'on répand ensuite dans le camp le bruit de la vision de Pélopidas et la nouvelle du sacrifice ». Pausanias (IX, 13) sait le nom des jeunes filles ; elles s'appelaient Molpia et Ippo. En toute bonne foi il rapporte les présages comme des faits réels.
[FN: § 2439-1]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV, compare Athènes et Thèbes, Périclès et Épaminondas : « (p. 477). Chez ces deux hommes, c'est leur culture si haute et si variée qui est la raison même de leur ascendant ». Ce n'est pas cela : à Athènes et à Thèbes, des démagogues ignorants obtinrent pleine et entière confiance de leurs concitoyens. Mais ensuite Curtius se rapproche de la vérité expérimentale : « (p. 477) Nous découvrons donc aussi à Thèbes, an sein d'un régime démocratique, une direction tout aristocratique [ici l'on fait allusion, sous d'autres termes, à la combinaison que nous avons indiquée dans le texte], un pouvoir personnel aux mains de l'homme qui est le premier par (p. 478) l'intelligence [ou mieux l'instinct des combinaisons]. Épaminondas aussi gouverne son pays, comme l'homme de confiance du peuple [qui ne comprend pas grand'chose, et qui, en ne le réélisant pas béotarque, met en danger le sort de la patrie], à titre de stratège réélu d'année en année [très grave dommage de la combinaison intrinsèquement avantageuse]. Dans cette position, il eut à éprouver l'inconstance de ses concitoyens et l'hostilité d'une opposition qui considère l'égalité garantie par la Constitution comme violée. Des hommes comme Ménéclidas jouent le rôle de Cléon [les termes de la combinaison sont intervertis : ceux qui ont les qualités pour obéir gouvernent ceux qui ont les qualités pour commander, ce qui détruit Athènes et fait courir un grave danger à Thèbes ; la Macédoine s'en tire parce qu'elle n'est pas atteinte de cette maladie]. Épaminondas aussi supporta avec le calme des grandes âmes toutes les attaques et les humiliations.. À la guerre, il fut, comme Périclès, toujours heureux dans toutes les entreprises importantes, parce qu'il savait également unir à la plus haute prudence la plus entière énergie, et surtout parce qu'il s'entendait à élever l'âme de ses soldats et à les animer de son esprit [mais beaucoup plus parce qu'il savait se servir de leurs préjugés]. Il leur apprit, comme fit Périclès à l'égard des Athéniens, à surmonter les préjugés superstitieux... ». Ici, l'auteur cite Diodore, XV, 53, qui raconte des faits arrivés avant la bataille de Leuctres (§ 2437). Mais ce récit ne montre nullement qu'Épaminondas enseignait aux Thébains de ne pas se laisser aller à leurs préjugés ; au contraire, il les encouragea et s'en servit à ses fins. Il ne dit nullement à ses soldats que les oracles étaient de vaines fables ; mais aux oracles défavorables, il en opposa d'autres, favorables. DIODORE parle pourtant clairement à l'endroit cité par Curtius, XV, 53 ; il dit : « (4) Épaminondas, voyant les soldats envahis d'une crainte superstitieuse, à cause des présages qui s'étaient manifestés, s'efforçait, par l'intelligence et l'artifice [MIOT traduit : „ dans son esprit éclairé et dans ses conceptions militaires “] de dissiper les terreurs du vulgaire ». ![]()
![]() [ici, c'est proprement des artifices de guerre]
[ici, c'est proprement des artifices de guerre] ![]() . L'auteur continue en rapportant précisément les artifices employés par Épaminondas. L'erreur d'un historien aussi éminent que Curtius est remarquable, parce qu'elle procède de la manie qu'ont les historiens de vouloir, non seulement décrire des faits et des rapports entre les faits, mais encore faire œuvre éthique. Souvent, même sans s'en apercevoir, l'historien est persuadé qu'il doit montrer l'excellence du savoir comparé à l'ignorance, de la vertu comparée au vice. Aussi Curtius exalte-t-il sans autre le savoir d'Épaminondas, et sans prendre garde qu'il produisit un effet favorable, précisément à cause de l'ignorance des gens persuadés et commandés par ce capitaine. – GROTE, t. XV, raconte le désespoir des soldats après la mort d'Épaminondas, à Mantinée : « (p. 209) Toutes les espérances de cette armée, composée d'éléments si divers, étaient concentrées dans Épaminondas ; toute confiance des soldats dans un succès, toute leur sécurité contre une défaite, avaient leur source dans l'idée qu'ils agissaient sous ses ordres ; tout leur pouvoir, même celui d'abattre un ennemi défait, parut disparaître lorsque ces ordres cessèrent. Nous ne devons pas, il est vrai, parler d'une pareille conduite avec éloge ». Et nous voilà retombés dans l'éthique ! Laissons de côté la louange ou le blâme, qui n'ont pas grand'chose ou rien à faire ici, et relevons seulement le fait que ces sentiments des soldats montrent combien puissante était en eux la persistance des agrégats ; en ce cas particulier, elle prenait la forme d'une confiance illimitée dans le chef, presque d'un culte pour lui. Nous verrons alors se confirmer la proposition suivant laquelle on obtient l'effet utile maximum, lorsque le chef a l'instinct des combinaisons, utile pour commander, et que les soldats ont les sentiments et les préjugés grâce auxquels l'obéissance devient une religion.
. L'auteur continue en rapportant précisément les artifices employés par Épaminondas. L'erreur d'un historien aussi éminent que Curtius est remarquable, parce qu'elle procède de la manie qu'ont les historiens de vouloir, non seulement décrire des faits et des rapports entre les faits, mais encore faire œuvre éthique. Souvent, même sans s'en apercevoir, l'historien est persuadé qu'il doit montrer l'excellence du savoir comparé à l'ignorance, de la vertu comparée au vice. Aussi Curtius exalte-t-il sans autre le savoir d'Épaminondas, et sans prendre garde qu'il produisit un effet favorable, précisément à cause de l'ignorance des gens persuadés et commandés par ce capitaine. – GROTE, t. XV, raconte le désespoir des soldats après la mort d'Épaminondas, à Mantinée : « (p. 209) Toutes les espérances de cette armée, composée d'éléments si divers, étaient concentrées dans Épaminondas ; toute confiance des soldats dans un succès, toute leur sécurité contre une défaite, avaient leur source dans l'idée qu'ils agissaient sous ses ordres ; tout leur pouvoir, même celui d'abattre un ennemi défait, parut disparaître lorsque ces ordres cessèrent. Nous ne devons pas, il est vrai, parler d'une pareille conduite avec éloge ». Et nous voilà retombés dans l'éthique ! Laissons de côté la louange ou le blâme, qui n'ont pas grand'chose ou rien à faire ici, et relevons seulement le fait que ces sentiments des soldats montrent combien puissante était en eux la persistance des agrégats ; en ce cas particulier, elle prenait la forme d'une confiance illimitée dans le chef, presque d'un culte pour lui. Nous verrons alors se confirmer la proposition suivant laquelle on obtient l'effet utile maximum, lorsque le chef a l'instinct des combinaisons, utile pour commander, et que les soldats ont les sentiments et les préjugés grâce auxquels l'obéissance devient une religion.
[FN: § 2440-1]
En abandonnant le port de Syracuse, les Athéniens pouvaient éviter la destruction totale qu'ils subirent. Tout était déjà prêt pour le départ, qui pouvait s'effectuer aisément ; « mais la veille du départ, à la tombée de la nuit, la lune s'éclipsa. C'est pourquoi Nicias, rendu plus craintif par scrupule superstitieux et à cause de la peste [qui sévissait] dans l'armée, convoqua les devins. La réponse de ceux-ci fut que, suivant l'usage, on devait attendre trois jours avant de mettre à la voile. Démosthène, [qui était favorable au départ] et ceux qui étaient avec lui durent donner leur consentement, par crainte des dieux ». – THUC. ; VII, 50, 4 : « ...la plupart des Athéniens exhortaient les stratèges à surseoir [au départ], poussés par un scrupule de conscience. Nicias (il était aussi trop superstitieux et adonné à ces choses), dit qu'on ne devait pas délibérer sur le départ, avant d'avoir attendu, comme le disaient les devins, trois fois neuf jours ». Cfr. POLYB. ; IX, 19. – Si Nicias avait été dépourvu de préjugés comme Épaminondas ou Pélopidas, il aurait trouvé facilement les dérivations capables de persuader à l'armée que l'éclipse était un signe favorable au départ. On les trouva après l'événement, pour sauver le crédit des prophéties. – PLUTARCH. ; Nicias, 23 (tract. TALBOT) : « Car ce phénomène, comme le dit Philochorus, n'était point mauvais pour des gens qui voulaient fuir ; il leur était même très favorable. Et de fait, les actes qu'on accomplit avec crainte ont besoin d'obscurité, et la lumière en est ennemie ». En de semblables circonstances, Dion et Alexandre le Grand surent interpréter les éclipses favorablement à leurs desseins. PLUTARQUE ; Dion, 24 (trad. TALBOT). Tandis que Dion est sur le point de marcher contre Denys, « après les libations et les prières d'usage, la lune s'éclipse. Cela n'a rien d'étonnant pour Dion, qui connaît les périodes écliptiques, et qui sait que l'ombre est causée par la rencontre de la terre avec la lune et son interposition entre elle et le soleil. Mais les soldats troublés ont besoin d'une explication, et le devin Miltas, se plaçant au milieu d'eux, les engage à prendre courage et à s'attendre au plus grand succès. La divinité montre par ce signe qu'il y aura éclipse d'un objet éclatant. Or, il. n'y a rien de plus éclatant que la tyrannie de Denys, et c'est son éclat qu'ils vont éclipser en mettant le pied en Sicile ». Tandis qu'Alexandre marchait contre Darius, il y eut une éclipse de lune. Mais Alexandre sacrifia aussitôt à la lune, au soleil, à la terre, et trouva, ou imagina un présage qui lui était favorable. – ARR. ; De exp. Alex., III, 7, 6 : « Il sembla à Aristandre que cet accident de la lune était favorable aux Macédoniens et à Alexandre, et qu'en ce mois aurait lieu la bataille, pour laquelle les sacrifices présageaient la victoire à Alexandre. – Q. CURT. ; IV, 10. Effrayés par l'éclipse de lune, les soldats murmuraient : Iam pro seditione res erat, cum ad omnia interritus, duces principesque militum frequentes adesse praetorio, Aegyptiosque vates, quos coeli ac siderum peritissimos esse credebat, quid sentirent, expromere iubet. At illi, qui satis scirent, temporum orbes implere destinatas vices, lunamque deficere, cum aut terram subiret, aut sole premeretur, rationem quidem ipsis perceptam non edocent vulgus : ceterum affirmant, solem Graecorum, lunam esse Persarum. : quoties illa deficiat, ruinam stragemque illis gentibus portendi; veteraque exempla percensent Persidis regum, quos adversis diis pugnasse lunae ostendisset defectio. Nulla res efficacius multitudinem regit quam superstitio : alioquin impotens, saeva, mutabilis, ubi vana religione capta est... Nos intellectuels oublient cette fonction séculaire de l'expérience. Aujourd'hui on ne croit plus que les éclipses lunaires ou solaires aient le moindre pouvoir sur les événements d'une guerre ; mais beaucoup de gens croient que ce pouvoir est détenu par la « justice » ou par l’« injustice » de la cause remise au sort des armes. C'est pourquoi les gouvernants modernes n'ont plus à se soucier des éclipses ; mais il est bon qu'ils se soucient de faire passer pour « juste » la cause pour laquelle ils combattent. Il est bon aussi qu'ils n'y aient pas trop foi, qu'ils n'imitent pas Nicias, lequel croyait à l'influence des éclipses lunaires, ou Napoléon III et son ministre Ollivier, lesquels se fiaient, pour vaincre, à la « justice » de leur cause. Il est bon qu'ils imitent plutôt Thémistocle, Épaminondas, Dion, Alexandre, qui savaient interpréter les présages en faveur de leurs desseins, ou bien Bismarck, qui parlait aux autres de justice, et en lui-même se préoccupait d'être fort par les armes. Quand Bismarck fut sur le point de falsifier la célèbre dépêche d'Ems, il ne prit pas conseil d'un moraliste, mais demanda à de Moltke et à de Roon si l'armée était prête et capable de remporter la victoire.
[FN: § 2441-1]
PLUTARQUE ; Pélop. (trad. TALBOT) : « Il [Pélopidas]... reçoit pour otages Philippe, frère du roi, avec trente autres enfants des plus illustres familles, et les conduit à Thèbes... Ce Philippe était celui qui fit plus tard la guerre aux Grecs pour les assujettir. Ce n'était alors qu'un enfant, vivant à Thèbes dans la maison de Pamménès. Cette circonstance fit croire qu'il avait pris Épaminondas pour modèle. Sans doute il avait compris son activité à la guerre et à la tête des armées, mais ce n'était là qu'une faible partie de la vertu de ce grand homme : quant à sa tempérance, sa justice, sa grandeur d'âme et sa bonté, qui l'ont fait réellement grand, Philippe n'en eut jamais rien ni de sa nature, ni par imitation ». – GROTE, Hist. de la Gr., t. XVII, c. 1, dit avec justesse de Philippe : « (p. 16) Son esprit fut enrichi de bonne heure des idées stratégiques les plus avancées de l'époque, et jeté dans la voie de la réflexion, de la comparaison et de l'invention, sur l'art de la guerre ». forces qui persistent longtemps, d'autres qui sont accidentelles et de courte durée ; mais enfin les premières finissent par l'emporter.
[FN: § 2442-1]
Bien qu'admirateur inlassable de la démocratie athénienne, GROTE, Hist. de la Gr., t. XVII, c. 1, ne cesse de déplorer la perte des meilleurs généraux, stupidement destitués par le peuple athénien : « (p. 39) La perte d'un citoyen tel que Timotheos [parti pour l'exil] était un nouveau malheur pour elle. Il avait conduit ses armées avec un succès signalé, maintenu l'honneur de son nom dans les mers orientales et occidentales, et grandement étendu la liste de ses alliés étrangers. Elle [Athènes] avait récemment perdu Chabrias dans une bataille, un second général, Timotheos, lui était actuellement enlevé, et le troisième, Iphikratès, bien qu'acquitté dans le dernier procès, semble, autant que nous pouvons le savoir, n'avoir jamais été employé dans la suite pour un commandement militaire. Ces trois hommes furent les trois derniers citoyens d'Athènes qui se firent distinguer à la guerre ; car Phokiôn, quoique brave et méritant, ne fut à comparer avec aucun d'eux. D'autre part, Charès, homme d'un grand courage personnel, mais n'ayant pas d'autre mérite, était alors en plein essor de réputation. La récente lutte judiciaire entre les trois amiraux athéniens (p. 40) avait été doublement funeste pour Athènes, d'abord en ce qu'elle avait décrédité Iphikratès et Timotheos, ensuite en ce qu'elle avait élevé Charès, auquel le commandement fut maintenant confié sans partage ».
[FN: § 2446-1]
Parmi les dérivations employées pour défendre le régime monarchique, il en est une remarquable. En réponse à l'objection de certains dommages incontestables survenus en certains faits historiques, elle répond que ces dommages n'auraient pas eu lieu si le souverain avait été bon, capable, apte au commandement. À cet égard, il n'y a en effet aucun doute ; mais l'objection est tout autre et consiste en ce qu'avec le régime monarchique, on n'est pas sûr d'avoir un monarque possédant ces qualités, ni que, s'il les a possédées un certain temps, il les conservera toujours. Par exemple, DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE, Souv. d'un vieil homme, veut innocenter le régime impérial des terribles défaites de 1870. Voici comment il raisonne : « (p. 178) Pour faire acte d'Empereur, il eût fallu que l'Empereur fût encore Empereur comme il l'était du temps de la Constitution de 1852 ou que du moins il fût resté ce qu'il était en 1863... (p. 179) Malheureusement nous n'en étions plus là ! Peu à peu le pauvre Empereur avait cédé aux exigences du Parlement et cela pour arriver finalement à abdiquer entre les mains, non pas seulement d'Ollivier, mais d'orléanistes comme Buffet et comme Daru, l'autorité qu'il tenait de la nation ! Il n'y avait plus rien à faire ! » Ne nous arrêtons pas à examiner les faits. Acceptons les yeux fermés tout ce qu'affirme Dugué de la Fauconnerie. Lui-même condamne sa thèse, puisqu'il nous montre un empereur qui détenait le pouvoir absolu et la force nécessaire à le conserver, et qui se laisse déposséder par des politiciens parlementaires. Si, comme le veut cet auteur, les maux arrivés furent causés par ces parlementaires, la première origine doit en être recherchée dans la faiblesse du souverain qui donna le pouvoir à ces parlementaires ; et puisque le régime impérial ne nous garantit nullement qu'il n'y aura pas de temps à autre un empereur de ce genre, l'origine des maux remonte encore plus haut et va jusqu'à ce régime. Tout cela doit être entendu comme une hypothèse fondée uniquement sur les affirmations de Dugué de la Fauconnerie. Les excuses qu'Émile Ollivier cherche pour son ministère sont d'un genre analogue : tout d'abord la mauvaise foi des Hohenzollern et de Bismarck, comme si la fonction principale d'un ministre n'était pas précisément de pourvoir à ce que la mauvaise foi des ennemis ne cause aucun dommage à son pays ; puis l'opposition de la droite, qui l'empêcha de connaître les véritables conditions de la santé de l'Empereur, et qui par conséquent le détermina, lui Ollivier, à consentir à ce que l'Empereur se rendit au camp et prît le commandement en chef de l'armée ; comme si ce n'était pas le rôle d'un ministre de s'informer de faits si essentiels, et comme si ce n'était pas son devoir de se retirer, lorsqu'on le met dans l'impossibilité d'accomplir ce qui est nécessaire pour la défense du pays. De même, ni les excuses de Lamarmora ni celles de Baratieri ne sont dignes d'être prises en considération. Un chef doit savoir et prévoir. Celui qui ne sait pas et ne prévoit pas fait mieux de remettre le commandement à un autre et de rentrer chez lui. Émile Ollivier a montré les graves dommages subis par le pays, du fait de la régence de l'impératrice, au temps de la guerre de 1870. Sous le gouvernement de la République, personne ne songerait à confier le sort du pays à une telle femme. Dans la Lanterne du 8 août 1868, ROCHEFORT écrivait : « (p. 34) Sa Majesté l'Impératrice des Français a présidé hier le conseil des ministres. Quelle ne serait pas ma surprise si j'apprenais que madame Pereire a présidé le conseil d'administration du Crédit mobilier ! » Parfois, on peut recevoir un bon conseil, même d'un ennemi. Si Napoléon III avait été attentif à cette observation très juste de Rochefort, il aurait peut être évité, ou du moins rendu plus difficile la chute de son gouvernement, lequel, comme l'a dit Ollivier, finit par un suicide auquel prit part l’impératrice-régente.
[FN: § 2446-2]
LIV ; XXII, 61 : Quo in tempore ipso, adeo, magno animo civitas fuit, ut consuli, ex tanta clade, cuius ipse causa magna fuisset, redeunti, et obviam itum frequenter ab omnibus ordinibus sit, et gratiae actae, quod de republica non desperasset ; cui, si Carthaginiensium ductor fuisset, nihil recusandum supplicii foret.
[FN: § 2447-1]
Baron COLMAR VONDER GOLTZ ; Rosbach et Iéna.
[FN: § 2450-1]
Georges SOREL ; La rév. dreyf. : « (p 35) Pour pouvoir se maintenir jusqu'à cette époque des élections, Waldeck-Rousseau fut obligé d'accepter de nombreux compromis qui durent paraître bien cruels à l'ancien collaborateur de Jules Ferry. C'est ainsi qu'il lui en coûta beaucoup de laisser traduire en Conseil de guerre les gendarmes qui étaient entrés en collision avec des grévistes à Chalon ; il lui fallut donner cette satisfaction aux députés socialistes parce que ceux-ci avaient grand'peur d'être accusés de trahison par leurs comités électoraux et que les voix de ces députés étaient nécessaires pour former une majorité gouvernementale dans certains jours difficiles. Après la démission de Galliffet, Waldeck-Rousseau voulait se retirer et il ne demeura sans doute que dans l'espoir de tirer une vengeance éclatante de ses ennemis à l'heure des élections ; il était certainement fixé sur la nullité militaire d'André, qui n'était devenu général que par la protection de Brisson ; il accepta cependant ce grotesque comme ministre de la Guerre, parce qu'il lui était imposé par Brisson et Léon Bourgeois (JOSEPH REINACH ; Hist. de l'aff. Dreyf., t. VI, p. 121) ce dernier venait de sauver le gouvernement à la séance du 28 mai. Autrefois les démissions du chef d'état-major et du généralissime auraient épouvanté Waldeck-Rousseau, qui avait, comme tous les gambettistes, une grande préoccupation des choses de l'armée ; il devait maintenant laisser opérer les radicaux et le „ céphalopode empanaché “ (l'expression est de Clémenceau), dont ils avaient fait leur ministre favori ». Heureusement pour la France et pour tous les peuples latins, il manquait à l'Allemagne un Bismarck et un Guillaume Ier. « (p. 36) Il fallait beaucoup de corruption pour conserver cette majorité provisoire, en attendant les élections. Waldeck-Rousseau avait pris pour secrétaire général de son ministère un homme qui ne pouvait être arrêté par aucun scrupule... Il y eut une prodigieuse curée, dans laquelle les socialistes parlementaires ne furent pas les moins cyniques... » Pourtant il y a encore des gens qui, de bonne foi, croient que le ministère Waldeck-Rousseau a fait triompher « l'honnêteté » politique et sociale.
[FN: § 2451-1]
Dès 1866, Stoffel, parlant de Moltke, relevait l'utilité d'un chef d'état-major puissant et compétent. STOFFEL ; Rapp. milit. ; Rapp, du 25 oct. 1866, p. 39.
[FN: § 2452-1]
Gazette de Laus., 3 août 1911. À propos d'une réforme destinée à donner la haute main a l'élément civil dans le « conseil supérieur de la défense nationale », l'auteur dit : « ... dans le conseil supérieur de la défense nationale, il fallait, non pas admettre sur un strapontin les commandants des forces de terre et de mer, mais faire entrer, toutes portes ouvertes, tous les membres des conseils supérieurs de la guerre et de la marine. „ Tendance à la réaction, s'exclame M. Messimy. Elle voudrait noyer le gouvernement sous un flot de généraux et d'amiraux ! “ Peut-être nous sera-t-il permis, à notre tour, de dénoncer cette incurable défiance qui hypnotise les hommes du bloc devant les périls que font courir les militaires au malheureux pouvoir civil perpétuellement menacé. Quand cette défiance se borne à empêcher de dormir ceux qu'elle possède, il n'y a pas grand mal ! C'est plus grave quand elle conduit à des mesures qui peuvent affaiblir la défense nationale. Est-ce encore à ce soupçon démocratique que M. Messimy a voulu faire une part, quand il a supprimé le titre, non pas de généralissime, puisqu'il n'a jamais existé légalement, mais de vice-président du conseil supérieur de la guerre... Il est bien entendu, au surplus, qu'en pareille matière, les questions de personnes priment toutes les autres. Avec le général Pau, l'armée aurait accepté n'importe quelle cacophonie de titres ou quelle combinaison de préséances. Avec le général Joffre, elle aurait pu y regarder d'un peu plus près. Il n'est pas douteux aujourd'hui – je vous l'avais fait pressentir immédiatement – que ce sont les pires raisons politiques qui ont déterminé le refus du général Pau. Il paraît que, ce soldat énergique et éminent avait revendiqué un droit de contrôle sur la nomination des commandants des corps, non seulement pour l'avenir mais pour le passé ; et il n'avait pas caché qu'il méditait quelques exécutions, notamment celle de l'officier général aussi scandaleusement incapable que grossièrement infatué que les caprices de la politique ont placé à la tête d'un de nos principaux corps d'armée. C'est ce qu'il fallait à tout prix éviter ; c'est ce qui n'était pas à craindre avec le général Joffre, homme d'une haute intelligence, mais assez politicailleur, et à ce qu'on m'assure franc-maçon. Heureusement que l'intelligence sauve bien des choses... » Ce n'est pas tout. Les politiciens voulaient mieux encore. Ils inventèrent une combinaison très ingénieuse, grâce à laquelle, en rejetant sur l'État-major la faute dont ils étaient eux-mêmes responsables, ils visaient à remettre le commandement de l'armée à leurs amis. Le 13 juillet 1914, le sénateur Charles Humbert, rapporteur de la commission de l'armée, exposa au Sénat les conditions absolument insuffisantes des armements. Il s'en suivit une discussion à la Chambre. La Liberté, 17 juillet 1914 : « Après les accusations de M. Humbert, la Chambre a compris qu'elle ne pouvait faire autrement que de paraître partager l'émotion du Sénat. Il n’est rien de ce qu'on a dit devant la haute assemblée que les députés ne connaissent... La Chambre, ou plutôt la majorité radicale qui gouverne à peu près sans interruption depuis quinze années, avait d'autant moins besoin d'ouvrir une enquête sur les insuffisances du matériel de guerre qu'elle est elle-même responsable de cette insuffisance. Elle a refusé les crédits demandés par l'État-major. Il y a les faits, les dates et les chiffres. Trois ministres de la guerre, incarnant les sentiments de la majorité avec une particulière fidélité, n'ont pas craint de prendre parti contre leur propre département pour ménager mieux les antimilitaristes et les retenir dans la majorité ministérielle ». À la Chambre, le député Driant dévoila les dessous du mouvement produit au Sénat. « Ce qui est étonnant c'est l'étonnement du Sénat. Si quelque chose peut étonner davantage, ce sont les indignations de M. Clémenceau. Il a été président du conseil pendant trois ans. Il nous a donné un ministre de la guerre mou et insuffisant. La campagne qui se prépare a pour but de préparer un changement du haut commandement et de lui substituer une coterie politico-militaire ». Personne ne démentit cela. Le député André Lefèvre compta que, de 1900 à 1912, la France avait dépensé pour ses armements 1056 millions de moins que l'Allemagne. Le journal La Liberté remarque à ce propos : « En 1898 notre armée était sans rivale. Vers 1900, la politique change et viennent des ministres de la guerre qui s'appellent le général André et le général Picquart. C'est à partir de ce moment que tous les besoins de l'armée sont systématiquement réduits et que l'armée allemande prend une avance accrue d'année en année.
[FN: § 2453-1]
ISOCR. ; Antidos., 26-7.
[FN: § 2454-1]
En général les gouvernements de « spéculateurs » non seulement souffrent du défaut de certains résidus de la IIe classe, mais encore ne savent pas se servir opportunément de ceux qui sont intenses chez leurs gouvernés. Cela vient de ce que l'homme a la tendance de juger autrui selon sa propre mentalité, et comprend mal des sentiments qu'il n'éprouve pas. On eut un exemple remarquable de ce fait dans la guerre de Libye, entreprise par l'Italie. Giolitti, chef d'un gouvernement de « spéculateurs », ne la voulait pas. Poussé irrésistiblement à la faire, par l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe qui se manifestaient dans le pays, il sut la préparer politiquement (non pas militairement) avec un art consommé, vraiment digne d'un maître en l'art des combinaisons (Ie classe). Mais il ne sut pas la diriger de manière à raffermir ces sentiments dans le pays, ni à en obtenir, sans résistance, les sacrifices nécessaires. Il donna la forme d'une opération économique, la seule que comprennent bien les « spéculateurs », à ce qui aurait dû être une opération soutenue par des sentiments nationaux, opération qui appartient à un genre en grande partie étranger à la mentalité des « spéculateurs ». Quand l'enthousiasme pour la guerre était au paroxysme, en Italie, si le gouvernement avait demandé des sacrifices pécuniaires au pays, celui-ci les aurait accordés avec joie ; et loin de nuire à l'enthousiasme pour la nouvelle entreprise, ces sacrifices l'auraient peut-être accru. Il n'est pas rare, en effet, dans des circonstances semblables que les peuples aiment leur patrie en proportion des sacrifices qu'ils accomplissent pour elle. Cela demeure inconcevable pour les « spéculateurs ». Ils ne peuvent se persuader qu'il y ait des gens qui jugent une opération autrement qu'en faisant le compte du doit et de l'avoir. C'est pourquoi, préoccupés uniquement de ce fait, les « spéculateurs » furent convaincus que le seul moyen de pousser le peuple italien à la guerre de Libye était de le persuader que cette guerre constituait une excellente opération économique ; qu'on la ferait sans lever de nouveaux impôts, sans que diminuassent les dépenses pour les travaux publics, sans écorner le moins du monde le budget. Dans ce but, ils recoururent à divers artifices, présentant même des budgets truqués de telle sorte qu'un boni figurait là où il y avait, en réalité, un déficit (§ 2306-1). Ils furent aussi poussés par un autre caractère de leur mentalité : la tendance à ne se soucier que du présent, et à négliger l'avenir. En effet, ces artifices réussirent quelque temps, mais ils furent d'autant plus nuisibles, lorsqu'on ne put finalement plus cacher la vérité. En agissant ainsi, les spéculateurs ne surent pas utiliser, comme c'eût été possible, la grande force de l'enthousiasme existant dans le pays ; aussi, négligée de la sorte, elle s'éteignit peu à peu.
[FN: § 2454-1]
À Athènes, bien que tous deux démocratiques, au temps de Thémistocle et à celui de Démosthène, les régimes politiques étaient en partie différents ; mais pas au point d'expliquer comment il se fait que, pour résister aux Perses, les Athéniens affrontèrent volontiers les énormes sacrifices conseillés par Thémistocle, tandis que, pour résister à Philippe de Macédoine, ils n'acceptaient en aucune façon les sacrifices bien moindres conseillés par Démosthène. On ne peut trouver l'explication que dans la différence de proportions des résidus de la IIe classe chez les Athéniens.
[FN: § 2454-3]
Chaque fois, par exemple, qu'un peuple A, chez lequel les résidus de la IIe classe sont affaiblis, et chez lequel, par conséquent, les intérêts matériels et temporaires prédominent, se trouvera menacé par les armements d'un peuple B, chez lequel les résidus de la IIe classe sont puissants, et chez lequel, par conséquent, il existe des tendances à sacrifier les intérêts matériels et temporaires à d'autres intérêts de nature plus abstraite et à des intérêts futurs, chaque fois l'on pourra adresser au peuple A les avertissements qu'en des circonstances analogues Démosthène adressait au peuple athénien. Celui-ci, pour sauver l'intégrité du fond théorique et s'amuser dans les fêtes, négligeait les armements contre Philippe, et préparait la défaite de Chéronée. Pour sauvegarder les dépenses en faveur des « réformes sociales » et d'autres qui procurent aux clientèles des politiciens leurs aises et des jouissances matérielles, les peuples modernes négligent les dépenses qui seraient indispensables pour sauvegarder l'indépendance de la patrie. – DEMOSTH : In Phil., Il : « (3) ... tous ceux qui sont poussés par la soif de dominer doivent être repoussés par les actes et par les faits, non par les discours ; et d'abord, nous autres orateurs, nous nous abstenons de les proposer et de les conseiller, craignant votre colère contre nous ». In, Phil., IV : « (55) ... s'il arrive qu'on parle des agissements de Philippe, aussitôt quelqu'un se lève. Il dit qu'il ne faut pas déraisonner et proposer la guerre. Là-dessus il continue en représentant combien il est doux de vivre en paix, et combien il est pénible d'entretenir une armée puissante. Il ajoute : „ Il en est qui veulent s'approprier l'argent “, et d'autres fables qui ont l'apparence de la vérité ». L'erreur principale des dérivations par lesquelles on tente de justifier la veulerie et la soif de jouissances matérielles de ceux qui se dérobent aux sacrifices nécessaires pour conserver l'indépendance de leur pays, consiste principalement en ce qu'on oublie que la guerre peut être imposée même à qui ne la veut pas, et que si celui-là n'y est pas préparé, elle peut causer sa ruine définitive. – GROTE ; Hist. de la Gr., t. XVII : « (p. 111) ...Démos au logis en était venu à croire que la cité marcherait sûrement toute seule sans aucun sacrifice de sa part, et qu'il était libre de s'absorber dans ses biens, sa famille, sa religion et ses divertissements. Et Athènes aurait en réalité pu marcher ainsi, en jouissant de la liberté, de la fortune, des raffinements et de la sécurité individuelle, si le monde grec avait pu être garanti contre le formidable ennemi macédonien du dehors ». Si l'on ne savait pas que Grote a écrit son histoire longtemps avant la guerre de 1870, on se demanderait s'il n'avait pas en vue la France de la fin de l'Empire, quand, à propos des Athéniens, il écrivait : « (p. 97) La supériorité de force fut d'abord tellement du côté d'Athènes [de la France au temps de la guerre de 1866], que si elle avait voulu l'employer, elle aurait pu retenir assurément Philippe au moins dans les limites de la Macédoine [la Prusse, dans les limites qu'elle avait avant la guerre avec l'Autriche]. Tout dépendait de sa volonté, de la question de savoir si ses citoyens avaient l'esprit préparé à subir la dépense et la fatigue d'une politique étrangère vigoureuse [et si l'empereur Napoléon III était disposé à la subir, au lieu de rêver à son humanitarisme], s'ils voudraient saisir leurs piques, ouvrir leurs bourses et renoncer au bien-être du foyer, pour défendre la liberté grecque et athénienne contre un destructeur qui grandissait, mais auquel on pouvait encore résister. Les Athéniens ne purent se résoudre à se soumettre à un pareil sacrifice ; et par suite de cette répugnance, ils finirent par être réduits à un sacrifice beaucoup plus grave et plus irréparable : la perte de la liberté, de la dignité et de la sécurité ». Le désastre de la guerre de 1870 fut beaucoup moindre ; mais on ne peut pas savoir quelle serait la gravité d'un désastre analogue, si, dans un avenir très prochain, les mêmes causes agissant, des effets analogues se produisaient.
[FN: § 2454-2]
Prince de BISMARCK ; Pensées et souvenirs, trad. franç., t. I.
[FN: § 2458-1]
BUSCH ; Les mém. de Bism., t. 1, p. 240 : « La conversation est tombée à table sur Napoléon III, et le chef [Bismarck] a déclaré que c'était un homme médiocre. „ il est meilleur qu'on ne le croit “, nous a-t-il dit, „ mais il est moins fort qu'on ne le suppose “. „ Oui “, dit Lehndorff, „ un brave homme, mais un imbécile “. „ Non “, répliqua le chef sérieusement, „ malgré tout ce qu'on peut penser de son coup d'État, c'est un homme bon, sensible, sentimental, mais son intelligence ne va guère plus loin que son instruction “ ». Dans ce jugement sur l'instruction, Bismarck s'est trompé ou a voulu se tromper. Napoléon III était très instruit, beaucoup plus que Bismarck ; mais il était humanitaire, rêveur, l'instrument d'un ramassis de gens qui s'enrichissaient par des spéculations. À quoi sert d'être intelligent, si l'on emploie son intelligence à son propre détriment ? Ainsi lorsque vint à Napoléon III l'idée stupéfiante d'aider les nationalités à se constituer en Europe ; ce qui était le meilleur moyen de préparer la ruine de son pays. Un souverain moins intelligent serait demeuré attaché à la tradition (résidus de la IIe classe), et aurait usé de tout son pouvoir pour que les voisins de la France, unie depuis des siècles, demeurassent désunis. On serait peut-être tenté de conclure que si Bismarck avait eu la mentalité de Napoléon III, et vice-versa, les sorts de la Prusse et de la France auraient aussi été intervertis. Ce serait une erreur, parce que sur la mentalité du pays, un Napoléon III, mis à la place d'un Bismarck, aurait en peu ou point d'action en Prusse et vice-versa en France, un Bismarck mis à la place d'un Napoléon III.
[FN: § 2461-1]
MAUPAS. Mém. sur le sec. emp., t. II. Au temps de Sadowa : « (p. 188) on sait à quel point il [1'Empereur] était obsédé par la pensée que nous aurions inévitablement, un jour, la guerre sur le Rhin ».
[FN: § 2461-2]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. X. L'auteur a un chapitre entier (p. 264-279) intitulé : « Comment la guerre avec la Prusse apparaît inévitable ». – GRANIER DE CASSAGNAC ; Souv. du sec. emp., t. III, p. 256 :
« Personne ne le niera : la guerre devint imminente dès la fin de l'année 1866, après la défaite de l’Autriche à Sadowa,... »
[FN: § 2461-3]
Peut-être écrira-t-on un jour quelque chose de semblable du président Poincaré, qui, vers la fin de 1913, dut se résigner à accepter le ministère Doumergue, lequel désorganisait la défense nationale. Eu égard aux hommes, il y a cette différence que Napoléon III pouvait et ne voulut pas, tandis que certainement Poincaré ne pouvait pas, et que nous ne savons pas s'il voulut ou non. Mais eu égard aux effets des formes de régime, il en fut somme toute de même avec le régime impérial et avec le régime républicain.
[FN: § 2463-1]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. X : « (p. 382) ...nous ne devions plus songer qu'à jouir des bienfaits du repos, à nous enrichir, et à n'avoir plus d'autre ennemi que cette tuberculose, produit des vices de la paix, qui, dans une année, fait plus de victimes que des mois de guerre. Aucun idéal sous aucune forme ! Comment demander à un peuple ainsi endoctriné d'avoir l'esprit militaire et de s'estimer heureux d'être enfermé dans des casernes ? Pour défendre son indépendance ? Mais il ne voulait pas la croire menacée. D'ailleurs, une, crainte vague, sans réalité tangible, ne suffit pas à allumer dans des âmes jouisseuses la passion des servitudes et des sacrifices de la vie militaire »,.. « (p. 351) Garnier-Pagès avait dit : „ L'influence d'une nation dépend de ses principes. Les armées, les rivières, les montagnes ont fait leur temps. La vraie frontière c'est le patriotisme. (p. 352) Tous ces thèmes furent repris, amplifiés dans la discussion, et ce fut à qui déclamerait le plus éloquemment contre les armées permanentes dont la fin était proche (Magnin, 20 et 21 septembre 1867), qui créent au milieu de nous une race d'hommes séparée du reste de leurs concitoyens (Jules Simon, 19 décembre 1867) ; ce fut à qui maudirait la paix armée, pire, avec ses énervements et ses sacrifices, que la guerre, „ car elle ne finit pas et elle ne donne pas la seule chose qui puisse consoler des batailles, cette énergie, cette virilité des peuples qui se retrempent dans le sang versé “ (Jules Simon, 23 décembre 1867) »... « (p. 353) Selon Garnier-Pagès, il ne fallait ni soldats, ni matériel, la levée en masse suffisait à tout : „ Lorsque nous avons fait la levée en masse “ disait-il, „ nous avons vaincu la Prusse et nous sommes allés à Berlin ; lorsque les Prussiens ont fait la levée en masse, ils sont venus à Paris “ (discours du 24 décembre 1867) »... Jules Favre disait : « (p. 558) „ Vous parlez de frontières, mais elles ont été renversées, les frontières ! Savez-vous qui les abaissées ? C'est la main de nos ingénieurs, c'est le ruban de fer qui circule autour de ces vallées, c'est la civilisation ! “ »... Quand cet éminent phraseur s'en vint larmoyer devant Bismarck, à Versailles, il s'est peut-être aperçu qu'outre la civilisation, il y avait une autre chose, appelée la force, qui avait quelque influence sur la fixation des frontières. Bismarck riait de semblables bouffonneries. – BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I, p. 312. Bismarck disait des programmes des candidats à l'Assemblée Nationale : « Trop d'éloquence... C'est comme Jules Favre : il est deux ou trois fois monté avec moi sur ses grands chevaux ; mais quand il a vu que je le blaguais, il a aussitôt mis pied à terre » (§ 2387-1). Jules Favre a pu gouverner le pays qu'il avait contribué à faire marcher à sa ruine. On a de nouveau entendu les mêmes absurdités en 1913, contre les mesures de défense, rendues nécessaires par les armements allemands. De nouveau l'on a entendu prêcher que c'était non par les armes, mais par les principes humanitaires et pacifistes qu'on résiste à l'ennemi. Par concession extrême, on parlait de la « nation armée », exactement comme au moment où la guerre de 1870 était imminente, tandis qu'il y avait aussi des Français, toujours comme avant la guerre de 1870, qui prêchaient le désarmement et la paix à leur pays. Cependant l'ennemi armait et se préparait à la guerre d'une manière formidable. Nous ne devons pas nous étonner de tout cela : les dérivations sont et demeurent de la nature qui convient le mieux au vulgaire qui les écoute et les admire. Les charlatans modernes usent des mêmes moyens que les charlatans de la Grèce antique et de la Rome antique, et nos démagogues ressemblent aussi aux démagogues grecs et romains.
[FN: § 2464-1]
E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t. X.
[FN: § 2465-1]
MAUPAS ; Mém. sur le sec. Emp., t. II Au temps de Sadowa, il paraît que Napoléon III et son ministre Drouyn de Lhuys avaient l'intention d'envoyer un corps d'observation sur le Rhin ; ce qui aurait pu changer le sort de la guerre. « (p. 189) Un instant... on put croire que la politique de prévoyance et d'énergie franchement acceptée par M. Drouyn de Lhuys et le maréchal Randon avait fini par prévaloir aux Tuileries. Le 5 juillet, les décrets pour la convocation des Chambres, pour la mobilisation de notre armée étaient préparés, signés peut-être, et ils allaient être envoyés au Journal Officiel quand de hautes influences, qui avaient accès près du Souverain, tentèrent sur lui un dernier effort. Au nombre des personnalités marquantes agissant à la dernière heure de cet émouvant épisode se trouvait M. Rouher... À quel mobile pouvait donc obéir, en particulier, le ministre d'État, pour s'opposer à la mise en marche d'un corps d'observation sur le Rhin ? Il n'en faut pas chercher la cause dans des considérations d'un ordre supérieur... M. Rouher céda (p. 190) à l'influence de ceux des amis fanatiques de l'Italie qui appartenaient à son intimité, et il subit encore la pression de ce groupe de financiers et de grands industriels qui n'avaient cessé de l'entourer depuis son passage au ministère des travaux publics. Ces hommes, chez lesquels la passion des affaires paralysait le sentiment du patriotisme, voyaient, dans l'envoi d'un corps d'observation sur le Rhin, ce qui était la conséquence évidente de la mobilisation de notre armée, l'essor des affaires pour longtemps compromis, et ils avaient réussi à persuader à M. Rouher que le véritable intérêt du pays, c'était la neutralité absolue, c'était l'inaction ». Un phénomène analogue se produisit en 1905, lorsque Rouvier, digne représentant des brasseurs d'affaires, renvoya Delcassé, pour obéir à une injonction de l'Allemagne. C'était aussi l'un des motifs pour lesquels Giolitti ne voulait pas la guerre de Libye.
[FN: § 2465-2]
STOFFEL ; Rapp. milit., rapp. du 23 avril 1868.
[FN: § 2466-1]
Si A est un indice de la valeur de l'ensemble des résidus de la Ie classe, et si B est un indice semblable pour les résidus de la IIe classe, il est important que nous connaissions, fût-ce d'une manière grossièrement approximative, comment varie :
q = B / A
L'une des plus grandes difficultés, pour acquérir cette connaissance, consiste en ce qu'il ne suffit pas de savoir, par exemple, que l'indice I s'est accru, pour pouvoir en conclure que q s'est aussi accru ; parce que si l'indice A s'est aussi accru, cette augmentation peut être assez forte pour compenser l'augmentation de l'indice B, et par conséquent pour faire que q change peu ou point ; ou bien elle peut être telle que q s'accroisse ; ou encore qu'il diminue. Il faut donc prêter attention aux variations, non pas d'un seul des indices, mais de tous les deux, et s'efforcer de les évaluer tant bien que mal. L'un des cas les plus favorables à ces recherches se présente lorsqu'on peut trouver des phénomènes qui dépendent directement de q, et qui, de ce fait, nous permettent d'avoir quelque idée de la manière dont varie q.
[FN: § 2467-1]
Les disc. de M. le prince de Bism., t. II, p. 382. Discours du 4 février 1868 à la Chambre prussienne.
[FN: § 2469-1]
BARON COLMAR VON DER GOLTZ : Rosbach et Iéna, trad. franç.
[FN: § 2469-2]
De même, les socialistes-pacifistes français de 1913 disent : « Pour préparer la guerre, il est nécessaire de renoncer aux dépenses des lois sociales. Nous n'en voulons rien. Concluons donc une alliance avec l'Allemagne, en quittant toute rancune pour la perte de l'Alsace-Lorraine ». Ces éminentes personnes oublient que dans l'histoire on voit à chaque instant se vérifier le proverbe : « Qui se fait agneau, le loup le mange ». Les bassesses volontaires de Carthage devant les Romains ne la sauvèrent pas de la destruction. L'attitude humble de Venise eut pour épilogue le traité de Campo-Formio. Les radicaux anglais du type de Lloyd George disent que les dépenses de la guerre doivent être payées uniquement par les riches, parce qu'eux seuls en retirent avantage pour la défense de leurs biens ; comme si, dans les territoires occupés par l'ennemi, le menu peuple n'était pas exposé à perdre, outre ses salaires, la vie, car il n'a pas d'argent pour se mettre en lieu sûr. Mais ces propos sont simplement des dérivations qui recouvrent le désir de jouissances obtenues aux frais d'autrui.
[FN: § 2470-1]
Journal des Goncourt, t. V, p. 59 : « Je déjeune, à Munich, avec de Ring, premier secrétaire d'ambassade à Vienne. C'est lui qui a été le cornac diplomatique de Jules Favre, à Ferrières. Il nous entretient de la naïveté de l'avocat, de la conviction qu'il avait de subjuguer Bismarck, avec le discours qu'il préparait sur le chemin. Il se vantait, l'innocent du Palais, de faire du Prussien un adepte de la fraternité des peuples, en lui faisant luire, en récompense de sa modération, la popularité qu'il s'acquerrait près des générations futures, réunies dans un embrassement universel. L'ironie du chancelier allemand souffla vite sur cette enfantine illusion » (§ 2380-1). Maintenant, il y a de nouveau des gens qui se repaissent de semblables sornettes. Elles atteignent le comble de l'absurde dans les discours de d'Estournelle de Constant. Cet auteur a du moins le mérite de manifester clairement sa pensée, tandis que le doute subsiste au sujet de la sincérité d'un grand nombre d'autres auteurs qui usent de dérivations analogues.
[FN: § 2474-1]
Exactement comme en Italie et en France, à l'époque présente. On a là un caractère spécifique des gouvernements faibles. Parmi les causes de faiblesse, il faut surtout en relever deux : l'humanitarisme, la lâcheté naturelle des aristocraties en décadence, et la lâcheté en partie naturelle, mais aussi en partie voulue, des gouvernements de spéculateurs (§ 2480-1), visant à des gains matériels. L'humanitarisme rentre dans les résidus de la IIe classe ; mais, comme nous l'avons déjà expliqué (§ 1859), il est parmi les plus faibles et les moins efficaces. C'est proprement une maladie des hommes manquant d’énergie et possédant en quantité certains résidus de la Ie classe, auxquels ils donnent un vernis sentimental.
[FN: § 2480-1]
En juin 1914, eurent lieu, un peu partout en Italie, mais surtout en Romagne, des troubles révolutionnaires qui nous offrent un excellent exemple, bien que dans une proportion très réduite, des faits rappelés dans le texte. Au moment où la révolte atteignait sa plus grande intensité, le 10 juin, le président du Conseil, Salandra, envoyait aux préfets la circulaire suivante : « Des faits regrettables se sont passés dans quelques villes du Royaume. Les esprits en sont attristés. Il importe avant tout d'éviter qu'ils ne se répètent. Vous voudrez bien y employer tous vos efforts, tout votre zèle. Le Gouvernement n'est pas un ennemi ; il a des devoirs à remplir, dont le premier est le maintien de l'ordre public. Mais il faut qu'en le maintenant, si l'usage de la force est indispensable, il soit appliqué avec la plus grande prudence. Le Gouvernement compte avoir, dans le rétablissement de la paix, l'appui de tous les citoyens patriotes, qui attendent de bons effets du respect commun de la loi et des libertés publiques ». À ce discours si humble et soumis du chef du gouvernement, qui semble presque s'excuser auprès de ses adversaires d'oser leur résister, comparons l'article que l'Avanti, journal officiel des socialistes, imprimait le 12 juin : « Trêve d'armes. La grève générale, qui a pris fin hier soir, est le mouvement populaire le plus grave qui ait secoué un tiers de l'Italie depuis 1870 à aujourd'hui. En comparaison de 1898, il y a eu un plus petit nombre de morts ; mais la grève d'aujourd'hui dépasse en étendue et en profondeur la révolte du mois de mai tragique. Deux éléments essentiels distinguent la récente grève générale de toutes les précédentes : l'extension et l'intensité. Il n'y a qu'une seule page sombre dans ces journées de feu et de sang. C'est la Confédération générale du Travail qui a voulu l'écrire, en décrétant inopinément et arbitrairement, à l'insu de la direction du parti, la cessation de la grève. Une autre page sombre est celle des chemineaux, auxquels il a fallu trois jours pour s'apercevoir de la grève ; et ils s'en sont aperçus pour... s'abstenir de faire grève. Mais tout cela n'efface pas la beauté du mouvement dans ses lignes grandioses. Nous comprenons, en présence d'une situation qui deviendra toujours plus difficile, les peines et les terreurs du réformisme et de la démocratie. L'honorable Salandra, libéral-conservateur, et l'honorable Sacchi, qui vote contre lui, sont pour nous exactement sur le même pied. Nous le constatons avec un peu de cette joie légitime que met l'artiste à contempler son œuvre. Nous revendiquons certainement notre part de responsabilité dans les événements et dans la situation politique qui se dessine. Si, le cas échéant, au lieu de l'honorable Salandra, c'eût été l'honorable Bissolati qui fût à la présidence du Conseil, nous aurions cherché à rendre la grève générale de protestation encore plus violente et nettement insurrectionnelle. Depuis hier soir, une autre période de trêve sociale a commencé. Quelle sera sa durée ? Nous l'ignorons. Nous en profiterons pour continuer notre activité socialiste multiforme, pour consolider nos organismes politiques, pour recruter de nouveaux ouvriers dans les organisations économiques, pour obtenir d'autres positions dans les communes et dans les provinces, pour préparer, en somme, un nombre toujours plus grand de conditions morales et matérielles favorables à notre mouvement ; de sorte que, quand retentira de nouveau la diane rouge, le prolétariat soit éveillé, prêt et décidé au plus grand sacrifice, à la plus grande et la plus décisive des batailles ». Ce langage de l'Avanti est confirmé par d'autres journaux socialistes. Par exemple, la Scintilla, 18 juin 1914 : « Les cataractes des sentiments humanitaires se sont ouvertes. Tous les cœurs tendres y versent maintenant leurs lamentations onctueuses, sur « toute violence », et les larmes de crocodile de la pitié « pour toutes les victimes ». Les journaux de la démocratie, qui ont surtout peur des contre-coups de la grève sur leurs « blocs » électoraux, se remplissent maintenant de sermons pathétiques, d'homélies mielleuses sur le dogme de l'évolution, et gémissent sur la sinistre inutilité de la violence. Nous sommes fiers de constater que le parti socialiste n'a pas contribué et ne contribue pas à cette salade de révoltantes hypocrisies... Nous n'avons rien à répudier et personne à renier, pas même ce qu'on appelle la „ Teppa “ ! Naturellement, nous ne conseillerons jamais à personne, comme nous ne l'avons jamais conseillé, l'emploi des pierres contre les cordons de la police. Nous n'aimons pas les révoltes à coups de pierres : elles sont stupides. Surtout, ce qui nous exaspère, c'est l'imbécillité de ceux qui s'imaginent pouvoir affronter avec des pierres les fusils „ dernier modèle “. C'est donc une question purement pratique de mesure entre l'offense et la réaction, que nous soulevons contre la révolte, frondeuse... ». On assiste tout à fait à la lutte du renard et du lion. D'un côté, on ne fait allusion qu'à la ruse pour vaincre : pas un mot où l'on voie l'esprit viril, courageux, de qui a une foi. De l'autre côté, des caractères opposés. Au Gouvernement qui ne veut pas être appelé l'ennemi de ses adversaires, ceux-ci répondent qu'ils sont et demeureront ses ennemis, à lui et à tout autre gouvernement semblable ; et vraiment, pour ne pas comprendre cela, il faut être aveugle et sourd. De la sorte, les hommes de l'Avanti font preuve des qualités de virilité et de loyauté qui tôt ou tard assurent la victoire, et qui, en fin de compte, sont utiles à la nation entière. Le renard, usant de ses artifices, pourra échapper assez longtemps ; mais il viendra peut-être un jour où le lion atteindra le renard d'un coup de griffe bien ajusté, et la lutte sera terminée. En attendant, une partie des socialistes, spécialement les réformistes, s'en remettent encore à la pitié de leurs veules adversaires, et invoquent les circonstances atténuantes. Ils disent que les révoltes sont occasionnées par la misère, que les révoltés sont doux comme des agneaux, et que si parfois ils usent de la violence, ils y sont entraînés malgré eux par les provocations du gouvernement, de la force publique, de la bourgeoisie. D'une façon générale, la force d'un gouvernement ou d'un parti d'opposition est en rapport avec les dérivations qu'il emploie ; de telle sorte que celles-ci peuvent souvent servir à évaluer celle-là. Là où la force est plus grande, moindre est l'appel à la pitié des adversaires ou des indifférents, et vice versa. Le Gouvernement se déroba devant la violence de la place ; il se déroba de nouveau devant la violence d'une minorité restreinte au Parlement. Le ministre Salandra avait fait siennes les mesures fiscales déjà proposées par Giolitti. Grâce à l'obstruction, une trentaine de députés socialistes tint en échec une majorité de plus de quatre cents députés. Les premiers étaient soutenus par le courage et par un idéal ; les seconds se préoccupaient surtout des affaires de leurs clients. Le Gouvernement dut entrer en composition avec la poignée d'hommes qui faisait l'obstruction. Le traité de paix fut favorable aux deux camps. Les spéculateurs, représentés par le Gouvernement, obtenaient de pouvoir établir temporairement les impôts : c'était tout ce qui leur importait ; ils ne se souciaient guère du reste. La minorité socialiste obtenait le grand avantage de prouver sa force, et de montrer que, sans sa bonne volonté, on ne pouvait pas gouverner.
[FN: § 2480-2]
La faiblesse du Gouvernement, qui n'ose pas maintenir en prison les suffragettes qui jeûnent, est la cause principale de la persistance de leur rébellion. Lorsque se produisirent, en Italie, les troubles de juin 1914, les journaux anglais se mirent en quête de motifs plus ou moins fantaisistes pour les expliquer. Ils n'avaient qu'à regarder autour d'eux. La cause principale des mouvements insurrectionnels en Italie est tout à fait identique à celle du mouvement rebelle des suffragettes en Angleterre. On n'observe pas des faits semblables en Allemagne, parce que là où la cause fait défaut, l'effet disparaît aussi.
[FN: § 2480-3]
Le 7 juin 1914, à Ancône, quelques personnes sortaient d'un comité privé, substitué à une réunion publique interdite par la questure. La police voulut les empêcher de se rendre à la Piazza Roma, où jouait la musique. Il s’en suivit une bagarre dans laquelle, parmi les manifestants, il y eut trois morts et cinq blessés ; parmi les gendarmes, dix-sept blessés. Ce fut le point de départ d'une série de mouvements insurrectionnels, dans lesquels il y eut plusieurs morts et de nombreux blessés. Le Gouvernement ne sut et ne voulut pas les réprimer. Par conséquent, il. s'opposa à une promenade qui pouvait être inoffensive, ou tout au plus occasionner quelques désordres ; et il ne s'opposa pas efficacement à des actes de véritable rébellion à main armée. Il se montra fort, lorsqu'il se trouva en présence d'adversaires faibles, et faible, lorsqu'il rencontra des adversaires forts. Le ministre Salandra dit à la Chambre, le 9 juin, qu'il avait interdit la réunion d'Ancône parce que « l'intention d'inciter les soldats à manquer à leur devoir était manifeste, ainsi que le dessein d'exciter le peuple au mépris de l'armée. La coïncidence du jour choisi pour les réunions avec la fête solennelle du Statut, révélait le dessein de troubler les fêtes civiles et militaires qui sont célébrées à cette occasion ». Le ministre opposa donc la force des armes à ceux qui voulaient offenser l'armée par des paroles. Il permit qu'impunément des officiers fussent frappés, désarmés, et même qu'un général fût fait prisonnier sans qu'on fit usage des armes. Il faut croire que l'offense des paroles qu'on prévoyait, offensait l'armée plus que les actes effectivement commis. Le ministre interdit que « l'on troublât les fêtes civiles et militaires » ; il permit que l'on saccageât et que l'on incendiât impunément des édifices publics. Il faut croire que le fait de « troubler » une fête est un plus grand crime que le sac et l'incendie.
[FN: § 2480-4]
Le Corriere della Sera, 13 juin 1914, disait très justement : « Et alors il nous reste à demander si cette lâcheté bourgeoise est un moyen, un système, une ressource, une tactique, ou seulement une humiliante disposition à laisser les destins de l'Italie sous la coupe d'une infime minorité [elle n'est pas beaucoup plus petite que celle qui gouverne] rendue très forte par son audace et par la balourdise innée de ses adversaires [en réalité on devrait dire : par l'artifice dont ils usent pour gouverner par la ruse, en évitant de recourir à la force]. Devons-nous vraiment admettre, pour essayer d'apaiser les clameurs des députés socialistes, que la présence de la force publique dans les lieux qu'envahit la foule enivrée par les orateurs des réunions populaires, soit une provocation ? Que ce soit une provocation d'exposer des agents et des soldats durant trois ou quatre jours aux sifflets, aux insultes, aux lapidations ? [Oui, tout cela doit être admis par qui n'est pas disposé à recourir à l'usage de la force, laquelle est l’ultima ratio pour décider des luttes]. Voyons la preuve. La force publique était très peu considérable en Romagne. Eh bien, durant trois jours (et il paraît que le spectacle n'a pas encore cessé), la criminalité a régné en maîtresse [c'est là l'exagération habituelle consistant à appeler criminels ses adversaires ; en réalité, dans toute révolution, y compris celles que fit la bourgeoisie italienne contre les gouvernements passés, il surgit des criminels qui cherchent à pêcher en eau trouble]. On a fendu le crâne à un commissaire qui parlementait, qui voulait recommander le calme. On s’est acharné sur ceux qui étaient tombés. On a mis le feu à des églises monumentales [dans les révolutions, comme dans les guerres, on endommage les monuments]… Un général et deux officiers ont été – disons le mot – faits prisonniers [ces faits n'arrivent pas en Prusse ; pourquoi ? Parce qu'il y a un gouvernement différent de ceux qui existent en Italie et en France. Il n'y a pas de raison pour que les révoltés s'abstiennent de faire prisonniers leurs adversaires]. On a fait largement usage des revolvers, en outre des traditionnels poignards [mais avec quoi doit-on faire la guerre, si ce n'est avec les armes ?]. C'est là pour les hymnes socialistes un sujet de gloire. À leur point de vue, ils ont raison [observation très juste, qui suffit à elle seule à donner un caractère de réalité à l'article] : qui veut la fin veut les moyens, et les révolutions ne se déchaînent pas en Arcadie [mais en Arcadie, on écrit des circulaires comme celle du ministre Salandra, citée au § 2280-1]. Seulement, quand il s'agit, en particulier, d'établir qui a tiré, ce n'est jamais le manifestant qui a frappé. Cela aussi est naturel. Le héros révolutionnaire alterne avec l'avocat retors [tandis que chez les adversaires, il y a seulement l'«avocat retors » et que le héros fait défaut]. Mais pourquoi devons-nous instituer en Arcadie la défense de notre existence ?... Sachons bien qu'on ne peut prononcer de semblables paroles sans entendre les adversaires, surtout ce parti de la bourgeoisie qui veut faire son petit commerce [et aussi les spéculations moyennes, grandes, très grandes] jusque dans les crises les plus douloureuses de la patrie et ultra, parler de réaction, de captation, de nostalgie de 98, et ainsi de suite ». Il paraît que le « parti de la bourgeoisie » a été de nouveau entendu, car, deux jours après, le même journal fait volte-face et justifie la faiblesse du Gouvernement. – Corriere della Sera, 15 juin 1914 : « L'honorable Salandra n'a pas contesté que, par des mesures plus énergiques, on aurait évité certaines violences révolutionnaires. „ On cherche, en Romagne, a-t-il dit à la Chambre – à rétablir l'ordre avec la plus grande prudence. Nos collègues comprennent qu'il serait facile de le rétablir violemment. Mais si les mesures du Gouvernement n'ont pas obtenu un effet immédiat, on le doit précisément à la prudence avec laquelle la force est employée “... Ici, la ligne de conduite de l'honorable Salandra apparaît clairement. Il a voulu éviter à tout prix de répandre du sang [pour cette fois, cela a réussi, mais il est certain qu'à la longue, la ligne de conduite indiquée est celle qui conduit à la défaite, à la destruction] ». Le journal examine quelles auraient été les conséquences d'une répression énergique : « Aurions-nous évité une grève générale beaucoup plus longue, plus générale, plus violente que celle que nous avons surmontée ? [précisément ce qu'il importait d'épargner à la bourgeoisie qui veut faire son petit commerce, et à laquelle on fait allusion dans le premier article.] Aurions-nous évité une grève des chemineaux beaucoup plus étendue, plus intense, et plus désastreuse pour l'économie nationale [et pour celle des spéculateurs] que celle qui a eu lieu ? » Ce sont là les raisons habituelles de ceux qui veulent s'arrêter à mi-chemin, et qui craignent, comme le plus grand malheur, de devoir aller jusqu'au bout. C'est ainsi que raisonne toujours le renard, mais non le lion ; et c'est le principal motif pour lequel le lion finit par tuer le renard. Le journal termine par une approbation pleine et entière de l'œuvre de Salandra. Il a raison, si on considère que le but suprême du gouvernement est de protéger l'ordre de la production économique sans se soucier d'autre chose. Mais il ne faut pas oublier quelles sont, dans d'autres domaines, les conséquences de cette œuvre. Elles sont bien exposées par le Giornale d'Italia, 16 juin 1914 : « Le but a été une révolution politique, une véritable révolution, et, ce qui est plus grave, une révolution qui a réussi pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, et non sans quelque ridicule. En effet, on peut appeler réussi ce mouvement qui bouleverse et met sens dessus dessous villes et campagnes, qui veut changer la forme de gouvernement, qui efface et annihile l'autorité existante, et y substitue une autorité de fortune dans le commandement et dans le symbole extérieur. Ajoutons que cela a été prémédité, et non sans une certaine science technique. Elle commença par l'isolement de chaque ville ou village, par la destruction des moyens de transport ferroviaire des troupes, par l'interruption des téléphones et des télégraphes. On réussit ainsi à créer le terrain apte à la propagation des plus fausses et des plus absurdes nouvelles. L'assaut des armureries, l'invasion des marchés, la séquestration des automobiles et la confiscation de la benzine complétaient l’exploit révolutionnaire. La composition des comités exécutifs particuliers, tous choisis avec représentation simultanée d'un républicain, d'un socialiste, d'un syndicaliste, d'un anarchiste, dit l'accord concerté des groupes subversifs. La force publique était paralysée, peu nombreuse, prise à l'improviste, contrainte de laisser passer la tourmente, obligée de livrer les culasses des fusils et de se confiner dans les casernes. Aussi la révolution triomphante a-t-elle pu aussitôt abattre les armoiries royales, hisser des drapeaux rouges, interdire la circulation à qui n’avait pas le visa du Comité révolutionnaire, confisquer des denrées, élaborer des listes de gens désignés pour verser des contributions en argent ou en nature, fermer des églises, brûler des gares et des bureaux d'octroi, et, en certains lieux, recruter même une espèce de garde nationale révolutionnaire, milice embryonnaire du nouvel état de choses ». Cette fois, ce ne fut qu'une tentative de révolution. Une autre fois, cela pourra être une révolution complète ; et peut-être sera-t-elle utile au pays. Le journal continue en remarquant qu'on ne doit pas, comme certains l'ont fait, négliger de prendre au sérieux ces faits : « Songez quel grand dommage représente pour notre vie nationale cette parenthèse rouge, cette tourmente de folie qui, pendant quelques jours, a tenu différentes cités de l'Italie centrale dans un enfer, et les a séparées du monde. Et quelle stupeur, que de débordements, que d'équivoques, fruits d'une longue période de transactions, de compromis et de dissolution, qui ont mortifié, avili, ralenti tous les organes du gouvernement ! Nous avons soif d'ordre, et l'ordre est au contraire représenté comme étant la réaction, et cela non seulement par les subversifs. Nous invoquons la protection raisonnable de la liberté pour tous de la part de la force publique, et la présence des soldats est au contraire représentée par des tribuns rhéteurs comme une provocation ! On se met à l'abri, hésitant et tremblant, tandis que cet abri apparaît urgent et sûr ; de telle sorte qu'il semble presque que dans les conditions où ont été réduits – depuis nombre d'années – le prestige de la loi et l'autorité de l'État, ce qui paraît une prudence superflue est désormais une inéluctable nécessité. Par conséquent, le tort moral, le coup violent porté à l'esprit public, la banqueroute de toute confiance en l'autorité de l'État, sont non moins ruineux que les dommages matériels, dont peu à peu les traces apparaîtraient dans quelques jours... Aujourd'hui, on n'attend pas l'injonction de la loi, mais celle des comités, des ligues, des fédérations, des chambres de travail, des syndicats. En somme, lorsque nous entendons des députés se féliciter à la Chambre de l'ordre rétabli – nous ne savons par quel éminent comité de salut public – parce que le mouvement subversif cesse, et que le pays rentre dans l'ordre, involontairement se fait jour dans notre esprit la conviction que, par une dégénérescence fatale, aujourd'hui, au-dessus du pouvoir exécutif, au-dessus du pouvoir législatif, nous avons laissé prendre racine à un pouvoir impératif supérieur de la démagogie, qui est le suprême arbitre des destinées nationales ». Depuis que le monde existe, ce sont toujours les forts et les courageux qui commandent, les faibles et les lâches qui obéissent ; et, comme d'habitude, il est utile à la nation qu'il en soit ainsi. « Maintenant, quelles sont les conséquences de cette nouvelle façon de considérer le néo-droit constitutionnel italien ? Les populations des Marches et de la Romagne le savent, elles sur qui s'est faite, dans ces jours, l'expérience pratique des finalités subversives. Si nous réfléchissons que les difficultés fiscales et internationales exigeront bientôt du pays des preuves amères de sacrifice et d'abnégation, nous sommes amenés à douter que l'on surmonte ces difficultés si, en même temps, on ne restaure pas le prestige de l'État, en renforçant le principe d'autorité, et en préférant le rétablissement de la loi, simplement de la loi, à une popularité artificieuse qui a été, pendant tant d'années, le porro unum, ministériel ». Mais cela est absolument impossible, si l'on ne veut pas faire usage de la force. Faire respecter la loi sans faire usage des armes contre qui veut la violer est un rêve humanitaire qui ne correspond à rien dans le monde réel. Les difficultés fiscales auxquelles on fait allusion sont dues en grande partie au gouvernement des « spéculateurs », qui extorquent autant d'argent que possible. Ils sont passés maîtres en fait d'astuce, mais il leur manque la volonté et le courage de se défendre par la force.
[FN: § 2480-5]
S'ils se souciaient de l'avenir, ils trouveraient facilement dans l'histoire où aboutissent de semblables voies. À la longue, les agents d'un gouvernement, ses troupes, se lassent d'être toujours sacrifiés. C'est pourquoi ils le défendent mollement ou même ne le défendent plus du tout. Parfois une partie d'entre eux trouve avantageux de se tourner contre lui et de s'unir à ses adversaires. Telle est la manière dont se sont produites un grand nombre de révolutions, et telle pourrait être aussi la manière dont prendrait fin la domination de la classe gouvernante qui règne aujourd'hui dans presque tous les pays civilisés. Mais comme cela n'arrivera certainement pas de sitôt, nos « spéculateurs » s'en soucient peu ou point ; de même que celui qui spécule à la Bourse se préoccupe bien de la prochaine liquidation, et tout au plus de quelques autres qui suivront ; mais il se soucie peu ou point des prix qui se pratiqueront en bourse dans plusieurs années.
[FN: § 2480-6]
Pour comprendre comment l'humanitarisme et la lâcheté des gouvernants peuvent paralyser la force d'une armée, considérons les faits suivants, qui eurent lieu en Italie, au mois de juin 1914. Corriere della Sera, 11 juin : « Gênes, 10 juin... Une colonne de syndicalistes et de grévistes a désarmé hier un lieutenant et un capitaine d'infanterie ». – Même journal, 13 juin : « Parme, 12 juin. Voici comment l'autorité raconte les faits qui se sont passés hier soir. Trois sous-lieutenants de l'École d'application revenaient, vers neuf heures du soir, d'accompagner un de leurs camarades chez lui,... lorsqu'ils furent en butte à des insultes, à des coups de pierres et de revolver. Les trois sous-lieutenants firent volte-face pour réagir, mais un nombre assez fort de jeunes gens les suivait. Aussi estimèrent-ils prudent (sic) de continuer jusqu'à la place Garibaldi, où ils racontèrent à leurs camarades, réunis en cet endroit, ce qui leur était arrivé ». Suivent différentes péripéties qu'il est inutile de rapporter « ... ils furent accueillis à coups de pierres et de feu, auxquels ils répondirent par des décharges en l'air ». Celles-ci, naturellement, n'étaient pas prises au sérieux. Arriva la troupe, et, comme d'habitude, elle tire en l'air, ce qui ne produit aucun effet : « La troupe et les agents avançaient, recevant toujours des insultes, des coups de revolver... ». La règle était précisément que soldats et gendarmes ne devaient pas faire usage de leurs armes, et que, lorsqu'ils étaient contraints d'y recourir, ils devaient tirer en l'air. En plusieurs endroits, ils perdirent patience, et comme il leur était défendu de faire usage de leurs armes, ils ramassèrent les pierres qu'on leur avait jetées et les renvoyèrent à leurs agresseurs. À ce qu'il paraît, ce duel à armes égales n'est pas interdit. Au Sénat, le sénateur Garofalo observa que « en Italie, l'usage s'est désormais implanté de laisser la troupe sans défense contre la violence des malfaiteurs » ; et le sénateur Santini dit que « lorsqu'on doit donner pour consigne à l'armée de se faire malmener et de s'exposer aux insultes... il vaut mieux la laisser dans ses casernes » (Corriere della Sera, 11 juin). Mais, à la Chambre, aucun député n'osa parler dans ce sens. Au contraire, un député conservateur – notez bien ce caractère – raconta divers épisodes dans lesquels les soldats avaient fait preuve d'une patience vraiment angélique. Il ajouta : « On a parlé des officiers ; eh bien, j'ai entendu raconter par un lieutenant qu'il avait été couvert de crachats, et était demeuré le revolver au poing, tandis que le sang lui montait à la tête ». À l'ouïe de ce récit, d'autres députés conservateurs crient : « Ce sont des héros ». Il conclut : « Ces pauvres soldats ont été admirables de longanimité, d'altruisme et d'esprit de sacrifice ». Tous les auditeurs présents, y compris les ministres, applaudissent. Il n'y a pas d'exemple d'une scène même très vaguement semblable au Reichstag allemand. Aucun ministre de la guerre, en Allemagne, n'aurait toléré de semblables louanges, bonnes pour des ascètes ou pour des moines, mais qui constituent des offenses, quand elles sont adressées à des officiers et à des soldats. Cette différence entre le gouvernement italien et le gouvernement allemand dépend surtout du fait que les « spéculateurs » ont beaucoup plus de pouvoir dans le premier que dans le second. Le cas du général Agliardi est très connu. Voici comment le raconta au Sénat le ministre de la guerre, répondant à une interpellation. Giornale d'Italia, le 12 juin 1914 : « Le général Agliardi et les officiers qui étaient avec lui se rendaient, le matin du 11, de Ravenne à Servia pour une manœuvre avec les cadres (manœuvre qui, étant données les circonstances, aurait dû être suspendue, et dont nous ne supportons pas la responsabilité). Ils furent gardés pendant cinq heures en otage, et ce qui est pis, le général et les autres officiers livrèrent leurs sabres à ceux qui les avaient faits prisonniers ». Il faut remarquer que le général Agliardi avait fait preuve de valeur à la guerre, ce qui exclut qu'il ait déposé les armes par manque de courage. Il fut mis en disponibilité. S'il s'était défendu à main armée contre ses agresseurs, il aurait facilement pu en tuer quelques-uns ; et, en ce cas, il eût été encore plus puni ; en sorte qu'il ne pouvait échapper en aucune manière à l'infortune qui le menaçait. Il semble qu'il y ait quelque contradiction chez un gouvernement qui ne veut pas qu’on fasse usage de ses armes contre ses agresseurs, et qui ne veut pas non plus qu'on les leur livre ; pourtant, l'unique moyen de ne pas les livrer est de s'en servir. Mais en somme, la contradiction disparaît, lorsqu'on remarque que le seul but du gouvernement est de vivre en paix, et qu'à ce but il sacrifie tout. Le ministre de la guerre répondit à l'interpellation qui lui avait été faite au Sénat sur le cas du général Agliardi, parce qu'il savait que, dans cette assemblée, il ne risquait pas de vifs débats. Le ministre Salandra ne voulut pas qu'on répondît, à la Chambre, à une interpellation analogue, parce qu'il craignait précisément ces vifs débats.
[FN: § 2480-7]
Il Se manifeste déjà quelques signes à peine perceptibles, qui montrent que plusieurs de ces défenseurs commencent à vouloir se soustraire à ces inconvénients. Dans le Giornale d'Italia, 15 juin 1914, MARIO MISSIROLI écrit : « Cet épisode [du général Agliardi] m'en rappelle un autre analogue. Il y a un an, durant la grève des fonderies de Imola, les grévistes furent remplacés par des travailleurs libres, qui devaient être protégés et défendus par les soldats. Ceux-ci, pour remplir leur devoir, ne trouvèrent rien de mieux à faire que de conseiller aux travailleurs libres de s'en aller, en les menaçant pendant la nuit, pour le cas où ils refuseraient. Les travailleurs libres s'en allèrent. Aujourd'hui il arrive souvent, dans les cas de grève générale, que les agents de police conseillent, forcent les commerçants à obéir aux grévistes et à fermer leurs magasins ».
[FN: § 2484-1]
En fait de signe précurseur, on remarquera la facilité avec laquelle la menace de violence dans l'Ulster tint en échec la ploutocratie démagogique anglaise, en 1914. On remarquera aussi, comme un phénomène beaucoup moins important mais cependant appréciable, que la violence des suffragettes eut pour effet qu'on leur permit d'incendier impunément des édifices, et de causer ainsi des dommages de plusieurs millions de livres sterling. En Italie, la violence des ouvriers romagnols s'imposa au gouvernement, et leur permit de constituer un État dans l'État, avec ses lois propres, mieux obéies que celles du gouvernement. Ajoutons l'exemple des troubles de Romagne, en juin 1914 (§ 2480).
[FN: § 2491-1]
PLUTARCH. ; Lycurg., 28.
[FN: § 2491-2]
SHŒMANN ; Ant. grec., I, p. 230 « ... Ces embuscades ![]() étaient dirigées surtout contre les Hilotes, et plus d'une fois sans doute il arriva que l'on fit disparaître, sans forme de procès, ceux dont on redoutait les complots. Ces patrouilles donnèrent à des écrivains postérieurs occasion de dire que tous les ans on organisait une chasse aux Hilotes ou que l'on en faisait une boucherie, exagération trop absurde pour mériter d'être contredite ». – Dict. DAREMBERG, s. r.
étaient dirigées surtout contre les Hilotes, et plus d'une fois sans doute il arriva que l'on fit disparaître, sans forme de procès, ceux dont on redoutait les complots. Ces patrouilles donnèrent à des écrivains postérieurs occasion de dire que tous les ans on organisait une chasse aux Hilotes ou que l'on en faisait une boucherie, exagération trop absurde pour mériter d'être contredite ». – Dict. DAREMBERG, s. r. ![]() (P. GIRARD) : « ... Qu'en même temps elle ait été un service de police destiné à maintenir l'ordre en Laconie, qu'en leur qualité de surveillants et de gardiens du territoire, les jeunes gens chargés de ce service aient eu fréquemment affaire aux hilotes et se soient montrés, dans certaines circonstances, particulièrement sévères et même cruels à leur égard, c'est ce qui est très vraisemblable ».
(P. GIRARD) : « ... Qu'en même temps elle ait été un service de police destiné à maintenir l'ordre en Laconie, qu'en leur qualité de surveillants et de gardiens du territoire, les jeunes gens chargés de ce service aient eu fréquemment affaire aux hilotes et se soient montrés, dans certaines circonstances, particulièrement sévères et même cruels à leur égard, c'est ce qui est très vraisemblable ».
[FN: § 2491-3]
THUC. ; IV, 80 : « (3) ... On prit toujours chez les Lacédémoniens des mesures pour se mettre à couvert de l'hostilité des Ilotes. Alors les Lacédémoniens proclamèrent que, parmi les Ilotes, ceux qui estimaient avoir été valeureux dans les combats eussent à se séparer des autres, pour recevoir la liberté. Les Lacédémoniens visaient ainsi à les découvrir et à connaître leurs sentiments, car ils jugeaient que ceux qui se croyaient dignes de recevoir les premiers la liberté auraient été aussi les mieux disposés à les attaquer. (4) Deux mille Ilotes ayant été ainsi rassemblés, ils les menèrent, couronnés comme des affranchis, autour des temples ; mais, après peu de temps, ils les firent disparaître, et personne ne sut de quelle manière on les avait détruits ». –DIOD ; XII, 67, 4 : ![]()
![]() « Deux mille s'étant inscrits, il fut prescrit aux plus puissants [citoyens] de les tuer, chacun dans sa maison ». Si les Spartiates avaient été humanitaires, comme l'aristocratie française de la fin du XVIIIe siècle, c'eût été les Ilotes qui eussent tué les Spartiates.
« Deux mille s'étant inscrits, il fut prescrit aux plus puissants [citoyens] de les tuer, chacun dans sa maison ». Si les Spartiates avaient été humanitaires, comme l'aristocratie française de la fin du XVIIIe siècle, c'eût été les Ilotes qui eussent tué les Spartiates.
[FN: § 2493-1]
THUCYD., VIII, 40.
[FN: § 2493-2]
ATHEN. ; VI, p. 265.
[FN: § 2493-3]
ATHEN ; VI, p. 267. De là vint, dit-on, le proverbe : ![]() : « Chio acheta le maître ».
: « Chio acheta le maître ».
[FN: § 2494-1]
ARISTOT. ; Po1it ., II, 6, 12 : ![]() ... « On dit... » La prévoyance supposée de parer au danger d'une trop grande réduction du nombre des Spartiates est suspecte. Elle a probablement été imaginée après que le fait se fut produit ; mais cela n'enlève rien à la probabilité des mesures ainsi expliquées.
... « On dit... » La prévoyance supposée de parer au danger d'une trop grande réduction du nombre des Spartiates est suspecte. Elle a probablement été imaginée après que le fait se fut produit ; mais cela n'enlève rien à la probabilité des mesures ainsi expliquées.
[FN: § 2494-2]
STRAB. ; VIII, 5, 4, p. 364. Après une lacune, vient le passage : ... ![]()
![]()
![]()
![]()
[FN: § 2495-1]
HÉROD. ; IX, 35 : Suivant Platon (De leg., I, p. 629), Tyrtée aussi aurait reçu le droit de cité spartiate. Il importe peu qu'il en soit vraiment ainsi. Il nous suffit de constater que l'octroi du droit de cité était une chose tout à fait exceptionnelle. Il s'agit ici uniquement des étrangers.
[FN: § 2495-2]
SCHŒMANN, Ant. grecq., t. I, décrit bien les faits : « (p. 244) Il est dit expressément, et nous devons admettre, qu'au début les Spartiates accueillirent volontiers dans leurs rangs les étrangers qu'ils rencontraient en Laconie, c'est-à-dire des Achéens... Ce fut seulement après avoir affermi leur autorité qu'ils se laissèrent gouverner par un esprit plus exclusif. Le droit de bourgeoisie, qui créait une classe à part en face du reste de la population, fut dès lors si rarement concédé qu'Hérodote cite comme le seul exemple (p. 245) connu la naturalisation de deux Éléens (§ 2495-1) ...Il n'est pas présumable que les Spartiates en aient usé plus libéralement dans les temps qui suivirent la mort d'Hérodote. On a vu que le droit de Cité avait été, refusé aux Néodamodes. Les Mothaques qui l'obtinrent quelquefois étaient des fils de Spartiates légitimés par leurs pères, et n'auraient pas obtenu cet honneur, s'ils s'étaient bornés à le mériter par leur conduite, sans justifier de ressources suffisantes. Il paraît que dans un temps où l'éducation était fort négligée ailleurs, des étrangers faisaient élever leurs enfants à Sparte. Quelques-uns de ces jeunes gens purent être admis plus tard dans les rangs de la bourgeoisie, mais il fallait qu'ils s'en fussent montrés dignes, et encore pour ceux qui n'avaient pas trouvé moyen de prendre racine à Sparte et d'y acquérir des biens-fonds, ce n'était là qu'un honneur stérile qui ne leur assurait pas l'exercice des droits essentiels ». Au contraire, CURTIUS, Hist. grecq., t. I, va manifestement un peu au delà de la réalité, quand il écrit : « (p. 231) D'autre part, le législateur de Sparte avait sagement pourvu à ce que la communauté spartiate pût se compléter avec des recrues d'un autre sang et des forces fraîches [il est certain que cela n'est pas arrivé, puisque aux temps historiques, il est indéniable que le nombre des Spartiates va toujours en diminuant] ; car il pouvait se faire que même des individus qui ne provenaient pas d'un mariage purement dorien, des enfants de périèques ou d'hilotes, s'ils avaient fait consciencieusement jusqu'au bout leur éducation militaire, fussent admis dans la communauté dorienne et mis en possession des lots vacants. Mais il fallait pour cela le consentement des rois ; c'est devant eux qu'avait lieu l'adoption solennelle du récipiendaire par un Dorien (p. 232) pourvu de son majorat. C'est ainsi que l'État recrutait de nouveaux citoyens [bien peu, en tout cas], et c'est à cette institution que Sparte dut une bonne partie de ses plus grands hommes d'État et de ses meilleurs généraux. Ainsi, c'était l'éducation, la discipline qui faisaient le Spartiate, et non le sang des aïeux ». Comme preuve, l'auteur cite PLUTARCH. Inst. Lacon., 22, et XENOPH., Hellen., V, 3, 9. Mais vraiment ces textes ne prouvent pas grand' chose. Plutarque parle de temps légendaire et n'est pas trop affirmatif non plus. ![]()
![]() .« Certains disent que, celui des étrangers qui consentait à vivre selon l’usage de la cité était mis à part de la répartition originaire du territoire, par une loi de Lycurgue ». – XENOPH., Hell., V, 3, 9, raconte comment Agésilopolis fut envoyé contre Olynthe avec trente Spartiates auxquels s'unirent volontairement des métèques et des bâtards
.« Certains disent que, celui des étrangers qui consentait à vivre selon l’usage de la cité était mis à part de la répartition originaire du territoire, par une loi de Lycurgue ». – XENOPH., Hell., V, 3, 9, raconte comment Agésilopolis fut envoyé contre Olynthe avec trente Spartiates auxquels s'unirent volontairement des métèques et des bâtards ![]() de caractère remarquable et n'ignorant pas la discipline spartiate. Le fait que l'auteur les nomme à part des Spartiates, suffit pour montrer qu'ils n’avaient pas tous les droits de ceux-ci.
de caractère remarquable et n'ignorant pas la discipline spartiate. Le fait que l'auteur les nomme à part des Spartiates, suffit pour montrer qu'ils n’avaient pas tous les droits de ceux-ci.
[FN: § 2495-3]
À propos de la tentative de révolte d'Agis, DROYSEN, Hist. de l'hellén., III, note : « (p. 407) La démocratie, la tyrannie, la domination étrangère, la révolution n'ont pas à Sparte, comme dans la plupart des autres États, balayé un amas confus d'organismes irrationnels, n’ayant qu'une valeur de fait, et laissé le champ libre pour une poussée nouvelle ». En somme, c'est le défaut de circulation des élites. – En l'an 227 av. J.-C., le coup d'État de Cléomène eut un meilleur sort, parce qu'il était fait en partie avec la force des mercenaires. Mais le nouvel ordre de choses dura peu, et en l'an 221 av. J.-C., Antigone rétablit le pouvoir de l'oligarchie à Sparte. Cléomène supprima les fonctions des éphores, excepté une seule qu'il garda pour lui (PLUTARCH. ; Cleom., 10). Ce fait ressemble à celui des empereurs romains, qui gardèrent pour eux-mêmes la tribunicia polestas. Dans les deux cas, on tint compte de l'intensité de la persistance des agrégats chez le peuple.
[FN: § 2496-1]
XENOPH. ; Laced. reip., X, 7 : ![]()
![]() .
.
[FN: § 2497-1]
ARIST. ; Polit., III, 7, 4.
[FN: § 2498-1]
CICER. ; Tusc ., II, 14, 34 : Spartae vero pueri ad aram sic verberibus accipiuntur, ut multus e visceribus sanguis exeat ; nonnumquam etiam, ut, cum ibi essem, audiebam, ad necem : quorum non modo nemo exclamavit unquam, sed ne ingemuit quidem. – Voilà la déposition d'un témoin du fait. Au temps de Cicéron, l'indépendance de Sparte n'existait plus, et l'on y conservait encore cet usage.
[FN: § 2500-1]
VETTOR SANDI ; Principj di Storia Civile della Repubblica di Venezia, 2e partie, vol. I, liv. V : « (p. 1) Ce livre comprendra un siècle entier : siècle important au point de vue de la police intérieure, beaucoup plus que dans les actions accomplies à l'extérieur... Et en effet : quelle question de gouvernement plus grave que l'établissement d'une aristocratie d'essence héréditaire par descendance mâle, dont l'existence soit perpétuée, et qui maintienne pure la Noblesse Dominante ? « (p. 5) Donc, le fait qu'en cette année le Conseil Majeur s'était renouvelé pour presque cinquante ans – on l'a déjà écrit – avait donné l'occasion d'en méditer une réforme. Mais ces méditations se prolongèrent jusque vers l'an 1286. On comprit alors finalement que l'on ne pouvait se mettre plus sagement à l'abri de la cabale, des factions, des autres mésaventures civiles, qu'en formant un premier Conseil toujours fixe de citoyens d'entre les plus qualifiés, et en nombre si grand que, sans rien ôter ou changer par un excès de nombre au dessein primitif d'avoir un gouvernement aristocratique, on satisfit aux vœux communs des gens de l'époque ; de telle sorte qu'ainsi formé, ce gouvernement fût sûr, stable et permanent. Pour l'obtenir, il ne pouvait y avoir de moyen plus sûr et plus pacifique que de le faire passer pour un caractère et une essence primitive chez les descendants légitimes des premiers nobles en ligne masculine, par succession perpétuelle ». « (p. 10) ...Quand enfin, au dernier jour de février de l'année vénitienne, le doge proposa la célèbre loi de 1296, qu'on appela vulgairement et par tradition la serrata del Consiglio maggiore, à laquelle la République doit en effet sa durée... »
[FN: § 2502-1]
Cette force provint exclusivement de l'extérieur pour la République de Venise, et en partie des mercenaires de Cléomène pour la République de Sparte. – POLYBE (IV, 41) remarque très justement : « (12) Ainsi donc, après la législation de Lycurgue, les Lacédémoniens eurent une excellente république et une très grande puissance, jusqu'à la bataille de Leuctres. Depuis que la fortune leur fut défavorable, leur république alla toujours de mal en pis (13). Enfin de nombreux troubles et des séditions civiles les frappèrent ; ils furent soumis à de nombreuses répartitions nouvelles de terres et à des exils, ils subirent des servitudes très dures, jusqu'à la tyrannie de Nabis... ».
[FN: § 2503-1]
MALAMANI ; La satira del costume a Venezia, nel secolo XVIII . Comme presque tous les historiens modernes, notre auteur confond l'énergie d'une classe sociale avec sa morale et, qui pis est, avec sa morale sexuelle, jugée selon les idées chrétiennes. Mais il est facile d'écarter cette erreur, et il reste de bonnes observations.
[FN: § 2505-1]
PIETRO GIUSTINANO ; Dell' historie venetiane : « (p. 668) Et dans la première rencontre [de la bataille de Lépante], les grosses galères des Vénitiens se lancèrent courageusement contre les ennemis. Grâce à leur valeur, la voie fut ouverte à la victoire des chrétiens ; en sorte que les galères des ennemis, s'avançant, serrées les unes contre les autres, pour attaquer les nôtres, furent de cette manière fracassées et détruites par les coups des artilleries des grosses galères, qui tiraient de terribles canonnades. Mis en déroute, les Barbares de ce côté prirent presque la fuite, car, voyant les dégâts que faisaient à elles seules six galères, ils s'en allaient, se figurant ce que pouvaient faire les autres, chose que les Turcs ne s'étaient jamais imaginée ». « (p. 672) Mais, parmi tous les capitaines de la flotte vénitienne... seul, Francesco Duodo, capitaine des grosses galères, obtint une louange unique et singulière... parce qu'avec les artilleries (comme je l'ai dit plus haut), il avait rompu la formation des Turcs. Cela contribua grandement à la victoire, ainsi qu’en font foi les patentes que lui firent Don Juan d'Autriche et Marc Antonio Colonna… ». L'auteur remarque ensuite que, pour réparer les navires « (p. 678) on envoya de Venise à Pola, où les dites grosses galères avaient été mises à sec, de nombreux maîtres de l'Arsenal, pour les radouber, en sorte que celles-ci ont une grande force en mer. Les vieux Vénitiens furent les inventeurs de ces machines navales, eux qui avaient une très grande pratique de la mer et de l'invention de vaisseaux maritimes. Les Vénitiens dépassèrent toutes les nations étrangères ».
[FN: § 2505-2]
P. DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. V, p. 216 : « À cette époque les forces de la république consistaient en huit ou dix vaisseaux de ligne, quelques frégates et quatre galères, qui tenaient la mer, et dans une vingtaine de bâtiments en construction ; mais ces bâtiments on ne les achevait jamais. Lorsque les Français entrèrent dans Venise, en 1797, ils trouvèrent sur les chantiers treize vaisseaux et sept frégates ; il n'y avait pas de matériaux suffisants pour les terminer, et de ces treize vaisseaux, deux étaient commencé depuis 1752, deux depuis 1743, deux enfin depuis 1732, c'est-à-dire qu'avant d'être en état de sortir du chantier ils avaient déjà soixante-cinq ans. Cet appareil de constructions navales n'était qu'un moyen d'entretenir l'illusion : ces vaisseaux étaient d'un faible échantillon ; ils ne portaient que du canon de (p. 217) vingt-quatre à leur batterie basse ; ils ne pouvaient sortir du port avec leur artillerie ; on était obligé de les armer dehors. Les officiers n'avaient eu depuis longtemps aucune occasion d'acquérir de l'expérience, et une marine marchande qui n'occupait que quatre ou cinq cents vaisseaux ne pouvait fournir des marins pour armer une escadre formidable ».
[FN: § 2506-1]
M. MACCHI ; Storia del Consiglio dei Dieci, t. IV : « (p. 30) Malgré tant de précautions, la bulle d'excommunication arriva à Venise par la voie de Mantoue. Il convient pourtant de dire que le patriarche Maffeo Gerardo, obéissant aux ordres du gouvernement, envoya au Conseil des Dix le message encore fermé et cacheté. Comme lui, le plus grand nombre des prêtres fit acte d'obéissance au gouvernement, et le petit nombre de ceux qui se crurent obligés par leur conscience de se soumettre aux ordres du pape furent bannis [en note : „ Le pape envoya cette bulle à Don Maffeo Girardo, patriarche de Venise, qui la fit publier sub poena excommunicationis, maledietionis, suspensionis et interdicti. Ayant entendu cela, la Seigneurie, avec les chefs du Conseil des Dix, auctoritate sua, envoya chercher le bref et l'excommunication, et ils ne voulurent en aucune façon qu'on la vît ni qu'on la publiât. Voyant que cette injuste excommunication ne devait pas être obéie, ils ordonnèrent, eux les chefs (p. 31) des Dix, qu'on célébrât comme d'habitude, dans toutes les églises, sous peine de notre disgrâce... SANUTO “] ». Venise en appela à un concile général ; le pape répondit par un autre Monitoire. « (p. 32) Les Vénitiens, à vrai dire, ne se soucièrent pas beaucoup de ces excommunications ». – MALIPIERO ; Annali Veneti : « (p. 282) Il ne se passa pas beaucoup de jours que le pape n'envoyât un de ses massiers auprès de D. Maffio Ghirardo, patriarche de cette Terre, avec son bref, lui commandant de signifier l'interdit au doge et à la Seigneurie... Le patriarche a feint d'être malade, et a fait savoir la chose au doge et aux conseillers des Dix. Il lui fut ordonné de tenir le tout secret et de ne l'exécuter en aucune façon... (p. 283). L'appellation a été rédigée dans la forme officielle en trois copies, et a été présentée au doge et à la Seigneurie, laquelle l'a envoyée à Rome par Traversin Bergamasco, courrier très fidèle, avec l'ordre d'en afficher une sur la porte de l'église de Saint-Celsus. Ce courrier est allé et a exécuté diligemment sa commission. Le 9 juillet, il est revenu. Le matin du 13 juillet, on parla au pape de l'appellation de la Seigneurie, affichée la nuit précédente, et on lui dit que toute la ville de Rome était en rumeur. Quelle que fût la diligence dont on usa, on ne put savoir, si ce n'est longtemps après, de quelle manière la chose avait transpiré ».
[FN: § 2506-2]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. III : « (p. 331) Toutes ces menaces n'étaient que vaines formules, objets de mépris, même pour le clergé ».
[FN: § 506-32]V. SANDI. ; Principj di st. civ. della rep. di Venezia, IIIe partie, v. II, 1. XX, c. VII, art. 3.
[FN: § 2506-4]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. IV : « (p. 218) ...il n'y eut dans toute la (p. 219) république qu'un grand-vicaire de Padoue, qui osa dire au podestat qui venait lui notifier ces ordres, qu'il ferait ce que le Saint-Esprit lui inspirerait ; à quoi le magistrat répondit qu'il le prévenait que le Saint-Esprit avait déjà inspiré au conseil des Dix de faire pendre les réfractaires ». Le Sénat de Venise ne dédaignait pas les dérivations à opposer au pape, et afin d'en être pourvu, il institua l'office de théologien consultant, auquel il nomma d’abord fra Paolo Sarpi. Même le pouvoir de l'Inquisition fut contenu dans d'étroites limites par le gouvernement vénitien. À ce sujet, SARPI écrivit, par ordre du doge, le Discours sur l'origine, la forme, les lois, et l'usage de l'office de l'Inquisition, dans la cité et puissance de Venise. Il parle très librement de la cour de Rome : « (p. 34) La Sérénissime République de Venise ne put être persuadée par les instances des Souverains Pontifes Innocent, Alexandre, Urbain et Clément, et par sept autres Papes qui les suivirent, de recevoir l'Office des frères inquisiteurs, institué par le Souverain Pontife. L'office séculaire qu'elle avait elle-même institué avec profit pour le service de Dieu lui suffisait. Ils [les Vénitiens] avaient devant les yeux les fréquents désordres que provoquait le nouvel Office, dans les autres cités où il existait, parce que les frères Inquisiteurs excitaient souvent le peuple dans leurs prédications ; et quand les gens prenaient la croix, ils causaient des troubles. De ce fait, un grand nombre de Croisés exerçaient leurs vengeances contre leurs ennemis, qu'ils qualifiaient d'hérétiques ; et d'autres gens également innocents, étaient, sous ce nom, opprimés par ceux qui voulaient les dépouiller... (p. 35) Mais, lorsque Nicolas IV monta sur le trône pontifical,... il insista tellement, qu'on résolut de recevoir l'Office, toutefois dans des conditions telles qu'il ne pourrait provoquer du scandale... (p. 36) Ici, il est nécessaire de s'arrêter pour considérer que l'Office de l'Inquisition, dans cette Puissance, ne dépend pas de la Cour de Rome, mais bien de la Sérénissime République, qu'il est indépendant, érigé et constitué par elle-même... ». L'auteur continue en citant plusieurs cas dans lesquels les papes abusèrent de leur pouvoir spirituel à des fins temporelles. Il conclut : « p. 47) Ces choses font voir que la malice de certaines personnes de cet Office s'applique à des intérêts humains et peu honnêtes : qu'il est donc nécessaire de bien examiner comment il fonctionne, et de ne pas laisser ces gens se mettre en mesure de pouvoir en abuser ». Plus loin : « (p. 55) Depuis plusieurs centaines d'années, les ecclésiastiques n'ont d'autre but que d'usurper la juridiction temporelle dont ils ont acquis déjà une grande partie, au grand détriment des gouvernements ».
[FN: § 2506-5]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. IV : « (p. 174) Pour être parfaitement assurée contre les envahissements de la puissance ecclésiastique, Venise commença par lui ôter tout prétexte d'intervenir dans les affaires de l'État ; elle resta invariablement fidèle au dogme. Jamais aucune des opinions nouvelles n'y prit la moindre faveur ; jamais aucun hérésiarque ne sortit de (p. 175) Venise. Les conciles, les disputes, les guerres de religion, se passèrent sans qu'elle y prit jamais la moindre part. Inébranlable dans sa foi, elle ne fut pas moins invariable dans son système de tolérance. Non-seulement ses sujets de la religion grecque conservèrent l'exercice de leur culte, leurs évêques et leurs prêtres, mais les protestants, les Arméniens, les Mahométans, les Juifs, toutes les religions, toutes les sectes qui se trouvaient dans Venise, avaient des temples, et la sépulture dans les églises n'était point refusée aux hérétiques ». Le peuple romain avait une manière analogue de gouverner au temps de la République. Il convient ici de répéter l'observation, faite tant de fois déjà, que l'art de gouverner consiste à savoir tirer parti des résidus existants, et non à s'attaquer à l'entreprise malencontreuse et souvent désespérée de vouloir les changer. Daru ajoute en note : « (p. 175) On raconte qu'en présence d'un Vénitien un étranger se permit de reprocher au gouvernement de la république l'état de nullité dans lequel il tenait les prêtres, accusant la nation, ou au moins les grands, d'incrédulité, d'irréligion. „ C'est tout au plus “ disait-il, „ s'ils croient au (p. 176) mystère de la sainte Trinité. “ Le Vénitien l'interrompit en lui demandant : „ Et cela vous paraît peu de chose, Seigneur ?“ » – SARPI ; loc. cit., § 2506-4 :« (p. 12). Chap. XXIV. Ils ne permettront pas qu'à l'Office on procède contre des Juifs pour une cause quelconque, ni contre toute autre sorte d'infidèles, de n'importe quelle secte, sous l'inculpation de délit commis en paroles ou en faits... ». « Chap. XXV. Pareillement, ils ne devront pas permettre que l'Office de l'Inquisition procède contre une personne appartenant à une nation chrétienne, laquelle vit tout entière avec ses rites propres, différents des nôtres, et se range sous ses propres prélats, comme les Grecs et autres peuples semblables, même si l'inculpation porte sur des articles reconnus par les deux parties... ». L'auteur explique ensuite ces chapitres : « Chap. XXIV (p. 95) ...L'infidélité n'est pas hérésie, et les transgressions que les infidèles commettent par offense et outrage à la foi n'ont pas besoin d'enquête ecclésiastique... Chap, XXV. En dehors de cet État, l'Office de 1'Inquisition prétend juger les chrétiens orientaux sur n'importe quel article, même là où toute la nation est d'un autre avis que la cour de Rome. Dans cette Sérénissime Puissance, eu égard à la protection que le Prince accorde à la nation grecque, les Inquisiteurs n'étendent pas leurs prétentions si loin. Ils disent seulement qu'on peut tolérer chez les Grecs les trois opinions sur lesquelles ils sont en désaccord avec les Occidentaux, mais que si l'un d'eux émet une opinion inadmissible au sujet des points capitaux sur lesquels leur nation s'accorde avec nous, cela doit être soumis à l'Inquisition. Cette distinction est abusive et non moins contraire à la protection du Prince, que si ces gens étaient jugés sur les trois points où il y a divergence ».
[FN: § 2509-1]
ARIST. ; Rep. Athen., 26.
[FN: § 2509-2]
BFAUCHET ; Hist. du dr. pr. de la rép. Ath., t. I, p. 488 : « Parmi les affranchis faits citoyens, on peut citer, dans la première moitié du IVe siècle avant J. C., les deux banquiers célèbres par les plaidoyers de Démosthène, Pasion et son successeur Phormion... Toutefois la rareté des textes prouve que le droit de cité devait être accordé assez difficilement aux métèques et aux affranchis ».
[FN: § 2511-1]
ARISTOT. ; Polit., III, 1, 10 : ... ![]()
![]() « ... car il inscrivit [parmi les citoyens] beaucoup d'étrangers et d'esclaves métèques ». Cfr. ARISTOT. ; De Rep. Athen., 26.
« ... car il inscrivit [parmi les citoyens] beaucoup d'étrangers et d'esclaves métèques ». Cfr. ARISTOT. ; De Rep. Athen., 26.
[FN: § 2512-1]
Dict. DAREMBERG, s. r. Areopagus: « (p. 397) Les aréopagites se transmettaient les uns aux autres des règles d'honneur et de vertu auxquelles les nouveaux venus s'empressaient de se conformer. Aussi Eschyle n'exagérait pas lorsqu'il parlait de cet auguste sénat, „ envié des Scythes et des Pélopides, véritable boulevard du pays qu'il protège contre l'anarchie et le despotisme, collège d'hommes désintéressés et sévères, graves et honorés,... ».
[FN: § 2512-2]
ARISTOT. ; De Rep. ath. : (23) ![]()
![]() « À cause de ce bienfait [accompli avant la bataille de Salamine], ils se firent déférents envers lui [les Athéniens envers l'Aréopage], et les Athéniens furent gouvernés excellemment et à leur avantage ».
« À cause de ce bienfait [accompli avant la bataille de Salamine], ils se firent déférents envers lui [les Athéniens envers l'Aréopage], et les Athéniens furent gouvernés excellemment et à leur avantage ».
[FN: § 2513-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., t. VIII. L'auteur parle du célèbre discours que Thucydide met dans la bouche de Périclès « (p. 180) À cette indulgence réciproque pour les diversités individuelles se rattachait non seulement l'accueil hospitalier qu'Athènes faisait à tous les étrangers, accueil que Periklès met en contraste avec la xenêlasia, ou expulsion jalouse pratiquée à Sparte, – mais encore avec l'activité variée, corporelle et intellectuelle, visible dans la première [résidus de la Ie classe, si opposée à ce cercle étroit de pensée, de discipline exclusive, d'éducation guerrière sans fin [résidus de la IIe, classe], qui formait le système de la seconde... (p. 181) Un idéal si compréhensif d'un développement social à mille faces... serait assez remarquable même si nous en supposions l'existence dans l'imagination d'un philosophe seulement ; mais il le devient bien davantage si nous nous rappelons que les traits principaux du moins en furent empruntés des concitoyens de l'orateur. Toutefois on doit le regarder comme appartenant particulièrement à l'Athènes de Periklès et de ses contemporains. Il n'aurait convenu ni à la période de la guerre des Perses, cinquante ans auparavant, ni à celle de Démosthène, soixante-dix ans après. À la première époque, l'art, les lettres et la philosophie, auxquels Periklès fait allusion avec orgueil, étaient encore en arrière, tandis même que l'énergie active et le stimulant démocratique, bien que très puissants, n'étaient pas encore parvenus au point qu'ils atteignirent plus tard ; à la seconde époque, bien que les manifestations intellectuelles d'Athènes subsistent dans toute leur vigueur et même avec une force accrue, nous verrons l'esprit personnel d'entreprise et l'ardeur énergique de ses citoyens considérablement affaiblis ». L'auteur veut expliquer cela par la guerre du Péloponèse. En réalité, la cause principale est la disparition de l’antique aristocratie, qui est remplacée par celle des démagogues et des sycophantes. Ce n'est pas la guerre du Péloponèse qui obligea les Athéniens à donner la succession de Périclès à un Cléon.
[FN: § 2514-1]
Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS : « (p. 206) Or, il y, en avait [des hérétiques] qui étaient Ariens, d'autres Manichéens, d'autres même Vaudois ou Lyonnais ; lesquels, bien que dissidents entre eux, conspiraient tous néanmoins pour la ruine des âmes contre la foi catholique (et disputaient ces Vaudois très subtilement contre les autres : d'où vient qu'en haine de ceux-là, ceux-ci étaient admis par des prêtres imbéciles) ». L'instinct des combinaisons se tournait vers la théologie. Les croisés qui venaient du Nord ne songeaient pas à disputer sur tout cela. « (p. 206) D'abondant, les capelans [les prêtres] étaient auprès des laïques (p. 207) en si grand mépris, que leur nom était par plusieurs employé en jurement comme s'ils eussent été juifs. Ainsi, de même qu'on dit : „ J'aimerais mieux être juif “ ; ainsi, disait-on : „ J'aimerais mieux être capelan que faire telle ou telle chose “ ».
[FN: § 2515-1]
SCHMIDT ; Hist. et doct. de la secte des Cathares ou Albigeois, t. I : « (p. 66) Les hautes classes de la société étaient arrivées à un degré de civilisation unique alors dans l'Europe ; la vie chevaleresque y fleurissait comme nulle part ailleurs, les nombreux et puissants seigneurs partageaient leurs jours entre les chances des combats, et les luttes plus frivoles de l'amour mondain ; poussés plutôt par un besoin irrésistible d'aventures extraordinaires que par une profonde ardeur religieuse, ils se croisaient fréquemment pour la Terre-Sainte, d'où ils rapportaient, au lieu d'émotions plus chrétiennes, une imagination nourrie des splendeurs orientales... (p. 67) D'ailleurs le clergé lui-même était entraîné par cet esprit léger et mondain qui dominait chez les nobles... Dans les villes régnaient des dispositions semblables. Après une lutte vive et longue pour s'affranchir de la domination féodale, les bourgeois finirent généralement, dès la fin du douzième siècle, par triompher de leurs anciens oppresseurs. Enrichies, les unes par leur commerce avec les ports d'Orient, les autres par leur industrie, les villes étaient fières de leur aisance, et défendaient avec un succès croissant leurs libertés municipales. Les bourgeois imitaient les mœurs des nobles ; ils rivalisaient avec eux de courtoisie et de bravoure ; ils étaient poètes comme eux, et devenaient chevaliers, s'ils le voulaient ;... (p. 68) De tout cela était résulté un esprit de liberté et de tolérance religieuse, dont nul autre pays de la chrétienté ne donnait alors l'exemple. Toutes les opinions pouvaient se manifester sans obstacles... ». « (p. 188) À la fin du douzième siècle l'état social et politique du midi de la France était encore le même qu'à l'époque où l'église cathare, sortant de son mystère, s'était publiquement organisée dans ces contrées... Dans les villes, la prospérité croissante des habitants avait développé de plus en plus leur esprit de liberté ; forts de leurs institutions municipales, ils étaient décidés à défendre leur indépendance contre quiconque oserait y porter atteinte. Aux cours des princes, dans les châteaux des nobles, aussi bien que dans les villes, la politesse extérieure des mœurs était arrivée à un point qui remplissait d'orgueil les méridionaux, tandis que les barons plus rudes et plus pauvres du Nord ne jetaient que des regards d'envie sur la vie joyeuse et poétique des chevaliers et sur l'opulence des bourgeois de la Provence. Cette civilisation plus avancée du Midi, jointe à la longue (p. 189) habitude de liberté civile et politique, avait donné naissance à cet esprit de tolérance religieuse qui déjà dans la période précédente avait favorisé à un si haut degré la propagation de doctrines contraires à celles de Rome. Cet esprit avait fini par prédominer au point que non-seulement l'Église cathare existait presque librement à côté de l'Église catholique, mais que les Vaudois avaient pu organiser à leur tour des communautés florissantes ; il y avait des familles nobles, comme celle de Foix, où se rencontraient des membres des deux sectes... La vie frivole et mondaine des laïques avait trouvé des imitateurs dans les ministres de l'Église... Le pape ainsi que les synodes provinciaux ne cessaient de se plaindre de cette décadence ; mais leurs plaintes restaient sans effet... (p. 190) L'anarchie en était venue au point que les veilles des (p. 191) fêtes des saints, le peuple se livrait dans les églises à des danses qu'il accompagnait de chants profanes... Les plus grands scandales étaient donnés par les prélats eux-mêmes ».
[FN: § 2515-2]
RAOUL DE CAEN ; dans la Collect. de mém.... GUIZOT ; Hist. de Tancr: « (p. 129) ...De même que la poule est en tout point le contraire du canard, de même les Provençaux diffèrent des Français par les mœurs, par l'esprit, par toutes les habitudes et la manière de vivre... Du temps de la disette ils rendirent par leur activité beaucoup plus de services que ne le faisaient d'autres races d'hommes plus empressées à combattre... (p. 130) En un seul point cependant ils se livraient beaucoup trop, et d'une manière honteuse pour eux, à leur cupidité ; ils vendaient aux autres peuples de la viande de chien en guise de lièvre, ou d'âne en guise de chèvre... ». L'auteur continue par le récit du cheval ou du mulet, que nous citons dans le texte.
[FN: § 2516-1]
Les auteurs favorables aux croisés du Nord ne peuvent passer sous silence leur cupidité et leur cruauté ; mais, comme d'habitude, ils en rejettent la faute sur la faiblesse humaine. Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS : « (p. 264) Il advint l'hiver suivant que Foucaud de Brigier, et Jean, son frère, avec plusieurs autres chevaliers, coururent de rechef par le même pays qu'ils avaient déjà pillé une fois (p. 265) et y firent beaucoup de butin... Ce Foucaud était un homme très cruel et plein d'orgueil, qui s'était, disait-on, fait une règle de mettre à mort tout prisonnier de guerre qui ne lui paierait pas cent sous d'or, lui faisant endurer les tortures de la faim dans une fosse souterraine, et voulant, quand on l'apportait on moribond ou mort, qu'il fût jeté dans un égout... Au demeurant, on ne doit ni ne peut raconter à quelles infamies se livraient les serviteurs de Dieu ; la plupart avaient des concubines et les entretenaient publiquement ; ils enlevaient de vive force les femmes d'autrui, et commettaient impunément ces méfaits et mille autres de ce genre. Or ce n'était bien sûr dans l'esprit qui les avait amenés qu'ils en agissaient ainsi ; la fin ne répondait pas au commencement, et ils n'offraient pas en sacrifice la queue avec la tête de la victime. Somme toute, ils n'étaient ni chauds ni froids, mais parce qu'ils étaient tièdes, le Seigneur commença à les vomir de sa bouche, et à les chasser du pays qu'ils avaient conquis ». Oui, mais en attendant, il le leur avait laissé conquérir ! – H. MARTIN ; Hist. de la Fr., t. IV, p. 204 : « Les pardons pontificaux consistaient dans la rémission de tous les péchés commis depuis la naissance du croisé, et dans l'autorisation de ne payer l'intérêt d'aucune dette, l'eût on promis par serment, pendant la durée de l'entreprise. L'espoir de ne pas payer leurs dettes, et surtout de piller les beaux manoirs et les riches villes de la langue d'oc, était plus que suffisant pour ameuter tous les nobles aventuriers de la chrétienté : qu'on juge de ce que dut soulever le levier du fanatisme ajouté à un si puissant mobile : tout ce que le cœur humain recèle de passions cupides et sanguinaires fut déchaîné avec une épouvantable violence ».
[FN: § 2517-1]
JEAN GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I « p. CCLXIV) Il y avait donc antagonisme entre la noblesse ecclésiastique et la noblesse laïque, celle-ci essayant de dépouiller celle-là, et celle-là essayant de reprendre à la première les biens usurpés à son détriment. L'hérésie albigeoise tira parti de cet état de choses assez général ».
[FN: § 2518-1]
ÉTIENNE DE BOURBON ; Anecd. hist., § 251 : (p. 213) Audivi a fratribus Provincie quod in terra Albigensium, cum, heretici convincuntur scripturis et racionibus, non habent forcius argumentum ad defensionem erroris sui et subversionem simplicium quam exempla mala catholicorum. et maxime prelatorum ; unde, cum eis deficiunt alia argumenta, adhuc recurrunt dicentes : « Videte quales sunt isti vel illi, et maxime prelati ; videte quomodo vivunt et incedunt, nec sicut antiqui, ut Petrus et Paulus et alii, ambulantes ». Cfr. § 83, p. 79. Ces braves gens qui se plaignaient du clergé corrompu furent emprisonnés, torturés, brûlés par le clergé ascète. Ils gagnèrent beaucoup au changement, en vérité !
[FN: § 2519-1]
JEAN GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I : « (p. CCLXXXVIII)
Relâchement du haut clergé. À vrai dire, c'était par le relâchement de sa discipline et de ses mœurs que le haut clergé favorisait le développement de l'hérésie, beaucoup plus que par une adhésion plus ou moins hypocrite à ses doctrines. Les essais de réforme tentés par les conciles nous montrent toute l'étendue du mal auquel il fallait remédier pour rendre à l'Église, avec des vertus surnaturelles, le moyen de résister à l'ascendant moral que les Parfaits exerçaient sur les foules ». – « (P. CCLXXXIX) Chapelains et hérétiques. Un autre chapelain, celui de Cadenal, habita pendant deux ans, avec un Parfait, l'écuyer Pons, prenant avec lui tous ses repas. Il savait fort bien qu'il était ainsi le commensal d'un hérétique vêtu, mais peu lui importait. Un curé servait de socius à un Parfait ! Le cas n'était pas banal ». Sans les Albigeois et la réaction qu'ils provoquèrent, peut-être aurait-on joui de la liberté de conscience depuis ce temps-là, au moins dans l'Europe méridionale. À peine l'a-t-on obtenue maintenant. – BRUCE WHYTE ; Hist. des langues romanes, trad. franç., t. II : « (p. 193) La conduite des prélats n'était pas seulement une violation flagrante de tout principe de morale ; elle montrait encore manifestement qu'ils regardaient le christianisme comme un simple rituel de cérémonies, comme un masque à la plus vile hypocrisie, comme un dépôt de spécifiques pour le succès ou l'absolution de tous les crimes ». Mais en attendant, sous ces prélats, on souffrait peu ou point de persécution pour ses croyances. Il y en eut, au contraire, une terrible et très cruelle, sous leurs très moraux successeurs. Quant aux crimes, il semble qu'ils furent moins nombreux sous les premiers que sous les seconds. En tout cas, on n'a aucune preuve qu'ils se soient accrus.
[FN: § 2519-2]
DARU ; Hist. de la rép. de Venise, t. IV « (p. 181) La politique du gouvernement parut juger que pour rester soumis il était bon que les gens d'église eussent besoin d'indulgence ; en conséquence on toléra chez eux cette liberté de mœurs dont toute la population de Venise fut toujours en possession ». En note : « (p. 181) Les religieux se permettent ces choses qui ne leur conviennent pas et qui, dans un autre pays, ne seraient pas tolérées de leur part. Ils se soustraient à l'obédience des supérieurs qui ne peuvent les contraindre, et l'autorité des messages apostoliques est sans force contre eux... Au temps des interdits (§ 2506), si la république avait eu tous ses religieux observant leur règle et obéissant à leurs supérieurs, non seulement elle n'aurait pas pu les contraindre à célébrer les offices divins, mais encore il se serait trouvé des prêtres par centaines qui, par les prédications et les harangues, auraient excité la plèbe contre elle. Mais les religions plus haut nommées étant délaissées, tous ses frères et ses prêtres prirent le parti du gouvernement (Relazione della cità Repubblica di Venezia...) ».
[FN: § 2520-1]
Collect. GUIZOT ; PIERRE DE VAULX-CERNAY ; Hist. de la guerre des Albigeois : « (p. 8) Ils disaient de l'église romaine presque tout entière qu'elle était une caverne de larrons, et la prostituée dont il est parlé dans l'Apocalypse... Ils attestaient de plus que la confirmation et la confession sont deux choses frivoles et du tout vaines, disant encore que le sacrement de mariage est une prostitution, et que nul ne peut être sauvé en lui en engendrant fils ou filles... (p. 9) Il faut savoir en outre que certains entre les hérétiques étaient dits parfaits ou bons, et d'autres croyants. Les parfaits portaient vêtements noirs, se disaient faussement [ce faussement semble être une calomnie de l'auteur] observateurs de chasteté, détestaient l'usage des viandes, œufs et fromage, et affectaient de paraître ne pas mentir... Étaient appelés croyants ceux qui vivaient dans le siècle, et bien qu'ils ne cherchassent à imiter les parfaits, espéraient, ce néanmoins qu'ils seraient sauvés en la foi de ceux-ci... (p. 11) Il y avait encore d'autres hérétiques appelés Vaudois, du nom d'un certain Valdo, Lyonnais... Pour ne rien dire de la plus grande partie de leurs erreurs, elles consistaient principalement en quatre points, à savoir : porter des sandales à la manière des apôtres ; dire qu'il n'était permis en aucune façon de jurer ou de tuer, et, en cela, surtout, qu'ils assuraient que le premier venu d'entre eux pouvait, en (p. 12) cas de besoin et pour urgence, consacrer le corps du Christ sans avoir reçu les ordre de la main de l'évêque, pourvu toutefois qu'il portât sandales ».
[FN: § 2520-2]
F. TOCCO ; L'er. nel. m. e., p. 88, 89. – Notes de l'auteur. * MONETA, p. 513 : Isti etiam haeretici omne bellum detestantur tanquam illicittum, dicentes quod non sit licitum se defendere,... p. 515. Obiiciunt etiam illud Matt., V, 38 : « Audistis quia dictum est oculum pro oculo et dentem pro dente. Ego autem dico vobis non resistere malo » ; p. 516. Obiiciunt Matt., XXII, 7 : « Perdidit homicidas illos » ; p. 517 : et illud. Matt., V, 44 : « Benefacite his qui oderant vos ». – SACCONI, dans la Summa, p. 486 : Item quod potestates seculares pecant, mortaliter puniendo malefactores vel haereticos. « Qu'on doive rapporter mortaliter à puniendo et non à peccant, cela est prouvé par Ebard, qui raconte, à p. 157, que les hérétiques avaient l'habitude d'objecter : dictum est non occides ».
[FN: § 2522-1]
SCHMIDT ; loc. cit. § 2515-1, t. II. L'auteur rapporte les divagations des Cathares : « (p. 68) …l’opinion la plus accréditée était que les âmes des premiers hommes ont été des anges. Le démon les enferma dans des corps matériels, pour les empêcher de s'en retourner au ciel ; mais il fallut aussi un moyen de les enchaîner à perpétuité au monde mauvais ; ce moyen, le démon crut le trouver dans la propagation du genre humain par l'union des sexes. Par Ève il se proposa de séduire Adam ; il voulut les faire pécher tous les deux, afin de les rendre ainsi à jamais ses esclaves, et de les ravir au monde céleste. Les ayant donc introduits dans son faux paradis, et leur ayant défendu, pour mieux les exciter, de manger de l'arbre de la science, il entra lui-même dans un serpent, et commença par séduire la femme ; de là l'éveil (p. 69) de la mauvaise volonté, de la concupiscence charnelle et ses suites. Suivant le dualisme mitigé, la pomme défendue n'a pas été autre chose que le commerce de l'homme avec la femme... Le péché de la chair, la „ fornicatio carnalis “ est le vrai péché originel ; c'est le plus grand de tous, car non seulement il a été commis par un effet du libre arbitre, et constitue ainsi une révolte volontaire de l'âme contre Dieu ; mais il est aussi le moyen de perpétuer une race mauvaise, et d'agrandir ainsi le règne du démon. À la fin du douzième siècle quelques partisans du dualisme mitigé en Italie croyaient qu'après avoir formé Ève, le démon eut commerce avec elle, et que Caïn fut leur fils ; du sang de celui-ci naquirent les chiens, dont le fidèle attachement aux hommes doit prouver qu'ils sont d'origine humaine ». Ces gens étaient les dignes prédécesseurs de nos vertuistes. – MONETA ; Adv. Cath. et Vald. : (p. 111) Nunc videndum, est, quod fuerit peccatum Adae secundum ipsos. Ad quod melius intelligendum, sciendum est secundum eos, quod Sathan alium Angelum inclusit in corpore muliebri facto de latere Adae dormientis, cum qua percavit Adam ; fuit autem peccatum Adae, ut asserunt, fornicatio carnalis, dicunt enim, quod semper accessit ad mulierem, et cum cauda corrupit eam, et ex eius coitu cum ipsa natum esse Cain... En note l'auteur cite MOSES BAR-CEPHA, qui écrit : Sunt quidam qui existiment non fuisse arborem id, de quo gustavit Adam, sed venereum amplexum, quo cura uxore ille corpus miscuit... MONETA continue : Dicunt etiam, quod mulier in luxuria assuefacta ad Adam ivit, et qualiter cum ipsa coiret, ostendit, et suasit, et sicut Eva suasit ei, sic Adam opere complevit, et istud esse esum ligni scientiae boni, et mali asserunt... – On trouve aussi des dérivations analogues chez les écrivains catholiques. Des plus étranges est celle qui attribue pour cause à certains péchés sexuels le déluge universel et qu'on lit dans SANCHEZ De sancto matrimonii sacramento disputationum : lib. IX, disp. XVI, p. 215.
Collect. GUIZOT, PIERRE DE VAULX-CERNAY ; Hist. de la guerre des Alb. L'auteur exagère certainement. Son témoignage doit être retenu seulement dans ce sens qu'il existait une grande disproportion entre le nombre des combattants de Montfort et ceux des Provençaux et des Aragonais. « (p. 268) Or, tous les nôtres, tant chevaliers que servants à cheval, n'étaient plus de huit cents, tandis qu'on croyait les ennemis monter à cent mille, outre que nous n'avions que très peu de gens de pied et presque nuls, auxquels même le comte avait défendu de sortir pendant la bataille ».
[FN: § 2523-1]
Collect. GUIZOT ; loc. cit. § 2523-1: « (p. 341) Au moment même où les ennemis faisaient cette sortie, un exprès vint trouver le comte qui... entendait la messe, le pressant de venir sans délai au secours des siens ; auquel ce dévot personnage : „ Souffre, dit-il, que j'assiste aux divins mystères...“, Il parlait encore qu'arriva un autre courrier... ». Le comte voulut demeurer jusqu'à la fin de la messe et dit : « (p. 342) Allons, et, s'il le faut, mourons pour celui qui a daigné mourir pour nous ».
[FN: § 2524-1]
Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS. En l'an 1229, le comte Raymond VII se mit à la discrétion du légat du pape et du roi de France. Il accepta un traité de paix tel que l'auteur croit la protection de Dieu sur le royaume de France seule capable de l'avoir suscité. « (p. 282) Mais je ne veux pas manquer de dire que, quand le royaume tomba dans les mains d'une femme et d'enfants, ce que le roi Philippe, leur aïeul, redoutait après la mort de son fils, n'arriva que par la volonté d'en-haut et la bonté du Roi des cieux, protecteur des Français [l'auteur aurait pu ajouter : et des assassins et des voleurs]. En effet, pour les premiers auspices du règne du jeune prince, Dieu voulut à tel point honorer son enfance à l'occasion d'une si longue guerre avec le susdit comte, que, de plusieurs clauses contenues au traité, chacune eût été à elle seule suffisante en guise de rançon, pour le cas où le roi aurait rencontré le dit comte en champ de bataille et l'aurait fait prisonnier ». Ce n'est pas tout : « (p. 281) Le comte fut réconcilié à l'Église la veille de Pâques (12 avril 1229) ; en même temps ceux qui étaient avec lui furent déliés de la sentence d'excommunication. Et c'était pitié que de voir un si grand homme, lequel, par si grand espace de temps, avait pu résister à tant et de si grandes nations, conduit nu en chemise, bras et pieds découverts, jusqu'à l'autel ».
[FN: § 2524-2]
PAUSANIAS (IV, 14) : « Accablés sous le faix, comme des ânes, ils sont dans la dure nécessité d'apporter à leurs maîtres la moitié de tous les fruits produits par leurs champs…. Ils se lamentent, eux et leurs femmes, lorsque la Parque funeste atteint quelqu'un de leurs maîtres ».
[FN: § 2527-1]
Journal de Genève, 17 juillet 1911. On commente et l'on reproduit en partie une étude du Dr E. Labat, sur la natalité en Gascogne. « On tient moins à s'élever qu'à jouir. On songe moins à la destinée du domaine familial, à l'avenir de sa descendance [résidu de la IIe classe] ; on songe beaucoup plus à soi-même. La femme, même la paysanne, redoute les sujétions, les fatigues, les dangers de la maternité, [parce qu'ils sont demeurés les mêmes, tandis que les sentiments qu'on leur opposait ont diminué d'intensité] ; l'homme fuit les préoccupations et les charges. Chacun tient à vivre pour soi, à utiliser à son profit le temps et les ressources dont il dispose [les résidus de la IIe classe ayant disparu, ces buts restent seuls]. Si cette vie est modeste et même étroite, on s'en consolera ; c'est surtout la vie facile, plénière, sans aléa, qui apparaît comme désirable ». « (E. Labat) Il est difficile de ne voir qu'une coïncidence entre la diminution de la moralité et l'affaiblissement du sentiment religieux [c'est la façon ordinaire dont on présente la considération des résidus de la IIe classe], à moins d'écarter les faits ou de leur faire subir quelque violence. Les différents centres de la vie psychique, les modes divers de l'activité de l'âme sont d'ailleurs trop étroitement solidaires pour que des changements aussi importants puissent s'y produire simultanément sans être dans une relation de dépendance. On n'a jamais été très religieux en Gascogne... Malgré tout, jusqu'à ces dernières années, l'imprégnation religieuse était générale, profonde et déterminante... La grossièreté et la misère de l'existence étaient soulevées, éclairées et embellies par un idéal dont on pouvait reconnaître l'origine et le caractère religieux non seulement dans les moments solennels, comme la mort, le mariage, les naissances, mais encore dans la conception de la famille, la notion générale du devoir, la fidélité aux engagements, la gravité du serment, le respect des vieillards, l'accueil réservé aux pauvres [description littéraire du fait des résidus de la IIe classe]. L'inculture morale des jeunes est troublante... Ce qui est précisément inattendu et pénible, c'est le contraste du progrès intellectuel [résidus de la Ie classe] et du recul moral [résidus de la IIe classe]. L'âme du petit paysan offre le spectacle d'un champ dont la moitié serait cultivée et l'autre presque en friche [disproportion entre les résidus de la Ie classe et ceux de la IIe] ».
[FN: § 2530-1]
J. BURCKHARDT ; La civilisat. en Italie au temps de la Renaiss., t. I : « (p. 124) L'Italie... a été la première à employer le système des mercenaires... Elle s'adressa d'abord aux Allemands ; mais à l'époque de la Renaissance, il se forma, au milieu des mercenaires étrangers, de bons soldats italiens. …(p. 125) En somme, les inventions nouvelles [des armes à feu] firent leur chemin, et on les utilisa de son mieux ; aussi les Italiens devinrent~ils les maîtres de toute l'Europe en ce qui concernait la balistique et la fortification. Des princes comme Frédéric d'Urbin et Alphonse de Ferrare acquirent dans ces connaissances spéciales une supériorité qui faisait pâlir même la réputation d'un Maximilien I. C'est l'Italie qui la première (p. 126) a fait de la guerre une science et un art complets et raisonnés ».
[FN: § 2531-1]
J. BURCKHARDT ; La civilisat. en Italie au temps de la Renaiss., t. I : « p. 120) Il n'y a pas ici [en Italie] de système féodal dans le genre de celui du Nord, avec des droits fondés sur des théories respectées [dérivations des résidus de la IIe classe] ; mais la puissance que chacun possède, il la possède généralement, de fait, tout entière. il n'y a pas ici de noblesse domestique qui travaille à maintenir dans l'esprit du prince l'idée du point d'honneur abstrait avec toutes ses bizarres conséquences [autres résidus de la IIe classe et leurs dérivations], mais les princes et leurs conseillers sont d'accord pour admettre qu'on ne doit agir que d'après les circonstances et d'après le but à atteindre [seuls des résidus de la Ie classe, et leurs dérivations]. Vis-à-vis des hommes qu'on emploie, vis-à-vis des alliés, de quelque part qu'ils viennent, il n'y a point cet orgueil de caste qui intimide et qui tient à distance ; surtout l'existence de la classe des condottieri, dans laquelle l'origine est une question parfaitement indifférente [aucune persistance des agrégats], atteste que la puissance est quelque chose de concret, de réel ».
[FN: § 2544-1]
Les termes de la science expérimentale correspondent à la réalité, en des limites plus ou moins étendues ; les termes de la théologie et de la métaphysique n'y correspondent en aucune manière ; ou, si l'on veut, les limites sont tellement écartées que l'approximation devient illusoire. Il existe certainement des choses qui correspondent au terme argile, des individus qui sont jeunes, vieux, des classes sociales, etc. Le doute ne peut porter que sur la limite à laquelle certaines matières n'appartiennent plus à la catégorie des argiles, certains individus à la catégorie des jeunes, certaines personnes à une classe sociale donnée. Mais quant à Zeus, à la justice, au bien, etc., toute correspondance avec la réalité expérimentale fait défaut ; et ce n'est plus de limites qu'il est question.
[FN: § 2546-1]
Ce terme est parmi les plus indéterminés de la sociologie. Nous l'employons ici exclusivement pour désigner un état de fait, sans vouloir le moins du monde en rechercher les causes. Nous ne voulons pas résoudre ce problème : Y a-t-il plusieurs races humaines différentes, et combien ? Comment se mélangent-elles, comment se constituent-elles, comment disparaissent-elles, etc. ? Dans l'antiquité, il y avait des hommes qui s'appelaient eux-mêmes et que d'autres appelaient : Romains, Samnites, Italiens, Hellènes, Carthaginois, Gaulois, etc. De nos jours, il y a des hommes qui s'appellent eux-mêmes et que d'autres appellent : Français, Italiens, Allemands, Slaves, Grecs, etc. C'est exclusivement ce fait, et aucun autre, que nous voulons désigner, quand nous parlons de différences ethniques. Chacun de ces noms désigne un certain nombre d'individus qui, dans une mesure plus ou moins grande, possèdent habituellement en commun certains caractères de sentiments, de pensée, de langue, parfois de religion, etc. Ici, nous acceptons sans autre le fait tel quel. Nous ne voulons nullement en rechercher les causes ou les origines. Nous répétons cela parce qu'il est nécessaire que le lecteur l'ait toujours présent à l'esprit, afin qu'il n'attribue pas au terme ethnique un sens différent de celui dans lequel nous l'employons.
[FN: § 2547-1]
Cours, t. II, 1. II, c. II. Il faut remarquer que l'auteur ne connaissait pas encore la théorie de la mutuelle dépendance des ondulations des phénomènes sociaux exposée ici (§ 2552, 2553), et dont il est nécessaire de tenir compte dans l'histoire de l'évolution des corporations romaines.
[FN: § 2548-1]
MOMMSEN ; Le dr. pub. rom. ; VI-2 ; « (p. 99) [sous la république]. L'individu de la plus basse naissance peut légalement recevoir les droits de chevalier. Mais, dans l'usage, le cheval équestre était donné de préférence aux enfants des vieilles familles... Le droit et le fait subsistent sans changement sous l'Empire ».
[FN: § 2548-2]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., VI-2 : « (p. 111) L'ordo publicanorum n'est jamais identifié avec l'ordo equester, et il ne peut pas l'être. Mais ils sortaient l'un et l'autre de cette classe moyenne formée par l'exclusion des sénateurs des marchés publics et par l'exclusion des centuries équestres du Sénat, et les chefs étaient, en grande partie, les mêmes dans les deux. En ce sens, la direction politico-commerciale des chevaliers appartenait aux publicains, et en outre leur unité les rendait aptes par excellence à la formation de grandes compagnies de commerce ». Voir la suite § 2549-7.
[FN: § 2548-3]
La circulation commence par les esclaves ; elle continue par les affranchis, par les pérégrins, par les étrangers ; elle se poursuit par les chevaliers, par les sénateurs, et arrivera jusqu'aux empereurs. Vers la fin de la République, l'esclave pouvait acquérir la liberté en peu d'années. CIC. ; Phil. VIII, 11 : Etenim, patres conscripti, cum in spem libertatis, sexenio post simus ingressi, diutiusque servitutem perpessi, quam captivi frugi et diligentes solent... Il ne faut pas prendre à la lettre ce terme de six ans. Il était simplement commode pour Cicéron, dans son discours ; mais il ne l'aurait pas employé, si le terme au bout duquel l'esclave sobre et laborieux obtenait la liberté avait été très long au lieu d'être court. Dans un autre passage de Cicéron, il est fait allusion à la rapidité de la circulation en général. Pro L. Cornelio Balbo, 7 : « Avant de traiter du droit et de la cause de Cornelius, il semble utile de rappeler brièvement notre condition commune à tous, afin d'éloigner de la cause la malveillance. Si, juges, chacun de nous devait conserver, de la naissance à la vieillesse, la condition dans laquelle il est né ou a été placé par la fortune, et si tous ceux que la fortune éleva ou qui furent illustrés par leurs labeurs et par leurs œuvres devaient être punis, cette loi ni ces conditions de vie ne paraîtraient plus graves pour L. Cornelius que pour un grand nombre d’hommes sages et énergiques. Si au contraire, par vertu, intelligence et connaissances, un grand nombre se sont élevés du dernier degré des classes et de la fortune, et ont conquis non seulement des amitiés et des richesses, mais de très grandes louanges, des honneurs, de la gloire, de la dignité, je ne comprends pas pourquoi l'envie pourrait offenser la vertu de Lucius Cornelius, plutôt que votre équité venir au secours de sa modestie ». – MOMMSEN explique bien la nature de la noblesse. Le dr. pub. rom., t. VI-2 : « (p. 52) La nobilitas n'est pas sans doute un droit de gentilité comme le patriciat ; mais elle est aussi héréditaire : elle est acquise à la personne, mais elle se transmet à la descendance agnatique du premier acquéreur, ou plutôt c'est chez ses descendants qu'elle commence ; car celui qui n'entre pas dans ce cercle par droit de succession, l'homo novus, n'est pas lui-même nobilis, et il anoblit ses (p. 53) descendants ». « (p. 54) Depuis que les magistratures curules ordinaires de la cité... devinrent accessibles aux plébéiens,... le magistrat acquit avec la magistrature pour lui et sa descendance agnatique les droits... que l'on réunit sous le nom de nobilitas ; .„ l'homme nouveau “ créa dans sa postérité une nouvelle famille de noblesse romaine ». « (p. 56) L'avantage le plus important que procure la nobilitas est aussi celui qui est le moins susceptible d'être déterminé juridiquement. Il consiste en ce que les descendants de l' „ homme nouveau “ sont, comme appartenant à la noblesse héréditaire, sur le pied d'égalité avec les nobles pour la brigue des magistratures et des sacerdoces ».
[FN: § 2548-4]
Le souvenir ne nous a été conservé que de quelques faits, mais il est probable que beaucoup d'autres se sont passés. – PLUTARCH. ; Sulla, 8. L'auteur parle de Sulpicius : « (2) ... il vendait le droit de cité romain aux affranchis et aux étrangers, comptant publiquement le prix devant une table placée sur le forum ». – Marius fit citoyen, en une seule fois, mille habitants de Camerinum. Comme on le lui reprochait, il dit : « que le bruit des armes l'avait empêché d'entendre la loi » (PLUTARCH. ; Marius, 28, 3). – Sulla et Pompée firent citoyens ceux qui leur plaisaient. APP. ; De bell. civil., 1, 100 « [Sulla] ... fit entrer dans le peuple plus de dix mille esclaves des proscrits, choisis parmi les plus jeunes et les plus vigoureux. En leur donnant la liberté, il les fit citoyens romains. On les appela Corneliani, de son nom [qui était celui de leur patron] ». Une loi décréta « que ceux que Pompée avait fait citoyens en particulier, selon l'avis de son conseil, seraient citoyens romains » (CIC. ; Pro L. C. Balbo, 8). – À ce propos, Cicéron insiste beaucoup sur l'utilité pour le peuple romain d'accorder le droit de cité aux gens qui le méritaient. On objectait à Cicéron que les alliés ne pouvaient être faits citoyens sans le consentement de leur nation. Entre autres choses, il répond qu'il serait dur de ne pouvoir récompenser ainsi les alliés, alors qu'on accordait le droit de cité à tant d'autres gens. (9) Nam et stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis, multos civitate donatos videmus : et qui hostes ad nostros imperatores perfugissent, et magno usui reipublicae nostrae fuissent, scimus civitate esse donatos : servos denique, quorum ius et fortunae conditio infima est, bene de republica meritos, persaepe libertate, id est, civitate, publice donari videmus. Cicéron cite de nombreux cas où le droit de cité romain fut accordé. Il lui arrive même de dire incidemment : (23) Multi in civitatem recepti ex liberis foederatisque populis, sunt liberati... Ailleurs, (Pro Archia, 10, 25), il dit que si Archias n'avait pas été citoyen romain de par la loi, il aurait facilement pu le devenir par quelque imperator. Pro Archia, 10, 25 : Itaque, credo, si civis romanus Archias legibus non esset, ut ab aliquo imperatore civitate donaretur, perficere non potuit ? Sulla, cum Hispanos et Gallos donaret, credo, hunc petentem repudiasset ?... 10, 26 : Quid ? a Q. Metello Pio, familiarissimo suo, qui civitate multos donavit, neque per se, neque per Lucullos impetravisset ? APP. ; De bell. civil., I, 53, dit qu'à la fin de la guerre sociale, tous les alliés obtinrent le droit de cité, excepté les Lucaniens et les Samnites, qui le reçurent plus tard. Plus loin (55), il remarque que les nouveaux citoyens étaient plus nombreux que les anciens. – FLOR. ; III, 19, remarque avec justesse que les alliés et les Romains ne formaient qu'un seul peuple : quippe cum populus romanus Etruscos, Latinos, Sabinosque miscuerit, et unum ex omnibus sanguinem ducat, corpus fecit ex membris, et ex omnibus unus est... Cependant toutes les cités n'acceptèrent pas le droit de cité. Dans d'autres, un petit nombre de citoyens accomplirent les formalités nécessaires pour l'acquérir. Par exemple, Brundusium devait être demeuré exclus du droit de cité, car Sulla, après son retour de la guerre contre Mithridate, l'exempta d'impôts (APP. ; De bell. civil., I, 79). Carbon créa aussi de nouveaux citoyens. LIV. ; Epit. 1. LXXXIV : Novis civibus senatusconsulto suffragium datum est. – Il est probable que dans toute cette période ce furent surtout les intrigants, les spéculateurs et leurs auxiliaires qui obtinrent le droit de cité. Les gens tranquilles et laborieux, les petits propriétaires, n'auront pas pris la peine nécessaire pour l'obtenir. César fut très large dans l'octroi du droit de cité et des honneurs. SUET. ; Iul. 76 : Civitate donatos et quosdam e semibarbaris Gallorum recepit in curiam. Le triumvirat d'Octave, d'Antoine et de Lépide appela à faire partie du Sénat un grand nombre d'alliés, de soldats, de fils d'affranchis, et jusqu'à des esclaves (DIO CASS., XLVIII, 34, p. 552). Plus tard, Octave, devenu seul maître sous le nom d'Auguste, voulut restreindre le nombre des esclaves auxquels on donnait la liberté ; ce qui faisait partie de son plan de rendre à Rome ses mœurs antiques (DIO CASS. ; LV, 13, p. 786 – SUET. ; Aug., 40). Dans son testament, il recommanda à Tibère de ne pas trop accorder la liberté aux esclaves, et de ne pas trop donner le droit de cité romain (DIO. CASS. ; LVI, 33, p. 832). Mais ces recommandations n'empêchèrent guère que le mouvement ne continuât sous ses successeurs.
[FN: § 2548-5]
DION. HALIC. ; Rom. ant., IV, 24 : « Ils obtenaient [anciennement] la liberté : le plus grand nombre gratuitement, à cause de leur courage et de leur probité. C'était là le meilleur moyen de se soustraire au pouvoir des maîtres. Le plus petit nombre payait son rachat, gagné par un travail licite et juste. Il n'en est pas ainsi de notre temps. Si grande est la confusion et si déshonorantes et viles sont devenues les bonnes mœurs de la République romaine, que certains gagnent par les vois, par les effractions, par la prostitution et par d'autres mauvaises actions, le nécessaire pour racheter la liberté et devenir bientôt citoyens romains. D'autres gens, devenus les témoins et les complices de leurs maîtres dans des empoisonnements, des homicides et des crimes contre les dieux et la République, sont récompensés par leurs patrons avec la liberté ; ... ».
[FN: § 2548-6]
Ce sénat de la République, dont Marcius Philippus dit qu'avec lui on ne pouvait pas gouverner, était le digne précurseur des sénats de l’Empire. – CIC. ; De oratore, III, 1 : Ut enim [L. Crassus] Romam rediit extremo scenicorum ludorum die, vehementer commotus ea oratione, quae ferebatur habita esse in concione a Philippo ; quem dixisse constabat, videndum sibi aliud esse consilium, illo senatu se rempublicain gerere non posse... Les « spéculateurs » et les gens vils, contents de leur état, s'accordent en cela qu'ils évitent l'emploi de la force.
[FN: § 2548-7]
Vers la fin de la République, la classe des chevaliers était en très grande partie composée de « spéculateurs ». Sa puissance et ses déprédations dans les provinces sont bien connues. – FLOR. ; III, 18 : Equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata fortunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus, peculabantur suo iure rempublicam. Cfr. 2354 1. – CIC. ; In Verrem, III, 72, 168 : Certe huic homini nulla salutis esset, si publicani, hoc est, si equites romani iudicarent. 41, 94 : « Précédemment, quand l'ordre équestre jugeait, même les magistrats déshonnêtes et rapaces, dans les provinces, respectaient les publicains, honoraient tous ceux qui fonctionnaient avec eux. N'importe quel chevalier romain qu'ils voyaient en province, ils le comblaient de bienfaits et de libéralités.. Ils estimaient alors [les chevaliers], je ne sais comment, presque d'un commun vouloir, que quiconque avait cru digne d'offense un chevalier romain, devait être jugé digne d'un mauvais sort par tout l'ordre ». Il n'en est pas autrement aujourd'hui pour nos ploutocrates soutenus par les parlementaires, par les gouvernements et par la magistrature qui en dépend (§ 2262-1).
[FN: § 2548-8]
SALL ; Iug., 41 : Paucorum arbitrio belli domique agitabatur ; penes eosdem aerarium, provinciae, magistratus, gloriae triumphique erant : populus militia atque inopia urgebatur [ceux qui n'étaient ni « spéculateurs » ni auxiliaires des « spéculateurs »]. Praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant : interea parentes, aut parvi liberi militum, ut quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. Ita cum potentia avaritia [dérivation éthique habituelle. Mais d'où venait cette puissance ? Elle était achetée dans les comices] sine modo modestiaque invadere, polluere et vastare omnia, nihil pensi neque sancti habere [déclamations éthiques habituelles], quoad semet ipsa praecipitavit [voilà finalement un fait]. – DIOD. ; XXXVI, 3. Ayant fait demander à Nicomède, roi de Bithynie, des auxiliaires pour l'expédition contre les Cimbres, Marius reçut pour réponse que la plupart des sujets de Nicomède avaient été réduits en servitude par les publicains. CIC. ; Pro lege Manilia, 22, 65 : Difficile est dictu, Quirites, quanto in odio simus apud exteras nationes, propter eorum, quos ad eas per hos annos cum imperio misimus, iniurias ac libidines. Quod enim fanum putatis in illis terris nostris magistratibus religiosum, quam civitatem sanctam, quam domum satis clausam ac munitam fuisse ? Urbes iara locupletes ac copiosae requiruntur, quibus causa belli propter diripiendi cupiditatem inferatur. Dans ce discours, Cicéron se montre favorable à Pompée. Dans un autre, le De provinciis consularibus, il veut se concilier les bonnes grâces de César et défend les publicains opprimés – dit-il – par Gabinius ; mais ainsi il confirme indirectement le pouvoir de ces « spéculateurs » : (5, 10) Iam vero publicanos miseros (me etiam miserum, illorum ita de me meritorum miseriis ac dolore) tradidit in servitutem Iudaeis et Syris, nationibus natis servituti. On voit qu'au temps de Cicéron on croyait que les Juifs et les Syriens étaient nés pour être esclaves, et devaient être par conséquent impunément exploités par les publicains. Aujourd'hui, les peuples civilisés ont une opinion semblable pour les peuples qu'ils traitent de sauvages ou de barbares. Ils les abandonnent à leurs « spéculateurs ». Statuit ab initio et in eo perseveravit, ius publicano non dicere ; pactiones sine ulla iniuria factas rescidit : custodias sustulit ; vectigales multos ac stipendiarios liberavit ; quo in oppido ipse esset, aut quo veniret, ibi publicanum, aut publicani servum esse vetuit... Cicéron conclut que le Sénat doit secourir ces bons publicains, malgré la pauvreté du fisc – in his angustiis aerarii. Pourtant Cicéron connaissait bien la mentalité de ses bons amis les publicains. Dans l'une de ses lettres à Quintus, il voudrait que, sans les heurter trop, on empêchât leur avidité de s'étendre démesurément. On croirait entendre quelque brave homme de notre époque écrivant à l'un de ses amis magistrats, et lui conseillant de ménager la chèvre et le chou. – Ad Quint, I, 1, 2 : Quod ego, dum saluti sociorum consulo, dum impudentiae nonnullorum negotiatorum resisto... « (I, 1, 11, 25) Ta volonté et ta sollicitude rencontrent chez les publicains une grande difficulté. Si nous nous tournons contre eux, nous repoussons loin de nous et de la République un ordre qui a bien mérité de nous, et qui par nous est attaché à la République. D'autre part, si nous sommes complaisants envers eux en toutes choses, nous supportons qu'on ruine entièrement les gens que nous devons sauver et protéger ». (§ 2300, 2268, 1713-5, 2178). Illa causa publicanorum quantam acerbitatem afferat sociis, intelleximus ex civibus... – LIV. ; XLV, 18. L'auteur parle des difficultés de percevoir les impôts en Macédoine, et dit de l'impôt des mines : nam neque sine publicano exerceri posse ; et, ut publicanus esset, ibi aut ius publicum vanum, aut libertatem sociis nullam esse. Il fallait de l'argent pour acheter les votes aux comices, et il fallait trouver une manière de s'en procurer. On avait des dons volontaires des provinciaux, le produit des rapines par la ruse, par les armes, par l'usure, etc. Quand on n'achetait pas les votes à Rome, c'était une exception extraordinaire. Cicéron approuve certaines libéralités ; et s'il en condamne d'autres, il paraît être poussé par le désir de faire voir qu'il y a des gens qui s'en abstiennent, ce qui, entre autres, est son propre cas. – CIC. ; De officiis, II, 17, 58. Il commence par dire qu'il faut éviter le soupçon d'avarice. Vitanda tamen est suspicio avaritia. En effet, l'idéal est le spéculateur qui, gagnant beaucoup, dépense beaucoup : tel est aussi notre ploutocrate. Il cite Mamercus, qui fut blackboulé aux élections consulaires, parce qu'il n'avait pas demandé premièrement l'édilité, fonction dans laquelle les dépenses étaient plus grandes. Il dit ensuite qu'on peut aussi faire des dépenses qui ne sont pas approuvées par les gens sages : Quare et, si postulatur a populo, bonis viris si non desiderantibus, attamen approbantibus, faciendum est, modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus ; et, si quando aliqua res maior atque utilior populari largitione acquiritur, ut Oresti nuper prandia in semitis decumae nomine magno honori fuerunt. Il raconte que L. Philippus, Cotta et Curius se vantaient d'avoir obtenu les premiers honneurs sans frais, et il dit que la même chose luiarriva, qu'il avait fait seulement de modiques dépenses.
[FN: § 2548-9]
CIC. ; Pro M. Fonteio, IV.
[FN: § 2548-10]
Plutarque nous rapporte un fait tout semblable à ceux qui se sont passés de nos jours. Ce fait témoigne de la grande augmentation du prix des immeubles ; augmentation qui est un indice certain de l'accroissement de la prospérité économique. PLUTARCH. ; Marius, 34 Près de Misène, Marius possédait une belle maison, qui avait été achetée par Cornélie pour 75 000 drachmes, et revendue peu après à Lucius Lucullus pour 2 500 000 drachmes. ![]()
![]() « Ainsi s'accrurent rapidement les grandes dépenses, et la prospérité provoqua le luxe en proportion ».
« Ainsi s'accrurent rapidement les grandes dépenses, et la prospérité provoqua le luxe en proportion ».
[FN: § 2548-11]
Caton le Censeur s'en prend aux « spéculateurs », poussé par des motifs éthiques. Comme il arrive habituellement dans des cas semblables, ce fut en vain. Le Sénat défendit les « spéculateurs », comme le font de nos jours les assemblées législatives. PLUTARCH. ; Cat. m ., 19. Caton diminua le prix des travaux affermés ; il accrut celui du fermage des impôts. Le Sénat déclara nuls ces contrats, et les tribuns firent condamner Caton à une amende.
[FN: § 2548-12]
MOMMSEN ; Le droit publ. rom., t. II : « (p. 156) À l'époque de Polybe, c'est-à-dire au commencement du VIIe siècle, la loi voulait, avant l'acquisition du tribunat militaire, au moins cinq et, avant celle d'une magistrature civile, en particulier de la questure, au moins dix années de service accomplies ; ce qui, puisque c'est là la durée générale du service obligatoire dans la cavalerie et que les personnes dont il s'agit servaient sans exception dans la cavalerie, peut encore s'exprimer en disant que la carrière politique ne (p. 157) pouvait commencer qu'après qu'il avait été satisfait au service militaire ». Les dix années pouvaient n'être pas effectives. Suivant Mommsen, « (p. 159) l'âge de quarante-six ans accomplis marquant en principe le terme de l'obligation du service militaire, la (p. 160) preuve du temps de service requis ne doit plus désormais être demandée, et par suite celui qui n'a pas servi pendant les dix années ou qui même n'a pas servi du tout est, à partir de ce moment, éligible ». Cette condition du service militaire cesse d'être légalement obligatoire vers la fin de la République, mais « (p. 162) il était encore d'usage à la fin de la République, chez ceux qui aspiraient à la carrière politique, de ne pas se soustraire complètement au service militaire ». Voir au § 2463-4 la comparaison entre cet état de choses et celui qui régna sous l'Empire.
[FN: § 2548-13]
Le mouvement commence avec Marius, qui composa les légions en grande partie de prolétaires. SALL. ; Iug., 86 : Ipse interea milites scribere, non more maiorum, neque ex classibus, sed uti cuiusque lubido erat, capite censos plerosque. Id factum alii inopia bonorum, alii per ambitionem consulis memorabant ; quod ab eo genere celebratus auctusque erat : et homini potentiam quaerenti egentissumus quisque opportunissumus ; cui neque sua curae, quippe quae nulla sunt, et omnia cum pretio honesta videntur. « ... Certains disaient qu'il avait fait cela parce que les gens aisés manquaient ; d'autres à cause de l'ambition du consul [Marius], car il avait été illustré et élevé aux honneurs par ces hommes. À qui recherche le pouvoir, l'homme le plus nécessiteux convient parfaitement, parce que, ne possédant rien, il ne se soucie pas de ses biens, et tout ce dont on lui donne un prix lui semble honnête ». Cette semence germa et produisit l'Empire. Si l'on s'arrête à ce fait que Marius, chef des prolétaires, ouvrît les milices aux prolétaires et fut le précurseur de César, on a volontiers l'opinion, qui autrefois avait cours, que l'Empire a été le triomphe du peuple luttant contre l'aristocratie. De même, si l'on s'arrête au fait qu'Auguste enleva tout pouvoir aux comices, et qu'il voulait restaurer les coutumes antiques, on estime que l'Empire a été une réaction contre les libertés populaires. Mais si l'on ne s'arrête pas à la surface des choses, et si l'on pénètre un peu plus ces phénomènes si compliqués (§ 2542), on voit aussitôt que les récompenses distribuées aux prolétaires étaient des moyens, et non un but des chefs militaires ; qu'un Marius démocrate en usa aussi bien qu'un Sulla aristocrate, qu'un César et un Octave qui n’appartenaient ni à l'un ni à l'autre de ces partis. Les chefs militaires se servirent à leurs fins des mercenaires, du peuple, du Sénat, des chevaliers, de tous ceux qui pouvaient leur être utiles et qui consentaient à se mettre à leur service. Si, au milieu d'une si grande variété de faits, nous voulons arriver à quelque chose d'un peu constant, nous le trouverons dans la lutte entre les « spéculateurs » et ceux qui détiennent la force, qui savent, qui veulent en faire usage. Ce sont les « spéculateurs » qui triomphent, au temps où Cicéron réprime la révolte de Catilina. Ce sont ceux qui font usage de la force qui triomphent, d'abord avec César, puis avec Auguste.
[FN: § 2549-1]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., VI-2 : « (p. 48) L'ancien système, selon lequel toutes les fonctions publiques étaient ouvertes à tous les citoyens, fut renversé : les magistratures et les sacerdoces furent complètement fermés à ceux qui n'appartenaient pas à une des deux noblesses [la nobilitas, héréditaire, et l’ordre équestre, personnelle ; ou bien : Ordo senatorius, Ordo equester, constituant l’uterque ordo], et, parmi les deux noblesses, il n’y eut qu’une moitié des magistratures et des sacerdoces d'accessibles à chacune ». « (p. 56) La nobilitas devint [sous Auguste]... un ordre sénatorial légalement fermé, une pairie héréditaire ». « (p. 58) L’ancienne nobilitas de la république se maintient en fait à côté de l'ordre sénatorial sous la dynastie Julio-Claudienne. Mais les vieilles familles s'éteignirent rapidement ou furent détruites... à partir des Flaviens, la nobilitas républicaine a, dans l'État romain, une place encore plus restreinte que celle occupée par le patriciat à l'époque moderne de la République ». « (p. 82 1) Les ex-tribuns militaires jouent un rôle saillant dans la chevalerie des derniers temps de la République avant la réforme d'Auguste ». – WALTZING ; Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. II : « (p. 7) L'administration romaine fut créée presque tout entière par l'Empire. La république, même à l'époque où elle dominait déjà le monde, n'administrait pas ; elle n'avait que peu de fonctionnaires ou d'agents financiers... Avec l'Empire, l'administration prit un développement rapide et extraordinaire... »
[FN: § 2549-2]
Dict. DAREMB. SAGL. ; s. r. Senatus (CH. LÉCRIVAIN ; « (p. 1195) Auguste constitue définitivement et officiellement un ordre sénatorial, une sorte de pairie héréditaire, ouverte seulement par la concession du laticlave ou l’allectio, qui a le monopole des anciennes magistratures... La nouvelle nobilitas acquiert un nom spécial probablement dès le milieu du Ier siècle, en tout cas officiellement à l'époque de Marc-Aurèle et de Vérus, le nom de clarissimus... appliqué aux hommes, femmes et enfants. Elle comprend les sénateurs, leurs femmes et leurs descendants agnats jusqu'au troisième degré ».
[FN: § 2549-3]
WALTZING ; loc. cit., t. II : (p. 255) Ainsi l'initiative privée fut longtemps [du Ier au IIe siècle] seule à fonder les collèges, même ceux dont les membres étaient au service public ; l'État intervint peu à peu, d'abord pour encourager, ensuite pour établir lui-même les corporations [on observe des faits analogues dans nos sociétés civilisées, au XIXe siècle et au commencement du XXe]... Il faut distinguer deux périodes : l'une de liberté, qui dura à peu près deux siècles, l'autre de servitude, qui commence dans le cours du troisième [périodes ascendantes et descendantes d'une oscillation (§ 2553), analogues à celles que nous observons aujourd'hui]... Durant deux à trois siècles l'État n'usa d'aucune contrainte ; le collège était avant tout une association privée ; il s'organisait avec une liberté presque entière... ». « (p. 258) En résumé, ce qui distingue cette période, c'est un service librement accepté et l'absence de toute contrainte ».
[FN: § 2549-4]
MARQUARDT ; La vie priv. des rom., t. I : « (p. 193) Dans l'ancien droit le commerce était interdit aux sénateurs, le (p. 194) prêt à intérêt était mal famé ; mais Caton l'Ancien déjà faisait le commerce maritime, et qui avait de l'argent le prêtait à intérêt. Les gains, même les plus sordides, n'entraînèrent plus la perte de la considération : on les faisait toutefois réaliser par des fermiers, des affranchis ou des esclaves, et les capitaux des gens riches trouvaient, grâce à ces intermédiaires, des débouchés jusqu'alors inconnus. Cette raison, entre tant d'autres,... peut servir à expliquer comment sous l'Empire l'activité industrielle et commerciale se trouva presque tout entière concentrée aux mains des esclaves et des affranchis ». En note : « Les Grecs et les Orientaux avaient une aptitude toute particulière pour les opérations commerciales. La fortune d'un affranchi (patrimonium libertini, SEN. ; Ep. XXVII, 5) a passé en proverbe sous l'Empire » (§ 2597-3).
[FN: § 2549-5]
DURUY ; Hist. rom., t. V : « (p. 329) ...dans la hiérarchie sociale, beaucoup d'ingénus descendent, beaucoup d'esclaves montent, et ils se rencontrent à mi-chemin de la servitude à la liberté : déchéance pour les uns, progrès pour les autres ». « (p. 636) ...des inscriptions, des enseignes de magasin, des débris parfois informes... attestent cette transformation : la société agricole de Caton l'Ancien devenant la société industrielle de l'Empire [l'auteur oublie les chevaliers et les negotiatores de la fin de la République]. Ce n'était pas moins qu'une révolution économique, par conséquent sociale [pas une révolution, mais une transformation graduelle], qui... (p. 637) modifia profondément la loi civile. La même révolution s'opérait dans toutes les provinces. Voyez au musée de Saint-Germain les nombreux monuments funéraires d'hommes de métiers que les seules fouilles de la Gaule ont déjà mis au jour. Ces monuments attestent deux faits : l'aisance de ces industriels, assez riches pour se construire de coûteux tombeaux, et la fierté de ces représentants du travail libre... ». DION. CASSIUS (LII, 37, p. 690) suppose que Mécène disait à Auguste : « Honore les artisans et ceux qui travaillent utilement ».
[FN: § 2549-6]
FRIEDLÆNDER ; Mœurs rom., t. I : « (p. 60) Jusqu'à Vitellius, les affranchis eurent, en quelque sorte, le monopole des offices de cour, qui avait fait passer dans leurs mains presque tout le pouvoir, depuis Caligula. Vitellius fut le premier qui conféra quelques-unes de ces charges à des chevaliers ». « (p. 63) C'est dans les contrées de l'Orient... la Grèce, l'Asie Mineure, la Syrie et l'Égypte, que se recrutait presque exclusivement, à cette époque, la domesticité du palais impérial, ainsi que celle des autres grandes maisons de Rome. Tandis que le Nord et l'Occident fournissaient surtout les gardes du corps, auxquels les empereurs confiaient la défense de leur personne, ce furent des Grecs et des Orientaux qu'ils choisissaient de préférence pour leur service particulier et la gestion de leurs affaires. On vit ainsi continuellement (p. 64) reparaître au faîte du pouvoir des hommes sortis du sein des nations que l'orgueil romain méprisait le plus profondément, entre toutes. C'est que les Orientaux, comme un des leurs, Hérodien (III, 8, 11), s'est complu à le faire sonner, avaient le plus de sagacité... ». « (p. 80) Les richesses qui affluaient dans leurs mains [des affranchis], par suite de leur position privilégiée, étaient une des principales sources de leur pouvoir. Il est certain qu'à cette époque, où l'opulence des affranchis était devenue proverbiale, (p. 81) très peu de particuliers pouvaient rivaliser, à cet égard, avec cette classe de serviteurs de la maison impériale... Indépendamment de ce que leur rapportaient des postes lucratifs, les affranchis avaient dans les provinces comme à Rome, dans les administrations fiscales comme au service particulier de l'empereur, mille occasions d'accroître leur fortune, en profitant habilement des circonstances, même sans précisément commettre des rapines et des exactions... (p. 83) Possesseurs de si énormes richesses, les affranchis de la maison impériale éclipsaient tous les grands de Rome par leur luxe et leur magnificence ».
[FN: § 2549-7]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 103) Pour participer, sous l'Empire, au service avantageux des légionnaires, le détenteur du cheval équestre devait le résigner. Cela s'est souvent produit sous la forme d'une concession immédiate du centurionat de légion faite aux personnes qui sortaient pour cette raison de l'ordre privilégié ».
[FN: § 2549-8]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : Suite de la note du § 2548-2- : « (p. 111) Sous le Principat, la condition (p. 112) juridique des publicani est, dans l'ensemble, restée la même ; mais leur condition pratique se transforma complètement. La réorganisation monarchique de l'État fit de la chevalerie par ses chefs un ordre de fonctionnaires ; sa réorganisation financière permit en principe à l'État de se passer des intermédiaires pour la perception des recettes comme pour les dépenses, et elle enleva par conséquent le terrain à la grande spéculation pratiquée par les chevaliers sous la République ».
[FN: § 2549-9]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 162) L'exclusion jalouse de l'ordre sénatorial des fonctions militaires, qui caractérise le Principat depuis les Sévères, est étrangère au système d'Auguste ».
[FN: § 2549-10]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 148) Auguste a sans doute retiré aux contubernales, que l'on rencontre encore dans les derniers temps de la République, ce qu'il leur restait du caractère militaire ». En note : « Nous avons montré, dans la théorie de la Capacité d'être magistrat, au sujet du service militaire, que le service en qualité de contubernales s'est maintenu jusqu'à César. Mais il doit avoir perdu de plus en plus son caractère militaire, non pas seulement parce que le service d'un cavalier qui n'était plus dans les rangs n'était pas sérieux, mais parce qu'il y avait, dans la cohors amirorum, de plus en plus des gens. qui ne servaient même pas nominalement... ». « (p. 170) L'accomplissement du service d'officier a pendant longtemps été, sous le Principat, la seule voie donnant accès aux fonctions équestres... (p. 171) Avec le temps, il s'ouvrit, pour entrer dans cette carrière, à côté de la voie militaire, une voie civile. L'existence ne peut en être établie au premier siècle ; mais depuis Hadrien, le service administratif, commencé par le bas de l'échelle, peut conduire, sans service d'officier, aux postes supérieurs... (p. 172) Les objections qui étaient encore opposées du temps d'Antonin le Pieux aux nominations de scribes et d'avocats, s'effacent peu à peu ; le temps où une période préalable d'instruction militaire était imposée aux fonctionnaires administratifs n'est plus ». T. II : « (p. 164)... ce tribunat (p. 165) a essentiellement perdu son importance militaire sous l'Empire, et... s'il n'est pas une fonction nominale, il y est cependant plutôt une fonction administrative qu'un véritable commandement ». En note : « La rédaction de la loi Julia Municipa1is et les dispositions rapportées [divers exemples cités par l'auteur] montrent que le séjour en province près du gouverneur était tenu pour un service ». L'auteur continue : « Le lien rigoureux établi sous l'Empire entre le service d'officier et la carrière politique est plus apparent que réel ; quant au fond, le service et le commandement militaire ont été un élément beaucoup plus essentiel de cette carrière sous la République, même à sa fin, que sous l'Empire ». MARQUARDT ; L'organ. milit. Sous l'Empire, « (p. 64) le tribunat militaire était donc une sorte de fonction honorifique donnant rang de chevalier ; on comprend que les empereurs aient conféré cette dignité à des personnes qui n'avaient pas l'intention de se vouer à la carrière militaire ; elles se contentaient de servir pendant un semestre (tribunatus semestris), (p. 6,5) puis elles rentraient dans la vie privée, en possession du titre qu'elles avaient ainsi obtenu ».
[FN: § 2550-1]
C'est surtout la sortie de certaines de ces castes qui est interdite ; ainsi celle des décurions et des corporations, parce qu'elles impliquent, dans l'État, des charges très lourdes. Les décurions jouissent de privilèges judiciaires et d'honneurs : cependant, vers la fin de l'Empire, ils fuient la curie autant qu’ils peuvent. Ce mouvement commence bientôt, avec la cristallisation de la société. – ULPIEN, dans le Dig., L, 2, 1 : Decuriones quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses, provinciae in patrium solum revocare et muneribus congruentibus fungi curet. – Ibidem, 2, 7, (2) : Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur. – WALTZING ; loc. cit. § 2549-1 : « p. 7) Si les empereurs rompirent avec les traditions de la république, c'est qu'ils y furent forcés. L'administration dépend de la constitution politique [rapports de cause à effet substitués à ceux de mutuelle dépendance]. Or, la révolution qui était en germe dans les réformes d'Auguste, quoiqu'elle ait mis trois siècles pour arriver à son complet développement ; ou mieux, pour se débarrasser de ses apparences demi-républicaines, peut se résumer ainsi : tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'Empereur ». « (p. 260) À Rome, l'absence de liberté économique fut une conséquence du manque de liberté politique. Ce fut le despotisme et la centralisation excessive qui tuèrent la liberté du travail ». Il n'est pas du tout certain que l'absence de liberté économique soit une conséquence de l'absence de liberté politique ; souvent, au contraire, la diminution de la première liberté coïncide avec une augmentation de la seconde. Pour le prouver, il suffit de citer l'exemple des peuples civilisés de notre époque, chez lesquels la liberté politique s'accroît, tandis que la liberté économique diminue (§ 2553-1). Notre ploutocratie démagogique a appris à se servir de la « liberté » et peut-être aussi de l'anarchie politique comme d'un instrument profitable. Nombre d'auteurs du temps présent sont poussés à rejeter la faute de la décadence de l'Empire romain sur le « despotisme » impérial, parce qu'ainsi ils détournent leurs regards d’une décadence analogue, à laquelle pourrait conduire le régime ploutocratique démagogique. Les corporations fermées de l'Empire romain et les monopoles d'État étaient un mal ; les syndicats obligatoires qu'on veut imposer aujourd'hui, et les monopoles d'État qu'on institue en nombre toujours croissant sont un bien. La cause de la différence, c'est le « despotisme » impérial. On a trouvé le bouc émissaire. L’auteur réfute lui-même sa thèse d'une organisation imposée par le despotisme impérial. « (p. 17) Est-ce à dire que le service de ces collèges fut dès le début une véritable corvée imposée et exigée comme l'impôt ? Non, ce système se développa lentement [on parcourt la courbe descendante d'une des oscillations mentionnées au § 2553]. Dans les premiers siècles, les dignités municipales n'étaient pas imposées non plus : elles étaient recherchées, au contraire, parce que l'honneur compensait la peine et la dépense [§ 2607-3]. Pour les corporations aussi, les avantages l'emportèrent au commencement sur les charges, et c'est sans répugnance que leurs membres acceptèrent, soit collectivement, soit individuellement, de servir l'État ou les villes, et consentirent à remplir une fonction spéciale que l'État aurait pu imposer à tous les contribuables ». Donc, s'ils ont « accepté » cette organisation et s'ils ont donné leur « consentement », on ne peut pas dire que cela leur a été imposé par le despotisme impérial. Aujourd'hui aussi, les citoyens « acceptent » ; ils veulent même les chaînes dont la ploutocratie démagogique profite. Ce que dit Waltzing dans le passage suivant, de l'Empire en décadence, on peut le répéter mot pour mot de l'état de choses vers lequel s'acheminent les peuples civilisés : « (p. 261) Peu à peu, cette administration si fortement organisée, qui avait ses agents partout [qu'on la compare avec l'énorme augmentation du nombre d'employés de nos gouvernements] et se mêlait de tout [pourtant pas de ce que mangeaient et buvaient les citoyens ; l'antialcoolisme est une maladie moderne] couvrit l'Empire tout entier. La population tout entière fut soumise à des fonctionnaires sans responsabilité sérieuse. S'occupant elle-même de tout, l'administration impériale commença par tuer le peu d'initiative privée que l'état social des Romains rendait possible, parce que là où le pouvoir fait tout, le citoyen ne fait plus rien et se désintéresse ». Il continue en disant : « Puis elle anéantit toute liberté, parce que personnes, et biens étaient à sa merci [comme ils sont à la merci des majorités parlementaires manipulées par nos ploutocrates démagogues], et elle facilite cette épouvantable oppression financière qui est restée célèbre [et qui peut-être sera dépassée par celle à laquelle s'acheminent nos sociétés] ». Ici, il y a une erreur. Ce n'est pas l'administration impériale qui anéantit la liberté des citoyens. C'est plutôt parce que celle-ci avait disparu que celle-là put exister. Tibère entrevoyait le fait quand il disait des sénateurs : « Oh ! hommes disposés à la servitude ! » – Memoriae proditur Tiberium, quoties curia egreditur, graecis verbis in hunc modum eloqui solitum : « 0 homines ad servitutem paratos ! » (TACIT. ; Ann., III, 65). – La liberté meurt le jour où les citoyens acceptent, invoquent les chaînes, et non celui où on leur impose ce qu'ils ont demandé, ni celui où ils en subissent les conséquences. Parmi les forces qui agissent sur l'homme, il en est une qui le pousse à conserver la liberté de ses actes, et beaucoup d'autres qui le poussent à les entraver, par intérêt, par ascétisme, par désir d'uniformiser les lois, les mœurs, etc. Suivant l'intensité diverse de ces forces, les peuples disposent de plus ou moins de liberté. Si les ascètes et les jurisconsultes ont été et sont encore parmi les plus grands destructeurs de la liberté, c'est parce que les citoyens se laissent amorcer par le désir d'imposer à tout le monde un genre de vie uniforme, au prix de n'importe quelles souffrances physiques et morales ; et ils ne se rendent pas compte, ils ne veulent pas se rendre compte que ceux qui sont aujourd'hui les oppresseurs demain seront les opprimés.
[FN: § 2550-2]
Remarquables sont les analogies entre cet état social et celui de la Chine quand elle fut conquise par les Tartares. Mais ceux-ci s'assimilèrent aux vaincus beaucoup plus que les Barbares qui envahirent l'empire romain. Ils adoptèrent leurs institutions au lieu de les détruire et de faire disparaître la rigidité sénile de la nation. C'est pourquoi la Chine continua à être un pays pacifique. Cela explique en partie son sort actuel, si différent de celui du Japon. Les Européens contemporains qui rêvent de « la paix par le droit », qui imaginent un état social où « civilisation, justice, droit » assureront les nations contre l'oppression de leurs voisins, sans qu'elles aient besoin de défendre leur indépendance par les armes, ces braves gens peuvent trouver dans l'histoire de la décadence de l'empire romain, surtout dans celle de l'empire d'Orient et dans celle de la Chine, de nombreux indices de ce que sera réellement l'état auquel ils veulent acheminer leurs nations. On sait que les Chinois, tout comme nos pacifistes, estimaient qu'un peuple devait faire plus grand cas de sa civilisation que de sa puissance militaire. C'est pourquoi, dans leur histoire légendaire, ils parlent de peuples soumis à la Chine, non par la force des armes, mais par respect pour les vertus du gouvernement chinois. Par exemple, Hist. gén. de la Chine ou Annales de cet Empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, t. I « (p. 49) La cinquième année du règne de Yao, Yuei-chang-chi, prince d'un pays situé au midi de la Chine, sur la seule réputation de l'empereur, et charmé des grandes choses qu'il entendoit dire de lui, se fit une gloire de venir se soumettre à ses loix, et de le reconnoître pour son souverain... ». « (p. 221) La sixième année du règne de Cao-Tsong, six royaumes étrangers, dont la langue était inconnue à la Chine, envoyèrent des ambassadeurs, qui avoient avec eux chacun leur interprète, pour rendre hommage à Cao-Tsong, et se soumettre à ses loix ». Cfr. p. 274, 316, et passim. La légende veut aussi que des rebelles aient été soumis par la vertu seule. Un certain Yeou-miao se révolta contre l'Empereur, qui envoya contre lui Yu avec la troupe : « (p. 105) Yu partit à la tête de ses troupes, et comme il vouloit éviter d'en venir aux mains, pour épargner le sang, il se contenta de le tenir assiégé dans son gouvernement ; il se passa plus d'un mois sans qu'il parût que Yeou-miao, ni les révoltés se disposassent à se soumettre, ce qui causoit du chagrin à Yu. Pé-y qui accompagnoit Yu dans cette expédition, s'en apercevant, lui tint ce discours : „ La seule vertu peut toucher le Ciel, il n'y a point de lieu, quelque éloigné qu'il soit, où elle ne pénètre... “ ». C'est ainsi que dissertent aujourd'hui nos humanitaires, sauf qu'ils invoquent le droit, la justice, la démocratie, au lieu du Ciel. « (p. 106) Yu, pénétré de la sublimité de ces paroles, pour témoigner à Pé-y combien il en étoit touché, ordonna, sur le champ, à ses troupes de se retirer et les fit camper dans un endroit fort éloigné de Yeou-miao [c'est ainsi qu'agissent nos humanitaires en cas de grève ; mais la réalité leur est habituellement moins favorable que la légende ne le fut à Yu]... Au bout de soixante-dix jours, Yeou-miao, et les autres rebelles vinrent se soumettre ». – En des temps plus historiques, en l'an 731 de notre ère, le roi Tsan-pou envoya une ambassade à l'empereur Hiuen-Tsong, pour lui demander les livres sacrés de la Chine. « (t. VI, p. 220) Yu-hiou-lieï, qui avoit soin de ces livres, lui représenta, à cette occasion, que quoique le prince de Tong-ping fût parent assez proche de la famille des Han, cependant ils lui avoient refusé les livres d'histoire qu'il demandoit ; qu'à plus forte raison on ne devoit pas en accorder au prince de Tou-san, ennemi de la Chine, parce que ce seroit lui procurer les moyens d'apprendre la manière de bien gouverner, et lui fournir des armes contre l'empire. Hiuen-Tsong, arrêté par cette objection, proposa l'affaire à son conseil, qui fut d'avis de donner ces livres au roi Tsau-pou, afin qu’il pût s'instruire des sages maximes qu'ils renferment, et il décida que non seulement il n'y avoit point d'inconvénient, mais qu'il étoit même nécessaire de les accorder, afin que ce prince y puisât les grands principes de droiture, de bonne foi et de vertu qu'on doit chercher à faire connoître à tout le monde. L'empereur suivit la décision de son conseil ». Cette controverse sur la vertu des livres de morale, qu'on estime capables de donner force et pouvoir à une nation, est digne de nos « intellectuels », qui substituent simplement les maximes de leur « droit international », ou d'autres semblables, à celles des livres chinois.
[FN: § 2551-1]
WALTZING ; loc. cit. § 2549-1, t. II « (p. 263) Le mouvement ascensionnel, qui renouvelle et maintient la classe moyenne et la classe supérieure, était arrêté ». « (p. 303) ...bientôt [après Constantin] les hommes seront partout liés à leur condition avec leurs biens et leur famille. Ce furent probablement les curiales qui se virent d'abord soumis à cette loi ; peu à peu, elle fut appliquée à toutes les conditions [de même aujourd'hui on a commencé à exploiter les gens aisés ou riches ; plus tard on exploitera les autres]. On naissait curiale, membre d'une corporation, employé d'un bureau, soldat d'une cohorte, colon d'un champ. On était forcé de succéder aux charges de ses pères. Presque tous les habitants de l'Empire sont assujettis de par leur naissance à une condition déterminée : obnoxii condicioni, condicionales, originarii ». Ainsi disposait la loi, mais en pratique la faveur de l'empereur permettait une certaine circulation : « (p. 318) Ces faveurs spéciales ne devaient pas être rares ; ce qui le prouve, c'est le grand nombre de lois où les princes défendent de leur adresser des suppliques pour obtenir un pareil rescrit [qui dispensait de la condition imposée par la loi]. C'est surtout par la protection des grands [aujourd'hui : la protection des politiciens] que l'on parvenait à les arracher au prince, soit que l'empereur cédât à leurs sollicitations, soit qu'il se laissât tromper par les ruses des corporati et de leurs protecteurs ».
[FN: § 2552-1]
Après avoir tenté d'expliquer par des considérations sur les mœurs les changements du luxe à Rome (§ 2585-3-), TACITE émet un doute qui le rapproche beaucoup de la réalité. Ann., III 55 : Nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut, quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur : nec omnia apud priores meliora... « à moins que ce ne soit peut-être le propre de toutes les choses de parcourir un cycle, de telle sorte que les mœurs changent comme les vicissitudes des temps ; tout n'était pas meilleur chez les anciens... ».
[FN: § 2553-1]
Ainsi que nous l'avons dit si souvent, les faits du présent servent à comprendre ceux du passé, et vice-versa. C'est pourquoi il est bon de prêter attention à l'exemple contemporain de la Suisse. Cet État fédéral est admirable en ce qu'il a fait vivre en parfaite harmonie et en parfait accord trois races ailleurs hostiles ; l'allemande, la française, l'italienne. On le doit non seulement aux mœurs du peuple, qui sont les meilleures d'Europe, mais surtout à l'indépendance des Cantons. Elle a supprimé les contrastes qui, en d'autres États, apparaissent entre différentes nationalités ; elle a permis à chacune de vivre selon ses goûts, sans être gênée par ceux des autres. Mais, depuis quelques années, il se dessine un mouvement qui s'accélère toujours plus, de centralisation politique et administrative, d'affaiblissement de la liberté des Cantons et des individus, d'entreprises et de monopoles fédéraux, de cristallisation des institutions judiciaires, économiques, sociales. Ce mouvement est en partie semblable à celui qui s'accomplit en France, en Angleterre, en Italie, sous les auspices et en faveur de la ploutocratie démagogique. Pour le moment, on ne perçoit que son premier effet : celui d'accroître la prospérité des pays où il se produit, en absorbant la somme d'énergies sociales et économiques accumulées par les efforts des particuliers, dans la période de liberté. Précisément à cause de cet effet, le mouvement est bien accueilli, favorisé par la majorité des personnes auxquelles on impose de nouveaux liens. Pour l'Empire romain de la décadence, on peut se demander s'il en a vraiment été de même, et si les liens n'ont pas été imposés par les empereurs qui gouvernaient avec la force des légions. Pour la France, l'Angleterre, l'Italie, ce doute disparaît en partie ; mais il n'est pas entièrement dissipé, car on peut objecter que les parlements ne représentent pas précisément les tendances des citoyens. Pour la Suisse, aucun doute n'est possible. On remarquera, en effet, que dans ce pays aucun changement ne peut être apporté à la Constitution fédérale, s'il n'est approuvé par la majorité des citoyens électeurs et des Cantons. C'est donc avec le plein consentement des uns et des autres que se désagrège l'ancienne organisation, qui apporta tant de prospérité, tant de paix, tant d'harmonie au pays, et c'est avec ce consentement qu'on en institue une nouvelle. Si le sens du mouvement demeurait toujours le même, ce qui peut encore ne pas arriver, cette organisation nouvelle aboutirait à un État centralisé, gouverné par la partie la plus nombreuse, la partie allemande, avec des procédés de gouvernement analogues à ceux de l'Empire allemand. Peut-être aussi ferait-elle surgir l'irrédentisme, qui, jusqu'ici, est parfaitement inconnu dans le pays. Ces faits, qui se passent sous nos yeux, confirment la conclusion à laquelle nous a conduit l'examen direct de l'histoire de la décadence de l'Empire romain : que la cristallisation des institutions fut voulue, ou du moins consentie par la population, plutôt qu'imposée par le gouvernement impérial.
[FN: § 2553-2]
L'analogie est peu frappante, mais pourtant notable, entre la façon dont certains empereurs romains achetèrent le pouvoir des prétoriens ou des légions, et la façon dont les politiciens achètent le pouvoir des électeurs, dans la ploutocratie démagogique contemporaine. Pourtant, aujourd'hui, ces opérations se recouvrent du moins de certains voiles ; à Rome, ils furent au contraire brutalement déchirés, lorsque après l'assassinat de Pertinax, les prétoriens mirent l'Empire aux enchères. DIO CASS. ; LXXIII, 11, p. 1234 : ![]()
![]()
![]()
![]() . « Alors se passa une chose honteuse et indigne de Rome. Comme sur une place publique et dans un marché, elle et tout son empire furent mis aux enchères ». Didius Julianus acheta l'Empire. Dion dit de lui qu'il « était toujours disposé à de nouvelles entreprises » (p. 1233). En cela il était semblable à nos ( spéculateurs ».
. « Alors se passa une chose honteuse et indigne de Rome. Comme sur une place publique et dans un marché, elle et tout son empire furent mis aux enchères ». Didius Julianus acheta l'Empire. Dion dit de lui qu'il « était toujours disposé à de nouvelles entreprises » (p. 1233). En cela il était semblable à nos ( spéculateurs ».
[FN: § 2553-3]
Les grosses dépenses s'étendaient à toute l'administration. LUIGI LUZZATTI ; Corriere della Sera, 3 septembre 1915 : « ... Lorsqu'il était chancelier de l’Échiquier, Lloyd George ne faisait pas d'économies. Il taxait avec facilité, mais augmentait trop l'administration et ses organismes. Ce fut lui qui permit que, des 400 livres sterling d'indemnité accordée à chaque membre de la Chambre des Communes, 100 livres fussent défalquées pour l'impôt sur le revenu, ce qu'on ne voulut pas faire en Italie. Ensuite, les dépenses pour les ministres s'accrurent notablement aussi. Au lieu d'un seul, on ajouta un second fauteuil ministériel, avec 5 000 livres sterling de traitement, etc., etc. On rapporte des cas singuliers, ressemblant un peu aux dépenses pour la péréquation des impôts fonciers en Italie. La commission qui évalue les revenus fonciers, dans le but de taxer ce qui n'est pas le produit du travail ou du capital, mais des circonstances favorables, coûte déjà 676 mille livres sterling, et a recueilli jusqu'à présent un produit de 50 mille livres ! [On institue de semblables commissions pour faire gagner ses amis et pour donner une satisfaction aux instincts démagogiques. En cela, la commission mentionnée a atteint son but]. Le 29 juin, cette énormité fut mise en lumière à la Chambre des Communes, et discutée sans aucune conclusion [parce que les loups ne se mangent pas entre eux]. Les administrations locales imitent le gouvernement. Par exemple, – chose excellente, mais en des temps de paix profonde – on crée des réseaux complets de routes indépendantes pour les automobiles ; et le subside de l'État au budget atteint presque un million et demi de livres sterling par année... ».
[FN: § 2553-4]
C'est à peu près ce que semble avoir compris Foscolo, lorsque, dans I sepolcri , il écrit que Machiavel « fait connaître aux gens les larmes et le sang dont dégoûte le sceptre des souverains ».
[FN: § 2553-5]
[NOTE DU TRADUCTEUR] G. LE BON ; Les Opinions et les croyances ; « (p. 136) En économie politique, par exemple, les convictions sont tellement inspirées par l'intérêt personnel qu'on peut généralement savoir d'avance, suivant la profession d'un individu, s'il est partisan ou non du libre-échange ».
D'une façon générale, la lecture des ouvrages de G. Le Bon sur la psychologie des collectivités sera des plus profitables, en particulier pour l'étude des résidus et des dérivations. La méthode vraiment scientifique de cet auteur, son originalité, sa pénétration, ainsi que la clarté et la concision de ses écrits, le placent tout à fait en dehors de la foule des sociologues-métaphysiciens de nos temps.
[FN: § 2556-1]
LIV. XLII, 32 : ... et multi voluntate nomina dabant, quia locupletes videbant, qui priore macedonico bello, aut adversus Antiochum in Asia, stipendia fecerant.
[FN: § 2557-1]
Cicéron nous parle d'un cas dans lequel il y avait une telle concurrence pour acheter les suffrages, que l’intérêt de l'argent monta du 4 au 8 %. – CIC. ; Ad. Att. ; IV, 15 : Sequere nunc me in campum. Ardet ambitus ; ![]() : fenus ex triente idibus Quinctilibus factum erat bessibus. Dices, istuc quidem. non moleste fero. O virum ! o civem ! (§ 2257 2, 2256 2]. – PLUTARCH. ; Sulla, 5, 4 : « Quand il [Sulla] exerçait la préture, parlant avec indignation contre César, il dit qu'il userait contre lui du pouvoir de sa fonction. César répondit en riant : „ Tu dis avec justesse ta fonction, puisque tu l'as achetée “ ». – Marius fat aussi accusé d'avoir acheté les suffrages pour obtenir la préture. PLUTARCH. ; Marius, 5, 2. – APP. ; De bell. civil.., II 19 : « ... et le peuple lui-même était aux marchés comme une marchandise ». Cfr. 2548-8.
: fenus ex triente idibus Quinctilibus factum erat bessibus. Dices, istuc quidem. non moleste fero. O virum ! o civem ! (§ 2257 2, 2256 2]. – PLUTARCH. ; Sulla, 5, 4 : « Quand il [Sulla] exerçait la préture, parlant avec indignation contre César, il dit qu'il userait contre lui du pouvoir de sa fonction. César répondit en riant : „ Tu dis avec justesse ta fonction, puisque tu l'as achetée “ ». – Marius fat aussi accusé d'avoir acheté les suffrages pour obtenir la préture. PLUTARCH. ; Marius, 5, 2. – APP. ; De bell. civil.., II 19 : « ... et le peuple lui-même était aux marchés comme une marchandise ». Cfr. 2548-8.
[FN: § 2558-1]
DIOD. SIC. ; XXXV11, 2 : L'auteur parle de la guerre marsique : « La première cause de la guerre fut que les Romains passèrent de la vie ordonnée, frugale et continente, qui leur procura une si grande prospérité, au luxe funeste et à l'insolence ». Cela se répète dans tous les temps où un peuple s'enrichit. Cfr. DANTE ; Parad., XV, 97 et sv. ; Boccace, VI, 10 : « pource que les raffinements du luxe d'Égypte n'étaient pas encore, sinon en petite partie, passés en Toscane, comme ils y sont venus depuis en foule, au grand dommage de l'Italie » (Trad. F. REYNARD).
[FN: § 2560-1]
DURUY ; Hist. des Rom., t. II. Il continue : « (p. 283) Voilà le grand fait de cette période et la cause de tous les bouleversements qui vont (p. 284) suivre [très bien, pourvu qu'on entende le changement de proportion des deux classes indiquées] ; car, avec cette classe, disparurent le patriotisme, la discipline et l'austérité des anciennes mœurs... » C'est là. une dérivation éthique renfermant un brin de vérité : une allusion à la prédominance des résidus de la Ie classe.
[FN: § 2561-1]
MARQUARDT ; La vie privée des R., t. II : (p. 15) Tandis que l'acquisition des provinces causait en Italie cette crise agricole, elle imprimait en même temps au commerce de l'argent et à la spéculation une extraordinaire impulsion. De tout temps les Romains eurent du goût pour les profits de cette sorte : ils avaient beau les juger indécents et odieux, ils ne pouvaient s'empêcher de les trouver abondants à souhait... À plus forte raison le scrupule moral s'est-il apaisé quand les provinces s'ouvrent à ce genre d'exploitation : à peine une nouvelle province est-elle conquise, qu'elle voit s'abattre une nuée de traitants romains... (p. 16) La noblesse fait fortune en administrant les provinces ; les chevaliers, en prenant à ferme les impôts et les faisant rentrer par d'atroces exactions : grands et petits pressurent à l'envi les pays conquis. La spéculation est encore encouragée par les concessions d'entreprises, ouvertes par les censeurs au nom de l'État, ou même par les communes et les simples particuliers : perception des impôts, construction de temples, de routes et d'aqueducs, entretien des édifices publics, des ponts et des égouts, fournitures à l'usage du culte et des jeux publics, puis encore affaires privées de toutes sortes, construction d'une maison, enlèvement d'une récolte, liquidation d'une masse successorale ou d'une distribution entre créanciers, cérémonie des obsèques ; autant de travaux concédés à forfait et riches de profit pour le spéculateur qui les prend à entreprise ». Ici Marquardt tombe dans l'erreur habituelle des éthiques qui s'imaginent que l'odieux spéculateur gagne toujours. Oui, ces travaux procurent des gains et la prospérité au spéculateur expert, habile dans les combinaisons ; ils provoquent des pertes et la ruine au spéculateur inexpérimenté, qui n'a pas d'aptitudes pour trouver et utiliser les combinaisons. De la sorte, il se fait un choix. Les individus possédant des résidus de la Ie classe et une grande ingéniosité s'élèvent ; les autres sont éliminés.
[FN: § 2561-2]
DELOUME ; Les manieurs d'argent à Rome : « (p. 45) ...Les chevaliers surtout, qui avaient quelques avances et que les préjugés aristocratiques n'arrêtaient pas, s'enrichissaient par les entreprises ou les fermages de l'État dont ils se rendaient adjudicataires. L'or des vaincus entrait sans mesure dans les coffres des negotiatores et des publicains. Les patriciens de race fidèles aux anciennes mœurs, dont le nombre diminuait tous les jours, étaient réduits aux seuls bénéfices de l'agriculture ; ils furent débordés de toutes parts. Ils abandonnaient, après des résistances héroïques et des prodiges d'habileté, chaque jour un nouveau privilège à la plèbe [en réalité : aux bandes dirigées par les spéculateurs]. Leurs patrimoines perdaient leur valeur relative, et les droits enlevés à la naissance, la fortune les conquérait par le fait des mœurs, autant que par celui des lois. Le siège de l'autorité et de l'influence se déplaçait ainsi ; il passait... des patriciens aux riches, aux homines novi. La morale de l'intérêt menaçait de n'être plus tempérée par les traditions de famille et de race [la proportion des résidus de la Ire et de la IIe classe change]. Aussi, on a pu appliquer aux assemblées politiques de Rome, ce que M. Guizot a écrit de celles de l'Angleterre : „ Dans un des premiers parlements du règne de Charles I, on remarquait avec surprise que la Chambre des communes était trois fois plus riche que la Chambre des lords... Les simples gentilshommes, les francs-tenanciers, les bourgeois, uniquement occupés de faire valoir leurs terres, leurs capitaux, croissaient en richesse, en crédit, s'unissaient chaque jour plus (p. 46) étroitement, attiraient le peuple entier sous leur influence...“ … À Rome, la révolution fut plus complète encore qu'en Angleterre ».
[FN: § 2562-1]
M. Emilius Scaurus est un type de spéculateur romain qui, mutatis mutandis, présente cependant des ressemblances avec les nôtres. Il était gendre de Sulla, et il semble qu'il n’a pas abusé de cette parenté pour s'enrichir. CIC. ; Pro M. Aemilio Scauro Argumentum ; M. Scaurus, M. Securus filius, qui princeps senatus fuit, vitricum habuit Sullam : quo victore et munifico in socios victoriae, ita abstinens fuit, ut nihil neque donare sibi voluerit, neque ab hasta emerit. Plusieurs de nos spéculateurs agissent de même et sont honnêtes dans les affaires privées. Parvenu à l'édilité, il fit comme les spéculateurs romains et les nôtres qui sèment pour moissonner. Aedilitatem summa magnificientia gessit, adeo ut in eius impensas opes suas absumpserit, magnumque aes alienum contraxerit. Les spéculateurs romains dépensaient leur argent. Les nôtres dépensent celui des contribuables ; mais en cela ils ont été devancés par Périclès. ARIST. ; ![]() , 27. L'auteur nous dit que Périclès n’étant pas suffisamment riche pour lutter de libéralité avec Cimon (lutte habituelle entre les parvenus et ceux qui possèdent une fortune de famille), imagina de faire des cadeaux aux citoyens avec leur propre argent. Pline décrit la magnificence d'un théâtre édifié par Scaurus pendant son édilité. Contrairement à ce qui est dit plus haut, il semble faire remonter à Sulla la puissance de Scaurus. – PLIN. ; Nat. hist., XXXVI, 24, 10 (XV) Non patiar istos duos Nerones, ne hac quidem gloria famae frui : docebimusque etiam insaniam eorum victam privatis operatibus M. Scauri, cuius nescio an aedilitas maxime prostraverit mores [toujours le fait particulier substitué au fait général, l'anecdote aux uniformités générales, le rapport de cause à effet à la mutuelle dépendance], maiusque sit Sullae malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot milium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, quae umquam fuere humana manu facta, non temporaria mora, verum etiam aeternitatis destinatione. Theatrum hoc fuit. Le grain produit la moisson. – Arg. cit. : Ex praetura provinciam Sardiniam obtinuit – puis on récolte –in qua neque satis abstinenter se gessisse existimatus est et valde arroganter : quod genus morum in eo paternum videbatur, cum cetera industria nequaquam esset par. Accusé de ce fait à Rome, il fut défendu par Cicéron, qui le savait pourtant coupable. Quand cet orateur s'apprêtait à le défendre, il écrivaità Atticus (IV, 15) que, si Scaurus n’était pas élu consul, il s'en tirerait difficilement. Le procès eut lieu et Scaurus fut acquitté à une grande majorité. (Asc. ; Pro M. Scaur., s. r. L. ipse Metellus). Se souvenant de ses libéralités et en espérant probablement d'autres nouvelles, le peuple le favorisait. –Asc. ; loc. cit. : Cato praetor, cum vellet de accusatoribus in consilium mittere, multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini, ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. De même aujourd'hui, les électeurs se montrent reconnaissants envers nos ploutocrates pour les profits passés, dans l'espérance de profits futurs (§ 2262).
, 27. L'auteur nous dit que Périclès n’étant pas suffisamment riche pour lutter de libéralité avec Cimon (lutte habituelle entre les parvenus et ceux qui possèdent une fortune de famille), imagina de faire des cadeaux aux citoyens avec leur propre argent. Pline décrit la magnificence d'un théâtre édifié par Scaurus pendant son édilité. Contrairement à ce qui est dit plus haut, il semble faire remonter à Sulla la puissance de Scaurus. – PLIN. ; Nat. hist., XXXVI, 24, 10 (XV) Non patiar istos duos Nerones, ne hac quidem gloria famae frui : docebimusque etiam insaniam eorum victam privatis operatibus M. Scauri, cuius nescio an aedilitas maxime prostraverit mores [toujours le fait particulier substitué au fait général, l'anecdote aux uniformités générales, le rapport de cause à effet à la mutuelle dépendance], maiusque sit Sullae malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot milium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, quae umquam fuere humana manu facta, non temporaria mora, verum etiam aeternitatis destinatione. Theatrum hoc fuit. Le grain produit la moisson. – Arg. cit. : Ex praetura provinciam Sardiniam obtinuit – puis on récolte –in qua neque satis abstinenter se gessisse existimatus est et valde arroganter : quod genus morum in eo paternum videbatur, cum cetera industria nequaquam esset par. Accusé de ce fait à Rome, il fut défendu par Cicéron, qui le savait pourtant coupable. Quand cet orateur s'apprêtait à le défendre, il écrivaità Atticus (IV, 15) que, si Scaurus n’était pas élu consul, il s'en tirerait difficilement. Le procès eut lieu et Scaurus fut acquitté à une grande majorité. (Asc. ; Pro M. Scaur., s. r. L. ipse Metellus). Se souvenant de ses libéralités et en espérant probablement d'autres nouvelles, le peuple le favorisait. –Asc. ; loc. cit. : Cato praetor, cum vellet de accusatoribus in consilium mittere, multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini, ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. De même aujourd'hui, les électeurs se montrent reconnaissants envers nos ploutocrates pour les profits passés, dans l'espérance de profits futurs (§ 2262).
[FN: § 2566-1]
Que l'on compare la révolte des Jacques, en 1358, et la révolution française de 1789. Il est impossible d'admettre que les souffrances du peuple fussent plus grandes au temps de la seconde qu'à celui de la première. Cela ne prouve pas que ces souffrances ne soient pas l'une des forces agissantes : cela montre qu'elles ne sont pas la seule ni la plus efficace. On trouve une autre différence entre ces deux révoltes, dans l'emploi de la force par la classe gouvernante. Cet emploi apparaît puissant et sûr dans la première, faible et incertain dans la seconde. Là encore, nous dirons qu'on n'en peut pas conclure que l'emploi de la force suffise à réprimer les révoltes ; mais on peut voir sans peine qu'étant donné ce but, cet emploi est parmi les causes les plus efficaces. Que serait-il arrivé si les gouvernants de 1789 avaient combattu avec l'énergie dont ont fait preuve ceux de 1358 ? Nous ne pouvons le dire avec certitude (§ 139), mais nous, pouvons affirmer que les gouvernants auraient eu de plus grandes probabilités de victoire qu'il ne leur en restait avec la résignation humble et vile qu'ils manifestèrent. Toute l'histoire démontre que si l'on peut être vainqueur ou vaincu en combattant vaillamment, on est sûrement vaincu lorsqu'on fuit le combat ; et l'on voit se vérifier toujours le proverbe : Qui se fait agneau, le loup le mange. Pour la Jacquerie, voir dans SIMÉON LUCE la description des souffrances des gouvernés et les odieuses cruautés des gouvernants. S. LUCE ; Hist. de la Jacq. L'auteur décrit le combat de Meaux. « (p. 141) Si l'on en croyait Froissart, depuis le commencement jusqu'à la fin du combat, les nobles n'eurent que la peine de tuer, sans courir eux-mêmes le moindre danger. Jamais on ne frappa plus en plein ni à la fois avec plus d'acharnement et de mépris dans la chair humaine. Il faut lire dans le chroniqueur l'expressive et vivante peinture qu'il nous a tracée de cette épouvantable boucherie ». Suit une citation de Froissart ; puis : « (p. 142) Toutefois, la victoire dut être plus chèrement achetée que Froissart ne semble ici le dire ; car les assaillants parvinrent jusqu'à la barrière et au delà. Plusieurs nobles furent tués, notamment [suivent des noms de gens tués]. Il est certain, d'autre part, que bon nombre de gens d'armes de Paris, ainsi que beaucoup de bourgeois de Meaux, réussirent à s'échapper, comme l'attestent encore aujourd'hui les nombreuses lettres de rémission qui leur furent délivrées plus tard (p. 143) sur le fait de leur participation à l'attaque du marché de Meaux. Quoi qu'il en soit, la vengeance que les nobles exercèrent après l'issue de la lutte ne fut pas moins impitoyable que la lutte elle-même. Toute la ville fut mise au pillage. Non seulement les habitations des particuliers, mais les églises elles-mêmes furent saccagées : on n'y laissa rien qui pût avoir quelque valeur. Une partie de la population de Meaux fut massacrée. Ceux des habitants qui eurent la vie sauve furent emmenés prisonniers dans la citadelle. Le maire Soulas, pris pendant le combat, fut pendu. Cela fait, les nobles mirent le feu à la ville. L'incendie dura quinze jours ; il consuma le château royal et un grand nombre de maisons, entre autres, quelques-unes de celles des chanoines. Tous les vilains qui y étaient enfermés périrent dans les flammes... De telles rigueurs auraient dû, ce semble, assouvir (p. 44) le ressentiment des nobles. Il ne se trouva point encore satisfait... Les nobles se ruèrent ensuite, comme des furieux, sur les campagnes, environnantes, égorgeant tous les vilains qu'ils pouvaient atteindre et mettant le feu à leurs villages. Les désastres furent tels, que, s'il faut en croire un chroniqueur, les nobles causèrent en cette occasion plus de maux au royaume que les Anglais eux-mêmes, ces ennemis-nés de la France, n'auraient pu lui en faire ». Ce carnage fait par le parti alors victorieux peut aller de pair avec les massacres de septembre accomplis par l'autre parti, qui fut victorieux au temps de la Révolution française. Il faut sans doute s'abstenir du raisonnement post hoc, propter hoc, mais on ne doit pourtant pas négliger de semblables rapprochements de faits, d'autant plus que l'histoire nous en fait connaître un grand nombre.
[FN: § 2566-2]
Dans l'ouvrage connu sous le nom de Testament politique du Cardinal de Richelieu, on répète une maxime courante en ces temps-là. Recueil des Testamens politiques; t. I, ch. IV, sec. V. Du peuple: « (p. 211) Tous les politiques sont d'accord que si les Peuples étoient trop à leur aise, il seroit impossible de les contenir dans les règles de leur devoir ».
[FN: § 2566-3]
Par exemple, la thèse de DE TOQUEVILLE et de TAINE est que la classe gouvernante française fut dépossédée par la Révolution, parce qu'elle conservait ses privilèges et négligeait ses « devoirs ». Il y a là une part de vérité ; mais il y a aussi une grande part qui diffère de ce que nous enseigne l'expérience. Celle-ci nous montre des gouvernants qui maintiennent leur pouvoir en opprimant les gouvernés. DE TOQUEVILLE nous fournit lui-même des arguments qui contredisent sa thèse. L'ancien régime et la Révolution : « (p. 33) Une chose surprend au premier abord : la Révolution, dont l'objet propre était d'abolir partout le reste des institutions du moyen âge, n'a pas éclaté dans les contrées où ces institutions, mieux conservées, faisaient le plus sentir au peuple leur gêne et leur rigueur, mais, au contraire, dans celles où elles les lui faisaient sentir le moins ; de telle sorte que leur joug a paru le plus insupportable là où il était en réalité le moins lourd. Dans presque aucune partie de l'Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, le servage n'était encore complètement aboli et, dans la plupart, le peuple demeurait positivement attaché à la glèbe, comme au moyen âge... ». TAINE met clairement en rapport la récompense avec les bonnes actions. L'ancien régime : « (p. 108) Juste et fatal [dérivation éthique] effet du privilège que l'on exploite à son profit au lieu de l'exercer au profit d'autrui. Qui dit sire ou seigneur, dit „ le protecteur qui nourrit, l'ancien qui conduit “ [dérivation verbale] ; à ce titre et pour cet emploi, on [qui peut bien être ce, messire on ?] ne peut lui donner trop, car il n'y a pas d'emploi plus difficile et plus haut. Mais il faut qu'il le remplisse ; sinon, au jour du danger, on le laisse là [en vérité, les troupes de Sulla, de Marius de César. d'Octave et beaucoup d'autres demandaient surtout de l'argent et des terres]. Déjà, et bien avant le jour du danger, sa troupe n'est plus à lui ; si elle marche, c'est par routine ; elle n'est qu'un amas d'individus, elle n'est plus un corps organisé ». Taine oublie que précisément un « amas d'individus » peut être facilement gouverné par qui dispose d'un petit nombre d'hommes armés, fidèles parce que bien pavés avec l’argent pris à 1'« amas d'individus ». « (p. 109) Déjà avant l'écroulement final, la France est dissoute, et elle est dissoute parce que les privilégiés ont oublié leur caractère d'hommes publics ». Si ce qu'expose Taine était une uniformité expérimentale, les « Jacques » auraient dû vaincre, car les nobles de ce temps, beaucoup plus que les nobles du temps de la révolution de 1789, avaient négligé leurs « devoirs » envers leurs sujets. – S. LUCE : Hist. de la Jacq. : « (p. 33) Quelle qu'en fût la source, ces revers répétés [de Courtray et de Crécy] eurent pour la noblesse française deux conséquences également désastreuses. D’abord ils la dépouillèrent d'un prestige qui était la plus grande partie de sa force, le prestige militaire [observation juste parce qu'elle concorde avec l'expérience en tout pays et en tout temps]. En second lieu, faits prisonniers en masse dans toutes ces batailles, les seigneurs, pour trouver l'argent nécessaire à leur rançon, durent recourir à des exactions qui poussèrent à bout la patience de leurs vassaux [autre observation expérimentalement juste]. Déjà méprisés, ils devinrent encore plus odieux [la force qui maintenait les vassaux dans l'obéissance diminue, celle qui les poussait à la révolte s'accroît]. La noblesse ne pouvait même plus, d'ailleurs. revendiquer le mérite du désintéressement dans la défense du pays. Commençant à vivre loin de leurs châteaux, près du roi, les chevaliers se mirent à prendre en retour les allures serviles et mercenaires des courtisans. (p. 34) Ils ne voulurent plus servir gratis... J'ajoute que, par une singulière coïncidence, les nobles choisissaient, pour exiger une solde qui était une innovation, le moment même où, par leurs fautes et leurs insuccès militaires, ils la méritaient le moins... (p. 36) „ Après la bataille de Poitiers “, dit le second continuateur de Nangis, „ les affaires du royaume commencèrent à prendre une fâcheuse tournure ; l'État fut en proie à l'anarchie ; les brigands se répandirent par tout le royaume. Les nobles, redoublant de haine et de mépris envers les vilains [belle façon de remplir ses devoirs ! En 1789, il n'y avait ni mépris ni haine, il y avait l'humanitarisme], se mirent à faire bon marché des intérêts de la Couronne et de ceux de leurs vassaux : ils pillaient et opprimaient leurs hommes et en général les gens de campagne...“ (p. 39) Souvent encore, sans se confondre intimement, gentilshommes et brigands s'associaient et marchaient tous ensemble à la proie de compte à demi... À cette époque, dit ce chroniqueur [Guillaume de Nangis], ceux qui auraient dû protéger le peuple ne lui faisaient pas subir moins de vexations que ses ennemis... ». Ceux qui commirent de si mauvaises actions furent vainqueurs, se tirèrent d'affaire, détruisirent leurs ennemis. Leurs successeurs, en 1789, dont les actions étaient, au contraire, humaines, honnêtes, bienveillantes, furent vaincus, marchèrent à leur perte, furent détruits. Il est probable qu'au point de vue de l'utilité sociale, il est bon de ne pas mettre en lumière ce contraste. mais expérimentalement, on ne peut le nier. On trouve dans un très grand nombre d'auteurs contemporains des conceptions analogues à celles qu'exprime Taine. En voici un exemple. MARIO MISSIROLI ; Satrapia : « (p. 13) Raffermir le sentiment du devoir et la liberté morale, même au prix de sacrifices – surtout à ce prix – [dérivation métaphysique], signifie résoudre la question économique, dans la mesure où les biens économiques sont évalués, lorsqu'ils sont considérés comme un moyen et non comme une fin [dérivation de l'âge d'or placé dans l'avenir]. Tant que toute la vie se déroulera dans la catégorie de l'économie et de l'intérêt personnel [à l'auri sacra fames, on donne ici le nom de catégorie], le problème économique (p. 14) sera prédominant et insoluble [il l'est depuis les temps les plus reculés dont le souvenir nous ait été conservé ; il le sera peut-être encore quelque temps]. Tout le monde voudra concourir aux jouissances matérielles et se déposséder tour à tour [c'est en effet ce que rapporte l'histoire]. L'histoire ne peut heureusement pas conclure [l'histoire a-t-elle une conclusion ?] à un échange de portefeuilles. Mais qui doit [dérivation métaphysique] donner cet exemple le premier ? C'est clair : ceux qui occupent le haut de l'échelle sociale : les bourgeois. J'en reviens involontairement aux idées exprimées au début. La bourgeoisie doit rénover le concept de la propriété et la regarder comme un devoir plutôt que comme un droit, et accepter tous les sacrifices, toutes les douleurs qui sont inhérentes à son idée ».
[FN: § 2570-1]
On a fait usage exactement des mêmes dérivations à l’occasion des troubles de Romagne, en juin 1914. Les « spéculateurs » et leurs satellites les jugèrent une œuvre néfaste des ennemis de la patrie, ou du moins de pauvres ignorants « abusés » par les chefs des « partis subversifs ». Ces partis les proclamèrent au contraire « une juste revendication du prolétaire opprimé ».
[FN: § 2573-1]
SALL. ; De bell. Cat., XIV. Puis il accuse Catilina d'avoir tué l'un de ses fils, et émet l'opinion que les remords ont peut-être hâté l'entreprise de Catilina. (XV) Quae quidem res mihi in primis videtur causa fuisse facinus maturandi. Namque animus impurus, dis hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat : ita conscientia mentem excitam vastabat. Igitur color ei exanguis, foedi oculi, citus modo, modo tardus incessus ; prorsus in facie vultuque vecordia inerat. Notre auteur passe sous silence la quatrième Catilinaire de Cicéron, et dissimule les attaques de Caton contre César. APPIEN, lui aussi, De bell. civ., II, 2, rappelle l'accusation lancée contre Catilina d'avoir tué son fils. Cfr. VAL. MAX., IX, I, 9 ; PLUTARCH. ; Sulla, 32.
[FN: § 2575-1]
APP. ; De bell. civ., II, 2 : ![]()
![]() . Ici
. Ici ![]() doit être pris dans le sens expliqué par PLUTARQUE, De unius in rep. domin., II, p. 826, et signifie l'acte de prendre part aux honneurs de la république ; par conséquent l'auteur veut dire que Catilina renonça à rechercher d'autres magistratures. – DIO CASS., XXIX, fait allusion à un décret du Sénat que Catilina crut – et avec raison, dit Dion – avoir été rendu contre lui, et qui le détermina à tenter de détruire les comices par la force.
doit être pris dans le sens expliqué par PLUTARQUE, De unius in rep. domin., II, p. 826, et signifie l'acte de prendre part aux honneurs de la république ; par conséquent l'auteur veut dire que Catilina renonça à rechercher d'autres magistratures. – DIO CASS., XXIX, fait allusion à un décret du Sénat que Catilina crut – et avec raison, dit Dion – avoir été rendu contre lui, et qui le détermina à tenter de détruire les comices par la force.
[FN: § 2575-2]
CIC. ; Pro Flacc ., XXXVIII, 95 : Oppressus est C. Antonius... cuius damnatione sepulcrum L. Catilinae, floribus ornatum, hominum audacissimorum ac domesticorum hostium conventu epulisque celebratum est : iusta Catilinae facta sunt.
[FN: § 2576-1]
NAPOLÉON III ; Hist. de J. César, t. I : « (p. 338) Certes Catilina était coupable de tenter le renversement des lois de son pays par la violence ; mais il ne faisait que suivre les exemples de Marius et de Sylla. Il rêvait une dictature révolutionnaire, la ruine du parti oligarchique, et, (p. 339) comme le dit Dion Cassius, le changement de la constitution de la République et le soulèvement des alliés. Son succès néanmoins eût été un malheur ; un bien durable ne peut sortir de mains impures ». Oh ! qu'elles étaient pures les mains d'Octave, qui fonda l'Empire romain ! Et celles de César qui le précéda ! Il est vraiment remarquable que la passion puisse à tel point oblitérer la raison.
[FN: § 2577-1]
APP. ; De bell. civ., 11, 2 : ![]()
![]() ... « il envoya de ci de là en Italie, chez les partisans de Sulla qui avaient dilapidé les biens enlevés par la violence, et qui aspiraient à des opérations semblables... ». SALL., De bell. Cat., XVI, confirme ce fait. Après avoir parlé des scélérats qui se groupaient autour de Catilina, il ajoute : Eis amicis sociisque confisus Catilina, simul quod aes alienum per omnis terras ingens erat, et quod plerique sullani milites, largius suo usi, rapinarum et victoriae veteris memores, civile bellum exoptabant, opprimundae reipublicae consilium cepit. – PLUTARCH. ; Cic., XIV, parle aussi des anciens soldats de Sulla « désireux de nouveau de butin et de pillages ». – DIO CASS. ; XXXVII, 30, dit la même chose. Ou bien les textes n'ont plus aucune valeur, ou bien il est impossible de ne pas voir en tant de semblables témoignages la trace du conflit entre la force et la ruse en politique.
... « il envoya de ci de là en Italie, chez les partisans de Sulla qui avaient dilapidé les biens enlevés par la violence, et qui aspiraient à des opérations semblables... ». SALL., De bell. Cat., XVI, confirme ce fait. Après avoir parlé des scélérats qui se groupaient autour de Catilina, il ajoute : Eis amicis sociisque confisus Catilina, simul quod aes alienum per omnis terras ingens erat, et quod plerique sullani milites, largius suo usi, rapinarum et victoriae veteris memores, civile bellum exoptabant, opprimundae reipublicae consilium cepit. – PLUTARCH. ; Cic., XIV, parle aussi des anciens soldats de Sulla « désireux de nouveau de butin et de pillages ». – DIO CASS. ; XXXVII, 30, dit la même chose. Ou bien les textes n'ont plus aucune valeur, ou bien il est impossible de ne pas voir en tant de semblables témoignages la trace du conflit entre la force et la ruse en politique.
[FN: § 2577-2]
CIC. ; Pro M. Coelio, IV, 10 : Nam quod catilinae familiaritas obiecta Coelio est ... quanquam multi boni adolescentes illi homini nequam atque improbo studuerunt ... Plus loin, Cicéron loue Catilina de ce dont on put aussi louer César : (V, 12) Erant apud illum illecebrae libidinum multae ; erant etiani industriae quidam stimuli, ac laboris. Flagrabant vitia libidinis apud illum ; vigebant etiam studia rei militaris... (VI, 13) Quis clarioribus viris quodam tempore iucundior ? Quis turpioribus coniunctior ?... (VI, 14) Hac ille tam varia multiplicique natura, cum omnes omnibus ex terris homines improbos audacesque collegerat : tum etiam multos fortes viros et bonos specie quadam virtutis assimulatae tenebat.
[FN: § 2577-3]
Un jour peut-être, lorsque le règne actuel de la ploutocratie aura été détruit par les anarchistes ou par les syndicalistes, ou par les militaristes, ou enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne, par ceux qui opposent la force à la ruse triomphante, on rappellera des propos semblables à ceux que SALLUSTE, De bell. Cat., 20, met dans la bouche de Catilina : « Ainsi, toute faveur, toute puissance, tout honneur, toute richesse sont à eux [les puissants d'alors, auxquels correspondent en partie nos « spéculateurs »] ou à ceux qu'ils veulent. À nous, ils nous ont laissé les refus, les dangers, les condamnations, la pauvreté. Ces faits, jusqu'à quand les souffrirez-vous, hommes intrépides ? Ne vaut il pas mieux mourir en faisant preuve de courage, que perdre avec infamie une vie misérable et méprisée, après avoir été le jouet de l'insolence d'autrui ? mais certainement par la foi des dieux et des hommes, la victoire est entre nos mains ! Notre âge est celui de la vigueur, notre courage est grand. Au contraire, eux, les années, les richesses, tout les affaiblit ».
[FN: § 2578-1]
SALL. ; De bell. Cat., XXXVI : Namque duobus senati decretis, ex tanta multitudine neque praemio inductus coniurationem patefecerat, neque ex castris Catilinae quisquam omnium discesserat. – Après la bataille de Fésules (Fiesole) : (LXI). Sed confecto proelio, tum vero cerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisse in exercitu Catilinae. Nam fere quem quisque vivos pugnando locum ceperat, eum, amissa anima, corpore tegebat. Pauci autem, quos medios cohors praetoria disiecerat paullo divorsius, sed omnes tamen advorsis volneribus conciderant.
[FN: § 2579-1]
SALL. ; De bell. Cat ., XXXIII.
[FN: § 2579-2]
SALL. ; De bell. Cat., XLIX : ... ut nonnulli equites romani, qui praesidii causa cum telis erant circum aedem Concordiae [où s'assemblait le Sénat], seu periculi magnitudine, seu animi nobilitate impulsi, quo studium suum in rempublicam clarius esset, egredienti ex senatu Caesari gladio minitarentur. – SUETONE (Caes.. XIV) ajoute d'autres détails. Après avoir dit que César s'opposa à la sentence de mort contre Catilina et ses complices, il ajoute : Ac ne sic quidem impedire rem destitit, quoad usque manus equitum romanorum, quae arata praesidii causa circumstabat, immoderatius perseveranti necem comminata est : etiam strictos gladios usque eo intentans, ut sedentem una proximi deseruerint, vix pauci complexu togaque obiecta protexerint. Tunc plane deterritus, non modo cessit, sed etiam, in reliquum anni tempus curia abstinuit. Si les chevaliers avaient continué à faire ainsi usage de la force, ils eussent été eux-mêmes vainqueurs ; mais leur tempérament s'y opposait ; c'est, d'une façon générale, celui des « spéculateurs ». Cfr. PLUTARCH. ; Caes., VIII. Dans son discours in toga candida, dont nous n'avons conservé qu'un petit nombre de fragments, CICÉRON dit que Catilina ne peut demander le consulat ni aux principaux citoyens, qui s'opposèrent à sa candidature, ni au Sénat, qui le condamna, ni à l'ordre des chevaliers dont Catilina fut l'assassin : ab equestri ordine ? quem trucidasti. - ASCONIUS note à ce propos : Equester ordo pro Cinnanis partibus contra Sullam steterat, multasque pecunias abstulerant : ex quo saccularii erant appellati : multique ob eius rei invidiam post Sullanam victoriam erant interfecti. Là, on voit bien les « spéculateurs » qui remplirent leur sac et ne furent réprimés que par la force. Cfr. Q. CIC. ; De pet. cons., II.
[FN: § 2581-1]
PLUTARQ. ; Cic., X.
[FN: § 2582-1]
NAPOLÉON III ; Hist. de J. Cés ., t. I, p. 339.
[FN: § 2582-2]
À cela notre auteur, loc. cit., p. 339, objecte : « On peut légitimement violer la légalité, lorsque, la société courant à sa perte, un remède héroïque est indispensable pour la sauver, et que le gouvernement, soutenu par la masse de la nation, se fait le représentant de ses intérêts et de ses désirs [c'est exactement ce que Cicéron pensait de la conjuration de Catilina, de même que Napoléon III de son Coup d'État]. Mais, au contraire, lorsque, dans un pays divisé par les factions, le gouvernement ne représente que l'une d'elles, il doit, pour déjouer un complot, s'attacher au respect le plus scrupuleux de la loi... »
[FN: § 2584-1]
Crassus est un type de ploutocrate et de politicien de la fin de la République ; il est semblable à nos ploutocrates et nos politiciens. Il en diffère surtout en ce qu'il était d'origine sénatoriale, tandis que nos ploutocrates et nos politiciens sortent généralement des classes moyennes ou inférieures de la population. Crassus, comme ceux-ci, a en abondance extraordinaire les résidus de la Ie classe et fort peu, presque pas du tout ceux de la IIe classe. Crassus était d'une race de spéculateurs ; tels sont aussi plusieurs de nos ploutocrates. – PLIN. ; Nat. hist., XXXIII, 47 (10) : Postea Divites cognominati : dummodo notum sit, eum qui primus acceperit hoc cognomen, decoxisse creditoribus suis. Ex eadem gentes M. Grassus negabat locupletem esse, nisi qui reditu annuo legionem tueri posset. – MOMMSEN décrit excellemment Crassus. Hist. rom., t. VI : « (p. 139) Du côté des dons de l'esprit, de la culture littéraire et des talents militaires, il restait loin en arrière de beaucoup de ses pareils : il les dépassait tous par son activité infatigable, par son ardeur opiniâtre à vouloir tout posséder, et à marquer en tout [exactement comme nos ploutocrates]. Il se jeta à corps perdu dans les spéculations [c'est ainsi que s'enrichissent nos ploutocrates]. Des achats de terres pendant la révolution (p. 140) furent la base de son énorme fortune [pour nos ploutocrates, les sources de la richesse sont généralement, outre la protection douanière, les fournitures au gouvernement, les concessions gouvernementales et autres faveurs qu'ils achètent des politiciens] sans qu’il négligeât d'ailleurs les autres moyens de s'enrichir, élevant dans la capitale des constructions grandioses autant que prévoyantes ; s'intéressant avec ses affranchis [ils correspondent aux partisans de nos ploutocrates] dans les sociétés et les compagnies commerciales ; tenant banque dans Rome et hors de Rome, avec ou sans le concours de ses gens ; prêtant son or à ses collègues du Sénat [comme Berteaux faisait en France avec les députés], et entreprenant pour leur compte et selon l'occasion, tantôt des travaux, tantôt l'achat des collèges de justice [de nos jours : des politiciens dont dépend la justice]... Attentif d'ailleurs à ne point entrer en lutte ouverte avec le juge criminel, il savait vivre simplement, bourgeoisement, en vrai homme d'argent qu'il était. C'est ainsi qu’en peu d'années on le vit, naguère possesseur d'un patrimoine sénatorial ordinaire, amasser de monstrueux trésors ; peu de temps avant sa mort, malgré des dépenses imprévues, inouïes, on estimait encore son avoir à 170 000 000 sesterces (48 750 000 francs)... Il n'était point de peine qu'il ne se donnât pour étendre ses relations... (p. 141)... La moitié des sénateurs étaient ses débiteurs [en France, un très grand nombre de députés étaient les débiteurs de Berteaux ; en Italie, l'enquête sur les banques a révélé que beaucoup de députés étaient les débiteurs de la ploutocratie] : il tenait une foule d’hommes considérables dans sa dépendance... Homme d'affaire avant tout, il prêtait sans distinction de partis, mettait la main dans tous les camps [exactement comme nos ploutocrates, qui soutiennent même des ennemis acharnés de la bourgeoisie, des financiers, des capitalistes], et donnait volontiers crédit à quiconque était solvable, ou pouvait devenir utile. Quant aux meneurs, même les plus hardis, quant à ceux dont les attaques n'épargnaient personne, ils se seraient gardés d'en venir aux mains avec Crassus... Depuis que Rome était Rome, les capitaux y avaient joué le rôle d'une puissance dans l'État : au temps actuel, on arrivait à tout par l'or aussi bien que par le fer [pour soutenir la comparaison avec notre temps, il faut supprimer le fer]... (p. 142) Ce fut alors (signe trop caractéristique des temps !) que l'on vit un Crassus, orateur et capitaine médiocre, un politique ayant l'activité et non l'énergie [on dirait la description des ploutocrates qui gouvernent aujourd'hui les pays civilisés], les convoitises et non l'ambition, ne se recommandant par rien si ce n'est sa colossale fortune et son habileté commerciale, étendre partout ses intelligences, accaparer la toute puissante influence des coteries et de l'intrigue [pour nos ploutocrates il faut ajouter : et des journaux], s'estimer l’égal des plus grands généraux, des plus grands hommes d'État de son siècle, et lutter avec eux pour la palme la plus haute qui puisse attirer les convoitises de l'ambitieux ! » – PLUTARCH. ; Crass., 2, 2 : « Au début, il ne possédait pas plus de trois cents talents ; puis, lorsqu’il fut au pouvoir, il consacra à Hercule la dîme de sa fortune, invita le peuple, distribua à chaque citoyen du grain pour trois mois. Toutefois, avant son expédition contre les Parthes, ayant fait le compte de sa fortune, il trouve la somme de 7 100 talents ». Plutarque raconte les entreprises de Crassus : il achetait à vil prix des maisons en mauvais état et les reconstruisait ; il possédait des mines d'argent, des fonds à la campagne donnant de gros revenus ; « (2, 7) toutefois cela semblerait peu de chose, si on le comparait avec l'argent qu'il retirait du travail des esclaves ; il possédait une quantité de ceux-ci et de toute espèce : des lecteurs, des copistes, des experts en métaux, des administrateurs, des maîtres d'hôtel ». Crassus faisait le démocrate comme nos ploutocrates font les socialistes ; il savait capter les bonnes grâces des puissants, toujours comme nos ploutocrates. Quand César était sur le point de se rendre en Espagne, Crassus le libéra de ses créanciers, en se portant sa caution pour au moins 830 talents (loc. cit., 7, 7). Après avoir remarqué qu'il y avait à Rome trois factions, celle de Pompée, celle de César, celle de Crassus, Plutarque ajoute : « (7, 8) Crassus tenant le milieu [entre les deux factions] profitait de toutes les deux, et changeant souvent dans la ville, il se mettait tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Il n'était ni un ami sûr, ni un ennemi implacable, mais abandonnait facilement la bienveillance ou la colère, suivant que cela lui était utile [exactement comme nos ploutocrates]. Souvent on le vit en peu de temps tantôt défenseur, tantôt adversaire des mêmes hommes ou des mêmes lois ». Ainsi fut le ministre Caillaux pour l'impôt sur le revenu et le ministre Giolitti pour le suffrage universel. Immédiatement après avoir repoussé comme excessive la modeste extension du suffrage, proposée par le ministre Luzzatti, la Chambre italienne approuve l'extension beaucoup plus considérable voulue par le ministre Giolitti. Les ploutocrates et leurs représentants se préoccupent de l'argent ; ils ne se soucient guère d'autre chose.
[FN: § 2585-1]
SENEC. ; Controv., II, 1 : (p. 124) census senatorium gradum ascendit, census equitem Romanum a plebe discernit, census in castris ordinem promovet, census indices in foro legit. Cfr. § 2548-3.
[FN: § 2585-2]
FUSTEL DE COULANGES : L'emp. rom. : « (p. 219) Toutes ces distinctions sociales étaient héréditaires. Chaque homme avait de plein droit le rang dans lequel la naissance l'avait placé. Toutefois on devait déchoir si l'on devenait pauvre, et l'ont pouvait aussi s'élever par degrés à mesure qu'on devenait riche. Monter les échelons de cette hiérarchie était l'ambition de tout ce qui était actif et énergique. Le gouvernement impérial ne s'opposa pas à cette sorte d'ascension continuelle vers laquelle tous les efforts tendaient. Il veilla seulement à ce qu'elle ne fût pas trop rapide ; il fixa les conditions et les règles suivant lesquelles elle était permise. Il prit soin d'empêcher, autant qu'il était possible, qu'une famille ne franchît deux degrés dans une seule vie d'homme. L'esclave pouvait, par l'affranchissement (p. 280) complet, s'élever à la plèbe ; mais il lui était défendu de monter au rang des curiales. Le plébéien devenait curiale à la condition de posséder vingt-cinq arpents de terre et de supporter sa part des charges municipales. Le curiale, à son tour, pouvait passer au rang des principaux s'il avait une fortune qui lui permît de faire les frais des hautes magistratures et si ses concitoyens les lui conféraient ; mais le gouvernement impérial exigeait que l'on remplît toutes les fonctions inférieures avant d'arriver aux plus élevées, ce qui était un premier obstacle et tout au moins un long retard pour les parvenus ». L'auteur cite le code théodosien. Il est vrai que c'était la loi écrite, mais il aurait du ajouter qu'en pratique les exceptions étaient nombreuses (§ 2551-1). Cfr. TAC. ; Ann., XIII, 27. « Quand la carrière municipale avait été parcourue tout entière, alors seulement une famille pouvait aspirer au titre de sénateur romain. Ici la richesse était encore nécessaire, mais elle ne suffisait plus. La règle était qu'il fallût obtenir du prince une magistrature romaine... »
[FN: § 2585-3]
Encore sous Tibère, à Rome, le luxe était extravagant. TACIT. ; Ann. II, : 38. Plus loin, III, 52 : C. Sulpicius, D. Haterius consules sequuntur : inturbidus externis rebus annus ; domi suspecta severitate adversum luxum, qui immensum proruperat ad cuncta quis pecunia, prodigitur. Les édiles voulaient diminuer ces dépenses, et le Sénat demanda à Tibère de décider sur ce qu'il y avait à faire. Tibère montra la difficulté de l'entreprise : « (p. 53) Que faut-il vraiment d'abord interdire pour entreprendre ensuite de revenir aux mœurs antiques ? Les vastes villas le nombre et la race des familles, la somme d'or et d'argent, les merveilles du bronze et des tableaux, les vêtements confondus des hommes et des femmes, et ceux qui sont bien ceux des femmes, lesquelles portent notre argent aux étrangers ou aux ennemis, pour acquérir des pierres précieuses ? » Les voiles habituels des dérivations éthiques une fois ôtés, ce que dit Tibère est juste : (54) Externis victoriis aliena, civilibus etiam nostra consumere didicimus. « Par les victoires remportées à l'extérieur, nous avons appris à dépenser les biens des étrangers ; par les victoires des guerres civiles, nous avons aussi appris à dépenser nos biens ». Tibère conclut au laisser-faire. Tacite observe (55) que cependant le luxe diminua. Il en attribue le mérite à l'élite qui, des provinces venait à Rome, et au bon exemple donné par Vespasien. Il fait ensuite allusion au doute que nous avons rapporté au § 2552-1. Les causes indiquées précédemment peuvent se trouver parmi les secondaires et non parmi les principales, parce qu'après Vespasien la première avait produit tout son effet possible, et que la seconde disparut entièrement; car parmi les successeurs de Vespasien, pour ne nommer que ceux-là, ce n'est pas un Commode, un Caracalla, un Eliogabale qui auront donné l'exemple de l'économie dans leur vie. Pourtant le luxe des particuliers et la prospérité économique continuèrent à diminuer.
[FN: § 2585-4]
MARQUARDT ; De l’organisation financière chez les Romains : « p. 121) Les prétoriens, qui formaient neuf cohortes de 1000 hommes, touchaient par an, sous Tibère, 720 deniers, mais sans fournitures en nature ; ils les obtinrent à partir de Néron... ». La somme totale des frais pour 25 légions, les prétoriens et les cohortes urbaines, est, suivant notre auteur, de 46 710 000 deniers, soit 50 625 000 fr. .(p. 121). Mais il y avait d'autres frais dont les donativa n'étaient pas les derniers, qu'on ne peut évaluer, et qui augmentèrent avec le temps.
[FN: § 2587-1]
VOPISCUS ; Aurel., nous raconte la mort d'Aurélien, l'interrègne et le règne de Tacite. Il cite la lettre des légions (41) où elles demandent au Sénat un empereur : ... et de vobis aliquem, sed dignum vestro iudicio, principem mittite. Tacite qui était consul, estima dangereux l'honneur fait au Sénat, et dit ; Nam de imperatore, deligendo ad eundem exercitum censeo esse referendum. Etenim in tali genere sententiae, nisi fiat quod dicitur, et electi periculum erit, et eligentis invidia. Le Sénat approuva cet avis ; mais comme on continuait à insister des deux côtés, il finit par nommer précisément Tacite : attamen cum iterum atque iterum mitterent, ex. S. C. quod in Taciti vita dicemus, Tacitus factus est imperator. Dans la vie de Tacite, notre auteur dit : « (2) Ergo quod rarum et difficile fuit, S. P. Q. R. perpessus est ut imperatorem per sex menses, dura bonus quaeritur, respub. non haberet. Mais il était nécessaire que l'armée eût un chef. Le consul Gordien dit au Sénat : (3) ... Imperator est deligendus : exercitus sine principe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur... Il ne se trouva aucun démagogue de la trempe de nos Jaurès, Caillaux, Edward Grey, etc., pour dire qu'on n'avait pas à se soucier des Germains belliqueux. Mais Rome n'y gagna pas grand'chose, parce que les Pères Conscrits, en bons humanitaires, estimèrent qu'on repoussait les ennemis par les vertus privées et civiques. Pour tant, le pauvre Tacite, refusant l'honneur qu'on voulait lui faire, dit avec beaucoup de bon sens : (4) ... Miror. P. C., in locum Aureliani fortissimi imperatoris senem velle principem facere... Un sénateur consulaire exprima délicieusement les rêveries humanitaires qui conseillaient le choix de Tacite : (6) Seniorem principem fecimus, et virum qui omnibus quasi pater consulat [Clémenceau aurait dit : qui sera un pur républicain]. Nihil ab hoc immaturum, nihil perperum, nihil asperum formidandum est. Scit enim qualem sibi principem semper optaverit : nec potest aliud nobis exhibere quam quod ipse desideravit et voluit. On dirait tout à fait une idylle. Il ne manque que la bergère et les moutons ornés de beaux rubans. Ce brave homme régna six mois. (13) ... Gessit autem propter brevitatem temporum nihil magnum. Interemptus est enim insidiis militaribus, ut alii dicunt, sexto mense : ut alii, morbo interiit. Tamen constat, factionibus eum oppressum, mente atque anime defecisse.
[FN: § 2590-1]
Par exemple PLIN. ; Nat. hist ., XIV, 5, (4), Summam ergo adeptus est gloriam Acilius Sthenelus e plebe libertina, LX iugerum [15 hectares] non amplius vineis excultis in Nomentano agro, atque C C C C nummum venumdatis. Magna fama et Vettileno Aegialo perinde libertino fuit, in Campaniae rure Liternino, maiorque etiam favore hominum, quoniam ipsum Africani colebat exsilium. Mais la renommée de Remnius Palemon, le grammairien, fut plus grande encore. Avec l'aide du même Acilius Sthenelus, il acheta une vigne pour 600 000 sesterces (126 000 fr.). Il sut si bien l'améliorer que la vendange d'une année fut payée 400 000 sesterces 84 000 fr.). Il revendit la vigne à Annœus Seneca quatre fois autant qu'il l'avait payée. – XII, 5. On fait allusion à un affranchi très riche.
[FN: § 2590-2]
TACIT. ; Ann ., XI, 21.
[FN: § 2591-1]
PETR. ; 76.
[FN: § 2591-2]
PETR. ; 77 : Crrdite mihi : assem habeas, assem valeas ; habes, habeberis. Sic amicus vester, qui fuit rana, nunc est rex.
[FN: § 2591-3]
PETR. ; 59. Ce bon Trimalcion est des plus comiques lorsqu'il dit : Diomedes et Ganymedes duo fratres fuerunt. Horum soror erat Helena. Agamemnon illam rapuit et Dianae cervam subiecit. Ita nunc Homeros dicit, quemadmodum, inter se pugnent Troiani et Parentini.
[FN: § 2591-4]
PETR. ; 67.
[FN: § 2592-1]
PETR. ; 67 : Sed narra, mihi, Gai, rogo, Fortanata quare non recumbit ? – Quomodo ? nosti, inquit, illam, Trimalchio, iiisi argentum composuerit, nisi reliquias pueris diviserit, aquam in os suum non coniciet... Venit [Fortunata] ergo galbino succincta cingillo, ita ut infra cerasina appareret tunica et periscelides tortae phaecasiaeque inauratae. Tunc sudario manus tergens, quod in collo liabebat...
[FN: § 2592-2]
PETR. ; 76.
[FN: § 2593-1]
PETR. ; 65. Cet Abinna va vêtu de blanc, avec un licteur et un nombreux cortège. Inter haec triclinii valvas lictor percussit, amictusque veste alba cum ingenti frequentia comissator intravit. Ego maiestate conterritus praetorem putabam venisse. Itaque temptavi assurgere et nudos pedes in terram deferre. Risit hanc trepidationem Agamemnon et contine te, inquit, homo stultissime. Habinas sevir est idemque lapidarius, qui videtur monumenta optime facere. Ces sévirs provenant en très grande partie de la classe des affranchis, étaient pour le moins aisés, car ils étaient tenus à de lourdes prestations – E. DE RUGGIERO ; Diz. Epig., I, s. r. Augustales. D'abord, il y a la « (p. 833) Summa honoraria. Panhormus (sic) C. X 7269 : aram Victoriae Sex. Pompeius Mercator VI vir Aug(ustalis) praeter summ(a)m pro honore d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) s(ua) p(osuit) ». Puis il y a les dépenses pour les jeux. « (p. 834). À l'origine, leur activité se concentrait sur l'organisation des spectacles... ». À Narbonne, (Orelli, 2489), les sévirs sacrifiaient deux fois l'an, à leurs frais, et fournissaient, quatre fois l'an, de l'encens et du vin à tous les coloni et à tous les incolae. - MARQUARDT ; Organ. de l'emp. rom. : « (p. 304) Les attributions des seviri comprenaient, d'une part, l'accomplissement des sacrifices ordinaires... et de festins populaires, dont les frais étaient couverts par l'argent qu'ils avaient payé, lorsque les décurions ne l'avaient pas employé en bâtiments publics de toute nature ». Un hasard singulier veut que parmi les inscriptions qui nous sont restées, il y en ait justement une d'un marmorarius qui était Augustalis. On nomme aussi des negotiatores, un argentarius, un mercator suarius, un vestiarius tenuiarius, purpurarius, pistor, etc. Cela montre comment de la plus basse classe sortait l'aisance.
[FN: § 2593-2]
PETR. ; 46 : ...vides Phileronem catisidicum : si non didicisset, hodie famem a labris non abigeret. Modo, modo collo suo circumferebat onera venalia, nunc etiam adversus Norbanum se extendit. Litterae thesaurum est, et artificium nunquam moritur.
[FN: § 2593-3]
PETR. : 38 : Reliquos autem collibertos eius cave contemnas. Valde sucossi sunt. Vides illum qui in imo imus recumbit : hodie sua octingenta possidet. De nihilo crevit.
[FN: § 2593-4]
MART :
III (59) Sutor cerdo dedit tibi, culta Bononiit, munus.
Fullo dedit Mutinae : nunc ubi caupo dabit ?
III (16) Das gladiatores, sutorum regule, cerdo,
Quodque tibi tribuit subula, sica rapit.
Ebrius es : nec enim faceres id sobrius unquam,
Ut velles corio ludere, cerdo tuo. ...
Tacite rapporte qu'un affranchi avait donné un spectacle de gladiateurs. TACIT. : Ann., IV, 62, ...Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret…
[FN: § 2594-1]
IUVEN. :
I (24). Patricios omnes opibus quum provocet unus,
Quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat.
X (225). Percurram citius, quot villas possideat nunc,
Quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat.
Le scholiaste note : (225) Percurram citius : quot villas habeat extonsor, eo die, qui me tutundit, senator factus. (226) Quo tondente gravis : Licinius ex tonsore senator factus.
[FN: § 2595-1]
Juvénal montre, d'une part les « descendants des Troyens » qui, tombés dans la misère, demandent la sportule, et de l'autre, un affranchi enrichi qui veut aller au-devant des Romains.
1 (102) Prior, inquit, ego adsum :
Cur timeani, dubitemve locum defendere, quamvis
Natus ad Euphraten, molles quod in aure fenestrae
Arguerint, licet ipse negem ? sed quinque tabernae
Quadringenta parant : quid confert purpura maior
Optandum, si Laurenti custodit in agro
Conductas Corvinus oves ? ego possideo plus
Pallante et Licinis ? Exspectent ergo tribuni ;
Vincant divitiae, sacro nec cedat honori,
Nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis :
« Cinq tavernes » pourrait être le nom d'un lieu ; mais cela n'est nullement probable. On blanchissait au gypse les pieds de l'esclave récemment importé d'outre mer, lorsqu'on le mettait en vente.
[FN: § 2595-2]
IUVEN. ; III :
(60) Non possum ferre, Quirites,
Graecam urbem : quamvis quota portio faecis Achaei ?
Iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes,
Et linguam, et mores, et cum tibicine chordas
Obliquas, nec non gentilia tympana secum
Vexit, et ad circum iussas prostare puellas :
Ite, quibus grata est pirta lupa barbara mitra.
[FN: § 2595-3]
IUVEN. ; III :
(158) ... Exeat, inquit,
Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,
Cuius res legi non sufficit ; et sedeaut hic
Lenonum pueri, quocunque in fornice nati.
Hic plaudat nitidi praeconis filius, inter
Pinnirapi cultos iuvenes, iuvenesque lanistae.
Le scholiaste note : nitidi praeconis filius : divitis degenere gladiatoris. Pinnirapi : a pinna. Pinnis pavonum ornari solent gladiatores, si quando ad pompam descendunt.
[FN: § 2597-1]
BELOT : Hist. des ch. rom., t. II : « (p. 385) Mais ce fut Claude qui fit faire le plus grand pas au pouvoir de ses affranchis, nommés à Rome procurateurs (p. 386) du fisc. Dominé par une camarilla, il ordonna que les sentences de ses affranchis fussent respectées comme les siennes. Il leur livra ainsi la justice extraordinaire et personnelle que l'empereur se plaisait à substituer à l'action des tribunaux. Ces causes de péculat, ces accusations de repetundis, pour lesquelles les partis républicains s'étaient livré tant de batailles, étaient maintenant décidées à huis-clos par le comptable Pallas, successeur de l'affranchi Ménandre. Les armées et les provinces se ressentirent de la faveur nouvelle des affranchis. L'affranchi Félix fut nommé tribun de cohorte, et préfet d’aile de cavalerie... et, au sortir de ces commandements militaires, il fut chargé de gouverner la Judée, où Claude envoyait indifféremment des procurateurs chevaliers ou des procurateurs affranchis ». L'auteur note d'autres provinces gouvernées par des procurateurs. « Tacite compte, à la mort de Néron, entre autres provinces gouvernées par les procurateurs, les deux Mauritanies, la Rhétie, la Norique, la Thrace. Bientôt les Alpes maritimes, la Cappadoce (p. 387), obéirent à la juridiction pacifique des procurateurs ».
[FN: § 2597-2]
DION CASS., LXXVIII, 13. L'auteur raconte que Macrin envoya comme lieutenants Agrippa en Dacie, Decius Triccianus en Pannonie. Le premier avait été esclave. Le second avait été simple soldat et portier du gouvernement de la Pannonie.
[FN: § 2597-3]
SENEC. ; Epist., 27 : Calvisius Sabinus memoria nostra fuit dives ; et patrimonium habebat libertini, et ingenium... Idem; Epist., 86 : ... Et adhuc plebeias listulas loquor : quid, cum ad balnea libertinorum pervenero ?... Idem; De benef., II, 27 : Cn. Lentulus augur, divitiarum maximum exemplum, antequam illum libertini pauperem facerent... Idem; Nat. quaest., I, 17 : Iam libertinorum virgunculis in unum speculum non sufficit illa dos, quam dedit populus romanus Scipioni.
[FN: §2597-4]
TACIT. ; Ann., II, 48, parle d'une riche affranchie morte sans avoir fait de testament, et dont Tibère fit attribuer le patrimoine à Æmilius Lepidus, auquel il paraissait qu'elle eût appartenu.
[FN: § 2597-5]
TACIT. ; Ann., XIII, 27 (trad. (Nisard).
[FN: § 2597-6]
SUET. ; Nero, 37. Néron disait qu'il voulait détruire l'ordre sénatorial ac provincias et exercitus equiti romano ac libertis permissurum. TACIT. ; Hist., I, 58 Vitellius ministeria principatus, per libertos agi solita, in equites romanos disponit. - PLINE LE JEUNE loue Trajan de n'avoir pas imité plusieurs de ses prédécesseurs, qui se laissaient gouverner par les affranchis. Paneg., 88 : Plerique principes, cum essent civium domini, libertorum erant servi : horum consiliis, horum nutu regebantur ; per hos audiebant, per hos loquebantur, per hos praeturae etiam et sacerdotia et consulatus, immo et ab his petebantur. Tu libertis tuis summum quidem honorem sed tanquam libertis, habes ; abundeque sufficere his credis, si probi et frugi existimentur. - Hist. Aug. ; A ntoninus Pius, 11 : Amicis suis in imperio suo non aliter usus est quam privatus : quia et ipsi nunquam de eo cum libertis suis per fumum aliquid vendiderunt : siquidem libertis suis severissime usus est. Pertinax, 7. Cet empereur fit vendre ceux qui avaient appartenu à Commode, mais et de his quos vendi iussit, multi postea reducti ad ministerium, oblectaverunt senem, qui per alios principes usque ad senatoriam dignitatem pervenerunt.
[FN: § 2598-1]
DIO CASS. ; LII, 42, p. 693. L'auteur observe : ![]()
![]() . « Puisque rien comme la noblesse ne périt dans les guerres civiles ». En Angleterre, la guerre des Deux Roses eut un effet semblable.
. « Puisque rien comme la noblesse ne périt dans les guerres civiles ». En Angleterre, la guerre des Deux Roses eut un effet semblable.
[FN: § 2598-2]
TACIT. Ann., III, 55.
[FN: § 2598-3]
TACIT. Ann., XI, 23. On objectait : ... non adeo aegram Italiam, ut senatara suppeditare urbi suae nequiret : suffecisse olim indigenas, consanguineis populis ; nec poenitere veteris reipublicae. Quin adhuc memorari exempla quae priscis moribus ad virtutem et gloriam romana indoles prodiderit. An parum quod Veneti et Insubres curiam irruperint, nisi coetus alienigenarum, velut captivitas, inferatur ? Quem ultra honorem residuis nobilium, aut si quis pauper e Latio senator, fore ? Oppleturos omnia divites illos quorum avi proavique, hostilium nationum duces, exercitus nostros ferro vique ceciderint... Mais Claude tint bon et conclut sa réponse au Sénat en disant : (24) Omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere : plebei magistratus post patricios : Latini post plebeios ; ceterarum Italiae gentium post Latinos. Inveterascet hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur inter exempla erit. Ainsi, il décrit bien la circulation des élites.
[FN: § 2598-4]
SUET. ; Vesp., 9 : Amplissimos ordines, et exhaustos caede varia, et contaminatos veteri neglegentia, purgavit, supplevitque, recenso Senatu et Equite ; sum motis indignissimis, et honestissimo quoque Italicorum se provincialium allecto. - AUR. VICT. ; De Caesar., 9. ... simul censu more veterum exercito, senatu motus probrosior quisque ; se, lectis undique optimis viris, mille gentes compositae, cum ducentas aegerrime reperisset, extinctis saevitia tyrannorum plerisque. Ainsi que le remarqua déjà Causabon (ad SUET. ; Caes., 41), gentes doit être entendu dans le sens de patriciens.
[FN: § 2600-1]
DION. CASS. ; LII, 14 à 40, p. 670 à 692. Dion met simplement dans la bouche de Mécène les principes idéaux de l'Empire de son temps. Il insiste (27, p. 681) sur l'opportunité de séparer entièrement les fonctions civiles des fonctions militaires.
[FN: § 2600-2]
DION. CASS. ; LXXIV, 2, p. 1243. L'auteur ajoute que ce fut la cause de la perte de la jeunesse italienne, qui se livra au brigandage et aux luttes des gladiateurs.
[FN: § 2600-2600-3]
MARQUARDT. ; Organ. de l’emp. rom., t. II, p. 585.
[FN: § 2602-1]
PLIN. ; Epist., VII, 31. Il parle d'un individu qu'il a connu lorsqu'il faisait son service militaire : Hunc cum simul militaremus, non solum ut commilito inspexi. Pracerat alae militari : ego iussus a legato consulari rationes alarum et cohortium excutere... Il paraît aussi qu'il trouvait le temps de s'occuper de philosophie et de littérature. - Epist., I, 10. Il parle du philosophe Euphrate : Hunc ego in Syria, cum adolescentulus militarem, penitus et domi inspexi, amarique ab eo laboravi, etsi non erat laborandum. - Epist., III, 11. Il parle d'un autre philosophe : ... et Artemidorum ipsum iam tum, cum in Syria tribunus militarem, arcta familiaritate complexus sum... D'ailleurs, ceux qui voulaient pouvaient aussi faire autrement, et, comme Trajan, faire réellement le service militaire. Paneg., 15 : Neque enim prospexisse castra, brevemque militiam quasi transisse contentus, ita egisti tribunum, ut esse statim dux posses, ... Tacite loue Agricola de n'avoir pas imité les jeunes gens qui passaient dans les plaisirs le temps du service militaire. - TACIT. ; Agric., V : Nec Agricola licenter, more iuvenum qui militiam in lasciviam vertunt, neque segniter, ad voluptates et commeatus titulum tribunatus et inscitiam retulit.
[FN: § 2602-2]
SUET. ; Claud., 25.
[FN: § 2603-1]
DION. CASS. ; LII, 42, p. 694. L'auteur remarque ensuite (LIII, 12, p. 703) que le véritable motif de la division des provinces entre Auguste et le Sénat fut qu'Auguste voulait être seul à avoir des soldats sous son commandement. En outre (LIII, 13, p. 705), il défendit aux sénateurs délégués pour gouverner les provinces de porter l'épée et le vêtement militaire, ce qu'il permit au contraire à ses gouverneurs.
[FN: § 2603-2]
TACIT. ; Ann., II, 59 : ... nam Augustus, inter alia dominationis arcana, vetitis, nisi permissu, ingredi senatoribus, aut equitibus romanis illustribus, seposuit Aegyptum : ne fama urgeret Italiam, quisquis eam provinciam, claustraque terrae ac maris, quamvis levi praesidio adversum ingentes exercitus, insedisset.
[FN: § 2603-3]
Hist. Aug.; Trigint, Tyr., 21 ... qui cum Theodoto vellet imperiu proconsulare decernere, a sacerdotibus est prohibitus, qui dixerunt fasces consulares ingredi Alexandriam non licere... Fertur enim apud Memphim in aurea columna Aegyptiis literis scriptum, tunc demum Aegyptum liberam fore cum in eam venissent Romani fasces, et praetexta Romanorum.
[FN: § 2604-1]
HERODIEN ; II, 11. L'auteur relève aussi le contraste entre les Italiens, au temps de la République, et ceux du temps de Septime Sévère. Il remarque que ce fut Auguste qui leur ôta leurs armes.
[FN: § 2605-1]
Zosim. ; I, 37.
[FN: § 2605-2]
AUREL. VICT. ; De Caesaribus, 33 : Quia primus ipse, metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit, etiam adire exercitum. La séparation entre les optimales et l'armée continua à devenir toujours plus rigide. Iust. Cod., X, 82 (31), 55 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Isidoro pp. Si quis decurio aut subiectus euriae ausus fuerit ullam adfectare militiam, nulla praescriptione temporis muniatur, sed ad condicionem propriam retrahatur, ne ipse vel eius liberi post talem ipsius stafum procreati quod patriae debetur valeant declinare. - D. III non. April Constantinopoli Isidoro et Senatore conss. [a. 436]. Cfr. Ibidem, XII, 33 (24), 2. - Theod. Cod., VIII, 4, 28. Le service militaire était aussi interdit à d'autres classes de la population. - Iust. Cod., XII, 34 (35). 1. Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui vel in hac alma urbe vel in provinciis cuidam ergasterio praesunt, militare de cetero prohibemus. D'ailleurs, il en excepte les banquiers, auxquels il interdit seulement d'entrer dans la troupe armée, ainsi qu'aux armuriers, à cause de leur utilité pour l'armée. Negotiantes etenim post hanc sanctionera huiusmodi militia privabuntur : illis, qui ad armorum structionem. suam professionem contulerint, minime prohibendis ad competentem suae professionis venire militiam et huiusmodi negotiationem nihilo minus retinere [an. 528-529]. Aux colons aussi l'accès de l'armée était interdit. - Iust. Cod., XII, 33 (34), 3. Impp. Arcadius et Honorius AA. Pulchro magistro utriusque militiae. Cura pervigili observare debebit sublimitas tua, ne coloni vel saltuenses aut ultro se offerentes ad militiam suscipiantur armatam aut cogantur inviti.
[FN: § 2605-3]
Hist. Aug. ; Alex. Sev., 45.
[FN: § 2606-1]
VEGET. ; I, 7. Plus loin : I, 28 : Sed longae securitas pacis homines partim ad delectationem otii, partim ad civilia traduxit officia. Ita cura exercitii militaris primo negligentius agi, postea dissimulari, ad postremum olim in oblivionem perducta cognoscitur... On put observer des faits semblables en Chine ; on en peut observer maintenant, en 1913, chez quelques peuples (§ 2423-1) qui manifestent leur mentalité, par l'humanitarisme démocratique.
[FN: § 2607-1]
Hist. Aug., Alex. Sev., 32 ; Corpora omnium constituit vinariorum, lupinariorum, caligariorum, et omnino omnium artium : hisque ex sese defensores dedit, et iussit quid ad quos indices pertineret. – Cours, t. II, § 803 : «(p. 144) D'une manière générale et sans attacher trop d'importance à des dates qui sont assez incertaines, on peut distinguer une période d'Auguste à Alexandre Sévère, dans laquelle les corporations autorisées par le gouvernement se recrutent librement. Les empereurs interviennent quelquefois pour donner des encouragements à certaines corporations qui ont des buts d'utilité publique. Une seconde période commence avec Alexandre Sévère, qui organisa, ou peut-être réorganisa les corporations... Dans (p. 145) la troisième période, qui va de Constantin à Théodose, le caractère coercitif des corporations s'accentue. L'équilibre est rompu ; les privilèges ne compensent plus les charges. Enfin, de Théodose à Honorius, la corporation établit ne sorte de servitude et les hommes font tous leurs efforts pour s'y soustraire. Le recrutement est forcé, comme le dit Serrigny (Droit pub., I, p. 170) : „ Cette interdiction de changer sa condition est un des traits le plus caractéristique de la législation impériale. Elle s'appliquait à un si grand nombre d'états ou de professions, qu'on peut la considérer comme une règle générale pour la masse des habitants de l'empire romain“ ».
[FN: § 2607-2]
Il faut entendre cela au point de vue de la production, qui est celui dont il s'agit maintenant. Au point de vue de la répartition des richesses, une organisation dans laquelle les corporations sont exploitées diffère entièrement d'une autre où ce sont elles qui exploitent le pays.
[FN: § 2607-3]
La cristallisation s'étend à l'ordre des augustales, qui était au-dessous de celui des décurions. DE RUGGIERO ; loc. cit. § 2583-1 : « (p. 851) Depuis la fin, de la troisième décade du IIe, siècle, une transformation radicale s'accomplit dans les institutions augustales. Elle s'étend d'une manière spéciale à ces communautés dans lesquelles il y avait eu jusqu'alors un collège annuel de sexviri Augustales... Mais dans les communes mêmes où jusqu'alors il n'y avait eu que des Augustales... on rencontre maintenant à leur place bon nombre de sexviri Augustales, organisés en corporations... Là même où le culte d'Auguste de la plèbe n'avait d'abord pas été admis... surgit actuellement une corporation organisée en collège qu'on désigne par le nom de sexviri Augustales ». Au temps de la prospérité de l'Empire, c'était un honneur très recherché de faire partie des sexviri Augustales. Au temps de la décadence, pour beaucoup de personnes cela devient un fardeau insupportable auquel on tâche d'échapper de toute façon. - BOUCHÉ-LECLERCQ, cité dans MARQUARDT ; Le culte chez les Romains : « (p. 233) Comme tous les honneurs sous l'empire, ceux-ci étaient onéreux et il vint un moment où ils ne furent plus guère qu'un impôt ajouté à tant d'autres... on rendit à la corporation quelques-uns des droits qu'elle avait perdus en cessant d'être une association privée, la capacité civile ou faculté de recevoir des legs et donations, la gestion de ses deniers et le choix de ses comptables... C'était un moyen de rendre un peu de vie à des organes menacés d'atrophie. Et cependant il fallut, vers la fin du IIIe siècle, appliquer à ce sacerdoce le système de l'investiture forcée au moyen duquel on maintenait au complet les conseils municipaux et les municipalités (C. I. L., X, 114. Cfr. II, 4514). Les décurions qui nommaient les Augustales exerçaient ainsi sur d'autres la contrainte qu'ils subissaient eux-mêmes ».
[FN: § 2609-1]
Guizot, en peu de mots, décrit bien l'état de la société, au temps de saint Grégoire de Tours. GUIZOT : Grég. de Tours, t. II : « (p. 265) Ce qu'était l'administration en ces temps de confusion, on pourrait l'imaginer, ne le sût-on pas par les documents. Les institutions procédant du pouvoir central se sont effacées ; les institutions municipales ont été en partie conservées par les villes, à l'existence desquelles elles étaient nécessaires, et tolérées par leurs nouveaux maîtres. Ceux-ci ont ramassé quelques-uns des rouages de la grande machine administrative créée par les Romains et les ont utilisés, mais en leur laissant subir les altérations qui devaient résulter du contact des habitudes germaines. Le désordre s'est étendu des institutions administratives aux circonscriptions géographiques qui leur répondaient... ».
[FN: § 2610-1]
Cours, t. II, § 802 : « (p. 144) La mauvaise organisation économique de l'Empire romain, la destruction systématique des capitaux mobiliers, affectaient de plus en plus la production. Au lieu de tâcher de remonter le courant qui conduisait à d'aussi funestes résultats, on s'enfonça de plus en plus dans la protection, et le gouvernement s'occupa d'organiser la production économique. On commença par donner des privilèges aux corporations d'arts et métiers, on finit par les réduire en une sorte de servage ». Voir : JULES NICOLE, Le livre du préfet ou l'Édit de l'Empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople, pour savoir jusqu'où put arriver, en ce temps là, la cristallisation sociale, l'organisation, et par conséquent pour avoir une lointaine idée de la limite analogue vers laquelle s'acheminent aujourd'hui nos sociétés. La description faite par l'auteur du Cours, de l'évolution économique de l'Empire romain, n'est pas exempte des erreurs indiquées aux § 2334 et 2385. Ce fait est remarquable, parce que la théorie des crises économiques du même auteur non seulement les évite, mais encore les dévoile. Ce fait est peut-être en rapport avec les suivants (§ 2547-1). 1° L'auteur cédait, au moins en partie, au préjugé des économistes qui estiment qu'on peut séparer entièrement le phénomène économique des autres phénomènes sociaux. Ce n'est qu'après avoir achevé les études exposées ici qu'il se rendit pleinement compte de cette erreur. En attendant, celle-ci l'avait empêché de faire le petit pas qui, de la théorie particulière des crises économiques, conduit à la théorie générale des phénomènes sociaux, indiquée aux § 2330 et sv. – 2° Il cédait aussi, sans trop s'en rendre compte, à la tendance habituelle aux économistes et aux sociologues, qui ne veulent pas se borner à la recherche et à la découverte des uniformités (lois) que contiennent les rapports des faits, mais qui, bien que disposant seulement de connaissances assez rudimentaires et assez imparfaites, croient pouvoir connaître le but vers lequel la société « doit » et peut marcher, et qui s'imaginent que leurs discours ont la vertu de contribuer à changer les faits et le pouvoir de rapprocher de ce but. Ils n'ont pas encore réussi à donner une forme tant soit peu bonne à l'étude des mouvements réels (§ 129), et ils s'imaginent pouvoir accomplir l'étude beaucoup plus difficile des mouvements virtuels (§ 130, 2653 : II-a). Il ne leur suffit pas de se livrer à des recherches scientifiques : ils veulent aussi conseiller et prêcher. – 3° L'auteur s'efforçait de substituer partout l'expérience scientifique à la foi, et ne s'apercevait pas qu'il restait en lui un vestige de foi, manifestée par une certaine inclination pour la liberté. Cette inclination dépasse la science pure, qui recherche les rapports des faits, sans aucune idée préconçue. Nous relevons cela dans le but de donner un exemple des obstacles qui, dans les sciences sociales, s'opposent à la recherche de la vérité expérimentale.
[FN: § 2610-2]
PRISCUS PANITES, dans Fragm. hist. graec., t. IV, p. 86-87. Si la période ascendante de notre ploutocratie démagogique se prolonge un certain temps, et amplifie le mouvement dont nous voyons le début, on peut imaginer qu'un homme ayant réussi à fuir l'oppression de ce temps-là, et réfugié chez certains X, répète sans y changer beaucoup le discours de l'interlocuteur de Priscus. Il dira que « ceux qui se trouvent chez les X ont la vie tranquille, après avoir travaillé, pour faire quelques épargnes : chacun jouit de ses biens, et n'est molesté en aucune façon par qui que ce soit ; tandis que là où il était avant, de toute manière, il était dépouillé et opprimé. De lourds impôts l'accablaient, établis par le vote du plus grand nombre, lequel ne les payait pas ; c'était un nombre toujours plus restreint de gens qui les payaient ; et ils étaient augmentés sans mesure, pour faire face aux dépenses énormes du gouvernement de la ploutocratie démagogique. En outre, il subissait les vexations de ceux qui font partie de ce gouvernement ou en sont les suppôts. Les lois ne sont pas égales pour tout le monde. Si quelque violateur de la loi appartient d'une manière ou d'une autre à la classe dominante, son délit n'encourt aucune peine ; si c'est quelqu'un qui, comme le contrebandier, attente aux privilèges fiscaux de cette classe, on lui applique la peine prévue par la loi. Un sort meilleur n'attend pas l'innocent accusé à tort, qui ne porte préjudice à personne, et voudrait qu'on ne lui en portât pas non plus, en traînant en longueur les procès, en lui faisant dépenser son argent, grâce aux caprices des « bons juges », et aux menées de ceux qui veulent se concilier la faveur des politiciens et des avocats-princes. Il y a, en effet, une manière absolument inique d'obtenir par protection ce qui ressortit à la loi ; cela en se mettant au service des gouvernants, et en leur étant utile aux élections, par lesquelles ils accaparent le pouvoir ».
[FN: § 2610-3]
PRISC. PAN. ; loc. cit. § 2610-2, p. 77.
[FN: § 2610-4]
PRISC. PAN. ; loc. cit. § 2610-2, p. 97.
[FN: § 2611-1]
SYNESII epistolae, dans Epist. graeci (Didot), p. 708, (252-253) epist. CX. ![]() . Voir, epist. CXXVII, p. 714-715, (262), ce qu'on dit d'un certain Euctale, préfet d'Égypte et brigand très brave.
. Voir, epist. CXXVII, p. 714-715, (262), ce qu'on dit d'un certain Euctale, préfet d'Égypte et brigand très brave.
[FN: § 2611-2]
Au temps de la guerre européenne de 1914, la bureaucratie russe renouvela exactement les erreurs commises dans la guerre contre le Japon. Elle sembla n'avoir rien appris de l'expérience. Un discours prononcé à la séance de la Douma, le 14 août 1915, par M. Maklakov, frère d'un ex-ministre de l'Intérieur, offre sous une forme modérée une vue synthétique de cet état social. « ... Cela nous amène à la question la plus épineuse de notre vie politique. Ce n'est un secret pour personne que la Russie est, par malheur, le modèle classique de l'État où beaucoup de gens ne sont pas à leur place [sénilité d'une bureaucratie qui autrefois fut bonne] (approbations à gauche et au centre). C'est le pays où l'on se plaint de manquer d'hommes et où l'on ne fait aucun cas de ceux qui y sont. Nous savons que, par malheur, ce sont surtout les gens complaisants qui réussissent, les nullités aimables (approbations), les causeurs agréables, les gens qui savent descendre le courant et deviner où le vent va souffler ; et ceux qui ne réussissent pas sont tous les hommes de caractère et de volonté et de science réelle [cette description de la circulation de la classe gouvernante est remarquable : elle est faite par un homme pratique]. Les choses en sont là, messieurs, qu'une carrière rapide et parfois brillante est un mauvais point pour un homme ; nous savons que derrière une belle carrière il n'y a pas des talents, des mérites et des services, mais des complaisances, des complicités, des protections et des faveurs (approbations à gauche et au centre). Nombre de nominations sont un scandale public, un défi à l'opinion publique ; et quand on s'aperçoit de l'erreur, il est trop tard pour éloigner ces créatures, le prestige du pouvoir ne le permet pas. Le nouveau gouvernement, dont la tâche est de vaincre les Allemands, verra bien vite qu'il est plus difficile encore de vaincre la résistance de ses subordonnés. Le grand obstacle contre lequel sont venues se briser tant d'initiatives, c'est le personnel administratif ». Un orateur socialiste avait rejeté sur le régime « despotique » la faute du manque de préparation de la Russie. M. Markov répondit très bien : « Mr. Adjemov a dit très justement que, dans cette affreuse guerre, l'Allemagne était prête. Il nous a dit aussi, en manière de reproche, que la France l'était aussi. Les Français étaient encore plus mal préparés que nous, et la guerre a montré que l'allié le plus fort c'est la Russie. À gauche, on dit que si nous ne sommes pas prêts, c'est qu'on a enchaîné la liberté ; mais les gouvernements français, anglais et belge ne l'ont pas enchaînée, et pourtant ils n'étaient pas prêts, ils l'étaient moins que la Russie ». (Journal de Genève, 3 septembre 1915). Ajoutons que, comparé au gouvernement russe actuel, le gouvernement de la grande Catherine était plutôt plus que moins autocratique, ce qui ne l'empêcha pas d'être victorieux en différentes guerres.