
Vilfredo Pareto, TraitÉ de sociologie gÉnÉrale, vol. 1a (texte) (1917)
 |
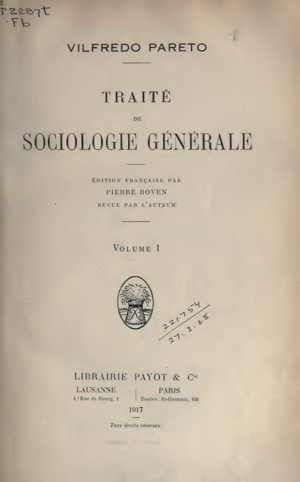 |
| Vilfredo Pareto (1848-1923) |
[Created: 31 Aug. 2022]
[Updated: November 30, 2022 ] |
Source
Pareto's Treatise was originally published in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.
Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).
Editor's note: Because of the text's length and complexity I have split it into 5 separate files (see the main page for details):
- vol. 1 (1917) in facs. PDF and HTML [vol. 1a text only and vol. 1b endnotes]
- vol. 2 (1919) in facs. PDF and HTML [vol. 2a text only and vol. 2b endnotes]
- my vol. 3 - tables and supplementary material
Table des matières
Volume 1a (le texte) [this file]
Les chapitres
- Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64
- Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149
- Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204
- Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632),vol. 1, pp. 205-344
- Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841),vol. 1, pp. 345-449
- Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577
- Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) Examen des IIIe et IVe classes. vol. 1, pp. 578-648
- Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) Examen des Ve - et VIe classes. vol. 1, pp. 649-784
- Additions
Volume 1b (les notes) [a separate file]
- Notes du Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64
- Notes du Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149
- Notes du Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204
- Notes du Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632), vol. 1, pp. 205-344
- Notes du Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841), vol. 1, pp. 345-449
- Notes du Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), pp. vol. 1, 450-577
- Notes du Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) Examen des IIIe et IVe classes. vol. 1, pp. 578-648
- Notes du Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) Examen des Ve - et VIe classes. vol. 1, pp. 649-784
TABLE DES CHAPITRES
Les chiffres arabes indiquent les pages.
PREMIER VOLUME
Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144) ... 1
Énoncé des règles suivies dans cet ouvrage. - Les sciences logico-expérimentales et les sciences non- logico-expérimentales. - Leurs différences. - Le domaine expérimental est absolument distinct et séparé du domaine non-expérimental. - Dans cet ouvrage, nous entendons demeurer exclusivement dans le domaine expérimental. - Notre étude est essentiellement contingente, et toutes nos propositions doivent être entendues avec cette restriction : dans les limites du temps, de l'espace et de l'expérience à nous connus. - Cette étude est un perpétuel devenir ; elle procède par approximations successives, et n'a nullement pour but d'obtenir la certitude, le nécessaire, l'absolu. - Considérations sur le langage des sciences logico-expérimentales, des sciences non logico-expérimentales, sur le langage vulgaire. - Définition de divers termes dont nous faisons usage dans cet ouvrage. - Les définitions sont de simples étiquettes pour désigner les choses. - Les noms ainsi définis pourraient être remplacés par de simples lettres de l'alphabet.
Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248) ... 64
Définition et classification des actions logiques et des actions non-logiques. - Comment celles-ci sont parfois capables d'atteindre très bien un but qui pourrait être logique. - Les actions non-logiques chez les animaux. - Les actions non-logiques chez les hommes. - La formation du langage humain. - Chez les hommes, les actions non-logiques sont en partie manifestées par le langage. - La théologie et le culte. - Les théories et les faits dont elles sont issues. -Différence d'intensité, chez des peuples différents, des forces qui unissent certaines tendances non-logiques, et des forces qui poussent à innover. - Exemple des peuples romain et athénien, anglais et français. - Pouvoir occulte que les mots semblent avoir sur les choses ; type extrême des théories théologiques et métaphysiques. - Dans les manifestations des actions non-logiques, il y a une partie presque constante et une partie très variable. - Exemple des orages provoqués ou conjurés. - Les interprétations s'adaptent aux tendances non-logiques du peuple. - L'évolution est multiple. - Premier aperçu de la nécessité de distinguer entièrement la vérité logico-expérimentale d'une doctrine, de son utilité sociale, ou d'autres utilités. - Forme logique donnée par les hommes aux actions non-logiques.
Chapitre III.– Les actions non-logiques dans l'histoire des doctrines (§249 à §367) ... 150
Si les actions non-logiques ont autant d'importance qu'il est dit au chapitre précédent, comment se fait-il que les hommes éminents qui ont étudié les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? - Le présent chapitre fait voir qu'ils s'en sont aperçus ; souvent ils en ont tenu compte implicitement ; souvent ils en ont parlé sous d'autres noms, sans en faire la théorie ; souvent ils n'ont considéré que des cas particuliers, sans s'élever au cas général. - Exemples de divers auteurs. - Comment l'imperfection scientifique du langage vulgaire contribue à étendre les interprétations logiques d'actions non-logiques. -Exemples. - Les hommes ont une tendance à éliminer la considération des actions non-logiques, qui sont, de ce fait, recouvertes d'un vernis logique ou autre. - Classification des moyens employés pour atteindre ce but. - Examen des différents genres. - Comment les hommes pratiques considèrent les actions non-logiques.
Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632) ... 205
Les termes courants de religion, de droit, de morale, etc., correspondent-ils à quelque chose de précis ? - Examen du terme religion. - Examen des termes : droit naturel, droit des gens. - La droite raison, le juste, l'honnête, etc. - Les doctrines types et les déviations. - Les matériaux des théories et les liens par lesquels ils sont unis. - Exemples divers. - Comment la sociologie fait usage des faits. - L'inconnu doit être expliqué par le connu, le présent sert à expliquer le passé, et, d'une manière subordonnée, le passé sert aussi à expliquer le présent. - La probabilité des conclusions. - Classification des propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale, ou qui la négligent. - Examen des genres de la catégorie dans laquelle les êtres abstraits sont connus indépendamment de l'expérience.
Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841) ... 345
Comment, une théorie étant donnée, on remonte aux faits dont elle peut tirer son origine. - Examen de la catégorie de théories dans laquelle les entités abstraites reçoivent explicitement une origine étrangère à l'expérience. - Résumé des résultats obtenus par l'induction. - Les principaux consistent en ce que, dans les théories non logico-expérimentales (c), il y a une partie peu variable (a) et une partie très variable (b) ; la première est le principe qui existe dans l'esprit de l'homme ; la seconde est constituée par les explications données de ce principe et des actes dont il procède. - Éclaircissements et exemples divers. - Dans les théories qui ajoutent quelque chose à l'expérience, il arrive souvent que les prémisses sont au moins partiellement implicites ; ces prémisses constituent une partie très importante du raisonnement. - Comment de certains principes arbitraires (a) on s'est efforcé de tirer des doctrines (c). - Exemples divers.
Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088) ... 450
Si l'on suivait la méthode déductive, ce chapitre devrait figurer en tête de l'ouvrage. - Ressemblances et différences, quant aux parties (a) et (b), entre les sciences logico-expérimentales et les sciences non logico- expérimentales. - La partie (a) correspond à certains instincts, mais ne les embrasse pas tous ; en outre, pour déterminer les formes sociales, il faut ajouter les intérêts. Aspect objectif et aspect subjectif des théories. - Exemples de la méthode à suivre pour séparer (a) de (b). - On donne des noms (arbitraires) aux choses (a), (b) et (c), simplement pour faciliter l'exposé. - Les choses (a) sont appelées résidus, les choses (b) dérivations, les choses (c) dérivées. - Correspondant aux instincts, les résidus manquent de précision. - Analogie entre notre étude des phénomènes sociaux et celle de la philologie. - Cette analogie provient du fait que le langage est un des phénomènes sociaux. - Classification des résidus. - Examen des résidus de la Ie et de la IIe classes.
Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) ... 578
Examen des IIIe et IVe classes.
Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) ... 649
Examen des Ve - et VIe classes.
A Madame JANE REGIS
Hommage de Vilfredo Pareto
[1]
Chapitre I↩
Préliminaires [(§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64]
§ 1. La société humaine est l'objet de nombreuses études. Les unes portent des noms spéciaux ; ainsi le droit, l'histoire, l'économie politique, l'histoire des religions, etc. D'autres embrassent des matières encore confuses, dont la synthèse avec celles qui sont déjà distinctes, vise à étudier la société humaine en général.
On peut donner à ce groupe d'études le nom de Sociologie.
§ 2. Une telle définition est très imparfaite. On pourrait peut-être l'améliorer, mais pas beaucoup ; car enfin, nous n'avons une définition rigoureuse d'aucune science ; pas même des diverses disciplines mathématiques ; et l'on ne peut en avoir, parce que c'est seulement à notre usage que nous divisons en différentes parties l'objet de notre connaissance, et qu'une telle division est artificielle et varie avec le temps. Qui peut dire où sont les limites entre la chimie et la physique, entre la physique et la mécanique ? Que devons-nous faire de la thermodynamique ? La mettrons-nous avec la physique ? Elle n'y serait pas trop mal. Préférons-nous lui faire une place dans la mécanique ? Elle n'y serait pas étrangère; et s'il nous plaît d'en faire une science distincte, personne ne pourra nous le reprocher. Mais, au lieu de perdre du temps à trouver sa place, ne vaudrait-il pas mieux étudier les faits dont elle s'occupe ? Laissons là les noms ; regardons aux choses.
De même, nous avons mieux à faire que perdre notre temps à chercher si la sociologie est ou n'est pas une science autonome ; si elle est autre chose que la philosophie de l'histoire sous un autre nom, ou à raisonner longuement sur les méthodes à suivre dans son étude. Occupons-nous de chercher les relations entre les faits sociaux, et laissons donner à cette étude le nom qu'on voudra. Peu importe la méthode par laquelle on acquerra la connaissance de ces relations. Le but seul nous importe [Voir Addition A1 par l’auteur] ; peu et même pas du tout les moyens qu permettent de l'atteindre.
§ 3. À propos de la définition de la sociologie, nous avons dû indiquer certaines normes que nous voulons suivre. Nous pourrions faire de même pour d'autres sujets, au fur et à mesure que l'opportunité s'en présenterait, ou bien nous pourrions exposer ces normes une fois pour toutes, dans un chapitre spécial qui servirait d'introduction à notre étude. Chacun de ces procédés a ses avantages et ses défauts. Ici, nous préférons employer le second [FN: § 3-1] .
Plusieurs sujets, très brièvement esquissés dans ce chapitre, seront développés dans la suite de l'ouvrage, où l'on trouvera les preuves de certaines propositions que nous avons ici simplement énoncées.
§ 4. Un auteur peut exposer de deux manières bien distinctes les principes qu'il veut suivre : 1° il peut demander que ces principes soient acceptés comme vérités démontrées ; si cela est admis, toutes leurs conséquences logiques seront tenues pour démontrées ; 2° il peut donner ces principes comme simple indication d'une voie parmi celles qu'il pourrait suivre ; dans ce cas, aucune de leurs conséquences logiques n'est démontrée, au point de vue concret ; elles ne sont qu'hypothétiques, tout autant que les prémisses dont on les tire. Aussi devra-t-on s'abstenir de faire usage de ces déductions et chercher les relations directement entre les faits.
Voyons un exemple. Supposons qu'on vous présente le postulat d'Euclide comme un théorème. Vous ne pouvez pas l'accepter sans discussion ; parce que si vous admettez le théo- rème, toute la géométrie euclidienne est démontrée, et vous ne pouvez plus rien lui opposer. Mais supposons qu'au contraire on vous donne le postulat comme une hypothèse ; vous ne serez pas obligé de la discuter. Libre au géomètre d'en tirer les conséquences logiques. Si elles sont d'accord avec les faits concrets, vous les accepterez, et si elles ne vous paraissent pas d'accord, vous les repousserez : votre liberté de choix n'est pas liée par une concession préliminaire. Ceci admis, il y a des géométries non euclidiennes que vous pouvez étudier sans lier en rien votre liberté de choix dans le domaine concret.
Notons que si les géomètres s'étaient butés à vouloir décider, avant de poursuivre leurs études, si oui ou non le postulat d'Euclide correspond à la réalité concrète, aujourd'hui la géométrie n'existerait même pas.
Cette observation est générale. Toutes les sciences ont progressé, quand les hommes, au lieu de disputer sur les principes, ont discuté les résultats. La mécanique céleste s'est const- ituée avec l'hypothèse de la loi d'attraction universelle. Aujourd'hui, on doute que l'attraction soit bien ce qu'on pensait ; mais quand même une nouvelle opinion serait acceptée, grâce à des observations nouvelles et meilleures, les résultats auxquels arrive la mécanique céleste subsisteraient toujours ; il n'y aurait qu'à y faire des retouches et des adjonctions.
§ 5. Instruits par l'expérience, nous voulons essayer d'employer, dans l'étude de la sociologie, les moyens qui furent si utiles dans celle des autres sciences. Par conséquent nous n'établissons aucun dogme, comme prémisse de notre étude, et l'exposé de nos principes n'est qu'une indication de la voie que nous voulons suivre, parmi les nombreuses qu'on pourrait choisir. C'est pourquoi, en nous accompagnant sur celle-là, on ne renonce nullement à en suivre une autre.
Dès les premières pages d'un traité de géométrie, l'auteur doit dire au lecteur s'il se propose d'exposer la géométrie euclidienne ou, par exemple, la géométrie de Lobatschewsky; mais ce n'est qu'un simple avertissement, et, s'il expose la géométrie de Lobatschewsky, cela ne veut pas dire qu'il nie la valeur des autres. C'est dans ce sens, et pas autrement, qu'on doit entendre l'exposé que nous faisons ici de nos principes.
§ 6. Jusqu'ici, la sociologie a été presque toujours présentée dogmatiquement. Le nom de positive, donné par Comte à sa philosophie, ne doit pas nous induire en erreur : sa sociologie est tout aussi dogmatique que le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Ce sont des religions différentes, mais enfin des religions ; et l'on en trouve du même genre, dans les œuvres de Spencer, de De Graef, de Letourneau et d'une infinité d'autres auteurs.
De sa nature la foi est exclusive. Celui qui croit posséder la vérité absolue ne peut admettre qu'il y ait d'autres vérités dans le monde. C'est pourquoi le chrétien fervent et le « libre penseur » combatif sont et doivent être intolérants. Ainsi, pour qui a la foi, une seule voie est bonne ; toutes les autres sont mauvaises. Le musulman ne voudra pas prêter serment sur l'Évangile ni le chrétien sur le Coran ; mais celui qui n'a aucune foi prêtera serment sur un livre ou sur un antre, et même sur le Contrat social de Rousseau, pour peu que cela puisse faire plaisir aux croyants humanitaires ; il ne refuserait pas non plus de prêter serment sur le Décaméron de Boccace, ne serait-ce que pour voir la mine que ferait M. Bérenger et les croyants de la religion de cet excellent monsieur.
Nous n'estimons point inutiles des sociologies qui procèdent de certains principes dogma- tiques ; de même que nous ne croyons nullement inutiles les géométries de Lobatschewsky ou de Riemann ; nous demandons seulement à ces sociologies d'employer des prémisses et des raisonnements aussi clairs que possible.
Nous sommes riches de sociologies humanitaires, telles étant presque toutes celles qui se publient maintenant. Nous ne manquons pas de sociologies métaphysiques, et parmi elles il faut ranger toutes les positivistes et toutes les humanitaires. Nous avons un certain nombre de sociologies chrétiennes, catholiques ou autres. Qu'on nous permette, sans vouloir faire tort à toutes ces estimables sociologies, d'en exposer ici une exclusivement expérimentale, comme la chimie, la physique et d'autres sciences du même genre [FN: § 6-1] .
Par conséquent, dans la suite, nous entendons prendre pour seuls guides l'expérience et l'observation.
Par abréviation, nous nommerons l'expérience seule, là où elle ne s'oppose pas à l'obser- vation. Ainsi, quand nous dirons qu'une chose nous est rendue manifeste par l'expérience, on devra sous-entendre : et par l'observation ; et quand nous parlerons de sciences expéri- mentales, il faudra comprendre : et d'observation ; et ainsi de suite.
§ 7. Dans une collectivité donnée, certaines propositions descriptives, préceptives ou autres ont cours ; par exemple : « La jeunesse est imprudente. – Tu ne convoiteras pas le bien ni la femme de ton prochain. – Sache épargner, si tu ne veux pas être un jour dans la misère. – Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De telles propositions, unies par un lien logique ou pseudo-logique et jointes à des narrations de divers genres, constituent des théories, des théologies, des cosmogonies, des métaphysiques, etc.
Toutes ces propositions et théories sont des faits expérimentaux, tant qu'on les considère de l'extérieur, sans en chercher le mérite intrinsèque, notion qui a son origine dans la foi ; et nous devons les considérer et les étudier comme des faits expérimentaux.
§ 8. Une telle étude est très utile à la sociologie, parce qu'une grande partie de ces propositions et de ces théories donne l'image de l'activité sociale. Souvent même, elles seules nous permettent d'avoir connaissance des forces qui agissent sur la société, c'est-à-dire des dispositions et des inclinations des hommes. C'est pourquoi nous nous en occuperons ici longuement.
D'abord nous devons nous efforcer de classer ces propositions et ces théories, puisque cette opération est presque indispensable pour bien connaître un grand nombre d'objets variés [FN: § 8-1] .
Pour ne pas répéter chaque fois : propositions et théories, nous ne nommerons dorénavant que ces dernières ; mais ce que nous dirons de celles-ci vaudra aussi pour celles-là, sauf indication contraire.
§ 9. Pour l'homme qui se laisse guider principalement par le sentiment, pour le croyant, il y a d'ordinaire deux seules classes de théories : celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Ces termes restent vagues ; on les sent plus qu'on ne les comprend.
§ 10. On groupe souvent ces trois axiomes : 1° Tout honnête homme, tout être intelligent doit accepter les propositions vraies et repousser les fausses ; celui qui ne le fait pas n'est pas honnête ou pas raisonnable. Les théories ont donc un caractère absolu, indépendant des sujets qui les produisent ou les acceptent. 2° Toute théorie vraie est aussi utile et vice versa. Par conséquent, lorsqu'on a démontré qu'une théorie est vraie, son étude est épuisée ; il n'y a pas besoin de rechercher si elle est utile ou nuisible. 3° On n'admet en aucune façon qu'une théorie puisse être utile pour certaines classes sociales et nuisible pour d'autres. Mais cet axiome est moderne, et beaucoup le repoussent, sans trop oser manifester leur opinion.
§ 11. Si à ces assertions nous en opposions d'autres, contraires, nous raisonnerions également a priori ; et toutes auraient, au point de vue expérimental, la même valeur, qui est zéro. Si nous voulons rester dans le domaine de l'expérience, il nous faut rechercher d'abord si les termes adoptés dans les assertions précédentes correspondent à quelque chose d'expérimental ; et, ensuite, si ces assertions sont vérifiées oui ou non par les faits. Mais, pour cela, il faut nécessairement admettre qu'on puisse répondre oui ou non ; parce qu'il est évident que si nous excluons a priori l'une de ces deux possibilités, nous résolvons ainsi a priori le problème que nous nous sommes proposé, au lieu d'en laisser, comme nous disions, la solution à l'expérience.
§ 12. Tâchons donc de classer ces théories, en suivant la même méthode que si nous avions à classer des insectes, des plantes, des roches.
Nous voyons immédiatement qu'une théorie n'est pas un ensemble homogène, comme serait un de ces corps que la chimie appelle simples ; mais qu'elle ressemble plutôt à une roche, dans la composition de laquelle entrent plusieurs corps simples.
On trouve, dans une théorie, des parties descriptives, des affirmations axiomatiques, l'intervention d'êtres concrets ou abstraits, réels ou imaginaires. Tout cela constitue en quelque sorte les matériaux de cette théorie. On y trouve aussi des raisonnements logiques ou pseudo-logiques, un appel au sentiment, des développements pathétiques, l'intervention d'éléments éthiques, religieux, etc. Tout cela donne en somme la façon dont on met en œuvre les matériaux, pour construire l'édifice qu'on appelle une théorie.
En attendant, voilà déjà un aspect sous lequel on peut considérer les théories. Pour le moment, il nous suffit de l'avoir indiqué; nous en traiterons plus loin tout au long, au chapitre IV (§ 467).
§ 13. Supposons une théorie construite de la façon indiquée tout à l'heure ; c'est un des objets de notre classification. Nous pouvons la considérer sous divers aspects.
l° Aspect objectif. On peut envisager la théorie indépendamment de celui qui l'a produite et de celui qui l'accepte ; disons objectivement, mais sans donner à ce terme aucune signifi- cation métaphysique.
Pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles entre la nature des matériaux et celle de leur lien, on devra distinguer les classes et les sous-classes suivantes :
CLASSE 1. Éléments expérimentaux :
(I a). Lien logique;
(I b). Lien non-logique;
CLASSE II. Éléments non-expérimentaux :
(II a). Lien logique;
(II b). Lien non-logique.
Les sous-classes (I b) et (II b) renferment des sophismes de logique ou des raisonnements artificieux tendant à induire en erreur. Dans l'étude que nous faisons maintenant, elles sont souvent de bien moindre importance que les sous-classes (I a) et (II a).
La sous-classe (I a) comprend toutes les sciences expérimentales ; nous l'appellerons logico-expérimentale. On peut y distinguer deux autres genres.
(I a 1) comprend le type rigoureusement pur, soit uniquement des éléments expérimen- taux et un lien logique. Les abstractions et principes généraux qu'on y emploie sont tirés exclusivement de l'expérience et y sont subordonnés (§ 63).
(I a 2) comprend une déviation du type, qui nous rapproche de (II). Les éléments sont explicitement expérimentaux et le lien logique ; mais les abstractions, les principes généraux reçoivent implicitement ou explicitement une valeur qui dépasse l'expérience.
Ce genre pourrait être appelé de transition. On en pourrait considérer d'autres semblables, mais ils n'ont pas l'importance de celui-ci.
La classification qui vient d'être faite, comme toutes celles qu'on peut imaginer, dépend de nos connaissances. Un homme qui tient pour expérimentaux certains éléments qu'un autre n'estime pas tels, placera dans la classe I une proposition que l'autre mettra dans la classe II Celui qui croit employer la logique et se trompe, rangera parmi les propositions logiques une proposition qu'un autre, ayant aperçu l'erreur, mettra parmi les non-logiques.
C'est une classification des types de théories que nous venons de faire. En réalité, une théorie donnée peut-être constituée d'un mélange de ces types. C'est-à-dire qu'une théorie donnée pourra contenir des parties expérimentales, des parties non-expérimentales, des parties logiques et des parties non-logiques [FN: § 13-1] .
2° Aspect subjectif. On peut considérer les théories par rapport à qui les produit et à qui les accepte ; et par conséquent nous aurons à envisager les aspects subjectifs suivants :
a) Raisons pour lesquelles une théorie donnée est produite par un homme donné. Pourquoi un homme donné affirme-t-il que A est égal à B ? Vice versa : s'il affirme cela, par quels mobiles est-il poussé ?
b) Raisons pour lesquelles un homme donné accepte une théorie donnée. Pourquoi un homme donné accepte-t-il l'assertion: A est égal à B ? Vice versa : s'il admet cette assertion, par quels mobiles est-il poussé ?
Ces questions s'étendent des individus aux collectivités.
3° Aspect de l'utilité. Il est bon de ne pas confondre la théorie et l'état d'esprit, les senti- ments qu'elle manifeste. Certains hommes produisent une théorie parce qu'ils ont certains sentiments ; puis cette théorie agit à son tour sur ces hommes ou sur d'autres, de manière à provoquer, renforcer, modifier certains sentiments.
1) Les sentiments exprimés par une théorie sont utiles ou nuisibles :
(I a) à celui qui la produit ;
(I b) à celui qui l'admet ;
II) Une théorie donnée est utile ou nuisible
(II a) à celui qui la produit ;
(II b) à celui qui l'admet.
Ces considérations s'étendent aussi aux collectivités.
Nous pouvons donc dire que nous considérerons les propositions et les théories sous l'aspect objectif, subjectif, de l'utilité individuelle ou sociale ; seulement le sens de ces termes ne doit pas être tiré de leur étymologie ni de leur acception vulgaire, mais exclusivement des définitions données dans le texte (§ 119).
§ 14. En résumé, soit, par exemple, la proposition: A égale B. Nous avons à répondre aux questions suivantes :
1° Aspect objectif. Cette proposition est-elle ou non d'accord avec l'expérience ?
2° Aspect subjectif. Pourquoi certains hommes disent-ils que A est égal à B ? Pourquoi d'autres hommes le croient-ils ?
3° Aspect de l'utilité. Quelle utilité ont les sentiments exprimés par la proposition : A égale B, pour qui l'énonce ? pour qui l'admet ? Quelle utilité a la théorie elle-même, d'après laquelle A égale B, pour qui l'émet ? pour qui l'accepte ?
Dans un cas extrême, on répond oui à la première question, et l'on ajoute pour les autres : « Les hommes disent, croient que A égale B, parce que c'est vrai ; les sentiments exprimés de cette façon sont utiles parce qu'ils sont vrais ; la théorie elle-même est utile parce qu'elle est vraie. »
Dans ce cas extrême, on trouve des propositions de la science logico-expérimentale, et alors vrai signifie d'accord avec l'expérience. Mais il s'y trouve aussi des propositions qui n'appartiennent en rien à la science logico-expérimentale; et, dans ce cas, vrai ne veut pas dire d'accord avec l'expérience, mais exprime tout autre chose : très souvent un simple accord avec les sentiments de celui qui défend cette thèse.
Nous verrons par l'étude expérimentale qui sera développée dans les chapitres suivants, que les faits sociaux présentent fréquemment les cas que voici : a) propositions d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord avec les sentiments, lesquels sont utiles ou nuisibles aux individus, à la société ; b) propositions d'accord avec l'expérience, repoussées parce qu'en désaccord avec les sentiments, lesquels, s'ils étaient admis, seraient nuisibles à la société ; c) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord de sentiments, lesquels sont utiles, parfois très utiles à la société ; d) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et acceptées par accord de sentiments, lesquels sont utiles à certains individus, nuisibles à d'autres, utiles ou nuisibles à la société.
De tout cela, nous ne pouvons rien savoir a priori ; nous demanderons à l'expérience de nous instruire.
§ 15. Après avoir classé les objets, il convient de les étudier ; ce sera le but des chapitres suivants. Dans les chapitres IV et V, nous considérerons particulièrement l'aspect de l'accord des théories avec l'observation et l'expérience ; dans les chapitres VI, VII et VIII, nous étudierons les sentiments dont procèdent ces théories ; dans les chapitres IX et X, nous traiterons de la manière dont ils se manifestent ; dans le chapitre XI, nous étudierons les propriétés des éléments théoriques ainsi trouvés ; et finalement, nous verrons aux chapitres XII et XIII, les effets sociaux des éléments dont nous avons vu les manifestations dans les théories, et nous aurons une idée approximative de la forme des sociétés ; ce qui est justement le but que nous visons et vers lequel nous nous serons acheminés dans les chapitres précédents.
On pourra, dans un autre ouvrage, continuer l'étude entreprise ici, et chercher les formes particulières des divers phénomènes sociaux dont nous avons trouvé la forme générale.
§ 16. Sous l'aspect objectif, nous avons divisé (§ 13) les propositions ou les théories en deux grandes classes, dont la première ne sort en aucune façon du domaine expérimental, tandis que l'autre dépasse en quelque sorte les limites de ce domaine [FN: § 16-1] . Il est essentiel, si l'on veut raisonner avec un peu de rigueur, de les maintenir bien distinctes, parce qu'au fond ce sont des choses hétérogènes que l'on ne doit jamais confondre en aucune façon, et qui ne peuvent pas même être comparées [FN: § 16-2] .
Chacune de ces classes a sa manière propre de raisonner et, en général, son critère particulier, qui la divise en deux catégories ; l’une desquelles comprend les propositions qui sont d'accord logiquement avec le critère choisi, et qui sont dites « vraies » ; l'autre qui embrasse les propositions que l'on ne peut accorder avec un tel critère, et qui sont dites « fausses » Ces termes « vraies » et « fausses » sont donc en dépendance étroite avec le critère choisi. Si l'on voulait leur donner un sens absolu, on sortirait du domaine logico- expérimental, pour entrer dans le domaine métaphysique.
Le critère de « vérité » de la première classe de propositions est tiré uniquement de l'expérience et de l'observation ; le critère de « vérité » de la seconde classe est en dehors de l'expérience objective ; on peut le trouver dans une révélation divine, dans les conceptions que, dit-on, l'esprit humain tire de lui-même, sans le secours de l'expérience objective, du consentement universel des hommes, etc.
Il ne faut jamais disputer sur les mots. Si donc il plaît à quelqu'un de donner une autre signification aux termes « vérité » et « science », nous n'y verrons pour notre part aucune difficulté ; il nous suffit qu'il fasse connaître clairement le sens qu'il entend donner aux termes adoptés, et surtout son critère de « vérité ».
§ 17. Si ce critère n'est pas indiqué, il est inutile de poursuivre la conversation, qui se perdrait en bavardages ; comme il est inutile que les avocats plaident, s'il n'y a pas un juge qui les écoute. Si quelqu'un dit: « A a la propriété B », avant de poursuivre la discussion, il convient de savoir qui jugera le procès entre cette personne et une autre qui soutient : « A n'a pas la propriété B ». Si elles tombent d'accord pour que l'expérience objective soit juge, celle- ci décidera si A a ou non la propriété B. Nous sommes alors dans le domaine de la science logico-expérimentale. Le lecteur voudra bien retenir que, dans cet ouvrage, j'entends absolument y rester, et que je refuse à tout prix d'en sortir ; par conséquent, s'il lui plaît d'avoir un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, il fera bien d'abandonner la lecture de ce livre, comme il cesserait de suivre à un procès, quand il en aurait récusé le juge.
§ 18. Si ceux qui disputent sur les propositions indiquées veulent un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, ils feront bien de déclarer quel est ce juge, et de le dire, si possi- ble, d'une façon claire ; ce qui leur arrive rarement. Ici, nous nous abstiendrons de nous mêler de discuter la nature de ces propositions. Nous n'en parlerons qu'extrinsèquement, comme de faits sociaux dont nous devons tenir compte.
§ 19. En général, les métaphysiciens appellent science la connaissance de l'essence des choses, des principes. Si nous admettons, pour un moment, cette définition, nous dirons que le présent ouvrage n'est en rien scientifique. Non seulement nous nous abstenons d'indiquer les essences et les principes, mais encore nous ne savons même pas ce que ces termes veulent dire (§ 530).
Vera [FN: § 19-1] dit : « (p. 78) La notion de science et la notion de science absolue sont insépa- rables... (p. 80). Or s'il y a une science absolue, elle n'est et ne peut être que la philosophie. Et ainsi la philosophie est le fond commun de toutes les sciences, et comme l'intelligence commune de toutes les intelligences ». Nous ne voulons rien avoir à faire ici avec une telle science, ni de près ni de loin ; « (p. 84) l'absolu ou l'essence, et l'unité ou les rapports nécessaires des êtres, voilà les deux premières conditions de la science. » Toutes deux sont étrangères à nos recherches ; nous ne comprenons même pas ce que c'est. Nous cherchons les rapports entre les choses, dans les limites d'espace et de temps à nous connus, et nous les demandons à l'expérience et à l'observation. « (p. 85) La philosophie est à la fois une explication et une création. » Nous ne savons pas et nous ne voulons pas expliquer, au sens de Vera, et encore moins créer.
« (p. 88) La science qui connaît l'absolu, et qui saisit la raison intime des choses, sait comment et pourquoi les événements et les êtres sont engendrés [nous, nous ne le savons pas] et non seulement elle le sait, mais elle les engendre d'une certaine façon elle-même, et les engendre par cela même qu'elle saisit l'absolu. Et en effet, ou il faut nier la science, ou il faut admettre qu'il y a (p. 89) un point où la connaissance et l'être, la pensée et son objet coïncident et se confondent ; et la science de l'absolu qui se produirait en dehors de l'absolu, et qui n'atteindrait pas sa nature réelle et intime ne serait pas la science de l'absolu, ou, pour mieux dire, elle ne serait pas la science. »
§ 20. Parfaitement ; je suis là-dessus d'accord avec Vera. Si la science doit être ce qu'ex- priment ces termes aussi admirables qu'incompréhensibles pour moi, ici je ne m'occupe pas de science.
Je m'intéresse au contraire à une autre chose, que définit très bien Vera, dans un cas particulier, quand il dit : « (p. 214, note). En général, la mécanique n'est qu'un mélange de données de l'expérience et de formules mathématiques. » On pourrait dire, pour être plus général: « Un mélange de données expérimentales et de déductions logiques de celles-ci. » Le lecteur me permettra d'appeler cela, pour un moment, non-science. Vera et Hegel ont raison de dire que les théories de Newton ne sont pas de la science, mais sont au contraire de la non-science. Quant à moi, je veux justement m'occuper ici de non-science, et je désire construire la sociologie sur le modèle de la mécanique céleste, de la physique, de la chimie et d'autres semblables non-sciences, laissant entièrement de côté les sciences ou la science des métaphysiciens (§ 503 (1), 514 (2)).
§ 21. Un lecteur pourrait observer : « Ceci admis, pourquoi, dans la suite de cet ouvrage, parlez-vous constamment de science, en donnant à ce mot le sens de non-science ? Auriez- vous peut-être l'intention de revendiquer ainsi pour votre non-science, l'autorité qui est l'apanage de la science seule ?»
Je répondrais que si le mot science avait généralement la signification que lui donnent les métaphysiciens, je me serais rigoureusement abstenu d'employer le nom, puisque je repousse la chose ; mais il n'en est pas ainsi, et beaucoup, beaucoup de gens appellent sciences la mécanique céleste, la physique, la chimie, etc.; et les appeler non-sciences ou user de quelque autre mot semblable, serait, je le crains, tout simplement ridicule. Mais si, d'autre part, quelqu'un pouvait en douter, qu'il ajoute un non partout où, dans cet ouvrage, il trouvera les mots science, scientifique ; il verra que le raisonnement reste le même, parce que c'est un raisonnement qui porte sur des choses et non sur des mots (§ 119).
§ 22. Tandis que la métaphysique descend des principes absolus aux cas concrets, la science expérimentale remonte des cas concrets, non pas à des principes absolus, qui pour elle n'existent pas, mais seulement à des principes généraux que l'on fait ensuite dépendre d'autres, plus généraux, et ainsi de suite indéfiniment. Un tel procédé, mal compris par qui a l'habitude des raisonnements métaphysiques, a donné lieu à plusieurs interprétations erronées.
§ 23. Notons seulement, en passant, le préjugé que, pour connaître une chose, il convient d'en connaître l'essence. Tout au contraire, la science expérimentale part de la connaissance des choses, pour remonter, sinon à l'essence qui, pour elle, est une entité inconnue, du moins aux principes généraux (§ 19 et sv.).
Un autre préjugé, en partie semblable au précédent, règne aujourd'hui en économie et en sociologie ; il consiste à croire qu'on ne peut acquérir la connaissance d'un phénomène, qu'en recherchant son « origine » [FN: § 23-1] (§ 93, 346).
§ 24. Sous une forme atténuée, le préjugé qui impose la connaissance de l' « essence », vise à démontrer les faits particuliers au moyen du principe général, au lieu de déduire celui- ci de ceux-là. On confond ainsi la démonstration du fait avec la démonstration de ses causes.
Par exemple, de certaines observations, nous concluons à l'existence d'un fait A, et de plus nous en indiquons comme causes probables: B, C, D,... On démontre que ces causes ne sont pas efficaces, et l'on en conclut que A n'existe pas. Cette démonstration serait pleinement convaincante, si l'on avait déduit l'existence de B, C, D,... de l'expérience, et si l'on en avait conclu à l'existence de A ; elle n'a pas la moindre force probante, si, au contraire, l'observation a donné directement A.
§ 25. La difficulté que beaucoup de gens éprouvent, à faire l'analyse d'un phénomène et à en étudier séparément les différentes parties, est aussi en relation avec un tel préjugé. Nous devrons souvent revenir sur ce chapitre ; qu'il nous suffise de noter ici que beaucoup de personnes n'admettront pas les distinctions faites au § 13 ; et que si d'autres les admettent théoriquement, elles les démentiront bientôt dans leur raisonnement pratique (§ 31, 32, 817).
§ 26. Pour qui possède une foi vive, les divers caractères des théories indiquées au § 13 se réduisent souvent à un seul. Le croyant cherche seulement si la proposition est vraie ou n'est pas vraie. Que signifie exactement ce terme vrai ? Personne ne le sait ; le croyant moins que tout autre. En gros, le sens de cette expression paraît être celui d'un accord avec les sentiments du croyant ; mais cela n'est perceptible qu'à celui qui juge la croyance, de l'extérieur, à celui qui lui est étranger ; non pas au croyant lui-même. D'habitude, il repousse et tient presque pour offense un tel caractère subjectif d'une croyance, que lui estime au contraire absolument vraie. C'est aussi pourquoi il refuse de séparer le terme vrai du sens qu'il lui donne, et pourquoi il parle volontiers d'une vérité différente de la vérité expéri- mentale et supérieure à elle. Nous aurons à nous entretenir longuement de ce sujet, dans les chapitres suivants.
§ 27. Il est inutile de s'adonner à de semblables discussions ; elles ne peuvent être que vaines et oiseuses, tant qu'on ne sait à quoi correspondent précisément les termes adoptés, et tant qu'un critère, un juge pour trancher le litige font défaut (§ 17 et sv.).
Ce critère, ce juge, est-ce l'observation et l'expérience ou quelque chose d'autre ? Il convient de bien fixer ce point, avant de passer outre.
Si vous avez toute liberté, vous pouvez choisir entre deux juges celui que vous préférez, pour prononcer sur votre cas ; mais vous ne pouvez les choisir tous deux en même temps, si vous n'êtes pas certain tout d'abord qu'ils auront une seule opinion et une seule volonté.
§ 28. Les métaphysiciens en ont la certitude a priori, parce que le critère non-expéri- mental jouit auprès d'eux d'une telle autorité et d'un si grand pouvoir, qu'il domine l'autre ; lequel doit nécessairement s'accorder avec lui ; et, pour un motif semblable, les théologiens sont sûrs que les deux critères ne peuvent jamais être en désaccord. Nous, moins éclairés, ne possédons pas de si grandes lumières a priori ;. car nous ignorons entièrement ce qui doit être et nous cherchons seulement ce qui est. Aussi devons-nous nous contenter d'un seul juge.
§ 29. Ajoutons qu'à notre avis, la logique même ne donne pas de conséquences néces- saires, hormis de simples tautologies ; et qu'elle tire son efficacité de la seule expérience (§ 97). Mais ce n'est pas ici le lieu de traiter ce sujet ; nous y avons fait allusion seulement pour éviter des équivoques.
§ 30. L'esprit de l'homme est synthétique ; seule, l'habitude du raisonnement scientifique permet à quelques personnes de séparer par l'analyse les parties d'un tout (§ 25). Les, femmes spécialement et, parmi les hommes, les moins cultivés, éprouvent souvent une difficulté invincible à considérer indépendamment l'un de l'autre, les divers aspects d'une chose. Qui veut s'en persuader n'a qu'à faire une expérience très simple : lire en société un fait de chronique d'un journal ; puis essayer de parler des différents aspects sous lesquels on peut l'envisager, en les passant en revue l'un après l'autre. Il verra qu'il n'est pas suivi par ceux qui l'écoutent, et qu'ils en reviennent sans cesse à considérer tous les aspects en même temps.
§ 31. De cette tendance de l'esprit humain, résulte, pour l'homme qui émet une propo- sition et pour celui qui l'écoute, une grande difficulté à tenir séparés les deux critères, expérimental et non-expérimental ; tandis qu'une force invincible pousse la majorité des hommes à les confondre. Un très grand nombre de faits fort importants pour la sociologie, trouvent ainsi leur explication, comme nous le verrons mieux dans la suite.
§ 32. Dans les sciences naturelles, on a fini par comprendre la nécessité de l'analyse, – pour l'étude des différentes parties du phénomène concret, – suivie de la synthèse, afin de revenir de la théorie au fait concret. Dans les sciences sociales, beaucoup n'ont pas encore compris cela.
§ 33. De là vient l'erreur très commune qui consiste à nier la vérité d'une théorie, parce qu'elle n'explique pas toutes les parties d'un fait concret ; et, sous une autre forme, la même erreur, consistant à vouloir englober dans une seule, toutes les autres théories analogues et même étrangères.
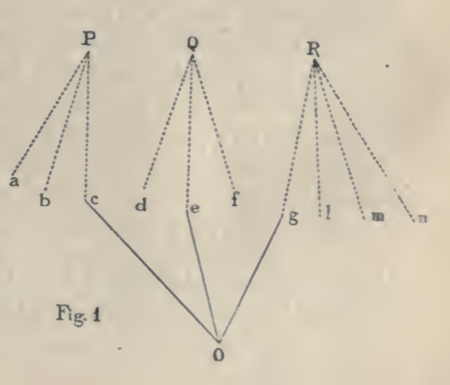
Figure 1
Soit O, un phénomène concret (Fig. 1). Séparons-y, par analyse, divers faits : c, e, g,... Le fait c et ceux qui lui sont analogues, c'est-à-dire a, b,... sont unis par une certaine théorie ils dépendent d'un principe général P. Semblablement e et les faits analogues à e, c'est-à-dire d, f,... donnent une autre théorie Q ; et les faits g, 1, m, n,... donnent une autre théorie R ; et ainsi de suite. Ces théories sont étudiées séparément ; puis, pour connaître le fait concret O, on réunit les résultats c, e, g,... des théories. À l'analyse, on fait suivre la synthèse.
Les personnes qui ne comprennent pas cela disent : « O ne contient pas seulement e, mais aussi c ; donc la théorie Q doit aussi renfermer c ». La conclusion est erronée ; il faut dire, et c'est la seule conclusion juste : « ... donc la théorie Q nous donne seulement une partie du phénomène O ».
§ 34. Exemple. Soit Q, la théorie de l'économie politique. Un phénomène concret O n'a pas seulement une partie économique e, mais aussi d'autres parties sociologiques, c, g,... C'est une erreur de vouloir englober dans l'économie politique les parties sociologiques C, g,..., comme l'ont fait beaucoup de gens ; la seule conclusion exacte à tirer de ce fait, est qu'il convient d'ajouter – ajouter, dis-je, et non substituer – aux théories économiques qui donnent e, d'autres théories qui donnent c, g,...
§ 35. En économie politique aussi, il faut ajouter, non substituer, les théories de l'économie appliquée à celles de l'économie pure ou mathématique. L'économie mathématique a pour but principal de mettre en lumière la mutuelle dépendance des phénomènes économiques ; et, jusqu'à présent, on ne connaît aucune autre manière d'atteindre ce but [FN: § 35-1] .
§ 36. Voici l'un de ces nombreux individus qui ont le malheur de discourir sur des choses qu'ils ne comprennent pas ; il découvre – voyez quel génie ! – que l'économie pure n'est pas l'économie appliquée, et conclut, non pas qu'il faut y ajouter quelque chose pour connaître les phénomènes concrets, mais qu'il faut y substituer sa phraséologie. Eh ! brave homme, l'économie mathématique arrive au moins à nous faire connaître, en gros, comment opère la mutuelle dépendance des phénomènes économiques, tandis que ton galimatias ne nous apprend rien du tout !
§ 37. Voici un autre merveilleux esprit, qui veut substituer la psychologie à l'économie politique, parce que beaucoup de phénomènes économiques dépendent de la volonté de l'homme. Pourquoi donc s'arrête-t-il là et n'y substitue-t-il la géographie et même l'astronomie ? Car enfin le phénomène économique dépend aussi des mers, des continents, des fleuves et principalement du soleil qui féconde
La terre, inépuisable et suprême matrice. (V.H.)
Il est des gens qui donnent à ces élucubrations le nom d'Économie positive ; ils ont au moins le mérite d'amuser leur lecteur.
§ 38. Passant à un sujet plus sérieux, nous observerons que beaucoup d'économistes ont eu la tendance d'englober dans la théorie de la valeur, n'importe quelle théorie économique [FN: § 38-1] . À la vérité, presque tous les phénomènes économiques se manifestent par la valeur ; mais on doit seulement en conclure qu'en séparant les diverses parties de ces phénomènes, nous trouverons la théorie de la valeur, et non pas que l'on doit englober les autres parties dans cette théorie. On va encore plus loin, et la valeur devient la porte par laquelle ou veut que la sociologie fasse irruption en économie politique. Dieu merci, on s'en tient là ; bien d'autres choses pourraient passer par cette porte. Au moyen de la psychologie, on pourrait expliquer comment et pourquoi une chose, réelle ou imaginaire, vau t; puis la physiologie viendrait au secours de la psychologie. Pourquoi n’y ferait-on pas entrer aussi un peu de biologie, qui expliquerait les conditions fondamentales de la physiologie ? N'y mettrons-nous pas un peu de mathématiques ? car enfin, dans une équation, le premier membre vaut le second ; fourrons donc aussi la théorie des équations dans celle de la valeur. On peut continuer ainsi à l'infini.
Dans tout cela, il y a de vrai que le phénomène concret est très compliqué et peut être considéré comme formé de nombreuses parties A, B, C,... L'expérience montre que pour en acquérir la connaissance, la meilleure manière est de séparer les parties A, B, C,... et de les étudier une à une ; puis de les réunir de nouveau pour avoir ainsi la théorie du phénomène complexe (§ 2010 et Sv.). C'est ce que fait la science logico-expérimentale ; mais celui qui n'en a pas l'habitude va au hasard, passe de A à B, de B à C et ainsi de suite ; à chaque instant, il retourne en arrière, se trompe, et donne dans le galimatias ; quand il étudie A, il pense à B, et quand il étudie B, il pense à autre chose. Pire encore si quelqu'un étudie A ; il s'interrompt pour discourir sur B, et quand ou lui répond sur B, il discourt sur C ; il passe du coq à l'âne, barbote, parle hors de propos, et ne démontre qu'une chose : son ignorance complète de toute méthode scientifique.
§ 39. Ceux qui nient le caractère scientifique de l'économie politique montrent qu'elle ne suffit pas à expliquer les phénomènes concrets. Ils en tirent la conclusion qu'on doit l'exclure de l'explication de tels phénomènes ; tandis qu'au contraire la conclusion rigoureuse serait qu'il faut y ajouter d'autres théories. En raisonnant comme ces personnes, on devrait dire qu'il faut exclure la chimie de l'explication des phénomènes de l'agriculture, parce qu'elle seule ne suffit pas à les expliquer entièrement. On devrait aussi exclure des écoles d'ingénieurs, la mécanique rationnelle, qui est à la mécanique pratique, à peu près ce que l'économie pure est à l'économie appliquée.
§ 40. Il est très difficile et presque impossible d'obtenir que l'on sépare la simple connaissance des uniformités de la société, de l'action qui a pour but de les modifier. Si quelqu'un s'occupe uniquement de connaître ce qui existe, on veut à tout prix qu'il ait quand même un but pratique ; on s'efforce de le trouver ; et, puisqu'il n'y en a pas, on finit par l'inventer.
§ 41. Il est aussi très difficile d'obtenir qu'on n'aille pas au delà de l'expression de la pensée d'un auteur, et qu’aux propositions exprimées par lui on n'en ajoute pas d'implicites, qu'il n'a jamais eues en vue (§ 73 et sv., 311). Si vous remarquez un défaut à une chose A, on entend que vous blâmez la chose en son entier ; si vous y notez un avantage, on comprend que vous la louez dans son ensemble. Il paraît étrange que vous en signaliez les défauts, si vous ne voulez pas la blâmer dans son ensemble ; ou les qualités, si vous ne l'estimez pas digne de louange en son entier. Cela serait raisonnable, au moins en partie, pour un discours de propagande, car il n'appartient pas à l'avocat d'accuser son propre client ; mais la déduction n'est pas juste, quand on veut la tirer d'une simple description ou d'une recherche d'uniformités. À la rigueur, ce serait admissible, dans un raisonnement non pas logico- expérimental, mais par accord de sentiments (§ 514). En effet, celui qui suit une telle métho- de doit, pour obtenir l'approbation du sentiment d'autrui, exprimer le sien propre ; et, s'il ne le fait pas explicitement, on peut supposer qu'il le fait implicitement. Mais celui qui raisonne objectivement, selon la méthode logico-expérimentale, n'a pas à exprimer son propre sentiment, ni explicitement ni implicitement.
§ 42. Quant aux preuves, celui qui affirme une proposition ou une théorie logico- expérimentale (§ 13-I a) recourt à l'observation, à l'expérience, à leurs déductions logiques ; mais celui qui affirme une proposition ou une théorie non logico-expérimentale ne peut compter que sur le consentement spontané de l'esprit d'autrui, et sur les déductions plus ou moins logiques qu'il peut tirer des principes qui ont cours. En somme, il prêche plus qu'il ne démontre. Toutefois, cela n'est généralement pas admis par ceux qui font usage des théories non logico-expérimentales ; ils s'imaginent donner des preuves du même genre que celles dont on use pour les théories logico-expérimentales ; et, dans ces raisonnements pseudo- expérimentaux, ils profitent beaucoup de l'indétermination du langage vulgaire.
Quand il s'agit de persuader autrui, les preuves n'ont de valeur que pour qui est familier avec le raisonnement logico-expérimental. L'autorité a une grande part, même dans les propositions logico-expérimentales, bien qu'elle n'y ait aucunement la valeur d'une preuve. L'accord des sentiments, les passions, l'indétermination des termes ont une grande valeur dans tout ce qui n'est pas raisonnement logico-expérimental (§ 514).
§ 43. Quant aux preuves, l'expérience ne peut rien contre la foi ni la foi contre l'expérience ; de sorte que chacune a son domaine propre. Si Paul n'est pas croyant et nie que Dieu créa le ciel et la terre, et que vous lui opposiez l'autorité de la Bible, vous aurez donné un beau coup de sabre dans l'eau ; parce que Paul niera l'autorité de la Bible, et tout votre raisonnement tombera. Substituer l'autorité de l'expérience chrétienne à celle de la Bible serait un puéril expédient, parce que Paul répliquera que sa propre expérience ne l'engage pas le moins du monde à être d'accord avec vous ; et si vous lui répondez que celle-ci n'est pas chrétienne, vous aurez fait un superbe raisonnement en cercle. Il est en effet certain que si, seule est chrétienne l'expérience qui conduit à des résultats donnés, on en peut incontes- tablement déduire que l'expérience chrétienne conduit à ces résultats ; mais avec cela nous n'apprenons rien du tout.
§ 44. Qui affirme une proposition logico-expérimentale (§ 13-1 a) peut placer son contradicteur dans l'alternative ou d'accepter cette affirmation pour vraie, ou de refuser créance à l'expérience et à la logique. Si quelqu'un prenait ce dernier parti, il serait dans la situation de Paul dont nous parlions tout à l'heure, et vous n'auriez aucun moyen de le persuader.
§ 45. On voit donc que, si nous excluons comme toujours le raisonnement sophistique et de mauvaise foi, la différence, au point de vue de la force probante, entre les théories logico- expérimentales (I a) et celles qui ne le sont pas, consiste principalement en ce que, à notre époque et dans nos pays, il est plus facile de trouver quelqu'un qui refuse de croire au Coran, à l'Évangile, à l'expérience chrétienne, intime, humanitaire, rationnelle – on l'appellera comme on voudra, – à l'impératif catégorique, aux dogmes du positivisme, du nationalisme, du pacifisme ou à une infinité d'autres semblables, qu'à la logique et à l'expérience. En d'autres temps et dans d'autres pays, il en peut être autrement.
§ 46. Gardons-nous de vouloir, en aucune façon, comme le fait une certaine méta- physique matérialiste, doter la logique et l'expérience d'une force et d'une dignité supérieures à celle des dogmes acceptés par le sentiment. Notre but est de distinguer, non de comparer et surtout pas de juger des mérites et des vertus de ceux-ci et de celles-là (§ 69).
§ 47. Gardons-nous aussi de faire rentrer par la fenêtre, la certitude que nous avons chassée par la porte. Nous n'affirmons pas que la preuve logico-expérimentale soit supérieure à l'autre, qu'elle doive lui être préférée ; nous disons seulement, – ce qui est très différent, – qu'elle est la seule à employer par qui ne veut sortir du champ logico-expérimental. C'est même d'ailleurs une tautologie. Il serait donc inutile de l'exprimer, si une telle proposition n'était oubliée à tout instant par qui confond l'expérience et la foi, le raisonnement et le sentiment.
§ 48. Le cas extrême de celui qui dénie toute force probante à toute expérience, à tout raisonnement logique, est très rare. On peut taire, négliger, éviter par différents artifices les considérations logico-expérimentales ; mais il est difficile d'en faire entièrement abstraction; c'est pourquoi on essaye presque toujours de démontrer les théories qui ne sont ni objectives ni expérimentales, à l'aide de preuves pseudo-expérimentales et pseudo-logiques.
§ 49. Toutes les religions ont des preuves de ce genre, auxquelles on ajoute volontiers celles de l'utilité pour l'individu et la société. Et quand une religion se substitue à une autre, elle cherche à faire croire que ses preuves expérimentales sont meilleures que celles dont la religion vaincue peut se prévaloir. Les miracles chrétiens étaient, nous dit-on, certainement beaucoup plus concluants que ceux des païens, et aujourd'hui les preuves scientifiques du solidarisme et de l'humanitarisme sont incontestablement meilleures que les miracles chré- tiens. Pourtant celui qui étudie ces faits sans le secours de la foi ne les trouve pas très différents, et leur assigne exactement la même valeur scientifique, c'est-à-dire zéro.
Nous devons croire qu'à la bataille de Trasimène, la défaite des Romains fut causée par la négligence impie du consul Flaminius, à l'égard des présages envoyés par les dieux. Le consul et son cheval tombèrent devant la statue de Jupiter Stator ; les poulets sacrés refusèrent la nourriture ; enfin, l'on ne pouvait plus arracher de terre les enseignes [FN: § 49-1] . Nous tiendrons aussi pour certain, – davantage ou moins ? je ne sais – que les croisés durent leur victoire d'Antioche à la protection céleste, dont le signe concret fut la sainte lance [FN: § 49-2] . Il est de même certain, voire très certain, puisque c'est affirmé par une religion meilleure et plus récente, que Louis XVI de France perdit le trône et la vie uniquement par son manque d'amour envers son cher et bon peuple. Le dieu humanitaire de la démocratie ne laisse jamais de telles offenses impunies.
§ 50. Prenons garde que la science expérimentale n'a pas de dogmes, et que par consé- quent les faits expérimentaux ne peuvent s'expliquer que par l'expérience. Si l'on observait le contraire, cette science accepterait ces solutions comme elle accepte tout autre fait d'obser- vation. En effet, elle admet que l'invention peut parfois profiter de principes non-expérimen- taux, et cela parce qu'une telle proposition est d'accord avec les résultats de l'expérience [FN: § 50-1] .
Quant à la démonstration, l'histoire des connaissances humaines met clairement en lumière la faillite de toutes les tentatives d'expliquer les faits naturels, grâce à des proposi- tions découlant de principes religieux ou métaphysiques. Aujourd'hui, de telles recherches sont entièrement abandonnées en astronomie, en géologie, en physiologie et en toute autre science semblable. S'il en reste des traces dans la sociologie et dans ses branches : le droit, l'économie, la morale et autres, cela vient de ce que ces études n'ont pas encore atteint l'état exclusivement scientifique [FN: § 50-2] .
§ 51. Une des dernières tentatives, faites pour soumettre l'expérience à la métaphysique, est celle de Hegel avec sa Philosophie de la Nature ; laquelle, à vrai dire, atteint et dépasse les limites de la plus comique absurdité [FN: § 51-1] .
§ 52. D'autre part, on commence de nos jours à refuser de croire aux dogmes qui usurpent le caractère de la science expérimentale.
Les sectaires de la religion humanitaire ont coutume d'opposer les théories certaines de la science aux fables de la religion qu'ils combattent ; mais cette certitude n'est rien d'autre qu'un de leurs préjugés. Les théories scientifiques sont de simples hypothèses, qui vivent tant qu'elles sont d'accord avec les faits, et qui meurent et disparaissent quand de nouvelles études détruisent cet accord. D'autres leur sont alors substituées, auxquelles est réservé le même sort (§ 15).
§ 53. Supposons qu'un certain nombre de faits soient donnés. Le problème d'en trouver la théorie n'a pas une solution unique. Il peut y avoir différentes théories qui satisfassent également bien aux données du problème, et parmi elles le choix peut être quelquefois suggéré par des motifs subjectifs, comme serait celui d'une plus grande simplicité (§ 64).
§ 54. Dans les théories logico-expérimentales (I a) comme dans celles qui ne le sont pas, il existe certaines propositions générales, dites principes, dont on déduit logiquement des conséquences qui constituent les théories. La nature de tels principes diffère entièrement dans ces deux genres de théories.
§ 55. Dans les théories logico-expérimentales (I a), les principes ne sont autre chose que certaines propositions abstraites, dans lesquelles sont condensés les caractères communs de nombreux faits ; ces caractères dépendent des faits et non ceux-ci de ceux-là; ils ne les dominent pas, mais leur sont soumis ; ou les accepte comme hypothèses, pour autant et tant qu'ils concordent avec les faits ; on les rejette sitôt qu'ils s'en éloignent (§ 63).
§ 56. Au contraire, dans les théories non logico-expérimentales, nous trouvons épars des principes qui sont admis a priori, indépendamment de l'expérience qu'ils dominent. Ils ne dépendent pas des faits, mais les régissent ; ils ne leur sont pas assujettis, mais les commandent. On les accepte sans s'inquiéter des faits, qui doivent nécessairement s'accorder avec les déductions tirées des principes ; et quand ils paraissent ne pas être d'accord, on essaie divers raisonnements, jusqu'à ce qu'il s'en trouve un qui rétablisse l'accord ; lequel ne saurait jamais faire défaut.
§ 57. Chronologiquement, l'ordre de nombreuses théories est l'inverse de celui indiqué au § 13 ; c'est-à-dire que les théories non-logico-expérimentales précèdent souvent les autres (I a).
§ 58. Dans les théories non logico-expérimentales, la subordination des faits aux prin- cipes se manifeste de plusieurs façons :
1° On est tellement sûr des principes dont on part, que l'on ne s'occupe même pas de rechercher si leurs conséquences sont d'accord avec l'expérience. L'accord doit exister, et l'expérience, véritable servante, ne peut pas, ne doit pas se révolter contre sa maîtresse [FN: § 58-1] . Cet état s'observe spécialement quand les propositions logico-expérimentales tentent d'envahir le domaine des théories non-logico-expérimentales.
2° Une telle invasion se poursuivant, le progrès des sciences expérimentales finit par les affranchir de la servitude à laquelle elles étaient soumises ; on leur concède une certaine autonomie; il leur est permis de vérifier les déductions tirées des principes généraux ; mais on affirme que cette vérification aboutit toujours à confirmer les dits principes ; s'il semble qu'elle n'y aboutit pas, la casuistique vient à la rescousse pour établir l'accord désiré.
3° Quand enfin cette manière de maintenir la domination des principes généraux vient, elle aussi, à faire défaut, on se résigne à permettre aux sciences expérimentales de jouir de l'indépendance qu'elles ont conquise ; mais on affirme que leur domaine est quelque chose d'inférieur, puisqu'elles visent au relatif, au particulier ; tandis que les principes philoso- phiques visent à l'absolu, à l'universel.
§ 59. On ne sort pas du champ expérimental, ni par conséquent du domaine des théories logico-expérimentales (I a), en faisant usage d'hypothèses, employées uniquement comme moyen de déduction, et toujours subordonnées aux vérifications de l'expérience. On en sortirait, si ces hypothèses jouaient le rôle de raison démonstrative, indépendamment des vérifications expérimentales. Par exemple, l'hypothèse de la gravitation universelle ne nous fait pas sortir du champ expérimental, si, comme le fait la mécanique céleste moderne, nous entendons toujours soumettre ses déductions à l'expérience. Elle nous en ferait sortir, si nous déclarions qu'elle est une propriété essentielle de la matière, et que par conséquent les mouvements des astres doivent nécessairement se produire selon les déductions de cette hypothèse.
Cela n'a pas été compris de ceux qui, comme A. Comte, voulaient exclure de la science l'hypothèse de l'éther lumineux. Cette hypothèse et d'autres semblables ne doivent pas être jugées d'une façon intrinsèque, mais extrinsèque ; c'est-à-dire en observant si et jusqu'où leurs conséquences concordent avec les faits.
§ 60. Quand un très grand nombre de conséquences d'une hypothèse ont été vérifiées par l'expérience, il devient extrêmement probable qu'une nouvelle conséquence le sera aussi ; donc, en ce cas, les deux genres d'hypothèses notées aux § § 55-56 tendent à se confondre ; et, pratiquement, on est poussé à admettre la nouvelle conséquence sans la vérifier. Cela expli- que la confusion qui se produit dans l'esprit de beaucoup de gens, entre l'hypothèse soumise à l'expérience et celle qui la domine. Toujours pratiquement, il y a des cas où l'on peut accepter sans discussion les conséquences de certaines hypothèses. Par exemple, on met en doute, aujourd'hui, divers principes de la mécanique rationnelle, au moins pour des vitesses beaucoup plus grandes que celles qu'on observe en pratique ; mais il est manifeste que l'ingé- nieur constructeur de machines peut, sans le moindre danger d'erreur, continuer à admettre ces principes, puisque les vitesses des pièces de ses machines sont certainement bien éloignées de celles qui exigeraient un changement des principes de la dynamique.
§ 61. En économie pure, l'hypothèse de l'ophélimité reste expérimentale, tant que ses conséquences sont vérifiables par les faits ; il n'en serait plus ainsi si une telle dépendance venait à cesser. C'est ce que Walras n'a pas compris pour la valeur d'échange [FN: § 61-1]. Si nous nous passons de l'hypothèse d'ophélimité, ce qui est possible moyennant l'observation des courbes d'indifférence ou grâce à d'autres procédés semblables, nous nous soustrayons aussi à la nécessité de vérifier expérimentalement les conséquences d'une hypothèse qui disparaît.
§ 62. De même, l'hypothèse de la valeur demeure expérimentale, si, par valeur, on entend un fait dont les conséquences sont vérifiables expérimentalement ; elle cesse de l'être, quand ce mot désigne une entité métaphysique qui devrait dominer les vérifications expéri- mentales [FN: § 62-1] (§ 104).
§ 63. Nous l'avons déjà dit : si l'on veut conserver rigoureusement leur caractère aux sciences logico-expérimentales, il faut envisager ce qu'on appelle des principes généraux (§ 55), comme de simples hypothèses ayant pour but de nous faire connaître une synthèse de faits, de les relier par une théorie, de les résumer. Les théories, leurs principes, leurs déduc- tions, sont entièrement subordonnés aux faits, et n'ont d'autre critère de vérité que de bien les représenter.
Ainsi est renversé le rapport qui, dans les théories non-logico-expérimentales (§ 13-II), unit les faits aux principes généraux ; mais l'esprit humain a une si grande inclination pour ce dernier genre de théories, que l'on vit souvent les principes généraux régner de nouveau dans celles qui avaient la prétention d'être rangées parmi les logico-expérimentales (I a). On admit que les principes avaient une existence presque indépendante ; qu'il y avait une seule théorie vraie et une infinité de fausses ; que l'expérience pouvait bien nous faire connaître quelle était la vraie, mais qu'elle-même devait ensuite s'y soumettre. Enfin, les principes généraux, sou- verains de par le droit divin dans les théories non-logico-expérimentales (§ 17), devinrent souverains par élection, mais souverains quand même, dans les théories logico-expéri- mentales (I a).
On obtient ainsi les deux sous-classes indiquées au § 13 ; mais il convient d'observer que souvent leurs caractères sont implicites plutôt qu'explicites; c'est-à-dire qu'on admet les principes généraux sans déclarer explicitement de quelle manière on les envisage.
§ 64. Le continuel progrès des sciences expérimentales amena de même la destruction de cette souveraineté élective, et nous conduisit ainsi aux théories rigoureusement logico- expérimentales (I a 1), dans lesquelles les principes généraux ne sont que des abstractions créées pour représenter les faits ; tandis qu'on admet qu'il peut y avoir différentes théories également vraies (§ 53), en ce sens qu'elles donnent une image également bonne des faits, et que parmi elles, le choix est arbitraire, entre certaines limites. En un mot, on peut dire que nous atteignons la limite extrême du nominalisme, pourvu qu'on dépouille ce terme de ses accessoires métaphysiques.
§ 65. Ayant résolu de ne pas sortir du champ logico-expérimental, nous n'avons pas à résoudre le problème métaphysique du nominalisme et du réalisme [FN: § 65-1] ; c'est-à-dire que nous ne croyons pas devoir décider si l'individu seul existe, ou si c'est l'espèce seule, (§ 1651) vu d'ailleurs que la signification précise de ce terme exister ne nous est pas suffisamment connu. Nous entendons étudier les choses, par conséquent les individus, et considérer les espèces comme des agrégats de choses plus ou moins semblables, et formés par nous en vue d'atteindre certains buts. Nous ne voulons pas pousser plus loin dans nos études ; libre à d'autres de poursuivre au delà des bornes auxquelles nous nous arrêtons.
§ 66. Notez qu'étudier les individus ne veut pas dire que l’on doit considérer plusieurs de ceux-ci mis ensemble, comme une simple somme ; ils forment un composé, lequel, à l'égal des composés chimiques, peut avoir des propriétés qui ne sont pas la somme des propriétés des composants.
§ 67. Que le principe substitué à l'expérience ou l'observation soit théologique, méta- physique ou pseudo-expérimental, cela peut avoir une grande importance à certains points de vue, mais n'en a aucune sous l'aspect considéré maintenant, de sciences logico-expérimen- tales. Saint Augustin nie qu'il y ait des antipodes, parce que l'Écriture Sainte n'en fait pas mention [FN: § 67-1] . En général, les Pères de l'Église trouvent dans les Écritures, le critère de toute vérité, même expérimentale. Les métaphysiciens les tournent en dérision, et aux principes théologiques en substituent d'autres qui sont tout aussi étrangers à l'expérience. Des savants postérieurs à Newton, oubliant qu'il avait seulement affirmé que les corps célestes se mouvaient comme s'ils s'attiraient suivant une certaine loi, envisagèrent celle-ci comme un principe absolu, découvert par l'esprit humain, vérifié par l'expérience, et auquel devait être soumise toute la création pour l'éternité. Mais récemment, les principes de la mécanique subirent une critique sévère, et l'on en vint à conclure que seuls subsistaient les faits et les équations qui les représentent. Le simple fait, observe judicieusement Poincaré, que certains phénomènes comportent une explication mécanique, implique qu'ils en admettent une infinité.
§ 68. Insensiblement, toutes les sciences naturelles acheminent plus ou moins leurs études vers le type logico-expérimental (I a 1); et nous devons déclarer ici que notre intention est d'étudier la sociologie de cette manière, c'est-à-dire en nous efforçant de la ramener à ce type (§ 6, 486, 514 [FN: § 1] ).
§ 69. La voie que nous voulons suivre, dans cet ouvrage, est donc la suivante :
1° Nous n'entendons nous occuper en aucune façon de la vérité intrinsèque de n'importe quelle religion, foi, croyance métaphysique, morale ou autre. Ce n'est pas que nous soyons imbu du moindre mépris pour ces choses, mais seulement qu'elles sortent des limites où nous désirons rester. Les religions, croyances, etc., nous les considérons seulement de l'extérieur, pour autant qu'elles sont des faits sociaux, à l'exclusion de leur valeur intrinsèque. La proposition : « A doit [FN: § 69-1] être égal à B, en vertu de quelque principe supérieur à l'expérience », échappe donc entièrement à notre examen (§ 46) ; mais nous étudions comment une telle croyance est née, s'est développée et dans quelle relation elle se trouve avec les autres faits sociaux.
2° Le domaine où nous travaillons est donc exclusivement celui de l'expérience et de l'observation. Nous employons ces termes au sens qu'ils ont dans les sciences naturelles, comme l'astronomie, la chimie, la physiologie, etc.; et non pour indiquer ce qu'on entend par : expérience intime, chrétienne, qui, changeant à peine de nom, ressuscite tout bonnement l’auto-observation des anciens métaphysiciens. Nous considérons cette auto-observation seulement comme un fait externe ; nous l'étudions donc comme tel, non comme un sentiment qui nous est propre.
3° N'envahissant pas le domaine d'autrui, nous n'admettons pas qu'on envahisse le nôtre [FN: § 69-2] . Nous estimons déraisonnable et vain d'opposer l'expérience aux principes qui la dépassent ; mais nous repoussons également la suzeraineté de ces principes sur l'expérience. [Voir Addition A2 par l’auteur]
4° Nous partons des faits, pour composer des théories, et nous tâchons toujours de nous éloigner le moins possible de ces faits. Nous ignorons ce qu'est l'essence des choses (§ 19, 91, 530), et n'en avons cure, parce qu'une telle étude sort de notre domaine (§ 91), Nous recher- chons les uniformités présentées par les faits, et leur donnons aussi le nom de lois [FN: § 69-3] ; mais ces faits ne sont pas soumis à ces dernières. au contraire. Les lois ne sont pas nécessaires (§ 29) ; ce sont des hypothèses qui servent à résumer un nombre plus ou moins grand de faits, et durent tant qu'on ne leur en substitue pas de meilleures.
5° Toutes nos recherches sont donc contingentes, relatives, et donnent des résultats qui ne sont que plus ou moins probables, tout au plus très probables. Il semble bien que l'espace dans lequel nous vivons soit à trois dimensions ; mais si quelqu'un disait qu'un jour le soleil nous emportera avec ses planètes dans un espace à quatre dimensions, nous ne répondrions ni oui ni non. Quand on nous présentera des preuves expérimentales d'une telle affirmation, nous les examinerons ; mais tant que ces preuves font défaut, la question ne nous intéresse pas. Toutes nos propositions, y compris celles de pure logique, doivent être entendues avec la restriction dans les limites du temps et de l'expérience à nous connus (§ 97).
6° Nous raisonnons exclusivement sur les choses et non sur les sentiments que leurs noms éveillent en nous. Ces sentiments, nous les étudions comme de simples faits extérieurs. Aussi refusons-nous, par exemple, de discuter si un acte A est juste ou n'est pas juste, moral ou immoral, si l'on n'a pas bien mis d'abord en lumière les choses auxquelles on veut faire correspondre ces termes. Mais nous étudierons comme un fait extérieur ce que les hommes d'un pays donné, appartenant à une classe sociale donnée, à une époque donnée, entendaient exprimer, quand ils affirmaient que A était un acte juste ou moral ; nous verrons par quels mobiles ils étaient poussés, et comment les principaux de ceux-ci opérèrent souvent à leur insu ; nous chercherons à connaître les relations existant entre ces hommes et d'autres faits sociaux. Nous repoussons les raisonnements qui emploient des termes manquant de précision (§ 486), parce qu'on ne peut tirer de prémisses imprécises que des conséquences imprécises [FN: § 69-4]. Mais nous étudierons ces raisonnements comme des faits sociaux, et nous aurons même à résoudre un problème singulier : trouver comment de prémisses entièrement en dehors de la réalité, sont tirées des conclusions qui ne s'en éloignent pas trop (chap. XI).
7° Nous cherchons les preuves de nos propositions seulement dans l'expérience et l'observation, ainsi que leurs conséquences logiques, en excluant toute preuve par accord de sentiments, par évidence interne ou dictée par la conscience.
8° Aussi emploierons-nous uniquement des mots correspondant à des choses et mettrons- nous tout notre soin, tout notre zèle, à leur donner une signification aussi précise que possible (§ 108).
9° Nous procédons par approximations successives ; c'est-à-dire en considérant d'abord le phénomène dans son ensemble, négligeant volontairement les détails dont nous tiendrons compte dans les approximations suivantes (§ 540) [FN: § 69-5] .
§ 70. Nous n'entendons pas le moins du monde affirmer que notre méthode soit meilleure que les autres; le terme meilleur n'ayant ici du reste aucun sens. Il n'y a pas de comparaison possible entre des théories entièrement contingentes et d'autres qui admettent l'absolu ; ce sont des choses hétérogènes qui demeurent toujours distinctes (§ 15).
Si quelqu'un veut partir de certains principes théologiques ou métaphysiques, ou bien comme font les contemporains, du « progrès démocratique », pour composer une sociologie, nous ne disputerons pas avec lui et ne dirons certainement aucun mal de son œuvre. Le conflit ne deviendra inévitable que du moment où, au nom de ces principes, on voudra nous imposer quelque résultat tombant dans le domaine de l'expérience et de l'observation.
Pour reprendre l'exemple précédent, quand Saint Augustin affirme que l'Écriture est inspirée par Dieu, nous n'avons rien à objecter à cette proposition, que du reste nous ne comprenons pas bien [FN: § 70-1] ; mais quand il veut trouver dans ce livre la preuve qu'il n'y a pas d'antipodes (§ 485), nous n'avons que faire de ses raisons, puisque cette question appartient à l'expérience et à l'observation.
§ 71. Nous nous mouvons dans un champ restreint ; dans celui de l'expérience et de l'observation, sans nier qu'il y en ait d'autres, mais avec la volonté bien arrêtée de ne pas nous en occuper ici. Notre but est de découvrir des théories qui représentent les faits de l'expérience et de l'observation (§ 486), et, dans le présent ouvrage, nous refusons de pousser plus loin. Si quelqu'un en éprouve le désir, s'il veut voyager hors du domaine logico- expérimental, qu'il se cherche une autre compagnie et abandonne la nôtre ; elle ne saurait lui convenir.
§ 72. Nous différons entièrement de beaucoup de ceux qui suivent une voie analogue à la nôtre ; car loin de nier l'utilité sociale d'autres théories, nous croyons même qu'elles peuvent être très profitables. Associer l'utilité sociale d'une théorie à sa vérité expérimentale est justement un de ces principes a priori que nous repoussons (§ 14). Ces deux choses sont-elles ou non toujours unies ? À cette question l'on ne peut répondre que par l'observation des faits ; et dans la suite on trouvera la preuve qu'en certains cas, elles peuvent être entièrement indépendantes.
§ 73. Je prie donc le lecteur d'avoir toujours présent à l'esprit que là où j'affirme l'absurdité d'une doctrine, je n'entends pas le moins du monde soutenir implicitement qu'elle est nuisible à la société ; au contraire, elle peut lui être très profitable. Vice versa, où j'affirme l'utilité d'une théorie pour la société, je ne veux pas du tout insinuer qu'elle est expérimen- talement vraie. En somme, une même doctrine peut être rejetée au point de vue expérimental et admise au point de vue de l'utilité sociale, et vice versa.
§ 74. Puisque nous en sommes aux conventions, j'ajouterai que, plus généralement, quand je fais allusion à quelque effet nuisible d'une chose A, même s'il est très grand, je n'entends pas du tout certifier ainsi que cette chose soit, dans son ensemble, nuisible à la société ; parce qu'il peut y avoir des effets avantageux qui surpassent les nuisibles. Et vice versa, quand je parle d'un effet avantageux de A, même s'il est très considérable, mon intention n'est en aucune manière de prétendre que, dans son ensemble, A soit profitable à la société.
§ 75. Cet avertissement était indispensable, parce qu'en général beaucoup d'auteurs qui s'occupent de sociologie, ayant un but de propagande, un idéal à défendre, blâment seulement les choses qu'ils tiennent pour mauvaises dans leur ensemble, et louent celles qu'ils jugent bonnes. En outre, comme ils emploient plus ou moins le raisonnement par accord de senti- ments (41, 514), ils sont poussés à manifester le leur, pour obtenir l'approbation d'autrui ; ils ne considèrent pas les faits d'un œil absolument indifférent, mais aiment ou détestent et manifestent les sentiments qui les inspirent. Le lecteur accoutumé à cette façon de procéder et de s'exprimer, pense avec raison que quand l'auteur dit du mal d'une chose, en note certains défauts, cela signifie qu'il l'estime mauvaise dans son ensemble et qu'il est mal disposé envers elle ; tandis que, s'il en dit du bien, y remarque diverses bonnes qualités, divers avantages, cela veut dire qu'il la tient pour bonne dans son ensemble et qu'il est bien disposé à son égard. J'estime donc de mon devoir d'avertir le lecteur qu'une telle règle n'est pas applicable à ce livre ; je devrai d'ailleurs le rappeler souvent (§ 311). Je ne raisonne ici qu'ob- jectivement et analytiquement, selon la méthode logico-expérimentale. Je n'ai pas à mani- fester les sentiments que je puis avoir [FN: § 75-1], et le jugement objectif porté sur une partie d'une chose n'entraîne nullement un jugement analogue sur cette chose, considérée dans son ensemble.
§ 76. Celui qui veut persuader autrui, en matière de science expérimentale, expose principalement, ou mieux exclusivement, des faits et des déductions logiques de faits (§ 42). Celui qui veut persuader autrui, en ce qu'on appelle la science sociale, s'adresse principale- ment aux sentiments et ajoute des considérations de faits et des déductions logiques. C'est ainsi qu'il doit procéder, s'il veut que sa parole porte ; car, en négligeant les sentiments, il persuaderait bien peu de gens ; il ne se ferait pas même écouter ; tandis que s'il sait exciter les sentiments avec habileté, il passera pour éloquent (514). Cette question, rapidement effleurée ici, se rattache à l'étude de l'aspect objectif des théories (§ 13), et sera amplement développée dans la suite.
§ 77. L'économie politique ayant été jusqu'à présent une doctrine pratique, qui tendait à persuader les hommes d'agir d'une certaine façon, elle ne pouvait négliger de faire aussi appel au sentiment ; et, de fait, c'est ce qui arriva. Elle est restée une éthique à laquelle on ajoutait, en proportion plus ou moins grande, des narrations de faits et des expositions de leurs conséquences logiques. Cela se voit très bien dans les œuvres de Bastiat, et aussi dans presque tous les autres ouvrages d'économie politique, y compris ceux de l'école historique, qui sont souvent plus métaphysiques et sentimentaux que les autres.
Voici deux simples exemples de prévisions déduites des lois scientifiques de l'économie et de la sociologie. Le premier volume du Cours fut publié en 1896, mais écrit en 1895, d'après des documents statistiques n'allant pas au delà de 1894.
1° Contrairement à l'opinion des éthiques, historiens ou non, et des sentimentaux anti- malthusiens, j'écrivais alors, au sujet des augmentations de population [FN: § 77-1] : « Nous devons donc conclure que nous observons à notre époque des accroissements qui n'ont pu exister par le passé et qui ne pourront continuer d'exister à l'avenir. » Je citais, à ce propos, l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne. Dans le premier de ces pays, on voyait déjà des signes de ralentissement de l'accroissement ; non dans le second, pour lequel on n'aurait alors rien pu conclure empiriquement ; mais aujourd'hui tous deux sont dans une période de décroissance [FN: § 77-2].
2° Spécialement pour l'Angleterre, après avoir trouvé la loi d'accroissement de la population, de 1801 à 1891, je concluais qu'elle ne pouvait continuer à croître dans cette proportion ; effectivement la raison d'accroissement a diminué [FN: § 77-3].
3° « Certains progrès des idées socialistes en Angleterre sont probablement l'effet de l'augmentation des obstacles économiques à l'accroissement de la population. [FN: § 77-4] » On l'a vu mieux encore, de nos jours, puisque le progrès du socialisme, en Angleterre, a eu lieu tandis qu'on observait un recul dans les autres pays d'Europe.
4° Nous verrons au chapitre XII la vérification d'une loi sociologique admise dans les Systèmes socialistes.
5° Le second volume du Cours a été publié en 1897. C'était alors pour beaucoup de gens un article de foi, que l'évolution sociale se faisait de telle sorte que les riches devenaient toujours plus riches et les pauvres plus pauvres. Contrairement à cette opinion sentimentale, la loi de la répartition des revenus conduit à la proposition [FN: § 77-5] que « si le total des revenus augmente par rapport à la population, il faut nécessairement : ou que le revenu minimum augmente ou que l'inégalité des revenus diminue, ou que ces deux effets se produisent simultanément. » De 1897 à 1911, le total des revenus a crû par rapport à la population, et l'on a eu effectivement une augmentation du revenu minimum et une diminution de l'inégalité des revenus [FN: § 77-6] .
Nous avons encore une contre-preuve dans le fait que les parties en défaut du Cours sont celles où le sentiment s'est introduit. La critique en a été faite dans la Préface du Manuale [FN: § 77-7], où les erreurs ont été relevées.
§ 78. On accepte souvent une proposition qu'on entend énoncer, uniquement parce qu'on la trouve d'accord avec ses sentiments ; c'est même en général de cette façon qu'elle paraît la plus évidente. Dans beaucoup de cas, il est bien qu'il en soit ainsi, au point de vue de l'utilité sociale ; mais au point de vue de la science expérimentale, l'accord d'une proposition avec certains sentiments n'a que peu et souvent point de valeur. Nous en donnerons de nombreux exemples.
§ 79. Puisque nous voulons ici nous placer exclusivement dans le domaine expérimental, nous nous efforcerons de ne recourir en aucune manière aux sentiments du lecteur, mais d'exposer simplement des faits et leurs conséquences. De là le grand nombre de citations qu'on trouvera dans ce livre ; elles ont justement pour but de donner au lecteur une impression des faits et de lui soumettre nos preuves.
§ 80. Quand on écrit une œuvre littéraire ou que l'on s'adresse d'une manière quelconque aux sentiments, il faut, tout en tenant compte de ceux-ci, faire des distinctions entre les faits que l'on cite ; car ils ne conviennent pas tous à la dignité de l'élocution, de la rhétorique ou de l'histoire. Il y a une aristocratie de faits dont l’usage est toujours louable ; il y a une classe moyenne de faits dont l'emploi est indifférent ; il y a une basse classe de faits dont l'usage est inconvenant et blâmable. C'est ainsi qu'il est agréable à celui qui aime collectionner des insectes, d'attraper des papillons aux couleurs voyantes; il lui est indifférent de capturer des mouches et des guêpes ; il lui répugne de mettre la main sur les insectes qui vivent dans les excréments ou d'autres ordures. Le naturaliste ne fait pas ces distinctions ; nous n'en ferons pas non plus pour la science sociale (§ 895).
§ 81. Nous accueillons tous les faits, quels qu'ils soient, pourvu que, directement ou indirectement, ils puissent nous conduire à la découverte d'une uniformité. Même un raisonnement absurde et stupide est un fait ; et, s'il est admis par un grand nombre de personnes, il devient un fait important pour la sociologie. Les croyances, quelles qu'elles soient, sont aussi des faits, et leur importance est en rapport non avec leur mérite intrinsèque, mais bien avec le nombre plus ou moins grand de gens qui les professent. Elles servent aussi à exprimer les sentiments de ces individus; or ces sentiments sont parmi les principaux facteurs qu'étudie la sociologie (§ 69).
§ 82. Il sera bon que le lecteur s'en souvienne, quand il trouvera cités ici des faits qui, à première vue, peuvent paraître insignifiants ou puérils. Des fables, des légendes, des inventions de magie ou de théologie peuvent souvent être tenues pour choses vaines et ridicules ; elles le sont, en effet, intrinsèquement ; mais elles peuvent être, au contraire, éminemment utiles comme moyens de connaître les idées et les sentiments des hommes. De même, le psychiatre observe les délires du dément, non pour leur valeur intrinsèque, mais vu leur importance comme symptôme de la maladie.
§ 83. La voie qui doit mener aux uniformités cherchées peut parfois être longue ; mais si c'est le cas dans cet ouvrage, le lecteur observera que la seule raison en est l'impossibilité où je me suis trouvé jusqu'à présent, d'en trouver une plus courte ; et si quelqu'un en découvre une, tant mieux ; je quitterai immédiatement la vieille route pour la nouvelle ; mais, en attendant, il me paraît utile de continuer à suivre la seule qui existe encore.
§ 84. Quand on cherche à éveiller ou à fortifier certains sentiments chez les hommes, on doit citer les faits favorables à ces sentiments et taire ceux qui les offusquent. Quand, au contraire, on ne recherche que les uniformités, il ne faut taire aucun fait capable d'en permettre la découverte d'une manière ou d'une autre ; et comme c'est justement le but de cet ouvrage, je refuse absolument de considérer dans les faits autre chose que leur valeur logico- expérimentale.
§ 85. Une seule concession m'est possible ; et à vrai dire, c'est plutôt un effort pour être plus clair, en tâchant de soulever le voile de sentiments qui pourrait gêner la vue du lecteur ; je choisirai entre un grand nombre de faits, ceux qui paraissent pouvoir le moins agir sur le sentiment. Ainsi, quand je trouve des faits d'égale importance expérimentale, appartenant les uns au passé, les autres au présent, je préfère ceux du passé ; c'est pourquoi le lecteur trouvera beaucoup de citations des auteurs grecs et latins. De même, en présence de faits d'égale valeur expérimentale, se rapportant les uns à des religions aujourd’hui éteintes, les autres à des religions encore existantes, je préfère les premiers.
Mais préférer une chose ne signifie pas en faire un usage exclusif ; et je suis contraint, dans beaucoup de cas, de citer des faits du présent ou de religions existantes, soit parce que je n'en ai pas d'autres d'égale valeur expérimentale, soit pour démontrer la continuité de certains phénomènes, du passé au présent. J’entends garder là-dessus entière liberté d'écrire ; comme je la garde contre le mauvais vouloir des inquisiteurs modernes de la vertu, dont je ne me soucie en aucune façon [FN: § 85-1] .
§ 86. L'auteur qui expose certaines théories désire généralement que chacun les admette et les fasse siennes ; car en lui, le rôle du chercheur de vérités expérimentales et celui de l'apôtre se confondent. Dans ce livre, je les sépare entièrement ; je retiens le premier, j'exclus le second. J'ai dit et je répète que mon unique but est la recherche des uniformités (lois) sociales ; j'ajoute que j'expose ici les résultats de cette recherche, car j'estime que, vu le nombre restreint de lecteurs que peut avoir ce livre et la culture scientifique qu'elle leur suppose [FN: § 86-1] , un tel exposé ne peut faire de mal ; mais je m'en abstiendrais, si je pouvais raisonnablement croire que cet ouvrage deviendrait un livre de culture populaire (§ 14, 1403).
§ 87. J'écrivais déjà dans le Manuel : « (p. 2)... 3° L'auteur peut se proposer uniquement de rechercher les uniformités que (p. 3) présentent les phénomènes, c'est-à-dire leurs lois (§ 4), sans avoir en vue aucune utilité pratique directe, sans se préoccuper en aucune manière de donner des recettes ou des préceptes, sans rechercher même le bonheur, l'utilité ou le bien- être de l'humanité ou d'une de ses parties. Le but est dans ce cas exclusivement scientifique ; on veut connaître, savoir sans plus. Je dois avertir le lecteur que je me propose, dans ce Manuel, exclusivement ce troisième objet. Ce n'est pas que je déprécie les deux autres ; j'entends simplement distinguer, séparer les méthodes et indiquer celle qui sera adoptée dans ce livre. » Cela me semble clair, et j'avoue que je ne saurais l'être davantage. Il s'est toutefois trouvé quelqu'un pour croire que je manifestais l'intention de réformer le monde, et même pour me comparer à Fourier [FN: § 87-1] !
§ 88. Cette façon d'étudier les sciences sociales n'est généralement pas comprise des économistes littéraires ; ce qui s'explique par leur tour d'esprit ; en outre, ils parlent souvent de livres ou d'autres écrits qu'ils ne connaissent que de seconde main ou qu'ils n'ont pas lus avec le soin nécessaire pour les comprendre. Enfin, quand on a toujours eu et qu'on persiste à avoir des visées pratiques, on se persuade difficilement que d’autres puissent avoir un but exclusivement scientifique ; ou, si on le comprend momentanément, on l'oublie aussitôt. J'ai donc peu d'espoir que les explications données dans ce chapitre réussissent à empêcher qu'on m'attribue des théories qui me sont étrangères, comme ne l'ont pas évité d'autres explications analogues, répétées à satiété ; mais je crois bien faire en suivant la maxime : fais ce que dois, advienne que pourra. J'ai seulement à m'excuser auprès du lecteur, de certaines répétitions, qui n'ont pas d'autre raison que celle indiquée plus haut, et qui peuvent paraître superflues – elles le sont effectivement – à qui veut bien lire ce livre avec un peu d'attention.
§ 89. Il n'y a pas lieu d'ajouter ici d'autres détails sur la façon dont j'envisage les théories économiques [FN: § 89-1] . Le lecteur trouvera d'excellents et amples développements dans les ouvrages cités de MM. Sensini et Boven.
§ 90. Nous avons vu (§ § 13 et 63) que la sous-classe (I a) des théories logico-expé- rimentales se divisait en deux genres, dans l'un desquels les principes généraux sont de simples abstractions de faits expérimentaux, tandis que dans l'autre ils tendent plus ou moins explicitement à avoir une existence propre, ne dépendant pas étroitement d'une simple abstraction des faits. Ces deux genres portent souvent les noms de méthode inductive et de méthode déductive. Mais cela n'est pas précis ; et ces genres diffèrent moins par la méthode que par le critère de vérité de leurs propositions et de leurs théories ; que celles-ci, dans le type rigoureux (I a 1), soient induites ou déduites, ou obtenues par un mélange d'inductions et de déductions, elles dépendent toujours de l'expérience, tandis que dans la déviation du type (I a 2), elles tendent explicitement à dominer l'expérience.
Quand un principe général est vérifié par un très grand nombre de faits, tel, par exemple, le principe de la géométrie euclidienne ou celui de la gravitation universelle, les deux genres indiqués tout à l'heure sont peu distincts, puisqu'en somme on peut souvent se borner à présumer la vérification expérimentale.
§ 91. Quand l'écart est grand entre les deux genres dont nous venons de parler, une différence apparaît, que l'on voit mieux encore, lorsqu'on l'observe entre les théories logico- expérimentales et celles qui ne le sont pas. Dans les premières, on procède graduellement, en allant des faits à certaines abstractions ; de celles-ci à d'autres plus générales, et l'on est d'autant plus prudent et réservé que l'on s'éloigne de l'expérience directe. Dans les secondes, on fait délibérément un saut, aussi grand que possible, loin de l'expérience directe, et l'on est d'autant plus tranquille et hardi qu'on s'en éloigne davantage. On veut connaître l'essence des choses ; recherche que l'on tient seule pour digne de la science ; tandis qu'on appelle empirisme l'expérience directe et ses inductions, et qu'on en fait peu de cas (§ 530).
§ 92. Ainsi, pour constituer une chimie selon cette dernière méthode, il faut d'abord savoir ce qu'est la matière ; et comme conséquences de cette notion, ou déduit les propriétés chimiques. Au contraire, le chimiste moderne, suivant en cela la voie et les procédés des sciences logico-expérimentales, étudie directement les propriétés chimiques dont il tire d'autres propriétés ou des abstractions toujours plus générales.
Les anciens croyaient étudier l'astronomie en imaginant des cosmogonies ; les modernes, au contraire, étudient directement les mouvements des astres, et s'arrêtent sitôt qu'ils ont découvert les uniformités de ces mouvements. Newton trouva qu'une certaine hypothèse, dite de la gravitation universelle, suffit à faire connaître les équations qui déterminent le mouve- ment des astres. Mais qu'est-ce que là gravitation ? Ni le savant ni ceux qui lui succédèrent dans l'étude de la mécanique céleste ne se cassèrent la tête à cette question subtile. Non que le problème ne mérite l'attention ; mais la mécanique céleste n'a pas à le résoudre ; peu importe la manière dont elle obtient ses équations, pourvu que celles-ci restent vérifiées.
§ 93. Un fait digne de remarque est que certaines erreurs, abandonnées depuis longtemps par les sciences les plus avancées, se répètent aujourd'hui dans des sciences moins développées. C'est ainsi que la doctrine de l'évolution joua, à l'égard de la sociologie, un rôle semblable à celui qu'eut autrefois la cosmogonie. On estima que pour découvrir les uniformités qui existent dans les phénomènes sociaux, il n'y avait d'autre moyen que la connaissance de l'histoire de ces phénomènes, et la recherche de leurs origines (§ 23,346).
§ 94. Pour les théories que nous avons à construire ici, nous ne pouvons éviter de remonter jusqu'à la distinction entre le phénomène objectif et le phénomène subjectif ; mais nous n'avons pas besoin d'aller au delà et de résoudre le problème de la « réalité du monde extérieur », à supposer toutefois que ce problème ait un sens précis (§ 149).
§ 95. Qu'on réponde comme on voudra à la question posée, ces deux grandes catégories de phénomènes n'en subsisteront pas moins, et devront recevoir des noms différents. Il se peut qu'une feuille de papier portant une vignette quelconque, et un billet authentique de la Banque d'Angleterre soient tous deux des concepts ; mais si, après avoir déjeuné dans un restaurant de Londres, vous essayez de payer votre hôte avec le premier de ces concepts, vous ne tarderez pas à vous apercevoir que, de celui-là en naîtront d'autres. Et tout d'abord, vous aurez le concept d'un policeman ; celui-ci, qu'il ait une réalité objective ou non, vous soumettra, quoi qu'il en soit, aux concepts d'un juge ; lequel vous donnera le concept d'un lieu bien fermé, où vous ferez connaissance avec le concept que les Anglais appellent hard labour, et qui est loin d'être agréable. Vous vous apercevrez ainsi que ces deux feuilles de papier appartiennent certainement à deux catégories bien distinctes ; car les faits, ou si vous voulez les concepts qui en découlent, sont différents.
De même, quand nous affirmons que, pour connaître les propriétés de l'anhydride sulfureux, il faut recourir à l'expérience, et qu'il ne sert à rien de le remplacer par les concepts du soufre et de l'oxygène, comme le voudrait la métaphysique hégélienne, nous n'entendons nullement opposer le monde extérieur au monde intérieur, la réalité objective à la réalité subjective, etc. Pour nous servir du langage qui n'admet d'existence que celle de l'idée, nous exprimerons la même proposition, en disant que pour avoir le concept de l'anhydride sulfureux, il ne suffit pas de posséder ceux du soufre et de l'oxygène, puis de méditer sur ce thème. On pourrait se livrer à cet exercice pendant des siècles et des siècles, sans acquérir pour cela des concepts de l'anhydride sulfureux qui soient d'accord avec les concepts des expériences chimiques. Les philosophes anciens crurent pouvoir suppléer de cette manière à l'observation et à l'expérience ; mais ils se trompèrent complètement. On apprend la chimie dans les laboratoires, et non par des méditations philosophiques, fussent-elles hégéliennes (§ 14). Pour avoir le concept ou les concepts de l'anhydride sulfureux, il faut posséder les nombreux concepts que l'on acquiert par celui nommé aussi l'expérience, en faisant brûler le soufre dans l'oxygène et dans l'air ; il faut encore le concept d'un vase de verre, où l'on recueillera le concept de l'anhydride sulfureux, et ainsi de suite ; on unira tous ces concepts dont on tirera celui des propriétés de l'anhydride sulfureux.
Cette façon de s'exprimer serait prolixe, ennuyeuse, ridicule ; et c'est seulement pour éviter ces défauts, que nous faisons usage des termes : subjectif et objectif. Étant donné le but logico-expérimental auquel nous tendons exclusivement, cette façon de nous exprimer nous suffit.
§ 96. Pour le même motif, il nous suffit de reconnaître que les faits sociaux révèlent certaines uniformités, et qu'il existe entre celles-ci des liens de mutuelle dépendance. Nous n'avons pas à nous occuper de savoir si et comment tel ou tel résultat que nous fournit l'observation peut se concilier avec ce qu'on appelle « le libre arbitre », si toutefois cette expression a un sens. De tels problèmes sortent de notre étude.
§ 97. Nous ne cherchons pas davantage si les lois scientifiques ont un caractère de « nécessité » (§ 528). L'observation ni l'expérience ne peuvent rien nous enseigner là-dessus ; elles nous font seulement connaître certaines uniformités, et encore uniquement dans les limites de temps et d'espace sur lesquelles portent ces observations et ces expériences. Donc, toute loi scientifique est soumise à cette restriction, et si, pour être bref, on néglige de la rappeler, il faut cependant toujours sous-entendre la condition suivante, dans l'énoncé de toute loi scientifique : dans les limites de temps et d'espace à nous connus (§ 69-6°).
Nous restons de même étrangers aux discussions sur la nécessité de la conclusion du syllogisme. Par exemple, le syllogisme des traités de logique : « Tout homme est mortel ; – Socrate est un homme ; – donc Socrate est mortel », doit, au point de vue expérimental, s'énoncer de cette façon: « Tous les hommes dont nous avons pu avoir connaissance sont morts ; – les caractères, à nous connus, de Socrate le placent dans la catégorie de ces hommes ; – donc il est très probable que Socrate est mortel. » Cette probabilité s'accroît dans de très grandes proportions, pour d'autres circonstances dont nous traiterons plus loin (§ 531, 556) ; et c'est pourquoi elle est beaucoup plus grande, énormément plus grande que celle du syllogisme suivant, que l'on pouvait faire avant la découverte de l'Australie. « Tous les cygnes dont nous avons pu avoir connaissance sont blancs ; – un oiseau qui a tous les caractères du cygne, mais dont on ignore la couleur, doit être rangé dans la catégorie des cygnes ; – donc cet oiseau sera probablement blanc. » (§ 526) Celui qui raisonne sur les essences peut, en certains cas, substituer la certitude à une très grande probabilité ; quant à nous, ignorant les essences, nous perdons la certitude.
§ 98. Affirmer, comme le font certaines personnes, que le miracle est impossible parce qu'il serait contraire à la constance reconnue des lois naturelles, c'est faire un raisonnement en cercle, et donner pour preuve d'une assertion, cette assertion même. Si l'on pouvait prouver le miracle, on détruirait en même temps cette constance des lois naturelles. La preuve d'un tel fait constitue donc seule le nœud de la question. Il faut d'ailleurs ajouter que cette preuve devra subir une critique d'autant plus sévère, qu'elle nous fera sortir davantage du cercle des faits que nous connaissons.
Si quelqu'un affirmait que le soleil conduira un jour son système planétaire en un lieu où les lois de la chimie, de la physique, de la mécanique seront autres que celles qui nous sont aujourd'hui connues, nous n'aurions rien à objecter ; nous rappellerions seulement que le fardeau de la preuve incombe à celui qui fait cette assertion.
Comme nous l'avons déjà dit (§ 29), nous ne faisons pas d'exception ; même pour les lois de la logique.
§ 99. Les lois scientifiques ne sont donc pour nous autre chose que des uniformités expérimentales (§ 69-411). à ce point de vue, il n'y a pas la moindre différence entre les lois de l'économie politique ou de la sociologie et celles des autres sciences. Les différences qui existent sont d'un tout autre genre. Elles résident surtout dans l'entrelacement plus ou moins grand des effets des différentes lois. La mécanique céleste a la chance de pouvoir étudier les effets d'une seule loi (uniformité) ; mais cela n'est pas tout, parce que ces effets pourraient être tels qu'ils permettraient difficilement la découverte de l'uniformité qu'ils présentent ; or, par une autre chance très heureuse, il se trouve que la masse du soleil est beaucoup plus grande que celle des planètes ; aussi découvre-t-on l'uniformité sous une forme simple, bien que non rigoureusement exacte, en supposant que les planètes se meuvent autour d'un soleil immobile et en rectifiant ensuite l'erreur commise dans cette première approximation. Au chapitre XII, nous verrons quelque chose d'un peu ressemblant pour la sociologie.
La chimie, la physique, la mécanique ont de même souvent à étudier des lois isolément, ou du moins peuvent en séparer artificiellement les effets [FN: § 99-1] ; pourtant, en certains cas, apparaissent déjà des entrelacements difficiles à débrouiller ; leur nombre croît, en biologie, en géologie et plus que jamais en météorologie ; c'est aussi le cas des sciences sociales.
§ 100. Un autre caractère distinctif des lois scientifiques est le fait de pouvoir ou non en isoler les effets, grâce à l'expérience, qui s'oppose ici à l'observation. Certaines sciences, comme la chimie, la physique, la mécanique, la biologie, peuvent faire et font très largement usage de l'expérience ; d'autres y parviennent dans une moindre mesure ; d'autres encore peu ou pas du tout, comme les sciences sociales ; d'autres enfin ne s'en servent absolument pas ; ainsi la mécanique céleste, tout au moins en ce qui concerne les mouvements des astres.
§ 101. Ni les lois économiques et sociologiques, ni les autres lois scientifiques ne souffrent proprement d'exceptions [FN: § 101-1] . Parler d'une uniformité non uniforme n'a aucun sens. Le phénomène auquel on donne communément le nom d'exception à une loi est en réalité la superposition de l'effet d'une autre loi à celui de la première. À ce point de vue, toutes les lois scientifiques, y compris les mathématiques, souffrent des exceptions. Tous les corps qui sont à la surface du sol sont attirés vers le centre de la terre ; mais une plume emportée par le vent s'en éloigne ; un ballon plein d'hydrogène s'élève dans les airs.
La principale difficulté qu'on rencontre dans l'étude d'un très grand nombre de sciences, consiste précisément à trouver le moyen de dévider cet écheveau, formé par l'entrelacement d'uniformités nombreuses et variées.
§ 102. Dans ce but, il est souvent utile de considérer, non les phénomènes observés, mais des phénomènes moyens, où les effets de certaines uniformités sont atténués, tandis que ceux d'autres phénomènes sont accentués. Ainsi, nous ne pouvons savoir quelle sera, par exemple, la température du 10 juin de l'année prochaine ; mais nous pouvons connaître à peu près quelle sera la température moyenne du mois de juin, et mieux encore la température moyenne d'un trimestre, pour quelques années. Personne ne peut savoir si Jacques vivra ou mourra l'an prochain ; mais nous pouvons savoir à peu près combien de personnes mourront, sur cent mille ayant le même âge que Jacques. Qui dira si un certain grain, semé par l'agriculteur, germera et produira quelque chose ? Mais nous pouvons prévoir avec une certaine probabilité quel sera le produit d'un hectare de terrain semé de grain, et mieux, encore quelle sera la moyenne de ce produit, pour un certain nombre d'années.
§ 103. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que ces moyennes sont en partie arbitraires, et que nous les formons pour notre usage. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas tomber dans l'erreur de les considérer comme quelque chose d’objectif, ayant une existence indépen- dante des faits. Nous les trouvons souvent sous un autre nom, comme entités métaphysiques dont les auteurs se prévalent pour trouver quelque chose de constant dans des faits variables.
§ 104. Par exemple, en économie politique, nous voyons que les prix des marchandises, en gros sont variables presque à chaque vente-achat ; mais, pour édifier une théorie, nous voulons avoir quelque chose de moins variable, de plus, constant. Pour procéder scientifi- quement, on considère certaines moyennes ; on fait certaines interpolations [FN: § 104-1] . Pour procéder selon la métaphysique, on considère une entité appelée valeur, qui serait une espèce de cause constante des prix variables. Cette seconde manière de raisonner induit facilement en erreur, parce qu'elle enlève à la moyenne les caractères que lui donne la science, pour en prendre d'autres entièrement imaginaires (§ 62). Nous n'adressons d'ailleurs de ce fait aucun blâme aux premiers économistes, qui employèrent le terme valeur ; et ce fut déjà un notable progrès, quand on distingua la valeur d'échange de la valeur d'usage.
De la conception de valeur d'usage, un nouveau progrès fit naître l'idée beaucoup plus précise de l'utilité finale ; et c'est ainsi que de fil en aiguille, on en vint aux théories générales de l'équilibre économique. Ce développement n'a rien de singulier, car c'est celui de toutes les sciences naturelles (§ 69-3, 106). Mais de même qu'on ne peut plus étudier aujourd'hui la mécanique céleste dans les œuvres de Ptolémée ni même dans celles de Kepler, on ne peut plus étudier l'économie politique au moyen du concept vague de valeur [FN: § 104-2].
§ 105. Dans une première approximation, nous pouvons nous contenter de savoir qu'on a éliminé tant bien que mal certains effets de peu d'importance, comparativement à d'autres qui en ont une plus grande. Mais il est bon de donner, sitôt que possible, quelque précision à ces termes peu, plus grande, et de savoir à peu près ce qu'on a éliminé et ce qu'on a conservé. Mieux encore, si l'on arrive à connaître les limites des différences qui existent entre le phénomène réel (les faits) et l'image que nous en obtenons par ces moyennes ou ces théories.
[fractions]Par exemple, en mathématique, il est déjà utile de savoir que 22/7 est une valeur approchée du rapport de la circonférence au diamètre. C'est encore mieux, quand on sait qu'elle est plus grande que ce rapport ; mieux encore, lorsqu'on apprend que l'erreur est inférieure à 0,015 ; ou quand on trouve que le dit rapport est compris entre 22/7 et 333/106.
Il est bon de savoir que les prix ne sont pas des nombres qui varient au hasard ; il est mieux de se rendre compte qu'ils ont quelque relation avec les goûts des hommes et les obstacles qui s'opposent à l'acquisition des marchandises ; mieux encore d'avoir une idée de ces relations, et toujours mieux de préciser cette idée, et d'arriver à saisir l'importance relative du phénomène dont la théorie est l'image, et de ceux qu'elle néglige.
§ 106. On ne peut connaître un phénomène concret dans tous ses détails ; il y a toujours un résidu, qui apparaît même parfois matériellement [FN: § 106-1] . Nous ne pouvons avoir que des idées approximatives des phénomènes concrets. Une théorie ne peut jamais figurer tous les détails des phénomènes ; aussi les divergences sont-elles inévitables, et ne reste-t-il qu'à les réduire au minimum. À ce point de vue aussi, nous sommes ramenés à la considération des approxi- mations successives. La science est un continuel devenir ; ce qui signifie que perpétuellement une théorie est suivie d'une autre, plus proche de la réalité. La théorie d'hier est aujourd'hui perfectionnée ; celle d’aujourd’hui le sera demain ; celle de demain le sera après-demain, et ainsi de suite. Chaque page de l'histoire des sciences le dit, et rien ne permet de supposer qu'elles ne continueront pas à le dire fort longtemps.
Puisque aucune théorie ne s'impose absolument, nous préférerons, dans le choix qui se présente à nous, celle qui, s'écartant le moins des faits du passé, nous permet de mieux prévoir ceux de l'avenir, et en embrasse le plus grand nombre.
§ 107. En astronomie, par exemple, la théorie des épicycles, que certains, poussés par le sentiment, cherchent à réhabiliter, satisfait à la condition de bien représenter les faits du passé, tels qu'ils nous sont connus. En multipliant autant qu'il est nécessaire le nombre des épicycles, on peut donner l'image de tout mouvement des astres, révélé par l'observation ; mais on ne peut prévoir, ou du moins aussi bien prévoir les mouvements futurs, qu'avec la théorie de la gravitation. En outre, cette dernière, grâce aux lois générales de la mécanique, s'étend à un nombre de faits plus considérable. Elle est donc préférable, comme on le juge en fait, à la théorie des épicycles. Mais le choix a lieu pour ces motifs ou d'autres semblables, et non pour des considérations métaphysiques sur l'essence des choses.
§ 108. Les faits au milieu desquels nous vivons agissent sur nous ; en sorte que notre esprit prend une certaine tournure, qui ne peut guère contraster avec ces faits. Les modes et les formes du langage procèdent de cet état psychique [FN: § 108-1] . Aussi la connaissance de l'esprit humain et du langage peut-elle apporter quelque lumière dans celle des faits extérieurs ; mais cette lumière est fort peu de chose, et dès qu'une science a fait quelque progrès, l'emploi de cette méthode lui procure plus d'erreurs que de vérités (§ 113 et sv.).
Les termes du langage ordinaire manquent de précision ; il n'en peut être autrement, vu que la précision appartient à la rigueur scientifique seule.
Tout raisonnement qui, comme ceux de la métaphysique, se fonde sur les sentiments, est forcé d'adopter des termes dépourvus de précision ; car les sentiments n'en ont pas, et le nom ne peut être plus précis que la chose. En outre, ces raisonnements profitent du manque de précision du langage ordinaire, pour masquer leur faiblesse logique, et pour persuader (§ 109). Au contraire, les raisonnements logico-expérimentaux, qui ont leur fondement dans l'observation objective, sont amenés à ne se servir des termes que pour désigner les choses ; et par conséquent à les choisir de manière à éviter toute ambiguïté ; à les rendre aussi précis que possible. Ces raisonnements engendrent d'ailleurs un langage technique spécial, qui leur permet d'échapper ainsi à l'indétermination du parler courant. Nous l'avons dit déjà (§ 69-8°) : notre intention étant de n'employer que le raisonnement logico-expérimental, nous mettrons tout notre soin à n'user que de mots aussi précis que possible, bien déterminés, et corres- pondant à des choses, sans équivoques ni ambiguïtés (§ 119), ou mieux, avec la plus petite erreur possible.
Il faut remarquer ici que le mot désigne un concept et que celui-ci peut correspondre ou non à une chose. Mais quand cette correspondance existe, elle ne peut être parfaite ; d'où il résulte que si le mot correspond à une chose, il ne peut jamais y correspondre précisément, d'une façon absolue. Il s'agit au contraire de plus ou de moins. Non seulement on ne trouve pas, dans la réalité concrète, les entités géométriques telles que la ligne droite, le cercle, etc., mais pas même les corps chimiques absolument purs, ni les espèces dont traitent les zoologistes et les botanistes, ni un corps particulier désigné par un nom ; car il faudrait indiquer aussi à quel moment on le considère : un morceau de fer ne reste pas identique à lui- même, quand change la température, l'état électrique, etc. En somme, la science logico- expérimentale ne connaît pas l'absolu ; aussi doit-on toujours attribuer une valeur contingente aux propositions que le langage courant nous présente avec une teinte d'absolu ; il faut de même substituer généralement des différences quantitatives, où le langage ordinaire met des différences qualitatives (§ 143[FN: § 1] ). Quand on s'est bien entendu sur ce point, toute équivoque est impossible ; et vouloir s'exprimer en toute rigueur donnerait lieu à des longueurs aussi inutiles que pédantes.
Nous dirons, par conséquent, que l'on sort entièrement du domaine expérimental, quand on raisonne sur des mots qui ne correspondent à rien dans ce domaine ; et que l'on en sort partiellement, quand on raisonne sur des mots dont le sens est indéterminé, et qui, en partie seulement, correspondent à des objets de ce domaine (chapitre X). On doit entendre cette proposition, en ce sens que si les mots présentent le minimum d'indétermination, corres- pondant à l'état actuel de la science, on s'éloigne si peu du domaine expérimental, que cette déviation est négligeable. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de corps chimiques absolument purs, les lois de la chimie sont valables avec une très grande approximation pour les corps que nos instruments d'analyse nous donnent comme purs.
§ 109. Le plus grand nombre des hommes emploie le langage vulgaire ; quelques hom- mes de science se servent du langage scientifique, chacun dans sa spécialité, hors de laquelle ils raisonnent souvent aussi mal et même plus mal que les gens du monde.
Deux genres de motifs poussent les hommes à tirer leur science du langage ordinaire. Le premier est qu'ils supposent qu'à tout mot doit nécessairement correspondre une chose. C'est la raison pour laquelle le mot finit par sembler être tout, et parfois même assume des propriétés mystérieuses. Le second est la grande facilité que l'on a de constituer ainsi la « science », chacun trouvant en lui-même tout ce qu'il faut pour cela, sans qu'il soit besoin de recherches longues, difficiles et fastidieuses.
Il est plus aisé de discourir sur les antipodes que d'aller voir s'il y en a réellement ; il est beaucoup plus expéditif de méditer sur le « principe » du « feu » ou celui de l' « humide », que de se livrer à toutes les observations dont se compose la géologie ; il est plus commode de méditer sur le « droit naturel », que d'étudier les législations des différents pays, à des époques diverses ; il est beaucoup moins difficile d'ergoter sur la valeur, de rechercher quand et dans quel cas, on dit qu' « une chose vaut », que d'étudier et de comprendre les lois de l'équilibre économique.
Quand on tient compte de tous ces faits, on conçoit que l'histoire des sciences jusqu'à nos jours, soit en somme l'histoire de la bataille que la méthode expérimentale a dû engager et continue à soutenir contre la méthode de l'auto-observation, des recherches sur les expres- sions du langage et l'étymologie. Cette dernière méthode, vaincue et défaite sur un point, reparaît sur un autre. Quand elle ne peut combattre ouvertement, elle se dissimule, et finit par s'insinuer sous des formes trompeuses, dans le camp de l'adversaire.
§ 110. De nos jours, ce procédé est en grande partie banni des sciences physiques, dont le progrès dépend de cette exclusion ; mais il règne encore en économie politique et plus que jamais en sociologie ; et pourtant il est indispensable que ces disciplines suivent l'exemple donné par les sciences physiques, si elles veulent progresser (§ 118).
§ 111. La croyance, que l'on pouvait connaître les faits de l'univers et leurs relations, grâce à l'auto-observation de l'esprit humain, était générale en d'autres temps et reste le fondement de la métaphysique, laquelle cherche hors de l'expérience un critère de vérité. De nos jours, elle se manifeste pleinement dans les délires de la Philosophie de la nature de Hegel. Inutile d'ajouter qu'avec cette méthode, les hommes ne sont jamais parvenus à connaître la moindre uniformité des faits naturels (§ 50,484).
§ 112. Le positivisme de Herbert Spencer est tout simplement une métaphysique. D'un côté, cet auteur affirme la contingence de toute connaissance ; de l'autre, il disserte sur les relations que ces connaissances ont avec la « réalité absolue » [FN: § 112-1] ; et tandis qu'il affirme l'existence de l'inconnaissable, il veut, par une plaisante contradiction, en connaître au moins quelque chose [FN: § 112-2] .
§ 113. Dans les affaires pratiques dont nous nous occupons journellement, nous ne pouvons certes pas raisonner avec la méthode et la rigueur des sciences logico- expérimentales (§ 108, § 109) ; c'est pourquoi nous sommes enclins à donner une grande importance aux mots. Une chose à laquelle on donne un nom se trouve, par ce seul fait, assimilée à une classe d'objets dont les caractères sont connus, et le deviennent par consé- quent aussi pour cette chose. En outre, et c'est le plus important, comme on la considère avec les sentiments suscités par le mot, il lui est profitable d'avoir un nom qui suscite des sentiments propices, et nuisible d'en porter un auquel s'attachent des sentiments défavorables. On trouvera de nombreux exemples de tels faits, dans la suite de cet ouvrage.
Dans la vie pratique, il serait difficile, voire impossible, de faire autrement. On ne peut remonter jusqu'aux origines et mettre tout en doute, à propos des innombrables questions qui surgissent à chaque pas. Quand on reconnaît qu'un chapeau est la propriété d'un homme, cela suffit ; il le met sur sa tête et s'en va. On ne peut pas, avant de le lui laisser prendre, discuter sur ce qu'est réellement la propriété, et résoudre la question de la propriété individuelle, collective, ou un autre problème du même genre. Dans les pays civilisés, les législations civiles et pénales ont une terminologie précise ; par conséquent, pour juger un acte, il faut savoir comment le désigner. Le langage ordinaire possède un très grand nombre de maximes qui, sauf la précision dont elles sont généralement dépourvues, présentent une analogie complète avec les articles de loi ; c'est pourquoi le mot par lequel on désigne un acte ou une chose a, pour ces maximes aussi, une grande importance. Le législateur emploie les termes dans le sens qu'ils ont habituellement parmi les gens auxquels il donne des lois. Il n'a pas besoin d'attendre que les hommes de science soient d'accord sur la définition du terme religion, pour édicter des prescriptions sur les offenses à la religion, sur la liberté religieuse, etc. On disserte couramment d'une infinité de choses, sans les connaître avec précision. La vie pratique se contente de l'à peu près, tandis que la science recherche l'exactitude.
Nous avons des théorèmes qui sont d'accord avec les faits, dans les limites de cet à peu près, pourvu qu'on ne les applique pas hors du domaine quelquefois très restreint, dans lequel ils peuvent être valables. Le langage vulgaire les cristallise et les conserve ; c'est là que nous pouvons donc les retrouver et en tirer parti ; mais toujours avec la restriction que, s'ils sont grossièrement approximatifs et vrais entre certaines limites, qui d'ailleurs nous restent généralement inconnues, ils deviennent faux hors de ces limites (chap. XI). Ces théorèmes portent plus sur les mots que sur les choses. Nous pouvons donc conclure que, dans la vie pratique, pour persuader autrui, et souvent aux tout premiers débuts des sciences, les mots sont de grand poids, et qu'en discuter n'est pas perdre son temps.
§ 114. On doit tirer des conclusions diamétralement opposées, quand il s'agit des recherches de la science expérimentale, puisque ces dernières, concernant exclusivement les choses, ne peuvent retirer aucun profit des mots eux-mêmes. Elles peuvent au contraire y trouver grand dommage, soit à cause des sentiments que suscitent les mots, soit parce qu'un mot lui-même peut tromper sur la réalité de la chose qu'il est censé représenter (§ 366), et introduire ainsi dans le domaine expérimental, des entités imaginaires, comme celles de la métaphysique ou de la théologie, soit enfin parce que les raisonnements sur les mots sont, en général, fortement dépourvus de précision.
§ 115. C'est pourquoi les sciences les plus avancées ont leur langage propre, soit parce qu'elles adoptent de nouveaux mots, soit parce que, conservant ceux du langage vulgaire, elles leur donnent une signification spéciale. Par exemple, l'eau de la chimie, la lumière de la physique, la vitesse de la mécanique ont une signification toute différente de celle que leur donne le langage courant.
§ 116. On peut souvent employer un moyen simple, pour découvrir si un raisonnement est du genre de ceux qui font appel au sentiment ou aux notions plus ou moins précises dont abonde le langage ordinaire, ou bien s'il est du genre de ceux qui appartiennent à la science expérimentale. Il suffit de substituer dans ce raisonnement, de simples lettres, a, b, c,... aux termes techniques qui y sont adoptés. Si le raisonnement perd ainsi toute sa force, il appartient au premier genre ; s'il la conserve, il appartient au second (§ 642).
§ 117. Comme d'autres sciences, l'économie politique commença par employer les mots du langage vulgaire ; mais elle s'efforça de leur donner un peu plus de précision ; de cette manière, elle s'enrichit de toute l'expérience accumulée dans le langage ordinaire ; ce qui n'était pas indifférent, car les opérations économiques occupent une grande partie de l'activité humaine. Puis, au fur et à mesure que l'économie politique progressait, cet avantage diminua, tandis qu'augmentaient les conséquences fâcheuses entraînées par l'emploi de ces mots. Avec beaucoup de raison, Jevons déjà renonça au terme valeur, dont la signification étirée en tous sens et rendue multiple, avait fini par disparaître (§ 62-1) ; il proposa un nouveau terme: la raison d'échange, et y attacha un sens précis (§ 387).
§ 118. Les économistes littéraires ne le suivirent pas dans cette voie ; aujourd'hui encore, ils se complaisent à rechercher ce qu'est la valeur, le capital, etc. On n'arrive pas à leur mettre dans la tête que les choses sont tout et les mots rien. Libre à eux de donner les noms de valeur et de capital aux choses qu'ils voudront, pourvu qu'ils aient l'obligeance de nous les indiquer d'une manière précise ; malheureusement ils ne le font pas, du moins en général. Si leurs raisonnements appartenaient à la science expérimentale, ils subsisteraient, alors même qu'on changerait les noms de valeur et de capital, puisque les choses demeureraient ; or, c'est uniquement de celles-là que s'occupe la science expérimentale [FN: § 118-1] ; mais comme leurs raisonnements sont au contraire avant tout de pure rhétorique, ils sont sous la dépendance étroite des mots aptes à susciter les sentiments capables de persuader l'auditeur ; voilà justement pourquoi les mots ont une si grande importance pour les économistes littéraires, tandis que les choses en ont peu.
Celui qui cherche « ce qu'est le capital, ce qu'est la valeur, ce qu'est la rente, etc. », montre par cela seul qu'il donne la première place au mot, la seconde à la chose. Le mot capital, par exemple, existe certainement pour lui ; il se demande ce qu'il représente et s'efforce de le trouver. On pourrait justifier ce procédé, de la manière suivante : « Il existe une chose inconnue dont l'influence sur le langage fait naître le mot capital ; puisque le langage ordinaire est la copie exacte des choses qu'il représente, en étudiant le mot, nous pourrons connaître la chose, et en recherchant ce qu'est le « capital », nous découvrirons cette chose inconnue ». Le défaut de cette justification gît dans la proposition soulignée, qui est fausse. Si l'on veut s'en persuader encore mieux, on n'a qu'à substituer au terme capital, un terme scientifique, par exemple l'eau, et voir si, en cherchant avec autant de soin qu'on voudra, ce « qu'on appelle eau », on pourra jamais arriver à connaître les propriétés du corps chimiquement pur, qu'on appelle l'eau.
En science, on suit une voie opposée à celle-là ; c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de la chose, et qu'ensuite ou lui cherche un nom [FN: § 118-2] . On commence par considérer le corps formé par la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène, puis l'on pense à le baptiser. Puisque ce corps se trouve en grande quantité dans la chose mal définie que le langage vulgaire appelle l'eau, on le nomme aussi l'eau ; mais ou aurait tout aussi bien pu le nommer autrement, par exemple Lavoisier, ce qui ne changerait rien à la chimie. On dirait simplement que la mer et les fleuves contiennent une grande quantité de Lavoisier. Économistes et sociologues littéraires n'y comprennent rien, parce que l'habitude d'esprit et la culture nécessaires leur font défaut.
§ 119. Nous entendons nous en tenir ici étroitement à la méthode logico-expérimentale (§ 108), et raisonner exclusivement sur des choses ; aussi n'attachons-nous aucune importance aux mots. Ils ne sont que de simples étiquettes pour désigner les choses; nous disons donc : « Nous appellerons cette chose A », ou, si l'on veut : « Il nous plaît de l'appeler A »; et non pas, ce qui est bien différent : « Cette chose, c'est A ». La première proposition est une définition qui dépend de notre arbitraire ; la seconde est un théorème qu'il convient de démontrer ; mais il faut auparavant savoir ce qu'est précisément A (§ 963).
Pour éviter le danger toujours imminent dans les sciences sociales, de voir quelqu'un chercher le sens des mots, non dans la définition objective qui en est donnée, mais dans l'usage courant ou dans l'étymologie, nous aurions volontiers substitué aux mots étiquettes, des numéros d'ordre ou des lettres de l'alphabet, a. b..., comme nous l'avons fait parfois (§ 798), au moins pour une partie du raisonnement ; mais nous y avons renoncé par crainte que le raisonnement n'en devienne ainsi trop ennuyeux et obscur. C'est pourquoi nous avons suivi l'usage du chimiste qui continue, par exemple, à se servir du mot eau, en lui donnant un sens précis [FN: § 119-1] ; nous emploierons aussi les termes du langage vulgaire, en indiquant avec précision les choses qu'ils doivent représenter. Nous prions donc le lecteur de s'en tenir rigoureusement à ces définitions, et de ne jamais chercher à deviner par l'étymologie ou les acceptions du langage courant, le sens des termes techniques dont nous faisons usage. C'est ainsi qu'il trouvera les termes résidus et dérivations (§ 868) ; s'il désire savoir ce qu'ils signifient, il doit s'en rapporter exclusivement aux définitions que nous en donnons, et prendre garde qu'en cherchant au contraire cette signification dans l'étymologie ou le langage ordinaire, il trouverait certainement des choses très différentes de celles dont nous voulons parler. Si quelqu'un ne trouve pas ces termes de son goût, qu'il les remplace par d'autres, à sa guise. Il verra qu'en substituant aux termes résidus, dérivations, les siens propres, et mieux des lettres alphabétiques ou des numéros d'ordre, tous les raisonnements où figurent ces expressions subsistent tels quels.
Le lecteur auquel ces explications paraîtront superflues voudra bien prendre patience. Mon excuse est que des développements semblables, donnés et répétés nombre de fois pour l'ophélimité, n'ont pas empêché des économistes littéraires d'en chercher le sens dans l'étymologie ; tandis que d'autres, qui devaient certainement avoir beaucoup de temps à per- dre, examinaient si le nom de désidérabilité [FN: § 119-2] ne conviendrait pas mieux ; et, pour mettre fin à ces ergotages, il n'a même pas suffi de montrer qu'on pouvait aussi se passer de l'ophélimité ou de tout autre terme semblable, dans l'exposé des théories de l'économie politique [FN: § 119-3] .
§ 120. J'emploierai dans cet ouvrage quelques termes usités en mécanique, et cela pour les motifs indiqués tout à l'heure. Il convient donc que j'explique au lecteur dans quel sens précis je les prendrai.
§ 121. Soient certaines choses A, B, C,… qui ont le pouvoir d'agir sur le phénomène économique et social. Nous pouvons considérer le phénomène à un moment où l'action de ces choses n'est pas encore épuisée, ou bien quand elle a produit tout son effet. Soit, par exemple A, le désir qu'un homme éprouve de boire du vin ; B, la crainte qu'il a de nuire à sa santé. Cet homme boit un verre de vin, puis un second, et s'arrête parce qu'après ce second verre, la crainte s'oppose victorieusement au désir. Après le premier verre, le phénomène n'est pas achevé ; le désir agit encore efficacement malgré la crainte ; et pourtant cette dernière n'a pas non plus produit tout son effet, parce qu'elle n'a pas encore empêché le désir de faire boire du vin à cet homme. Quand nous considérons un phénomène, il est manifeste qu'il faut dire si nous l'envisageons lorsque les choses A, B n'ont pas encore produit tout leur effet, ou bien après qu'elles ont achevé d'agir.
En mécanique, il existe un phénomène analogue – le lecteur prendra garde que je dis analogue et non identique ; – c'est celui de deux forces qui agissent sur un point matériel. Au lieu de parler de choses A, B qui ont le pouvoir d'agir sur le phénomène économique ou social, on peut aussi, pour simplifier, traiter de forces A et B.
§ 122. L'état intermédiaire, dans lequel l'individu, ayant bu un premier verre de vin, se dispose à en boire un second, c'est-à-dire dans lequel l'action de A et de B n'est pas encore achevée, s'exprime en mécanique, en disant que l'équilibre n'est pas encore atteint. L'état dans lequel le désir et la crainte ont produit leur effet de telle manière que notre homme ne boit plus de vin, s'exprime en mécanique, en disant que l'équilibre est atteint. On peut, par analogie – non par identité – employer aussi ce terme d'équilibre, pour le phénomène économique ou social.
§ 123. Mais une analogie n'est pas une définition ; et nous en contenter, pour indiquer le sens de l'équilibre économique ou social, serait nous exposer volontairement à des erreurs aussi nombreuses que faciles. Il faut donc donner une définition précise de cet équilibre économique ou social. Le lecteur la trouvera au chapitre XII.
§ 124. En maintenant cette définition, on peut changer comme on veut le mot équilibre
; les raisonnements restent les mêmes. Par exemple, au lieu d'appeler A et B forces, ou pourrait leur donner le nom de choses agissantes ou bien encore de choses (1) ; au lieu d'équilibre, on pourrait désigner l'état défini tout à l'heure par ![]() ou bien encore par état X
; et tous les raisonnements où figurent les termes forces et équilibres subsisteraient tels quels.
ou bien encore par état X
; et tous les raisonnements où figurent les termes forces et équilibres subsisteraient tels quels.
§ 125. C'est donc une grande erreur que de dire, comme l'a fait certain auteur, que quand je traite d'équilibre, je parle d'un état qui me paraît meilleur qu'un autre, parce que l'équilibre est meilleur que le manque d'équilibre !
§ 126. On peut employer par analogie d'autres termes de la mécanique, en économie et en sociologie. Considérons une société dans laquelle existe la propriété privée. Nous pouvons nous proposer d'étudier les formes possibles de cette société, en maintenant la condition de l'existence de la propriété privée. De même, d'autres relations existant entre les phénomènes nous donnent d'autres conditions que l'on peut supposer respectées ou non. Il existe, en mécanique, des phénomènes analogues, et ces conditions se nomment liaisons. Par analogie, nous pouvons nous servir de ce terme en économie politique ou en sociologie. Il serait d'ailleurs inutile de le faire, et mieux vaudrait ne pas employer le mot liaisons, s'il n'y avait pas d'autres analogies.
§ 127. Considérons un système de points matériels, réunis par certains liens, et sur lequel agissent certaines forces A, B, C,... Les positions successives des points seront déterminées par les forces, dans la mesure compatible avec les liaisons. Supposons une collectivité d'indi- vidus. On y trouve certaines conditions, comme la propriété privée, la liberté ou l'esclavage, des connaissances techniques, des richesses, des connaissances scientifiques, une religion, etc. ; en outre, certains désirs, certains intérêts, certains préjugés des hommes, etc. On peut supposer que les états successifs de cette collectivité sont déterminés par l'action de ces éléments et dans la mesure compatible avec les conditions posées.
§ 128. Nous pourrons donc, par analogie – non par identité – appeler cette collectivité un système social ou un système économique, et dire que certaines forces agissent sur lui, qui déterminent les positions des points du système, compatibles avec les liens. L'emploi de ces termes n'a d'autre motif que la brièveté, et, comme toujours, on peut leur en substituer d'autres, à volonté.
§ 129. En mécanique, le passage d'un état à un autre s'appelle mouvement. On peut user du même terme en sociologie. Si, en mécanique, nous supposons donnés les liens et les forces, les mouvements du système sont déterminés ; de même, si nous supposons donnés, en sociologie, les conditions et les facteurs agissants, les différents états successifs de la collec- tivité sont déterminés. De tels mouvements sont dits réels, en mécanique ; on peut aussi leur donner ce nom en sociologie.
§ 130. Si, dans un but de recherche, nous supprimons, par hypothèse, un lien en méca- nique, une condition en sociologie, le système mécanique pourra être affecté d'autres mouvements que les réels, et la collectivité sociologique pourra présenter des états différents de ceux qu'on observe en réalité ; ces mouvements sont appelés virtuels, en mécanique, et peuvent porter le même nom en sociologie. Par exemple, rechercher comment serait la société, si la propriété privée venait à y être supprimée, constitue une étude de mouvements virtuels.
§ 131. On peut réunir les liaisons et les forces du système social ; et si nous donnons à cet ensemble le nom de conditions [FN: § 131-1] , la théorie qui porte le nom de déterminisme s'exprimera en disant que l'état du système est entièrement déterminé par les conditions, et que, par conséquent, cet état ne peut changer qu'avec les conditions.
§ 132. La science n'a pas de dogmes ; elle ne doit et ne peut donc pas admettre le déter- minisme a priori ; et, quand elle l'admet, ce ne doit être, comme toujours, que dans les limites de l'espace et du temps considérés. Cela posé, l'expérience nous enseigne qu'en des cas très nombreux, les phénomènes sociaux paraissent justement être déterminés par les conditions, et qu'ils ne changent qu'avec celles-ci ; aussi admet-on le déterminisme pour ces cas, mais sans nier le moins du monde qu'il en puisse être d'autres, où il ne soit pas admissible. [Voir Addition A3 par l’auteur]
§ 133. En nous plaçant dans l'hypothèse du déterminisme, nous avons à résoudre un problème qui se présente à chaque instant, sous différentes formes, en sociologie et dans l'histoire. D'après le déterminisme, tout ce qui arrive ne saurait être autrement ; les termes possible, impossible, du langage ordinaire n'ont donc aucun sens, puisque n'est possible que ce qui arrive, impossible que ce qui n'arrive pas. Nous ne voulons pas discuter sur les mots ; par conséquent, si quelqu'un trouve bon de supprimer ces termes, supprimons les pour le contenter ; mais, cela fait, les choses différentes qu'ils désignaient n'en subsistent pas moins, et nous devrons leur trouver d'autres noms.
Paul n'a pas déjeuné hier. On dit couramment qu'il était possible qu'il déjeunât. Il ne s'est pas coupé la tête ; mais il était impossible qu'il se la coupât, puis se la remît sur les épaules avec un peu de colle forte et fût aujourd'hui encore vivant et en bonne santé. Il est bien entendu qu'au point de vue du déterminisme, les deux faits sont également impossibles ; d'autre part, il est évident qu'ils ont tous deux des caractères distincts, et qu'il est indispensable de pouvoir séparer les genres différents auxquels ils appartiennent. Appelons pour un moment (I) le premier genre de faits, (II) le second. Nous voyons immédiatement que la différence entre (I) et (II) consiste en ce qu'on a vu déjà des faits semblables à (I), et que l'on n'a jamais vu de faits semblables à (II).
§ 134. Pour être plus précis, nous dirons que dans l'un et l'autre cas, on traite de mouve- ments virtuels, et qu'en les déclarant tous deux impossibles, le déterminisme leur assigne simplement le caractère de mouvements virtuels, par opposition aux mouvements réels. Mais il y a plusieurs genres de mouvements virtuels. L'un d'eux apparaît, quand on supprime, par hypothèse, quelque liaison qui ne faisait pas défaut lorsqu'on a observé le mouvement réel considéré, mais dont on a constaté l'absence, en d'autres occasions où l'on a remarqué un mouvement réel égal au mouvement virtuel que l'on vient d'indiquer. Celui-ci fait donc partie du genre que nous avons nommé (I), et que le langage courant appelle : des choses possibles. Il est un autre genre de mouvements virtuels. On les observe seulement quand on supprime, par hypothèse, une liaison dont on n'a jamais constaté le défaut ; par conséquent, ils sont tels qu'on n'a jamais observé de mouvements réels qui leur fussent égaux. Nous avons ainsi le genre que nous avons appelé (II), et que le langage courant appelle : des choses impossibles.
Maintenant que nous avons défini avec précision les choses auxquelles correspondent ces termes possible et impossible, il n'y a aucun inconvénient à les employer aussi dans l'hypothèse du déterminisme.
§ 135. À quoi peut bien servir l'étude des mouvements virtuels, s'ils sont en dehors de la réalité, et si les mouvements réels seuls se produisent ? On peut entreprendre une telle étude pour deux motifs : 1° Si nous considérons des mouvements virtuels, qui n'ont pu être classés parmi les réels, à cause de certaines liaisons dont la présence a été observée en d'autres occasions, autrement dit, quand on considère des mouvements qui se présentent comme virtuels dans un cas et réels dans un autre, leur étude peut servir à prévoir ce que seront des mouvements réels. De ce genre sont les prévisions faites sur les effets d'une loi ou de tout autre mesure sociale. 2° La considération des mouvements virtuels peut servir à trouver les caractères et les propriétés d'un certain état social.
§ 136. Dire : « A détermine B », ou bien : « sans A, B manquerait », exprime le même fait, dans le premier cas, sous forme de propriété de A, dans le second, sous forme de mouve- ments virtuels. Dire: « dans cet état, la société obtient le maximum de A » ou bien : « si la société s'éloigne de l'état considéré, A diminue », exprime le même fait ; dans le premier cas, sous forme de propriété de cet état ; dans le second, sous forme de mouvements virtuels.
§ 137. Dans l'étude des sciences sociales, il convient de n'avoir recours à la considération des mouvements virtuels qu'avec beaucoup de précaution, parce que nous ignorons très souvent quels seraient les effets de la suppression d'une condition ou d'une liaison. Quand on dit, par exemple : «Si l'empereur Julien avait régné longtemps, la religion chrétienne n'aurait pas duré », on suppose que la mort seule de Julien donna la victoire au christianisme ; et quand on répond : « Si l'empereur Julien avait régné longtemps, il aurait pu retarder, mais non empêcher le triomphe du christianisme », on suppose l'existence d'autres conditions qui assuraient cette victoire. En général, les propositions de cette seconde catégorie se vérifient plus souvent que celles de la première ; c'est à-dire que très souvent le développement social est déterminé par l'ensemble d'un grand nombre de conditions, et qu'en supprimer une ne modifie la marche du phénomène que dans une faible mesure.
§ 138. Ajoutons que les conditions ne sont pas indépendantes ; beaucoup agissent les unes sur les autres. Ce n'est pas tout. Les effets de ces conditions agissent à leur tour sur les conditions elles-mêmes. En somme, les faits sociaux, c'est-à-dire conditions et effets, sont mutuellement dépendants ; une modification de l'un se répercute sur une partie plus ou moins grande des autres, avec une intensité plus ou moins forte.
§ 139. Aussi ne compose-t-on que des romans, quand on essaie de refaire l'histoire, en cherchant à deviner ce qui serait arrivé, si un certain fait n'avait pas eu lieu. Nous n'avons aucun moyen de connaître toutes les modifications qu'aurait apportées l'hypothèse choisie ; par conséquent, nous ne savons rien de ce qui serait advenu, si elle s'était réalisée. Que se serait-il passé, si Napoléon 1er avait été victorieux à Waterloo ? On ne peut donner qu'une seule réponse : « Nous n'en savons rien ».
§ 140. Il est possible d'acquérir quelques connaissances, en limitant les recherches à des effets tout proches, dans un domaine très restreint. Le progrès de la science sociale aura justement pour effet de reculer peu à peu ces frontières si rapprochées. Chaque fois que nous réussissons à découvrir, dans les faits sociaux, une relation jusqu'alors inconnue, nous devenons plus à même de connaître les effets de certaines modifications dans l'état social ; et, en suivant cette voie, nous faisons un nouveau pas, si petit qu'il soit, vers la connaissance du développement probable des faits sociaux.
C'est pourquoi l'on ne peut qualifier d'inutile aucune étude ayant pour but de trouver une uniformité dans les relations des faits sociaux entre eux. Elle peut l'être aujourd'hui, même dans un avenir prochain ; mais nous ne pouvons savoir si un jour ne viendra pas où, jointe à d'autres, elle permettra de prévoir le développement social probable.
§ 141. Le phénomène social étant très complexe, grandes sont les difficultés inhérentes à la recherche de ses uniformités ; elles croissent outre mesure et deviennent insurmontables, quand on s'adonne à cette étude, non dans le seul et unique but de découvrir ces uniformités, mais avec l'intention avouée ou masquée par le sentiment, de confirmer un principe, une doctrine, un article de foi ; c'est à cause de tels obstacles que les sciences sociales sont encore si arriérées.
§ 142. Il n'existe pas d'homme qui ne subisse l'influence des sentiments, qui soit entièrement dépourvu de préjugés et d'une foi quelconque. S'il fallait à tout prix satisfaire à ces conditions, pour se livrer à une étude profitable des sciences sociales, autant vaudrait dire que cette étude est impossible. Mais l'expérience montre que l'homme peut se dédoubler en une certaine mesure, et, quand il étudie un sujet, faire abstraction, au moins en partie, de ses sentiments, de ses préjugés, de sa foi, quitte à s'y livrer ensuite, quand il abandonne son étude. C'était, par exemple, le cas de Pasteur qui, hors de son laboratoire, se montrait fervent catholique, et dans son laboratoire, employait exclusivement la méthode expérimentale. On pourrait encore citer avant lui Newton, qui, certes, usait de méthodes bien différentes, quand il rédigeait ses commentaires sur l'Apocalypse et quand il écrivait ses Principia.
§ 143. Un tel dédoublement est beaucoup plus facile dans les sciences naturelles que dans les sciences sociales. Il est aisé d'étudier les fourmis avec l'indifférence sceptique de la science expérimentale ; il est beaucoup plus difficile d'envisager les hommes de cette façon. Toutefois, s'il est impossible d'y arriver entièrement, on peut du moins tâcher d'y réussir en partie, en réduisant au minimum l'influence et le pouvoir des sentiments, des préjugés, de la foi. C'est à ce prix seulement que les sciences sociales peuvent progresser.
§ 144. Les faits sociaux sont les éléments de notre étude. Nous tâcherons tout d'abord de les classer, ayant en vue le seul et unique but que nous indiquons, c'est-à-dire la découverte des uniformités (lois), des rapports qui existent entre ces faits. En groupant ainsi des faits semblables, l'induction fera ressortir quelques-unes de ces uniformités, et quand nous nous serons suffisamment avancés dans cette voie, avant tout inductive, nous en suivrons une autre, où la déduction aura plus d'importance. Nous vérifierons ainsi les uniformités aux- quelles nous avait conduits la méthode inductive ; nous leur donnerons une forme moins empirique, plus théorique ; nous en tirerons les conséquences et verrons comment elles représentent le phénomène social.
En général, on étudie des choses qui varient par degrés insensibles ; et plus la représen- tation qu'on s'en fait approche de la réalité, plus elle tend à devenir quantitative. On exprime souvent ce fait, en disant qu'en se perfectionnant, les sciences tendent à devenir quantitatives. Cette étude est beaucoup plus difficile que celle des différences simplement qualitatives [FN: § 144-1] ; et le premier progrès qu'on réalise consiste justement en une grossière approximation quanti- tative. Il est facile de distinguer le jour de la nuit, avec une certaine approximation. Bien qu'il n'y ait pas à proprement parler d'instant précis auquel le premier cesse et la seconde commence, on peut toutefois dire, d'une façon générale, qu'il y a là une différence de qualités. Il est plus difficile de diviser ces espaces de temps en parties définies. On y arrive, avec une très grossière approximation, quand on dit : « peu après le lever du soleil, vers midi, etc. »; et tant bien que mal, plutôt mal que bien, en divisant la nuit en veilles. Quand on eut les horloges, on put obtenir une mesure quantitative du temps, dont la précision augmenta avec celle des horloges, et devint très précise avec les chronomètres. Longtemps les hommes se contentèrent de savoir que la mortalité était plus grande chez les vieillards que chez les jeunes gens, sans que l'on sût, comme il arrive généralement, le point précis où finissait la jeunesse et où commençait la vieillesse. Puis on apprit quelque chose de plus ; on eut ensuite des tables de mortalité très imparfaites, puis meilleures, aujourd'hui passables et qui chaque jour deviennent plus parfaites.
Longtemps l'économie politique fut presque entièrement qualitative ; puis avec l'écono- mie pure, elle devint quantitative, au moins théoriquement. Nous tâcherons donc de réaliser, en sociologie aussi, un semblable progrès, et de substituer autant que possible des consi- dérations quantitatives aux considérations qualitatives ; car, bien qu'imparfaites, voire très imparfaites, les premières valent du moins toujours un peu mieux que les secondes. Nous ferons ce que nous pourrons; d'autres ensuite feront mieux. Ainsi progresse la science.
Dans cet ouvrage, nous nous contenterons d'une représentation très générale, semblable à celle qui assigne à la terre la forme d'un sphéroïde ; c'est pourquoi notre livre porte le nom de Sociologie générale. Les détails resteront à étudier, comme on dessine les océans, les continents et les montagnes sur le sphéroïde terrestre ; ce qui constituera une étude de sociologie spéciale. Toutefois nous devrons examiner en passant quelques-uns de ces détails, parce que nous les rencontrerons sur la route que nous aurons à parcourir pour arriver à la connaissance du phénomène général.
[64]
Chapitre II↩
Les actions non-logiques. [(§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149]
§ 145. Au chapitre précédent, nous avons exprimé les conditions que nous nous imposions en écrivant cet ouvrage, et indiqué dans quel domaine nous voulions demeurer. Maintenant nous allons étudier les actions humaines, l'état d'esprit auquel elles correspondent et les façons dont il se manifeste ; cela pour arriver finalement à notre but, qui est la connaissance des formes sociales.
Nous suivons la méthode inductive, écartant toute opinion préconçue et toute idée a priori. En présence des faits, nous les décrivons, les classons, étudions leurs propriétés, et cherchons à découvrir quelque uniformité (loi) dans leurs relations.
Dans ce chapitre, nous commencerons par nous occuper d'une distinction fondamentale des actions [FN: § 145-1] .
§ 146. C'est notre premier pas dans la voie de l'induction. Si, par exemple, nous trouvons que toutes les actions humaines correspondent aux théories logico-expérimentales, ou encore que ces actions sont les plus importantes, les autres devant être considérées comme des déviations d'un type normal, comme des phénomènes de pathologie sociale, il est manifeste que notre voie divergerait entièrement de celle qu'il conviendrait de suivre, si, au contraire, un grand nombre d'actions humaines, parmi les plus importantes, correspondent aux théories qui ne sont pas logico-expérimentales.
§ 147. Étudions donc les actions au point de vue du caractère logico-expérimental. Dans ce but, nous devons tout d'abord tâcher de les classer ; et pour le faire, nous nous proposons de suivre les principes de la classification dite naturelle, en botanique et en zoologie, d'après laquelle on groupe les objets ayant un ensemble de caractères semblables. C'est ainsi qu'en botanique la classification de Tournefort a été abandonnée avec raison. Elle divisait les plantes en « herbes » et en « arbres », séparant ainsi des végétaux qui sont au contraire fort semblables. La méthode dite naturelle, que l'on suit maintenant, élimine toute division de ce genre, prend pour critère l'ensemble des caractères des végétaux, réunit ceux qui sont semblables, sépare ceux qui différent. Nous allons tâcher de trouver des divisions analogues pour les actions humaines.
§ 148. Ce ne sont pas les actions concrètes, que nous avons à classer, mais leurs éléments. De même, le chimiste classe les corps simples et leurs combinaisons, alors que dans la nature on trouve des mélanges de ces combinaisons. Les actions concrètes sont synthétiques ; elles proviennent de mélanges, en proportions variables, des éléments que nous avons à classer.
§ 149. Tout phénomène social peut être envisagé sous deux aspects, c'est-à-dire comme il est en réalité ou tel qu'il se présente à l'esprit de certains hommes. Nous appellerons le premier aspect : objectif, le second : subjectif (§ 94 et sv.). Cette division est nécessaire, parce que nous ne pouvons mettre dans une même classe, par exemple, les opérations que le chimiste exécute dans son laboratoire, et celles de l'individu qui s'adonne à la magie, les actions qu'accomplissaient les marins grecs, ramant pour chasser leur navire sur l'eau, et les sacrifices qu'ils offraient à Poséidon pour obtenir une navigation propice. À Rome, la loi des XII Tables punissait celui qui opérait des sortilèges contre les moissons. Nous voulons distinguer cette action de celle qui consiste à incendier les moissons.
Les noms donnés à ces deux classes ne doivent pas nous induire en erreur. En réalité, elles sont toutes les deux subjectives ; parce que toute connaissance humaine est subjective. Elles se distinguent, non par une différence de nature, mais par une somme plus ou moins grande de connaissances des faits. Nous savons – ou croyons savoir – que les sacrifices à Poséidon n'ont aucune influence sur la navigation. Nous les séparons donc d'autres actions qui, d'après nos connaissances, peuvent avoir une influence sur la navigation. Si l'on venait à découvrir, un jour, que nous nous trompons, et que les sacrifices à Poséidon sont très utiles pour obtenir une navigation favorable, il faudrait replacer ces sacrifices parmi les autres actions qui ont ce caractère. À vrai dire, tout cela n'est qu'un pléonasme et revient à affirmer que l'individu qui établit une classification, la fait d'après les connaissances qu'il possède. On ne comprend pas comment il pourrait en être autrement.
§ 150. Il y a des actions qui sont des moyens appropriés au but, et qui s'unissent logiquement à ce but. Il en est d'autres auxquelles ce caractère fait défaut. Ces deux classes d'actions sont très différentes, suivant qu'on les considère sous leur aspect objectif ou sous leur aspect subjectif. Sous ce dernier aspect, presque toutes les actions humaines font partie de la première classe. Pour les marins grecs, les sacrifices à Poséidon et l'action de ramer étaient des moyens également logiques de naviguer.
Il convient de donner des noms à ces classes d'actions, afin d'éviter des longueurs qui deviendraient fastidieuses. Comme nous l'avons dit déjà aux § 116 et sv., il vaudrait peut-être mieux se servir de noms qui n'aient par eux-mêmes aucun sens, par exemple des lettres de l'alphabet. D'autre part, un tel procédé nuirait à la clarté de l'exposition. Il faut donc se résigner à employer les termes du langage commun ; mais le lecteur voudra bien se souvenir que ces noms – ou leurs étymologies – ne servent à rien, si l'on veut savoir ce qu'ils désignent. Ces classes doivent être étudiées directement, et leur nom n'est qu'une étiquette quelconque servant à les indiquer (§ 119). Cela dit une fois pour toutes, nous appellerons « actions logiques », les opérations qui sont logiquement unies à leur but, non seulement par rapport au sujet qui accomplit ces opérations, mais encore pour ceux qui ont des connaissances plus étendues ; c'est-à-dire les actions ayant subjectivement et objectivement le sens expliqué plus haut. Les autres actions seront dites « non-logiques »; ce qui ne signifie pas illogiques. Cette classe se divisera en différents genres.
§ 151. Il convient de donner un tableau synoptique de cette classification.
| GENRE ET ESPÈCES | LES ACTIONS ONT-ELLES UNE FIN LOGIQUE? | |
| Objectivement | Subjectivement | |
| Ie CLASSE - Actions logiques. Le but objectif est identique au but subjectif. |
||
| Oui | Oui | |
| IIe CLASSE Actions non-logiques. Le but objectif est identique au but subjectif. |
||
| 1er genre ... | Non | Non |
| 2d genre ... | Non | Oui |
| 3e genre ... | Oui | Non |
| 4e genre ... | Oui | Oui |
| ESPÈCES DU 3e ET DU 4e GENRES | ||
| 3α, 4α ... | Le sujet accepterait le but objectif, s'il le connaissait. | |
| 3β, 4β ... | Le sujet n'accepterait pas le but objectif, s'il le connaissait. | |
Le but dont nous parlons ici est un but direct ; la considération d'un but indirect est exclue. Le but objectif est un but réel, rentrant dans le domaine de l'observation et de l'expérience, et non un but imaginaire, étranger à ce domaine, et qui pourrait être au contraire un but subjectif.
§ 152. Les actions logiques sont très nombreuses chez les peuples civilisés. Les travaux artistiques et scientifiques appartiennent à cette classe, au moins en ce qui concerne les personnes qui connaissent ces deux disciplines. Pour les exécuteurs matériels de ces travaux, qui ne font qu'accomplir les ordres de leurs chefs, ce sont des actions de la 2e classe, 4e genre. Les actions étudiées par l'économie politique appartiennent, elles aussi, en très grande partie, à cette classe. On doit y ranger, en outre, un certain nombre d'opérations militaires, politiques, juridiques, etc.
§ 153. Voilà que l'induction nous amène à reconnaître que les actions non-logiques ont une grande part dans le phénomène social. Donc, procédons à leur étude ; et, ce faisant, nous aurons à effleurer, dans ce chapitre, certains sujets que nous traiterons plus à fond, dans la suite de notre ouvrage, pour revenir enfin sur les questions indiquées ici.
§ 154. Tout d'abord, pour mieux connaître ces actions non-logiques, voyons quelques exemples ; beaucoup d'autres trouveront d'ailleurs leur place dans les chapitres suivants. Voici des exemples d'actions de la 2e classe.
Le 1er et le 3e genres, qui n'ont pas de but subjectif, sont très peu importants pour la race humaine. Les hommes ont une tendance très prononcée à donner un vernis logique à leurs actions ; celles-ci rentrent donc presque toutes dans le 2e et le 4e genres. Beaucoup d'actions imposées par la politesse ou la coutume pourraient appartenir au 1er genre. Mais très souvent les hommes invoquent un motif quelconque, pour justifier leurs actions ; ce qui les fait passer dans le 2e genre.
Si nous laissons de côté le motif indirect, résultant du fait que l'homme qui s'écarte des usages communs est blâmé et mal vu, nous trouvons quelques actions à placer dans le 1er et le 3e genres. Hésiode dit : « N'urine pas à l'embouchure d'un fleuve qui se jette dans la mer ni dans une fontaine. Il faut l'éviter. N'y soulage pas ton ventre ; cela vaut mieux [FN: § 154-1]. » Le précepte de ne pas souiller les fleuves à leur embouchure appartient au 1er genre. On ne voit aucun but objectif ni subjectif à l'action d'éviter cette souillure. Le précepte de ne pas souiller les fontaines appartient au 3e genre. Il a un but objectif qu'Hésiode ne pouvait connaître, mais que les modernes connaissent : c'est le fait d'éviter la diffusion de certaines maladies.
Il est probable qu'il existe, chez les sauvages et les barbares, plusieurs actions du 1er, et du 3e genres ; mais les voyageurs, voulant coûte que coûte connaître la cause des actions qu'ils observent, finissent par obtenir, d'une manière ou d'une autre, quelque réponse qui les fait passer dans le 2e et le 4e genres.
§ 155. Chez les animaux, pour autant que nous admettions leur absence de raisonnement, presque toutes les actions dites instinctives prennent place dans le 3e genre ; quelques-unes peuvent aussi rentrer dans le 1er.
Le 3e genre est le type pur des actions non-logiques. Leur étude chez les animaux nous aidera à comprendre ces actions chez les hommes. À propos des insectes appelés euménides, Émile Blanchard [FN: § 155-1] dit qu'à l'instar d'autres hyménoptères, ils vont (p. 71)
« pomper le miel dans le nectaire des fleurs, quand ils sont adultes, mais leurs larves ne vivent que de proie vivante ; et cependant, aussi bien que celles des Guêpes et des Abeilles, elles sont apodes, incapables de se nourrir ; elles périraient bientôt, si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. D'après cela, on devine ce qui arrive ; c'est la mère qui doit procurer la nourriture à ses petits. Cette industrieuse femelle, qui ne vit que du suc des fleurs, va faire la guerre aux insectes pour assurer l'existence de sa progéniture. Presque toujours l'Hyménoptère s'attaque à une espèce particulière pour en approvisionner son nid ; il sait parfaitement trouver ceux qui nous paraissent bien rares, quand nous les cherchons. La femelle pique ses victimes avec son aiguillon et les emporte à son nid. L'insecte ainsi blessé ne meurt pas immédiatement, il demeure plongé dans un état d'engourdissement complet, qui le rend incapable de se mouvoir et surtout de se défendre. Les larves, qui éclosent auprès de ces provisions péniblement amassées par leur mère, trouvent à leur portée une nourriture convenable, en quantité suffisante pour toute la durée de leur existence à l'état de larve. Rien n'est plus surprenant que cette admirable prévoyance sans doute tout instinctive de chaque femelle, qui, au moment de pondre ses œufs, prépare la nourriture de ses larves, qu'elle ne verra jamais ; déjà elle aura cessé de vivre, quand celles-ci viendront à éclore. »
D'autres hyménoptères, les cerceris, s'attaquent aux coléoptères. L'action subjectivement non-logique est ici d'une merveilleuse logique objective. Laissons parler Fabre [FN: § 155-2]. Il observe que, pour paralyser sa proie, l'hyménoptère doit trouver des coléoptères chez lesquels les trois ganglions thoraciques sont très rapprochés, contigus, ou chez lesquels les deux derniers sont soudés ensemble « (p. 72) Voilà vraiment la proie qu'il faut aux Cerceris. Ces coléoptères à centres moteurs rapprochés jusqu'à se toucher, assemblés même en une masse commune et de la sorte solidaires l'un de l'autre, seront à l'instant même paralysés d'un seul coup d'aiguillon ; ou bien, s'il faut plusieurs coups de lancette, les ganglions à piquer seront tous là, du moins, réunis sous la pointe du dard. » Et plus loin :
« (p. 73) Parmi le nombre immense de Coléoptères sur lesquels sembleraient pouvoir se porter les déprédations des Cerceris, deux groupes seulement, les Charançons et les Buprestes, remplissent les conditions indispensables. Ils vivent loin de l'infection et de l'ordure, objets peut-être de répugnances invincibles pour le délicat chasseur ; ils ont dans leurs nombreux représentants les tailles les plus variées, proportionnées à la taille des divers ravisseurs, qui peuvent ainsi choisir à leur convenance ; ils sont beaucoup plus que tous les autres vulnérables au seul point où l'aiguillon de l'Hyménoptère puisse pénétrer avec succès, car en ce point se pressent, tous aisément accessibles au dard, les centres moteurs des pattes et des ailes. En ce point, pour les Charançons, les trois ganglions thoraciques sont très rapprochés, les deux derniers même sont contigus ; en ce même point, pour les Buprestes, le second et le troisième sont confondus en une seule et grosse masse, à peu de distance du premier. Et ce sont précisément des Buprestes et des Charançons que nous voyons chasser, à l'exclusion absolue de tout autre gibier, par les huit espèces de Cerceris dont l'approvisionnement en Coléoptères est constaté ! »
§ 156. D'un autre côté, une partie des actions des animaux révèle une espèce de raisonnement, ou mieux d'adaptation des moyens au but, quand les circonstances changent. Fabre, que nous citons abondamment, parce que c'est l'auteur qui a le mieux étudié ces questions, dit [FN: § 156-1] : « (p. 165) Pour l'instinct rien n'est difficile, tant que l'acte ne sort pas de l'immuable (p. 166) cycle dévolu à l'animal : pour l'instinct aussi rien n'est facile si l'acte doit s'écarter des voies habituellement suivies. L'insecte qui nous émerveille, qui nous épouvante de sa haute lucidité, un instant après, en face du fait le plus simple mais étranger à sa pratique ordinaire, nous étonne par sa stupidité. » Et plus loin [FN: § 156-2] :
« (p. 65) Dans la psychique de l'insecte, deux domaines, fort différents, sont à distinguer. L'un est l'instinct proprement dit (p. 66), l'impulsion inconsciente qui préside à ce que l'animal accomplit de plus merveilleux dans son industrie... C'est lui, et rien que lui, qui fait construire pour une famille ignorée de la mère, qui conseille des provisions destinées à l'inconnu, qui dirige le dard vers le centre nerveux de la proie... en vue de la bonne conservation des vivres... Mais avec sa rigide science qui s'ignore, l'instinct (p. 67) pur, s'il était seul, laisserait l'insecte désarmé, dans le perpétuel conflit des circonstances... un guide est nécessaire pour rechercher, accepter, refuser, choisir, préférer ceci, ne faire cas de cela, tirer enfin parti de ce que l'occasion peut offrir d'utilisable. Ce guide, l'insecte le possède certes, à un degré même très évident. C'est le second domaine de sa psychique. Là, il est conscient et perfectible par l'expérience. N'osant appeler cette aptitude rudimentaire intelligence, titre trop élevé pour elle, je l'appellerai discernement. »
§ 157. Qualitativement (§ 143-3] ), les phénomènes sont à peu près les mêmes pour l'homme ; mais quantitativement, le champ des actions logiques, très restreint chez l'animal, devient extrêmement étendu chez l'homme. Cependant, un très grand nombre d'actions humaines, même aujourd'hui chez les peuples civilisés, sont accomplies instinctivement, mécaniquement, sous l'empire de l'habitude. On l'observe encore mieux dans le passé et chez les peuples moins avancés. Il y a des cas où l'on observe que l'efficacité de certains actes du culte est admise instinctivement, et non comme conséquence logique de la religion qui professe ce culte (§ 952).
Fabre dit [FN: § 157-1] :
« (p. 174) Les divers actes instinctifs des insectes sont donc fatalement liés l'un à l'autre. Parce que telle chose vient de se faire, telle autre doit inévitablement se faire pour compléter la première ou pour préparer les voies à son complément [c'est le cas de nombreuses actions humaines] ; et les deux actes sont dans une telle dépendance l'un de l'autre, que l'exécution du premier entraîne celle du second, lors même que, par des circonstances fortuites, le second soit devenu non seulement inopportun, mais quelquefois même contraire aux intérêts de l'animal. »
Mais la logique, qui prend une si grande importance chez l'homme, apparaît en germe chez l'animal. Après avoir raconté comment il déroutait certains insectes qui s'obstinaient à exécuter des actes inutiles, Fabre ajoute:
« (p. 176) Rappelons ici que le Sphex à ailes jaunes ne se laisse pas toujours duper dans ce jeu qui consiste à lui reculer le grillon. Il y a chez lui des tribus d'élite, des familles à forte tête, qui, après quelques échecs, reconnaissent les malices de l'opérateur et savent les (p. 177) déjouer. Mais ces révolutionnaires, aptes au progrès, sont le petit nombre ; les autres, conservateurs entêtés des vieux us et coutumes, sont la majorité, la foule. »
Il est utile que le lecteur retienne cette observation ; parce que ce contraste entre la tendance aux combinaisons, laquelle innove, et la tendance à la permanence des agrégats de sensations, laquelle conserve, pourrait nous mettre sur la voie de l'explication d'un grand nombre de faits des sociétés humaines (chap. XII).
§ 158. La formation du langage humain n'est pas moins merveilleuse que les actions instinctives des insectes. Il serait absurde de prétendre que la théorie grammaticale ait précédé la pratique du langage. Elle l'a certainement suivi ; et c'est sans en avoir conscience, que les hommes ont créé de subtiles théories grammaticales. Prenons comme exemple la langue grecque. Si l'on voulait remonter plus haut, à quelque idiome indo-européen dont on ferait dériver le grec, nos observations se vérifieraient a fortiori, parce que les abstractions grammaticales deviendraient de moins en moins probables. On ne saurait admettre que les Grecs se soient réunis, un beau jour, pour décréter la conjugaison de leurs verbes. L'usage seul en a fait un chef-d'œuvre. Nous savons que les Attiques avaient l'augment, signe du passé des temps historiques, et que, par une nuance fort délicate, ils distinguaient, outre l'augment syllabique, l'augment temporel, qui consiste dans l'allongement de la voyelle initiale. La conception de l'aoriste et son rôle dans la syntaxe sont une invention qui ferait honneur au logicien le plus expert. Les nombreuses formes du verbe et la précision de leur rôle dans la syntaxe constituent un tout admirable [FN: § 158-1].
§ 159. À Rome, le général revêtu de l'imperium doit, avant de quitter la ville, prendre les auspices au Capitole. Il ne peut le faire qu'à Rome. Il est impossible d'admettre que cette disposition eût, à l'origine, le but politique qu'elle a fini par atteindre [FN: § 159-1] .
« (p. 114) Tandis qu'il dépendait exclusivement de la volonté des comices de prolonger les imperia qui existaient, il ne pouvait en être établi de nouveaux comportant la plénitude du commandement militaire qu'avec la prise des auspices au Capitole, par conséquent avec un acte accompli dans la sphère de la compétence urbaine... et en en organisant une en dehors de la constitution, on aurait franchi les bornes qui s'imposaient même aux comices du peuple souverain. Il n'y a guère de barrière constitutionnelle qui ait aussi longtemps résisté que la garantie qu'on avait trouvée là, dans ces auspices du général, contre les pouvoirs militaires extraordinaires, mais cette prescription a fini par être elle-même écartée ou plutôt tournée. À l'époque récente, on annexait, par une fiction de droit, à la ville de Rome, comme s'il avait été situé dans le pomerium, un morceau de terrain quelconque situé hors de la ville, et on y (p. 115) accomplissait l'auspicium requis. »
Plus tard, Sulla non seulement abolit cette garantie des auspices, mais la rendit même impossible, grâce à une disposition par laquelle il obligeait le magistrat à ne prendre le commandement qu'à l'expiration de son année de fonctions ; c'est-à-dire quand il ne pouvait plus prendre les auspices de Rome. Le conservateur Sulla n'avait évidemment pas l'intention de préparer ainsi la destruction de sa constitution ; de même qu'en sanctionnant l'obligation de prendre les auspices dans la capitale, on n'avait pas en vue de prévenir les attaques à la constitution républicaine. En réalité, nous avons, dans ce dernier cas, une action non-logique 4 α; et, dans le cas de Sulla, une action 4 β. Dans le phénomène économique, un fait est remarquable : dans un état de libre concurrence, les entrepreneurs accomplissent en partie des actions non-logiques 4 β: c'est-à-dire des actions dont la fin objective n'est pas égale à la fin subjective [FN: § 159-2] . Au contraire, si certaines de ces entreprises jouissent d'un monopole, ces actions deviennent logiques.
§ 160. Il y a une autre différence très importante entre les actions des hommes et celles des animaux : nous n'observons pas les actions des hommes seulement de l'extérieur, comme nous observons celles des animaux. Souvent nous ne connaissons les premières que par les appréciations qu'en donnent les hommes, par l'impression qu'elles font sur eux, par les motifs qu'il leur plait d'imaginer on d'attribuer comme causes à ces actions. C'est pourquoi les actions qui appartiendraient au 1er et au 3e genres, passent dans le 2e et le 4e.
Quand d'autres actions ne sont pas ajoutées aux opérations magiques, ces dernières appartiennent au 2e genre. Les sacrifices des Grecs et des Romains doivent en faire partie, du moins dès qu'on ne croit plus à la réalité de leurs dieux. Hésiode veut qu'on ne traverse jamais un fleuve sans avoir prié et s'y être lavé les mains. Ce serait là une action du 1er genre ; mais il ajoute que les dieux punissent celui qui traverse un fleuve sans se laver les mains [FN: § 160-1] . L'action passe ainsi dans le 2e genre.
Ce procédé est habituel et très répandu. Hésiode dit qu'il ne faut pas semer le treizième jour du mois, mais que ce jour est excellent pour planter [FN: § 160-2] . Il donne encore un très grand nombre de préceptes semblables. Ces actions appartiennent au 2e genre. À Rome, l'augure qui avait observé les signes célestes, pouvait renvoyer les comices à un autre jour [FN: § 160-3] . Vers la fin de la République, quand on ne croyait plus à la science augurale, celle-ci donnait lieu à des actions logiques. C'était un moyen d'atteindre un résultat désiré. Mais quand on croyait encore à la science augurale, elle engendrait des actions du 4e genre, se rattachant à l'espèce 4 α, pour les augures qui, avec l'aide des dieux, empêchaient ainsi une délibération, à leurs yeux funeste au peuple romain.
En général, ces actions correspondent, très imparfaitement c'est vrai, aux précautions prises aujourd'hui pour éviter les décisions hâtives d'une assemblée : exigence de deux ou trois délibérations consécutives, accord de deux assemblées, etc. Il se trouve ainsi que les actions des augures appartenaient souvent à l'espèce 4 α .
La majeure partie des actes politiques procédant de la tradition, de la prétendue mission d'un peuple ou d'un homme, appartiennent au 4e genre. Le roi de Prusse, Guillaume 1er, et l'empereur des Français, Napoléon III, se considéraient tous deux comme des hommes « providentiels ». Mais le premier croyait que sa mission était de faire le bien et la grandeur de son pays ; tandis que le second pensait être destiné à faire le bien de l'humanité. Le premier accomplit des actions de l'espèce 4 α; le second, de l'espèce 4 β.
Les hommes se donnent ordinairement certaines règles générales (morale, coutume, droit) dont dérive un nombre plus ou moins grand d'actions 4 α et aussi d'actions 4 β.
§ 161. Les actions logiques sont, au moins dans leur partie principale, le résultat d'un raisonnement ; les actions non-logiques proviennent principalement d'un certain état psychique : sentiments, subconscience, etc. C'est à la psychologie à s'occuper de cet état psychique. Dans notre étude, nous partons de cet état de fait, sans vouloir remonter plus haut.
§ 162. Pour les animaux (fig. 2), supposons que les actes B, qui sont les seuls que nous puissions observer, soient unis à un état psychique hypothétique A (I). Chez les hommes, cet état psychique ne se manifeste pas seulement par des actes B, mais aussi par des expressions C, de sentiments, qui se développent souvent en théories morales, religieuses et autres. La tendance très marquée qu'ont les hommes à prendre les actions non-logiques pour des actions logiques, les porte à croire que B est un effet de la « cause » C. On établit de la sorte une relation directe CB, au lieu de la relation indirecte qui résulte des deux rapports AB, AC.
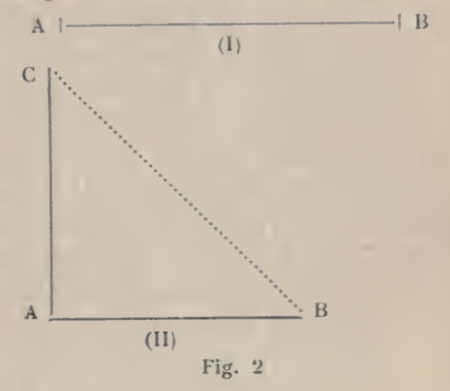
Figure 2
Parfois la relation CB existe véritablement ; mais cela n'arrive pas si souvent qu'on le croit. Le même sentiment qui pousse les hommes à s'abstenir de faire une action B (relation AB), les pousse à créer une théorie C (relation AC). L'un a, par exemple, horreur de l'homicide B et s'en abstiendra ; mais il dira que les dieux punissent l'homicide ; ce qui constitue une théorie C.
§ 163. Il s'agit ici non seulement de relations qualitatives (143-1), mais aussi de relations quantitatives. Supposons pour un moment une force donnée, qui pousse un homme à exécuter l'action B ; elle a un indice égal à 10. L'individu accomplit ou non cette action B, suivant que les forces qui agissent pour l'en empêcher ont un indice inférieur ou supérieur à 10. Nous aurons alors les cas suivants : 1° La force de la liaison AB a un indice supérieur à 10. Dans ce cas, elle suffit pour empêcher l'homme d'accomplir l'action. Si la liaison CB existe, elle est superflue. 2° La force de la liaison CB, si elle existe, a un indice supérieur à 10. Dans ce cas, elle suffit à empêcher l'action B, même si la force AB est égale à zéro. 3° La force résultant de la liaison AB a, par exemple, un indice égal à 4 ; celle résultant de la liaison CB, un indice égal à 7. La somme des indices est 11 : l'action ne sera pas exécutée. La force résultant de la liaison AB a un indice égal à 2 ; l'autre force conserve l'indice 7 ; la somme est 9 : l'action sera exécutée.
Par exemple, la liaison AB représente la répugnance qu'éprouve un individu à accomplir l'action B ; AC représente la théorie d'après laquelle les dieux punissent celui qui exécute l'action B. Il y aura des gens qui s'abstiendront de B par simple répugnance (1er cas). Il y en aura d'autres qui s'en abstiendront uniquement parce qu'ils craignent la punition des dieux (2e cas). Il y en aura aussi qui s'en abstiendront pour ces deux causes ensemble (3e cas).
§ 164. Les propositions suivantes sont donc fausses, étant trop absolues : « La disposition naturelle à faire le bien suffit pour empêcher les hommes de faire le mal. La menace des châtiments éternels suffit à empêcher les hommes de faire le mal. La morale est indépendante de la religion. La morale est une dépendance nécessaire de la religion. »
Supposons que C soit une sanction édictée par la loi. Le même sentiment qui pousse les hommes à craindre cette sanction, les retient d'accomplir l'action B. Chez quelques-uns, la répugnance pour B suffit à les empêcher d'exécuter cette action; chez d'autres, c'est la crainte de la sanction C ; chez d'autres encore, ce sont ces deux causes réunies.
§ 165. Les relations que nous avons envisagées entre A, B, C sont élémentaires, mais sont bien loin d'être les seules. Tout d'abord, l'existence de la théorie C réagit sur l'état psychique A, et contribue souvent à le renforcer. Elle agit ainsi sur B en suivant la voie C A B. D'autre part, l'abstention B de faire certains actes réagit sur l'état psychique A, et par conséquent sur la théorie C, en suivant la voie B A C. Puis l'action de C sur B agit sur A et revient ainsi en C. Supposons, par exemple, qu'une sanction C soit jugée excessive pour un délit B. L'application de cette sanction (CB) modifie l'état psychique A, et par l'effet de cette modification, la sanction C est remplacée par une autre moins sévère. Un changement qui vient à se produire dans un état psychique, se manifeste d'abord par une augmentation de certains délits B. Cette augmentation produit une modification de l'état psychique A ; modification qui se traduit par un changement de C.
On peut, jusqu'à un certain point, assimiler le culte d'une religion à B ; sa théologie à C. Toutes deux proviennent d'un certain état psychique A.
§ 166. Considérons certaines actions D (fig. 3), dépendant de cet état psychique A. Le culte B n'agit pas directement sur D, mais sur A et ainsi sur D ; il agit de même aussi sur C, et vice versa, C agit sur B. Il peut aussi y avoir une action directe CD. L'action de la théologie C sur A est ordinairement assez faible ; par conséquent, très faible aussi sur D, puisque l'action CD est de même généralement faible. On commet donc en général une grave erreur, quand on suppose que la théologie C est la cause des actions D. La proposition qu'on émet souvent : « Ce peuple agit ainsi parce qu'il croit cela », est rarement vraie ; elle est presque toujours erronée. La proposition inverse : « Le peuple croit cela parce qu'il agit ainsi », renferme généralement une plus grande somme de vérité ; mais elle est trop absolue et a sa part d'erreur. Il est vrai que les croyances et les actions ne sont pas indépendantes ; mais leur dépendance consiste à être deux branches d'un même arbre (§ 267). Ce sujet sera amplement développé au chapitre XI.
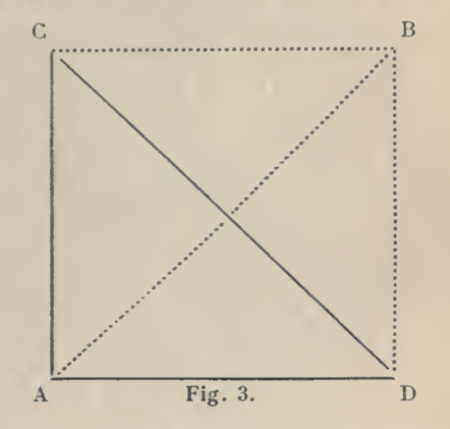
Figure 3
§ 167. Avant l'invasion des dieux de la Grèce, l'ancienne religion romaine n'avait pas de théologie C ; elle se réduisait à un culte B. Mais ce culte B, réagissant sur A, influait fortement sur les actions D du peuple romain. Il y a plus. Quand le rapport direct BD existe, il se présente à nous, modernes, comme manifestement absurde. Mais le rapport BAD pouvait au contraire être en certains cas très raisonnable et utile au peuple romain. En général, la théologie C a sur D une influence directe encore plus faible que sur A. C'est donc une grave erreur que de vouloir estimer la valeur sociale d'une religion, en considérant uniquement la valeur logique et raisonnable de sa théologie (§ 14). Sans doute, si cette dernière devient absurde au point d’agir fortement sur A, de ce fait elle agira fortement aussi sur D. Mais ce cas se présente rarement : ce n'est guère qu'après une modification de l'état psychique A, qu'il arrive aux hommes d'apercevoir certaines absurdités, qui leur avaient tout d'abord entièrement échappé.
Ces observations s'appliquent à toute espèce de théories [FN: § 167-1] . Par exemple, C est la théorie du libre échange ; D est l’adoption pratique du libre échange dans un pays ; A est un état psychique résultant en grande partie des intérêts économiques, politiques, sociaux, des individus et des circonstances dans lesquelles ils vivent. Le rapport direct entre C et D est généralement très faible. Agir sur C pour modifier D ne conduit qu’à des résultats insignifiants. Au contraire, une modification de A peut se répercuter sur C et sur D. On les verra donc changer en même temps, et un observateur superficiel pourra croire que D a été modifié par le changement de C ; mais une étude plus profonde montrera que D et C ne dépendent pas directement l'un de l'autre, mais que tous deux dépendent d'une cause commune A.
§ 168. Les discussions théoriques C ne sont donc pas directement très utiles pour modifier D ; indirectement, elles peuvent être utiles pour modifier A. Mais pour y arriver, il faut recourir aux sentiments beaucoup plus qu'à la logique et aux résultats de l'expérience. Nous exprimerons ce fait d'une manière incorrecte, parce que trop absolue, mais frappante, en disant que, pour agir sur les hommes, les raisonnements ont besoin de se transformer en sentiments.
En Angleterre, de nos jours, la pratique du libre échange B (fig. 3), suivie durant de longues années, a réagi sur l'état A (intérêts, etc.), et renforcé par conséquent cet état psychique ; elle s'est ainsi opposée à l'introduction du protectionnisme. Ce n'est donc pas du tout le fait de la théorie C du libre échange. Maintenant d'autres faits, tels que les nécessités croissantes du fisc, viennent à leur tour modifier A. Ces modifications pourront amener un changement de B et imposer le protectionnisme. En même temps, on verra se modifier C et se développer des théories favorables au nouvel état de choses.
Une théorie C a des conséquences logiques ; un certain nombre de celles-ci se trouvent en B ; d'autres ne s'y trouvent pas. Cela ne pourrait arriver si B était la conséquence directe de C. En ce cas, toutes les conséquences logiques devraient se trouver sans exception en B. Mais comme C et B sont simplement les conséquences d'un certain état psychique A, rien n'exige qu'il y ait entre eux parfaite correspondance logique. Nous ferons donc toujours fausse route, quand nous croirons pouvoir déduire B de C, en établissant cette correspondance. Il faudrait partir de C pour connaître A et en savoir déduire ensuite B. Ici se présentent des difficultés très graves ; et, par malheur, ce n'est qu'en les surmontant qu'on peut espérer acquérir une connaissance scientifique des phénomènes sociaux.
§ 169. Nous ne connaissons pas directement A, mais certaines manifestations de A, telles que C et B, et nous devons remonter de celles-ci vers A. Les difficultés augmentent, parce que si B est susceptible d'observation exacte, C est presque toujours exprimé d'une manière douteuse et sans la moindre précision.
§ 170. Le cas que nous considérons est celui d'une interprétation populaire ou du moins appartenant à une collectivité nombreuse. Un cas semblable sur certains points, mais différent sur beaucoup d'autres, est celui dans lequel C représente une théorie construite par des hommes de science. Quand le raisonnement n'est pas froidement scientifique, C est modifié par l'état psychique des hommes de science qui construisent la théorie. S'ils font partie de la collectivité qui a exécuté les actes B, leur état psychique a quelque chose de commun avec celui des membres de cette collectivité, excepté des cas très rares d'hommes qui s'éloignent des chemins battus. A agit par conséquent sur C. Voilà ce que cet exemple peut avoir de commun avec le précédent.
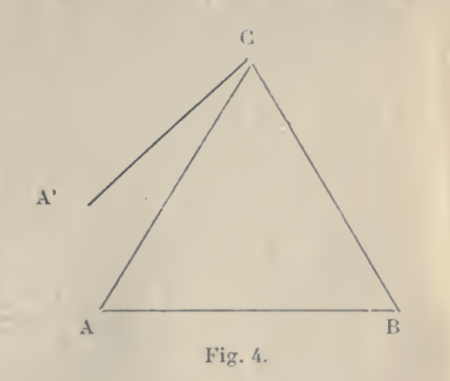
Figure 4
Si les hommes de science font la théorie d'actes accomplis par des hommes qui appartiennent à des collectivités complètement différentes de celle dont ils font partie, soit qu'il s'agisse d'un pays étranger ou d'une civilisation très différente, soit qu'il s'agisse de faits historiques remontant à un lointain passé, l'état psychique A ’ de ces hommes de science n'est pas identique à A ; il peut en différer plus ou moins, être même tout à fait différent, dans certains cas particuliers. Or, c'est cet état psychique qui influe sur C ; par conséquent A ne peut agir sur C que peu ou pas du tout.
Si nous négligeons cette influence de A ou de A ’, nous nous trouvons dans le cas des interprétations purement théoriques des faits B. Si C est un principe rigoureux, précis, s’il est uni à B par un raisonnement logique, sans équivoque d'aucune sorte, nous avons des interprétations scientifiques.
§ 171. Mais la catégorie que nous examinons en renferme d'autres. C peut être un principe douteux, manquant de précision et parfois même de sens expérimental. Il peut, en outre, être uni à B par des raisonnements sans consistance logique, procédant par analogie, faisant appel au sentiment et se perdant en divagations nébuleuses. Nous avons alors des théories de peu ou de point de valeur logico-expérimentale, bien qu'elles puissent avoir une grande valeur sociale (§ 14). Elles sont fort nombreuses, et nous aurons à nous en occuper longuement. Nous touchons ici par induction de nombreux points que nous ne dépasserons pas ; mais nous poursuivrons notre route dans les chapitres suivants, et nous étudierons alors en détail ce que nous effleurons maintenant.
§ 172. Revenons au cas de la figure 3 ; et pour nous familiariser avec cette matière qui n'est rien moins que facile, laissons de côté les abstractions ; examinons un cas concret. De cette manière, nous serons amenés à certaines inductions qui naissent spontanément de l'exposition des faits ; puis nous reviendrons au cas général, et nous continuerons l'étude que nous n'avons fait qu'ébaucher.
Un état psychique très important est celui qui établit et maintient certains rapports entre des sensations ou des faits, par l'intermédiaire d'autres sensations P, Q, R,... Ces sensations peuvent être successives ; c'est probablement une des manières dont se manifeste l'instinct des animaux. Elles peuvent être simultanées ou du moins considérées comme telles, et leur union constitue l'une des forces principales de l'équilibre social.
Ne donnons aucun nom à cet état psychique, pour éviter, si possible, qu'on ne veuille tirer du mot le sens de la chose (§ 119), et continuons à désigner cet état simplement par la lettre A, comme nous avons fait pour un état psychique en général. Il ne faut pas envisager seulement un état statique ; il faut encore considérer un état dynamique. Il est en effet très important de savoir comment se transforme la partie fondamentale des institutions d'un peuple. 1° Elle peut ne changer que difficilement, lentement, avoir une tendance marquée à se conserver identique. 2° Elle peut changer facilement, dans une mesure appréciable, mais de diverses manières ; c'est-à-dire : α ) la forme change aussi facilement que le fond : à nouveau fond, nouvelle forme ; les sensations P, Q, R,... peuvent être séparées facilement, soit parce que la force x qui les unit est faible, soit parce qu'étant considérable, elle est vaincue par une autre force encore plus puissante ; β) le fond change plus facilement que la forme : à nouveau fond, forme ancienne. Les sensations P, Q, R,... se séparent difficilement, soit parce que la force x qui les unit est plus considérable, soit parce qu'étant faible, elle n'entre en lutte avec aucune autre force notable.
Les sensations P, Q, R,... peuvent naître de certaines choses et apparaître ensuite à l'individu comme des abstractions de ces choses, des principes, des maximes, des préceptes, etc. Elles constituent un agrégat. L'étude de la persistance de cet agrégat donnera lieu à de longues et importantes considérations, qui seront développées au chapitre VI, quand nous aurons poussé l'induction assez loin pour pouvoir y substituer la déduction. Pour le moment, il serait prématuré de nous y arrêter longuement.
§ 173. Un observateur superficiel pourra confondre le cas (2 β) avec le premier. Mais il y a, en réalité, des différences radicales entre elles. Les peuples qu'on appelle conservateurs peuvent l'être seulement quant à la forme (cas 2 β), ou bien quant au fond (cas 1). Les peuples dits formalistes peuvent conserver la forme et le fond (cas 1), ou conserver seulement la forme (cas 2 β). Les peuples dont on dit qu'ils se sont cristallisés dans un certain état se rattachent au 1er cas.
§ 174. Quand la force x est très considérable et que la force y qui pousse à innover est très faible ou nulle, nous avons les phénomènes de l'instinct des animaux ; nous nous rapprochons de Sparte, cristallisée dans ses institutions. Quand x est forte, mais que y est également importante, et que les innovations se produisent dans le fond tout en respectant la forme, nous avons un état semblable à celui de Rome ancienne. On s'efforce de changer les institutions en dérangeant le moins possible les unions P, Q, R,... On y parvient en laissant subsister dans la forme, les rapports P, Q, R,... À ce point de vue, on peut considérer le peuple romain comme formaliste, à une certaine époque de son histoire, et l'on peut faire la même observation pour le peuple anglais. La répugnance qu'éprouvent ces deux peuples à innover les rapports formels P, Q, R,... permet aussi de les appeler conservateurs ; mais si l'on fixe son attention sur le fond, on s'apercevra que loin de le conserver, ils le transforment. Chez l'ancien peuple athénien comme chez le peuple français moderne, x est relativement faible. Il est difficile d'affirmer que y était plus intense chez les Athéniens que chez les Romains, chez les Français que chez les Anglais du XVIIe au XIXe siècle. Si les effets se manifestent sous une forme différente, cela dépend plutôt du degré de vigueur de x que de y.
Supposons que chez deux peuples y soit identique et x différente. Quand il innove, le peuple chez lequel x est faible fait table rase des rapports P, Q, R,... et leur en substitue d'autres ; le peuple chez lequel x est intense laisse subsister autant que possible ces rapports, et modifie la signification de P, Q, R.... En outre, on trouvera des survivances moins importantes chez le premier peuple que chez le second. Puisque x est faible, rien n'empêche la disparition des rapports P, Q, R,. regardés comme inutiles ; mais quand x est forte, on les conservera même si on les juge inutiles.
Nous obtenons ces inductions grâce à l'observation des manifestations de l'état psychique A. Pour Rome, les faits abondent. D'abord la religion. Il n'y a plus aucun doute : 1° qu'aux premiers temps de Rome, la mythologie n'existait pas ou était extrêmement pauvre ; 2° que la mythologie classique de Rome n'est, en grande partie, autre chose qu'une forme grecque donnée aux dieux romains, ou une invasion de divinités étrangères. L'ancienne religion romaine consistait essentiellement dans l'association de certaines pratiques religieuses avec les faits et gestes de la vie courante ; c'était le type des associations P, Q, R,. Cicéron put dire [FN: § 174-1] que « toute la religion du peuple romain se divise en culte et en auspices (§ 361), auxquels se sont ajoutées ensuite les prédictions, qui tirent leur origine des explications des présages et des prodiges, données par les interprètes de la Sibylle et les aruspices ».
§ 175. On peut observer de notre temps aussi des types nombreux et variés d'associations P, Q, R,… E. Deschamps [FN: § 175-1] dit, par exemple, qu'à Ceylan, « dans tous les actes de la vie de l'indigène l'astrologue joue son rôle ; on ne saurait rien entreprendre sans son avis et – ajoute-t-il –je me suis souvent vu refuser les moindres services parce que l'astrologue n'avait pas été consulté sur le jour et l'heure favorable pour me les accorder ». Quand on veut défricher et cultiver un terrain, on consulte d'abord l'astrologue, auquel on offre des feuilles de bétel et des noix d'arec [FN: § 175-2]. « (p. 159) Si la prédiction est favorable, les feuilles de bétel et les noix d'arec lui sont renouvelées, un certain jour, et une « heure heureuse » (nakata ) est choisie pour commencer à couper les arbres et les arbustes. Le jour fixé les cultivateurs de la terre déterminée, après avoir pris part au repas de gâteaux et de riz au lait préparés pour cette occasion, sortent, le visage tourné dans la direction propice dénoncée par l'astrologue. Si un lézard de maison vient à crier au moment où ils sortent, ou si, en route, ils rencontrent quelque objet de mauvaise augure, telle une personne portant du bois mort ou des armes blessantes, un serpent-rat en travers du sentier ou un pivert des bois, ils abandonnent la culture de cette terre ou, le plus souvent, n'y vont pas ce jour-là et décident de repartir à une autre nakata. D'un autre côté, s'ils rencontrent des choses agréables, telles qu'une vache à lait ou une femme qui allaite, ils poursuivent avec bonheur et confiance. Quand ils arrivent à la terre, l'heure favorable est attendue. » On met feu aux arbres et aux broussailles. « (p. 160) Laissant quinze ou vingt jours à la terre pour refroidir, une autre nakata est fixée pour le nettoyage complet de la terre... (p. 161) un homme, à une nakata ordonnée par le même astrologue, sème la première poignée de riz comme prélude... » Les oiseaux et la pluie peuvent porter préjudice à la semence. « (p. 161) Pour éloigner ces méfaits, un kéma ou charme appelé nava-nilla (« neuf herbes ? ») est préparé... Si ce kéma se montre inefficace, une espèce particulière d'huile est distillée pour un autre charme... (p. 162) Au temps du sarclage, on a encore recours au même astrologue, qui doit fixer une heure heureuse pour commencer le travail... Quand la saison de la floraison est passée, a lieu la cérémonie de l'aspersion des cinq sortes de laits ». On continue de la même manière pour toutes les opérations successives, jusqu'à ce qu'enfin le riz soit récolté et mis en magasin.
§ 176. On trouve plus ou moins de pratiques semblables, aux origines de l'histoire de tous les peuples [FN: § 176-1]. Les différences sont de quantité, non de qualité. Preller [FN: § 176-2] observe qu'à Rome, à côté du monde des dieux, il y avait une famille d'esprits et de génies. « (p. 65) Tous les phénomènes, toutes les actions qui s'y passent, dans la nature comme dans l'humanité, depuis la naissance jusqu'à la mort, toutes les vicissitudes de la vie et de l'activité humaine, tous les rapports des citoyens entre eux, toutes les entreprises, etc., sont du ressort de ces petits dieux. Ils ne doivent même leur existence qu'à ces mille relations sociales auxquelles ils peuvent s'identifier. » C'étaient, à l'origine, de simples associations d'idées, comme celles que nous trouvons dans le fétichisme, et qui produisirent des agrégats auxquels on donna le nom de divinité ou un autre semblable. Pline [FN: § 176-3] observe justement que le nombre de ces dieux est plus grand que celui des hommes. Quand se développa la tendance à donner un vernis logique aux actions non-logiques, on voulut expliquer pourquoi certains actes s'associent à certains autres, et l'on fit alors remonter les actes du culte à un grand nombre de dieux ; ou bien l'on s'imagina que ces actes étaient la manifestation d'un culte des forces de la nature ou de diverses abstractions.
En réalité, nous avons là un cas semblable à celui du § 175. Par suite de certaines associations d'idées et d'actes, l'état psychique A des Romains (fig. 2) a eu pour conséquence les actes du culte B. Plus tard et en certains cas à cette même époque, cet état psychique s'est manifesté par la considération C, d'abstractions, de forces de la nature, d'attributs de certaines divinités, etc.; puis, de l'existence concomitante de B et de C, on a conclu, mais à tort le plus souvent, que B était conséquence de C.
§ 177. L'interprétation qui voit dans les actes du culte une conséquence de l'adoration de certaines abstractions, qu'elles soient considérées comme des « forces de la nature » ou autrement, est la moins admissible, et doit être absolument rejetée [FN: § 177-1] (§ 158, § 996). Des preuves innombrables démontrent que les hommes procèdent généralement du concret à l'abstrait, et non de l'abstrait au concret [FN: § 177-2] . La faculté d'abstraction se développe avec la civilisation ; elle est très faible chez les peuples barbares. Les théories qui la supposent développée aux origines de la société sont gravement suspectes d'erreur. Les anciens Romains, encore incultes, n'avaient certainement pas une puissance d'abstraction assez développée pour découvrir la manifestation d'une force naturelle, sous chaque fait concret souvent même tout à fait insignifiant. Si cette force d'abstraction avait existé, elle aurait laissé quelque trace dans la langue. Les Grecs, à l'origine, ne la possédaient probablement pas plus que les Romains; mais ils l'acquirent de bonne heure, et lui donnèrent un développement considérable ; aussi leur langue en garde-t-elle une profonde empreinte. Grâce à l'article, ils peuvent substantifier un adjectif, un participe, une proposition entière. Les Latins, ne connaissant pas l'article, ne pouvaient avoir recours à ce moyen, mais en auraient trouvé certainement un autre, s'ils en avaient éprouvé le besoin. Au contraire, c'est un fait bien connu, que la faculté d'employer les adjectifs substantivement est beaucoup plus restreinte en latin qu'en grec et même qu'en français [FN: § 177-3].
Il est probable qu'il y a de l'exagération dans ce que rapporte Saint Augustin [FN: § 177-4], à propos de la multitude des « dieux » romains ; cependant, même si l'on fait une large part à l'exagération, il reste un grand nombre de dieux qui paraissent n'avoir été créés que pour expliquer logiquement l'association de certains actes avec certains autres. En parlant de la conception de l'homme, Varron fait l'énumération des dieux, dit Saint Augustin [FN: § 177-4] . Il commence par Janus, et, passant successivement en revue toutes les divinités qui prennent soin de l'homme, jusqu'à son extrême vieillesse, il clôt la liste par Nenia, qui n'est autre chose que le chant lugubre dont on accompagne les funérailles des vieillards. D'autre part, il énumère des divinités dont le rôle ne concerne pas directement la personne de l'homme, mais les choses qu'il emploie : vivres, vêtements, etc.
§ 178. Gaston Boissier [FN: § 178-1] dit à ce propos : « (p. 5) Ce qui frappe d'abord, c'est de voir combien tous ces dieux sont peu vivants. On n'a pas pris la peine de leur faire une légende, ils n'ont pas d'histoire. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'il faut les prier à un certain moment et qu'ils peuvent alors rendre service. Ce moment passé, on les oublie. Ils ne possèdent pas de nom véritable ; celui qu'on leur donne ne les désigne pas eux-mêmes, il indique seulement les fonctions qu'ils remplissent ». Les faits sont exacts ; l'exposé en est légèrement erroné, parce que l'auteur se place au point de vue des actions logiques. Ces dieux n'étaient pas seulement peu vivants ; ils ne l'étaient pas du tout. Autrefois, c'étaient de simples associations d'actes et d'idées ; ce n'est qu'à une époque relativement moderne qu'ils sont devenus des dieux. (§ 955) « Tout ce qu'on sait d'eux » est ce qu'il suffit de savoir pour ces associations d'actes et d'idées. Quand on dit qu'il faut « les prier » à un certain moment, on donne un nom nouveau à un concept ancien. On s'exprimerait mieux en disant qu'on les invoque, et mieux encore en disant qu'on fait intervenir certaines paroles. Quand, pour empêcher un scorpion de piquer, on prononce le nombre deux (§ 182), dira-t-on qu'on prie le nombre deux, qu'on l'invoque ? Est-il étonnant qu'il n'ait pas une légende, une histoire ?
§ 179. Dans l'Odyssée (X, 304-305), Hermès donne à Ulysse une plante qui doit le préserver des maléfices de Circé. « Elle est noire dans sa racine et semblable au lait, dans sa fleur. Les dieux l'appellent moly. Il est difficile aux mortels de l'arracher ; mais les dieux sont tout-puissants ».
Nous avons là un type pur d'actions non-logiques. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une opération magique, grâce à laquelle on contraint un dieu d'agir ; car, au contraire, ici c'est un dieu qui donne la plante à l'homme. On n'allègue aucun motif pour expliquer l'action de la plante. Supposons qu'au lieu d'une fiction poétique, il s'agisse d'une plante réelle, employée en vue d'un but réel. Une association d'idées se formerait entre cette plante et Hermès, et l'on tenterait de nombreuses explications logiques. On verrait dans cette plante un procédé pour contraindre Hermès à intervenir ; ce qui est une véritable opération magique. Ou bien on y verrait une manière d'invoquer Hermès ; ou encore une forme d'Hermès ; ou l'un des noms d'Hermès; ou une façon de reconnaître les « forces de la nature ». Homère désigne cette plante par l'expression [mots grecs], qu'on peut traduire par remède salutaire. N'est-il pas évident, dira-t-on, qu'il s'agit ici des forces naturelles qu'on invoque pour empêcher les funestes effets des poisons ? Et toute la végétation qu'on peut trouver dans Homère y passerait [FN: § 179-1].
§ 180. L'homme a une si forte tendance à ajouter des développements logiques aux actions non-logiques, que tout lui sert de prétexte pour s'adonner à cette chère occupation. Il y a eu probablement de nombreuses associations d'idées et d'actes, en Grèce comme à Rome ; mais en Grèce, une grande partie a disparu plus tôt qu'à Rome. L'anthropomorphisme grec a transformé de simples associations d'idées et d'actes en attributs divins. Gaston Boissier dit [FN: § 180-1] :
« (p. 4) Sans doute on a éprouvé dans d'autres pays le besoin de mettre les principaux actes de la vie sous la protection divine, mais d'ordinaire on choisit pour cet office des dieux connus puissants, éprouvés, afin d'être sûr que leur concours sera efficace. C'est la grande Athéné, c'est le sage Hermès qu'on invoque en Grèce, pour que l'enfant devienne habile et savant. À Rome on a préféré des dieux spéciaux, créés pour cette circonstance même et qui n'ont pas d'autre usage ».
Les faits sont exacts ; mais l'exposé est complètement erroné ; toujours parce que l'auteur voit les faits sous l'aspect d'actions logiques. Il s'exprime comme celui qui, voulant expliquer les déclinaisons de la grammaire latine, dirait: « Sans doute on a éprouvé, dans d'autres pays, le besoin de distinguer le rôle des substantifs et des adjectifs dans la proposition, mais d'ordinaire on choisit pour cet office des prépositions, etc. » Non, les peuples n'ont pas choisi leurs dieux, pas plus que les formes grammaticales de leur langue. Les Athéniens n'ont pas délibéré pour savoir s'ils devaient mettre l'enfant sous la protection d'Hermès et d'Athéna, pas plus que les Romains n'ont choisi pour cet office, après mûre réflexion, Vaticanus, Fabulinus, Educa, Potina, etc.
§ 181. Peut-être observons-nous simplement, en Grèce, un état postérieur à celui qu'on remarque à Rome, dans l'évolution qui fait passer du concret à l'abstrait, du non-logique au logique ; peut-être l'évolution a-t-elle été différente dans les deux pays ? Le manque de documents ne nous permet pas de l'établir avec certitude. En tout cas – et c'est ce qui nous importe dans l'étude que nous faisons ici – à l'époque historiqué, les stades de l'évolution sont différents à Athènes et à Rome.
§ 182. Une très remarquable persistance des associations d'idées et d'actes est celle qui semble accorder un pouvoir occulte aux mots sur les choses [FN: § 182-1] .
Même à une époque aussi récente que celle de Pline le Naturaliste, on pouvait lire [FN: § 182-2] :
« Au sujet des remèdes fournis par l'homme, il s'élève d'abord une grande question toujours pendante : les paroles et les charmes magiques ont-ils quelque puissance ? S'ils en ont, il conviendra de les rapporter à l'homme. Consultés en particulier, les gens les plus sages n'en croient rien ; et cependant, en masse, les actes de tous les instants impliquent, sans qu'on s'en aperçoive, la croyance à cette puissance [FN: § 182-3] . [Pline se montre ici excellent observateur, et décrit très bien une action non-logique.] Ainsi, on pense que sans une formule de prière, il serait inutile d'immoler des victimes, et que les dieux ne pourraient être convenablement consultés [FN: § 182-4] . De plus, il y a des paroles diverses, les unes d'impétration, les autres de dépulsion (Littré), d'autres de recommandation [FN: § 182-5]. Nous avons vu que des personnes revêtues de magistratures souveraines ont prononcé des formules déterminées : pour n'omettre ou ne transposer aucun mot, un homme prononce la formule qu'il lit sur le rituel, un autre est préposé pour suivre toutes les paroles, un autre est chargé de faire observer le silence, un musicien joue de la flûte pour qu'aucune autre parole ne soit entendue ; et ces deux faits remarquables sont consignés, à savoir : que toutes les fois qu'un sacrifice a été troublé par des imprécations, ou que la prière a été mal récitée, aussitôt le lobe du foie ou le cœur de la victime a disparu ou a été doublé, sans que la victime ait bougé. On conserve encore, comme un témoignage immense, la formule que les Décius, père et fils, prononcèrent en se dévouant [FN: § 182-6] . On a la prière récitée par la vestale Tuccia, lorsque, accusée d'inceste, elle porta de l'eau dans un crible, l'an de Rome 609. Un homme et une femme, Grecs d'origine ou de quelqu'une des autres nations avec qui nous étions alors en guerre, ont été enterrés vivants dans le marché aux bœufs ; et cela s'est vu même de notre temps. La prière usitée dans ce sacrifice, laquelle est récitée d'abord par le chef du collège des Quindécemvirs, arrachera certainement à celui qui la lira l'aveu de la puissance de ces formules, puissance confirmée par huit cent trente ans de succès. Aujourd'hui, nous croyons que nos vestales retiennent sur place, par une simple prière, les esclaves fugitifs qui ne sont point encore sortis de Rome. Si l'on admet cela, si l'on pense que les dieux exaucent quelques prières ou se laissent ébranler par ces formules, il faut concéder le tout [FN: § 182-7] . »
Pline continue en invoquant la conscience, – non pas la raison ; c'est-à-dire qu'il met fort bien en lumière le caractère non-logique des actions.
« (5,1) Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je veux en appeler au sentiment intime de chacun. Pourquoi, en effet, nous souhaitons-nous réciproquement une heureuse année au premier jour de l'an ? Pourquoi, dans les purifications publiques, choisit-on pour conduire les victimes des gens porteurs de noms heureux ?... Pourquoi croyons-nous que les nombres impairs ont pour toute chose plus de vertu [FN: § 182-8] , vertu qui se reconnaît dans les fièvres à l'observation des jours ?... Attale (Philométor) assure que si en voyant un scorpion on dit deux, [Voir Addition A4 par l’auteur] l'insecte s'arrête, et ne pique point [FN: § 182-9] . »
§ 183. Ces actes, grâce auxquels les mots agissent sur les choses, appartiennent à ce genre d'opérations que le langage courant désigne d'une manière peu précise, par le terme d'opérations magiques. Un type extrême est celui de certaines paroles et de certains actes qui, par une vertu inconnue, ont le pouvoir de produire certains effets. Puis, une première couche de vernis logique explique ce pouvoir par l'intervention d'êtres supérieurs, de dieux. En suivant cette voie, on atteint l'autre extrême, qui est celui d'actes entièrement logiques ; par exemple, la croyance qu'on avait, au moyen-âge, que l'être humain qui vendait son âme à Satan acquérait le pouvoir de nuire à autrui.
Quand on ne conçoit que des actions logiques, et qu'on rencontre des phénomènes semblables à ceux de tout à l'heure, on les omet, on les dédaigne, on les considère comme des états pathologiques et l'on passe outre sans plus s'en préoccuper. Mais quand on sait quel rôle jouent les actions non-logiques, dans la vie sociale, on s’astreint à les étudier aussi avec soin.
Le lecteur observera qu'en ce cas comme en d'autres, notre induction atteint le seuil de certaines études que nous devrons ensuite reprendre longuement. Dans ce chapitre-ci, nous marcherons encore à tâtons, en cherchant à découvrir la voie qui nous permettra de trouver la forme et la nature de la société humaine.
§ 184. Supposons qu'on ne connaisse que les faits qui font dépendre le succès des opérations magiques, de l'intervention du démon. Nous pourrions accepter comme vraie l'interprétation logique, et dire : « Les hommes croient à l'efficacité des opérations magiques, parce qu'ils croient au démon. » Cette conclusion ne serait pas modifiée profondément par la connaissance d'autres faits qui substitueraient une divinité quelconque au démon. Mais elle est réduite à néant, si nous connaissons des faits absolument indépendants de toute intervention divine. Nous voyons alors que, dans ces phénomènes, l'important consiste en actions non-logiques qui unissent certaines paroles, certaines invocations, certaines pratiques, à des effets désirés [FN: § 184-1] , et que l'intervention des dieux, des démons, des esprits, etc., n'est que la forme logique donnée à ces faits. Nous avons de nouveau un des nombreux faits envisagés au § 162. La forme logique sert à unir C à B.
Notons que, le fond restant intact, plusieurs formes peuvent coexister chez un même individu, sans que ce dernier ait conscience de la part qui revient à chacune. La magicienne de Théocrite compte sur l'intervention des dieux et sur l'efficacité des pratiques magiques, sans bien distinguer comment agissent ces deux puissances. Elle demande à Hécate de rendre les philtres qu'elle a préparés pires que ceux de Circé, de Médée ou de la blonde Périmède [FN: § 184-2]. Si elle ne comptait que sur l'intervention de la divinité, il serait plus simple qu'elle lui demandât directement le résultat qu'elle attend des philtres. Quand elle répète le refrain: « [mot grec] [Oiseau magique], attire cet homme vers ma demeure », elle a évidemment en vue un certain rapport occulte entre l'oiseau magique et l'effet désiré.
Les gens crurent pendant des siècles et des siècles à de semblables fables, présentées sous des formes diverses, et même aujourd'hui, il y a des gens qui les prennent au sérieux. Seulement, depuis deux ou trois siècles, le nombre s'est accru, des gens qui en rient comme en riait déjà Lucien [FN: § 184-3]. Mais les faits du spiritisme, de la télépathie, de la Christian science (§ 1965-1] ) et autres semblables suffisent à faire voir quel empire ont encore ces sentiments et d'autres analogues.
§ 185. « Ton bœuf ne mourrait pas si tu n'avais un mauvais voisin [FN: § 185-1] », dit Hésiode ; mais il n'explique pas comment ce fait a lieu. Les lois des XII Tables parlent de « celui qui jettera un sortilège contre les moissons... » [FN: § 185-2] et de « celui qui prononcera un maléfice... », mais sans expliquer en quoi consistent exactement ces opérations. Cette forme d'actions non-logiques subsista pourtant à travers les siècles, et se manifeste encore de nos jours par la foi aux amulettes. Dans le Napolitain, nombreux sont ceux qui portent une corne de corail suspendue à leur chaîne de montre, pour se préserver du mauvais œil. Beaucoup de joueurs possèdent des amulettes ou exécutent certains actes qu'ils estiment capables de les faire gagner [FN: § 185-3] .
§ 186. Bornons-nous à examiner une seule des actions non-logiques : celle de provoquer ou d'empêcher les orages et de détruire ou de préserver les récoltes. Laissons de côté ce qui se rapporte à des pays étrangers au monde gréco-latin, pour éviter le doute qui règne, quand on prend au hasard les faits un peu partout, et qu'on les réunit artificiellement. Nous étudierons simplement un phénomène et ses variétés, dans le monde gréco-latin, en citant quelques faits étrangers.
Justement parce qu'ils n'excitent plus les sentiments, qui troubleraient l'œuvre objective que nous voulons accomplir, nous choisirons comme premier exemple une catégorie de faits qui, aujourd'hui du moins, ont peu d'importance sociale. Ces sentiments sont les pires ennemis que rencontre l'étude scientifique de la sociologie. Malheureusement, nous ne réussirons pas toujours à les éviter complètement. Il faudra que le lecteur lui-même s'efforce d'éloigner cette cause d'erreur.
La méthode que nous suivons pour la catégorie de faits que nous étudions maintenant est identique à celle que nous emploierons pour d'autres catégories semblables. Les phénomènes de cette catégorie constituent une famille naturelle, semblable à celle des papilionacées en botanique. On peut facilement les reconnaître et les grouper. Leur nombre est considérable ; aussi nous est-il impossible de les rappeler tous ; mais nous parlerons au moins des types principaux.
§ 187. Nous avons beaucoup de cas dans lesquels des gens croient pouvoir susciter ou éloigner des ouragans, grâce à certaines pratiques. Parfois on ne sait pas comment se produit cet effet, qu'on présente comme donné par l'observation ; d'autrefois, on expose des soi-disant motifs, et l'on tient l'effet pour une conséquence théoriquement explicable de l'action de certaines forces. En général, ou suppose que les phénomènes météorologiques sont placés sous la dépendance de certaines pratiques, soit directement, soit indirectement, grâce à l'intervention de puissances supérieures.
§ 188. Pallas donne des préceptes sans commentaires. Columelle ajoute un brin d'interprétation logique, en disant que l'usage et l'expérience en ont enseigné l'efficacité [FN: § 188-1]. Longtemps auparavant, selon Diogène Laërce (VIII, 59), Empédocle se vantait de commander à la pluie et aux vents. D'après Timée (loc. cit. 60), un jour que les vents soufflaient avec violence et menaçaient de détruire les récoltes, il fit faire des outres de peau d'âne et les envoya porter sur les montagnes. De cette manière, les vents, emprisonnés dans ces outres, cessèrent de souffler. Suidas rend cette interprétation un peu moins absurde, en disant qu'Empédocle plaça des peaux d'âne tout autour de la ville. Plutarque (adv. Colot.) donne des interprétations moins invraisemblables, bien que toujours telles, lorsqu'il dit qu'Empédocle a délivré une contrée de la stérilité et de la peste, en fermant les gorges des montagnes, par lesquelles les vents soufflaient dans la plaine. Il répète à peu près la même chose ailleurs (De curios.), mais seulement à propos de la peste. Clément d'Alexandrie [FN: § 188-2] dit qu'Empédocle fit cesser un vent qui rendait les habitants malades et les femmes stériles ; et là paraît un élément nouveau, puisque ce fait serait une contrefaçon faite par les Grecs, des miracles israélites ; ce qui nous donne ainsi une interprétation théologique.
§ 189. Il est évident que nous avons là comme un tronc duquel partent de nombreuses ramifications : un élément constant et beaucoup d'interprétations différentes. Le tronc, l'élément constant est la croyance qu'Empédocle a empêché les vents de nuire à une contrée ; les ramifications, les interprétations sont les conceptions différentes de la manière dont cet effet s'est produit ; naturellement elles dépendent des inclinations des auteurs dont elles émanent. L'homme pratique se met à la recherche de raisons pseudo-expérimentales ; le théologien, de causes théologiques.
Dans Pausanias, on trouve pêle-mêle les explications pseudo-expérimentales, magiques, théologiques. Notre auteur écrit, à propos d'une statue d'Athéna Anémotide, élevée à Mothone (IV, 35) : « On dit que c'est Diomède qui éleva la statue et donna un nom à la déesse. Les vents les plus violents, soufflant hors de saison, dévastaient la contrée. Diomède adressa des prières à Athéna ; dès lors, la terre ne subit plus aucun dommage des vents. » Ailleurs (II, 12): «. Au pied de la colline (puisque le temple a été édifié au sommet), se trouve l'autel des vents, sur lequel, une nuit chaque année, le prêtre sacrifie aux vents. Il accomplit aussi d'autres cérémonies secrètes, dans quatre fosses, afin d'apaiser la fureur des vents ; il chante encore des paroles magiques qui viennent, dit-on, de Médée. » Plus loin (II, 34) : « Je relève encore, chez les Métaniens, ce fait qui m'étonne beaucoup. Le siroco, soufflant du golfe de Saronique sur les vignes qui bourgeonnent, en dessèche les boutons. Aussi, dès que le vent se lève, deux hommes, après avoir dépecé un coq entièrement blanc, courent autour des vignes, chacun portant une moitié du coq ; arrivés au lieu dont ils sont partis, ils les enterrent. Tel est le procédé que ces gens ont découvert. »
Mais il y a mieux encore. Quand les tempêtes abîmaient les moissons, on punissait ceux qui étaient chargés de les éloigner (§ 194).
Pomponius Mela [FN: § 189-1] parle de neuf vierges qui habitaient l'île de Séna et qui pouvaient, par leurs chants, déchaîner la mer et les vents. [Voir Addition A5 par l’auteur]
§ 190. De ce noyau d'interprétations des actions non-logiques, se détache une ramification qui aboutit à la divinisation des tempêtes. Cicéron (De nat. deor., III, 20, 51) fait objecter par Cotta à Balbus que le ciel, les astres et les phénomènes météorologiques multiplient le nombre des dieux. Ici, ce cas reste isolé ; ailleurs il se subdivise et donne lieu à de nombreuses interprétations, à des personnifications, à des explications [FN: § 190-1]. [Voir Addition A6 par l’auteur]
§ 191. Commander aux vents et aux tempêtes devient un signe de puissance intellectuelle ou spirituelle, comme chez Empédocle, ou de divinité comme chez le Christ, quand il fait taire la tempête [FN: § 191-1] . Les magiciens, les sorciers manifestent ainsi leur pouvoir ; et l'anthropomorphisme grec connaît les maîtres des vents, des tempêtes, de la mer.
§ 192. On sacrifiait aux vents. Le sacrifice n'est qu'un développement logique d'une action magique semblable à celle dont nous avons parlé tout à l'heure, à propos du coq blanc. Il suffit, en effet, pour transformer cette action en sacrifice, d'ajouter que le dépeçage du coq blanc est un sacrifice à une divinité. Virgile [FN: § 192-1] fait sacrifier une brebis noire à la Tempête, une blanche au Zéphyr favorable. Remarquez les éléments de cette opération : 1° Élément principal : l'idée que moyennant certains actes on peut agir sur la tempête et sur les vents ; 2° Élément secondaire : explication logique de ces actes, grâce à l'intervention d'une entité imaginaire (personnification du vent, divinité, etc.); 3° Élément encore plus accessoire : détermination des actes, au moyen de certaines ressemblances entre la brebis noire et la tempête, la brebis blanche et le vent favorable.
§ 193. Les vents protégèrent les Grecs contre l'invasion perse et, pour les remercier, les Delphiens leur élevèrent un autel à Tia [FN: § 193-1] . On sait que Borée, gendre des Athéniens [FN: § 193-2] par son mariage avec Orestie, fille d'Érechthée, dispersa la flotte perse, et mérita ainsi l'autel que les Athéniens lui élevèrent au bord de 1'Ilyssus. Cet excellent Borée protégeait aussi d'autres gens que les Athéniens. Il détruisit, la flotte de Denys, qui avait pris la mer pour attaquer les Tyriens [FN: § 193-3] . « C'est pourquoi les Tyriens sacrifièrent à Borée, décrétèrent que le vent était citoyen [de la ville], lui réservèrent une maison et un champ, et célèbrent chaque année une fête en son honneur. » Il sauva aussi les Mégalopolitains assiégés par les Lacédémoniens ; aussi les premiers lui sacrifient-ils chaque année, et l'honorent-ils autant que tout autre dieu [FN: § 193-4] .
Les Mages de la Perse connaissaient, eux aussi, l'art d'apaiser les vents. À propos de la tempête suscitée par Borée pour venir en aide aux Athéniens, et qui infligea de graves dommages à la flotte perse, Hérodote dit : « La tempête sévit trois jours. À la fin, lorsque les Mages eurent sacrifié des victimes et conjuré les vents par la magie, et qu'ils eurent en outre sacrifié à Thétis et aux Néréides, les vents tombèrent le quatrième jour, si ce n'est spontanément. » Ce doute d'Hérodote est remarquable [FN: § 193-5] .
§ 194. On trouve souvent chez les auteurs anciens l'idée que la magie peut susciter la pluie, la tempête et le vent [FN: § 194-1]. Sénèque traite longuement des causes des phénomènes météorologiques, et se moque des opérations magiques [FN: § 194-2] . Il n'admet pas la prévision du temps par l'observation ; ce n'est pour lui qu'un préparatif aux pratiques suivies pour éloigner le mauvais temps. Il raconte qu'à Kléones, il y a des officiers publics appelés observateurs de la grêle. Sitôt qu'ils annonçaient l'approche de l'ouragan, les habitants couraient au temple et sacrifiaient, qui un agneau, qui un poulet ; et les nuages s'en allaient ailleurs. Celui qui n'avait rien à sacrifier se piquait le doigt et versait un peu de sang. «(7) On a cherché la raison de ce phénomène. Les uns, comme il convient à des hommes très savants, nient qu'il soit possible de marchander avec la grêle et de se racheter de la tempête moyennant de petites offrandes, bien que les offrandes fléchissent les dieux mêmes. D'autres supposent qu'il y a dans le sang quelque force capable d'éloigner les nuages. Mais comment, dans une si petite goutte de sang, peut-il y avoir une force assez grande pour agir là-haut et influencer les nuages ? Combien il valait mieux dire : C'est un mensonge et une fable ! Mais à Kléones, on punissait ceux auxquels était confié le soin de prévoir les tempêtes, lorsque, par leur négligence, les vignes étaient frappées et les moissons abattues. Chez nous, les XII Tables défendent qu'on prononce des incantations contre les récoltes d'autrui. L'antiquité inculte croyait que les chants magiques attiraient les nuages et les éloignaient ; ce qui est si clairement impossible, qu'il est inutile d'entrer dans une école philosophique pour l'apprendre ». Mais peu d'auteurs font preuve du scepticisme de Sénèque ; aussi avons-nous une longue suite de légendes sur les orages et les vents, qui persiste jusqu'à une époque voisine de la nôtre.
§ 195. Les légions romaines conduites par Marc-Aurèle contre les Quades, eurent à souffrir du manque d'eau ; mais un ouragan survint entre temps pour les rafraîchir. Le fait semble certain. Nous n'avons pas à rechercher ici si la légion Fulminée tira son nom de cet ouragan ; cela ne nous importe nullement pour le but que nous voulons atteindre. Et si même l'histoire de l'ouragan n'était pas vraie, l'exemple nous servirait comme avant, puisque nous traitons non du fait lui-même, mais des sentiments manifestés par les histoires, vraies ou fausses, que nous en possédons.
On veut expliquer le comment et le pourquoi de cet ouragan ; et chacun le fait suivant ses sentiments, ses inclinations. Ce peut être l'effet d'opérations magiques. On connaît même le nom du sorcier. Dans ces cas, l'extrême précision ne coûte pas cher. Suidas [FN: § 195-1] l'appelle Arnouphis: « Philosophe égyptien qui, se trouvant avec l'empereur des Romains, Marc-Aurèle, le philosophe, quand les Romains souffraient de la soif, fit immédiatement rassembler des nuages noirs et tomber une forte pluie, accompagnée de tonnerres et de fréquents éclairs ; et cela, il le fit avec sa science. D'autres disent que ce prodige fut accompli par Julien le Chaldéen ». Les dieux païens peuvent bien intervenir. Sinon à quoi passeraient-ils leur temps dans le monde ? Dion Cassius (LXXI, 8) dit que les Romains, serrés de près par les Quades, souffraient terriblement de la chaleur et de la soif ; « tout d'un coup de nombreux nuages se rassemblèrent, et, non sans l'intervention divine, une grosse pluie s'abattit avec violence. Donc, on raconte qu'un magicien égyptien du nom d'Arnouphis, qui se trouvait avec Marc, invoqua par la magie plusieurs divinités [FN: § 195-2] et principalement Hermès Aérien ; il fit, par ce moyen, tomber la pluie. » Claudien [FN: § 195-3] croit que l'ennemi fut mis en fuite par une pluie de feu. Pour quelle raison ? Les pratiques magiques ou la faveur de Jupiter Tonnant. Capitolinus [FN: § 195-4] sait que Marc-Antonin « dirigea par ses prières le feu du ciel contre les machines de guerre des ennemis, et obtint la pluie pour ses soldats qui souffraient de la soif ».
Ce fait de la tempête qui, par la puissance de la magie ou la sympathie divine, favorise un des belligérants, se rencontre dans des pays lointains et des conditions telles que tout soupçon d'imitation est exclu [FN: § 195-5].
Chez Lampride [FN: § 195-6] , le fait se transforme de nouveau et revêt un autre aspect. Marc-Antonin avait réussi, par certains procédés magiques, à rendre les Marcomans amis des Romains ; on ne veut pas révéler ces procédés à Héliogabale, par crainte qu'il ne veuille susciter une nouvelle guerre. Finalement, les chrétiens revendiquent le miracle pour leur Dieu. Après le passage de Dion Cassius que nous venons de citer, Sifilinus [FN: § 195-7] ajoute que cet écrivain induit en erreur son lecteur, volontairement ou involontairement, mais plutôt volontairement. Il n'ignorait pas en effet l'existence de la légion Fulminante [ou Fulminée ], à laquelle l'armée dut son salut, et non au magicien Arnouphis. Voici la vérité. Marc-Aurèle avait une légion composée entièrement de chrétiens. Pendant le combat, le préfet du Prétoire vint dire à Marc-Aurèle que les chrétiens pouvaient tout obtenir par leurs prières, et qu'il y avait une légion chrétienne dans l'armée. « Marc ayant donc entendu cela, leur demanda de prier leur Dieu. Quand ils l'eurent fait, Dieu les exauça incontinent, et frappa les ennemis de la foudre, tandis qu'il réconforta les Romains par la pluie. » Sifilinus ajoute encore qu'il existe, à ce qu'on dit, une lettre de Marc-Antonin, sur ce fait. D'autres auteurs font aussi allusion à cette lettre, inventée par des gens plus pieux que véridiques ; et l'on va même jusqu'à nous en donner le texte authentique, dans les œuvres de Saint Justin martyr [FN: § 195 note 8].
§ 196. Ainsi croît et embellit la légende, qui approche du roman ; mais les enjolivures extérieures n'augmentent pas seules : les idées fondamentales se multiplient aussi. Le noyau est un concept mécanique ; [Voir Addition A7 par l’auteur] c'est-à-dire qu'on prononce certaines paroles, on fait certaines opérations, et la pluie tombe. Puis vient le besoin d'expliquer ce prodige. La première explication suppose l'action d'êtres surnaturels. Mais on éprouve aussi le besoin d'expliquer leur intervention, et voilà une seconde explication. Celle-ci se subdivise à son tour suivant les motifs que l'on suppose à cette intervention. Parmi ceux-ci apparaît principalement le motif éthique. On introduit ainsi un nouveau concept qui manquait entièrement à l'opération magique. Le nouveau concept élargit à son tour l'action. La pluie était le but de l'opération magique ; elle devient le moyen par lequel la puissance divine récompense ses protégés et frappe leurs ennemis ; ensuite, c'est aussi le moyen de récompenser la foi et la vertu. Enfin, du cas particulier, on passe au général. On ne traite plus d'un fait isolé, mais de faits multiples, d'après une norme commune. Ce passage s'effectue déjà dans Tertullien [FN: § 196-1] . Après avoir rappelé le fait de la pluie obtenue par les soldats de Marc-Aurèle, il ajoute : « Combien de fois n'avons-nous pas fait cesser la sécheresse par nos prières et nos jeûnes ? »
On pourrait rapporter d'autres faits analogues, qui montrent que les sentiments dont ils proviennent sont très communs dans la race humaine [FN: § 196 note 2|. [Voir Addition A8 par l’auteur]
§ 197. Chez les auteurs chrétiens, il est naturel que les explications logiques de la loi générale des tempêtes aboutissent au démon. Clément d'Alexandrie [FN: § 197-1] nous apprend que les mauvais anges jouent un rôle dans les tempêtes et autres semblables calamités (§ 188 note 2). Mais prenons garde que c'est là une adjonction servant d'explication au noyau principal ; c'est-à-dire à la croyance que, moyennant certaines pratiques, on peut agir sur les tempêtes et sur d'autres calamités semblables[FN: § 197-2]. [Voir Addition A9 par l’auteur]
Pour faire triompher ses interprétations, le christianisme victorieux eut à lutter d'abord avec les anciennes pratiques païennes [FN: § 197-3], puis avec la magie, qui continua une partie de ces pratiques et en imagina de nouvelles ; car on avait grand besoin d'éviter les ouragans, et la croyance était tenace, qu'il y avait des procédés pour cela. Aussi, d'une façon ou d'une autre, on pourvoyait au besoin et l'on satisfaisait la croyance.
§ 198. Au moyen âge, on appelait Tempestarii ceux qui avaient ce pouvoir. Les lois même s'occupent d'eux. Toutefois l'Église n'admit pas de plein gré ce pouvoir de provoquer les tempêtes. Le concile de Braga, en 563, anathématise quiconque enseigne que le diable peut provoquer le tonnerre, les éclairs, la tempête et la sécheresse. Un décret célèbre dénie toute réalité aux imaginations des sorcières [FN: § 198-1]. Saint Agobard écrivit un livre entier Contre la sotte opinion du vulgaire sur la grêle et les tonnerres. Il dit [FN: § 198-2] « (1) Dans cette contrée, presque tout le monde, nobles et vilains, citadins et campagnards, jeunes et vieux, croient que les hommes peuvent provoquer la grêle et les tonnerres selon leur volonté. Aussi s'écrient-ils, sitôt qu'ils entendent le tonnerre et voient des éclairs : « C'est une brise lévatice ». Interrogés sur ce qu'est la « brise lévatice », ils affirment, les uns avec réserve et comme s'ils en avaient du remords, d'autres avec l'assurance habituelle des ignorants, que la brise est levée par les sortilèges d'hommes appelés Tempestarii, et que c'est pour cela qu'ils disent la brise lévatice... (2) Nous vîmes et nous entendîmes beaucoup de gens atteints d'une si grande folie, et mis hors de sens par une si grande sottise, qu'ils croient et disent qu'il est une certaine contrée qu'ils nomment Magonie, dont viennent, par-dessus les nuages, des navires qui y rapportent les moissons que fauche la grêle et qu'abat la tempête ; les Tempestarii sont payés par ces navigateurs aériens qui reçoivent le blé et les autres récoltes. Nous avons vu beaucoup d'hommes, aveuglés par une si grande sottise, qu'ils croyaient cela possible, et montraient dans une assemblée quatre personnes chargées de chaînes, soit trois hommes et une femme, soi-disant tombés de ces navires. Après les avoir gardés enchaînés quelques jours, enfin, quand l'assemblée fut réunie, ainsi que je l'ai dit, on les exhiba en notre présence, comme s'ils devaient être lapidés. Toutefois, après de nombreuses explications, la vérité l'emporta, et les exhibiteurs mêmes restèrent, suivant l'expression du prophète, confondus comme le voleur pris sur le fait. » En citant l'Écriture Sainte, Saint Agobard démontre l'erreur de la croyance d'après laquelle la grêle et le tonnerre sont soumis au caprice de l'homme. En citant aussi l'Écriture Sainte, d'autres démontreront au contraire que cette croyance mérite l'attention. De tout temps, on a trouvé dans la Bible des preuves contradictoires.
§ 199. Les doctrines qui admettaient le pouvoir des sorcières étaient suspectes à l'Église pour deux motifs. Tout d'abord, elles apparaissaient comme une réminiscence du paganisme, aux dieux duquel on assimilait les démons ; ensuite, elles prenaient une teinte de manichéisme, en opposant le principe du mal au principe du bien. Mais, sous la pression des croyances populaires par lesquelles se manifestait l'action non-logique des pratiques magiques, l'Église finit par subir ce qu'elle ne pouvait empêcher, et trouva sans peine une interprétation qui satisfaisait le préjugé populaire, sans heurter les principes de la théologie catholique. En somme, que voulait-elle ? Que le principe du mal fût soumis au principe du bien. C'est bientôt fait. Nous dirons, il est vrai, que la magie est œuvre du diable, mais nous ajouterons : avec la permission de Dieu. Cette doctrine demeurera définitivement celle de l'Église catholique.
§ 200. Les préjugés populaires pesaient non seulement sur l'Église, mais aussi sur les gouvernements; et les gouvernements, sans trop se soucier d'interprétations logiques, procédaient au châtiment de toute sorte de sorciers, y compris les Tempestarii [FN: § 200-1].
§ 201. Quand existe un certain état de faits et de croyances, il est rare qu'il ne se trouve personne pour tâcher d'en profiter; aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si les particuliers, les gouvernements et l'Église s'efforcèrent de tirer parti des croyances à la sorcellerie. Saint Agobard rapporte qu'on payait un tribut aux Tempestarii [FN: § 201-1] ; et Charlemagne recommande à ses sujets de payer régulièrement les dîmes à l'Église, pour sauver les moissons[FN: § 201-2].
§ 202. Au moyen âge et dans les siècles suivants, les accusations de provoquer des tempêtes et de détruire les moissons surabondent contre les sorciers. Pendant nombre de siècles, les hommes vécurent dans la terreur du démon. Quand ils en parlaient, ils semblaient frappés d'aliénation mentale et, à l'instar des gens déséquilibrés, semaient des morts et des ruines.
§ 203. Le Malleus maleficarum résume bien la doctrine en cours au XVe siècle elle datait d'un siècle environ, et persista près d'un siècle encore [FN: § 203-1] .
« Les démons et leurs disciples peuvent produire les maléfices des tonnerres, des grêles et des tempêtes, ayant reçu ce pouvoir de Dieu, et par sa permission. Cela est prouvé par l'Écriture Sainte, Job, 1 et 2... Saint Thomas, dans une note sur Job, s'exprime ainsi : « Il est nécessaire de reconnaître qu'avec la permission de Dieu, les démons peuvent produire des perturbations dans l'air, susciter des tempêtes et faire tomber le feu du ciel. Bien que pour prendre des formes, la nature corporelle n'obéisse à la volonté ni des bons ni des mauvais anges, mais seulement à Dieu créateur, toutefois, pour le mouvement local, elle est capable d'obéir à la nature spirituelle. Cela se voit chez les hommes, car, sous le seul empire de la volonté, qui est subjective dans l'âme, ils meuvent leurs membres, pour leur faire accomplir les œuvres imposées par la volonté. Donc, par force naturelle, non seulement les bons, mais aussi les mauvais anges, si Dieu ne le défend pas, peuvent faire toutes les choses susceptibles d'être produites par le seul mouvement local ».
Cette dissertation sur le pouvoir des démons continue, et l'on en donne enfin un exemple. Dans le Fourmilier, on raconte que, mis en prison par le juge, un individu auquel on demandait comment les sorciers procédaient pour susciter la grêle et les tempêtes, et si cela leur était facile, répondit : « Nous suscitons facilement la grêle, mais nous ne pouvons pas nuire selon notre volonté, à cause de la protection des bons anges ». Il ajouta:
« Nous pouvons nuire seulement à ceux qui sont privés de l'aide de Dieu, mais nous ne pouvons pas nuire à ceux qui s'aident du signe de la croix. La façon dont nous agissons est la suivante. D'abord, par des paroles magiques sur les champs, nous implorons le prince de tous les démons, afin qu'il nous envoie quelqu'un des siens, qui frappe là où nous indiquons. Ensuite, pour avoir la grâce de ce démon, nous lui immolons un poulet noir dans un carrefour, et, le lançant en l'air, il est pris par le démon, qui obéit et qui aussitôt excite la tempête et fait tomber la grêle et le tonnerre, cependant pas toujours là où nous avons indiqué, mais selon la permission de Dieu ».
L'auteur continue et rapporte d'autres cas aussi certains qu'admirables. Nous parlerons brièvement d'un seul d'entre eux, raconté dans une autre partie de l'ouvrage.
Les filles des sorcières opèrent souvent comme leur mère [FN: § 203-2] . « Ainsi, il peut arriver, et l'on a souvent observé, qu'une enfant impubère de 8 ou 10 ans a suscité des tempêtes et fait tomber la grêle ». Et l'auteur en rapporte un exemple: « En Souabe, un paysan, avec sa fille de 8 ans à peine, se désolait en voyant les moissons dans les champs, et la sécheresse de la terre lui faisait penser à la pluie ; il la désirait, disant : Eh ! Quand viendra la pluie,? L'enfant, entendant les paroles du père, dit, en la simplicité de son âme : Père, si tu désires la pluie, je la ferai vite venir. Et le père : Comment, tu sais faire venir la pluie ? L'enfant répondit : Certes ; et non seulement je sais susciter la pluie, mais aussi la grêle et les tempêtes. Le père : Qui te l'a enseigné ? Ma mère, répondit-elle ; mais elle m'a défendu de l'enseigner à d'autres ». Le dialogue continue ; enfin le père conduit l'enfant à un torrent :
« Fais – lui dit-il – mais seulement sur notre champ. Alors l'enfant mit la main dans l'eau et, au nom de son maître, selon les enseignements de sa mère, la remua. Et voilà que la pluie tombe seulement sur le champ indiqué. Voyant cela, le père dit : Fais tomber la grêle, mais seulement sur un de nos champs. L'enfant ayant de nouveau fait cela, le père, persuadé par ces expériences, accusa sa femme devant le juge. Emprisonnée et convaincue [de son crime], elle fut brûlée. La fille, rebaptisée et consacrée à Dieu, ne put plus opérer ».
Bien que Delrio cite le Malleus à côté d'un autre auteur, il rapporte ce récit avec des circonstances quelque peu différentes, spécialement au sujet de la manière dont la pluie est obtenue [FN: § 203-3]. [Voir Addition A10 par l’auteur] Nous surprenons ici la formation de ces légendes. Il est probable que tout n'est pas inventé. Il existe vraisemblablement un fait, qui est amplifié, commenté, expliqué, et dont naît, comme d'une petite semence, une abondante moisson d'inventions fantastiques et bizarres.
§ 204. Martin Delrio [FN: § 204-1] donne une longue liste d'écrivains d'une très grande autorité qui prétendent que les sorciers peuvent provoquer la grêle et les tempêtes. Il dit que si l'on y ajoute l'autorité de l'Écriture Sainte et certains exemples pratiques dont témoignent des personnes tout à fait dignes de foi, il y a certainement des faits capables de vaincre l'incrédulité la plus tenace.
§ 205. Godelmann [FN: § 205-1] nous enseigne diverses façons dont les sorcières, instruites par le démon, peuvent susciter la grêle. « Elles jettent un caillou derrière elles, du côté du couchant ; quelquefois, elles jettent en l'air le sable des torrents ; souvent elles plongent un balai dans l'eau et le secouent vers le ciel ; ou bien, ayant creusé une petite fosse, et mis de l'urine ou de l'eau dedans, elles la remuent avec le doigt ; ensuite elles font bouillir des poils de porc dans une marmite ; parfois, elles placent des poutres ou des morceaux de bois en travers du rivage ». C'est ainsi qu'elles font croire que la grêle arrive grâce à leurs opérations, tandis qu'elle est l'œuvre du démon, avec la permission de Dieu.
§ 206. Wier [FN: § 206-1] dénie tout pouvoir aux sorcières, mais non à l'œuvre diabolique accomplie avec la permission de Dieu ; et c'était l'interprétation par laquelle il cherchait à sauver ces pauvres femmes qu'on voulait envoyer au bûcher. Elle pouvait être crue de celui qui la donnait, et pouvait être imposée par des temps où les coutumes et les lois refusaient la liberté aux manifestations de la pensée. Peu de gens se risquaient aussi loin que Tartarotti, qui met les succès de la sorcellerie au compte des forces naturelles, et ne laisse au démon que le mérite de les prévoir [FN: § 206-2], suivant en cela une doctrine qui existait depuis des siècles, dans l'Église chrétienne (§ 213). Mais il invoque aussi l'autorité de l'Écriture, et flatte prudemment la Sainte Inquisition Romaine, en écrivant :
« (p. 63) Et je ne pourrais me dispenser ici, sans tomber dans une injustice grave, de rendre hommage au très vénérable et très prudent Tribunal de la Sainte Inquisition Romaine ; lequel se dirige en cette matière avec tant de modération et de prudence, qu'il montre bien l'esprit qui l'anime et le gouverne, et combien les plaintes et les injures que lui jettent les hérétiques sont injustes et sans consistance ».
§ 207. De notre temps, on peut dire ce qu'on veut des sorcières, mais non du péché charnel ; et de même qu'autrefois, par conviction ou pour complaire à des gens qu'à ce point de vue on peut seulement qualifier d'ignorants et de fanatiques, les gouvernements persécutaient ceux qui parlaient librement de la Bible, aujourd'hui, nos gouvernements persécutent, pour de semblables motifs, ceux qui traitent librement de l'acte sexuel. Lucrèce pouvait écrire en toute liberté sur la religion des dieux comme sur la religion sexuelle.
§ 208. Comme d'habitude, autrefois et aujourd'hui, l'hérétique est traité de malfaiteur. Quand on lit ce qu'écrit Bodin [FN: § 208-1] contre Wier, on croit entendre ce que dit aujourd'hui M. Bérenger ou ses adeptes, contre ceux qui ont l'esprit moins étroit qu'eux.
§ 209. Parlons d'une autre analogie, qui met en lumière la nature des actions non-logiques. Comme nous l'avons déjà noté (§ 199), les interprétations durent s'adapter aux préjugés populaires ; et cela eut lien aussi pour les lois et les procédures pénales. Dans un très grand nombre de procès de sorcellerie, on peut constater que la voix publique dénonce les sorciers ; la fureur publique les attaque, les persécute et contraint l'autorité publique à intervenir. Voici un exemple parmi tous ceux qu'on pourrait citer [FN: § 209-1]:
En 1546, dans la baronnie de Viry, une certaine Marguerite Moral, femme de Jean Girard, se plaint auprès du châtelain de la baronnie, parce que certaines femmes l'ont attaquée et battue, en l'appelant sorcière (hyrige ). Le châtelain procède contre les dénoncées, entend plusieurs témoins dont il apprend que Marguerite est accusée d'avoir causé la mort de certains enfants. Donc, exactement comme on le ferait encore aujourd'hui, il recherche si les faits imputés à Marguerite sont vrais ; et celle-ci, de plaignante, devient accusée. L'accusation s'étend ensuite au mari de Marguerite. De nombreux témoins déposent que les enfants sont morts, croit-on, du fait de Marguerite. Ensuite, par la torture, on lui fait dire ce qu'on veut, ainsi qu'à son mari. Ils avouent l'intervention du diable, comme ils auraient avoué avoir administré du poison, comme ils auraient avoué tout ce qu'on aurait voulu d'autre. Ils sont condamnés au bûcher et brûlés.
§ 210. Les interprétations jouent ici un rôle très accessoire. La partie principale est constituée par l'idée que l'on peut donner la mort d'une manière mystérieuse ; et cette conception agit principalement sur l'esprit du peuple. Les juges l'admettent aussi ; mais sans l'autre préjugé, que l'on peut obtenir la vérité par la torture, il est impossible de prévoir quelle issue aurait eue le procès. Enfin, il apparaît clairement que c'est l'opinion publique qui pousse les juges, et que, sans son intervention, ils ne se seraient pas émus. De même, nos gouvernements n'ont pris des mesures contre l'hérésie sexuelle, qu'après y avoir été sollicités depuis longtemps par les esprits étroits qui s'assemblent dans les sociétés pour la morale, et dans les congrès contre la pornographie ; et les législateurs, comme aussi les juges, ne cèdent souvent qu'à contre-cœur, et tâchent d'atténuer au moins les fureurs hystériques des vertuistes.
§ 211. Jusqu'au XVIIIe siècle, on continua à condamner les sorcières, et les gouvernements comme l'Église secondaient en cela le préjugé populaire, et, de cette façon, contribuaient à le fortifier, mais n'en étaient certainement pas les auteurs.
Loin d'avoir imposé, à l'origine, la croyance en ces actions non-logiques, l'Église l'a, au contraire, subie en lui cherchant des interprétations logiques ; et ce n'est que plus tard qu'elle l'a entièrement acceptée, avec le correctif de ces interprétations.
Un auteur qu'on ne peut suspecter de partialité envers l'Église catholique dit [FN: § 211-1]
« (p. 522) Un fait nous montre combien l'Église, au XIIIe siècle, prêtait encore peu d'attention à la magie. Quand l'Inquisition fut organisée, cette catégorie de crimes resta longtemps distraite de sa juridiction. En 1248 le concile de Valence... ordonna de livrer les magiciens aux évêques qui les emprisonneront ou les puniront de quelque autre manière. Ensuite, pendant une soixantaine d'années, la question fut agitée dans divers conciles... En 1310, notamment le concile de Trèves, qui énumère avec grand soin les arts réprouvés, ordonne bien aux prêtres paroissiaux de prohiber ces coupables pratiques ; mais il ne fixe aucun châtiment, en cas de désobéissance, que le retrait des sacrements, suivi, à l'égard des criminels endurcis, de l'excommunication et des autres sanctions légales dont disposent les Ordinaires épiscopaux. C'est là en vérité une mansuétude presque inexplicable. D'ailleurs l'Église était portée à se montrer plus sensée que le peuple, comme le prouve un incident qui se passa, en 1279, à Ruffach, en Alsace. Une Dominicaine était accusée d'avoir baptisé une figurine de cire, à la façon des magiciennes qui veulent faire périr un ennemi ou gagner le cœur d'un amant. Les paysans la traînèrent dans un champ et l'auraient brûlée vive, si des moines n'étaient venus la délivrer. » Et plus loin : « (p. 523) Ainsi jusque fort avant dans le XIVe siècle, l'Église se montra disposée à traiter avec une singulière indulgence les pratiques vulgaires de la sorcellerie et de la magie ».
§ 212. Elle est donc fausse, l'idée de ceux qui, voyant partout des actions logiques, rendent la théologie catholique responsable des procès de sorcellerie. Remarquons plutôt, en passant, qu'ils furent aussi nombreux chez les protestants que chez les catholiques [FN: § 212-1] et que la croyance à la magie existe de tout temps et chez tous les peuples. Les interprétations sont soumises aux faits et ne les dominent pas. D'autres personnes, comme Michelet, trouvent dans la féodalité la cause de la sorcellerie. Mais où était la féodalité, quand, à Rome, les XII Tables parlaient de ceux qui enchantaient les moissons ? quand on croyait aux sorcières thessaliennes ? quand on accusait Apulée de s'être fait aimer, grâce à des opérations magiques, de la femme qu'il épousa, et dans une infinité d'autres cas du même genre ? Ici, nous avons simplement une interprétation semblable à celle des chrétiens ; mais le « grand ennemi » a changé de nom : au lieu de Satan, il s'appelle féodalité.
§ 213. Revenons aux interprétations chrétiennes. Même si l'on admettait que le démon n'avait pas le pouvoir de faire naître les tempêtes, on n'était pas contraint pour cela de le chasser entièrement de ces phénomènes. On avait un moyen de le faire intervenir d'une autre façon, en disant qu'il les prévoyait et pouvait ainsi les annoncer. On trouve cette explication dès les premiers temps du christianisme jusqu'à nos jours.
En somme, on admet que les démons ont un corps aérien, se meuvent très rapidement, possèdent une longue expérience, parce qu'ils sont immortels, peuvent par conséquent savoir et prédire nombre de choses, sans compter qu'ils prédisent souvent ce qu'eux-mêmes feront [FN: § 213-1].
Reste à expliquer comment certaines pratiques peuvent bien attirer les dé mons. N'ayez pas peur ! Des explications, il y en aura autant qu'on voudra. Saint Augustin nous dit que les démons sont attirés « non par la nourriture, comme les animaux, mais comme des esprits, par des signes correspondant à leur affection, par divers genres de pierres, d'herbes, de bois, d'animaux, de chants, de rites ». De sa grande autorité, Saint Thomas confirme cette opinion [FN: § 213-2] .
§ 214. Dès les premiers temps des interprétations à propos de démons, une grave question se posa : celle de savoir si aux sortilèges mal intentionnés on pouvait opposer les sortilèges bien intentionnés. Constantin l'admet ; mais Godefroy reprend cet empereur, dans son commentaire, parce que, dit-il, on ne saurait faire de mauvaises choses, pour en provoquer de bonnes [FN: § 214-1]. Telle fut aussi la doctrine de l'Église.
§ 215. D'autre part, on ne manque pas de nombreux remèdes licites, outre les exorcismes et les exercices spirituels ; et tous les démonologues en dissertent longuement. Par exemple, le Malleus nous enseigne que [FN: § 215 note 1| :
« Contre la grêle et les tempêtes, outre le signe de la croix, comme il est dit, on emploie le remède suivant. On jette au feu trois grains de grêle, sous l'invocation de la très sainte Trinité ; on y ajoute l'oraison dominicale, avec la salutation angélique, deux ou trois fois, plus le verset de Jean : In principio erat Verbum, en faisant le signe de la croix de tous côtés contre la tempête, devant et derrière, et en se tournant dans toutes les directions de la terre. Alors, après avoir enfin récité trois fois : Verbum caro factum est, et répété trois fois ensuite les paroles de l'Évangile, on dit : Que cette tempête fuie. Elle cessera immédiatement, si elle est produite par maléfice. Ces faits sont considérés comme des expériences très véridiques et non suspectes. Mais si l'on jette les grains [de grêle] au feu, sans invoquer le nom divin, on estime que c'est une superstition. Si l'on dit : Sans les grains, ne peut-on faire cesser la tempête ? On répond: Certainement, avec d'autres paroles sacrées. En jetant les grains, on veut molester le diable, tandis que, grâce à l'invocation de la très sainte Trinité, on entreprend de détruire son œuvre. On jette les grains plutôt dans le feu que dans l'eau, parce que plus vite ils se fondent, plus vite aussi l'œuvre du diable est détruite ; toutefois, l'effet est remis à la volonté divine ».
Suivent d'autres fantasmagories sur la manière dont on peut faire tomber la grêle, et sur le moyen de la repousser. Delrio fournit une infinité de remèdes naturels, surnaturels, licites, illicites, par lesquels on peut éloigner les maux de la sorcellerie.
§ 216. Nous pouvons nous arrêter ici, non que la matière fasse défaut ; elle pourrait au contraire remplir plusieurs gros volumes ; mais ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit à nous faire connaître les caractères essentiels de la famille de faits que nous avons examinés, de même qu'un certain nombre de plantes suffisent à faire connaître les caractères de la famille des papilionacées.
Nous aurons à faire de nombreuses autres études semblables à celle-ci, c'est-à-dire que nous aurons à examiner de nombreuses familles de faits, pour trouver en chacune les parties constantes et les parties variables, et les classer ensuite, en les divisant en ordres, classes, genres, espèces, encore comme fait précisément le botaniste.
Dans cette étude, nous avons estimé profitable de présenter au lecteur, à titre d'exemple, une partie pas très grande, il est vrai, mais pourtant notable, des faits que nous avons étudiés pour en tirer nos conclusions. Mais l'espace nous manque pour continuer à le faire dans toutes les autres études analogues ; et le lecteur voudra bien se rappeler que nous lui soumettons seulement une petite partie, et souvent une infime partie des faits qui nous servirent dans les inductions que nous lui présentons.
§ 217. De l'étude précédente, on déduit clairement les caractères. suivants (§ 514-3) :
1° Il existe un noyau non-logique formé simplement par l'union de certains actes, de certaines paroles, qui ont des effets, déterminés, tels qu'un ouragan ou la destruction d'une récolte.
2° De ces noyaux partent de nombreuses ramifications d'interprétations logiques. Il est impossible de ne pas reconnaître qu'en général les interprétations ne sont imaginées que pour rendre compte du fait que les tempêtes sont provoquées ou conjurées, les récoltes détruites ou préservées. On observe seulement d'une manière tout à fait exceptionnelle le phénomène opposé, c'est-à-dire celui d'après lequel ce serait la théorie logique qui aurait conduit à la croyance aux faits.
Ces interprétations ne sont pas toujours clairement distinctes elles s'entrelacent souvent sans que la personne qui les écoute sache avec précision quelle part revient à chacune.
3° Les interprétations logiques assument les formes les plus en usage au temps où elles se produisent. On pourrait les comparer aux costumes que portent les hommes du temps.
4° Cette évolution n'est pas du tout directe, comme celle de la figure 5, mais a la forme que représente la figure 6. L'action purement non-logique ne s'est pas transformée en une action à forme logique ; elle subsiste en même temps que les autres actions qui en dérivent.
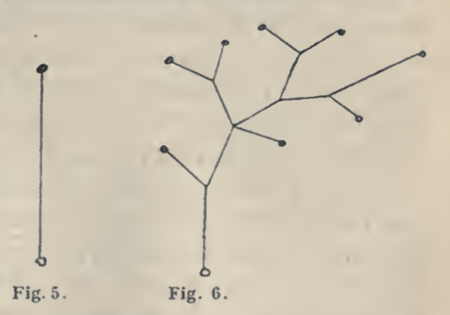
Figure 5 : Figure 6
On ne peut déterminer la façon dont s'est produite cette transformation, en cherchant à fixer, par exemple, que de la simple association d'actes et de faits [fétichisme], on ait passé à une interprétation théologique, puis à une interprétation métaphysique, et enfin à une interprétation positiviste. Cette succession chronologique n'existe pas. Les interprétations que l'on pourrait appeler fétichistes, magiques, expérimentales ou pseudo-expérimentales, se confondent d'ailleurs souvent, sans qu'il soit possible de les distinguer, et sans que très probablement celui qui les accepte puisse les distinguer. Il sait que certains actes doivent avoir pour conséquence certains faits, et ne se préoccupe pas beaucoup de savoir comment cela arrive.
5° Certainement, à la longue, le degré d'instruction des hommes en général influe sur le phénomène ; mais il n'y a pas de relation constante. Les Romains ne brûlaient ni sorciers ni magiciennes ; et pourtant leur développement scientifique était sans aucun doute moindre que celui des Italiens, des Français, des Allemands, etc. du XVIIe siècle, qui faisaient mourir en grand nombre tant celles-ci que ceux-là. C'est ainsi que vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe, ces malheureux n'étaient pas du tout persécutés. Toutefois, il est incontestable que le développement intellectuel et scientifique de ce temps était de beaucoup inférieur à celui du XVIIe siècle.
6° Ce n'est pas par un artifice logique, que l'Église, les gouvernements ou d'autres personnes ont imposé la croyance en ces actions non-logiques ; c'est au contraire ces actions non-logiques qui ont imposé les artifices logiques, pour leur explication. Ce qui n'empêche pas qu'à leur tour, ces artifices aient pu renforcer la croyance dans les actions non-logiques, et même la faire naître là où elle n'existait pas.
Cette dernière induction nous prépare à comprendre comment des phénomènes analogues peuvent avoir lieu, et comment nous nous trompons quand, ne connaissant les actions non logiques que par leur vernis logique, nous donnons à ce vernis une importance qu'il n'a pas.
§ 218. Dans tous les faits que nous avons vus à propos des tempêtes, il y a quelque chose de commun, de constant : c'est le sentiment que, par certains moyens, on peut agir sur les tempêtes. Il y a en outre une partie mobile, variable : c'est justement ces moyens et leur raison d'être.
La première partie est évidemment la plus importante. Quand elle existe, les hommes découvrent la seconde sans trop de peine. Il se pourrait donc que pour la détermination de la forme sociale, les parties semblables à celles dont nous venons de noter la constance, aient une importance plus grande que d'autres. Pour le moment, nous ne pouvons rien décider. L'induction nous révèle seulement, une voie qu'il faut essayer.
Comme il arrive souvent avec la méthode inductive, nous avons, trouvé non seulement ce que nous cherchions, mais encore autre chose que nous ne cherchions pas.
Nous voulions savoir comment les actions non-logiques prennent une forme logique ; et, en considérant un cas spécial, nous avons vu comment cela se produisait. Mais nous avons vu en outre comment ces phénomènes ont une partie constante ou presque constante et une autre partie très variable. La science recherche justement les parties constantes des phénomènes, pour arriver à la connaissance des uniformités. Nous devrons donc étudier spécialement ces parties, et le ferons aux chapitres suivants (§ 182-1).
§ 219. En attendant, d'autres inductions surgissent à notre esprit, non pas encore comme certaines, parce qu'elles résultent de trop peu de faits, mais plutôt comme des propositions à vérifier en élargissant le champ de nos investigations :
1° Si, pour un moment, nous envisageons les faits exclusivement sous l'aspect logico-expérimental, l'œuvre de l'Église, à l'égard de la magie, est tout simplement absurde ; et toutes ces histoires de démons sont ridiculement puériles. Ceci posé, il y a des gens qui, de ces prémisses, tirent la conclusion que la religion de l'Église est aussi absurde, et qu'elle est par conséquent nuisible à la société. Pouvons-nous accepter cette opinion ?
Remarquons tout d'abord que le raisonnement s'applique non seulement à la religion catholique, mais à toutes les autres religions, même à toutes les métaphysiques ; en un mot, à tout ce qui n'est pas science logico-expérimentale. Or, il est impossible d'admettre cette conclusion, et de considérer comme absurde la majeure partie de la vie des sociétés humaines jusqu'à nos jours. Prenons garde ensuite que si tout ce qui n'est pas logique est nuisible à la société et par conséquent aussi à l'individu, il ne devrait pas y avoir des cas comme ceux observés chez les animaux, et comme d'autres que nous verrous chez les hommes, où certaines actions non-logiques sont au contraire utiles et même très utiles.
Les conclusions étant erronées, le raisonnement doit l'être aussi où est l'erreur ?
Les syllogismes complets seraient: a) Toute doctrine qui contient une partie absurde est absurde ; la doctrine de l'Église contient une partie absurde : celle qui a trait à la magie ; donc, etc. b) Toute doctrine qui n'est pas logico-expérimentale est nuisible à la société la doctrine de l'Eglise n'est pas logico-expérimentale, donc, etc.
Les propositions qui probablement vicient le raisonnement qui précède sont : a) toute doctrine qui contient une partie absurde est absurde ; b) toute doctrine qui n'est pas logico-expérimentale est nuisible à la société.
Il nous faut donc les examiner de près, et voir si elles concordent avec les faits ou les contredisent. Mais pour cela, il faut tout d'abord avoir une théorie des doctrines et de leur influence sur les individus et sur la société ; et c'est ce dont nous devrons nous occuper dans les chapitres suivants (§ 14).
2° Des questions analogues à celles qui se posent maintenant pour les doctrines surgissent aussi à propos des hommes.
Si nous considérons leur œuvre sous l'aspect logico-expérimental, nous ne trouvons pas d'autre nom que celui de sot pour qualifier un auteur qui écrit les énormes sottises exposées par Bodin dans sa Démonomanie. Et si nous considérons cette œuvre au point de vue du bien ou du mal causé à autrui, le vocabulaire ne renferme que des termes synonymes de malfaiteur et de criminel, pour désigner ceux qui, grâce à de pareilles insanités, ont infligé des souffrances si terribles à tant de gens et même la mort à un grand nombre.
Mais nous ne tardons pas à nous apercevoir que nous appliquons ainsi au tout, ce qui en réalité se rapporte seulement à la partie. Une infinité d'exemples montrent qu'un homme peut être déraisonnable en certaines choses, raisonnable en d'autres ; malhonnête dans certains de ses actes, honnête en d'autres.
De ce contraste résultent deux erreurs de même origine, en apparence opposées. Les propositions suivantes sont également fausses : « Bodin a dit des insanités et a fait tort à autrui ; donc c'est un sot et un coupable. – Bodin était un homme intelligent et honnête ; donc ce qu'il écrit dans sa Démonomanie est sensé, et l'œuvre qu'il a accomplie est honnête ».
Nous voyons ainsi qu'il nous est impossible de juger de la valeur logico-expérimentale et de l'utilité des doctrines, par la considération facile de l'autorité de leur auteur, et qu'il faut au contraire suivre la voie ardue et difficile de leur étude directe. Nous voilà de nouveau amenés à la conclusion que nous avons tirée de l'examen des doctrines elles-mêmes (§ 1434 et sv.).
Nous parlerons amplement de tout cela plus loin. Pour le moment, continuons à nous occuper des actions non-logiques.
§ 220. La forme logique donnée par les Romains à leurs relations avec les dieux est digne de remarque. C'est en général celle d'un contrat clair et précis, qui doit être interprété d'après les règles du droit. Si l'on s'arrêtait à cet aspect, on découvrirait dans ces faits une simple manifestation de ce qu'on appelle l'esprit juridique des Romains. Mais on observe des faits semblables chez tous les peuples. Même de nos jours, la bonne femme qui promet une petite obole à Saint Antoine de Padoue, s'il lui fait retrouver un objet perdu, agit envers lui précisément comme les Romains envers leurs dieux. Ce qui distingue les Romains, c'est la richesse et la précision des détails ; c'est la forme qui l'emporte sur le fond ; c'est, en un mot, la force de cohésion des actes entre eux. Nous voyons ainsi une manifestation de l'état psychique de ce peuple.
§ 221. L'Athénien Platon ne se préoccupe pas de ces associations d'idées et de faits, qui empêchent de séparer logiquement ces derniers. Dans l'Euthyphron, il s'indigne de ce qu'on puisse supposer que la sainteté soit la science de demander aux dieux [FN: § 221-1] . Au contraire, pour les Romains, surtout pour l'homme d'État romain, c'est là toute la science des relations entre les dieux et les hommes. Cette science est difficile. Tout d'abord, il faut savoir à quelle divinité l'on doit s'adresser, dans une conjoncture donnée, puis connaître exactement son nom ; et comme il pourrait y avoir des doutes à ce propos, on a des formules pour lever la difficulté [FN: § 221-2] ; par exemple: « lupiter optime, maxime, sive quo alio nomine te appellari volueris ».
§ 222. Aulu-Gelle [FN: § 222-1] observe qu'on ignore quelle divinité il faut invoquer en cas de tremblement de terre. Voilà un embarras très grave. C'est pourquoi « les anciens Romains, qui étaient fort exacts, et prudents dans tous les devoirs de la vie et spécialement en ce qui regarde la religion et les dieux immortels, édictaient des cérémonies publiques, quand ils avaient connaissance d'un tremblement de terre ; mais ils s'abstenaient de nommer – comme c'était leur coutume – le dieu en l'honneur duquel on célébrait ces fêtes, afin qu'en nommant un dieu pour un autre, il ne leur arrivât pas de compromettre le peuple par un faux culte ».
§ 223. Quand on offre du vin à une divinité, il faut dire « Accepte ce vin que j'ai dans les mains [FN: § 223-1] ». On ajoute ces derniers mots, pour éviter une erreur possible, et pour qu'il n'arrive pas de consacrer à la divinité, sans le vouloir, tout le vin qui se trouve dans la cave. « Dans la doctrine des augures, existe le principe que les imprécations et les auspices, quels qu'ils soient, sont privés de valeur pour ceux qui, au début d'une entreprise quelconque, déclarent n'y attacher aucune importance ; c'est un des plus grands bienfaits de la bonté, divine [FN: § 223-2] ». Tout cela semble absurde et ridicule, si l'on veut argumenter logiquement sur le fond, mais devient au contraire raisonnable, si l'on prend certaines associations d'actes et d'idées comme prémisses. N'est-il pas évident que si l'on évite réellement la piqûre d'un scorpion en prononçant le nombre deux (§ 182), il est nécessaire de savoir d'abord avec précision s'il s'agit vraiment d'un scorpion, quand on rencontre un insecte et qu'on en veut éviter la piqûre ? Si c'est l'acte qui a plus de valeur que n'importe quoi d'autre, il est clair que, quand on offre du vin à la divinité, il faut exécuter exactement l'acte fixé, et non un autre. Mais quelle que soit la valeur de ces raisonnements, ils n'ont été faits qu'a posteriori, pour justifier des actions non-logiques.
§ 224. La divination ne différait pas moins que la religion, à Rome et à Athènes, et les différences se manifestaient dans le même sens. À Rome [FN: § 224-1] , la divination consistait en
« (p. 176) une simple demande, toujours la même, et visant uniquement le présent ou l'avenir immédiat qui le suit. Cette demande pourrait se formuler ainsi : « les dieux ont-ils pour agréable, oui ou non, l'action que va faire le consultant ou qui va se faire sous ses auspices ?» Elle ne pose que cette alternative et n'accepte que des signes positifs ou des signes négatifs... Quant aux méthodes divinatoires réglementées par le rituel augural, elles étaient aussi simples et aussi peu nombreuses que possible. L'observation des oiseaux en faisait le fond et serait restée l'unique source des auspices si le prestige de l'art fulgural des Toscans n'avait décidé les Romains à observer le ciel, et même à attribuer au signe mystérieux de la foudre une énergie supérieure. La divination officielle ne connaissait ni les oracles ou sorts, ni l'inspection des entrailles, elle se refusait à entrer dans la discussion et l'appréciation des signes fortuits, n'en tenant compte que s'ils survenaient dans la prise des auspices ; à plus forte raison s'abstenait-elle d'interpréter les prodiges ».
§ 225. Ce que les Romains ne pouvaient trouver chez eux, ils le demandèrent à la Grèce et à l'Étrurie, où l'imagination, plus libre, créait de nouvelles formes de divination. L'importance donnée à la simple association d'actes et d'idées explique une des règles les plus extraordinaires de la divination romaine : celle qui donne à l'auspice inventé la même efficacité qu'à l'auspice réellement observé.
« (p. 202) L'auspiciant pouvait... se contenter du premier signe, s'il était favorable, ou laisser passer les indices fâcheux pour en attendre de meilleurs. Il pouvait encore, ce qui était plus sûr et devint l'usage ordinaire, se faire annoncer par l'augure assistant que les oiseaux attendus volaient ou chantaient dans les conditions requises. Cette annonce (renuntiatio ) faite suivant une formule sacramentelle, créait un auspice ominal, équivalent pour celui qui l'entendait à l'auspice réel » [FN: § 225-1].
§ 226. Les Romains arrangeaient le fond suivant leur convenance, tout en respectant la forme, ou plutôt certaines associations d'idées et d'actes. Les Athéniens modifiaient le fond et la forme. Il répugnait aux Spartiates de changer l'une et l'autre.
Avant la bataille de Marathon, les Athéniens envoyèrent demander des secours à Sparte [FN: § 226-1]
« (p. 189) Les autorités spartiates s'empressèrent de promettre leur aide, mais, par malheur, c'était alors le neuvième jour de la lune. Une (p. 190) ancienne loi, ou un ancien usage, leur défendait de marcher, ce mois-là du moins, pendant le dernier quartier avant la pleine lune ; mais après la pleine lune, ils s'engagèrent à marcher sans délai. Un retard de cinq jours à ce moment critique pouvait être la ruine totale de la ville en danger ; cependant la raison alléguée ne paraît pas avoir été un prétexte de la part des Spartiates. Ce n'était qu'un attachement opiniâtre et aveugle à une ancienne habitude, ténacité que nous verrons diminuer, sinon disparaître complètement, à mesure que nous avancerons dans leur histoire ».
Les Athéniens auraient changé le fond et la forme. Les Romains modifiaient le fond en respectant la forme. Pour déclarer la guerre, le fécial devait jeter un dard sur le territoire ennemi. Comment faire pour accomplir ce rite et déclarer ainsi la guerre à Pyrrhus, dont les états étaient si éloignés de Rome ? Rien de plus simple. Les Romains avaient capturé un soldat de Pyrrhus. Ils lui firent acquérir un petit terrain, au cirque de Flaminius ; et c'est là que le fécial jeta le dard. L'association d'idées du peuple romain, entre le jet du dard et une guerre juste, était ainsi respectée [FN: § 226-2].
§ 227. On rencontre, dans le vieux droit romain, les mêmes caractères que nous avons relevés dans la religion et dans la divination ; ce qui renforce l'impression qu'il s'agit d'une qualité intrinsèque de l'esprit romain ; qualité qui se manifeste dans les différentes branches de l'activité humaine. Dans le droit comme dans la religion et dans la divination, il y a encore des différences de qualité, que nous aurons à examiner, en comparant Athènes à Rome [FN: § 227-1]
« (p. 134) Le mot, soit écrit, soit solennellement exprimé (la formule), apparaît aux peuples enfants comme quelque chose de mystérieux, et la foi naïve lui attribue une force surnaturelle. Nulle part cette foi au mot ne fut plus robuste que dans la Rome ancienne. Le culte du mot pénètre tous les rapports de la vie publique et de la vie privée, de la religion, des usages et du droit. Pour le Romain ancien, le mot est une puissance ; il lie et délie. S'il ne transporte pas des montagnes, il a du moins le pouvoir de déplacer les moissons d'un champ sur un champ appartenant à autrui ; il est assez puissant pour évoquer (p. 135) les divinités (devocare ), et pour leur faire abandonner la ville assiégée (evocatio deorum ) ».
lhering n'a raison qu'en partie ; ce ne sont pas seulement les paroles qui ont ce pouvoir, mais les paroles et les actes. D'une façon plus générale encore, ce sont certaines associations de paroles, d'actes, d'effets, qui persistent et ne se disjoignent pas facilement. Dans l'exemple cité tant de fois, de Gaius, où l'on voit un demandeur perdre sa cause parce qu'il avait appelé par leur nom ses vignes, qu'il aurait dû nommer arbres, tel étant le terme employé dans la loi des XII Tables, on ne peut découvrir aucun pouvoir aux paroles. Il s'était simplement formé certaines associations d'idées, que les Romains répugnaient à disjoindre. Ce peuple développait son droit, tout en respectant ces associations. On créait un droit nouveau, en conservant la forme des actions de la loi.
« (p. 104) [FN: § 227-2] La théorie des modes volontaires d'acquisition était, dans le droit romain, bien différente de ce qu'elle a été dans le droit attique. Il existait, en effet, à Rome, des modes solennels d'acquisition, à savoir la mancipatio et l’in iure cessio, ayant par eux-mêmes une vertu translative, indépendamment de toute tradition. Or, à Athènes, on ne rencontre rien de semblable. Si, dans quelques autres cités de la Grèce, la vente est accompagnée de formalités rappelant celles de la mancipation, elle est, dans le droit attique, un contrat purement consensuel et translatif ipso iure de la (p. 105) propriété inter partes. D'un autre côté, la tradition qui joue un si grand rôle à Rome comme mode de translation de la propriété, n'a, dans le droit attique, que la valeur d'un simple fait. Elle y est dépourvue de toute qualité translative, et n'apparaît que comme un simple moyen d'exécution des obligations ; l'acquisition de la propriété étant déjà antérieurement réalisée par l'effet de la convention ».
Le droit attique, lui non plus, n'a pas subordonné la perfection du contrat à l'observation de certaines formes solennelles. La loi athénienne n'exigeait, d'autre part, aucune des formalités que l'on voit être pratiquées ailleurs, comme la présence d'un magistrat, l'intervention des -voisins, les sacrifices, etc. La vente avait lieu par le seul fait de l'échange des consentements, même sans que la présence de témoins ou la stipulation d'un acte écrit fussent nécessaires.
§ 228. Mais le caractère le plus remarquable du vieux droit romain n'est pas la fidélité à la lettre, à la forme, mais bien le progrès qu'il accomplit, tout en respectant les associations d'idées. Ihering l'a assez bien reconnu, quoiqu'il considère un autre aspect. Après avoir cité plusieurs cas dans lesquels il semblait que les jurisconsultes anciens eussent sacrifié le sens à l'expression littérale (loc. cit.), il ajoute : « (p. 151) Ces exemples semblent mettre hors de doute que la jurisprudence ancienne, dans l'interprétation des lois, s'en est rigoureusement tenue au mot. À mon avis cependant, il faut absolument rejeter cette opinion. Pour nous en convaincre, nous allons énumérer une série de cas dans lesquels la jurisprudence s'est incontestablement écartée du mot ».
Le vieux droit romain était tout forme et mécanisme, et réduisait au minimum l'arbitraire des parties et du magistrat. Les actions de la loi ressemblaient à un moulin : on mettait le grain d'un côté; de l'autre sortait la farine.
Girard dit [FN: § 228-1] :
« (p. 973)... il est nécessaire de bien comprendre le rôle du magistrat. Il ne juge pas. Ce serait presque exagérer de dire qu'il organise l'instance. Il donne simplement par son concours une sorte d'authenticité indispensable aux actes des parties, spécialement à ceux du demandeur. Comme dans la procédure extrajudiciaire, c'est le demandeur qui réalise son droit en accomplissant la legis actio... (p. 974). Quant au magistrat, son rôle est un rôle d'assistant, sinon purement passif, au moins à peu près mécanique [FN: § 228-2] . Il doit être là, prononcer les paroles que la loi lui ordonne de prononcer. Mais c'est à peu près tout. Il ne peut ni accorder l'action, quand la loi ne l'accorde pas, ni, à notre sens, la refuser (denegare legis actionem ), quand la loi la donne [FN: § 228-3] , et, s'il y a un procès, ce n'est pas lui qui le juge... l'instance organisée in iure devant le magistrat est tranchée in iudicio par une autorité différente. La tâche du magistrat finit par la nomination du juge, faite encore beaucoup plus par les parties que par lui-même ».
§ 229. Nous pourrions continuer cet exposé, parce que dans toutes les parties du droit romain, on peut découvrir la manifestation de cet état psychique qui accepte le progrès tout en respectant les associations d'idées. Après avoir vu cela dans le système de la legis actio, nous en rencontrerions des traces dans le système formulaire. Nous le verrions dominer toute la matière des fictions. Ces dernières se retrouvent chez presque tous les peuples, à une certaine époque de leur histoire ; mais, dans la Rome antique comme dans l'Angleterre moderne, leur développement et leur persistance sont remarquables.
§ 230. Dans les manifestations de la vie politique, nous trouvons des phénomènes semblables à ceux que nous venons d'observer. Par l'effet d'une évolution commune à la majeure partie des villes grecques et latines, le roi a été remplacé par de nouveaux magistrats, à Athènes comme à Sparte et à Rome [FN: § 230-1], mais à Athènes, on change complètement le fond et la forme. À Sparte, le changement de l'une et de l'autre a été moindre. À Rome, il a été notable dans le fond, moindre dans la forme.
Pour conserver certaines associations d'idées et d'actes, à Athènes, les fonctions sacerdotales du roi passèrent à l'archonte-roi, et à Rome, elles passèrent au rex sacrorum ; mais ni l'un ni l'autre de ces deux personnages n'ont d'importance politique. Sous cet aspect, à Athènes, le roi disparaît complètement ; à Sparte, il subsiste partiellement ; à Rome, il se transforme avec les moindres changements possibles dans la forme. La magistrature suprême devient annuelle et se dédouble entre deux consuls [FN: § 230-2] qui sont égaux, chacun pouvant agir isolément, chacun pouvant arrêter l'action de l'autre. « (p. 246) [FN: § 230-3] La constitution réservait aux consuls le droit de compléter leur collège, en particulier en cas de guerre, par l'adjonction d'un troisième membre ayant un droit plus fort, d'un dictateur. Et à la vérité l'élection populaire n'est intervenue pour la dictature que tardivement et à titre isolé. Le dictateur est nommé (p. 247) par l'un des consuls, comme le roi l'était probablement autrefois par l'interroi cette nomination royale n'a qu'une barrière, c'est que les consuls et leurs collègues les préteurs restent en fonction à côté du dictateur, bien qu'en cas de conflit ils s'inclinent devant le dictateur ».
§ 231. Dans la constitution romaine, il est plus que singulier que les hauts magistrats, bien qu'ils soient en réalité nommés par les comices, paraissaient l'être par leurs prédécesseurs.
« (p. 116) [FN: § 231-1] L'élection populaire la plus ancienne n'était pas un choix librement exercé parmi les personnes capables ; elle a été probablement liée à l'origine par le droit de proposition du magistrat qui dirigeait le vote. Il est vraisemblable qu'à l'origine la plus ancienne, on soumettait au peuple juste autant de noms qu'il y avait de personnes à élire et que, dans le principe, les votants ne pouvaient qu'accepter ou repousser purement et simplement la personne proposée tout comme la loi proposée ».
Même aux temps plus récents de la république, le magistrat qui dirige la votation peut agréer une candidature (nomen accipere ), ou la refuser (nomen non accipere). En conséquence, il faut aussi que le magistrat qui préside à la votation consente à ( renuntiare » l'élu [FN: § 231-2], et s'il s'y refuse, personne ne peut l'y contraindre.
§ 232. À Athènes, nous ne trouvons rien de tout cela. Il y avait bien un examen, pour juger si les archontes, magistrats désignés par le sort, les stratèges, magistrats élus, et les sénateurs étaient aptes à exercer leur charge. Mais c'est une espèce de vérification des pouvoirs très différente de la renuntiatio. Athènes accorde la forme et le fond. À Rome, on passa de la royauté à la république, en divisant les fonctions des magistrats ; on revint au principat, en les concentrant de nouveau. Dans les innombrables transformations constitutionnelles qui ont eu lieu entre ces deux limites extrêmes, on a conservé autant que possible la forme, tout en modifiant le fond.
§ 233. Vers la fin de sa vie, César parut vouloir se soustraire à cette règle. Un peuple comme celui d'Athènes n'aurait rien vu là que de très raisonnable. Les quelques Romains qui étaient encore imbus des vieilles conceptions, furent indignés de cette dissociation d'idées et d'actes, qu'on voulait opérer. C'est seulement en prenant la partie pour le tout, qu'on a pu dire que ce furent les honneurs excessifs que César s'était fait décerner, qui occasionnèrent sa ruine [FN: § 233-1] . Ces honneurs étaient seulement une partie d'un ensemble de faits qui indisposaient les citoyens romains, dont l'état psychique était encore celui de leurs ancêtres. Auguste sut mieux respecter les traditions. Dans l'inscription d'Ancyre, il ment effrontément, quand il dit [FN: § 233-2] : « Dans mes sixième et septième consulats, après avoir éteint les guerres civiles, j'ai restitué au Sénat et au peuple romain les pouvoirs que j'avais reçus du consentement universel. En reconnaissance, un sénatus-consulte m'a donné le nom d'Auguste... Car, bien que je fusse au-dessus de tous par les honneurs, je n'avais pas de pouvoirs plus étendus que mes collègues ». Velleius Paterculus, qui décerne les plus grandes louanges à Auguste et à Tibère, dit qu'Auguste rendit aux lois leur force, aux juges leur autorité, au Sénat sa majesté, aux magistrats leur pouvoir [FN: § 233-3] .
§ 234. Sous l'empire, il y a encore des consuls et des tribuns ; mais ce ne sont plus que de vains noms. Il y a de même, encore sous Auguste, des comices pour l'élection des magistrats ; et, ce qui est plus surprenant et démontre encore mieux l'affection des Romains pour certaines formes, on trouve, jusque sous Vespasien, une loi votée par les comices pour investir le prince, du pouvoir ! À ne juger les choses que superficiellement, on trouve qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de temps à perdre, pour jouer de semblables comédies.
« (p. 150) [FN: § 234-1] La puissance tribunicienne a été conférée de la même façon à Auguste en 718, et ensuite à ses successeurs ; à la suite de la décision du Sénat, un magistrat, probablement un des consuls en fonction, présentait la rogation déterminant à la fois les pouvoirs et la personne du prince, aux comices... (p. 151) en sorte que le Sénat et le peuple concouraient l'un et l'autre à cet acte... La forme était donc celle dans laquelle des magistrats extraordinaires ont été institués sous la république par une loi spéciale et par une élection populaire... (p. 152) Le transfert des élections des comices au Sénat, opéré en l'an 14 après J. C., ne changea rien quant aux comices impériaux, car ce transfert ne concernait que la nomination des magistrats ordinaires, mais il était étranger à celle des magistrats théoriquement extraordinaires ».
§ 235. On découvre là l'inanité de certains motifs logiques, que les hommes donnent à leurs actions. C'est sérieusement, sans jouer sur les mots, que les jurisconsultes nous disent que « l'on n'a jamais douté que la volonté du prince n'obtînt force de loi, puisque l'empereur reçoit lui-même l'empire d'une loi [FN: § 235-1] ». À la vérité, la force des prétoriens et des légions comptait aussi pour quelque chose ! Dans la légende, une simple femme raisonnait mieux que le grave Ulpien, quand elle disait à Caracalla : « Ne sais-tu pas qu'il convient à un empereur de faire des lois et non d'en recevoir [FN: § 235-2] ? »
§ 236. On a déjà observé que les Grecs n'ont pas de terme qui corresponde exactement au mot « religio ». Sans vouloir entrer dans des discussions étymologiques, qui seraient d'ailleurs de minime utilité, nous nous bornerons à observer que, même à l'époque classique, un des sens de « religio » est indubitablement celui de soins minutieux, scrupuleux, diligents [FN: § 236-1]. C'est un état d'esprit par lequel s'établissent certains liens qui s'imposent fortement à la conscience. Si donc on voulait absolument choisir un terme, parmi ceux qui existent, pour exprimer l'état psychique dont nous avons parlé précédemment, celui qui semblerait le plus topique, sans être toutefois parfaitement exact, serait le terme « religio ». Cependant, même si on lui conservait la forme latine, on n'éviterait pas, soit à cause de la ressemblance avec le terme français « religion », soit en raison d'autres sens que possède le terme latin, qu'on ne le prît dans une acception tout à fait différente de celle que nous voulons lui attribuer. L'expérience nous enseigne qu'il n'est pas de précaution suffisante, pour éviter qu'un terme ne soit pris dans son sens courant et sans tenir compte de la définition qu'en a donné l'auteur, si explicite et claire qu'elle soit.
§ 237. Une anecdote racontée par Tite-Live [FN: § 237-1] met bien en relief l'attachement scrupuleux aux liens, attachement qui l'emporte sur tout autre sentiment. Quelques soldats qui ne voulaient pas obéir aux consuls, commencèrent par examiner si, en tuant les consuls, ils se délieraient du serment qu'ils leur avaient prêté. Mais ensuite ils se persuadèrent qu'un délit ne pourrait annuler un engagement sacré, et recoururent à une espèce de grève. Peu importe que ce soit de l'histoire ou de la fable. Si c'est une fable, celui qui l'a inventée savait que ceux qui l'entendraient raconter trouveraient très naturel qu'on examinât si tuer la personne à laquelle on a prêté serment, est un moyen de se délier ; et qu'on pouvait se décider pour la négative, non par répugnance pour l'homicide en lui-même, mais parce qu'il ne serait pas un moyen valable de se délier du serment. Toute cette discussion sur la manière d'éviter les conséquences d'un serment appartient à la « religio », dans le sens indiqué.
§ 238. C'est comme des manifestations de cette même « religio », que nous devons considérer les innombrables faits qui nous montrent les Romains précis, exacts, scrupuleux, aimant l'ordre et la régularité jusqu'à l'excès, dans toute leur vie privée. C'est ainsi que tout chef de famille avait un journal dans lequel il notait non seulement les recettes et les dépenses, mais tous les faits d'une certaine importance, qui avaient lieu dans la famille: quelque chose de semblable à un journal de comptabilité commerciale, que la loi impose, en France et ailleurs, aux commerçants [FN: § 238-1], mais où l'on ajoutait des faits étrangers à la simple administration du patrimoine.
§ 239. Il semblerait que la religion des Grecs, où la raison et l'imagination jouent le rôle principal, aurait dû être plus morale que celle des Romains, qui se réduisait à une série de fictions, dans lesquelles la raison n'a aucune part. Ce fut pourtant le contraire [FN: § 239-1] . Ne nous arrêtons pas aux aventures scandaleuses des dieux. Voyons la religion dans son action sur les actes de la vie journalière. Pour les Romains, les actes extérieurs du culte sont tout, l'intention rien. Les Grecs, eux aussi, ont connu un semblable état, à une époque archaïque. L'homicide s'expiait moyennant une cérémonie tout extérieure. Mais ils dépassèrent, ou pour mieux dire, leurs penseurs dépassèrent bientôt cette morale matérialiste et formaliste. « De même qu'il n'y a pas de remède à la perte de la virginité – dira Eschyle [FN: § 239-2] – tous les fleuves réunis ensemble ne réussiraient pas à purifier les mains tachées de sang, de l'homicide ». À une si grande délicatesse de sentiment doit certainement correspondre une grande rectitude dans les actions. Pourtant on observe le contraire. Rome finit par devenir aussi peu morale que la Grèce ; mais, à l'origine, et à une époque récente comme celle des Scipions, Polybe [FN: § 239-3] pouvait dire :
« Ainsi, sans parler d'autre chose, si l'on confie un seul talent à ceux qui ont, chez les Grecs, la manipulation des deniers publics, quand même ils ont dix cautions, dix sceaux et un nombre double de témoins, ils ne respectent pas la foi jurée ; tandis que chez les Romains, ceux qui, comme magistrats ou ambassadeurs, disposent de sommes considérables, respectent la parole donnée, à cause de leur serment [FN: § 239-4] ».
Les poulets sacrés pouvaient bien être ridicules ; mais ils ne causèrent jamais aux armées romaines un désastre comparable à celui qu'eut à subir l'armée athénienne, en Sicile, par la faute de ses devins.
§ 240. Rome n'eut pas de procès pour impiété à comparer à ceux pour [mot grec] à Athènes, et beaucoup moins aux innombrables procès religieux dont le christianisme affligea l'humanité. Si Anaxagore avait vécu à Rome, il aurait pu affirmer tant qu'il l'aurait voulu que le soleil était un bloc incandescent, sans que personne se souciât de ses propos [FN: § 240-1]. Quand, en l'année 155 avant J. C., les Athéniens envoyèrent à Rome une ambassade composée de trois philosophes. Critolaos, Diogène et Carnéade, les philhellènes de Rome admirèrent fort l'éloquence captieuse de ce dernier ; mais Caton le Censeur, représentant l'esprit des vieux Romains, trouvait plus que suspects tous ces discours subtils, et demanda au Sénat de terminer au plus tôt l'affaire qui avait amené ces ambassadeurs à Rome : « afin qu'ils retournassent disserter dans leurs écoles devant les enfants grecs, et que les jeunes Romains écoutassent comme avant les magistrats et les lois [FN: § 240-2] ».
Notez bien que Caton ne veut pas le moins du monde discuter les doctrines de Carnéade ; il ne s'inquiète en aucune façon de savoir si elles procèdent ou non de bonne logique ; il les juge extérieurement. Toutes ces argumentations captieuses lui paraissent n'avoir aucune valeur, et il croit inutile et dangereux pour les jeunes Romains de les écouter.
Grand aurait été l'étonnement de Caton, s'il avait su qu'un jour, les hommes répandraient leur sang pour affirmer ou nier la consubstantialité du Verbe ou de la seconde personne de la Trinité [FN: § 240-3] ; et c'eût été bien à raison qu'il aurait remercié Iupiter optimus maximus, d'avoir préservé les Romains d'une semblable folie ; laquelle pourtant, en certains cas, recouvrait un fond raisonnable.
§ 241. Le droit athénien, essentiellement logique, qui se proposait de résoudre les questions dans leur ensemble, et qui n'était pas embarrassé d'un vain formalisme, ni de fictions trop nombreuses, devrait être de beaucoup supérieur au droit romain. Et cependant, c'est juste le contraire.
« (p. 75) [FN: § 241-1] L'intellect grec, avec toute sa mobilité et son élasticité, était entièrement incapable de se confiner lui-même dans le vêtement d'une formule légale ; et si nous pouvons en juger par les tribunaux populaires d'Athènes, dont nous avons une connaissance certaine, les tribunaux grecs montrèrent une forte tendance à confondre la loi et le fait (p. 76). De cette manière, un système de jurisprudence durable n'était pas possible. Un peuple qui n'avait jamais aucune répugnance à modifier les règles du droit écrit, chaque fois qu'elles étaient un obstacle sur la voie de la réalisation d'un idéal de perfection, dans des décisions de cas particuliers, ce peuple, s'il léguait un corps de principes juridiques à la postérité, ne pouvait lui en laisser qu'un, formé des conceptions du juste et de l'injuste, tels qu'on désirait les voir triompher en ce temps ».
Jusque-là, nous sommes d'accord avec Sumner Maine ; mais nous ne pouvons partager son avis, quand il attribue la perfection du droit romain à la théorie que les Romains avaient du droit naturel. Cette théorie est venue s'ajouter, à une époque relativement récente, au vieux fond du droit romain. Ihering serre de plus près le problème. La description du phénomène est excellente ; quant à ses causes, ce qu'il appelle « la logique rigoureuse de l'esprit conservateur » n'est pas autre chose que l'état psychique dont nous avons parlé précédemment, combiné avec des déductions logiques et pratiques, qui apportent les moindres modifications possibles à certaines associations d'idées et d'actes.
Nous reproduisons le passage de Ihering [FN: § 241-2] , en mettant entre parenthèses les modifications que nous croyons opportun d'y faire:
« (p. 328) Si la science juridique romaine a trouvé tout fait un droit simple et logique, elle le doit moralement au peuple romain antique qui, malgré son esprit de liberté, s'était laissé imposer pendant des siècles le joug d'une logique impitoyable [des conséquences logiques des associations d'idées et d'actes, qu'on voulait respecter ]... Ce que nous venons de dire se manifeste dans la manière particulière des Romains, si familière à tous ceux qui connaissent le droit romain, de concilier la logique gênante [certaines associations d'idées et d'actes ] avec le besoin de la pratique, au moyen d'artifices, de toute espèce : actes apparents, moyens détournés, fictions. L'aversion morale des Romains pour toute violation d'un principe une fois reconnu [résultant des associations d'idées et d'actes ], stimule et presse, en quelque sorte, leur intelligence à déployer toute sa sagacité, afin de découvrir les voies et les moyens pour opérer cette conciliation de la logique et de la nécessité pratique. La nécessité rend inventif... (p. 329) La seconde qualité nationale des Romains, que nous avons nommée plus haut, leur esprit conservateur [conservateur de la forme, innovateur du fond ], exerça exactement la même influence, et fut, elle aussi, un puissant levier pour leur génie inventif juridique. Concilier les nécessités du présent avec les traditions du passé, rendre justice aux premières sans rompre, ni dans la forme ni dans le fond, avec les principes traditionnels du passé, discipliner le commerce juridique, conduire la force progressive du droit dans sa véritable voie, telle fut pendant des siècles, à Rome, la mission véritablement noble et patriotique de la science juridique [laissons de côté la mission, la noblesse et le patriotisme ]. Elle grandit en proportion des difficultés qu'elle rencontra ».
§ 242. Quant à la politique, il y a mieux encore. C'est le cas de se demander comment a jamais pu fonctionner un système si absurde, au point de vue logique. Ces magistrats, égaux en droits, tels que les deux consuls et les deux censeurs ; ces tribuns qui peuvent arrêter toute la vie juridique et politique ; ces comices avec les complications des auspices ; ce Sénat sans attributions bien déterminées ; tout cela semble constituer les organes d'une machine difforme, qui n'a jamais pu fonctionner. Et pourtant elle a été en action pendant des siècles et des siècles, et a donné à Rome la domination du monde méditerranéen ; et quand elle s'est détraquée, c'est arrivé parce qu'elle était employée par un peuple nouveau qui n'avait plus la « religio » de l'ancien (§ 247). Grâce aux liaisons (sens mécanique) des actions non-logiques, et grâce à des forces innovatrices, Rome a su concilier la discipline avec la liberté, et s'est tenue dans un juste milieu entre Athènes et Sparte.
§ 243. Le discours que Thucydide [FN: § 243-1] attribue à Périclès et celui de Cicéron sur la réponse des aruspices, forment un contraste qui frappe.
L'Athénien parle comme un homme moderne. La prospérité d'Athènes est due à la démocratie, à de justes lois, au bon sens des citoyens, à leur courage. Ces qualités des Athéniens font qu'Athènes est supérieure aux autres cités de la Grèce.
Le Romain loue beaucoup moins la science et le courage de ses concitoyens [FN: § 243-2] :
« Quel que soit l'amour que nous ayons pour nous-mêmes, Pères Conscrits, nous n'avons été supérieurs ni aux Espagnols par le nombre, ni aux Gaulois par la force, ni aux Carthaginois par la ruse, ni aux Grecs par les arts, ni aux Italiens eux-mêmes et aux Latins par le bon sens naturel de notre pays. Mais, nous avons vaincu tous les peuples et toutes les nations par la piété et par la religion, et aussi par la sagesse qui nous a fait reconnaître que tout est dirigé et gouverné par les dieux immortels ». Il semble que ce soit là le langage du préjugé ; et c'est, au contraire, celui de la raison, surtout si l'on prend le mot « religion » au sens que nous avons indiqué. La cause de la prospérité des Romains fut un certain nombre de liaisons, de « religiones », qui conservaient la discipline à ce peuple. Il est vrai que Cicéron ne l'entendait pas ainsi ; il se proposait de parler de la puissance des dieux immortels ; mais le concept de la règle, des liaisons, ne manquait pas chez lui. Il a commencé par louer la sagesse des ancêtres, « qui ont pensé que les rites sacrés et les cérémonies regardent les pontifes ; les présages heureux, les augures ; que les antiques prédictions d'Apollon sont contenues dans les livres sybillins, et que l'explication des prodiges appartient à la doctrine des Étrusques [FN: § 243-3] ».
C'est là une conception vraiment toute romaine de l'ordre et de la régularité.
§ 244. Parmi les peuples modernes, les Anglais ressemblent plus que tout autre peuple aux Romains, pour l'état psychique [FN: § 244-1] , du moins jusque vers la fin du XIXe siècle. Leur droit est encore plein de fictions. Leur organisation politique conserve les mêmes noms, les mêmes formes arriérées, tandis que le fond change continuellement. Il y a encore un roi en Angleterre, comme au temps des Plantagenets, des Tudors, des Stuarts ; mais il a fini par avoir moins d'autorité, moins de pouvoir que le président de la république des États-Unis d'Amérique. Sous Charles 1er, on voit éclater une guerre civile que le roi, dans son parlement, faisait au roi, dans son camp. Jammais les Romains n.avaient imaginé une aussi ingénieuse fiction.
Aujourd'hui encore, les cérémonies pour l'ouverture du parlement sont archaïques au point de paraître comiques. On voit arriver aux Communes un grave personnage, appelé the gentleman usher of the black rod, qui les invite à se présenter à la Chambre des Lords, pour entendre le discours du trône. Les députés vont à la Chambre des Lords, puis retournent à leur place, où le speaker leur raconte avec le plus grand sérieux ce qu'ils ont entendu aussi bien que lui. Il faut immédiatement donner lecture d'un bill, seulement pour la forme, afin de sauvegarder le droit du parlement, de discuter en premier les affaires, sans examiner les motifs de la convocation.
Cette organisation politique s'adapte aux besoins du peuple anglais, comme l'organisation politique de l'ancienne Rome s'adaptait aux besoins du peuple romain ; et tous les peuples modernes ont cherché à la copier plus ou moins fidèlement, Cette organisation a permis à l'Angleterre de rester victorieuse dans les guerres de Napoléon 1er, et assura aux Anglais une liberté plus grande que celle dont jouirent la plupart des peuples européens. Tout cela tend maintenant à se modifier, grâce à des coutumes et des habitudes nouvelles, qui semblent prendre pied en Angleterre.
§ 245. Dans l'exposé fait jusqu'ici, nous avons dû nous servir des termes du langage ordinaire, qui, de leur nature, sont peu rigoureux. Pour le moment, nous ne nous occuperons que des termes: Athéniens, Romains, etc., employés plus haut.
Que représentaient précisément ces termes ? Certainement, pour les peuples antiques, ils ne représentaient que les citoyens, tandis que les esclaves, les pérégrins étaient exclus. Mais nos propositions s'appliquent-elles vraiment à tous les citoyens ? De certains faits, de certains actes, de certaines lois ou coutumes, nous avons déduit l'état psychique de ceux qui exécutèrent ces faits et ces actes, qui acceptaient ces lois et ces coutumes. C'est légitime ; mais dire que ceux-ci constituaient la totalité ou même la majorité numérique de la nation, ne le serait pas du tout.
§ 246. Tout peuple est gouverné par une élite [FN: § 246-1] et, pour être exact, nous devons dire que c'est justement l'état psychique de cette élite que nous avons observé. Tout au plus pouvons-nous ajouter que l'impulsion qu'elle a donnée était admise par le reste de la population.
Une élite peut se modifier par le changement des hommes qui la composent, ou de leurs descendants, ou aussi par l'infiltration d'éléments étrangers, qui peuvent provenir de la nation elle-même ou d'une autre. À Athènes, quand seuls les fils des citoyens athéniens étaient citoyens, l'élite a pu se modifier uniquement parce que ses membres changeaient, ou qu'elle en recevait d'autres du corps des citoyens athéniens.
§ 247. À Rome, non seulement on peut observer des changements analogues, mais il y a aussi une infiltration de peuples étrangers, soit de Latins et d'Italiens, par l'extension du droit de cité, soit de toutes sortes de peuples, même barbares, grâce aux affranchis et à leurs descendants. P. Scipion Émilien pouvait déjà dire aux individus composant la plèbe qui se livrait à un tumulte, qu'ils n'étaient pas même Italiens [FN: § 247-1] . Nous devons donc nous tenir en garde contre des conclusions hâtives qu'on pourrait tirer des exemples que nous avons cités. Nous avons bien trouvé les caractères de certaines élites ; mais nous n'avons pas résolu le problème de leur composition.
§ 248. Ces considérations nous conduisent à la limite au delà de laquelle on pénètre dans une matière d'une nature différente de celle dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent. Il serait prématuré de pousser plus avant, et dangereux de le faire sans avoir terminé d'abord l'étude commencée. Revenons-y donc. L'excursion de tout à l'heure était nécessaire, pour nous faire connaître au moins l'existence de cette autre matière. Nous l'étudierons dans les derniers chapitres.
[150]
Chapitre III↩
Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines [(§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204]
§ 249. Outre certaines inductions accessoires, l'étude accomplie au chapitre précédent nous a fait connaître les faits suivants :
1° L'existence et l'importance des actions non-logiques. Cela est contraire à beaucoup de théories sociologiques, qui dédaignent ou négligent les actions non-logiques, ou leur donnent peu d'importance, en s'efforçant de rendre toutes les actions logiques. La voie à suivre pour étudier les actions des hommes en relation avec l'équilibre social sera différente, suivant qu'on donnera une importance plus grande aux actions non-logiques ou aux actions logiques. Il faut donc maintenant que nous pénétrions dans cette matière.
2° Les actions non-logiques sont généralement considérées au point de vue logique par ceux qui les accomplissent ou par ceux qui en traitent, qui en font la théorie. De là la nécessité d'une opération de prime importance pour notre étude, laquelle tend à lever ces voiles et à retrouver les choses qu'ils dissimulent. C'est aussi contraire à beaucoup de théories qui s'arrêtent aux voiles, non tenus pour tels, mais pris pour la partie fondamentale des actions. Nous devons examiner ces théories ; parce que si nous les trouvions vraies – c'est-à-dire d'accord avec l'expérience, – nous devrions prendre une tout autre voie que celle qu'il conviendrait de suivre, si nous reconnaissions que la partie fondamentale est au contraire la chose voilée.
3° La vérité expérimentale d'une théorie et son utilité sociale sont des choses différentes. Une théorie expérimentalement vraie peut être utile – ou nuisible – à la société, comme aussi une théorie expérimentalement fausse. Un très grand nombre de personnes le nient. Il ne faut donc pas nous contenter des quelques aperçus du chapitre précédent, et moins que jamais de la simple affirmation du § 34 ; mais nous devons voir si l'observation des faits confirme ou dément l'induction faite (§ 14).
4° Il existe des différences entre les hommes, ou, si l'on envisage les choses en gros, entre les classes sociales, à propos des actions logiques et non-logiques. Il existe aussi des différences entre les degrés d'utilité que les théories expérimentalement vraies ou fausses et les sentiments manifestés par les actions non-logiques, peuvent avoir pour ces individus ou ces classes. Beaucoup nient cette différence, qui excite même l'indignation d'un assez grand nombre de gens. Il sera, par conséquent, nécessaire de poursuivre l'étude à peine commencée sur cette matière, et de bien voir ce que nous disent les faits.
§ 250. En attendant, l'étude qui vient d'être faite nous donne déjà une idée, superficielle c'est entendu, des réponses à faire aux questions effleurées aux § 13 et 14, et nous voyons que certaines distinctions faites dans ces paragraphes ne sont pas seulement hypothétiques, mais correspondent à la réalité.
§ 251. Dans le présent chapitre, nous nous occuperons surtout de déceler les actions non-logiques, dans les théories ou les descriptions des faits sociaux, données par différents auteurs ; de cette manière, nous acquerrons aussi une idée approximative des voiles qui cachent ces actions non-logiques.
§ 252. Si vraiment les actions non-logiques ont l'importance suggérée par l'induction du chapitre précédent, il serait étrange, en vérité, que les hommes intelligents qui se sont occupés de l'étude des sociétés humaines n'y eussent prêté aucune attention. Ils peuvent les avoir entrevues, distraits par des préjugés, détournés par des théories erronées ; mais il est difficile de croire qu'ils n'aient réellement rien vu de ce que nous trouvons maintenant si important. Cherchons donc ce qui en est.
§ 253. Pour cela, il faut envisager les choses d'une façon encore plus générale ; c'est-à-dire chercher comment la réalité se trouve transformée dans les théories et narrations qu'en donnent les auteurs. Nous avons une image sur un miroir courbe, et nous voulons retrouver la forme de l'objet, altérée par le miroir. Pour le moment, laissons de côté les cas les plus simples, par exemple des auteurs qui reconnaissent que les actions des hommes dépendent, au moins en partie, du territoire où ils vivent, du climat, de la race, des occupations, des inclinations. Il est manifeste que l'action déterminée par ces causes n'est pas le fruit du raisonnement pur, mais que c'est une action non-logique. Et pourtant, les auteurs mêmes qui ont admis ces causes ne s'en rendent souvent pas compte. Il y aurait donc chez eux une contradiction; mais parfois elle disparaît, car lorsqu'ils admettent ces causes, les auteurs étudient ce qui est ; quand ils veulent que toutes les actions soient logiques, ils étudient ce qui, d'après eux, devrait être. Ils passent d'une étude scientifique à un prêche.
§ 254. Abordons des cas moins simples, et commençons par ceux dans lesquels il est plus facile de reconnaître la vérité expérimentale, sous des expressions imparfaites et en partie erronées, pour procéder ensuite à l'étude d'autres cas, dans lesquels cette recherche est plus difficile.
Voici par exemple un livre: La Cité Antique, de Fustel de Coulanges. Nous y lisons : « (p. 73) De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il résulte clairement que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme à s'approprier la terre, et qui lui a assuré son droit sur elle ». Mais il est vraiment singulier que la religion domestique ait précédé la possession du sol. L'auteur n'en donne aucune preuve. Il se pourrait aussi que ce fût le contraire, ou que la religion et la possession se fussent développées ensemble. Il est manifeste que l'auteur a l'idée préconçue que la possession doit avoir une cause. Ceci posé, il la cherche et la trouve dans la religion. Ainsi, posséder devient une action logique, déduite, de la religion qui, à son tour, pourra se déduire logiquement de quelque autre chose.
Par une circonstance singulière, notre auteur nous donne ici, lui-même, la rectification que nous devons apporter. Il avait écrit un peu plus haut : « (p. 63) Il y a trois choses que, dès l'âge le plus ancien, on trouve fondées et solidement établies dans ces sociétés grecques et italiennes : la religion domestique, la famille, le droit de propriété ; trois choses qui ont eu entre elles, à l'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir été inséparables ».
Comment l'auteur n'a-t-il pas vu que ces deux passages étaient en contradiction ? Si trois choses A, B, C, sont « inséparables », l'une d'elles, par exemple A, ne peut en produire une autre, par exemple 2; car si A produit B, cela veut dire qu'elle en était alors séparée.
Il faut donc nécessairement faire un choix entre ces deux propositions du même auteur. Si nous voulons conserver la première, il convient d'éliminer la seconde ou vice-versa. Or, nous devons adopter ce dernier choix, c'est-à-dire éliminer la proposition qui place la religion et la propriété dans une relation de cause à effet, et conserver la proposition qui met ces choses en relation de mutuelle dépendance (§ 996). Les mêmes faits, cités par Fustel de Coulanges, nous imposent ce choix. Quand il écrit : « (p. 64) Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupée autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même », spontanément surgit l'observation : « Oui, pourvu que ce soit possible ». Supposons un état social, tel que la famille ne puisse se fixer au sol, et, dans ce cas, ce sera la religion qui devra se modifier. Il est manifeste qu'il y a eu une série d'actions et de réactions, sans qu'on puisse déterminer comment elles ont commencé. Le fait qu'il est arrivé à certains hommes de vivre en familles séparées et fixées au sol, a eu comme manifestation une certaine forme de religion ; laquelle, à son tour, a contribué à maintenir les familles séparées et fixées au sol.
§ 255. Nous découvrons, dans le cas présent, un exemple d'une erreur très générale, qui consiste à substituer des relations de cause à effet à des relations de mutuelle dépendance (§ 137). Cette erreur en produit une autre, en plaçant dans la classe des actions logiques, l'effet que l'on prend à tort pour une conséquence logique de la cause.
§ 256. Quand Polybe nous donnera la religion comme une des causes de la puissance romaine, nous accepterons cette remarque, qui a une grande valeur ; mais nous repousserons l'explication logique qu'il donne du fait (§ 313-1] ).
Dans l'Ancient Law de Sumner Maine, nous trouvons un autre exemple, semblable à celui de Fustel de Coulanges. Sumner Maine observe que les sociétés antiques étaient constituées par des familles. C'est une donnée de fait que nous ne voulons pas discuter [FN: § 256-1] . De là, il tire la conséquence que le droit antique était adapté (adjusted) [FN: § 256-2] « (p. 126) à un système de petites corporations indépendantes ». Cela aussi est bien ; les institutions s'adaptent à l'état de choses. Mais plus loin, voici que le concept des actions logiques s'insinue en tapinois [FN: § 256-3]. « (p. 183) Les hommes sont considérés et traités non comme individus, mais toujours comme parties d'un groupe spécial ». Il serait plus précis de dire que telle est la réalité, et que, par conséquent, le droit se développe comme s'ils étaient considérés et traités comme parties d'un groupe spécial.
Avant cette dernière observation, l'intromission des actions logiques est plus manifeste. Après le passage que nous avons cité, où l'on observait que la société antique était composée de petites corporations indépendantes, l'auteur ajoute [FN: § 256-4] : « (p. 126) Les corporations ne meurent jamais, et par conséquent le droit primitif considère les entités dont il s'occupe, c'est-à-dire les groupes patriarcaux de familles, comme perpétuels et inextinguibles ». De là, Sumner Maine tire comme conséquence l'institution de la transmission, au décès, de 1'universitas iuris, que nous trouvons dans le droit romain. Cela peut bien être d'accord avec une analyse logique postérieure, d'actions non-logiques antérieures, mais ne représente pas précisément les faits. Pour nous en approcher, il faut intervertir quelques termes des observations précédentes. La succession de l'universitas iuris ne procède pas du concept d'une corporation qui ne s'éteint jamais ; c'est au contraire celui-ci qui procède de celle-là. Une famille ou un autre groupe ethnique occupait un terrain, avait des troupeaux, etc. Le fait de la perpétuité de l'occupation, de la possession, est, suivant toute probabilité, antérieur à tout concept abstrait, et à tout concept de droit de succession, puisque nous le voyons même chez les animaux. Les grands félins occupent un certain territoire de chasse, qui demeure propre à la famille, si l'homme ne vient pas la déranger [FN: § 256-5] . La fourmilière est perpétuelle ; et il ne paraît pas probable que les fourmis aient le concept de la corporation ni celui de la succession. Chez l'homme, au contraire, le fait engendra le concept. Puis, l'homme étant un animal logique, il voulut trouver le pourquoi du fait ; et parmi toutes les explications qu'il imagina, il peut bien y avoir eu aussi celle que donne Sumner Maine.
Cet auteur est l'un de ceux qui ont le mieux montré la différence qui existe entre le droit-fait et le droit-théorie ; et pourtant il l'oublie à chaque instant, tellement est ancrée l'idée qui fait voir partout des actions logiques. Le droit-fait est constitué par un ensemble d'actions non-logiques qui se répètent régulièrement. Le droit-théorie comprend deux parties, soit 1° une analyse logique – ou pseudo-logique ou même imaginaire – de ces actions non-logiques ; 2° des conséquences des principes que cette analyse a déduits. Le droit-fait n'est pas seulement primitif ; il vit à côté du droit-théorie, s'insinue à la dérobée dans la jurisprudence et la modifie ; puis vient un jour où l'on fait la théorie de ces modifications ; la chenille devient papillon ; le droit-théorie possède un nouveau chapitre.
§ 257. Quand Duruy [FN: § 257-1] écrit, à propos de l'assassinat de César : « (p. 411) Depuis la fondation de la république, l'aristocratie romaine avait adroitement nourri dans le peuple l'horreur pour le nom de roi », nous reconnaissons aussitôt le vernis logique des actions non-logiques. Et quand ensuite notre auteur ajoutera : « (p. 411) Si la solution monarchique répondait aux besoins du temps, il était à peu près inévitable que le premier monarque payerait de sa vie sa royauté, comme notre Henri IV a payé de la sienne sa couronne », nous verrons bientôt dans les « besoins du temps », une de ces bonnes fictions que l'on veut nous donner pour quelque chose de concret ; et quant à la loi suivant laquelle les premiers monarques de chaque dynastie doivent être assassinés, comme l'histoire ne nous en donne pas la preuve expérimentale, nous y verrons une simple réminiscence du fatum, et nous l'enverrons tenir compagnie aux nombreux et fantaisistes produits semblables de l'imagination.
§ 258. Nous éliminerons de l'histoire, sans chercher à les interpréter, les prodiges que Suétone n'oublie jamais de raconter, à l'occasion de la naissance ou de la mort des empereurs ; parce que nous verrons combien cette voie serait trompeuse (§ 672 et sv.); et nous retiendrons seulement les faits qui sont ou du moins paraissent être historiques. Nous en ferons autant dans tout autre cas semblable, par exemple pour les histoires des Croisades.
Mais il faut prendre garde ici que nous sommes engagés sur une voie dangereuse ; et nous verrons que si l'on prenait comme règle absolue de diviser un récit en deux parties, l'une miraculeuse, incroyable, que l'on rejette, et une autre, naturelle, croyable, que l'on conserve, on irait certainement au devant de très grosses erreurs (§ 674). Il faut que la partie que l'on accepte ait des probabilités extrinsèques de vérité, soit à cause des qualités connues de l'auteur, soit par l'accord d'autres témoignages.
§ 259. Nous ne pouvons rien tirer d'historique de la légende. Mais nous pouvons en déduire quelque chose, et souvent beaucoup, quant à l'état psychique des hommes qui l'ont créée ou acceptée. Or notre étude a justement la connaissance de ces états psychiques pour fondement. Aussi nous arrivera-t-il souvent de citer des faits sans rechercher s'ils sont historiques ou légendaires ; car, pour ce que nous en voulons tirer, ils nous servent également bien, dans l'un et l'autre cas ; quelquefois même, les faits légendaires nous sont plus utiles que les faits historiques.
§ 260. L'interprétation logique d'actions non-logiques devient à son tour une cause d'actions logiques, et quelquefois même d'actions non-logiques. On doit par conséquent l'envisager aussi, pour déterminer l'équilibre social. À ce point de vue, l'interprétation du vulgaire a généralement plus d'importance que celle des théoriciens. Pour étudier l'équilibre social, il importe beaucoup plus de savoir ce que le vulgaire entend par vertu, que de connaître ce qu'en pensent les philosophes.
§ 261. Il y a fort peu d'auteurs qui omettent entièrement d'envisager les actions non-logiques. Elles apparaissent généralement dans la considération de certaines inclinations naturelles, que, bon gré mal gré, l'auteur doit pourtant reconnaître aux hommes. Mais l'éclipse des actions logiques dure peu : chassées ici, elles reparaissent là. On réduit ces inclinations au minimum, et l'on suppose que les hommes en tirent des conséquences logiques et agissent d'après elles.
§ 262. Cela d'une façon générale ; mais en particulier les théoriciens ont de plus un autre motif, très puissant, pour substituer les actions logiques aux non-logiques. Si nous supposons que certaines actions sont logiques, il devient beaucoup plus facile d'en faire la théorie, que si nous les supposons non-logiques ; car chacun de nous a dans son propre esprit l'instrument qui fait les déductions logiques ; aussi n'a-t-il pas besoin d'autre chose ; tandis que pour les actions non-logiques, il faut recourir à l'observation de nombreux faits, étendre en outre les recherches dans l'espace et dans le temps, et prendre garde de n'être pas induit en erreur par des documents imparfaits. En somme, c'est un travail long et difficile, que doit accomplir celui qui veut édifier une théorie, pour trouver en dehors de lui les matériaux que son esprit lui offrait directement par le secours de la logique seule, dans le cas des actions logiques.
§ 263. Si l'économie politique est beaucoup plus avancée que la sociologie, cela dépend en grande partie du fait qu'elle étudie des actions logiques [FN: § 263-1] . Elle aurait été dès le début une science très bien constituée, si elle n'avait rencontré un grave obstacle dans le fait que les phénomènes étudiés étaient mutuellement dépendants, alors que les personnes qui s'adonnaient à cette étude étaient incapables de suivre l'unique voie qui nous soit connue, pour tenir compte de la dépendance mutuelle. L'obstacle indiqué fut surmonté, au moins en partie, quand on employa la mathématique dans l'étude des phénomènes économiques ; et l'on constitua de cette manière une science, c'est-à-dire l'économie mathématique, qui peut aller de pair avec d'autres sciences naturelles. [Voir Addition A11 par l’auteur]
§ 264. D'autres motifs agissent pour éloigner les théoriciens, du champ des actions non-logiques, et pour les refouler dans celui des actions logiques. La majeure partie de ces théoriciens ne se contentent pas d'étudier ce qui est, mais veulent savoir, et surtout enseigner à autrui ce qui devrait être. Dans cette dernière recherche, la logique est pour eux souveraine ; et sitôt qu'ils ont reconnu l'existence des actions non-logiques, au lieu de suivre la voie sur laquelle ils se sont engagés, ils dévient, souvent paraissent oublier ces actions non-logiques, généralement les négligent et suivent la voie qui conduit aux actions logiques.
§ 265. On élimine de même les actions non-logiques, en les considérant, – à l'ordinaire sans le dire explicitement, – comme une chose blâmable ou pour le moins hors de propos, et qui ne devrait pas se voir dans une société bien policée. On les considère, par exemple, comme des superstitions qui doivent être extirpées par l'usage de la raison. Personne, en pratique, n'agit comme s'il croyait que le physique et le moral d'un homme n'avaient au moins une part dans la détermination de ses actes. Mais quand on fait une théorie, on admetvolontiers que l'homme doit être mu seulement par la raison, et l'on ferme volontairement les yeux sur ce que la pratique journalière vous enseigne.
§ 266. L'imperfection scientifique du langage ordinaire contribue aussi à élargir les interprétations logiques d'actions non-logiques.
§ 267. Elle n'est pas étrangère à la confusion que l'on a coutume de faire, quand on prend deux phénomènes comme cause et effet, seulement parce qu'on les rencontre ensemble. Nous avons déjà fait allusion à cette erreur (§ 16) ; mais il faut maintenant que nous pénétrions un peu plus avant dans son étude, car elle n'est pas de menue importance pour la sociologie.
Soit comme au § 166, C, une croyance, D, certaines actions. Au lieu de dire simplement : « Certains hommes font D et croient C », le langage ordinaire ajoute quelque chose, en exprimant que « certains hommes font D, parce qu'ils croient C ». Prise dans son sens rigoureux, cette proposition est souvent fausse ; et la proposition suivante l'est moins souvent : « Certains hommes croient C, parce qu'ils font D ». Mais il y a aussi de nombreux cas dans lesquels on peut dire seulement : «Certains hommes font D et croient C ».
On peut aussi faire disparaître la rigueur logique du terme parce que, employé dans la première des trois propositions précédentes, en excluant qu'il établisse, dans cette proposition, un rapport de cause à effet entre C et D ; on dira donc : « Nous pouvons admettre que certains hommes font D, parce qu'ils ont une croyance C, par laquelle se manifestent justement les sentiments qui les poussent à faire D » ; c'est-à-dire, en se rapportant à la fig. 3, parce qu'ils ont un état psychique A, manifesté par C. Sous cette forme, la proposition approche beaucoup de la vérité, comme nous avons vu au § 166.
§ 268. La figure 3 peut se décomposer en trois autres :
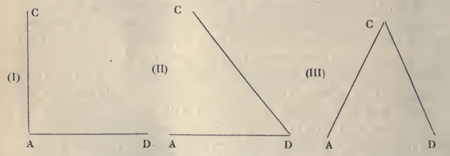
Figure 7
(I) L'état psychique A produit la croyance C et les actes D, qui n'ont entre eux aucun rapport direct. C'est le cas indiqué par la troisième des propositions formulées.
(II) L'état psychique A fait naître les actions D, et tous deux produisent la croyance C. C'est le cas indiqué par la seconde des trois propositions.
(III) L'état psychique A fait naître la croyance C, qui est cause des actions D. C'est le cas indiqué par la première des trois propositions.
§ 269. Bien que le cas (III) ne soit pas le seul ni le plus fréquent, les hommes inclinent à le croire général, et à le confondre avec les ras (I) et (II), dont ils ne veulent tenir compte que peu ou pas du tout. Le langage courant favorise l'erreur par son défaut de précision, parce qu'on énonce explicitement le cas (III), tandis que sans s'en apercevoir, on pense aussi aux cas (I) et (II). Ensuite il arrive souvent qu'on a des mélanges de ces trois cas, en proportions variées.
§ 270. Voyons maintenant des exemples concrets de raisonnements de divers auteurs. Dans sa Politique, Aristote commence ainsi [FN: § 270-1] : « Comme nous voyons que toute cité est une société, et que toute société est constituée en vue de quelque bien, (puisque tous agissent pour accomplir ce qui leur paraît bien), il est manifeste que toutes les sociétés recherchent quelque bien... ». Ici nous sommes entièrement dans le domaine des actions logiques : de propos délibéré et en vue d'accomplir un certain bien, les hommes ont constitué la société qui s'appelle cité. Il semblerait donc qu'Aristote va tomber dans les absurdités du contrat social ; mais il n'en est rien ; il dévie aussitôt ; et le principe qu'il a posé tout à l'heure lui servira à rechercher ce que doit être une cité, plutôt qu'à étudier ce qu'elle est.
§ 271. À peine Aristote a-t-il énoncé son principe d'une association en vue d'un certain bien, qu'il le met de côté et nous propose une autre origine de la société. D'abord, il remarque la nécessité de l'union des sexes, et observe très bien que « cela n'a pas lieu par choix volontaire [FN: § 271-1] ». Nous entrons ainsi manifestement dans le domaine des actions non-logiques. Il continue en disant: « (I, 1, 4) la Nature a fait certains êtres pour commander et d'autres pour obéir ». La Nature a distingué parmi les Grecs la femme et l'esclave ; elle ne l'a pas fait parmi les Barbares, parce que chez eux la Nature n'a pas fait d'êtres pour commander. Nous restons donc dans le domaine des actions non-logiques, et nous y sommes toujours, quand l'auteur nous dit que les deux associations du maître et de l'esclave, du mari et de la femme, sont le fondement de la famille ; quand il remarque ensuite que le village est constitué de plusieurs familles ; quand il poursuit en observant que plusieurs villages forment un État ; et quand il conclut finalement en ces termes explicites : « Donc toute cité vient de la Nature, de même que les premières associations [FN: § 271-2] ».
Il est impossible de mentionner plus clairement des actions non-logiques.
§ 272. Mais si la cité vient de la Nature, elle ne vient pas de la volonté arrêtée des citoyens qui s'associent en vue d'un certain bien. Il y a ici contradiction entre le principe posé tout d'abord et la conclusion à laquelle on arrive. [Voir Addition A12 par l’auteur] Nous ne pouvons savoir comment Aristote est tombé dans cette contradiction ; mais qui voudrait la reproduire n'aurait qu'à procéder ainsi. Qu'il pense d'abord exclusivement à l'idée de cité ou d'État : il s'établira facilement une relation avec l'idée d'association, et entre celle-ci et l'idée d'un groupement volontaire d'hommes. On obtient ainsi le premier principe. Puis, qu'il pense aux nombreuses idées suggérées par les faits qu'on observe dans une cité ou dans un État, soit à la famille, aux maîtres et aux esclaves, etc.; le propos délibéré ne s'ajustera pas à ces idées, qui suggéreront au contraire celle de quelque chose qui se développe naturellement. Nous aurons ainsi la seconde description d'Aristote.
§ 273. Il fait tomber la contradiction, grâce à la métaphysique, qui ne refuse jamais son secours dans ces cas désespérés. Reconnaissant les actions non-logiques, il dit: « (I, 1, 13) Il est donc manifeste que la cité vient de la Nature, et qu'elle s'impose à l'homme.. C'est par conséquent de la Nature que vient chez tous la tendance à cette association. Aussi le premier qui l'institua fut-il cause d'un très grand bien ». Il y a donc la tendance donnée par la Nature ; mais il faut en outre qu'un homme institue la cité. À l'action non-logique, on superpose une action logique (§ 306-I β) ; et cela ne peut manquer, parce que, dit Aristote, la Nature ne fait rien en vain [FN: § 273-1] . Remercions donc cette excellente dame Nature, qui sait tirer d'embarras les philosophes avec tant d'à-propos.
§ 274. En séparant les Grecs des Barbares, au moyen de sa théorie célèbre de l'esclavage naturel, Aristote recourt au concept des actions non-logiques. Il est entre autres manifeste que la logique étant la même pour les Grecs et pour les Barbares, si toutes les actions étaient logiques, il ne pourrait y avoir aucune différence entre ces nations. Ce n'est pas tout. En bon observateur qu'il est, Aristote remarque aussi des différences parmi les citoyens. À propos des formes de la démocratie, il dit: « (VI, 2, 1) Le meilleur peuple est celui des agriculteurs ; par conséquent, on peut instituer la démocratie là où le peuple vit de l'agriculture et de l'élevage des troupeaux ». Il répète : « (VI, 2, 7) Après les agriculteurs, le meilleur peuple est celui des bergers, qui vit de ses bestiaux... Les autres agrégats dont sont constituées les autres démocraties sont très inférieurs ». Voilà donc des classes bien distinctes de citoyens, et presque une ébauche du matérialisme économique.
Il n'y a pas de motif pour nous arrêter là. Si nous poursuivons, nous voyons qu'en général les actions des hommes dépendent du tempérament de ces hommes et de leurs occupations.
Cicéron [FN: § 274-1] attribue aux ancêtres des Romains de son temps le mérite d'avoir su que « les coutumes des hommes procèdent moins de la race et de l'origine, que de ces éléments fournis aux habitudes ordinaires par la nature même des lieux, et dont nous tirons vie et subsistance. Les Carthaginois étaient déloyaux et menteurs, non par inclination, mais de par la nature du pays, dont le port et les relations avec de nombreux marchands et étrangers les poussaient à chercher des bénéfices en trompant autrui. Les montagnards liguriens sont rudes et agrestes... Les Campaniens sont toujours fiers, à cause de la fertilité de leur pays, de l'abondance de leurs moissons, de la salubrité, de l'étendue, de la beauté de leur cité ».
§ 275. Dans la Rhétorique [FN: § 275-1], Aristote fait une analyse restée célèbre, des caractères de l'homme à ses divers âges ; c'est-à-dire de l'adolescent, de l'homme fait, du vieillard. Il pousse encore plus loin l'analyse, en examinant l'effet de la noblesse, de la richesse, du pouvoir, sur les coutumes ; et toute cette étude est fort bien menée à terme. Mais ainsi l'auteur se trouve évidemment dans le domaine des actions non-logiques [FN: § 275-2].
§ 276. Il y a même l'idée de l'évolution. Dans la Politique II, 5, 12), Aristote observe que les ancêtres des Grecs ressemblaient probablement aux hommes vulgaires et ignorants qui existaient parmi ses contemporains.
§ 277. Si Aristote avait suivi la voie qu'il avait partiellement si bien parcourue, nous aurions eu, dès son époque, une sociologie scientifique. Pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? Il y a eu peut-être à cela de nombreux motifs; mais il paraît probable que parmi les principaux, se trouve ce besoin d'applications pratiques prématurées, qui s'oppose toujours au progrès de la science ; sans compter la manie de prêcher aux gens ce qu'ils doivent faire, préoccupation d'ailleurs plus qu'inutile, au lieu d'étudier ce qu'ils font. L'Histoire des Animaux échappe à ces causes d'erreurs ; et c'est peut-être pour cela qu'elle est scientifiquement très supérieure à la Politique.
§ 278. Il paraît étrange de trouver quelque vestige des actions non-logiques chez un rêveur comme Platon ; et pourtant c'est un fait certain. On voit apparaître cette idée dans les motifs qu'allègue Platon pour fonder sa colonie loin de la mer [FN: § 278-1] . Le fait d'en être voisin commence par être doux, mais finit par être amer à une cité ; « car la ville, se remplissant de commerce et de trafic, engendre des coutumes déloyales et instables et des esprits trompeurs ».
On trouve en outre les actions non-logiques dans l'apologue de Platon, bien connu, sur les races d'hommes. Le dieu qui a créé les hommes a mis de l'or dans la composition de ceux qui sont aptes à gouverner, de l'argent dans la composition des gardiens de la république (c'est-à-dire des guerriers), du fer dans la composition de ceux qui s'occupent d'agriculture et d'autres travaux.
Platon a aussi une vague idée de la circulation des élites. Il sait qu'il peut arriver que des hommes de la race d'argent naissent de la race d'or, et vice versa, et qu'il peut en être de même pour les autres races [FN: § 275-2] .
§ 279. Ceci posé, si l'on veut rester dans le domaine scientifique, il convient de rechercher quels seront les caractères, quelle sera l'évolution d'une collectivité constituée par diverses races d'hommes qui ne se reproduisent pas précisément avec les mêmes caractères, et qui peuvent se mélanger. On travaillerait ainsi à constituer la science des sociétés. Mais Platon a un tout autre but : il s'inquiète peu de ce qui est, et emploie tout son effort intellectuel à trouver ce qui doit être. Les actions non-logiques disparaissent alors, et la fantaisie de l'auteur se donne libre cours avec les actions logiques, qu'il invente en masse. Voilà notre philosophe qui institue à peu de frais des magistrats chargés de remettre à la place qu'il aurait dû occuper celui qui, dans une race, naîtrait avec des caractères différents de ceux de ses parents ; le voilà qui se met à édicter des lois pour maintenir et modifier les mœurs ; le voilà, en somme, qui abandonne la modeste tâche de la science pour s'élever aux régions sublimes de la création.
§ 280. Les controverses sur cette question : « la vertu peut-elle être enseignée ? » nous révèlent aussi une conception vague des actions non-logiques. D'après les documents que nous connaissons, il paraîtrait que Socrate estimait que la « vertu » est une « science », et qu'il laissait par conséquent peu de place aux actions non-logiques [FN: § 280-1]. Platon et Aristote abandonnent cette attitude extrême. Ils pensent qu'une certaine inclination naturelle est nécessaire à la « vertu ». Mais sitôt que cette disposition naturelle est supposée, nous rentrons dans le domaine de la logique, qui est chargée d'en tirer les conséquences nécessaires ; lesquelles donnent leur forme aux actions humaines. Ces controverses ressemblent sur certains points à celles qui eurent lieu, longtemps après, sur la grâce efficace et la grâce non efficace.
§ 281. Le procédé de Platon et d'Aristote, dans les controverses sur l'enseignement de la « vertu », est général. Suivant ce procédé, on attribue aux actions non-logiques un rôle qu'il serait absurde de nier ; mais aussitôt on le rejette en revenant aux conséquences logiques. En outre, divisant en « bonnes » et « mauvaises » ces inclinations qu'on a été forcé d'admettre, on trouve moyen de conserver seulement celles qui se plient à son système logique, et d'éliminer les autres.
§ 282. Saint Thomas [FN: § 282-1] essaie aussi de louvoyer entre la nécessité d'admettre certaines inclinations non-logiques et son grand désir de donner plein pouvoir à la raison ; entre le déterminisme des actions non-logiques et la doctrine du libre arbitre, dans les actions logiques. Il dit que « la vertu est une bonne qualité ou habitude de l'esprit, grâce à laquelle on vit dans le droit chemin, dont personne n'use à tort, et que Dieu suscite en nous, sans nous ». On fait la part des actions non-logiques, en considérant la vertu comme une « habitude de l'esprit » ; et de même en disant que Dieu la suscite en nous, sans nous. Mais, par cette intervention divine, on fait disparaître l'incertitude de la fin des actions non-logiques, lesquelles deviennent logiques selon les desseins de Dieu, et par conséquent aussi pour les théologiens, qui ont le bonheur de connaître ces desseins. D'autres emploient la Nature, dans le même but et toujours avec le même effet. L'homme agit selon certaines inclinations ; voilà la partie des actions non-logiques réduite au minimum, parce que les actions sont supposées conséquences logiques des inclinations ; et l'on fait même disparaître cette infime partie, comme par un tour de passe-passe ; car ces inclinations sont supposées données, produites par une entité (Dieu, Nature ou autre), qui agit logiquement (§ 306 I β). De sorte que si ceux qui accomplissent les actions peuvent croire parfois exécuter des actions non-logiques, celui qui connaît les desseins ou le procédé logique de l'entité plus haut nommée, – et tous les philosophes, les sociologues, etc., ont ce privilège – celui-là sait que toutes les actions sont logiques.
§ 283. La controverse entre Herbert Spencer et Auguste Comte nous donne l'occasion de présenter quelques observations sur les actions non-logiques.
§ 284. Dans son Cours de Philosophie positive [FN: § 284-1], Auguste Comte paraît être décidément favorable à la prédominance des actions logiques. Il voit dans la philosophie positive « (p. 26) la seule base solide de la réorganisation sociale qui doit terminer l'état de crise dans lequel se trouvent depuis si longtemps les nations civilisées ». C'est donc une théorie qui doit réorganiser le monde. Comment cela aura-t-il lieu ?
« (p. 26) * Ce n'est pas aux lecteurs de cet ouvrage que je croirai jamais devoir prouver que les idées gouvernent et bouleversent le monde, ou, en d'autres termes, que tout le mécanisme social repose finalement sur des opinions. Ils savent surtout que la grande crise politique et morale des sociétés actuelles tient, en dernière analyse, à l'anarchie intellectuelle.* Notre mal le plus grave consiste, en effet, dans cette profonde divergence qui existe maintenant entre tous les esprits relativement à toutes les maximes fondamentales dont la fixité est la première condition d'un véritable ordre social. Tant que les intelligences individuelles n'auront pas adhéré par un assentiment unanime à un certain nombre d'idées générales, capables de former une doctrine sociale commune, on ne peut se dissimuler que l'état des nations restera, de toute nécessité, essentiellement révolutionnaire... Il est également certain que si cette réunion des esprits dans une même communion de principes peut une fois être obtenue, les institutions convenables en découleront nécessairement... ».
§ 285. Après avoir cité le passage que nous avons placé entre deux astérisques (*), Herbert Spencer [FN: § 285-1] expose une théorie d'actions non-logiques agissant exclusivement sur la société.
« (p. 115) Les idées ne gouvernent ni ne bouleversent le monde : le monde est gouverné ou bouleversé par les sentiments auxquels les idées servent seulement de guides. Le mécanisme social ne repose pas finalement sur des opinions, mais presque entièrement sur le caractère. Ce n'est (p. 116) pas l'anarchie intellectuelle, mais l'antagonisme moral, qui est la cause des crises politiques. Tous les phénomènes sociaux sont produits par l'ensemble des sentiments et des croyances humaines... Dans la pratique, le caractère national et l'état social déterminent les idées qui doivent avoir cours ; ce ne sont point (p. 117) les idées qui ont cours qui déterminent l'état social et le caractère national. La modification de la nature morale des hommes, produite graduellement par l'action continue de la discipline de la vie sociale, est la principale cause immédiate du progrès des sociétés » (Statique sociale, ch. XXX).
§ 286. Suit un fait singulier : c'est que ces auteurs échangent réciproquement leurs positions. Dans le Système de politique positive, A. Comte se décide à faire prévaloir le sentiment ; et, sur ce point, il s'exprime très clairement. « (p. 5) [FN: § 286-1] Quoique j'aie toujours proclamé l'universelle prépondérance du sentiment, je devais jusqu'ici fixer principalement l'attention sur l'intelligence et l'activité, qui prévalent en sociologie. Mais leur essor décisif ayant maintenant amené l'époque de leur vraie systématisation, cette destination finale conduit à faire explicitement dominer le sentiment, domaine essentiel de la morale ».
L'auteur s'éloigne quelque peu de la vérité, quand il affirme « avoir toujours proclamé l'universelle prépondérance du sentiment ». Dans le Cours de Philosophie positive, on ne trouve pas cette prépondérance ; et ce sont bien les idées qui occupent la première place. Mais A. Comte a changé d'opinion [FN: § 286-2] ; il a commencé par considérer les théories existantes, auxquelles il voulait en substituer d'autres de sa confection ; et alors, dans cette lutte des idées, les siennes l'emportaient naturellement, et ce sont elles qui devaient donner une vie nouvelle au monde. Avec le temps, A. Comte est devenu prophète. La lutte des idées est terminée. Il se figure avoir vaincu définitivement. Désormais il dicte le dogme, prononce ex cathedra ; il est donc naturel que seuls subsistent les sentiments, ses sentiments.
§ 287. En outre, A. Comte a commencé par espérer convertir les hommes, et naturellement le moyen d'y arriver était alors les idées. Mais il a fini par n'avoir d'autre espoir que celui d'une religion imposée, même par le tsar Nicolas, même par le Sultan ou tout au moins par Louis-Napoléon, qui aurait dû se contenter de n'être qu'un dictateur au service du positivisme [FN: § 287-1]. Là domine le sentiment, et l'on ne peut dire que « les idées gouvernent et bouleversent le monde ». Il serait absurde de supposer que A. Comte s'adressait au tsar, à Reschid pacha ou à Louis-Napoléon, pour les engager à prêcher les idées aux gens.
On pourrait seulement objecter que les idées de A. Comte déterminent la religion qui devrait ensuite être imposée aux hommes, et que, de cette manière, les idées auraient « bouleversé le monde », si le tsar, le Sultan, Louis-Napoléon ou quelque despote bien intentionné, avait voulu se charger d'imposer le positivisme de A. Comte. Mais cette signification n'est pas du tout celle des assertions du Cours de Philosophie positive.
§ 288. A. Comte reconnaît et exagère même beaucoup l'influence sociale du culte et la valeur qu'il a dans l'éducation ; ce qui n'est autre chose qu'un cas particulier de la valeur des actions non-logiques. Si A. Comte avait pu se résigner à n'être qu'un homme de science, il aurait pu écrire un livre excellent sur cette valeur du culte, et nous enseigner beaucoup de choses ; mais il voulait être le prophète d'une religion nouvelle. Au lieu d'étudier les effets des cultes qui ont existé ou qui existent, il en veut créer un nouveau ; ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous n'avons ainsi qu'un nouvel exemple des dommages causés à la science par la manie des applications pratiques.
§ 289. D'autre part, après avoir admis, trop exclusivement aussi, l'influence des actions non-logiques, H. Spencer les élimine entièrement par le procédé général que nous avons exposé au § 261. Il dit : « (52) [FN: § 289-1] Nous devons partir du postulat que les idées primitives sont naturelles, et, dans les conditions où elles se produisent, rationnelles ». Voici que la logique, chassée par la porte, rentre parla fenêtre. « Dans notre enfance, on nous a appris que la nature humaine est partout la même... Il faut rejeter cette erreur et y substituer le principe que les lois de la pensée sont partout les mêmes, et que, en admettant qu'il connaisse les données de ces conclusions, l'homme primitif tire des conclusions raisonnables » [FN: § 289-2] .
§ 290. Si l'on admet cela, H. Spencer se donne tort à lui-même dans sa controverse avec A. Comte. Si les hommes tirent toujours des conclusions logiques des données dont ils disposent, et s'ils agissent ensuite suivant ces conclusions, il ne reste plus que des actions logiques ; et ce sont alors « les idées qui gouvernent et bouleversent le monde ». Il n'y a plus de place pour les sentiments, auxquels H. Spencer voulait attribuer ce pouvoir ; ils ne peuvent en aucune façon s'introduire dans un ensemble complet, constitué par des faits expérimentaux, même mal observés, et par les conséquences logiques qu'on en tire.
§ 291. Le principe posé par H. Spencer rend les études sociologiques très faciles ; spécialement s'il est uni à deux autres principes du même auteur : celui de l'unité d'évolution et celui de l'identité ou de la quasi-identité des sauvages contemporains et des hommes primitifs (§ 728, 731). Les récits d'un voyageur, plus ou moins authentiques, plus ou moins bien interprétés, nous font connaître les données dont disposait l'homme primitif ; et quand ils font défaut, notre imagination supplée ; ne pouvant obtenir le vrai, elle trouve le vraisemblable. Maintenant nous avons tout ce qu'il faut pour constituer la sociologie, puisqu'il nous suffit de tirer simplement les conséquences logiques de ces données, sans perdre notre temps à des recherches historiques, longues et difficiles.
§ 292. C'est ainsi que procède H. Spencer, par exemple pour découvrir l'origine et l'évolution de la religion. L'homme primitif nous apparaît comme un homme de science moderne, qui, dans son laboratoire, travaille à construire une théorie. L'homme primitif ne dispose que de matériaux imparfaits ; c'est pourquoi, malgré ses raisonnements rigoureusement logiques, il n'en peut tirer que des conclusions imparfaites. Mais il a des concepts philosophiques fort subtils. Par exemple, H. Spencer donne comme « une idée primitive », « que toute propriété caractéristique d'un agrégat est inhérente à chacune de ses parties intégrantes » (Sociol., 154).
Qui veut connaître la valeur de cette théorie n'a qu'à répéter cette proposition à une personne d'entre les moins cultivées de notre société ; il verra immédiatement qu'elle ne comprend même pas ce qu'on veut lui dire. Et pourtant H. Spencer prétend qu'elle tire des conclusions logiques de cette proposition qu'elle ne comprend pas. « (154, p. 417) L'âme, présente dans le cadavre de l'homme mort conservé tout entier, est aussi présente dans les parties conservées de son corps. De là la foi aux reliques ». À coup sûr, notre auteur n'en a jamais parlé à quelque bonne femme catholique. La voie qu'il indique pourrait peut-être conduire à la foi aux reliques quelque philosophe épris de logique ; mais elle est entièrement étrangère à la foi populaire.
§ 293. De la sorte, sur quelques points, le procédé adopté par H. Spencer est semblable à celui dont use A. Comte. En général, on peut l'exprimer de la façon suivante. Nous avons deux choses, P et Q, dont il faut tenir compte pour déterminer l'organisation sociale R. On commence par affirmer que la chose Q détermine seule cette organisation ; puis on démontre que P détermine Q. De cette façon, la chose Q est éliminée, et c'est la chose P qui détermine exclusivement l'organisation sociale.
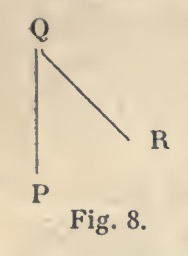
Figure 8
§ 294. Si Q désigne « les idées » et P « les sentiments », nous avons à peu près l'évolution des théories de A. Comte. Si Q désigne « les sentiments » et P « les idées », nous avons, toujours à peu près, l'évolution des théories de H. Spencer.
§ 295. Ce que nous venons d'exposer est confirmé par les observations de John Stuart Mill, à propos de la controverse entre A. Comte et H. Spencer. Il dit : « (p. 109) [FN: § 295-1] Un examen impartial de ce qu'a écrit M. Comte ne fera pas découvrir qu'il ait rien omis de la somme de vérité contenue dans la théorie de Spencer. Il n'aurait pas dit, vraiment (ce que M. Spencer veut apparemment nous faire dire), que les effets qu'on peut historiquement rapporter à la religion, par exemple, n'ont pas été produits par la croyance en Dieu, mais par la vénération et par la crainte qu'il inspirait. Il aurait dit que la vénération et la crainte présupposent la croyance qu'il faut croire en un Dieu avant de pouvoir le craindre ou le vénérer ». Nous retrouvons là le procédé indiqué tout à l'heure. P est la croyance qu'il existe un Dieu ; Q indique les sentiments de crainte et de vénération ; P produit Q, et devient ainsi la cause déterminante des actions.
§ 296. Il paraît absurde à un parfait logicien comme Mill, que l'on puisse éprouver un sentiment de crainte, s'il n'est logiquement déduit d'un sujet capable d'inspirer la crainte. Mill aurait dû se rappeler le vers de Stace [FN: § 296-1]
Primus in orbe deos fecit limor,
et il aurait vu qu'une voie diamétralement opposée à celle qu'il indique est parfaitement concevable [FN: § 3] . Cela posé, quelle est la voie suivie en réalité ? Ou mieux, quelles sont les différentes voies suivies ? C'est aux documents historiques à nous l'enseigner, et nous ne pouvons y substituer notre fantaisie, prendre pour réel ce qui nous paraît vraisemblable. Il faut savoir comment les faits se sont passés et non comment ils auraient dû se dérouler, pour satisfaire un esprit rigoureusement logique [FN: § 296-3] .
§ 297. En d'autres matières, Mill reconnaît très bien le rôle social des actions non-logiques ; mais il retire bientôt, du moins en partie, la concession qu'il a faite ; parce qu'au lieu de continuer à étudier ce qui est, il se met à rechercher ce qui devrait exister. C'est là un procédé général, employé par beaucoup d'auteurs, pour éliminer les actions non-logiques.
§ 298. Par exemple, dans son livre sur la Liberté, Mill écrit : « (p. 103) [FN: § 298-1] les opinions des hommes sur ce qui est louable ou blâmable sont affectées par toutes les causes diverses qui influent sur leurs désirs à propos de la conduite des autres, causes aussi nombreuses que celles qui déterminent leurs désirs sur tout autre sujet. Quelquefois c'est leur raison ; d'autres fois leurs préjugés ou leurs superstitions ; souvent leurs sentiments sociables, pas très rarement leurs penchants antisociaux, leur envie ou leur jalousie, leur arrogance ou leur mépris. Mais le plus souvent l'homme est guidé par son propre intérêt, légitime ou illégitime. Partout où il y a une classe dominante, presque toute la morale publique dérive des intérêts de cette classe ».
À part quelques restrictions, tout cela est bien dit et exprime à peu près les faits. Mill aurait pu continuer dans cette voie ; et puisque son étude portait sur la Liberté, Il aurait pu rechercher dans quelle relation elle se trouvait avec les motifs qu'il attribuait aux actions humaines. Il aurait ainsi fait une découverte ; il aurait vu qu'il procédait d'une façon contradictoire, en tâchant, pour autant que cela lui était possible, de faire passer le pouvoir politique au plus grand nombre, et en défendant une certaine Liberté, qui était incompatible avec les préjugés, les sentiments, les intérêts, etc., de ce plus grand nombre. Cette découverte lui aurait aussi permis de faire une prévision ; ce qui est le but essentiel de la science. Il aurait pu prévoir que la Liberté, telle qu'il la concevait, devait aller en diminuant, parce qu'elle était contraire aux motifs qu'il considérait comme déterminant les désirs de la classe qui était sur le point de devenir dominante.
§ 299. Mais Mill s'occupait moins de ce qui était, que de ce qui devait être. Il nous dit : « (p. 109) Un homme ne peut pas, en bonne justice, être obligé d'agir ou de s'abstenir, parce que ce serait meilleur pour lui, parce que cela le rendrait plus heureux, ou parce que dans l'opinion des autres, ce serait sage ou même juste. Ce sont de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, pour raisonner avec lui, pour le convaincre ou pour le supplier, mais non pour le contraindre ou pour lui causer aucun dommage s'il passe outre [FN: § 299-1] ».
Il se peut que ce soit une bonne justice ; mais ce n'est malheureusement pas celle de nos maîtres, qui nous gratifient chaque année de nouvelles lois, précisément pour empêcher de faire ce que Mill disait qu'on devait laisser faire. Son prêche a donc été parfaitement inutile.
§ 300. Chez certains auteurs, la partie des actions non-logiques disparaît entièrement, ou plutôt est considérée seulement comme la partie exceptionnelle du mal. La logique seule constitue un moyen de progrès humain ; elle est synonyme de « bien », de même que tout ce qui n'est pas logique est synonyme de « mal ». Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom de logique. Cette croyance n'a rien à faire avec la science logico-expérimentale : et le culte de la raison peut aller de pair avec un autre culte religieux quelconque, y compris celui des fétiches.
§ 301. Condorcet s'exprime ainsi : « (p. 250) [FN: § 301-1] Ainsi une connaissance générale des droits naturels de l'homme, l'opinion même que ces droits sont inaliénables et imprescriptibles, un vœu fortement prononcé pour la liberté de penser et d'écrire, pour celle du commerce et de l'industrie, pour le soulagement du peuple,... l'indifférence pour les religions, placées enfin au nombre des superstitions ou des inventions politiques, [le pauvre homme ne s'aperçoit pas que son adoration du Progrès est une religion !] la haine de l'hypocrisie et du fanatisme, le mépris des préjugés, le zèle pour la propagation des lumières,... devinrent la profession commune, le symbole de tous ceux qui n'étaient ni machiavélistes ni imbéciles ». L'auteur, qui prêche la tolérance religieuse, ne s'aperçoit pas qu'il donne une preuve d'intolérance, en traitant les dissidents de sa religion du Progrès comme les orthodoxes ont toujours traité les hérétiques. Il est vrai qu'il estime avoir raison et pense que ses adversaires ont tort, parce que sa religion est bonne et la leur mauvaise ; mais c'est justement ce que ceux-ci disent, en intervertissant les termes.
§ 302. Nous trouvons, chez Condorcet et chez d'autres auteurs, ses contemporains, des maximes que répètent aujourd'hui encore les humanitaires fanatiques. Condorcet dit ensuite [FN: § 302-1] : « (p. 292) Toutes les erreurs en politique, en morale, ont pour base des erreurs philosophiques, qui elles-mêmes sont liées à des erreurs physiques. Il n'existe ni un système religieux, ni une extravagance surnaturelle, qui ne soit fondée sur l'ignorance des lois de la nature ». Mais lui-même fait preuve de cette ignorance, quand il veut nous faire avaler des absurdités comme la suivante [FN: § 302-2] : « (p. 345) Quelle est l'habitude vicieuse, l'usage contraire à la bonne foi, quel est même le crime, dont on ne puisse montrer l'origine, la cause première, dans la législation, dans les institutions, dans les préjugés du pays où l'on observe cet usage, cette habitude, où ce crime s'est commis ?» Il conclut enfin : « (p. 346) que la nature lie, par une chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu ».
§ 303. De semblables idées sont communes parmi les philosophes français de la fin du XVIIIe siècle. Pour eux, tout bien vient de la « raison » ; tout mal, de la « superstition ». D'Holbach [FN: § 303-1] voit dans l'« erreur », la source de tous les maux humains. C'est resté un dogme pour la sacro-sainte religion humanitaire [FN: § 303-2] dont les « intellectuels » sont les prêtres.
§ 304. Tous ces gens ne s'aperçoivent pas que le culte de la Raison, de la Vérité, du Progrès et d'autres entités semblables, fait partie, comme tous les cultes, des actions non-logiques. Il est né, s'est développé et continue à prospérer, pour combattre les autres cultes ; de même que dans la société païenne, les cultes orientaux surgirent par réaction contre le culte polythéiste gréco-romain.
Un même courant d'actions non-logiques se manifestait alors par le taurobole et le criobole, par le culte de Mithra, par l'importance accrue des mystères, par le néoplatonisme, par le mysticisme et finalement par le christianisme, qui devait l'emporter sur les cultes rivaux, tout en leur empruntant beaucoup. De même, vers la fin du XVIIIe siècle et le commencement du XIXe un même courant d'actions non-logiques se manifeste par le théisme des philosophes, les divagations sentimentales de Rousseau, le culte de la Raison, de l'Être suprême, le culte décadaire, la théophilanthropie, dont la religion positiviste de A. Comte n'est en somme qu'un simple rameau, la religion saint-simonienne, la religion pacifiste, et d'autres qui existent encore de notre temps.
Ces considérations font partie d'un ordre beaucoup plus étendu, qui est proprement celui de l'aspect subjectif des théories, indiqué au § 13. C'est-à-dire qu'en général il faut se demander pourquoi et comment les sujets produisent et acceptent certaines théories. En particulier, après avoir déterminé l'un de leurs buts, qui est de donner le caractère logique aux actions qui ne l'ont pas, il faut rechercher par quels moyens on atteint ce but. Au point de vue objectif, l'erreur des raisonnements indiqués tout à l'heure consiste à donner une réponse a priori aux questions du § 14, et à croire qu'il suffit qu'une théorie soit d'accord avec les faits, pour qu'elle soit utile à la société. Il s'y ajoute d'habitude l'erreur de considérer les faits, non pas comme ils sont en réalité, mais tels que se les figure la fantaisie exaltée d'un auteur.
§ 305. L'induction suivie jusqu'à présent nous a fait voir, dans quelques cas particuliers, qu'il existe une tendance à éliminer la considération des actions non-logiques, considération qui s'impose pourtant à l'esprit de qui entreprend de raisonner sur les sociétés humaines ; elle nous montre en outre que la question n'est pas de petite importance. C'est pourquoi nous devons nous en occuper maintenant avec soin et d'une façon générale. Plus loin, au chapitre IX, nous aurons à envisager un sujet plus général encore, soit les raisonnements variables auxquels sont enclins les hommes, poussés par certains de leurs sentiments, et leur manie de recouvrir les actions non-logiques d'un vernis logique.
Cette manière de suivre la méthode inductive fait que le problème particulier se présente à nous avant le problème général ; puis, étudier d'abord le problème particulier a cet inconvénient de nous obliger à répéter des choses que nous exposons ici ; mais d'autre part, l'induction a cet avantage de rendre plus clair et plus aisé le sujet qu'on étudie.
§ 306. Donc, procédons maintenant à l'étude des moyens par lesquels on élimine les actions non-logiques, pour ne conserver que les logiques ; et, comme d'habitude, commençons par classer les objets que nous voulons étudier.
CLASSE A. On suppose que les principes [FN: § 1] des actions non-logiques sont dénués de toute réalité objective (§ 307-318).
Genres.
I. On les néglige entièrement (§ 307-308).
II. On les considère comme des préjugés absurdes (§ 309-311).
III.On les considère comme des artifices (§ 312-318).
CLASSE B. On suppose que les principes des actions non-logiques participent peu ou beaucoup à la réalité objective (§ 319-351).
Genres et sous-genres.
Genre I. La réalité objective est entière et directe (§ 319-338).
(I α) Préceptes avec sanction en partie imaginaire (§ 321-333).
(I β) Intervention d'un dieu personnel ou d'une abstraction personnifiée (332-333).
(I γ ) À la simple intervention considérée dans le sous-genre précédent, on ajoute des légendes et des déductions logiques (§ 334).
(I δ ) La réalité est assimilée à une entité métaphysique (§ 335-336).
(I ε) La réalité se trouve dans l'accord des principes avec certains sentiments (§ 337-338).
Genre II. La réalité objective n'est ni entière ni directe. On la trouve indirectement dans des faits qui sont réputés mal observés ou mal connus (§ 339-350).
(II α) On suppose que les hommes font des observations imparfaites, dont ils déduisent logiquement les conséquences (§ 340-346).
(II β) Un mythe est le reflet d'une réalité historique cachée de diverses manières, ou bien une simple imitation (§ 347-349).
(II γ ) Un mythe se compose de deux parties : d'un fait historique et d'une adjonction imaginaire (§ 350).
Genre III. Les principes des actions non-logiques ne sont que des allégories (§ 351-352).
Examinons ces diverses catégories.
§ 307. A-I. On peut négliger entièrement les actions non-logiques comme n'appartenant pas à la réalité. C'est ce que fait le Socrate de Platon [FN: § 307-1] , à propos du culte national. On lui demande ce qu'il pense du rapt d'Orithye, fille d'Erechthée, commis par Borée. Il répond en repoussant d'abord l'interprétation logique des gens qui veulent trouver un fait réel dans le mythe (II γ) ; puis il exprime l'avis que ces recherches sont aussi subtiles qu'inutiles, et s'en remet à la croyance populaire sur ce point. C'est à elle que se référait l'oracle de Delphes [FN: § 307-2], quand il prescrivait comme meilleur moyen d'honorer les dieux, celui de suivre l'usage de la cité à laquelle on appartenait. Il n'entendait pas le moins du monde dire que ces usages correspondaient à des choses irréelles ; mais en fait, c'était comme s'ils avaient été tels, puisqu'ils étaient entièrement soustraits aux vérifications imposées aux faits réels. Il convient d'ajouter que cette façon de considérer les croyances conduit souvent à les envisager comme des actions non-logiques, que l'on ne cherche pas à expliquer, que l'on accepte sans autre, comme elles sont, en cherchant seulement quelles relations elles peuvent avoir avec d'autres faits sociaux. Cette attitude est celle de nombreux hommes d'État, soit ouvertement, soit secrètement.
§ 308. Ainsi, dans l'ouvrage de Cicéron De Natura Deorum, le pontife Cotta sépare l'homme d'État du philosophe. Comme pontife, il proteste qu'il défendra toujours les croyances, le culte, les cérémonies et la religion des ancêtres, et que jamais aucun discours d'homme de science ou d'ignorant ne lui fera changer d'avis. Il est persuadé que Romulus a fondé Rome par les auspices et Numa par le culte [FN: § 308-1] . « Voilà, Balbus, ce que je pense personnellement et comme pontife. Fais donc que je sache ce que tu penses ; car de toi, philosophe, je dois recevoir la religion en vertu de la raison ; tandis que de nos ancêtres, même sans aucune raison, je la dois croire ». Il est ici manifeste que, comme pontife, il se place volontairement en dehors de la réalité logique ; ce qui a pour conséquence ou bien que cette réalité n'existe pas, ou bien qu'elle est du genre des principes des actions non-logiques [FN: § 308-2] .
§ 309. A II. On peut ne prendre garde qu'à la forme des actions non-logiques, et ne la tenant pas pour raisonnable, les considérer comme d'absurdes préjugés, dignes tout au plus d'être étudiés au point de vue pathologique, comme de véritables maladies de la race humaine. Beaucoup d'auteurs ont adopté cette attitude, à l'égard des formalités légales et des formalités politiques, et surtout à l'égard des religions et encore plus des cultes. Telle est encore l'attitude de notre anti-cléricalisme, en face de la religion chrétienne ; ce qui révèle, chez ces sectaires, une grande ignorance, unie à un esprit étroit et incapable de comprendre les phénomènes sociaux.
Nous avons vu déjà, dans les œuvres de Condorcet (§ 301 et sv.) et de D'Holbach (§ 296[FN: § 2] , 303), des types de cette façon de raisonner ; et si c'était utile, on pourrait ajouter beaucoup d'autres citations à celles-ci. Un type extrême se voit dans les dissertations que soutiennent certaines personnes, pour rendre une religion plus scientifique (§ 15), et qui partent de l'idée qu'une religion qui n'est pas scientifique est absurde ou blâmable. C'est ainsi qu'autrefois on chercha à éliminer, par des interprétations subtiles, les parties qu'on estimait non-logiques, dans les légendes et dans le culte des dieux du paganisme. Ainsi procédèrent les protestants, au temps de la Réforme ; aujourd'hui, les protestants libéraux renouvellent leurs efforts en invoquant une pseudo-expérience. Ainsi procèdent les modernistes à l'égard du catholicisme ; ainsi se comportent les radicaux-socialistes, à l'égard du marxisme.
§ 310. Celui qui estime absurdes certaines actions non-logiques, peut avant tout s'en tenir à en considérer le côté ridicule ; et c'est une arme souvent efficace pour combattre la foi qui naît de ces actions. De Lucien à Voltaire, elle fut souvent employée contre les religions existantes. Comme exemple, voyons l'opinion qu'exprime Voltaire, au sujet de la religion romaine.
Dans un article où les erreurs historiques abondent, il dit [FN: § 310-1] :
« (p. 289) Je suppose que (p. 290) César, après avoir conquis l'Égypte, voulant faire fleurir le commerce dans l'empire romain, eût envoyé une ambassade à la Chine... L'empereur Iventi, premier du nom, régnait alors... Après avoir reçu les ambassadeurs de César avec toute la politesse chinoise, il s'informe secrètement, par ses interprètes, des usages, des sciences, et de la religion de ce peuple romain... Il apprend que cette nation entretient à grands frais un collège de prêtres, qui savent au juste le temps où il faut s'embarquer, et où l'on doit donner bataille, par l'inspection du foie d'un bœuf, ou par la manière dont les poulets mangent de l'orge. Cette science sacrée fut apportée autrefois aux Romains par un petit dieu nommé Tagès, qui sortit de terre en Toscane. Ces peuples adorent un dieu unique qu'ils appellent toujours Dieu très grand et très bon. Cependant ils ont bâti un temple à une courtisane nommée Flora, et les bonnes femmes de Rome ont presque toutes chez elles de petits dieux pénates hauts de quatre à cinq pouces. Une de ces petites divinités est la déesse des tétons, l'autre celle des fesses... L'empereur se met à rire : les tribunaux de Nankin pensent d'abord avec lui que les ambassadeurs romains sont des fous ou des imposteurs... mais comme l'empereur est aussi juste que poli, il a des conversations particulières avec les ambassadeurs... On lui avoue que le collège des augures a été établi dans les premiers temps de la barbarie, qu'on a laissé subsister une institution ridicule devenue chère au peuple longtemps grossier, que tous les honnêtes gens se moquent des augures ; que César ne les a jamais consultés ; qu'au rapport d'un très grand homme, nommé Caton, jamais augure n'a pu parler à son camarade sans rire ; et qu'enfin Cicéron, le plus grand orateur et le meilleur philosophe de Rome, vient de faire contre les augures un petit ouvrage intitulé De la divination, dans lequel il livre à un ridicule éternel tous les auspices, toutes les prédictions, et tous les sortilèges dont la terre est infatuée. L'empereur de la Chine a la curiosité de lire ce livre de Cicéron ; ses interprètes le traduisent ; il admire le livre et la république romaine ».
§ 311. Quant à cet ouvrage et à d'autres semblables, il faut prendre garde de ne pas tomber dans l'erreur que nous relevons au sujet des actions non-logiques [FN: § 311-1] . La valeur intrinsèque de ces ouvrages peut être nulle, au point de vue de la vérité expérimentale, et leur valeur polémique très grande. Ce sont là des choses qu'il faut toujours distinguer. Il peut en outre y avoir une certaine valeur intrinsèque, qui a les origines suivantes. Un ensemble d'actions non-logiques peut convenir pour atteindre un but donné, sans que proprement aucune d'elles, séparée des autres, convienne à ce but. Certaines actions ridicules peuvent être éliminées de cet ensemble, sans qu'il devienne moins efficace. Pourtant, en raisonnant ainsi, il faut prendre garde de ne pas répéter le sophisme de l'homme auquel on pouvait enlever tous les cheveux, sans qu'il fût chauve, parce que cela était vrai pour un seul cheveu.
§ 312. A-III. Après avoir posé, comme précédemment, que certaines actions ne sont pas logiques, et voulant toutefois les rendre telles, c'est-à-dire voulant que toute action humaine soit accomplie au nom de la logique, on peut affirmer que l'institution de certaines actions non-logiques est due à des personnes qui voulaient, de cette manière, obtenir leur avantage ou celui de l'État, d'une société donnée, du genre humain. Ainsi, les actions intrinsèquement non-logiques sont transformées en actions logiques, par rapport au but que l'on veut atteindre.
Celui qui suit cette voie à l'égard des actions que l'on estime utiles à la société, s'éloigne du cas extrême indiqué au § 14, dans lequel on affirme que seules, les théories d'accord avec les faits (logico-expérimentales) peuvent être utiles à la société. Il reconnaît qu'il y a des théories qui ne sont pas logico-expérimentales, et sont toutefois utiles à la société ; mais il ne peut se résigner à accepter qu'elles soient nées spontanément des actions non-logiques. Non, toutes les actions doivent être logiques ; donc ces théories sont, elles aussi, le fruit d'actions logiques. Celles-ci ne peuvent avoir les théories pour origine, puisqu'il est reconnu que cette origine n'est pas d'accord avec l'expérience ; mais leur but peut être le même que celui des théories dont l'expérience nous enseigne l'utilité [FN: § 312-1] pour la société. Nous avons donc la solution suivante : « Les théories qui ne sont pas d'accord avec les faits peuvent être utiles à la société, et sont par conséquent logiquement établies pour atteindre ce but ».
On remarquera que si l'on substituait, dans cette proposition, le mot conservées à établies, elle posséderait parfois une partie, grande ou petite, qui serait d'accord avec la réalité (§ 316).
§ 313. L'idée que les actions non-logiques ont été logiquement établies en vue d'un certain but, est admise par un très grand nombre d'auteurs.
Même Polybe [FN: § 313-1], qui est pourtant un auteur d'une grande sagacité, parle de la religion des Romains comme si elle devait son origine à des artifices.
Et pourtant lui-même a reconnu que les Romains sont arrivés à constituer leur république, non par des choix raisonnés, mais en se laissant guider par les événements [FN: § 313-2] .
§ 314. Comme type de cette interprétation, on peut citer la manière dont Montesquieu envisage la religion romaine [FN: § 314-1] . « (p. 179) Ce ne fut ni la crainte, ni la piété, qui établit la religion chez les Romains, mais la nécessité où sont toutes les sociétés d'en avoir une... Je trouve cette différence entre les législateurs romains et ceux des autres peuples, que les premiers firent la religion pour l'État, et les autres l'État pour la religion. Romulus, Tatius et Numa asservirent les dieux à la politique : le culte et les cérémonies qu'ils instituèrent furent trouvés si sages, que, lorsque les rois furent chassés, le joug de la religion fut le seul dont ce peuple, dans sa fureur pour la liberté, n'osa s'affranchir ».
« Quand les législateurs romains établirent la religion, ils ne pensèrent point à la réformation des mœurs, ni à donner des principes de morale,... Ils n'eurent donc d'abord qu'une vue générale, qui était d'inspirer à (p. 180) un peuple qui ne craignait rien, la crainte des dieux, et de se servir de cette crainte pour le conduire à leur fantaisie ».
Plus loin:
« (p. 181) C'était, à la vérité, une chose très-extravagante de faire dépendre le salut de la république de l'appétit sacré d'un poulet, et de la disposition des entrailles des victimes ; mais ceux qui introduisirent ces cérémonies en connaissaient bien le fort et le faible, et ce ne fut que par de bonnes (p. 182) raisons qu'ils péchèrent contre la raison même. Si ce culte avait été plus raisonnable, les gens d'esprit en auraient été la dupe aussi bien que le peuple, et par là on aurait perdu tout l'avantage qu'on en pouvait attendre... ».
§ 315. Il est singulier que Voltaire et Montesquieu aient suivi des voies opposées, mais également erronées, et qu'aucun des deux n'ait pensé à un développement spontané d'actions non-logiques.
§ 316. Le genre d'interprétation que nous examinons ici contient parfois une part de vérité, non quant à l'origine des actions non-logiques, mais à l'égard du but auquel elles peuvent tendre, lorsqu'elles sont devenues usuelles. Alors il est naturel que les gens avisés s'en servent à leurs propres fins, comme ils se servent de n'importe quelle autre force sociale. L'erreur consiste à croire que ces forces aient été créées artificiellement (§ 312) [FN: § 316-1].
Un exemple contemporain fera mieux comprendre le fait. Il y a certainement des charlatans qui tirent avantage du spiritisme ; mais il serait absurde de supposer que seuls les artifices des charlatans aient produit le spiritisme.
§ 317. La théorie de Van Dale, qui ne voit autre chose que des artifices, dans les oracles des Gentils, fait partie de ce genre d'interprétations. Eusèbe oscille entre cette interprétation et celle qui veut que les oracles soient œuvre des démons. De semblables mélanges d'interprétations sont fréquents. Nous reviendrons sur ce sujet.
§ 318. Font encore partie de ce genre les interprétations qui placent les actions non-logiques parmi les conséquences d’une doctrine exotérique, qui sert à masquer une doctrine ésotérique. Ainsi, les actions apparemment non-logiques sont en réalité logiques. Comme exemple, rappelons le suivant, emprunté au Dialogo dei massimi sistemi de Galilée:
« (p. 15) Salviati. Que les Pythagoriciens eussent en très grande estime la science des nombres... je le sais fort bien, et je ne serais pas loin de porter là-dessus le même jugement ; mais que les mystères au nom desquels Pythagore et sa secte avaient en si grande vénération la science des nombres, soient les absurdités dont écrit et parle le vulgaire, je n'y crois en aucune manière ; car je sais au contraire qu'afin que les choses admirables ne fussent pas exposées aux disputes et au mépris de la plèbe, ils condamnaient comme un sacrilège la publication des propriétés les plus cachées des nombres et des quantités incommensurables et irrationnelles qu'ils étudiaient, et prêchaient que celui qui les avait révélées était tourmenté dans l'autre monde. Je pense que certain d'entre eux, pour jeter de la poudre aux yeux de la plèbe, et se débarrasser de ses demandes, lui disait que leurs mystères des nombres étaient ces enfantillages qui se répandirent ensuite parmi le peuple ; cela avec une malice et une perspicacité semblables à celle du jeune homme sagace (p. 16) qui, pour échapper à l'importunité – je ne sais si c'était de sa mère ou de sa femme curieuse, qui l'obsédait pour qu'il lui confiât les secrets du Sénat, – composa cette histoire qui la ridiculisa ensuite, ainsi que beaucoup d'autres femmes, à la grande joie du Sénat ».
Que les Pythagoriciens aient parfois caché leur doctrine, cela paraît certain. Mais il ne semble pas du tout que ce fût le cas pour leurs idées sur la perfection de certains nombres ; et en cela Galilée est dans l'erreur (§ 960 et sv.)
§ 319. (B-I) Ce cas extrême reconnaît la nature des actions non-logiques, et ne devrait donc pas figurer parmi les procédés tendant à faire paraître logiques les actions non-logiques ; mais nous devons le considérer comme un point de départ de beaucoup de ces procédés. C'est donc pour ce motif que nous en traitons maintenant.
On observe ce genre dans les actions religieuses accomplies par qui est animé d'une foi aveugle. Dans ce cas, elles ne diffèrent que peu ou pas du tout des autres actions logiques. Celui qui est persuadé que pour obtenir une bonne navigation, il faut sacrifier à Poséidon et avoir un navire qui ne fasse pas eau, accomplit le sacrifice et aveugle les voies d'eau, exactement de la même façon.
§ 320. Il faut remarquer que ces doctrines s'approchent parfois plus que d'autres des doctrines scientifiques, dont elles ne diffèrent que par une adjonction : celle de la réalité d'un principe imaginaire ; tandis que beaucoup d'autres, outre cette adjonction, diffèrent des doctrines scientifiques par leurs déductions fantaisistes ou dépourvues de toute précision.
§ 321. (B-I α ) Ce genre comprend des interprétations obtenues par une adjonction au type simple du précepte sans sanction ou tabou. Le type simple ne fait pas partie du genre, parce qu'il ne repousse pas, mais admet la considération des actions non-logiques ; c'est même justement dans ce type simple qu'elles se voient le mieux.
§ 322. S. Reinach écrit [FN: § 322-1] :
« (p. 1) Un tabou est une interdiction ; un objet tabou ou taboué est un objet interdit. L'interdiction peut porter sur le contact corporel ou sur le contact visuel ; elle peut aussi soustraire l'objet tabou à ce genre particulier de violation qui consiste à le nommer... on trouve des interdictions analogues en Grèce, à Rome et chez un grand nombre de peuples, où on les explique généralement par l'idée que la connaissance d'un nom permettait (p. 2) d'évoquer, dans une intention nocive, la puissance qu'il désigne. Cette explication a pu être vraie à certaines époques, mais n'est sans doute pas primitive ; à l'origine, c'est la sainteté même du nom qui est redoutée, au même titre que le contact d'un objet tabou ».
Reinach a raison d'envisager comme une adjonction la considération du pouvoir que la connaissance du nom donnerait sur la chose ; mais la considération de la sainteté est aussi une adjonction. Bien plus, la majeure partie de ceux qui respectèrent ce tabou ne savaient peut-être pas ce qu'était l'abstraction qu'on appelle sainteté. Pour eux, le tabou est simplement une action non-logique ; c'est la répugnance à toucher, à regarder, à nommer la chose tabou. On cherche ensuite à expliquer, à justifier cette répugnance ; et alors on invente ce pouvoir dont parle Reinach : la sainteté.
Notre auteur continue : « (p. 2) La notion du tabou est plus étroite que celle de l'interdiction. Le premier caractère qui les distingue, c'est que le tabou n'est jamais motivé ». Parfaitement ; voilà bien le caractère des actions non-logiques ; mais c'est justement pourquoi Reinach ne devait pas, dans un cas spécial, motiver le tabou par la considération de la sainteté.
Reinach continue: « (p. 2... ) on énonce la défense en sous-entendant la cause, qui n'est autre que le tabou lui-même, c'est-à-dire l'annonce d'un péril mortel ». Ainsi, il retire la concession qu'il a faite, et veut rentrer dans le domaine des actions logiques.
On ne sous-entend pas la cause. Le tabou consiste dans la répugnance absolue de faire une certaine chose. Si nous en voulons un exemple parmi nos contemporains, regardons certaines personnes sensibles qui, pour rien au monde, ne voudraient égorger un poulet. Là, il n'y a pas de cause ; il y a une répugnance, et cela suffit pour empêcher d'égorger le poulet. Ensuite, on ne sait pas pourquoi Reinach veut que la peine de la transgression du tabou soit toujours un péril mortel. Lui-même donne des exemples du contraire ; tel celui que nous rappellerons tout à l'heure. En continuant son exposé, Reinach rentre de nouveau dans le domaine des actions non-logiques, et observe que « (p. 2) Les tabous qui se sont perpétués dans les civilisations contemporaines sont souvent énoncés avec des motifs à l'appui ; mais ces motifs ont été imaginés à une date relativement récente [on ne saurait mieux dire] et portent le cachet d'idées modernes. Ainsi l'on dira : « Parler bas dans une chambre mortuaire [voilà un tabou dont rien n'indique que la sanction fût un péril mortel], pour ne pas manquer au respect dû à la mort », alors que le tabou primitif consiste à fuir non seulement le contact, mais le voisinage d'un cadavre [les preuves d'un péril mortel font toujours défaut]. Cependant, même aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, on énonce des tabous sans les motiver, ou en se contentant de spécifier le genre d'interdiction : « Ne lève pas la chemise, parce que c'est inconvenant ». Hésiode, dans Les travaux et les jours (v. 725), interdit de lâcher l'eau en se tournant vers le soleil, mais n'allègue pas les motifs de cette défense [type de l'action non-logique] ; la plupart des tabous relatifs aux bienséances se sont transmis de siècle en siècle sans considérants ». Et sans la menace d'un péril mortel !
Ici nous avons envisagé les sanctions du tabou comme un moyen de rendre logiques les actions non-logiques ; plus loin nous les considérerons comme un moyen employé pour persuader d'observer le tabou.
Il convient de mettre avec les tabous d'autres phénomènes semblables, où l'interprétation logique est réduite au minimum.
§ 323. W. Marsden [FN: § 323-1] dit des mahométans de Sumatra: « (p. 100) Plusieurs de ceux qui professent cette religion ne se mettent nullement en peine de ses préceptes, ou même ne les connaissent pas. Un Malais reprochait à un homme du Passumah l'ignorance totale de la religion dans laquelle sa nation était plongée : « Vous honorez – lui disait-il – les tombeaux de vos ancêtres : quelle raison avez-vous de supposer que vos ancêtres peuvent vous donner quelque assistance ? » « Cela peut être vrai –répondit l'autre – mais quelle raison avez-vous vous-même d'attendre l'assistance d'Allah (Dieu) et de Mahomet ? » « N'avez-vous pas lu – répliqua le Malais – ce qui est écrit dans un livre ? N'avez-vous pas entendu parler du Koran ? » L'habitant du Passumah, sentant son infériorité, se soumit à la force de cet argument ». Nous verrons plus loin d'autres cas semblables (§ 1430 et sv.). Ceci est la semence qui germe et donne de copieuses moissons d'interprétations logiques, dont nous trouverons une partie dans les autres sous-genres.
§ 324. Le précepte est semblable au tabou. Le premier peut être donné sans sanction: « Fais cela ». C'est ainsi une simple action non-logique. Déjà quand on dit : « Tu dois faire cela », il y a un petit, quelquefois très petit essai d'explication. Elle est contenue dans le terme Tu dois, qui rappelle l'entité mystérieuse du Devoir. Souvent on ajoute une sanction réelle ou imaginaire, et l'on a des actions effectivement logiques, ou qu'on fait seulement passer pour telles. Par conséquent, seule, une partie des préceptes peut prendre place parmi les choses que nous classons maintenant.
§ 325. En général, on peut distinguer les préceptes de la façon suivante.
(a ) Précepte pur, sans motif ni démonstration. La proposition n'est pas elliptique. On ne donne pas de démonstration, parce qu'il n'y en a pas ou qu'elle n'est pas réclamée. On a ainsi le type pur des actions non-logiques. Mais les hommes ont une telle manie d'explications logiques, qu'habituellement ils en ajoutent une, même si elle est puérile. « Fais cela » est un précepte. Si l'on demande: « Pourquoi dois-je faire cela ? », on répond par exemple: « Parce qu'on fait ainsi [FN: § 325-1] ». C'est une adjonction logique de bien peu de valeur, excepté quand la transgression de l'usage emporte une peine : mais, dans ce cas, la peine est le motif logique, et non plus l'usage.
§ 326. (b) La démonstration est elliptique. Il y a une démonstration, valable ou non ; elle a été supprimée, mais peut être rétablie. La proposition n'a que l'apparence d'un précepte. On peut supprimer les termes : tu dois, il faut, ou autres semblables, et ramener le précepte à un théorème expérimental ou pseudo-expérimental, la conséquence étant engendrée par l'action sans intervention étrangère. Le type de ce genre de préceptes est le suivant : « Pour obtenir A, il faut faire B »; ou bien, sous forme négative : « Si l'on ne veut pas A, on ne doit pas faire B ». La première proposition est équivalente à la suivante : « Quand on a fait B, il en résulte A » ; de même pour la seconde.
§ 327. Si A et B sont tous deux des choses réelles, et si vraiment leur lien est logico-expérimental, on a des propositions scientifiques. Elles sont étrangères aux choses que nous classons maintenant. Si le lien n'est pas logico-expérimental, ce sont des propositions pseudo-scientifiques. Une partie sert à rendre logiques des actions non-logiques. Par exemple, si A est une bonne navigation et B, les sacrifices à Poséidon, le lien est imaginaire, et l'action non-logique B est justifiée par ce lien qui l'unit à A. Mais si, au contraire, A est une bonne navigation et B la construction défectueuse du navire, nous avons seulement une proposition scientifique erronée, puisque la construction défectueuse n'est pas une action non-logique [FN: § 327-1] .
§ 328. Si A et B sont tous deux imaginaires, nous sommes entièrement en dehors du domaine expérimental, et nous n'avons pas à parler de ces propositions. – Si A est imaginaire et B une chose réelle' nous avons des actions non-logiques B, justifiées par le prétexte A.
§ 329. (c) La proposition est réellement un précepte, mais on y ajoute une sanction réelle, due à une cause étrangère et réelle. On a ainsi des actions logiques. On fait la chose pour éviter la sanction.
§ 330. (d) La proposition est comme précédemment un précepte, mais la sanction est imaginaire ou imposée par une puissance imaginaire. Nous avons des actions non-logiques, justifiées par cette sanction. De plus amples explications seront données dans la suite (chap. IX).
§ 331. Les termes du langage ordinaire ont rarement un sens bien défini. Le terme sanction peut avoir un sens plus ou moins large. Ici nous l'avons pris dans un sens restreint. Si on voulait le prendre dans un sens large, on pourrait dire que la sanction existe toujours. Par exemple, pour les propositions scientifiques, la sanction pourrait être le plaisir de bien raisonner, le désagrément de raisonner mal. Mais c'est perdre son temps que s'arrêter à de telles subtilités.
§ 332. (B-I β) L'intervention d'un dieu personnel nous donne une adjonction assez simple au tabou ou au précepte pur ; de même une personnification, comme la Nature, dont la volonté impose aux hommes des actions non-logiques, qui sont ainsi logiquement expliquées. La manière dont elles sont imposées demeure parfois obscure. « Un dieu, la Nature veulent que l'on fasse ainsi ». « Et si on ne le faisait pas ? » Cette question demeure sans réponse. Mais souvent, au contraire, on y répond ; et l'on affirme que le dieu, la Nature puniront celui qui trangresse le précepte. Dans ce cas, on a un précepte avec sanction, de l'espèce (d ).
§ 333. Quand les Grecs disaient que « les étrangers et les mendiants viennent de Zeus [FN: § 333-1] », ils manifestaient simplement leur inclination à les bien accueillir, et Zeus n'intervenait que pour donner un vernis logique à cette action, soit que l'on interprétât le bon accueil comme un signe de respect pour Zeus, soit qu’on l'admît comme un moyen d'éviter le châtiment que Zeus réservait à qui transgressait le précepte.
§ 334. (B-I γ). Il est rare que l'adjonction précédente ne se complète pas de nombreuses légendes et déductions logiques. Ces nouvelles adjonctions nous donnent les mythologies et les théologies, qui s'éloignent toujours plus de l'idée des actions non-logiques. Il convient d'observer que les théologies quelque peu développées n'appartiennent qu'à une classe restreinte de personnes ; qu'elles nous font sortir du domaine des interprétations populaires et nous transportent dans celui des interprétations des gens cultivés.
À ce sous-genre appartiennent les interprétations des Pères de l'Église chrétienne, qui estimaient que les dieux païens étaient des démons.
§ 335. (B-I δ). La réalité est attribuée non plus à an dieu personnel ou à une personnification, mais à une abstraction métaphysique. Le vrai, le bien, le beau, la vertu, l'honnête, la morale, le droit naturel, l'humanité, la solidarité, le progrès ou les abstractions contraires ordonnent ou défendent certaines actions, qui deviennent ainsi conséquences logiques de ces abstractions. Nous entrerons plus loin dans les détails (1510 et sv.).
§ 336. Dans les interprétations (B-1 β), le dieu personnel peut infliger un châtiment, parce que telle est sa volonté, et la Nature, comme conséquence spontanée de l'action. L'interprétation est donc passablement logique. Mais les abstractions métaphysiques interviennent au contraire d'une façon peu ou point logique. Si l'on dit à quelqu'un : « Tu dois faire cela, parce que c'est bien », et s'il répond: « Je ne veux pas faire le bien », on reste désarmé, parce que monseigneur le bien ne lance pas la foudre comme Zeus.
De même, les néo-chrétiens conservent le dieu de la Bible, mais le dépouillent de toute arme. Il n'y a guère à plaisanter avec le dieu de la Bible, qui venge durement les transgressions à ses lois [FN: § 336-1], ou avec le dieu de saint Paul, qui est tout aussi redoutable [FN: § 336-2] ; mais les néo-chrétiens, en vertu des abstractions de leur pseudo-expérience, de quoi peuvent-ils bien menacer le mécréant ? de quoi peuvent-ils promettre de récompenser le croyant ? De rien. Les actions qu'ils recommandent sont simplement des actions non-logiques. Cela ne veut pas dire qu'elles ne conviennent pas autant que d'autres, et même mieux que d'autres, à l'individu, à la collectivité. Cela peut être ou non ; mais il est certain que ce ne sont pas des déductions logiques d'un principe, comme sont celles qui concluent à la punition des mécréants et à la récompense des croyants, par la volonté et la puissance divine.
§ 337. (B-I ε). La réalité se trouve dans l'accord des principes avec certains sentiments. Cette façon d'envisager les faits est plutôt implicite qu'explicite. Ainsi, pour certains néo-chrétiens, la réalité de Christ paraît consister dans l'accord de l'idée qu'ils ont de Christ avec certains de leurs sentiments. Ils sortent du domaine objectif, abandonnent entièrement le caractère divin de Christ, et ne paraissent pas s'inquiéter beaucoup de sa réalité historique. Ils se contentent d'affirmer que c'est le type le plus parfait de l'humanité. Ce qui veut dire qu'ils accordent les idées qu'ils ont du Christ et celles du type le plus parfait de l'humanité, d'après leurs sentiments. Lancés sur cette voie, ils finissent par laisser entièrement de côté toute théologie, tout culte, et aboutissent à l'affirmation que « la religion est une vie [FN: § 337-1] ».
§ 338. De cette manière, ils se rapprocheraient de l'idée des actions non-logiques ; mais ils ne s'en séparent pas moins radicalement, parce qu'ils recherchent non pas ce qui est, mais ce qui doit être, et parce qu'ils ôtent à ce devoir le caractère de subordination, (§ 326) qu'on pourrait admettre aussi dans certains cas, et le rendent au contraire absolu, de manière à nous mettre tout à fait en dehors du domaine expérimental. Au fond, leurs théories n'ont d'autre but que de donner une teinte logique à des actions non-logiques.
§ 339. (B-II) La réalité n'est plus directe; c'est-à-dire qu'on n'a plus un dieu, une personnification, une abstraction, etc., dont nous puissions logiquement déduire les actions non-logiques. On admet que celles-ci se sont produites spontanément, par des faits bons ou mauvais, sur des faits plus ou moins bien observés. La différence avec le genre précédent est radicale ; car, tandis que dans le premier on attribue la réalité à des entités extérieures au domaine expérimental, dans ce genre-ci, les entités admises appartiennent à ce domaine. Il n'y a doute que sur le point de savoir si elles ont vraiment été observées, et si l'on en a bien tiré les conséquences admises. « Zeus nous envoie les mendiants » est une interprétation du 1er genre. Je crée une entité, Zeus, que je suppose réelle, et de son existence je tire certaines conséquences. « Celui qui traite bien les mendiants sera heureux » est une interprétation du IIe genre. Je suppose avoir observé que celui qui traita bien les mendiants fut heureux, et j'en tire la conséquence qu'en continuant à le faire, il continuera à être heureux. Je n'ai créé aucune entité. J'envisage des faits réels, et je les combine arbitrairement.
§ 340. (B-II α) Cette manière de raisonner a pour but de rejeter sur les prémisses le défaut logico-expérimental qu'on ne peut nier. Nous avons certaines conclusions qui sont manifestement en contradiction avec la science logico-expérimentale. Nous pouvons l'expliquer en disant que le raisonnement qui les donne n'est pas logique. Ainsi, nous voilà dans le domaine des actions non-logiques. Ou bien nous pouvons admettre que le raisonnement est logique ; mais que, partant de prémisses en contradiction avec la science logico-expérimentale, il conduit à des conclusions où l'on trouve de même cette contradiction ; et de cette façon, nous restons dans le domaine des actions logiques.
Les théories de H. Spencer fournissent le type de ce genre. Nous les avons exposées aux §289 et sv. La part des actions non-logiques est réduite au minimum et peut même disparaître. L'observation de certains faits serait à l'origine de certains phénomènes. On admet que les hommes ont tiré des conséquences de ces observations hypothétiques, en raisonnant à peu près comme nous pouvons raisonner de nos jours ; et l'on obtient ainsi les doctrines de ces hommes et les motifs de leur façon de procéder.
§ 341. Des concepts semblables jouent un rôle, important ou effacé, dans presque toutes les théories qui recherchent « l'origine » des phénomènes sociaux, tels que la « religion », la « morale », le « droit », etc. Les auteurs se résignent à admettre les actions non-logiques, mais ont soin de les refouler autant que possible dans le passé.
§ 342. Il peut y avoir quelque chose de vrai dans ces théories, pour autant qu'elles présentent certains types simples de phénomènes complexes. L'erreur consiste à vouloir déduire le phénomène complexe du type simple ; et, ce qui est pire, à supposer que cette déduction est logique.
§ 343. Négligeons, pour un moment, la complexité des phénomènes sociaux, et supposons que certains phénomènes P que nous observons maintenant aient effectivement une origine A. Si l'évolution se produisait suivant une ligne continue ABCDP, on pourrait, au moins dans une certaine mesure, prendre comme origine ou comme cause du phénomène P l'un des phénomènes intermédiaires B, C,... Si, par exemple, en remontant aussi haut que nos connaissances historiques nous le permettent, ou trouvait un phénomène B, du genre de P, mais beaucoup plus simple, l'erreur de le considérer comme l'origine ou la cause de P, ne serait pas trop grave.
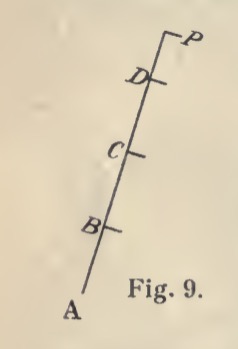
Figure 9
§ 344. Malheureusement, l'hypothèse d'une évolution suivant une ligne continue n'est pas du tout d'accord avec les faits, en ce qui concerne les phénomènes sociaux, et de même pour plusieurs phénomènes biologiques. L'évolution paraît plutôt avoir lieu suivant une ligne à nombreuses branches, comme celle de la fig. 10 ; étant donné toujours qu'on néglige la complexité des phénomènes, qui nous permet difficilement de séparer des autres un phénomène social P (§ 513).
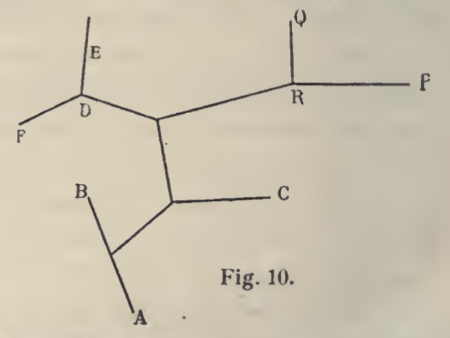
Figure 10
Les faits B, C, D,... de la fig. 9 ne sont plus sur une ligne droite et continue, mais se trouvent aux embranchements ou aux extrémités de certains rameaux ; et l'on ne peut plus supposer, pas même comme hypothèse grossièrement approchée des faits, que C , par exemple, ou E ou un autre fait semblable observé dans le passé, soit l'origine, la cause de P que nous étudions maintenant.
§ 345. Pour citer un fait concret, S. Reinach voit dans les tabous l'« origine » de la religion. Il paraît ainsi se placer dans le cas de la fig. 9. B représenterait les tabous ; P, la religion à l'état actuel. Mais, même en supposant que le phénomène religieux puisse être séparé des autres, nous serions dans le cas de la fig. 10, et les tabous B seraient l'extrémité d'une branche. On ne saurait les donner comme « l'origine » de la religion ; mais on peut les considérer comme un type simple de phénomènes dont les religions C, Q, P sont des types composés. Voilà ce qu'il y a de vrai dans les théories de Reinach. C'est d'ailleurs une chose très importante, parce qu'elle met en lumière le rôle des actions non-logiques dans les phénomènes religieux.
§ 346. Il faut observer que les recherches sur les « origines » des phénomènes sociaux sont souvent conduites à la façon de l'étymologie ancienne [FN: § 346-1] ; c'est-à-dire qu'on suppose, qu'on invente les passages intermédiaires C, D, ... (fig. 9), pour aller de B à P. Souvent et volontiers on cherche comment les faits auraient dû se produire, plutôt que la manière dont ils se sont produits. Dans ce cas, ces investigations sont en dehors de la réalité expérimentale ; mais elles ne furent pas inutiles ; car elles réussirent à faire une brèche aux théories éthiques et a priori qui expliquaient P par des principes imaginaires. Maintenant que cette opération est achevée, elles doivent faire place aux théories purement expérimentales.
§ 347. (B-II β). On laisse de côté l'origine et l'évolution et l'on admet que tout mythe est l'image déformée de quelque chose de réel. De ce genre sont les interprétations connues sous le nom d'évhémérisme, que nous étudierons plus loin (§ 682 et sv., 708). Il est certain qu'il y eut des hommes divinisés. L'erreur consiste d'abord à généraliser un fait particulier, et ensuite à confondre le point B de la fig. 9, avec le point B de la fig. 10 ; c'est-à-dire à croire que par la seule raison qu'un fait est antérieur à un autre dans le temps, il est l'origine de cet autre. Les interprétations de Palaephate, dont nous aurons à parler aussi (§ 661), font de même partie de ce sous-genre.
§ 348. En général, de semblables interprétations sont très faciles. On les obtient en changeant arbitrairement ce qu'il faut, dans le mythe, pour avoir une image réelle. Soit, par exemple, l'hippogriffe d'Astolphe, dans le Roland Furieux. On le placera dans la réalité, en interprétant la fable dans le sens que l'hippogriffe était un cheval très rapide, et que c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il avait des ailes. Dante voit Francesca et son beau-frère, emportés par la bourrasque infernale. On peut interpréter cela en disant que c'est une image de l'amour qui, semblable à un vent violent, emporta les deux amants ; et ainsi de suite. On ne rencontrera jamais la moindre difficulté (§ 661).
§ 349. On peut placer, dans ce sous-genre, les théories qui voient dans les actions non-logiques existant en une société donnée, des imitations d'autres actions non-logiques de sociétés différentes. Ainsi, à vrai dire, on n'élimine pas toutes les actions non-logiques. On en réduit seulement le nombre, en en ramenant plusieurs à l'imitation d'une seule. Plus loin, nous donnerons des exemples de ce genre d'interprétations (§ 733 et Sv.).
§ 350. (B-II γ). Dans ce sous-genre, nous approchons un peu de la réalité. On admet que dans tout mythe la légende a un noyau réel, historique, recouvert par des adjonctions fantaisistes. Il faut les enlever pour retrouver le fond dessous. De nombreux travaux ont été écrits dans cette intention. Il n'y a pas si longtemps que toutes les légendes qui nous sont parvenues de l'antiquité gréco-latine étaient traitées de cette façon. Nous aurons, dans la suite, à nous occuper de plusieurs de ces interprétations (chap. V).
Le sous-genre précédent, II β, est souvent le cas extrême de celui-ci. Dans un mythe, il peut y avoir quelque chose de réel. Ce quelque chose peut être plus ou moins grand. Quand il diminue et disparaît, on a le sous-genre II β.
§ 351. (B-III.) Les principes des actions non-logiques sont des allégories. On croit qu'en réalité ces actions sont logiques, et que, si elles paraissent non-logiques, c'est uniquement parce qu'on prend les allégories à la lettre. À ces conceptions, on peut ajouter celle qui met dans le langage la source de ces erreurs, par l'intermédiaire des allégories. Max Muller [FN: § 351-1] écrit : « (p. 84) Il y a dans Hésiode beaucoup de mythes... où nous n'avons qu'à remplacer le verbe complet par un auxiliaire, pour changer le langage mythique en langage logique. Hésiode appelle [mot Grec] (la Nuit) la mère de [mot Grec] (le Sort), et la sombre [mot Grec] (la Destruction) mère de [mot Grec] (la Mort), de [mot Grec] (le Sommeil) et de la tribu des [mot Grec] (les Rêves)... Employons nos expressions modernes, telles que : « On voit les étoiles quand la nuit approche », « nous dormons », « nous rêvons », « nous mourons », « nous courons des (p. 85) dangers pendant la nuit,. » et nous aurons traduit dans la forme moderne de la pensée et du discours le langage d'Hésiode ».
§ 352. Par conséquent tous les mythes seraient des charades. Il paraît impossible qu'une théorie si manifestement fausse ait eu autant d'adeptes. Les disciples firent encore pire que le maître, et le mythe solaire est devenu une explication commode et universelle de toutes les légendes possibles.
§ 353. CLASSE C. En réalité, dans cette classe, les actions non-logiques ne sont pas interprétées dans le but d'être rendues logiques ; elles sont éliminées ; il ne reste ainsi que des actions logiques. De cette manière, on arrive également à réduire tout à des actions logiques. Ces opinions sont très communes à notre époque, et deviennent même facilement un article de foi pour beaucoup de personnes, qui adorent une puissante déesse qu'elles appellent Science. Bon nombre d'humanitaires appartiennent à cette catégorie.
§ 354. D'autres personnes raisonnent mieux. Après avoir observé, avec raison, combien la science a été utile à la civilisation, elles poussent plus loin, et veulent montrer que tout ce qui n'est pas science ne peut être utile. Comme type de ces théories on peut citer le célèbre raisonnement de Buckle [FN: § 354-1] :
« (p, 199). il est évident que, prenant le monde dans son ensemble, la conduite morale et intellectuelle des hommes est gouvernée par les notions morales et intellectuelles qui dominent à leur époque. Or il suffit d'une connaissance superficielle de l'histoire (p. 200) pour savoir que ce modèle change constamment. Cette extrême mutabilité du modèle ordinaire sur lequel les hommes règlent leurs actions démontre que les conditions dont dépend ce modèle doivent être elles-mêmes très instables : or ces conditions, quelles qu'elles soient, sont évidemment la cause originelle de la conduite intellectuelle et morale de la plus grande partie des hommes. Voici donc une base qui nous permettra de marcher sûrement. Nous savons que la cause principale des actions des hommes est extrêmement variable ; nous n'avons donc qu'à faire passer par cette épreuve toute circonstance que l'on soupçonne d'être cette cause ; et si nous trouvons que ces circonstances ne sont pas très variables, nous devons conclure qu'elles ne sont pas la cause que nous cherchons à découvrir.
« En soumettant à la même épreuve les motifs de la morale, ou les préceptes de ce qu'on appelle l'instinct moral, nous verrons tout de suite combien petite est l'influence que ces motifs ont exercée sur les progrès de la civilisation. Car, sans conteste, l'on ne trouvera rien au monde qui ait subi aussi peu de changement que ces grands dogmes qui composent le système moral. Faire du bien à autrui... (p. 201). Mais si nous comparons cet aspect stationnaire des vérités morales avec l'aspect progressif des vérités intellectuelles, la différence est vraiment surprenante [FN: § 354-2] . Tous les grands systèmes de morale qui ont exercé beaucoup d'influence ont (p. 202) tous été fondamentalement les mêmes ; tous les grands systèmes intellectuels ont été fondamentalement différents... Puisque la civilisation est le produit de causes morales et intellectuelles, et que ce produit change sans cesse, évidemment il ne saurait être régi par l'agent stationnaire ; car, les circonstances ambiantes ne changeant pas, l'agent stationnaire ne peut produire qu'un effet stationnaire. Or il ne reste plus qu'un agent, l'agent intellectuel : il est le moteur réel... ».
§ 355. Ce raisonnement est bon, pourvu qu'on ajoute que toutes les actions des hommes sont des actions logiques, et qu'elles sont la conséquence du principe moral et du principe intellectuel. Mais cette proposition est fausse. 1° Beaucoup d'actions très importantes sont des actions non-logiques. 2°, Ce qu'on désigne sous les noms de : principe moral, principe intellectuel, manque de toute précision, et ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux. 3° Le raisonnement de Buckle a le défaut général des raisonnements par élimination, en sociologie ; c'est-à-dire que l'énumération n'est jamais complète [FN: § 355-1] . Ici des choses très importantes ont été omises. Les principes théoriques de la morale peuvent être les mêmes, et les habitudes morales différer de beaucoup. Par exemple, tous les peuples qui professent la morale chrétienne sont loin de la mettre en pratique.
§ 356. Le raisonnement de Buckle réduit à bien peu de chose le rôle des théories morales. En cela, il est d'accord avec les faits. Toutefois, ce qu'on ôte à ces théories ne doit pas être généreusement attribué à un certain « principe intellectuel », mais doit au contraire appartenir aux actions non-logiques, au développement économique, aux nouvelles conditions de communication, etc. Il est vrai qu'une partie doit aussi être attribuée au progrès scientifique, et pourrait par conséquent être acquise à quelque « principe intellectuel » ; mais il y a de la marge entre cette action indirecte, non-logique, et une action directe, produite par les déductions logiques d'un principe donné [FN: § 356-1].
§ 357. Nous ne pousserons pas plus loin l'étude de cette classification spéciale. Elle nous a fait voir qu'on peut décomposer les doctrines existantes en deux parties distinctes, soit certains sentiments et les déductions de ces sentiments. Devant nous s'ouvre ainsi une voie qu'il peut être utile ou inutile de suivre. Nous le verrons dans la suite.
§ 358. Beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'historiens parlent des actions non-logiques sans leur donner ce nom, et sans s'occuper d'en faire la théorie. Pour ne pas allonger outre mesure, citons seulement quelques exemples empruntés aux œuvres de Bayle [FN: § 358-1] . On trouve qu'elles contiennent plusieurs théories des actions non-logiques, et l'on est surpris de lire dans cet auteur des vérités qui, aujourd'hui encore, sont méconnues. C'est ainsi qu'il explique comment « (p. 272)... les opinions ne sont pas la règle des actions »; il répète : « (p. 361) Que l'homme ne règle pas sa vie sur ses opinions... Les Turcs tiennent (p. 362) quelque chose de cette doctrine des Stoïciens [de la fatalité] et outrent extrêmement la matière de la Prédestination. Cependant on les voit fuir le péril tout comme les autres hommes le fuient, et il s'en faut bien qu'ils montent à l'assaut aussi hardiment que les Français qui rie croient point à la Prédestination ». Il n'est pas possible de reconnaître plus clairement l'existence et l'importance des actions non-logiques. Qu'on généralise cette observation particulière, et l'on aura un principe de la théorie des actions non-logiques.
§ 359. Bayle observe encore: « (p. 273) Qu'on ne peut pas dire que ceux qui ne vivent pas selon les maximes de leur religion, ne croient pas qu'il y ait un Dieu ». Il insiste sur le fait :
« (p. 266) Que l'homme n'agit pas selon ses principes. – Que l'homme soit une créature raisonnable tant qu'il vous plaira ; il n'en est pas moins vrai qu'il n'agit presque jamais conséquemment à ses principes [c'est-à-dire que ses actions ne sont pas logiques]. Il a bien la force dans les choses de spéculation, de ne point tirer de mauvaises conséquences, car dans cette sorte de matières il pèche beaucoup plus par la facilité qu'il a de recevoir de faux principes, que par les fausses conclusions qu'il en infère. Mais c'est tout autre chose quand il est question des bonnes mœurs [ce que l'auteur dit de ce cas particulier est vrai en général]. Ne donnant presque jamais dans des faux principes, retenant presque toujours dans sa conscience les idées de l'équité naturelle, il conclut néanmoins toujours à l'avantage de ses désirs déréglés [c'est l'habituelle phraséologie peu précise ; mais le fond est d'accord avec les faits]... (p. 267) le véritable principe des actions de l'homme... n'est autre chose que le tempérament, l'inclination naturelle pour le plaisir, le goût que l'on contracte pour certains objets, le désir de plaire à quelqu'un, une habitude gagnée dans le commerce de ses amis, ou quelque autre disposition qui résulte du fond de notre nature, en quelque pays que l'on naisse [cela contredit ce qui précède et devrait être supprimé], et de quelques connaissances que l'on nous remplisse l'esprit ? »
Voilà qui approche beaucoup des faits. Si nous cherchions à donner une plus grande précision à ce langage, à établir une meilleure classification, ne nous arriverait-il pas de trouver une théorie des actions non-logiques, dont nous voyons toujours plus la grande importance ?
§ 360. Bayle cite, en l'approuvant, un passage de Nicolle [FN: § 360-1] : « (p. 741) Quand il s'agit de passer de la speculation à la pratique, les hommes ne tirent point de consequences ; et c'est une chose étrange comment leur esprit se peut arrester à certaines veritez speculatives sans les pousser aux suites de pratique, qui sont tellement liées avec ces veritez, qu'il semble impossible de les en separer... ».
§ 361. Bayle a très bien vu que « (p. 230)... la religion païenne se contentait d'un culte extérieur » (§ 174); mais il a tort de croire qu'elle « (p. 593) ne servait de rien par rapport aux bonnes mœurs ». Il n'a pas vu que les formalités du culte fortifiaient les actions non-logiques qui donnent les bonnes mœurs.
§ 362. Notre auteur se multiplie pour prouver que l'athéisme est préférable à l'idolâtrie. Pour bien le comprendre, il faut tenir compte du temps auquel il vivait, et des périls qu'il courait. De même qu'il y a maintenant des gens qui font la chasse aux livres « immoraux », il y en avait qui faisaient la chasse aux livres contraires à la religion chrétienne. Bayle frappe la selle, ne pouvant frapper le cheval, et adresse à l'idolâtrie des critiques qui garderaient leur valeur contre d'autres religions. En somme, le raisonnement de Bayle a pour but de prouver que la majeure partie des actions humaines étant des actions non-logiques, la forme de la croyance des hommes importe peu.
§ 363. C'est ce que n'a pas compris Montesquieu, et la réponse qu'il fait à ce qu'il appelle « le paradoxe de Bayle » n'a que peu ou point de valeur. Il résout la question par la question même, en disant: « (p. 404) [FN: § 363-1] Un prince qui aime la religion et qui la craint est un lion qui cède à la main qui le flatte ou à la voix qui l'apaise ; celui qui craint la religion et qui la hait est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent ; celui qui n'a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dévore ». Sous ces déclamations enflées, il y a évidemment l'idée que les hommes agissent logiquement d'après leurs croyances. Mais c'est précisément ce que nie Bayle ! Il fallait donc détruire par de bonnes raisons cette proposition de Bayle, avec laquelle tombait aussi sa théorie. Quant à répéter, sans donner aucune preuve, l'affirmation niée par son adversaire, cela ne sert à rien (§ 368).
§ 364. Restant dans le domaine des actions logiques, Montesquieu dit que : « Quand il serait inutile que les sujets eussent une religion, il ne le serait pas que les princes en eussent (loc. cit.) ». Dans le domaine des actions non-logiques, on arrive à une conclusion entièrement contraire ; car c'est l'usage des combinaisons logiques qui importe le plus à celui qui commande, et le fait d'avoir une règle indépendante de ses connaissances peu nombreuses, à celui qui obéit.
§ 365. Le défaut du raisonnement de Bayle ne consiste nullement en ce que lui reproche Montesquieu, mais se trouve dans un tout autre domaine. Après avoir observé et amplement démontré que l'homme n'agit pas selon les conséquences logiques de ses principes, de ses opinions, et que par conséquent beaucoup d'actions humaines très importantes sont des actions non-logiques, il aurait dû prêter attention à ces actions. Il aurait vu qu'il y en avait de nombreux genres, et aurait dû rechercher si elles sont indépendantes ou agissent les unes sur les autres. Il aurait facilement vu qu'en réalité ce dernier cas se vérifie, et aurait par conséquent observé que l'importance sociale de la religion ne consiste pas du tout dans la valeur logique de ses dogmes, de ses principes, de sa théologie, mais plutôt dans les actions non-logiques qu'elle provoque. Il était justement sur la bonne voie pour atteindre cette conclusion, quand il affirmait qu'« il faut juger une religion d'après le culte qu'elle pratique », et quand il rappelait que la religion païenne se contentait d'un culte extérieur : il s'était approché autant que possible de la vérité expérimentale. Encore un peu, et il la possédait tout entière. Malheureusement il dévie. Au lieu de considérer les actions non-logiques de la religion d'après le rôle social qu'elles peuvent jouer, il se perd en recherches sur leur valeur morale, ou pour mieux dire, sur leur rapport avec ce qu'il lui plaît d'appeler « moral ». De cette façon, nous assistons à un retour offensif des actions logiques, qui reviennent envahir le terrain dont elles avaient été chassées.
À ce point de vue, on pourrait répéter pour Bayle ce que dit Sumner Maine, en parlant de Rousseau [FN: § 365-1] : « (p. 83) Ce fut la première tentative faite pour reconstruire l'édifice de la croyance humaine, après les travaux de démolition commencés par Bayle et par Locke, achevés par Voltaire ». Mais c'est là un exemple de la manière dont on peut exprimer des idées entièrement différentes avec les mêmes mots, grâce à l'indétermination du langage vulgaire. Sumner Maine a en vue non la science, la théorie, mais la pratique. Cela se voit bien par la proposition qui suit immédiatement le passage cité : « et outre la supériorité que toute tentative de construction a toujours sur les œuvres purement destructives... ». Ce n'est pas l'affaire de la théorie, de créer des croyances ; mais seulement d'expliquer celles qui existent, d'en rechercher les uniformités. Bayle fit un grand pas dans ce sens, montra la vanité de certaines interprétations, et indiqua la voie permettant d'en trouver d'autres cadrant mieux avec les faits. Sous cet aspect théorique, son œuvre, bien loin d'être inférieure, est supérieure à celle de Rousseau, autant que l'astronomie de Kepler est supérieure à celle de Cosme Indicopleuste ; et l'on ne peut déplorer qu'une chose : c'est qu'il se soit arrêté trop tôt sur la voie qu'il avait si bien déblayée.
§ 366. Pourquoi en fut-il ainsi ? Ce n'est pas facile à savoir. Ou observe souvent des cas semblables, et il paraît qu'en science il faut souvent détruire avant de construire. Il se peut aussi que Bayle ait été empêché d'exprimer toute sa pensée, par les persécutions religieuses et morales dont était coutumière l'époque où il vivait, et qui pesaient sur le penseur, au point de vue non seulement matériel, mais aussi intellectuel, en le contraignant à revêtir sa pensée de certaines formes.
De même, aujourd'hui, les persécutions et les tracasseries de tout genre de la religion de la vertu sexuelle ont engendré une hypocrisie de langage, et parfois même de pensée, qui s'impose aux auteurs. C'est pourquoi si, dans les siècles futurs, l'expression de la pensée humaine vient à être délivrée de ces liens, comme elle est délivrée aujourd'hui de l'obligation de se soumettre à la Bible, quand on voudra connaître toute la pensée des auteurs de notre temps, on devra tenir compte des voiles dont la recouvrent les préjugés contemporains.
On voit en outre apparaître ici une cause qui réside dans les défectuosités du langage vulgaire employé en science. Si Bayle n'avait pas eu à sa disposition ces termes « religion », « morale », qui paraissent précis et ne le sont pas, il aurait dû raisonner sur des faits, au lieu de raisonner sur des mots, sur des sentiments, sur des fantaisies; et ce faisant, peut-être n'aurait-il pas perdu son chemin (§ 114).
§ 367. Mais ce cas n'est autre chose que le type d'une classe très vaste d'autres faits semblables, où l'on voit que les défectuosités du langage se trouvent en rapport avec les erreurs du raisonnement. Donc, si l'on veut rester dans le domaine logico-expérimental et ne pas divaguer dans celui du sentiment, on doit toujours avoir l'œil sur ce grand ennemi de la science (§ 119).
Dans les questions sociales, les hommes emploient généralement un langage qui les éloigne du domaine logico-expérimental. Qu'y a-t-il de réel dans ce langage ? Nous devons l'étudier pour pouvoir aller de l'avant. C'est à quoi le chapitre suivant sera consacré.
[205]
Chapitre IV↩
Les théories qui dépassent l'expérience. [(§368 à §632),vol. 1, pp. 205-344]
§ 368. Suivons encore la méthode inductive dans ce chapitre.
Il y a des phénomènes auxquels on donne certains noms, dans le langage vulgaire ; il y a des récits, des théories, des doctrines, qui se rapportent à des faits sociaux. Comment devons-nous les comprendre ? Correspondent-ils à quelque chose de précis ? (§ 114.) Peuvent-ils, moyennant quelques modifications opportunes de forme, trouver place parmi les théories logico-expérimentales (§ 13), ou bien doivent ils être rangés parmi les théories non logico-expérimentales ? Même placés parmi celles-ci, correspondent-ils à quelque chose de précis ?
L'étude que nous allons faire s'attache exclusivement à la force logico-expérimentale que certains raisonnements peuvent avoir ou ne pas avoir. De propos délibéré, nous négligeons de rechercher ici quels sentiments ils recouvrent, question dont nous nous occuperons aux chapitres VI à VIII ; de même, quelle est leur force persuasive, question appartenant aux chapitres IX et X ; et pas davantage quelle peut être l'utilité sociale de ces sentiments, et par conséquent de ce qui peut les faire naître, étude à laquelle nous nous livrerons au chapitre XII. Nous n'envisageons ici que l'aspect objectif des théories, indiqué au § 13.
Les phénomènes désignés dans le langage ordinaire par les termes religion, morale, droit, sont d'une grande importance pour la sociologie. Il y a des siècles que les hommes discutent à leur sujet, et ils ne sont même pas encore arrivés à s'entendre sur le sens de ces termes. On en donne un très grand nombre de définitions, et comme celles-ci ne concordent pas, les hommes en sont réduits à désigner des choses différentes par le même nom, ce qui est un excellent moyen de ne pas s'entendre. Quelle est la raison de ce fait ? Allons-nous essayer d'ajouter une nouvelle définition à toutes celles qu'on a déjà données ? ou ne serait-il pas préférable de suivre une autre voie, pour découvrir la nature de ces phénomènes? (§ 117).
§ 369. Nous avons des récits, comme l'Évangile selon saint Jean, que certains prirent autrefois, et que plusieurs prennent aujourd'hui pour un récit historique, tandis que d'autres y voient une simple allégorie, et que d'autres encore estiment que l'allégorie est mêlée à l'histoire ; et il y a des gens qui prétendent avoir une recette pour distinguer les deux choses. Des opinions semblables eurent cours déjà pour les mythes du polythéisme, et le phénomène paraît général. Que devons-nous penser de ces diverses opinions ? Devons-nous en choisir une ? ou quelque autre voie s'ouvre-t-elle devant nous ?
Nous avons d'innombrables théories sur la morale, sur le droit, etc. Si nous en pouvions trouver une qui soit vraie, c'est-à-dire qui soit d'accord avec les faits, notre travail serait rendu plus facile. Et si nous ne pouvons trouver cette théorie, comment devons-nous procéder pour étudier ces phénomènes ?
§ 370. L'induction nous mettra sur la bonne voie pour reconnaître certaines uniformités expérimentales. Si nous réussissons à les trouver, nous procéderons ensuite d'une manière inverse, c'est-à-dire par voie déductive, et nous comparerons les déductions avec les faits. S'ils concordent, nous accepterons les hypothèses faites, c'est-à-dire les principes expérimentaux obtenus par l'induction. S'ils ne concordent pas, nous rejetterons principes et hypothèses (§ 68, 69).
§ 371. Arrêtons-nous un peu à examiner le terme religion. Ce que nous en dirons s'appliquera par analogie aux autres termes de ce genre, tels que morale, droit, etc., dont nous aurons plus tard souvent à nous occuper. Admettre a priori l'existence de la religion, de la morale, du droit, etc., conduit à rechercher la définition de ces choses ; et vice-versa, rechercher cette définition, c'est admettre l'existence des choses que l'on veut définir. Il est très remarquable que toutes les tentatives faites jusqu'à présent, pour trouver ces définitions, ont été vaines.
Avant de poursuivre notre étude, nous devons rappeler la distinction que nous avons faite (§ 129) entre les mouvements réels et les mouvements virtuels. Nous n'étudions maintenant que les mouvements réels, tandis que nous renvoyons à plus tard l'étude des mouvements virtuels. En d'autres termes, nous nous occupons de ce qui existe, sans chercher ce qui devrait exister pour atteindre un but déterminé.
§ 372. Tout d'abord observons qu'il y a généralement une confusion dans l'emploi des mots religion, morale, droit, etc. Non seulement on unit souvent les deux études que nous avons séparées tout à l'heure, mais encore, quand on les sépare et qu'on dit vouloir s'occuper uniquement de la première, on ne distingue pas ou l'on distingue mal deux aspects, ou, pour mieux dire, plusieurs aspects.
§ 373. Il faut, en effet, distinguer la théorie de la pratique. En un temps donné et chez un peuple donné, il existe une religion théorique, une morale théorique, un droit théorique – (nous les réduisons à l'unité par abréviation ; en réalité ils sont en plus grand nombre, même là où il y a apparence d'unité), – et une religion pratique, une morale pratique, un droit pratique – (et là encore, pour être précis, il faut substituer un nombre respectable à l'unité) (§ 464 et sv.) On ne peut nier ces faits ; mais on a l'habitude de les décrire de manière à en diminuer autant que possible l'importance.
§ 374. Continuant à dire de la religion ce qui doit s'étendre aussi à la morale, au droit, etc., nous voyons donc qu'on suppose qu'il y a une certaine religion, – pour le croyant, celle qu'il dit être vraie, – et dont les religions théoriques qu'on observe sont des déviations ; tandis que les religions pratiques sont à leur tour des déviations de ces religions théoriques. Par exemple, il existe un certain théorème de géométrie. Il peut être démontré plus ou moins bien; et l'on a ainsi des déviations théoriques. Il peut être entendu plus ou moins bien ; et l'on a ainsi des déviations pratiques. Mais tout cela n'infirme pas la rigueur du théorème.
§ 375. Si la comparaison était poussée jusqu'au bout, le sens des termes religion, morale, droit, serait aussi précis qu'on peut le désirer. Ces mots représenteraient certains types, qu'on pourrait aussi déduire des faits existants, – ce qu'on ne peut faire pour le théorème de géométrie – en supprimant l'accessoire de ces faits, et en conservant le principal ; ou bien, comme le veulent les évolutionnistes, en cherchant vers quelle limite tendent ces faits.
§ 376. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Chacun est fermement persuadé que sa religion, sa morale, son droit sont les types vrais ; mais il n'a aucun moyen d'en persuader autrui ; il lui manque le secours de l'expérience en général, ou de cette expérience spéciale qui réside dans le raisonnement logique. Dans une controverse entre deux chimistes, il y a un juge : c'est l'expérience. Dans une controverse entre un musulman et un chrétien, qui est juge ? Personne (§ 16 et sv.).
§ 377. De nos jours, certaines personnes ont cru éviter cet écueil, en renonçant au surnaturel. Ces personnes se figurent que la divergence peut résider uniquement dans ce domaine. Elles se trompent, comme se trompèrent autrefois les diverses sectes chrétiennes, en croyant que les divergences pouvaient naître seulement de l'interprétation de l'Écriture Sainte, laquelle était au-dessus de toute discussion.
§ 378. Au point de vue logico-expérimental, on ne gagne rien à substituer des principes métaphysiques aux êtres surnaturels ; car on peut affirmer ou nier ceux-ci comme ceux-là, sans qu'il y ait un juge pour trancher le différend (§ 16 et sv.).
§ 379. Il ne sert à rien d'appeler à l'aide l'indignation publique. Il est certain que lorsque les luthériens disputaient avec les catholiques, celui qui aurait dit que l’Écriture Sainte avait autant de valeur, au point de vue expérimental, que la théogonie d'Hésiode, celui-là aurait soulevé l'indignation générale, voire unanime ou presque, en Europe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, celui qui s'aviserait de mettre en doute le dogme d'après lequel la société a pour unique but le bien « du plus grand nombre », et de contester que le devoir strict de chaque homme est de se sacrifier pour le bien « des petits et des humbles », soulèverait l'indignation publique. Mais les questions scientifiques sont résolues par les faits ; non par l'indignation de quelques-uns, de beaucoup, ni même de tous.
§ 380. De cette manière, nous n'arrivons donc pas à pouvoir donner aux termes un sens bien défini ; et pourtant, c'est la première chose à faire, si l'on veut raisonner utilement sur des faits scientifiques ; tandis que si le même terme est employé avec des sens différents, par les diverses personnes qui en font usage, tout raisonnement rigoureux devient impossible (§ 442, 490, 965).
§ 381. En outre, cette façon de raisonner a le grave défaut de reporter sur les définitions, des controverses qui devraient venir seulement après que, grâce aux définitions, on sait comment désigner avec précision les choses dont on veut traiter (§ 119, 387, 963).
§ 382. Si l'on dit vouloir définir la vraie religion ou la religion type, ou la religion limite, il est manifeste que l'on ne peut abandonner donner cette définition à l'arbitraire de l'adversaire. Elle renferme un théorème : c'est l'affirmation que la chose définie est celle qui correspond à la vérité, au type, à la limite. Tel est le principal motif pour lequel les physiciens ne songent pas à se chamailler au sujet du nom donné aux rayons X ; ni les chimistes, à propos de celui donné au radium ; ni les astronomes, sur le nom donné à l'une des nombreuses petites planètes (excepté les questions d'amour-propre du découvreur) ; tandis qu'on dispute avec tant d'énergie sur la définition qu'on veut donner de la religion (§ 119).
§ 383. Voici, par exemple, S. Reinach qui écrit un livre sous le titre d'Orpheus, Histoire générale des religions, qui serait peut-être mieux nommé -. Histoire générale des religions, vues à la lumière du procès Dreyfus. Il croit que les dogmes de la religion catholique, voire chrétienne, sont faux, tandis que les dogmes de sa religion humanitaire-démocratique sont vrais. Il peut avoir tort ou raison. Nous ne discutons pas ce point, et ne croyons pas que la science expérimentale ait la moindre compétence pour résoudre la question. De toute façon, elle devrait être traitée indépendamment des définitions. Au contraire, Reinach tâche de faire accepter une définition qui lui permette d'atteindre son but.
Ses adversaires puisaient leur force dans la religion catholique. Il veut montrer qu'au fond cette religion ne consiste que dans les tabous des peuples inférieurs. C'est pourquoi il lui est nécessaire d'éliminer, dès la définition, tout ce qui correspond à des concepts intellectuellement supérieurs. Il le fait habilement ; car enfin sa définition [FN: § 383-1] ne s'éloigne pas trop des faits (977). Mais ses propositions, vraies ou fausses, auraient leur place dans un théorème, sujet à controverse de par sa nature, et non dans une définition dont celui qui la donne peut disposer arbitrairement, au moins en partie.
§ 384. D'autre part, voici le P. Lagrange qui croit à la vérité des dogmes catholiques et qui, naturellement, ne peut accepter la définition de Reinach, sous peine de suicide. Il dit [FN: § 384-1] : « (p. 8) M. Reinach semble croire qu'une bonne définition doit s'appliquer à toute l'extension qu'a (p. 9) prise un terme, même par abus ». Au fond, on trouve ici l'idée de religion-type. Quand on s'éloigne du type, on tombe dans l'abus. Mais le P. Lagrange ne prend pas garde que ce qui est pour lui type est abus pour un autre, et vice versa.
Il continue : « (p. 9) Parce qu'on parle, abusivement, – la figure se nomme catachrèse en termes de rhétorique, – de la religion de l'honneur, cette définition doit être contenue dans la définition de la religion en général ». Oui, elle doit y être contenue, si l'on veut définir ce que les hommes appellent religion ; de même que la définition de la conjugaison du verbe irrégulier doit être contenue dans la définition générale de la conjugaison, si l'on vent définir ce que les grammairiens appellent conjugaison ; et il n'y a pas à chercher si c'est la conjugaison régulière ou irrégulière qui est abusive. Non, elle ne doit pas y être contenue si, à l'avance, on a explicitement exclu certains faits ; ce que ne fait pas du tout le P. Lagrange. Je puis dire qu'en latin, les verbes actifs de la première conjugaison forment leur futur en abo, abis, abit, etc., parce qu'en disant verbes actifs de la première conjugaison, j'ai, à l'avance et explicitement, exclu les autres. Mais je ne pourrais en dire autant des verbes en général, puis, quand on me mettrait sous les yeux le verbe lego, qui fait legam, leges... au futur, me tirer d'embarras en disant que c'est là un abus. Je puis dire, bien que cette théorie ne soit peut-être pas juste, qu'à l'origine, les désinences actives des temps principaux des verbes grecs étaient ![]() …, parce que j'ai, à l'avance et explicitement, dit que je m'occupais de l'origine
; ce qui me permet de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant (à tort ou à raison) qu'ils ne sont pas primitifs. Mais je ne pourrais dire d'une façon générale, sans la restriction de l'origine, que les verbes grecs ont cette désinence, et tenter ensuite de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant que c'est un abus.
…, parce que j'ai, à l'avance et explicitement, dit que je m'occupais de l'origine
; ce qui me permet de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant (à tort ou à raison) qu'ils ne sont pas primitifs. Mais je ne pourrais dire d'une façon générale, sans la restriction de l'origine, que les verbes grecs ont cette désinence, et tenter ensuite de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant que c'est un abus.
En somme, que veut définir le P. Lagrange ? Ce que les hommes appellent religion (question linguistique) ? ou bien autre chose ? Et dans ce dernier cas, quelle est précisément cette chose ? S'il ne nous le dit pas, nous ne pouvons savoir si sa définition est bonne ou mauvaise.
§ 385. Le P. Lagrange continue : « (p. 9) Et l'on aboutit à cette définition de la religion : un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés. On dirait que c'est une gageure, car, avec une candeur triomphante, M. Reinach note aussitôt que sa définition élimine du concept fondamental de la religion – tout ce qu'on entend généralement comme l'objet propre du sentiment religieux ».
§ 386. Il paraîtrait donc que le P. Lagrange cherche ce qu'on entend généralement par religion. Nous retombons dans une question de linguistique. Mais prenons garde à ce terme généralement, car il est trompeur. Que veut-il dire ? Allons-nous faire une statistique des opinions des hommes ? des vivants ou aussi de ceux qui vécurent aux temps passés ? des Européens ou de tous les hommes qui vivent ou vécurent à la surface du globe ? Allons-nous compter les opinions ou les peser? (§ 594) et dans ce dernier cas, avec quelle balance ? Il semblerait que le P. Lagrange veuille les peser, puisqu'il y en a qu'il appelle abusives. Mais, dans ce cas, prenons bien garde que si c'est lui qui choisit la balance, elle donnera le poids qu'il voudra ; et si c'est un de ses adversaires qui la choisit, elle donnera un poids entièrement différent. Et puis prenons garde qu'outre cette religion générale, il reste des religions particulières. Qu'allons-nous en faire ? Pour les exclure, il faut revenir à la théorie de la religion type.
§ 387. Notre auteur ajoute : « (p. 9) C'est dire que la définition est détestable. Sans doute les logiciens admettent qu'un mot n'a que le sens qu'on lui prête, mais définir un terme reçu à rebours de l'opinion générale c'est un jeu puéril ou un attrape-nigauds ».
Un instant ; est-ce bien sûr ? Par exemple, l'eau des chimistes n'est pas du tout l'eau du vulgaire. L'or des chimistes n'est pas du tout l'or du vulgaire. Pour celui-ci, un louis est en or ; pour le chimiste, il est d'or, mélangé à du cuivre, et présente des traces de nombreux autres corps simples. Ce ne fut pas du tout un « jeu puéril » que définir les corps chimiques, contrairement à « l'opinion générale ». Au contraire, ce fut l'unique moyen d'élever la chimie au rang de science (§ 115). Reinach est donc parfaitement maître de définir la religion « contrairement à l'opinion générale », pourvu que : 1° il donne une définition claire et précise; 2° qu'il ne confonde jamais ce qu'il a défini, avec une autre chose différente qui porte le même nom; 3° qu'il montre que cette nouvelle définition a une utilité compensant le souci de devoir toujours nous rappeler que la religion de Reinach n'est pas la religion des autres gens ; et pour nous ôter ce souci et éviter tout danger de confusion, il serait bon, au lieu d'adopter un terme déjà en usage, qu'il en adoptât un autre (§ 117), et qu'il dît, par exemple : « J'appelle X l'ensemble des scrupules qui font obstacle au libre usage de nos facultés ». Après, mais seulement après (§ 381), pourrait venir un théorème où l'on dirait : « X se trouve dans tout ce que les hommes appellent religion, et pas ailleurs ». On pourrait alors vérifier par les faits si cette proposition est vraie ou fausse (§ 963).
§ 388. C'est ce que nous allons faire, parce que c'est l'unique aspect sous lequel la science expérimentale peut considérer ces questions. Le chimiste nous dit que l'eau est un composé d'hydrogène et d'oxygène. La première des conditions que nous avons posées est satisfaite. La seconde l’est aussi, parce que, dans un traité de chimie, on ne confond jamais l'eau chimiquement pure et l'eau ordinaire. La troisième l'est, parce que l'utilité de savoir précisément quelle est la substance qu'on appelle eau, est évidente (§ 108, 69-3). Puis on nous dit : l'eau chimique constitue la partie principale de l'eau des puits, des lacs, des fleuves, de la mer, de la pluie : toutes substances que le vulgaire appelle eau. Nous vérifions, et nous voyons que c'est vrai. Si l'on ajoutait ensuite que l'eau chimique n'est pas la partie principale des choses auxquelles le vulgaire refuse le nom d'eau, la vérification ne réussirait pas aussi bien, parce que l'eau est la partie principale du vin, de la bière, des sirops, etc.
§ 389. Pour éviter des amphibologies, donnons un nom à la chose définie par Reinach, et appelons-la la religion α. Si la religion α se trouve ensuite être identique à la simple religion, tant mieux pour la théorie de Reinach. Nous ne faisons aucun tort à cette théorie en employant ce nom de religion α, qui est une simple étiquette mise sur la chose pour pouvoir la désigner (§ 119).
§ 390. Il est certain que beaucoup de religions, qui sont et furent celles de millions et de millions d'hommes, comme le polythéisme indo-européen, les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, le fétichisme, etc., contiennent la religion α. Mais toutes ces religions que nous venons d'énumérer, excepté, au moins en partie, le fétichisme, contiennent aussi autre chose que nous appellerons religion β (§ 119), et qui, pour employer les termes du P. Lagrange [FN: § 390-1] , est « la croyance à des pouvoirs supérieurs avec lesquels on peut nouer des relations ». Quelle est la partie principale ? la religion α ou la religion β, dans ce que les gens appellent religion ? Pour répondre, il serait nécessaire de savoir ce que veut dire précisément ce terme principale. Quand on comparait l'eau chimique à l'eau des fleuves, principale voulait dire la partie de plus grand poids. Après avoir fait l'analyse chimique de l'eau d'un fleuve, on voit que l'eau chimique est la partie qui, de beaucoup, pèse plus que les autres. Mais comment ferons-nous l'analyse des religions, et comment en pèserons-nous les éléments ?
§ 391. On peut dire : « La partie principale est la croyance à des pouvoirs supérieurs, car les scrupules dont parle Reinach en procèdent logiquement ». À quoi l'on peut répondre : « La partie principale c'est les scrupules, car c'est leur existence qui a engendré chez l'homme la croyance aux pouvoirs supérieurs ». Rappelons-nous les deux propositions : « S'il y a des dieux, il est une divination », et : « S'il est une divination, il y a des dieux [FN: § 391-1] ». Prenons garde qu'ici « principale » paraît vouloir dire : « antérieure ». Quand bien même on aurait démontré que la croyance aux pouvoirs supérieurs précéda les scrupules, il n'en résulterait pas du tout qu'à une époque postérieure, les scrupules demeurèrent seuls, et constituèrent la partie la plus active. Si l'on démontrait que les scrupules sont antérieurs, cela n'impliquerait pas qu'ils n'aient pas cédé ensuite la place à la croyance aux pouvoirs supérieurs.
§ 392. Si l'on demande ensuite : « La religion α ou la religion β existent-elles dans tous les phénomènes qui portent le nom de religieux ? » il faut répondre non. D'une part, la religion α est plus répandue que la religion β ; car, sinon dans tout, au moins dans une partie du fétichisme et des tabous, comme aussi dans la libre pensée moderne, dans le positivisme de A. Comte, dans la religion humanitaire, dans les religions métaphysiques, on trouve les scrupules et pas les puissances supérieures, ou du moins elles n'apparaissent pas clairement. Il est vrai que A. Comte finit par en créer de fictives ; mais dans le domaine théorique, elles demeurent toujours telles. Cela prouve seulement que là où l'on trouve les scrupules, il se manifeste aussi une propension à les expliquer par les puissances supérieures.
§ 393. D'autre part, il y a aussi quelques cas où, si l'on réduit la religion β à la croyance en des êtres supérieurs, on peut dire que la religion β existe sans la religion α , ou du moins sans que celle-ci dépende de celle-là. Exemple : la religion des Épicuriens [FN: § 393-1] . Si l'on disait qu'on n'en doit pas tenir compte, parce qu'elle est blâmable, nous répondrions que nous ne cherchons pas comment sont composées les religions louables, mais toutes les croyances qui portent le nom de religion. Et si l'on disait que les Épicuriens avaient aussi des scrupules, nous répondrions que si l'on veut donner cette signification à la religion α , on la trouve partout ; car il n'y a pas et il n'y a pas eu un homme au monde, qui n'ait quelque scrupule, ou qui n'en ait pas eu. Dans ce cas, la religion α ne définirait rien, parce qu'elle définirait tout.
§ 394. Il est une secte bouddhique où l'on ne trouve pas trace de la seconde partie de la définition de la religion β, c'est-à-dire des relations étroites avec les êtres supérieurs ; et même cette partie est formellement exclue. Écoutez plutôt cette conversation entre Guimet et trois théologiens japonais [FN: § 394-1] .
« (p. 337) GUIMET. Je suis venu aujourd'hui dans votre temple pour vous demander des renseignements sur les principes de la religion bouddhique en général et sur ceux de votre secte en particulier * ».
On remarquera que Guimet et beaucoup d'autres personnes appellent religion la chose dont nous parlons ici. Si l'on accepte la thèse du P. Lagrange, on pourrait vouloir exclure cette chose du nombre des religions, en disant qu'elle porte abusivement ce nom. Mais si la simple épithète abus suffit à exclure les faits contraires à une théorie, il est manifeste que toute théorie sera toujours vérifiée par les faits, et qu'il est inutile de perdre son temps à des investigations sur ce point. Rappelons pour la dernière fois que nous cherchons ici les caractères des choses nommées religions, et non de celles qu'il peut plaire à un auteur de désigner par ce nom.
« (p. 338) D. Ma première question porte sur l'origine du ciel, de la terre et de tout ce qui nous entoure. Comment expliquez-vous leur formation d'après le principe de la religion bouddhique ? »
« R. La religion bouddhique attribue l'existence de toute chose à ce qu'elle appelle In-En (Cause-Effet). Chaque chose n'est que la réunion d'atomes, infiniment subtils, et ce sont ces atomes qui, se réunissant les uns aux autres, ont formé les montagnes, les rivières, les plaines, les métaux, les pierres, les plantes et les arbres. L'existence de ces objets découle du rapport naturel de leur In à leur En, absolument comme tous les êtres animés naissent en vertu de leur propre In-En. »
« D. N'y a-t-il donc aucun créateur du ciel, de la terre et de toutes les autres choses ? »
« R. Non. »
« D. Qu'est-ce alors que vous appelez In-En ? »
« R. Aucune chose ne se forme naturellement et de son propre mouvement. C'est toujours le rapport de ceci à cela qui constitue une chose …… »
« (p. 339) D.... Je vous demande maintenant si les actes des hommes dépendent de Dieu. »
« (p. 340) R. Les actes de l'homme sont ses actes propres ; ils ne dépendent en aucune façon de Dieu ».
Où sont les relations avec les êtres supérieurs, que tous admettent, d'après le P. Lagrange ?
« D. Alors, n'admettez-vous pas que Dieu exerce son influence sur l'humanité et nous dirige dans l'accomplissement des divers actes d'invention ou de perfectionnement ? »
« R. La religion bouddhique n'admettant aucun créateur et attribuant tout à l'In-En, déclare par cela même que tout acte de l'homme s'accomplit par sa propre initiative sans aucune intervention de Dieu. »
« D. L'expression de Dieu est impropre. Néanmoins votre religion reconnaît un être supérieur, Amida, qu'elle adore avec vénération et foi. Eh ! bien, la puissance d'Amida n'influe-t-elle pas sur les actes de l'homme ? »
« R. Les différences qui existent entre les hommes au point de vue de leur valeur personnelle et de la valeur de leurs actes, tiennent au plus ou moins d'éducation qu'ils ont reçue, mais ne dépendent pas de la volonté d'Amida. »
……………………………………………………………………………………….
« D. J'admettrai bien que c'est par le travail qu'on augmente ses connaissances... mais en entrant dans le domaine de la morale, de la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, ne semble-t-il pas qu'il existe un être supérieur qui récompense ou punit nos actes, de même que le pouvoir social punit les infractions aux règles d'ordre public ? »
« R. Tout bien ou tout mal a pour conséquence un bonheur ou une peine. Cela résulte de l'idée toute naturelle de l'In-Goua (synonyme de In-En) ».
§ 395. Plus loin : « (p. 344) R. Dans la religion bouddhique en général, on parle souvent du succès des demandes adressées à la divinité ; mais notre secte les interdit absolument ».
Si nous voulons maintenir inséparables les deux parties de la définition de la religion β soit la croyance en des êtres supérieurs et la croyance qu'on peut nouer des relations avec eux, nous devrons dire qu'on ne trouve pas la religion β dans les deux qui viennent d'être citées ; et nous ne saurons pas où les ranger, parce qu'elles ne rentrent pas non plus dans la définition de la religion α.
§ 396. Concluons donc que, comme d'habitude, les termes du langage courant ne se prêtent pas à des classifications rigoureuses. La chimie, la physique, la mécanique, etc., n'ont pas été constituées en étudiant les termes du langage vulgaire et en les classant, mais en étudiant et classant les faits. Essayons d'en faire autant pour la sociologie.
§ 397. En attendant, et toujours par induction, nous découvrons ici que les définitions de Reinach et du P. Lagrange sont de natures diverses. Peut-être sans que ces auteurs s'en aperçoivent, tendent-elles à classer des faits différents ; la définition de Reinach : certains états d'âme ; celle du P. Lagrange : les explications qu'on en donne ? Sont-ce là, d'une façon générale, deux ordres de faits qu'il convient de distinguer, de classer, d'étudier ? Nous verrons. Il y a ici une différence de fond, et non de formes du langage ordinaire. Pour le moment, continuons l'étude que nous avons commencée.
§ 398. Les difficultés rencontrées par ceux qui ont essayé de définir le droit et la morale ne sont pas moindres que celles dont est assailli celui qui veut définir la religion. On n'a pas même trouvé moyen de séparer le droit de la morale. À un extrême, nous avons une définition grossièrement empirique. On nous dit que le droit est constitué par les règles qui ont pour sanction les injonctions de l'autorité publique, et que la morale est formée par les règles imposées seulement par la conscience. Cette définition convient très bien aux buts pratiques de l'avocat et du juge, mais n'a pas la moindre valeur scientifique, parce qu'elle prend pour critère des éléments accidentels et variables. Elle est semblable à celle qui, pour classer les oiseaux, prendrait pour critère la couleur des plumes. Un acte passe du droit à la morale ou vice versa, suivant la volonté ou le caprice du législateur, et par conséquent cette classification peut nous faire connaître cette volonté ou ce caprice, et non, comme c'était notre but, la nature des actes, abstraction faite de la manière dont ils peuvent être jugés. Notez en outre que cette classification devient inutile quand, comme cela arriva en des temps reculés, le pouvoir public ne s'entremet pas pour imposer ou appuyer le droit privé. Dans les pays civilisés modernes, il y a une législation écrite ; par conséquent il est facile de savoir si oui ou non un acte quelconque est réglé par la loi. La définition qui vient d'être donnée est donc expérimentale, claire et précise ; mais cela importe peu, car elle ne classe pas les choses que l'on avait en vue.
§ 399. Quand ensuite, on veut au contraire considérer intrinsèquement ces choses, on est conduit à en rechercher l'essence. De cette façon, on abandonne peu à peu le domaine expérimental pour planer dans les nuages de la métaphysique, et l'on tombe dans l'autre extrême où disparaît toute réalité objective.
§ 400. Il y a des gens qui ont la naïveté de l'avouer. Voici, par exemple, Ad. Franck, qui nous dit [FN: § 400-1] : « L'idée du droit, à la considérer en elle-même, indépendamment des applications dont elle est susceptible et des lois plus ou moins justes qui ont été faites en son nom, est une idée de la raison absolument simple et qui échappe par là même à toute définition logique ». Voilà qu'on reconnaît clairement que ce concept appartient à une catégorie qui correspond aux actions non-logiques ; et si quelque autre théorie, comme celle des idées innées, ne vient à notre secours, nous devrons admettre que ce concept varie suivant le temps, les lieux, les individus. Pour le nier, il faut donner à ces « idées simples » une existence objective, comme l'eurent autrefois les dieux de l'Olympe.
Il est des gens qui essaient de combler par des subtilités ingénieuses le fossé qui sépare ces idéologies de la réalité, comme font d'habitude ceux qui tâchent de recouvrir les actions non-logiques, d'un vernis logique. Nous en avons parlé déjà au chapitre III.
§ 401. Un autre bel exemple de discours dépourvus de toute précision est celui des théories sur le droit naturel et sur le droit des gens. De nombreux penseurs ont eu des sentiments qu'ils ont exprimés de leur mieux par ces termes, et se sont ensuite ingéniés à accorder ces sentiments avec les buts pratiques qu'ils voulaient atteindre. Dans cette œuvre, ils ont, comme d'habitude, fait tourner à leur avantage l'emploi de mots indéterminés qui ne correspondent pas à des choses, mais seulement à des sentiments. Nous allons examiner ces raisonnements au point de vue de la correspondance qu'ils peuvent avoir ou non avec la réalité expérimentale. Il ne faut pas transporter dans un autre domaine les conclusions auxquelles nous arriverons ainsi (§ 41). Ce point de vue est indépendant de celui de l'utilité sociale. Il peut arriver qu'une théorie ait cette utilité en certains cas et à certaines époques, sans correspondre à la réalité expérimentale. Le droit naturel est simplement celui qui paraît être le meilleur à qui emploie cette expression. Mais l'on ne peut étaler naïvement la chose en ces termes. Il convient d'user de quelque artifice, d'ajouter quelque raisonnement.
§ 402. Les objections que l'on pourrait faire à qui veut nous enseigner le droit naturel, seraient repoussées de la manière suivante : « Pourquoi dois-je admettre votre opinion ? – Parce qu'elle est conforme à la raison. – Mais moi aussi j'use de la raison, et je pense autrement que vous. – Oui, mais la mienne, c'est la Droite Raison (§ 422 et sv.). – Comment se fait-il que vous ne soyez que quelques-uns à la connaître ? – Nous ne sommes pas quelques-uns ; notre opinion jouit du consentement universel. – Et pourtant il y a des gens qui pensent différemment. – Nous entendons : le consentement des bons et des sages. – Soit. Est-ce vous, les bons et les sages, qui avez inventé ce droit naturel ? – Non, en vérité ; il nous a été enseigné par la Nature, par Dieu ».
§ 403. Les éléments que les défenseurs du -droit naturel mettent en œuvre sont avant tout : la Droite Raison, la Nature et ses appendices : c'est-à-dire la raison naturelle, l'état de nature, la conformité avec la nature ; et ensuite la sociabilité, etc., le consentement de tous les hommes ou d'une partie seulement, la volonté divine.
§ 404. On envisage en particulier deux questions : qui est l'auteur du droit naturel ? comment nous est-il révélé [FN: § 404-1] ? Dieu peut être l'auteur du droit naturel, ou directement, ou indirectement, par le moyen de la Droite Raison et de la Nature, ses ministres. La Nature peut être l'origine du droit naturel, ou directement, ou mieux indirectement, en inculquant à l'esprit humain le droit naturel (ou la loi) qui est ensuite découvert par la Droite Raison ou par l'observation de l'opinion générale ou de celle des hommes les plus qualifiés. On peut aussi méditer sur ce que serait l'homme « à l'état de nature »; état qu'à vrai dire personne n'a jamais vu, mais qui n'a pas de mystère pour messieurs les métaphysiciens, tant et si bien que, de cet état à eux très connu, aux autres gens entièrement inconnu, ils tirent la connaissance de ce que nous avons sous les yeux, et que nous pourrions ainsi connaître directement. Enfin, la Droite Raison peut seule imposer l'observation du droit naturel.
§ 405. Le droit naturel peut nous être révélé directement par Dieu, au moyen d'écrits inspirés par lui ; mais c'est un cas peu fréquent. L'observation directe et le consentement de tous les hommes ou d'une partie des hommes, pourraient aussi révéler directement le droit naturel. Mais pratiquement, cette méthode s'emploie peu ou point. Proprement, c'est à la Droite Raison qu'incombe la tâche de nous révéler le droit naturel, soit comme procédant d'elle-même, soit comme tirant son origine de la Nature, de Dieu, ou comme résultant du consentement universel ou d'un consentement plus limité.
§ 406. En somme, on affirme assez généralement que le concept de loi naturelle existe dans l'esprit humain. On ajoute souvent l'indication de l'origine de ce concept ; et l'on ajoute aussi la confirmation du consentement universel, ou des gens les plus qualifiés. D'habitude, presque tous les éléments sont mis en œuvre ensemble, parce qu'il convient de s'aider de la plus grande somme possible de sentiments ; et les divers modes de révélation sont aussi déclarés concordants, toujours pour le même motif.
§ 407. Le raisonnement subjectif procédant par accord de sentiments paraît être le suivant. On s'aperçoit que les lois existantes ne sont pas une production arbitraire, ni entièrement logique ; qu'il y a un substratum qui échappe à l'arbitraire et qui a une existence propre. Cette induction est d'accord avec les faits et devrait être exprimée en disant qu'il y a certains principes d'actions non-logiques, dont les hommes tirent leurs lois. Ces principes d'actions non-logiques (ou résidus, chap. VI) sont en rapport avec toutes les conditions dans lesquelles vivent les hommes, et changeantes avec elles.
§ 408. Mais cette forme de raisonnement, qui met en lumière les caractères relatifs, subjectifs, non-logiques des principes, répugne aux métaphysiciens, aux théologiens et aussi à de très nombreuses personnes qui étudient les faits sociaux. Ils cherchent l'absolu, l'objectif, le logique, et le trouvent toujours, grâce à l'usage de mots indéterminés et de raisonnements défectueux (dérivations, chap. IX). Dans notre cas, les auteurs cherchent l'absolu et l'objectif dans le consentement de beaucoup de gens ou de tous, dans la conformité avec la Nature, dans la volonté divine. Toutes ces choses ou une partie d'entre elles apparaissent à leur esprit comme excellentes, Elles doivent donc s'accorder avec cette autre chose excellente qu'est le droit naturel ; et la logique doit nous donner le lien qui unit celui-ci à celles-là (§ 514). Dans leurs théories, sous les voiles on voit apparaître constamment l'idée de l'opposition entre quelque chose de constant et de bon (droit naturel) et quelque chose de variable et de médiocre (droit positif). C'est de cette opposition que naît principalement leur persuasion et celle de qui les approuve (§ 515).
§ 409. Suivant les préférences de l'auteur, tel ou tel élément occupe la première place. On comprend que les chrétiens ne puissent se passer de Dieu ; mais il est remarquable qu'ils le font intervenir plutôt indirectement que directement. Cela vient peut-être de ce que, chez eux, le métaphysicien s'impose au chrétien. Les métaphysiciens purs se contentent de la Droite Raison.
§ 410. Aristote [FN: § 410-1] donne pour caractéristique du droit naturel le fait qu'il a partout la même force ; ce qui ne veut pas dire qu'il soit partout le même ; car il peut être variable de sa nature (4). Aristote oppose cette considération à ceux qui niaient le droit naturel, parce que le droit des différents peuples est variable (2). Dans la Rhétorique (1, 13, 2), il s'exprime ainsi [FN: § 410-2] : « Je dis que la loi est particulière ou commune. La loi particulière est celle que quelques-uns établissent pour eux-mêmes. Elle peut être écrite ou non. La loi commune est celle qui est selon la Nature, puisqu'il y a un juste et un injuste par nature, que tous devinent sans qu'il y ait eu entre eux communication ni entente ». Ce sont là justement des principes d'actions non-logiques, principes qui existent chez les hommes et varient suivant les conditions au milieu desquelles ils vivent. La théorie d'Aristote paraît donc évidemment attribuer la première place à la Nature. Le consentement universel est une façon de manifester cette origine selon la nature.
§ 411. Ce qui a partout la même force, on ne sait comment le distinguer de ce qui n'a pas cette force. Aristote croit l'expliquer en citant l'exemple de la loi qui prescrit de sacrifier une chèvre à Zeus, et non une brebis. En effet, à première vue, il semble que le caractère arbitraire soit ici patent ; mais une légère modification suffit pour présenter la même prescription avec le caractère de pseudo-universalité, requis pour le droit naturel. Il suffit de dire : « En chaque contrée, on doit suivre les usages du pays. En ce pays, on a l'habitude de sacrifier une chèvre et non une brebis ; donc on doit sacrifier la chèvre ».
§ 412. Il est remarquable que dans un seul et même traité, Cicéron louvoie entre les diverses démonstrations, montrant ainsi que ce ne sont pas les conclusions qui résultent de la démonstration, mais bien qu'on choisit cette dernière de façon à obtenir les premières. Dans le traité des Lois, Cicéron dit : « (I, 6, 20) Je rechercherai l'origine du droit dans la Nature, qui doit nous guider dans toute cette discussion ». Ici, la Nature est invoquée directement ; mais un peu plus haut, elle apparaissait indirectement, et la première place était donnée à la « Raison suprême ». L'auteur dit : « (I, 6, 18) La loi est la Raison suprême, inculquée à notre nature, qui ordonne ce qu'on doit faire, défend le contraire. Quand cette raison est définie et imprimée dans l'esprit de l'homme, c'est la loi... ». (6, 19) Si c'est bien juste, comme il me paraît, c'est de la loi qu'est issu le droit : elle est la force de la nature, l'esprit et la raison du sage ; elle est la règle du juste et de l'injuste ».
§ 413. La divinité manquait à cette énumération de choses parfaites. La voici qui apparaît. « (II, 4, 8) Je vois que l'opinion des plus savants fut que la loi n'est pas imaginée par l'esprit de l'homme ni décrétée par aucun peuple ; mais que c'est quelque chose d'éternel, qui régit tout le monde par la sagesse des prescriptions et des défenses. C'est pourquoi ils disaient que cette première et dernière loi était l'esprit des dieux obligeant ou défendant, avec toute raison. Par conséquent, cette loi que les dieux donnèrent au genre humain est à bon droit louée. C'est donc la raison et l'esprit du sage, capables d'exhorter et de dissuader ».
§ 414. Autre part, la Droite Raison est donnée comme étant la loi ; et puisque la Droite Raison est commune aux dieux et aux hommes, ceux-ci sont en société avec les dieux. C'est bien cela. « (I, 7, 23) Puisque rien n'est meilleur que la raison, et qu'elle existe chez l'homme et chez le dieu, il y a donc une première société de raison de l'homme et du dieu. Mais ceux qui possèdent la raison en commun ont aussi en commun la Droite Raison ; et puisque celle-ci est la loi (quae cum sit lex), nous devons, de par la loi, nous estimer associés aux dieux ».
§ 415. De nouveau, nous revenons à la Nature. « (II, 5, 13) Donc la loi est la distinction du juste et de l'injuste, principe de toute chose, modelée très anciennement sur la Nature ». Cette nature est élastique comme la gomme : on en fait tout ce qu'on veut. « (I, 8, 25) La vertu n'est pas autre chose que la Nature parfaite en elle-même et achevée [FN: § 415 note 1)] ».
§ 416. Il est impossible de lire tout cela sans voir que l'auteur a une idée claire d'une loi qui n'est pas conventionnelle. Il le manifeste en disant: « (I, 10, 28) que le droit a été constitué non d'après une opinion, mais d'après la nature – neque opinione, sed natura constitutum esse ius ». Puis il a des idées confuses au sujet de l'origine et de la nature de cette loi ; il va à tâtons, et cherche tout ce qu'il peut trouver de parfait, pour l'associer à son idée de la loi.
§ 417. Depuis Cicéron, on n'a fait que peu ou point de progrès, et les auteurs qui traitent du droit naturel continuent à combiner les mêmes concepts, de toutes les manières possibles. On n'a fait que substituer le Dieu des chrétiens aux dieux des païens. On ajoute un vernis scientifique, et l'on demande à une pseudo-observation de nous faire connaître la volonté de dame Nature.
§ 418. Les jurisconsultes romains ont souvent placé leurs théories sous la protection d'un certain droit naturel (ius naturae, naturale) commun à tous les hommes et même aux animaux. On a voulu les justifier en observant qu'il existe certains caractères communs aux hommes et aux animaux. Mais ce n'est pas du tout de ces caractères qu'il s'agit. Ils ne jouent en aucune façon le rôle d'un principe de droit, tel que les partisans du droit naturel l'ont en vue : Semblablement, du fait que certains caractères bons ou mauvais du père influent sur la nature de sa descendance, ou a voulu déduire qu'il était juste que les fils fussent punis pour les fautes du père (§ 1965 et sv.). On confond ainsi un état de fait avec un état de « droit » : ce qui arrive avec ce que l'on prescrit devoir arriver. Autre chose est dire : « D'un père syphilitique naît une progéniture qui a certaines maladies », autre chose : « On doit punir le père syphilitique dans le fils, en donnant artificiellement à celui-ci des maladies qu'il n'a pas ».
De même, on a donné le nom de solidarité à la dépendance mutuelle des hommes et des animaux ou des hommes entre eux ; puis, de ce fait, on a voulu déduire une chose entièrement différente, soit un certain droit de solidarité (§ 449, 450).
§ 419. Dans les Institutes de Justinien, on nous dit : « (I, 2) Le droit naturel est celui que la Nature enseigne à tous les êtres vivants ; car ce droit n'est pas propre au genre humain, mais à tous les êtres qui vivent dans le ciel, sur la terre, dans la mer. De là vient l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage ; de là, la procréation et l'éducation des enfants. Nous voyons effectivement que les autres êtres vivants semblent avoir connaissance de ce droit ». Si nous enlevons le voile du sentiment, ce passage est vraiment comique. Il ne suffit pas aux compilateurs des Institutes d'énumérer tous les animaux. Ils insistent afin de dissiper tous les doutes et d'enfler la période : ils parlent de tous les êtres qui vivent dans l'air, sur la terre et dans l'eau. Nous avons ainsi un droit naturel des lombrics, des puces, des poux, des mouches, et aujourd'hui nous pourrions ajouter : des infusoires. Non seulement ce beau droit existe, mais ces animaux le connaissent ; ce qui est certes merveilleux au-delà de toute expression.
§ 420. Comme preuve, on donne le mariage. Chez certaines espèces d'araignées, le mâle saisit le moment auquel la femelle ne le voit pas, pour s'élancer sur elle et s'accoupler ; puis il s'enfuit au plus vite, car si la femelle l'attrape, elle le dévore. Elle est vraiment étrange la manière dont ces animaux connaissent et emploient le droit naturel du mariage !
§ 421. Pour mettre d'accord le droit avec les faits, les compilateurs des Institutes se servent d'un moyen qui est très en usage : ils changent quelque peu le sens des termes. Quand ils disent : hinc descendit maris atque feminae coniugatio (al. coniunctio), quam nos matrimonium appellamus, ils contredisent ce qu'ils avancent plus loin (I 10, 12) : Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur. Donc, tantôt ils déclarent appeler matrimonium la simple union, comme est celle des animaux, tantôt ils refusent ce nom aux unions qui n'ont pas d'autres caractères donnés. L'une de ces deux propositions doit nécessairement être éliminée, puisqu'elles sont contradictoires. Il convient que ce soit la première, car il est certain que, dans le langage du droit, le matrimonium est quelque chose d'autre que la simple union.
§ 422. Le droit des gens (ius gentium) nous est donné comme imposé par la raison naturelle (naturalis ratio). C'est là une belle entité, à laquelle on peut recourir dans les cas difficiles, et qui sert à démontrer beaucoup de belles choses ! Elle s’appelle aussi la droite raison ![]() , la vraie raison, la juste, l'honnête raison, etc. On ne réussit pas à expliquer comment on peut distinguer la raison qui mérite ces excellentes épithètes, de celle qui en doit être dépourvue ; mais, en somme, la première est toujours celle qui plaît le mieux à l'auteur qui lui donne l'épithète favorable.
, la vraie raison, la juste, l'honnête raison, etc. On ne réussit pas à expliquer comment on peut distinguer la raison qui mérite ces excellentes épithètes, de celle qui en doit être dépourvue ; mais, en somme, la première est toujours celle qui plaît le mieux à l'auteur qui lui donne l'épithète favorable.
§ 423. Paul affirme que A est B ; Jacques le nie. Paul croit démontrer son assertion en ajoutant que la droite raison veut que A soit B. Mais pourquoi la raison de Paul est-elle droite, et pas celle de Jacques ? Qui jugera de cette controverse ? Si Jean survient et dit qu'à son idée c'est la raison de Paul qui est droite, cela prouve seulement que Paul et Jean pensent de même sur ce point. Quel rapport a ce fait avec l'autre, avec celui que A doit être B ? Si, au lieu de Jean, ce sont plusieurs hommes, beaucoup d'hommes, tous les hommes, qui admettent l'avis de Paul, cela continue à n'avoir pas de rapport avec la proposition objective d'après laquelle A est B, excepté le cas où l'on verrait en ce consentement la preuve de cette proposition. Mais si l'on veut raisonner ainsi, il vaut autant et même mieux donner directement ce motif, sans exhiber la droite raison pour la faire disparaître ensuite. Cela au point de vue exclusivement expérimental et logique. Mais pour agir sur le sentiment, l'intervention de la droite raison est utile ; car on suggère que celui qui n'accepte pas la démonstration que l'on veut donner est digne de blâme. Ce procédé est général. Nous en traiterons plus loin (§ 480 et sv.).
§ 424. Nous avons ensuite une élite de jurisconsultes, qui construisirent la théorie du droit naturel et des gens, et qui sont très admirés par ceux qui ont la chance de la comprendre. Tels Grotius, Selden, Pufendorf, Burlamaqui, Vattel, etc. Nous ne pouvons, vu le manque de place, examiner toutes ces définitions ; mais il n'y a pas grand mal, parce qu'elles se ressemblent toutes et sont également indéterminées.
§ 425. Grotius [FN: § 425-1] dit : « Pour commencer par le Droit Naturel, il consiste dans certains principes de la Droite Raison, qui nous font connaître qu'une Action est moralement honnête † ou déshonnête, selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu'elle a avec une Nature Raisonnable * et Sociable ; et par conséquent que Dieu, qui est l'Auteur de la Nature, ordonne ou défend une telle action ».
Pufendorf observe qu'ainsi on raisonne en cercle, car on définit les lois naturelles par ce qui est honnête ; et puis, pour savoir ce qui est honnête, on est contraint de recourir aux lois naturelles [FN: § 425-2] (2). Mais Burlamaqui [FN: § 425-3] lave Grotius de cette tache : « (II, 5, 6) Je ne vois point là de cercle ; car, sur cette demande, d'où vient l'honnêteté ou la turpitude naturelle des actions prescrites ou défendues, Grotius ne répond point comme on le fait répondre ; il dira au contraire que cette honnêteté ou cette turpitude vient de la convenance ou de la disconvenance nécessaire de nos actions avec une nature raisonnable et sociable ». C'est toujours la façon de définir une inconnue par une autre inconnue. Des lois naturelles, on nous renvoie à ce qui est honnête ; de ce qui est honnête à la convenance, sans compter cette fameuse nature raisonnable, qu'on ne distingue pas très bien de celle qui ne l'est pas.
§ 426. En attendant, continuons ; et puisqu'on nous a renvoyés à la convenance, voyons si nous réussissons à savoir ce que cela peut bien être. Burlamaqui nous le dit : « (II, 8, 2) Enfin pour la convenance, elle approche beaucoup de l'ordre même. C'est un rapport de conformité entre plusieurs choses, dont l'une est propre par elle-même à la conservation et à la perfection de l'autre, et contribue à la maintenir en un état bon et avantageux ». Donc il paraîtrait que l'honnête est ce qui présente le rapport indiqué tout à l'heure, avec la nature raisonnable et sociable. Le nombre des inconnues croit au lieu de diminuer. Maintenant, outre qu'il nous reste à savoir ce qu'est la nature raisonnable, il nous faut aussi connaître le sens que l'auteur donne aux mots : conservation, perfection, état bon et avantageux.
§ 427. Tout ce brouillamini revient finalement à dire que le droit naturel est ce qui, dans l'esprit de l'auteur, produit des idées analogues à celles qu'engendrent les mots : nature raisonnable, conservation, perfection, état bon et avantageux, qui sont tous essentiellement indéterminés.
Pourquoi donc l'auteur fait-il un si grand détour, et n'emploie-t-il pas sans autre cette forme ? L'induction nous amène ici à envisager un phénomène général, que nous étudierons tout au long au chapitre IX. Pour le moment, continuons à voir en quels rapports ces théories se trouvent avec les faits expérimentaux.
§ 428. Pour Pufendorf [FN: § 428-1] , « (I, 2, 16) la loi naturelle est celle qui convient si invariablement à la nature raisonnable et sociable de l'homme, que sans l'observation de ses normes, il ne pourrait y avoir de société honnête et pacifique dans le genre humain ». Il semblerait qu'il recoure uniquement à l'expérience, et si l'on continuait sur cette voie, la loi naturelle serait simplement celle qui règle les sociétés, de manière à ce qu'elles puissent subsister. Malheureusement, l'expérience nous enseigne que nombreuses sont les sociétés qui subsistent, chacune avec une loi différente ; de sorte que nous ne pouvons savoir laquelle est naturelle, excepté si nous cherchons ce qu'elles ont de commun ; ce qui nous transporte dans un autre domaine [FN: § 428-2].
§ 429. Mais l'auteur ne l'entend certainement pas ainsi. Il chasse sans plus tarder l'expérience, en disant que cette loi peut être découverte avec le seul secours de la raison naturelle, et une simple contemplation de la nature humaine, considérée en général. Et sachez par conséquent que « (I, 3, 1) pour découvrir entièrement et évidemment le caractère distinctif de la loi naturelle,... il suffit d'examiner avec soin la nature et les inclinations de l'homme en général ». Ainsi, nous voilà rejetés en pleine métaphysique, grâce à cette chère Nature ; ce qui nous fait aborder au rivage où habite la Loi fondamentale du droit naturel, qui consiste en ce que « (I, 3,9) chacun doit agir, autant qu'il le peut, pour conserver le bien de la société humaine en général ». Cela nous apprend peu de chose, car la discussion portera maintenant sur ce qu'est ce bien. L'un dira, par exemple : « Le bien d'une société est d'avoir une aristocratie ». Un autre de répliquer : « Le bien de la société, c'est la démocratie ». Comment ferons-nous pour trancher le différend au moyen des principes du droit naturel ? Pufendorf ajoute (I, 3, 11) que « la loi naturelle a Dieu pour auteur ». En vérité, il ne pourrait en être autrement.
§ 430. Burlamaqui s'écarte peu de Pufendorf. Il dit : « (Principes, II, 1, 2) L'on entend par loi naturelle une loi que Dieu impose à tous les hommes, et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état ». Ici ont disparu les animaux [FN: § 430-1], qui faisaient si belle figure dans les Institutes de Justinien. Mais une autre entité est apparue : Dieu, sans que l'on sache d'ailleurs si c'est le Dieu des chrétiens, des musulmans ou quelque autre. Dieu a imposé un droit naturel, commun à tous les hommes, qui, d'autre part, n'ont pas le même Dieu. On dirait une énigme.
§ 431. Dans la proposition de Burlamaqui, il y a deux définitions et un théorème. La loi naturelle se définit de deux manières : 1° elle est donnée par Dieu; 2°on peut la connaître au moyen de la raison. Le théorème consiste à affirmer que les deux définitions concordent. On ne voit pas très bien comment ceux qui ont un Dieu différent, et surtout les athées, peuvent marcher tous d'accord. Quant aux résultats auxquels conduit la considération attentive de la nature et de l'état de l'homme, ce sont simplement des choses que l'auteur trouve en accord avec ses sentiments. Il va sans dire que si quelqu'un n'arrive pas à de tels résultats, il doit s'accuser lui-même, et penser qu'il n'a pas su considérer avec une attention suffisante la nature et l'état des hommes. Mais si la personne en question persévérait dans son opinion, et affirmait qu'en considérant attentivement la nature de l'homme et son état, elle arrive à des conclusions différentes, quel sera le critère pour qui voudra savoir quelles conclusions il doit accepter ? (§ 16 et sv.) Dans la considération de la nature, on peut trouver tout ce qu'on veut. L'auteur des Problèmes qu'on attribue à Aristote, y trouve pourquoi l'homme est de tous les êtres vivants celui qui, proportionnellement à son corps, a les yeux les plus rapprochés l'un de l'autre ; il se demande [FN: § 431-1] si : « c'est peut être parce qu'il est plus que les autres selon la nature? »
L'« expérience » des croyants du droit naturel est semblable à l’« expérience du chrétien » moderne. Il n'y a, dans un cas comme dans l'autre, rien qui ressemble à l'expérience des sciences naturelles ; et ce terme expérience ne sert qu'à dissimuler le fait que celui qui l'emploie exprime simplement son opinion et celle de ceux qui pensent comme lui (§ 602).
§ 432. Dans la préface de son traité De officio hominis et civis, Pufendorf résume ses idées, en disant qu'il existe trois sciences distinctes : « le Droit naturel commun à tous les hommes, le Droit civil, qui est et peut être différent dans les divers États, et la Théologie morale... Le Droit naturel prescrit telle ou telle autre chose, parce que la Droite Raison nous la fait juger nécessaire pour conserver la société humaine en général ». Bien entendu, la raison qui ne prescrit pas ce que veut notre auteur n'est pas droite ; et nous ne pouvons savoir si vraiment elle n'est pas telle, tant que nous n'en avons pas une définition claire et précise.
§ 433. Interprétant les idées de Pufendorf, Barbeyrac essaie de donner cette définition [FN: § 433-1] . « De là il paroît par où il faut juger de la droiture de la Raison dans la recherche des fondemens du Droit Naturel ; c'est-à-dire, à quoi l'on connoît qu'une maxime est conforme ou contraire à la droite Raison. Car les maximes de la droite Raison sont des principes vrais, c'est-à-dire, qui s'accordent avec la nature des choses bien examinée, ou qui sont déduits par une juste conséquence de quelque premier principe vrai en lui-même. Ce sont au contraire des maximes de la Raison corrompue, lorsqu'on bâtit sur de faux principes, ou que de principes véritables en eux-mêmes on vient à tirer quelque fausse conséquence ».
§ 434. Sous cette longue dissertation, il n'est pas difficile de reconnaître le principe cher aux métaphysiciens, d'après lequel on peut découvrir les vérités expérimentales grâce à l'auto-observation de l' « esprit humain » (§ 493). Ainsi la droite raison doit nécessairement être d'accord avec l'expérience, avec la « Nature » comme disent ces messieurs.
§ 435. Notre auteur continue [FN: § 435-1]: « Si donc ce que l'on donne pour une maxime de la Loi Naturelle, est effectivement fondé sur la nature des choses, on pourra le regarder à coup sûr comme un principe véritable, et par conséquent comme un principe de la droite Raison : car la nature des choses ne nous fait connaître que ce qui existe réellement... ». S'il suivait la méthode expérimentale, il renverserait cette proposition en disant: « Ce qui existe réellement nous fait connaître la nature des choses ». Mais comme il suit la méthode métaphysique, il ne demande pas ce qui existe réellement, à l'observation des faits, mais bien « à des principes conformes à la nature des choses ». La Droite Raison demeure juge de cette conformité. Par conséquent, nous tournons en cercle : pour connaître la droite raison, on nous renvoie à la nature des choses ; et pour connaître la nature des choses, on nous renvoie à la droite raison.
§ 436. Avec cette belle façon de raisonner, l'auteur peut nous donner à entendre tout ce qu'il veut ; et c'est ainsi que sans trop de peine – dit-il – on arrive à découvrir que le fondement du droit naturel est la sociabilité [FN: § 436-1]. La sociabilité entre toujours dans tous ces systèmes, soit ouvertement, soit dissimulée, parce que leur but est de pousser l'homme à ne pas nuire à autrui, mais au contraire à lui être utile ; et par conséquent, il faut le secours des sentiments dits de sociabilité.
§ 437. Burlamaqui appelle à l'aide d'autres sentiments aussi estimant que plus on en peut avoir de favorables, mieux cela vaut. Parlant à des chrétiens, il appelle leur religion à la rescousse. Aux égoïstes, il veut persuader que l'altruisme est une bonne règle de l'égoïsme (1479 et sv.). Aussi a-t-il trois principes des lois naturelles : « (II, 4, 18) La religion ; l'amour de soi-même ; la sociabilité ou la bienveillance envers les autres hommes ».
§ 438. Le défaut des définitions des entités métaphysiques employées dans l'étude du droit naturel, n'échappe souvent pas aux auteurs, et chacun s'ingénie, hélas ! avec peu de succès, à trouver une meilleure définition.
§ 439. Voici Burlamaqui, qui déclare vouloir employer la méthode expérimentale et dit [FN: § 439-1] : « On parle beaucoup de l'utile, du juste, de l'honnête, de l'ordre et de la convenance ; mais le plus souvent on ne définit point ces différentes notions d'une manière précise... Ce défaut de précision ne peut que laisser dans le discours de la confusion et de l'embarras ; si l'on veut faire naître la lumière, il faut bien distinguer et bien définir ». Bravo ! Écoutons-le donc un peu, lui qui nous donnera des définitions claires et précises. Sachez que « (II, 8, 2) une action utile est celle qui, par elle-même, tend à la conservation et à la perfection de l'homme ». Notez ici l'équivoque de l'impersonnel : l'homme. Si l'on disait d'un homme, on pourrait répondre que ce qui tend à la conservation et à la perfection d'un voleur, c'est de savoir voler avec adresse ; mais on ne peut le dire de l'homme en général. Reste encore à démontrer que ce qui est utile à l'homme en général est aussi utile à l'homme en particulier, puisque c'est à lui que le discours s'adresse. Mais l'auteur ne s'en soucie pas.
Une action est dite honnête, quand elle est considérée comme « conforme aux maximes de la droite raison [comment distinguer la droite raison de celle qui n'est pas droite ?], conforme à la dignité de notre nature [qu'est-ce que cette nouvelle entité ?], méritant par là l'approbation des hommes [et s'il y a des gens qui l'approuvent et d'autres qui la désapprouvent ?], et procurant en conséquence à celui qui la fait, de la considération, de l'estime et de l'honneur [parmi les peuples guerriers, c'est l'apanage de celui qui a tué le plus grand nombre d'ennemis ; parmi les anthropophages, de qui en a mangé le plus] ». On appelle ordre : « la disposition de plusieurs choses, relative à un certain but, et proportionnée à l'effet que l'on veut produire. » Enfin, il y a encore la convenance : « elle approche beaucoup de l'ordre même. C'est un rapport de conformité [qu'est-ce que cette conformité ?] entre plusieurs choses, dont l'une est propre par elle-même à la conservation et à la perfection de l'autre [qu'est-ce que cette perfection ?], et contribue à la maintenir dans un état bon et avantageux » [bon pour qui ? avantageux pour qui ?]. Par exemple, un poison qui ne laisse pas de traces est « propre à la conservation et à la perfection » de qui veut empoisonner son prochain, et le maintient dans un état « bon et avantageux » pour lui ; mais ou ne peut dire qu'il soit « propre à la conservation et à la perfection » de qui est empoisonné, et qu'il le maintienne dans un état « bon et avantageux ». On ne peut donc traiter, dans le sens donné par notre auteur, de la convenance en général, mais il faut dire par rapport à qui, en particulier.
§ 440. Au contraire, l'auteur traite de tout objectivement et comme si ces entités avaient des existences indépendantes (§ 471). De plus, remarquez comment il emploie ses définitions : « (II, 8, 3) Il ne faut donc pas confondre le juste, l'utile et l'honnête,... Mais ces idées, quoique distinctes l'une et l'autre, n'ont cependant rien d'opposé entre elles : ce sont trois relations, qui peuvent toutes convenir et s'appliquer à une seule et même action considérée sous différents égards. Et même, si l'on remonte jusqu'à la première origine, on trouvera qu'elles dérivent toutes d'une source commune, ou d'un seul et même principe, comme trois branches sortent du même tronc. Ce principe général, c'est l'approbation de la raison... ». Était-il vraiment besoin d'un si long détour pour arriver enfin à dame Raison, présentée tant de fois déjà comme la mère du droit naturel ?
§ 441. Vattel laisse de côté la droite raison ; mais nous n'y gagnons pas grand'chose, car un certain bonheur, encore plus inconnu, apparaît à son tour. L'auteur dit [FN: § 441-1] : « (I, p. 39) Le droit naturel est la science des lois de la nature [il se confondrait donc avec la chimie, la physique, l'astronomie, la biologie, etc., qui sont certainement des lois de la nature ? Non, parce que l'auteur change brusquement de route], de ces lois que la nature impose aux hommes, ou auxquelles ils sont soumis par cela même qu'ils sont hommes ; science dont le premier principe (p. 40) est cette vérité de sentiment [que peut bien être cette entité ?], cet axiome incontestable [et si quelque hérétique le contestait ?] : La grande fin de tout être doué d'intelligence et de sentiment est le bonheur ». Mais quel bonheur ? Celui du « destructeur de villes » n'est certainement pas celui des citoyens tués. Celui du voleur n'est pas celui du volé. Il s'agit donc, ici d'un certain bonheur spécial, et l'on ne dit pas en quoi il se distingue de ce qui porte ordinairement ce nom. Ce bonheur spécial s'appelle souvent : vrai bonheur ; mais cet adjectif ne nous fait guère approcher de la réalité expérimentale. Le blâme et les injures contre ceux qui refusent de reconnaître ce bonheur ne servent à rien non plus. « (p. 40) Il n'est point d'homme, quelles que soient ses idées sur l'origine des choses, eût-il même le malheur d'être athée, qui ne doive se soumettre aux lois de la nature. Elles sont nécessaires au commun bonheur des hommes. Celui qui les rejetterait, qui les mépriserait hautement, se déclarerait par cela même l'ennemi du genre humain, et mériterait d'être traité comme tel » (§ 593). Mettre un homme en prison ou le brûler n'est malheureusement pas une démonstration logico-expérimentale.
§ 442. Toutes ces définitions et d'autres semblables ont les caractères suivants : 1° elles emploient des termes indéterminés, qui font naître certains sentiments, mais qui ne correspondent à rien de précis (§ 380, 387, 490); 2° elles définissent l'inconnu par l'inconnu ; 3° elles mélangent des définitions et des théorèmes qu'elles ne démontrent pas ; 4° leur but est en somme d'exciter autant que possible les sentiments, pour amener à un but déjà déterminé la personne à laquelle on s'adresse.
§ 443. Selden [FN: § 443-1] commence par observer que les auteurs qui se sont occupés du droit naturel lui ont assigné quatre origines différentes : l° ce qui est commun à tous les êtres vivants ; 2° ou bien à toutes les nations ou au plus grand nombre d'entre elles ; 3° la raison naturelle et son droit usage ; 4° enfin la Nature, et par conséquent la raison naturelle des ancêtres, c'est-à-dire l'autorité et les préceptes des dieux sacro-saints. Il repousse les trois premières et n'accepte que la quatrième, en la réduisant à la raison naturelle des Hébreux et à l'autorité de leur Dieu.
444. Le Talmud [FN: § 444-1] nous donne de précieux détails sur la façon dont la Loi que Dieu donna a pu être connue par les diverses nations ; et, après tout, ce moyen n'est pas moins croyable que celui de la Droite Raison ; en compensation, il est beaucoup plus sûr ; et Bartenora observe avec raison que de cette manière les nations ne pouvaient s'excuser en disant : « Nous n'avons eu aucun moyen de nous instruire ».
§ 445. Si nous ne prêtons attention qu'à la forme, toutes ces dissertations sur le droit naturel nous apparaissent comme un tas d'absurdités. Si, au contraire, nous négligeons la forme, pour envisager ce qu'elle recouvre, nous trouvons des inclinations et des sentiments qui agissent puissamment pour déterminer la constitution sociale, et qui, par conséquent, méritent une étude attentive. Il ne faut pas accepter les démonstrations données sous cette forme, parce qu'elles sont d'accord avec les sentiments ; ni les repousser, parce qu'elles sont en désaccord manifeste avec la logique et l'expérience. Il faut les considérer comme non existantes (§ 464), et prêter attention aux éléments qu'elles recouvrent, étudier directement ceux-ci, en prenant garde à leurs caractères intrinsèques. L'induction nous oblige donc de nouveau à séparer en deux les doctrines, telles que nous les trouvons exprimées, et nous montre que, de ces deux parties, l'une est beaucoup plus importante que l'autre. Donc, dans la suite de cette étude, nous devrons tâcher de séparer ces deux parties ; et ensuite, de ne pas nous arrêter à l'idée qu'un raisonnement donné n'est pas concluant, est stupide, absurde, mais de rechercher s'il ne manifeste pas des sentiments utiles à la société, et s’il ne les manifeste pas d'une manière capable de persuader beaucoup d'hommes, qui ne seraient pas du tout convaincus par d'excellents raisonnements logico-expérimentaux. Pour le moment, il suffit d'avoir reconnu cette voie qui s'ouvre devant nous. La parcourir est ce qu'il nous reste à accomplir dans la suite de cet ouvrage.
§ 446. Le bon sens d'un homme pratique comme Montaigne [FN: § 446-1] , est une antidote contre l'insanité des auteurs qui divaguent sur le droit naturel, mais ne suffit pas à connaître exactement où gît l'erreur et quels sentiments le raisonnement dissimule.
§ 447. Beaucoup d'autres dissertations sont semblables à celles sur le droit naturel, et naissent toutes du désir de revêtir ce qui est contingent et subjectif, d'une apparence absolue et objective. Voici par exemple les Physiocrates, qui ont certaines idées sur l'organisation des sociétés, sur la constitution politique, sur la liberté du commerce, etc. Ils pourraient en traiter directement, comme d'autres ont fait, au moins en partie ; mais ils préfèrent les déduire d'un « ordre naturel et essentiel des sociétés politiques » imaginaire ; et c'est là précisément le titre de l'œuvre célèbre de Le Mercier de la Rivière [FN: § 447-1] . Nous voilà donc retombés dans les logomachies « (p. 11) Le juste absolu peut être défini un ordre de devoirs et de droits qui sont d'une nécessité physique, et par conséquent absolue. Ainsi l'injuste absolu est tout ce qui se trouve contraire à cet ordre. Le terme d'absolu n'est point ici employé par opposition au relatif ; car ce n'est que dans le relatif que le juste et l'injuste peuvent avoir lieu ; mais ce qui, rigoureusement parlant, n'est qu'un juste relatif devient cependant un juste absolu par rapport à la nécessité absolue où nous sommes de vivre en société ». Puis il y a un certain ordre essentiel, qui est « (p. 29) l'ordre des devoirs et des droits réciproques dont l'établissement est essentiellement nécessaire à la plus grande multiplication possible des productions, afin de procurer au genre humain la plus grande somme possible de bonheur, et la plus grande multiplication possible ». A ce qu'il paraît, c’est très évident, comme aussi le fait que cet ordre naturel est une branche de l'ordre physique. « (p. 38) Si quelqu'un faisoit difficulté de reconnoître l'ordre naturel et essentiel de la société pour une branche de l'ordre physique, je le regarderois comme un aveugle volontaire, et je me garderois bien d'entreprendre de le guérir » (§ 379, 435-1] ). Au fond, l'auteur a une idée qui est d’accord avec l'expérience ; c'est « (p. 38) que l'ordre social n'a rien d'arbitraire » ; mais la démonstration qu'il donne de cette proposition est vraiment fort mauvaise.
§ 448. Comme d'habitude, dans ce genre de dissertations, l'auteur estime que ses idées doivent être acceptées par tout le monde, dès qu'il les a manifestées. (§ 591 et sv.). « (p. 38) La simplicité et l'évidence de cet ordre social sont (p. 39) manifestes pour quiconque veut y faire la plus légère attention ».
Mais voici Mably [FN: § 448-1] qui, malgré beaucoup d'attention, ne demeure pas du tout persuadé de cette évidence, ni de certaines autres auxquelles il est fait allusion dans les deux premières parties de l'ouvrage de Le Mercier de la Rivière. Il dit : « (p. 4) Je vois qu'on y parle beaucoup d'évidence, et il me semble que rien n'y est évident. J'ai lu, j'ai relu ; et loin de voir dissiper mes doutes, je les ai vus se multiplier ». Sur certains points, Mably ne raisonne pas mal du tout ; par exemple, quand il observe qu'on ne peut qualifier une organisation déterminée, de nécessaire aux sociétés, alors qu'on trouve dans le monde concret des sociétés qui s'en passent. Le Mercier de la Rivière démontre (p. 21) la nécessité de la propriété foncière. Mably dit : «(p. 7) Si l'on se contentoit de demander que chaque société eût en corps, une propriété foncière, je n'aurois aucun embarras ; car je vois très-bien qu'il est indispensable qu'une société ait un domaine pour assurer la subsistance des Citoyens ; mais, (p. 8) qu'on regarde comme d'une nécessité et d'une justice absolues, une chose dont les sociétés policées et florissantes se sont passées : voilà ce qui confond ma raison, et bouleverse toutes mes idées ». Laissons de côté, pour un moment, la propriété de la société et dame Justice Absolue que nous ne connaissons pas bien. Le reste du raisonnement est bon. L'auteur cite l'exemple de Sparte, qui n'est guère bien choisi ; car s'il n'y avait pas un genre de propriété foncière, à Sparte, semblable à celle de Rome, il y existait pourtant un certain genre de propriété foncière. Mais l'exemple des Missions du Paraguay est pleinement efficace. «(p. 9.) Il n'y a pas jusqu'aux Jésuites, Monsieur, qui ne vous fassent des objections, et ils se donnent la licence, au Paraguay, de braver impunément la Loi essentielle de votre Ordre naturel ».
Prenons garde que Mably, exactement comme Le Mercier de la Rivière, a une idée préconçue à défendre. Il recourt à l'expérience quand elle lui est favorable, pour défendre la propriété collective qu'il préconise, comme Le Mercier de la Rivière appelait l'ordre naturel à son aide, pour défendre la propriété foncière individuelle. Cela explique pourquoi Mably ne s'aperçoit pas qu'on peut précisément opposer à la première partie de son raisonnement, la même objection qu'il formule dans la seconde. En effet, les peuples nomades n'ont de propriété foncière, ni collective, ni privée.
Mably pourrait répondre que les nomades ne sont pas des «Sociétés policées et florissantes » ; mais s'il s'engageait sur cette voie, il s'exposerait à voir réfuter son exemple du Paraguay, pour un motif identique ; et si Le Mercier de la Rivière voulait bien laisser de côté ses fantaisies sur l'ordre naturel et essentiel, il pourrait démontrer par de bons exemples, que les sociétés les plus civilisées et les plus florissantes furent justement celles où existait la propriété foncière privée. Mais la discussion sortirait ainsi du domaine des sentiments et de la métaphysique, où se promènent souvent nos auteurs, pour passer dans celui de la science logico-expérimentale.
F. Quesnay cite différentes opinions sur le droit naturel, et il trouve qu'il y a dans toutes une part de vérité ; mais [FN: § 448-2] « (p. 42) les philosophes se sont arrêtés au paralogisme, ou argument incomplet, dans leurs recherches sur cette matière importante, qui est le principe naturel de tous les devoirs de l'homme réglés par la raison ». Il complète donc leurs recherches. D'abord il s'occupe de la justice. « (p. 42) Si on me demande ce que c'est que la justice ? Je répondrai que c'est (p. 43) une règle naturelle et souveraine, reconnue par les lumières de la raison [si la « raison » de certains hommes « reconnaît » une règle, et la « raison » de certains autres en reconnaît une qui est différente, comment décide-t-on quelle règle est la bonne ?] qui détermine évidemment ce qui appartient à soi-même ou à un autre ». Ensuite, après de longs développements, il conclut ainsi : « (p. 52) Les hommes réunis en société doivent donc être assujettis à des lois naturelles et à des lois positives. – Les lois naturelles sont ou physiques, ou morales. – On entend ici par lois physiques, le cours réglé de tout évènement (p. 53) physique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain. On entend ici, par loi morale, la règle de toute action humaine de l'ordre moral, conforme à l'ordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain. Ces lois forment ensemble ce qu'on appelle la loi naturelle. Tous les hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines instituées par l'Être-Suprême [Quesnay augmente ainsi d'une unité le nombre extrêmement considérable des hommes qui ont cru connaître la volonté de cet Être Suprême, et qui, malheureusement, ne s'accordent guère entre eux] ; elles sont immuables et irréfragables, et les meilleures lois possibles... ». C'est un raisonnement en cercle, car si l'on définit la loi naturelle « ce qui est évidemment le plus avantageux au genre humain », il serait difficile de comprendre que « les lois formant ensemble la loi naturelle » ne sont pas « les meilleures lois possibles ». Mais il est vraiment surprenant que ces lois étant « immuables et irréfragables », n'aient pas été découvertes avant Quesnay, et n'aient pas été généralement adoptées après qu'il les a trouvées et fait connaître au genre humain.
§ 449. Notons encore les analogies qui existent entre les théories semblables à celles du droit naturel, et cet autre rêve métaphysique appelé théorie de la solidarité. Dans cette dernière, comme dans l'une des théories du droit naturel, on part – ou mieux : on feint de partir – de l'expérience. La théorie du droit naturel reconnaît un droit commun aux hommes et aux animaux. La théorie de la solidarité va encore plus loin : elle reconnaît une loi de mutuelle dépendance entre les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux [FN: § 449 note 1)]. Si la première est bonne, la seconde est parfaite.
§ 450. Mais messieurs les métaphysiciens s'entendent mal avec l'expérience ; aussi ne tardera-t-elle pas à être bannie d'un côté ou de l'autre. Le droit naturel abandonne les animaux à leur triste sort. La doctrine de la solidarité fait mieux : elle renie son origine, jusqu'à opposer comme contraires la « solidarité-fait » et la « solidarité-devoir [FN: § 450-1] ».
§ 451. Comment trouverons-nous cette dernière ? Après ce que nous avons dit, le lecteur ne peut avoir aucun doute. Mais que font dans le monde la droite raison, la nature, le juste, l'honnête, etc.? De même qu'ils nous ont donné la théorie du droit naturel, ils nous donneront la théorie de la solidarité, et autant d'autres semblables, que de braves auteurs voudront bien imaginer [FN: § 451-1].
§ 452. Trois éléments apparaissent dans les théories que nous venons d'examiner : 1° un élément expérimental, qui fait rarement défaut, mais est souvent plus apparent que réel ; 2° un élément métaphysique, soit extra-expérimental, qui est parfois dissimulé, mais ne fait jamais défaut; 3° un élément théologique, par conséquent soustrait à l'expérience, qu'on trouve dans certaines théories, et qui, en d'autres, fait défaut.
Ces deux derniers éléments sont choisis d'habitude parmi les doctrines qui jouissent du plus grand crédit dans la société où vit l'auteur de la théorie. La théologie ne s'imposait pas, dans l'ancienne société païenne, et par conséquent l'élément théologique fait défaut en beaucoup de théories nées dans cette société. Au contraire, elle ne manque presque jamais dans les théories nées chez les sociétés chrétiennes, où l'on imposait la théologie. Maintenant, la pauvre théologie a été détrônée, et la Science a pris sa place. Toutefois prenons bien garde que ce n'est pas du tout la science expérimentale, mais bien une espèce d'entité métaphysique à laquelle on a donné ce nom.
§ 453. Burlamaqui appelait la religion à son aide (§ 430 et sv.). S'il avait vécu à notre époque, il aurait invoqué la Science. M. L. Bourgeois appelle à son aide la Science [FN: § 453-1]. S'il avait vécu au temps de Burlamaqui, il aurait invoqué la religion. Que le lecteur n'aille pas s'imaginer que cela cause la moindre difficulté à ces hommes éminents. Ils savent où ils en veulent venir, et n'ignorent pas que tout chemin mène à Rome.
§ 454. On comprend que la philosophie chrétienne cherche l'origine du droit naturel dans la volonté de Dieu. Elle pourrait s'en contenter, et l'on aurait une théorie constituée par le seul élément théologique ; mais il est remarquable qu'elle veut s'assurer aussi le secours de l'élément métaphysique et peut-être de l'élément expérimental ; ce qui confirme de nouveau que la forme de semblables théories ne dépend pas tant de leur substance, que des concepts qui sont en faveur dans la société où ils règnent. La majeure partie des hommes répugne à se contenter de la théologie seule ; et pour la persuader, il faut encore obtenir l'appui de la métaphysique et de l'expérience.
§ 455. On nous dit que : « La loi naturelle est directement implantée et inscrite dans le cœur de l'homme par Dieu même, et son but est de diriger l'homme, aspirant à son terme, comme un être libre, capable du bien et du mal [FN: § 455-1] ». Que Dieu ait implanté et inscrit la loi naturelle dans le cœur de l'homme, c'est bien ; mais comment la connaîtrons-nous ? Si c'était exclusivement par la révélation, nous aurions une théorie exclusivement théologique ; mais la métaphysique intervient et, à ce qu'il paraît, l'expérience aussi.
§ 456. Saint Paul dit déjà [FN: § 456-1] : « (14) Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; (15) ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs... ». L'expérience pourrait donc la faire retrouver dans le cœur des hommes. Mais on nous avertit que la conscience ayant été corrompue, on ne peut s'y fier exclusivement. « Or, les facultés primordiales de l'homme ayant été affaiblies par le péché, il est naturel que ces conséquences [de la loi naturelle] ne soient jamais déduites dans toute leur perfection par aucun homme et qu'elles le soient souvent d'une manière défectueuse et erronée ; c'est pourquoi les lois humaines, qui ne sont et ne doivent être que des conséquences de la loi naturelle, sont toujours imparfaites, souvent défectueuses et parfois fausses » [FN: § 456-2] .
Nous retrouvons cette loi de nature dans l'ancien droit irlandais, avec des adjonctions d'ecclésiastiques et de savants docteurs irlandais [FN: § 456-3].
§ 457. Saint Thomas distingue : 1° une loi éternelle, existant dans l'esprit de Dieu ; 2° une loi naturelle, existant chez les hommes et participant de la loi éternelle : c'est d'après elle que les hommes discernent le bien et le mal ; 3° une loi trouvée par les hommes, suivant laquelle ils disposent de ce qui est contenu dans la loi naturelle ; enfin une loi divine, par laquelle les hommes sont infailliblement conduits au but surnaturel, qui est l'extrême béatitude [FN: § 457-1] . Madame la Droite Raison est absente, mais nous allons la voir revenir bientôt. Le saint homme nous dit que : « il est certain que toutes les lois sont dérivées de la loi éternelle, pour autant qu'elles participent de la droite raison [FN: § 457-2] ».
§ 458. Il est à remarquer que le Décret de Gratien [FN: § 458-1] reproduit à peu près, pour le droit naturel, la définition du droit romain (§ 419) ; ce qui nous ramène à une notion pseudo-expérimentale. Mais la concession n'a pas grande importance, parce qu'il faut toujours rechercher ensuite ce qu'imposent l'Écriture et la tradition catholique.,
§ 459. Quand on désigne la Nature comme origine directe du droit naturel, les concepts issus de celui-ci peuvent prendre place parmi les idées innées, et acquérir ainsi un caractère absolu ; ce qui n'empêche pas de recourir aussi à l'action divine, en la présentant comme créatrice des idées innées.
§ 460. Locke, niant les idées innées, doit par conséquent repousser la théorie d'après laquelle le droit naturel en procède. Mais la science n'y gagne pas grand'chose, et nous retombons dans le royaume de la droite raison. Il dit [FN: § 460-1] : Du fait que je nie l'existence d'aucune loi innée, il serait erroné de conclure que je crois qu'il n'y a autre chose que des lois positives. Ce serait se méprendre absolument sur mon opinion. Il y a une grande différence entre une loi innée et une loi de nature ; entre une vérité inculquée primitivement dans l'âme et une vérité que nous ignorons, mais que nous pouvons arriver à connaître, en usant convenablement des facultés que la nature nous a données ». C'est toujours la méthode métaphysique qui présuppose l'existence d'entités abstraites ; et il est probable que Locke, même s'il avait voulu s'en détacher, en aurait été retenu par l'idée qu'il ne pouvait pas, sans de graves conséquences, changer le point où son raisonnement devait aboutir : l'existence du droit naturel.
§ 461. Grotius pose l'élément métaphysique a priori, l'élément expérimental a posteriori. Barbeyrac [FN: § 461-1] voit combien cette dernière démonstration du droit naturel est faible ; mais au lieu de conclure qu'elle échappe à l'expérience et doit donc être considérée comme scientifiquement inexistante, il a recours à la démonstration métaphysique, et l'estime solide.
§ 462. Hobbes [FN: § 462-1] (I, 2, 1) nie que la loi naturelle soit exprimée par le consentement universel, ni même par le seul consentement des nations les plus sages ou les plus civilisées. Il demande judicieusement qui jugera de la sagesse des nations (§ 592). Il ne peut y avoir, suivant lui, d'autre loi de nature que la raison, ni d'autres préceptes de cette loi, que ceux qui montrent le chemin de la paix, si on peut l'obtenir, ou sinon, la manière de se défendre par la guerre. Comme d'habitude, on fait appel ensuite à la religion et à la morale (I, 5. 1). Les lois dites de nature, parce que c'est la raison naturelle qui les prescrit, sont aussi des lois morales, car elles concernent les mœurs, et des lois divines, car c'est Dieu qui en est l'auteur. Par conséquent elles ne peuvent pas être contraires à la parole divine, révélée par l'Écriture Sainte. On le démontre par force belles citations.
§ 463. Épicure cherchait dans le pacte ou contrat la définition de la justice naturelle [FN: § 463-1] . Hobbes en fait l'un des principaux fondements de ses théories, comme aussi Rousseau, avec son célèbre contrat social, comme encore nos solidaristes contemporains ; et tous tirent des conclusions différentes du même principe ; ce qui leur est facile, car ce principe manque de toute signification précise, et leurs propos ne tirent pas leur force de la logique et de l'expérience, mais de l'accord des sentiments. Le défaut de précision entache toutes ces théories et les rend stériles. Au point de vue logico-expérimental, elles ne sont ni vraies ni fausses ; elles ne signifient tout simplement rien (§ 445).
§ 464. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une religion, d'un droit, etc. ; mais, comme nous l'avons observé déjà (§ 373), on ne peut pas davantage admettre cette unité. Non seulement il existe différentes religions, différentes morales, divers droits, etc., mais encore, quand on peut envisager certains types de ces entités, il faut prendre garde aux déviations que l'on rencontre dans les phénomènes concrets, par rapport à ces types.
Supposons pour un moment, – bien que cela ne soit en général pas vrai, – qu'il existe, au moins dans une collectivité restreinte, un certain type théorique, dont les croyances et les usages pratiques puissent être considérés comme des déviations. Par exemple, là où il y a un code civil, on peut supposer, – bien que cela ne soit pas entièrement vrai, – qu'il n'y a que de simples déviations des normes du code, dans les arrêts des tribunaux, tels qu'ils sont dictés par la jurisprudence qui s'est constituée parallèlement au code et quelquefois contre le code, ou tels qu'ils sont formulés par erreur ou ignorance des magistrats, ou pour d'autres causes.
§ 465. Soit, par hypothèse, une collectivité catholique. Nous pouvons observer trois types de déviations.
1° Le croyant est parfaitement sincère, mais il pèche parce que la chair est faible ; il se repend et déteste son péché. Nous avons une séparation complète entre la théorie et la pratique. C'est le fait qu'expriment ces vers bien connus :
(20) video meliora, proboque ;
Deteriora sequor.(OVID., Métam., VII).
La pratique ne tend pas le moins du monde à produire une théorie.
Tous les confesseurs savent qu'à ce propos, il y a de notables différences entre les hommes. Il en est qui retombent souvent et d'autres plus rarement, dans le même péché. Il est évident que deux collectivités ayant exactement la même foi théorique pourront différer pratiquement, suivant qu'il y a dans l'une plus d'hommes de la première espèce que de la seconde.
2° Tel qui est croyant, mais n'est pas très fervent, néglige quelque peu les préceptes de sa religion, et n'éprouve que peu ou point de remords. Il y a là déjà le germe d'une divergence théorique. Certains fidèles sont seulement indifférents : pour eux la déviation théorique est minime. D'autres croient pouvoir compenser dans une certaine mesure leurs manquements religieux ; d'autres ne les considèrent pas même comme tels ; ils discutent, ergotent, font appel à la casuistique. Ainsi apparaissent des déviations théoriques, qui croissent sur la foi orthodoxe comme des plantes parasites. De la sorte, les déviations pratiques sont accompagnées de déviations théoriques qui ne vont pourtant pas jusqu'au schisme.
3° Les divergences théoriques s'accentuent. Le schisme, l'hérésie, la négation partielle ou entière de la théorie-type apparaissent. La déviation, arrivée à ce point, cesse souvent d'être telle, et l'on voit, à proprement parler, surgir un nouveau type de théorie. Prenons garde que, comme d'habitude, on passe par degrés insensibles de l'un à l'autre de ces genres de déviations.
§ 466. Dans l'étude de la sociologie, le fait de négliger ces déviations pour considérer seulement la théorie-type, est la source de nombreuses erreurs. Rien de plus faux qu'apprécier, d'après sa théologie, l'œuvre d'une religion donnée. Si l'on raisonnait par exemple ainsi : « La religion chrétienne impose le pardon des injures ; donc les hommes du moyen-âge, qui étaient de très bons chrétiens, pardonnaient les injures », on s'éloignerait tout à fait de la vérité. Semblable est l'erreur, quand on juge de la valeur sociale d'une morale d'après son expression théorique.
Moindre, mais pourtant toujours notable, est l'erreur, quand on croit que les sentences des tribunaux, dans un pays donné, sont rendues selon la législation écrite [FN: § 466 note 1)]. Les constitutions des empereurs byzantins restaient souvent lettre morte. De nos jours, en France et en Italie, les lois écrites du droit civil peuvent donner une idée au moins approximative de la législation pratique, mais le code pénal et les lois écrites de ce droit ne correspondent pas du tout aux sentences pratiques, et souvent la divergence est énorme [FN: § 466 note 2)|. Quant au droit constitutionnel, il n'y a généralement aucun rapport entre la théorie et la pratique, si ce n'est dans l'esprit de théoriciens aussi nombreux qu'inutiles.
Un fait pratique est conséquence de beaucoup d'autres, dont une partie donnent lieu à des théories, et peuvent par conséquent être connus grâce à ces dernières. Soit, par exemple, une sentence pénale, rendue en suite du verdict d'un jury. Parmi les causes de ce fait, on peut énumérer les suivantes : 1° La législation écrite ; en matière pénale, son rôle est souvent peu important. 2° Les influences politiques ; elles peuvent être grandes, dans certains procès. 3° Les tendances humanitaires des jurés ; elles nous sont connues par les théories humanitaires et par la littérature. 4° Les tendances passionnelles, socialistes, sociales, politiques, etc., des jurés ; toutes manifestées par les théories et par la littérature. 5° L'idée générale, propre à tous les despotismes, fussent-ils royaux, oligarchiques, populaires, que la loi ne lie pas le « souverain », et que celui-ci peut substituer son caprice aux dispositions de la loi. Cette idée aussi nous est connue par les théories. On dit aujourd'hui que la loi doit être vivante, flexible, qu'elle doit s'adapter à la conscience populaire ; et ce sont là autant d'euphémismes pour indiquer qu'elle doit se plier au caprice de celui qui détient le pouvoir. 6° Une infinité d'autres tendances qui, peut-être, n'agissent généralement pas, mais peuvent se trouver prépondérantes chez les douze individus, habituellement peu intelligents, peu cultivés, et de peu d'élévation morale, qui sont appelés à fonctionner comme jurés. 7° Des intérêts particuliers de ces citoyens. 8° Une impression momentanée produite sur eux par quelque fait remarquable. Ainsi, après certains exploits retentissants de brigands, les jurés deviennent plus sévères pendant quelque temps. En résumé, la sentence dépend d'intérêts, de sentiments existant à un moment donné dans la société, de caprices aussi, de cas fortuits, et peu, parfois presque pas du tout, du code et des lois écrites [FN: § 466-3].
Quand tous ces faits sont d'une nature générale et agissent fortement, ils donnent lieu à des théories ; et c'est justement pourquoi nous étudions ces théories, moins pour les connaître directement, que pour arriver, grâce à elles, à la connaissance des tendances dont elles tirent leur origine.
§ 467. Au § 12, nous avons relevé qu'il était nécessaire de distinguer les matériaux d'une théorie, et le lien par lequel ces matériaux étaient unis pour constituer la théorie. Donc, pour une théorie donnée, deux questions générales et deux particulières se posent, soit : Point de vue général : 1°, Quels sont les éléments mis en usage dans les théories ? 2° Par quels liens sont-ils unis ? Point de vue particulier: 1° Quels sont les éléments mis en usage dans une théorie donnée ? (§ 470). 2° Par quels liens sont-ils unis? (§ 519). La réponse à ces questions nous a justement donné la classification des types de théories (§ 13). Maintenant nous devons pénétrer plus à fond dans cette étude à peine effleurée.
§ 468. Notons une analogie. Des questions semblables se posent à propos du langage. La grammaire répond aux questions générales. La morphologie nous fait connaître les éléments du langage, C'est-à-dire les substantifs, les adjectifs, les verbes, etc. La syntaxe nous enseigne comment ils s'unissent. L'analyse grammaticale et l'analyse logique d'un passage répondent aux questions particulières, pour le dit passage. L'analyse grammaticale nous fait connaître les éléments (substantifs, verbes, etc.) employés dans ce passage ; l'analyse logique nous apprend comment ils sont unis et quel sens ils acquièrent par cette union. En continuant à envisager l'analogie, on peut ajouter que la rhétorique s'occupe spécialement de cet écrit, au point de vue subjectif (§ 13).
§ 469. L'analogie s'étend aussi aux relations entre la théorie et la pratique. Celle-là n'est jamais la copie parfaite de celle-ci. La langue est un organisme vivant, même aujourd'hui, dans nos pays où l'on cherche à la fixer en des formes précises, qu'elle rompt à chaque instant, comme les racines des plantes font sauter le rocher dans les fissures duquel elles croissent. En des temps reculés, elle se développait librement, comme les plantes d'une forêt vierge [FN: § 469-1] . Nous n'avons aucune raison de croire qu'il en arrive et en soit arrivé autrement pour les produits semblables de l'activité humaine, qu'on appelle le droit, la morale, la religion ; au contraire, des faits très nombreux nous forcent à admettre qu'ils se sont développés d'une façon analogue à celle de la langue. À une époque reculée, ils se confondaient en une masse unique, comme les mots qui, dans les anciennes inscriptions grecques, sont écrits sans séparations, [Voir Addition A13 par l’auteur] et dont le contact modifie la lettre finale d'un mot et la lettre initiale du mot suivant [FN: § 469-2]. L'opération analytique si simple, consistant à séparer un mot d'un autre, demeure incomplète en sanscrit, s'accomplit en grec à une époque pas très ancienne, et laisse des traces de l'antique union, jusque dans la littérature classique. De même, l'opération analytique consistant à séparer le droit, la morale, la religion, est fortement avancée, bien que non achevée, chez les peuples civilisés modernes ; elle reste encore à exécuter chez les Barbares. Les inscriptions grecques, ainsi que l'histoire des origines gréco-latines, nous présentent la langue, le droit, la morale, la religion, comme une espèce de protoplasma dont, par scission, naissent des parties qui croissent, se différencient, se séparent. Ensuite, étudiant les faits du passé avec les idées d'aujourd'hui, nous donnons corps à des abstractions créées par nous, et nous nous imaginons les trouver dans le passé. Quand nous voyons que les faits s'écartent de ces théories, nous appelons cet écart déviation ; et nous imaginons un droit naturel, dont les droits positifs sont des déviations, de même qu'après avoir établi les conjugaisons des verbes réguliers, on a supposé que les conjugaisons des verbes irréguliers en étaient des déviations. L'étude historique du droit, la grammaire historique de nos langues, ont détruit en ces matières ce bel édifice. Celui qui a été construit pour la sociologie subsiste encore, et sert d'abri aux métaphysiciens. Il est impossible d'étudier expérimentalement l'histoire, et de ne pas voir le caractère contingent du droit et de la morale. Longtemps, la grammaire et le vocabulaire latins furent pour nous ceux de César et de Cicéron. Chez les autres auteurs, on observait des déviations, quand on ne disait pas des erreurs. Le français était la langue des auteurs de l'Académie, et qui parlait autrement tombait dans l’erreur. Or, on a finalement reconnu qu'il n'y pas une grammaire latine, un vocabulaire latin, mais qu'il y en beaucoup, et que si Plaute et Tacite écrivent autrement que Cicéron, il est un peu ridicule que nous prétendions les corriger, comme s'ils étaient de petits écoliers qui n'ont pas su bien écrire le devoir que le maître leur a donné. Jusque dans nos contrées, où le droit est fixé dans les lois, la langue dans les règles grammaticales, pas plus l'évolution de l'un que celle de l'autre ne s'arrête, et l'unité est une abstraction qui disparaît dans le monde concret.
§ 470. Les éléments des théories. Observons avec soin les matériaux avec lesquels on édifie les théories, et nous verrons qu'ils sont de deux espèces bien distinctes. Les théories envisagent certaines choses qui tombent sous le coup de l'observation et de l'expérience objective (§ 13), ou qui peuvent être déduites de ces dernières avec une rigueur logique ; elles en envisagent d'autres, qui dépassent l'observation et l'expérience objectives ; et parmi ces dernières théories, nous plaçons celles qui résultent de l'auto-observation ou de l'expérience subjective (§ 94, 95). Les choses de la première espèce seront dites entités expérimentales ; celles de la seconde, entités non-expérimentales (§ 119). Il ne faut jamais oublier que, comme nous l'avons dit au § 6, nous employons le terme expérimental dans le seul but d'être bref, et non pour désigner l'expérience seule, mais bien l'expérience et l'observation objectives.
§ 471. Prenons bien garde à certaines entités qui paraissent expérimentales et ne le sont pas. De ce genre sont le chaud, le froid, le sec, l'humide, le bas, le haut, et autres termes semblables dont les anciens naturalistes font si grand usage [FN: § 471-1]. Ajoutons-y les atomes d'Épicure, le feu et d'autres semblables entités. Tout le poème de Lucrèce peut paraître expérimental ; il ne l'est pourtant pas, car il raisonne sur des entités qui sont en dehors du domaine expérimental.
Condillac s'exprime bien, quand il dit [FN: § 471-2] : « (p. 137) Lorsque les philosophes se servent de ces mots, être, substance, essence, genre, espèce, il ne faut pas s'imaginer qu'ils n'entendent que certaines collections d'idées simples qui nous viennent par sensation et par réflexion : ils veulent pénétrer plus avant, et voir dans chacun d'eux des réalités spécifiques. Si même nous descendons dans un plus grand détail, et que nous passions en revue les noms des substances, corps, animal, homme, métal, or, argent, etc., tous dévoilent aux yeux des philosophes des êtres cachés au reste des hommes.
» Une preuve qu'ils regardent ces mots comme signes de quelque réalité, c'est que, quoiqu’une substance ait souffert quelque altération, ils ne laissent pas de demander si elle appartient (p. 138) encore à la même espèce à laquelle elle se rapportait avant ce changement : question qui deviendrait superflue s'ils mettaient les notions des substances et celles de leurs espèces dans différentes collections d'idées simples. Lorsqu'ils demandent si de la glace et de la neige sont de l'eau ; si un fœtus monstrueux est un homme ; si Dieu, les esprits, les corps ou même le vide sont des substances [toutes demandes que la science logico-expérimentale tient pour privées de sens, sans réponses, vaines], il est évident que la question n'est pas si ces choses conviennent avec les idées simples rassemblées sous ces mots, eau, homme, substance [ici nous dévions dans la métaphysique ; en réalité, c'est uniquement par l'accord des sentiments que l'on résout ces problèmes] ; elle se résoudrait d'elle-même. Il s'agit de savoir si ces choses renferment certaines essences, certaines réalités qu'on suppose que ces mots, eau, homme, substance, signifient ».
Parfois on reconnaît explicitement que ces êtres sont non-expérimentaux, et l'on tient même que, par ce fait, ils sont revêtus d'une dignité supérieure. Parfois on veut les faire passer pour expérimentaux. D'autres fois encore, celui qui en use louvoie entre l'un et l'autre concept, et souvent aussi n'a pas même une idée claire à leur sujet ; c'est habituellement le cas des hommes politiques et d'autres hommes pratiques, qui recourent à ces êtres pour manifester leurs idées. Tout cela ne change pas la manière dont nous devons considérer ces êtres au point de vue logico-expérimental ; de quelque façon qu'ils soient définis par celui qui les emploie, et même s'ils ne sont pas définis, ils sont et restent en dehors du domaine expérimental. Ensuite, n'oublions pas que nous étudions ici les théories objectivement, et que nous ne recherchons pas quelle a pu être la pensée intime de celui qui les exprime : nous les détachons de leur auteur, et les considérons seules.
§ 472. Entre les deux espèces d'éléments que nous venons de noter, trois genres de combinaisons peuvent avoir lieu : I entités expérimentales avec entités expérimentales ; II entités expérimentales avec entités non-expérimentales ; III entités non-expérimentales avec entités non-expérimentales.
§ 473. Au point de vue dont nous nous occupons ici maintenant, c'est-à-dire au point de vue de l'accord avec l'expérience, il est manifeste que nous ne pouvons envisager que le premier genre de combinaisons, puisque les deux autres échappent à toute vérification expérimentale. Comme nous l'avons relevé (§ 17, 27), dans toute controverse il faut un juge, et l'expérience refuse de trancher les procès faisant partie des genres II et III, indiqués tout à l'heure [FN: § 473-1].
§ 474. Dans le traité qui porte le nom de De Melisso [FN: § 474-1], on attribue cette proposition à un philosophe [FN: § 474-2] : « Dieu, étant partout semblable, doit être sphérique ». Là, on met en rapport une entité non-expérimentale, Dieu, avec une entité expérimentale, la forme sphérique. Aucun critère expérimental ne peut nous permettre de juger de cette assertion ; et pourtant on donne une raison qui paraît expérimentale, pour prouver que Dieu est sphérique : on dit qu'il est unique, absolument semblable à lui-même, qu'il voit et entend de tous côtés [FN: § 474-3] . L'auteur du De Melisso n'est pas convaincu ; il observe que si tout ce qui est de toute part semblable à soi-même devait être sphérique, la céruse, qui est blanche en toutes ses parties, devrait aussi être sphérique ; et il ajoute d'autres raisons semblables. Tout cela échappe évidemment à l'expérience, et si l'on veut rester dans le domaine expérimental, on ne peut donner tort ni raison à l'un quelconque des deux adversaires. Celui qui se rapprochera plus de l'un que de l'autre le fera sous l'impulsion du sentiment ; jamais en vertu d'aucun motif expérimental.
§ 475. Mais voici, dans le même traité, une autre controverse. Xénophane dit que la terre et l'air s'étendent à l'infini, tandis qu'Empédocle le nie [FN: § 475-1] . Là, il n'y a que des entités expérimentales ; l'expérience peut juger et, de fait, elle a rendu son arrêt, qui est favorable à Empédocle.
§ 476. Il faut faire attention au fait que la plus grande partie des théories qui ont eu cours jusqu'à présent sur les sujets sociaux, se rapprochent du genre de théories dans lesquelles entrent des entités non-expérimentales, tout en usurpant la forme et l'apparence de théories expérimentales.
§ 477. Si nous nous plaçons dans le domaine de la logique formelle, abstraction faite de la validité des prémisses, la position la plus forte est celle donnée par les combinaisons du genre III ; puis vient celle donnée par les combinaisons du genre II. Il est manifeste que si, dans la proposition « A est B », les deux termes A et B sont en dehors du domaine expérimental, celui qui veut rester dans ce domaine ne peut rien, absolument rien objecter. Quand saint Thomas affirme qu'un ange parle à un autre ange [FN: § 477-1] , il met en rapport des choses sur lesquelles celui qui s'en tient uniquement à l'expérience n'a rien à dire. On peut faire la même observation, quand le raisonnement s'allonge par l'emploi de la logique, et tire des conséquences variées. Saint Thomas ne se contente pas de son affirmation ; il veut aussi la démontrer et dit : « Puisqu'un ange peut manifester son idée à un autre ange, et puisque celui qui a une idée peut, grâce à sa volonté, la manifester à quelqu'un d'autre, il est clair qu'un ange parle à un autre ». La science expérimentale n'a rien à reprendre à ce raisonnement, qui sort entièrement de son domaine. Beaucoup de raisonnements métaphysiques sont semblables à celui que nous venons de noter, et beaucoup d'autres en diffèrent seulement parce qu'ils empruntent quelque terme se rapportant au monde expérimental.
§ 478. On nous donne la définition suivante : « Tous les êtres capables de quelque degré d'activité, on pourrait dire simplement tous les êtres, puisque l'inertie absolue équivaut au néant ; tous les êtres tendent à une fin, vers laquelle se dirigent tous leurs efforts et toutes leurs facultés. Cette fin, sans laquelle ils n'agiraient pas, c'est-à-dire n'existeraient pas, c'est ce qu'on appelle le bien [FN: § 478-1] ». C'est ainsi qu'on définit une chose inconnue et en dehors du domaine expérimental (le bien), par une autre chose encore plus inconnue et de même en dehors du domaine expérimental (la fin); par conséquent, nous devrions rester étrangers à ce raisonnement. Mais, par malheur, on ne s'en tient pas à ces termes, et l'on ne tarde pas à étendre le dit raisonnement au monde expérimental, dans lequel on vient nécessairement se heurter à la science expérimentale.
§ 479. Le premier genre de combinaisons comprend toutes les théories scientifiques, mais en contient aussi d'autres très remarquables, qui sont pseudo-scientifiques ; celles-ci proviennent de l'élimination d'une entité non-expérimentale, admise seulement pour établir entre des entités expérimentales certaines relations qui, autrement, ne seraient pas démontrables. Par exemple, celui qui a donné la définition notée tout à l'heure, du bien, n'a pas le moins du monde l'intention de rester dans les hautes et nuageuses régions d'où il a pris son vol ; il veut tôt ou tard revenir ici-bas, sur la terre de l'expérience, qui a trop d'importance pour être entièrement négligée. De même celui qui veut rester dans le domaine de la science logico-expérimentale, n'a rien à objecter à qui affirme que l'Écriture Sainte est inspirée par Dieu ; mais ceux qui invoquent l'inspiration divine entendent s'en prévaloir ensuite, pour établir certains rapports entre des entités expérimentales ; par exemple, pour affirmer qu'il n'y a pas d'antipodes ; et ces propositions, la science expérimentale doit les juger intrinsèquement, sans se soucier des motifs échappant à l'expérience, en vertu desquels elles sont énoncées. De même encore, la théorie métaphysique de la « solidarité » échappe aux objections de la science logico-expérimentale ; mais ceux qui ont créé cette entité en dehors de l'expérience entendent s'en prévaloir pour établir des rapports entre des entités expérimentales, et principalement pour soutirer de l'argent à leur prochain. Il appartient à la science logico-expérimentale de juger intrinsèquement ces rapports et ces opérations expérimentales, sans se soucier des rêves et des divagations des saints Pères de la religion « solidariste ».
§ 480. Ces cas particuliers sont compris dans la formule générale suivante. Soient deux choses, A et B, qui appartiennent au domaine expérimental, et X, une autre chose, qui n'en fait pas partie. On fait un syllogisme dont X est le moyen terme ; celui-ci disparaît ensuite, et il ne reste qu'une relation entre A et B. Au point de vue expérimental, ni la majeure, ni la mineure, qui constituent le syllogisme, ne peuvent être admises, à cause du terme X, qui échappe à l'expérience ; et par conséquent le rapport entre A et B ne peut pas non plus être admis ni rejeté : il n'est expérimental qu'en apparence. Au contraire, dans la logique des sentiments (§ 1407), dans le raisonnement qui procède par accord de sentiments, le syllogisme peut être bon, et si nous tenons compte de l'indétermination des termes du langage vulgaire, si les sentiments suscités par le mot A concordent avec les sentiments suscités par le mot X, et ceux-ci avec les sentiments suscités par le mot B, il s'ensuit qu'en gros les sentiments suscités par A concordent avec ceux suscités par B.
Plus loin (§ 514), nous examinerons le raisonnement sous cette forme. Maintenant, commençons par l'envisager au point de vue expérimental.
§ 481. Il faut faire bien attention à deux erreurs que l'on peut faire, et qui sont de sens inverses ; c'est-à-dire: 1° admettre le rapport entre A et B, qui naît de ]!élimination de X, en vertu du raisonnement indiqué, sans une vérification exclusivement expérimentale ; 2° si l'on vérifie expérimentalement que ce rapport existe entre A et B, en conclure que, d'après la science expérimentale, X « existe » ; ou bien, si l'on vérifie expérimentalement que le rapport supposé entre A et B n'existe pas, en conclure que, d'après la science expérimentale, X n' « existe » pas (§ 487, 516, 1689).
§ 482. D'autre part, rejeter, au nom de la science expérimentale, le rapport entre A et B, qui provient de l'élimination de X, est un motif en partie formel ; et nous pourrions le négliger, si le rapport entre A et B était vérifié expérimentalement. En fin de compte, c'est là le but de la théorie ; qu'importe le moyen par lequel on l'atteint ?
§ 483. Il faut distinguer ici :
(a) l'étude de ce qui est ; c'est-à-dire des mouvements réels ;
(b) l'étude de ce qui arriverait, sous certaines conditions ; c'est-à-dire des mouvements virtuels ;
(c) l'étude de ce qui doit être.
§ 484. (a) Quant à ce qui est, l'expérience a rendu son arrêt. Les raisonnements du genre envisagé tout à l'heure n'aboutissent presque jamais à des rapports qui soient ensuite vérifiés par les faits (§ 50).
§ 485. Revenons à l'exemple des antipodes, indiqué déjà au § 67. La terre a-t-elle des antipodes ? Le bon sens et la prudence auraient dû conseiller de laisser à l'expérience la tâche de résoudre ce problème. Au contraire, Saint Augustin veut le résoudre par des motifs a priori ; et, après tout, son raisonnement n'est pas plus mauvais que beaucoup d'autres que l'on continue d'admettre aujourd'hui ; il a au moins le mérite d'être intelligible. Notre auteur dit [FN: § 485-1] : « Il n'y a aucune raison de croire que, comme on le conte, il y ait des Antipodes, c'est-à-dire des hommes sur la partie opposée de la terre, où paraît le soleil quand il disparaît sur la nôtre, des hommes qui, de leurs pieds, foulent le côté opposé à nos pas ». Il n'y a pas de preuve historique du fait. La partie de la terre opposée à la nôtre peut être recouverte par l'eau, et par conséquent sans habitants ; et puis, même si elle n'est pas recouverte par l'eau, « il n'est pas du tout nécessaire qu'il s'y trouve des hommes, puisqu’en aucune manière on ne saurait tenir pour trompeuse l'Écriture, dont les récits font foi que, pour le passé, ce qu'elle a prédit s'est accompli ; et que c'est le comble de l'absurdité de dire que quelques hommes, ayant franchi l'immense Océan, ont pu naviguer et parvenir de cette partie-ci de la terre à celle-là ». Ce raisonnement est beau, et, si l'on veut, même excellent ; mais malheureusement il se heurte aux faits ; et beaucoup d'autres semblables, par lesquels on démontrait qu'il n'existait pas, qu'il ne pouvait pas exister d'antipodes, n'ont pas un sort meilleur.
§ 486. Lactance dit [FN: § 486-1] : « Est-il bien possible qu'il se trouve quelqu'un d'assez stupide, pour croire qu'il y a des hommes dont les pieds sont au-dessus de la tête ? ou que [aux Antipodes ] tout ce qui, chez nous, est par terre, là-bas est suspendu à l'envers ? Les moissons et les arbres croîtraient en bas ? La pluie, la neige, la grêle tomberaient en haut sur la terre ? » Ici l'erreur est peut-être, à l'origine, théologique ; mais, dans la forme du moins, elle est métaphysique. Lactance raisonne comme un hégélien. Il trouve, et tous trouveront avec lui, que l'existence des antipodes répugne aux concepts haut, bas, en haut, en bas, tels que nous les avons là où nous vivons. En fait il a raison ; et il est ridicule de se figurer que les hommes marchent la tête en bas et les pieds en haut. D'autre part, celui qui raisonne non sur les concepts, mais sur les choses, celui qui ne considère les noms que comme des étiquettes qui servent à désigner les choses (§ 119), ne tarde pas à voir que, quand on passe du côté de la terre opposé à celui où nous sommes, il faut changer de place les étiquettes, intervertir les étiquettes en bas, en haut ; et de cette manière la croyance aux antipodes cesse d'être ridicule.
Prenons garde que si les erreurs du genre de celles de Lactance ont disparu – ou presque disparu – des sciences naturelles, elles demeurent au contraire très communes dans les sciences sociales, où beaucoup continuent à raisonner comme Lactance. Celui qui ne se soucie pas de voir son raisonnement aboutir à des conclusions ayant avec les faits des rapports de ce genre, n'a qu'à raisonner comme Lactance ou les hégéliens. Celui qui, au contraire, désire arriver autant que possible à des conclusions ayant avec les faits des rapports semblables à ceux que nous voyons dans les sciences physiques, doit s'efforcer de raisonner comme on le fait maintenant dans ces sciences (§ 5, § 69, § 71).
§ 487. Beaucoup se sont fait, et continuent à se faire une arme contre la religion chrétienne, ou, tout au moins contre la religion catholique, des erreurs des Pères au sujet des antipodes ; mais vraiment la religion chrétienne ni la catholique ne sont en rien la cause de ces erreurs. Il suffit, pour le prouver, d'observer que beaucoup de païens donnèrent à la terre une autre forme que la sphérique [FN: § 487-1] , et tournèrent en ridicule ceux qui croyaient aux antipodes [FN: § 487-2] . L'athée Lucrèce ne raisonne pas mieux que Lactance. Il estime absurde l'opinion de ceux qui affirment que la terre se maintient parce que tous les corps tendent au centre. « Mais peux-tu croire – dit-il – que les corps puissent se soutenir d'eux-mêmes, que tous les corps pesants qui sont sous la terre tendent vers le haut et restent ensuite sur la partie opposée de la terre, comme les images que nous voyons ici dans l'eau ? Avec de telles raisons, on soutient que les animaux marchent autour, à la renverse, et qu'ils ne peuvent tomber de la terre dans les lieux inférieurs du ciel, comme nos corps ne peuvent voler dans les régions supérieures du ciel [FN: § 487-3] ».
§ 488. On pourrait seulement dire qu'une foi vive, quelle qu'elle soit, non seulement religieuse, mais aussi métaphysique, grâce à l'orgueil qu'engendre la connaissance de l'absolu, éloigne du scepticisme prudent des sciences expérimentales. Mais cette foi est une cause indirecte de l'erreur ; tandis que la cause directe se trouve dans le fait de vouloir raisonner sur des concepts plutôt que sur des faits, et d'employer l'auto-observation au lieu de l'observation objective [FN: § 488-1] .
§ 489. Cosme Indicopleuste, dans sa Topographie chrétienne, est bien amusant. Le 2d prologue a pour titre [FN: § 489-1] : « Topographie chrétienne de tout l'univers, démontrée par l'Écriture Sainte, avec laquelle les chrétiens ne doivent pas être en désaccord ». Dès l'abord, il s'en prend (57 B – Migne 58) « à ceux qui, bien que chrétiens, croient et enseignent, selon les Gentils, que le ciel est sphérique ». Notre auteur a vraiment d'excellentes raisons pour démontrer que la terre n'est pas sphérique. « Comment, avec son poids incalculable, la terre peut-elle être suspendue, rester en l'air, et ne pas tomber [FN: § 489-2] ? » Au contraire, nous voyons par l'Écriture Sainte que le monde a la forme d'un four et que la terre est quadrangulaire. Le tabernacle construit par Moïse est l'image du monde. Inutile de relever que l'existence des antipodes est une fable ridicule ; et pour montrer combien elle l'est, l'auteur fait un dessin où, sur un tout petit globe, on voit des hommes très grands, dont l'un a les pieds opposés à ceux de l'autre. (131 D, 132 A – Migne 130) « Au sujet des antipodes, les Saintes Écritures ne permettent ni de dire, ni d'écouter une semblable fable ; puisqu'elles disent (Act. 17,26): Il a fait que toute la race des hommes, issue d'un seul sang, habitât sur toute la face de la terre. Elles ne disent pas : sur toutes les faces, mais sur la face ». À cette raison s'en ajoutent d'autres également très solides.
§ 490. Même des auteurs, au demeurant d'un très grand mérite, lorsqu'ils ont recours au raisonnement métaphysique, ont des théories qui ne valent pas mieux que celles exposées tout à l'heure. Dans le traité De caelo, Aristote démontre longuement que le mouvement du ciel doit être circulaire. Il commence par affirmer que tout mouvement dans l'espace doit être en ligne droite, ou circulaire, ou un mélange de ces deux mouvements (I, 2, 2); il ajoute une autre affirmation, soit que seuls les mouvements en ligne droite et les mouvements circulaires sont simples. Il dit ensuite : « J'appelle corps simples ceux qui ont naturellement en eux-mêmes le principe du mouvement, comme le feu, la terre et d'autres du même genre [FN: § 4] ». C'est une définition, et il n'y aurait rien à objecter si elle était claire ; malheureusement elle ne l'est pas. C'est là un défaut qu'on trouve dans toutes les définitions des métaphysiciens, parce qu'ils ont des termes qui ne correspondent à rien de réel. Que peut bien signifier : « avoir naturellement en soi le principe du mouvement » ? Vraiment rien. Ce sont des termes qui agissent uniquement sur le sentiment de l'auditeur.
§ 491. Ces affirmations et définitions qui ne signifient rien servent ensuite à des raisonnements qu'on prétend rigoureux. (I, 2, 5) « Donc, puisqu'il y a un mouvement simple, – et le mouvement circulaire est simple, – puisqu'un corps simple a un mouvement simple, – et un mouvement simple appartient à un corps simple, car s'il était composé, il se mouvrait selon l'élément prépondérant, – il est nécessaire qu'il y ait un corps simple qui, par nature, se meuve circulairement ». À ce beau raisonnement, on ajoute le suivant : « Donc ce mouvement doit nécessairement être le premier. Le parfait, de sa nature, précède l'imparfait ; or le cercle est parfait, tandis que la ligne droite ne l'est pas... Donc si le mouvement primitif est celui du corps qui est le premier dans la nature, et que le mouvement en cercle soit supérieur au mouvement en ligne droite, qui est propre aux corps simples (étant donné que le feu monte en ligne droite et que les corps terrestres descendent vers le milieu), il est nécessaire que le mouvement circulaire appartienne à un corps simple [FN: § 491-1] ». Il est manifeste que ce raisonnement n'a rien d'expérimental ; toute sa force gît dans les sentiments que font naître des termes convenablement choisis, et on l'admet parce que ces sentiments paraissent s'accorder ensemble, ou du moins n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre.
Lancé sur cette voie, on peut trouver ce qu'on veut ; de même qu'en regardant les nuages au ciel, on peut y découvrir toutes sortes d'animaux. C'est ainsi que Platon trouve « divins » le cercle et la sphère [FN: § 491-2] . Pourquoi pas ? Il peut bien le dire ; de même qu'au contraire un étudiant, aux prises avec les problèmes de la trigonométrie sphérique, pourra les trouver « diaboliques ». Ce sont de simples expressions de sentiments, sans aucune correspondance objective.
§ 492. Aristote (De caelo, II, 13, 19) nous apprend comment, selon Anaximandre, on démontrait l'immobilité de la terre. Il n'y a aucun motif pour qu'un corps placé au centre et distant également des extrémités, soit poussé en haut plutôt qu'en bas ou en direction oblique ; et puisqu'il est impossible que le mouvement se produise en même temps de côtés opposés, ce corps doit nécessairement rester immobile. Maintenant voici comment s'exprime un des plus grands savants de notre temps : « Un point en repos ne peut se donner aucun mouvement, puisqu'il ne renferme pas en lui-même de raison pour se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre... La direction du mouvement en ligne droite, suit évidemment de ce qu'il n'y a aucune raison pour que ce point s'écarte plutôt à droite qu'à gauche de sa direction primitive [FN: § 492-1] ».
La proposition d'Anaximandre est contredite par l'expérience ; les propositions de Laplace sont confirmées par elle ; dans l'un et l'autre cas, la démonstration est également sans la moindre valeur.
§ 493. On la fait sur le modèle suivant : « Tout ce qui, à moi et aux autres hommes, ne paraît pas pouvoir arriver, n'arrivera certainement pas ; je ne vois aucun motif pour lequel A doive être B ; donc A ne peut être B ». C'est là la méthode habituelle de l'auto-observation (§ 43,69, 111, 434).
§ 494. L'erreur de la démonstration est moins apparente, parce qu'on donne une forme objective à ce qui devrait avoir une forme subjective. Si Laplace avait voulu s'exprimer rigoureusement, au lieu de dire : « il n'y a aucune raison pour que ce point s'écarte plutôt à droite qu'à gauche... », il aurait dû dire : « il ne me semble pas qu'il y ait aucune raison pour que, etc. »; et de cette façon, on aurait pu mieux voir le caractère trompeur de la démonstration. Laplace aurait pu répondre qu'il n'a pas employé cette forme, parce que non seulement lui, mais tous les hommes, ont cette impression. Ainsi apparaît une autre des grandes sources d'erreurs de ce raisonnement. Passons sur le fait qu'il est faux que les choses paraissent ainsi à tous les hommes, puisque le plus grand nombre des hommes n'y a jamais pensé ; mais quand bien même ils y auraient pensé, le consentement unanime des hommes n'ajouterait aucune valeur à la proposition, et n'a aucun pouvoir pour changer en objectif ce qui est subjectif (§ 592).
§ 495. Comme d'habitude, ainsi que nous avons dû souvent le répéter, et que nous devrons le répéter encore, toute précision fait défaut dans des raisonnements de ce genre. Que veut dire qu'un point « ne renferme pas en lui-même de raison pour se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre » ? Et comment fait-on pour savoir si vraiment il n'a en lui-même aucun de ces motifs ? Il n'y a pas d'autre manière que de voir s'il reste immobile. Par conséquent la proposition de Laplace finit par signifier qu'un point est immobile quand il est immobile ; ce qui est aussi vrai qu'inutile à savoir.
§ 496. Quand on dit que la force est la cause du mouvement [FN: § 496-1], on croit affirmer quelque chose, et l'on ne dit rien. On définit une inconnue par une autre inconnue. Et que peut bien être la cause du mouvement ? Il est difficile de trouver une, réponse qui ne soit, en somme, que cette cause est une force ; d'où notre proposition revient à dire que la force c'est la force. La mécanique moderne a exclu de la science de semblables façons de raisonner [FN: § 496-2]. Nous voulons tâcher d'en faire autant en sociologie.
§ 497. Les mouvements naturels, violents, volontaires, jouent un grand rôle dans la philosophie ancienne. Si l'on veut voir combien on peut entasser de non-sens en raisonnant sur ces choses, on n'a qu'à lire le livre X des Lois de Platon. Malheureusement, Aristote se laisse parfois aussi entraîner par des élucubrations semblables, et l'on peut, par conséquent, l'opposer à Galilée, quand celui-ci constituait la physique expérimentale. Pour cette science, l'œuvre de Galilée a sa place dans le passé ; pour la sociologie, une œuvre analogue commence à peine de nos jours.
§ 498. Pour prouver que les astres se meuvent volontairement, Cicéron fait discourir Balbus. Celui-ci commence par observer que, d'après Aristote, tout ce qui se meut est mu par la nature, par la force ou par la volonté ; il continue en recherchant comment se meuvent le soleil, la lune et tous les astres : « Ce qui est mu par la nature est porté ou vers le bas par la pesanteur, ou vers le haut par la légèreté ; tandis que ni l'un ni l'autre cas ne se présente pour les astres, puisqu'ils se meuvent suivant une orbite circulaire ; et l'on ne peut dire qu'une force meuve les astres contrairement à la nature. Quelle force, en effet, serait assez grande ? Il reste donc seulement à admettre que le mouvement des astres est volontaire [FN: § 498-1] ».
§ 499. On construit des théories de ce genre en grande quantité, quand on raisonne sur les concepts et sur les mots, au lieu de raisonner sur les faits [FN: § 499-1] . Lorsque ensuite l'erreur devient manifeste, quand on ne peut plus la nier, au lieu d'abandonner la façon de raisonner qui a induit en erreur, on veut obstinément la conserver, et l'on tâche seulement de l'adapter aux résultats de l'expérience.
§ 500. Si celle-ci a fait précédemment connaître le rapport existant entre deux faits expérimentaux, A et B, le théologien ou le métaphysicien arrange ses expressions de manière à reproduire autant que possible ce rapport. Malheureusement, celui qui a l'habitude des raisonnements théologiques ou métaphysiques s'adapte difficilement à la précision des raisonnements scientifiques ; c'est pourquoi le désir de reproduire le rapport expérimental existant entre A et B n'est pas suivi d'un effet proportionnel, et souvent ce rapport apparaît déformé.
§ 501. L'idée que les corps célestes, étant parfaits, devaient se mouvoir suivant des cercles, régna longtemps. Finalement, on reconnut que cette idée est fausse – ou mieux qu'elle n'a pas de sens. On le découvrit par une voie tout à fait différente de celle qu'avait suivie Aristote pour l'établir, c'est-à-dire par la voie empirique suivie par Kepler.
§ 502. Maintenant que les métaphysiciens savent – ou croient savoir – que les planètes se meuvent selon des ellipses dont un des foyers est occupé par le soleil [FN: § 502-1] (§ 69-3 ), ils s'efforcent d'atteindre par leurs raisonnements ce résultat qui est – ou mieux qu'ils se figurent être – donné par l'expérience.
Hegel dit : [FN: § 502-2]
« (p. 293, § 270) Le cercle est la ligne courbe où tous les rayons sont égaux, c'est-à-dire il est complètement déterminé par le rayon. C'est une unité qui s'ajoute à elle-même, et c'est là toute sa déterminabilité. Mais dans le mouvement libre, où les déterminations du temps et de l'espace se différencient, et où il s'établit entre ceux-ci un rapport qualitatif, il faut que ce même rapport s'introduise dans l'espace comme une différence qui y produit deux déterminations. Par (p. 294) conséquent, la forme essentielle de la révolution des planètes est l'ellipse ».
§ 503. La démonstration de la troisième loi de Kepler est fort belle [FN: § 503-1]. « (p. 296) Comme racine, le temps n'est qu'une grandeur empirique, et, en tant que qualité, il n'est qu'une unité abstraite [FN: § 503-*]. Comme moment de la totalité développée, il est de plus une unité déterminée, une totalité réfléchie [FN: § 503-**]; il se produit, et en se produisant il ne sort pas de lui-même.[FN: § 503-***] Mais comme il n'a pas de dimensions, en se produisant, il n'atteint qu'à une identité formelle avec lui-même, au carré, et l'espace, au contraire, qui forme le principe positif de la continuité (p. 297) extérieure, [FN: § 503-†] atteint à la dimension de la notion, au cube. Ainsi leur différence primitive subsiste dans leur réalisation. C'est là la troisième loi de Kepler, concernant le rapport des cubes des distances aux carrés des temps... ». Vraiment ? Qui s'en serait jamais douté ? Quelle prodigieuse intelligence doivent avoir ceux qui comprennent cela !
§ 504. Mais il y a mieux. Savez-vous ce qu'est le diamant [FN: § 504-1] ? « (p. 21, § 317) Le cristal typique est le diamant, ce produit de la terre, à l'aspect duquel l'œil se réjouit parce qu'il y voit le premier-né de la lumière et de la pesanteur. La lumière est l'identité abstraite et complètement libre. L'air est l'identité des éléments. L'identité subordonnée [FN: § 504-*] est une identité passive pour la lumière, et c'est là la transparence du diamant ». Maintenant que vous avez compris ce qu'est la transparence du diamant, faites bien attention à ce qu'est le métal. « Le métal est, au contraire, opaque, parce qu'en lui l'identité individuelle est concentrée dans une unité plus profonde par une haute pesanteur spécifique [FN: § 504-2] ».
§ 505. Il y a probablement une réminiscence de si profondes conceptions dans le passage suivant d'un philosophe contemporain [FN: § 505-1] « (p. 22) : Qu'est-ce que le mouvement d'un mobile à travers l'espace ? C'est de la mécanique qui se réalise elle-même. Qu'est-ce que la formation d'un cristal au sein de la terre ? C'est de la géométrie qui se rend elle-même visible aux yeux ». On trouve des raisonnements semblables chez tous nos métaphysiciens (§ 1686-2). Depuis longtemps, les Chinois avaient observé l'influence de la lune sur les marées, et en avaient donné une explication qui est digne, en vérité, de la Philosophie de la Nature, de Hegel [FN: § 505-2].
§ 506. Saint Thomas sait pourquoi il y a des corps qui sont transparents et d'autres qui sont opaques [FN: § 506-1]. « Puisque, la lumière étant une qualité du premier altérant, qui est au plus haut point parfait et formel dans les corps, les corps, qui sont au plus haut point formels et mobiles, sont lucides actu, ceux qui sont près d'eux reçoivent la lumière ; ainsi les corps diaphanes ; et ceux qui sont au plus haut point matériels, n'ont pas de lumière dans leur nature et ne sont pas non plus récepteurs de lumière, mais sont opaques. Cela se voit d'une façon manifeste dans les éléments, puisque le feu a la lumière dans sa nature, mais que sa lumière ne nous apparaît que dans une matière étrangère, à cause de sa subtilité. L'air et l'eau sont en vérité moins formels que le feu ; c'est pourquoi ils ne sont que diaphanes. La terre, qui est au plus haut point matérielle, est opaque ». Notre docteur est un grand saint, mais pas un grand physicien.
Les termes juste, équitable, moral, humain, solidaire et autres semblables, qu'on emploie aujourd'hui dans les sciences sociales, sont de même nature que les termes chaud (§ 871), froid, pesant, léger, etc., qu'on employait en d'autres temps dans les sciences naturelles. Ce sont eux qui souvent égarent l'esprit et font croire qu'un raisonnement fantaisiste est un raisonnement expérimental (§ 965).
§ 507. Il est remarquable qu'en étudiant les théories de ses prédécesseurs, Aristote ait vu la cause de leurs erreurs [FN: § 507-1] . « La raison pour laquelle ils virent moins bien les faits courants fut le défaut d'expérience. C'est pourquoi ceux qui ont passé leur vie à observer la nature sont plus à même de faire des hypothèses sur les principes qui peuvent unir un grand nombre de faits ». Si Aristote était resté fidèle au principe qu'il avait si bien posé, il aurait peut-être procuré une anticipation de plusieurs siècles aux connaissances scientifiques de l'humanité.
§ 508. Plus remarquable encore est le cas de Bacon. On a déjà souvent observé qu'il raisonnait fort bien sur la méthode expérimentale, et qu'ensuite il la mettait mal en pratique. Par exemple, il nous avertit que [FN: § 508-1] : « Il n'y a rien de bon, ni en logique, ni en physique, dans les notions suivantes : ni la substance, ni la qualité, ni l'action, ni l'impression, ni même l'être, ne sont de bonnes notions ; encore beaucoup moins : pesant, léger, dense, ténu, humide, sec, génération, corruption, attraction, répulsion, élément, matière, forme et autres semblables ; elles sont toutes fantaisistes et indéterminées ». Mais ensuite il considère les corps [FN: § 3] « comme un ensemble ou union de natures simples »; et il ne lui vient pas à l'idée que ces natures simples ont leur place parmi les « notions » qu'il condamne.
§ 509. Dans ces raisonnements pseudo-expérimentaux, les termes A, B,... qu'on met en rapport, sont habituellement indéterminés. Nous avons vu déjà des amphibologies, dans le raisonnement d'Aristote (§ 491) ; mais ce n'est rien en comparaison de l'absolue indétermination des termes employés par certains métaphysiciens (§ 963)
§ 510. Quand Hegel dit [FN: § 510-1] « (p. 383, § 279) En général, on ne peut pas nier l'influence des comètes. Autrefois je fis jeter les hauts cris à M. Bode en disant que l'expérience montre maintenant que les comètes sont accompagnées (p. 384) d'une bonne vendange, ainsi que cela a eu lieu en 1811 et 1819, et que cette double expérience vaut tout autant, et mieux encore que celles qui concernent le retour des comètes », il énonce une proposition fausse, et fait preuve d'une grande ignorance en mécanique céleste, en supposant que l'uniformité du « retour » des comètes n'est qu'empirique ; mais enfin, il emploie des termes clairs, précis et qui correspondent à des choses concrètes ; c'est même justement pour cela que l'on voit tout de suite la fausseté de sa proposition. Mais le caractère de clarté dans les termes fait ensuite défaut, quand il ajoute : « (p. 384) Ce qui rend bon le vin cométaire, c'est que le processus aqueux abandonne la terre, et amène par là un changement dans l'état de la planète ». Et que peut bien être ce « processus aqueux » qui abandonne notre terre ? Qui l'a jamais vu ou en a jamais entendu parler ?
§ 511. L'indétermination et l'absurde augmentent, quand Hegel dit : « (p. 378) La lune est le cristal sans (p. 379) eau, qui s'efforce de se compléter, et d'apaiser la soif de sa rigidité par notre mer, et qui produit ainsi la marée » (§ 505-2). À la rigueur, on sait ce que veulent dire les termes : cristal, eau, soif, rigidité ; et c'est seulement la manière dont ils sont combinés qui est difficile à saisir. Mais même cette lueur de compréhension disparaît, quand Hegel dit :
« (p. 360, § 276)... la lumière est la pensée simple elle-même, qui existe sous forme de nature. C'est l'entendement dans la nature, ou ce qui revient au même, ce sont les formes de l'entendement qui existent dans la nature [FN: § 511-1] * » ; ou bien : « (p. 365, § 277) La lumière en tant qu'elle constitue l'identité physique universelle, se pose d'abord comme terme différencié, et, par conséquent, comme formant ici un principe distinct et extérieur † dans la matière qualifiée d'après une autre détermination de la notion qui constitue la négation de la lumière, ou l'ombre ** ».
§ 512. Si ces galimatias n'étaient que la conséquence de l'état psychique d'un auteur, il n'y aurait pas lieu de s'en préoccuper plus que des divagations d'une personne qui n'est pas très saine d'esprit ; mais beaucoup de gens les ont admirés, et l'on continue à tenir en grande estime leurs équivalents, en sciences sociales ; c'est pourquoi ils sont dignes d'attention, comme phénomène social important (§ 965).
§ 513. L'état psychique des personnes qui s'imaginaient comprendre de semblables raisonnements, ne diffère pas beaucoup de celui des gens qui croyaient saisir les abstractions mythologiques et théologiques. On a là une nouvelle confirmation du fait que l'évolution n'a pas lieu suivant une ligne continue (§ 344). Les trois états psychiques indiqués tout à l'heure, A, B, C, se suivent de telle sorte qu'on peut les supposer former un ensemble continu ; mais il y a d'autres branches, qui conduisent à des connaissances expérimentales : p, q, r,... ou à d'autres divagations mystiques, théologiques, etc.: M, N,...
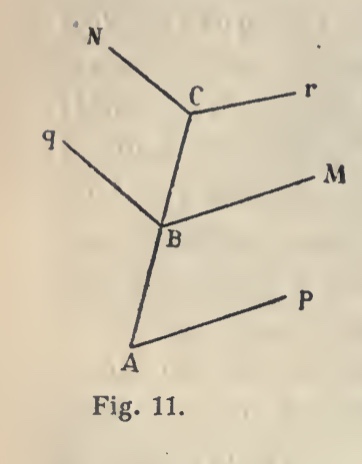
Figure 11
§ 514. Ces considérations nous portent dans le domaine de la logique des sentiments, mentionnée déjà au § 480. Le raisonnement vulgaire confond ensemble les propositions suivantes [FN: § 514-1] :
I. A est égal à X; X est égal à B ; donc A est égal à B.
II. Le nom a de la chose A suscite, chez un homme, des sentiments égaux à ceux suscités par le mot X, et ceux-ci sont égaux aux sentiments suscités par le nom b de la chose B ; donc le nom a suscite des sentiments égaux à ceux suscités par le nom b.
III. Les prémisses sont les mêmes que dans le cas II ; mais la conclusion est : « donc A est égal à B ».
Au point de vue expérimental, la proposition I est d'accord avec l'expérience, si A, X, B sont des choses réelles et bien définies ; et cet accord est d'autant plus rigoureux que les choses A, X, B sont mieux définies ; de même qu'au contraire il peut disparaître, si elles sont mal définies. Si X n'est pas réel, ou, d'une façon générale, si l'une des trois choses A, X, B n'est pas réelle, on ne saurait parler d'accord avec l'expérience (§ 480).
Les sentiments suscités par les mots a, X, b sont des choses réelles ; par conséquent la proposition II est semblable à la proposition I, dans le cas où A, X, B sont réels, et comme elle, elle concorde avec l'expérience. Mais a, X, b sont habituellement assez mal définis ; aussi cet accord est-il d'ordinaire peu rigoureux.
La proposition III n'a aucune valeur logique, puisque dans la conclusion figurent des choses A et B différentes de a et b qui figurent dans les prémisses. Pour qu'elle acquière cette valeur, il ne suffirait pas que A, X, B soient des choses réelles, bien définies : il faudrait de plus que l'accord des concepts a, X, b correspondît précisément au rapport existant entre A, X, B. C'est là justement que gît la différence entre la métaphysique et la science logico-expérimentale : la première admet cet accord a priori ; la seconde le subordonne à la vérification expérimentale [FN: § 514-2].
Dans la logique des sentiments, la proposition III est au fond le type de chaque raisonnement, et passe pour être certainement « vraie ». Ce type peut prendre la forme des divers genres de syllogismes. Par exemple, on peut dire: « Les sentiments que me fait éprouver le mot a sont les mêmes que ceux que me fait éprouver le mot X, qui désigne une classe générale ; et ceux-ci sont les mêmes que ceux que me fait éprouver le mot b: par conséquent, la chose A, correspondant au mot a, a l'attribut B, correspondant au mot b ». Mais on est généralement moins explicite, et, en résumé, le type est : « Les sentiments que me fait éprouver a concordent avec ceux que me fait éprouver X, et ceux-ci concordent avec ceux que me fait éprouver b ; donc A a l'attribut B ». La forme est ensuite celle d'un syllogisme parfaitement logique, et s'obtient en traduisant les propositions précédentes, de la façon suivante. La proposition : « Les sentiments que me fait éprouver a concordent avec ceux que me fait éprouver X », se traduit : « A fait partie de la classe X ». La proposition : « Les sentiments que me fait éprouver X concordent avec ceux que me fait éprouver b », se traduit: « Les X ont l'attribut B ». On conclut donc, sans que la logique formelle puisse rien y reprendre, que « A a l'attribut B ». Ce raisonnement est très employé ; on peut dire qu'il est de règle générale, à l'exception des sciences logico-expérimentales ; il est employé par le vulgaire, et c'est presque le seul qui puisse le persuader. Il domine spécialement dans les matières politiques et sociales [FN: § 514-3] (§ 586 et sv.).
Au point de vue logico-expérimental, les causes d'erreur sont les suivantes : 1° On ne peut admettre expérimentalement les traductions que nous venons d'indiquer, même si A, X, B sont des choses réelles. 2° On ne sait pas à quoi correspondent précisément les termes a, X, b. Le cas le plus favorable à la vérification expérimentale, mais non à la persuasion par voie de sentiment, est celui où ces termes correspondent à des choses réelles, sans trop d'indétermination. Alors les traductions s'adaptent plus ou moins bien à la réalité, et la conclusion est, en gros, vérifiée par l'expérience. Mais la correspondance entre a, X, b et des choses réelles peut être très incertaine ; elle peut même disparaître, si quelqu'une de ces choses cesse d'être réelle. Cela ne se voit pas dans le raisonnement, puisqu'il porte uniquement sur les termes a, X, b, qui persistent même si les choses réelles correspondantes disparaissent. C'est là la plus grande cause d'erreur ; elle vicie tout raisonnement de ce genre. 3° L'accord de certains sentiments avec certains autres, ou celui des premiers avec les seconds, est un rapport indéterminé où toute précision fait entièrement défaut ; par conséquent, les propositions du genre de celles-ci : « Les sentiments que me fait éprouver a s'accordent avec ceux que me fait éprouver X », sont en grande partie arbitraires.
Il faut enfin remarquer que si, dans la logique ordinaire, la conclusion résulte des prémisses, dans la logique des sentiments, ce sont les prémisses qui résultent de la conclusion. C'est-à-dire que celui qui fait le raisonnement, comme celui qui l'accepte, est persuadé préalablement que A a l'attribut B ; puis il veut donner un vernis logique à cette conviction, se met à la recherche de deux prémisses qui justifient cette conclusion, c'est-à-dire des prémisses : « les sentiments que a fait éprouver concordent avec ceux que fait éprouver X ; lesquels concordent ensuite avec ceux que fait éprouver b » ; et il les trouve très facilement, grâce à l'indétermination des termes et du rapport exprimé par le verbe concorder [FN: § 514-4].
§ 515. Donc, contrairement à ce qui a lieu dans le raisonnement logico-expérimental, où les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont mieux déterminés, dans le raisonnement par accord de sentiments, ils sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus indéterminés. C'est ce qui explique l'abondant usage qu'on fait, dans ce raisonnement, des termes comme bon, beau, juste, etc. (§ 408). Plus les concepts qui correspondent à a, X, b sont indéterminés, plus il est facile d'établir par le sentiment l'accord entre le concept de a et celui de X, entre le concept de X et celui de b. Par exemple, si X est le concept de parfait, il est si indéterminé qu'on l'accordera facilement avec d'autres concepts A et B, qu'on a en vue, déterminés ou indéterminés. « Le mouvement des corps célestes est parfait ». Pourquoi pas ? Le sentiment ne met pas en opposition ces deux concepts (§ 491-1 , 1557).
§ 516 Nous voici arrivés par induction, en examinant les faits concrets, au point déjà indiqué d'une façon hypothétique, au § 13 ; autrement dit, nous voyons qu'il y a de nombreux et puissants motifs subjectifs, de sentiment, qui font produire et accepter les théories, indépendamment de leur valeur logico-expérimentale (§ 309). Nous aurons donc à nous occuper longuement de cette matière (chap. IX).
En attendant, notons une autre erreur, déjà rappelée (§ 15, 16), et qu'on observe souvent. Elle provient de ce qu'on transporte hors du domaine logico-expérimental les conclusions qui n'ont de valeur que dans ce domaine. L'élimination d'un terme non expérimental, X, ayant produit un rapport entre les termes expérimentaux A et B, le fait que ce rapport est confirmé ou démenti par l'expérience ne peut en rien servir à prouver ou à rejeter « l'existence » de X. Il n'y a rien de commun entre le monde expérimental et le monde non-expérimental, et l'on ne peut rien conclure de celui-ci à celui-là, ou vice versa.
Longtemps, on a voulu déduire de la Bible des propositions scientifiques ; par exemple, les propositions relatives au mouvement de la terre et des corps célestes ; maintenant, le raisonnement contraire est en vogue ; c'est-à-dire que, de la fausseté de ces propositions scientifiques, on veut déduire la fausseté de la théologie biblique (§ 487). Celui qui veut rester dans le domaine expérimental ne peut pas plus admettre l'une de ces manières de raisonner que l'autre (§ 481). Les erreurs scientifiques de la Bible démontrent seulement que l'on ne doit pas demander à la théologie les rapports qui existent entre les faits expérimentaux ; comme les erreurs scientifiques de Hegel démontrent que pour nous fournir ces rapports, la métaphysique ne vaut pas mieux que la théologie ; et c'est tout ; cela ne peut rien prouver au sujet des doctrines qu'il plaira à la théologie ou à la métaphysique d'établir en dehors du domaine expérimental.
§ 517. (b ) Les recherches sur les mouvements virtuels, quand ceux-ci appartiennent au domaine expérimental, ne sont qu'une manière d'envisager les rapports expérimentaux ; et, par conséquent, les considérations présentées tout à l'heure s'appliquent à elles. Si quelque terme auquel aboutissent les mouvements virtuels est en dehors du domaine expérimental, nous n'avons pas à nous en occuper ici, sauf si l'on tente de revenir à l'expérience, en éliminant ce terme ; et dans ce cas, l'on revient encore aux rapports entre faits expérimentaux.
§ 518. (c ) Il y a enfin la considération de ce qu'on doit faire, ou le précepte (§ 325 et sv.). C'est un genre de rapport qui peut être entièrement en dehors de l'expérience, même quand les termes qui sont mis en rapport sont expérimentaux ; le terme doit, qui ne correspond à aucune réalité concrète, le fait sortir du domaine expérimental [FN: § 518-1] . On peut toujours poser la question : « Et si un homme ne fait pas ce qu'on assure qu'il doit faire, qu'arrivera-t-il ? » Cette question conduit à la considération des mouvements virtuels (b).
§ 519. Liaisons entre les éléments des théories. Abordons maintenant la seconde des questions posées au § 467, et commençons par prendre un exemple. Voyons la chimie, au moment où la théorie atomique était en pleine vigueur. On partait de certaines hypothèses, et l'on arrivait à expliquer les faits chimiques connus, à en prévoir d'inconnus, que l'expérience vérifiait ensuite. Toutes les théories scientifiques sont de ce genre, et possèdent des caractères bien distincts.
§ 520. Mais voici, comme autre exemple, une des nombreuses théories dites morales ; elle a un caractère tout différent. Toute vérification quelconque fait défaut. On cherche comment les choses doivent être, et l'on fait cette étude de manière à trouver entre les choses certains rapports qui existent ou que l'on désirerait voir exister. Supposez un chimiste qui dirait : « C'est un grave inconvénient que le protochlorure de mercure puisse spontanément, à la lumière, se transformer en bichlorure, qui est un violent poison ; donc, je chercherai une théorie chimique telle que cela ne soit pas possible »; et vous aurez un type très répandu de théories morales.
§ 521. Même en dehors de ce type, la différence est notable, entre les théories qui ont les faits pour seuls guides et les théories qui veulent au contraire régler les faits. Comparez, par exemple, la théorie atomique des chimistes modernes et la théorie atomique de Lucrèce. La différence consiste plus dans la nature des recherches que dans la plus ou moins grande vérité expérimentale des données et des conclusions.
§ 522. Autrefois, les théories des faits naturels avaient le caractère des théories morales modernes ; depuis, elles ont entièrement changé de nature, et sont devenues les théories scientifiques modernes. Le traité De caelo d'Aristote peut figurer dans une même classe que les traités de morale modernes ; mais il ne peut être dans la même classe que le traité Philosophiae naturalis principia mathematica de Newton, et encore moins dans la même classe que le Traité de mécanique céleste de Laplace. Si l'on veut lire ces livres à la suite l'un de l'autre, on verra bientôt que celui d'Aristote diffère absolument des autres par la nature même et le but des investigations. Il n'y a pas à rechercher la raison de cette différence dans l'esprit ou les connaissances des auteurs, puisque Newton a écrit sur l'Apocalypse un commentaire qui peut dignement prendre place auprès du traité De caelo d'Aristote.
§ 523. Donc, si nous nous proposons de disposer les théories suivant la nature de leurs démonstrations, nous devrons séparer deux types. Dans l'un, la liaison consiste seulement en conséquences logiques des faits ; dans l'autre, on y ajoute quelque chose qui dépasse l'expérience : un concept : nécessaire, devoir, ou autre semblable. Enfin, pour achever l'opération, il faut aussi considérer les propositions dans lesquelles le lien logique est réduit à peu de chose ou à rien, et qui sont de simples descriptions ou narrations. Nous aurons donc les trois genres suivants :
1° Propositions descriptives.
2° Propositions qui affirment une uniformité expérimentale.
3° Propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale ou la négligent.
§ 524. Les théories scientifiques se composent de propositions du 1er et du 2e genre. Il s'y ajoute quelquefois des propositions du 3e genre, qui peuvent n'être pas nuisibles, si l'adjonction non-expérimentale est superflue, mais qui risquent de porter préjudice au caractère scientifique, si l'adjonction non-expérimentale influe sur les résultats de la théorie. Les théories sociologiques et beaucoup de théories économiques ont fait jusqu'à présent un usage abondant des propositions du 3e genre, qui influaient sur les résultats. Il faut exclure ces propositions, si l'on veut avoir une sociologie et une économie présentant les caractères des sciences logico-expérimentales.
Ici, nous n'avons pas à nous occuper, sinon en passant, des sciences naturelles ; et nous devons diriger principalement notre étude sur les théories qui dépendent des faits sociaux. Procédons donc à l'étude générale des sciences logico-expérimentales en rapport avec les genres notés tout à l'heure.
§ 525. 1er GENRE. Propositions descriptives. Par exemple : J'ai cherché la densité de l'eau pure, sous la pression atmosphérique de 760 m/m de mercure, et j'ai observé qu'il y avait un maximum à la température de 4°. Le mariage romain était d'une seule femme avec un seul homme à la fois. La description peut s'allonger tant qu'on veut ; mais quand elle s'étend un peu, on risque d’y mêler des propositions d'une autre classe. L'homme éprouve une grande difficulté à s'en tenir à la description seule ; il se sent constamment poussé à y ajouter des explications. Dire : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, est une description ; mais dire : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, parce qu 'ils croyaient qu'ils venaient de Zeus, ajoute une explication à la description. On en reviendrait à une simple description, si l'on disait : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, et certains affirmaient qu'on devait le faire parce qu'ils venaient de Zeus (§ 1690-2). Cette distinction peut paraître subtile ; mais elle est d'une grande importance, car dissimuler les explications parmi les descriptions, est un procédé fort usité pour faire admettre des explications qui n'ont pas de fondement logico-expérimental. Ce n'est pas ici le lieu de nous arrêter à chercher jusqu'à quel point est déterminé le terme générique : les Grecs, adopté tout à l'heure.
§ 526. 2e GENRE. Propositions qui affirment une uniformité expérimentale. Dans l'affirmation d'une uniformité, il y a quelque chose de plus que la description de faits passés ; il y a la prévision plus ou moins probable de faits futurs. Si je dis : « Sous la pression de 760 m/m de mercure, l'eau atteint son maximum de densité à la température de 4° », je dis quelque chose de plus que ce que j'exprimais dans la proposition descriptive rappelée naguère : j'affirme que si l'on met de l'eau dans ces conditions, on observera un maximum de densité à 4°. Notez ensuite que la dernière proposition contient quelques affirmations implicites. Elle affirme que seules la pression et la température influent pour déterminer la densité. Si, par exemple, l'état électrique de l'air influait aussi, la proposition descriptive serait incomplète, parce que j'aurais dû noter cet état ; mais la proposition affirmant une uniformité serait fausse, puisque, en faisant une expérience avec un état électrique différent, je ne trouverais pas le maximum à 4°.
§ 527. Au lieu d'un cas hypothétique, voici un cas réel. Si je dis: « J'avais un thermomètre dans de l'eau pure ; j'ai observé qu'à 0° l'eau se solidifiait », ma proposition est incomplète. J'aurais dû noter d'autres circonstances, par exemple la pression atmosphérique. Si je dis : « L'eau pure se solidifie à 0° », et que je ne sous-entende pas certaines conditions, la proposition est fausse. James Thomson a trouvé que, sous la pression de 16,8 atmosphères, l'eau pure se solidifie à la température de – 0°,129. La proposition que nous venons d'énoncer, bien que fausse, prise au pied de la lettre, s'emploie couramment en physique, parce qu'on sous-entend qu'on doit faire l'expérience à la pression atmosphérique usuelle de 760 m/m, de mercure, et sous d'autres conditions bien connues des physiciens. Dans ce cas, l'énoncé de la proposition ne présente pas d'inconvénients ; mais si les conditions sous-entendues n'étaient pas bien déterminées, si elles étaient le moins du monde douteuses, cet énoncé serait à rejeter. C'est justement d'une semblable incertitude que se prévalent ceux qui veulent introduire des conditions qu'ils ne pourraient adopter explicitement.
§ 528. Les métaphysiciens s'imaginent que la science expérimentale a des propositions absolues (§ 97) ; et, de cette hypothèse, ils tirent avec raison la conséquence que, dans la proposition « l'eau se solidifie à 0° », il doit y avoir quelque chose de plus qu'un simple résumé d'expériences, qu'il doit y avoir un principe de nécessité. Mais cet édifice s'écroule, parce que ses fondements ne tiennent pas. La proposition scientifique : « l'eau se solidifie à 0°», indique seulement que cela a été observé jusqu'à présent, et que par conséquent, il est très probable qu'on l'observera à l'avenir (§ 97).
§ 529. Si quelqu'un disait : « Cette proposition ne tient pas compte du lieu où le soleil et ses planètes se trouvent dans l'espace ; il est vrai que jusqu'à présent cela n'a eu aucun effet sur la température de solidification de l'eau ; mais qui vous dit que cela n'en aura aucun à l'avenir ? », nous devrions seulement répondre : « Nous n'en savons rien » ; et nous devrions aussi donner cette réponse à qui affirmerait que le soleil, dans sa course vertigineuse, nous portera un jour dans un espace à quatre dimensions, ou bien en un lieu où les lois de la physique et de la chimie seront changées. Prenons bien garde que toute proposition scientifique doit s'entendre comme si elle était précédée de la condition : « Dans les limites du temps et de l'espace à nous connus » ; en dehors de ces limites, il y a des probabilités tantôt faibles, tantôt très fortes, mais rien de plus (§ 69-6°).
§ 530. Tandis que dans des sciences aussi avancées que la physique et la chimie, il est indispensable de faire ces restrictions, il est singulier qu'il se trouve des gens pour croire qu'elles ne sont pas nécessaires dans une science aussi arriérée que la sociologie. Mais nous ne voulons en aucune façon avoir maille à partir avec ces personnes. Nous les estimons heureuses de connaître l'essence des choses (§ 19), et de savoir les rapports nécessaires des faits ; mais nous ne pouvons nous élever à cette hauteur : nous cherchons uniquement les rapports que nous fait reconnaître l'expérience (§ 69-4°). Si ces braves gens ont raison, cela veut dire que nous trouverons très péniblement, après de longues recherches, ce qui leur a été facilement révélé par la lumière métaphysique. Si les rapports à eux connus sont vraiment nécessaires, il est impossible que nous en puissions trouver d'autres qui soient différents.
§ 531. Les métaphysiciens remarquent encore, d'habitude, qu'une expérience bien faite suffit pour établir une uniformité en chimie ou en physique, et que par conséquent il faut un principe supérieur, qui permette de tirer cette conclusion, laquelle ne résulte certainement pas de nombreux faits, puisqu'elle est tirée d'un seul. Ils se trompent complètement, car les autres nombreux faits existent : ce sont tous les autres, semblables, que l'on a déjà observés. Pourquoi suffit-il d'une seule analyse chimique pour connaître la proportion dans laquelle deux corps simples se combinent en un composé ? Parce que ce fait rentre dans la catégorie des innombrables faits qui nous ont appris l'uniformité des proportions définies. Pourquoi une observation bien faite suffit-elle à connaître le temps qui s'écoule de la conception à la délivrance, pour la femelle d'un mammifère ? Parce que ce fait appartient à la catégorie très nombreuse de ceux qui nous montrent que ce temps est constant (§ 544).
§ 532. C'est justement pourquoi, quand on rattache à tort le fait à une semblable catégorie, la conclusion est erronée. Par exemple, si, de l'observation d'un mâle et d'une femelle de phylloxéra, ou concluait que tous les phylloxéras naissent d'un mâle et d'une femelle, parce qu'on placerait ce cas parmi les innombrables autres, de génération sexuelle, on tomberait dans l'erreur ; car, au contraire, la génération des phylloxéras doit être rangée dans la catégorie des générations où l'on observe la parthénogenèse. Il n'y a aucun principe supérieur qui puisse nous guider ; il n'y a que l'expérience, qui nous enseigne qu'outre les cas de génération sexuelle, il y a les cas de parthénogenèse.
§ 533. Parmi les propositions qui affirment une uniformité, il y a celles qui donnent l'explication expérimentale d'un fait. Cette explication consiste uniquement à mettre en rapport avec d'autres faits celui qu'on veut expliquer. Ainsi, une science, la thermodynamique, explique pourquoi il y a des corps (comme l'eau) dont la température de fusion diminue quand la pression croît, et d'autres pour lesquels, au contraire elle décroît. Cette explication consiste uniquement à mettre cette propriété des corps en rapport d'uniformité avec d'autres propriétés des mêmes corps. Il n'existe pas d'autres explications scientifiques.
§ 534. C'est une façon erronée de s'exprimer que de dire : La mécanique céleste explique le mouvement des corps célestes par la gravitation universelle. La mécanique céleste a fait l'hypothèse que le mouvement des corps célestes satisfait aux équations de la dynamique, et, jusqu'à présent, les positions des corps, calculées de cette façon, se sont trouvées les mêmes que celles observées dans les limites d'erreurs possibles. Tant qu'il en sera ainsi, on tiendra l'hypothèse pour bonne ; si un jour cela n'avait plus lieu, on modifierait l'hypothèse faite.
§ 535. Voyons maintenant comment on peut utiliser les faits en sociologie, et comment on peut en tirer des uniformités. À vrai dire, c'est là le but de tout l'ouvrage : à mesure que nous cherchons et trouvons ces uniformités, nous distinguons les moyens appropriés de ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi, ici, nous n'aurions qu'à renvoyer à tout le reste du livre ; mais il est utile d'avoir une vue générale de la matière et d'en observer les grandes lignes. Tel sera justement le but des considérations suivantes.
§ 536. LES FAITS [FN: § 536-1]. Les faits nous sont connus par différentes sources que la critique historique examine et discute. Nous n'avons pas ici à nous occuper en détail de l'étude qu'elle accomplit ; nous devons seulement fixer notre attention sur certains sujets particuliers qui importent spécialement à la sociologie.
§ 537. LE NOMBRE DES FAITS. Il est évident que plus on en peut recueillir, mieux cela vaut, et qu'on obtiendrait la perfection, si l'on pouvait rassembler tous les faits passés de l'espèce considérée. Mais c'est absolument impossible, et il s'agit donc seulement de plus ou de moins.
Deux obstacles de genre différent s'opposent à ce que nous ayons un grand nombre de faits d'une espèce donnée. Pour l'antiquité, les sources nous en fournissent peu ; pour l'époque moderne, ils sont trop abondants pour être recherchés et cités tous. Les trouver tous serait un gros travail peu profitable ; et quand on les aurait trouvés, aucun éditeur ne voudrait imprimer les gros in-folio qui les contiendraient ; aucun lecteur ne les voudrait lire. À quoi bon, par exemple, rechercher dans tous les pays les récits de toutes les grèves, grandes et petites, et les reproduire par l'imprimerie dans un grand nombre de volumes ?
Pour l'antiquité, le nombre des faits étant peu considérable, l'usage moderne est de citer tous ou presque tous les auteurs qui font allusion au sujet qu'on étudie ; et c'est fort bien : il ne semble pas qu'on puisse faire autrement dans les ouvrages d'érudition. Par exemple, on procède à peu près de cette manière, dans le Manuel des antiquités romaines, de Mommsen et de Marquardt, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, et dans d'autres ouvrages analogues. Parfois, on peut faire cela pour les auteurs du moyen âge, mais on laisse de côté beaucoup de documents restés encore inédits, au fond des archives. Pour les temps modernes, c'est impossible, en raison de l'abondance des matériaux; aussi doit-on faire un choix [FN: § 537-1].
§ 538. L'IMPORTANCE DES FAITS. L'importance des faits compte plus que leur nombre ; un seul fait, bien observé et bien décrit, en vaut un très grand nombre de mal observés et mal décrits [FN: § 538-1] .
L'usage pédant des « bibliographies complètes » est devenu maintenant à la mode. Qui traite un sujet doit citer tous les auteurs en la matière, quelle que soit la valeur de leurs écrits [FN: § 538-2] . D'habitude il les cite, mais ne les lit pas, et les étudie encore moins, ne serait-ce que par manque de temps pour cette entreprise [FN: § 538-3] ; mais il en transcrit les titres dans un bel index, et plus il en met, plus il est admiré des pédants et des gens naïfs. Pour connaître les rapports entre les faits, c'est-à-dire les lois scientifiques, il vaudrait beaucoup mieux étudier, mais bien étudier, les principaux auteurs, et ne pas s'occuper des autres. Même pour connaître l'histoire d'une doctrine, il est inutile de lire tous ceux qui ont écrit sur ce sujet ; il suffit qu'on s'occupe des principaux types. On ne peut vraiment s'empêcher de trouver plaisant qu'une personne fasse une « bibliographie complète » des auteurs qui ont écrit sur la « rente », alors qu'elle ignore entièrement les phénomènes qui ont porté ce nom, et plus encore leurs rapports avec les autres phénomènes économiques.
§ 539. Comme d'habitude, nous sommes tombés dans cet extrême pour en éviter un autre, où l'on raisonnait sans citer des faits ; et entre les deux inconvénients, il vaut mieux, beaucoup mieux, citer trop de faits que n'en citer aucun ; et il est préférable aussi que le nombre des faits cités soit supérieur plutôt qu'inférieur à ce que nécessite la démonstration. Mieux vaut aussi une « bibliographie complète » d'auteurs lus à la hâte, qu'une complète ignorance des auteurs qui ont traité le sujet qu'on veut étudier.
§ 540. Laissant de côté la certitude absolue, qui n'existe pas dans les sciences expérimentales, et traitant seulement d'une probabilité plus ou moins grande, il faut reconnaître que pour beaucoup de faits historiques, elle est petite, pour d'autres grande, pour d'autres encore très grande, au point d'être égale à ce qu'on appelle certitude, dans le langage vulgaire. En ce sens, beaucoup de faits sont certains dans les grandes lignes, incertains dans les détails. Il semble certain, par exemple, que la bataille de Salamine a eu lieu ; mais il n'est pas du tout certain que, dans le détail, tout se soit passé comme le raconte Hérodote ; au contraire, si nous en jugeons par l'analogie avec d'autres récits semblables, il est très probable qu'une partie de ces détails sont erronés ; mais nous ne savons pas lesquels. Même en des temps qui sont plus rapprochés de nous, il y a lieu de faire une observation analogue. Il est certain, par exemple, que la bataille de Waterloo a eu lieu ; mais on dispute encore sur certains points particuliers de ce combat.
En suivant la méthode indiquée au § 547, il est facile de vérifier que lorsqu'on a différentes relations d'un fait, elles divergent souvent dans les détails ; et pour quelques-unes d'entre elles, nous pouvons reconnaître que les détails sont erronés (§ 649); par conséquent, l'interprétation qui les tiendrait pour exacts nous induirait certainement en erreur.
Ici, deux écueils sont à éviter : d'un côté, celui de construire des théories qui aient des faits de ce genre pour fondement principal ; souvent c'est ce qui arrive quand on recherche les origines ; de l'autre, celui de rejeter toute théorie qui ne s'appuie pas sur des faits tout à fait certains, comme semblent maintenant vouloir le faire certains pédants ; car de cette façon on rejetterait tout. Il faut s'en tenir à un juste milieu ; c'est-à-dire construire les théories avec prudence, en appréciant et choisissant les faits; et en user de même avec prudence, c'est-à-dire avoir toujours présent à l'esprit que, dans les meilleures théories, il peut toujours y avoir un peu d'erreur (§ 69-3).
Tout cela n'est pas spécial à la sociologie, mais s'applique à toutes les sciences, même les plus exactes. Celui qui emploie une table de logarithmes à sept décimales doit savoir qu'il ne connaît pas le logarithme au delà de cette limite. Il n'y a pas longtemps, on ne connaissait que grossièrement le poids atomique des corps chimiques ; maintenant, on le connaît avec une certaine exactitude ; mais on n'obtiendra jamais la précision absolue. Depuis le temps de Tycho-Brahé jusqu'à nos jours, les mesures des positions des astres ont toujours été en se perfectionnant ; mais elles étaient encore très imparfaites, au temps de Newton. Est-ce que pour cette raison, pour faire plaisir à quelques pédants, les savants auraient dû s'abstenir de créer les théories de la mécanique céleste ? Bien plus, devraient-ils continuer à s'en abstenir maintenant et toujours, puisqu'on n'a pas ces mesures absolument précises, et qu'on ne les aura jamais ?
Il y a plus. Ce fut une heureuse circonstance pour la création de la mécanique céleste, qu'au temps de Kepler les observations de la planète Mars n'aient pas été trop exactes ; si elles l'avaient été, Kepler n'aurait pas trouvé que la courbe parcourue par la planète était une ellipse, et il n'aurait pas découvert les lois du mouvement planétaire [FN: § 540-1]. Ce fut heureux aussi qu'il se mît à étudier le mouvement de Mars plutôt que celui de la lune, pour lequel les perturbations sont plus grandes.
Ce que fit alors le hasard, la méthode des approximations successives doit le faire maintenant (§ 69-80). À chaque instant, il y a des gens qui reprochent aux théories scientifiques de l'économie ou de la sociologie, de négliger certains détails [FN: § 540-2]. C'est au contraire un mérite. On doit d'abord acquérir une idée générale du phénomène, en négligeant les détails, considérés comme des perturbations ; puis envisager ces détails, en partant des plus importants et en allant successivement vers les moins importants.
§ 541. Supposons avoir un texte ou plusieurs textes d'un auteur. On peut les considérer sous trois aspects ; on peut rechercher : 1° ce que pensait l'auteur, quel était son état psychique, et comment il a été déterminé ; 2° ce que signifie un passage déterminé; 3° comment l'ont compris les hommes d'une collectivité donnée, en un temps déterminé. Au point de vue de l'équilibre social, l'importance va croissant du 1er au 3e aspect. Au point de vue objectif, le 2e est presque seul à considérer, pour autant qu'on peut établir une relation quelque peu précise entre le témoignage qu'il apporte et une réalité objective. Le 1er point de vue est personnel à l'auteur ; le 2e est impersonnel, objectif : on peut envisager le passage indépendamment de celui qui l'a écrit (§ 855); le 3e point de vue est celui des personnes qui prennent connaissance du texte considéré.
1° L'unité n'existe pas toujours dans les idées d'un auteur (§ 1545), non seulement parce qu'elles changent avec le temps, comme on peut le voir dans les Rétractations de saint Augustin et dans tant d'autres cas semblables, mais aussi parce que, spécialement dans les matières touchant le sentiment, des opinions différentes et même contradictoires peuvent se manifester en un même texte, sans que l'auteur s'en aperçoive. Donc, quand on cherche l'opinion unique qu'un auteur avait d'un certain sujet, on peut parfois chercher ce qui n'existe pas. Cette recherche est pourtant aujourd'hui à la mode, et l'on fait des études dites psychologiques sur les auteurs ; études qui ne sont fort souvent qu'un recueil d'anecdotes et de bavardages, dont on tire argument pour des conférences et des livres, fort agréables à de belles dames, qui se figurent ainsi faire une étude scientifique (§ 858, 859). Il est de même à la mode de rechercher pourquoi un auteur a écrit un certain passage ; et si l'on réussit à trouver qu'il l'a fait dans un moment de colère, provoquée par la trahison d'une maîtresse, on croit avoir découvert l'Amérique.
Il est certain que la manière de penser d'un auteur est en rapport avec les sentiments existants dans la collectivité où il vit ; aussi peut-on, en de certaines limites, de l'expression de cette manière de penser, déduire ces sentiments, qui sont les éléments de l'équilibre social. Mais il faut noter que cette opération donne de meilleurs résultats pour les auteurs ordinaires, de peu de talent, que pour les auteurs éminents, de grand talent ; c'est justement par leurs qualités que ceux-ci émergent, se séparent du vulgaire ; et par conséquent ils en reflètent moins bien les idées, les croyances, les sentiments [FN: § 541-1].
2°, Quand nous possédons le texte d'un auteur dont nous pouvons considérer le témoignage, en tout ou en partie, comme digne de foi, nous pouvons interpréter ce texte et en tirer la connaissance de certains faits. Tels sont en somme tous les documents que nous appelons historiques.
3° Outre les faits généralement racontés de cette manière, il y en a d'autres qu'il nous importe de connaître. Nous avons déjà vu, et nous verrons mieux encore dans la suite de cette étude, que les sentiments manifestés par les croyances et les idées des hommes agissent puissamment dans la détermination des phénomènes sociaux. Il en résulte que les sentiments et leurs manifestations sont, pour la sociologie, des faits aussi « importants » que les actions. Par exemple, même si la bataille de Marathon n'avait pas eu lieu, l'idée qu'en avaient les Athéniens reste un « fait » de grande importance pour la forme de la société athénienne. Thucydide nie que, comme le croyaient les gens du peuple d'Athènes, Hipparque fût tyran, lorsque Harmodius et Aristogiton le tuèrent. Mais le fait lui-même a moins d'importance pour la forme de la société athénienne, que l'idée qu'avait de ce fait le peuple d'Athènes ; et, parmi les forces agissant puissamment pour déterminer cette forme, il y avait sans doute le sentiment manifesté par les Athéniens, lorsqu'ils chantaient les louanges d'Harmodius et d'Aristogiton, qui avaient tué le tyran et rendu les Athéniens égaux devant la loi [FN: § 541-2] . On arrive ainsi à la conclusion suivante, qui semble à tort paradoxale : pour déterminer la forme de la société athénienne, il importe beaucoup moins de savoir si vraiment Hipparque était tyran quand il fut tué par Harmodius et Aristogiton, ou même si le fait est entièrement légendaire, que de connaître l'idée des Athéniens sur ce point.
La célèbre oraison funèbre des Athéniens morts à la guerre, que Thucydide met dans la bouche de Périclès, reproduit-elle, ne serait-ce qu'avec une grossière approximation, les paroles vraiment prononcées par Périclès ? Nous ne le savons pas ; et pour l'étude des mœurs athéniennes de ce temps, cela importe peu. Il est manifeste que, selon toute probabilité, Thucydide a composé ce discours en tenant compte de ces mœurs, qu'il connaissait bien. Il serait extraordinaire que, même s'il l'a inventé de toutes pièces, il l'ait composé de manière à choquer des us et coutumes qui lui étaient bien connus, ainsi qu'à tous ceux qui lisaient son œuvre.
Certaines personnes soutiennent maintenant que le Christ est un mythe solaire. Admettons-le pour un moment. Est-ce que cela diminue le rôle énorme qu'a joué le christianisme, ou mieux les sentiments manifestés sous cette forme dans la société européenne ? Sorel dit fort bien [FN: § 541-3] : « (p. 37) Ainsi, pour les stigmates de saint François nous n'avons nul besoin de savoir en quoi consistaient ces plaies ; mais nous devons chercher quelle conception le moyen âge en avait ; c'est cette conception qui a agi dans l'histoire et cette action est indépendante du problème physiologique ».
De même, le texte d'un auteur vaut, pour un temps donné et un pays déterminé, moins par ce que cet auteur a voulu dire, que par ce que les hommes de ce temps et de ce pays comprenaient quand ils lisaient le dit texte [FN: § 541-4] . Il y a une différence radicale entre un texte envisagé comme témoignage de ce qu'a observé ou compris l'auteur, et qu'on utilise dans le but de remonter justement aux choses que cet auteur a observées ou comprises, et un texte considéré comme exerçant une influence sur les individus qui en ont connaissance, et qui est employé pour connaître les idées et les actions de ces individus. Pour un texte envisagé au premier point de vue, il importe beaucoup de connaître ce que l'auteur voulait exprimer ; pour un texte considéré au second point de vue, cette recherche est presque inutile ; il importe au contraire de savoir comment ce texte est compris, même s'il est compris à rebours.
Ce n'est pas l'avis de ceux qui estiment que le texte donne la vérité absolue, et qu'on doit l'entendre seulement dans son vrai sens ; aussi recherchent-ils ce vrai sens, qui est celui qui leur plaît, et blâment-ils les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. [Voir Addition A14 par l’auteur]
§ 542. Les manifestations de la pensée sont des faits aussi bien que les actions des hommes. Les premiers faits sont, en certains cas, plus faciles à connaître avec certitude (avec une très grande probabilité), que les seconds. Il est vrai que l'on peut avoir des doutes sur la correction du texte qui est à notre disposition ; mais, sauf ce doute, nous avons sous les yeux le fait même dont nous voulons nous occuper, et nous n'en parlons pas seulement d'après ce qu'une autre personne nous rapporte. Nous connaissons beaucoup mieux, d'après nos textes, ce que Cicéron dit de certaines actions de Catilina, que ces actions mêmes.
§ 543. Pour les faits historiques ou les indications géographiques, les productions littéraires de fictions, de fables ou autres écrits semblables, ont généralement peu de valeur. Cependant, nous sommes parfois contraints par la rareté des documents à en faire usage pour les temps anciens et mal connus ; mais il faut pour cela beaucoup de prudence. Afin de nous en rendre mieux compte, employons une méthode dont il sera parlé au § 547.
§ 544. Voici un roman de Karr [FN: § 544-1] , où l'on parle de Lausanne, de Montreux, de Genève. D'une manière analogue à ce qui arrive maintenant pour la Grèce ancienne, supposons que dans deux mille ans on n'ait conservé le souvenir de Montreux que dans cet ouvrage, et que les érudits veuillent y découvrir où se trouvait cette ville, par rapport à Lausanne et à Genève. La critique démontre que l'auteur est digne de tout crédit. Il vivait quand Montreux existait ; il demeurait en un pays voisin : la France. Nous savons que les Français cultivés et aisés visitaient presque tous la Suisse ; il est donc très probable que Karr a vu Montreux, et son témoignage doit être considéré comme celui d'un témoin oculaire. D'autre part, il n'avait pas le moindre intérêt à cacher la vérité. On ne peut avoir meilleur témoignage que le sien. Un érudit fouille, étudie, médite, et trouve qu'un personnage de Karr passe par Montreux, pour aller de Lausanne à Genève. Ce pourrait être une faute d'impression, semblable aux erreurs qu'on trouve dans les manuscrits anciens ; mais ce cas est exclu par les indications que donne l'auteur : « (p. 8) Je suis arrivé vers quatre heures à Montreux; c'est un village qui, en venant de Lausanne, est (p. 9) à droite de la route qui côtoie le lac, et à quelques centaines de pas de cette route ; on y monte par un petit chemin hérissé de pierres... ». C'est donc bien la route qui va de Lausanne à Genève, et qui, lorsqu'on vient de Lausanne, a le lac à gauche, les collines à droite. Vient ensuite un autre passage qui confirme le fait et lève tout soupçon d'erreurs ou d'interpolations dans le texte. Le personnage du récit revient de Genève à Lausanne : « (p. 78) Une demi-heure après, les deux amis partirent pour Lausanne. En passant devant Montreux, qui se trouvait à gauche, sur la hauteur, Eugène demanda à y monter un instant... ». Un érudit de ce temps lointain écrira un savant ouvrage, qu'il présentera à quelque très savante académie, et démontrera que Montreux devait être entre Lausanne et Genève ; et qui sait si quelque archéologue, fort de cette indication, ne retrouvera pas les ruines de la localité indiquée ! Et pourtant, s'il est une chose certaine, c'est que Montreux se trouve au delà de Lausanne, pour qui vient de Genève, et qu'en allant de Lausanne à Genève, ou en revenant de Genève à Lausanne, on ne passe pas par Montreux.
Parmi les connaissances que nous avons ou croyons avoir de l'antiquité, plusieurs n'ont certainement pas de meilleur fondement que celui de la déduction tirée du texte de Karr ; et l'erreur certaine de celle-ci nous porte à admettre la possibilité d'erreurs analogues dans celles-là.
§ 545. Les productions purement littéraires, de fictions, de fables et autres écrits semblables, peuvent souvent avoir une grande valeur pour nous faire connaître les sentiments ; et parfois un témoignage indirect de ce genre vaut plus que beaucoup de témoignages directs. Par exemple, dans ses mimïambes, Hérondas nous donne la parodie d'un plaidoyer fait devant un tribunal. L'orateur allègue en substance que si son adversaire a amené du grain dans la cité (ou bien : si lui, orateur, n'en a pas amené), cela ne doit pas lui porter, à lui orateur, préjudice auprès des juges [FN: § 545-1] . Il est par là manifeste que c'était l'opinion commune, que les juges décidaient d'après des motifs de bienveillance ou de malveillance de ce genre, étrangers aux mérites de la cause ; autrement la parodie n'aurait pas de sens. Ce témoignage en vaut un grand nombre d'autres (§ 572).
Beaucoup de romans nous font également connaître les opinions existantes ; celles-ci correspondent souvent à certains faits, et en donnent une idée synthétique, meilleure que celle qu'on pourrait avoir de témoignages directs, nombreux et confus [FN: § 5454-2] . Quand un livre a beaucoup de lecteurs, il est assez probable qu'il se conforme à leurs sentiments, et qu'il peut, par conséquent, servir à les faire connaître [FN: § 545-3]. Pourtant il faut marcher prudemment dans cette voie, parce qu'en courant un peu trop après les interprétations, on risque de tomber en de graves erreurs.
§ 546. LES INTERPRÉTATIONS. Précisément parce que la connaissance directe des faits est très rare, les interprétations sont indispensables ; et qui voudrait absolument s'en passer pourrait aussi se dispenser de s'occuper d'histoire et de sociologie ; mais il faut rechercher quand et jusqu'où l'on peut y avoir recours avec quelque probabilité d'exactitude. Nous devons procéder à cette recherche au moyen de l'expérience, comme pour toutes les recherches de la science expérimentale.
§ 547. Une méthode qui donne en beaucoup de cas de bons résultats, est la suivante. Soit A, un fait du passé dont nous ignorons l'« explication ». Nous l'obtenons au moyen d'une certaine interprétation ; c'est-à-dire que nous mettons A en rapport avec un autre fait, B. Ensuite nous voulons rechercher si ce genre d'interprétation conduit ou non à des résultats probables. Pour cela, si nous réussissons à trouver dans le présent un fait a, semblable à A, uni d'une façon bien connue à un autre fait b, bien connu aussi et semblable à B, nous employons le moyen qui a mis en rapport A et B pour « expliquer » a. Si nous obtenons l'explication effective b, cela est favorable à l'usage de ce moyen ; et s'il nous est possible d'avoir beaucoup d'autres cas semblables, nous pouvons admettre que ce genre d'interprétation donne des résultats assez probables. Mais si, voulant expliquer a, nous ne trouvons pas b, cela seul suffit pour nous faire suspecter ce genre d'interprétation : il présente une exception et peut en avoir d'autres. Si nous en trouvons effectivement un nombre suffisant, les résultats de ce genre d'interprétation n'ont plus en leur faveur qu'une faible probabilité. Nous avons employé souvent déjà cette méthode (§ 544), et nous en userons très abondamment dans le cours de cet ouvrage ; c'est pourquoi nous nous abstenons d'en donner ici des exemples [FN: § 547-1].
§ 548. On doit en général expliquer l'inconnu par le connu ; c'est pourquoi le passé s'explique mieux par le présent, que le présent par le passé, comme l'ont fait la plupart des auteurs, aux débuts de la sociologie, et comme beaucoup continuent à le faire (§ 571).
§ 549. Une certaine interprétation des témoignages est presque toujours nécessaire, parce que celui qui rapporte un fait emploie son langage, en y mettant plus ou moins de ses sentiments ; aussi devons-nous, pour remonter au fait, dépouiller le récit de ces accessoires ; parfois ce sera facile, parfois difficile ; mais il ne faut jamais en oublier la nécessité ou au moins l'utilité. Les voyageurs traduisent selon leurs idées et dans leur langue les idées qu'ils ont entendu exprimer dans la langue des peuples qu'ils ont visités. C'est pourquoi leurs récits s'éloignent souvent plus ou moins de la vérité, et il faut, autant que possible, faire une traduction inverse pour retrouver les idées réelles des peuples dont les voyageurs nous donnent connaissance [FN: § 549-1].
§ 550. De même, dans beaucoup de cas, il est difficile de travailler pour la sociologie sur les traductions, et, quand c'est possible, il faut recourir au texte original. Comme d'habitude, il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre ; il y a de nombreux cas dans lesquels suffit non seulement une traduction, mais un simple résumé. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut voir si les conclusions dépendent du sens précis d'un ou de plusieurs termes ; dans ce cas, il est indispensable de recourir à l'original [FN: § 550-1].
§ 551. Les plus grandes difficultés que nous éprouvons à comprendre les faits d'autres peuples ou d'autres temps, proviennent de ce que nous les jugeons avec les habitudes mentales de notre nation et de notre temps. Par exemple, comme nous vivons dans des pays et à une époque où existent des lois écrites dont l'autorité publique impose l'observation, nous saisissons mal l'état des peuples chez lesquels, à nos lois, correspondaient certains usages non écrits, et dont aucune autorité publique n'imposait l'observation [FN: § 551-1]. Grâce à leurs études, les érudits vivent en partie dans le passé ; leur esprit finit par prendre un peu la couleur de ce temps ; aussi peuvent-ils en comprendre les faits mieux que les profanes. De même chez nous, la séparation est complète, en certains cas, entre le fait et le droit ; par exemple entre le fait de la propriété et le droit de propriété. Il y eut des peuples et des temps où le fait se confondait avec le droit ; puis ils se séparèrent peu à peu, par une lente évolution. Il nous est difficile d'avoir une idée claire de l'un de ces états intermédiaires.
§ 552. Mais tout cela est peu de chose en regard des difficultés qui naissent de l'intromission des sentiments, des désirs, de certains intérêts, d'entités étrangères à l'expérience, comme seraient les entités métaphysiques et les théologiques ; et c'est justement la nécessité de ne pas nous contenter de l'apparence, souvent très trompeuse, qu'ils donnent aux faits, et de remonter au contraire à ceux-ci, qui nous guide dans la présente étude, et qui nous oblige à parcourir une voie longue et pénible.
§ 553. LA PROBABILITÉ DES CONCLUSIONS. Nous avons à résoudre pratiquement un problème du genre de ceux que résout le calcul des probabilités, sous le nom de probabilités des causes. Soit, par exemple, une urne contenant 100 boules, dont une partie est blanche, une partie noire ; nous ignorons dans quelle proportion, mais nous savons que toutes les proportions sont a priori également probables. On tire une boule blanche ; il devient ainsi certain que toutes les boules ne sont pas noires ; mais toutes les combinaisons dans lesquelles entre au moins une boule blanche sont possibles. La probabilité que toutes les boules soient blanches est de blanches est de 2/101 , par conséquent très petite. La probabilité qu'il y ait au moins 50 boules blanches et de 765/1010 , c'est-à-dire environ 0,75.
Admettons que, suivant une loi hypothétique, toutes les boules devraient être blanches. L'extraction d'une boule blanche signifie la vérification de la loi, dans un cas ; cette vérification donne une probabilité très petite à la loi, soit environ deux centièmes. La probabilité que la loi se vérifie dans un nombre de cas plus grand que celui dans lequel elle ne se vérifie pas, n'est pas très grande non plus, puisqu'elle n'est que d'environ 3/4 .
§ 554. Quand on commença à étudier le calcul des probabilités, on espéra qu'il nous donnerait des normes précises pour trouver la probabilité des causes ; mais cette espérance fut trompeuse, parce que le moyen nous manque d'assimiler les cas pratiques, à l'extraction d'une ou de plusieurs boules d'une urne. Nous ignorons complètement le nombre des boules contenues dans l'urne, et ne savons que peu ou rien de la probabilité a priori des diverses combinaisons. En conséquence, le secours que nous pouvions espérer du calcul des probabilités fait défaut, et il ne nous reste plus qu'à évaluer grossièrement les probabilités avec d'autres considérations.
§ 555. Un cas extrême est celui considéré au § 531. Nous avons une urne qui, très probablement, contient des boules, toutes d'une même couleur. Une extraction suffit pour connaître cette couleur avec une très grande probabilité. Nous savons, par exemple, que très probablement tous les corps simples se combinent suivant des proportions définies. Cette propriété correspond à la propriété des boules d'être d'une même couleur. Une seule expérience suffit pour déterminer la proportion en une certaine espèce de combinaisons ; c'est-à-dire une seule extraction pour déterminer la couleur (§ 97, 531).
§ 556. Quand on peut assimiler un fait A à d'autres faits, il est a priori probable qu'il suit les mêmes lois que ceux-ci ; une seule vérification donne par conséquent une grande probabilité qu'effectivement les lois envisagées s'appliquent aussi à A (§ 531). On procède donc en notant des similitudes et en faisant des vérifications ; et c'est là une des méthodes le plus en usage pour découvrir les lois expérimentales. Ce fut ainsi que Newton, étendant par hypothèse aux corps célestes les lois du mouvement connues pour les corps terrestres, et faisant la vérification du mouvement de la lune autour de la terre, découvrit les lois du mouvement des corps célestes. Ses successeurs continuèrent à faire des vérifications, toutes avec succès, et ainsi ces lois sont aujourd'hui très probables.
Les étymologistes modernes purent observer dans les faits les changements successifs d'un mot du latin populaire, qui s'était transformé en un mot français ou italien moderne ; ils étendirent par similitude aux autres mots les lois supposées qu'ils avaient trouvées, procédèrent à des vérifications, et constituèrent ainsi la science de l'étymologie de ces langues.
Le point difficile est d'établir la similitude, parce qu'il y a toujours en cela plus ou moins d'arbitraire ; et ici comme toujours, il faut avoir recours à l'observation et à l'expérience, qui seules peuvent nous donner des renseignements sûrs. Une des erreurs habituelles des
écrivains anciens était de conclure de la ressemblance des noms à la ressemblance des choses.
§ 557. Les considérations sur la similitude peuvent donner les solutions de quelques problèmes qui paraissent paradoxaux. En voici un. Bertrand dit [FN: § 557-1] : « (p. 90) Un événement incertain n'a-t-il pas toujours une probabilité déterminée connue ou inconnue ? – Il faut se garder de le croire. – Quelle est la probabilité qu'il pleuve demain ? Elle n'existe pas... (p. 91) Le roi de Siam a quarante ans, quelle est la probabilité pour qu'il vive dans dix ans ? Elle est autre pour nous que pour ceux qui ont interrogé son médecin, autre pour le médecin que pour ceux qui ont reçu ses confidences... ». La conséquence serait que la personne qui joue une somme qu'elle gagnera si le roi de Siam meurt dans un an, n'est guidée en rien par la probabilité, puisqu'elle n'existe pas. Jusqu'à un certain point, c'est juste. En effet, celui qui assure sur la vie un homme seul fait un jeu pur et simple. Au contraire, ceux qui, comme les sociétés d'assurance, assurent un grand nombre d'hommes, exécutent une opération financière dépendant du calcul des probabilités. Il est donc vrai que celui qui veut opérer seulement d'après les probabilités, ne peut rien décider au sujet du roi de Siam.
D'autre part, si Bertrand avait été enfermé en prison, et qu'on lui eût dit : « Vous n'en sortirez que quand A ou B mourra ; vous savez uniquement que A a 20 ans et B 60 ; choisissez de la mort duquel vous voulez que votre liberté dépende » ; il est à croire qu'il aurait choisi B préférablement à A. Devrons-nous dire qu'il aurait agi au hasard, sans se préoccuper des probabilités ? En général, si un événement P, pour le cas où il se répéterait, a une plus grande probabilité que Q, dirons-nous que nous agissons au hasard quand, pour qu'une chose nous soit favorable, nous choisissons un certain P, préférablement à Q ? Oui, dirait Bertrand, puisque le choix a lieu une seule fois et ne peut se répéter. « (p. 91) Que le roi de Siam meure ou vive, il est impossible de renouveler l'épreuve ». Mais on peut en renouveler d'autres semblables, soit pour d'autres hommes de l'âge du roi de Siam, soit pour d'autres cas analogues d'événements éventuels.
Supposons que P 1 , et Q 1 , P 2 et Q 2 , P 3 et Q 3,... soient des événements entièrement différents, mais que P1 P2,... soient semblables seulement en ce qu'ils ont une probabilité plus grande que Q1, Q2,... et qu'on puisse renouveler l'épreuve. Ceci dit, je puis poser le problème : « Au cas où le choix entre P1, et Q1, entre P2 et Q2,... ne se renouvellerait pas, ai-je une plus grande probabilité d'obtenir un résultat favorable en choisissant P1 , P2,... ou bien Q1, Q2,... ? » La réponse n'est pas douteuse : il faut choisir P1 , P2 ,.... Il est clair que Bertrand aurait peut-être eu avantage à faire dépendre sa libération de la mort de l'homme de 20 ans, plutôt que de la mort de l'homme de 60 ; mais il est certain que s'il agissait également, dans tous les cas semblables, et si, dans tous les actes de sa vie, il choisissait comme favorable le parti qui serait le moins probable, au cas où l'on pourrait renouveler l'épreuve, il finirait par s'en trouver plus mal que s'il avait fait le contraire.
Bertrand résout différemment le problème. Il existe pour lui des probabilités objectives et des probabilités subjectives. Le type des premières serait une urne contenant un nombre connu de boules blanches et de boules noires, et dont on extrait une boule. Un type des secondes serait justement un fait comme la mort du roi de Siam, qui dépend de circonstances que nous ne connaissons qu'en partie. Bertrand exclut cette seconde probabilité de ses calculs.
§ 558. On en viendrait ainsi à dire qu'autant vaut ne jamais s'occuper de probabilité et agir dans tous les cas à l'aveuglette, au hasard, parce que toutes les probabilités sont subjectives ; et la distinction que voudrait faire Bertrand existe seulement en tant que quantité plus ou moins grande de connaissances.
Bertrand dit [FN: § 558-1] : « (p. 90) Il pleuvra ou il ne pleuvra pas [demain], l'un des deux événements est certain dès à présent, et l'autre impossible. Les forces physiques dont dépend la pluie sont aussi bien déterminées, soumises à des lois aussi précises que celles qui dirigent les planètes. – Oserait-on demander la probabilité pour qu'il y ait éclipse de lune le mois prochain [FN: § 558-2] ? »
Eh bien, on peut en dire autant de l'extraction qu'on est en train de faire d'une urne. Les mouvements de celui qui doit extraire la boule sont déterminés comme ceux des planètes ; la différence consiste seulement en ce que nous ne savons pas calculer les premiers et que nous savons calculer les seconds. La régularité de certains mouvements dépend du nombre et du mode d'action des forces ; et ce que nous appelons manifestation du hasard est la manifestation de nombreux effets qui s'entrecroisent. Bertrand, lui-même, en donne une preuve. « (p. XXIV) L'empreinte du hasard [cette expression manque entièrement de précision] est marquée très curieusement quelquefois, dans les nombres déduits des lois les plus précises. Une table de logarithmes en témoigne. Pour 10000 nombres successifs dans les Tables à 10 décimales de Véga, je prends la septième figure du logarithme : rien dans ce choix n'est laissé au hasard. L'Algèbre gouverne tout, une loi inflexible enchaîne tous les chiffres. Si l'on compte cependant les résultats, on aura, à très peu près, sur 10000, 1000 fois le chiffre 0, 1000 fois le chiffre 1 et ainsi des autres ; la formule se conforme aux lois du hasard [entre-croisement des causes]. Vérification faite, sur 10000 logarithmes, le septième chiffre s'est trouvé 990 fois égal à 0, 997 fois à 1, 993 fois à 2, 1012 fois à 4 ». Cela n'aurait pas lieu pour les derniers chiffres d'une table de carrés, qui, non seulement excluent certains nombres, mais encore se succèdent dans un ordre déterminé, qui est le suivant : 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. L'éclipse de lune dont parle Bertrand peut être comparée à ce second phénomène, soit à la détermination du dernier chiffre des carrés ; mais cette comparaison ne tient que si celui qui cherche à prévoir l'éclipse a des notions suffisantes d'astronomie. Pour celui qui en est dépourvu, l'éclipse de lune est un phénomène fortuit dont il ignore les uniformités. Le tirage fait dans une urne peut être comparé au premier phénomène, soit à celui observé à propos du septième chiffre des logarithmes de Véga ; naturellement pour qui a des connaissances d'arithmétique assez étendues ; autrement, quand on ignore ce que sont des carrés et des logarithmes, on ne peut rien prévoir.
§ 559. Si un fait est certain (très probable), s'il est décrit avec une très grande précision, une théorie déduite de ce fait, avec une logique rigoureuse, est aussi certaine (a une très grande probabilité). Souvent les faits sur lesquels la sociologie doit se fonder n'ont pas une très grande probabilité, et en particulier ne sont pas précis ; par conséquent, même en usant d'une logique rigoureuse, la théorie qu'on obtient d'un seul fait est peu probable ; elle l'est encore moins quand, à la logique rigoureuse, on substitue des inductions où les sentiments, le sens commun, les maximes usuelles, etc., jouent un rôle. Pour y remédier, il faut tout d'abord exclure autant que possible ces inductions, puis considérer non pas un, mais autant de faits qu'on peut, d'ailleurs toujours avec discernement, comme nous l'avons dit déjà (§ 538 et sv.).
§ 560. Rien ne contribue à augmenter la probabilité comme la possibilité de faire des vérifications directes, des expériences, au sens propre. Tel est le motif principal de la très grande probabilité des lois de la chimie et de la physique, et aussi des lois de l'astronomie. Dans ce dernier cas, l'expérience consiste à vérifier si les astres occupent réellement le lieu que leur assigne la théorie. Dans une mesure beaucoup moindre, mais toujours assez notable, on accroît la probabilité des lois qui ne sont pas susceptibles de ces vérifications, s'il est possible de montrer au moins qu'elles sont semblables à d'autres, pour lesquelles ces vérifications ont lieu.
§ 561. Le nombre des gens qui, des anciens temps à nos jours, ont affirmé avoir vu des fantômes, est énorme. Si donc les probabilités croissaient uniquement par le nombre des observations, l'existence des fantômes devrait avoir une très grande probabilité. Au contraire, peu de gens y croient aujourd'hui. Pourquoi cela ? Il ne faut pas résoudre la question en invoquant de prétendues lois naturelles qui seraient contredites par l'existence des fantômes ; parce qu'ainsi on tournerait en cercle. Si l'existence des fantômes était démontrée, ces lois ne subsisteraient plus ; elles ne sauraient donc être invoquées pour prouver l'inexistence des fantômes. On ne doit pas dire non plus qu'il faut nier les apparitions de fantômes parce qu'on ne saurait les « expliquer ». Ceux qui croient aux fantômes ou à d'autres choses analogues, répondent fort bien que ni la lumière, ni l'électricité, ni l'affinité, ne se peuvent « expliquer », et que pourtant cela ne nuit pas le moins du monde à la réalité des faits qui passent pour les manifester. La réalité d'un fait ne dépend pas de l' « explication [FN: § 561-1] » qu'on en peut donner.
§ 562. Il y a deux raisons importantes, pour lesquelles nous ne croyons pas à l'existence des fantômes (elle nous paraît fort peu probable).
1° L'expérience directe fait très souvent défaut. Si quelqu'un ne croit pas à la télégraphie sans fil, il n'a qu'à acheter un petit appareil – on en vend même dans les magasins de jouets – et il verra se produire le phénomène de cette télégraphie. Il n'est pas nécessaire qu'il y croie préalablement. Au contraire, s'il veut voir un fantôme, s'il veut invoquer le diable ou procéder à d'autres expériences semblables, il réussira ou ne réussira pas à le voir, suivant les dispositions de son esprit. « Hors d'ici, incrédules ! » dit la thaumaturgie. « Approchez, incrédules ! » dit au contraire la science logico-expérimentale.
2° Il n'y a pas de catégorie de faits à laquelle on puisse assimiler l'apparition des fantômes. Si, par exemple, il était démontré expérimentalement que le diable peut être invoqué, il y aurait certaines probabilités en faveur de l'apparition des fantômes, et vice-versa. Mais malheureusement toutes les catégories analogues à l'apparition des fantômes échappent aux vérifications expérimentales ; donc, pour le moment, l'existence de ces apparitions a une probabilité extrêmement petite.
§ 563. À la suite du cardinal Newman [FN: § 563-1], beaucoup d'auteurs ont donné une grande importance à une accumulation de petites probabilités indépendantes, pour produire en nous une conviction ayant une grande probabilité. Il y a du vrai en cela ; c'est ce que nous avons vu au sujet de l'utilité d'appuyer une théorie sur des faits nombreux et variés ; mais il y a aussi du faux, étant donné qu'on ne tient pas compte du puissant motif de conviction qui naît de la seule possibilité de faire des vérifications.
§ 564. Newman [FN: § 564-1] croit que si un Anglais est convaincu que son pays est une île, c'est seulement grâce à une accumulation de petites probabilités. Non ; il y a un motif bien plus puissant ; c'est la possibilité d'une vérification. Il n'est pas nécessaire que l'individu qui croit l'Angleterre une île ait fait lui-même cette vérification ; il n'est pas nécessaire qu'il connaisse quelqu'un qui l'ait faite ; il suffit qu'il soit possible de la faire, parce qu'on peut alors raisonner ainsi : « Quelle renommée acquerrait celui qui prouverait que l'Angleterre n'est pas une île ! que d'argent il gagnerait avec ses publications ! Si personne n'a jamais fait cela, il faut vraiment croire que c'est impossible ». Supposez qu'un prix de dix millions soit assigné à celui qui découvrirait un loup dans l'île de Wight, et qu'au bout d'un siècle, personne n'ait gagné le prix. On serait sûr sans autre, et spécialement sans l'accumulation de petites probabilités, qu'il n'existe pas de loup dans cette île. Supposez au contraire qu'il y ait la peine de mort pour celui qui dit que l'Angleterre n'est pas une île, et pour qui fait des recherches dans ce sens. Toutes les petites probabilités de Newman n'empêcheraient pas un doute de subsister : l'Angleterre est-elle bien une île ?
§ 565. Les partisans de Newman ont un but. Par cette voie indirecte, ils veulent démontrer la réalité des traditions historiques, et spécialement des traditions religieuses ; mais y croire n'est pas du tout semblable à croire que l'Angleterre est une île ; parce que la possibilité de vérifier, qui existe pour ce fait, manque pour ces traditions. Depuis nombre de siècles jusqu'à nos jours, on sait que l'Angleterre est une île. Il y a cent cinquante ans, on tenait pour vraies, dans l'histoire romaine, bien des choses qui passent aujourd'hui pour de simples légendes ; et si les déductions de Pais sont exactes, nous devrons encore ôter d'autres choses à cette histoire.
§ 566. Pour connaître les mœurs romaines, il n'y a pas d'accumulation de petites probabilités qui vaille la découverte, à Pompéi, d'une chose que tout le monde peut voir et vérifier.
§ 567. Nous avons vu (§ 541) que, suivant Thucydide, beaucoup d'Athéniens étaient dans l'erreur au sujet du meurtre d'Hipparque. Qui sait combien il existe d'autres faits semblables et combien nous tenons pour vrais de faits historiques qui peut-être sont faux ! Mais ce doute ne règne pas quant à l'existence des États américains, même pour qui n'y est pas allé et ne connaît personne qui les ait vus ; parce que la possibilité de la vérification existe, et cela suffit, si l'on tient compte du grand intérêt qu'il y aurait à démontrer l'erreur de l'opinion commune.
§ 568. Il suit de là que, pour juger de la vérité d'une théorie, il est presque indispensable qu'on puisse la combattre librement. Toute restriction, même indirecte, même lointaine, mise à qui veut la contredire, suffit pour en faire douter. Par conséquent, la liberté d'exprimer sa pensée, même quand elle est contraire à l'opinion du plus grand nombre on de tous, même quand elle froisse les sentiments de quelques-uns ou de beaucoup, même quand elle est généralement tenue pour absurde ou criminelle, tourne toujours à l'avantage de la recherche de la vérité objective (accord de la théorie avec les faits). Mais il n'est point ainsi démontré que cette liberté soit toujours favorable à la bonne organisation de la société, à l'augmentation de sa prospérité politique, économique, etc. Cela peut être ; cela peut ne pas être, suivant les cas ; c'est une question qui reste à examiner.
§ 569. Au point de vue de la recherche de la vérité expérimentale d'une doctrine, autant vaut imposer directement cette doctrine que certains principes dont on peut la déduire ainsi que d'autres. Une autorité vous impose de croire que 24 est égal à 20. Il en vient une autre qui dit : « Je suis beaucoup plus libérale ; je vous impose seulement de croire que 5 est égal à 6 ». C'est exactement la même chose ; parce que si 5 est égal à 6, deux nombres égaux multipliés par le même nombre, devant donner des produits égaux, il s'en suit que les produits de 5 et de 6 par 4 doivent être égaux, et qu'ainsi 20 est égal à 24.
§ 570. Au point de vue de la « liberté scientifique », autant vaut donc la religion catholique, qui impose directement la doctrine, que la religion protestante, qui impose seulement de la déduire des Saintes Écritures. Aujourd'hui, le « protestantisme libéral » a cru faire un nouveau pas dans la voie de la « liberté scientifique », en supprimant la croyance à l'inspiration divine de l'Écriture Sainte ; mais la croyance en un certain idéal de perfection subsiste toujours, et cela suffit pour nous chasser hors du domaine logico-expérimental. On ne peut pas non plus faire d'exception pour les dogmes humanitaires, ni pour ceux de la religion sexuelle, si chers à M. Bérenger et à ses intelligents amis. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de liberté scientifique, si l'on ne peut mettre tout en doute, y compris la géométrie euclidienne et l'espace à trois dimensions. Il est ridicule de dire qu'on veut laisser la liberté de la « vérité », non celle de l' « erreur » ; parce que la question à résoudre est justement de savoir où est la « vérité » et où est « l'erreur » ; et l'on ne peut résoudre cette question, si l'on ne peut défendre l' « erreur » et avancer en sa faveur toutes les raisons possibles. C'est seulement après que ces questions ont été bien et dûment réfutées, que le jugement porté sur l'« erreur » se confirme, jusqu'à plus ample informé. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, parce que, pour juger de la «vérité » ou de l'« erreur », elles substituent le critère du sentiment au critère logico-expérimental.
§ 571. La possibilité de faire des vérifications directes, dans le sens qu'on peut faire de nouvelles observations, est aussi un motif pour expliquer les faits du passé par ceux du présent, que nous pouvons observer tout à notre aise (§ 548).
§ 572. On a, par exemple, la proposition suivante : « À Athènes, les considérations politiques et d'intérêt des juges influaient beaucoup sur les jugements en matière d'affaires privées » (§ 545). Nous en avons des preuves directes dans les quelques plaidoyers qui nous sont parvenus. La probabilité de vérité de la proposition croît, grâce à certaines preuves indirectes, comme le seraient celles données par Aristophane et par Hérondas (§ 545-1). Mais elle s'accroît ensuite énormément par la similitude avec ce qui arrive aujourd'hui en Italie et en France. Celui qui douterait encore que la politique a beaucoup d'influence dans les procès des particuliers, peut faire, en une certaine mesure, des expériences. Qu'il lise avec soin les journaux et note les faits où cette influence apparaît ; il en trouvera plusieurs, chaque année, et verra que, pour différentes raisons, on ne peut les connaître tous. Qu'il interroge des gens qui ont la pratique de ces affaires, dans des conditions telles qu'ils soient disposés à dire la vérité, et il verra l'induction directe confirmée par voie indirecte.
§ 573. Autre exemple. Suivant certaines personnes, ceux qui nous racontent des miracles du passé, ou nous donnent des témoignages de faits surnaturels, sont toujours de mauvaise foi. Voyons ce qui arrive dans le présent : faisons des expériences. Parmi nos connaissances, il ne nous sera pas difficile de trouver des personnes que nous savons bien être de parfaite bonne foi, et qui affirment pourtant avoir été en communication avec les esprits. Notre temps est sceptique ; les temps passés étaient crédules. Le fait observé, de la bonne foi, doit donc s'être produit encore plus facilement dans le passé.
§ 574. 3e GENRE. Propositions qui ajoutent quelque chose à 1'uniformité expérimentale ou la négligent. Cherchons la façon dont les principes étrangers à l'expérience influent sur les théories qui, envisagées au point de vue objectif, sont donc celles de la IIe classe (§ 13). Considérons la partie principale du phénomène. Il convient de distinguer le cas (A ), dans lequel l'intervention d'un élément non expérimental est explicite, du cas (B ), où il est au contraire implicite. Nous disons la partie principale du phénomène, parce que, dans les cas concrets, les types peuvent se mélanger. Ici, nous recherchons simplement s'ils ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale ou s'ils la négligent. Nous retrouverons une partie de ces types aux chapitres VIII et IX, et nous étudierons les manières dont, à l'exclusion des déductions logico-expérimentales, on obtient certaines conclusions (§ 1393). Ainsi l'autorité est ici envisagée au point de vue de ce qu'elle ajoute aux uniformités expérimentales, et aux chapitres IX et X elle sera considérée quant à l'usage qu'on en fait pour imposer certaines conclusions. Il en va de même du consentement universel, de celui du plus grand nombre, des meilleurs, etc.
§ 575. Au point de vue que nous envisageons maintenant, nous classerons les types de la façon suivante.
A. Les entités abstraites recherchées sont connues indépendamment de l'expérience. Cette connaissance est supérieure à la connaissance expérimentale (§ 576 à 632).
A –α . On ne donne que peu ou point de place à l'expérience « § 582 à 612).
A – α 1. Autorité. Autorité divine, connue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs hommes. – Autorité d'un ou de plusieurs hommes (§ 583 à 590).
A – α 2. Consentements de plusieurs hommes ; ces consentements sont comptés, pesés ; ou bien consentement de l'esprit d'un être abstrait (§ 591 à 612).
A – β. L'existence des abstractions et des principes, reconnue indépendamment de l'expérience, est confirmée par elle d'une façon subsidiaire (§ 613 à 630).
A - γ. On attribue, ou l'on se figure attribuer une grande part à l'expérience, mais elle est toujours subordonnée (§ 631 à 632).
B. Les entités abstraites qu'on recherche ne sont pas explicitement dotées d'une origine étrangère à l'expérience. Ce sont de simples abstractions déduites arbitrairement de l'expérience ; ou bien elles ont une existence propre, qui, implicitement, peut être non-expérimentale (§ 641 à 796).
B – α . Les mythes, les récits religieux et autres semblables légendes sont des réalités historiques (§ 643 à 661).
B – α 1. Prises à la lettre, sans y rien changer (§ 650 à 660).
B - α 2. Avec de légers et faciles changements dans l'expression littérale (§ 661).
B – β. Les mythes, etc., renferment une part d'histoire, mêlée à une partie non réelle (§ 662 à 680).
B – β 1. Les mythes, etc., ont une origine historique, et le récit a été altéré avec le temps (§ 681 à 691).
B – β 2. Les mythes, etc., sont le produit d'expériences mal interprétées, de déductions fausses de faits réels (§ 692 à 719).
B – β 3. Les faits historiques sont des déviations d'un type, ou constituent une série ayant une limite ou une asymptote (au sens mathématique) (§ 720 à 732).
B – β 4. Les mythes, etc., sont des imitations d'autres mythes semblables. Deux ou plusieurs institutions semblables sont imitées l'une de l'autre (§ 733 à 763).
B - γ. Les mythes, etc., sont entièrement irréels « § 764 à 796).
Dans ce chapitre, nous étudierons la catégorie (A ); dans le suivant, nous nous occuperons de la catégorie (B ).
§ 576. (A). Les entités abstraites recherchées sont connues indépendamment de l'expérience. Cette connaissance est supérieure à la connaissance expérimentale. C'est en quoi consiste le principal caractère de la classe. Par exemple, si l'on tire de l'expérience le théorème d'après lequel l'évolution est unique, on fait une théorie de la classe I (§ 13). Si on l'admet a priori, on fait une théorie de la classe II. En général, dans ce cas, on ne soustrait pas volontairement ce principe au domaine expérimental ; on l'admet comme évident, et on passe outre. De cette manière, on a une théorie de la classe B. Au contraire, celui qui, par exemple, admet un droit naturel imposé par la naturalis ratio, peut bien recourir ensuite autant qu'il veut à l'expérience, sa théorie reste toujours dans la classe A, parce que la naturalis ratio est au-dessus de l'expérience, qui peut bien en confirmer les arrêts, mais jamais les contredire.
§ 577. À un moment donné, il y a une certaine distance entre le centre de la terre et le centre du soleil. Comme cette distance ne varie pas beaucoup, on peut définir une certaine distance moyenne (caractère arbitraire), et l'appeler distance de la terre au soleil. Il peut être difficile de la trouver, mais il n'y a aucun doute qu'elle existe, et nous pouvons la chercher expérimentalement.
§ 578. Au contraire, si nous cherchons qui est Jupiter, le doute naît que la chose cherchée n'existe pas. Et même si nous cherchons quelle idée les Romains avaient de Jupiter, il se peut que nous cherchions une chose qui n'existe pas ; car cette idée pourrait n'avoir pas été unique. Nous pouvons bien définir, par le procédé employé tout à l'heure, une certaine moyenne d'idées. On pourra ensuite rechercher et découvrir cette entité que nous avons créée plus ou moins arbitrairement (§ 103).
§ 579. La croyance que certaines entités abstraites existent indépendamment de l'expérience, qu'elles ne sont pas le produit d'une abstraction en partie arbitraire, est si invétérée et si évidente dans l'esprit de la plupart des gens, que la grande puissance du sentiment non-logique auquel elle correspond apparaît manifestement ; et nous découvrons déjà l'un des principes qui pourront nous fournir une classification utile des faits sociaux, en rapport avec la détermination de l'équilibre social. En outre, comme cette croyance a fait bon ménage avec le progrès des sociétés humaines, une question se pose : si cette croyance est erronée au point de vue expérimental, ne peut-elle néanmoins être utile dans la pratique de la vie des sociétés ? Pour le moment, nous ne pouvons rien décider à ce propos ; mais nous avons dû faire mention de ce doute, pour qu'on ne croie pas, comme d'habitude, qu'en rejetant cette croyance, au point de vue expérimental, nous entendons aussi la blâmer au point de vue social (§ 72 et sv., 311).
§ 580. Afin de diviser en genres les théories de la catégorie (A ), nous pouvons prendre pour critère les diverses quantités de déductions expérimentales qu'elles renferment, en partant d'un extrême (α ), où il y en a peu ou point, passer par un genre (β ), où l'expérience est mêlée à d'autres considérations, pour arriver à un autre extrême (γ ), où l'on fait dominer les considérations expérimentales, au moins en apparence.
Ici, par expériences (§ 6) nous désignons l'expérience et l'observation directes des personnes qui les rapportent. Quelqu'un pourrait nous dire qu'il fait appel à l'expérience (ou à l'observation), quand il cherche dans la Bible si le fait de toucher l'arche du Seigneur fait mourir les gens, et qu'il accepte ce témoignage sans oser le mettre en doute, le critiquer. Soit ; nous ne voulons pas discuter sur les mots ; seulement, afin de nous entendre, nous avertissons le lecteur que tel n'est pas le sens que nous donnons ici au mot expérience (et observation), qui signifie observer directement ou par l'intermédiaire de témoignages passés au crible, discutés, critiqués, si ceux qui touchent cette arche meurent ou vivent.
§ 581. Les motifs que nous avons d'accepter une opinion sont externes ou internes. Les motifs externes, outre l'expérience rigoureusement scientifique, que nous ne considérons pas ici, sont spécialement l'autorité et le consentement d'autres hommes, soit réel, soit imaginaire, avec l'intervention de l'esprit d'un être abstrait. Nous avons ainsi les deux genres (A - α 1), (A - α 2). Les motifs internes se réduisent à l'accord avec nos sentiments. Ils nous présentent d'abord des phénomènes où l'expérience n'a point part, comme seraient ceux d'une foi vive, qui en vient à proclamer qu'elle croit une chose parce qu'elle est absurde. Nous n'avons pas a nous en occuper ici, puisque nous étudions seulement les façons dont on veut faire apparaître logique ce qui est non-logique. La foi vive dont on vient de parler est non-logique ; mais on ne cherche pas à la donner pour logique. Viennent ensuite d'autres phénomènes où l'expérience peut avoir, ou paraître avoir part.
Dans le cas concret du tabou sans sanction, il y a d'abord un élément prépondérant de foi vive, grâce à laquelle on croit sans chercher de motifs ; puis on y peut voir un germe d'explication logique ; laquelle est purement verbale et se réduit à dire : « On fait ainsi, parce qu'on doit faire ainsi ». À ce point de vue, on peut la mentionner dans la catégorie (A), renvoyant une étude plus complète au chapitre IX, où nous traiterons d'une manière générale des explications que les hommes donnent de leurs actions.
Les motifs internes nous présentent des phénomènes, où l'expérience paraît avoir part ; et l'on a ainsi les genres (A-β) et (A-γ), et en outre un élément principal ou secondaire de la catégorie (B). On obtient un semblant d'expérience, soit en supposant confirmé par elle ce qui est en réalité le produit du sentiment, soit en opérant une confusion entre l'expérience objective et l'expression de nos sentiments. Ce raisonnement, poussé à l'extrême, nous donne l'auto-observation des métaphysiciens, qui prend aujourd'hui le nom d'expérience religieuse des néo-chrétiens. De cette façon, celui qui crée une théorie devient en même temps juge et partie (§ 17). Son sentiment juge la théorie que ce sentiment même a créée, et par conséquent l'accord ne peut être que parfait et l'arrêt favorable (§ 591). Il en va autrement, quand c'est l'expérience objective qui est juge ; elle peut démentir la théorie construite par le sentiment, et cela arrive très souvent. Le juge est distinct de la partie.
§ 582. (A-α). On ne donne que peu ou point de place à l'expérience. C'est en somme le fondement des théologies et des métaphysiques. Le cas extrême est celui, rappelé tout à l'heure, du tabou sans sanction, quand on dit : « On fait ainsi parce qu'on doit faire ainsi ». On ajoute ensuite des développements pseudo-logiques toujours plus abondants, jusqu'à constituer de longues légendes ou de longues élucubrations. Ces développements pseudologiques emploient largement l'autorité et le consentement des hommes, comme moyens de démonstration.
§ 583. (A- α 1). Autorité. Ici nous la considérons seulement comme un moyen de donner un vernis logique aux actions non-logiques et aux sentiments dont elles tirent leur origine. Au chapitre IX, nous en parlerons de nouveau, à un point de vue général.
La révélation divine fait partie de ce sous-genre, pour autant qu'elle n'est pas considérée comme un fait historique (B-α). De même, en font partie : l'injonction divine, la prophétie divine ; car enfin elles ne nous sont communiquées que par des hommes. En y regardant bien, on voit que dans le motif qu'on peut alléguer au sujet de la volonté divine, il y a seulement une explication de l'autorité que l'on accorde à celui qui est réputé interprète de cette volonté [FN: § 583-1]. Les adeptes de Mahomet acceptaient son autorité comme les gens cultivés d'une certaine époque acceptaient l'autorité d'Aristote. Les premiers donnaient pour motif l'inspiration divine ; les seconds, le profond savoir du Stagirite ; et c'étaient là deux explications de même nature. On comprend par conséquent comment, en des temps d'ignorance, les deux explications peuvent s'emmêler, et comment Virgile, admiré comme littérateur, devient Virgile le fameux magicien (§ 668 et sv.).
§ 584. Souvent l'autorité est donnée comme une adjonction à d'autres démonstrations. Dans ce cas, le sens en est à peu près le suivant : « Les faits que nous citons sont si connus, les raisonnements que nous faisons sont tellement persuasifs, qu'ils sont admis par tous, ou du moins par tous ceux qui sont cultivés et intelligents ». Cette manière de raisonner a été très en usage pour démontrer l'existence des sorciers, des fantômes, etc. Nous en parlerons plus loin (§ 1438 et sv.).
§ 585. Le protestant qui accepte sincèrement l'autorité de l'Écriture Sainte, le catholique qui accepte l'autorité du pape prononçant ex cathedra, manifestent le même phénomène sous une forme différente. On le voit également dans le fait de l'humanitaire qui se pâme à la lecture des œuvres de Rousseau ; ou dans celui du socialiste qui jure par Marx et Engels, dont les œuvres renferment tout le savoir humain ; ou bien encore dans celui de l'adorateur de la démocratie, lequel, s'inclinant respectueusement, soumet son jugement et sa volonté aux décisions du suffrage universel ou restreint, et même, ce qui est pis encore, à celles d'assemblées parlementaires, où l'on sait pourtant qu'il ne manque pas de politiciens peu estimables [FN: § 585-1]. Il va sans dire que chacun de ces croyants estime sa croyance raisonnable, les autres absurdes. Celui qui admet l'infaillibilité du suffrage universel, manifesté par des politiciens quelque peu véreux, ne peut contenir son indignation à la seule pensée qu'il est des gens qui admettent l'infaillibilité du pape ; et il demande qu'on leur interdise d'enseigner, parce que leur jugement n'est pas « libre » ; tandis que, à ce qu'il paraît, libre est le jugement de celui qui change d'opinion, non par conviction personnelle, mais pour obéir aux décisions d'une assemblée politique.
§ 586. Quand on s'attache seulement à la force logico-expérimentale des raisonnements, on pourrait croire que ceux qui se fournissent ainsi de postulats devraient au moins les choisir précis et aptes à des déductions rigoureuses. Mais l'expérience a démontré qu'il n'en est pas ainsi ; et cela ne doit pas surprendre les personnes qui ont quelque connaissance de la logique des sentiments (§ 514). Les postulats qui peuvent tout signifier, justement parce qu'ils ne signifient rien de précis, sont excellents pour persuader les gens ; et en effet, on observe qu'on tire de ces postulats des conclusions différentes et parfois entièrement opposées. Souvent aussi les postulats (α 1) se mêlent et se confondent avec les postulats (α 2). La partie logique est souvent meilleure dans (α 1) que dans (α 2).
§ 587. Parmi le très grand nombre d'exemples qu'on pourrait citer de conclusions opposées, tirées du même principe, les suivants suffiront; nous en rencontrerons d'ailleurs constamment (§ 873).
L'eau et le feu étant considérés comme purs et sacrés, les Hindous en déduisaient qu'il faut jeter les cadavres dans le Gange ou les brûler. Les Perses tiraient au contraire la conséquence opposée ; à savoir qu'on ne devait souiller ni l'eau ni le feu, par le contact des cadavres [FN: § 587-1]. Il paraît que dans l'Inde des Védas, l'incinération des cadavres n'était pas la règle absolue ; mais quoi qu'il en soit, l'incinération est restée la manière principale de faire disparaître les cadavres. On dépose le mort sur un bûcher édifié au milieu de trois feux, allumés aux trois feux sacrés du mort (s'il a entretenu ces trois feux), et l'on brûle le cadavre avec certaines cérémonies dont nous n'avons pas à nous occuper ici. « Comme sur la naissance, ainsi veille le feu sur les phases essentielles de la vie de l'Hindou [FN: § 587-2] ». Aujourd'hui encore, on brûle les cadavres [FN: § 587-3] . « (p. 92) Aussi-tôt que le bucher est éteint, on répand dessus du lait, et on ramasse les os épargnés par le feu. Ces os sont mis dans des vases, et on les garde jusqu'à ce qu'on trouve une occasion de les faire jetter dans quelques rivières saintes ou dans le Gange ; car les Indiens sont persuadés que tout homme dont on aura jetté les ossemens dans ce fleuve sacré, jouira d'un bonheur infini pendant des millions d'années. Ceux qui demeurent sur ses bords, y jettent même les corps entiers, après avoir souvent accéléré la mort des malades à force de leur en faire boire de l'eau, à laquelle ils attribuent une vertu miraculeuse ».
Hérodote (I 140) parle de l'usage des Perses, ou au moins des Mages, de faire dévorer les cadavres par les chiens. Une épigramme de Dioscoride dit [FN: § 587-4] : « Euphrate, ne brûle pas Philonime, et ne souille pas le feu par mon corps. Je suis Perse et de race perse indigène ; oui, mon maître. Souiller le feu est pour nous une chose grave et plus amère que la mort. Mais enveloppe-moi d'un suaire ; donne-moi à la terre. Ne répands pas d'eau sur le mort : ô mon maître, je vénère aussi les fleuves ». Chardin décrit le cimetière des Guèbres, en Perse, où les cadavres sont exposés aux oiseaux de proie et aux corbeaux [FN: § 587-5]. [Voir Addition A15 par l’auteur]
§ 588. Le défaut de précision des prémisses explique comment on en peut tirer des conclusions différentes, mais n'explique pas pourquoi on les tire ; et, dans des cas nombreux, on reste à se demander si l'autorité est source de la croyance, ou si c'est la croyance, ou mieux les sentiments qui y correspondent, qui sont la source de l'autorité. Dans un autre très grand nombre de cas, il semble qu'il y ait une suite d'actions et de réactions. Certains sentiments induisent à admettre une certaine autorité qui, à son tour, les renforce ou les modifie, et ainsi de suite.
§ 589. L'autorité peut être celle d'un ou de plusieurs hommes ; et quand bien même elle est constatée par l'observation directe, elle ne sort pas du sous-genre (α 1). Mais il faut prendre garde que souvent le consentement de ces hommes ne procède pas de l'observation directe, mais qu'on le présume, en le déduisant de certains sentiments de celui qui l'affirme. Dans ce cas, nous avons un fait du sous-genre (α 2). Cela se produit, par exemple, quand on parle du « consentement universel » ; car il est certain que personne n'a jamais pu s'en assurer auprès de tous les hommes qui ont vécu ou qui vivent sur le globe terrestre ; et il est d'ailleurs certain que le plus grand nombre de ces hommes, la plupart du temps, ne comprendraient pas le moins du monde les questions auxquelles on prétend qu'ils donnent tous la même réponse. On doit donc traduire une affirmation de telle sorte en disant : « Ce qui, selon moi, devrait avoir le consentement universel » ; ou bien : « Ce qui, selon moi, devrait avoir le consentement universel des hommes que j'estime sages, avisés, savants, etc. » ; et ce n'est pas du tout la même chose que l'affirmation précédente.
§ 590. Le principe d'autorité persiste même dans nos sociétés, non seulement chez les ignorants, non seulement en matière de religion et de morale, mais aussi en sciences, dans celles de leurs branches que l'individu n'a pas spécialement étudiées. A. Comte a bien mis le fait en lumière, quoiqu'il en ait ensuite tiré des conséquences erronées.
§ 591. (A-α 2). Consentements de plusieurs hommes ; ces consentements sont comptés, pesés ; ou bien consentement de l'esprit d'un être abstrait. On peut invoquer ces consentements pour montrer que certaines choses sont inconcevables ; par exemple une ligne droite « indéfinie ». C'est le cas de l'abstraction, scientifique ou métaphysique. Nous ne nous en occupons pas ici. Ou bien les consentements peuvent porter sur des propositions dont le contraire est parfaitement concevable ; par exemple l'existence des dieux. C'est de ces consentements que nous avons à traiter ici.
Si le consentement universel ou du plus grand nombre, ou même de quelques-uns, est explicitement invoqué comme témoignage de l'expérience, nous avons les récits de la science expérimentale, ou bien, là où le témoignage échappe à l'expérience, les récits de la catégorie (B). Ici, nous devons nous occuper uniquement des cas dans lesquels le consentement agit par sa vertu propre et se trouve placé au-dessus de l'expérience. Il peut y avoir deux choses étrangères à l'expérience : 1° le fait du consentement; 2° les conséquences du fait.
§ 592. 1° Le fait du consentement. Une statistique pourrait le constater. On interrogerait un certain nombre d'hommes, et l'on prendrait note de leurs réponses. Dans ce cas, le fait serait expérimental. Mais généralement on ne suit pas cette voie : on présume le consentement des hommes, et c'est tout au plus si on le vérifie par quelque vague recherche expérimentale ou pseudo-expérimentale. Notons que là où l'on parle du consentement de tous les hommes, la preuve expérimentale est absolument exclue, même quand tous les hommes se réduit aux hommes vivants, les morts étant laissés de côté, puisqu'il est impossible d'interroger tous les hommes qui vivent sur la terre, et qu'il serait même impossible de faire comprendre à beaucoup d'entre eux les questions auxquelles on demande une réponse. Il en va de même, si l'on parle du plus grand nombre des hommes, même si le nombre total est celui d'un pays restreint.
Pour éviter une semblable difficulté, on a l'habitude d'ajouter des épithètes, et l'on parle du consentement de tous les hommes intelligents, raisonnables, honnêtes (§ 462), ou du plus grand nombre d'entre eux ; puis, directement ou indirectement, on admet dans cette catégorie d'hommes intelligents, honnêtes, raisonnables, seulement ceux qui ont l'opinion qu'on veut gratifier du consentement universel ; et par conséquent l'on démontre par un beau raisonnement en cercle que cette opinion en jouit effectivement.
Pour que le raisonnement ne soit pas en cercle, il serait nécessaire que les qualités requises, chez les hommes dont on veut l'avis, fussent indépendantes du sens de cet avis, et qu'elles ne fussent déterminées que par des considérations générales, telles que celles de la compétence en une certaine matière. Ce serait le cas, par exemple, si l'on demandait l'avis de celui qui travaille la terre, au sujet d'une culture donnée ; l'avis de celui qui a étudié une science, à propos d'une question de cette science, etc. Mais on sort ainsi de notre sujet, pour passer à celui de l'autorité. Afin de supprimer l'inconvénient de ne pouvoir faire une statistique des consentements sans tomber dans l'erreur du raisonnement en cercle, on fait intervenir l'esprit d'un être abstrait. On ne définit pas cet esprit et l'on ne peut le définir ; c'est en somme celui de la personne qui affirme le consentement universel, qu'elle déduit du consentement de son esprit, baptisé du nom d'esprit d'un être abstrait. On a ainsi l'auto-observation des métaphysiciens et de leurs continuateurs néo-chrétiens. Des consentements comptés, qu'il est impossible de connaître, on passe ainsi aux consentements pesés avec certaines balances arbitraires, et l'on en réduit peu à peu le nombre jusqu'à les ramener à celui de la personne qui en a besoin pour démontrer sa théorie (§ 402 et sv., 427). Tout cela nous fait sortir de l'expérience, qui devrait nous faire connaître le prétendu consentement du plus grand nombre des hommes ou de tous les hommes, ou même de certains hommes déterminés par des conditions indépendantes de l'avis demandé.
§ 593. 2° Les conséquences du fait. Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus favorable au but que l'on vise, et supposons que le fait du consentement soit présenté avec une certaine probabilité par l'expérience. Comme on l'a dit déjà (§ 591), on laisse ici de côté le cas où l'on en déduit justement l'existence probable de cette expérience. D'habitude, on juge que, par sa vertu propre, le concept manifesté par ce consentement doit nécessairement correspondre à la réalité, et même, selon certains métaphysiciens, qu'il est lui-même la réalité. Même quand on se borne à affirmer une correspondance nécessaire avec la réalité expérimentale, on sort de l'expérience ; car celle-ci ne démontre pas le moins du inonde que, lorsqu'un très grand nombre d'hommes ont une opinion, elle corresponde à la réalité. Au contraire, du soleil qui se plongeait dans l'Océan, aux innombrables opérations magiques, on a l'exemple d'erreurs manifestes qui furent prises pour vérités par un très grand nombre d'hommes. Quand donc on affirme que ce qui est dans l'esprit du plus grand nombre est d'accord avec la réalité, on se soustrait entièrement à l'expérience, et semblable assertion ne peut être crue que pour des motifs non-expérimentaux (§ 42).
Ici de nouveau, le raisonnement en cercle est employé. Si l'on nous objecte qu'un très grand nombre d'hommes ont cru aux sorcières, nous répondrons qu'ils n'étaient pas intelligents ou pas éclairés ; et si l'on nous demande comment on reconnaît les hommes intelligents et éclairés, nous dirons que ce sont ceux qui croient uniquement les choses qui existent en réalité. Après cela, nous pourrons affirmer sans crainte que les idées des personnes intelligentes et éclairées correspondent toujours à la réalité (§ 441)
Si, pour éviter le raisonnement en cercle, on a recours à l'expédient déjà indiqué, quand il s'agissait de reconnaître le fait, autrement dit si l'on envisage le consentement des hommes « compétents », en déterminant cette compétence indépendamment du sens de l'avis qu'on demande, on demeure également en dehors de l'expérience, au cas où l'on affirme que cet avis est toujours d'accord avec la réalité. Tout au contraire, l'expérience démontre que l'avis des hommes « compétents » est souvent tout à fait en désaccord avec la réalité, et l'histoire de la science est l'histoire des erreurs des hommes « compétents ». On ne peut donc employer cet avis que comme indice de concordance d'une théorie donnée avec la réalité, comme apportant à cette théorie une probabilité plus on moins grande, suivant l'état de la science et la compétence de celui qui exprime l'avis ; jamais comme une preuve expérimentale de cette théorie ; preuve qui ne peut être donnée que par l'expérience directe ou indirecte ; et si l'on ne tient pas compte de cela, on sort du domaine expérimental. Le rôle de juge (§ 17), dans les sciences logico-expérimentales, revient à l'expérience ; mais l'on comprend qu'il puisse, en certains cas, être délégué à des hommes « compétents », pourvu qu'ils ne soient pas choisis en vue du sens de la réponse que l'on veut obtenir ; que la question qu'on leur propose soit exprimée avec une clarté suffisante, qu'ils agissent vraiment au nom de l'expérience, et non pour imposer une certaine foi, et qu'enfin leur verdict puisse toujours être déféré à la suprême instance de l'expérience.
§ 594. Quand ensuite on entre dans la voie qui aboutit à cette affirmation que, par sa vertu propre, le concept manifesté par le consentement universel est la réalité, qu'il crée la réalité [FN: § 594-1], on entend habituellement que ce consentement est celui, non pas d'hommes en chair et en os, mais d'un certain homme idéal ; non plus des esprits d'individus particuliers, mais d'une abstraction qui porte le nom d'esprit humain. Et comme le métaphysicien forme cette abstraction selon son bon plaisir, il est compréhensible qu'ensuite, par reconnaissance envers son créateur, elle consente à tout ce qui plaît à celui-ci. De là naissent des formules comme celle-ci: « L'inconcevable n'existe pas », ou cette autre : « Pour connaître une chose, il faut la penser ». La correspondance entre la réalité et les idées de l'esprit abstrait, qui n'est au fond que celui de l'auteur des théories, devient évidente, soit parce que ces idées sont elles-mêmes la réalité, soit parce que, dans le cas où l'on veut faire une petite place à l'expérience, l'esprit créateur de la théorie devient en même temps juge et partie (§ 581).
§ 595. Dans les cas concrets de raisonnements qui invoquent le consentement universel ou celui du plus grand nombre, on sort généralement de l'expérience, des deux façons indiquées ; c'est-à-dire en présumant un consentement qui n'est pas expérimental, et en tirant des déductions qui ne le sont pas davantage. Il faut noter en outre le caractère du défaut de précision qu'on observe dans tous les raisonnements de ce genre. On tait tout ce qui pourrait donner de la précision et de la rigueur à la théorie. On allègue le consentement universel ou celui du plus grand nombre, sans dire comment on l'a obtenu, si les avis ont été comptés ou pesés, comment et pourquoi on le présume. Très souvent, on use de formules indéfinies comme les suivantes : «Tout homme reconnaît... Tout honnête homme admet... Chaque homme intelligent tient pour certain... etc. ». On ferme volontairement les yeux sur les contradictions les plus éclatantes. Par exemple, pour prouver l'existence de Dieu à un athée, on invoque le consentement universel, sans prendre garde que l'existence même de l'athée qu'on veut convaincre ou combattre détruit l'universalité du consentement.
La proposition suivant laquelle les idées d'un certain esprit abstrait (§ 594) doivent nécessairement s'adapter à l'expérience, n'est explicitement formulée que chez quelques métaphysiciens. Habituellement, on l'admet d'une manière implicite ; en affirmant que tout le monde pense que A est B, on insinue, on suggère plus qu'on ne démontre qu'expérimentalement A sera B (§ 493).
§ 596. Tout cela est indéterminé et inconsistant, parce que si c'était déterminé et consistant, on verrait apparaître le vice du raisonnement qu'on veut donner comme logico-expérimental, alors qu'il ne l'est pas. Quand on affirme que les hommes et les animaux ont un certain droit commun, on ne dit pas précisément quelle est la chose à laquelle on donne le nom de droit; si, par les termes hommes, animaux, on veut vraiment indiquer tous les hommes et tous les animaux, ou bien si l'on fait un choix, et comment ; de quelles observations il résulte que les hommes et les animaux indiqués ont en commun la dite chose ; quelles conclusions l'on peut tirer, en science expérimentale, de l'existence, supposée vérifiée, de ce caractère commun aux hommes et aux animaux. Tout cela est et demeure voilé par un nuage, et le discours où figurent ces termes indéfinis agit seulement sur les sentiments.
§ 597. Si l'on envisage les faits intrinsèquement, il peut paraître étrange qu'il y ait eu des hommes cultivés et intelligents, pour se figurer que, de cette façon, ils arriveraient à connaître les uniformités expérimentales ; plus étrange encore qu'ils aient eu tant de disciples, que leurs théories aient été, nous ne disons pas comprises, mais admirées par un très grand nombre d'hommes ; tout à fait étrange qu'il y ait des gens qui s'imaginent comprendre les dissertations sur le « un » et sur le « multiple », des formules comme celle de Gioberti, d'après laquelle l’être crée les existences, des abstractions comme la bonne volonté de Kant [FN: § 597-1] ; laquelle (p. 13) « n'est pas telle en vertu de ce qu'elle opère, ou parce qu'elle est propre à atteindre une fin proposée, mais seulement par le vouloir, c'est-à-dire considérée en elle-même ».
§ 598. Mais puisque, loin d'être singuliers, étranges, extraordinaires, de tels faits sont au contraire communs, usités, ordinaires, il devient manifeste qu'ils doivent être l'effet d'une cause puissante et générale, et l'on se demande si nous devons la rechercher, non dans la force des raisonnements, qui est vraiment zéro, mais dans les sentiments que recouvrent ces raisonnements. Si cela était, la partie principale des théories métaphysiques résiderait dans ces sentiments, et non dans les raisonnements. C'est pourquoi celui qui s'arrête à ces derniers et juge la métaphysique par ses théories, n'agit pas autrement que celui qui voudrait juger de la force d'une armée par l'uniforme de ses soldats. Il se pourrait aussi que nous ayons là de nouveau l'un des nombreux cas où des théories erronées ont une utilité sociale ; ce qui profiterait, au moins d'une façon subsidiaire, à la durée des théories ; car l'action des sentiments reste toujours principale. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de tout cela. Envisageons maintenant les théories, principalement au point de vue de l'accord avec l'expérience. Il nous est déjà arrivé souvent de rechercher comment et pourquoi elles survivent ; nous le verrons mieux encore plus tard (chap. IX et X).
§ 599. La preuve du consentement est souvent dissimulée sous une apparence qui voudrait être et qui n'est pas expérimentale. Cela se produit généralement dans l'auto-observation. L'individu qui fait une expérience sur lui-même entend, bien qu'il ne le dise pas explicitement, qu'elle doit s'appliquer à tous les autres hommes, ou du moins aux hommes qui sont raisonnables, sages, philosophes. Par exemple, Descartes [FN: § 599-1] , expérimentant sur lui-même, commence par estimer fausses toutes les choses qu'il croyait, et ajoute : « Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulois ainsi penser que tout étoit faux, il falloit nécessairement que moi qui le pensois fusse quelque chose ; et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, étoit si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étoient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvois la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchois ». Il résulte à l'évidence de tout le discours, que notre auteur n'a pas pour but de nous exprimer uniquement ses sensations : il veut établir une proposition qui ait de la valeur pour les autres gens aussi. En y regardant bien, on voit qu'il suppose implicitement : 1° que sa proposition: je pense, donc je suis, a aussi un sens pour d'autres que pour lui; 2° que d'autres admettront cette proposition ; 3°, que la proposition ainsi admise sera quelque chose de plus qu'une illusion collective. En outre, il discute avec ceux qui pourraient repousser sa proposition ; preuve évidente qu'à son avis elle doit être acceptée par quiconque comprend et raisonne correctement. C'est la manière de faire habituelle des métaphysiciens : ils ont une idée quelconque, et, parce que la chose leur paraît être ainsi, ils prétendent que tout homme de bon sens doit être de leur avis ; cela passe à leurs yeux pour le consentement de tous les hommes de bon sens, ou d'une belle abstraction qu'ils appellent esprit humain, qu'aucun mortel n'a jamais vue ni ne saisit précisément.
§ 600. Il est souvent utile, pour dissimuler le sophisme, de s'exprimer sous la forme impersonnelle. Sans aller chercher des exemples plus loin, voici comment Descartes s'exprime : « Mais si nous ne savions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'un être parfait et infini, pour claires et distinctes que fussent nos idées, nous n'aurions aucune raison qui nous assurât qu'elles eussent la perfection d'être vraies ». Ici nous indique, sous une forme impersonnelle, les hommes. Mais ces nous ou ces hommes, qui sont-ils ? Descartes devait pourtant savoir que parmi tous les hommes vivant sur le globe terrestre, le plus grand nombre n'avait même pas la plus petite idée de sa proposition ; et que, parmi ceux qui la connaissaient, beaucoup ne la comprenaient en aucune façon, plusieurs la niaient, et un très petit nombre seulement l'acceptaient. Maintenant, reste à savoir pourquoi un homme qui n'appartenait pas à cette dernière catégorie devait admettre la proposition de Descartes ? S'il y avait une preuve expérimentale, on répondrait : « en vertu de cette preuve » (§ 44) ; mais comme il n'y a pas de preuve expérimentale, et qu'il n'y a même pas à parler du consentement, ni universel, ni du plus grand nombre de gens, ni de beaucoup, Descartes et ses disciples en reviennent à dire : « Nous avons raison... parce que nous avons raison ».
§ 601. Spinoza cherche la cause générale et première du mouvement (heureux celui qui sait ce que cela veut dire !). Il observe que nous ne devons rien admettre que nous ne percevions clairement et distinctement [FN: § 601-1] : « (p. 294) comme nous ne devons rien admettre que nous ne percevions clairement et distinctement, et que nous ne connaissons clairement et distinctement aucune autre cause que Dieu (c'est-à-dire le créateur de la Matière), il apparaît manifestement que nulle cause générale autre que Dieu ne doit être admise ». De grâce, qui sont les hommes désignés par le pronom nous ? Certainement pas tous les hommes ; cela pour les motifs indiqués tantôt. Et comme ce ne sont pas tous les hommes, comment faire pour choisir ceux qui auront l'honneur de faire partie de ce nous, et les distinguer des réprouvés qui en seront exclus ? Spinoza voit « clairement et distinctement » Dieu comme cause du mouvement. Il a bien de la chance ! Mais il y a tant de gens qui, non seulement ne voient pas « clairement et distinctement » Dieu comme cause du mouvement, mais qui ne savent même pas ce que peuvent bien être ces entités.
§ 602. On peut répéter ces observations pour un très grand nombre de propositions métaphysiques. Elles s'appliquent aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui « l'expérience du chrétien », qui n'est d'ailleurs, sous un nom nouveau, qu'une chose vieille de bien des siècles, c'est-à-dire l'auto-observation (§ 43, 69, 431).
§ 603. Le raisonnement que nous venons de faire ne concerne qu'une des faces du problème que nous avons à résoudre, au sujet de toutes les propositions semblables à celles que nous venons de noter. Il est incontestable que beaucoup de ces propositions ont été admises par des hommes instruits, intelligents, pondérés ; et si l'on veut rester dans le domaine des actions logiques, on comprend d'autant moins comment ce fait a pu se produire, que l'on démontre plus clairement l'absence de tout fondement logico-expérimental dans ces propositions. Il faut donc chercher la réponse à cette question dans un autre domaine. Ce n'est pas ici le lieu de le faire (§ 598), et il nous suffit, pour le moment, de bien comprendre que nous ne traitons là qu'une face de la question, et peut-être la moins importante au point de vue social.
§ 604. En pratique, il arrive bien rarement qu'on puisse séparer entièrement les sous-genres (α 1) et (α 2). En général, ils sont unis et se prêtent un mutuel appui ; on peut même y ajouter le genre (β). Une chose qu'on admet principalement en raison de l'autorité, se voit ensuite confirmée par l'accord de la « raison » et de l'expérience. Par exemple, l'auto-observation donne un certain principe ; on le voit confirmé par l'autorité de celui qui a fait l'auto-observation, par le consentement d'autrui, obtenu comme nous l'avons vu tout à l'heure, et parfois même grâce à des arguments pseudo-expérimentaux.
§ 605. Nous avons un autre exemple, dans la doctrine catholique. Le concile du Vatican affirme clairement que « Dieu, principe et fin de toute chose, peut certainement être connu par la lumière naturelle de la raison humaine et des choses créées... toutefois il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même et les éternels décrets de sa volonté, au genre humain, d'une manière différente et surnaturelle [FN: § 605-1] ... ». Ainsi (α 1) et (α 2) sont étroitement unis ; unis de manière qu'aucun contraste n'apparaît. On ne demande pas à l'expérience : « La foi peut-elle enseigner une chose et la raison une autre ? La réponse expérimentale serait affirmative, tandis qu'on la veut négative. Le procédé employé pour la démontrer telle est le même que celui usité par toutes les métaphysiques, ou par toutes les croyances qu'on veut imposer sans faire appel à l'expérience : il consiste à affirmer que la réponse doit être négative [FN: § 605-2], et que seule la raison qui marche d'accord avec la foi mérite le nom de raison. Nous avons ainsi une démonstration incontestable, car c'est une simple tautologie.
§ 606. Saint Thomas fait une démonstration qui est au fond celle admise par le concile du Vatican. Elle consiste à proclamer égales à la « vérité » les opérations de la raison et celles de la foi, puis à conclure qu'elles doivent être égales, puisque deux choses égales à une troisième sont égales entre elles [FN: § 606-1].
§ 607. Il est frappant que les Pères de l'Église chrétienne, dans leurs disputes avec les Gentils, cherchent les preuves de leur religion dans son accord avec les principes de la morale et principalement de la morale sexuelle. Si nous oublions pour un moment qu'en dehors du domaine expérimental, la logique est sans objet, et si nous nous laissons guider par elle, il paraîtrait que là où il y a un être tout puissant, une chose est morale, parce qu'il la veut telle, et non qu'au contraire il existe parce qu'il veut ce qui est moral. Mais si, au lieu de la démonstration logique, nous envisageons la force persuasive, nous verrons bientôt que, spécialement dans une dispute avec les Gentils, elle se trouve dans le raisonnement qui subordonne Dieu à la morale. Les Gentils avaient, en commun avec les chrétiens, certains principes moraux ; il convenait par conséquent de partir de ces principes pour les persuader de ce que voulaient les chrétiens (chap. IX et X).
§ 608. Parlant aux Gentils de leurs dieux, Tertullien dit [FN: § 608-1] : « Je veux donc rechercher s'ils (vos dieux) ont mérité d'être élevés au ciel, et non pas mieux d'être précipités au fond du Tartare qui, à ce que vous affirmez, est le lieu des châtiments infernaux ». Il leur rappelle tous les coupables qui y sont tourmentés, et qu'il affirme être égaux aux dieux des Gentils. C'est une démonstration valide et très forte, si elle s'appuie sur les sentiments ; car ceux que nous fait éprouver l'idée d'un être divin, et ceux que nous suggère l'idée d'un coupable, nous répugnent à être associés ; mais la démonstration est de nulle valeur logico-expérimentale ; car si l'on demande : « Pourquoi ceux-ci sont-ils coupables ? » on ne sait que répondre, sauf si l'on dit qu'ils le sont parce qu'ils contreviennent à la volonté divine ; mais voilà qu'ainsi nous aboutissons, comme d'habitude, à une tautologie. On peut le prouver par l'autorité même des docteurs de l'Église. Les auteurs chrétiens reprochaient aux dieux des Gentils leurs fornications. Mais pourquoi la fornication est-elle un délit ou un péché quelconque ? Saint Thomas dit que « si, chez les Gentils, la fornication simple n'était pas réputée illicite, à cause de la corruption de la raison naturelle, les Israélites, instruits par la loi divine, la tenaient pour illicite » [FN: § 608-2] . Donc, si c'est la loi divine qui la révèle illicite, comment peut-elle servir à démontrer que la loi qui la considère comme telle est divine ? De cette manière, on raisonne en cercle.
§ 609. C'est ainsi que raisonnent aujourd'hui les saints Pères de l'Église humanitaire. Ils commencent par appeler bon tout ce qui convient, et mal tout ce qui nuit au plus grand nombre, au peuple, aux prolétaires ; puis ils concluent qu'il est bon d'être utile à ces braves gens, mal de leur nuire.
§ 610. Les chrétiens pouvaient choisir entre deux méthodes pour rejeter les dieux des Gentils ; c'est-à-dire qu'ils pouvaient les considérer comme entièrement imaginaires, ou bien leur assigner une réalité qui eût sa place dans la nouvelle religion. Ils n'avaient pas à en expliquer le concept par les actions non-logiques, non seulement parce que la science était loin d'être assez avancée pour le faire, mais aussi parce que cela aurait porté un coup sérieux aux principes généraux de la foi chrétienne. En fait, les chrétiens suivirent les deux méthodes indiquées tantôt, et de préférence la seconde ; ce qui se comprend aisément, celle-ci s'accordant mieux avec une foi vive et active, qui voit partout l'action de Dieu, des anges, des démons. C'est pourquoi, même en des temps rapprochés du nôtre, le livre de Van Dale, sur les oracles, fut estimé offensant pour la religion chrétienne, et pis encore la paraphrase élégante qu'en fit Fontenelle ; c'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de chrétiens ferment les yeux aux impostures du spiritisme et de la télépathie.
Les chrétiens sentaient instinctivement que s'ils n'admettaient pas le surnaturel dans les oracles des Gentils, ils couraient le risque de voir cette théorie appliquée à leurs prophètes, et que l'une des meilleures preuves qu'on estimait pouvoir donner de la vérité de la religion chrétienne aurait été ainsi sérieusement ébranlée. Considérer au contraire les oracles comme l'œuvre des démons avait de grands et puissants avantages. On respectait ainsi le principe commun à la religion des Gentils et à celle des chrétiens, suivant lequel il pouvait y avoir des prophètes et des oracles, et l'on faisait ensuite un triage des bons et des mauvais. Inutile d'ajouter que pour chacun les bons étaient les siens, les mauvais ceux des autres ; œuvre de Dieu, les premiers ; œuvre des démons, les derniers.
Le même fait se répète pour les miracles. Ni les Gentils ni les chrétiens ne niaient que les miracles fussent possibles ; mais chacun estimait les siens vrais, ceux des adversaires faux ; et les chrétiens ajoutaient que le démon singeait les miracles divins. Il ne faut pas oublier que, pendant nombre de siècles, les hommes se sont complus à ces raisonnements, qui, après tout, ne sont pas plus mauvais que tant d'autres aujourd'hui à la mode.
§ 611. De nos jours, une nouvelle croyance, qui conserve le nom de christianisme, veut se substituer au christianisme traditionnel, en repoussant le surnaturel qui, pendant tant de siècles, en fut une des parties principales, et qui se trouve dans l'Évangile [FN: § 611-1]. Elle se manifeste principalement dans le protestantisme dit libéral, et d'une façon secondaire dans le modernisme. De même que le christianisme ancien gardait les traits principaux de la morale païenne, en en modifiant la théologie, et se prévalait précisément de la morale commune pour justifier ce changement, ainsi le néo-christianisme conserve la morale de l'ancien christianisme, en en modifiant la théologie, et en se prévalant de la morale commune, pour justifier ce changement. Si Jupiter a été détrôné par le Dieu des chrétiens, la divinité de Jésus-Christ disparaît maintenant, pour faire place à celle de l'Humanité, et Jésus est révéré seulement parce qu'il représente « l'homme parfait ». Le consentement universel révélé par l'expérience intime du chrétien est l'artisan de cette transformation. Les braves gens qui s'en servent ne s'aperçoivent pas qu'ils ne trouvent dans l'Évangile que ce qu'ils y mettent, et qu'ils pourraient tout aussi bien tirer leurs théories de l'Énéide de Virgile ou de quelque autre livre semblable.
§ 612. Cet excellent Platon a une manière simple, facile, efficace, d'obtenir le consentement universel, ou, si l'on veut, celui des sages : il se le fait accorder par un interlocuteur de ses dialogues, auquel il fait dire ce qu'il veut ; en sorte que ce consentement n'est au fond que celui de Platon, et qu'il est admis sans peine par ceux dont il flatte l'imagination. Quand, par exemple, dans le Théétète, Socrate demande : « Le mouvement n'est-il donc pas une bonne chose pour l'âme et pour le corps, et l'opposé le contraire [FN: § 612-1] ? » Platon fait répondre par l'interlocuteur, Théétète : « Il semble ». Mais s'il y avait un autre interlocuteur, il pourrait répondre, au contraire: « Je ne sais, Socrate, ce que tu veux dire par ce galimatias » ; et alors adieu le consentement universel, celui des sages, de la raison humaine, ou tel autre qu'on voudra bien imaginer.
Il faut pourtant observer que Platon ne soumet pas directement ses théories au consentement universel. Au contraire, il paraît dédaigner les jugements d'un grand nombre d'hommes, si ces jugements sont seulement comptés et non pesés [FN: § 612-2]. Le consentement qu'il suppose lui être donné par son interlocuteur représente le consentement d'un esprit abstrait, et ne sert qu'indirectement à constituer la théorie de Platon [FN: § 612-3] ; il est comme un bloc de marbre brut, dont Platon saura plus tard former une statue. De cette façon, il atteint le but, qui est de confondre le consentement universel avec celui de l'esprit abstrait, qui n'est après tout que le sien propre.
§ 613. (A-β). L'existence des abstractions et des principes, reconnue indépendamment de l'expérience, est confirmée par elle, d'une façon subsidiaire. Comme nous l'avons vu déjà, il est malaisé d'abandonner entièrement le domaine expérimental, et l'on cherche tôt ou tard à y revenir, parce qu'en fin de compte la pratique de la vie l'emporte sur toute autre chose. Aussi la théologie et la métaphysique ne dédaignent-elles pas entièrement l'expérience, pourvu qu'elle leur soit subordonnée. Elles se complaisent à montrer que leurs déductions pseudo-expérimentales sont vérifiées par les faits ; mais le croyant et le métaphysicien savaient déjà, avant toute investigation expérimentale que cette vérification devait réussir à merveille, parce qu'un principe supérieur ne permettait pas qu'il pût en advenir autrement. Par leurs recherches dépassant la contingence expérimentale, ils satisfont le besoin, vif et même prédominant chez beaucoup, de connaître, moins ce qui a existé ou existe que ce qui devrait, ce qui doit nécessairement exister ; tandis qu'en montrant qu'ils tiennent compte de l'expérience – bien ou mal, cela importe peu – ils évitent le reproche de marcher au rebours du progrès scientifique, ou même du simple bon sens. Mais les faits dont ils tiennent compte sont choisis dans un but déterminé, et n'ont d'autre emploi que de justifier une théorie déjà préconçue dans l'esprit de son auteur ; non pas que celle-ci ait besoin de cette justification, mais uniquement par surabondance de preuves. Parfois, la part de l'expérience est très restreinte ; parfois elle paraît grande ; mais toujours entre ces limites et dans ces conditions. Les doctrines de A. Comte et de Herbert Spencer sont les types de ce dernier cas.
§ 614. Les disciples des auteurs de ces théories les estiment parfaites. Il ne peut en être autrement, parce que leurs connaissances intellectuelles et leurs sentiments sont conformes à ceux de leur maître, et parce que rien ne leur paraît pouvoir être objecté à une doctrine qui, non seulement satisfait l'esprit et les sentiments, mais a de plus l'appui de ces pseudo-vérifications expérimentales.
§ 615. À un point de vue non plus strictement logico-expérimental, mais didactique, et en vue de faire progresser la science, ces doctrines peuvent être utiles. Elles constituent une transition entre les théories qui ont pour unique fondement une foi aveugle, ou même des concepts exclusivement théologiques, métaphysiques, éthiques, et les théories nettement expérimentales [FN: § 615-1]. Des premières aux secondes la distance est trop grande pour pouvoir être franchie d'un saut : il faut un pont. C'est déjà beaucoup d'obtenir que l'homme accorde une petite place à l'expérience, et ne s'en tienne pas exclusivement à ce qu'il trouve ou croit trouver dans sa conscience. Même quand on admet l'expérience seulement comme une vérification a posteriori, un pas très important est ainsi fait ; si important que beaucoup de gens ne l'ont pas encore fait, à commencer par ceux qui croient pouvoir tirer des songes les numéros du loto, jusqu'aux fidèles de l'impératif catégorique.
§ 616. Une fois l'expérience introduite n'importe comment dans l'édifice théologique et métaphysique, celui-ci se désagrège peu à peu, toujours, cela s'entend, en ce qui concerne la partie qui se rattache au monde expérimental, car l'autre est à l'abri des coups de l'expérience. La désagrégation finirait par s'accomplir jusqu'au bout, sans l'intervention d'un fait très important : l'utilité sociale de certaines doctrines expérimentalement fausses. Nous aurons à nous en occuper longuement plus loin (chap. XII); pour l'heure, nous excluons entièrement cette considération, de la matière que nous traitons. Mais cet aperçu était nécessaire pour faire comprendre comment l'édifice théologique et métaphysique a pu tomber en ruine, du moins en grande partie, dans les sciences naturelles, tandis qu'il résistait plus longtemps dans les sciences sociales, et qu'il résistera peut-être toujours dans la pratique sociale. Les hommes en ont tellement besoin, que s'il arrive à l'un de ces édifices de tomber en ruine, aussitôt on en reconstruit un autre avec les mêmes matériaux. C'est ce qui est arrivé à l'égard du positivisme, qui est en somme une des très nombreuses espèces de métaphysique. L'ancienne métaphysique s'éclipsa pour peu de temps, et reparut bientôt sous la forme du positivisme. Maintenant, celui-ci menace ruine à son tour, et, pour le remplacer, on est en train d'élever un autre édifice métaphysique. Le fait se produit parce que les hommes s'obstinent à ne pas vouloir séparer ce qui est d'accord avec l'expérience, de ce qui est utile aux individus ou à la société, et à vouloir diviniser une certaine entité à laquelle ils ont donné le nom de « Vérité ». Soit A, l'une de ces choses utiles à la société. Elle nous est conseillée, imposée par une certaine doctrine ou une foi P, qui n'est pas expérimentale, et qui souvent ne peut l'être, si l'on veut que la plus grande partie des hommes d'un pays donné l'adoptent. Elle domine durant un temps plus ou moins long. Ensuite, si la science expérimentale a ou acquiert quelque crédit, des gens se mettent à affirmer que la doctrine ou la foi doit être d'accord avec l'expérience. Ils y sont poussés, souvent sans s'en apercevoir, par la considération de l'utilité. D'autres gens attaquent cette assertion, la combattent, la tournent en ridicule. Mais comme on ne peut se passer de la chose A, une partie de ces gens substitue simplement à la doctrine ou à la foi P, une autre doctrine, une autre foi Q, qui, elle aussi, est en désaccord avec l'expérience, comme la doctrine ou la foi P. Ainsi les années et les siècles s'écoulent ; les nations, les gouvernements, les coutumes et les façons de vivre passent, et, à chaque instant, de nouvelles théologies métaphysiques surgissent successivement, chacune étant réputée beaucoup plus « vraie »,beaucoup « meilleure » que celles qui la précédèrent. Il se peut qu'en certains cas elles soient effectivement « meilleures », si, par ce terme, on entend plus conformes à l'utilité de la société ; mais plus « vraies », non, si par ce terme on désigne l'accord avec la réalité expérimentale. Il n'y a pas de foi plus scientifique qu'une autre (§ 16). Sous le rapport de la réalité expérimentale, on peut mettre au même rang le polythéisme, le christianisme, qu'il soit catholique, protestant, « libéral », moderniste ou de quelle autre secte on voudra, l'islamisme, les innombrables sectes métaphysiques, y compris les kantiennes, les hégéliennes, les bergsoniennes, et, sans oublier les doctrines positivistes de Comte, de Spencer et de tant d'autres hommes éminents, la foi des solidaristes, des humanitaires, des anticléricaux, des adorateurs du Progrès, et tant d'autres qui ont existé, qui existent, qui existeront, ou qu'on pourrait simplement imaginer. Jupiter optimus maximus échappe aussi bien à l'expérience que le Dieu de la Bible, que le Dieu des chrétiens ou des mahométans, que les abstractions du néo-christianisme, que l'impératif catégorique, que les déesses Vérité, Justice, Humanité, Majorité, que le dieu Peuple, le dieu Progrès et tant d'autres qui peuplent en nombre infini le panthéon des théologiens, des métaphysiciens, des positivistes, des humanitaires ; ce qui n'empêche pas que la croyance en une partie d'entre eux, ou même en tous, ait pu être utile en son temps, ou puisse l'être toujours. Là-dessus, on ne peut rien décider a priori, et il appartient à l'expérience seule de nous instruire.
La métaphysique de l'éthique bourgeoise a été attaquée et démolie par la métaphysique de l'éthique socialiste ; laquelle, à son tour, a eu à subir l'assaut de la métaphysique de l'éthique syndicaliste. De cette lutte, il est resté quelque chose qui nous fait approcher du concept expérimental qu'on peut avoir de ces éthiques ; c'est-à-dire qu'on en a vu plus ou moins distinctement le caractère contingent. En partie parce qu'elle s'appuyait sur la religion, la morale bourgeoise assumait un caractère de vérité absolue, qu'elle a perdu partiellement depuis un siècle, après avoir eu d'heureuses rivales.
§ 617. Dans les sciences naturelles, la désagrégation se poursuit avec de simples oscillations, dues au fait que les hommes qui cultivent ces sciences vivent aussi dans la société, et que les opinions, les croyances, les préjugés de leur société agissent plus ou moins sur eux. L'expérience, qui autrefois avait timidement commencé à poindre dans les sciences naturelles, y est aujourd'hui reine et maîtresse, et en chasse les principes a priori qu'on voudrait lui opposer. Cette liberté de la science nous paraît naturelle, parce que nous vivons en un temps où elle est admise presque partout ; mais il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a à peine deux siècles, et même moins, un savant ne pouvait parler de sa science sans protester qu'il recourait à l'expérience uniquement en ce qui n'était pas matière de foi. Il était alors utile qu'il prît cette position subordonnée, car c'était l'unique moyen d'introduire l'ennemi dans la place forte qui devait plus tard être détruite.
§ 618. Dans les sciences qui ont quelque rapport avec la vie sociale, on n'a pas encore la liberté dont on jouit dans les sciences naturelles. Il est vrai que si l'on excepte la religion sexuelle [FN: § 618-1] , le bras séculier ne frappe plus guère les hérétiques et les mécréants, du moins d'une manière directe ; mais ils sont en butte à l'indignation et à l'hostilité du public, qui veut sauvegarder certains principes ou préjugés ; ce qui est toutefois souvent utile au bien-être social. Indirectement, l'autorité publique fait sentir le poids de son hostilité à ceux qui, même seulement au point de vue scientifique, s'écartent des dogmes du gouvernement existant [FN: § 618-2].
§ 619. La méthode « historique » a ouvert la porte par laquelle l'expérience s'est introduite dans une partie des sciences sociales, dont elle était exclue. Ce fut donc une transition, utile au point de vue exclusivement logico-expérimental, pour rapprocher ces sciences de l'état déjà atteint par les sciences naturelles. La confusion qui existe dans l'esprit de beaucoup de personnes entre la méthode historique et la méthode expérimentale est remarquable [FN: § 619-1]. Quand, ce qui arrive rarement, la première est à l'état pur, et sans mélange de considérations métaphysiques, sentimentales, patriotiques, etc., elle n'est qu'une partie de la seconde : elle a seulement pour but d'étudier une partie des rapports qu'on trouve dans le domaine de celle-ci ; c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'évolution, de la manière dont certains faits succèdent à d'autres ; mais elle néglige les rapports qui existent à un moment donné entre les faits qui se produisent à ce moment et les uniformités auxquelles ils donnent lieu souvent aussi les rapports des faits successifs et leurs uniformités presque toujours les dépendances mutuelles de tous. Quand nous saurons de quelle plante vient le blé, et quelles transformations elle a subies, et que nous connaîtrons aussi l'origine de l'homme et ses transformations, il nous restera à connaître les quantités de blé que l'homme tire d'un hectare de terrain, en un pays et en un temps donnés, et le nombre infini de rapports existant entre cette culture et les faits de la vie humaine. Quand nous connaîtrons l'histoire de la monnaie, cela ne nous apprendra pas son rôle précis dans le phénomène économique, et encore moins la dépendance de l'usage de la monnaie, et des autres faits économiques et sociaux. Quand nous aurons une connaissance parfaite de l'histoire de la chimie, cela pourra nous être utile, mais ne suffira pas à nous faire connaître les propriétés de nouvelles combinaisons (§ 34, 39).618-
À la méthode métaphysique, en économie politique ou en sociologie, il ne faut pas croire que s'oppose la « méthode historique », même si, par un singulier hasard, cette méthode historique est à l'état tout à fait pur. Au contraire, c'est avec la méthode expérimentale que le contraste a lieu.
§ 620. Parmi les vérifications pseudo-expérimentales des théologies, on trouve souvent les prophéties et les miracles [FN: § 620-1].
Il va sans dire que chaque religion n'estime bonnes que ses prophéties, et vrais que ses miracles ; tandis qu'elle tient pour très mauvaises les prophéties et pour faux les miracles des autres religions. Il est inutile d'observer que, même si les faits étaient historiquement vrais – et ce n'est pas le cas – ils ne prouveraient rien, au point de vue logico-expérimental, à l'égard de la partie surnaturelle de la religion. Ce n'est pas dans une démonstration logico-expérimentale [FN: § 620-2] qu'on doit chercher le motif pour lequel les prophéties et les miracles contribuent puissamment à fortifier la foi, même si, pour assurer que les premières se sont vérifiées, on recourt à de prodigieuses subtilités d'interprétation, et si les seconds sont dépourvus de toute preuve historique sérieuse. Ce motif consiste principalement dans l'accroissement d'autorité que ces faits – ou ces fables – procurent aux hommes qui passent pour en être les auteurs.
§ 621. Des miracles, il s'en est toujours fait et il s'en fait toujours, même de notre temps, avec la télépathie et autres opérations semblables. Nous ne manquons pas non plus de prophètes religieux, particulièrement en Amérique et en Angleterre. D'autres, plus modestes, se contentent de deviner l'avenir des personnes qui ont recours à leurs lumières, ou de prévoir certains événements de moindre importance. On peut lire, en quatrième page des journaux italiens, les élucubrations des prophètes qui, mus par une ardente philanthropie, non exempte du soin de leur propre intérêt, font connaître à autrui les numéros du loto aux prochains tirages. Il y a bien une trentaine d'années qu'on lit ces avis, et il se trouve toujours des gens pour croire à ces prophéties ; preuve en soient les dépenses que font ces dignes prophètes pour les insertions dans les journaux ; car si les recettes ne couvraient pas au moins les frais, ils y renonceraient certainement.
§ 622. Songez que nous vivons en un temps quelque peu sceptique, que les prophéties exprimées au moyen des nombres du loto ne souffrent aucune subtilité d'interprétation, qu'entre le moment où la prophétie est faite et celui où elle doit se vérifier, il s'écoule un espace de temps très bref : vous vous rendrez compte alors que si, nonobstant ces circonstances très défavorables, la foi aux prophéties persiste, elle devait à plus forte raison se maintenir vive et forte, en des temps superstitieux, pour des prophéties faites en termes obscurs auxquels on pouvait donner le sens qu'on voulait, et qui étaient à longue échéance.
§ 623. Galluppi écrit, dans sa Théologie naturelle [FN: § 623-1] : (p. 60, § 43) « On doit penser que si Dieu choisit et envoie réellement des hommes pour prêcher aux autres, en son nom, les vérités qu'il leur a immédiatement révélées, il ne manque pas de donner à ces apôtres et envoyés, tous les moyens nécessaires pour démontrer l'authenticité de leur mission [Autorité]. Dieu doit cela à lui-même, aux apôtres qu'il envoie et à ceux auxquels ils sont envoyés [Preuve par conformité de sentiments. Galluppi pensait ainsi, donc cela doit être ainsi]. Mais quels sont ces moyens ? Ce sont les miracles et les prophéties... La prophétie est la prédiction certaine des événements futurs, qui ne peuvent être prévus par les hommes dans les causes naturelles... Dieu peut donc donner à ses apôtres le don de faire des miracles en son nom, et le don de prophétie. Quand donc ceux qui s'annoncent comme apôtres de Dieu manifestent aux hommes des dogmes non contraires aux principes de la droite raison et tendent à la gloire de Dieu et au bonheur des hommes, quand ils font des miracles pour prouver la vérité de la doctrine qu'ils annoncent, ils ont suffisamment prouvé leur mission ; et les hommes auxquels ils s'adressent sont obligés de les accueillir comme divins, et de recevoir les vérités qu'ils leur manifestent ». La droite raison sert ici de défense pour repousser les Gentils, qui ont, eux aussi, des prophéties et des miracles à foison. Mais les leurs sont contraires aux principes de la droite raison, et ceux des chrétiens n'y sont pas contraires. Pourquoi ? Devinez. Plus loin : « (p. 61) Rigoureusement parlant, la prophétie est un miracle ; car c'est une connaissance non naturelle, mais au delà des forces naturelles de l'esprit humain. Toutefois, la prophétie peut se rapporter à des événements très lointains, et le prophète peut n'avoir pas le don des miracles. La prophétie seule n'est donc pas toujours suffisante pour prouver la mission divine. Mais le miracle par lequel un apôtre divin promet aux hommes de prouver sa mission divine, est toujours uni à une certaine prophétie... Les signes de la révélation divine sont donc au nombre de trois : l'un intrinsèque : c'est la vérité et la sainteté de la doctrine qu'elle enseigne [accord avec certains sentiments] ; les deux autres sont extrinsèques [pseudo-expérimentaux] : ce sont les miracles et les prophéties... ».
§ 624. Calvin veut que l'Écriture Sainte renferme en elle-même toute l'évidence de son inspiration divine [FN: § 624-1] ; autrement dit, il paraît recourir exclusivement à la foi ; et s'il restait sur ce terrain, la science expérimentale ne pourrait rien lui objecter au sujet de la partie intrinsèque de sa doctrine. Seulement, à propos de la partie extrinsèque, il faut observer que la doctrine de Calvin ne démontre rien et ne peut être acceptée que par celui qui la professe déjà. Au point de vue expérimental, les affirmations de Calvin ont tout autant de valeur que les négations de l'un quelconque de ses contradicteurs [FN: § 624-2]. Le bon Calvin ne l'entend pas de cette oreille et reprend bientôt ce qu'il avait abandonné [FN: § 624-3]. C'est l'habitude générale des théologiens et des métaphysiciens. Ils quittent le monde expérimental, quand l'expérience encombre la voie qu'ils veulent suivre pour établir leurs croyances ; mais quand ils les ont fixées, ils reviennent au monde expérimental, qui, en fin de compte, leur importe comme à tout autre homme ; et le mépris qu'ils ont affiché n'est qu'un artifice pour éviter des objections auxquelles ils ne sauraient répondre.
§ 625. L'embryon d'expérience que les catholiques trouvaient dans le consentement des Pères de l'Église, gênait Calvin. Il s'en débarrasse en prétendant que chacun doit croire à l'Écriture Sainte, par conviction intime. Et ceux qui n'y croient pas ? Il vous les fait brûler comme le pauvre Servet ; ou bien, s'il ne peut faire autre chose, il les injurie [FN: § 625 note 1)]. Ce peuvent être d'excellents moyens de persuasion, mais leur valeur logico-expérimentale est proprement zéro.
§ 626. Le néo-christianisme semble maintenant vouloir négliger plus ou moins, et peut-être en entier, les éléments extrinsèques, pour ne s'en remettre qu'aux éléments intrinsèques ; ce qui améliorerait beaucoup sa logique si, après être ainsi sorti du domaine expérimental, il ne voulait pas y rentrer en dictant des règles à la vie sociale. De cette façon, toute preuve se réduit à l'accord avec les sentiments de celui qui prêche une certaine doctrine ; mais personne ne nous dit pourquoi ni comment les dissidents doivent l'accepter. En réalité, le succès de cette doctrine est dû à un accord avec les sentiments démocratiques ; elle est le voile dont certaines personnes – un petit nombre – ont plaisir à couvrir ces sentiments.
§ 627. Par ces doctrines, on croit de bonne foi donner, ou quelquefois l'on feint de donner une large part à l'expérience [FN: § 627-1] ; mais, en réalité, on ne fait que passer du genre (α 1) au genre (α 2). On abandonne l'autorité, parce qu'elle semble trop en conflit avec l'expérience. On recourt au consentement intérieur, parce que sa contradiction avec l'expérience apparaît moins ; mais elle n'en est pas moins profonde.
§ 628. Par exemple, après avoir reconnu et mis en lumière les erreurs de la Bible, Piepenbring veut cependant qu'elle renferme une partie divine ; et, pour la distinguer de l'autre, il est contraint de recourir exclusivement au consentement intérieur. Il dit [FN: § 628-1] : « (p. 307) Peut-on distinguer, dans la Bible, les éléments humains des éléments divins, les erreurs humaines de la vérité divine ? Peut-on dire que telle parole ou tel texte biblique est inspiré et que tel autre ne l'est pas? Non. Ce procédé serait bien mécanique et superficiel ; il serait en outre irréalisable... (p. 308). Ce n'est pas dans la lettre morte qu'il faut chercher l'inspiration et la révélation, comme le veut cette doctrine, mais dans l'action directe de l'esprit de Dieu sur les cœurs ». Voilà clairement indiqué le passage de (α 1) à (α 2). L'auteur continue : « (p. 308) Nous venons de présenter comme un fait indéniable que cette partie de l'Écriture renferme des erreurs. Celui qui s'occupera exclusivement de critique sacrée, au lieu de tenter la reconstruction historique de l'enseignement biblique, comme nous l'avons fait, pourra constater des erreurs bien plus nombreuses que celles qui ont été indiquées en passant... Le fait que nous avons avancé est donc pleinement fondé. Mais en voici un autre qui, nous paraît-il, l'est tout autant, c'est que l'élite de la nation israélite – en tête de laquelle se trouvaient les prophètes, les psalmistes, les auteurs sacrés en général – était sous l'influence de l'esprit de Dieu, qui lui communiquait une vie et des lumières supérieures, dont nous trouvons l'expression, la traduction, imparfaite mais réelle, dans l'Ancien Testament ».
§ 629. Il se peut bien que les deux faits soient également certains ; mais il est assuré que les preuves qu'on en peut donner sont de nature essentiellement différente. Du premier fait, c'est-à-dire des erreurs historiques et physiques, on donne des preuves objectives que tous peuvent vérifier. Du second fait, on donne des preuves subjectives ; elles n'ont de valeur que pour les quelques personnes qui ont des sentiments semblables à ceux de l'auteur. N'importe qui peut vérifier que le procédé employé par Jacob pour faire naître des agneaux tachetés ne réussit pas du tout ; et il n'est pas nécessaire d'avoir certains sentiments pour trouver que la zoologie biblique ne concorde pas avec les faits. Au contraire, il y a un très grand nombre de personnes qui ne partagent pas le moins du monde l'admiration de notre auteur pour les prophètes israélites, et qui estiment inférieures les lumières que notre auteur trouve supérieures. Comment faire pour savoir qui a raison ? et même que veut dire, dans ce cas, avoir raison ?
§ 630. Tout cela montre combien est erronée l'idée de ceux qui tiennent ces doctrines et d'autres semblables, pour plus « scientifiques » que des doctrines qui, à l'instar du catholicisme, ont l'autorité pour fondement (§ 16, 517). En réalité, on disserte des diverses manières de recourir à ce qu'on présume être – et qui n'est pas – la « science ». Cette différence est générale, et nous la trouvons dans beaucoup d'autres théories. Quelques-unes demandent une vérification à la réalité historique, et façonnent cette réalité de manière à lui faire signifier ce qu'elles veulent. D'un côté, on peut dire qu'elles reconnaissent la valeur et l'importance de cette réalité historique, puisqu'elles y font appel. D'un autre côté, on peut dire qu'elles la méconnaissent, puisque, même involontairement, sans s'en apercevoir, elles l'interprètent et l'altèrent. D'autres théories laissent de côté les vérifications au moyen de la réalité historique, et s'attaquent seulement à celle de la conscience. D'un côté, on peut dire qu'elles méconnaissent la valeur de cette réalité historique, puisqu'elles ne s'en occupent pas, dans la démonstration de leurs théorèmes. D'un autre côté, on peut dire qu'elles la respectent, puisqu'elles ne se proposent pas de l'interpréter et de l'altérer.
§ 631. (A-γ). On attribue, ou l'on se figure attribuer une grande part à l’expérience, mais elle est toujours subordonnée. Par degrés insensibles, on passe du genre précédent à celui-ci, où l'expérience paraît être souveraine, mais où son pouvoir, semblable à celui des rois constitutionnels, se réduit à peu de chose. Les théories concrètes renferment généralement des parties se rattachant à ces deux classes. Il est souvent malaisé de séparer ces parties, pour cette raison, entre autres, que l'auteur n'indique pas, et fréquemment ne sait lui-même pas, si certains principes par lui adoptés, sont supérieurs à l'expérience ou lui sont subordonnés. Pour ne pas faire deux fois l'examen d'une même théorie, nous parlerons de ce genre (γ) au chapitre suivant, où nous devons justement étudier la classe B.
§ 632. Nous procédons ainsi seulement pour une raison pratique. Cela n'altère pas du tout la valeur théorique du critère de classification. Il pourrait sembler peut-être que le fait d'indiquer explicitement ou, au contraire, implicitement le domaine réservé aux principes étrangers à l'expérience, n'est pas un caractère assez important pour justifier une distinction de classe. Mais il faut observer au contraire que cette circonstance est capitale ; parce que si le dit domaine est indiqué explicitement, la voie de l'expérience est fermée, tandis qu'elle reste ouverte, si le domaine est implicitement donné Par exemple, dans la théorie de la morale, construite par Spencer, il y a des principes a priori ; mais comme ils sont implicites, rien n'empêche qu'en poursuivant sur la même voie, on ne les rectifie, et que l’on arrive, peut-être après un long parcours, à une théorie scientifique. Au contraire, dans la morale que les humanitaires veulent constituer, il y a des principes qui dépassent explicitement l'expérience ; tel celui d'après lequel on doit tout sacrifier au « bien du plus grand nombre ». On ne saurait concevoir comment une proposition de ce genre peut être vérifiée par l'expérience, et celle-ci, par conséquent, ne peut en aucune façon servir à la rectifier. Elle constitue un acte de foi qui nous transporte dans un domaine entièrement différent du domaine expérimental.
[345]
Chapitre V↩
Les théories pseudo-scientifiques [(§633 à §841),vol. 1, pp. 345-449]
§ 633. Il nous reste à étudier les théories de la catégorie (B). C'est la tâche du présent chapitre.
L'intervention des principes non-expérimentaux, qui était manifeste, explicite, dans la catégorie (A), est plus ou moins dissimulée, implicite, dans la catégorie (B). Les théories ne sont pas logico-expérimentales, mais on veut les faire passer pour telles. À la vérité, il y a des cas où elles peuvent le devenir effectivement. Cela aura lieu quand il sera possible de retrancher la partie non-expérimentale, sans trop altérer les résultats de la théorie. Mais si cela n'est pas possible, les théories, même modifiées, ne pourront prendre place parmi les logico-expérimentales.
§ 634. Ici, nous envisageons principalement les théories de la catégorie (B), dans le but d'y séparer la partie logico-expérimentale de la partie qui ne l'est pas. Cette étude est importante à deux points de vue : 1° ces théories correspondent à des faits déformés ; si nous réussissons à séparer la partie logico-expérimentale, nous pourrons retrouver la forme réelle des faits ; 2° si par hasard, dans quelques-unes de ces théories, la partie non logico-expérimentale était accessoire, nous pourrions l'éliminer, et nous aurions une théorie logico-expérimentale.
§ 635. Soit donc le texte d'un récit ou d'une théorie.
Nous pourrons envisager les deux problèmes suivants: 1° à supposer que des déductions métaphysiques, arbitraires, des mythes, des allégories, etc., aient une part, petite ou grande, dans ce texte, est-il possible de remonter du texte aux idées que l'auteur a vraiment voulu exprimer, aux faits qu'il entendait raconter, aux relations logico-expérimentales qu'il a voulu énoncer, et comment faire ? 2° quels procédés peut-on employer pour tirer, grâce à l'emploi de ces déductions métaphysiques arbitraires, de ces mythes, de ces allégories, etc., certaines conclusions auxquelles on veut arriver?
§ 636. Graphiquement, on voit encore mieux la chose.
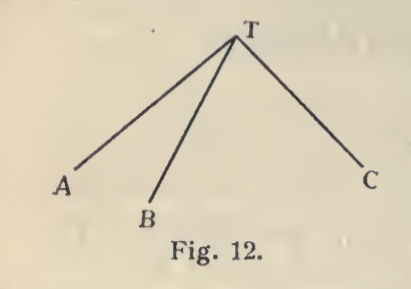
Figure 12
1° On a une théorie T qu'on suppose exprimer certains faits A, un texte qu'on suppose procéder des faits A. Connaissant T, on veut trouver A. Si l'on réussit dans cette entreprise, on parcourra la voie TA, et partant du texte T, on arrivera en A. Mais si, par hasard, l'entreprise échoue, au lieu de A, on trouvera B ; . et l'on croira à tort que B a produit T. L'opération que fait la critique moderne, pour remonter des différents manuscrits existants d'une œuvre, au texte original, est analogue à celle qui de T conduit en A, ou en B. Le texte original est A, et les différents manuscrits constituent le complexe T. 2° De la théorie, du texte T, on veut tirer certaines conclusions C, qui, généralement, sont déjà connues ; et grâce à des déductions qui ne sont pas logico-expérimentales, en partant de T, on arrive en C.
Dans le premier problème, on cherche A ; dans le second problème, on ne cherche pas C, mais bien la voie pour arriver à C. Parfois, on le fait volontairement ; autrement dit, on sait que C n'est pas une conséquence de T, mais on veut le donner pour tel. Nous avons ainsi un artifice, une action logique de celui qui veut persuader autrui d'une chose qu'il sait bien n'être pas vraie. Mais plus souvent, très souvent, la recherche de la voie permettant le passage de T à C, est involontaire. La foi en T et le vif désir d'atteindre C existent dans l'esprit de celui qui se livre à cette étude. Involontairement, ces deux sentiments s'unissent suivant une voie TC. Nous avons ainsi une action non-logique. Celui qui tâche de persuader autrui s'est d'abord persuadé lui-même, et n'use en rien d'artifices. Dans le premier problème, soit quand on cherche A, bien que souvent on emploie aussi l'accord de sentiments, on suppose au moins vouloir se servir de déductions logico-expérimentales, et l'on s'en sert effectivement dans les sciences. La voie TA (ou TB, si l'on se trompe) est donc donnée ou supposée donnée, et l'on cherche A. Dans le second problème, c'est-à-dire quand, volontairement ou involontairement, on cherche la voie TC, bien que souvent on feigne et que très souvent on croie employer la voie logico-expérimentale, en fait on se sert presque toujours de l'accord des sentiments : on cherche la voie TC, qui peut conduire au but C et qui peut être agréable aux gens que l'on veut persuader.
Habituellement, tout cela n'est pas apparent. On ne sépare pas les deux problèmes, et l'on recherche la voie TC avec la ferme conviction qu'on cherche au contraire uniquement A. Comme d'habitude, l'action non-logique se recouvre du vernis de la logique. Par exemple, soit T, le texte de l'Évangile. On peut chercher les faits A dont il tire son origine ; ce serait la tâche de la critique historique. Mais celui qui n'y fait pas appel, ou qui n'y fait pas exclusivement appel, veut tirer de l'Évangile certaines conclusions issues de sa propre morale, ou qu'il a faites siennes d'une manière quelconque ; c'est pourquoi il se sert d'une interprétation TC qui puisse le conduire au but désiré. Il sait à l'avance qu'il doit croire en T et en C. Ces deux termes sont fixes, et il cherche seulement le moyen de les unir.
§ 637. Dans ce chapitre, nous traiterons principalement du premier problème; aux chapitres IX et X, nous traiterons du second. Nous disons principalement et non exclusivement, parce que, dans les cas concrets, les éléments correspondant à ces deux problèmes sont habituellement unis en des proportions variables ; et l'on irait au devant de longues et fastidieuses répétitions, si, lorsqu'on examine un cas concret, on voulait rigoureusement séparer ces éléments, et parler exclusivement d'abord de l'un, puis de l'autre.
§ 638. Dans les sciences logico-expérimentales, on parcourt d'abord la voie AT, en déduisant une théorie des faits ; puis la voie TA, en déduisant de la théorie, des prévisions de faits. Dans les productions littéraires qui s'écartent des sciences logico-expérimentales, on parcourt quelquefois la voie TB, presque toujours la voie TC. En outre, T est habituellement indéterminé, et l'on peut en tirer tout ce qu'on veut. La voie TC a, souvent aussi, peu de rapports avec la logique. En somme, de certains sentiments indéterminés T, on déduit ce qu'on désire, c'est-à-dire C.
§ 639. Quand on parcourt la voie AT, on va de la chose au mot; quand on parcourt TA, TB ou TC, on va du mot à la chose. Le sentiment qui nous pousse à donner pour objectives nos sensations subjectives, agit de manière à nous faire croire qu'en tout cas il doit y avoir quelque objet réel, correspondant à un terme quelconque T du langage, et qu'il suffit par conséquent de savoir le chercher pour le trouver. Par exemple, puisque le terme justice existe, il doit nécessairement exister une chose réelle qui y corresponde ; aussi la cherche-t-on en tout endroit où l'on croit pouvoir la trouver. En réalité, il y a de nombreux termes du langage T qui correspondent seulement à des sentiments d'une ou de plusieurs personnes et non à des choses. Par conséquent, en partant de T, on peut bien trouver ces sentiments, mais non des objets qui n'existent pas [FN: § 639-1].
§ 640. Le phénomène suivant est assez fréquent. Des sentiments A, existant chez beaucoup de gens, on obtient une expression indéterminée T ; puis vient un auteur qui veut déduire de T certaines conclusions C. Précisément à cause de l'indétermination de T, cet auteur en tire ce qu'il veut (§ 514). Il croit ensuite et fait croire aux autres qu'il a obtenu un résultat objectif C. En réalité, il admet C uniquement parce qu'il est d'accord avec ses sentiments A ; et au lieu de suivre ouvertement cette voie directe, il suit la voie indirecte ATC, souvent très longue, pour donner satisfaction au besoin de raisonner, qui existe en lui et chez les autres hommes.
Continuons maintenant l'examen des théories, déjà commencé au chapitre précédent, et voyons si et comment on peut en déduire les faits qu'on les suppose représenter.
§ 641. (B) Les entités abstraites qu'on recherche ne sont pas explicitement dotées d'une origine étrangère à l'expérience. Nous devons nous résigner à voir encore dans cette classe des principes métaphysiques a priori, et nous devons nous contenter d'en réduire le rôle à peu de chose. Si nous voulions les exclure complètement, nous n'aurions rien ou presque rien à mettre dans la classe que nous envisageons, parce que ces principes s'implantent d'une manière ou d'une autre dans les sujets sociaux ; et cela arrive non seulement parce qu'ils correspondent à des sentiments très puissants chez les hommes, mais encore parce qu'on n'étudie jamais ces matières dans le but exclusif de découvrir des uniformités, et qu'on a au contraire le désir de quelque résultat pratique, de quelque propagande, de quelque justification de croyances a priori.
§ 642. Les entités abstraites sont de simples abstractions déduites arbitrairement de l'expérience. C'est là le caractère des sciences expérimentales ; et le signe auquel on reconnaît ces abstractions est qu'on peut s'en passer quand on veut. On peut exposer toute la mécanique céleste, sans faire usage du concept de l'attraction universelle. Comme nous l'avons dit déjà, l'hypothèse, que l'on cherche à vérifier par les faits, est que les corps célestes se meuvent de manière à satisfaire aux équations de la dynamique. On peut exposer toute la mécanique sans faire usage du concept de force ; toute la chimie, sans nommer l'affinité, etc. Quant à l'économie politique, nous avons fait voir qu'on pouvait exposer les théories de l'équilibre économique, sans faire usage de l'ophélimité, ni de la valeur, ni d'autre entité semblable ; de même qu'on pouvait aussi se passer de l'abstraction indiquée par le terme capital (§ 117 et sv.). Quant à la sociologie, dans le présent ouvrage, on peut substituer de simples lettres aux termes actions non-logiques, résidus, dérivations (§ 868), etc., et tout le raisonnement subsistera également, sans la moindre altération. Nous raisonnons sur des choses et non sur des mots ou sur des sentiments suscités par des mots (§ 116 et sv.).
Laissons maintenant de côté ces théories logico-expérimentales, et portons notre attention uniquement sur celles qui, s'en écartant plus ou moins, ont jusqu'ici constitué la science sociale.
§ 643. (B-α) Les mythes, les récits religieux et autres semblables légendes, sont des réalités historiques. C'est la solution la plus simple et aussi la plus facile du problème que nous nous sommes proposé ; c'est-à-dire de remonter d'un texte aux faits qui lui ont donné naissance. Elle peut être acceptée sous l'empire d'une foi vive qui ne raisonne pas, qui se vante de croire même l'absurde. Comme nous l'avons dit déjà (§ 581), nous n'avons pas à nous en occuper. Ou bien elle peut être admise comme tout autre récit historique, et donc comme conséquence d une pseudo-expérience, qui serait une véritable expérience, si le récit était soumis à une sévère critique historique et à toute autre vérification expérimentale nécessaire. Les théories données par cette solution diffèrent des théories de la catégorie (A), en ce que, dans ces dernières, le récit est imposé comme un article de foi par quelque puissance non-expérimentale qui nous est généralement comme grâce à l'autorité d'un homme (§ 583) ; et c'est l'intervention de cette puissance qui procure l' « explication » désirée ; tandis que dans le présent cas (B-α), les théories sont crues grâce à leur évidence pseudo-expérimentale. Au point de vue scientifique, cette distinction est capitale (§ 632). En effet, si un récit nous est donné comme article de foi, cela suffit pour le mettre hors du domaine de la science logico-expérimentale, qui n'a plus à s'en occuper, ni pour l'accepter, ni pour le repousser. Si, au contraire, il nous est donné comme possédant en lui-même son autorité et son évidence, il tombe entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale, et c'est la foi qui n'a plus rien à y voir. Il faut s'empresser d'ajouter que cette distinction est rarement faite par celui qui admet le récit ; et il est bien difficile de savoir s'il le considère seulement comme un récit historique, ou s'il y croit, poussé par d'autres considérations. C'est pourquoi un très grand nombre de cas concrets sont un mélange des théories (A) et (B). Par exemple, l'autorité non-expérimentale de l'auteur du récit fait rarement défaut.
§ 644. Si le texte que nous voulons interpréter était un récit historique, on pourrait effectivement le tenir pour une représentation au moins approchée des faits qu'il exprime (§ 541 et sv.).
§ 645. Pourtant, même dans ce cas, il y a toujours des divergences. Par exemple, le récit d'un fait même très simple reproduit difficilement le fait précis. Les professeurs de droit pénal ont souvent fait cette expérience : un fait se produit en présence des étudiants ; on prie chacun d'eux d'en écrire le récit, et l'on obtient autant de récits légèrement différents qu'il y a de personnes. Vous êtes témoin d'un fait, en compagnie d'un enfant ou avec un adulte doué d'une vive imagination, et vous leur demandez ensuite de vous le raconter. Vous verrez qu'ils y ajoutent toujours quelque chose, et qu'ils donnent aux traits de leur récit une plus grande force que celle de la réalité. La même chose se produit pour celui qui répète une histoire qu'il a entendue (§ 1568).
Il y a plus. Comme il est précisément d'usage courant d'exagérer cette force, celui qui écoute le récit finit par en rabattre. Donc, pour lui donner une impression correspondant à la réalité, il faut employer des termes qui dépassent un peu la vérité. Si, sur dix personnes, vous en voyez neuf qui rient, et si vous voulez faire éprouver à quelqu'un d'autre une impression du fait, correspondant à la réalité, vous direz : « Tout le monde a ri. » Si vous disiez : « La plus grande partie d'entre eux ont ri », l'impression resterait en dessous de la réalité.
§ 646. Pour qu'un récit s'altère, il n'est pas nécessaire qu'il passe de bouche en bouche. Il s'altère même quand il est répété par la même personne. Par exemple, une chose qu'on voulait donner pour grande deviendra toujours plus grande, dans les récits successifs ; une chose petite, toujours plus petite. On augmente la dose, en cédant chaque fois au même sentiment.
§ 647. Nous avons des faits précis, qui montrent combien certaines impressions sont trompeuses. Ainsi les illusions au sujet des citations de certains auteurs, sont singulières. Beaucoup de Français croient citer Molière en disant :
Il est avec le ciel des accommodements [FN: § 647-1] .
« (p. 153) [FN: § 647-2] Le vers est excellent, mais Molière ne l'a pas écrit, l'on a donc tort de le lui prêter. Pour l'obtenir, il faut prendre la substance de deux (p. 154) des siens à l'acte IV, scène V; c'est Tartufe qui parle :
Le ciel défend, de vrai, certains contentements ;
Mais on trouve avec lui des accommodements.
La célèbre phrase de Mirabeau : « Allez dire à votre maître, etc. » n'a jamais été prononcée. Le marquis de Dreux-Brézé a rectifié les faits, à la séance du 10 mars 1833, de la Chambre des Pairs : « (p. 229) Mirabeau dit à mon père : Nous sommes assemblés par la volonté nationale, nous n'en sortirons que par la force. Je demande à M. de Montlosier si cela est exact [FN: § 647-3] ».
§ 648. On a observé que souvent un auteur national est cité moins bien par ses concitoyens, qui citent volontiers de mémoire, que par des étrangers, qui se donnent la peine de vérifier la citation dans le texte. Il peut s'être produit quelque chose de semblable pour les auteurs de la Grèce antique qui citent Homère [FN: § 648-1]. Ces citations diffèrent souvent du texte que nous possédons ; ce qui s'explique en grande partie par la diversité des textes que ces auteurs avaient sous les yeux ; mais il n'en reste pas moins des cas où la divergence paraît due au fait qu'ils citaient de mémoire. Les écrivains anciens n'éprouvaient pas le moins du monde le besoin de précision qu'éprouvent une partie au moins des auteurs modernes. Il y a peu de temps encore, beaucoup citaient des passages d'un auteur sans dire où ils se trouvaient, et, qui pis est, ils mentionnaient une opinion qu'ils affirmaient être celle d'un auteur, sans dire où ils l'avaient prise. Encore en 1893, Gomperz écrit un ouvrage étendu, sous le titre de Griechische Denker, dans lequel il n'y a presque aucune citation. On doit tout croire simplement de par son autorité. Il parle comme l'oracle de Delphes. Mais aujourd'hui, dans les ouvrages historiques, l'usage général est différent ; on en a des exemples dans les travaux de Fustel de Coulanges, dans le Manuel des antiquités romaines, de Mommsen et Marquardt, dans l'Histoire romaine, de Pais, et dans de très nombreux autres ouvrages. Le principal souci de l'auteur est d'être aussi précis et objectif que possible, et de donner de ses assertions des démonstrations sérieuses.
§ 649. Les divergences entre les faits et les récits peuvent être petites, insignifiantes, et peuvent aussi croître, se multiplier, s'étendre (§ 540), donnant ainsi naissance à des récits qui s'écartent des faits, au point de n'avoir presque plus rien de commun avec eux. On a de la sorte des histoires fantaisistes, des légendes, des romans, dans lesquels on ne peut plus distinguer si l'on y fait allusion à des faits réels, ni ce que sont ces faits. Même des écrits qui ne passent pas pour légendaires et sont réputés historiques, peuvent s'écarter beaucoup de la réalité, au point de finir par n'avoir plus que bien peu de ressemblance avec elle [FN: § 649-1]. Si nous suivons encore ici la méthode indiquée au § 547, nous trouverons en grande quantité des exemples qui montrent avec quelles précautions il faut accepter des détails de récits qui sont, au demeurant, tout à fait historiques. Voici l'un de ces exemples. En 1192, Conrad, marquis de Tyr, fut assassiné dans cette ville. Ses sujets, qui avaient besoin d'un chef et d'un protecteur, voulurent qu'Isabelle, veuve de Conrad, épousât incontinent Henri, comte de Champagne, bien qu'elle fût enceinte. El'Imad raconte le fait de la façon suivante [FN: § 649-2] :
« (p. 52) La nuit même de l'assassinat, le Comte Henri épousa la princesse veuve du (p. 53) Marquis et consomma son union avec elle, bien qu'elle fût en état de grossesse. Mais dans la religion des Francs, cette circonstance n'est pas un obstacle au mariage, l'enfant étant attribué à la mère. Telle est la règle chez ce peuple de mécréants ».
Si nous ne savions des Francs que ce qui est dit là, nous croirions que chez eux la filiation s'établissait par la mère, et ce peuple irait augmenter le nombre de ceux chez lesquels florissait le matriarcat. Il est probable que plusieurs faits présentés à l'appui de cette théorie n'ont pas plus de fondement que celui-ci.
§ 650. (B-α 1) Les mythes et les récits doivent être pris à la lettre ; On a des types de ce genre dans la foi aveugle avec laquelle si longtemps on accepta les récits de la Bible, considérée comme un simple livre d'histoire. Si on l'envisageait, au contraire, comme un livre inspiré de Dieu, et que l'on trouvât en cette circonstance le motif de croire aux récits historiques qu'elle renferme, on produirait une théorie de la classe III-A. On trouve d'autres types semblables dans les nombreuses légendes de la fondation de Rome et dans d'autres analogues.
§ 651. Durant nombre de siècles, on a pris pour de l'or en barre tout ce qui se trouvait chez quelque auteur ancien. Le fait était d'autant plus croyable que l'écrivain était plus ancien : Magister dixit ». On reste aujourd'hui stupéfait en voyant les fantasmagories qu'on prit longtemps pour de l'histoire ; et ce fait peut servir à illustrer la valeur du consentement universel dont les métaphysiciens se prévalent.
§ 652. On n'est pas moins étonné en voyant des hommes de grand talent accorder crédit à des fables et à des prophéties ; et cela montre combien peu de considération mérite l'autorité, en ces matières. Il paraît incroyable, et c'est pourtant la vérité, que le grand Newton ait pu écrire un livre pour démontrer que les prophéties de l'Apocalypse s'étaient vérifiées [FN: § 652-1], et que de semblables enfantillages aient pu trouver place dans l'esprit de l'homme qui fonda la mécanique céleste. Mais le fait n'est pas isolé ; au contraire, il est fréquent, bien que dans de moindres proportions ; et beaucoup d'hommes raisonnent fort bien en certaines matières et très mal en d'autres, faisant preuve en même temps de sagesse dans les premières et d'inintelligence dans les secondes. Innombrables sont les chronologies commençant au déluge, à l'année de la fondation de Troie, etc. Il faut voir, par exemple, dans les histoires de P. Orose [FN: § 652-2], comment il ramasse toutes les légendes, et les donne, sans le moindre doute, pour des histoires vraies, en leur assignant, par-dessus le marché, une date précise. Pour lui tout est bon, que cela vienne de la Bible ou des mythologies des païens, contre lesquels il écrit pourtant.
§ 653. Nous trouvons jusqu'en 1802 de ces chronologies. En cette année 1802, Larcher, par de longues et savantes dissertations, détermine encore la date d'une infinité d'événements légendaires [FN: § 653-1] . Il y a tout un chapitre pour déterminer exactement l'année où Troie fut prise, et l'auteur dit d'abord : « (p. 290) Je pose en fait actuellement que cette ville a été prise l'an 3,444 de la période julienne, 1,270 ans avant l'ère vulgaire, et je le prouverai dans le chapitre concernant cette époque ».
§ 654. Déjà dans l'antiquité, plus encore au moyen âge et même un peu plus tard, beaucoup de peuples trouvaient leur origine dans les pérégrinations des Troyens. Guillaume Le Breton nous dit sérieusement [FN: § 654-1] : « (p. 184) Comme nous l'avons appris des chroniques d'Eusèbe, d'Idace, de Grégoire de Tours, et de beaucoup d'autres, et du rapport de tous les anciens Hector, fils de Priam, eut un fils appelé Francion. Troïlus, fils de ce même Priam, roi d'Asie, eut, dit-on, aussi un fils nommé Turc. Après la destruction de Troye, (p. 185) la plus grande partie des habitans s'étant échappée, se divisa en deux peuples, dont l'un se choisit pour roi Francion, ce qui lui fit donner le nom de Franc. Les autres nommèrent pour chef Turc, d'où les Turcs tirèrent leur nom ».
§ 655. En 1829, alors que trois éditions de l'ouvrage de Niebuhr avaient déjà été publiées, les saint-simoniens croyaient encore à Numa [FN: § 655-1] .
§ 656. Mais, parmi ceux qui étudiaient les antiquités romaines, il y avait longtemps déjà que dès doutes s'étaient manifestés. Cluvier, en 1624, Perizonius, en 1685, Baufort, en 1738, Charles Lévesque, en 1807, et enfin Niebuhr, en 1811, tendirent peu à peu à montrer la vanité historique des légendes antiques.. Mommsen et enfin Pais en ont définitivement débarrassé l'histoire. Grote avait accompli déjà cette œuvre pour la Grèce.
§ 657. Les hommes ne se résignent pas volontiers à abandonner leurs légendes, et essaient au moins d'en sauver la plus grande partie possible. Le procédé généralement en usage consiste à changer le sens de la partie qu'on ne saurait vraiment pas accepter, afin de lui enlever un caractère d'impossibilité trop frappant.
§ 658. On a de très nombreux exemples de mots transformés en choses ou en propriétés de choses ; et souvent on construit toute une légende sur un seul terme dont on interprète le sens extensivement [FN: § 658-1].
Dans les langues où les noms de choses ont un genre, on personnifie les mâles par des noms masculins, les femelles par des noms féminins (§ 1645 et sv.). Il peut arriver qu'il soit parfois possible de remonter du nom à la chose ; mais il faut prendre bien garde de ne faire cela que si l'on a de bonnes preuves du passage effectué de la chose au nom. Certes, on est très porté, quand on cherche ce que signifie un terme, à l'altérer légèrement, à faire preuve d'ingéniosité, en mettant en lumière des interprétations cachées, et à unir ainsi le nom à une chose ; mais l'expérience du passé montre que, de cette manière, on est presque toujours tombé dans l'erreur (§ 547) ; et même d'autant plus facilement que le talent et l'érudition de l'interprète étaient plus grands. Celui-ci est poussé, justement par ces qualités, à tenter des voies inexplorées. Aller du nom à la chose, c'est parcourir à rebours la voie qui mène de la chose au nom ; et le parcours à rebours peut se faire avec quelque sécurité, seulement quand on a au moins une idée plus ou moins claire de la voie directe. Nous traiterons longuement ce sujet au chapitre IX.
§ 659. Il y a là un phénomène analogue à celui qu'on a observé pour l'étymologie. Les anciens tiraient leurs étymologies de ressemblances des termes, souvent très superficielles, et se trompaient presque toujours. Les modernes n'acceptent aucune étymologie qui n'est pas d'accord avec les lois de la phonétique ; c'est-à-dire qu'ils refusent de parcourir à rebours la voie suivie, s'ils n'ont pas de preuve du parcours suivant la voie directe.
§ 660. Ainsi, nous restons dans le doute quand, de sainte Venise, on veut remonter à Vénus, tant qu'on ne nous donne pas d'autre preuve que la ressemblance des noms ; mais cette dépendance deviendra d'autant plus probable que les preuves qu'on nous donnera du passage direct de Vénus à Venise seront meilleures. C'est justement ce que fait Maury [FN: § 660-1] : « (p. 349) La légende de cette sainte, telle qu'elle est rapportée par Petrus Subertus, dans son ouvrage intitulé De cultu vineæ Domini, telle qu'elle se lit dans un fragment attribué à Luitprand de Crémone, auteur du dixième siècle, et dans la chronique de Dexter, achève de démontrer l'origine païenne et tout aphrodisiaque de cette sainte qu'on chercherait vainement dans les Actes ».
Au contraire, tant que nous n'aurons pas de preuves de la voie directe, nous ne pourrons pas admettre les explications de certains auteurs sur la naissance d'Orion [FN: § 660-2].
§ 661. (B-α 2) Changements légers et faciles dans l'expression littérale. On a le type de ce genre d'interprétations dans le procédé employé par Palæphate, pour expliquer les légendes ; procédé si commode et si aisé, que n'importe qui peut l'employer, sans la moindre difficulté [FN: § 661-1] . Nous l'avons déjà mentionné comme moyen de dissimuler les actions non-logiques (§ 348). On conserve littéralement la légende, mais on change le sens des termes, autant qu'il le faut pour éliminer tout ce qui ne semble pas croyable.
Tout le monde connaît la belle description qu'Hésiode fait du combat entre les dieux descendant de Kronos et les Titans ; et il est évident que l'auteur n'a pas voulu faire autre chose qu'un simple récit. Les dieux eurent pour alliés Briarée, Cottos et Gyas ; chacun de ces derniers avait cent mains et cinquante tètes. Voici comment s'en tire Palæphate [FN: § 661-2] : « On raconte à leur sujet qu'ils avaient cent mains, tout en étant des hommes. Comment ne pas juger cela une absurdité ? Mais voici la vérité. Ils habitaient une ville nommée Cent-mains, située dans la contrée appelée aujourd'hui Orestiade ; aussi les hommes nommaient-ils Cent-mains: Cottos, Briarée et Gyas. Appelés par les dieux, ils chassèrent les Titans, de l'Olympe ».
La fable d'Éole devient facilement de l'histoire [FN: § 661-3] . Éole était un astrologue qui prédit à Ulysse quels vents devaient souffler. On disait que la Chimère était lion devant, dragon derrière et chèvre au milieu. Mais c'est impossible : un lion et une chèvre ne pouvaient avoir des aliments communs. La vérité est que la Chimère était une montagne où se trouvaient un lion sur la partie antérieure, un dragon sur la partie postérieure et des bergers au milieu. Si cette explication ne vous satisfait pas, en voici une autre, donnée par Héraclite [FN: § 661-4] : « La forme de la Chimère est ainsi décrite par Homère : Lion devant, dragon derrière, chèvre au milieu. La vérité aura été la suivante : Une femme qui régnait en un pays avait deux frères, appelés Lion et Dragon : ils lui étaient associés... ». Si l'on veut une autre explication, on la trouvera sans peine.
Diodore de Sicile voit en Ouranos un roi des Atlantes, qui habitaient les rives de l'Océan. Il eut, de plusieurs femmes, quarante-cinq fils, parmi lesquels dix-huit étaient appelés Titans, du nom ![]() , de leur mère. Après leur mort, Ouranos et Titaia furent adorés, celui-ci sous le nom de Ciel, celle-là sous le nom de Terre.
, de leur mère. Après leur mort, Ouranos et Titaia furent adorés, celui-ci sous le nom de Ciel, celle-là sous le nom de Terre.
Encore de nos jours, il s'est trouvé des auteurs qui ont pris au sérieux les interprétations de Palæphate [FN: § 661-5], et l'on en trouve même des traces dans les théories modernes sur l'origine de la famille et sur le totémisme.
§ 662. (B-β) Les mythes, etc., renferment une part d'histoire mêlée à une part non-réelle. C'est là un des genres les plus importants. Les explications qui s'y rattachent étaient autrefois fort en usage, et ne sont pas encore tombées en désuétude. Ce genre a le mérite, aux yeux de beaucoup, de concilier l'amour des légendes avec le désir d'une certaine précision historique ; en outre, et en général, il est commode, parce qu'il permet d'employer un grand nombre de documents écrits, et en particulier parce qu'il supporte facilement qu'on tire de ces documents ce que veut un auteur déterminé. Comme les règles servant à séparer la partie historique de la partie légendaire ne sont rien moins que précises, chacun, le plus souvent sans s'en apercevoir, les interprète selon le but qu'il a en vue.
§ 663. Maintenant, on y ajoute aussi des considérations éthiques et esthétiques. On prétend faire ainsi une histoire « vivante », par opposition à l'histoire « morte », qui serait celle qui vise exclusivement à être d'accord avec les faits [FN: § 663-1]. En somme, ce procédé substitue le produit de l'imagination de l'auteur aux réalités historiques. Au point de vue didactique, il est vrai que cette substitution peut faire naître chez le lecteur une image du passé, laquelle se grave ainsi dans l'esprit, mieux que si l'on employait une autre méthode plus précise. Les dessins des histoires illustrées sont de même utiles aux enfants et à beaucoup d'adultes, pour suppléer par la mémoire visuelle à la mémoire rationnelle. Nous n'avons pas à nous en occuper ici, et nous reviendrons plus loin sur la question de l'histoire (§ 1580 et sv.).
§ 664. Rejetant les fables de la tradition romaine, Niebuhr a voulu en tirer pourtant quelque chose; c'est-à-dire que du genre (α), il nous fait passer au genre (β). Duruy est bien moins scientifique que Niebuhr. Il ne sait vraiment pas se décider à abandonner la tradition, et cherche toute espèce de prétextes pour se rapprocher du genre (α). Il va jusqu'à dire [FN: § 664-1] : « (p. 62) Ce n'est pas que nous voulions rejeter l'existence de Romulus ; seulement les hymnes chantés encore du temps d'Auguste, et qui conservaient la poétique histoire du premier roi de Rome, ne seront pour nous qu'une légende comme en ont tous les vieux peuples... ». Voilà que nous approchons des belles interprétations de Palæphate [FN: § 664-2]. Comment Duruy fait-il pour admettre l'existence historique de Romulus, tandis qu'il reconnaît le caractère légendaire des seuls documents qui nous en ont conservé la mémoire ? Ce ne peut être qu'en vertu du principe non-expérimental, d'après lequel ces légendes ont une origine historique, et au moyen d'une méthode encore moins expérimentale, par laquelle on prétend reconnaître cette origine sous le voile de la légende.
§ 665. À ces affirmations a priori, la science expérimentale ne peut opposer des négations également a priori. Il est nécessaire de rechercher par l'expérience, exclusivement par l'expérience, si la méthode proposée est susceptible, oui ou non, de nous faire trouver la réalité historique sous la légende (§ 547).
§ 666. Pour y arriver, nous avons heureusement une série de faits parallèles : historiques d'une part, légendaires d'autre part. Autrement dit, nous connaissons un fait historique, et nous connaissons la légende à laquelle il a donné naissance. À supposer que l'on connaisse uniquement la légende, nous tâchons d'en tirer le fait historique par une certaine méthode, et nous pouvons vérifier si, de cette manière, nous trouvons vraiment le fait réel ; si oui, la méthode est bonne ; si non, elle ne vaut rien ou presque rien (§ 547).
§ 667. Commençons par observer que la reconstruction du fait historique doit faire plus qu'affirmer l'existence de personnes dont on ignore tout, y compris le nom ; sans quoi cela ne nous apprend vraiment rien. À quoi sert de croire à l'existence de Romulus, comme y croit Duruy, si nous ne savons rien de lui ? Et quel besoin avons-nous de la légende pour avoir cette connaissance ? Les anciens Romains eurent un chef, comme tous les peuples ont eu des chefs. Admettons-le ; c'est même presque certain ; mais pour le savoir, l'analogie suffit, sans que la légende de Romulus soit nécessaire.
Le problème à résoudre est donc le suivant. Étant donnée une légende, avons-nous un moyen d'en séparer une partie historique, aussi petite soit-elle ? Le manque de place ne nous permet pas de traiter ce problème dans toute son ampleur. Voyons au moins un exemple.
§ 668. Virgile est un personnage historique ; d'autre part, c'est aussi un personnage légendaire ; et grâce au beau travail de Comparetti [FN: § 668-1] , nous en connaissons bien la légende, ou mieux les légendes. Voyons si nous pourrions reconstruire l'histoire, quand nous ne connaîtrions que ces légendes.
Comparetti distingue deux ordres de légendes : 1° Virgile dans la tradition littéraire; 2° Virgile dans la légende populaire. C'est seulement de cette dernière partie que nous avons à nous occuper ici. L'idée principale de ces légendes, au moyen âge, est de placer Virgile parmi les magiciens ; et beaucoup de ces légendes n'ont d'autre point de contact avec la réalité historique que de faire de Virgile un citoyen romain et de le mettre en rapport avec un empereur. Il faut avouer que c'est bien peu. Voici, par exemple, un livre [FN: § 668-2] qui nous fait connaître « Les faietz merveilleux de Virgille ». Les titres des chapitres suffiront à donner une idée de la nature de la légende.
« I. Comment Romulus occit Remus son frere, et comment le filz de Remus occit Romulus son oncle ». On nous apprend que : « (p. 284) Si advint que Remus quis estoit empereur mourut, et son filz qu'il avoit fut empereur après luy. Et celluy chevalier qui avoit espousé la fille du senateur meut une grant guerre qui moult le greva et fit despendre du sien. Celluy chevalier eut ung filz de sa femme qui à grant peine nasquit, ne naistre ne vouloit, et fut contendue grant temps la nature de la mère, et après nasquit et le convint longuement veiller. Et pourtant fut il nomme Virgille. – II. Du naissement de Virgille et comment il fut mis à lescolle. (p. 285) Et quand Virgille nasquit si crousla toute la cité de Romme de l'un des boutz jusques à lautre bout. Virgille sen etoit allé à Tollette pour apprendre prendre, car il apprenait trop voluntiers, et moult fut sage des ars de nigromance... – III. Comment Virgille sen vint à Romme et se complaignit à lempereur. – IV. Comment lempereur de Romme assalit Virgille en son chastel. – V. Comment Virgille avoit enclos lempereur et son ost de murs. – VI. Comment lempereur fit paix avec Virgille. (p. 289) Et tant advint que Virgille ayma une damoiselle,... et la fit requerir damour par une vieille sorcière ». Cette demoiselle fait savoir à Virgile « (p. 290) que si vouloit coucher avec elle, il convenoit venir tout quoy auprès de la tour où elle gisoit, quant toutes gens seroient couchez, et elle lui avallerait une corbeille à terre bien encordée, et il entreroit dedans, et elle le tireroit à mont jusques en sa chambre. – VII. Comment la damoiselle pendit Virgille en la corbeille ». La demoiselle se joue de Virgile, et celui-ci se venge : « (p. 290) Si print Virgille ses livres et fist tant que tout le feux de Romme fust esteint et n'y avoit nul qui en peust apporter en la cité de dehors Romme. VIII. Comment Virgille estaingnit le feu de Romme ». L'empereur et ses barons demandent à Virgile comment ils pourront obtenir du feu ; il répond: « (p. 291) Vous ferez ung escharfault au marché, et en iceluy eacharfault vous ferez monter toute nue en sa chemise la damoiselle qui devant hier me pendit en la corbeille, et ferez crier par toute Romme que qui vouldra avoir du feu viennent à lescharfault en prendre, et allumer à la nature dicelle damoiselle, ou autrement ilz n'en auront point. – IX. Comment la damoiselle fut mise en lescharfault et y allait chacun allumer sa chandelle ou sa torche entre ses jambes. – X. Comment Virgille fist une lampe qui tousjours ardoit. – XI. Cy apres parle du vergier que Virgille fist à la fontaine de lestang. – XII. Lymage que fist Virgille à sa femme ». Cette image « (p. 293) estoit de telle vertu que toute femme qui lavoit veu navoit voulenté de faire le peché de fournication. Et de ce furent moult courroucées les dames de Romme qui aymoyent par amour. ». Elles se plaignent à la femme de Virgile ; celle-ci jette l'image. – « XIII. Comment Virgille refist lymage et trabucha sa femme et comment il fist ung pont sur la mer ». Une fille du Sultan s'éprend de Virgile, et celui-ci la mène chez lui sur « ung pont en laer par dessus la mer. – XIV. Comment Virgille reporta la damoiselle en son pays. – XV. Comment Virgille fut pris avec la damoiselle et comment il eschappa et emmena la damoiselle. – XVI. Comment Virgille eschappa et ramena la damoiselle et fonda la cité de Naples. – XVII. Comment lempereur de Romme assiegea la cité de Naples. – XVIII. Comment Virgille fist peupler la cité d'escolliers et de marschandises. – XIX. Comment Virgille fist ung serpent à Romme. – XX. Comment Virgille mourut [FN: § 668-3] ».
§ 669. Supposons que nous ne connaissions de Virgile que cette longue légende. Quelle réalité historique pourrions-nous en tirer ? Vraiment aucune. Le récit sera beau, admirable, plein de vie autant qu'on voudra ; mais il demeure tout à fait étranger aux faits.
§ 670. Si nous voulons nous lancer en plein dans les interprétations, nous pouvons, par des raisonnements qui peuvent paraître bons, mais ne conduisent à rien de conforme à la réalité historique, tirer ce qu'il nous plaît de cette légende. On pourrait y voir le souvenir d'une guerre entre Rome et Naples, comme dans l'Iliade on voit le souvenir d'une guerre entre les Grecs et les Asiatiques. Les aventures érotiques pourraient faire placer Virgile parmi les dieux de la génération, dont il serait une forme romaine... ou napolitaine. La difficulté de sa naissance pourrait nous induire à voir en lui une des formes d'Hercule, ou, si nous préférons, de Bacchus. Naples étant une colonie grecque, ces hypothèses ont une confirmation historique, et l'on peut écrire un beau et long chapitre, pour montrer que notre légende est du grand nombre de celles qui font allusion à l'invasion des dieux de la Grèce en terre romaine. Il serait bon de rappeler le sénatus-consulte des Bacchanales, et de rapprocher des obscénités de ces mystères de Bacchus la façon obscène dont Virgile – qui pour la légende est une forme de Bacchus –fait rallumer le feu à Rome. De nombreuses interprétations de légendes s'appuient sur des preuves beaucoup plus faibles que celles dont nous pourrions faire état dans cette interprétation, entièrement fausse, nous le savons.
D'autres méthodes d'interprétation nous donneraient d'autres résultats, qui seraient tous étrangers à la réalité (§ 789).
§ 671. D'autres légendes peuvent avoir été formées diversement ; mais il est possible aussi qu'elles aient été formées comme celles-ci ; et, tant que nous n'avons pas quelque document historique, pour distinguer si la légende dont nous voulons tirer une réalité historique appartient à cette classe-ci ou à celle-là, nous ne pouvons rien, absolument rien en tirer [FN: § 671-1].
Des légendes analogues, il y en a tant qu'on veut dans l'antiquité, au moyen âge et jusqu'aux temps modernes. Nous voyons d'une manière certaine le roman se mêler à l'histoire [FN: § 671-2] ; aussi bien, en conséquence, quand nous ne connaissons que le mélange, nous demeurons dans le doute sur la manière dont il a été composé.
§ 672. Un procédé d'interprétation souvent employé consiste à éliminer d'un récit toute la partie qui semble fabuleuse, et à conserver le reste comme de l'histoire. Employé non comme interprétation, mais seulement comme manière d'éliminer des parties accessoires de textes qui ont, dans leurs autres parties, le caractère d'histoire, ce procédé est non seulement utile, niais indispensable même, en nombre de cas. Bien rares sont les textes anciens dans lesquels le merveilleux ne se mêle pas à la réalité historique ; et si ce merveilleux devait nous faire rejeter le reste, nous ne saurions plus rien de l'antiquité, ni même de temps plus rapprochés.
§ 673. Mais prenons bien garde aux deux conditions posées. Il faut que la fable soit accessoire, et que la partie qu'on tient pour historique possède d'autres caractères et d'autres témoignages qui la fassent accepter comme telle. Si la partie fabuleuse prévaut, si la partie historique est dépourvue de l'appui d'autres témoignages ou au moins d'une probabilité notable, la méthode, qui devient de la simple interprétation, est tout à fait trompeuse (§ 258). Enfin, les motifs qui font accepter le témoignage d'un auteur doivent être intrinsèques à la personne et à l'ouvrage ; l'on ne doit pas être mu par le motif extrinsèque de séparer la partie vraisemblable de celle qui ne l'est pas. Il ne suffit pas qu'une chose soit vraisemblable pour être vraie.
§ 674. Il y a plus. Il est des cas où, en éliminant de cette façon la partie sur laquelle tombe quelque soupçon de fable, et en conservant celle qui paraît être de l'histoire, on élimine précisément la partie qui, si elle n’est pas vraie, peut du moins être telle, et l'on conserve celle qui est certainement fausse.
Par exemple, dans un recueil de récits, on lit l'histoire suivante [FN: § 674-1] : « (p. 229) On list es croniques que l'an vint et deuxiesme de la fondation de Rome, les Romains firent ériger une columne de marbre dedans le capitolle de la cité, et sus la columne misrent l'ymage de Julius César, et sus l'ymage son nom escript ».
« Mais celluy ci César eut trois signes merveilleux devant que mourir. Le centiesme jour devant sa mort, la fouldre tomba devant son ymage, rasant de son nom suscript la première lettre. La nuyt de sa mort precedente, les fenestres de sa chambre furent si impétueusement ouvertes qu'il estimoit que la maison tomboit. Le mesme jour qu'il fut tué, comme il entroit au Capitolle, baillées lui furent des lettres indices, et (p. 230) qui luy demonstroient sa mort, lesquelles s'il les eust leues il fust évadé de son occision et meurtre ».
Dans ce récit, si nous voulons garder la partie qui semble être de l'histoire, et éliminer celle qui paraît fabuleuse, nous devrons conserver le fait que César vivait en l'an 22 de la fondation de Rome, et qu'en ce temps une colonne portant son image et son nom fut érigée au Capitole ; ce qui est entièrement faux. Nous devrons d'autre part éliminer les trois faits qui précédèrent la mort de César, et qui, de l'aveu de l'auteur, appartiennent au merveilleux. Mais ces faits ont justement un fondement dans les histoires d'un temps proche de celui de César [FN: § 674-2] ; ils peuvent être faux, mais peuvent aussi bien être vrais, au moins en partie.
§ 675. Dans la légende de Virgile, rappelée tantôt, nous avons un exemple de la manière dont les récits de mythes se constituent en général. Cette manière ressemble à celle dont se forment les cristaux. Jetez un petit grain de sable dans une solution saturée d'alun, et vous verrez se former autour du grain de gros et nombreux cristaux. De même, autour d'un récit qui n'a rien de réel, mais qui est une simple expression concrète d'un sentiment, d'autres récits semblables et diverses fioritures se groupent et s'agglomèrent avec le premier. Parfois, les personnages sont dépourvus de tout caractère historique, et parfois on les choisit parmi les personnes historiques, auxquelles l'aventure paraît s'appliquer plus ou moins bien. Après avoir ainsi choisi un personnage, historique ou non, il arrive souvent qu'il devient un type qu'on fait intervenir dans d'autres aventures, imaginées d'une manière analogue. Il est évident que ces personnages et les aventures elles-mêmes constituent une partie accessoire du récit, dont la partie principale gît, au contraire, dans les sentiments qu'il exprime. Mais habituellement, quand on étudie ces récits, on intervertit l'importance des parties ; on prête principalement attention aux personnages et aux aventures, et l'on néglige les sentiments dont l'expression fait naître les récits [FN: § 675-1]. De cette façon, on fait aussi une classification artificielle des récits, en mettant ensemble, par exemple, tous ceux qui se rapportent à un même personnage, et qui ne se ressemblent que dans cette partie subordonnée ; tandis qu'une classification naturelle mettrait ensemble tous ceux qui expriment les mêmes sentiments, et qui, par conséquent, se ressemblent dans la partie principale ; et l'on ne se préoccuperait pas davantage des noms employés pour donner une forme concrète à l'expression des sentiments (§ 684-1). De même encore, autour d'un fait historique, si insignifiant qu'il se réduit souvent à un nom seul (Virgile), on dispose une riche et abondante floraison de récits qui n'ont rien, vraiment rien à voir avec l'histoire. Quand ensuite nous étudions ces légendes et voulons en trouver l'origine, nous ne pouvons la découvrir dans la partie pseudo-historique ; mais nous devons la rechercher dans la partie principale, qui est la manifestation de certains sentiments.
§ 676. Il arrive donc qu'autour d'un seul nom se rassemblent des aventures variées. Cela s'est produit pour les dieux du paganisme. Quand, plus tard, à la naissance de la critique, on a vu qu'il était impossible d'attribuer toutes ces aventures à une même personne, on a cherché une façon quelconque d'expliquer la légende. Mais au lieu de reconnaître le mode de formation indiqué tout à l'heure, on a préféré dédoubler ou même diviser en trois ou plusieurs personnes, le dieu ou le héros auquel toutes ces aventures étaient attribuées. Ainsi, comme dans les interprétations de Palæphate, on respecte la lettre de la légende, en en changeant le sens. Cicéron énumère trois Jupiter, cinq Vulcain, trois Esculape, etc. [FN: § 676-1]
§ 677. Il est incontestable que certaines divinités de divers peuples se sont fondues ensemble, et ont pris un même nom. Il suffit de se rappeler l'exemple de l'assimilation des divinités grecques aux divinités romaines. Mais l'erreur consiste à vouloir que toutes les légendes aient une origine semblable.
§ 678. Comme d'habitude, recourons à l'expérience pour savoir comment ces légendes se constituent (§ 547). Nous avons de nombreux cas dans lesquels il est certain que le nom d'une personne, à laquelle on prête diverses aventures, n'est pas du tout celui de deux ou plusieurs personnes qui se sont fondues ensemble. Par exemple, on attribue à Mme de Talleyrand une aventure assez comique [FN: § 678-1] ; mais si l'on tâche de vérifier le fait, on voit qu'elle était déjà connue avant la naissance de Mme de Talleyrand. Celle-ci avait la réputation d'une femme stupide, et on lui attribuait les aventures qui conviennent aux femmes stupides. Au contraire, son mari avait la réputation d'un homme d'esprit, avisé, intelligent ; et par le même procédé, on lui attribuait tous les bons mots qu'on pouvait trouver. Après avoir dit que Talleyrand s'attribuait souvent les bons mots de l'Improvisateur français, E. Fournier ajoute [FN: § 678-2] : « (p. 267) M. de Talleyrand était souvent approvisionné d'esprit avec moins de peine encore. Il lui en arrivait de partout, sans qu'il y songeât, sans même qu'il le sût. Tout mot bien venu prenait son nom pour enseigne, et ainsi recommandé ne faisait que mieux son chemin, en raison de cette nonchalante habitude des causeurs que Nodier définit ainsi : « C'est le propre de l'érudition populaire de rattacher toutes ses connaissances à un nom vulgaire [FN: § 678-*] ». Un mot ne lui venait quelquefois à lui-même que harassé, défloré. L'apprenant après tout le (p. 268) monde, il en riait naïvement comme d'une nouveauté, quand chacun était las d'en rire ».
§ 679. Voici encore une personne historique, mais de l'antiquité, à laquelle on prête nombre d'aventures chronologiquement impossibles. C'est la courtisane Laïs. Comme d'habitude, pour écarter les difficultés de la narration, on suppose deux Laïs. «La conjecture – dit Bayle [FN: § 679-1] – de ceux qui disent qu'il y a eu deux courtisanes nommées Laïs est fondée sur ce que la chronologie ne souffre pas que l'on applique à la même femme tout ce qui se dit de Laïs ».
Mais cela ne suffit pas ; et pour accepter les faits du récit, Bayle fait voir qu'il faut admettre trois Laïs. D'ailleurs, ajoute-t-il très justement, il est préférable de supposer qu'on a attribué à Laïs les aventures d'autres courtisanes.
§ 680. Il y a des légendes dont l'origine est historique. Par exemple, la Chanson de Roland, étudiée par G. Paris [FN: § 680-1] . Un fait historique paraît certain : « (p. 3) Le 15 août 778, l'arrière-garde de l'armée que le roi des Francs, Charles, ramenait d'Espagne après une expédition à moitié heureuse, fut surprise dans les Pyrénées par les Basques navarrais – avec lesquels les Francs n'étaient pas en guerre ouverte et entièrement détruite ». Le roi revint en arrière, mais ne put venger le désastre des siens, et dut continuer sa route. « (p. 3) Telle est la version que donnent les Annales (p. 4) royales et la Vie de Charlemagne d'Einhard ; c'est celle qu'ont adoptée tous nos historiens. La version arabe est toute différente, d'après Ibn-al-Athîr... ce furent les musulmans de Saragosse – ceux-là même qui avaient appelé Charles en Espagne – qui firent subir à l'armée franque, lorsqu'elle était hors du territoire arabe et se croyait en pleine sûreté, le grave échec dont il s'agit ».
Sur ce fondement historique fort étroit, est construit un vaste édifice de légendes, sans qu'aucun caractère extrinsèque nous autorise à remonter de ces légendes à la réalité historique. Après avoir essayé de reconstituer l'histoire du combat, G. Paris observe : « (p. 53) De cette image du combat telle que nous pouvons nous la former, il ne reste pas grand'chose (p. 54) dans nos poèmes ». Et il conclut : « (p. 61) Il résulte de toutes ces remarques... que la Chanson de Roland repose certainement, à l'origine, sur une connaissance directe des faits, des hommes et des lieux, et présente même en certains points une concordance tout à fait remarquable avec les renseignements fournis par l'histoire ; mais que la forme où elle nous est arrivée, postérieure de trois siècles à la forme première, est extrêmement éloignée de celle-ci et est due en très grande partie aux inventions successives d'amplificateurs (p. 62) et remanieurs, qui se souciaient uniquement de l'effet poétique, et qui d'ailleurs, en dehors de la Chanson même, n'avaient aucun moyen... de se procurer des renseignements sur les faits célébrés dans le poème ». Mais à quoi sert de savoir qu'une légende a un fond historique, si les moyens de le reconnaître sous le voile de la légende nous font défaut ? La Chanson de Roland avait un fond historique. Induits en erreur par l'analogie, voudrions-nous étendre cette conclusion à toutes les légendes du cycle de Charlemagne ? [FN: § 680-2]. Ce serait une grossière erreur, car il y en a beaucoup auxquelles ce fond historique fait défaut.
Nous concluons donc que si le critère consistant à tenir pour légendaire tout ce qui sent le surnaturel, peut avoir quelque succès pour les œuvres principalement historiques, il est au contraire presque toujours trompeur pour les légendes ; nous en avons des preuves en grand nombre. On ne peut donc tirer que peu ou point de réalité historique, et plutôt point que peu, des légendes dépourvues d'autres adjonctions historiques extrinsèques.
§ 681. (B-β 1) Les mythes, etc., ont une origine historique, et le récit a été altéré avec le temps. Les observations que nous venons de faire pour le genre β s'appliquent aussi à l'espèce (β 1), qui fait partie de ce genre. Un type de cette espèce est l'évhémérisme, que nous appellerons ancien, pour le distinguer du néo-évhémérisme de Spencer.
§ 682. L'histoire d'Évhémère ne nous est pas bien connue. On y peut distinguer deux parties : une interprétation, et les preuves qu'on en donne. L'interprétation, qui voit dans les dieux des hommes divinisés, est en partie vraie, sinon dans les cas signalés par Évhémère, du moins dans d'autres analogues. Les preuves n'ont pas la moindre valeur. Évhémère affirmait être parvenu dans ses voyages à une île nommée Panchea, qui était entièrement consacrée aux dieux, et y avoir vu un temple de ![]() édifié par ce dieu en personne, tandis qu'il habitait la terre. Dans ce temple, il y avait une colonne d'or sur laquelle étaient écrits les faits attribués à Ouranos, à Chronos, à Zeus, qui tous trois avaient vécu et régné. Évhémère remplissait entièrement un livre, intitulé
édifié par ce dieu en personne, tandis qu'il habitait la terre. Dans ce temple, il y avait une colonne d'or sur laquelle étaient écrits les faits attribués à Ouranos, à Chronos, à Zeus, qui tous trois avaient vécu et régné. Évhémère remplissait entièrement un livre, intitulé ![]() des exploits d'hommes devenus dieux.
des exploits d'hommes devenus dieux.
En fin de compte, nous ne savons pas si ces voyages étaient donnés comme preuves, ou s'ils étaient une simple fiction pour exposer une théorie qui disposait d'ailleurs de preuves meilleures. Plusieurs écrivains anciens ont considéré les récits d'Évhémère comme de simples mensonges. Strabon est de cet avis. Après avoir rappelé certains récits qu'il tient pour fabuleux, il ajoute [FN: § 682-1] : «Tout cela diffère peu des fables de Pittéas, d'Évhémère et d'Antiphane ; mais à eux on les leur pardonne ; ces charlatans s'entendaient bien à leur métier... ». Polybe aussi semble avoir tenu Évhémère pour un vrai menteur ; mais ce n'était que les preuves d'Évhémère qu'il rejetait, car, au sujet de l'interprétation, Polybe voyait aussi des hommes dans les dieux. Il dit, par exemple [FN: § 682-2] : (5) « Éole enseignait aux navigateurs comment ils devaient se comporter dans le détroit [de Sicile], fait en serpentin et d'une issue difficile, à cause du flux et du reflux. C'est pourquoi il fut appelé dispensateur des vents et tenu pour leur roi ». Il continue en citant des cas semblables, et finit par dire : (8) « Ainsi nous trouvons qu'en chacun des dieux on honore l'inventeur de choses utiles ».
§ 683. Polybe connaissait d'ailleurs des faits réels qui démontraient comment on avait divinisé des hommes. Il observe (X, 10, 11) que près de Carthagène il y a trois petites collines. « Celle qui est au levant est appelée colline d'Hèphaestos ; celle qui est voisine porte le nom d'Alestos. On dit que ce dernier a obtenu d'être honoré comme un dieu, pour avoir découvert des mines d'argent. La troisième est appelée colline de Chronos ».
§ 684. Les Pères de l'Église, qui, en général, n'employaient guère la critique historique, devaient accueillir favorablement la théorie et les preuves d'Évhémère, qui faisaient justement leur affaire.
Saint Augustin (De civ. dei, VII, 18) pense que l'opinion la plus croyable, au sujet des dieux, est l'hypothèse qu'ils ont été des hommes. Chacun d'eux, suivant ses aptitudes, ses habitudes, ses actions et les hasards, a obtenu de ses admirateurs d'être considéré comme un dieu et d'avoir un culte et des cérémonies. Il dit ailleurs (De civ. dei, VI, 7) : « Que pensaient du même Jupiter ceux qui placèrent sa nourrice au Capitole ? Ne sont-ils pas d'accord avec Évhémère, qui écrivit, non sous forme d'un bavardage fabuleux, mais avec le souci de l'histoire, que tous ces dieux avaient été hommes et mortels ? »
Lactance prend au sérieux ce que dit Ennius, interprète d'Évhémère, au sujet des règnes d'Uranus et de Saturne [FN: § 684-1]. Minucius Félix (XXI) dit : « Lis les écrits des historiens ou des philosophes ; tu reconnaîtras avec moi que les hommes ont été déifiés, à cause de leurs mérites ou de leurs largesses, comme le raconte Évhémère, qui nous fait connaître leurs dates de naissance, leurs patries, leurs tombeaux, dont il indique le lieu, comme pour Jupiter Diktéen, Apollon Delphien, Isis de Faria, Cérès d'Éleusis. Prodicus dit qu'on a déifié ceux qui, secourant les pays et trouvant de nouvelles utilités aux produits, les révélèrent aux hommes. Persée est aussi du même avis ; il ajoute qu'on donna leurs noms aux découvertes ; d'où vient le plaisant dicton : Vénus languit, sans Liberus et Cérès ».
685. Très nombreuses furent et sont toujours les interprétations qui appartiennent à ce genre, et par lesquelles on cherche à enlever les parties les moins croyables d'un récit, pour pouvoir sauver le reste. Aussi les naissances miraculeuses, par exemple, se changent-elles en naissances naturelles.
§ 686. À ce genre appartiennent les théories d'après lesquelles on peut, d'un nom, déduire la nature et les propriétés de la chose qui porte ce nom (chap. X). Ces théories ont pour prémisses, au moins implicites, qu'à l'origine, on a donné aux choses un nom qui correspond précisément à leur nature. À ces prémisses, les métaphysiciens peuvent en ajouter d'autres, toujours implicitement ; car, estimant que les choses sont comme se les imagine l'esprit humain, ils croient qu'il est indifférent de raisonner sur le nom ou sur la chose. En somme, c'est un des très nombreux cas dans lesquels on donne une existence objective à des sentiments subjectifs. Cette théorie atteint le comble de l'absurde dans le Cratyle de Platon.
§ 687. Laissons de côté ces considérations a priori et, comme d'habitude, recourons à l'expérience. Il est vrai que, de nos jours, les hommes de science tâchent de donner aux choses nouvelles des noms nouveaux, qui en indiquent quelque propriété. Dans ce cas, l'étymologie pourrait donc être utile pour trouver, sinon les propriétés réelles des choses, du moins l'idée qu'en avait celui qui a découvert la chose. Ainsi, le nom oxygène nous indique non pas que ce corps est le seul générateur d'oxydes, mais que tel se le figuraient ceux qui lui donnèrent ce nom.
Les noms donnés par le vulgaire, et par conséquent la majeure partie des termes du langage courant, n'ont pas même cet usage limité, et dépendent de circonstances accidentelles, qui n'ont souvent rien ou presque rien à faire avec le caractère des choses. [FN: § 687 note 1)]. Voyons un exemple.
§ 688. Parmi les interprétations rigoureusement étymologiques, il y en a une qui est demeurée célèbre. Longtemps on a dit et répété que servus, c'est-à-dire esclave, venait de servare, c'est-à-dire conserver, maintenir sain et sauf ; et, de cette étymologie, ou a tiré une superbe théorie de l'esclavage. Les Institutes de Justinien disent [FN: § 688-1] : « Les esclaves (servi) sont ainsi appelés parce que les généraux ordonnaient de vendre les prisonniers; c'est pourquoi ou avait l'habitude de les conserver (servare) et non de les tuer ». Mais aujourd'hui, cette étymologie ne vaut plus rien. À ce qu'il paraît, servus veut dire gardien de la maison. Ainsi est anéantie cette excellente théorie de l'esclavage. C'est vraiment dommage ! S'il y a des gens qui ont à mettre au jour une théorie de l'esclavage, déduite de l'étymologie de servus, ils feront bien de se dépêcher, parce que bientôt l'étymologie que nous venons de donner pourrait de nouveau changer [FN: § 688-2].
§ 689. En Italie et dans les pays où travaillent beaucoup d'ouvriers italiens, on emploie le nom de Kroumir, pour désigner les ouvriers qui travaillent tandis que leurs compagnons font grève. Si ce mot était ancien, on en pourrait tirer de belles théories étymologiques. Kroumir pourrait venir de ![]() , heurter, frapper, qui donne
, heurter, frapper, qui donne ![]() , coup, meurtrissure
; ainsi l'étymologie nous apprendrait que les Kroumirs sont frappés par leurs compagnons. Beaucoup d'étymologies qui ont eu et ont encore cours sont pires que celle-là [FN: § 689-1]. Mais nous savons d'où vient ce nom. Les Kroumirs étaient une tribu de la Tunisie. Les Français prirent prétexte de prétendues déprédations de cette tribu pour envahir la Tunisie. Le mécontentement éprouvé de ce fait en Italie fit que le nom de Kroumir se trouva associé à des sentiments désagréables ; et quand les ouvriers éprouvèrent d'autres sentiments désagréables envers ceux dont ils pensaient être trahis dans les grèves, ils employèrent sans autre ce mot de Kroumir.
, coup, meurtrissure
; ainsi l'étymologie nous apprendrait que les Kroumirs sont frappés par leurs compagnons. Beaucoup d'étymologies qui ont eu et ont encore cours sont pires que celle-là [FN: § 689-1]. Mais nous savons d'où vient ce nom. Les Kroumirs étaient une tribu de la Tunisie. Les Français prirent prétexte de prétendues déprédations de cette tribu pour envahir la Tunisie. Le mécontentement éprouvé de ce fait en Italie fit que le nom de Kroumir se trouva associé à des sentiments désagréables ; et quand les ouvriers éprouvèrent d'autres sentiments désagréables envers ceux dont ils pensaient être trahis dans les grèves, ils employèrent sans autre ce mot de Kroumir.
§ 690. Ce cas est le type d'une classe très étendue. Tous les jours, nous voyons se former des mots et des locutions qui ont pour origine des associations d'idées souvent tout à fait fortuites [FN: § 690-1]. Celui qui, dans les siècles futurs, voudrait connaître par ces mots et ces locutions les choses qu'ils désignaient, tomberait certainement dans l'erreur. Il est par conséquent manifeste que si nous voulons suivre maintenant cette méthode pour connaître l'antiquité, peut-être pouvons-nous être parfois dans le vrai, mais nous tomberons facilement dans l'erreur.
§ 691. L'opération étymologique directe tire le nom, des propriétés des choses ; l'opération inverse attribue aux choses certaines propriétés, simplement à cause de leur nom. Cette opération inverse paraît avoir joué un grand rôle dans la mythologie, et beaucoup d'événements semblent avoir été inventés à cause des noms [FN: § 691-1]. Pourtant, en de nombreux cas, il n'y a que de légères probabilités, et l'on n'a pas de preuves certaines.
L'étymologie sert aussi dans un autre genre d'interprétations c'est dans le genre (γ) de la classe B, comme nous le verrons plus loin (§ 780 et sv.).
§ 692. (B-β 3) Les mythes, etc., sont le produit d'expériences mal interprétées, de déductions fausses de faits réels. Ce genre diffère du précédent en ce qu'on donne une plus grande place à l'expérience, sinon en réalité, au moins en apparence, et que les déductions pseudo-expérimentales sont plus longues, plus ingénieuses et plus subtiles.
§ 693. La théorie de l'animisme appartient à ce genre. Elle prend plusieurs formes. Sous sa forme la plus précise, elle affirme que les peuples primitifs sont persuadés que l'homme, les animaux, les végétaux, même les êtres non-vivants ont une âme ; et d'après elle, les phénomènes religieux tirent leur origine et leur développement des déductions logiques de cette croyance. Sous une forme moins précise, on dit : « Nous pouvons affirmer que l'enfant et le sauvage sont animistes ; c'est-à-dire qu'ils projettent à l'extérieur la volonté qui agit en eux, qu'ils peuplent de vie et de sentiments semblables aux leurs le monde et en quelque sorte les êtres et les objets qui les entourent».
Ni ici ni ailleurs, nous ne voulons résoudre le problème des « origines », au point de vue chronologique (§ 885 et sv.). Les documents font défaut pour cette étude, qui devient ainsi une œuvre de pure imagination. Nous voulons seulement chercher à décomposer les phénomènes complexes en d'autres plus simples, et à en étudier les rapports. Il se peut que les phénomènes simples aient précédé chronologiquement les phénomènes composés ; il se peut aussi que c'ait été le contraire. Pour le moment, nous ne nous en occupons pas.
Dans la première forme d'animisme, il y a évidemment des déductions plus étendues que dans la seconde ; mais elles ne manquent pas non plus dans celle-ci. Pour la ramener à des sentiments correspondant à des actions non-logiques, il faut en changer les termes et dire que l'enfant et le sauvage en nombre de cas, et même parfois l'homme civilisé, agissent de la même manière envers les êtres humains, les êtres vivants, et même les objets avec lesquels ils sont en rapport.
§ 694. Quand on veut donner une teinte logique à ces actions non-logiques, on ajoute des déductions. On peut dire : « J'agis de cette façon, parce que je crois que les animaux, les plantes, les objets avec lesquels je suis en rapport, ont une volonté comme moi j'en ai une et comme en ont les autres hommes ». Ou bien on peut allonger les déductions, en attribuant une cause à cette volonté, en en faisant un caractère essentiel d'une entité nommée âme, et en affirmant que d'autres êtres ont une âme, comme l'homme a une âme.
Tylor va même un peu plus loin [FN: § 694-1] . Il dit : « (p. 493) La croyance à des êtres spirituels, tel est, dans sa plus large acception, le sens du mot spiritualisme ; c'est dans le même sens que nous employons ici le terme animisme ». Puis il ajoute: « (p. 494) L'animisme caractérise les tribus les plus inférieures dans l'échelle de l'humanité ; puis, de ce premier échelon, modifié profondément dans le cours de son ascension, mais, du commencement à la fin, gardant une continuité parfaite, il monte et s'élève jusqu'à la hauteur de notre civilisation moderne ».
Ce serait donc une évolution de ces sentiments non-logiques – ou de leur expression – que décrit notre auteur. À vrai dire, on est surpris que « les tribus les plus basses » de l'humanité aient déjà une théorie aussi subtile que celle de l'existence d'êtres spirituels. Leur langue même doit être assez perfectionnée pour pouvoir exprimer les abstractions être et spirituel. Il faut en outre qu'elle soit assez bien connue des voyageurs, pour qu'ils puissent en traduire avec précision ces termes dans nos langues.
§ 695. Notons que certains doutes subsistent encore, au sujet de langues pourtant très connues [FN: § 695-1]. Ainsi, pour la morale chinoise, on nous dit [FN: § 685-2] : « (p. 2) Rien n'est donc plus facile, pour le traducteur, que de céder à la tentation de solliciter le texte pour lui faire dire ce qui lui plaît, et, bien entendu, cette tentation est toujours grande quand il s'agit de traductions d'œuvres de philosophie ou de morale ». Il est donc raisonnable de se demander si les missionnaires et les voyageurs, par l'intermédiaire desquels nous connaissons les faits des peuples sauvages ou même seulement barbares, n'ont pas altéré le sens des termes dans leurs traductions [FN: § 695-3]. Mais enfin toute présomption, fût-elle même raisonnable et probable, doit s'effacer devant les faits. C'est donc à ceux-ci que nous demandons la solution de notre problème.
§ 696. D'abord, nous ne pouvons pas ranger parmi les phénomènes de l'animisme ceux qu'on observe chez nos enfants. Il est certain que ceux-ci parlent au chien de la maison et à leur poupée, comme si chiens et poupées pouvaient comprendre, et cela bien avant que les enfants aient les idées exprimées par les termes êtres et spirituels. Il y a plus ; même parmi les adultes, un chasseur qui tient des discours à son chien, serait ébahi, quand on lui demanderait s'il croit s'adresser à un être spirituel. En réalité, dans tous ces cas, nous avons des actions non-logiques, des expressions de certaines tendances, et non le fruit de déductions logiques [FN: § 696-1].
§ 697. Mais cela ne prouve rien quant aux sauvages ; aussi devons-nous examiner directement les faits qui se rapportent à eux. Tylor nous avertit que toutes ses recherches sont faites selon deux principes [FN: § 697-1] . « (p. 495) Les doctrines et les pratiques religieuses examinées sont d'abord considérées comme faisant partie de systèmes théologiques enfantés par la raison humaine sans l'intervention d'agents surnaturels et sans révélation, en d'autres termes, comme des développements de la religion naturelle. Ensuite, ces mêmes doctrines et ces pratiques sont considérées au point de vue des rapports existant entre les idées et les rites analogues du monde sauvage et du (p. 496) monde civilisé ».
§ 698. Le premier principe tend à résoudre a priori un problème qui ne devrait trouver sa solution que dans l'observation. Rien ne nous permet de voir, dans les doctrines et les pratiques religieuses, que le seul fruit de la raison, en excluant ainsi les actions non-logiques. Il est clair, d'autre part, que si nous les excluons a priori, nous ne pourrons les trouver ensuite dans les faits. Ce qui suit confirme cette observation. « (p. 496) Quelle idée les races inférieures se font-elles de l'âme ? Nous pouvons l'expliquer clairement, en reconstituant l'histoire du développement des doctrines animistes ». Dans ce passage, on trouve les erreurs habituelles de ce mode de raisonnement. 1° On traite de l'abstraction métaphysique âme, comme si c'était une chose réelle. Tout homme ayant des yeux voit le soleil. On peut donc chercher quelle idée il s'en fait ; – souvent cette idée est très confuse ; – mais avant de connaître l'idée qu'il se fait de l'âme, il faut savoir si, dans son esprit, quelque idée correspond vraiment à ce terme. 2° Nous voilà conduits aux reconstructions de théories des peuples sauvages, faites avec nos idées d'hommes civilisés contemporains. De cette façon, nous obtenons, non pas les théories des peuples sauvages, – si toutefois ils en ont – mais, ce qui est très différent, les théories que nous formerions si, mettant de côté certaines de nos idées, de nos connaissances, nous raisonnions avec notre logique, exclusivement sur les idées et les connaissances qui restent.
§ 699. Voici en effet comment Tylor continue : « (p. 496) L'intelligence humaine, encore à un état de culture peu avancé, semble surtout préoccupée de deux catégories de problèmes biologiques. À savoir : d'abord ce qui constitue la différence entre un corps vivant et un corps mort, la cause de la veille, du sommeil, de la catalepsie, de la maladie, de la mort. Ensuite, la nature de ces forces humaines qui apparaissent en rêve et dans les visions. Méditant sur ces deux ordres de phénomènes, les anciens philosophes sauvages doivent avoir été amenés dans le principe à cette induction toute naturelle qu'il y a dans chaque homme une vie et un fantôme. Ces deux éléments sont en étroite connexion avec le corps. La vie le rend apte à sentir, à penser, à agir ; le fantôme est son (p. 497) image, un second lui-même. Tous deux, aussi, sont nettement séparables du corps, – la vie est susceptible de s'en retirer, de le laisser insensible ou mort ; le fantôme peut apparaître à des personnes qui en sont éloignées ».
§ 700. Cette façon d'étudier les phénomènes, bien qu'un peu meilleure peut-être, part cependant toujours des mêmes principes que la manière employée par Rousseau (§ 821), qui écarte les faits pour ne se confier qu'à sa seule imagination. Il est certain que si les sauvages ont eu un Aristote, il aura pu raisonner avec cette logique rigoureuse, sur ces abstractions métaphysiques ; mais reste à savoir si cet Aristote a existé. Ajoutons qu'après avoir si bien raisonné, il faut que ces hommes en aient perdu l'habitude, puisqu'aux temps historiques, nous trouvons des raisonnements qui sont bien loin d'être aussi logiques et aussi clairs que ceux dont on gratifie leurs ancêtres sauvages.
§ 701. Nous ne chercherons pas comment les peuples sauvages ou barbares ont dû raisonner, mais bien comment ils raisonnent effectivement. Nous ne voulons pas nous écarter des faits, comme on s'en écarte dans la méthode chère à Rousseau (§ 821) et à ses disciples ; tout au contraire, nous tâchons de nous garder autant que possible de l'imagination, et de nous en tenir le plus étroitement que nous pouvons aux faits. Innombrables sont les faits démontrant que les peuples sauvages ou barbares ne sont que peu ou pas du tout portés aux raisonnements abstraits [FN: § 701-1], qu'ils sont fort éloignés de vouloir résoudre des problèmes métaphysiques ou philosophiques, ou même seulement quelque peu abstraits, et que souvent ils sont même très peu curieux.
§ 702. À propos de la tribu nègre dite des Mandingues, Mungo Park dit [FN: § 702-1] : « (p. 21) J'ai souvent demandé à quelques uns d'eux ce que devenoit le soleil pendant la nuit, et si le matin nous (p. 22) reverrions le même soleil, ou un autre que la veille. Mais je remarquai qu'ils regardoient ces questions comme très puériles. Ce sujet leur paraissoit hors de la portée de l'intelligence humaine. Ils ne s'étoient jamais permis de conjectures, ni n'avoient fait d'hypothèses à cet égard ». L'auteur dit d'autre part que « (p. 24) la croyance d'un Dieu, ainsi que celle d'un état futur de peines et de récompenses est universelle chez eux ». Mais reste à savoir si Mungo Park n'a pas un peu prêté ses idées à ces hommes, car il ajoute aussitôt des choses qui ne s'accordent pas très bien avec cette croyance. « (24) Si on leur demande (p. 25) pourquoi donc ils font des prières lorsqu'ils voient la nouvelle lune, ils répondent que l'usage en a fait une loi, et qu'ils le font parce que leurs pères l'ont fait avant eux. Tel est l'aveuglement de l'homme que n'a point éclairé la lumière de la révélation ». Puis : «(p. 25) Lorsqu'on les interroge en particulier sur leurs idées d'une vie future, ils s'en expriment avec un grand respect : mais ils tâchent d'abréger la discussion en disant mo o mo inta allo (personne ne sait rien là-dessus). Ils se contentent, disent-ils, de suivre, dans les diverses occasions de la vie, les leçons et les exemples de leurs (p. 26) ancêtres ; et lorsque ce monde ne leur offre ni jouissance, ni consolations, ils tournent des regards inquiets vers un autre, qu'ils supposent devoir être mieux assorti à leur nature, mais sur lequel ils ne se permettent ni dissertations, ni vaines conjectures ».
§ 703. Tout cela n'empêche pas qu'il y ait eu des peuples possédant une théorie de l'animisme analogue à celle mentionnée par Tylor [FN: § 703-1] ; le fait est même certain ; mais cela ne prouve pas le moins du monde, ni que ce phénomène soit l'« origine » de la religion, ni qu'il soit une forme simple de religions plus complexes.
§ 704. La réfutation que Herbert Spencer fait de l'animisme a les mêmes défauts que la théorie qu'il critique. Spencer cite [FN: § 704-1] des faits qui montrent que « (185) en nous élevant dans l'échelle animale, nous voyons que la faculté de distinguer l'animé de l'inanimé augmente. D'abord extrêmement vagues, les actes discriminatifs deviennent peu à peu plus définis ; d'abord très-généraux, ils deviennent ensuite plus spéciaux ; enfin les actes de classification deviennent moins souvent erronés. D'abord le mouvement, puis le mouvement spontané, puis le mouvement spontané adapté, tels sont les signes auxquels l'intelligence a successivement recours à mesure qu'elle progresse ».
Le fond de ces observations est vrai ; la forme est fausse ; et, malheureusement, dans la suite du raisonnement de Spencer, la forme prévaut. Ce que Spencer appelle classification est bien tel pour nous, mais pas pour les animaux qui la font.
§ 705. Revenons un instant aux expériences que nous avons rappelées, de Fabre (§ 155), sur les cerceris. Afin de pourvoir leurs larves, d'animaux encore vivants, mais paralysés, ils choisissent certaines espèces de coléoptères. Le terme choisissent appelle une explication. Si nous disons que les cerceris choisissent ces coléoptères, nous exprimons le point de vue objectif, et, en ce sens, la proposition est vraie. Mais personne n'admettrait que les cerceris connaissent nos classifications, et qu'ils choisissent ces espèces de coléoptères, comme pourrait le faire un entomologiste qui classe les insectes. Nous ignorons comment et pourquoi les cerceris choisissent ; mais il est certain que ce n'est pas de la manière rationnelle, scientifique, d'un entomologiste. On peut observer des faits semblables chez les hommes, et l'on ne doit pas confondre ces actions non-logiques avec des actions logiques, comme le sont les classifications scientifiques.
§ 706. Herbert Spencer étend les actions logiques aux animaux. Il dit [FN: § 706-1] : « (p. 184) Il y a encore un signe auquel les animaux intelligents distinguent le vivant du non-vivant : c'est l'adaptation du mouvement à ses fins. Quand un chat s'amuse d'une souris qu'il a attrapée, s'il la voit demeurer longtemps immobile, il la touche du bout de sa griffe pour la faire courir. Évidemment le chat pense qu'un être vivant qu'on dérange cherchera à s'échapper, et que ce sera pour lui un moyen de recommencer la chasse. Non seulement il s'attend à un mouvement spontané, en ce sens que c'est la souris qui le produira ; mais il s'attend à voir ce mouvement dirigé dans un sens qui éloigne la souris du danger » (§ 63).
En gros, le fait est vrai ; la façon dont il est décrit est entièrement fausse ; et l'erreur consiste à supposer que l'animal raisonne comme un homme logique [FN: § 706-2] . 1° Les animaux n'ont pas la notion abstraite du vivant et du non-vivant. Il suffit d'observer attentivement un chien pour s'en assurer. Les animaux peuvent encore moins savoir ce que sont des fins et une adaptation. 2° Rien ne nous permet de croire que le chat pense qu'un être vivant qui vient à être secoué cherche à fuir. Le chat a l'habitude de toucher avec la patte tout petit objet, et si possible de le faire bouger ; et l'on n'observe pas la moindre différence, à ce point de vue, entre un porte-plume qu'il connaît bien, par exemple, et une souris ou un insecte. Il agit très certainement comme s'il n'avait pas ces notions abstraites de vivant et de non-vivant, dont le gratifie Spencer. 3° De même, il n'a pas de notions qui correspondent aux termes abstraits indiquant un mouvement qui éloigne la souris du danger. Qui veut s'en assurer n'a qu'à prendre une boule de papier, l'attacher à un fil et la faire bouger, en l'approchant on en l'éloignant du chat. Il verra que celui-ci saute également sur la boule, qu'elle se meuve dans un sens ou dans l'autre. Laissez ensuite la boule immobile, au milieu de la chambre, et vous verrez bientôt le chat s'approcher et la toucher avec la patte, d'une manière tout à fait semblable, identique à celle dont il touche une souris ; il n'y a vraiment pas la moindre différence ; et pourtant, ici l'on ne peut dire avec Spencer qu’« un être vivant qu'on dérange cherchera à s'échapper ». Et si l'on venait à objecter qu'il croit la boule de papier vivante, cela signifierait qu'il est incapable de distinguer le vivant du non-vivant, et tout le raisonnement de Spencer tomberait. En tout cas, on voit clairement que Spencer a simplement traduit dans le langage des actions logiques, les actions non-logiques du chat. D'autres traduisent de la même façon les actions non-logiques des hommes.
§ 707. Le même Spencer passe des animaux aux hommes [FN: § 707-1] . « (p. 186) Dirons-nous que l'homme primitif est moins intelligent que les animaux inférieurs, moins intelligent que les oiseaux et les reptiles, moins même que les insectes ? À moins de cela, il faut dire que l'homme primitif distingue le vivant du non-vivant, et, si nous lui accordons plus d'intelligence qu'aux bêtes, il faut conclure qu'il le distingue mieux qu'elles ».
Cette manière de raisonner serait excellente si les actions étaient exclusivement logiques ; elle n'a pas la moindre valeur pour les actions non-logiques. Elle prouve trop ; c'est pourquoi elle ne prouve rien. Si elle était valable, elle aurait pour conséquence que l'homme, qui est certainement plus intelligent que les cerceris, doit distinguer mieux qu'eux les espèces de coléoptères dont les cerceris font leur proie. Adressez-vous si vous voulez à un homme très intelligent, même très instruit dans toutes les sciences, sauf en entomologie, et demandez-lui de vous trouver l'un de ces coléoptères. Vous verrez qu'il en est absolument incapable.
§ 708. Spencer a une autre théorie animiste, qui, développée, le conduit à un néo-évhémérisme dont le résultat est le même que celui de l'ancien ; mais la démonstration est différente. L'ancien évhémérisme possédait des preuves pseudo-historiques ; le nouveau tire ses preuves des déductions logiques de certains faits qui nous paraissent probables. Il y a quelque analogie avec l'évolution qui, dans la religion, substitue le consentement interne à l'autorité externe.
§ 709. Spencer suppose que le sauvage interprète ses rêves, le phénomène de la catalepsie et celui de la mort, avec une logique rigoureuse. Par une suite de déductions ingénieuses, le sauvage tire la conclusion qu'il existe un double de l'homme, qui peut se séparer du corps ; et il étend cette conclusion aux plantes et aux objets inanimés. Puisqu'on ne voit, dans la syncope et dans la catalepsie, qu'un état temporaire, le sauvage, raisonnant comme Spencer trouve qu'il doit raisonner, croit que la mort est aussi temporaire, ou que si elle est définitive, c'est parce que le double est trop longtemps loin du corps [FN: § 709-1] . « (p. 255) La croyance à la réanimation suppose la croyance à une vie subséquente ». Par conséquent, toujours suivant la logique, naît l'idée d'un autre monde. « (p. 294, § 114). La transition d'un séjour sur une montagne à un séjour dans le ciel, tel que les hommes primitifs conçoivent le ciel, ne présente aucune difficulté ». Et voilà le ciel peuplé de doubles d'hommes. « (p. 295, § 114) Mais,... l'origine qui fait descendre les hommes d'en haut, qui entraîne à croire que les morts vivent sur des sommets ou dans les cieux, n'est pas la seule origine possible ; il y en a une autre, qui est même probable et qui ne mène pas à la même conclusion ; au contraire, elle réserve cette demeure céleste à une race d'êtres différents à l'exclusion de toute autre ». Cette race est constituée par des « (p. 297, § 114) chefs appartenant à une race d'envahisseurs, importateurs de connaissances, de métiers, d'arts, d'engins, inconnus aux indigènes, passant pour des êtres d'un ordre supérieur, comme les hommes civilisés le sont aujourd'hui aux yeux des sauvages... ». Ces hommes se sont établis sur les sommets, près des nuages, et sont devenus des habitants du ciel, des divinités.
§ 710. L'origine des dieux connue de cette manière, nous expliquons facilement les autres phénomènes religieux [FN: § 710-1] . « (p. 437, § 162)... le culte du fétiche est le culte d'un esprit résidant dans le fétiche, ou d'un être surnaturel dérivé du fétiche... ». « (p. 443, § 164) Les sacrifices propitiatoires aux morts, d'abord origine des rites funèbres, plus tard des observances qui constituent le culte d'une manière générale, aboutissent donc, entre autres résultats différents, à l'idolâtrie et au fétichisme ».
Nous verrons plus loin (§ 793 et sv.) comment, de sa théorie, Spencer tire aussi l'explication du totémisme et des mythes analogues aux mythes solaires.
§ 711. La théorie de Spencer n'est ni meilleure ni pire que d'autres du même genre qui ont toutes le même caractère ; c'est-à-dire qu'on y prend pour prémisses certains faits supposés, mais qui sont grosso modo d'accord avec les faits observés ; puis on raisonne comme on croit que « l'homme primitif » a dû raisonner, et de ces prémisses on tire certaines conclusions. On est persuadé d'avoir ainsi découvert la façon dont certains phénomènes se sont produits, en des temps pour lesquels tout souvenir historique ou expérimental nous fait défaut.
§ 712. Dans ces théories, il y a une partie expérimentalement vraie. L'erreur consiste à passer du particulier au général, comme le ferait celui qui, ayant vu une forêt de sapins, affirmerait que toutes les forêts sont de sapins. Cette part de vérité expérimentale est notable dans le totémisme. Salomon Reinach propose d'énoncer de la façon suivante le code du totémisme [FN: § 712-1] . « (p. 17) 1° Certains animaux ne sont ni tués, ni mangés, mais les hommes en élèvent des spécimens et leur donnent des soins (p. 18.) 2° On porte le deuil d'un animal mort accidentellement et on l'enterre avec les mêmes honneurs que les membres du clan. 3° L'interdiction alimentaire ne porte quelquefois que sur une partie du corps d'un animal. 4°, Quand les animaux qu'on s'abstient de tuer ordinairement le sont sous l'empire d'une nécessité urgente, on leur adresse des excuses ou l'on s'efforce, par divers artifices, d'atténuer la violation du tabou c'est-à-dire le meurtre. (p. 19) 5° On pleure l'animal tabou après l'avoir sacrifié rituellement. (p. 20) 6° Les hommes revêtent la peau de certains animaux, en particulier dans les cérémonies religieuses; là où le totémisme existe, ces animaux sont des totems. (p. 21) 7° Les clans et les individus prennent des noms d'animaux; là où le totémisme existe, ces animaux sont des totems. (p. 22) 8° Nombre de clans font figurer des images d'animaux sur leurs enseignes et sur leurs armes ; nombre d'hommes les peignent sur leurs corps ou les y impriment par les procédés du tatouage. (p. 23) 9° Les animaux totem, lorsqu'ils sont dangereux, passent pour épargner les membres du clan totémique, mais seulement ceux qui appartiennent à ce clan par la naissance. (p. 24) 10° Les animaux totem secourent et protègent les membres du clan totémique. 11° Les animaux totem annoncent l'avenir à leurs fidèles et leur servent de guides. (p. 25-26) 12° Les membres d'un clan totémique se croient très souvent apparentés à l'animal totem par le lien d'une descendance commune ».
§ 713. Ce code est trop détaillé, trop précis [FN: § 713-1]. On représente mieux les faits, en disant que le totémisme, tel qu'il est compris par différents auteurs (§ 718-1), est un état d'esprit dans lequel on respecte, on honore, on révère certains animaux, auxquels on croit être uni par certains liens, auxquels on rend des services et dont on en attend.
§ 714. Beaucoup d'auteurs se sont occupés de ces phénomènes, et, comme il arrive habituellement, on a voulu donner un caractère général à ce qui est seulement particulier. Dans le totémisme, on a cru trouver jusqu'à l'origine de la « religion ». Partout où l'on a trouvé quelque fait, même vaguement semblable à celui du totémisme, on a cru démontrer que là existait le totémisme. Salomon Reinach cite un grand nombre de ces preuves. Frazer fait encore pire : l'allusion la plus lointaine à un animal lui suffit pour y voir le totémisme.
§ 715. Probablement sans s'en apercevoir, ces auteurs raisonnent comme le paléontologiste qui, trouvant quelques os fossiles, peut reconstituer l'animal auquel ils appartiennent. Mais les deux cas sont très différents. L'animal est certainement un être unique, dont les parties ont des liaisons nécessaires ; par exemple la dentition et l'alimentation. Il n'existe rien de semblable pour le complexe artificiel auquel on a donné le nom de totémisme. Il est impossible que la mâchoire d'un lion appartienne à un animal herbivore. Il se peut très bien que le fait d'honorer un animal ne soit pas lié à tous les autres caractères que l'on veut attribuer au totémisme.
§ 716. Comme d'habitude, voyons ce que dit l'expérience (547). Supposons que, dans un grand nombre de siècles, on n'ait que peu de renseignements, recueillis çà et là, sur la république de Florence. On constate que cette république entretenait des lions, que la rue où étaient logés ces animaux s'appelait Via dei Leoni et qu'elle conserva ce nom durant des siècles. En outre, des fouilles pratiquées à l'endroit où se trouvait la ville de Florence, ont amené la découverte de nombreux petits lions de pierre appelés marzocchi ; et l'on sait aussi que lorsque la république de Florence faisait la conquête de quelque territoire, elle y érigeait une colonne surmontée du marzocco. Quoi encore ? Il existe des légendes qui montrent que, comme le veut le code du totémisme, les lions respectaient les citoyens florentins [FN: § 716-1]. De cette façon, nous avons un faisceau de preuves bien plus importantes que celles dont se contentent les partisans du totémisme, dans des cas semblables ; et si nous devons les suivre dans leurs déductions, nous sommes forcés d'admettre que le lion a été le totem des Florentins, aux temps de leur république. Pourtant, nous sommes tout à fait certains que cela n'a pas été ; et il n'y a pas la moindre probabilité que cela ait eu lieu en des temps plus anciens, et que le marzocco ait été le totem des Florentins, aux temps de la république romaine, ou même à une époque plus reculée. Donc, si, dans ce cas, les preuves recueillies ne démontrent pas le totémisme, comment des preuves moins nombreuses, moins solides, pourraient-elles bien le démontrer, en des cas semblables ?
§ 717. On a découvert à Muri, près Berne, un groupe représentant une déesse (?) et une ourse ; rien de plus. On y voit la preuve de l'existence d'un clan totémique, dont le totem était l'ours [FN: § 717-1] . Si c'est là une preuve solide, pourquoi ne pourrions-nous pas aussi bien conclure que Venise était habitée par un clan totémique dont le totem était le lion ? C'est plus d'un seul et unique groupe, qu'on y trouve ! À Venise, on en voit beaucoup qui figurent un homme et un lion. Nous savons que l'homme est Saint Marc ; mais si nous ne le savions pas, nous pourrions le prendre pour un dieu, de même que l'image bernoise a été assimilée à celle d'une déesse ; et si celle-ci et son ourse sont la preuve d'un clan totémique, pourquoi l'image de Saint Marc et de son lion ne le serait-elle pas également ?
Si le raisonnement touchant le groupe bernois n’avait d'autre but que d'indiquer la voie à suivre dans nos recherches, on pourrait l'accepter, parce qu'en ce cas il s'appliquerait également bien à Florence et à Venise. Pour Berne, nos recherches ne peuvent être poussées plus avant, toute autre preuve faisant défaut, et nous nous arrêtons sans rien conclure. Pour Florence et Venise, il existe des preuves historiques; et nous allons de l'avant, jusqu'à conclure qu'il n'y a pas trace de totémisme.
§ 718. Tel qu'il est entendu par plus d'un auteur [FN: § 718-1] , le totémisme possède plusieurs caractères : A, B, C, D,... Nous venons de voir que si A se trouve chez un certain peuple, on ne peut conclure que B, C, D,... existent aussi... Vice-versa, si A n'existe pas, on ne peut conclure que B, C, D n'existent pas non plus.
§ 719. Cette considération enlève toute efficacité à certaines critiques que Foucart adresse au totémisme. Par exemple. il observe que [FN:§ 719-1] « (p. 72) tous les membres de la tribu indienne se disent descendants et parents de l'animal totem. Seul le (p. 73) chef égyptien est le descendant du dieu animal. Le Pharaon de l'époque historique est le seul qui soit le fils de l'Épervier, qui porte son nom, et qui, en cette qualité, soit l'héritier du royaume de l'Épervier et le prêtre de l'Épervier. Le reste des hommes de la nation ne sont pas et ne prétendent pas être Éperviers ». On pourrait objecter que les chefs ont peut-être usurpé et se sont approprié exclusivement ce qui jadis était à tous. Mais même si l'on néglige cette observation, et toute autre semblable, la critique de Foucart prouverait seulement qu'il existe une variété de totémisme, qui a le caractère indiqué par lui ; tandis qu'elle ne prouve rien contre le totémisme en général. Pour qu'elle puisse prouver quelque chose dans ce sens, il faudrait que le totémisme fût un corps indivisible. Nous pouvons répéter cela pour d'autres critiques. En somme, Foucart a démontré que le code totémique de Salomon Reinach ne s'appliquait pas à l'Égypte, telle que nous la connaissons ; mais il n'a pas du tout démontré que les Égyptiens n'ont pas eu avec les animaux, des rapports semblables à ceux que le totémisme nous a fait connaître.
On peut faire des observations semblables au sujet de la théorie qui voit dans la magie l'origine de la religion.
§ 720. (B -β 3) Les faits historiques sont des déviations d'un type ou constituent une série ayant une limite [FN: § 720-1] . Souvent, pour les auteurs de ces théories, elles ont un principe supérieur à l'expérience, et devraient par conséquent prendre place dans le genre (γ) de la Ie classe ; mais elles sont exposées uniquement comme des théories expérimentales, et rentrent donc dans ce genre [FN: § 720-2].
§ 721. Nous avons l'hypothèse d'un état primitif de perfection religieuse. Cette perfection se retrouve dans une des religions contemporaines, qui est naturellement la vraie religion. Les autres, que l'histoire nous fait connaître, sont des déviations corrompues du type. Nous avons aussi l'hypothèse contraire. Les diverses religions historiques sont des tentatives imparfaites, qui approchent peu à peu de la perfection. Cette perfection est au terme dont nous nous approchons avec les déviations. Dans l'hypothèse précédente, elle était à l'origine, et les déviations nous éloignaient de la perfection. Les controverses touchant un état primitif de perfection religieuse importent surtout pour l'attaque et la défense des religions juive et chrétienne ; elles sont donc en partie étrangères au domaine de la sociologie.
§ 722. Pendant de longs siècles, en Europe, cet état de perfection était un dogme que l'on ne pouvait mettre en doute sans danger. Puis est venue la réaction ; et à ce dogme on en a substitué un autre, qui n'est pas encore imposé directement par le bras séculier, et qui place l'état de perfection au terme de l'évolution.
§ 723. Nous devons rester étrangers à cette controverse, et nous tenir exclusivement dans le domaine de la science expérimentale. Celui qui a la foi peut aussi rester dans ce domaine, pourvu qu'il veuille séparer la foi de l'expérience. C’est du moins ce que le P. Marie-Joseph Lagrange affirme vouloir faire dans son livre : Études sur les religions sémitiques ; et c'est ce que n'affirment ni ne font certains sectaires du dieu Progrès, comme MM. Aulard, Bayet et Cie [FN: § 723-1].
§ 724. Si nous voulons nous en tenir exclusivement aux faits, nous verrons que le phénomène n'est pas uniformément croissant, ab, ou décroissant, mais qu'il suit une ligne ondulée p q r s t, qui tantôt monte, tantôt descend.
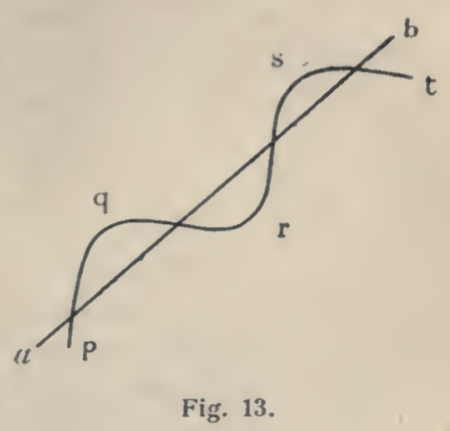
Figure 13.
§ 725. Les mythologies d'Hésiode et d'Homère sont certainement moins abstraites, moins subtiles que la religion de Platon, laquelle l'est encore plus que celle de l'Évangile et des premiers Pères de l'Église. Il parait probable que la Grèce ancienne, après une période archaïque de civilisation, a eu un moyen-âge, suivi d'une renaissance ; et l'on a ainsi un phénomène analogue à celui qui s'est produit en Europe, depuis les temps de la république romaine jusqu'aux nôtres.
§ 726. L'étude de la religion égyptienne paraît conduire aussi à des résultats semblables. Elle nous révèle plusieurs oscillations. Étudiant la dernière religion de l'ancienne Égypte, Erman dit [FN: § 726-1] : « (p. 238) Qui a suivi jusqu'à ce moment le développement de la religion égyptienne pourrait penser qu'elle marchait à sa complète dissolution et à une fin rapide. Le peuple égyptien, épuisé dans ses forces et semblant se survivre, était devenu une proie pour les conquérants étrangers. Et cependant, ce peuple vieillard se releva encore une fois et sa religion reprit avec lui une vie nouvelle, sinon une nouvelle jeunesse. Vers la fin du huitième siècle, nous rencontrons ce symptôme remarquable d'une envolée vers les idées du peuple... (p. 239) À ce retour vers l'ancien esprit égyptien, la religion gagna elle aussi une nouvelle force, et plus que jamais elle pénétra l'existence entière du peuple, comme si elle était l'unique objet de cette vie... (p. 239) Mais justement, c'est au milieu de ces dispositions que le côté étrange de la foi égyptienne, tel que la vénération des (p. 240) animaux prend son développement le plus excessif ».
§ 727. Si l'on raisonnait a priori, on serait porté à croire que l'adoration des animaux a commencé par comprendre toute l'espèce, puis s'est restreinte. Au contraire, du moins pour l'une des oscillations que l'on a pu observer, l'adoration d'un animal s'est étendue à tous les autres animaux de la même espèce. Prenons garde, d'autre part, que cela ne démontre pas le moins du monde que cette oscillation n'ait pas été précédée d'une autre en sens contraire.
§ 728. La théorie qui place la perfection au terme de l'évolution est généralement unie à une autre, que nous avons souvent rappelée, et suivant laquelle les sauvages contemporains sont très semblables aux ancêtres préhistoriques des peuples civilisés (§ 291). De cette manière, on a deux points fixes, pour déterminer la ligne de l'évolution; et, en la prolongeant suffisamment, on obtient, ou l'on croit obtenir, la limite [FN: § 728-1] dont l'évolution s'approchera désormais.
§ 729. Par exemple, Spencer veut s'opposer à la théorie qui attribue le culte des ancêtres aux races inférieures. Il objecte [FN: § 729-1] qu'il est étrange que « (p. 401) les partisans de la doctrine évolutionniste admettent et même affirment une différence aussi profonde entre les esprits des diverses races humaines ». « Ceux qui croient que la création est une œuvre de mains peuvent sans contradiction admettre que les Aryens et les Sémites ont été dotés par voie surnaturelle de conceptions plus élevées que celles des Touraniens : si les espèces animales (p. 402) ont été créées avec des différences fondamentales, pourquoi n'en serait-il pas de même des variétés humaines ? Mais il faut une inconséquence rare pour affirmer que le type humain est sorti par évolution des types inférieurs, et pour nier ensuite que les races humaines supérieures soient sorties par évolution, mentale aussi bien que physique, des races inférieures, et qu'elles aient dû posséder jadis les conceptions générales que les races inférieures possèdent encore ».
§ 730. C'est là un raisonnement suivant la métaphysique et non suivant la science expérimentale. D'abord, on ne peut enfermer les rapports des faits présents et des faits passés, dans le dilemme : ou création ou évolution unique (§ 344). Puis, en admettant même pour un instant la doctrine de l'évolution unique, il n'est pas prouvé que les races inférieures contemporaines soient identiques à nos ancêtres préhistoriques ; au contraire, il est plutôt probable qu'elles en diffèrent beaucoup, ne serait-ce que pour la raison qu'elles manquent de ces dispositions qui ont produit la civilisation de nos races. Il n'y a pas de preuve non plus que l'évolution mentale doive être parallèle à l'évolution physique. Enfin, même si elle lui était parallèle, pourquoi l'évolution mentale n'aurait-elle pas pu, d'un tronc commun M, pousser deux branches A et B, dont l'une aurait abouti au culte des ancêtres, et l'autre à une croyance différente ? Une évolution semblable a certainement eu lieu pour le physique, si l'on admet un tronc commun M, puisque nous avons maintenant au moins les trois branches des races blanche, noire et rouge.
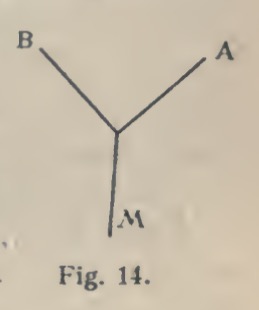
Figure 14
§ 731. La théorie suivant laquelle les sauvages contemporains sont identiques ou au moins semblables aux ancêtres préhistoriques des peuples civilisés, rencontre maintenant beaucoup de contradicteurs [FN: § 731-1]. Mais, comme il arrive généralement, on est allé d'un extrême à l'autre, en affirmant que les sauvages représentent la sénilité des races humaines, plutôt que leur enfance. On voit ici l'effet de la croyance qui place l'état parfait au commencement de l'« évolution », au lieu de le placer à la fin. Mais les faits échappent à ces idées a priori. Si, pour les anciens Gaulois d'avant la conquête romaine, on ne veut d'autres points de comparaison que les sauvages, ou les Français contemporains, il est manifeste qu'ils se rapprochent plus du premier terme de comparaison que du second ; et l'on ne peut admettre que les sauvages contemporains s'éloignent plus que les anciens Gaulois, de nos Français contemporains.
§ 732. La « série historique » des saint-simoniens [FN: § 732-1], quand on l'envisage au point de vue de la démonstration expérimentale qu’ils croient pouvoir en donner, appartient à ce genre, de même aussi la théorie des trois états de A. Comte. Ajoutons-y la théorie de la prémorale, de Herbert Spencer. Il veut tirer la morale de l'expérience, et tombe sur des faits qui ne s'accordent pas avec ses idées. Pour les exclure, il dit qu'ils n'appartiennent pas à la morale, mais à la prémorale.
§ 733. (B-β 4) Les mythes, etc., sont des imitations d'autres mythes semblables. D'après ce principe, partout où l'on rencontre deux institutions semblables, on admet que l'une est la copie de l'autre. Ici aussi l'erreur consiste seulement à vouloir généraliser un fait qui est tout à fait vrai dans des cas particuliers, et à dépasser ainsi l'expérience.
§ 734. Comme d'habitude, employons la méthode indiquée au § 547. Nous avons des exemples remarquables d'institution, presque identiques, et qui ne paraissent vraiment pas avoir été copiées l'une de l'autre. Pétrone décrit de la façon suivante une coutume de Marseille [FN: § 734-1] : « Quand les Marseillais étaient affligés de la peste, un pauvre s'offrait pour être entretenu, durant une année entière, par les deniers publics et avec les meilleurs mets. Puis, orné de verveine et couvert de vêtements sacrés, on le portait par toute la ville, accompagné de malédictions, afin que tous les maux de la ville retombassent sur lui ; enfin il était jeté [dans la mer] ».
§ 735. Au Mexique, les Aztèques avaient chaque année une cérémonie semblable. Ils choisissaient un jeune homme parmi les prisonniers. (p. 125) Désigné pour mourir une année à l'avance, ce jeune homme, à dater de ce jour, portait les mêmes vêtements que l'idole [du dieu Tezcatlipoca.] Il parcourait la ville à son gré, mais toujours escorté de gardes, et on l'adorait comme l'image de la divinité suprême. Vingt jours avant la fête, on mariait ce malheureux à quatre jeunes filles et, durant les cinq derniers jours, on lui procurait tous les plaisirs possibles. Le matin de la fête, on le conduisait au temple en grande pompe, et, un instant avant d'y arriver, il adressait ses adieux à (p. 126) ses femmes. Il accompagnait l'idole dans la procession... ; puis, l'heure du sacrifice venue, on l'étendait devant l'autel, où le grand prêtre, avec des façons respectueuses, lui ouvrait la poitrine et lui arrachait le cœur [FN: § 735 note 1)] ».
§ 736. L'idée commune d'une année entière de délices, suivie de la mort, n'a pas été transmise des Marseillais aux anciens Mexicains ou vice versa ; elle est née spontanément aux deux endroits. Cette même idée fait partie d'une autre, plus générale, qui plaît beaucoup aux hommes ; c'est le désir de combiner des choses contraires, opposées (§ 910 et sv.). De là partent une infinité de branches qui, d'une origine commune, aboutissent à divers phénomènes concrets.
§ 737. Frazer puis Reinach remarquèrent l'une de ces branches, laquelle, à son tour, se divise en d'autres [FN: § 737-1] . Reinach commence par rappeler « (p. 332) une coutume périodique analogue à celle des Saturnales romaines et caractérisée par la suspension momentanée des lois civiles et morales... Leur trait caractéristique [des Saturnales] était la licence permise aux esclaves, qui devenaient pour un temps les maîtres de la maison ». Voilà le contraste. Au moyen âge, nous aurons un autre contraste analogue mais non identique, dans la fête des fous [FN: § 737-2]. « (p. 333) En province, les choses se passaient de même, mais avec des traits, si l'on peut dire, plus archaïques [cela peut être ; mais Reinach ne donne aucune preuve de cet archaïsme]. Nous connaissons les détails de la fête des Saturnales dans une troupe de soldats romains campés sur le Danube, à Durostolum, sous les règnes de Maximien et de Dioclétien ; ils se sont conservés dans une relation du martyre de saint Dasius, publiée en 1897, d'après un manuscrit grec de la Bibliothèque Nationale, par M. Cumont [cette source est peut-être un peu suspecte ; dans les actes des martyrs, il y a souvent plus de foi que de vérité historique].
Trente jours avant la fête, les soldats désignaient au sort un beau jeune homme qu'ils habillaient en roi et qui, censé représenter le bon roi Saturne, paradait entouré d'une brillante escorte, avec le droit d'user et d'abuser de sa puissance. Le trentième jour, on l'obligeait à se tuer sur l'autel du Dieu Saturne qu'il personnifiait... Le roi des Saturnales à Rome n'est plus, à l'époque classique, qu'un roi de théâtre, un pître inoffensif; mais l'histoire de saint Dasius paraît prouver qu'à une époque plus ancienne ce roi perdait la vie avec la couronne... ». Et voilà l'erreur habituelle, de vouloir que l'évolution puisse se faire seulement suivant une ligne continue (§ 344). À supposer que le fait de saint Dasius soit vrai, pourquoi donc ce fait, arrivé après l'institution des Saturnales, à Rome, doit-il représenter un fait arrivé avant, et dont les Saturnales seraient la conséquence ? Et dans cette ligne continue, où plaçons-nous le fait des Mexicains ? Il est plus probable que celui-ci, le fait de Marseille et d'autres analogues, sont comme les extrémités A, B, C, D..., de branches qui divergent d'un tronc commun T, et parmi lesquelles il peut s'en trouver, comme les Saturnales E et la fête des fous F, qui donnent effectivement une évolution en ligne continue.
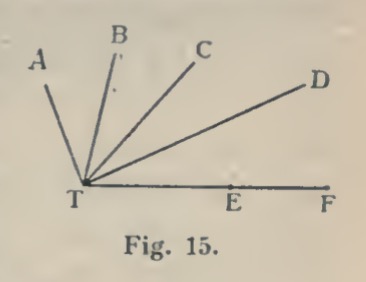
Figure 15
Reinach ajoute : « (p. 334) Des coutumes analogues aux Saturnales romaines existaient en Crète, à Thessalie, à Olympie, à Rhodes et ailleurs... Plus singulière encore était la fête des Sacaea, qui durait cinq jours à Babylone. Comme à Rome, les esclaves y devenaient les maîtres et, dans chaque maison, un esclave habillé en roi et portant le titre de Zoganes exerçait un éphémère pouvoir. En outre un condamné était habillé en roi et autorisé à se conduire en conséquence, jusqu'au point d'user des concubines royales ; à la fin de la fête, il était dépouillé de ses beaux vêtements, flagellé et pendu ou crucifié ». Puis Reinach remarque aussi la ressemblance de ces faits avec le récit d'Esther, avec celui d'une autre fête qu'on célébrait en Perse, et y ajoute ensuite le récit d'un fait historique, arrivé à Alexandrie, et raconté par Philon. De ces ressemblances, étendues au récit de la Passion du Christ, Reinach tire argument pour considérer ce récit comme mythique [FN: § 737-3].
§ 738. Il aurait pu étendre beaucoup plus les analogies qu'il avait remarquées, et aurait facilement trouvé une grande quantité de faits, de récits, de légendes, où l'on oppose le comble du bonheur au comble de la misère ; ou bien dans lesquels, par ironie ou pour un autre motif, on attribue des insignes de puissance au misérable, ou vice versa. La littérature de tous les pays puise largement à cette source ; et, sans se préoccuper de faits réels, elle nous donne, autant que nous voulons, des fables et des nouvelles. On pourrait, par exemple, citer le récit des Mille et une nuits, suivant lequel le pauvre Aboul-Hassân jouit, un jour, de tous les délices qui sont l'apanage du souverain, puis est bâtonné le lendemain, comme s'il était fou [FN: § 738-1]. Dans les romans grecs, on trouve habituellement une trame tissée dans le but de provoquer ce sentiment de contraste ; elle servit à Boccace pour les nouvelles de la cinquième journée, dans lesquelles « on traite de ce qui advint heureusement à un amant, après quelques graves et fâcheux accidents ».
Traitant des faits cités par Reinach, le P. Lagrange [FN: § 1] a très bien vu que les Sacées et autres fêtes analogues peuvent avoir des origines communes, mais qu'elles n'ont pas de rapport direct qui, par imitation ou autrement, fasse venir l'une de l'autre.
§ 739. Jusqu'ici, ce sont des produits de l'imagination. Mais les hommes aiment à placer le plus possible leurs fables dans la réalité, même sous de vaines apparences ; aussi a-t-on tiré de ces fictions diverses représentations théâtrales, toujours inoffensives à notre époque, mais qui, dans la Rome ancienne [FN: § 739-1], infligèrent parfois des souffrances réelles aux acteurs, et firent couler le sang. On prend ici sur le fait la transformation en actes de ce sentiment qui pousse à vouloir les contrastes, et qui donne naissance tant aux représentations sanglantes de Rome qu'à celles du Mexique.
§ 740. Tous ces récits, toutes ces représentations de faits ou ces faits eux-mêmes ont un noyau commun. C’est un autre exemple d'un phénomène dont nous avons déjà traité à propos de la faculté de produire ou d'éloigner les tempêtes (§ 186 et sv.), et qu'au chapitre suivant nous verrons être général. Nous retrouverons alors le noyau remarqué ici (§ 913 et sv.). Mais les récits, les représentations, les faits dans lesquels existe un caractère commun, ont aussi d'autres caractères qui les rendent différents et leur font constituer diverses catégories. On peut, par conséquent, les séparer en plusieurs genres, et cela de plusieurs manières, suivant le critère qu'on choisit pour la classification.
§ 741. La réalité peut être un premier critère. Nous placerons donc les simples fictions, comme les nouvelles de Boccace, dans une catégorie (a). Une autre catégorie, (b), contiendra les représentations scéniques de fictions. Nous y mettrons les tragédies, les drames, où l'on n'accomplit pas pour de vrai le fait d'Alexandrie raconté par Philon, la fête des fous, etc. Il y aura une catégorie (c), où la représentation est mêlée de réalité, où elle se fait pour de bon. Nous y mettrons, d'une part, les Saturnales, et d'autre part, les représentations sanglantes du cirque romain. Enfin viendra une catégorie (d), où la réalité est complète et où le sentiment des contrastes donne seul la forme. Nous y mettrons les faits de Marseille et du Mexique.
Le critère peut être tout autre ; c'est-à-dire qu'on peut considérer jusqu'où le contraste est poussé. Nous aurons ainsi une catégorie (1), dans laquelle le contraste consiste seulement à attribuer aux hommes ou aux choses des caractères qui ne jurent pas avec la réalité. Dans cette catégorie figureront le fait d'Alexandrie, la fête des fous, un très grand nombre de récits où le niais se montre homme d'esprit, ou vice versa, etc. (§ 668-3, 737-2). Dans une autre catégorie, (2), le contraste est poussé à l'extrême : un état heureux est suivi du pire malheur, ou vice versa. Les tragédies grecques renferment des parties importantes qui appartiennent à cette catégorie ; et c'est surtout la puissance de ce sentiment de contraste qui leur donne le sublime. Dans cette catégorie, nous placerons aussi les faits de Marseille et du Mexique. Au fond, le sentiment de contraste, qui naît de la vue du puissant et glorieux Agamemnon tombant sous la hache de Clytemnestre, n'est pas très différent du sentiment qu'on éprouve du fait d'un jeune homme qui est tué, après avoir joui, durant une année, de tous les plaisirs de la vie. On pourrait choisir d'autres critères, qui donneraient d'autres classifications, toujours au point de vue des sentiments ou des actions non-logiques.
D'autres points de vue, tels que ceux des actions logiques ou de la réalité expérimentale, nous transporteraient dans un tout autre domaine et sépareraient entièrement les objets qui, au point de vue des actions non-logiques, font partie d'une même catégorie. Par exemple, la tragédie d'Agamemnon et le fait du Mexique devraient se trouver dans des classes différentes.
§ 742. Dans les faits concrets, on peut trouver des mélanges de ces types. En outre, d'autres sentiments, certaines déductions logiques, des ornements de rhétorique, etc., s'y ajoutent (chap. VI et VII). Nous ne nous en occupons pas pour le moment ; nous voulions seulement donner un exemple des branches nombreuses et variées qui se séparent du tronc d'un même sentiment.
§ 743. En attendant, on voit, et l'on verra mieux par de nouveaux exemples (§ 746 à 763), qu'il n'y a que peu de chose ou rien à inférer de la similitude de certains faits, en ce sens que l'un serait imité d'un autre, ou qu'il tirerait son origine d'une autre transformation directe ; et l'on ne peut pas traiter d'artificielle ou de mythique la ressemblance de ces faits : elle peut fort bien être réelle, reproduisant ainsi le sentiment dont elle a pris naissance [FN: § 743-1].
§ 744. C'est pourquoi le P. Lagrange a raison de rejeter le raisonnement par lequel Salomon Reinach voudrait prouver que le récit évangélique de la Passion du Christ est une simple reproduction d'une légende ou d'un rite païen [FN: § 744-1]. Il cite divers faits de malheureux auxquels on accordait des plaisirs et l'on faisait fête, pour les maltraiter ensuite. L'un de ces faits, celui d'Alexandrie, raconté par Philon, doit être exclu ; car il ne fait pas partie des catégories (c) et (d) (§ 741) dont Reinach se prévaut, pour démontrer que le récit de la Passion du Christ est un mythe imité de fêtes existantes. Ceux qui restent prouvent bien peu de chose ; ils ne prouvent même rien, si ce n'est que dans la Passion du Christ se manifeste le sentiment de contraste, qui apparaît dans une infinité d'autres faits (§ 913 et sv.).
Si le raisonnement de Reinach était solide, pourquoi justement le récit de la Passion du Christ serait-il seul imité des autres récits, et pourquoi une partie de ceux-ci ne seraient-ils pas également imités d'autres récits ? Ensuite, si tous les faits où apparaît le sentiment de contraste, manifesté dans les Sacées ou en d'autres cérémonies analogues, devaient être considérés comme mythiques, il resterait en vérité peu de réel dans une grande partie de l'histoire. Je n'entends nullement résoudre ici le problème de la vérité de tous ces faits ; je dis seulement que, de leur ressemblance, on ne peut rien déduire pour nier la vérité d'une partie d'entre eux et pour l'accorder à d'autres.
§ 745. On peut apporter beaucoup d'autres exemples d'institutions semblables, bien que non imitées l'une de l'autre. Hérodote rappelle une fête des lanternes, en Égypte [FN: § 745-1], qui ressemble à une fête chinoise, et que nous pouvons trouver semblable à celle des rificolone, à Florence. Il est certain qu'entre elles n'existe pas le rapport d'une imitation.
§ 746. L'institution des Virgines Vestales, à Rome, est parfaitement semblable à celle des Vierges du Soleil, au Pérou. À Rome, le pontifex maximus choisissait les Vestales. Au Pérou, un rôle semblable était rempli par une femme, qui était chef de ces vierges. À Rome et au Pérou, les vierges ainsi choisies conservaient le feu sacré et devaient observer une chasteté très stricte. Si elles y manquaient, elles étaient ensevelies vivantes. Naturellement, ceux qui expliquent tout par la logique savaient et savent le pourquoi de ce genre de supplice, comme aussi de tout autre détail de ces deux institutions.
§ 747. D'abord, pourquoi élisait-on des vierges ? On a donné plusieurs explications, parmi lesquelles nous pouvons choisir à volonté. Denys d'Halicarnasse nous dit que Numa éleva un temple à Vesta et qu'il y confia le culte à des vierges, suivant l'usage des Latins. « Quelques difficultés surgissent à propos de ce qu'on garde dans le temple, et sur la raison pour laquelle le soin en est confié à des vierges. D'aucuns disent qu'on ne garde autre chose que le feu qui est visible à tout le monde, et que la garde en est confiée à des vierges plutôt qu'à des hommes, à cause de la ressemblance ; parce que le feu est sans tache, comme la vierge est pure, et qu'au plus chaste des dieux la chose la plus pure des mortels est agréable [FN: § 747-1] ».
Ovide (§ 747 note 2) pose la question : « Pourquoi la déesse a-t-elle des vierges comme ministres de son culte ? » et il répond que c'est parce que Vesta est vierge. « Qu'y a-t-il d'étrange à ce qu'une vierge veuille des vierges pour la servir et accomplir avec des mains chastes les cérémonies du culte ? Tu ne dois voir en Vesta qu'une flamme vive, et tu n'as jamais vu un corps naître de la flamme. Il est donc juste que celle qui ne produit ni ne reçoit aucune semence soit vierge, et qu'elle ait des compagnes de virginité ».
Cicéron est plus pratique [FN: § 747-3]. « Que des vierges accomplissent son culte [de Vesta], afin qu'elles veillent plus facilement à la garde du feu, et que les femmes sentent toute la chasteté que leur nature peut supporter ».
Plutarque a des explications en abondance. Dans Numa [FN: § 747-4] , il nous dit que ce roi confia aux Vestales la garde du feu immortel, « (5) soit parce qu'il voulait donner la garde de la nature pure et incorruptible du feu à des corps intacts et purs, soit parce qu'il estimait la stérilité et l'infécondité du feu en accord avec la virginité [FN: § 747-5] ». Puis dans Camille [FN: § 747-6] , voici apparaître d'autres explications ; et l'on nous dit (3) que le roi Numa institua le culte du feu parce qu'il est le principe de toute chose, et qu'il est l'image de la puissance éternelle qui gouverne tout. D'autres disent (6) que les Romains, comme les Grecs, font brûler le feu devant les choses sacrées, à cause de sa pureté.
§ 748. Mais le fait de la virginité des Vestales est loin d'être unique, et toutes ces explications logiques tombent d'elles-mêmes. Un courant de sentiment – non pas de logique – se fait sentir depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, mettant en rapport la virginité et le service des dieux ou de Dieu. La Pythie devait être vierge. Il va sans dire que les explications logiques ne manquent pas ; quand font-elles jamais défaut ? Loin de manquer, pour un seul fait il y en a plusieurs ; toutes bonnes, voire excellentes, il s'entend. « On dit qu'autrefois les prophétesses étaient vierges, à cause de leur nature sans tache et de leur ressemblance avec Artémis [qui était vierge], et parce qu'elles étaient aptes à garder le secret des oracles [FN: § 748-1] ». Mais un Thessalien du nom d'Echécrate ayant enlevé et violé une Pythie dont il s'était épris, les habitants de Delphes firent une loi par laquelle, au lieu d'une vierge, c'était une femme de plus de cinquante ans qui devait être prophétesse. Mais il paraît que plus tard on recommença à donner cet emploi à de jeunes femmes. Tel est du moins ce qu'on peut déduire d'un passage de Plutarque [FN: § 748-2].
§ 749. Au temps de Pausanias, il y avait, sur les confins du pays des Orchomènes, dans les environs de Mantinée, un temple d'Artémis Imnia. Une jeune vierge était autrefois prêtresse de ce temple. Un certain Aristocrate, qui est quelque peu légendaire, viola cette vierge, qui s'était réfugiée dans le temple, auprès d'Artémis. Les Arcadiens le lapidèrent, et fixèrent ensuite comme loi qu' [FN: § 749-1] « au lieu d'une vierge, ils donnaient pour prêtresse à Artémis une femme qui avait eu des rapports avec des hommes ».
§ 750. Un autre temple d'Artémis Imnia avait un prêtre et une prêtresse qui devaient vivre dans la chasteté. Semblable était le devoir de ceux qui, à Éphèse, présidaient aux cènes, dans le temple d'Artémis ; mais ils ne restaient en charge qu'un an [FN: § 750-1] . Dans le temple de la Terre, près du fleuve Cratès, il y avait une femme qui devait avoir eu des rapports avec un seul homme, avant d'être nommée prêtresse, puis n'en devait plus connaître aucun [FN: § 750-2] .
§ 751. Au contraire, d'autres prêtresses restaient dans le temple tant qu'elles étaient vierges [FN: § 751-1] , et cessaient d'être prêtresses quand elles se mariaient. Plus prudents étaient les Tégéens, qui donnaient à Athéna une prêtresse qui gardait cet emploi seulement jusqu'à l'âge de la puberté [FN: § 751-2] . À Athènes, la femme de l'archonte-roi devait avoir été épousée par lui, vierge [FN: § 751-3] . On sait que chez les Israélites, le prêtre devait épouser une vierge [FN: § 751-4] .
§ 752. La virginité n'était pas la seule qualité exigée d'une Vestale il fallait encore qu'elle n'eût pas de défauts corporels, qu'elle ne fût ni sourde ni muette. À l'âge où elle était prise par le pontife pour le service de Vesta, elle devait avoir son père et sa mère vivants, ou, comme disaient les Latins, être matrima et patrima ; elle devait être de famille honorable, etc. [FN: § 752-1] De même, les victimes offertes aux dieux devaient être parfaites. Ce sentiment de la perfection des personnes et des choses mises au service des dieux, ou qui leur sont offertes, persiste depuis l'antiquité jusqu'à nos jours [FN: § 752-2].
§ 753. Il est tout à fait manifeste que ce n'est pas dans cette variété d'explications logiques que nous devons chercher la cause de ces faits, et que nous la trouverons uniquement si nous dirigeons nos recherches vers certains sentiments, dont les dits faits tirent origine, de même que les explications qu'on en donne.
§ 754. Passons maintenant au fait du supplice identique pour les Vestales, à Rome, et pour les Vierges du Soleil, au Pérou, qui étaient ensevelies vivantes si elles manquaient à leur vœu de chasteté. À Rome, on portait la Vestale coupable [FN: § 754-1] « (p. 28) dans une bière au campus sceleratus à (p. 29) la porte Colline ; là on la fustigeait, puis on l'enterrait toute vivante, sans oser la tuer, parce qu'on regardait comme un nefas de faire périr d'une mort violente une personne vouée à la divinité ».
Si cette explication ne vous satisfait pas, en voici une autre : on brûle les morts. Ne serait-il pas injuste de brûler celle qui n'a pas bien gardé le feu ? [FN: § 754-2] En voulez-vous une autre ? On remettait la coupable aux dieux, en leur laissant le soin de la châtier.
§ 755. Si vous n'êtes pas encore satisfaits, nous trouverons autre chose. A. Réville a découvert l'explication suivante, qui peut servir pour Rome et pour le Pérou [FN: § 755 note 1)].
« N'est-il pas étonnant que le supplice réservé [au Pérou] à celles qui le violaient [le vœu de chasteté] fût exactement le même que celui qui punissait à Rome la vestale impudique ! Elles étaient enterrées vivantes. Cette ressemblance tient à ce que dans les deux pays la coupable était considérée comme odieuse désormais aux divinités du jour, de la lumière; elle avait provoqué leur colère, il ne fallait pas continuer à leur infliger la vue d'un être digne de tous leurs ressentiments, elle ne pouvait plus qu'être vouée aux dieux souterrains de l'obscurité, de la mort, dont elle était devenue la servante ».
§ 756. Les Romains avaient d'autres motifs pour punir les Vestales. Il paraît qu'ils cherchaient principalement à éviter des malheurs qui les menaçaient. « Plusieurs indices apparaissent – dit Denys d'Halicarnasse [FN: § 756-1] – quand le service divin n'a pas été régulier ; principalement l'extinction du feu ; chose que les Romains craignent plus que tout autre malheur, parce que, quelle qu'en soit la cause, ils croient que c'est un présage de ruine pour la ville ».
§ 757. On raconte [FN: § 757-1] – histoire ou légende, peu importe – que vers l'an 481 av. J.-C., des prodiges manifestèrent, à Rome, la colère des dieux. On découvrit alors que la Vestale Opimia n'était plus vierge. Elle fut enterrée vive. Ensuite, les sacrifices redevinrent favorables, et la colère divine fut apaisée.
À une autre époque, légendaire aussi, soit en l'an 470 av. J.-C., une maladie fit mourir un grand nombre de femmes, à Rome [FN: § 757-2] . On ne savait à quel remède recourir, quand un esclave informa les pontifes que la Vestale Urbinia n'était plus vierge, et qu'elle offrait des sacrifices pour la ville avec des mains impures. Cette Vestale fut ensevelie vivante. L'un de ses amants se tua, l'autre fut tué. «L'épidémie des femmes et les morts fréquentes cessèrent aussitôt que ces choses furent faites ».
§ 758. En des temps historiques, c'est-à-dire après la défaite de Cannes, on vit des prodiges effrayants [FN: § 758-1] . Les Romains furent atterrés par le fait que, dans l'année, « deux Vestales, Opimia et Floromia, avaient été convaincues d'avoir transgressé leur vœu de chasteté. L'une avait été ensevelie vivante, suivant l'usage, près de la porte Colline ; l'autre s'était donné la mort ». Leurs amants furent frappés de verges jusqu'à la mort. Tout cela ne suffit pas pour dissiper la terreur. Alors on ouvrit les livres sybillins, qui prescrivirent des sacrifices extraordinaires. « Un homme et une femme gaulois, un homme et une femme grecs furent ensevelis vivants au forum boarium, en un lieu entouré de pierres, où avaient eu lieu d'autres sacrifices humains ; ce qui est indigne de la religion romaine ».
§ 759. Ici, il n'y a pas à dire que ces êtres humains, Gaulois et Grecs, aient été ensevelis vivants parce qu'ils étaient considérés comme odieux aux divinités du jour, de la lumière. Nous voyons la nature des actions non-logiques, qui se manifestent par ces sacrifices et par ceux des Vestales. C'est l'instinct de conservation, qui veut unir des remèdes extrêmes à des maux extrêmes (§ 929 et sv.). C'est le même instinct qui pousse à sacrifier des êtres humains, pour le succès d'opérations magiques (§ 931).
§ 760. La Vestale était ensevelie dans une petite cellule, avec très peu de provisions, soit un peu de pain, d'eau, de lait et d'huile [FN: § 760-1] . Ce genre de mort n'était pas propre uniquement aux Vestales coupables. Nous le trouvons cité dans une tragédie de Sophocle [FN: § 760-2] . Certaines traditions veulent que le genre de mort des Vestales coupables n'ait pas toujours été le même. Suivant Zonara [FN: § 760-3] , ce serait Tarquin l'Ancien qui aurait prescrit de les ensevelir vivantes.
§ 761. Sous l'empire, les lois anciennes ne furent pas toujours observées. Suétone raconte de Domitien [FN: § 761-1] : « Il réprima par des peines diverses et sévères, d'abord par la peine capitale, puis par le supplice selon l'usage ancien, les incestes des vierges Vestales, négligés par son père et son frère ». Il permit aux sœurs Ocellata et à Varronilla aussi, de choisir le genre de leur mort, et il exila leurs complices. La grande Vestale Cornelia, naguère acquittée, ayant été accusée à nouveau et convaincue, il la fit enterrer vive, et fit battre de verges, jusqu'à la mort, ses complices, à l'exception d'un ancien préteur, contre lequel manquaient les preuves, et qui fut exilé. Caracalla fit aussi enterrer vives des Vestales [FN: § 761-2] .
§ 762. On peut remarquer comme une coïncidence fortuite, qu'au Pérou les Vierges du Soleil pouvaient avoir des rapports avec les Incas, qui étaient fils du Soleil, et qu'à Rome, Héliogabale, qui était empereur et prêtre du Soleil, osa célébrer son mariage avec une Vestale, et dire [FN: § 762-1] : « J'ai fait cela afin que des fils divins naissent de moi, souverain pontife, et d'elle grande Vestale ».
§ 763. Voici une autre singulière coïncidence. Au Pérou, les vierges du Soleil pétrissaient une farine très pure, pour faire certains pains offerts aux Incas, lors d'une fête du Soleil. À Rome, les vierges Vestales préparaient un brouet de la farine (mola salsa), pour l'offrir à la déesse Vesta [FN: § 763-1]. Tous ces exemples confirment que, comme nous l'avons vu déjà, au § 744, la ressemblance de certains rites n'est en rien une preuve que l'un procède directement de l'autre.
§ 764. (B -.γ) Les mythes, etc., sont entièrement irréels. Dans ce genre, nous avons les nombreuses et importantes théories de l'allégorie, y compris celles du mythe solaire et d'autres semblables. Toutes ces théories, très en usage par le passé, ont encore des adeptes aujourd'hui. Elles sont chères aux esprits ingénieux, subtils, prompts à imaginer, désireux de découvertes inattendues. En Outre, elles constituent une transition utile entre la foi aveugle et l'incrédulité : on abandonne ce que l'on ne peut plus défendre, et l'on tâche de sauver le plus possible des mythes anciens.
§ 765. Pourtant il arrive souvent, en réalité, qu'on ne sauve que peu de chose ou rien. L'expérience du passé fait voir que l'on ne gagne pas beaucoup à tâcher de rendre plus « raisonnable » une ancienne croyance; et c'est même souvent le moyen d'en hâter la ruine. Les raisonnements abstraits, subtils, ingénieux, agissent très peu pour maintenir les sentiments non-logiques qui forment le fond des croyances [FN: § 765-1].
§ 766. Il est nécessaire de se rappeler, ici en particulier, ce que nous avons exposé déjà, d'une façon générale (§ 635 et sv.), sur le but de ce chapitre. Étant donné un texte dans lequel on suppose que les mythes, les allégories, etc., ont une part plus ou moins grande, ici nous recherchons surtout si et comment on peut remonter du texte aux idées de l'auteur, ou aux faits qu'il a voulu décrire.
§ 767. Grote a excellemment jugé l'interprétation allégorique et historique des anciens mythes grecs. Il dit [FN: § 767-1] : « (p. 167) La doctrine que l'on suppose avoir été symbolisée primitivement et postérieurement obscurcie dans les mythes grecs, y fut en réalité introduite pour la première fois par l'imagination inconsciente d'interprètes plus récents. C'était une des diverses voies que prenaient des hommes instruits pour échapper à la nécessité d'admettre littéralement les anciens mythes, et pour arriver à quelque nouvelle forme de croyance plus conforme aux idées qu'ils se faisaient de ce que devaient être les attributs et le caractère des dieux ». « (p. 169) Le même conflit de sentiments qui amenait les philosophes à décomposer les mythes divins pour les changer en allégories, poussait les historiens à réduire les mythes héroïques en quelque chose qui ressemblât à une histoire politique continue, avec une longue suite chronologique calculée sur les généalogies héroïques. L'un de ces procédés, aussi bien que l'autre, était une œuvre d'explications conjecturales et sans critérium ni témoignage quelconque justificatif. Tandis qu'on faisait ainsi disparaître la beauté caractéristique du mythe, en le réduisant en quelque chose d'antimythique, on cherchait à arriver à l'histoire et à la philosophie, par des routes impraticables ».
§ 768. Le commentaire des poésies homériques, dont Héraclide est l'auteur [FN: § 768-1] , peut être cité comme type des interprétations allégoriques. L'auteur a pour but de rendre raisonnables, moraux, pieux, les récits d'Homère. Ainsi, à propos du passage (Il. I, 396 et sv.), où il est dit que les dieux voulaient enchaîner Zeus, Héraclide remarque que « Pour ces vers, Homère mériterait d'être chassé non seulement d'une république de Platon, mais au-delà des lointaines colonnes d'Hercule et de l'inaccessible océan ». Après l'avoir démontré, Héraclide ajoute : « Au reste, pour excuser cette impiété, il n'y a qu'un seul remède : nous prouverons que le mythe est allégorique ». Suivent de longues explications, suivant lesquelles Zeus est l'éther, Héra est l'air, Poséidon, l'eau, Athéna, la terre, Thétis, la Providence. Quand Homère dit que Thétis a délivré Zeus qu'Héra, Poséidon et Athéna voulaient enchaîner, il exprime la perturbation des éléments, empêchée par la Providence.
§ 769. Dans l'Odyssée (V, 121), on dit que l'Aurore aux doigts de rose enleva Orion. Héraclide croit qu'Homère a voulu exprimer « qu'un jeune garçon a été enlevé par le destin, à la fleur de l'âge. En effet, c'était une coutume des anciens, quand un homme mourait, de ne transporter son corps ni la nuit ni à la chaleur de midi, mais de le transporter à l'aurore, quand les rayons du soleil n'étaient pas encore chauds. Aussi, quand mourait un jeune homme bien né et illustre par sa beauté, c'est avec à propos qu'ils appelaient enlèvement du jour son transport matinal, comme s'il n'était pas mort, mais qu'il avait été enlevé en raison d'un désir amoureux ». Ces allégories et d'autres semblables n'ont pas plus de réalité que les interprétations de Palæphate. Il vaudrait tout autant dire qu'une reine du nom d'Aurore a enlevé un jeune homme du nom d'Orion.
§ 770. Nous avons une infinité d'autres explications allégoriques des poésies d'Homère ; et, des temps anciens à nos jours, on en exhibe une à chaque instant. Eustache en a plusieurs, et peu à peu on arrive à un certain Hugon , pour lequel les poésies d'Homère sont une prophétie de la Passion du Christ, et [FN: § 770-1] à Croës [FN: § 770-2], pour lequel elles sont une histoire allégorique du peuple hébreu.
§ 771. C'est de la même façon et pour les mêmes motifs que Virgile a eu aussi ses explications allégoriques. Comparetti relève comment, dans les œuvres de Virgile, on vit une prophétie de la venue du Christ [FN: § 771-] . « (p. 134) L'interprétation la plus répandue, de cette nature, se trouve dans une allocution tenue par l'empereur Constantin, devant une assemblée ecclésiastique... la traduction (p. 135) de l'églogue [la IVe ]en vers grecs, telle qu'on la lit aujourd'hui dans ce discours, révèle l'ancien défaut des sibyllistes ; en plusieurs endroits, elle s'écarte arbitrairement de l'original, en altère le sens, avec l'intention évidente de l'adapter à l'interprétation chrétienne qui est développée dans le discours. Examinant dans ses différentes parties cette composition de Virgile, l'empereur y trouve la prédiction de la venue du Christ, désignée avec plusieurs circonstances. La vierge qui revient, c'est Marie ; la nouvelle progéniture envoyée par le ciel, c'est Jésus, et le serpent qui n'existera plus, c'est le vieux tentateur de nos pères, etc. ».
§ 772. Une autre interprétation passablement fantaisiste est celle de Fulgentius [FN: § 772-1)]. « (p. 144) Le De continentia Virgiliana, où Fulgentius déclare ce que contient, ou mieux ce qui est caché dans le livre de Virgile, est l'un des plus étranges et des plus curieux écrits du moyen âge latin... (p. 145) Dans un préambule, l'auteur se hâte de déclarer qu'il limitera son travail à l'Énéide seule, car les Bucoliques et les Géorgiques contiennent des sens mystiques si profonds, qu'il n'y a presque pas d'art capable de les pénétrer entièrement. C'est pourquoi il y renonce, le fardeau étant trop lourd pour ses épaules, et trop de science étant nécessaire ; car le premier sens des Géorgiques est tout astrologique ; le second, physionomiste et médical ; le troisième se rapporte entièrement à l'art des aruspices, etc. ».
§ 773. Toujours de la même manière et toujours pour le même motif, on a cherché et trouvé des allégories dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile. L'œuvre ainsi accomplie par les Pères de l'Église et leurs successeurs protestants, catholiques, modernistes, est immense. Philon le Juif a écrit les Allégories des lois sacrées, qui vont de pair avec les allégories homériques, avec les allégories virgiliennes, et avec les allégories que les modernistes ont aujourd’hui découvertes dans l'Évangile. En ce dernier cas, il est étrange qu'on appelle moderne un retour à l'antiquité, et cela ressemble un peu à la découverte que l'on ferait de l'Amérique, au XXe siècle.
§ 774. Voulez-vous savoir ce que signifient ces paroles de la Bible [FN: § 774-1] : « Adam et sa femme étaient tous deux nus »? Philon va vous le dire. Elles signifient que « l'esprit ne pensait pas, et que la sensation ne sentait pas ; mais celle-ci était privée et nue de pensée ; celui-là de la faculté de sentir ». On ne saurait être plus clair ni plus précis.
Voulez-vous savoir ce que signifie le miracle de l'eau changée en vin, ou celui de l'aveugle qui voit et du mort qui ressuscite ? L'abbé Loisy [FN: § 774-2] vous le dira avec non moins de clarté et de précision que Philon. L'eau changée en vin signifie l'Évangile substitué à la Loi. L'aveugle qui voit et le mort ressuscité représentent l'humanité appelée à la « vraie » lumière et à la « vraie vie » du Verbe incarné, qui est lui-même la lumière et la vie. L'abbé Loisy tance vertement ceux qui n'acceptent pas d'emblée ces explications lumineuses. Il dit : « (p. 52) Les théologiens de nos jours sont si éloignés (p. 53) de la mentalité de l'évangéliste [Jean], et, en même temps, ils ont si peu le sens du possible et du réel en matière d'histoire, qu'il faut renoncer à leur faire comprendre que les récits comme le miracle de Cana, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, inintelligibles, absurdes ou ridicules comme matière de foi, à moins qu'on y voie des tours audacieux de prestidigitateur, sont d'une interprétation facile et simple quand on se sert des clefs fournies par l'évangéliste lui-même, et qu'on reconnaît dans l'eau changée en vin la Loi remplacée par l'Évangile, dans l'aveugle qui voit, et dans le mort qui ressuscite, l'humanité appelée à la véritable lumière et à la véritable vie par le Verbe incarné, qui est lui-même la lumière et la vie ». On peut malheureusement répéter cela pour toutes les interprétations allégoriques de la mythologie ; et il est très difficile de faire un choix, pour en admettre une partie et rejeter le reste [FN: § 774-3].
§ 775. Y a-t-il des allégories dans l'Évangile selon St-Jean ? Cela se peut ; c'est même probable. Mais tout critère nous fait défaut pour pouvoir discerner la partie allégorique de la partie historique [FN: § 775-1] ; et il se pourrait encore que l'auteur même de l'Évangile ne discernât pas clairement ces parties. Cela ne suffit pas. À supposer que nous puissions savoir avec certitude qu'un récit est allégorique, il nous reste encore à savoir quelle est précisément l'allégorie que l'auteur avait dans l'esprit. À ce sujet, il suffira de citer l'exemple de l'Apocalypse, laquelle est certainement allégorique. Mais quelle peut être l'allégorie ? Il y a des siècles qu'on la cherche, et l'on n'a rien découvert de certain.
§ 776. L'abbé Loisy a une étrange façon de comprendre la valeur des preuves historiques. Il dit [FN: § 776-1] : « (p. 70) Ôtez de l'Évangile l'idée du grand avènement et celle du Christ-Roi, je vous défie de prouver l'existence historique du Sauveur ; car vous aurez enlevé toute signification historique à sa vie et à sa mort ». Par conséquent, ce serait l'idée contenue dans un récit qui démontrerait la réalité historique de ce récit !
§ 777. C'est la confusion habituelle entre les preuves subjectives et les preuves objectives. Il faut se décider. Ou bien un récit est du ressort de la foi, et dans ce cas les preuves objectives sont superflues ; ou bien c'est un récit historique d'éléments expérimentaux ; et dans ce cas, les preuves subjectives, les « idées », les croyances n'ont pas rang parmi les preuves. On peut faire la même objection aux néo-chrétiens comme Piepenbring, qui s'efforcent de toute manière d'éliminer de l'Évangile le surnaturel et le miracle [FN: § 777-1]. Si l'on doit envisager l'Évangile simplement comme un texte historique, son accord avec les sentiments de certaines personnes, « l'expérience du chrétien », n'ont aucune valeur. L'erreur de ces personnes consiste à croire que leurs conceptions humanitaires ont une plus grande valeur objective que la foi au miracle.
§ 778. Au point de vue de la réalité objective, on ne comprend pas ce que plus loin l'abbé Loisy veut dire par ces mots : « (p. 93) Ce Christ [de l'Évangile de Jean], sans doute n'est pas une abstraction métaphysique, car il est vivant dans l'âme de l'évangéliste » (§ 1630-3), Toute abstraction métaphysique quelque peu puissante est « vivante » dans l'esprit du métaphysicien. En face de l'Église romaine, l'abbé Loisy se pose en représentant de la critique historique et scientifique, alors qu'il est un théologien plus métaphysicien, plus subtil, plus abstrait que les théologiens romains [FN: § 778-1].
§ 779. Pour ajouter quelque chose de réel à l'allégorie, on fait appel à l'étymologie ; et l'on a ainsi des méthodes d'interprétation dont il y a des exemples jusqu'en nos temps, où l'une d'elles, la méthode d'interprétation qui conduit au mythe solaire, a obtenu un grand crédit [FN: § 779-1]. Pour la sociologie, la valeur intrinsèque de la méthode importe moins que la manière dont elle a été accueillie, ni est un indice d'un état mental important ; lequel démontre la tendance anti-scientifique, qui prévaut encore dans les études des traditions et des institutions des temps passés.
§ 780. Max Muller et ses disciples ont poussé jusqu'à ses extrêmes limites la méthode des interprétations allégorico-étymologiques. Leur procédé consiste à profiter, pour leurs démonstrations, du sens douteux et très étendu de certains mots, que Max Muller tire généralement du sanscrit, et d'en déduire, par des raisonnements peu ou pas précis, des conclusions bien délimitées et rigoureuses.
§ 781. Voici un exemple. Max Muller veut interpréter la fable de Prokris [FN: § 781-1]. Il la décompose en éléments. « (p. 111) Le premier de ces éléments est : Képhalos aime Prokris. Pour expliquer Prokris, il faut recourir à une comparaison avec le sanscrit, où prush et prish signifient “arroser”, et sont employés spécialement pour désigner les gouttes de pluie. Par exemple dans le Rig-Véda (I, CLXVIII, 8) : “Les éclairs sourient à la terre, quand les vents versent par ondée la pluie sur la terre”. La même racine, dans le (p. 112) langage teutonique a pris le sens de “gelée” et Bopp identifie prush avec l'ancien haut-allemand frus, frigere. En grec, nous devons rapporter a la même racine ![]() , une goutte de rosée, et aussi Prokris –
, une goutte de rosée, et aussi Prokris – ![]() – la rosée. Ainsi la femme de Képhalos n'est qu'une répétition de Hersé, sa mère ; Hersé, rosée, étant également dérivée du sanscrit vrish, arroser ; Prokris, rosée, qui se rattache à la racine sanscrite prush, ayant le même sens. La (p. 113) première partie de notre mythe signifie donc simplement : Le Soleil baise la rosée du matin ». Il se peut qu'on raisonne ainsi quand on est à moitié endormi ; mais on ne peut vraiment rien démontrer – ou l'on peut tout démontrer – de cette façon. Dans une note, l'auteur défend ses étymologies de Prokris et de
– la rosée. Ainsi la femme de Képhalos n'est qu'une répétition de Hersé, sa mère ; Hersé, rosée, étant également dérivée du sanscrit vrish, arroser ; Prokris, rosée, qui se rattache à la racine sanscrite prush, ayant le même sens. La (p. 113) première partie de notre mythe signifie donc simplement : Le Soleil baise la rosée du matin ». Il se peut qu'on raisonne ainsi quand on est à moitié endormi ; mais on ne peut vraiment rien démontrer – ou l'on peut tout démontrer – de cette façon. Dans une note, l'auteur défend ses étymologies de Prokris et de ![]() qui ont été attaquées. Il nous dit que « (p. 112, note) Prishat, féminin prishali, signifie arrosé, en latin guttatus, et s'applique à un daim moucheté, à une vache mouchetée, à un cheval moucheté ». Quand on dispose d'un terme qui, à lui seul, veut dire goutte de pluie, flocon de givre, rosée, animal tacheté, et d'autres termes d'une égale précision, il n'est pas difficile d'en tirer tout ce qu'on veut [FN: § 781-2] .
qui ont été attaquées. Il nous dit que « (p. 112, note) Prishat, féminin prishali, signifie arrosé, en latin guttatus, et s'applique à un daim moucheté, à une vache mouchetée, à un cheval moucheté ». Quand on dispose d'un terme qui, à lui seul, veut dire goutte de pluie, flocon de givre, rosée, animal tacheté, et d'autres termes d'une égale précision, il n'est pas difficile d'en tirer tout ce qu'on veut [FN: § 781-2] .
§ 782. Il serait trop simple de voir dans les centaures un produit de l'imagination, qui a créé ces monstres comme elle en a créé tant d'autres. Il doit y avoir quelque mystère sous ce terme, et l'étymologie nous permettra de choisir entre de nombreuses interprétations.
Il peut désigner [FN: § 782-1] « une population de bouviers ; car ce nom est dérivé de ![]() piquer, et
piquer, et ![]() , taureau ; il rappelle l'usage où sont les conducteurs de bœufs de mener ces animaux avec l'aiguillon ». Si cette étymologie ne vous plaît pas, en voici sur-le-champ une autre [FN: § 782-2] . « Une autre étymologie, celle-ci moderne, associe au mot
, taureau ; il rappelle l'usage où sont les conducteurs de bœufs de mener ces animaux avec l'aiguillon ». Si cette étymologie ne vous plaît pas, en voici sur-le-champ une autre [FN: § 782-2] . « Une autre étymologie, celle-ci moderne, associe au mot ![]() celui d'
celui d'![]() , lièvre, et fait des centaures des piqueurs de lièvres ». Vous n'êtes pas encore satisfait ? [FN: § 782-3] « La mythologie comparée, en leur supposant une origine asiatique, les a rapprochés des Gandharvas de l'Inde, dieux velus comme des singes, aimant, eux aussi, le vin et les femmes, cultivant la médecine, la divination, la musique, comme les ont cultivées les centaures de la mythologie hellénique. Ce rapprochement avec les Gandharvas (ce nom signifie cheval en sanscrit), tendrait à faire des centaures, ces hommes-chevaux, des personnifications des rayons solaires, que l'imagination aryenne comparait à des chevaux ; ou, comme on l'a dit aussi, des nuages qui semblaient chevaucher autour du soleil ». Cela ne vous suffit point encore ? Faisons-en des fils d'Ixion et de Néphélè. [FN: § 782-4] « Les uns ont vu dans Ixion et dans sa roue une image du soleil emporté d'un mouvement éternel. Pour d'autres, c'est une personnification de l'ouragan et de la trombe. Les centaures sont ou les rayons du soleil, ou les nuages qui l'entourent. On y verra les démons de la tempête, à moins qu'on ne préfère y voir un symbole des torrents qui descendent du Pélion ».
, lièvre, et fait des centaures des piqueurs de lièvres ». Vous n'êtes pas encore satisfait ? [FN: § 782-3] « La mythologie comparée, en leur supposant une origine asiatique, les a rapprochés des Gandharvas de l'Inde, dieux velus comme des singes, aimant, eux aussi, le vin et les femmes, cultivant la médecine, la divination, la musique, comme les ont cultivées les centaures de la mythologie hellénique. Ce rapprochement avec les Gandharvas (ce nom signifie cheval en sanscrit), tendrait à faire des centaures, ces hommes-chevaux, des personnifications des rayons solaires, que l'imagination aryenne comparait à des chevaux ; ou, comme on l'a dit aussi, des nuages qui semblaient chevaucher autour du soleil ». Cela ne vous suffit point encore ? Faisons-en des fils d'Ixion et de Néphélè. [FN: § 782-4] « Les uns ont vu dans Ixion et dans sa roue une image du soleil emporté d'un mouvement éternel. Pour d'autres, c'est une personnification de l'ouragan et de la trombe. Les centaures sont ou les rayons du soleil, ou les nuages qui l'entourent. On y verra les démons de la tempête, à moins qu'on ne préfère y voir un symbole des torrents qui descendent du Pélion ».
§ 783. Il convient de noter, comme type, le raisonnement suivant, grossièrement approché: « Une roue tourne ; le soleil tourne ; donc la roue d'Ixion est le soleil ». En général, voici la méthode qu'on emploie. On veut prouver que A est égal à B. On tâche, en choisissant convenablement certains termes pour désigner A et B, de faire naître, chez les hommes, nos contemporains, des sensations ayant quelques ressemblances. On conclut alors que, pour les hommes des temps passés, A était rigoureusement égal à B. Pour atteindre le but, il est nécessaire que l'exposé ne soit pas trop court ; il faut qu'il s'allonge de manière à donner le temps à ces sensations de naître et de croître, et en sorte que le grand nombre de mots recouvre la vanité du raisonnement [FN: § 783-1] .
§ 784. Maury voit, dans les centaures [FN: § 784-1] « (p. 202) la métamorphose que les Gandharvas subirent en Grèce » ; et il ajoute : « Les Gandharvas sont en effet les rayons du soleil, les flammes du foyer sacré dans lesquelles se jouent des reflets éclatants, les flots du Soma, où ces feux se réfléchissent, et que l'imagination de l'Arya compare à des chevaux ». Ces braves Gandharvas sont toutes ces choses ; excusez du peu. Comme si cela ne suffisait pas, ils se transforment aussi en centaures. Mais Ulenbeck ne croit vraiment pas que les Gandharvas aient rien à voir avec les centaures. V. Henry le blâme et lui oppose le raisonnement suivant [FN: § 784-2] : « ....dans la mythologie védique les Gandharvas passent pour des êtres prodigieusement puissants et lascifs. C'est l'épithète qui les précède, l'attribut qui les suit partout... De l'histoire des centaures que savons-nous ? Peu de chose, en vérité. Si les descriptions abondent, les contes proprement dits font défaut. Pourtant, dans cette incroyable indigence de faits, un seul récit surnage et précisément dans l'ordre d'idées où nous orientent les peintures védiques ; invités aux noces de Pirithoüs et d'Hippodamie, ils tentèrent de ravir l'épousée ; mais ils furent vaincus par Thésée et les Lapithes ». Si ce seul récit surnage, c'est parce qu'ainsi plaît à notre auteur ; car on trouverait, si l'on voulait, d'autres récits de non moindre importance ; par exemple, les aventures d'Hercule au pays des centaures.
§ 785. Il faut admirer comment notre auteur sait tirer parti de tout. Si les aventures des centaures et des Gandharvas étaient semblables, ce serait une preuve de l'identité de ces êtres fabuleux. Mais elles sont différentes ! N'en ayez nul souci. Il y a remède à tout, sauf à la mort. « la considération capitale, à mes yeux, c'est que l'histoire n'est point la même. Il en va du conte comme du nom : si les noms étaient identiques, l'étymologiste flairerait quelque emprunt ; si le récit était tout pareil, le mythographe le soupçonnerait d'avoir voyagé. Mais bien loin de là : les Hindous connaissent sur les Gandharvas un trait de mœurs que les Grecs ont oublié ». C'est notre auteur qui dit qu'ils l'ont oublié; mais il n'en donne pas la moindre preuve. « En récompense, ceux-ci racontent des centaures une anecdote dont les Hindous ignorent le premier mot ; et ce trait de mœurs et cette anecdote s'adaptent comme les cassures de deux fragments de vase, sortent visiblement du même fonds d'idées. Il semble que, réduisant ce fonds à sa plus simple expression, il ne reste plus qu'à formuler le concept premier, ou, si l'on veut, la naïve devinette qui porta dans ses flancs toute cette mythologie : Qui sont les mâles difformes qui vont toujours fécondant ? À quoi le moins informé répondra sans peine : les nuages ». Justement les centaures prennent place parmi les personnages de la mythologie grecque qui fécondent le moins ! Ils sont lascifs, mais peu fécondants. La solution de la devinette de notre auteur serait plutôt Zeus. C'est un mâle ; il est difforme, en ce sens qu'il change souvent de forme pour séduire des déesses ou des mortelles ; et quant à féconder, il n'a pas son pareil. Dans la mythologie grecque, on ne parle que de ses fils et de ses filles.
§ 786. Si l'on tombe sur quelque personnage historique dont l'existence n'est pas certaine et semble légendaire, on finit généralement par en faire un mythe solaire. Tel doit être, par exemple, Junius Brutus, le meurtrier de Tarquin [FN: § 786-1].
§ 787. Employons ici encore la méthode indiquée au § 547. Un auteur grec – pour le moment ne disons pas qui –nous parle d'un certain Lamproclès, ![]() . Ce nom est composé de
. Ce nom est composé de ![]() , brillant, et de
, brillant, et de ![]() , gloire, célébrité. Mais qui est essentiellement brillant, glorieux, fameux ? Le Soleil, assurément. D'autre part, nous savons que Lamproclès était fils d'une cavale dorée ; et qui ne voit pas que c'est le Soleil, qui apparaît après l'Aurore au peplum couleur de crocus –
, gloire, célébrité. Mais qui est essentiellement brillant, glorieux, fameux ? Le Soleil, assurément. D'autre part, nous savons que Lamproclès était fils d'une cavale dorée ; et qui ne voit pas que c'est le Soleil, qui apparaît après l'Aurore au peplum couleur de crocus – ![]() ? C'est là un mythe solaire, plus certainement qu'un très grand nombre d'autres. Mais il y a une difficulté. L'auteur dont on n'a pas encore donné le nom est Xénophon ; Lamproclès est fils de Socrate et de Xanthippe (
? C'est là un mythe solaire, plus certainement qu'un très grand nombre d'autres. Mais il y a une difficulté. L'auteur dont on n'a pas encore donné le nom est Xénophon ; Lamproclès est fils de Socrate et de Xanthippe (![]()
![]() = rouge doré, =
= rouge doré, = ![]() cheval) ; et, en vérité, ni le Soleil ni l'Aurore n'ont que faire en tout cela.
cheval) ; et, en vérité, ni le Soleil ni l'Aurore n'ont que faire en tout cela.
§ 788. Célèbre est la plaisanterie qu'on a faite du mythe solaire, en montrant que même l'histoire de Napoléon 1er pouvait s'expliquer par ce mythe [FN: § 788-1].
§ 789. Nous avons parlé d'une légende de Virgile (§ 670). On pourrait facilement y voir un mythe solaire. Le voyage aérien de Virgile, le feu qui s'éteint et se rallume, nous suggèrent l'idée du Soleil, qui parcourt le ciel, s'éteint chaque jour en se couchant, et se rallume en se levant. L'identité de Virgile et du Soleil devient plus évidente, quand on songe à la manière dont Virgile mourut [FN: § 789-1] « ...(p. 229) il sentra en ung basteau et sen alla esbattre sur mer luy quatrieme par compagnie ; et ainsi quilz alloient devisant sur leau, vint ung estourbillon de vent... (p. 330) Si furent enlevez en haulte mer, puis apres nul deulx ne fut veu ne aparceu... ». Pour les habitants de Naples, le Soleil se couche en effet dans la mer. Quant au bateau, qui ne voit que c'est un emprunt fait à la mythologie égyptienne, laquelle fait voyager le Soleil dans un bateau ?
§ 790. Un auteur a démontré, non pour plaisanter, mais sérieusement, que le récit évangélique de la vie du Christ est un mythe solaire, semblable à des mythes hébraïques et babyloniens [FN: § 790-1] .
§ 791. Tout cela ne vise pas du tout à nier l'existence de mythes solaires, mais seulement à montrer qu'ils doivent être reconnus au moyen de preuves historiques, et non en vertu de ressemblances entre les circonstances d'un récit, indéterminées, arbitrairement interprétées, et les caractères généraux du mouvement solaire.
§ 792. D'une manière plus générale, il y a certainement eu des allégories ; non seulement celles qui sont l'œuvre artificielle d'interprètes, mais aussi d'autres qui naissent spontanément du peuple. D'autre part, le développement du phénomène est souvent l'inverse de ce qu'on suppose, quand on croit que l'allégorie vient du nom ; au contraire c'est souvent le nom qui vient de l'allégorie. Ce n'est pas parce qu'une jeune fille avait les doigts roses, qu'on l'a nommée Aurore ; c'est le phénomène de l'aurore qui a suggéré l'allégorie des doigts de rose.
§ 793. Herbert Spencer ne l'entend pas ainsi. Il étend au totémisme et aux mythes solaires sa théorie des déductions imparfaites de faits expérimentaux. Le culte des animaux est né du fait que l'homme et l'animal sont confondus dans l'esprit du sauvage. L'habitude de donner des noms d'animaux aux enfants, ou aux hommes, comme surnoms, aide cette assimilation des hommes et des animaux [FN: § 793-1] « (p. 464, § 171)... nous ne devons pas nous étonner que le sauvage qui manque de connaissance, qui n'a qu'une langue grossière, ait l'idée qu'un ancêtre appelé le Tigre était un vrai tigre ». De cette descendance de l'homme portant un nom d'animal, confondue avec la descendance de l'animal, on tire, par de beaux raisonnements logiques, tous les caractères du totémisme. « (p. 467, § 172) Une seconde conséquence, c'est que les animaux, une fois regardés comme parents des hommes, sont souvent traités avec considération... (p. 468, § 172) Naturellement, comme nouvelle conséquence, l'animal particulier qui donne le nom à la tribu et que l'on regarde comme un parent, est traité avec des égards particuliers... (p. 469, § 173) Si les Africains de l'est, selon Livingstone, croient que les âmes des chefs morts entrent dans les lions et rendent ces animaux sacrés, nous pourrons en conclure que le même caractère sacré s'attache aux animaux dont les âmes humaines sont des ancêtres. Les indigènes du Congo, qui ont au sujet des lions la même croyance, croient que le « lion épargne l'homme qu'il rencontre, quand il en est salué avec courtoisie » ; c'est que, d'après eux, on se concilie la faveur de la bête-chef qui a été l'auteur de la tribu. On peut prévoir que les prières et les offrandes seront l'origine d'un culte, et que l'homonyme animal deviendra un dieu ». L'auteur conclut ainsi : « (p. 471, § 173) Ainsi, étant une fois donnée la méprise à propos de titres métaphoriques qui ne manque pas de se produire dans le langage primitif, le culte des animaux est une conséquence naturelle ».
§ 794. Cette théorie ne voit que des actions logiques. Elle s'applique aussi aux végétaux et aux êtres inanimés. « (p. 491, § 181) Si l'on traite avec vénération un animal parce qu'on le regarde comme un premier ancêtre, on peut prévoir qu'il en sera de même d'un ancêtre végétal... (p. 504, § 186) La montagne est le lieu d'où la race est venue, l'origine, le père de la race ; les distinctions impliquées par les divers mots dont nous nous servons en ce moment ne peuvent se rendre dans les langues grossières. Ou bien les premiers parents de la race habitaient des cavernes de la montagne, ou la montagne s'identifie avec le lieu d'où ils sont sortis, parce qu'elle marque d'une façon très saisissante la région élevée qui fut leur berceau ». De cette façon tout s'explique. « (p. 507, § 187). Il ne semble pas improbable qu’une erreur d'interprétation des noms d'individus ait donné lieu à la croyance que la mer est un ancêtre ». – « (p. 509, § 188) Il est possible qu'on ait donné quelquefois le nom d'aurore en manière de compliment à une jeune fille aux (p. 510) joues vermeilles ; mais je n'en saurais fournir une preuve. Seulement, nous avons une preuve certaine qu'Aurore est un nom de naissance ». Herbert Spencer rapporte de nombreux faits qui démontrent comment les sauvages ont donné le nom d'Aurore à des êtres humains. Dans nos pays, il y a beaucoup de femmes qui portent ce nom. « (p. 510, § 188) Si donc Aurore est le nom réel d'une personne, si dans les pays où règne cette manière de distinguer les enfants, on l'a peut-être donné souvent à ceux qui naissent le matin de bonne heure, il se peut dire que les traditions concernant une personne appelée de ce nom aient conduit le sauvage à l’esprit simple, enclin à croire à la lettre tout ce que ses pères lui disaient, à confondre cette personne avec l'aube du jour. Par suite il aura interprété les aventures de cette personne de la façon que les phénomènes de l'aube rendaient la plus plausible ».
Le lecteur remarquera cette façon de raisonner, en accumulant une longue série d'hypothèses et de vraisemblances ; et il constatera que, par cette longue voie, nous parvenons au même but que l'on atteint d'un saut, quand on dit qu'une femme du nom d'Aurore a enlevé un jeune homme du nom d'Orion (§ 769).
Spencer continue: « (p. 511, § 189) Le culte des étoiles a-t-il une semblable origine ? Peut-on aussi les identifier avec des ancêtres ? Il semble difficile de le concevoir, et pourtant il y a des faits qui nous autorisent à le soupçonner ». – « (p. 515, § 190) Est-ce que l'identification de la lune avec des personnes qui ont vécu autrefois a pour cause une erreur d'interprétation de noms ? Il y a des raisons de le croire, alors même que nous n'en aurions pas de preuve directe ». – « (p. 519, § 191) N'y eût-il aucune preuve directe que les mythes solaires proviennent d'erreurs suscitées par des récits concernant des personnes réelles ou des événements réels de l'histoire d'un homme, les preuves tirées par analogie suffiraient pour légitimer notre opinion, mais les preuves directes abondent ». Ces preuves directes sont au contraire de simples interprétations de l'auteur, semblables à celles dont nous avons déjà donné des exemples,
§ 795. Toutes ces explications simples et a priori nous transportent en dehors de la réalité, où l'on trouve les faits très complexes des récits de mythes. Des souvenirs de faits réels, des imaginations fantaisistes, et, chez les peuples qui possèdent une littérature, des souvenirs d'œuvres littéraires jouent un rôle dans ces mythes et se mélangent en proportions variées. Il s'y ajoute diverses théories, depuis celles qui sont puériles, jusqu'aux plus ingénieuses, des métaphores, des allégories, etc. N'oublions pas non plus le groupement spontané des légendes autour d'un noyau primitif (§ 740), et l'emploi successif de voies souvent différentes.
§ 796. Par exemple, la proposition affirmant qu'Apollon est un dieu solaire est mêlée d'erreur et de vérité. Il y a de l'erreur, en ce sens que dans un cycle comme celui de l'Iliade, Apollon n'est pas un dieu solaire. Il y a du vrai, en ce que, dans d'autres cycles, les mythes solaires se sont mêlés au mythe non encore solaire d'Apollon, et qu'ils ont finalement acquis une telle prédominance, que ![]() s'est confondu avec
s'est confondu avec ![]() et avec Apollon.
et avec Apollon.
§ 797. Arrêtons-nous un moment, et voyons où l'induction nous a conduits. Non seulement elle a confirmé l'importance des actions non-logiques, déjà notée dès le chapitre II, mais elle nous a fait voir, en outre, comment ces actions constituent le fond de nombreuses théories qui, jugées superficiellement, paraîtraient être un produit exclusif de la logique.
§ 798. La longue étude que nous venons de faire, de certaines théories, a en tout cas abouti à reconnaître que les théories concrètes peuvent être divisées au moins en deux parties, dont l'une est beaucoup plus constante que l'autre. Afin d'éviter autant que possible que l'on ne raisonne sur des mots, au lieu de raisonner sur des faits (§ 119), nous commencerons par employer de simples lettres de l'αbet, pour désigner les choses dont nous voulons parler ; et ce n'est qu'au chapitre suivant que nous substituerons des noms à ce mode de notation peu commode. Nous dirons donc que dans les théories concrètes que nous désignerons par (c), outre les données de faits, il y a deux éléments ou parties principales : une partie ou élément fondamental, que nous désignerons par (a), et une partie ou élément contingent, généralement assez variable, que nous désignerons par (b) (§ 217, § 514-4).
La partie (a) correspond directement à des actions non-logiques ; elle est l'expression de certains sentiments. La partie (b) est la manifestation du besoin de logique qu'a l'homme. Elle correspond aussi partiellement à des sentiments, à des actions non-logiques, mais les revêt de raisonnements logiques ou pseudo-logiques. La partie (a) est le principe qui existe dans l'esprit de l'homme ; la partie (b), ce sont les explications, les déductions de ce principe.
§ 799. Par exemple, il existe un état psychique, auquel on peut donner le nom de principe, sentiment, ou tout autre à volonté, en vertu duquel certains nombres paraissent vénérables.
C'est la partie principale (a) d'un phénomène que nous étudierons plus loin(§ 960 et Sv.). Mais l'homme ne se contente pas d'unir des sentiments de vénération et des idées de nombres ; il veut aussi « expliquer » comment cela se fait, « démontrer » qu'il est mu par la force de la logique. Alors intervient la partie (b), et l'on a les différentes « explications » et « démonstrations » du motif pour lequel certains nombres sont sacrés.
Il existe chez l'homme un sentiment qui lui interdit d'abandonner sur-le-champ d'anciennes croyances ; c'est la partie (a) d'un phénomène étudié tantôt (§ 172 et sv.). Mais l'homme veut justifier, expliquer, démontrer son attitude. Alors intervient une partie (b) qui, de diverses manières, maintient la lettre de ces croyances et en change le fond.
§ 800. La partie principale du phénomène est évidemment celle à laquelle l'homme s'attache avec le plus de force, et qu'il tâche ensuite de justifier ; c'est la partie (a); et c'est, par conséquent, cette partie qui est la plus importante dans la recherche de l'équilibre social.
§ 801. Mais la partie (b), bien que secondaire, a aussi un effet sur l'équilibre. Parfois cet effet est si petit qu'on peut le considérer comme étant égal à zéro ; quand, par exemple, on justifie la perfection du nombre six, en disant qu'il est égal à la somme de ses parties aliquotes. Mais cet effet peut aussi être important ; par exemple, quand l'Inquisition brûlait les gens qui tombaient dans quelque erreur de déductions théologiques.
§ 802. Nous avons dit (§ 798) que la partie (b) est constituée en proportions variables de sentiments et de déductions logiques. Il convient de noter que, d'habitude, dans les sujets sociaux, sa force persuasive dépend principalement des sentiments, plutôt que de la déduction logique, qui est acceptée surtout parce qu'elle correspond à ces sentiments. Au contraire, dans les sciences logico-expérimentales, la part du sentiment tend vers zéro, au fur et à mesure que ces sciences deviennent plus parfaites, et la force persuasive réside tout entière dans la partie logique et dans les faits (§ 2340 et sv.). Parvenue à cet extrême, la partie (b) change évidemment de nature ; nous l'indiquerons par (B). À un autre extrême, on trouve des cas où la déduction logique ne se manifeste pas clairement ; ainsi, dans le phénomène dit des « principes latents » du droit [FN: § 802-1]. Les physiologistes expliquent ces cas à l'aide du subconscient, ou d'une autre manière. Quant à nous, nous ne voulons pas ici remonter si haut : nous nous arrêtons au fait, laissant à d'autres le soin d'en chercher l'explication. Entre ces deux extrêmes se trouvent toutes les théories concrètes, qui approchent plus ou moins de l'un de ces extrêmes.
§ 803. Bien que le sentiment n'ait rien à faire dans les sciences logico-expérimentales, il envahit toutefois un peu ce domaine. Négligeant pour un moment ce fait, nous pourrons dire que si nous désignons par (C) les théories concrètes de la science logico-expérimentale, lesquelles constituent le 2e genre du § 523, ces théories peuvent se décomposer en une partie (A) constituée par des principes expérimentaux, des descriptions, des affirmations expérimentales, et en une autre partie (B), constituée par des déductions logiques, auxquelles s'ajoutent aussi des principes et des descriptions expérimentales, employés pour tirer des déductions de la partie (A).
Les théories (c) où le sentiment joue un rôle, et qui ajoutent quelque chose à l'expérience, qui sont au delà de l'expérience, et qui constituent le 3e genre du § 523, se décomposent de même en une partie (a), constituée par la manifestation de certains sentiments, et une partie (b), constituée par des raisonnements logiques, des sophismes, et en outre par d'autres manifestations de sentiments, employées pour tirer des déductions de (a). De cette façon, il y a correspondance entre (a) et (A), entre (b) et (B), entre (c) et (C). Nous ne nous occupons ici que des théories (c), et nous laissons de côté les théories scientifiques, expérimentales (C).
§ 804. Dans les théories (c) qui dépassent l'expérience ou qui sont pseudo-expérimentales, il est bien rare que les auteurs distinguent avec une clarté suffisante les parties (a) et (b). Habituellement, ils les confondent plus ou moins.
§ 805. EXEMPLE. Parmi les principes du droit romain se trouve celui du droit de propriété. Ce principe admis, on en tire logiquement de nombreuses conséquences, qui constituent une partie très importante de la théorie du droit civil romain. Il y a un cas célèbre, celui de la spécification, où ce principe ne suffit pas pour résoudre les questions qu'on rencontre en pratique. Un éminent romaniste, Girard, s'exprime ainsi [FN: § 1] : « (p. 316) La théorie de la spécification suppose qu'une personne a pris une chose, notamment une chose appartenant à autrui, et a donné par son travail à cette substance une forme nouvelle, a créé une nova species (speciem novam fecit ), a fait du vin avec des raisins, un vase avec du métal, une barque avec des planches, etc. [FN: § 805-*] La question qui se pose est de savoir (p. 317) si l'objet ainsi confectionné est toujours l'objet ancien, qui appartiendrait alors forcément toujours à l'ancien propriétaire, ou si c'est un objet nouveau pour lequel on pourrait concevoir qu'il eût aussi un maître nouveau ». Cette façon de poser la question confond déjà quelque peu les parties (a) et (b) du droit. Pour bien les distinguer, on devrait dire : « La question qui se pose est de savoir à qui l'on doit donner un objet unique, en lequel se sont confondus deux droits de propriété ».
§ 806. Celui qui s'occupe exclusivement de théories juridiques (c) devrait, dans ce cas, avouer simplement que les principes qui lui sont provenus de la partie (a) du droit, ne suffisent pas à résoudre le problème, et que, par conséquent, d'autres sont nécessaires. Le nouveau principe requis pourrait être qu'un objet ancien appartient toujours à l'ancien propriétaire, et qu'un objet nouveau peut avoir un propriétaire nouveau. Dans ce cas, l'énoncé du problème, donné par Girard, est parfait ; mais nous n'éludons une difficulté que pour en rencontrer une autre. Il nous faut maintenant un principe, pour savoir avec rigueur et précision comment on distingue l'objet nouveau de l'ancien ; non pas en général, prenons-y garde, mais au point de vue de la propriété. Par conséquent, nous n'avons approché que peu ou pas du tout de la solution du problème.
§ 807. Le droit (a) peut nous donner le principe d'après lequel la propriété de la chose l'emporte sur la propriété du travail. Nous pouvons prévoir que ce fut peut-être là le principe archaïque ; parce que, d'un côté, la propriété de la matière est une chose plus concrète que la propriété du travail, et qu'en général, le concret précède l'abstrait, et parce que, d'un autre côté, le travail n'était pas très considéré, dans l'ancienne société romaine.
§ 808. Girard dit : « (p. 317) Il est à croire que les anciens jurisconsultes considéraient, sans raffinements doctrinaux, l'objet comme étant toujours le même ». Il décrit ainsi plutôt l'évolution de la forme que celle du fond. Les anciens jurisconsultes avaient probablement dans l'esprit une tendance non-logique, qui les poussait à faire prévaloir la propriété de la matière sur celle du travail. Ensuite, eux ou leurs successeurs, voulant donner un motif logique à leur manière de procéder, auront imaginé de considérer que l'objet était toujours le même. Mais un autre prétexte quelconque aurait pu servir tout aussi bien.
§ 809. Le progrès de la civilisation romaine produisit le progrès correspondant des facultés d'abstraction et de la considération du travail. Nous devons donc prévoir qu'en des temps postérieurs, le droit (a) nous donnera d'autres principes non-logiques, qui seront plus favorables au travail.
§ 810. Traitant justement de la spécification, Gains dit (II, 79) : « En d'autres espèces, on recourt à la raison naturelle ». Cette naturalis ratio est notre vieille connaissance. Il serait extraordinaire qu'elle n'eût pas fait apparition. Elle était l'autorité sous laquelle les jurisconsultes romains plaçaient l'expression de leurs sentiments, qui correspondaient aux actions non-logiques de la société dans laquelle ils vivaient. Gaius dit (II, 77) que l'écrit fait sur parchemin appartient au propriétaire du parchemin ; tandis que (II, 78), pour un tableau peint sur toile, on décide le contraire ; et il ajoute qu'« on donne de cette différence un motif à peine valable ». C'est ce qui arrive habituellement, quand on veut expliquer logiquement les actions non-logiques.
§ 811. Girard continue : « (p. 317) Plus tard, les Proculiens ont, en vertu d'une analyse plus délicate, soutenu que c'était un objet nouveau et qu'il devait appartenir à l'ouvrier, soit en disant que celui-ci l'avait acquis par occupation, soit peut-être simplement en partant de l'idée qu'une chose doit être à celui qui l'a faite ». Là aussi, nous avons l'évolution de la forme plutôt que celle du fond. Ce n'est pas « une analyse plus délicate », qui a donné de nouveaux principes ; elle a donné la justification logique des sentiments non-logiques qui s'étaient developpés dans l'esprit des Romains et de leurs jurisconsultes.
§ 812. « (p. 317) En face de cette doctrine nouvelle, les Sabiniens, probablement sans nier qu'il y eût un objet nouveau, ont refusé d'admettre l'acquisition de l'œuvre par l'ouvrier et ont soutenu que la chose nouvelle devait appartenir au propriétaire de la chose ancienne ». Comme de coutume, les Sabiniens avaient une solution dictée par certains de leurs sentiments, et tâchaient ensuite de la justifier par des raisonnements logiques.
§ 813. Le Digeste nous donne un échantillon de ces raisonnements (XLI, 1, 7). « Si quelqu'un a créé en son nom une nouvelle espèce, avec les matériaux d'autrui, Nerva et Proculus estiment que le propriétaire est celui qui a créé. Sabinus et Cassius estiment plus conforme à la raison naturelle, que celui qui était propriétaire des matériaux soit propriétaire de ce qui est fait avec ces mêmes matériaux ; parce que sans matériaux, aucune espèce ne peut être produite ». Elle est complaisante, cette naturalis ratio ; elle ne refuse jamais son secours à personne, et grâce à elle, on peut démontrer très facilement le pour et le contre. Ces raisonnements sont vides de sens et ne manifestent que certains sentiments.
§ 814. On a fini par admettre une solution moyenne, sans pouvoir l'appuyer sur de meilleurs motifs. On a suivi l'opinion de Sabinus et de Cassius, quand on pouvait rendre à l'ouvrage fait sa forme primitive ; et quand cela n'était pas possible, on a suivi l'opinion de Nerva et de Proculus.
§ 815. Revenons au cas général. Le langage vulgaire est presque toujours synthétique et vise des cas concrets ; aussi confond-il habituellement les parties (a) et (b) que l'analyse scientifique doit séparer (§ 817). Au point de vue pratique, il peut être utile de traiter ensemble les parties (a) et (b). Si les principes (a) étaient précis, ceux qui les admettent en accepteraient aussi toutes les conséquences logiques (b) ; mais les principes (a) manquant de précision, on en peut tirer ce qu'on veut ; et c'est pourquoi les déductions (b) ne sont admises que dans la mesure où elles sont d'accord avec les sentiments qui, de cette manière, sont appelés à dominer les déductions logiques [FN: § 815-1] .
§ 816. Le blâme souvent adressé à la casuistique morale ou aux subtilités légales, a pour principale raison le fait que, grâce au manque de précision des principes (a), on a intentionnellement tiré de ceux-ci des conséquences qui répugnent au sentiment.
§ 817. Au point de vue scientifique, tout perfectionnement de la théorie est étroitement lié au fait de séparer autant que possible les parties (a) et (b). C'est là un point sur lequel on ne saurait trop insister. Il va sans dire que l'art doit étudier synthétiquement le phénomène concret (c), et que, par conséquent, il ne sépare pas les parties (a) et (b) ; et c'est un puissant moyen de persuasion, parce que presque tous les hommes ont l'habitude de la synthèse, et comprennent difficilement, ou mieux, sont incapables de comprendre l'analyse scientifique. Mais qui veut édifier une théorie scientifique ne peut s'en passer. Tout cela est très difficile à faire comprendre à ceux qui n'ont pas l'habitude du raisonnement scientifique, ou qui s'en défont quand ils traitent de matières touchant la sociologie. Ils veulent obstinément envisager les phénomènes d'une manière synthétique (§ 25, 31).
§ 818. Quand on lit un auteur avec l'intention d'en juger scientifiquement les théories, il faut donc effectuer d'abord la séparation qu'il n'a presque jamais faite, des parties (a) et (b). En général, dans toute théorie, il est nécessaire de bien séparer les prémisses, c'est-à-dire les principes, les postulats, les sentiments, des déductions qu'on en tire [FN: § 818-1].
§ 819. Il faut prendre garde que souvent, dans les théories qui ajoutent quelque chose à l'expérience (§ 803), les prémisses sont au moins partiellement implicites ; c'est-à-dire que la partie (a) de la théorie n'est pas exprimée ou ne l'est pas entièrement. Si on veut la connaître, il faut la chercher. C'est justement ce que nous avons été conduit à effectuer incidemment, depuis le chapitre II (§ 186 et sv., 740), puis dans les chapitres IV et V. Bientôt nous nous en occuperons à fond dans les chapitres suivants.
§ 820. Au point de vue logico-expérimental, le fait que les prémisses sont implicites, même seulement d'une manière partielle, peut être la source de très graves erreurs. Le seul fait d'exprimer les prémisses pousse à rechercher si et comment on doit les admettre ; tandis que, si elles sont implicites, on les accepte sans avoir conscience de ce qu'on fait ; on les croit rigoureuses, alors que, loin de l'être, c'est à peine si on peut leur trouver un sens quelconque.
§ 821. Souvent les auteurs passent sous silence les prémisses étrangères à l'expérience, et souvent aussi, quand ils les énoncent, ils essaient de faire naître une confusion entre elles et les résultats de l'expérience. On a un exemple remarquable de cette confusion, dans la théorie dont Rousseau fait précéder son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes [FN: § 821-1] . « Commençons donc d'abord par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblables à celles que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde » [FN: § 821-2] . En somme, c'est donc une recherche expérimentale que veut faire Rousseau ; mais son expérience est d'une nature spéciale – comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience religieuse – et qui n'a rien à voir avec l'expérience des sciences physiques, malgré la confusion que Rousseau essaie de créer, et qui n'est qu'une preuve de sa grande ignorance. Notre auteur continue : « La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes de l'état de nature immédiatement après la création, ils sont inégaux parce qu'il a voulu qu'ils le fussent ; mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la nature seule de l'homme et des êtres qui l’environnent [voilà la pseudo-expérience], sur ce qu'aurait pu devenir le genre humain s'il fût resté abandonné à lui-même. Voilà ce qu'on me demande, et ce que je me propose d'examiner dans ce discours. Mon sujet intéressant l'homme en général [abstraction qui a pour but de chasser l'expérience, après avoir fait semblant de l'admettre], je tâcherai de prendre un langage qui convienne à toutes les nations [dont une partie était absolument inconnue à ce savant rhéteur], ou plutôt, oubliant le temps et les lieux, pour ne songer qu'aux hommes à qui je parle, je me supposerai dans le lycée d'Athènes, ayant les Platon et les Xénocrate pour juges, et le genre humain pour auditeur ». Et il continue à pérorer, et découvre, en partant de la nature des choses, comment elles ont dû être ; cela sans avoir l'ennui de vérifier ses belles théories par les faits, puisqu'il a commencé par dire qu'il les mettait de côté. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de personnes qui admirent de tels discours vides de sens ; c'est pourquoi l'on doit en tenir compte, quand on veut étudier les phénomènes sociaux.
§ 822. Bon nombre d'autres auteurs, qui affectent pourtant de n'employer que des méthodes scientifiques et même de science « matérialiste », suivent d'une manière plus ou moins couverte la voie ouvertement parcourue par Rousseau. Voici, par exemple, Engels, qui avoue qu'on ne peut avoir de témoignages directs d'un certain état inférieur de l'humanité, mais qui en démontre a priori l'existence, comme étant une conséquence de la transformation de l'animal en homme. Il est beau d'écrire ainsi l'histoire [FN: § 822-1], et de tirer d'hypothèses tout à fait incertaines, la description de temps tout à fait inconnus. Les gens qui admirent de semblables façons de raisonner se croient plus « scientifiques » que ceux qui admiraient les saints Pères de l'Église catholique, quand ils niaient l'existence des antipodes (§ 15).
§ 823. Un cas amusant est celui de Burlamaqui (§ 439). Sa théorie du « droit naturel » est entièrement métaphysique. Il écrit pourtant [FN: § 823-1] : « ... si l'on fait bien attention à la manière dont nous avons établi les principes des lois naturelles, on reconnaîtra que la méthode que nous avons suivie est une nouvelle preuve de la certitude et de la réalité de ces lois. Nous avons mis à part toute spéculation abstraite et métaphysique, pour ne consulter que le fait, que la nature et l'état des choses ». Mais il ne tarde pas à se démentir lui-même, avec une grande naïveté, en continuant ainsi :. « C'est dans la constitution essentielle de l'homme et dans les rapports qu'il a avec les autres êtres, que nous avons puisé nos principes... ». La constitution essentielle dépasse l'expérience, à laquelle sont étrangères toutes les considérations sur les essences. Notre auteur comprend si peu ce qu'il dit, qu'il ajoute : « ...il nous semble qu'on ne saurait méconnaître les lois naturelles, ni douter de leur réalité, sans renoncer aux plus pures lumières de la raison, ce qui conduirait jusqu'au pyrrhonisme ». Dans le domaine expérimental, c'est l'accord de la théorie avec les faits qui décide, et non « la pure lumière de la raison ».
§ 824. En admettant la partie (a), on peut constituer par la méthode déductive la partie (b) ou mieux (B) ; c'est pourquoi son étude est beaucoup plus facile que celle de la partie (a). Cette étude a produit les seules sciences sociales qui sont aujourd'hui développées et rigoureuses : la science des théories juridiques et l'économie pure (§ 825). Cette étude de la partie (b) sera d'autant plus parfaite qu'elle sera constituée davantage par la logique seule ; d'autant plus imparfaite, au contraire, qu'un grand nombre de principes non-expérimentaux s'insinueront et seront acceptés, alors que, rigoureusement, ils devraient rester dans la partie (a). En outre, puisque cette partie (a) ou même (A) (§ 803) est celle qui donne ou peut donner lieu à des doutes et des incertitudes, plus elle sera petite, plus la science qu'on en déduit pourra être rigoureuse.
§ 825. L'économie pure a justement l'avantage de pouvoir tirer ses déductions d'un très petit nombre de principes expérimentaux, et emploie la logique avec tant de rigueur [FN: § 825-1] , qu'elle peut donner une forme mathématique à ses raisonnements ; ceux-ci ont aussi le très grand avantage de porter sur des quantités. La science des théories juridiques a aussi l'avantage de nécessiter un petit nombre de principes, mais n'a pas celui de pouvoir traiter de quantités. Ce grave inconvénient subsiste encore pour la sociologie ; mais il faut faire disparaître celui de l'intromission de la partie (a) dans la partie (b).
§ 826. En général, on peut admettre arbitrairement certains principes (a) ; et pourvu qu'ils soient précis, on en pourra tirer un corps de doctrine (c). Mais il est évident que si ces principes (a) n’ont rien à voir avec la réalité, la partie (c) n'aura rien à faire avec les cas concrets. Quand on veut constituer une science, il convient donc de choisir judicieusement les principes (a), de façon à s'approcher le plus possible de la réalité, en sachant toutefois que jamais une théorie (c) ne pourra la reproduire dans tous ses détails (§ 106).
§ 827. Il y a d'autres théories sociologiques, par lesquelles on a essayé de constituer un corps de doctrine rigoureusement scientifique, mais malheureusement sans réaliser cette intention, parce que les principes dont on tirait les déductions s'écartaient trop de l'expérience (§ 2015 et sv.).
§ 828. Le darwinisme social est l'une de ces théories. Si l'on admet que les institutions d'une société sont toujours celles qui correspondent le mieux aux circonstances où elle se trouve, excepté des oscillations temporaires, et que les sociétés qui ne possèdent pas d'institutions de ce genre finissent par disparaître, on a un principe apte à recevoir des développements logiques importants, et capable de constituer une science. Cette étude a été faite, et pendant quelque temps, on a pu espérer avoir enfin une théorie scientifique (c) de la sociologie, étant donné qu'une partie des déductions (b) étaient vérifiées par les faits. Mais cette doctrine tomba en décadence avec celle dont elle tirait son origine : avec la théorie darwinienne de la production des espèces animales et végétales. On s'aperçut que, trop souvent, on arrivait à donner des explications verbales des faits. Toute forme des institutions sociales ou des êtres vivants devait être expliquée par l'utilité qu'elle produisait ; et, pour y arriver, on faisait intervenir des utilités arbitraires et imaginaires. Sans s'en apercevoir, on revenait ainsi à l'ancienne théorie des causes finales. Le darwinisme social demeure encore un corps de doctrine (c) assez bien construit ; mais il faut le modifier beaucoup, pour le mettre d'accord avec les faits. Il ne détermine pas la forme des institutions : il détermine seulement certaines limites que celles-ci ne peuvent outrepasser (§ 1770).
§ 829. Une autre théorie (b) est constituée par le matérialisme historique. Si on le comprend en ce sens que l'état économique d'une société y détermine entièrement tous les autres phénomènes sociaux, on obtient un principe (a), dont on peut tirer de nombreuses déductions, de manière à constituer une doctrine. Le matérialisme historique a été un notable progrès scientifique, parce qu'il a servi à mettre en lumière le caractère contingent de certains phénomènes, tel que le phénomène moral et le phénomène religieux, auxquels on donnait, et beaucoup donnent encore, un caractère absolu. En outre, il renferme certainement une part de vérité, qui est la mutuelle dépendance du phénomène économique et des autres phénomènes sociaux. L'erreur, ainsi que nous aurons souvent à le rappeler, consiste à avoir changé cette mutuelle dépendance en une relation de cause à effet.
§ 830. Une circonstance accessoire est venue accroître considérablement l'erreur. Le matérialisme historique s'est joint à une autre théorie : celle de la « lutte des classes », dont il pourrait toutefois être entièrement indépendant ; et de plus, par une audacieuse dichotomie, ces classes furent réduites à deux. De cette manière, on abandonna de plus en plus le domaine de la science, pour faire des excursions dans celui du roman. La sociologie devient une science très facile ; il est inutile de perdre son temps et sa peine à découvrir les rapports des phénomènes, leurs uniformités ; quel que soit le fait que nous raconte l'histoire ; quelle que soit l'institution qu'elle nous décrive, quelle que soit l'organisation politique, morale, religieuse, qu'elle nous fasse connaître, tous ces faits ont pour cause unique l'action de la « bourgeoisie » pour « exploiter le prolétariat », et subsidiairement la résistance du « prolétariat » à l'exploitation. Si les faits correspondaient à ces déductions, nous aurions une science aussi et même plus parfaite que toute autre science humaine. Malheureusement, la théorie suit une voie, et les faits en suivent une autre, entièrement différente (§ 1884).
§ 831. Une autre théorie encore, qu'on peut dire être celle de Spencer et de ses adeptes, pourrait s'appeler la théorie des limites, si l'on enlève les nombreuses parties métaphysiques des œuvres de ces auteurs. Elle prend pour principe (a) que toutes les institutions sociales tendent vers une limite, sont semblables à une courbe qui a une asymptote (§ 2279 et sv.). Connaissant la courbe, on peut déterminer l'asymptote. Connaissant le développement historique d'une institution, on peut en déterminer la limite ; et même, on le fait plus facilement que dans le problème beaucoup plus simple de la détermination mathématique des asymptotes ; car, pour celle-ci, il ne suffit pas de connaître quelques points de la courbe : il faut en avoir l'équation, c'est-à-dire en connaître la nature intrinsèque ; tandis qu'une fois donnés quelques points de la courbe qui représente une institution, on peut, ou pour mieux dire, on croit pouvoir en déterminer ipso facto la limite.
§ 832. Ce principe (a) est susceptible de déductions scientifiques (b), et donne par conséquent un corps de doctrine étendu. On peut le voir dans la sociologie de Spencer et dans d'autres ouvrages analogues. Avec ces doctrines, nous nous approchons beaucoup de la méthode expérimentale, – toujours abstraction faite des parties métaphysiques de ces œuvres – car enfin, c'est des faits que nous tirons les conclusions. Malheureusement, ce n'est pas des faits seuls : il y a en outre l'intromission de ce principe, que les institutions ont une limite, et de cet autre, qu'on peut déterminer cette limite, en connaissant un petit nombre d'états successifs des institutions.
Ajoutons que, par une coïncidence qui serait vraiment étrange si elle était fortuite, la limite qu'un auteur suppose déterminée exclusivement par les faits, se trouve être identique à celle que l'auteur est poussé à désirer par ses propres sentiments. S'il est pacifiste comme Spencer, des faits complaisants lui démontrent que la limite dont se rapprochent les sociétés humaines est celle de la paix universelle ; s'il est démocrate, aucun doute que la limite ne sera le triomphe complet de la démocratie ; s'il est collectiviste, le triomphe du collectivisme ; et ainsi de suite. Alors surgit et se fortifie un doute : les faits ne serviraient-ils pas uniquement à voiler des motifs plus puissants de persuasion ?
Quoi qu'il en soit, les motifs admis de cette manière, par ces positivistes, ne correspondent pas du tout aux faits, et cela vicie toutes les déductions qu'on en tire. Ensuite, leurs théories présentent le grave défaut, qui d'ailleurs pourrait se corriger avec le temps, que nous sommes bien loin de posséder aujourd'hui les renseignements historiques qui seraient strictement indispensables à l'emploi de cette méthode.
§ 833. La théorie à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure est d'une autre nature que celles qui, choisissant un principe (a), tout à fait dépourvu de précision, vague, indéfini, nébuleux, en tirent des conclusions avec une logique apparemment rigoureuse. Ces conclusions ne sont autre chose que l'expression des sentiments de leur auteur, et le raisonnement qui les relie à (a) ne leur procure pas même la plus petite force démonstrative. En effet, un cas très fréquent est celui où, d'un même principe (a), un auteur tire certaines conclusions, tandis qu'un autre en tire d'entièrement opposées. En général, il y a peu à dire sur le raisonnement, mais beaucoup sur le principe, qui ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux, et qui, comme la gomme élastique, peut être étiré dans le sens désiré.
§ 834. Les théories (c) ne peuvent parvenir à une forme même passablement scientifique, que si les principes (a) sont tant soit peu précis. À ce point de vue, une précision artificielle vaut encore mieux que le défaut de toute précision. Quand nous traitons de matières juridiques, ce défaut de précision peut être corrigé par les fictions (§ 834 note 1). Dans d'autres sciences aussi, on peut tirer profit de cette méthode, employée dans le but de simplifier l'énoncé des théorèmes. On s'en sert même en mathématique. Par exemple, le théorème d'après lequel toute équation algébrique a un nombre de racines égal à son degré est utile et commode sous cette forme ; mais il n'est vrai que grâce à la fiction qui fait compter au nombre des racines, non seulement les racines réelles, mais aussi les racines imaginaires.
§ 835 C'est un fait très connu qu'à Rome le droit prétorien a corrigé le droit civil, non pas en en changeant les principes (a), qui conservèrent quelque temps toute leur rigueur formelle, mais en y ajoutant des interprétations et des dispositions. Le préteur annonce que, tandis que, d'après le droit civil, l'engagement obtenu par le dol est valable, il donnera une exception pour ne pas exécuter l'engagement, c'est-à-dire qu'il insère dans la formule la clause qui enjoint au juge de condamner, seulement si in ea re nihil dolo malo Auli Ageri (nom conventionnel du demandeur) factum sit neque fiat (exceptio doli mali) [FN: § 835-1] . Quelle que soit la théorie qu'on admette à propos de la bonorum possessio, il est incontestable qu'à une certaine époque, cette bonorum possessio a servi à l'introduction d'une hérédité prétorienne plus étendue que l'hérédité du droit civil. Les deux modes d'hérédité existaient ensemble. Si l'on voulait, par exemple, tenir compte de la consanguinité, on aurait pu modifier le droit civil, comme les empereurs le firent plus tard. On a préféré appeler à l'hérédité unde liberi ceux que le droit civil aurait appelés comme sui, s'ils n'avaient été l'objet d'une minima capilis diminutio.
§ 836. Cette façon de procéder était en rapport étroit avec l'état psychique dont nous avons longuement parlé au chapitre II ; mais en outre, probablement sans s'en apercevoir, on atteignait un résultat fort important : celui de donner de la stabilité aux principes (a) du droit et, par conséquent, de pouvoir constituer le corps de doctrines (c). C'est là probablement une des raisons principales pour lesquelles le droit romain put devenir tellement supérieur au droit athénien.
§ 837. Il existe des théories semblables à celles du droit romain, dans un très grand nombre de cas. On a pu croire que certains pays, comme l'Angleterre, qui n'avaient que le droit coutumier (en Angleterre : la common law ), possédaient seulement un droit (a). Mais c'est une erreur que Sumner Maine a très bien corrigée [FN: § 837-1] . Il a noté les analogies du droit anglais, supposé issu des case law antérieures, avec les responsa prudentium des Romains. La partie (b) existe dans le droit de la common law ; mais elle est théoriquement très inférieure aux parties (b) d'autres droits, qui ont décidément édifié et accepté les théories juridiques.
§ 838. Les êtres concrets juridiques sont constitués par les parties (a) et (b). Le droit descriptif (c) nous fait connaître ces êtres, comme la minéralogie nous fait connaître les roches et les minéraux dont la chimie nous apprend ensuite la composition.
§ 839. Le prof. Roguin nous a donné des traités de (b) et de (c), avec peu de (a). Par conséquent ces traités appartiennent, au moins en partie, à la science générale de la société. Dans son livre : La règle de droit, il s'occupe de (b). Il dit : « (p. V) il s'agit d'une étude absolument neutre, c'est-à-dire affranchie de toute appréciation. Il n'y a dans notre livre aucune trace de critique, au point de vue de la justice ou de la morale. Ce n'est pas non plus une étude de droit naturel, ni de philosophie, dans le sens ordinairement prêté à ce mot. L'ouvrage ne porte pas davantage sur l'histoire du droit ; il ne se préoccupe point de rattacher les institutions juridiques à leurs causes, ni d'en montrer les effets. Nous ne traitons pas même du droit comparé. – Nous avons eu pour but d'analyser les règles de droit ayant existé historiquement ou « même seulement (p. VI) imaginables, possibles, de montrer la nature distincte du rapport juridique à l'égard des relations d'autres espèces et d'en dégager les éléments constants ».
§ 840. Puis, dans son Traité de droit civil comparé, le même auteur s'occupe de (c), en y ajoutant quelque développement (b) [FN: § 840-1] . « (p. 9) Il importe de distinguer rigoureusement les constatations des appréciations [on le fait bien rarement en sociologie], l'histoire, qui enregistre les faits objectifs, de la critique, exprimant sur eux des jugements [on ne veut pas même le faire en histoire !] ».
§ 841. L'application des dispositions du droit civil est souvent facile, parce qu'elles excitent peu, du moins en général, les sentiments. Ceux-ci acquièrent déjà une grande force dans le droit pénal ; ils deviennent souverains dans le droit international. C'est l'une des très nombreuses raisons pour lesquelles les théories du droit pénal ont toujours été beaucoup moins parfaites que celles du droit civil. Dans la morale et dans la religion, les sentiments dominent, et par conséquent il est très difficile d'avoir des théories, sinon scientifiques, du moins un peu précises. On a simplement un monceau informe d'expressions de sentiments et de préjugés métaphysiques [FN: § 841-1] . L'école italienne du droit positif pourrait devenir scientifique, si elle se débarrassait des appendices inutiles de la foi démocratique, et si elle n'avait pas la manie des applications immédiates, qui sont le grand ennemi de tout genre de théories. Il semble en tout cas que c'est en suivant la voie qu'elle a ouverte, qu'on pourra parvenir à une théorie scientifique du droit pénal. La théologie possède une partie (b), qui est souvent bonne et bien développée, comme chez Saint Thomas, mais la partie (a) dépasse entièrement l'expérience ; et par conséquent, nous n'avons pas à nous en occuper. L'éthique part aussi de principes non expérimentaux, et a de plus une partie (b) vraiment informe, et qui perd presque toute valeur logique quand l'éthique se sépare de la théologie. Avec ces pseudo-sciences, nous sortons complètement du domaine logico-expérimental.
[450]
Chapitre VI↩
Les résidus [(§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577]
§ 842. Si l'on suivait la méthode déductive, ce chapitre devrait être placé au commencement de l'ouvrage. Plus tard, il conviendra peut-être d'employer cette méthode pour d'autres traités. J'ai préféré commencer maintenant par la méthode inductive, afin que le lecteur parcoure, lui aussi, le chemin suivi pour trouver les théories qui vont être exposées.
En observant les phénomènes concrets et complexes, nous avons vu immédiatement qu'il était avantageux de les diviser au moins en deux parties, et de séparer les actions logiques des actions non-logiques. Le chapitre II a pour but d'effectuer cette séparation, et d'acquérir une première idée de la nature des actions non-logiques et de leur importance dans les phénomènes sociaux. À cet endroit, surgit cette question : si les actions non-logiques ont tant d'importance dans les phénomènes sociaux, comment a-t-on pu négliger jusqu'à présent d'en tenir compte ? (§ 252). On répond, au chapitre III, que presque tous les auteurs qui se sont occupés d'études politiques ou sociales, ont vu ou entrevu les actions non-logiques. Ainsi nous faisons maintenant une théorie dont beaucoup d'éléments sont épars çà et là, souvent d'une façon à peine reconnaissable.
§ 843. Mais tous ces auteurs ont des idées auxquelles ils donnent explicitement une importance capitale ; telles seraient les idées de religion, de morale, de droit, etc., autour desquelles on bataille depuis des siècles. Et s'ils reconnaissent implicitement les actions non-logiques, ils exaltent explicitement les actions logiques, et le plus grand nombre d'entre eux les considèrent comme seules dignes d'être prises en considération dans les phénomènes sociaux. Nous devons voir ce qu'il y a de vrai dans ces théories, et décider ensuite s'il nous faut quitter la voie où nous sommes entrés, ou la poursuivre. Au chapitre IV, nous étudions justement ces façons d'envisager les phénomènes sociaux ; et nous reconnaissons qu'au point de vue logico-expérimental, elles manquent absolument de précision, et sont dépourvues de tout accord rigoureux avec les faits ; tandis que, d'autre part, nous ne pouvons nier la grande importance qu'elles ont dans l'histoire et dans la détermination de l'équilibre social. Ainsi acquiert de la force une conception que le chapitre I nous avait déjà donnée, et dont l'importance ira toujours en augmentant dans le reste de l'ouvrage ; c'est l'idée de la séparation de la vérité expérimentale de certaines théories, et de leur utilité sociale ; choses qui, non seulement ne se confondent pas, mais peuvent même être et sont souvent contradictoires (§ 1681 et sv., 1897 et sv.).
§ 844. Cette séparation est aussi importante que celle des actions logiques et des actions non-logiques; et l'induction nous montre que c’est pour l'avoir négligée, que la plupart des théories sociales sont tombées dans l'erreur, au point de vue scientifique.
§ 845. Nous étudions alors d'un peu plus près ces théories, et nous voyons comment et pourquoi elles sont erronées, et comment et pourquoi, tout en étant telles, elles ont eu et ont encore un si grand crédit. C'est la tâche du chapitre V. En procédant à cette étude, nous trouvons d'autres choses auxquelles nous n'avions pas pensé tout d'abord. Poursuivant nos recherches, nous continuons à analyser, à séparer. Et voici maintenant une nouvelle séparation, certainement aussi importante que les autres auxquelles nous avons procédé jusqu'à présent : la séparation d'une partie constante, instinctive, non-logique, et d'une partie déductive, qui vise à expliquer, justifier, démontrer la première.
§ 846. Arrivés à ce point, grâce à l'induction, nous avons les éléments d'une théorie. Il faut maintenant la constituer ; C'est-à-dire abandonner la méthode inductive pour la méthode déductive, et voir quelles sont les conséquences des principes que nous avons trouvés ou cru trouver. Nous comparerons ensuite ces déductions avec les faits. S'ils concordent, nous conserverons notre théorie s'ils ne concordent pas, nous l'abandonnerons.
§ 847. Dans le présent chapitre et, en raison de l'abondance des matériaux, dans les deux suivants aussi, nous étudierons la partie constante que nous avons désignée par la lettre (a). Aux chapitres IX et X, nous étudierons la partie déductive (b). Mais avant de poursuivre ces études difficiles, il est nécessaire de placer encore quelques considérations générales sur (a) et (b), ainsi que sur leur résultante (c).
§ 848. Nous avons déjà vu (§ 803) que, dans les théories de la science logico-expérimentale, on trouve des éléments (A) et (B), qui sont en partie semblables aux éléments (a) et (b) des théories non purement logico-expérimentales, et sont en partie différents.
Dans les sciences sociales, telles qu'on les a étudiées jusqu'à présent, on trouve des éléments qui se rapprochent plus de (a) que de (A), parce qu'on n'a pas évité l'intromission du sentiment, de préjugés, d'articles de foi et d'autres semblables tendances, postulats, principes, qui font sortir du domaine logico-expérimental.
§ 849. La partie déductive des sciences sociales, telles qu'on les a étudiées jusqu'à présent, se rapproche parfois beaucoup de (B), et l'on ne manque pas d'exemples, dans lesquels l'emploi d'une logique rigoureuse la ferait concorder tout à fait avec (B), si ce n'était le défaut de précision des prémisses (a) ; défaut qui enlève toute rigueur au raisonnement. Mais souvent, dans ces sciences sociales, la partie déductive se rapproche beaucoup de (b), parce qu'elle renferme de nombreux principes non-logiques, non-expérimentaux, et que les tendances, les préjugés, etc., y sont très puissants.
§ 850. Occupons-nous maintenant d'étudier à fond les éléments (a) et (b). L'élément (a) correspond peut-être à certains instincts de l'homme, ou pour mieux dire, des hommes, parce que (a) n'a pas d'existence objective et diffère suivant les hommes ; et c'est probablement parce qu'il correspond à ces instincts, qu'il est presque constant dans les phénomènes. L'élément (b) correspond au travail accompli par l'esprit pour rendre raison de l'élément (a). C'est pour cela qu'il est beaucoup plus variable, puisqu'il reflète le travail de la fantaisie. Nous avons vu déjà, au chapitre précédent, (§ 802) que la partie (b) doit, à son tour, être divisée, en partant d'un extrême où elle est purement logique, pour arriver à un autre extrême où elle est un pur instinct et une fantaisie. Nous nous occuperons de cela aux chapitres IX et X.
§ 851. Mais si la partie (a) correspond à certains instincts, elle est bien loin de les comprendre tous. Cela se voit à la manière même dont on l'a trouvée. Nous avons analysé les raisonnements et cherché la partie constante. Ainsi donc, nous ne pouvons avoir trouvé que les instincts qui donnent naissance à des raisonnements, et nous n'avons pu rencontrer sur notre chemin ceux qui ne sont pas recouverts par des raisonnements. Restent donc tous les simples appétits, les goûts, les dispositions et, dans les faits sociaux, cette classe très importante qu'on appelle les intérêts.
§ 832. En outre, il se peut que nous n'ayons trouvé qu'une partie d'une des choses (a), l'autre demeurant à l'état de simple appétit. Par exemple, si l'instinct sexuel ne se manifestait qu'en tendant à rapprocher les sexes, il n'apparaîtrait pas dans nos études. Mais cet instinct se recouvre souvent et se dissimule sous le couvert de l'ascétisme : il y a des gens qui prêchent la chasteté pour avoir l'occasion d'arrêter leurs pensées aux unions sexuelles. Quand nous examinerons leurs raisonnements, nous trouverons donc une partie (a), qui correspond à l'instinct sexuel, et une partie (b), qui est un raisonnement dont elle se revêt. En cherchant attentivement, peut-être trouverait-on des parties analogues dans les appétits pour les aliments et les boissons ; mais pour ceux-ci la part du simple instinct est en tous cas beaucoup plus importante que l'autre.
§ 853. Le fait d'être prévoyant ou imprévoyant dépend de certains instincts et de certains goûts ; et, à ce point de vue, on ne trouverait pas ce fait dans les choses (a). Mais l'imprévoyance a donné lieu, spécialement aux États-Unis d'Amérique, à une théorie par laquelle on prêche aux gens qu'ils doivent dépenser tout ce qu'ils gagnent ; et par conséquent, si nous examinons cette théorie, nous y trouverons une chose (a) qui sera l'imprévoyance.
§ 854. Un politicien est poussé à préconiser la théorie de la solidarité, par le désir d'obtenir argent, pouvoir, honneurs. Dans l'étude de cette théorie, ce désir, qui est d'ailleurs celui de presque tous les politiciens, n'apparaîtra qu'à la dérobée. Au contraire, les principes (a), propres à persuader autrui, occuperont la première place. Il est manifeste que si le politicien disait : « Croyez à cette théorie, parce qu'elle tourne à mon profit ». il ferait rire et ne persuaderait personne. Il doit donc se fonder sur certains principes qui puissent être admis par ceux qui l'écoutent.
En nous arrêtant à cette observation, il pourrait sembler que, dans le cas examiné, les (a) se trouveraient, non pas dans les principes au nom desquels la théorie est préconisée, mais bien dans ceux au nom desquels elle est acceptée. Mais en avançant davantage, on voit que cette distinction ne tient pas ; car souvent celui qui veut persuader autrui commence par se persuader lui-même ; bien plus, s'il est mû principalement par son propre intérêt, il finit par croire qu'il est mû par le désir du bien d'autrui. Rare et peu persuasif est l'apôtre incroyant ; au contraire, fréquent et persuasif est l'apôtre croyant ; et plus il est croyant, plus son œuvre est efficace. Par conséquent, les parties (a) de la théorie se trouvent aussi bien chez celui qui l'accepte que chez celui qui la préconise, mais il faut y ajouter l'intérêt, tant de celui-ci que de celui-là.
§ 855. Quand nous analysons une théorie (c), il faut distinguer soigneusement les recherches au point de vue objectif et celles au point de vue subjectif (§ 13). Très souvent, au contraire, on les confond, et ainsi naissent deux erreurs principales. D'abord – nous en avons parlé souvent déjà – on confond la valeur logico-expérimentale d'une théorie avec, sa force de persuasion ou avec son utilité sociale. Puis, erreur spécialement moderne, on substitue à l'étude objective d’une théorie, l'étude subjective, recherchant comment et pourquoi son auteur l'a construite. Cette seconde étude est certainement importante, mais doit s'ajouter et non se substituer à la première. Savoir si un théorème d'Euclide est vrai ou faux, et savoir comment Euclide l'a découvert, sont des investigations différentes et telles que l'une n'exclut pas l'autre. Si les Principia de Newton étaient d'un auteur inconnu, leur valeur en diminuerait-elle pour cela ?
C'est ainsi que l'on confond deux des aspects indiqués au § 541, et sous lesquels on peut envisager la théorie d'un auteur ; savoir : 1° ce que pensait l'auteur, son état psychique, et comment il a été déterminé ; 2° ce que l'auteur a voulu dire, en un passage déterminé. Le premier aspect, qui est personnel, subjectif pour l'auteur, vient à se confondre avec le second, qui est impersonnel, objectif. À cela contribue souvent la considération de l'autorité de l'auteur ; car, poussé par ce sentiment, on admet a priori que ce qu'il pense et croit, doit nécessairement être « vrai » ; aussi vaut-il tout autant rechercher ses idées, que d'examiner si ce qu'il a voulu dire est « vrai », ou est d'accord avec l'expérience, dans le cas des sciences logico-expérimentales.
§ 856. On a longtemps été porté à envisager les théories exclusivement sous le 2e aspect ; c'est-à-dire sous l'aspect de leur valeur intrinsèque, qui était parfois la valeur logico-expérimentale, et beaucoup plus souvent la valeur par rapport aux sentiments de celui qui les examinait, ou par rapport à certains principes métaphysiques ou théologiques. Maintenant, on incline à les considérer exclusivement sous l'aspect extrinsèque de la manière dont elles ont été produites et acceptées, c'est-à-dire sous les aspects 1°, et 3 du § 541. Si ces deux façons d'envisager les théories sont exclusives elles sont également incomplètes et, par ce fait, erronées.
§ 857. La seconde erreur notée au § 855 est l'opposé de la première. Celle-ci ne tenait compte que de la valeur intrinsèque de la théorie (2e aspect du § 541); celle-là ne tient compte que de sa valeur extrinsèque (1er et 3e aspect) ; elle apparaît souvent dans l'abus que l'on fait maintenant de la méthode historique, spécialement dans les sciences économiques et sociales. À l'origine, les auteurs qui créèrent l'économie politique eurent le tort de donner à leur science une valeur absolue, cherchant à la soustraire aux contingences de lieu et de temps. Heureuse fut donc la réaction qui s'efforça, au contraire, d'en tenir compte ; et, à ce point de vue, la méthode historique fit progresser la science. Tout aussi importants furent les progrès scientifiques qui, aux principes dogmatiques dont on voulait tirer d'une manière absolue la forme des institutions sociales, substituèrent l'étude de l'histoire de ces institutions ; étude par laquelle on arrivait à connaître leur développement et leurs rapports avec les autres faits sociaux. Nous nous plaçons entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale, quand, au lieu d'étudier, par exemple, ce que doit être la famille, nous étudions ce qu'elle a été réellement. Mais il faut ajouter, et non substituer, cette étude à celle qui recherche les rapports où se trouve la constitution de la famille avec les autres faits sociaux. Il est utile de connaître comment ont été produites, historiquement, les théories de la rente ; mais il est utile aussi de savoir dans quel rapport ces théories se trouvent avec les faits, quelle est leur valeur logico-expérimentale.
§ 858. D'autre part, cette étude est beaucoup plus difficile que celle qui consiste à écrire une histoire. Nous voyons en effet nombre de gens, absolument incapables non seulement de créer, mais aussi de comprendre une théorie logico-expérimentale de l'économie politique, qui écrivent présomptueusement une histoire de l'économie politique.
§ 859. En littérature, l'étude historique dégénère souvent en un récit anecdotique, facile à faire, agréable à entendre. Trouver comment mangeait, buvait, dormait et se vêtait un auteur, est beaucoup plus facile, au point de vue intellectuel et scientifique, qu'examiner dans quels rapports ses théories se trouvent avec la réalité expérimentale ; et si l'on peut parler de ses amours, on fait un livre d'une lecture délectable (§ 541).
§ 860. L'étude de la partie (b) d'une théorie est justement celle de la partie subjective ; mais celle-ci peut encore être divisée en deux ; c'est-à-dire qu'il faut distinguer les causes générales des causes spéciales pour lesquelles une théorie est produite ou acquiert du crédit. Les causes générales sont celles qui agissent durant un temps qui n'est pas trop court, et qui s'appliquent à un nombre important d’individus. Les causes spéciales sont celles qui agissent essentiellement d'une manière contingente. Une théorie est-elle produite parce qu'elle convient à une classe sociale ? elle a une cause générale ; est-elle produite parce que son auteur a été payé, ou parce qu'il manifeste ainsi sa colère contre un rival ? elle a une cause spéciale.
Dans l'étude que nous ferons des théories (b), nous nous occuperons seulement des causes générales. L'étude des autres est secondaire et peut venir plus tard.
§ 861. Les choses qui ont une influence notable sur l'organisation sociale donnent lieu à des théories. Nous les trouverons, par conséquent, lorsque nous chercherons les (a). À ces choses, comme nous le disions tantôt, il faut ajouter les appétits et les intérêts ; et nous aurons ainsi l'ensemble de choses qui agissent sensiblement pour déterminer l'organisation sociale(§ 851), en prenant garde pourtant que l'organisation elle-même réagit sur ces choses, et que nous avons, par conséquent, un rapport non pas de cause à effet, mais de mutuelle dépendance. Si nous supposons, comme cela semble probable, que les animaux n'ont pas de théories, il ne pourra exister pour eux aucune partie (a), peut-être pas d'intérêts non plus, et il ne resterait que les instincts. Les peuples sauvages, même s'ils sont très proches des animaux, ont certaines théories ; et par conséquent, pour eux existe une partie (a) ; de plus, il y a certainement des instincts et des intérêts. Les peuples civilisés ont des théories pour un très grand nombre de leurs instincts et de leurs intérêts ; aussi la partie (a) se retrouve-t-elle dans presque toute leur vie sociale.
§ 862. Nous rechercherons justement cette partie (a), dans le présent chapitre et dans les suivants.
En nombre de cas déjà, (§ 186 et sv., 514-3] , 740) nous avons séparé les parties (a) et (b), mélangées et confondues en un même phénomène (c). De cette façon, nous nous sommes mis sur la voie de trouver une règle qui nous guide dans ces analyses. Voyons encore mieux cela par des exemples, et puis nous procéderons systématiquement à cette étude.
§ 863. Exemple I. Les chrétiens font usage du baptême. Si l'on ne connaissait que cette action, on ne saurait si l'on peut la décomposer en d'autres, ni comment (§ 186, 740). En outre, nous avons une explication : on nous dit qu'on procède à cette opération, pour effacer le péché originel. Cela ne suffit pas encore ; et si nous ne connaissions pas d'autres faits semblables, il nous serait difficile de décomposer en ses parties le phénomène complexe. Mais nous connaissons d'autres faits semblables. Les païens aussi avaient l'eau lustrale, qui servait aux purifications. Si l'on s'arrêtait là, on mettrait en rapport l'usage de l'eau et le fait de la purification. D'autres faits semblables nous montrent au contraire que l'usage de l'eau n'est pas encore la partie constante des phénomènes. Pour les purifications, on peut se servir de sang et d'autres matières. Cela ne suffit pas : il y a diverses pratiques qui atteignent le même but. Pour les transgressions aux tabous, (§ 1252) on procède à certaines opérations qui enlèvent à l'homme la tache contractée en certaines circonstances. Ainsi s'élargit toujours le cercle de faits semblables, tandis que dans une si grande variété de moyens et d'explications de leur efficacité, le sentiment demeure constant que, grâce à certaines pratiques, on rétablit l'intégrité de l'individu, altérée par certaines raisons, réelles ou imaginaires. Le phénomène concret est donc composé de cette partie constante (a) et d'une partie variable (b), qui comprend les moyens employés pour rétablir l'intégrité, et les raisonnements par lesquels on veut expliquer l'efficacité de ces moyens. L'homme a le sentiment confus que l'eau peut laver les taches morales, comme elle lave les taches matérielles ; mais d'habitude, il ne justifie pas de cette manière, jugée trop simple, l'emploi de l'eau pour rétablir l'intégrité : il va à la recherche d'explications plus complexes, de raisonnements plus étendus, et découvre facilement ce qu'il désire.
§ 864. Le noyau (a) trouvé tout à l'heure se compose de diverses parties. Nous y distinguons d'abord un instinct des combinaisons : on veut « faire quelque chose », combiner certaines choses et certains actes. Puis il y a la persistance des liaisons imaginées de cette manière. On pourrait essayer tous les jours une nouvelle combinaison ; mais il y en a une, même fantaisiste, qui domine et qui parfois devient exclusive ; elle persiste dans le temps. Enfin, il y a un instinct qui pousse à croire à l'efficacité de certaines combinaisons pour atteindre un but. On pourra dire que les combinaisons réellement efficaces, comme serait le fait d'allumer le feu avec le silex, poussent l'homme à croire aussi à l'efficacité de combinaisons imaginaires. Mais nous n'avons pas à nous occuper, pour le moment, de cette explication ou d'autres semblables. Il nous suffit d'avoir reconnu l'existence du fait, et nous nous arrêtons là, pour le moment. Dans d'autres études, nous pourrons tâcher de pousser plus avant, et d'expliquer les faits auxquels nous nous arrêtons maintenant par d'autres faits ; ceux-ci par d'autres encore et ainsi de suite.
§ 865. Exemple II. Au chapitre II (§ 186 et sv.), nous avons vu de nombreux cas dans lesquels les hommes croient pouvoir susciter ou éloigner les tempêtes. Si nous ne connaissions qu'un seul de ces cas, nous n'en pourrions rien ou presque rien inférer. Mais nous en connaissons beaucoup, et nous y voyons un noyau constant. Négligeant pour un moment la partie de ce noyau, qui, comme précédemment, se rapporte à la persistance de certaines combinaisons et à la foi en leur efficacité, nous trouvons d'abord une certaine partie constante (a), correspondant au sentiment de l'existence d'une divinité dont on peut provoquer l'intervention par des moyens variables (b), pour qu'elle agisse sur les tempêtes. Ensuite voici un autre genre, dans lequel on croit pouvoir obtenir l'effet par certaines pratiques qui, en elles-mêmes, ne signifient rien ; par exemple, en dépeçant un coq blanc et en en portant les deux moitiés autour du champ que l'on veut préserver du vent chaud (§ 189). Ainsi s'élargit le cercle et apparaît une autre partie constante (a), correspondant à un instinct de combinaisons par lequel, au hasard, on unit des choses et des actes, en vue d'obtenir un effet.
§ 866. Exemple III. Les catholiques estiment que le vendredi est un jour de mauvais augure, à cause, dit-on, de la passion du Christ. Si nous ne connaissions que ce cas, il serait difficile de savoir lequel des deux faits, c'est-à-dire le mauvais augure ou la passion du Christ, est le principal et lequel est l'accessoire. Mais nous avons beaucoup d'autres faits semblables. Les Romains avaient les dies atri ou vitiosi, qui étaient de mauvais augure : par exemple, le 18 juillet, jour où ils avaient perdu la bataille de l'Allia. Voilà un genre de (a) : le sentiment qui fait considérer comme de mauvais augure le jour qui rappelle un événement funeste. Mais il y a d'autres faits. Les Romains et les Grecs avaient des jours de mauvais ou de bon augure, sans qu'il y ait pour cela une raison spéciale, de la nature des précédentes. Il y a donc une classe de (a), qui comprend le genre précédent de (a), et qui correspond à des sentiments de combinaisons de jours – et d'autres choses aussi – à un bon ou à un mauvais augure (§ 908 et sv.).
§ 867. Ces exemples nous mettent à même de trouver comment on peut décomposer un phénomène complexe (c), en ses éléments (a) et (b). Dans le présent chapitre, nous ferons un très grand nombre d'autres décompositions semblables.
§ 868. Avant de pousser plus avant, il sera bon, peut-être, de donner des noms aux choses (a), (b) et (c) ; car les désigner par des lettres de l'αbet embarrasse quelque peu l'exposé et le rend moins clair. Pour ce motif (§ 119), à l'exclusion de tout autre, nous appellerons résidus les choses (a), dérivations les choses (b), dérivées les choses (c). Mais il faut avoir toujours présent à l'esprit qu'il n'y a rien, absolument rien, à inférer du sens propre de ces noms, de leurs étymologies, et que leur signification est exclusivement celle des choses (a), (b) et (c).
§ 869. Comme nous l'avons déjà vu, les résidus (a) constituent un ensemble de faits nombreux, qu'il faut classer suivant les analogies qu'on y trouve; et nous aurons ainsi des classes, des genres, des espèces. Il en est de même pour les dérivations (b).
§ 870. Les résidus correspondent à certains instincts des hommes ; c'est pourquoi la précision, la délimitation rigoureuse, leur font habituellement défaut ; et même ce caractère pourrait presque toujours servir à les distinguer des faits ou des principes scientifiques (A), qui ont avec eux quelque ressemblance. Souvent les (A) sont issus des (a), moyennant une opération qui a précisé les (a). Ainsi, le terme chaud est indéterminé ; et, en l'employant, on a pu dire que l'eau des puits est chaude en hiver et froide en été. Mais le terme physique chaud, correspondant à des degrés de chaleur mesurés avec un thermomètre, est déterminé ; et l'on a pu voir que l'eau des puits n'est pas, en ce sens, plus chaude en hiver qu'en été ; car un thermomètre, plongé dans cette eau, marque à peu près les mêmes degrés, ou indique une température plus basse l'hiver que l'été.
§ 871. Voyez, par exemple, dans Macrobe [FN: § 871-1], combien le terme chaud a de sens différents, qui ont pour résidu les sentiments que ce terme fait naître dans l'esprit de certaines personnes (§ 506). (VI) Les médecins disent que le vin est chaud ; mais il semble à un interlocuteur des Saturnales que la nature du vin est plutôt froide que chaude. (VII) Il y a un grand froid, dans le corps de la femme, dit quelqu'un ; mais quelqu'un d'autre réplique que, par nature, le corps de la femme est plus chaud que celui de l'homme. Et il renferme une telle chaleur que, lorsqu'il était d'usage de brûler les morts, avec dix cadavres d'hommes, on en mettait un de femme, grâce auquel on pouvait facilement brûler les premiers. La chaleur est le principe de la génération. Les femmes ont en elles une si grande chaleur que, lorsqu'il fait froid, elles peuvent garder des vêtements légers. Tout cela est contesté par un autre, excepté pour la génération, dont la cause paraît être vraiment la chaleur. (VIII) Pourquoi, en Égypte, qui est un pays très chaud, le vin a-t-il une vertu presque froide, au lieu d'être chaude ? Parce que, quand l'air est chaud, il repousse le froid dans la terre ; et, l'air étant toujours chaud en Égypte, le froid, en pénétrant dans la terre, agit sur les racines de la vigne et donne au vin sa qualité. Puis on explique aussi pourquoi un éventail donne de la fraîcheur [FN: § 871-2].
§ 872. C'est là le type des raisonnements métaphysiques anciens et modernes. Leurs prémisses renferment des termes dépourvus de toute précision, dont on veut tirer des conclusions certaines, avec une logique rigoureuse, comme si c'étaient des axiomes mathématiques. En somme, ils ont pour but d'étudier, non pas les choses, mais les concepts que certaines personnes ont de ces choses. Il est des gens qui, par une concession extrême, acceptent d'exclure ces raisonnements des sciences physiques, et veulent les conserver dans les sciences sociales. Mais aucun motif ne peut justifier cette différence, tant que nous restons dans le domaine expérimental.
§ 873. Nous avons là un nouvel exemple, montrant comment les termes qui manquent de précision peuvent facilement être employés pour démontrer aussi bien le pour que le contre [FN: § 873-1]. Les femmes, dit l'un des interlocuteurs, peuvent se vêtir plus légèrement que les hommes, parce que la chaleur qu'elles ont dans le corps résiste au froid. Non, réplique un contradicteur, la raison en est le froid naturel que les femmes ont dans le corps ; car des choses semblables se conviennent réciproquement (VII).
§ 874. En général, c'est dans l'indétermination des résidus (a) qu'il faut chercher la raison pour laquelle ils ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureux, comme peuvent l'être et le sont en effet, dans les sciences, les propositions (A).
§ 875. Il faut bien prendre garde de ne pas confondre les résidus (a) avec les sentiments, ni avec les instincts auxquels ils correspondent (§ 1689 et sv.). Les résidus (a) sont la manifestation de ces sentiments et de ces instincts, comme l'élévation du mercure, dans le tube d'un thermomètre, est la manifestation d'un accroissement de température. C'est seulement par une ellipse, pour abréger le discours, que nous disons, par exemple, que les résidus, outre les appétits, les intérêts, etc. (§ 851 et sv.), jouent un rôle principal dans la détermination de l'équilibre social. Ainsi disons-nous que l'eau bout à 100°. Les propositions complètes seraient : « Les sentiments ou instincts qui correspondent aux résidus, outre ceux qui correspondent aux appétits, aux intérêts, etc., jouent un rôle principal dans la détermination de l'équilibre social. L'eau bout quand l'état calorifique atteint une température indiquée par 100° du thermomètre centigrade ».
§ 876. Ce n'est que dans un but d'étude analytique que nous séparons divers résidus (a1), (a2), (a3)... ; tandis que chez l'individu existent les sentiments qui correspondent aux groupes (a1) (a2) (a3), (a1) (a3) (a4) ; (a3) (a5) ; etc. Ceux-ci sont composés, relativement aux résidus (a1), (a2), qui sont plus simples. On pourrait continuer et décomposer aussi (a1), (a2) , en éléments plus simples encore ; mais il faut savoir s'arrêter à temps, parce que les propositions trop générales finissent par ne plus rien signifier du tout. Ainsi, les conditions de la vie sur notre globe sont diverses, et peuvent être réduites, d'une façon générale, à la lumière solaire, à l'existence de l'atmosphère, etc. ; mais il faut au biologiste des conditions beaucoup moins générales, dont il puisse tirer une plus grande quantité de lois de la vie.
§ 877. Il arrive parfois qu'une dérivée (c), à laquelle on est parvenu en partant d'un résidu (a), moyennant une dérivation (b), devienne à son tour résidu d'autres phénomènes, et soit sujette à des dérivations. Il se peut, par exemple, que le mauvais augure, tiré du fait d'être treize à table, soit une dérivée issue du sentiment d'horreur pour la trahison de Judas, suivie de sa mort. Mais dès lors cette dérivée est devenue, à son tour, un résidu, et, sans penser le moins du monde à Judas, les gens éprouvent toutefois un malaise à être assis à une table de treize convives.
§ 878. Dans l'étude que nous allons entreprendre, le lecteur voudra bien avoir toujours présentes à l'esprit les observations données tout à l'heure. S'il les oubliait, il comprendrait à rebours ce que nous allons exposer (§ 88).
§ 879. Arrivé à ce point, le lecteur se sera peut-être déjà aperçu que les recherches auxquelles nous nous livrons ont une analogie avec d'autres qui sont habituelles en philologie ; c'est-à-dire avec celles qui ont pour but de rechercher les racines et les dérivations dont les mots d'une langue sont issus. Cette analogie n'est pas artificielle. Elle provient du fait que, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de produits de l'activité de l'esprit humain, qui ont un processus commun. Prenons, par exemple, la langue grecque. On peut distribuer les mots de cette langue en familles ayant chacune sa racine. Ainsi, les mots qui signifient ancre ![]() hameçon
hameçon ![]() objet recourbé
objet recourbé ![]() bras recourbé
bras recourbé![]() courbure du bras
courbure du bras ![]() coude
coude ![]() etc., recourbé
etc., recourbé ![]() , en forme de crochet
, en forme de crochet ![]() pêcher à l'hameçon
pêcher à l'hameçon ![]() (
(![]() recourber
recourber![]() etc., etc., ont tous la même racine (résidu), c'est-à-dire
etc., etc., ont tous la même racine (résidu), c'est-à-dire ![]() qui correspond à l'idée assez indéterminée, de quelque chose qui est recourbé, replié, crochu, et qui manifeste cette idée. Par des dérivations qui ont leurs règles, de ces racines on tire les mots, comme des résidus (a) on obtient les dérivées (c). Nous avons des unions de racines, comme nous avons des unions de résidus. Ainsi l'adjectif « qui mord à l'hameçon »
qui correspond à l'idée assez indéterminée, de quelque chose qui est recourbé, replié, crochu, et qui manifeste cette idée. Par des dérivations qui ont leurs règles, de ces racines on tire les mots, comme des résidus (a) on obtient les dérivées (c). Nous avons des unions de racines, comme nous avons des unions de résidus. Ainsi l'adjectif « qui mord à l'hameçon » ![]() a pour racines a
a pour racines a ![]() et
et![]() correspondant, la première à quelque chose de recourbé, sans précision, la seconde à manger. Il y a des dérivations d'un grand usage en grec ; par exemple le suffixe
correspondant, la première à quelque chose de recourbé, sans précision, la seconde à manger. Il y a des dérivations d'un grand usage en grec ; par exemple le suffixe ![]() , qui, uni aux racines, donne un grand nombre de mots signifiant l'effet de l'action indiquée par les racines. Il y a de même, dans les faits sociaux, des dérivations très usuelles, par exemple la volonté de la divinité, qui sert à justifier une infinité de prescriptions. C'est ainsi que cette volonté, unie au résidu de l'amour pour ses parents, donne le précepte : « Honore ton père et ta mère, car c'est la volonté de Dieu ».
, qui, uni aux racines, donne un grand nombre de mots signifiant l'effet de l'action indiquée par les racines. Il y a de même, dans les faits sociaux, des dérivations très usuelles, par exemple la volonté de la divinité, qui sert à justifier une infinité de prescriptions. C'est ainsi que cette volonté, unie au résidu de l'amour pour ses parents, donne le précepte : « Honore ton père et ta mère, car c'est la volonté de Dieu ».
§ 880. Les résidus peuvent produire, par dérivation, des dérivées (c), qu'on observe effectivement dans la société ; ils peuvent aussi en produire d'autres (γ), qu'on n'observe pas, bien qu'elles se déduisent régulièrement comme les (c).
§ 881. Ce fait a son analogue en philologie, dans l'existence des verbes réguliers et des verbes irréguliers. En réalité, il ne faut pas prendre ces termes à la lettre : un verbe dit irrégulier est de fait aussi régulier qu'un autre. La différence consiste dans les différents modes de dérivations. Un procédé de dérivation, usité pour certaines racines, donne une classe de verbes qu'on trouve effectivement dans le langage ; employé pour d'autres racines, il donne des verbes qu'on ne trouve pas dans la langue. Et vice versa, le procédé de dérivation qui, avec ces dernières racines, donne des verbes qu'on trouve dans le langage, donne, avec les premières, des verbes qu'on n'y trouve pas.
§ 882. Les dérivées qui sont à leur tour résidus ont leur pareil dans le langage. Le mot indiqué tout à l'heure : « qui mord à l'hameçon », ne s'est pas formé directement des racines ![]() , et
, et ![]() , mais bien de
, mais bien de ![]() et de
et de ![]() . Les flexions, les conjugaisons, les formations de comparatifs, de superlatifs, de locatifs, etc., nous font voir des exemples de dérivations obtenues par d'autres dérivations.
. Les flexions, les conjugaisons, les formations de comparatifs, de superlatifs, de locatifs, etc., nous font voir des exemples de dérivations obtenues par d'autres dérivations.
§ 883. Ce n'est pas tout. Il y a encore des analogies d'un autre genre. La philologie moderne sait fort bien que le langage est un organisme qui s'est développé suivant ses propres lois, qui n'a pas été créé artificiellement. Seuls, quelques termes techniques, comme oxygène, mètre, thermomètre, etc., sont le produit de l'activité logique des savants. Ils correspondent aux actions logiques, dans la société, tandis que la formation du plus grand nombre des mots employés par le vulgaire, correspond aux actions non-logiques. Il est temps, désormais, que la sociologie progresse, et tâche d'atteindre le niveau auquel se trouve déjà la philologie.
§ 884. Nous avons indiqué ces analogies, uniquement pour aider le lecteur à se former une idée claire des théories que nous exposons. [Voir Addition A16 par l’auteur] Mais il voudra bien se souvenir qu'on ne peut tirer de ces analogies aucune démonstration, et que celle-ci doit procéder exclusivement de l'étude directe des faits. La méthode qui demande des démonstrations aux analogies est très mauvaise.
§ 885. Les recherches sur l'origine des phénomènes sociaux, recherches qui constituent jusqu'à présent la majeure partie de la sociologie, ont été souvent, sans que leurs auteurs s'en aperçussent, des recherches de résidus. Ces auteurs admettaient, sans trop préciser, que le simple avait dû précéder le composé, que le résidu devait être antérieur à la dérivée (§ 693). Quand Herbert Spencer voit, dans la déification des hommes, l'origine chronologique de la religion, il croit avoir trouvé le résidu des phénomènes religieux, le phénomène simple dont sont dérivés les phénomènes complexes que l'on observe aujourd'hui.
§ 886. Là-dessus, deux observations s'imposent. 1° Il convient de remarquer qu'aucune preuve n'est donnée de la vérité de l'hypothèse, d'après laquelle la connaissance du résidu serait chronologiquement antérieure à celle de la dérivée. Parfois, cela s'est produit ; mais d'autres fois, cela n'a certainement pas eu lieu. De même, en chimie, il y a des composés qui ont été connus après les corps simples dont ils tirent leur origine ; mais beaucoup d'autres ont été connus avant. En sociologie, les règles latentes du droit (§ 802-1) sont un excellent exemple de dérivées connues antérieurement à leurs résidus. La bonne femme athénienne qui, entendant parler Théophraste, le reconnut pour un étranger [FN: § 886-1], connaissait fort bien, par la pratique, la conjugaison d'un certain nombre de verbes grecs, beaucoup mieux que certains savants modernes ; mais elle n'avait pas la plus lointaine idée des règles des dérivations, par lesquelles, des racines, on obtient ces conjugaisons. 2° Même si la connaissance du résidu est antérieure à celle de la dérivée, il convient de suivre une voie directement opposée à celle qu'on a parcourue jusqu'à présent. La recherche chronologique du résidu (a) est difficile, souvent impossible, parce que, pour des temps éloignés de nous, les documents font défaut ; et l'on ne peut se permettre d'y suppléer parla fantaisie et le « bon sens » de l'homme moderne. On peut bien avoir ainsi des théories ingénieuses, mais elles ne correspondent que peu ou pas du tout aux faits. Vouloir découvrir, dans les temps primitifs, le résidu (a) dont sont dérivés des phénomènes (c) que nous pouvons observer dans le présent, c'est vouloir expliquer le connu par l'inconnu (§ 548, 57). Il faut au contraire déduire des faits les mieux connus ceux qui le sont moins : tâcher de découvrir les résidus (a) dans les phénomènes (c) que nous observons à l'époque présente, puis voir si, dans les documents historiques, on trouve des traces de (a). Si, de cette manière, on trouvait que (a) existait alors qu'on ne connaissait pas encore (c), on pourrait conclure que (a) est antérieur à (c), et que l'origine, dans ce cas, se confond avec le résidu. Mais si cette preuve fait défaut, on ne peut accepter la confusion indiquée.
§ 887. C'est pourquoi nous avons essayé, et nous essayerons toujours d'expliquer les faits du passé par d'autres qu'il nous est donné d'observer dans le présent (§ 547), et en tout cas, nous mettrons le plus grand soin à procéder toujours du plus connu au moins connu. Ici, nous ne nous occupons pas des origines ; non que nous méconnaissions l'importance historique de ce problème, mais parce que la connaissance des origines n'est pas ou presque pas utile à la recherche des conditions de l'équilibre social, tandis que la connaissance des instincts et des sentiments qui correspondent aux résidus est d'une grande importance pour cette recherche.
§ 888. Commençons par classer les résidus, puis nous classerons les dérivations. N'oublions pas que, dans les phénomènes sociaux, outre les sentiments manifestés par les résidus, il y a les appétits, les inclinations, etc. (§ 851), et qu'ici nous nous occupons seulement de la partie qui correspond aux résidus. Cette partie renferme souvent un grand nombre, et parfois même un très grand nombre de résidus simples. Il arrive de même que les roches contiennent beaucoup d'éléments simples, qui sont séparés par l'analyse chimique. Il y a des phénomènes concrets dans lesquels un résidu l'emporte sur les autres; par conséquent, ces phénomènes peuvent représenter approximativement ce résidu. La classification que nous faisons ici est objective (§ 855); mais nous devrons parfois ajouter quelque considération subjective.
Ie Classe.
INSTINCT DES COMBINAISONS (§ 889-990).
(1-α) Combinaisons en général (892-909).
(1-β) Combinaisons de choses semblables ou contraires (§ 910-943).
(I-β 1) Ressemblance et opposition en général (§ 913-921).
(I-β 2) Choses rares ; événements exceptionnels (§ 922-928).
(1-β 3) Choses et événements terribles (§ 929-931).
(I-β 4) État heureux uni à des choses bonnes ; état malheureux uni à des choses mauvaises (§ 932-936).
(I-β 5) Choses assimilées produisant des effets de nature semblable ; rarement de nature opposée (§ 937-943).
(I-γ) Pouvoir mystérieux de certaines choses et de certains actes (§ 944-965).
(1-γ 1) Pouvoir mystérieux en général (§ 947-957).
(I-γ 2) Noms unis mystérieusement aux choses (§ 958-965).
(1-δ) Besoin d'unir les résidus (§ 966-971).
(I-ε) Besoin de développements logiques (§ 972-975).
(I-ζ) Foi en l'efficacité des combinaisons (§ 976-990).
IIe Classe.
PERSISTANCE DES AGRÉGATS (991-1088).
(II-α) Persistance des rapports d'un homme avec d'autres hommes et avec des lieux (§ 1015-1051).
(II-α 1) Rapports de famille et de collectivité (§ 1016-1040).
(II-α 2 ) Rapports avec des lieux (§ 1041-1042).
(II-α 3) Rapports de classes sociales (§ 1043-1051).
(II-β) Persistance des rapports entre les vivants et les morts (§ 1052-1055).
(II-γ) Persistance des rapports entre un mort et des choses qu'il possédait durant sa vie (§ 1056-1064).
(II-δ) Persistance d'une abstraction (§ 1065-1067). (II-ε) Persistance des uniformités «§ 1068).
(II-ζ) Sentiments transformés en réalités objectives (§ 1069). (II-êta) Personnifications (§ 1070-1085).
(II-η) Besoin de nouvelles abstractions (§ 1086-1088).
IIIe Classe.
BESOIN DE MANIFESTER SES SENTIMENTS PAR DES ACTES EXTÉRIEURS (§ 1089-1112).
(III-α) Besoin d'agir se manifestant par des combinaisons (§ 1092-1093).
(III-β) Exaltation religieuse (§ 1094-1112).
IVe Classe.
RÉSIDUS EN RAPPORT AVEC LA SOCIABILITÉ (§ 1113-1206).
(IV-α) Sociétés particulières (§ 1114).
(IV-β) Besoin d'uniformité (§ 1115-1132).
(IV-β 1) Uniformité obtenue en agissant sur soi-même (§ 1117-1125).
(IV-β 2) Uniformité imposée aux autres (§ 1126-1129).
(IV-β 3) Néophobie (§ 1130-1132).
(IV-γ) Pitié et cruauté «§ 1133-1144).
(IV-γ 1) Pitié pour soi reportée sur autrui (§ 1138-1141).
(IV-γ 2) Répugnance instinctive pour la souffrance en général (§ 1142-1143).
(IV-γ 3) Répugnance raisonnée pour les souffrances inutiles (§ 1144).
(IV-δ) Tendance à imposer à soi-même un mal, pour le bien d'autrui (§ 1145-1152).
(IV-δ 1) Tendance à exposer sa vie (§ 1148).
(IV-δ 2) Partage de ses biens avec autrui (§ 1149-1152).
(IV-ε) Sentiments de hiérarchie (§ 1153-1162).
(IV-ε 1) Sentiments des supérieurs (§ 1155).
(IV-ε 2) Sentiments des inférieurs (§ 1156-1159).
(IV-ε 3) Besoin de l'approbation de la collectivité (§ 1160-1162).
(IV-ζ) Ascétisme (§ 1163-1206).
Ve Classe.
INTÉGRITÉ DE L'INDIVIDU ET DE SES DÉPENDANCES (§ 1207-1323).
(V-α) Sentiments qui contrastent avec les altérations de l'équilibre social (§ 1208-1219).
(V-β) Sentiments d'égalité chez les inférieurs (§ 1220-1228).
(V-γ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant aux sujets qui ont souffert l'altération (§ 1229-1239).
(V-γ 1) Sujets réels (§ 1240-1295).
(V-γ 2) Sujets imaginaires ou abstraits (§ 1296-1311).
(V-δ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant à ceux qui l'ont altérée (§ 1312).
(V-δ 1) Agent réel d'altération (§ 1313-1319).
(V-δ 2) Agent imaginaire ou abstrait (§ 1320-1323).
VIe Classe.
RÉSIDU SEXUEL (§ 1324-1396)
§ 889. Ie CLASSE. Instinct des combinaisons. Cette classe est constituée par les résidus correspondant à cet instinct, qui est puissant dans l'espèce humaine, et qui a probablement été et demeure une cause importante de la civilisation. Un très grand nombre de phénomènes donnent pour résidu une tendance à combiner certaines choses. L'homme de science, dans son laboratoire, les combine suivant certaines règles, certaines vues, certaines hypothèses, la plupart du temps raisonnables ; mais quelquefois aussi il le fait au hasard. Il accomplit, en grande partie, des actions logiques. L'ignorant fait les combinaisons, guidé par des analogies, la plupart du temps fantaisiste, puériles, absurdes, et souvent aussi au hasard. Ce terme de hasard indique seulement notre ignorance des causes que ces actions peuvent avoir eues. En tout cas, ces actions sont en très grande partie non-logiques. Nous avons un instinct qui pousse aux combinaisons en général, et qui, pour des causes passagères, ignorées, donne le genre (I-α). Souvent on unit des choses semblables et parfois contraires ; c'est ainsi qu'on a le genre (1-β). Si ces ressemblances ou oppositions sont génériques, on a l'espèce (I-β 1). Souvent on unit des choses rares à des événements importants, et l'on a l'espèce (1-β 2); ou bien des choses et des événements terribles, et l'on a l'espèce (1-β 3). En outre, (1-β 4), un état heureux attire à lui des choses bonnes, louables, et vice versa. Un état malheureux attire à lui des choses mauvaises, répugnantes, qui font horreur, ou vice versa. Nous avons un genre (I-γ) de la combinaison mystérieuse de certaines choses et de certains actes. Ce genre se divise en deux espèces : la première (1-γ 1) comprend les opérations mystérieuses en général ; la seconde (1-γ 2) unit mystérieusement les noms aux choses. Suit un genre (1-δ), qui se rapporte au besoin que l'homme éprouve d'unir différents résidus. Enfin, on a deux genres : l'un (I-ε) est donné par le besoin, d'autant plus grand que les peuples sont plus civilisés, de recouvrir d'un vernis logique les actions non-logiques, et de créer des théories même imaginaires, pourvu qu'elles soient logiques. L'autre genre (I-ζ) est donné par la croyance en l'efficacité des combinaisons. En résumé, il y a, pour ce qui concerne la Ie classe : 1° une propension aux combinaisons ; 2° la recherche des combinaisons estimées les meilleures ; 3° la propension à croire à l'efficacité des combinaisons.
§ 890. En outre, il y a une partie passive, dans laquelle l'homme subit les combinaisons, et une partie active, dans laquelle il les interprète et les fait naître. La propension aux combinaisons est un sentiment général, indistinct, qui agit passivement et activement ; il est puissant dans les jeux, qu'on observe chez tous les peuples. La recherche des combinaisons estimées les meilleures est évidemment active. Quant à la propension à croire en l'efficacité des combinaisons, elle présente une partie passive et une partie active. En fait, sous l'aspect passif, on peut croire que A est nécessairement uni à B, et que, par conséquent, si l'on observe A, B doit se produire ; ou bien, sous l'aspect actif, qu'en produisant artificiellement A, on produira par conséquent aussi B (§ 971 et sv.)
§ 891. Dans les phénomènes concrets, des résidus d'autres classes jouent aussi un rôle ; et parmi ceux-ci il faut noter les résidus de la IIe classe, sans lesquels les combinaisons de la première seraient passagères et inconsistantes. On peut comparer de tels phénomènes à un édifice dont l'instinct des combinaisons, la recherche de celles qui sont les meilleures, la foi en leur efficacité fournissent les matériaux. La persistance des agrégats donne de la solidité à l'édifice, constitue le ciment qui l'affermit. Enfin, la foi en l'efficacité des combinaisons intervient pour pousser l'homme à se servir de cet édifice. En de nombreux phénomènes, spécialement chez les peuples civilisés, on trouve un mélange d'actions logiques, de déductions scientifiques et d'actions non-logiques, d'opérations dictées par le sentiment. Ici, nous avons disjoint par analyse des choses qui peuvent se trouver réunies.
§ 892. (1-α) Combinaisons en général. Les causes des combinaisons génériques existent précisément comme celles des combinaisons spéciales (1-β) ou d'autres ; et, si cela était utile, on pourrait séparer différentes espèces dans le genre (α). Des milliers et des milliers d'individus jouent au loto en assignant un numéro à certaines choses qu'ils ont rêvées ou à certains événements sur lesquels ils fixent leur attention [FN: § 892-1]. On comprend pourquoi le numéro 1 a été assigné au soleil. Il y a là un résidu (β-1) : le soleil, étant unique, a bien un rapport de convenance avec le nombre 1. Mais pourquoi la lune a-t-elle le numéro 6, une paire de ciseaux le numéro 7, la chatte blanche le 31, la chatte noire le 36, et ainsi de suite ? On ne viendra pas dire que c'est l'expérience qui a fait croire à cette correspondance. Cela peut être arrivé, en certains cas peu nombreux, mais à parcourir le livre des songes, on comprend qu'on n'a jamais pu faire des expériences assez étendues pour pouvoir donner tous les nombres de ce livre. Il faudrait vraiment avoir la manie des interprétations logiques, pour croire que les paroles privées de sens des opérations magiques aient été choisies par l'expérience ; que Caton, par exemple, ou quelqu'un d'autre pour lui, après avoir expérimenté diverses paroles, s'est arrêté à celles qu'il emploie dans son opération magique pour guérir les luxations (§ 184-1).
§ 893. C'est tout le contraire. On commence par avoir foi en certaines combinaisons et, après seulement, arrivent des gens qui essaient de justifier cette foi par la logique et l'expérience [FN: § 893-1]. Les Grecs croyaient aux songes, bien avant qu'un Artémidore parût pour en démontrer, au moyen de l'expérience, la correspondance avec la réalité.
§ 894 Quand on lit l'Histoire naturelle de Pline, on est frappé du nombre infini de combinaisons qu'on a essayées pour guérir les maladies ; il semble vraiment qu'on ait tenté toutes les combinaisons possibles [FN: § 894-1]. Par exemple, pour l'épilepsie, nous avons d'abord la racine de laserpitium chironium avec la présure de veau marin, à la dose de trois parties de la plante pour une partie de coagulum ; le plantago, la bétoine ou l'agaric dans l'oxymel, et ainsi de suite (XXVI, 70). Il y a en tout, dans ce paragraphe, 12 plantes, outre la présure de veau marin et celle de castor. Puis il y a des remèdes tirés du règne animal ; c'est-à-dire (XXVIII, 63) : les testicules d'ours, ceux de sanglier, l'urine du sanglier, et notez bien qu'elle est plus efficace si on l'a laissée se dessécher dans la vessie de l'animal, les testicules de porc, desséchés et broyés dans le lait de truie, les poumons de lièvre avec de l'encens et du vin blanc, etc. En tout, 19 combinaisons sont indiquées dans le paragraphe. N'oublions pas le sang de gladiateur (XXVIII, 2). Un autre paragraphe (XXXII, 37) indique 8 combinaisons tirées du règne animal. Un autre (XXX, 27) en donne 29. En additionnant, on a 69 combinaisons, et il y en a eu certainement d'autres que Pline n'a pas indiquées. Pour guérir la jaunisse, Pline nous dit qu'on peut boire du vin dans lequel on a lavé les pattes d'une poule, après les avoir nettoyées dans l'eau ; et comme il ajoute que ces pattes doivent être jaunes (XXX, 9-8), nous sommes dans le cas d'un résidu (β). Mais quand on nous dit (XXX, 30) que, pour la fièvre, il est bon de porter sur soi la plus longue dent d'un chien noir, nous ne réussissons à trouver aucun motif, même fantaisiste, de cette prescription. On pourrait en citer d'autres semblables, par centaines et par milliers, sur toute la surface du globe. Elles persistèrent dans nos pays jusqu'à une époque récente. Le cardinal de Richelieu fut traité au crotin de cheval détrempé dans du vin blanc. On guérissait la fièvre en portant au cou une araignée vivante, enfermée dans une coquille de noix [FN: § 894-2]. Les vipères et les crapauds jouaient
un rôle considérable dans la pharmacopée. Tout cela n'est qu'absurdité ; mais si ces absurdités n'avaient pas existé, la science expérimentale ne serait pas née non plus [FN: § 894-3].
§ 895. P. Du Chaillu raconte un fait qui est caractéristique [FN: § 895-1]. Après qu'il eut tué un léopard, les indigènes demandèrent l'extrémité de la queue, parce que c'était une amulette érotique. Ils voulaient aussi la cervelle, car c'était une amulette pour avoir du courage et être heureux à la chasse. Enfin ils le prièrent de détruire le fiel, parce que c'était un poison. Les deux premières combinaisons sont certainement inefficaces ; la première est du genre (I-α) ; la seconde peut être du sous-genre (1-β 1), car le léopard est bon chasseur ; la troisième combinaison peut être efficace, à cause des ptomaïnes qui tirent leur origine de la putréfaction.
§ 896. Il peut sembler ridicule de prêter attention à une histoire de queue de léopard, quand on veut rechercher la forme des grands événements sociaux. Mais qui raisonnerait de cette manière devrait s'abstenir de s'occuper des crachats des phtisiques, pour découvrir la maladie, ou de s'occuper des rats, pour édicter des mesures de précaution contre la peste. C'est ainsi qu'autrefois, la philologie dédaignait de s'occuper des dialectes, et ne s'attachait qu'à la langue des « bons auteurs ». Mais ce temps est aujourd'hui passé pour la philologie, et doit aussi passer pour la sociologie (§ 80). L'instinct des combinaisons est parmi les plus grandes forces sociales qui déterminent l'équilibre ; et si quelquefois il se manifeste par des phénomènes ridicules et qui tiennent de l'absurde, cela n'enlève rien à son importance.
§ 897. Les savants qui recherchent l'origine des choses se sont escrimés pour trouver comment on avait pu domestiquer les animaux, et ont rencontré de très grosses difficultés, surtout quand ils étaient poussés par le désir de considérer toutes les actions comme logiques. Nous n'examinerons pas ici toutes les hypothèses qu'on a faites à ce propos ; nous ne parlerons que d'une seule : celle de S. Reinach, parce qu'elle donne lieu à des observations qui s'appliquent au sujet que nous traitons ici.
§ 898. S. Reinach commence par exclure le cas de simples combinaisons [FN: § 898-1]. « (p. 88) Là où existent des animaux capables de devenir domestiques, l'homme n'en sait rien ; c'est l'expérience, une longue expérience qui seule peut l'édifier à cet égard. Mais n'ayant pas l'idée de la domestication, comment et pourquoi tenterait-il cette expérience ? Le hasard peut faire découvrir à l'homme primitif une paillette d'or, un minerai de cuivre ou de fer, mais il ne peut pas lui faire découvrir un animal domestique ; puisqu'il ne saurait y avoir d'animaux domestiques que par l'effet de l'éducation qu'ils reçoivent de l'homme ».
§ 899. Ce raisonnement serait excellent, si toutes les actions de l'homme étaient logiques ; d'où, à part le fait indiqué par Reinach, où le pur hasard fait tomber sous les yeux précisément la chose qu'il peut être utile et profitable d'accomplir, il résulte qu'il n'y aurait pas d'autre voie pour les découvertes, que de savoir d'abord ce qu'on veut trouver, puis de chercher les meilleurs moyens de l'obtenir. Telle est, en effet, la voie suivie pour arriver aux découvertes faites scientifiquement, grâce au raisonnement. Par exemple, on cherche une machine motrice qui soit légère et produise beaucoup de travail, et l'on trouve la machine des automobiles. Mais le plus grand nombre des découvertes, surtout dans le passé, n'ont pas été faites de cette façon. Il y a une autre voie pour y arriver : c'est justement l'instinct des combinaisons, qui pousse l'homme à mettre ensemble des choses et des opérations, sans avoir un plan préétabli, sans savoir précisément où il veut en venir, comme une personne qui parcourt un bois, pour le seul plaisir de se promener. Et même quand ce plan existe, il n'a souvent rien de commun avec le résultat qu'on obtient. Le cas de celui qui cherchait une chose et en a trouvé une autre est très fréquent. L'exemple suffira, des alchimistes qui cherchaient le moyen de faire de l'or et qui trouvèrent un grand nombre de composés chimiques. Voilà un individu auquel vient à l'esprit de laisser putréfier de l'urine d'homme. Il la mélange avec du sable fin et distille le tout. La conséquence de ces opérations étranges et compliquées est la découverte du phosphore. En beaucoup d'autres cas semblables, les combinaisons n'ont rien donné d'utile ; on marche à l'aveuglette : parfois on trouve, le plus souvent on ne trouve pas.
§ 900. Notons que, dans le cas des animaux domestiques, les hommes peuvent avoir eu quelque idée du résultat de certaines opérations. Il arrive souvent, aujourd'hui, que les enfants recueillent un petit moineau tombé du nid, et qu'ils l'élèvent ; pour peu qu'il fût utile, ils en feraient un animal domestique. Les enfants n'ont pas du tout ce but : ils veulent seulement s'amuser, donnent libre cours à l'instinct des combinaisons. Ainsi qu'ils le font quand ils se livrent à leurs jeux, ils combinent de la manière la plus étrange les objets dont ils disposent. Il arrive souvent aussi, à la campagne, qu'on élève un levraut trouvé dans les champs ; mais il ne devient jamais domestique ; et en l'élevant, on n'a pas d'autre but que de trouver du plaisir à la chose. Pourquoi n'aurait-on pas pu faire cela jadis, avec le lapin, et ne serait-ce pas la manière dont cet animal s'est domestiqué ?
§ 901. Il y a mieux. Voici un fait raconté par un voyageur, où l'on voit à l'œuvre le simple instinct des combinaisons, pour domestiquer des animaux [FN: § 901-1]. « (p. 287) Sur le territoire appartenant à Hinza, un Cafre, dont les richesses excitaient l'envie, fut accusé d'élever un loup qu'il retenait dans la journée, et qu'il lâchait dans la nuit pour détruire les troupeaux. On s'empara de lui et de tout ce qu'il possédait, ses bestiaux furent partagés, moitié à Hinza, moitié à ses conseillers. L'homme fut banni. En s'éloignant, à son tour, il s'empara du troupeau d'un autre, qu'il conduisit à Voosani, chef des Tambooky. Hinza envoya se plaindre et redemander le troupeau, en informant ce chef du crime de son protégé. Le troupeau fut rendu avec tous les témoignages d'une (p. 288) grande horreur pour le crime. Le missionnaire, parlant à Hinza sur ce sujet, lui demanda pourquoi il avait ruiné cet homme ; à quoi Hinza lui répondit d'un ton ironique et avec un sourire qui laissait voir qu'il savait à quoi s'en tenir : „C'est vrai, mais vous savez qu'élever un loup est une chose étrange “ ».
§ 902. De cette manière, nous voyons ici deux résidus ; soit celui des combinaisons, dans l'homme qui élève le loup, et celui de la néophobie (IV-β 3), chez ceux qui bannissent l'individu. Remarquons que ces deux résidus peuvent exister chez le même homme ; et peut-être celui qui élevait le loup aurait-il eu horreur d'autres nouveautés, comme ceux qui estimaient que la nouveauté du loup était un crime, se sont peut-être adonnés à d'autres combinaisons nouvelles.
§ 903. Suivant S. Reinach, les animaux domestiques sont d'anciens totem. Il part de là, ajoute des hypothèses et des descriptions de faits ignorés, comme s'il les avait vus. C'est un procédé analogue à celui de H. Spencer et de beaucoup d'autres sociologues. Un auteur ingénieux, intelligent, cultivé, fait une hypothèse. Il en raisonne selon sa logique, sa culture, ses sentiments, et puis s'imagine avoir reconstitué le passé d'hommes arriérés, peu intelligents, incultes et, de plus, vivant en de tout autres conditions que celles où vit le savant, créateur de l'hypothèse et de ses conséquences.
§ 904. « (p. 93) Soient – dit Reinach [FN: § 904-1] – des chasseurs sauvages vivant dans l'ancienne France, pays où existaient à l'état indigène des taureaux, des chevaux, des chèvres, des ours et des loups, pour ne point parler d'autres animaux. Ces chasseurs sont divisés en clans ou petites tribus dont chacune croit avoir pour ancêtre un animal différent. Le clan du loup croit descendre du loup, avoir fait un traité d'alliance avec les loups et, sauf dans le cas de légitime défense, ne pas pouvoir tuer de loups... Chacun de ces clans s'abstiendra de chasser et de tuer telle ou telle espèce d'animaux, mais il ne se contentera pas de cela, Puisque ces animaux sont les protecteurs du clan, qu'ils le guident dans ses pérégrinations, l'avertissent par leur inquiétude, par leurs cris, des dangers qui le menacent, il faut qu'il y ait toujours au milieu du clan, comme des sentinelles, deux ou plusieurs de ces animaux ». Les faits ne sont pas entièrement exacts. Il est de nombreux clans totémiques qui n'ont pas les sentinelles que l'auteur suppose exister. Passons : il suffit que d'autres en aient eu. Mais pourquoi justement « deux ou plusieurs individus » ? Un seul ne suffirait-il pas ? Il serait bien suffisant pour la garde, mais pas pour la reproduction, que notre auteur a en vue. « (p. 93) Ces animaux, pris tout jeunes, s'habitueront à l'homme, s'apprivoiseront; leurs petits, nés au contact même des hommes du clan, deviendront leurs amis ». Voilà pourquoi il devait y avoir au moins deux animaux totem. Mais cela ne suffit pas : il faut encore qu'ils soient mâle et femelle. Si un clan a pour totem le coq, qui, par son chant, l'avertit des dangers, il faut aussi lui procurer une ou plusieurs poules. Mais quand on est dans le royaume des hypothèses, tout peut facilement s'expliquer. Nous pouvons dire que ces hommes, adorant le coq, cherchent, dans une aimable intention, à lui procurer le plaisir de l'accouplement.
§ 905. La découverte des plantes qui sont un remède spécifique de certaines maladies, est tout aussi difficile à expliquer que la domestication des animaux. Par exemple, comment le simple hasard peut-il avoir fait connaître aux Péruviens que l'écorce du quinquina est un spécifique de la fièvre ? Dirons-nous peut-être que cette plante était le totem d'un clan qui, par vénération pour le totem, a voulu en employer l'écorce en cas de maladie ? Soit ; mais cette explication s'appliquera aussi à d'autres remèdes semblables, et nous aurons ainsi autant de totem qu'on a essayé de remèdes pour les maladies ; et celles-ci étant en nombre infini, nous devrons admettre, contrairement aux faits, ce nombre infini de totem.
§ 906. Il n'y a peut-être pas de plante qui n'ait passé pour guérir non seulement une, mais plusieurs maladies. Il faut lire, dans Pline, combien le raifort en guérit ! On voit ainsi à quel point est erronée l'idée de ceux qui croient que ces combinaisons sont semblables aux expériences qu'on fait dans nos laboratoires. C'est-à-dire qu'on aurait essayé une plante contre diverses maladies, et l'on en aurait conservé l'emploi seulement pour celles contre lesquelles il aurait été reconnu efficace. Au contraire, les recettes données par Pline avaient été conservées, bien qu'inefficaces, et beaucoup ont survécu jusqu'à nos jours. En réalité, c'est l'instinct des combinaisons qui l'emporte et qui se manifeste, même aujourd'hui, quand, en cas de maladie, on dit qu' « il faut faire quelque chose », et qu'on donne des remèdes, au petit bonheur.
§ 907. Il se pourrait aussi qu'au temps où l'on domestiqua les animaux, il se soit présenté des cas comme ceux que suppose Reinach ; c'est même probable ; et le fait qu'un animal était totem peut avoir été l'un des très nombreux motifs qui poussèrent aux combinaisons dont résulta la domestication des animaux. L'erreur de S. Reinach consiste principalement à prendre pour unique un motif qui peut avoir existé avec d'autres. Nous ne savons rien de ce temps et ne pouvons, par conséquent, nier une chose qui, en elle-même, est possible ; mais nous ne pouvons pas non plus l'affirmer ; et, parce qu'une chose est possible sous certaines conditions, affirmer qu'elle a dû se trouver dans ces conditions-là, c'est faire un raisonnement erroné. On peut aller encore plus loin. Si nous aussi ne voyons maintenant qu'une seule circonstance dans laquelle la chose soit possible, ce pourrait être une présomption qu'elle a effectivement eu lieu ainsi ; mais il serait encore possible qu'elle se fût produite dans d'autres circonstances que nous ignorons à l'heure qu'il est.
§ 908. Dans l'instinct qui pousse à considérer certains jours comme de bon ou de mauvais augure, il peut y avoir de nombreux résidus. Parfois il y a celui de simple combinaison (1-α). Par exemple, il est difficile d'en trouver d'autres en certaines correspondances établies par Hésiode. Parfois il peut s'y trouver un résidu du genre (I-β). Mais dans ce cas encore, on peut, à la longue, comme nous l'avons déjà vu (§ 831), revenir au genre (I-α). De cette façon, ainsi que l'observe Aulu-Gelle [FN: § 908-1], le vulgaire romain avait fini par confondre les religiosi dies, qui rappelaient, à l'origine, un événement funeste, avec les simples dies nefasti, pendant lesquels il était interdit au préteur de juger et de convoquer les comices. Outre les jours de fêtes publiques, il y en avait d'autres d'ordre privé. Certaines familles en avaient de spéciaux. Les particuliers célébraient alors, comme aujourd'hui encore, le jour de leur naissance, et avaient aussi d'autres fêtes pour différents motifs [FN: § 908-2]. En Grèce, nous trouvons de même les jours où l'on estimait funeste d'agir, et Lucien, dans une diatribe contre un certain Timarque, dit que les Athéniens appelaient ![]() les jours funestes, abominables, défavorables, de mauvais augure, dans lesquels « les magistrats ne siègent pas, aucune cause n'est introduite devant les juges, on n'accomplit aucune cérémonie religieuse et l'on ne fait rien de bon augure... On fait ainsi pour diverses raisons : ou à cause de grandes batailles perdues, pour lesquelles on décréta que les jours où ces faits avaient eu lieu seraient fériés et impropres à toute action légale, ou même pour Zeus,... » [FN: § 908-3]. Les points suspensifs sont de Lucien, qui dédaigne de rapporter des faits si connus.
les jours funestes, abominables, défavorables, de mauvais augure, dans lesquels « les magistrats ne siègent pas, aucune cause n'est introduite devant les juges, on n'accomplit aucune cérémonie religieuse et l'on ne fait rien de bon augure... On fait ainsi pour diverses raisons : ou à cause de grandes batailles perdues, pour lesquelles on décréta que les jours où ces faits avaient eu lieu seraient fériés et impropres à toute action légale, ou même pour Zeus,... » [FN: § 908-3]. Les points suspensifs sont de Lucien, qui dédaigne de rapporter des faits si connus.
§ 909. Ces combinaisons – ou superstitions, comme les appellent les auteurs chrétiens – ont survécu longtemps. Muratori [FN: § 909-1] remarque que, depuis une haute antiquité, les jours égyptiens furent observés, et notés même dans les calendriers publics, jusqu'au XVIe siècle de l'ère chrétienne. Ce résidu est l'un des plus tenaces ; nous le trouvons en tout temps, en tout pays, chez les hommes ignorants comme chez les hommes cultivés et même très cultivés, superstitieux ou sans préjugés [FN: § 909-2].
§ 910. (1-β) Combinaisons de choses semblables ou contraires. La ressemblance ou dissemblance des choses – peu importe si elle est imaginaire et fantaisiste – est un puissant motif de combinaisons. On comprend tout de suite pourquoi, quand on fixe son esprit aux associations d'idées suscitées par ces choses. Les raisonnements non-logiques sont souvent des raisonnements par association d'idées.
§ 911. Il faut prendre garde que si A et B sont des choses semblables, C et D des choses contraires, le phénomène contraire à la combinaison A + B est, non pas la combinaison C + D, mais bien l'absence de toute combinaison. À la croyance en Dieu n'est pas opposée la croyance au Diable, mais bien l'absence de l'une et de l'autre. À l'état d'esprit de celui qui parle à chaque instant de l'acte sexuel, n'est pas opposé l'état d'esprit de celui qui en parle toujours avec horreur, mais bien l'état d'esprit de celui qui s'en soucie peu, comme de tout autre besoin corporel. Il y a longtemps que les écrivains nous répètent que la haine n'est pas le contraire de l'amour, mais bien l'indifférence (§ 957-1).
§ 912. Le principe des homéopathes : similia similibus curantur, unit les choses semblables [FN: § 912-1]. Le principe opposé : contraria contrariis, unit des choses contraires. À ces affirmations arbitraires s'oppose la science expérimentale, qui n'a pas de principes a priori, mais qui, en chaque cas, laisse décider l'expérience.
§ 913. (I-β 1) Ressemblance ou opposition en général. Les résidus de ce genre sont extrêmement nombreux. On les rencontre souvent dans les opérations magiques : on unit des choses semblables et des opérations semblables [FN: § 913-1] ; on agit sur un homme, un animal, une chose, en opérant sur une parcelle qui leur a été enlevée. Il y a là une double ressemblance : celle des choses et celle des opérations. On unit aussi des choses contraires et, en beaucoup de cas, il semble que certains sentiments agissent pour pousser les hommes à rechercher des contrastes (§ 738 et sv.) [FN: § 913-2].
§ 914. La magicienne de Théocrite dit [FN: § 914-1] : « Delphis [son amant] me tourmenta, et moi je brûle sur Delphis un laurier. De même que celui-ci, en s'allumant, crépite fortement et brûle en un instant, et que nous n'en voyons pas même les cendres, qu'ainsi les chairs de Delphis soient aussi consumées par le feu. Comme je fais fondre cette cire, avec l'aide d'une divinité, qu'ainsi Delphis, le Myndien, soit aussitôt fondu par l'amour ; et comme je fais tourner ce rhombe de bronze, qu'ainsi cet homme [Delphis] soit tourné vers ma porte par Aphrodite ». En outre, elle opère sur des choses qui ont appartenu à son amant : « (53-54) Delphis a perdu cette frange de son manteau, et je la jette dans le feu sauvage, en l'effilant. ». On a cru – et il y a aujourd'hui encore des gens qui croient – qu'en sévissant sur des images de cire, on peut nuire à ceux que ces images représentent [FN: § 914-2]. Tartarotti écrit [FN: § 914-3] : « (p. 192) Jean Bodin, l'un des écrivains les plus passionnés pour exalter la puissance du Démon, des magiciens et des sorcières, parlant de ceux qui font des statuettes de cire, puis les percent avec des aiguilles ou les consument au feu, espérant ainsi se venger de leurs ennemis, ne peut s'empêcher d'avouer que cela se produit rarement, par le fait que Dieu ne le permet pas souvent : « car de cent peut estre, qu'il n'y en aura pas deux offensez, comme il s'est cogneu par les confessions des Sorciers » (Démonomanie, liv. II, ch. VIII) ». Les juges qui jugèrent La Môle, accusé d'avoir fait une image de cire de Charles IX et de l'avoir transpercée avec des épingles, crurent ou firent semblant de croire à ces pratiques ; de même ceux qui jugèrent la maréchale d'Ancre [FN: § 914-4] et d'autres encore.
§ 915 Il est à noter qu'ici, comme d'habitude, nous avons un noyau autour duquel se disposent diverses amplifications : un résidu avec différentes dérivations. Chez Théocrite et chez Virgile, on trouve une simple ressemblance entre le fait de la fusion d'une figurine de cire et celui d'un homme qui brûle d'amour ; ce germe croit, prospère et devient une longue fable qu'on raconte d'un roi d'Écosse. En peu de mots, celui-ci souffrait d'une maladie que les médecins ne connaissaient pas. Chaque nuit, il transpirait abondamment et, de jour, pouvait reposer à peine. Après diverses péripéties, on découvrit que cela se produisait parce que, bien loin, en Moravie, certaines sorcières possédaient une figure de cire du roi ; et quand elles la mettaient devant le feu, le roi se fondait en sueur, et quand elles récitaient des incantations devant cette image, le roi ne pouvait dormir. Il va sans dire que tout cela arrivait par pratique diabolique. C'est là une dérivation que ni Virgile ni Théocrite ne pouvaient connaître, mais qui ne fait jamais défaut, à l'époque chrétienne. Théocrite, il est vrai, a une dérivation semblable dans le rhombe qu'on fait tourner et qui, grâce au pouvoir d'Aphrodite, doit rappeler l'amant infidèle. Wier, qui était médecin, et imbu de cet art expérimental qui déplut tant et déplaît encore aux métaphysiciens et aux théologiens [FN: § 915-1], [Voir Addition A17 par l’auteur] ne croit point à cette histoire du roi écossais [FN: § 915-2] ; mais les Boutroux et les W. James de ce temps y croyaient, et il leur semblait que c'était d'une vérité qui est bien meilleure que la vérité expérimentale, et qui possède une dignité bien plus grande.
§ 916. Pour extorquer de l'argent aux niais, les sorciers avaient et ont encore l'habitude de leur persuader d'enterrer quelque part de l'or ou des pierres précieuses, en leur donnant l'espoir que, par attraction, de l'autre or, d'autres pierres précieuses, s'ajouteront à celui-ci ou à celles-là, tandis qu'ensuite le sorcier se les approprie. À chaque instant, on lit dans les journaux quelque bel exploit de ce genre.
§ 917. L'antipathie, réelle ou imaginaire, de certains êtres entre eux, a aussi servi à chasser l'un par l'autre. Dans les Géopontiques, on enseigne la manière de sauver un champ du fléau de la plante parasite nommée orobanche, qui détruit les légumineuses. Cette plante s'appelait aussi herbe-lion ; et cela suffit pour qu'on suppose que ce qui passe pour être contraire au lion lui est aussi contraire [FN: § 917-1]. « Si tu veux que cette herbe n'apparaisse pas du tout, prends cinq coquilles [ou des tessons] et dessines-y avec de la craie ou avec une autre couleur blanche Hercule suffoquant le lion ; puis dépose-les aux quatre angles et au milieu du champ. On a trouvé un autre remède physique, agissant par antipathie, et dont Démocrite témoigne en disant que, puisque le lion, animal, est frappé de terreur à la vue d'un coq et s'en va, de même si quelqu'un †ayant dans les mains un coq, tourne résolument autour du champ, aussitôt l'herbe-lion est éloignée, et les légumineuses deviennent meilleures, car l'herbe-lion a peur du coq ». Il y a ici des résidus de deux genres : 1° un résidu du genre (1-γ 2), qui rattache le nom à l'herbe, de telle sorte que, parce qu'elle s'appelle herbe-lion, elle a aussi les caractères du lion, animal ; 2° un résidu du présent genre (I-βl 1), pour lequel existe une opposition entre le coq et le lion. Clisthène, tyran de Sicyone, voulait extirper de sa cité le culte d'Adraste, parce qu'il constituait un lien avec les Argiens dont Clisthène était l'ennemi. C'est pourquoi, raconte Hérodote (V, 67), il commença par demander à la Pythie s'il pouvait chasser Adraste. Ayant reçu d'elle un refus catégorique, il imagina un moyen indirect pour chasser Adraste. Il demanda Mélanippe aux Thébains ; et, l'ayant eu, il lui consacra une chapelle au prytanée. Il fit cela parce que Mélanippe avait été un ennemi acharné d'Adraste. En l'honorant et en lui transférant les fêtes qu'on célébrait pour Adraste, on supposait que celui-ci devait s'en aller.
§ 918. La parodie des actes d'un culte fait partie du présent genre de résidus. Cette parodie, souvent employée dans les siècles passés, chez les peuples catholiques, avait pour but d'obtenir des choses contraires à la religion et à la morale. De ce genre étaient les messes noires.
§ 919. Dans l'antiquité gréco-latine, les sacrifices sont souvent déterminés par des ressemblances arbitraires, étranges, absurdes. On peut les considérer comme produits par des résidus religieux, moyennant une dérivation dont le résidu principal est celui des combinaisons (I-β 1). En Grèce, la tête de la victime était dirigée vers le ciel, quand on sacrifiait aux dieux olympiques ; elle était dirigée vers la terre, quand on sacrifiait aux dieux infernaux. En règle générale, d'ailleurs avec nombre d'exceptions, on sacrifiait des animaux mâles aux dieux, femelles aux déesses. La similitude opérait en beaucoup de cas ; mais en beaucoup d'autres, il y avait des motifs qui, ou bien ne sont pas connus [FN: § 919-1], ou bien paraissent puérils, extravagants.
§ 920. De même, en d'autres occasions fort nombreuses, de singulières ressemblances apparaissent. Par exemple, à Rome, « la nouvelle mariée était ceinte d'une ceinture que l'époux déliait dans le lit. Cette ceinture était faite de laine de mouton, pour que l'époux fût attaché et lié à son épouse, comme la laine enlevée par flocons est entrelacée. L'époux délie le nœud herculéen de la ceinture, en vue du présage, afin qu'il soit aussi heureux en procréant des fils que le fut Hercule, qui en laissa soixante-dix [FN: § 920-1] ».
§ 921. On trouve aussi le présent résidu, uni à d'autres (Ve classe), dans le fait d'Auguste qui, une fois dans l'année, demandait l'aumône [FN: § 921-1] ; et plus généralement dans les pratiques employées pour échapper à l' « envie des dieux ». Il se retrouve aussi dans l'agrégat de sentiments qui fait traiter des objets inanimés comme s'ils étaient animés, et des choses et des animaux comme s'ils avaient l'usage de la raison. D'une façon générale, il joue un rôle, plus ou moins important, dans les sentiments qui nous poussent à employer l'analogie comme démonstration; et nous le retrouverons par conséquent dans les dérivations.
§ 922. (I-β 2) Choses rares ; événements exceptionnels. L'instinct qui pousse à croire que des choses rares et des événements exceptionnels s'unissent à d'autres choses rares et à d'autres choses exceptionnelles, ou même seulement à ce qu'on désire ardemment, contribue aussi à entretenir la foi en l'efficacité de cette union ; car justement parce que ces choses sont rares, il n'est pas donné de procéder aux nombreuses preuves et contre-preuves qui pourraient démontrer la vanité de la croyance. Mais il faut prendre bien garde de ne pas voir en cela la cause de la croyance ; car on peut observer que souvent des expériences contraires, même très fréquentes, n'ébranlent pas ou ébranlent peu la foi. Ainsi, dans l'Italie méridionale, beaucoup de personnes portent à leur chaîne de montre une corne de corail ou d'autre matière, qui doit être un remède certain contre la jettature ; et l'expérience n'a vraiment rien à voir avec cette pratique.
§ 923. La rareté de l'objet peut être intrinsèque ou extrinsèque ; c'est-à-dire que l'objet – ou l'acte – peut appartenir à une classe d'objets – ou d'actes – rares, ou bien être tel, en raison de quelque circonstance accidentelle et même imaginaire. Nombre de talismans et de reliques appartiennent à cette dernière catégorie [FN: § 923-1].
§ 924. Les présages donnent très souvent des résidus du genre (I-β 2). Souvent les présages sont inventés après que le fait s'est produit ; quelquefois on les exprime d'abord, puis on tâche d'en trouver une vérification. Il peut aussi arriver que l'attente d'un événement serve à en faciliter l'annonce. Les présages puisent leur force spécialement dans la croyance en l'efficacité des combinaisons (§ 926 et sv.).
§ 925. Suétone ne manque pas de nous raconter les prodiges qui présageaient le règne d'un nouvel empereur et sa mort ; il en trouve toujours à foison. Il y a, par exemple, la belle histoire d'une poule qu'un aigle laissa tomber sur les genoux de Livie, femme d'Auguste. Cette poule tenait au bec un rameau de laurier. L'événement est donc sans doute étrange, et naturellement il doit se relier à quelque fait important (§ 983). C'est effectivement ce qui se passa, au moins dans la fantaisie de celui qui imagina la fable. Livie planta le rameau de laurier, qui devint un arbre où les Césars prirent les rameaux dont ils se couronnaient dans leurs triomphes. L'usage vint de les planter ensuite au même endroit, et l'on remarqua – tant l'expérience a de valeur ! – qu'après la mort d'un César, le laurier qu'il avait planté dépérissait. Dans les dernières années de Néron, tout le bois de laurier se dessécha jusqu'aux racines, et tous les descendants de la poule moururent. Tout cela présageait évidemment la fin de la famille des Césars, qui s'éteignit avec Néron [FN: § 925-1]. Ces expériences sont semblables à celles que font aujourd'hui nos théologiens et nos métaphysiciens : on en tire précisément ce qu'on y a mis. Pourquoi donc le fait qu'une mule met bas doit-il présager quelque événement important ? On ne peut trouver d'autre motif que celui de l'union d'un fait rare avec un autre fait rare que les Romains jugèrent devoir être funeste [FN: § 925-2]. Avant que le consul L. Cornelius Scipion passât en Asie, les pontifes observèrent les prodiges, parmi lesquels se trouvait justement une mule qui avait mis bas [FN: § 925-3]. La foudre avait frappé les murs de Velletri, et cela présageait qu'un citoyen de cette ville devait avoir le pouvoir suprême. Entraînés par leur confiance dans ce présage, les Vellétriens firent la guerre aux Romains, mais sans grand succès. « Beaucoup plus tard [FN: § 925-4], il fut manifeste que ce prodige présageait la puissance d'Auguste », qui était d'une famille de Velletri. C'est là une des très nombreuses prophéties que l'on comprend seulement après que le fait s'est produit (§ 1579), quand toutefois elles n'ont pas été inventées de toutes pièces.
Les chrétiens, qui pourtant rapportent tout à Dieu, racontent souvent les présages sans parler, du moins explicitement, de l'intervention divine, parce qu'il semble naturel que des choses rares et des événements exceptionnels aillent ensemble. Par exemple, la légende de Charlemagne nous fait connaître les signes qui présagèrent la mort de cet empereur. Le soleil et la lune s'obscurcirent ; le nom de Charlemagne disparut spontanément de la paroi d'une église fondée par l'empereur ; et ainsi de suite : il y a, bien cinq signes en tout [FN: § 925-5]. Les présages, la divination, entendus comme manifestations de l'activité divine, sont une dérivation des résidus (I-β) et principalement des résidus (I-β 2). Toute chose exceptionnelle pouvait correspondre à ce résidu, et l'on recourut à l'intervention divine pour expliquer cette correspondance.
§ 926. L'origine divine des héros et des grands hommes est un phénomène constant au cours de nombreux siècles. Tout homme, réel ou légendaire, dont l'histoire ou la légende parle beaucoup, doit sa naissance à quelque opération divine ou du moins entourée de prodiges [FN: § 926-1]. Il ne faut pas confondre la légende d'une origine divine avec la qualification de divin, appliquée à un homme. Souvent cette qualification indique simplement que cet homme est éminent par certaines qualités, qu'il est admirable, vénérable, excellent. Dans ce sens, par exemple, Homère (Odyss., XIV) nomme le divin porcher, ![]() . Dans les cas concrets de générations divines, il y a différents résidus. Le noyau principal est formé : 1°, des résidus de la permanence des agrégats, par lesquels les dieux et les esprits sont un prolongement de la personne humaine [FN: § 926-2] ; 2° des résidus sexuels, par lesquels l'homme arrête volontiers son esprit sur l'acte de génération ; 3° des résidus du présent genre : ce qui est remarquable devant aussi avoir une origine remarquable. Cela a lieu de deux façons : ou parce que d'une chose on remonte à une origine imaginaire, ou parce que d'une origine imaginaire on descend à un produit également imaginaire.
. Dans les cas concrets de générations divines, il y a différents résidus. Le noyau principal est formé : 1°, des résidus de la permanence des agrégats, par lesquels les dieux et les esprits sont un prolongement de la personne humaine [FN: § 926-2] ; 2° des résidus sexuels, par lesquels l'homme arrête volontiers son esprit sur l'acte de génération ; 3° des résidus du présent genre : ce qui est remarquable devant aussi avoir une origine remarquable. Cela a lieu de deux façons : ou parce que d'une chose on remonte à une origine imaginaire, ou parce que d'une origine imaginaire on descend à un produit également imaginaire.
§ 927. On peut diviser les générations divines en deux genres : 1° êtres divins qui s'unissent à d'autres êtres divins et ont des produits divins. De là proviennent les théogonies, si nombreuses chez les différents peuples. Viennent ensuite divers appendices. Les êtres indiqués tout à l'heure comme divins peuvent être simplement spirituels ; ils peuvent s'écarter de la personnification jusqu'à devenir de simples abstractions métaphysiques (§ 1070 et sv.). Dans une autre direction, on ajoute un autre résidu à ceux du présent genre. Si la génération divine est habituelle, on l'exclut pour l'être suprême, lequel devient l'être éternel, incréé ; de même on regarde comme exceptionnel celui qui n'est engendré que par un seul être, comme Minerve, que Jupiter eut sans avoir commerce avec un être féminin, et Vulcain, que Junon eut sans avoir commerce avec un être masculin [FN: § 927-1]. 2°, Êtres humains qui s'unissent à des êtres humains, et aussi, mais très rarement, à des animaux. Les unions de mâles divins avec des femmes sont, dans nos races, plus fréquentes que celles de femmes divines avec des hommes ; cela parce que les légendes furent composées principalement par les hommes de peuples où la famille était patriarcale. Il ne peut y avoir d'autre motif au fait que, dans la Bible, ce sont des anges mâles qui s'enamourent des filles des hommes [FN: § 927-2; et note ajoutée à l’édition française par l’auteur : Addition 18], et non les anges femmes, des fils des hommes. Comme dans le genre précédent, il y a les appendices ; et, par différentes gradations, on arrive jusqu'au vent, qui féconde les juments et même les femmes [FN: § 927-3]. et [FN: § 927 note 3b]] Là encore, ont lieu de nouvelles adjonctions des résidus du présent genre. Quand la génération par union d'êtres divins avec des êtres humains est devenue commune, on ajoute d'autres circonstances, pour avoir des générations exceptionnelles. Il ne suffit pas qu'un homme naisse d'un dieu : il doit aussi naître d'une vierge. Celle-ci doit enfanter en restant vierge. Il ne suffit pas que Zeus engendre Héraclès : il faut, de plus, qu'il mette trois nuits pour accomplir cette œuvre [FN: § 927-4]. Dans le nombre de trois nuits, que les auteurs donnent généralement, mais non exclusivement, il y a aussi le résidu qui fait de trois un nombre sacré (§ 960-8); et c'est là un cas particulier d'un fait général, c'est-à-dire de l'adjonction, dans les légendes, de nombreux résidus secondaires aux résidus principaux.
Dans la haute antiquité classique, il serait plus facile d'énumérer les personnages célèbres ayant une origine humaine, que ceux ayant une origine divine, laquelle apparaît comme proprement normale. On a la preuve de la permanence tenace de ce résidu dans le fait que, sous son impulsion, les chrétiens eux-mêmes employèrent largement les légendes d'union d'êtres spirituels avec des femmes, pour engendrer des hommes exceptionnels. Dans cette fonction, les démons chrétiens se substituèrent simplement aux dieux du paganisme[FN: § 927-5] ; et, à vrai dire, on a usé et abusé de la génération par leurs œuvres. Ainsi, l'enchanteur Merlin était fils du démon, et l'on trouve aussi des gens pour donner une semblable origine à Luther [FN: § 927-6]. Aujourd'hui, le culte des hommes éminents a beaucoup diminué ; par conséquent ces origines appartiennent seulement au passé.
§ 928. Les légendes constituées au moyen des résidus sont ensuite expliquées par les dérivations. Tant que l'être divin ou seulement spirituel, formé par la persistance des agrégats, s'écarte encore peu de son origine humaine, on n'éprouve aucune difficulté à concevoir son union avec d'autres êtres semblables ou avec des êtres réels. De ce tronc se détache une branche, dans laquelle la difficulté n'est pas grande non plus ; c'est celle où les êtres divins se transforment plus ou moins en abstractions métaphysiques qui s'unissent ensemble. La persistance des agrégats facilite le passage entre des faits comme celui du chaud et de l'humide, qui font germer le grain, et d'autres faits où les principes métaphysiques deviennent générateurs d'êtres réels ou imaginaires. Mais dans une autre branche, apparaissent de plus grandes difficultés ; c'est celle où la personnification des êtres spirituels demeure, et où leur écart avec les êtres humains s'accroît. Les Grecs ne ressentirent nullement le besoin de rechercher comment la semence de Zeus avait pu féconder les nombreuses femmes qu'il avait connues charnellement, tandis que les chrétiens éprouvèrent le besoin de résoudre une question semblable, au sujet des démons qui avaient des rapports avec les femmes [FN: § 928-1].
Les anticléricaux puisent un motif dans ces fables pour condamner la religion chrétienne. Mais celle-ci ne les a pas inventées : elle les a reçues de l'antiquité ; et après tout, ces fables ne sont pas plus étranges que d'autres qui continuent à avoir cours. Au point de vue exclusivement logico-expérimental, celui qui croit aux dogmes du suffrage universel peut aussi croire à l'origine divine des héros, car l'effort intellectuel nécessaire pour avoir l'une ou l'autre foi n'est pas très différent. Au point de vue de l'utilité sociale, les fables anciennes et modernes peuvent avoir eu une utilité grande, petite, nulle, négative. On ne peut rien dire a priori ; cela dépend du lieu, du temps, des circonstances.
§ 929. (I-β 3) Choses et événements terribles. Ce résidu apparaît presque seul, en certains faits, dont le suivant est un type. À propos de la conjuration de Catilina, Salluste dit [FN: § 929-1] : « Il y en eut [des gens] dans ce temps-là qui dirent que Catilina, après son discours, voulant lier par un serment les complices de son crime, fit circuler une coupe remplie de vin et de sang humain ; qu'après qu'ils en eurent tous goûté avec des imprécations, comme il est d'usage dans les sacrifices solennels, il leur dévoila son projet : il voulait ainsi, disait-on, les unir entre eux plus fortement par la complicité dans cet horrible attentat. Mais plusieurs pensent que ce détail et beaucoup d'autres furent inventés par ceux qui voulaient apaiser la haine qui s'éleva plus tard contre Cicéron, et qui, pour cela, exagéraient l'atrocité du crime de ceux qui avaient été punis ».
Que le fait soit vrai ou inventé, il n'en reste pas moins que l'on unit deux choses terribles : boire le sang humain et conspirer pour détruire la république romaine. On voit encore ce résidu dans certains sacrifices humains, substitués aux sacrifices d'animaux. Ceux-ci suffisent dans les conditions ordinaires ; ceux-là subviennent aux conditions extraordinaires, terribles.
Le serment des complices de Catilina n'est pas raconté de la même façon par tous les auteurs ; mais le même résidu transparaît sous des formes diverses. Plutarque dit de Catilina et de ses complices [FN: § 929-2] : « Pour se lier réciproquement par la foi du serment, ayant tué un homme, ils en goûtèrent les chairs ». Dion Cassius dit de Catilina [FN: § 929-3] : « Ayant tué un jeune garçon, il jura sur ses entrailles, puis, en les touchant, lui et les autres conjurés confirmèrent le serment ». Nous avons vu aussi ce résidu dans les sacrifices humains faits à Rome, après la défaite de Cannes. Dion Cassius [FN: § 929-4] raconte comment les soldats de César se révoltèrent, parce qu'ils n'avaient pas reçu l'argent que César avait dépensé pour certains jeux. César saisit et conduisit au supplice un des rebelles. « Celui-ci fut donc puni pour ce motif ; deux autres hommes furent égorgés comme dans un sacrifice. La raison de ce fait, je ne saurais la dire ». La raison est à rechercher, au moins en partie, dans le résidu dont nous traitons. Le crime des rebelles parut énorme, et ne pouvait être expié que d'une manière terrible [FN: § 929-5]. On n'aura d'ailleurs pas manqué de prétextes logiques pour justifier ce sacrifice [FN: § 929-6].
§ 930. Le ver sacrum nous apparaît de la même façon. Dans les circonstances ordinaires, il suffisait de promettre aux dieux des sacrifices d'animaux, des jeux, des temples, la dîme du butin fait à la guerre, etc. Mais quand se produisait quelque chose d'extraordinaire, de terrible, on promettait aux dieux tous les êtres animés qui naîtraient en un printemps. Il paraît qu'en des temps reculés, les peuples italiques mettaient aussi les hommes parmi ces êtres ; mais à l'époque historique, les Romains les excluaient [FN: § 930-1]. Un ver sacrum fut voué, quand Rome était serrée de près par Annibal [FN: § 930-2]. Le contrat avec les dieux fut fait avec les précautions formalistes et minutieuses qui étaient propres aux Romains (§ 220 et sv.). Les dieux tinrent loyalement parole, mais les Romains rechignèrent. Ce n'est que vingt-un ans après qu'ils se décidèrent à accomplir leur vœu, et encore pas trop correctement [FN: § 930-3] aussi durent-ils l'accomplir à nouveau [FN: § 930-4].
§ 931. On trouve aussi le présent résidu dans les opérations magiques, quand on sacrifiait des enfants [FN: § 931-1]. Les descriptions d'Horace (Epod., 5) et de Juvénal (VI, 552) sont bien connues. En Europe, jusqu'au XVIIe siècle, on entend de fréquentes accusations, vraies ou fausses, de ces sacrifices. Il paraîtrait qu'on en fit un pour conserver a Mme de Montespan [FN: § 931-2] l'amour de Louis XIV.
§ 932. (I-β 4) État heureux uni à des choses bonnes; état malheureux uni à des choses mauvaises. Quand un certain état A est estimé heureux, on est porté à y rattacher toutes les choses estimées bonnes ; et, au contraire, si un état B est estimé malheureux, on est poussé à y rattacher tout ce qui est mauvais. Ce résidu est souvent uni à un autre de la IIe classe. Ainsi se forme un noyau, autour duquel se disposent nombre de concepts de choses bonnes ou mauvaises ; et de cette manière se prépare, grâce à l'abstraction, une personnification de cette nébuleuse, qui devient un être spécial, ayant une existence subjective dans la conscience des hommes, et auquel ensuite, suivant un procédé habituel, on confère une existence objective [FN: § 932-1] (§ 94 et sv.).
§ 933. Longtemps, en Europe, tout ce qui était bien était placé sous la protection de la « sagesse des ancêtres ». Aujourd'hui, tout ce qui passe pour bon est attribué au « Progrès ». Avoir un « sentiment moderne » de certaines choses, veut dire en avoir un sentiment juste et bon. Autrefois, on louait un homme en disant qu'il avait des « vertus antiques ». Aujourd'hui, on le loue en disant qu'il est un « homme moderne »; et quelques-uns emploient le néologisme : « qui a un sens de modernité ». Autrefois, il était louable d'agir « chrétiennement ». Aujourd'hui, il est louable d'agir « d'une manière humaine », et mieux, « d'une manière largement humaine » ; par exemple en protégeant les voleurs et les assassins. Secourir son semblable s'appelait autrefois être « charitable ». Aujourd'hui, on dit : « faire oeuvre de solidarité ». Pour désigner des hommes dangereux, voués au mal, on disait autrefois que c'étaient des « hérétiques » ou des « excommuniés ». Aujourd'hui, on dit que ce sont des « réactionnaires ». Tout ce qui est bon est « démocratique » ; tout ce qui est mauvais est « aristocratique ». Les pontifes du dieu « Progrès » et leurs fidèles frémirent d'indignation quand le sultan Abdul Hamid réprima la révolte des Arméniens ; ils l'appelèrent « le sultan rouge ». Mais après avoir dépensé tant d'indignation, il ne leur en resta plus quand, en 1910, les « Jeunes Turcs », couverts par le pavillon du « Progrès », réprimèrent la révolte des Albanais. Le critère de ces gens paraît être le suivant. Un gouvernement a le droit de réprimer une insurrection, s'il jouit plus et mieux que les insurgés, de la protection du dieu « Progrès »; autrement il n'a pas ce droit.
§ 934. Ceux qui sont hostiles à une institution lui attribuent la responsabilité de tous les maux qui arrivent. Ceux qui la favorisent lui accordent le mérite de tout bien. Que de lamentations fit-on entendre sur les impôts levés par les gouvernements de jadis ! Pourtant ils étaient moindres qu'aujourd'hui ; maintenant, bien que plus lourds, on les supporte allégrement. Les « libéraux », en Toscane, en voulaient au Grand Duc, parce qu'il maintenait « le jeu immoral du loto ». Voyez ce que Giusti écrivit à ce propos. Mais ensuite il leur parut naturel et moral que le gouvernement italien le maintint aussi. En France, sous l'Empire, les candidatures officielles excitaient l'indignation des républicains. Arrivés au pouvoir, ils en usèrent plus largement et plus intensément que l'Empire [FN: § 934-1]. Les mêmes Anglais qui affirment qu'en Russie les délits politiques sont dus exclusivement au mauvais gouvernement, sont persuadés, d'autre part, que des délits identiques, commis aux Indes, sont dus uniquement aux accès de brutalité criminelle de leurs sujets.
§ 935. Les anciens Romains attribuaient aux dieux le mérite des succès de leur république. Les peuples modernes accordent le mérite du progrès économique à des parlements corrompus, ignorants et peu estimables. Il s'y ajoute des considérations sur lesquelles nous aurons à revenir (§ 1069 et sv.). En France, sous l'ancienne monarchie, le roi avait quelque chose de divin. Si l'on voyait se produire quelque abus, on disait: « Si le roi savait ! » Aujourd'hui, la république, le suffrage universel sont devenus des divinités [FN: § 935-1]. « Le suffrage universel, notre maître à tous ! » s'écrient députés et sénateurs, élus grâce au vote de ceux qui proclament le dogme : « Ni Dieu ni maître ». Quand on ne peut nier un abus, on en accuse quelque circonstance souvent très accessoire. Il y a des gens qui sont persuadés que tous les maux qu'on peut voir dans un pays parlementaire sont dus au scrutin uninominal, ou au scrutin de liste, ou au scrutin qui ne tient compte que de la majorité, à laquelle on oppose la représentation proportionnelle [FN: § 935-2]. Ces gens croient parer par des artifices de forme à des maux affectant le fond. Ils ferment les yeux sur le fond, parce qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas aller contre le sentiment qui fait voir tout en beau dans le suffrage universel et dans la démocratie.
§ 936. En France, un juge de paix avait jugé qu'un homme idiot, au sens médical du terme, ne pouvait être électeur. La Cour de Cassation, par jugement du 8 avril 1910, cassa ce jugement et décida que « la faiblesse d'esprit, lorsqu'elle n'a pas motivé l'interdiction, n'est pas incompatible avec la jouissance du droit électoral tel que le réglemente le décret du 2 février 1852 ». Là-dessus, Mme Marguerite Durand présenta comme candidat, dans une réunion populaire, précisément un idiot, et fit cette observation: « Les femmes ne votent pas, mais les idiots sont électeurs et même éligibles ». Cette dame a ainsi montré le ridicule, non seulement de l'inégalité électorale des femmes et des hommes, mais du principe même du suffrage universel. Après tout, un idiot peut bien figurer aussi comme électeur parmi les entremetteurs, les délinquants et autres semblables gens qui votent allégrement. Rappelons-nous qu'ainsi nous ne démontrons nullement qu'à tout prendre, et en un certain moment historique, le suffrage universel soit condamnable. Nous démontrons seulement que l'auréole de sainteté dont on l'entoure est ridicule, et nous mettons en lumière les sentiments qu'exprime l'adoration de cette divinité. Cela ne prouve pas non plus que la croyance en cette divinité ne soit utile à la société. Ce peut être –ou ne pas être – l'un des très nombreux cas dans lesquels une croyance, intrinsèquement fausse, est socialement avantageuse. Dans une étude objective comme celle-ci, il faut s'en tenir strictement aux termes d'une proposition et ne jamais les outrepasser (§ 41, 73, 74, 1678 et sv.).
§ 937. (I-β 5) Choses assimilées produisant des effets de nature semblable ; rarement de nature opposée. Souvent les hommes ont cru qu'en s'assimilant certaines choses, ils acquéraient une part des qualités de ces choses. Quelquefois, ces phénomènes peuvent se confondre avec une communion mystérieuse entre l'homme et son totem ou sa divinité ; mais plus souvent, ce sont des choses distinctes.
§ 938. Zeus, à qui l'on avait prédit que de Métis et de lui naîtrait un fils qui serait le maître du ciel, engloutit Métis, grosse d'Athéna. Un vers d'Hésiode [FN: § 938-1] ajoute : « Afin que la déesse lui communiquât la connaissance du bien et du mal ». Pindare (Ol., I, 62) dit que Tantale osa dérober à Zeus et donner à ses compagnons le nectar et l'ambroisie, qui l'avaient rendu lui-même immortel. Ailleurs (Pyth., IX, 63), il dit que les Heures donnèrent à Aristée l'immortalité, en versant sur ses lèvres le nectar et l'ambroisie. On sait quel rôle considérable le Sôma joue dans la religion des Védas [FN: § 938-2].
§ 939. En voyant et en considérant la force, le courage, la rapidité d'Achille, on estima opportun de supposer que, dès l'enfance, il se nourrit de moelle d'os de lions et de cerfs ; on y ajouta aussi la moelle d'os d'ours et les entrailles de lions et de sangliers [FN: § 939-1]. Là, le résidu est manifeste, à moins toutefois que les fanatiques du totémisme ne veuillent affirmer qu'Achille avait en même temps pour totem le lion, l'ours, le sanglier, le cerf. Les Nouveaux-Zélandais mangent leur ennemi pour acquérir sa force. Comme toujours, on ne manque pas d'explications diverses (dérivations) ; mais le résidu se reconnaît facilement. Dumont d'Urville nous raconte comment les Nouveaux-Zélandais dévorent « l'âme » des ennemis qu'ils ont tués [FN: § 939-2]. On pourrait décrire d'une manière identique la façon dont Achille était nourri, quand il était enfant. On voulait qu'il s'assimilât le waidoua des lions, des ours, etc., et comme il réside dans la moelle ou dans les viscères, on lui faisait manger ces parties des animaux. De nombreux usages des peuples sauvages contiennent le résidu dont nous parlons ; ce dernier se retrouve aussi chez les peuples civilisés, sous une forme peut-être quelque peu voilée [FN: § 939-3].
§ 940. Quand les sauvages mangent le totem, on a un cas particulier du phénomène de l'assimilation de ce qu'on croit avantageux ; mais avec l'abus qu'on a fait aujourd'hui du totémisme, on a voulu voir dans la communion avec le totem le « fait primitif » dont les autres seraient issus. Les faits que nous connaissons ne démontrent pas du tout cela. Nous avons seulement de nombreux faits, ayant un résidu commun, qui est celui de l'assimilation. On voit aussi ce résidu dans ce que dit Justin de l'Eucharistie [FN: § 940-1] : « (3) Ensuite on porte au président des frères, du pain et une coupe de vin mélangé d'eau. Il prend ces choses, loue et glorifie le Père de l'Univers, au nom du Fils et du Saint-Esprit, puis fait une longue eucharistie pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui... (5) Quand le président a fait l'eucharistie et que tout le peuple a répondu, ceux que nous appelons diacres donnent à chacun des assistants, le pain eucharistique, le vin et l'eau, et en portent aux absents. (LXVI, 1) Nous appelons cet aliment Eucharistie... (2) Car nous ne le prenons pas comme du pain ordinaire ou comme une boisson ordinaire ; mais de même que c'est à cause du verbe de Dieu que Jésus-Christ, notre Sauveur, s'incarna et prit chair et sang pour notre salut, de même aussi à cause des paroles de sa prière, nous savons que l'aliment consacré [FN: § 940-2], grâce auquel notre sang et nos chairs sont nourris par transformation de Jésus incarné, est de la chair et du sang [FN: § 940-3] ».
§ 941. On sait comment à ce simple fait se sont ajoutées des dérivations sans fin, et avec quelle abondance et quelle âpreté ont disputé sur ce sujet les théologiens, et maintenant aussi les détracteurs du christianisme. Nous n'avons pas à nous occuper de cette question. Notons seulement que le sentiment qui forme le résidu de ce fait ne porte aucune atteinte à la doctrine catholique ou à toute autre doctrine théologique ; autrement, reconnaître comme résidu, par exemple, dans l'amour pour Dieu, le sentiment d'amour envers un être puissant et bienfaisant, serait porter atteinte à toute religion qui inspire cet amour. Quelle que soit la foi, elle ne peut s'exprimer que dans la langue parlée par les hommes, et au moyen des sentiments qui existent en eux. L'étude de ces modes d'expression ne porte aucune atteinte aux choses qu'ils expriment (§ 74).
§ 942. Des controverses comme celles qui ont eu lieu sur l'Eucharistie auraient pu se produire dans d'autres cas analogues. Par exemple, si le paganisme gréco-latin avait duré jusqu'à nos jours, et que les mystères d'Éleusis eussent prospéré, on aurait pu disserter sur le cicéon tout aussi longuement que sur l'Eucharistie, et peut-être même envoyer quelque hérétique au bûcher. Les initiés aux mystères d'Éleusis répétaient la formule [FN: § 942-1] : « J'ai jeûné ; j'ai bu le cicéon ; j'ai pris dans le ciste ; j'ai vu ; j'ai mis dans le panier, et puis du panier dans le ciste ». Le cicéon que buvaient les initiés n'était évidemment pas un cicéon quelconque, comme on le buvait d'habitude : il acquérait des qualités mystiques, par la cérémonie dans laquelle on l'employait. Déméter avait bu le cicéon, tandis que, désolée, elle cherchait sa fille (Hymn. Hom. in Cererem, 208-209) ; et suivant ses prescriptions, il était composé d'eau, de farine et de feuilles de menthe triturées. Dans la suite, la composition de cette boisson paraît avoir changé [FN: § 942-2] ; et il semble aussi qu'on y ajouta du vin, bien que Déméter eût refusé d'en boire. Dans l'Argonautique, sur laquelle on met le nom d'Orphée, les Argonautes, pour s'engager par serment, boivent un cicéon dont la composition est différente.
§ 943. De ces faits naît une riche moisson de dérivations qui importent peu à la sociologie. Celle-ci doit s'occuper, au contraire, du résidu qu'on rencontre en nombre de phénomènes sociaux, et qui contribue à les expliquer. Avec le fait raconté dans l'Argo-nautique, nous avons passé, comme il arrive souvent, d'un résidu spécial à un résidu général, c'est-à-dire du résidu (I-β 5) au résidu (I-α). Chez plusieurs peuples, on trouve l'usage de faire avaler à un malade un morceau de papier sur lequel on a tracé certains caractères, ou la cendre de ce morceau de papier, ou l'eau dans laquelle on l'a laissé infuser [FN: § 943-1].
§ 944. (I-γ) Pouvoirs mystérieux de certaines choses et de certains actes. On trouve ce résidu en beaucoup d'opérations magiques, dans les amulettes, les serments prêtés sur certaines choses, les ordalies, etc. Il constitue aussi la partie principale des phénomènes des tabous avec ou sans sanction. Ce résidu correspond à un sentiment par lequel des choses et des actes sont investis d'un pouvoir occulte, souvent indéterminé, mal expliqué.
§ 945. Si nous ne connaissions que le jugement de Dieu, du moyen âge, nous pourrions nous demander si la partie principale est l'intervention supposée, de la divinité. Mais on trouve les ordalies un peu partout, souvent avec intervention d'un jugement supposé de la divinité, et souvent aussi sans elle. Au moyen âge, le jugement de Dieu a été imposé à l'Église, malgré sa résistance, par la superstition populaire. On voit par conséquent que la partie principale est l'instinct des combinaisons, et que l'intervention supposée du jugement divin est une dérivation qui a pour but d'expliquer et de justifier cet instinct. L'étude des ordalies appartient à la sociologie spéciale ; il nous suffit ici d'avoir indiqué ce cas de l'instinct des combinaisons.
§ 946. Il sera utile de séparer de la catégorie générale (I-γ 1) une catégorie spéciale (I-γ 2), dans laquelle les noms des choses sont supposés avoir un pouvoir occulte sur ces choses.
§ 947. (I-γ 1) Pouvoirs mystérieux en général. Les faits sont innombrables. Nous ne parlerons ici que de quelques-uns. Souvent un résidu se voit bien dans les faits de peu d'importance. Le 2 mai 1910, fut justicié à Lucerne un certain Muff, incendiaire et assassin. Voici ce que les journaux racontent à ce propos [FN: § 947-1] : « Les derniers sacrements lui ont été administrés [à Muff]. En marchant au supplice, il portait sur lui une particule authentique de la vraie croix que Mme Erica von Handel-Mazzetti lui avait fait parvenir avec des paroles de consolation ». Il est impossible de donner logiquement une place quelconque à cette relique dans le jugement que Dieu portera, d'une part sur les crimes de cet homme, et de l'autre sur son repentir. Il faut donc conclure que cette relique a un genre de pouvoir mystérieux, comme serait celui d'une parcelle de bromure de radium, enfermée dans un tube de verre.
§ 948. Habituellement, notre résidu se manifeste sous les voiles d'une de ses dérivations. Les hommes qui éprouvent le besoin de rendre logique leur attitude (résidu I-ε) se demandent : «Comment ces choses, ces actes peuvent-ils bien agir ? » Et ils se répondent : « Par l'intervention d'un esprit, d'un dieu, du démon ». Cette réponse vaut celle qui explique que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive.
§ 949. Une anecdote racontée par Saint Grégoire de Tours met à découvert le résidu et sa dérivation. Un individu accusé d'avoir incendié la maison de son voisin, dit [FN: § 949-1] : « J'irai au temple de Saint Martin, et, en jurant sur ma foi, je reviendrai innocent de ce crime ». Celui qui apprit le fait à Saint Grégoire dit : « Il était certain que cet homme avait incendié la maison. Tandis qu'il s'acheminait pour prêter serment, m'étant tourné vers lui, je lui dis « À ce que disent les voisins, tu n'es pas innocent de ce crime mais Dieu est partout, et son pouvoir est le même hors de l'église que dedans. Si donc tu as la vaine croyance que Dieu et ses saints ne vengent pas le parjure, voici le temple sain ; prête serment dehors si tu veux, car il ne te sera pas permis d'en fouler le seuil ». Il prête serment et, aussitôt frappé par le feu céleste, il expire. On voit que le narrateur flotte entre deux idées peu conciliables : celle que le serment est également efficace en tout lieu, et l'autre, qu'il est plus efficace en certains lieux qu'en d'autres [FN: § 949-2] ; car c'est pour avoir osé prêter serment en présence du temple de Saint Martin, que le parjure fut frappé ; raison pour laquelle l'auteur ajoute : Multis haec causa documentum fuit, ne in hoc loco auderent ulterius peierare. « Pour beaucoup de gens, ce fut un enseignement de ne plus oser se parjurer en ce lieu »
§ 950. Marsden [FN: § 950-1] nous apprend comment on prête serment, à Sumatra, et sur quels étranges objets on le fait : un vieux poignard (cris), un vieux canon de fusil, un fusil, et quelquefois la terre sur laquelle on pose la main. L'auteur qui, d'habitude, pense surtout aux actions logiques, observe : « (p. 11) C'est une chose frappante de voir les hommes soumis à des pratiques aussi déraisonnables, et qui sont dans le fait, aussi bizarres et aussi puériles, quoique communes à des Nations le plus séparées par la distance des lieux, le climat, le (p. 12) langage... »
§ 951. D'habitude, on tâche justement de renforcer, de façons analogues, la foi au pouvoir occulte des choses. Dans l'Iliade (III, 271-291), Agamemnon sacrifie des victimes, pour rendre ferme et solennel le serment avec Priam. Il coupe des poils sur la tête des agneaux ; et ces poils sont distribués aux meilleurs des Troyens et des Achéens; Agamemnon égorge les agneaux et prononce un serment auquel Priam répond par un autre serment semblable. Un grand nombre d'années et même de siècles après ce récit légendaire, des actes de ce genre se répètent ; seule, la forme change. Peu importe que l'on jure sur des victimes, sur des reliques de saints ou sur d'autres objets, qu'on invoque Zeus, Hélios, les Fleuves, la Terre, le Dieu des chrétiens et les saints, un démon ou un autre être quelconque. Seul importe le fait que les hommes croient fermement se lier par le moyen de certains actes en partie mystérieux. On trouve là le résidu que nous observons depuis des époques reculées, et chez tous les peuples. Aujourd'hui encore, il est des pays où l'on doit jurer en posant la main sur la Bible ou sur l'Évangile, et il est nécessaire que la main soit nue. Il est impossible de découvrir aucun motif logique, pour lequel, si la peau d'un gant se trouve entre la main et l'Écriture Sainte, le serment risquerait d'être moins efficace. Il y a sans doute un sentiment vague, indéfini, qui pousse à croire que la peau du gant nuirait au pouvoir mystérieux du livre, comme un corps non conducteur empêche le passage de l'électricité. D'ailleurs ce sentiment n'a pas une forme définie de cette façon ou d'une autre analogue ; il est constitué par un instinct qui admet certaines choses, en rejette d'autres, et il peut s'exprimer par notre résidu.
§ 952. Un sentiment semblable se retrouve dans l'idée qu'on a du pouvoir des reliques. Au sujet des choses estimées bienfaisantes, il faut distinguer deux éléments : l'action de ces choses et le sentiment de vénération qu'on a pour elles. Un élément peut exister sans l'autre. On peut estimer bienfaisantes des choses qu'on ne vénère pas, et vénérer des choses qu'on n'estime pas bienfaisantes. Les deux choses peuvent aussi être unies ; c'est ce qu'on observe pour les reliques. Innombrables sont les cas dans lesquels une chose appartenant à un saint agit presque par sa vertu propre. En général, les hommes peuvent croire à l'efficacité de certains actes du culte d'une religion, sans croire à cette religion [FN: § 952-1]. Là apparaît clairement la nature non-logique de certaines actions (§ 157, 184-1). Logiquement, on devrait croire d'abord en une religion donnée, puis en l'efficacité des actes de son culte ; efficacité qui est la conséquence logique de la première croyance. Une question posée, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse y répondre, est logiquement absurde. Mais les actions non-logiques suivent une voie inverse. En certains cas, on croit instinctivement à l'efficacité des actions du culte ; puis on veut avoir une « explication » de cette croyance, et alors on recourt à la religion. C'est là un des cas si nombreux dans lesquels le résidu apparaît comme partie principale, et la dérivation comme partie secondaire. En particulier, innombrables sont les cas dans lesquels une chose appartenant à un saint, agit presque par sa vertu propre sur qui entre en contact avec elle.
Les Actes des apôtres [FN: § 952-2] rapportent que « (11) Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, (12) au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient [FN: § 952-3] ».
§ 953. Les opérations magiques nous fournissent un nombre immense d'actions mystérieuses. Si nous connaissions seulement la magie des chrétiens, où le pouvoir des opérations magiques est attribué au démon, on bien d'autres magies où le pouvoir est aussi attribué à quelque être surnaturel, nous nous demanderions si la croyance en l'efficacité des opérations magiques est, non pas un résidu du genre envisagé maintenant, mais au contraire une dérivation, c'est-à-dire une conséquence de la croyance au démon et à d'autres êtres surnaturels.
§ 954. Mais le doute s'évanouit, quand on observe qu'il y a des opérations magiques, sans qu'on suppose l'intervention d'êtres surnaturels. La partie constante n'est donc pas cette intervention, mais bien la croyance en une action mystérieuse. L'intervention de l'être surnaturel est une dérivation par laquelle on cherche à expliquer, justifier les combinaisons qui révèlent le résidu. [Voir Addition A19 par l’auteur] En outre, il y a de nombreux cas dans lesquels des opérations magiques ou quasi-magiques se mêlent à la religion, sans qu'on y prenne garde, involontairement, sans la moindre intention perverse. L'Église catholique a dû condamner l'abus qu'on faisait de l'eau bénite, de l'hostie consacrée, de nombreuses pratiques du culte, et de beaucoup de superstitions [FN: § 954-1]. Saint Thomas tâche autant qu'il peut de ménager la chèvre et le chou, et de justifier le résidu par la dérivation. Au sujet du port des reliques sur soi, il dit [FN: § 954-2] : « Si on les porte à cause de la confiance qu'on a en Dieu et aux saints dont viennent les reliques, ce n'est pas illicite ; mais si l'on s'attachait à quelque chose vaine, supposons au fait que le vase est triangulaire, ou à une autre chose semblable n'appartenant pas à la vénération de Dieu et des saints, ce serait supersticieux et illicite ». Quant aux écrits qu'on peut porter sur soi, il faut bien regarder « s'ils contiennent des noms inconnus, afin que dessous ne se dissimule pas quelque chose d'illicite ». Ici, il est évident que l'action illicite serait involontaire. Les « superstitions » persistent, tandis que la religion change ; en d'autres termes, le résidu persiste et les dérivations varient. Les chrétiens, par exemple, n'inventèrent pas le mauvais œil ; ils ne le déduisirent pas de l'existence de leur démon ; ils l'expliquèrent seulement, l'ayant déjà trouvé dans la société païenne.
§ 955. Tertullien [FN: § 955-1] dit que « chez les idolâtres, il y a une chose redoutable, qu'ils appellent fascinum, qui cause le malheur par la louange et une trop grande gloire. Parfois, nous estimons que c'est œuvre du diable, parce qu'il hait le bien ; parfois nous estimons que c'est œuvre de Dieu, parce qu'il juge l'orgueil, en élevant les humbles et en écrasant les superbes ». On remarque ici deux choses : d'abord la variabilité des dérivations, qui vont d'un extrême à l'autre, du diable à Dieu ; puis l'intervention de Dieu pour rabaisser celui qui se glorifie trop ; elle rappelle en partie l'envie des dieux des païens. Saint Basile observe qu'il y avait des gens qui croyaient que les envieux pouvaient nuire à autrui par leur seul regard [FN: § 955-2], « presque comme un flux maléfique, qui jaillit des yeux de l'envieux, et qui nuit et corrompt ». Mais il rejette cela comme fables populaires et de bonnes femmes. Ce sont au contraire les démons, ennemis des bons, qui se servent des yeux des envieux pour nuire à autrui. Delrio accepte cette sainte autorité, rejette toute autre cause, et tient le fascinum pour oeuvre du diable. Comme d'habitude, la dérivation bourgeonne, se feuille, croît exubérante. Delrio sait même – voyez quel savant ! – comment opère le démon [FN: § 955-3]. « Le fascinum est une qualité pernicieuse, donnée par un sortilège des démons, ensuite d'un pacte tacite ou exprès de l'homme et du démon. Le diable répand cette qualité pernicieuse dans l'air ambiant, et l'homme, en respirant l'air infecté qui est autour de lui, l'attire au cœur au moyen des artères du cœur, et par là des maux et la consomption se communiquent à tout le corps. » Il y avait longtemps déjà qu'on connaissait de semblables explications ingénieuses. Plutarque [FN: § 955-4] en traite longuement. Le fait du fascinum est certain, dit-il ; mais la difficulté d'en trouver l'explication fait qu'il y a des incrédules. Et il continue, montrant comment le fascinum peut se produire d'une façon naturelle. Une autre explication, toujours naturelle, est donnée par Héliodore [FN: § 955-5]. Inutile de rapporter toutes ces sornettes ; il est bon seulement de remarquer cet exemple de dérivations variables d'un résidu constant.
Naturellement, le mal connu, on court au remède, qui peut être de différents genres, c'est-à-dire naturel, magique, religieux.
§ 956. Tandis que ces branches se détachent du tronc, le tronc lui-même subsiste à travers les siècles ; et, des temps anciens aux nôtres, persiste la simple idée d'une influence mystérieuse due au mauvais œil.
Hésiode [FN: § 956-1] dit : « Tu ne perdrais pas ton bœuf, si tu n'avais un mauvais voisin ». Columelle [FN: § 956-2] surenchérit. Il rappelle cette parole, et ajoute : « Ce qui est dit, non seulement du bœuf, mais de tout ce qui nous appartient » ; et il paraît confondre le mauvais œil avec les vexations du voisin. Catulle [FN: § 956-3], en embrassant sa maîtresse, craint le mauvais œil de l'envieux ; et Virgile [FN: § 956-4], dans les Églogues, craint aussi le fascinum. Pline [FN: § 956-5] rapporte que, « selon Isigone et Nimphodore, il y a, en Afrique, des familles de fascinateurs dont les incantations tuent les troupeaux, dessèchent les arbres, font mourir les enfants ». Isigone ajoute que chez les Triballes et les Illyriens, il y a des individus du même genre, qui fascinent par le regard, et tuent ceux qu'ils fixent longuement, surtout d'un œil irrité. Les adultes sont frappés plus facilement. Il est à noter qu'ils ont deux pupilles dans chaque œil. Il y a des femmes du même genre, en Scythie, qui sont appelées Bities, à ce que dit Apollonide. Philarque place dans le Pont les Tibiens et beaucoup d'autres gens de la même nature, qui sont connus parce qu'ils ont, dit-il, une double pupille dans un œil, et l'effigie d'un cheval, dans l'autre. En outre, ils ne peuvent être submergés, même s'ils sont chargés de vêtements. [Voir Addition A20 par l’auteur] Damon raconte l'histoire de gens semblables, soit des Pharnaciens, en Éthiopie, dont la sueur cause la consomption aux corps qu'elle touche. Même chez nous, Cicéron dit que toutes les femmes qui ont doubles pupilles nuisent par leur regard ». De nos temps aussi, on croit au mauvais œil, sans que le démon y ait aucune part. Il suffit, à ce propos, de rappeler que beaucoup de bons catholiques étaient persuadés que Pie IX était jettatore. Notez que les jettatrices sont plus nombreuses que les jettatori, et qu'elles sont presque toujours – on pourrait dire : toujours – vieilles et laides, ou au moins laides ; celles qui sont jeunes et belles n'ont pas le mauvais oeil [FN: § 956-6]. Il y a là un autre résidu : un résidu du genre (I-β).
§ 957. L'efficacité des remèdes est mystérieuse, comme la maladie est mystérieuse, bien que parfois d'autres résidus puissent offrir une explication quelconque [FN: § 957-1]. Nous parlerons plus à propos des tabous, en traitant des dérivations (§ 1481 et sv.).
§ 958. (I-γ 2) Noms unis mystérieusement aux choses. Le nom peut être uni aux choses de deux manières : sans motif expérimental, mystérieusement, ou bien parce qu'il rappelle certaines propriétés expérimentales, ou même imaginaires, des choses. La première manière donne le présent genre de résidus ; la seconde donne des résidus de persistance des agrégats (IIe classe). Au point de vue scientifique, le nom est une simple étiquette pour désigner une chose, et l'on peut toujours changer l'étiquette, pourvu qu'il y ait quelque utilité. C'est d'après cette utilité surtout qu'on doit juger les définitions (§ 119 et sv.).
§ 959. Sous les deux aspects rappelés tout à l'heure, il en va différemment. Le nom est uni à la chose par certains liens mystérieux, ou du domaine des abstractions, liens expérimentaux, pseudo-expérimentaux, sentimentaux, imaginaires, fantaisistes ; et cette combinaison échappe à l'arbitraire de l'homme, tandis que pour la science expérimentale, le nom est arbitraire.
§ 960. Un excellent exemple du genre de résidus naissant d'une union mystérieuse du nom à la chose, est celui qu'on a dans les nombres dits parfaits ; il démontre clairement le contraste entre les raisonnements logico-expérimentaux et ceux par accord de sentiments. Pour les mathématiciens, parfait est une simple étiquette (§ 119, 963) qui sert à désigner un nombre égal à la somme de ses parties aliquotes. Par exemple, pour 6, ces parties sont: 1, 2,3, et leur somme donne précisément 6. Les nombres parfaits aujourd'hui connus sont : 6, 28, 496, 8128, etc.; ils sont tous pairs ; on ne connaît pas de nombres parfaits impairs. Au lieu de désigner ces nombres par le nom de parfaits, on pourrait employer un autre nom quelconque ; par exemple les appeler imparfaits ; et il n'y aurait rien, absolument rien de changé. La formule d'Euler, qui donne des nombres parfaits, en donnerait d'imparfaits, mais ce seraient de même des nombres égaux à la somme de leurs parties aliquotes. Il n'en est pas ainsi, quand on raisonne avec le sentiment. Alors le nom est d'une grande importance : parfait est le contraire d'imparfait, et le même motif qui fait placer un nombre parmi ceux qui sont parfaits, l'enlève de ceux qui sont imparfaits. D'ailleurs ce que signifie précisément ce nom de parfait, on ne le sait pas avec plus de précision que l'on ne sait ce que veulent dire les noms semblables: juste, bon, vrai, beau, etc. Il semble seulement que tous ces termes sont les épithètes de certains sentiments agréables qu'éprouvent certains hommes. Rapporter tous les discours oiseux des pythagoriciens sur les nombres, serait du temps perdu. Aristote en a bien vu le caractère fantaisiste et arbitraire. À propos de leurs théories des nombres, Aristote [FN: § 960-1] dit : « Et si elles étaient quelque part en défaut, ils les adaptaient de manière à ce que les résultats de leurs études fussent cohérents. Je cite un exemple. Étant donné que la décade semble être parfaite et comprendre toute la nature des nombres, ils disent que les corps célestes doivent être au nombre de dix ; mais comme il n'y en a que neuf de visibles, ils ajoutent l’anti-terre ». Il se peut bien que 10 soit un nombre parfait. Comment pouvons-nous l'affirmer ou le nier, si nous ignorons ce qu'est précisément ce parfait ? Philolaüs ne nous le dit pas plus qu'un autre, mais chante un hymne à la décade [FN: § 960-2]. « Il faut contempler le pouvoir et la nature des nombres, d'après le pouvoir qui se trouve dans la décade. La vertu de la décade est suprême, parfaite, créatrice de toute chose, principe, guide et ordonnatrice de la vie divine, céleste et humaine. Sans elle, tout est sans fin, incertain, obscur ». Il y a monseigneur le nombre quatre, qui est divin, et par lequel on jure, dans les Vers dorés pythagoriciens (v. 45-48). Commentant ces vers, Hiéroclès demande [FN: § 960-3] « Comment le nombre quatre est-il dieu ? »; et il en donne cette raison : « La décade est l'intervalle qui sépare les nombres, puisque celui qui veut compter plus loin [que dix], revient en arrière aux nombres un, deux et trois, et compte la seconde décade, jusqu'à ce qu'il atteigne la vingtaine ; de même pour la troisième décade, jusqu'à ce qu'il atteigne la trentaine ; et l'on procède ainsi de nouveau, jusqu'à ce qu'ayant compté la dixième décade, on arrive à cent. Et de nouveau on compte cent dix, de la même manière. Ainsi l'on peut continuer sans fin, avec l'intervalle de la décade ». En d'autres termes et sans tant de propos oiseux, l'auteur veut dire que 10 est la base de la numération des Grecs. Il continue : « Le nombre quatre est la vertu [la force] de la décade » ; et il en donne pour motif que les nombres 1, 2, 3, 4, additionnés ensemble, donnent la décade. En outre, quatre dépasse l'unité de trois, et il est dépassé aussi de 3 par le nombre 7. Puis on nous dit que « l'unité et le nombre sept ont de très belles et très excellentes propriétés ». Ce cher nombre sept a eu une infinité d'admirateurs, et même à notre époque, l'illustre Auguste Comte. Ainsi sept mérite que nous voyons ce que Hiéroclès pense de lui. « Le nombre sept étant sans mère et vierge, occupe le second rang en dignité, après l'unité [FN: § 960-4] ». Par l'expression « sans mère », on veut dire qu'il n'a pas de facteurs, qu'il est un nombre premier. Par l'expression « vierge », on veut dire qu'aucun multiple de sept n'est compris entre un et dix. Pourquoi ces deux propriétés rendent un nombre plus digne qu'un autre, nous ne le savons pas, de même que nous ignorons ce que peut bien être la dignité d'un nombre. Aux propriétés énoncées, il s'en ajoute d'autres semblables qui, paraît-il, augmentent la noblesse du nombre sept.
Nous renonçons à décrire les belles propriétés que les pythagoriciens trouvaient à d'autres nombres, mais nous ne pouvons passer sous silence le très célèbre nombre trois, qui joue un si grand rôle dans le culte des hommes. Sachez donc que [FN: § 960-5] « comme le disent aussi les pythagoriciens, l'univers et toute chose sont déterminés par le nombre trois, car la fin, le milieu et le commencement constituent le nombre de l'univers : c'est la trinité. Puisque ce nombre est reçu de la Nature selon ses lois, nous l'employons pour célébrer les sacrifices aux dieux ». Suivent d'autres divagations, inutiles à rapporter. Rappelons seulement que « (3) Puisque si toutes les choses, l'univers, le parfait, ne diffèrent pas l'un de l'autre, suivant l'idée, mais seulement par la matière et par les choses auxquelles ou les applique, le corps serait la seule grandeur parfaite, car lui seul est défini par le nombre trois. C'est là le tout ». Quand on rêve, on raisonne peu près ainsi.
Les Grecs appelaient « sacrifice parfait [FN: § 960-6] » celui de trois animaux : un porc, un bélier, un bouc. Il était semblable au suovetaurilia [FN: § 960-7] des Latins, où l'on sacrifiait un porc, un bouc, un taureau. « Le nombre impair plaît aux dieux », dit Virgile ; et le commentaire de Servius nous explique qu'on peut comprendre cela du nombre trois ou d'un autre nombre impair [voir : (FN: § 960 note 8). La sainteté du nombre 333 333 1/3, employé dans les vœux à Rome [FN: § 960 note 9], doit être en rapport avec celle du nombre trois.
Pour éviter des longueurs, nous renonçons à rappeler les nombreuses trinités divines qui régnèrent et qui règnent encore. Nous ne parlerons que d'une seule un peu plus loin (§ 1658), parce qu'elle est née à notre époque : celle des saint-simoniens.
§ 961. Auguste Comte plagie les pythagoriciens et s'approprie leurs divagations. Il accorde au fétichisme d'avoir divinisé les nombres, et parle de [FN: § 961-1] « (p. 129) certaines spéculations numériques, qui, d'abord très saintes sous la spontanéité fétichique, furent ensuite viciées par les mystères métaphysiques. Elles concernent ce qu'on peut justement nommer les propriétés philosophiques ou religieuses des nombres, méconnues de nos docteurs académiques. Leur juste appréciation, réservée à la sociologie, repose sur l'aptitude logique des trois premiers nombres... D'ingénieuses expériences ont démontré que, chez les animaux, la numération distincte cesse au delà de trois. Mais on tenterait vainement d'attribuer à notre espèce un privilège plus étendu. Il faut d'ailleurs, dans les deux cas, considérer seulement la coexistence abstraite, toujours confuse après trois, tandis que la coexistence concrète peut être, de part et d'autre, exactement appréciée au delà, les objets y dispensant des mots. C'est uniquement d'une telle abstraction que dépend le principal caractère philosophique de chaque nombre, vu son attribution logique. En approfondissant ce phénomène intellectuel, on y (p. 130) reconnaît la source des propriétés mentales que j'assignai précédemment aux nombres sacrés, parmi lesquels un représente toute systématisation, deux distingue toujours la combinaison, et trois définit partout la progression ».
Cette métaphysique positiviste est tout à fait identique à la métaphysique sans l'épithète de positiviste. Qui dira pourquoi une combinaison doit toujours être de deux éléments, et ne peut l'être de trois ou d'un plus grand nombre ? Tout cela est puéril. Comme d'habitude, l'auteur s'en tire avec le raisonnement en cercle, en déclarant vicieuse toute combinaison qui n'est pas binaire [FN: § 961-2]. Il est certain que si l'on exclut celles des combinaisons qui ont plus de deux éléments, on peut dire que toutes les combinaisons sont de deux éléments. On voit qu'A. Comte exclut des nombres sacrés celui de quatre, qui est au contraire divin pour les pythagoriciens. En fin de compte, autant vaut le sentiment du positiviste moderne, que celui des philosophes anciens. Personne ne peut dire qui a raison et qui a tort, car il manque un juge pour trancher ce litige, et l'on ne sait même pas ce que veulent dire ici les termes : raison, tort. Après avoir élevé le nombre sept à une très haute dignité, A. Comte veut l'imposer comme base de la numération [FN: § 961-3]. « Formé de deux progressions suivies d'une synthèse, ou d'une progression entre deux couples, le nombre sept, succédant à la somme (les trois nombres sacrés [c'est-à-dire 1, 2, 3], détermine le plus vaste groupe que nous puissions distinctement imaginer. Réciproquement, il pose la limite des divisions que nous pouvons directement concevoir dans une grandeur quelconque [affirmations arbitraires de Comte ; comme tous les métaphysiciens, il ne déduit pas la théorie des faits, mais plie les faits à ses théories]. Un tel privilège (p. 128) doit systématiquement conduire à le prendre pour base de la numération finale, tant concrète qu'abstraite ». Quel rapport y a-t-il entre le fait que 7 est égal à 3 + 3 + 1 ou à 2 + 2 + 2 + 1, et celui d'être choisi comme base de la numération ? Mais l'adverbe systématiquement sauve tout. De la même façon, la vraie liberté s'oppose à la liberté sans épithète (§ 1554 et sv.).
Mais il y a encore d'autres bonnes raisons. « (p. 128) Il faut que cette base soit un nombre premier [c'est ce que dit le souverain pontife du positivisme ; les mathématiciens disent au contraire que le nombre qui a le plus de facteurs est préférable, et que par conséquent, 12 serait préférable à 10], surtout en vertu du besoin général d'irréductibilité [il n'est pas si général, puisque beaucoup de peuples ont choisi 10], mais aussi d'après l'avantage spécial d'une pleine périodicité dans les transformations fractionnaires ».
§ 962. Les auteurs israélites et les auteurs chrétiens devaient éprouver un grand respect pour les nombres six et sept, à cause du temps employé pour la création. Philon le Juif, qui reproduit plusieurs divagations pythagoriciennes sur les nombres, dit [FN: § 962-1] : « Puisque le monde entier a été achevé suivant la nature parfaite du nombre six, le Père honorait le septième jour qui suivait, en le louant et en l'appelant saint ; car ce n'est pas fête seulement pour un seul peuple ou pour une seule contrée, mais pour l'univers ; et cette fête est digne d'être seule appelée populaire et jour de naissance du monde [FN: § 962-2]. Je ne sais qui pourrait assez célébrer la nature du nombre sept, car elle dépasse tout ce que l'on peut exprimer ». Mais il tâche au moins de noter beaucoup de belles propriétés de ce saint nombre. Il revient plusieurs fois sur ce sujet très important. Dans le Commentaire allégorique des saintes lois, il commence par louer le nombre six [FN: § 962-3]. Il serait absurde de croire que le monde est né en six jours, puisque le temps ne peut être antérieur au monde ; donc, par l'expression six jours, on doit entendre, non un espace de temps, mais un nombre parfait. Le nombre six est parfait, car il est le premier qui soit égal à la somme de ses facteurs ; en outre, il est le produit de deux facteurs inégaux (2 x 3). Suit une explication d'une beauté transcendante... pour qui la comprend. « Le deux et le trois ont dépassé un, qui est la nature incorporelle ; le deux est l'image de la matière, comme elle, divisé et coupé ; le trois est l'image du corps solide, puisque le solide a trois dimensions ». Puis on trouve d'autres belles propriétés du nombre six, dans les corps vivants. Ceux-ci se meuvent dans six directions ; et il faut savoir que Moïse [FN: § 962-4] « fait correspondre les choses mortelles au nombre six, les immortelles et les bienheureuses, à sept ». Ajoutons que la bonne dame qui s'appelle la Nature aime le nombre sept et s'en réjouit [FN: § 962-5]. Mais trêve désormais à ces discours de Philon ; celui qui en voudrait davantage n'aurait qu'à lire les œuvres de cet auteur [FN: § 962-6].
§ 963. Saint Augustin se demande si l'on doit prendre à la lettre les six jours de la Genèse ; mais il n'a aucun doute sur la perfection du nombre six [FN: § 963-1]. « Nous disons ce nombre six parfait, parce qu'il est la somme de ses parties, qui, rien qu'en les multipliant, peuvent reproduire le nombre dont elles sont une partie ». C'est-à-dire que ces parties sont les facteurs de six. On voit très bien ici la différence entre les définitions de la science logico-expérimentale et les théories du sentiment. Six est égal à la somme de ses facteurs, c'est-à-dire de 1, 2, 3. C'est là un fait expérimental. Les mathématiciens mettent une étiquette (§ 119, 963) sur les nombres qui ont cette propriété. Sur cette étiquette, ils écrivent nombre parfait ; mais ils pourraient tout aussi bien écrire : nombre imparfait ou un autre nom quelconque. Ceux qui raisonnent par accord de sentiments font de cette définition un théorème. Le sentiment qu'ils ont du parfait concorde, on ne sait pourquoi, avec le sentiment qui naît en eux de l'idée qu'un nombre est égal à la somme de ses facteurs ; donc un tel nombre est parfait, et six étant un nombre de ce genre, est parfait. Mais en vérité, le raisonnement par accord de sentiments n'est pas si rigoureux. Il y a une masse confuse de sentiments issus de la considération du nombre six, et qui sont grosso modo d'accord avec l'autre masse indéterminée, de sentiments qu'engendre la considération du mot parfait. Ce dernier ensemble de sentiments s'accorde également bien, suivant les individus, avec l'ensemble issu d'autres nombres, par exemple de quatre, de dix, etc. Étant donnée la définition des mathématiciens, du nombre parfait, dix, n'est pas un nombre parfait ; mais d'après le sentiment, il peut fort bien l'être, car ce mot parfait désigne une chose indéterminée (§ 509).
D'après le raisonnement logico-expérimental, il serait ridicule de dire : « Six est égal à la somme de ses facteurs ; donc Dieu devait créer le monde en six jours ». Il n'y a pas de rapport entre les prémisses et la conclusion. Mais, au contraire, le raisonnement par accord de sentiments crée ce rapport, grâce au terme parfait, qu'il élimine ensuite, selon un procédé général (§ 480). « Le nombre six est parfait ; la création est parfaite ; donc elle doit avoir été accomplie en six jours ». Saint Augustin le dit clairement [FN: § 963-2] (2) : « En un nombre parfait, c'est-à-dire en six jours, Dieu accomplit l'œuvre qu'il fit ». [Voir Addition A21 par l’auteur]
§ 964. Il paraîtra peut-être que nous avons parlé trop longuement de ces extravagances, et il en serait bien ainsi si l'on voulait les envisager au point de vue objectif, c'est-à-dire logico-expérimental ; mais si on les considère au point de vue subjectif, et qu'on fasse attention qu'elles ont été propres à un nombre immense de personnes, en tout temps, on verra qu'elles doivent correspondre à des sentiments diffus et puissants, qui, par conséquent, ne peuvent être négligés dans une étude des formes sociales [FN: § 964-1].
§ 965. L'étude que nous venons d'accomplir a les buts suivants :
1° Citer un nouvel exemple de la partie constante (résidus) et de la partie variable (dérivations) des phénomènes. Mais nous en avons déjà donné tant d'exemples, qu'on aurait pu négliger celui-ci. La partie constante est ici un sentiment qui lie mystérieusement la perfection aux nombres. Le nombre auquel on assigne cet attribut varie suivant les inclinations du sujet, et les motifs fantaisistes de cette perfection varient encore davantage.
2° Citer un exemple remarquable de raisonnements par accord de sentiments, c'est-à-dire un exemple de dérivations. À ce point de vue, nous aurions dû placer cette étude au chapitre IX ; mais pour éviter de nous répéter, il est mieux d'en traiter ici. Le raisonnement sur les nombres parfaits est entièrement semblable à celui sur le droit naturel, sur la solidarité, etc.; et des hommes comme Saint Augustin le tenaient pour non moins solide, et même pour plus solide que d'autres raisonnements par accord de sentiments. Mais parmi les hommes de notre temps, il sera facile d'en trouver qui l'estiment absurde, tandis qu'ils tiennent les autres pour bons ; c'est pourquoi ces personnes comprendront les considérations générales sur les nombres parfaits, plus facilement que celles sur le droit naturel ou la solidarité. Tel est le principal but dans lequel nous nous sommes arrêtés sur ce sujet.
3°Montrer, par un bon exemple, la différence tant de fois notée, entre les définitions de la science logico-expérimentale et les affirmations métaphysiques, théologiques, sentimentales. Les personnes qui continuent à rechercher si une chose est juste, bonne, etc., ne s'aperçoivent pas que cette recherche diffère peu ou pas du tout de celle qui tend à découvrir si un nombre est parfait (§ 119, 387, 506, 963).
4° Opposer la précision des sciences logico-expérimentales à l'indétermination des recherches métaphysiques, théologiques, sentimentales. Ce contraste est semblable à celui que nous venons de voir, entre la conception que les mathématiciens ont de certains nombres, auxquels ils donnent arbitrairement le nom de parfaits, et l'idée de ceux qui approprient sentimentalement cette épithète à un nombre qu'ils ont en prédilection.
Au point de vue des buts 2°, 3°, 4°, nous venons de traiter longuement des nombres parfaits ; cela nous permettra d'être plus bref pour d'autres exemples analogues.
5° Citer un exemple où les actions non-logiques ne paraissent avoir aucune utilité sociale. Les actions non-logiques qui correspondent aux élucubrations du droit naturel, paraissent souvent avoir, et ont parfois effectivement une utilité sociale ; ce qui ne permet pas de voir si facilement leur absolue vanité logico-expérimentale.
§ 966. (I-δ) Besoin d'unir les résidus. Souvent l'homme éprouve le besoin d'unir certains résidus qui existent dans son esprit. C'est une manifestation de l'inclination synthétique, qui est indispensable, en pratique. Séparer ces résidus par l'analyse est une opération scientifique dont peu d'hommes sont capables. On peut le vérifier facilement. Demandez à une personne qui n'a pas l'habitude du raisonnement scientifique – et parfois même à qui a cette habitude ou devrait l'avoir – de résoudre la question: « A est-il B ? » ; et vous verrez qu'elle sera entraînée presque irrésistiblement à envisager en même temps, sans les séparer le moins du monde, d'autres questions comme : « Est-il utile que A soit B ? Est-il utile qu'on croie que A est B ? Est-ce d'accord avec le sentiment de certaines personnes, que A soit B ? » Ou bien : « Cela heurte-t-il quelque sentiment ? etc. ». Par exemple, un grand nombre de personnes ne sauraient se résoudre à envisager séparément la question : « L'homme qui suit les règles de la morale obtiendra-t-il le bien-être matériel ? » (§ 1898 et sv.).
§ 967. L'homme répugne à séparer la foi de l'expérience : il veut un tout complet, où il n'y ait pas de notes discordantes. Pendant bien des années, les chrétiens crurent que leur Écriture Sainte ne contenait rien qui fût contraire à l'expérience historique ou scientifique. Une partie d'entre eux a maintenant abandonné cette idée quant aux sciences naturelles, mais la conserve à l'égard de l'histoire. Une partie abandonne la science et l'histoire, mais veut au moins conserver la « morale ». Une partie veut qu'on obtienne l'accord tant désiré, sinon à la lettre, du moins allégoriquement, par de subtiles interprétations. Les musulmans sont persuadés que tout ce que l'homme peut savoir est contenu dans le Coran. Pour les anciens Grecs, l'autorité d'Homère était souveraine. Celle de Marx l'est ou l'était aussi pour certains socialistes. Une infinité de sentiments de bonheur se mélangent en un tout harmonieux, dans le Saint Progrès et la Sainte Démocratie des peuples modernes.
§ 968. Les Épicuriens séparaient entièrement les résidus correspondant aux divinités, des résidus d'un autre genre ; mais c'est là un cas unique ou très rare. En général, dans la conception des divinités, se confondent des résidus de nombreux genres. Un tel mouvement d'agrégation persiste parmi les différentes divinités, et constitue l'une des principales forces qui font passer du polythéisme au monothéisme.
§ 969. Le besoin d'unir les résidus a une grande part dans l'emploi que les hommes font de certains mots au sens complètement indéterminé, mais qu'ils croient correspondre à des choses réelles (§ 963). Par exemple, tous les hommes comprennent le terme bon ou son analogue bien, et croient qu'ils représentent une chose réelle. On appelle bon ce qui plaît au goût ; puis, étendant le cercle des sensations, ce qui plaît au goût et profite à la santé ; puis seulement ce qui profite à la santé. On étend à nouveau le cercle des sensations ; on y comprend des sensations morales, et celles-ci dominent le bon et le bien. Enfin, chez les philosophes et surtout les moralistes, on ne tient compte que des sensations morales. En résumé, ces termes reviennent à désigner un ensemble de résidus, pour lequel l'individu qui emploie le terme éprouve de l'attraction, ne ressent aucune répugnance.
§ 970. Le besoin d'unir des résidus persiste chez les intellectuels. On met ensemble le bien, le bon, le beau, le vrai, et il y en a même qui ajoutent l'humain, ou mieux le largement humain, l'altruisme, la solidarité, en en formant un ensemble qui chatouille agréablement leur sentimentalité. Cet ensemble ou un autre semblable, né d'un besoin de combinaisons, peut ensuite, grâce aux résidus de la permanence des agrégats, acquérir une existence indépendante, et même, en certains cas, être personnifié. [FN: § 970-1]
§ 971. Parmi les différences qui existent entre une œuvre scientifique et une œuvre littéraire, il ne faut pas négliger que la première sépare les résidus unis par la seconde. Celle-ci satisfait donc le besoin d'unir les résidus ; besoin laissé inassouvi par celle-là. Quant au besoin de logique, dont nous parlerons bientôt, il semblerait qu'il devrait être mieux satisfait par l'œuvre scientifique que par l'œuvre littéraire, et cela peut avoir lieu, en certains cas, mais ne se produit pas pour le plus grand nombre des hommes, parce qu'ils se contentent pleinement de la pseudo-logique de l'œuvre littéraire, qu'ils comprennent et goûtent beaucoup mieux que la logique précise et rigoureuse de la méthode expérimentale. C'est pourquoi enfin, si l'œuvre scientifique peut convaincre quelques personnes compétentes en la matière, l'œuvre littéraire persuade toujours mieux le plus grand nombre des hommes. C'est là une des si nombreuses causes pour lesquelles l'économie politique est demeurée en grande partie littéraire ; et il est bon qu'elle demeure en cet état, pour ceux qui veulent prêcher, mais non pour ceux qui veulent trouver les uniformités des phénomènes (§ 77).
§ 972. (I-ε) Besoin de développements logiques. Ce genre pourrait être considéré comme une espèce du précédent ; car il unit à d'autres résidus celui du besoin de raisonnement. Mais sa grande importance engage à en faire un genre à part. Le besoin de logique est satisfait, tant par une logique rigoureuse que par une pseudo-logique. Au fond, les hommes veulent raisonner ; que ce soit bien ou mal, peu importe. Qu'on remarque à quelles discussions fantaisistes ont donné lieu et donnent encore lieu des sujets incompréhensibles, comme les diverses théologies, les métaphysiques, les divagations sur la création du monde, sur la fin de l'homme, et l'on aura une idée de la prédominance du besoin satisfait par ces productions.
§ 973. Ceux qui ont proclamé «la faillite de la Science [FN: § 973-1] » avaient raison, dans ce sens que la science ne peut satisfaire le besoin infini de développements pseudo-logiques, éprouvé par l'homme. La science ne peut que mettre en rapport un fait avec un autre, et par conséquent c'est toujours à un fait qu'elle s'arrête. La fantaisie humaine veut passer outre, veut raisonner encore sur ce dernier fait, veut connaître la « cause », et si elle n'en trouve pas une réelle, elle en invente une imaginaire.
§ 974. On remarquera que c'est justement ce besoin de chercher des causes quelconques, réelles ou imaginaires, qui, s'il a créé de toutes pièces les imaginaires, a fait trouver les réelles. En ce qui concerne les résidus, la science expérimentale, la théologie, la métaphysique, les divagations sur l'origine et sur la fin des choses, ont un point de départ commun, qui est le désir de ne pas s'arrêter à la dernière cause des faits, laquelle nous est connue, mais de remonter plus haut, de raisonner sur elle, de trouver ou d'imaginer quelque chose d'autre, au delà de cette limite. Les peuples sauvages dédaignent les élucubrations métaphysiques des peuples civilisés, mais sont de même étrangers à leurs recherches scientifiques ; et celui qui affirmerait que sans la théologie et la métaphysique, la science expérimentale n'existerait pas non plus, se placerait dans des conditions telles qu'on ne pourrait pas facilement le réfuter. Ces trois genres d'activité sont probablement la manifestation d'un certain état psychique, et si cet état disparaît, ces genres d'activité font aussi défaut.
§ 975. Ici nous ne parlerons pas davantage de ce genre de résidus, parce qu'il en est longuement traité dans tout l'ouvrage. C'est de lui que provient le besoin de recouvrir les actions non-logiques d'un vernis logique, et nous nous sommes souvent et abondamment entretenus de ce sujet. C'est de lui aussi que provient la partie des phénomènes que nous avons désignée par (b), et qui constitue les dérivations, dont nous aurons à nous occuper aux chapitres IX et X. Elles ont habituellement pour but de satisfaire par une pseudo-logique le besoin de logique et de raisonnement que l'homme éprouve.
§ 976. (I-ζ) Foi en l'efficacité des combinaisons. Comme nous l'avons déjà noté (§ 890), on peut croire que A est nécessairement uni à B. Cette croyance peut naître de l'expérience, c'est-à-dire de l'observation constante que A est uni à B. D'ailleurs la science logico-expérimentale en déduit seulement qu'avec une probabilité plus ou moins grande, A sera toujours uni à B (§ 97). Pour donner le caractère de nécessité à cette proposition, il faut y ajouter quelque chose de non-expérimental, un acte de foi.
§ 977. Cela posé, si l'invention était identique à la démonstration [FN: § 977-1], le savant, dans son laboratoire, observerait les combinaisons AB, sans aucune idée préconçue ; mais il n'en est pas ainsi. Quand il cherche, invente, il se laisse guider par des suppositions, par des idées préconçues, peut-être même par des préjugés. Cela n'a pas d'inconvénients, car l'expérience viendra corriger ce que ces sentiments renfermeront d'erroné.
§ 978. Chez l'homme qui n'a pas l'habitude de la méthode logico-expérimentale, les parties sont interverties : les sentiments jouent le rôle prépondérant ; l'homme est mu surtout par la foi en l'efficacité des combinaisons. Souvent il ne se soucie pas de vérifications expérimentales ; souvent encore, quand il s'en préoccupe, il se contente de preuves absolument insuffisantes, parfois même ridicules.
§ 979. Ces idées sont souveraines, dans l'esprit du plus grand nombre des hommes ; c'est pourquoi il arrive précisément qu'elles étendent leur domination même à l'esprit des savants ; ce qui arrivera d'autant plus facilement que le savant, en étudiant sa science, sera plus en contact avec le reste de la population, et d'autant moins que les élucubrations de ses sentiments viendront se heurter à l'expérience. Tel est la cause pour laquelle celui qui étudie les sciences sociales éprouve des difficultés bien plus grandes, à suivre la méthode logico-expérimentale, que celui qui étudie une science comme la chimie ou la physique.
§ 980. Laissons maintenant de côté les sciences logico-expérimentales, et traitons des phénomènes, au point de vue des sentiments et des résidus. Si la combinaison AB n'est pas un fait de laboratoire, mais un fait de la vie courante, elle engendre à la longue, dans l'esprit de l'homme, un sentiment qui unit indissolublement A à B ; et l'on a de la peine à distinguer ce sentiment d'un autre, qui ait une origine étrangère à l'expérience ou pseudo-expérimentale.
§ 981. Quand on met un coq avec des poules, des œufs de celles-ci naissent des poussins. Quand un coq chante à minuit dans une maison, quelqu'un y meurt. Pour qui raisonne avec le sentiment, ces deux propositions sont également certaines, et même également expérimentales ; et le sentiment qui les dicte naît également d'expériences directes et d'expériences indirectes, rapportées par une autre personne. Si l'on objecte qu'il est arrivé d'entendre chanter un coq à minuit, sans que quelqu'un mourût, on peut répondre qu'il arrive souvent que d'un oeuf d'une poule vivant avec un coq ne naisse aucun poussin. L'homme de science sépare les deux phénomènes, non seulement par l'expérience directe, mais encore par l'assimilation (§ 556). Le vulgaire ne peut faire cela ; et quand il déclare que l'annonce de la mort par le chant du coq est un absurde préjugé, il n'a pas du tout des raisons meilleures que lorsqu'il le tenait pour une vérité indiscutable.
§ 982. En général, l'ignorant est guidé par la foi en l'efficacité des combinaisons (§ 78), maintenue vive par le fait que beaucoup sont vraiment efficaces ; mais cette foi naît en lui spontanément, comme on peut bien le voir chez l'enfant qui s'amuse à tenter les plus étranges combinaisons. L'ignorant distingue peu ou ne distingue pas du tout les combinaisons efficaces, des non-efficaces ; il joue les numéros du loto, correspondant à ses songes, de la même foi avec laquelle il se rend à la gare, à l'heure indiquée par l'horaire ; il consulte la somnambule ou le charlatan, comme il consulterait le médecin le plus éminent. Caton l'Ancien expose avec la même foi les remèdes magiques et les opérations agricoles.
§ 983. Quand la science expérimentale progresse, on veut donner une apparence expérimentale aux produits du sentiment, et l'on affirme que la foi aux combinaisons est due à l'expérience ; mais il suffit d'examiner les phénomènes d'un peu près, pour reconnaître combien cette explication est peu fondée.
§ 984. Si les préjugés ont aujourd'hui diminué chez le vulgaire, cela n'est pas arrivé sous l'influence directe des sciences expérimentales, mais en partie sous une influence indirecte ; c'est-à-dire par l'autorité de ceux qui cultivent ces sciences, et qui pourtant ont introduit quelques préjugés nouveaux ; en partie de même grâce à l'énorme accroissement de la vie industrielle, qui est aussi une vie expérimentale, et qui est venue heurter, fût-ce indirectement et sans qu'on en ait conscience, le préjugé du sentiment.
§ 985. La croyance que A doit nécessairement être uni à B se renforce et devient stable, grâce aux résidus de la persistance des agrégats. Précisément parce qu'elle a son origine dans les sentiments, elle tient de ceux-ci l'indétermination qui leur est propre, et souvent A et B ne sont pas des choses ou des actes déterminés, mais des classes de choses ou d'actes, qui, suivant l'habitude, correspondent aux genres (β) et (γ) [FN: § 985-1]. Par conséquent, une chose A est unie à une chose B quelconque, pourvu qu'elle lui soit semblable ou contraire, qu'elle soit exceptionnelle, terrible, heureuse, etc. Une comète annonce la mort d'un grand personnage, mais on ne sait pas précisément qui c'est.
§ 986. Quelle que soit l'origine expérimentale, pseudo-expérimentale, sentimentale, fantaisiste on autre, de la croyance que A est uni à B, celle-ci, quand elle existe et qu'elle est rendue stable, grâce à la persistance des agrégats, agit fortement sur les sentiments et sur les actions. Cela se produit en deux sens : passif et actif (§ 890 et sv.).
§ 987. Dans le sens passif, si l'on observe un élément de la combinaison AB, on éprouve du malaise, quand on n'observe pas la combinaison entière. Si donc B est postérieur à A, quand on observe A, on attend B (comètes et événements annoncés par elles ; présages en général). Quand on observe B, on est persuadé qu'il a dû être précédé de A, et l'on fouille tellement dans le passé, qu'on finit par trouver un A qui lui correspond [FN: § 987-1] (faits qu'on suppose avoir présagé la puissance impériale aux futurs empereurs romains). Enfin, si A et B sont également dans le passé, on les accouple ensemble, même s'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre (présages racontés par les historiens, quand ils ne sont pas inventés de toute pièce).
§ 988. Il est à noter que souvent B demeure indéterminé ou déterminé seulement par le fait qu'il doit appartenir à une certaine classe. Il doit se passer quelque chose ; mais on ne sait pas précisément quoi (§ 925). La persistance des agrégats a fait que la combinaison AB s'est acquis une personnalité propre, indépendante de B, en de certaines limites.
§ 989. Dans le sens actif, on est persuadé qu'en produisant A, on suscite B. La science passive de la divination (§ 924) devient ainsi la science active de la magie. Les Romains avaient introduit un élément actif dans la divination, avec l'art d'accepter ou de rejeter les présages. Toutes les combinaisons ne se prêtent pas à cette transformation. D'abord, sont naturellement exclues les combinaisons dans lesquelles A n'est pas au pouvoir de l'homme, comme le tonnerre ou l'apparition des comètes ; mais, même quand A est au pouvoir de l'homme, il y a des cas dans lesquels on ne croit pas qu'en l'employant on fasse naître B. Un être surhumain naît d'une vierge ; mais on ne croit pas qu'avec une vierge on puisse provoquer cette naissance. Il fallut trois nuits ou plus pour engendrer Hercule ; mais on ne croit pas que celui qui a des rapports continus avec une femme pendant cet espace de temps, puisse s'attendre à avoir un fils semblable à Hercule. Il y a ensuite des cas dans lesquels on trouve un mélange de partie passive et de partie active ; par exemple, les paroles de bon augure. Si on les entend par hasard, elles présagent un événement heureux ; et il est bon de les faire entendre volontairement pour faciliter la venue de cet événement ; et vice-versa pour les paroles de mauvais augure.
§ 990. En général, on peut dire que l'idée de l'efficacité de A pour provoquer B, ajoute quelque chose à la simple idée de l'union AB.
Ce serait ici le lieu de traiter de la magie et d'autres pratiques analogues ; mais cette étude, faite en détail, doit être renvoyée à la sociologie spéciale.
§ 991. IIe CLASSE. Persistance des agrégats. Certaines combinaisons constituent un agrégat de parties étroitement unies, comme en un seul corps, qui finit, de la sorte, par acquérir une personnalité semblable à celle des êtres réels. On peut souvent reconnaître ces combinaisons à leur caractère d'avoir un nom propre et distinct de la simple énumération des parties. L'existence de ce nom contribue ensuite à donner une plus grande consistance à l'idée de la personnalité de l'agrégat (§ 1013), à cause du résidu d'après lequel à un nom correspond une chose (chapitre X). Les sentiments correspondant à l'agrégat peuvent demeurer presque constants, et peuvent aussi varier en intensité et en extension. Il faut tenir cette variation séparée de l'autre, beaucoup plus grande, des formes sous lesquelles ces sentiments se manifestent, c'est-à-dire de la variation des dérivations. En somme, on a un noyau avec une personnalité propre, mais qui peut se développer, comme le poussin qui devient poule ou la chenille qui devient papillon ; puis on a, sous forme de dérivation, les manifestations de ce noyau, comme seraient les actions variées et capricieuses de l'animal.
§ 992. Après que l'agrégat a été constitué, un certain instinct agit souvent ; avec une force variable, il s'oppose à ce que les choses ainsi unies se séparent, et si la séparation ne peut être évitée, il tâche de la dissimuler, en conservant le simulacre de l'agrégat. On peut, grosso modo, comparer cet instinct à l'inertie mécanique. Il s'oppose au mouvement donné par d'autres instincts. De là naît la grande importance sociale des résidus de la IIe classe.
§ 993. Des combinaisons qui disparaissent aussitôt qu'elles sont formées ne constituent pas un agrégat ayant une existence propre. Mais si elles persistent, elles finissent par acquérir ce caractère ; et ce n'est pas seulement par abstraction qu'elles revêtent une espèce de personnalité, comme ce n'est pas seulement par abstraction que nous connaissons un ensemble de sensations du nom de faim, de colère, d'amour, et un ensemble de fourmis, du nom de fourmilière. Il est nécessaire de bien saisir cela. Il n'y a pas de chose correspondant au nom de troupeau, en ce sens qu'on ne peut séparer le troupeau des moutons qui le constituent ; mais le troupeau n'est pas égal à la simple somme des moutons. Ceux-ci, par le seul fait qu'ils sont réunis, acquièrent des propriétés qu'ils n'auraient pas, s'ils n'étaient pas réunis. Un mâle et une femelle, mis ensemble à l'âge de la reproduction, sont quelque chose de différent du même mâle et de la même femelle, séparés. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait une entité X, distincte du mâle et de la femelle, et qui représente le mâle accouplé avec la femelle.
§ 994. À ces considérations, il faut en ajouter une autre, rappelée bien des fois déjà ; c'est-à-dire que si l'abstraction correspondant à l'agrégat n'a pas d'existence objective, elle peut avoir une existence subjective ; et cette circonstance est importante pour l'équilibre social. Un exemple éclairera la chose. Supposons qu'on ait observé que certains hommes se sont fait d'un fleuve une divinité. Ce fait peut être expliqué de bien des façons. (a) On peut dire que, du fleuve concret, ces hommes ont séparé par abstraction un fleuve idéal qu'ils considèrent comme une « force de la nature » et qu'ils adorent comme telle. (b) On peut dire que l'on a attribué au fleuve une ressemblance humaine, que, comme à un homme, on lui suppose une âme, et que cette âme a été divinisée. (c) On peut dire que ce fleuve a fait naître chez les hommes diverses sensations mal définies, au moins en partie, et très puissantes. Ces sensations persistent, et leur ensemble constitue, pour le sujet, une chose à laquelle il donne un nom, comme à toutes les autres choses subjectives qui sont remarquables. Cette entité, avec son nom, est attirée par d'autres entités semblables, et peut prendre place dans le panthéon du peuple considéré, comme elle peut prendre place auprès du drapeau dans l'agrégat patriotique (le Rhin allemand), ou bien, plus modestement, dans le bagage des poètes. On ne peut exclure aucune de ces trois formes de phénomènes ; mais la troisième explique plusieurs faits qui ne sont pas expliqués par les deux premières, et qui, parfois même, sont en contradiction avec elles. Le résidu auquel correspond la troisième hypothèse est par conséquent beaucoup plus usité que les deux autres.
§ 995. Nous avons déjà rencontré ces faits, en parlant des dieux de l'ancienne Rome (§ 176 et sv.), et nous avons vu qu'ils correspondaient à certaines associations d'actes et d'idées. Maintenant, nous poussons un peu plus loin l'analyse, et nous voyons des résidus de la Ire classe devenir persistants, grâce aux résidus de la IIe classe. Ce culte est un fétichisme, dans lequel le fétiche n'est pas une chose, mais un acte. Si nous voulions l'expliquer par les hypothèses (a) ou (b), nous ne réussirions pas à comprendre comment les Romains, dont l'esprit était incontestablement plus pratique, moins subtil, moins ingénieux que celui des Grecs, ont pu mettre au jour tant d'abstractions, voir partout tant de « forces de la nature », tandis qu'ils n'avaient peut-être pas même une idée correspondant à ce terme, et se montrer ainsi beaucoup plus idéalistes que les Grecs. Il semble plutôt qu'il aurait dû arriver le contraire. Avec l'hypothèse (c), les faits s'expliquent très facilement. Les résidus de la IIe classe étaient beaucoup plus puissants chez les Romains que chez les Grecs. Nous en avons donné des preuves au chapitre II. Il devait donc arriver – et il est arrivé – qu'un plus grand nombre d'agrégats acquissent une existence individuelle; et ce sont justement ces agrégats qu'ensuite des raisonneurs beaucoup plus subtils que le peuple fruste où ces ensembles se formèrent, ont pris pour des « personnifications des forces de la nature ».
§ 996. On possède des inscriptions consacrées à la déesse Annona [FN: § 996-1]. Il semble difficile que les Romains aient, par abstraction, personnifié l'approvisionnement de Rome, pour élever ensuite cette personnification aux honneurs de la divinité. Au contraire, on voit facilement comment les sensations provoquées par les besoins de cet approvisionnement important et difficile, étaient fortes et profondes. Elles constituèrent un agrégat qui, en persistant, acquit une personnalité propre et devint une chose. Celle-ci, avec son nom d'Annona, alla ensuite rejoindre un grand nombre d'autres compagnes dans le panthéon romain.
§ 997. L'Annona n'a pas d'existence objective, mais bien subjective. Si, au temps de la Rome antique, on avait eu l'idée de faire des pseudo-expériences religieuses, comme on en fait maintenant, on aurait trouvé dans l'esprit des Romains la déesse Annona avec ses compagnes et ses compagnons. Cela aurait prouvé que, dans l'esprit des Romains, existaient, sous ces noms, certains agrégats de sentiments et d'idées, mais n'aurait nullement démontré l'existence objective de ces agrégats. En un certain sens, si l'on veut user du langage poétique, on peut dire que ces agrégats étaient vivants dans la conscience des Romains ; mais on ne peut pas dire qu'ils prissent vie hors de cette conscience [FN: § 997-1].
§ 998. Les phénomènes de ce genre diffèrent d'autant plus qu'ils s'éloignent davantage des résidus. Chez les Romains, justement à cause de leur peu de goût pour les spéculations théologiques et philosophiques, on reste très près des résidus. Chez les Grecs, grâce à leur tendance à ces spéculations, on s'éloigne passablement des résidus avec les dérivations ; et l'une de ces dérivations nous donne l'anthropomorphisme des dieux de la Grèce ; ce qui explique le fait que les dieux de la Grèce sont beaucoup plus vivants que les dieux des Romains (§ 178).
§ 999. L'apothéose des empereurs romains, envisagée au point de vue logique, est absurde et ridicule; mais, considérée comme la manifestation de la permanence des résidus, elle apparaît naturelle et raisonnable. L'empereur, quel qu'il fût, personnifiait l'empire, l'administration régulière, la justice, la paix romaine, et ces sentiments ne disparaissaient pas le moins du monde, parce qu'un homme mourait, et qu'un autre prenait sa place. La permanence de cet agrégat était le fait ; l'apothéose avec l'approbation du Sénat une des formes sous lesquelles elle se manifestait.
§ 1000. Des considérations analogues s'appliquent à beaucoup d'autres cas de déification des hommes. La chose ne s'est pas produite comme se l'imagine H. Spencer, par l'effet d'une analyse logique (§ 684 et sv.). Elle n'est autre que l'une des très nombreuses manifestations de la permanence des agrégats. Nous verrons plus loin (§ 1074-1) que d'abord Rome est divinisée, et qu'ensuite on imagine une femme qui a eu ce nom et qui ainsi a été déifiée. Il y a un très grand nombre d'exemples semblables. Parfois, d'un dieu, on remonte à un homme imaginaire, et parfois encore d'un homme réel on va à un dieu. Tout cela constitue des dérivations essentiellement variables, tandis que les sentiments qui se manifestent de cette manière sont constants.
§ 1001. On a observé qu'il y a des usages qui subsistent après que les causes dont ils tirent leur origine ont disparu. Ce phénomène a reçu le nom de survivance, à vrai dire non en général, mais dans un cas particulier. Tylor dit [FN: § 1001-1] : « Quand un usage, un art, une opinion, a fait, à son heure, son entrée dans le monde, des influences contraires peuvent, pendant longtemps, le combattre si faiblement que son cours ne s'en poursuit pas moins d'âge en âge... » L'auteur donne à ce phénomène le nom de survivance ; mais c'est un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général. La persistance d'un usage peut être due au fait qu'il a été faiblement contrarié ; mais elle peut aussi être due au fait que cet usage a été secondé par une force supérieure à celle, pourtant très considérable, qui lui était contraire. C'est ainsi que l'Église chrétienne a certainement combattu de tout son pouvoir les « superstitions » païennes, mais avec des chances diverses : une partie ont été vaincues, ont disparu ; une partie n'ont pu être vaincues, ont subsisté. Quand l'Église s'est aperçue que la résistance était trop forte, elle a fini par transiger et par se contenter de donner une couleur nouvelle, souvent assez transparente, à une antique superstition.
§ 1002. Dans ces phénomènes, on voit clairement l'existence des résidus constitués par la persistance des agrégats ; mais nous pouvons avoir plus et mieux que cette simple observation ; c'est-à-dire que nous pouvons expliquer de nombreux faits. Mgr Duchesne dit [FN: § 1002-1] : «(p. 293) Les litanies sont des supplications solennelles, instituées pour appeler la protection céleste sur les biens de la terre. On les faisait au printemps, dans la saison des gelées tardives, si redoutées des laboureurs. Il ne faut pas s'étonner que, sur ce point, le christianisme se soit rencontré avec des usages religieux antérieurs à lui ». Le christianisme ne s'est pas « rencontré » ; il a dû se résigner à accepter certains usages ; ce qui est bien différent. «(p. 293) Les mêmes besoins, le même (p. 294) sentiment de certains dangers, la même confiance dans un secours divin, ont inspiré des rites assez semblables ». Il semblerait presque que la religion païenne et la religion chrétienne, agissant chacune pour son propre compte, indépendamment, se sont rencontrées par hasard, ou ont été poussées par des raisons analogues, pour instituer la même fête. On pourrait peut-être l'admettre d'une façon générale ; mais cela perd toute probabilité dans le présent cas, si l'on considère que les deux religions n'étaient pas du tout indépendantes, que la nouvelle se superposa à l'ancienne, et que les détails des fêtes sont identiques. Comme l'observe encore Mgr Duchesne lui-même : « (p. 294) À Rome, le jour consacré était le 25 avril, date traditionnelle, à laquelle les anciens Romains célébraient la fête des Robigalia. De celle-ci, le rite principal était une procession qui, sortant de la ville par la porte Flaminienne, se dirigeait vers le pont Milvius... La procession chrétienne qui lui fut substituée suivait le même parcours jusqu'au pont Milvius».
§ 1003. Il convient de remarquer qu'en d'autres cas, l'Église opposa une résistance plus grande et plus efficace à la persistance des anciens usages. Elle pourvut à ce que la Pâque chrétienne n'eût pas la même date que la Pâque israëlite ; elle s'efforça d'empêcher que l'on continuât à célébrer la fête païenne du 1er janvier, et arriva partiellement à ses fins, en y substituant la fête de Noël. Il est donc probable que, si elle avait pu, elle aurait aussi transporté à un autre jour la fête des Rogations.
§ 1004. Le même auteur, que nous citons justement parce qu'il n'est pas suspect d'hostilité à l'égard de l'Église catholique, nous fait connaître d'autres exemples.
« (p. 283) Le même calendrier [le calendrier philocalien] de l'année 336 contient, au 22 février, une fête intitulée Natale Petri de (p. 284) cathedra. Elle avait pour but de solenniser le souvenir de l'inauguration de l'épiscopat ou de l'apostolat de saint Pierre... Le choix du jour n'avait été dicté par aucune tradition chrétienne. Il suffit de jeter les yeux sur les anciens calendriers de la religion romaine (MOMMSEN, C. I. L. t. , p. 386) pour voir que le 22 février était consacré à une fête populaire entre toutes, celle des défunts de chaque famille. L'observation de cette fête et des [sic, probablement les ] rites qui l'accompagnaient étaient considérés comme incompatibles avec la profession chrétienne. Mais il était très difficile de déraciner des habitudes particulièrement chères et invétérées. C'est pour cela, on n'en peut douter, que fut instituée la fête du 22 février ». Ici Mgr. Duchesne est entièrement dans le vrai ; et l'explication qu'il donne est celle qui concorde le mieux avec les faits. L’Église catholique eut beaucoup de peine à faire cesser les banquets païens en l'honneur des morts ; et souvent elle dut user de prudence et se contenter de transformer ce qu'elle ne pouvait détruire [FN: § 1004-1].
§ 1005. Un très grand nombre de faits nous montrent les saints héritant du culte des dieux païens, et rendent ainsi manifeste qu'en somme il y a une chose identique prenant des formes diverses.
§ 1006. A. Maury dit [FN: § 1006-1] : « (p. 157) Cette substitution des pratiques chrétiennes aux rites païens s'accomplissait toutes les fois que ceux-ci étaient de nature à être sanctifiés. Elle avait surtout lieu dans les pays tels que la Gaule, la Grande-Bretagne (p. 158), la Germanie et les contrées septentrionales, où l'Évangile ne fut prêché qu'assez tard, où les croyances païennes se montraient plus vivaces et plus rebelles. L'Église elle-même avait engagé ses apôtres à ce compromis avec la superstition populaire ; aussi en trouvons-nous encore aujourd'hui des traces nombreuses dans nos campagnes. Le denier de Caron se dépose en certains lieux dans la bouche du mort, la statue du saint est plongée comme celle de Cybèle dans le bain sacré, la fontaine continue à recevoir au nom d'un (p. 159) saint les offrandes qu'on lui offrait jadis comme à une divinité, les oracles se prennent à peu près de la même façon que le faisaient nos ancêtres païens [ajoutez : et comme faisait le paganisme naturiste, avant le paganisme anthropomorphique], et il n'est pas jusqu'au culte du phallus qui n'ait été sanctifié sous une forme détournée ».
§ 1007. Un résidu, constitué par certaines associations d'idées et d'actes, dans la Rome ancienne, survit jusqu'à notre époque, sous des formes variées et successives (§ 178). Il ne change pas avec l'invasion de l'anthropomorphisme grec, grâce auquel la fontaine devient une divinité personnifiée. Il ne change pas non plus avec l'invasion du christianisme, et le dieu – ou la déesse – devient un saint ou une sainte. Parallèlement, une transformation métaphysique donne à ce résidu la forme abstraite d'une « force de la nature » ou d'une « manifestation de la puissance divine » ; mais ces transformations restent à l'usage des littérateurs et des philosophes, et le vulgaire ne leur fait pas bon accueil. La puissance du résidu est mise en lumière par sa conservation au milieu de vicissitudes si nombreuses et si diverses ; et l'on comprend ainsi comment, pour la détermination de l'équilibre social, il importe beaucoup plus d'envisager le résidu, que les formes différentes et fugitives dont il est revêtu par le temps.
§ 1008. On voit de même que les changements sont plus faciles pour la forme que pour le fond, pour les dérivations que pour les résidus [FN: § 1008-1]. Les banquets en l'honneur des morts peuvent devenir des banquets en l'honneur des dieux ; puis de nouveau des banquets en l'honneur des saints, et redevenir de simples banquets commémoratifs. On peut changer ces formes, mais on pourrait plus difficilement supprimer les banquets. D'une façon brève, mais assez peu précise, justement parce qu'elle est brève, on peut dire que les usages religieux ou autres semblables opposent d'autant moins de résistance à un changement, qu'ils s'éloignent davantage du résidu d'une simple association d'idées et d'actes, et que la proportion de concepts théologiques, métaphysiques, logiques qu'ils renferment, est plus grande.
§ 1009. Voilà pourquoi l'Église catholique a pu vaincre facilement les grands dieux du paganisme, et beaucoup plus difficilement les petits dieux secondaires ; et voilà pourquoi elle a pu faire accepter à la société gréco-latine la conception théologique d'un dieu unique, – ou d'une trinité – à condition de permettre aux résidus persistants de l'ancienne religion, de se manifester par l'adoration des saints et par beaucoup d'usages qui, au fond, s'écartaient peu de ceux qui existaient déjà. Voilà aussi pourquoi il est plus facile de changer la forme du gouvernement d'un peuple que sa religion, ses usages, ses coutumes, sa langue ; et dans le changement même du gouvernement, le fond se transforme peu sous les diverses formes. Un préfet de la troisième république, en France, est bien le frère jumeau d'un préfet du second empire, et la candidature officielle diffère peu, sous ces deux gouvernements.
§ 1010. Le fanatisme et l'imbécillité qui engendrèrent les procès de sorcellerie se retrouvent tout à fait pareils dans les procès modernes de lèse-religion sexuelle. Il est vrai qu'on ne brûle plus personne ; mais cela vient de ce que toute l'échelle des pénalités s'est abaissée. Quand elle était élevée, on brûlait les sorcières, on pendait les voleurs. Aujourd'hui, les hérétiques sexuels et les voleurs s'en tirent avec la prison. Mais la forme du phénomène et les principes qu'elle révèle sont les mêmes. La procédure de l'Inquisition ôtait au prévenu les garanties dont il avait joui auprès des cours épiscopales et civiles. Lea écrit [FN: § 1010-1] : « (p. 450) La procédure des cours épiscopales, dont il a été question dans un des chapitres précédents, était fondée sur les principes du droit romain ; elle était en théorie équitable et soumise à des règles rigoureusement définies. Avec l'Inquisition ces garanties disparurent ».
§ 1011. Et voilà qu'il arrive la même chose pour le délit d'hérésie sexuelle ; c'est-à-dire pour le délit consistant à imprimer des récits obscènes ou réputés tels, ou même seulement « immoraux », de photographier des femmes légèrement vêtues, de rappeler les ébats de Daphnis et de Chloé, et, en somme, ce que l'homme et la femme ont toujours fait et feront toujours dans la race humaine. Les états civilisés accueillent les réfugiés politiques, même s'ils ont commis des homicides ; mais ils livrent à ceux qui les recherchent les hérétiques sexuels, dont le délit est bien plus grand que l'homicide, comme l'était, en d'autres temps, le délit d'hérésie de la religion catholique. En Angleterre, dans le pays de l'Habeas corpus, la Chambre des Communes approuvait en seconde lecture, au mois de juin 1912, un bill qui permet à la police d'arrêter sans mandat de l'autorité judiciaire, n'importe qui est suspect d'être sur le point de commettre un délit connexe à la « traite des blanches ». Si l'on désignait par ce nom le simple fait d'attirer par fraude ou par tromperie une femme dans une maison de prostitution, il n'y aurait pas à parler de religion sexuelle. Ce serait là un délit comme tous ceux qui ont pour origine la fraude et la tromperie, rendu plus grave, en certains cas, par le tort plus grand fait à la victime. Mais il n'en est pas ainsi [FN: § 1011-1]. Il est arrivé souvent que, dans les ports de mer, on a arrêté des prostituées qui, délibérément et en pleine connaissance des faits, voulaient se rendre au-delà de la mer, pour le simple motif qu'elles espéraient gagner davantage en ces pays. Là, il n'y a pas trace, pas même semblant de fraude ou de tromperie, et le délit apparaît comme la transgression d'un tabou spécial. De même, à Bâle, il est arrivé qu'au milieu de la nuit, la police s'est rendue dans tous les hôtels, a réveillé les voyageurs, et là où elle trouvait un homme et une femme, dans une chambre, elle exigeait la preuve qu'ils étaient unis par un mariage légitime. Ici encore, quel que soit le titre qu'on veuille donner à la loi qui s'exécutait de cette façon, il est manifeste qu'il ne s'agit pas de fraude, de tromperie ou d'autre délit analogue, mais qu'il ne peut être question que de la transgression d'un tabou sexuel, semblable à la transgression du catholique qui mange de la viande un vendredi, du musulman qui, pendant le ramadan et de jour, mange, boit ou a commerce avec sa femme.
§ 1012. On a coutume de justifier les procédures exceptionnelles par la gravité du délit, qui est assez grande pour engager à courir le risque de condamner plusieurs innocents, pourvu que le coupable n'échappe pas. Et telle est en vérité la justification expérimentale des procédures exceptionnelles en temps de guerre ou en temps de révolution, comme serait celle de la loi des suspects, en France. La justification est sentimentale pour les procédures contre les hérétiques religieux, parmi lesquels prennent place aujourd'hui les dissidents de la religion sexuelle que les vertuistes veulent imposer aux sociétés civilisées [FN: § 1012-1].
§ 1013. En de nombreux faits de permanence des agrégats se manifeste un phénomène important. Le résidu est issu de la permanence de certains faits, et contribue ensuite à maintenir cette permanence, jusqu'à ce qu'elle vienne heurter quelque obstacle qui la fasse cesser ou la modifie. Il y a une suite d'actions et de réactions (§ 991).
§ 1014. La théorie idéaliste, qui prend le résidu pour la cause des faits est erronée. La théorie matérialiste, qui prend les faits pour la cause du résidu, est erronée aussi. En réalité, les faits renforcent le résidu et le résidu renforce les faits. Les changements se produisent parce que de nouvelles forces viennent à agir, ou sur les faits, ou sur le résidu, ou sur celui-ci et ceux-là, et que de nouvelles circonstances provoquent la diversité dans les formes d'existence (§ 976).
§ 1015. (II-α) Persistance des rapports d'un homme avec d'autres hommes et avec des lieux. Ce genre se divise en trois espèces qui ont des caractères semblables et analogues, à tel point qu'ils peuvent facilement se confondre et que les résidus peuvent se compenser. Ces résidus sont communs aux hommes et aux animaux. On a dit que certains animaux ont le « sentiment de la propriété ». Cela veut dire simplement qu'en eux persiste le sentiment qui les unit à des lieux et à des choses. Le sentiment qui les unit à des hommes et à d'autres animaux persiste aussi. Le chien connaît non seulement son maître, mais aussi les personnes et les animaux de la maison. Un chien vit dans un jardin, en respectant les chats et les poules du lieu, tandis que, sitôt hors de la grille, il court après les chats et les poules qu'il rencontre, de même qu'il attaque aussi un chat étranger qui s'introduit dans son jardin. Plusieurs coqs, nés d'une même couvée et demeurés toujours ensemble, ne se faisaient pas la guerre. On tint l'un d'eux à l'écart pendant six jours. On crut ensuite pouvoir le remettre avec les autres, sans danger. Il fut, au contraire, immédiatement assailli et tué. Un fait semblable s'est produit pour deux matous qui, nés ensemble, vivaient ensemble pacifiquement. On les sépara peu de temps, et quand on voulut les remettre ensemble, ils s'élancèrent furieusement l'un contre l'autre. Les sentiments qu'on appelle, chez l'homme, de famille, de propriété, de patriotisme, d'amour de sa langue, de sa religion, de ses amis, etc., sont de ce genre [FN: § 1015-1]. L'homme ne fait qu'y ajouter des dérivations et des explications, qui naissent parfois du résidu.
§ 1016. (II-α 1) Rapports de famille et de collectivité. Chez les animaux qui élèvent leur progéniture, il y a nécessairement une union temporaire entre l'un des parents ou tous les deux et la progéniture. Mais il ne semble généralement pas que des résidus importants naissent de cette union. Quand la progéniture se suffit à elle-même, elle se sépare de ses parents et ne les reconnaît plus. Au contraire, dans la race humaine, probablement à cause du temps beaucoup plus long pendant lequel la progéniture a besoin de ses parents ou de ceux qui lui en tiennent lieu, des résidus importants et parfois très puissants apparaissent.
§ 1017. Ils correspondent à la forme de l'association familiale où ils ont pris naissance, et qu'ils ont ensuite contribué à renforcer ou à modifier. La littérature qui nous est le mieux connue – ou qui seule nous est connue – est celle des peuples qui ont eu la famille patriarcale, c'est-à-dire de tous les peuples civilisés ; et par conséquent, les seuls résidus que nous connaissons bien sont ceux qui correspondent à ce type de famille. Nous les trouvons dans toute l'antiquité gréco-latine, dans la Bible, dans les littératures chinoise, hindoue, persane. De là vint l'idée que le type de famille patriarcale était l'unique type existant, et que les déviations étaient d'importance minime ou nulle, bien qu'elles fussent connues depuis les temps anciens. Les braves gens qui rêvent d'un « droit naturel » ne manquèrent pas de croire que la famille du type patriarcal appartenait à ce droit. Mais un jour vint où, au grand étonnement des savants, on découvrit que d'autres types de famille étaient non seulement usités chez des peuples sauvages ou barbares, mais qu'ils avaient eu peut-être une part dans l'organisation de la famille de nos ancêtres préhistoriques, laissant des vestiges qu'on reconnaît à l'époque historique.
§ 1018. Comme d'habitude, on passa d'un extrême à l'autre. C'était le temps où l'idée de l'unité d'évolution régnait souveraine. Aussi édifia-t-on, sur-le-champ, des théories qui, partant d'une époque primitive de la famille, – pour quelques-uns, c'est la promiscuité des sexes, la communauté des femmes – et passant par les types intermédiaires qu'on nous décrit avec une grande précision, comme si les auteurs avaient pu les observer, en viennent à nous montrer comment tous les peuples ont modifié l'organisation de la famille, d'une manière uniforme, et les peuples civilisés ont connu le type de famille qu'ils ont à présent.
§ 1019. Ces vestiges si rares de types différents de la famille patriarcale, qu'on trouve dans la littérature classique, furent regardés avec une loupe d'un puissant grossissement, et l'on en tira des théories complètes qui font honneur à l'esprit subtil et à l'imagination brillante de leurs auteurs, mais ne déposent pas également en faveur de leur sens historique ni surtout scientifique. Engels fit d'une pierre deux coups : il reconstitua une histoire inconnue à tout le monde, sauf à lui, et mit mieux en lumière l'infamie et l'hypocrisie bourgeoise, ainsi que la beauté idéale du terme de l'évolution vers lequel nous nous acheminons grâce au socialisme.
§ 1020. Les nouvelles théories sur la famille, scientifiquement erronées, furent utiles au point de vue didactique, parce qu'elles servirent à briser le cercle dans lequel, grâce à l'idée unique du type patriarcal, toute étude sur la famille s'enfermait autrefois ; et jusque là l'étude de Engels peut avoir été utile, en montrant à beaucoup de gens qui ne sont pas aptes à l'étude scientifique, ce que certaines formes de l'idéalisme bourgeois renferment de futile, d'absurde et d'hypocrite.
§ 1021. Chez un grand nombre de peuples, quelles qu'en soient les causes, certaines collectivités se constituèrent, qui se considéraient comme unies au sol et permanentes dans le temps, les individus qui mouraient étant au fur et à mesure remplacés par d'autres. Il arriva aussi que le noyau de ces collectivités était formé d'individus unis par les liens du sang. Le fait de l'existence des dites collectivités est en rapport de mutuelle dépendance avec celui de l'existence de sentiments qui s'adaptent à la permanence de la collectivité, et qui se manifestent de diverses manières, dont la principale est celle qu'on appelle la religion. Nous ne connaissons pas « l'origine » de ces collectivités. Nos documents historiques nous les font connaître à un état d'évolution avancée, souvent même de décadence. Cela posé, on a donné trois explications prinpales du phénomène historique. 1° En portant son attention sur le noyau, on a dit que ces collectivités avaient pour origine la famille, et que si, dans les temps historiques, ce n'étaient plus de simples familles, cela venait de déviations du type ou de « l'origine », causées par des abus qui avaient altéré l'institution « primitive ». 2° Portant son attention sur les sentiments qui existent dans la collectivité et la consolident, on dit que ces collectivités avaient pour origine les croyances religieuses (§ 254), et l'on expliqua le noyau familial par la prescription religieuse ordonnant que certains actes religieux fussent accomplis par des personnes ayant certains liens du sang (§ 254). Les déviations sont ici beaucoup moindres que dans le cas précédent, et à l'époque historique, dans les pays considérés, le lien religieux correspond au lien de la collectivité ; mais cela ne prouve nullement que celui-ci ait été l'origine de celui-là. Seule, la manie des interprétations logiques et l'erreur très grave qu'on commet en croyant que les sentiments doivent précéder les actes, peuvent induire à voir dans le lien religieux « l'origine » du lieu de la collectivité. 3° On a pu croire que ces collectivités étaient entièrement artificielles et constituées par un législateur. Cette explication a maintenant peu de crédit, et à juste titre.
§ 1022. Mais il y a une quatrième hypothèse, qui explique beaucoup mieux les faits connus, et qui consiste à envisager ces collectivités comme des formations naturelles, constituées par un noyau qui est généralement la famille avec divers appendices. Ces collectivités, par leur permanence, font naître ou renforcent certains sentiments qui, à leur tour, les rendent plus solides, plus résistantes et plus durables.
§ 1023. Ces considérations générales s'appliquent aux cas particuliers de la gens romaine, du ![]() , des castes hindoues. Les difficultés rencontrées par les savants cherchant à déterminer ce qu'étaient précisément la gens et le
, des castes hindoues. Les difficultés rencontrées par les savants cherchant à déterminer ce qu'étaient précisément la gens et le ![]() , viennent en partie de ce qu'ils cherchaient la précision là où elle n'existait pas, du moins en des temps très anciens. C'est l'erreur habituelle, consistant à s'imaginer que des hommes frustes et peu ou pas du tout portés à l'abstraction et au raisonnement scientifique, raisonnaient avec la rigueur et la précision de jurisconsultes vivant au milieu de peuples beaucoup plus civilisés et plus instruits. Ces jurisconsultes avaient à résoudre des problèmes compliqués, et devaient les résoudre d'une façon claire, précise, logique, pour savoir qui appartenait à la gens ou au
, viennent en partie de ce qu'ils cherchaient la précision là où elle n'existait pas, du moins en des temps très anciens. C'est l'erreur habituelle, consistant à s'imaginer que des hommes frustes et peu ou pas du tout portés à l'abstraction et au raisonnement scientifique, raisonnaient avec la rigueur et la précision de jurisconsultes vivant au milieu de peuples beaucoup plus civilisés et plus instruits. Ces jurisconsultes avaient à résoudre des problèmes compliqués, et devaient les résoudre d'une façon claire, précise, logique, pour savoir qui appartenait à la gens ou au ![]() . Mais, en des temps frustes, ces problèmes étaient beaucoup plus simples et se réduisaient à une question de fait ; ce qui ne veut pas dire que le fait fût arbitraire, mais seulement qu'il était déterminé par une infinité de motifs qui, ensuite, lorsqu'on voulut bien les déterminer et les classer, diminuèrent en nombre, et changèrent même de degré d'efficacité.
. Mais, en des temps frustes, ces problèmes étaient beaucoup plus simples et se réduisaient à une question de fait ; ce qui ne veut pas dire que le fait fût arbitraire, mais seulement qu'il était déterminé par une infinité de motifs qui, ensuite, lorsqu'on voulut bien les déterminer et les classer, diminuèrent en nombre, et changèrent même de degré d'efficacité.
§ 1024. Il est certain qu'à l'époque historique, la famille est le noyau de la gens romaine. Mais il est tout aussi certain que le lien du sang ne suffit pas à constituer la gens. Nous ne voulons pas traiter ici la question difficile de savoir si la gens était constituée par une ou plusieurs familles. À l'époque historique, il y a des jeunes filles d'une gens qui se marient dans une autre. Supposons aussi que cela ne soit pas arrivé dans les temps les plus anciens, et faisons ainsi disparaître cette difficulté. D'autre part, l'adoption et l'adrogation introduisent des étrangers dans la gens. Mettons-les aussi de côté : mais ensuite il reste des difficultés insurmontables. La filiation légitime ne suffit pas pour qu'un mâle fasse partie de la gens. Peu après sa naissance, il est présenté au père, qui peut l'accepter ou le répudier : liberum repudiare, negare. Cette disposition est commune à la Grèce et à Rome. Elle n'a pas la moindre apparence d'être d'une date récente ; au contraire, elle présente tous les signes d'un antique usage, et elle seule suffit à démontrer que dans la gens, et dans le![]() , il y a quelque chose d'autre que la descendance d'un ancêtre commun.
, il y a quelque chose d'autre que la descendance d'un ancêtre commun.
§ 1025. Il y a de plus les appendices de la famille, et par conséquent du ![]() . On les considère comme appendices, parce qu'on veut a priori que la descendance ait été l'unique origine de la collectivité familiale. Mais qui nous dit que ces appendices ne sont pas au contraire une survivance d'une partie de cette collectivité antique ? De même, en Inde, on considère aujourd'hui comme des abus les pratiques qui introduisent des étrangers dans la caste, et c'est peut-être avec raison ; mais qui nous dit que dans les anciens temps elles ne furent pas une des façons dont se constituèrent les castes [FN: § 1025-1] ?
. On les considère comme appendices, parce qu'on veut a priori que la descendance ait été l'unique origine de la collectivité familiale. Mais qui nous dit que ces appendices ne sont pas au contraire une survivance d'une partie de cette collectivité antique ? De même, en Inde, on considère aujourd'hui comme des abus les pratiques qui introduisent des étrangers dans la caste, et c'est peut-être avec raison ; mais qui nous dit que dans les anciens temps elles ne furent pas une des façons dont se constituèrent les castes [FN: § 1025-1] ?
§ 1026. L'ancienne clientèle est le plus important de ces appendices. Elle met bien en lumière le caractère de la cellule vivante des sociétés anciennes. Cette cellule n'est pas seulement constituée d'un noyau d'individus ayant une descendance commune, mais d'individus qui vivent ensemble, fortement liés par des droits et des devoirs communs. À Athènes, le nouvel esclave est appelé à faire partie de la famille par une initiation religieuse. Quand une famille vient à s'éteindre complètement, la loi de Gortyne attribue le patrimoine à ses esclaves attachés à la glèbe.
§ 1027. Ne pouvant nier tous ces faits, on a dû ajouter le lien religieux à la descendance commune, pour constituer la famille, la gens et le ![]() . Nous nous rapprochons ainsi davantage de la réalité, parce que ce lien religieux est justement l'une des formes sous lesquelles se manifestent ces liens de fait, qui s'ajoutent à la descendance commune. Mais ce n'est pas sans péril qu'on substitue ainsi l'indice à la chose, le mode de manifestation à la chose manifestée. On peut être induit à croire que la religion a été l'« origine » de la famille, de la gens et du
. Nous nous rapprochons ainsi davantage de la réalité, parce que ce lien religieux est justement l'une des formes sous lesquelles se manifestent ces liens de fait, qui s'ajoutent à la descendance commune. Mais ce n'est pas sans péril qu'on substitue ainsi l'indice à la chose, le mode de manifestation à la chose manifestée. On peut être induit à croire que la religion a été l'« origine » de la famille, de la gens et du ![]() ; ce qui serait erroné.
; ce qui serait erroné.
§ 1028. Fustel de Coulanges, qui attribue justement ce rôle à la religion, ne voit d'autres hypothèses que celles que nous avons indiquées aux numéros 1 et 3 du § 965. Il démontre facilement que le lien du sang ne suffisait pas pour constituer les collectivités envisagées, et sa démonstration met ainsi en lumière les autres liens que nous venons d'indiquer. Il démontre facilement aussi que l'origine de ces collectivités ne peut être artificielle. Mais il ne songe pas à démontrer que son raisonnement, qui donne la religion comme l’« origine » de ces collectivités, n'est pas l'habituel post hoc propter hoc. C'est là justement le point faible de sa théorie.
§ 1029. À propos de la théorie qui veut que l'origine de la gens soit artificielle, il dit [FN: § 1029-1] : « (p. 119) Un autre défaut de ce système est qu'il suppose que les sociétés humaines ont pu commencer par une convention et par un artifice, ce que la science historique ne peut pas admettre comme vrai ».
§ 1030. Tout à fait juste. Mais on a exactement la même difficulté à admettre que les croyances aient pu précéder les faits auxquels elles se rapportent. On comprend à la rigueur que les croyants d'une religion révélée admettent cela pour leur religion. Laissons donc de côté la croyance que peut avoir un chrétien, que les dogmes de sa foi sont antérieurs aux faits auxquels ils se rapportent ; mais ce même chrétien ne peut admettre cela pour les rites païens. Et même si l'on admet la théorie de la décadence et de la corruption d'une religion révélée, la nécessité subsiste de reconnaître que cette décadence et cette perversion ont été déterminées par les faits, et qu'elles n'en sont pas indépendantes.
§ 1031. La religion de l'antiquité gréco-romaine est en rapport étroit avec le fait de la constitution des collectivités, lesquelles comprenaient les cellules sociales ; elle est formée par les résidus qui naissaient de la permanence de ces organismes, et qui, à leur tour, en assuraient l'existence et la permanence (§ 1013).
§ 1032. Les résidus, très semblables en Grèce et à Rome, présentèrent des dérivations différentes, à cause du caractère différent de ces peuples ; et les résidus qui constituaient les religions des familles devinrent, sans beaucoup de modifications ni d'adjonctions, les résidus qui constituaient les religions des cités. Il n'y a pas lieu de s'étonner si l'on trouve dans ces religions le caractère indiqué par S. Reinach (§ 383) ; c'est-à-dire « un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés » : car ces résidus correspondent précisément à l'ensemble de liens, autrement dit d'obstacles au libre exercice des facultés, qui donnaient vie et force à la cellule sociale. Toute théorie a la tendance d'augmenter démesurément l'importance de ses principes ; aussi la religion, qui était la manifestation de liens existants, en créa-t-elle à son tour de nouveaux et parfois d'absurdes. Beaucoup de personnes ont dit que la religion enveloppait tous les actes de la vie antique ; mais on dirait mieux encore qu'elle était la manifestation de liens spontanés ou artificiels, qui existaient dans tous les actes de la vie. La séparation des religions et de l'État peut avoir un sens pour les peuples modernes ; elle ne pouvait pas en avoir pour l'antiquité gréco-romaine, où elle aurait signifié la séparation des liens de la vie civile et de l'État. La tolérance de l'ancienne cité romaine envers les diverses religions, pourvu que le culte national fût respecté, correspond parfaitement à la tolérance des États civilisés modernes envers les différentes morales et certains statuts personnels, pourvu que la législation de ces États soit respectée.
§ 1033. Le culte des cités fut en grande partie modelé sur le culte des familles ; il y eut imitation directe. Par exemple, le culte du feu domestique devint le culte du feu sacré de la cité, au Prytanée grec on dans le temple romain de Vesta. Mais il y a d'autres cas où un culte public tire son origine des mêmes résidus qui ont donné le culte familial ; et ce n'est pas – ou ne semble pas être – une imitation directe.
§ 1034. Les Pénates romains correspondent, au moins en partie, à l'idée des provisions alimentaires domestiques. L'importance que celles-ci avaient pour les familles antiques, les précautions qu'on devait prendre pour éviter la famine, les sentiments agréables qu'entraînait avec elle l'abondance des genres alimentaires, correspondaient à un résidu puissant, qui se manifestait dans le caractère religieux des Pénates, lesquels recouvraient aussi d'autres résidus.
§ 1035. En un temps très postérieur, l'origine de la déification de l'Annona est semblable (§ 996 et sv.) Mais là, il n'y a pas du tout d'imitation directe, pour autant que nous le savons : la déification de l'Annona n'a pas été une copie de celle des Pénates familiaux ou publics. Elle a au contraire pris naissance de ces mêmes sentiments, qui s'étaient autrefois manifestés en donnant aux provisions domestiques le caractère religieux.
§ 1036. On sait que les tribus grecques avaient un héros éponyme, et que les cités grecques et les latines avaient un fondateur plus ou moins divinisé. On a voulu voir dans ces faits la copie du fait réel de la descendance d'un unique auteur de la famille, du ![]() , de la gens ; et il peut bien en être ainsi ; mais cela pourrait aussi ne pas être, et l'existence de cet auteur pourrait être une fiction pareille à celle du héros éponyme et du fondateur divin. Nous ne pouvons rien trancher, tant que les preuves directes nous font défaut.
, de la gens ; et il peut bien en être ainsi ; mais cela pourrait aussi ne pas être, et l'existence de cet auteur pourrait être une fiction pareille à celle du héros éponyme et du fondateur divin. Nous ne pouvons rien trancher, tant que les preuves directes nous font défaut.
§ 1037. Au moyen âge, en nos pays, se reproduisirent des circonstances en partie semblables à celles dans lesquelles se constituèrent les anciennes familles de notre race ; et comme la confédération des anciennes familles indépendantes avait produit la cité, ainsi la hiérarchie féodale produisit la monarchie des siècles passés. La collectivité féodale avait un noyau de famille auquel s'ajoutaient des éléments étrangers. Flach observe [FN: § 1037-1] : « (p. 455) Les parents groupés autour de leur chef forment le noyau d'un compagnonnage bien plus étendu, dont l'importance ne me semble pas avoir été mise en suffisant relief par les historiens, la maisnie, la maison du seigneur, son corps d'élite, le centre de résistance de son (p. 456) armée, son meilleur conseil, son entourage de chaque jour. La maisnie se complète, en dehors de la famille naturelle, par les fils et les proches des vassaux ou des alliés les plus fidèles et même par des étrangers ». Comme dans les temps les plus anciens, la religion intervient pour manifester et renforcer le lien de cette collectivité. Mais les circonstances sont en partie changées. Les familles antiques constituaient leur religion : c'est pourquoi elles divinisaient les choses qui servaient aux liens. Les familles féodales avaient une religion constituée extérieurement à elles, et la divinisation était déjà consommée. Elles ne créèrent donc pas de nouvelles divinités, mais firent servir à leurs besoins celles qui existaient. Après avoir fait allusion à la recommandation et à l'hommage, Flach ajoute : « (p. 522) Mais l'autorité ainsi créée sur un homme ne l'est qu'en vue de son entrée dans la famille qui s'incarne dans le seigneur [comme autrefois dans le pater familias [FN: § 1037-2] , de son affiliation au corps familial, avec les droits et les devoirs qu'elle emporte. Or, cette affiliation s'opère par l'acte le plus grave, le plus solennel, que connussent les hommes dans les sociétés naissantes, par un serment religieux. Au temps du paganisme, l'affilié devenait participant du culte domestique ; il se livrait, il se dévouait corps et âme à une famille nouvelle et s'il manquait à sa foi il attirait sur sa tête la vengeance des dieux ». [Ce sont là des dérivations. Aux temps les plus reculés, la religion était la manifestation même de ces liens]. À l'époque chrétienne qui nous occupe, le serment par lequel le vassal engage sa personne est le plus redoutable ; il fait des martyrs de ceux qui sacrifient leur vie pour y rester fidèles, des maudits de ceux qui le violent ».
§ 1038. Pertile [FN: § 1038-1] nie que les fiefs fussent issus des clientèles de l'ancien droit romain ou des bénéfices militaires de l'Empire. Il observe que « (p. 204) puisque de ces institutions aux fiefs, il n'y a pas continuité de temps, par conséquent il ne peut pas y avoir filiation ». Il a raison, dans le sens d'une imitation directe, comme nous avons vu un peu plus haut que l'Annona ne venait pas directement des Pénates ; mais nier une origine commune serait une erreur. Les mêmes sentiments (résidus), se trouvant dans des circonstances de fait en grande partie semblables, et aussi en partie différentes, ont engendré les phénomènes en grande partie semblables, et aussi en partie différentes, de l'ancienne clientèle, de la recommandation, des bénéfices, des fiefs.
§ 1039. Pertile dit que « (p. 203), dans la clientèle,... l'élément réel fait complètement défaut ». C'est l'erreur habituelle des juristes, qui regardent plus à la forme qu'au fond. L'élément réel manquait dans la clientèle ancienne, au point de vue de la loi, mais pas en fait ; et, toujours en fait, l'élément militaire ne manquait pas non plus, en ce sens que le client aidait le patron, même dans des conflits violents.
§ 1040. Lisez le récit d'Eumée, dans l'Odyssée. Eumée, serviteur d'Ulysse, dit que si son maître revenait, il lui donnerait, à lui Eumée [FN: § 1040-1], « les choses qu'un maître bienveillant donne au serviteur qui a bien travaillé » ; c'est-à-dire une maison, un champ et une épouse. Dans la maison et dans le champ se trouvent bien, de fait, l'élément réel. Ulysse se fait reconnaître d'Eumée, et celui-ci combat aux côtés de son maître, pour défaire les prétendants. Tout cela montre qu'en fait il est avec Ulysse dans les mêmes rapports qu'un vassal avec son seigneur féodal.
§ 1041. (II-α 2) Rapports avec des lieux. Ces résidus se confondent souvent avec les précédents et avec les résidus (II-β). Chez les peuples modernes aussi, on parle du « pays natal », qui, en réalité, est celui où réside la famille, et où l'on a passé son enfance, car la mère peut avoir enfanté ailleurs. Chez les anciens peuples gréco-latins, les rapports avec des lieux s'unissaient aux rapports de famille, de collectivité, et à ceux avec les morts, pour donner un ensemble de résidus.
§ 1042. Un fait semblable se produit chez les peuples modernes. En regardant les choses d'une façon superficielle, on pourrait croire que le patriotisme moderne est territorial, parce que les nations modernes tirent leurs noms des territoires qu'elles occupent. Mais en regardant les choses de plus près, on s'aperçoit que pour donner le sentiment du patriotisme, ce nom du territoire suggère un ensemble de sentiments, d'une souche qu'on croit commune, de langue, de religion, de traditions, d'histoire, etc. En réalité, on ne peut définir avec précision le patriotisme, comme on ne peut définir avec précision la religion, la morale, la justice, le bon, le beau, etc. Tous ces noms rappellent seulement certains ensembles de sentiments, qui ont des formes mal définies et des limites très incertaines (§ 380 et sv.). Ces ensembles sont maintenus unis par la persistance des agrégats.
§ 1043. (II-α 3) Rapports de classes sociales. Le fait de vivre dans une collectivité donnée imprime certaines idées dans l'esprit, certaines manières de penser et d'agir, certains préjugés, certaines croyances, qui subsistent ensuite et acquièrent une existence pseudoobjective, comme tant d'autres entités analogues. Les résidus correspondants acquirent souvent la forme des résidus de rapports de famille. On supposa que les classes sociales, les nations elles-mêmes, étaient autant de descendantes ayant chacune un auteur commun, réel ou mystique, et de même ses dieux, ennemis de ceux d'autres collectivités. Mais ce n'est là qu'une simple dérivation. Aujourd'hui, elle est tombée en désuétude chez les peuples civilisés.
§ 1044. La forme des castes, en Inde, est particulière ; mais le fond est très général, et l'on observe ce phénomène dans tous les pays, et souvent avec une plus grande intensité là où justement on se prévaut d'un principe d'égalité. La distance qui sépare un milliardaire américain d'un homme du peuple, américain aussi, est plus grande que celle existant entre un noble allemand et un homme du peuple, et se rapproche beaucoup de celle qui, aux Indes, sépare les castes ; cette dernière distance est dépassée à son tour par celle qui, aux États-Unis d'Amérique, sépare le blanc du nègre.
§ 1045. En Europe, la propagande marxiste de la « lutte des classes », ou mieux les circonstances qui se manifestèrent sous cette forme, eurent pour effet de faire naître et de fortifier les résidus correspondants, dans la classe des « prolétaires »», ou mieux dans une partie du peuple ; tandis que d'autre part, le besoin qu'avaient les « entrepreneurs » de ne pas heurter les sentiments de la démocratie, mais au contraire de s'en prévaloir pour faire de l'argent, faisait diminuer et détruisait certains résidus de rapports collectifs, dans les hautes classes sociales.
§ 1046. Plusieurs caractères qu'on trouve chez les Israélites contemporains, et qu'on veut attribuer à leur race, ne sont au contraire que des manifestations de résidus produits par de longs siècles d'oppression. La démonstration est facile. Il suffit de comparer un Juif russe avec un Juif anglais. Le premier se distingue immédiatement de ses concitoyens chrétiens ; le second ne s'en distingue pas du tout. Il y a de plus les degrés intermédiaires, correspondant justement à la durée plus ou moins grande de l'oppression. On sait que les différentes professions se manifestent souvent par des types distincts ; c'est-à-dire qu'elles montrent différents résidus correspondant à leurs différents genres d'activité.
§ 1047. Les associations qu'on appelle des sectes, constituées par des sentiments forts et exclusifs, présentent des caractères bien connus et qui furent observés en tous temps. La persistance des rapports dans la secte renforce ces caractères, et affaiblit l'action du contraste avec d'autres sentiments existant hors de la secte. On a ainsi l'un des caractères principaux des sectaires ; caractère qui consiste à perdre les idées que les autres hommes ont généralement de la valeur relative des choses [FN: § 1047-1]. Ce que les autres hommes tiennent pour un péché très léger peut apparaître au sectaire comme un crime très grave ; [Voir Addition A22 par l’auteur] et vice-versa, ce qu'ils estiment honteux ou criminel peut apparaître au sectaire comme honorable ou honnête. Par exemple, les hommes, en général, tiennent pour déshonorant d'espionner, de dénoncer. Aux temps de l'Inquisition, beaucoup de gens le considéraient comme un devoir, en vue d'exterminer les hérétiques de la religion catholique. Aujourd'hui, beaucoup de gens le considèrent comme un devoir et un honneur, en vue de faire disparaître les hérétiques de la religion sexuelle des vertuistes. En Italie, la Camorra et la Maffia sont célèbres. Mais les principes qu'elles emploient s'appliquent à des cas divers ; par exemple, lorsque les législateurs refusent l'autorisation de procéder contre leurs collègues, pour des délits ou des contraventions qui n'ont rien de politique, pour des diffamations privées, et même pour des excès de vitesse en automobile. Il est évident que c'est bien là une camorra de législateurs. Les jurés d'Interlaken qui, pour satisfaire un caprice humanitaire, frappèrent d'une peine tout à fait légère Tatiana Leontieff, laquelle avait assassiné un pauvre vieillard inoffensif ; les jurés français qui, par un autre caprice, humanitaire ou simplement imbécile, on ne sait, acquittèrent un fils qui avait assassiné son père, se croient de bonne foi très supérieurs aux délinquants et infiniment au-dessus des « despotes qui règnent sur les pauvres peuples ».
§ 1048. Les sentiments des sectaires peuvent acquérir une force assez grande pour pousser ces gens à n'importe quel crime, fût-il le plus atroce, et le nom même d'assassin vient des actes de certains sectaires. Tout cela est fort connu ; mais on ne prend pas assez garde au fait suivant. Parmi les manifestations diverses qui, par exemple, de l'acte d'abjecte délation d'un dominicain de la vertu, en viennent à l'assassinat perpétré par un sectaire, il n'y a qu'une différence d'intensité des sentiments, et quelquefois seulement une différence de courage. C'est entre autres le cas de deux hommes dont, pour tirer une vengeance, l'un recourt au poison, et l'autre affronte son ennemi à main armée.
§ 1049. L'idée, très générale parmi les peuples barbares, que contre l'étranger, contre l'ennemi, tout est permis, que dans les rapports avec eux, les règles de la morale usitées envers les concitoyens ne s'appliquent pas, manifeste encore les résidus dont nous traitons. Cette idée appartient aussi à des peuples civilisés, comme le peuple romain, et n'a pas encore entièrement disparu chez nos peuples contemporains (§ 1050-2). Les peuples civilisés modernes, à l'image de ce qui avait lieu pour les peuples de l'ancienne Grèce, ont entre eux des rapports qui ne s'écartent pas trop des règles morales en usage chez ces peuples ; mais ils estiment n'avoir pas à tenir compte de ces règles, dans leurs rapports avec des peuples barbares, ou par eux jugés tels.
§ 1050. La théorie d'Aristote sur l'esclavage naturel [FN: § 1050-1] est aussi celle des peuples civilisés modernes, pour justifier leurs conquêtes et leur domination sur des peuples qu'ils disent de race inférieure. Et de même qu'Aristote disait qu'il est des hommes naturellement esclaves, d'autres naturellement maîtres, et qu'il convient que les premiers servent et que les seconds commandent, chose juste et profitable à tous, de même les peuples modernes, qui se gratifient de l'épithète de civilisés, disent qu'il y a des peuples qui doivent naturellement dominer : ce sont eux-mêmes, et d'autres qui doivent non moins naturellement obéir : ce sont ceux qu'ils veulent exploiter ; et il est juste, convenable et profitable à tous que ceux-là commandent et que ceux-ci servent. Il en résulte qu'un Anglais, un Allemand, un Français, un Belge, un Italien qui combat et meurt pour sa patrie est un héros ; mais qu'un Africain qui a l'audace de défendre sa patrie contre ces nations est un vil rebelle et un traître. Les Européens accomplissent leur devoir sacro-saint de détruire les Africains, comme au Congo [FN: § 1050-2], pour leur apprendre à se civiliser. D'ailleurs, il ne manque pas de gens pour admirer béatement cette œuvre de « paix, de progrès, de civilisation ». Il faut ajouter qu'avec une hypocrisie vraiment admirable, les bons peuples civilisés prétendent que c'est pour faire le bien de leurs peuples sujets, qu'ils les oppriment et même les détruisent ; et l'amour qu'ils leur portent est si grand qu'ils veulent les « délivrer » de force. C'est ainsi que les Anglais délivrèrent les Hindous de la « tyrannie » des radjas ; que les Allemands délivrèrent les Africains de la « tyrannie »des rois nègres ; que les Français délivrèrent les habitants de Madagascar, et, pour les rendre plus libres, en tuèrent un certain nombre et réduisirent les autres dans un état auquel il ne manque que le nom d'esclavage ; et que les Italiens délivrèrent les Arabes de l'oppression des Turcs. On dit tout cela sérieusement, et il y a même des gens qui le croient. Le chat attrape la souris et la mange ; mais il ne dit pas qu'il le fait pour le bien de la souris ; il ne proclame pas le dogme de l'égalité de tous les animaux, et ne lève pas des yeux hypocrites vers le ciel pour adorer le Dieu de l'univers.
§ 1051. Habituellement, la théorie de la supériorité, des peuples civilisés n'est employée que contre les peuples non européens. Mais la Prusse s'en sert aussi contre les Polonais ; et il y a des gens, en Allemagne, qui voudraient l'utiliser contre les peuples latins, qu'ils estiment barbares, en comparaison des très bons, très moraux, très vertueux, très intelligents et très civilisés peuples germaniques. En Angleterre et en Amérique, il est des gens qui revendiquent ces éminentes qualités pour la divine race anglo-saxonne [FN: § 1051-1]. Tous ces gens se croient absolument « scientifiques », et raillent, comme bourrées de vieux préjugés, les personnes qui ne sont pas de leur avis.
§ 1052. (II-β) Persistance des rapports des vivants avec les morts. L'ensemble des rapports d'un homme avec d'autres hommes persiste, par abstraction, même après l'absence ou la mort de cet homme. Nous avons ainsi des résidus d'un très grand nombre de phénomènes [FN: § 1052-1]. Ils sont en partie semblables aux résidus du genre (II-α). Cela explique comment on les rencontre unis à ces résidus en un grand nombre de cas, comme pour la famille, les castes, le patriotisme, la religion, etc. Unis aux résidus qui nous poussent à partager ce qui nous appartient avec les personnes pour lesquelles nous avons de l'affection, ou même simplement de la bienveillance (IV-δ 2), ils se manifestent dans les phénomènes complexes des honneurs aux morts, du culte dont ils sont l'objet, des repas et des sacrifices qu'on fait à l'occasion des funérailles, de la commémoration des morts [FN: § 1052-2].
§ 1053. Ceux qui veulent expliquer logiquement les croyances admettent que tous ces phénomènes ont pour postulat la croyance en l'immortalité de l'âme, car elles ne seraient plus logiques, si l'on se passait de ce postulat. Mais pour démentir cette opinion, outre une infinité de preuves historiques, il suffirait de remarquer que, parmi nos contemporains, les matérialistes n'honorent pas moins que d'autres leurs morts, et qu'à Londres et à Paris, pour ne parler que de ces villes, il y a des cimetières pour chiens, où ces animaux sont mis par des personnes qui ne supposent assurément pas que le chien ait une âme immortelle.
§ 1054. Les apparitions de morts, qu'on a crues réelles un peu dans tous les temps, un peu plus ou un peu moins, suivant les endroits, ne sont autre chose qu'une forme tangible donnée aux résidus de la persistance des rapports entre vivants et morts. Ces rapports se retrouvent aussi en partie, par raison de similitude, dans les apparitions de divinités, d'anges, de démons, de lutins et d'autres semblables entités personnifiées. Elles ont aujourd'hui leur écho dans le « dédoublement de la personne », dans la télépathie et en d'autres fables semblables [FN: § 1054-1].
§ 1055. En y réfléchissant bien, on voit que l'idée de la survivance du mort n'est autre chose que le prolongement d'une autre idée, en nous très puissante : celle de l'unité d'un homme, au cours des années. En réalité, la partie corporelle et la partie psychique d'un homme se transforment. Un homme âgé n’est identique à lui-même, enfant, ni matériellement ni moralement ; et pourtant nous admettons qu'il y a en lui une unité qui persiste. Ceux qui sortent du domaine expérimental l'appellent âme, sans d'ailleurs réussir à expliquer clairement ce que devient cette âme chez l'aliéné, chez le vieillard tombé en enfance, ni quand elle s'introduit dans le corps du nouveau-né, entre le moment où la semence de l'homme entre dans l'utérus de la femme, et celui où l'on entend les premiers vagissements du nouveau-né. Mais nous n'avons pas à nous occuper de toutes ces choses, parce qu'elles sortent du domaine expérimental, où nous voulons rester. Notre intention est seulement de montrer comment un même résidu se retrouve dans la croyance en l'unité de l'être vivant et de la survivance après la mort.
§ 1056. (II-γ) Persistance des rapports d'un mort avec des choses qui lui appartenaient durant sa vie. Les rapports d'un homme avec les choses qu'il a possédées persistent après sa mort, dans l'esprit des vivants. De là vient l'usage très général d'ensevelir ou de brûler avec le cadavre des objets qui appartenaient au mort, ou bien de les détruire, de tuer ses femmes, ses esclaves, ses animaux.
§ 1057. Comme d'habitude, l'explication logique de ces usages n'a pas manqué. On les a considérés comme une conséquence d'une nouvelle vie du mort. Si l'on place les armes d'un guerrier dans son tombeau, c'est pour qu'il s'en serve dans une autre vie. Si l'on fait des libations et qu'on dépose des aliments sur sa tombe, c'est pour que l'âme boive et mange. Si l'on sacrifie des êtres vivants au mort, c'est pour qu'ils l'accompagnent dans l'autre vie, etc.
§ 1058. Ces croyances existent certainement, mais sont des dérivations ; c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement variables, tandis que la partie constante des phénomènes est la persistance des rapports du mort avec les choses qu'il a possédées.
§ 1059. Qu'on lise, par exemple, dans l'Iliade, le récit des funérailles de Patrocle. L'ombre de Patrocle apparaît en songe à Achille. Elle ne lui demande nullement des objets et des êtres qui l'accompagnent dans une autre vie. Patrocle demande à son ami que leurs os reposent ensemble dans la même urne. Voilà notre résidu, presque sans aucune dérivation ; et ce résidu est si puissant, qu'il est resté intact après des siècles et après tant de changements dans les peuples et dans leurs croyances. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui, par acte de dernière volonté, prescrivent que leur corps doit reposer auprès de celui d'une autre personne qui leur fut chère. Qu'ils soient chrétiens ou libres-penseurs, il n'y a aucune conséquence logique de leurs croyances qui puisse les pousser à agir ainsi : ils sont mus exclusivement par les sentiments qui se manifestent dans notre résidu. Les Mirmidons d'Achille consacrent leur chevelure à Patrocle ; mais il est manifeste que celui-ci ne pouvait rien en faire dans une autre vie. De même, les douze prisonniers troyens égorgés sur son bûcher ne pouvaient lui être des compagnons agréables. Pourquoi donnerait-on une autre explication des quatre chevaux et des deux chiens égorgés de la même manière ? En tout cas rien, dans le poème, ne permet de supposer qu'ils devaient servir à l'âme de Patrocle. Les auteurs de l'explication logique peuvent répliquer qu'« à l'origine », on sacrifiait les êtres qui devaient accompagner l'âme du mort, et qu'ensuite, le sens de la tradition s'étant perdu, on tuait un peu au hasard hommes et bêtes. Mais c'est là une simple hypothèse, qui n'est pas appuyée sur les faits, et pas davantage sur l'analogie avec d'autres faits, car ce sont généralement les actions non-logiques qui précédent les actions logiques, et l'on suppose ici qu'il est arrivé le contraire.
§ 1060. Le bûcher qui a consumé le corps de Patrocle est éteint avec du vin. Par l'emploi de ce précieux liquide (I-β 2), on veut honorer le héros ; et dans le poème, il n'y a pas la moindre allusion qui laisse croire que Patrocle boive ce vin. Dans l'Odyssée, Ulysse fait, en l'honneur des morts, les libations d'eau, de miel, de vin, et répand de la farine. Les morts ne goûtent à rien de tout cela et accourent seulement pour boire le sang des victimes. Elpénor demande à Ulysse de brûler ses armes avec son corps ; mais il n'y a pas la moindre allusion au fait qu'il doive s'en servir dans une autre vie. On les brûle pour le même motif qu'on plante une rame sur le tombeau qui recouvre le corps d'Elpénor. Ici, nous avons simplement une permanence des rapports entre un homme et les choses qui lui appartiennent. La mère d'Ulysse dit : « Sitôt que la vie a quitté les os blancs, l'âme, voltigeant comme un songe, erre çà et là ». Elle ne rappelle nullement qu'elle est accompagnée des objets déposés dans sa tombe ou brûlés sur son bûcher.
§ 1061. Le préjugé de l'explication logique a une si grande force, que souvent, sans s'en apercevoir, les auteurs l'ajoutent à leurs descriptions. Dans les plus anciennes sépultures de l'Égypte, on trouve, avec les ossements, des objets ou des images d'objets qui servaient aux vivants. Nous manquons de tout document qui indique les rapports que les contemporains supposaient exister entre ces choses. Voici maintenant comment un savant égyptologue, A. Erman, décrit les faits. Nous soulignons les explications logiques ajoutées par lui [FN: § 1061-1] : « (p. 164) En ce temps ancien, on mettait dans la main du défunt quelque objet qu'on supposait lui devoir servir dans la mort ; ainsi un des cadavres anciens de notre collection tient encore la large pierre à frotter sur laquelle durant sa vie il avait broyé le fard vert destiné à colorier son corps, et un autre a dans la main une bourse de cuir. Mais on met encore bien d'autres choses auprès du cadavre, surtout des pots et des écuelles avec des mets et de la boisson, pour que le défunt ne souffre pas de la faim ; des harpons et des couteaux de pierre pour qu'il puisse chasser sa nourriture et se défendre contre des ennemis ; un damier pour distraire ses loisirs... On y ajoutait aussi des choses ne pouvant avoir d'utilité qu'au surnaturel. La petite barque de glaise doit lui permettre de passer les lacs qui... entourent les champs célestes des bienheureux. Le bœuf de glaise sera abattu pour lui et l'hippopotame de même matière sera son butin de chasse ; la servante d'argile dans la grande cuve, lui pétrit de ses pieds la (p. 165) pâte de l'orge pour lui préparer la bière... À cette autre figure de femme se tenant coi écheoit évidemment de fournir à son seigneur les services de l’amour, aussi est-elle peinte de belles couleurs variées, comme si elle allait être parée et couronnée de fleurs ; et ses cuisses et son fondement ont-ils ce puissant développement que l'Africain de nos jours considère encore comme le suprême de la beauté féminine ».
§ 1062. Il est certain qu'en un temps postérieur, ces explications logiques correspondent pleinement à la croyance populaire. Mais cela ne prouve nullement qu'elles y correspondaient en un temps plus ancien, pour lequel les documents font défaut. C'est au contraire cette correspondance que les explications logiques supposent.
§ 1063. Enfin, le fait du développement chronologique est bien différent du fait des résidus et de leurs dérivations ; et nous n'avons pas besoin de deviner comment le premier s'est passé, en des temps pour lesquels nous n'avons pas de renseignements, si nous voulons étudier le second, en des temps que nous connaissons bien.
§ 1064. En décembre 1911, des malfaiteurs profanèrent la tombe de la Lantelme, pour voler les précieux et riches joyaux qui avaient été enterrés avec cette actrice. Leur projet ne réussit pas, et l'on retrouva dans la tombe une enveloppe avec les bijoux. Deux choses sont alors certaines, autant qu'une chose peut être certaine ; 1° que les bijoux furent ensevelis avec la morte ; 2° que ceux qui firent cela ne s'imaginaient nullement que les dits bijoux dussent servir matériellement à la morte, dans une autre vie. Maintenant, supposons que dans deux ou trois mille ans, on retrouve cette tombe avec les bijoux, comme on retrouve maintenant d'autres tombes du temps passé, avec des armes et des bijoux, et que, raisonnant comme nous raisonnons aujourd'hui, on conclue que les hommes de notre temps croyaient que le mort se servait dans une autre vie des objets ensevelis avec lui. Cette conclusion serait manifestement erronée. Pourquoi donc la conclusion semblable que nous tirons pour le passé, d'une manière semblable, de faits identiques, ne pourrait-elle pas être également erronée ? Nous mentionnons la possibilité de l'erreur ; nous ne disons pas qu'elle existe nécessairement ; mais la seule possibilité suffit pour ôter toute efficacité à un raisonnement qu'on peut résumer de la façon suivante : « Certains faits ont, à notre avis, une seule explication logique ; donc ces faits se sont nécessairement passés de la manière indiquée par la dite explication ». Non, ils peuvent s'être produits d'une autre façon ; et le choix entre les diverses façons doit être fait au moyen de preuves directes, et non pas indirectement, grâce à des inductions logiques ; les faits nous démontrent très souvent qu'elles sont trompeuses. Il faut aller du connu à l'inconnu, expliquer les faits par d'autres faits, et non par les impressions que notre esprit reçoit des faits (§ 547).
§ 1065. (II-α) Persistance d'une abstraction. Une agglomération de rapports une fois constituée, soit de la manière indiquée au § 991, soit d'une autre manière quelconque, une abstraction correspondante prend naissance. Elle peut persister, et alors un nouvel être subjectif est créé.
§ 1066. Ces résidus sont le fondement de la théologie et de la métaphysique, qu'on pourrait exactement définir : un ensemble de dérivations de ces résidus. C'est pourquoi la théologie et la métaphysique ont une grande importance ; non pas celle qu'on leur suppose, en les considérant comme des sciences logiques, mais celle qui provient du fait qu'elles manifestent des résidus qui correspondent à des forces sociales puissantes.
§ 1067. À ce point de vue, les faits du passé et ceux du présent démontrent une uniformité remarquable. Il y a, au contraire, une différence, quant à la personnification des abstractions, qui, chez les peuples de nos pays, se produisait beaucoup plus souvent par le passé qu'en des temps plus récents. Pour ne pas répéter deux fois les mêmes choses, nous parlerons plus loin (§ 1070 et sv.) de certaines abstractions, en même temps que de personnifications. En attendant, voyons d'autres abstractions, qui, par leur importance, méritent de constituer des genres séparés.
§ 1068. (II-ε) Persistance des uniformités. On trouve un cas important de la persistance des abstractions, dans l'opération qu'on exécute en donnant un caractère général à une uniformité particulière, ou même à un seul et unique fait. On observe un fait ; on l'exprime sous une forme abstraite ; cette abstraction persiste et devient une règle générale. Cela se produit tous les jours. On peut même admettre que les raisonnements de cette sorte sont le propre des gens qui n'ont pas l'habitude des raisonnements scientifiques, et même de beaucoup de ceux qui ont cette habitude. Rares sont les personnes qui expriment les faits particuliers sous une forme particulière, et qui savent bien distinguer cette expression de celle qui donne une règle générale; qui savent en outre distinguer la règle générale, qui est un moyen de recherche et qui est soumise à la vérification expérimentale, de la règle qu'on veut placer au-dessus de cette vérification (§ 63). En allant à l'extrême, dans la voie de ces abstractions qui dominent l'expérience, on obtient les principes métaphysiques, les principes naturels, les rapports nécessaires des choses, etc. (§ 531). Il est inutile que nous donnions ici des exemples de ces résidus, ainsi que des suivants : ils se trouvent en grand nombre dans tout cet ouvrage.
§ 1069. (II-ζ) Sentiments transformés en réalités objectives. Ces résidus sont infiniment nombreux, au point de manquer rarement dans un discours qui n'est pas rigoureusement scientifique. Ils constituent le fondement des démonstrations subjectives, obtenues au moyen des sentiments. Ils agissent puissamment sur les motifs pour lesquels on émet et on accepte les théories (§ 13). L'auto-observation des métaphysiciens, l'expérience du chrétien et d'autres opérations semblables transforment en effet les sentiments en réalités objectives.
§ 1070. (II-êta) Personnifications. Le premier degré de la personnification consiste à donner un nom à une abstraction, à une uniformité, à un sentiment, et à les transformer ainsi en individus objectifs. Puis, peu à peu, on s'élève au degré le plus élevé, où la personnification est complète : on atteint l'anthropomorphisme [FN: § 1070-1]. Si l'on y ajoute le résidu sexuel, on obtient des principes mâles et des principes femelles, ou bien des divinités entièrement semblables à l'homme et à la femme. On peut aussi personnifier des lieux et des choses, sans pour cela les diviniser. Ces personnifications naissent spontanément dans l'esprit, sans qu'il soit besoin de raisonnements [FN: § 1070-2]
§ 1071. Le langage est un excellent moyen de faire persister les agrégats et de les personnifier. Il suffit souvent de donner un nom à un agrégat d'abstractions, pour le transformer en une réalité objective. Vice versa, on suppose qu'à un nom quelconque doit nécessairement correspondre une telle réalité (§ 1543 à 1686). Il se peut que le langage agisse aussi pour donner un sexe à ces abstractions ; mais le résidu sexuel suffit à cet office. Le langage intervient ensuite pour déterminer le choix du sexe.
§ 1072. L'anthropomorphisme agit diversement chez des peuples différents et à des époques différentes. Il y a une grande différence entre l'anthropomorphisme grec et la religion archaïque romaine. Il y a aussi une grande différence entre l'anthropomorphisme de l'antiquité classique gréco-romaine et les conceptions religieuses de nos temps. Mais nous ne manquons pas d'abstractions qui, la personnification mise à part, ressemblent beaucoup à celles du passé.
§ 1073. Par exemple, on a dit souvent que le socialisme est une religion. Dans le domaine des dérivations anthropomorphiques, cette proposition est absurde, et personne, assurément, parmi les contemporains, ne s'est jamais représenté le socialisme sous les traits d'un homme, comme les anciens Romains se représentaient la déesse Rome sous les traits d'une femme. Mais, dans le domaine des résidus, la proposition rappelée tout à l'heure correspond aux faits, en ce sens que les sentiments qui se manifestaient jadis par le culte de la déesse Rome ou de la déesse Annona, et ceux qui se manifestent maintenant par la foi au Socialisme, au Progrès, à la Démocratie, etc., constituent des phénomènes semblables.
§ 1074. Les sentiments à l'égard de Rome commencent par donner lieu à une simple représentation, puis croissent en intensité jusqu'à la déification, et finissent par décroître jusqu'à une admiration poétique ou littéraire qui subsiste encore de nos jours [FN: § 1074-1]. Les Romains commencèrent par représenter Rome sous une forme féminine, puis en firent une déesse. Le sentiment vif qui correspondait à la divinisation subsista sous une autre forme, même après la chute du paganisme, tout en s'affaiblissant et en devenant une simple expression poétique. Nous avons ainsi un noyau de sentiments qui persistent avec des intensités différentes, et se manifestent sous diverses formes. Chez les peuples qui jouissaient de la « paix romaine », on avait à l'égard de Rome un ensemble de sentiments et d'idées correspondant à la puissance de Rome et aux bienfaits de son gouvernement. Ces sentiments et ces idées trouvaient justement leur expression dans le langage qu'employaient alors les hommes, en donnant à la ville de Rome le nom d'une divinité, et en lui élevant des temples [FN: § 1074-2]. Des sentiments semblables se manifestent par le culte commun de Rome et de l'empereur régnant : Romae et Augusto, disent les inscriptions ; et c'est ainsi que nous avons aussi un culte commun de Rome et de Vénus.
§ 1075. Le fait d'une grande admiration de Rome et celui de la déification de cette ville, sont différents au point de vue logique, mais sont semblables au point de vue du sentiment ; et souvent le second est une simple traduction du premier en langage courant. Martial n'exprime que des sentiments populaires, quand il s'écrie : « Rome, déesse de la terre et des nations, que rien n'égale et que rien ne surpasse... »
§ 1076. Ces sentiments persistent ensuite, par simple force d'inertie, même quand les faits dont ils tirent leur origine sont passés. L'abstraction se détache des faits et vit de sa vie propre. Saint Jérôme dit encore de Rome [FN: § 1076-1] : « Ville puissante, ville reine des villes, ville louée par la voix de l'apôtre, ton nom, Rome, est interprété comme signifiant force, chez les Grecs, et sublimité, chez les Hébreux ». Puis, peu à peu, il ne reste que la simple réminiscence poétique, chez les poètes contemporains. Mais si c'est aujourd'hui une réminiscence, il y eut un temps où ce fut un sentiment vif et fort.
§ 1077. Dès le milieu du XIXe siècle, les peuples de l'Europe occidentale ont vu leurs conditions de vie s'améliorer progressivement, et cette amélioration a été notablement plus grande à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe. Cela a créé un agrégat de sentiments et d'idées agréables, qui se sont ensuite cristallisés autour de noyaux qu'on a nommés Progrès et Démocratie. Ces êtres puissants et bienfaisants sont considérés par nos contemporains, avec des sentiments semblables à ceux qu'éprouvaient leurs aïeux pour la puissance de Rome.
§ 1078. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples semblables, car tout sentiment vif tend en général à prendre la forme d'une foi en une certaine abstraction ; mais l'exemple seul du pacifisme suffira. M. Kemeny écrit [FN: § 1078-1] : « (p. 99) C'est donc d'une doctrine que je veux parler, non d'une religion, encore moins d'une confession. Le sens de ces deux termes a été, au cours des siècles, tellement altéré, ils ont subi tant d'avatars, qu'ils en demeurent défigurés et qu'ils servent souvent aujourd'hui à exprimer des idées en opposition directe avec l'idée pacifiste [voilà l'idée de la religion, chassée par la porte... mais nous la verrons rentrer par la fenêtre] J'espère ne me rendre coupable d'aucun blasphème en déclarant que le pacifisme, dans son acception la plus haute, n'est ni un moyen ni un but, mais une croyance qui repose sur une sorte de révélation [n'est-ce pas là le caractère prédominant de beaucoup de doctrines qu'on appelle religions ? ] La substance morale du pacifisme étant d'un ordre supérieur [il nous manque la définition qui permette de séparer l'ordre supérieur de l'ordre inférieur ] et se retrouvant dans toute conception universelle de la vie [qu'est-ce que cela peut bien être ?], le pacifisme doit être mis au même rang que le bouddaïsme, le judaïsme, l'islam, le christianisme [mais pourquoi l'auteur a-t-il commencé par dire que ce n'est pas une religion ?], mais il est permis de dire qu'il dépasse toutes ces conceptions en tant qu'il est commun à toutes, qu'il se retrouve dans toutes, qu'il les réunit toutes ».
§ 1079. Cet exemple est remarquable, parce que c'est l'un de ceux, si nombreux, où l'on voit transparaître très clairement les résidus à travers les dérivations La puissance du sentiment fait disparaître la logique. L'auteur a commencé par exclure le pacifisme de la classe des « religions », et, quelques lignes plus bas, il le met « au même rang » que des doctrines qui, incontestablement, sont appelées des « religions » par tout le monde. Mais pour lui, il n'y a pas contradiction, car il écrit sous l'empire d'un sentiment puissant, pour lequel le pacifisme plane comme un aigle, au-dessus des autres religions. Voilà pourquoi il ne fait pas partie de leur classe, bien qu'il leur soit en partie semblable. M. Kemeny démontre que le pacifisme ne contredit aucune religion ; l'aigle vole comme le simple moineau ; puis l'auteur ajoute : « (p. 100) Il y a une autre analogie entre les religions et le pacifisme, analogie exprimée par ces mots que l'on prononce souvent en manière de plaisanterie : « C'est la foi qui sauve ! » Le pacifisme opère, lui aussi, le salut. Tous ceux qui ont travaillé au mouvement pacifiste avec suite, sincèrement, sans arrière-pensée égoïste ou intéressée, ont certainement constaté qu'ils sont devenus meilleurs. Le pacifisme détruit peu à peu les germes du mal ; il purifie les pensées, ennoblit les instincts et devient par là même un élément régénérateur des individus et des races ». Si à ces idées on ajoutait le désir des personnifications, on aurait une image du pacifisme, comme on a une image des divinités païennes, comme on représente la déesse Rome, comme on voit le Dieu des chrétiens dans les nuées, sous la forme d'un beau vieillard à grande barbe.
§ 1080. Ajoutons que, fût-ce à titre d'exception, des dérivations modernes, semblables aux anciennes, ne manquèrent pas. Auguste Comte a personnifié la terre, à laquelle il a donné le nom de « grand fétiche », et l'humanité, à laquelle il a décrété un culte. Ceux qui s'appellent aujourd'hui « humanitaires » expriment en un autre langage plusieurs idées de Comte.
§ 1081. Le terme de socialisme a représenté et représente encore quelque chose de grand, de puissant, de bienfaisant ; et autour de ce noyau se disposent une infinité de sensations agréables, d'espérances, de rêves. De même que les anciennes divinités se succédaient, se dédoublaient, se faisaient concurrence, ainsi de nos jours, outre la divinité du socialisme, nous avons celle des « réformes sociales » ou des « lois sociales » ; et les petits dieux ne manquent pas ; tels « l'art social », « l'hygiène sociale », « la médecine sociale », et tant d'autres choses qui, grâce à l'épithète « sociale », participent de l'essence divine.
§ 1082. Sir Alfred C. Lyall nous fait connaître les diverses formes de déification, chez les Indiens. Moyennant quelques modifications, elles s'appliquent aussi à beaucoup d'autres peuples [FN: § 1082-1]. Il expose ainsi ces formes [FN: § 1082-2] : « (p. 14) 1° Le culte de simples morceaux de bois, souches ou troncs d'arbres, de pierres et d'accidents de terrains locaux, ayant une dimension, une forme ou une position soit extraordinaire soit grotesque [cfr. les résidus de la Ie classe] ; 2° le culte d'objets inanimés, doués de mouvements mystérieux ; 3° le culte d'animaux redoutés ; 4°, le culte d'objets visibles animés ou inanimés, directement utiles et profitables ou qui possèdent soit des propriétés, soit des fonctions incompréhensibles ». Jusqu’ici, nous avons les formes les plus simples d'agrégats de sensations. Vient ensuite une abstraction plus éloignée des simples sensations : « (p. 15) 5° le culte d'un Deo ou esprit, être sans forme et intangible, – vague personnification de ce sentiment de crainte que l'on éprouve en certains endroits ». Puis viennent des catégories appartenant à la persistance de certaines sensations : « 6° le culte des parents morts ou autres personnes défuntes connues de l'adorateur en leur vivant ; 7° le culte des personnes qui ont été pendant leur vie en grande réputation ou qui sont mortes d'une façon étrange ou notable : culte célébré près de la tombe ». Nous passons ensuite à des abstractions d'une complication croissante : « 8° le culte dans les temples de personnes appartenant à la catégorie précédente, adorées comme demi-dieux ou divinités subalternes ; 9° le culte des nombreuses incarnations locales des anciens dieux et de leurs symboles ; 10° le culte des divinités départementales ; 11° le culte des dieux suprêmes de l'hindouisme, et des anciennes incarnations ou personnifications connues par la tradition des écritures brahmaniques ».
§ 1083. Jusque ici, la description du phénomène est parfaite mais l'auteur cède à la tendance générale des explications logiques, quand il suppose qu'on peut rechercher le culte de certains objets inanimés, dans « (p. 17) l'intelligence qui prétend voir la divinité s'incarner dans une souche ou une pierre, uniquement parce que celle-ci offre une forme bizarre ou exceptionnelle, exprime un type de fétichisme grossier ». Puis, sans s'en apercevoir, lui-même réfute cette théorie. Il dit : « (p. 18) Or, les brahmanes ont toujours sous la main une explication pour rendre plausible ce respect envers les objets d'aspect curieux, surtout envers les choses coniques ou concaves, et ils la proposent à quiconque se met sérieusement en quête de manifestations ou d'emblèmes divins. Mais ces interprétations semblent appartenir à un symbolisme ultérieur, que les gens ingénieux inventent d'habitude pour justifier, d'après des principes orthodoxes, ce qui n'est en réalité rien de plus qu'un fétichisme primitif s'élevant dans une atmosphère supérieure [FN: § 1083-1] ».
§ 1084. Étudiant directement les faits, sir Alfred C. Lyall a pu parvenir jusqu'aux résidus ; et si ceux-ci ne se manifestent pas toujours, c'est parce que les faits ne nous sont pas connus directement, mais seulement voilés par les interprétations des littérateurs, des poètes, des philosophes, des théologiens. Par exemple, tout ce que nous savons de l'antique religion des Veddas n'est autre chose qu'un produit littéraire et théologique, que nous connaissons par des hymnes religieux d'une vanité prolixe vraiment remarquable, et auxquels manque le bon sens autant que la précision. Nous n'avons pas d'autres documents pour découvrir les formes parallèles des croyances populaires qui existaient alors, selon toute probabilité, comme elles existent aujourd'hui et se manifestent dans les faits qu'a pu étudier sir Alfred C. Lyall [FN: § 1084-1].
§ 1085. De même, la mythologie des poètes tragiques grecs, pourtant si supérieure aux hymnes des Veddas, par la précision, le bon sens, la clarté, est probablement – on pourrait dire certainement – différente de la mythologie populaire – que nous devinons au moins dans les quelques documents que nous connaissons sur ce sujet ; par exemple, dans l'ouvrage de Pausanias.
§ 1086. (II-η) Besoin de nouvelles abstractions. Le besoin d'abstractions persiste quand certaines d'entre elles tombent en désuétude, sont rejetées pour un motif quelconque. Il en faut alors de nouvelles, pour remplacer celles qui disparaissent ou demeurent affaiblies. Les mythologies populaires sont ainsi remplacées, dans les classes cultivées, par des mythologies savantes, subtiles, abstruses. Ainsi naissent les théogonies ingénieuses, les recherches sur la création du monde, sur l'état primitif de l'humanité, etc. Puis on fait un nouveau pas : les abstractions surnaturelles donnent lieu aux abstractions métaphysiques ; on institue des recherches sur l'essence des choses ; on divague en un langage incompréhensible sur des matières encore plus incompréhensibles. Puis, aux abstractions métaphysiques on ajoute des abstractions pseudo-scientifiques. La nébuleuse de Laplace jouait un grand rôle dans les prédications socialistes qu'on entendait il y a quelques années ; et grâce à elle, ou démontrait clairement que l'évolution, la Sainte Évolution, devait conduire le monde à l'âge d'or socialiste. Celui qui cesse d'adorer les reliques des saints se met à adorer la Solidarité. Celui auquel répugne la théologie de l'Église romaine se tourne vers la théologie moderniste, qu'il dit être plus « scientifique [FN: § 1086-1] ». Les cas semblables, où la forme change et le besoin d'abstractions persistantes subsiste, sont en nombre infini.
§ 1087. D'après le peu que nous en savons, la religion primitive du peuple romain manquait, au moins en partie, de cet élément d'abstractions théologiques et métaphysiques. C'est l'une des très nombreuses causes qui facilitèrent l'invasion de l'hellénisme. Elle n'est pas étrangère à l'invasion des cultes orientaux de Mithra et du christianisme, bien que la substitution d'une nouvelle population à l'ancienne population de Rome ait de beaucoup la plus grande part en ce phénomène. La pauvreté de l'élément abstractions théologiques et métaphysiques, dans l'humanitarisme, en entrave le progrès comme religion. Il en est de même pour la doctrine assez voisine du protestantisme libéral.
§ 1088. Non seulement l'homme a besoin d'abstractions ; il a besoin aussi de les développer. Il les veut vives dans l'esprit, et non mortes. Ainsi, il arrive que plus une religion est florissante, plus les hérésies naissent vives et fortes. Il y a un besoin statique et un besoin dynamique d'abstractions.
[578]
Chapitre VII↩
Les résidus (Suite). Examen des IIIe et IVe classes. [(§1089 à §1206), vol. 1, pp. 578-648]
§ 1089. IIIe CLASSE. Besoin de manifester ses sentiments par des actes extérieurs. Des sentiments puissants sont généralement accompagnés de certains actes, qui peuvent même ne pas être en rapport direct avec ces sentiments, mais qui satisfont le besoin d'agir. On peut observer des phénomènes semblables chez les animaux. À la vue d'un oiseau, le chat claque des mâchoires. En voyant son maître, le chien s'agite, remue la queue ; le perroquet bat des ailes, etc.
§ 1090. Sir Alfred C. Lyall termine les observations que nous avons citées (§ 1083), en disant : « (p. 21) L'auteur de ce livre a connu un fonctionnaire hindou, d'une grande finesse d'esprit et d'une culture très suffisante, qui consacrait, chaque jour, de longues heures au culte méticuleux de cinq cailloux ronds, qu'il s'était désignés pour symboliser à ses yeux l'Omnipotence. Tout en professant une croyance générale à l'ubiquité de la présence divine, il lui fallait un symbole quelconque à manier et auquel il pût adresser ses hommages ». Il convient de noter ici, non seulement le besoin du symbole, mais surtout le besoin de « faire quelque chose », d'agir, de remuer les membres, de fixer son attention sur quelque chose de concret, enfin de s'échapper d'une abstraction passive. De nos jours, Flammarion et d'autres savants se réunissent à l'équinoxe de printemps, pour assister au lever du soleil.
§ 1091. Les actes par lesquels se manifestent les sentiments les renforcent et peuvent même les faire naître chez ceux qui ne les ont pas encore. C'est un fait psychologique bien connu, que si une émotion se manifeste par un certain état physique, il peut arriver que la personne qui se met en cet état fasse naître chez elle l'émotion correspondante. Par conséquent, les résidus de cette classe sont unis aux émotions, aux sentiments, aux passions, par une chaîne complexe d'actions et de réactions.
§ 1092. (III-α) Besoin d'agir se manifestant par des combinaisons. À propos des combinaisons, nous devons retrouver ici les résidus de la Ire classe. Nous avons proprement un genre de résidus composés. Rares sont les faits comme celui que nous avons cité tout à l'heure, d'après sir Alfred-C. Lyall, et qui nous montrent des combinaisons dues au simple hasard, ou mieux à des motifs complexes et indéfinis. D'habitude, une règle plus ou moins fantaisiste détermine le choix de la combinaison. Le besoin d'agir est tyrannique ; la fantaisie travaille et trouve moyen de le satisfaire. Dans ces phénomènes, notre résidu, c'est-à-dire le besoin d'agir, constitue le principal ; les résidus de la Ire classe, c'est-à-dire les combinaisons, sont secondaires ; et les règles de ces combinaisons, c'est-à-dire les dérivations des résidus de la Ire classe, sont accidentelles et, en général, de peu d'importance.
§ 1093. C'est justement pourquoi il est difficile, souvent impossible, de distinguer les opérations magiques, du culte religieux ; si bien que grâce à la tendance habituelle de substituer la recherche des « origines » à celle des résidus, on a pu dire que la magie était « l'origine » de la religion. Le besoin d'agir, qui correspond au résidu du présent genre, donne lieu à des opérations d'art naturel, de magie, de religion. On passe par degrés insensibles, de la première espèce d'opérations à la dernière. On en a de très nombreux exemples dans les opérations tendant à guérir les malades. Au chapitre II, nous avons exposé la variété des opérations engendrées par le besoin qu'éprouvaient les hommes d'éloigner ou de susciter les tempêtes (§ 186 et sv.).
§ 1094. (III-β) Exaltation religieuse. Le besoin calme et pondéré d'agir peut croître en intensité jusqu'à l'exaltation, l'enthousiasme, le délire. Aussi, entre le genre précédent et celui-ci, la différence n’est que de quantité. Les chants religieux, les contorsions, les danses, les mutilations accomplies dans le délire font partie de ce genre. Mais dans les mutilations, et plus généralement dans les souffrances volontaires, on trouve souvent un autre genre de résidus : celui de l'ascétisme, dont nous traiterons plus loin.
§ 1095. Le shamanisme est un cas remarquable de phénomènes qui nous montrent les dits résidus sans beaucoup d'adjonctions. Sir John Lubbock dit [FN: § 1095-1] : « (p. 338) Wrangel (Siberia and polar Sea, p. 123) qui, lui, regarde le shamanisme comme une religion dans le sens ordinaire du mot, s'étonne "qu'il ne comporte aucun dogme" ; ce n'est – dit-il – ni un système enseigné, ni un système transmis de génération en génération ; bien que fort répandu, il semble prendre sa source dans chaque individu séparément, comme le résultat d'une imagination surexcitée au plus haut degré et influencée par des impressions extérieures, qui se ressemblent beaucoup dans toute l'étendue des déserts de la Sibérie Septentrionale ». Ayant, comme tous ceux qui traitent ces matières, l'idée fixe des dérivations logiques, sir John Lubbock ajoute : « (p. 338) Il est fort difficile, dans la pratique, d'établir une distinction entre le shamanisme et le totémisme, d'une part, et l'idolâtrie de l'autre. La principale différence réside dans la conception de la divinité. Dans le totémisme, les divinités habitent notre terre, dans le shamanisme, elles vivent ordinairement dans un monde à part et s'inquiètent fort peu de ce qui se passe ici-bas. La divinité honore quelquefois le shaman de sa présence, ou elle lui permet de visiter les régions célestes ».
§ 1096. Là, nous avons l'erreur habituelle, consistant à croire qu'on passe de l'abstrait au concret, tandis qu'en réalité on suit la voie inverse. Alors qu'il n'y avait pas encore de faits concrets du genre examiné, les hommes, à ce qu'il paraîtrait, ont commencé par se forger une idée logique et abstraite de la divinité, puis en ont déduit les règles de leurs actions ; enfin, les faits concrets se sont produits suivant cette idée et ces règles. En général, il arrive précisément le contraire. La théorie qui fait vivre les divinités sur la terre, et celle qui les place dans un autre monde sont très accessoires, en comparaison des faits concrets du totémisme et du shamanisme. Elles n'ont pas engendré les faits, mais ont été imaginées pour les expliquer.
§ 1097. L'exaltation religieuse n'est le propre d'aucune religion, d'aucun peuple, mais se rencontre dans la plupart des religions et chez le plus grand nombre des peuples, parfois très légère, parfois intense. Elle n'est donc pas la conséquence de l'une des religions qu'on observe. Au contraire, c'est d'elle que certaines théories sont la conséquence. Nous pouvons l'étudier en des faits qui se passent sous nos yeux, et procéder ainsi du connu à l'inconnu, pour étudier des faits plus éloignés ou plus reculés. Voyez, par exemple, l'Armée du Salut. Son principal moyen de propagande réside justement dans l'exaltation religieuse. Elle veut appartenir à la religion chrétienne, mais ne changerait rien à son œuvre si elle appartenait à une autre religion, par exemple au mahométisme.
§ 1098. Le « Réveil du Pays de Galles » est peu différent. La partie théologique est minime ; l'enthousiasme religieux est la partie principale. M. Bois, qui a étudié le Réveil [FN: § 1098-1] des années 1904-1905, observe que les gens saisis par cette ferveur religieuse fuient la discussion avec les incrédules [FB: § 1098-2]. Il note fort bien la différence entre la mission Torrey, dont une petite partie est théologique, et le Réveil, qui ne l'est pas du tout [FN: § 1098-3]. L'auteur nous raconte ce qu'il a vu au meeting du 11 avril : « (p. 269). Meeting étrange. Prières ferventes, passionnées, de femmes et d'hommes boxant les (p. 270) poings fermés. Plusieurs tombent dans le hwyl [FN: § 1098-4]... Évidemment, quand on tombe dans le hwyl, on ne se possède plus, on n'a presque plus conscience de soi, c'est le subconscient qui s'épanouit. Une petite fille, à ma droite, séparée de moi par une jeune fille, commence à prier en même temps que d'autres. On chante, rien n'y fait. La petite continue. On l'écoute un moment toute seule avec des amen, oui, très bien. Puis l'assemblée en a assez, il faut croire, car elle se met à chanter un grand hymne. La petite continue de prier. Il y a très longtemps qu'elle prie. Elle est dans le hwyl, complètement oublieuse de tout ce qui l'entoure, les yeux fermés, comme possédée par une influence extérieure qui la maîtrise ».
§ 1099. Cet état d'inconscience et d'exaltation est identique à celui du shaman, bien que les dérivations par lesquelles les croyants veulent expliquer ces états soient entièrement différentes. De même, quand M. Bois nous décrit l'état extatique dans lequel tombent les fanatiques du Réveil [FN: § 1099-1], nous retrouvons des faits semblables à ceux, bien connus, qu'on observa en tout temps, et chez tous les peuples.
§ 1100. On peut affirmer que les cris de l'Angekok sont inspirés du diable, et que ceux des fidèles du Réveil sont inspirés de Dieu. C'est là un problème dont la science expérimentale n'a pas à s'occuper, et qu'elle ne saurait résoudre en aucune façon. Mais il est certain qu'expérimentalement les deux cas sont identiques et manifestent les mêmes résidus.
§ 1101. Les prophètes de tous les temps paraissent avoir eu quelque chose de commun avec ces exaltés. La démocratie moderne a voulu aller chercher ses ancêtres parmi les prophètes hébreux [FN: § 1101-1]. Ce sont de ces généalogies fantaisistes qui chatouillent agréablement la vanité des parvenus. En attribuant à Dieu l'inspiration de leurs prophètes et au diable celle des prophètes païens, les premiers chrétiens se rapprochaient de la vérité, en ce sens qu'ils avaient l'intuition que dans ces phénomènes il y avait des manifestations du même résidu. Ceux qui voyaient dans les uns et les autres de ces prophètes des charlatans et des imposteurs, s'écartaient beaucoup plus de la vérité, et confondaient l'exception avec la règle.
§ 1102. De même, ceux qui ne voient chez les prophètes israëlites que des dégénérés et des aliénés s'écartent aussi de la vérité [FN: § 1102-1]. Assurément, la pathologie mentale joue un rôle dans ces phénomènes; mais elle ne les règle pas entièrement ; et, pour s'en persuader, il suffit d'observer les phénomènes que nous avons sous les yeux (§ 547).
En attendant, aux États-Unis d'Amérique, nous avons des prophètes, tel celui qui prit le nom d'Élie, parfaitement sains d'esprit, et qui ont pour but unique – qu'ils atteignent souvent – de gagner de l'argent. Il ne manque pas de faits analogues, partout et en tout temps. Récemment, en Angleterre, l'enquête Marconi a démontré que certains hommes politiques qui jouissent de la faveur des fanatiques Gallois, et qui, dans leurs discours en public, imitent les prophètes d'Israël, n'oublient pas leur intérêt ni les spéculations de bourse. Ces faits ne jouent aucun rôle dans le phénomène que nous examinons. Mais, parmi les gens de l'Armée du Salut et ceux du Réveil, parmi les énergumènes de l'anti-alcoolisme ou de la « vertu » sexuelle, parmi les humanitaires, parmi les prophètes du dieu Progrès, etc., il y a incontestablement des individus qui s'écartent peu du type normal de l'homme sain ; et si d'autres s'en écartent davantage, cela prouve que l'enthousiasme peut facilement s'ajouter à un état pathologique, mais ne prouve pas qu'on ne puisse le rencontrer chez les gens sains.
§ 1103. On remarquera que l'importance sociale du prophétisme réside moins dans les prophètes que dans les gens qui y croient ; et quand, parmi ceux-ci, se trouve un Newton, il convient de reconnaître que notre résidu a une grande part dans les phénomènes sociaux.
§ 1104. Seule, la manie de juger les phénomènes d'après leur partie accessoire, qui est celle des dérivations, peut cacher la parfaite similitude de tous les phénomènes d'exaltation religieuse ou d'autres genres analogues.
§ 1105. Par exemple, l'extase, la manie de la Pythie, avait exactement le même résidu que d'autres phénomènes d'extase religieuse ; et quant au bon sens, la Pythie en avait plus que beaucoup de prophètes israélites. Bouché-Leclercq dit [FN: § 1105-1] : « (p. 101) La Pythie enivrée, disait-on, par les vapeurs de l'antre et saisie par le dieu, tombait aussitôt dans une extase que les poètes se sont plu à décrire sous les couleurs les plus criardes et que nous ne décrirons pas après eux. Ce qui est certain, c'est que cette crise nerveuse n'était pas toujours simulée, car au temps de Plutarque une pythie en mourut. (Def. orac., 51) ».
§ 1106. L'étude des phénomènes du Réveil gallois nous fait comprendre ce qu'étaient les phénomènes qu'on observait au temps des Croisades (§ 547). C'est une erreur d'y voir exclusivement l'effet « des superstitions du moyen âge ». Ils provinrent de nombreuses circonstances, dont une partie s'observe encore. Ces circonstances sont celles qui correspondent à l'enthousiasme, tel qu'il se manifeste aujourd'hui encore dans les Réveils et en d'autres faits semblables. La grande part que les jeunes garçons et les jeunes filles prennent aux Réveils nous fait comprendre comment ont pu avoir lieu les croisades d'enfants [FN: § 1106-1].
§ 1107. Les Anglais sont plus pondérés que les Gallois, et plusieurs d'entre eux étaient choqués par l'anarchie du Réveil. L'un d'eux disait à M. Bois (loc. cit.) : « (p. 261) Ces péans de louanges, que voulez-vous, cela me rappelle les chorybantes ! » En somme, il ne s'éloignait pas trop de la vérité, car les deux phénomènes ont le même résidu [FN: § 1107-1]. M. Bois nous raconte aussi ce que pensait une dame anglicane, à laquelle il parlait avec enthousiasme d'une réunion du Réveil (loc. cit.) : « (p. 137) Mon admiration et mon enthousiasme ne trouvent que peu d'écho. Mon hôtesse, qui appartient à l'Église anglicane, a assisté à une réunion galloise. Elle a été toute scandalisée du manque d'ordre, de régularité, de ce meeting. Pensez un peu ! Elle avait apporté son livre d'hymnes anglicans, comme on fait quand on va à une réunion qui se respecte ; elle n'a pu une seule minute se servir de son livre !... »
§ 1108. Tels auront été, à peu près, les sentiments de nombreux sénateurs romains, quand fut édicté le sénatus-consulte des Bacchanales ; et leurs sentiments ne devaient guère différer de ceux qu'Euripide fait exprimer à Penthée [FN: § 1108-1].
§ 1109. Le récit de Tite-Live est manifestement exagéré. Les reproches d'obscénité faits aux Bacchanales sont ceux que les sectes religieuses ont l'habitude de s'adresser réciproquement. Justement parce que ces reproches sont toujours répétés, on ne peut savoir s'ils sont vrais ou non [FN: § 1109-1]. Il nous est donc impossible d'accepter comme certain le témoignage de Tite-Live, et nous ignorons jusqu'à quel point furent justifiées les accusations portées contre les Bacchanales. Toutefois, supposons pour un moment qu'elles fussent vraies. Il n'en reste pas moins que le Sénat défendit aussi les mystères, célébrés dans la Grande Grèce, mystères qui ne passaient nullement pour être obscènes. Il est donc manifeste que le Sénat avait de bien autres visées que celle de protéger la morale. Il suffit d'ailleurs de lire le discours que Tite-Live attribue au consul Postumius, pour voir que les intentions politiques étaient au premier plan (XXXIX, 16). «Le mal serait moindre s'ils n'avaient fait que s'efféminer par ces ignominies qui leur font grand'honte, et si leurs mains s'étaient abstenues des crimes, leurs esprits des conjurations. La République ne souffrit jamais d'un si grand mal, ni de plus d'hommes ni de plus de choses. Sachez que toutes les luxures, les fraudes, les scélératesses qui furent commises en ces dernières années, ont pris naissance dans ce sanctuaire de crimes. Encore cette conjuration n'a-t-elle pas révélé tous les maux. Elle se borne aux crimes privés, parce qu'elle n'est pas assez forte pour opprimer la République... »
§ 1110. Les légendes des ennemis que rencontre Dionysos et qui sont vaincus par lui nous révèlent, dans le sentiment grec, une certaine résistance à l'enthousiasme religieux. Cette résistance fut moins efficace chez les Grecs que chez les Romains, parce que la vie des premiers était moins sérieuse, moins retenue, moins digne que celle des seconds.
§ 1111. Avant d'écrire la vie d'Épaminondas, Cornelius Nepos avertit le lecteur qu'il ne doit pas juger des mœurs étrangères d'après celles de sa patrie. « Nous savons, en effet, que suivant nos mœurs, la musique ne convient pas à une personne distinguée, que nous plaçons la danse parmi les vices ; tandis que, chez les Grecs, ces choses sont bienvenues et honorées ». Et pourtant le chant et la danse figurent dans le culte romain des Saliens et des Arvales. Dans les Lupercales, les Luperques, presque nus, parfumés, couraient autour du pomerium de l'ancienne ville du Palatin, fouettaient avec des lanières de cuir les femmes qu'ils rencontraient, et les rendaient ainsi fécondes. Notons en passant que cette fête fut parmi les dernières à disparaître par l'effet du christianisme. Comme nous l'avons déjà dit (§ 1008, 1004), de tels résidus sont beaucoup plus résistants que les dérivations.
§ 1112. L'enthousiasme religieux a souvent pour effet de faire croire que certaines personnes sont en communication avec la divinité. Souvent aussi ont lieu des excursions dans le monde surnaturel. Williams décrit un fait de ce genre, vu par lui aux îles Viti [FN: § 1112-1]. Comparez cette description avec celle que donne Bois, de certains phénomènes du Réveil, [FN: § 1112-2] et vous verrez, sans en pouvoir douter le moins du monde, que les dérivations sont différentes, mais que le résidu est le même dans les deux cas.
§ 1113. IVe CLASSE. Résidus en rapport avec la sociabilité. Cette classe est constituée par des résidus qui sont en rapport avec la vie sociale. On y peut mettre aussi les résidus qui sont en rapport avec la discipline, si l'on admet que les sentiments correspondants sont renforcés par la vie en société. En ce sens, on a observé que tous les animaux domestiques, excepté le chat, vivaient en société, lorsqu'ils étaient en liberté. D'autre part, la société est impossible sans quelque discipline, et par conséquent l'établissement d'une sociabilité et celui d'une discipline ont nécessairement certains points de contact.
§ 1114. (IV-α) Sociétés particulières. Chez le plus grand nombre des peuples, on observe le besoin d'associations particulières. Il y en a des genres très différents : dans la seule intention de se distraire, avec un but d'utilité particulière, avec des vues religieuses, politiques, littéraires, etc. Ce n'est pas ici le lieu d'en donner une description, même sommaire. Nous voulons seulement noter les résidus qu'on observe en général dans des faits semblables.
Après avoir remarqué la diffusion des collèges funéraires, à Rome, Renan observe que les membres de ces associations deviennent étroitement unis et comme parents. De cette façon, on comprend comment des sentiments puissants sont issus du fait des réunions de ce genre. Renan, lui-même, a retrouvé les mêmes sentiments parmi les chrétiens orientaux de son temps. Ils sont d'ailleurs peu différents de ceux que nous pouvons facilement observer chez beaucoup de sectes religieuses, politiques, sociales. Les corporations du moyen âge ressemblaient aux anciens collèges. Le fait que le patron était un saint chrétien, au lieu d'être un dieu païen, n'en changeait certainement pas la nature. On observera aussi que la plus grande partie des manifestations de l'activité des sociétaires étaient les mêmes, y compris les banquets ; et c'est l'un des cas si nombreux dans lesquels on voit changer la forme, tandis que le fond demeure identique : les dérivations changent ; le résidu persiste. Il faut distinguer les sentiments qui poussent les hommes à constituer des sociétés particulières, des sentiments qui se développent dans ces sociétés, et qui correspondent à toutes sortes de résidus. Parmi ceux-ci, il faut mentionner les résidus II-α 3 (§ 1038 et sv.).
§ 1115. (IV-β) Besoin d'uniformité. Ce besoin existe aussi chez les animaux qui vivent en société. Si l'on teint une poule en rouge et qu'on la remette avec ses compagnes, celles-ci l'attaquent aussitôt. Chez les peuples barbares, le besoin d'uniformité est beaucoup plus grand que chez les peuples civilisés.
§ 1116. Dans les sociétés humaines, l'uniformité recherchée peut être générale chez un peuple, mais différente aussi, en divers groupes d'individus de ce peuple. La cristallisation des solutions d'un sel donne une image du phénomène. Autour d'un noyau se déposent des couches successives, qui constituent un gros cristal. Mais il n'y a pas qu'un seul cristal, dans la solution : il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul centre de réunion des personnes semblables dans une société donnée : il y en a plusieurs. Parfois, il y a lutte entre les diverses collectivités qui veulent étendre à d'autres leur propre uniformité ; parfois la lutte n'existe pas, et chacun se contente de l'uniformité de la collectivité dont il fait partie, et respecte les autres uniformités.
§ 1117. (IV-β 1) Uniformité obtenue en agissant sur soi-même. À ce genre appartient l'imitation. Elle joue un grand rôle dans les phénomènes sociaux : un individu en imite d'autres ; une collectivité, une nation en imite d'autres. Toutefois, nous avons vu (§ 733 et sv.) qu'il serait erroné de croire que là où l'on rencontre des institutions semblables, elles le sont nécessairement devenues par imitation. Elles peuvent être semblables, parce qu'elles naissent de causes semblables. En outre, il peut aussi arriver que l'imitation intervienne pour renforcer la similitude. Par exemple, les lois contre le vol proviennent chez les différents peuples, de causes semblables. Mais quand ces peuples en viennent à des rapports d'échange, ils peuvent imiter certaines formes de ces lois. On peut faire des observations analogues pour les institutions politiques et pour d'autres genres de l'activité sociale.
§ 1118. L'imitation peut avoir pour but d'obtenir quelque chose d'utile – ou d'estimé tel – en employant des moyens qui, mis en œuvre par d'autres individus, ont atteint ce résultat. On a ainsi des actions logiques. Mais souvent ce but n'existe pas ou n'est pas connu, et l'on a des actions non-logiques, auxquelles on s'efforce, comme d'habitude, de donner une teinte logique.
§ 1119. Le résidu se manifeste presque à l'état pur, dans l'uniformité temporaire imposée par la mode [FN: § 1119-1]. Souvent, il est vraiment impossible d'y trouver aucune utilité quelconque. Dire que « l'on suit la mode pour faire comme tout le monde », c'est dire simplement qu'on imite parce qu'on imite. Il est vrai que celui qui n'imiterait pas serait aussitôt en butte au blâme public ; mais ce n'est que la sanction d'un sentiment général, grâce à laquelle on passe, en ce cas, du présent genre au suivant.
§ 1120. La manière dont ces faits prennent naissance est souvent obscure. La manière dont ils sont imités et le motif de cette imitation dépendent souvent d'un ensemble de circonstances peu connues, que nous désignons par le nom de hasard. Par conséquent, le procédé qui veut attribuer des causes logiques à des faits qu'on observe à un moment donné, est souvent erroné, et les déductions qu'on fait dans ce sens sont alors fantaisistes.
§ 1121. En 1909, les femmes portaient, en Europe, de grands chapeaux, dits à la veuve joyeuse. Supposons qu'un voyageur, ne connaissant rien de l'Europe, y fût alors arrivé. Il aurait pu rechercher les causes logiques de cet usage, comme les voyageurs européens recherchent les causes logiques de faits semblables, observés chez les sauvages. Il aurait dit, par exemple, dans la relation de son voyage, que les femmes européennes croyaient s'assurer un heureux veuvage en portant de grands chapeaux d'une forme spéciale. Un autre aurait démontré qu'au contraire c'était un préservatif du veuvage. Un autre encore y aurait vu les restes de coutumes d'un autre état social.
§ 1122. Ce qui est ici une hypothèse arbitraire est au contraire une réalité pour un très grand nombre d'études sur les usages de l'antiquité et de peuples sauvages ou barbares. Par exemple, quand on observe un tabou, on veut aussitôt y trouver une raison logique. On ne saurait nier que le fait ne se soit produit ; mais ces cas sont rares. Il se peut aussi que nous soyons à même d'y découvrir cette raison ; mais ces cas sont très rares. Les cas habituels sont ceux dans lesquels, ou bien il n'y a pas de raison logique, ou bien, s'il y en a une, nous ne savons pas la trouver, et nous en imaginons une autre.
§ 1123. Les wahabites défendent l'usage du tabac. Pour eux, cette substance est tabou. Dans ce cas, il est inutile de chercher un motif archéologique, puisque la prohibition est récente. Palgrave a cherché une explication logique de ce tabou [FN: § 1123-1]. Il la trouve dans la « (p. 80) passion des sectaires pour les signes de ralliement bien tranchés ». Il y a là du vrai, en ce sens que les sectaires imitent des usages qui sont propres à la secte. Mais ensuite Palgrave s'écarte quelque peu de la réalité, quand il y ajoute des motifs de desseins logiques des chefs de la secte [FN: § 1123-2]. S'il disposait de documents et d'observations directes pour le prouver, il n'y aurait qu'à accepter l'explication. Mais celle-ci n'est qu'une induction issue de la prémisse implicite que les tabous doivent avoir une raison logique, qu'on tente de découvrir en tenant compte des intentions du législateur.
§ 1124. En général, cette voie est trompeuse. Les fondateurs de religions ne sont pas des hypocrites astucieux, qui veulent atteindre certains buts par des chemins couverts. L'apôtre est généralement un homme persuadé de sa religion ; et c'est même une condition presque indispensable pour qu'il puisse persuader autrui. Par conséquent, lui attribuer des intentions astucieuses et fourbes, quand on manque de documents, éloigne du vrai, selon toute probabilité. Cela n'empêche pas qu'après la prohibition du tabac, survenue pour des raisons multiples que nous ignorons, le fait qu'elle était un moyen facile de distinguer les wahabites des autres musulmans, ait contribué à la maintenir, ainsi que le remarque Palgrave. Les explications logiques que les wahabites donnent eux-mêmes de la prohibition du tabac, appartiennent aux dérivations.
§ 1125. Dans les tabous, il y a des usages si étranges qu'ils défient toute explication logique possible. Par exemple, voyez ce que dit Frazer [FN: § 1125-1]. Qui voudrait d'autres faits en trouverait tant et plus dans les relations de voyages. Mais sans nous éloigner de nos pays, voyez les usages étranges de beaucoup de nos sectes, comme celles des Francs-Maçons ou des Bons-Templiers. Celle-ci est une secte anti-alcoolique. Dans une réunion secrète tenue à Lausanne, on ne voyait que son huissier, vêtu de rouge flamboyant. Qui trouvera le rapport qu'il peut y avoir entre cette couleur et l'anti-alcoolisme ?
§ 1126. (IV-β 2) Uniformité imposée aux autres. Non seulement l'homme imite pour s'uniformiser avec les autres : il veut que les autres fassent de même. Si un autre homme s'écarte de l'uniformité, cela paraît détonner et produit, indépendamment de tout raisonnement, une impression de malaise chez les personnes qui sont en rapport avec lui. On tâche de faire disparaître le contraste par la persuasion ; plus souvent parle blâme ; plus souvent encore par la force. Comme d'habitude, les vains discours logiques ne manquent pas, pour expliquer cette attitude. Mais la cause n'est pas de celles qu'on indique : elle réside, au moins en grande partie, dans le sentiment d'hostilité aux transgressions d'uniformité, auquel s'ajoutent des sentiments d'ascétisme et d'autres semblables.
§ 1127. Le besoin d'uniformité est particulièrement puissant dans les matières où l'on prétend faire usage de la logique. Au point de vue logique, le comble de l'absurde semble être atteint par une doctrine qui condamne un homme au bûcher parce qu'il ne pense pas comme les autres, sur une question de théologie, incompréhensible à tout homme raisonnable. Mais ce jugement n'a de valeur que pour la dérivation, pour le motif logique qu'on a imaginé à l'acte exécuté. L'acte lui-même n'est que la manifestation du sentiment d'hostilité à une transgression estimée très grave par rapport à l'uniformité. Aujourd'hui, on ne brûle plus les transgresseurs, parce que toute l'échelle des pénalités a été diminuée ; mais on condamne à la prison des gens qui prêchent le malthusianisme. Il est permis de ne pas croire à la présence réelle de Jésus Christ dans l'hostie, mais il n'est pas permis de croire que celui qui n'a pas les moyens d'entretenir des enfants fait mieux de ne pas leur donner naissance, et d'employer des moyens aptes à empêcher la conception [FN: § 1127-1]. Il est extraordinaire que les gens qui condamnent ces derniers hérétiques pleurent les premiers ; que le persécuteur des hérétiques de la religion sexuelle parle avec horreur de ceux qui persécutaient les hérétiques de la foi catholique ; qu'il les traite d'ignorants fanatiques, et dise et croie de bonne foi être beaucoup plus qu'eux sage, savant et dépourvu de préjugés. C'est bien ce qui se passe. Il y a des gens qui croient que pour condamner la religion catholique, il suffit de citer l'Inquisition et les tortures qu'elle infligeait aux hérétiques, tandis qu'ils admirent des juges anglais qui condamnent à la peine du fouet ceux qui ne sont accusés d'autre chose que d'avoir vendu des dessins obscènes [FN: § 1127-2].
Joinville raconte comment Saint Louis punissait les blasphémateurs de sa foi [FN: § 1127-3]. C'est un grand scandale pour nos libres penseurs, qui estiment très juste que ceux qui s'avisent de blasphémer contre l'un de leurs dogmes, soient également punis. Les fanatiques de la sainte Science disent vouloir demeurer dans le domaine de la logique et de l'expérience ; c'est même pour cela qu'ils s'estiment si supérieurs aux croyants d'autres religions. Mais si vraiment l'on veut rester dans ce domaine, il est impossible de démontrer que faire voir le dessin d'une femme nue est un plus grand crime que blasphémer contre le dieu d'une religion quelconque, ni que les crimes de la première espèce causent plus de tort à la société que ceux de la seconde. C'est justement pourquoi, ne pouvant s'appuyer sur la raison, les fanatiques, dans tous les pays et dans tous les temps, sont portés à recourir à la force, pour imposer à autrui les uniformités qui leur sont chères. Le même Joinville raconte une anecdote, où l'on voit ce recours à la force exposé naïvement et sans aucune hypocrisie. Les catholiques invitent les Juifs à une discussion. Un chevalier des premiers n'emploie d'autre argument que les coups, et le bon roi l'approuve et le loue [FN: § 1127-4]. « Voilà l'effet de la « superstition catholique », diront quelques-uns de nos contemporains. Un instant. Ce chevalier a eu le grand honneur d'être le précurseur du sénateur Bérenger, qui oppose à ses contradicteurs, non pas des raisonnements, mais des dénonciations au procureur de la république, et qui se trouve exactement dans le cas où le roi Louis voulait qu'on usât de la force ; car il est difficile à M. Bérenger de démontrer sa foi d'une autre manière [FN: § 1127-5].
§ 1128. Le besoin d'uniformité n'existe pas également dans tous les sens. N'étant pas le moins du monde théologiens, les Romains n'imposaient l'uniformité que pour les actes extérieurs du culte. Le gouvernement chinois tolère toutes sortes de religion, pourvu qu'elle soit soumise à l'État. Les gouvernements modernes séquestrent les journaux où l'on représente une femme nue, et laissent vendre les journaux qui prêchent le sac, l'incendie et le meurtre des bourgeois [FN: § 1128-1].
§ 1129. En outre, ces manifestations de l'instinct d'uniformité sont irrégulières et déraisonnables, comme presque toutes les manifestations de semblables instincts. À Athènes, on fit peu de procès pour impiété, et les impies étaient nombreux. Les persécutions des Romains contre les chrétiens furent faites sans suite ni méthode. Les persécutions qui furent opérées par l'Église catholique furent beaucoup mieux ordonnées, plus logiques, parce qu'elles n'étaient pas une pure manifestation de l'instinct d'uniformité. L'Église catholique disciplina la matière et y ajouta un peu de logique. La logique tend à disparaître, dans les persécutions des gouvernements modernes, contre les hérétiques de la religion sexuelle qui est aujourd'hui officielle. On laisse vendre, sans le moindre obstacle, des livres très obscènes. On saisit des journaux beaucoup moins obscènes. Certains auteurs sont condamnés ; d'autres jouissent de l'impunité, sans qu'on puisse trouver le moindre motif raisonnable pour justifier cette différence. On porte plainte à tort et à travers. Il semble qu'on voie une de ces grosses mouches qui ne savent trouver la sortie d'une chambre où elles sont enfermées.
L'attitude de certains gouvernements à l'égard de l'anti-militarisme, ne paraît pas moins étrange. En Allemagne, cette doctrine a toujours été réprimée ; mais en France et en Italie, elle est tantôt tolérée, tantôt poursuivie. En France, on met Hervé en prison, et on laisse les instituteurs prêcher l'anti-militarisme à l'école ; bien plus, pour défendre l'école laïque, on menace de la prison et de l'amende ceux qui les désapprouvent. En Italie, il y a peu d'années, il était permis de prêcher l'anti-militarisme et de vilipender l'armée. En 1912, on fait un procès à la Propaganda de Naples, pour des articles anti-militaristes, parmi lesquels s'en trouve un d'un haut officier de l'armée, publié en 1887, dans la Riforma sociale. La contradiction apparente disparaît, si l'on prend garde que l'œuvre du gouvernement suit, épouse les variations des dérivations que le sentiment d'une partie de la population veut uniformes ; et parmi tous ces changements persiste le besoin d'uniformité.
§ 1130. (IV-β 3) Néophobie. C'est le sentiment qui empêche les innovations qui viendraient à troubler l'uniformité. Il est très fort chez les peuples sauvages ou barbares, et notable encore chez les peuples civilisés, où il n'est surmonté que par l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe).
§ 1131. À Paris, en février 1911, le peuple se jeta sur des femmes portant la jupe-culotte, et les frappa. Des faits semblables eurent lieu en Italie, en Espagne, un peu partout. Auparavant, on les avait aussi observés pour les grands chapeaux, ou pour d'autres innovations de la mode.
§ 1132. Il faut remarquer que parmi les personnes affectées de ces néophobies, il y en a beaucoup pour lesquelles, au contraire, tout ce qui est nouveau en politique ou en religion doit être bon, par cela seul que c'est nouveau. Elles sont froissées des innovations des tailleurs et des modistes, tandis qu'elles sont indignées parce que le Pape n'accepte pas les innovations des modernistes, et blâment tout retard des gouvernements dans l'acceptation des innovations sociales. C'est une preuve nouvelle que les résidus contradictoires peuvent subsister ensemble dans l'esprit d'un même homme. Les résidus de la religion du Progrès, qui contrastent avec ceux de la néophobie, sont dans ce cas.
On pourrait aussi envisager le contraire de la néophobie, soit l'amour des innovations ; mais on peut se demander s'il est directement un sentiment, ou s'il n'est plutôt que l'effet des sentiments qui poussent aux combinaisons et, de nos jours, aussi des sentiments d'adoration pour le dieu Progrès.
§ 1133. (IV-γ) Pitié et cruauté. Ces sentiments contraires doivent être étudiés ensemble. Comme nous l'avons déjà observé (§ 911), la classe contraire à tous les deux serait l'indifférence. Il n'est pas facile de distinguer le sentiment de pitié de beaucoup d'autres qui en prennent la forme. Il est incontestable que, depuis un siècle jusqu'à présent, la répression des crimes est devenue toujours plus faible. Il ne se passe pas d'année qu'on ne fasse de nouvelles lois en faveur des délinquants, tandis que celles qui existent sont appliquées par les cours et par le jury, avec une indulgence toujours croissante. Il semblerait donc que la pitié envers les délinquants va en augmentant, tandis que celle envers leurs victimes va en diminuant.
§ 1134. D'autre part, il y a des cas dans lesquels ce peut être la pitié en général qui va en augmentant ; et la différence notée dépend du fait que les délinquants mis en jugement sont présents, tandis que les victimes sont absentes. Les sentiments de pitié sont surtout intenses pour ceux qui sont présents ; ils sont beaucoup plus faibles pour ceux qui sont absents. Le jury voit l'assassin et éprouve de la pitié pour lui. Le même fait se produit aussi avec les juges. On ne voit pas la victime : elle a disparu ; y penser devient un devoir pénible. Notez que ces mêmes jurés qui ont aujourd'hui absous un assassin, s'ils assistent demain à un assassinat, voudront peut-être, avec le reste de la foule, lyncher celui qui a commis le crime.
§ 1135. À ce propos, le livre chinois de Meng-Tseu contient un récit caractéristique. Un roi voit passer un bœuf qui doit être sacrifié. Il en a pitié et ordonne qu'on y substitue un mouton. Il avoue que cela est arrivé parce qu'il voyait le bœuf et qu'il ne voyait pas le mouton [FN: § 1135-1].
§ 1136. Mais il y a d'autres cas, où l'assassin a disparu, tandis que les victimes restent ; et il est évident que, quand cela se produit, le raisonnement que nous venons de faire ne tient plus. Un cas qui peut servir de type à une classe étendue de faits, est celui de Liabeuf [FN: § 1136-1], voleur, souteneur, assassin, qui fut glorifié par certains révolutionnaires, parce qu'il tua un agent de police, et pleuré par de belles dames [FN: § 1136-2] et par de riches bourgeois qui s'adonnent au sport de la pitié tolstoïenne ou de toute autre espèce analogue. Chez les révolutionnaires, l'action peut être logique : ils sont ennemis de la police ; il est donc naturel qu'ils favorisent ceux qui la combattent. Chez certains bourgeois, l'action peut aussi être logique, avec le but d'obtenir la faveur de certains électeurs et de certains politiciens. Mais il n'en reste pas moins des individus pour lesquels ces raisons ou d'autres semblables n'ont pas de valeur, et qui accomplissent par conséquent des actions non-logiques, sentimentales. Celles-ci sont complexes. Il n'y a pas seulement chez eux un sentiment générique de pitié, mais bien un sentiment spécial de pitié pour le malfaiteur, d'autant plus intense que ce dernier est plus malfaisant. S'il n'y avait eu qu'un sentiment générique de pitié chez les bourgeois qui, poussés par le sentiment, demandaient la grâce de Liabeuf, le pleuraient, le favorisaient, ce sentiment aurait dû se manifester pour la victime et sa veuve, au moins autant que pour l'assassin. Au contraire, aucun de ces bourgeois ne songe le moins du monde à la pauvre veuve de l'agent Deray, tué par Liabeuf [FN: § 1136-3]. Qu'on y ajoute la vive opposition de beaucoup de gens à ce qu'on permette aux agents de police de faire usage de leurs armes, pour leur propre défense [FN: § 1136-4]. Il fallut les exploits des apaches Garnier, Bonnot et Cie, pour que la peur de maux futurs l'emportât sur la pitié humanitaire chez les bons bourgeois, et pour que le gouvernement permît enfin aux agents de police de faire usage de leurs armes contre les malfaiteurs qui voulaient les tuer.
§ 1137. Les sentiments sont toujours quelque peu complexes et souvent très complexes. Par conséquent, pour faire une analyse scientifique, nous devons avoir en vue principalement, non pas les personnes, mais les sentiments. Si donc nous examinons ceux-ci, nous serons amenés à décomposer la masse complexe des sentiments de pitié pour les malfaiteurs, de la façon suivante : l° le résidu sexuel : on le rencontre dans presque tous les jugements de crimes dits passionnels. 2° les résidus des sentiments des sectes, du patriotisme et d'autres analogues : nous sommes très indulgents envers les individus appartenant à notre collectivité ; indifférents ou même hostiles envers qui n'y appartient pas ; 3° les résidus de la IIe classe. La foi religieuse et la foi politique nous rendent bienveillants envers qui partage nos sentiments ; malveillants envers qui ne les partage pas. En outre, il faut tenir compte de l'avantage personnel de celui qui fait montre de pitié pour en retirer quelque avantage. C'est là une action logique. On peut diviser en trois genres les autres résidus se rapportant à la pitié. Dans l'un, prévaut le sentiment de ses propres souffrances, qui se reflète sur celles d'autrui (IV-γ 1). Dans les deux autres, le sentiment est moins personnel ou ne l'est pas du tout ; il conduit à une répugnance instinctive (IV-γ 2) pour la souffrance d'autrui, ou à une répugnance raisonnée (IV-γ 3).
§ 1138. (IV-γ 1) Pitié pour soi reportée sur autrui. Les gens qui sont malheureux, qui ont la tendance d'accuser de leurs maux le milieu dans lequel ils vivent, la société, sont portés à la bienveillance envers tous ceux qui souffrent. Ce n'est pas un raisonnement logique, mais une suite de sensations. Si nous voulons les exprimer sous forme de raisonnement, nous leur enlevons ce qui leur donne précisément de la force et de la vigueur, c'est-à-dire l'indétermination. En tenant compte de cette restriction, voici à peu près le raisonnement qui correspond à ces sensations : « Je suis malheureux ; c'est la faute de la société. Un tel est malheureux, ce doit donc être aussi la faute de la société ; nous sommes compagnons d'infortune ; j'ai pour mon compagnon l'indulgence que j'aurais pour moi-même, j'ai pitié de lui ».
§ 1139. On trouve quelque chose de semblable dans l'humanitarisme de notre époque. Des gens qui ne vivent pas dans de bonnes conditions économiques sont persuadés que c'est la faute de la société. Par analogie, ils estiment aussi que les délits des voleurs, des assassins, sont de même l'effet des fautes de la société. Aussi, voleurs et assassins leur paraissent-ils être des frères malheureux, dignes de bienveillance et de pitié. Les « intellectuels » sont persuadés de n'avoir pas une place suffisante dans la hiérarchie sociale. Ils envient les riches, les militaires gradés, les prélats, etc., en somme le reste de la haute classe sociale. Ils supposent que les pauvres, les délinquants sont, eux aussi, victimes de cette classe. Ils se sentent en cela semblables à eux ; c'est pourquoi ils éprouvent de la bienveillance et de la pitié pour eux. Quand le procès de la Tarnowska se déroulait à Venise, l'accusée reçut une poésie qui lui était adressée par une maîtresse d'école. Celle-ci lui souhaitait une prompte libération. Il se peut que cette maîtresse d'école fût une femme honnête, mais malheureuse, et que le malheur la fit compagne de l'accusée, pour laquelle elle ressentait de la pitié. Les romans de George Sand, les Misérables de Victor Hugo se sont largement vendus à des gens qui éprouvaient des sentiments semblables. Certaines femmes éprouvent indistinctement le sentiment qu'il leur serait agréable d'avoir un mari qui pourvût à leur entretien et à leur luxe, et beaucoup d'amants qui satisfissent leurs désirs amoureux. Certains hommes trouvent de même commode de faire entretenir par d'autres les femmes dont ils jouissent. Tous ces sentiments trouvent leur expression dans une théorie dite « du droit au bonheur ». En d'autres termes que ceux du beau langage, c'est simplement le droit à l'adultère. On a, par conséquent, des sentiments de bienveillance pour l'adultère, et même un peu pour les souteneurs.
§ 1140. Ces sentiments peuvent aussi agir de manière à pousser à la rebellion, aux attentats. Quand les brigands Bonnot et Garnier [FN: § 1140-1] eurent trouvé la mort, dans leur conflit avec la police, beaucoup de gens, quand ils se croyaient lésés par elle, même pour une simple contravention, criaient : « Vive Bonnot ! » Les attentats contre les souverains, les présidents de républiques, les hommes très en vue, sont souvent l'œuvre de toqués qui souffrent et donnent libre cours à leur sentiment, en s'en prenant, au hasard, à la première personne revêtue d'une dignité éminente, qu'ils rencontrent.
§ 1141. L'existence de ces résidus rend probable la bonne foi de beaucoup de ceux qui, demandant des avantages pour eux-mêmes, disent les demander pour la « société ». Il se peut donc qu'un grand nombre de ceux qui font du socialisme pratique en obtenant des avantages pour eux-mêmes, croient faire du socialisme théorique, où les avantages seraient pour tous, ou du moins pour le plus grand nombre.
§ 1142. (IV-γ 2) Répugnance instinctive pour la souffrance en général. C'est un sentiment de répulsion à la vue de la souffrance, sans qu'on s'inquiète le moins du monde si elle peut être utile. Il a donné naissance au proverbe italien : Le médecin pitoyable fait la plaie infecte. Ce sentiment s'observe souvent chez les êtres faibles, veules, privés d'énergie [FN: § 1142-1] ; et il arrive que quand ils réussissent à le vaincre, ils deviennent très cruels. Cela explique l'observation faite en plusieurs circonstances, que les femmes sont plus pitoyables et aussi plus cruelles que les hommes.
§ 1143. Chez les Grecs et chez les Romains, la coutume qu'avaient les pères de famille, de sacrifier des animaux, a probablement empêché le développement du genre de pitié noté ici. C'est à lui que recourent souvent ceux qui condamnent toutes les guerres. Ils insistent principalement sur les souffrances des blessés et des morts, sans s'arrêter à considérer l'utilité qu'elles peuvent avoir. Mais parmi ces humanitaires, il en est qui oublient facilement ces déclamations, quand d'autres sentiments l'emportent. On doit prendre en considération les souffrances des blessés et des morts, seulement lorsque cela peut être utile à certains pacifistes (§ 1559). Ce genre de pitié se retrouve abondamment chez les élites en décadence. Il peut même servir de symptôme de cet état.
§ 1144. (IV-γ, 3) Répugnance raisonnée pour les souffrances inutiles. Ce sentiment est propre aux êtres forts, énergiques, qui savent ce qu'ils veulent, et sont capables de s'arrêter au point précis qu'ils estiment utile d'atteindre. Instinctivement, les sujets d'un gouvernement comprennent très bien la différence entre ce genre de pitié et le précédent. Ils respectent, estiment, aiment la pitié des gouvernements forts ; raillent et méprisent la pitié des gouvernements faibles. Pour eux, la seconde est de la lâcheté ; la première, de la générosité. Le terme inutile est ici subjectif : il désigne un sentiment de celui qui l'emploie. En certains cas, on peut aussi savoir que certaines choses sont objectivement inutiles à la société ; mais en un très grand nombre d'autres, on demeure dans le doute, et la sociologie est bien loin d'être assez avancée pour pouvoir trancher cette question. Pourtant, conclure d'une possibilité éventuelle et lointaine d'une utilité quelconque, que les souffrances infligées sont utiles, serait un raisonnement erroné. Il faut se décider suivant les probabilités plus ou moins grandes. Il serait évidemment absurde de dire qu'il peut être utile de tuer au hasard une centaine de personnes, parce qu'il peut se trouver parmi elles un futur assassin. Mais, au contraire, un doute surgit, au sujet du raisonnement qu'on a souvent fait, pour justifier les persécutions contre les sorcières, en disant que, parmi elles, il y avait un grand nombre de vulgaires criminelles. Peut-être le doute subsisterait-il, s'il n'y avait pas quelque moyen de séparer de l'empoisonneuse la femme hystérique qui croit avoir des rapports avec le diable. Mais comme ce moyen existe, le doute disparaît et les souffrances infligées sont objectivement inutiles.
Ce n'est pas ici le lieu de continuer à exposer ces considérations, qui nous font sortir de la matière des résidus, pour nous transporter dans celle des actions logiques.
§ 1145. (IV-δ) Tendance à s'imposer à soi-même un mal pour le bien d'autrui. La vie en société a pour fondement nécessaire une bienveillance réciproque des individus. Ce sentiment peut être fort ou léger, mais ne peut faire entièrement défaut. Il se manifeste chez les animaux comme chez les hommes par une aide mutuelle et par la commune défense, ou bien, en un mot, par le fait que l'individu souffre pour le bien d'autrui. On observe aussi de semblables phénomènes chez les animaux qui ne vivent pas en société, dans leurs rapports avec leur progéniture qui est nourrie par l'un des parents ou par tous les deux. La lionne partage sa proie avec ses lionceaux ; le faucon et sa femelle avec leurs petits. On peut voir, dans nos maisons, le canari donner la becquée à sa femelle et à ses petits.
§ 1146. Tous les faits connus induisent à croire que le sentiment grâce auquel l'homme aide et défend la famille et la collectivité à laquelle il appartient est, au moins en partie, semblable à celui qu'on observe chez les animaux. La différence consiste en ce que l'homme recouvre ses actions d'un vernis logique. On a fait de très belles théories pour démontrer que l'homme doit aimer sa patrie. Mais l'effet de ces théories est presque nul. En tout cas, il est insignifiant, en comparaison du sentiment non-logique qui pousse au patriotisme. Il faut vraiment avoir l'esprit malade des songe-creux du « contrat social », de la « dette sociale », de la « solidarité », pour se figurer que les hommes défendent leur patrie comme l'associé d'une entreprise commerciale paie sa quote part.
§ 1147. Les sentiments par lesquels un homme s'impose un mal, afin d'être utile à autrui, agissent sur les individus composant une collectivité, non seulement pour les pousser directement à exécuter certains actes, mais aussi pour les induire à approuver, ou même à admirer ceux qui les accomplissent. Par ce moyen, ils agissent indirectement sur l'individu qui est poussé à exécuter certains actes, non seulement par son sentiment favorable à ces actes, mais aussi, et souvent plus encore, par le désir d'obtenir l'approbation d'autrui, d'en éviter le blâme. Vice versa, ainsi que nous le verrons en général au § 1161, là où nous trouvons certains actes exécutés pour satisfaire ce dernier désir, nous pouvons conclure avec certitude que, dans la collectivité, il existe des sentiments correspondant aux résidus de l'espèce (δ).
§ 1148. (IV-δ 1) Tendance à exposer sa vie. On expose ou même on sacrifie sa vie, poussé par un sentiment intime de sociabilité, et par l'importance qu'on attache à l'estime d'autrui. Chez les animaux, il semble que le premier sentiment puisse seul agir. Des mâles polygames ont l'habitude de défendre leurs femelles. Il est commun d'observer que le coq défend ses poules, le taureau ses vaches. Quand des animaux domestiqués, même d'espèces différentes, vivent ensemble, ils se défendent réciproquement. On voit un chien défendre le chat de la maison, et celui-ci défendre un petit chien. Chez les hommes, il est impossible, dans le plus grand nombre des cas, de distinguer un sentiment de ce genre, d'un autre sentiment qui pousse à désirer l'approbation de la collectivité. Tacite nous dit que, chez les Germains, les chefs étaient entourés de compagnons qui combattaient courageusement pour les défendre, et qui étaient notés d'infamie, s'ils revenaient vivants d'une bataille où leur chef avait péri [FN: § 1148-1]. Le général japonais Nogi, vainqueur de Port-Arthur, se tua avec sa femme, le jour des funérailles du Mikado. Dans ce cas, le sacrifice de la vie n'avait pas d'utilité directe. C'était une simple manifestation de sentiments de sociabilité, de hiérarchie, mêlés à la persistance d'agrégats des anciens Samouraï, et à des sentiments du désir de l'approbation de ceux précisément qui avaient ces sentiments.
§ 1149. (IV-α 2) Partage de ses biens avec autrui. Par degrés insensibles, de la forme précédente on passe à celle-ci, moins accusée, où l'on renonce en faveur d'autrui seulement à certaines jouissances. Là encore, les exemples sont innombrables chez les animaux et chez les hommes.
§ 1150. La fillette qui habille sa poupée et lui offre des aliments ne fait pas qu'imiter sa mère : elle manifeste aussi un sentiment qui surgit spontanément en elle, comme il se manifeste chez l'hirondelle qui a couvé pour la première fois et qui porte de la nourriture à ses petits.
§ 1151. Le présent résidu, combiné avec ceux de la IIe classe, donne lieu à des sacrifices qui sont offerts à des objets inanimés ou animés, à des morts, aux dieux. D'autres causes peuvent ensuite s'ajouter à celles-ci, dans les phénomènes plus complexes.
§ 1152. En examinant les choses d'une façon superficielle, on pourrait croire qu'on rencontre ce résidu chez tous les individus de la classe dominante qui prennent le parti de la classe sujette ; mais il n'en est pas ainsi ; et, en y regardant bien, on voit qu'on peut répartir ces individus dans les catégories suivantes. 1° Les personnes qui se mettent à la tête des gens sujets, afin d'obtenir ainsi quelque avantage politique, financier ou autre. L'histoire est pleine des faits et gestes de ceux-là. Les aristocraties tombèrent habituellement sous leurs coups. Autrefois, ils ne pouvaient employer que la violence, ce qui restreignait leur nombre. Maintenant, grâce aux moyens pacifiques des élections, leur nombre s'est accru démesurément ; car, pour assurer leur succès, il n'y a pas besoin d'une révolution. En outre, la démocratie offre un débouché à toutes les ambitions, depuis l'électeur influent d'une commune, aux conseillers communaux, provinciaux, aux députés, aux sénateurs : du modeste emploi obtenu grâce à la faveur du député, jusqu'à la charge de directeur général ou de conseiller à la Cour de Cassation. Combien de gens font aujourd'hui les socialistes pour obtenir ces charges, comme ils feraient les réactionnaires, si un gouvernement de ce genre venait au pouvoir ! 2° Des gens qui, dans l'intérêt de leurs affaires, se soumettent aveuglément aux ordres de leurs maîtres. En France, sous la Restauration, le « bon jeune homme » allait à la messe. Sous le règne de Louis-Philippe, il lisait les œuvres de Voltaire. Sous le second Empire, il était tout à son honneur de dire qu'« il ne s'occupait pas de politique ». Aujourd'hui, au contraire, il doit s'en occuper, être blocard [FN: § 1152-1], humanitaire, socialiste, peut-être même de l'opposition. Demain, peut-être devra-t-il être nationaliste. Aujourd'hui, les industriels et les financiers ont découvert qu'ils peuvent trouver leur avantage en s'alliant aux socialistes. Vous voyez des industriels et des banquiers, riches à millions, qui réclament des « lois sociales », et vous pourriez croire qu'en eux c'est le pur amour du prochain qui agit, que c'est, enflammés par cet amour, qu'ils brûlent de partager leurs biens. Mais faites bien attention à ce qui arrivera après l'adoption des « lois sociales », et vous verrez que leur richesse ne diminue pas, qu'elle s'accroît ; en sorte qu'ils n'ont rien donné du tout aux autres; au contraire, ils en ont retiré quelque chose. En France, le ministère Caillaux-Bertaux était constitué. en grande partie de millionnaires. Chez eux, même en y regardant au microscope, on ne trouvait pas trace du désir de partager ses biens avec autrui. En Italie, le ministère « démocratique » Giolitti avait à la Chambre, une majorité de gens qui paraissaient s'entendre fort bien en « affaires », spécialement lorsqu'il s'agissait des leurs. L'appui du trust métallurgique ne lui faisait pas défaut, ni celui des sucriers. Mais il est quelque peu douteux que le désir de partager ses biens avec autrui poussât tous ces braves gens. Ils devinrent nationalistes et belliqueux, quand ce fut leur intérêt ; et ils approuvèrent le suffrage universel étendu aux illettrés, quand le maître leur assura que c'était un excellent moyen d'obtenir de « bonnes élections [FN: § 1152-3] » et de gagner ainsi des sommes rondelettes.
En Angleterre, Lloyd Georges veut bien distribuer au « pauvre peuple » la fortune des lords, mais il est bon ménager de la sienne, et ne dédaigne pas les spéculations de bourse. Personne n'a jamais su ce qu'a donné à autrui son collègue John Burns ; mais tous voient ce qu'il a reçu et les beaux traitements qu'il a su obtenir... poussé par le désir de faire le bien d'autrui. 3° Les gens qui, de bonne foi, sont disposés à donner quelque chose à autrui, parce qu'ils comprennent instinctivement qu'ils recevront davantage : ils donnent un œuf pour recevoir un bœuf. Il y a chez eux le présent résidu, combiné avec d'autres qui font espérer l'avantage désiré. 4° Finalement, un petit nombre d'« intellectuels » manquant d'énergie, de connaissances, de bon sens, qui prennent au sérieux les déclamations des catégories précédentes ; mais leur nombre est très restreint, et plusieurs de ceux qu'on serait tenté de ranger dans cette catégorie appartiennent au contraire aux précédentes. 5° On ne peut enfin nier qu'il puisse y avoir des personnes ayant de l'énergie, des connaissances, du bon sens, et qui, en défendant les doctrines sociales de la solidarité, soient vraiment poussées par le désir de partager leurs biens avec autrui ; mais il n'est pas facile d'en trouver des exemples. Saint-Simon était riche et mourut pauvre et abandonné. Il semblerait donc pouvoir être cité comme l'un de ces exemples. Mais il dilapida ses biens pour se procurer des jouissances ; et dans la pauvreté, il eut l'orgueil d'être un messie, le fondateur d'une religion nouvelle. C'est là que gît le principal mobile de ses actes. Toutes ces catégories se retrouvent, par exemple, chez ceux qui suivent la doctrine de la « solidarité », qu'on invoque beaucoup plus pour demander que pour donner ; et ceux qui y croient sans arrière-pensée sont aussi rares que les merles blancs. Comme nous l'avons déjà noté (§ 1147), et comme nous le verrons encore (§ 1162), l'existence de ces diverses catégories n'enlève rien à l'importance des sentiments manifestés par les résidus du présent genre ; au contraire, elle démontre combien elle est grande ; car, fût-ce indirectement, on y recourt et l'on s'en sert sous des formes nombreuses et variées.
§ 1153. (IV-ε) Sentiments de hiérarchie. Les sentiments de hiérarchie, tant de la part des inférieurs que de celle des supérieurs, s'observent déjà chez les animaux, et sont très répandus dans les sociétés humaines. Il semble même que là où celles-ci sont quelque peu complexes, elles ne pourraient subsister sans ces sentiments. La hiérarchie se transforme, mais subsiste pourtant toujours dans les sociétés qui, en apparence, proclament l'égalité des individus. Il s'y constitue une espèce de féodalité temporaire dans laquelle on descend des grands politiciens aux plus petits. Qui en douterait n'a qu'à essayer, en France ou en Italie, d'obtenir quoi que ce soit sans l'appui de, l'électeur influent ou du député, du chef, en art, en science, dans l'administration, ou bien du camoriste. Parmi les sentiments de hiérarchie, nous pouvons placer le sentiment de déférence que l'individu éprouve pour la collectivité dont il fait partie, ou pour d'autres, et le désir d'en être approuvé, loué, admiré.
§ 1154. S'imaginer que l'ancienne féodalité, en Europe, fut imposée exclusivement par la force est une chose absurde. Elle se maintenait en partie par des sentiments d'affection réciproque, qui s'observèrent aussi dans d'autres pays où existait la féodalité ; par exemple, au Japon. On peut répéter la même chose pour la clientèle romaine, pour les maîtrises du moyen âge, pour les monarchies et, en général, pour toutes les organisations sociales où existe une hiérarchie ; celle-ci ne cesse d'être spontanée pour être imposée exclusivement ou d'une manière prépondérante par la force, qu'au moment où elle est sur le point de disparaître. Nous disons prépondérante, parce que le secours, même très atténué, de la force ne fait jamais défaut.
§ 1155. (IV-ε 1) Sentiments des supérieurs. Ce sont des sentiments de protection et de bienveillance, auxquels s'ajoutent souvent des sentiments de domination et d'orgueil. Ces derniers peuvent coexister avec des sentiments d'humilité apparente, ainsi qu'on en a des exemples dans les corporations religieuses et chez les ascètes. On peut, de bonne foi, éprouver de l'orgueil à être plus humble qu'un autre.
§ 1156. (IV-ε 2) Sentiments des inférieurs. Ce sont des sentiments de sujétion, d'affection, de respect, de crainte. Éprouver ces sentiments est une condition indispensable à la constitution des sociétés animales, à la domestication des animaux, à la constitution des sociétés humaines. En réalité, on les observe souvent, aussi chez ceux qui se disent anarchistes, et parmi lesquels il y a des hommes qui sont, mais ne s'appellent pas des chefs. Il ne manque pas d'anarchistes pour accepter avec une foi superstitieuse l'autorité de médecins et d'hygiénistes, souvent quelque peu charlatans. Les manifestations du sentiment d'autorité sont très nombreuses et fort diverses. On accepte l'autorité de qui a ou est présumé avoir quelque signe, réel ou imaginaire, de supériorité [FN: § 1156-1]. De là le respect du jeune homme pour le vieillard ; du novice pour l'homme expert ; autrefois : de l'illettré pour le lettré, de celui qui ne parlait qu'en langue vulgaire, pour celui qui s'exprimait en latin ; de l'homme du peuple pour le noble, pour un souverain souvent fort méprisable ; aujourd'hui : de l'ouvrier qui n'appartient pas à un syndicat et de beaucoup de bourgeois pour le syndicaliste ; du faible pour le fort ou celui que l'on croit tel ; de l'homme d'une race pour celui d'une autre, réputée supérieure ; de la femme pour l'homme, quand elle ne domine pas, en raison d'autres circonstances; des sujets pour le souverain ; des fidèles pour le prêtre, pour le prophète, pour l'ascète, pour l'homme que l'on croit être plus que d'autres dans les bonnes grâces de la divinité ; de l'électeur pour le politicien ; de l'homme simple pour l'homme mystérieux, pour le devin, pour le charlatan ; aujourd'hui, spécialement pour le médecin, pour l'hygiéniste, pour qui préconise des « mesures sociales », pour qui se révèle prêtre du dieu Progrès ; de pauvres d'esprit pour la femme libre, qu'ils se figurent dépourvue des appétits de son sexe ; de l'ancienne béguine pour quelque moinillon ; de la nouvelle béguine pour les pontifes de l'humanitarisme ; et ainsi de suite.
§ 1157. En vertu de la persistance des abstractions (§ 1060 et sv.), le sentiment d'autorité peut se détacher plus ou moins de l'homme, et s'attacher au signe, réel ou présumé, de l'autorité. De là naît l'utilité, pour qui jouit de l'autorité, de maintenir le prestige, l'apparence de la supériorité. L'écart peut être complet, et le sentiment d'autorité peut s'appliquer à des objets inanimés ; ainsi le respect que beaucoup de personnes portent à ce qui est écrit, imprimé, et, en certains pays, écrit sur papier timbré (§ 1430). Ce résidu tient une place plus ou moins grande en d'autres phénomènes, comme le fétichisme, l'adoration des reliques, etc.
§ 1158. Dans la Mandragore de Machiavel, le préjugé vulgaire du respect envers qui parle latin est fort bien mis en lumière [FN: § 1158-1]. Molière s'en moque aussi. Mais il y eut un temps où c'était l'opinion des gens bien pensants, que l'on devait chercher la vérité historique dans les textes latins, et qu'un texte méritait créance, par le seul fait qu'il était écrit en latin [FN: § 1158-2]. En des temps même très rapprochés de nous, on croyait qu'un manuscrit était certainement d'autant meilleur qu'il était plus ancien. La paléographie a montré que certains manuscrits anciens sont moins corrects que d'autres, plus récents.
§ 1159. En Angleterre, il existait un singulier privilège, dit privilegium clericale, the benefit of Clergy, par lequel certaines personnes échappaient à la condamnation, au moins une première fois, quand elles avaient commis un crime. Ce privilège s'appliquait non seulement à ceux qui étaient dans les ordres sacrés, mais à quiconque savait lire. Blackstone, qui veut en donner un motif logique, dit [FN: § 1159-1] qu'« en ces temps, l'ignorance et la superstition étaient si grandes que quiconque savait lire et écrire était appelé clerc, clericus, et de ce fait, sans être dans les ordres sacrés, jouissaient des immunités du clergé ». Mais les hommes de ce temps n'étaient pas assez stupides pour considérer comme appartenant au clergé des gens qu'ils savaient fort bien ne pas y appartenir. Le privilège n'avait donc pas cette origine. Il provenait, au contraire, du respect qu'on avait pour le clergé et pour d'autres catégories analogues de citoyens. Le roi Jacques Ier, par son Statut 21, c. 6, étendit aux femmes, même si elles ne savaient pas lire, le privilège du clergé, lorsqu'elles seraient convaincues d'un vol d'une valeur moindre que dix shellings. Les Statuts 3, 4, 5, de Guillaume et de Marie étendirent sans restriction aux femmes le privilège du clergé, dont jouissaient les hommes. Il est donc évident que, même en un temps assez rapproché de nous, c'était là simplement un privilège accordé à certaines catégories de personnes, estimées dignes d'égards spéciaux, et parmi lesquelles se trouvaient justement celles qui savaient lire et écrire.
§ 1160. (IV-ε 3) Besoin de l'approbation de la collectivité. C'est l'un des cas où apparaît le mieux la différence entre le sentiment et sa manifestation, qui constitue le résidu. Le besoin que l'individu éprouve d'être bien vu de la collectivité, d'en obtenir l'approbation, est un sentiment très puissant [FN: § 1160-1], et c'est vraiment le fondement de la société humaine. Mais il agit tacitement, souvent sans être exprimé. Il arrive même que celui qui recherche le plus l'admiration, la gloire, fasse semblant de ne pas s'en soucier. Il peut aussi arriver, bien que cela paraisse étrange, que chez un même individu cette préoccupation existe réellement, tandis que, sans s'en apercevoir, il se laisse effectivement guider par l'approbation ou par l'admiration d'autrui. Cela se voit chez les ascètes de bonne foi.
§ 1161. Presque toujours, les sentiments de sociabilité, manifestés par les diverses espèces de résidus que nous examinons, sont accompagnés par le sentiment du désir d'être approuvé par autrui ou d'en éviter le blâme. Mais il n'est pas tellement fréquent que ce sentiment se manifeste au moyen du résidu correspondant. Vice versa, ce résidu en recouvre parfois d'autres. Par exemple, un individu dit être poussé par le désir d'obtenir l'estime d'autrui, tandis que, dans une certaine mesure, aussi faible soit-elle, il est aussi poussé par le désir d'accomplir la chose qui mérite cette estime. Quand un homme fait une chose en disant: « Ceci est bien », ou s'abstient d'en faire une autre, en disant : « Ceci est mal », on peut se demander si ces expressions signifient : « Ceci est approuvé par la collectivité – ceci est blâmé par elle », ou bien: « Ceci s'accorde avec mon sentiment – ceci y répugne ». Généralement, ces deux causes agissent ensemble : l'approbation ou le blâme de la collectivité renforce le sentiment qui existe déjà chez l'individu (§ 163). Il peut assurément se trouver un parfait hypocrite qui, n'ayant aucune envie de faire une chose, l'accomplit pour obtenir l'estime publique. Il peut se trouver un lâche qui se fait tuer à la guerre, pour fuir l'infamie de la lâcheté. Mais ces gens ne sont pas si fréquents. Habituellement, celui qui a un faible désir de faire une chose l'accomplit pour obtenir l'estime publique ; celui qui est courageux s'exalte et se fait tuer, poussé par l'idée de la gloire.
§ 1162. Remarquons que, pour montrer l'importance du sentiment correspondant à notre résidu, il faut aussi tenir compte des cas notés tout à l'heure, où l'individu n'est pas du tout ou pas entièrement poussé par un sentiment correspondant à ce résidu, mais bien, en tout ou partie, par le désir d'obtenir l'approbation de la collectivité ou d'en éviter le blâme; car si ce résidu n'agit pas directement sur l’individu, il agit indirectement, par le moyen de l'approbation ou du blâme d'autrui ; et c'est parce que ce sentiment est fort dans la collectivité, que l'approbation et le blâme sont puissants. Même l'ascète parfaitement hypocrite démontre la puissance de l'ascétisme, dans la collectivité dont l'opinion lui importe. L'hypocrisie de l'ascète lui est utile, et se produit uniquement dans la mesure où l'ascétisme est approuvé, admiré par cette collectivité ; si elle le réprouvait ou ne s'en souciait nullement, l'hypocrisie n'aurait plus de but.
§ 1163. (IV-ζ) Ascétisme. Chez les hommes, on observe un genre spécial de sentiments, qui n'a aucune correspondance chez les animaux, et qui pousse l'individu à s'infliger des souffrances, à s'abstenir de plaisirs, sans aucun but d'utilité personnelle, à aller au rebours de l'instinct qui pousse les êtres vivants à rechercher les choses agréables et à fuir les choses désagréables. Voilà le noyau des phénomènes connus sous le nom d'ascétisme.
§ 1164. Si nous ne connaissions qu'un genre d'ascétisme, par exemple l'ascétisme catholique, nous pourrions difficilement distinguer du résidu la dérivation. Un homme fait pénitence, parce qu'il croit être agréable à Dieu et faire amende honorable de ses péchés. Ce sentiment religieux pourrait être le résidu, et la pénitence, la conséquence logique du résidu. En effet, i1 y a des cas où il semble bien qu'il en soit ainsi. Mais il y a d'autres cas, dans lesquels la partie variable est la raison de la pénitence ; bien plus, où la pénitence elle-même devient une simple renonciation aux biens de la vie ; et c'est là la partie constante. Tandis que les motifs varient avec la diversité des idées que l'homme a de la divinité, il reste une partie constante, qui est l'idée religieuse en général. Mais voici qu'il y a des ascètes, comme les anciens cyniques, dépourvus de toute idée religieuse, et par conséquent cette partie constante s'évanouit aussi [FN: § 1164-1]. Voici les Spartiates qui sont ascètes, uniquement pour maintenir une forte discipline ; voici les bouddhistes, qui sont ascètes pour mettre un frein à toute énergie vitale ; voici finalement, parmi nos contemporains, des gens qui se font ascètes au nom de la sainte Science, laquelle, à ce qu'ils disent, condamne l'usage des boissons alcooliques ; d'autres ont peur de regarder une belle femme, au nom d'une morale sexuelle qui leur est propre, en vertu de laquelle – on ne sait pourquoi – le plaisir sexuel est le pire des pires crimes ; en voici d'autres qui ne peuvent souffrir la littérature amusante ; d'autres encore, qui font la guerre aux œuvres théâtrales qui n'engendrent pas l'ennui, qui ne « résolvent pas quelque question sociale »; et ainsi de suite. Il est donc manifeste que la partie constante se trouve dans les souffrances que les hommes s'infligent à eux-mêmes ; la partie variable, dans les motifs qu'ils ont – ou prétendent avoir – pour le faire.
§ 1165. Le résidu principal se trouve dans cette partie constante mais il n'y est pas seul. Tous les phénomènes de la société sont complexes, mélangés, renferment de nombreux résidus. Ici, outre le résidu de l'ascétisme, nous avons souvent, chez l'ascète, le résidu de l'orgueil ; car il se sent supérieur au commun des mortels, et chez ceux qui l'admirent, nous avons justement la reconnaissance de cette supériorité (§ 1161). Parfois, il y a le résidu religieux; d'autres fois, quand on veut imposer l'ascétisme à autrui, le résidu de l'uniformité ; d'autres fois encore, le résidu d'une utilité présumée, réelle ou imaginaire, etc. Il faut éliminer tous ces résidus, pour arriver à celui de l'ascétisme pur.
§ 1166. Maintenant que nous l'avons trouvé, il nous reste encore à savoir à quels autres résidus il est analogue, c'est-à-dire dans quelle classe nous devons le mettre [FN: § 1166-1]. La chose n'est pas facile ; et il semblerait presque qu'on devrait en faire une classe à part. Mais nous ne tardons pas à voir que les actes d'ascétisme font partie d'une grande classe qui comprend des actes d'abstinence, de renonciation aux jouissances, de maux qu'un individu s'inflige volontairement à lui-même. Dans cette classe, les genres se distinguent par le but de ces sacrifices et par leur intensité. Deux individus réduisent volontairement leur consommation de pain, l'un en temps de famine, pour qu'il y ait un peu de pain pour tout le monde, l'autre en temps d'abondance, dans le seul but de s'infliger une peine. Ce sont évidemment deux genres distincts d'actes, bien que le second puisse être considéré comme une manifestation différente de certains instincts qui existaient aussi chez le premier. Quatre individus s'abstiennent de boire du vin ; le premier, parce qu'il a reconnu que le vin nuit à sa santé ; le second, pour épargner l'argent qu'il consacre au vin et en faire jouir ses enfants ; le troisième, pour donner le bon exemple de l'abstinence à un ivrogne qui se ruine, lui et sa famille ; le quatrième, pour s'infliger une peine. Nous avons ainsi quatre genres différents d'actes. Le premier dépend de l'égoïsme : des résidus de l'intégrité personnelle. Le second et le troisième dépendent de l'amour du prochain, des résidus de la sociabilité. Le quatrième se distingue de ces deux derniers, d'abord parce que le but qu'on observe en eux disparaît, au moins en partie, et souvent à cause de l'intensité des sentiments, qui est habituellement plus grande. On peut donc faire une seule catégorie des trois derniers genres d'actes, et considérer le quatrième genre comme un cas particulier des instincts qui nous donnent les deux autres.
§ 1167. De cette façon nous sommes sur la voie de trouver la place des actes d'ascétisme, dans une classification naturelle : ils nous apparaissent comme des actes qui dépendent des résidus de la sociabilité, et dans lesquels s'atténue, s'affaiblit et peut même disparaître le but de la sociabilité, tandis que l'intensité s'accroît, grandit démesurément, devient hyperbolique. En général, l'abstinence d'un individu, outre qu'elle peut être utile à l'individu lui-même, cas dont nous ne nous occupons pas ici, peut être utile aux autres, à la collectivité. Là où la nourriture fait défaut, le jeûne est utile. Là où il y a peu de richesse, s'abstenir des consommations voluptuaires est utile à la collectivité. Si tous les hommes cédaient à l'instinct sexuel sitôt qu'ils voient une femme, la société humaine se dissoudrait. L'abstinence, dans ce domaine, est donc très utile ; et cela explique comment l'ascétisme sexuel est très répandu. Ce n'est pas qu'il ait artificiellement pris naissance de ce but, mais c'est parce que, comme manifestations de certains sentiments, il ne rencontra pas d'obstacles dans l'utilité sociale. Aussitôt après vient l'ascétisme alimentaire, qui se manifeste par les jeûnes, par l'usage restreint d'aliments grossiers, car le besoin de nourriture était l'un des principaux des sociétés anciennes, et les famines y étaient fréquentes. Observons que les résidus de l'orgueil, de l'admiration, et autres semblables sont aussi favorisés par ces circonstances, car s'abstenir de rapports sexuels et de nourriture est une preuve de volonté peu commune.
§ 1168. Prévoir, savoir s'abstenir d'un bien présent en vue d'un bien futur est très utile à la collectivité ; c'est même une condition indispensable à sa civilisation. L'économie, très utile à l'individu, peut s'hypertrophier jusqu'à l'avarice ; de même, pour la collectivité, l'abstention des biens présents peut s'hypertrophier jusqu'à l'ascétisme. Notons que la jouissance présente est souvent représentée par le plaisir des sens ; la jouissance future, fruit de l'abstinence et de la prévoyance, est représentée par des réflexions intellectuelles. De là naît l'un des nombreux motifs pour lesquels on subordonne les sens à l'intelligence. L'ascète va plus loin et déclare vain tout plaisir procuré par les sens. Il y a des gens qui poussent encore plus loin dans cette voie ; le plaisir des sens n'est pas seulement vanité : [Voir Addition A23 par l’auteur] il devient une faute, un crime, et l'on doit passer sa vie à mortifier ses sens. Il est souvent utile à la collectivité que l'individu se sacrifie lui-même à sa foi ; et l'admiration pour les martyrs provient, au moins en partie, de ce sentiment instinctif. L'individu qui se voue entièrement à une foi, qui ne voit rien d'autre dans le monde, semble facilement aux hommes pondérés n'être pas très sain d'esprit. En poussant à l'extrême limite dans cette voie, on trouve les ascètes chrétiens qui, par ascétisme, simulaient la folie [FN: § 1168-1].
§ 1169. L'admiration pour les signes extérieurs de l'ascétisme provient en partie de l'utilité que pourraient avoir parfois, et moyennant certaines restrictions, les actes de l'ascétisme. En général, les hommes n'y regardent pas de si près, et prennent facilement l'indice pour la chose. On trouve une autre origine du sentiment d'admiration, dans l'envie et dans le sentiment qui pousse l'homme privé de certaines jouissances à désirer que d'autres hommes en soient aussi privés. Il se sent leur compagnon, et admire ceux qui, spontanément, se privent de ce qu'une dure nécessité lui enlève. Cela explique en partie la faveur que les ordres mendiants acquirent auprès de la plèbe, et fait comprendre aussi le phénomène général de l'admiration pour la chasteté. Pour beaucoup d'êtres humains, la société de femmes jeunes et belles est un luxe qu'ils ne peuvent se procurer. La jalousie du mâle leur fait détester ceux qui peuvent en jouir. Les sentiments d'un sacrifice commun leur font admirer ceux qui, pouvant en jouir, s'en privent. Beaucoup de féministes haïssent l'homme et persécutent les femmes qui jouissent des plaisirs de l'amour, uniquement parce qu'elles n'ont pu trouver un homme qui les aime. De tout temps, on a remarqué qu'un grand nombre d'êtres humains méprisent ce qu'ils ne peuvent avoir, et tiennent pour louable ce mépris chez eux-mêmes et chez les autres.
§ 1170. Il y a certains actes qui ne semblent pas du tout pouvoir être directement utiles à la collectivité. Par exemple, quel avantage celle-ci peut-elle tirer du fait qu'un homme vit sur une colonne ? Mais il faut observer qu'indirectement, les sentiments qui se manifestent de cette façon et d'autres manières qui sont ridicules, peuvent être utiles, en tant qu'ils correspondent à une domination sur les instincts sensuels et matériels, qu'on ne trouve pas chez tous les hommes. À propos de ces actes et des autres qui, pouvant être utiles à la collectivité, entre d'étroites limites, dépassent, et souvent de beaucoup, ces limites, nous observerons que, chez l'homme comme chez l'animal, on trouve une tendance à continuer certains actes, quand même leur utilité cesse pour l'individu qui les accomplit. Ainsi, un chat qui n'a pas de souris à prendre, joue avec une boule de papier comme si c'était une souris. Des écureuils auxquels on donne autant de nourriture qu'ils en veulent, continuent à faire des provisions. Le chien auquel on donne autant de pain qu'il en veut, enterre un gros morceau de pain qui lui reste, puis le déterre pour le manger, alors qu'il en a d'autres à sa disposition.
§ 1171. Les actes de l'ascétisme sont en grande partie des actes qui ont un résidu inhérent à la vie sociale, et qui persistent quand ils ont cessé d'être utiles ; ou bien qui acquièrent une intensité qui les porte au delà du point où ils seraient utiles. Le résidu de l'ascétisme doit donc être placé parmi les résidus en rapport avec la sociabilité, et représente souvent une hypertrophie des sentiments de sociabilité.
§ 1172. Cette dernière circonstance explique pourquoi les ascètes sont souvent très égoïstes. En se développant outre mesure, l'ascétisme a attiré à lui tous les instincts de sociabilité de l'individu ; il ne lui en reste plus pour faire preuve de bienveillance envers autrui, et souvent, pas même envers sa famille [FN: § 1172-1] (§ 1187).
§ 1173. L'instinct de sociabilité est beaucoup plus développé dans la race humaine que chez les animaux. C'est pourquoi l'on ne trouve l'ascétisme que chez les hommes. De même, l'intelligence de l'homme étant très supérieure à celle des animaux, la folie est une maladie propre aux hommes.
§ 1174. Mais si le noyau de l'ascétisme est une hypertrophie de certains instincts relatifs à la sociabilité, il s'en suit, comme il arrive généralement en des phénomènes analogues, qu'autour de ce noyau se disposent d'autres manifestations qui sont étrangères à la sociabilité. L'abstention de choses utiles à autrui attire à elle, par imitation, l'abstention de choses qui ne sont d'aucune utilité à autrui, ou même de choses telles que s'en abstenir porte préjudice à autrui. L'abstention de choses utiles, comme les vêtements, les aliments et autres objets semblables, est souvent accompagnée, chez les ascètes, d'actes ridiculement inutiles, comme ceux des stylites, qui se tenaient debout sur une colonne, ou d'actes qui nuisent à la collectivité, comme la saleté, qui va souvent de pair avec d'autres actes d'ascétisme.
§ 1175. Dans nos sociétés, la manifestation de l'ascétisme qui apparaît dans les macérations et les mutilations, a presque cessé, ou a cessé entièrement. Elle aussi peut avoir été, autrefois, une hypertrophie des instincts qui poussaient les individus à souffrir pour la collectivité. Par exemple, c'était probablement le cas de la flagellation rituelle, dont nous avons des exemples en de nombreux pays et à différentes époques, avec des dérivations justificatives, variant selon les pays et les époques (§ 1190).
§ 1176. Dans les phénomènes de l'ascétisme, on observe souvent l'hypocrisie. Il semble même que le type du parfait hypocrite soit celui qui feint l'ascétisme. On en a trop dit sur ce sujet pour que nous y ajoutions quelque chose. Mais outre ce cas où le noyau de l'ascétisme disparaît entièrement des phénomènes, il y en a d'autres, où il est réduit presque jusqu'à disparaître, tandis que d'autres résidus prévalent dans le phénomène composé.
§ 1177. Quand on observe un certain nombre de cas concrets d'ascétisme, en apparence égaux, il est difficile, disons tout à fait impossible de les diviser, même approximativement, entre les différentes classes [FN: § 1177-1]. D'habitude, on se trompe autant si on y suppose en tous la bonne foi, que si l'on y voit uniquement des manifestations d'hypocrisie. Il y a des ascètes francs et sincères ; et, même pour ceux-là, nous ne savons pas ce que peut en eux le résidu de l'ascétisme ou la dérivation qui, née de ce résidu, en reproduit ensuite les actes correspondants, même quand il vient à disparaître. Il y a ceux qui sont mus par le besoin d'imiter ; chez beaucoup, il est prépondérant ; d'autres, qui sont poussés plus ou moins par leur intérêt, par des sentiments variés ou complexes, étrangers à l'ascétisme. Enfin, il y a les hypocrites. Pour ceux-là aussi, on observe divers degrés : tel est en partie ascète et en partie hypocrite ; tel autre est entièrement ou presque entièrement hypocrite [FN: § 1177-2].
§ 1178. Chez les dominicains de la vertu, qui, de nos jours, persécutent ce qu'ils appellent l'immoralité, il y a de même un petit nombre de gens convaincus, étrangers à tout plaisir sexuel. D'autres, peu nombreux, agissant avec sincérité, vainquent les désirs de la chair par l'idée « morale ». D'autres, en nombre considérable, trouvent dans leur action pour la « morale » le prétexte cherché de s'occuper de choses obscènes. Ils ne liraient pas un livre obscène par plaisir : ils le lisent pour prendre connaissance de ce qu'ils croient qu'on doit réprimer comme crime. Des femmes qui eurent beaucoup d'amants dans leur jeunesse, parvenues à l'âge mûr, s'occupent volontiers de remettre les prostituées dans le droit chemin, et jouissent par la conversation de ce qui vient à leur manquer matériellement. Jusque là, le résidu de l'ascétisme accompagne les autres ; mais il disparaît chez les hypocrites, chez les personnes qui haïssent l'autre sexe, parce qu'elles sont trop attirées par le leur ; chez celles qui compensent la lascivité de leurs actes par l'austérité de leurs paroles ; chez les pauvres d'esprit qui répètent comme des perroquets ce qu'ils entendent dire à autrui. En un mot, ce sont des actes concrets, qui ont une apparence semblable, et sont issus des causes les plus diverses [FN: § 1178-1].
§ 1179. Parmi les résidus étrangers à l'ascétisme, qui, dans les cas concrets, s'ajoutent au résidu de l'ascétisme, ceux de l'intégrité personnelle (Ve classe) sont remarquables. Ils se manifestent par l'orgueil de l'ascète ; et, grâce à eux, l'ascétisme devient une espèce de sport. Les cyniques d'Athènes jouissaient certainement de la surprise ou de l'étonnement dont, en voyant leurs actes, les autres gens faisaient preuve. Le récit du fait, vrai ou imaginé, de Platon qui, accusé d'orgueil par Diogène, lui retourne l'accusation, manifeste les sentiments que beaucoup éprouvaient pour les bizarreries des cyniques [FN: § 1179-1] ; et l'on peut en dire autant du récit que Lucien fait de la mort de Peregrinos. Quand Daniel monta sur sa colonne (§ 1187-5), il ne manqua pas de gens qui crurent qu'il le faisait par vanité.
§ 1180. En outre, dans tous les temps et dans tous les pays, la vie ascétique, sincère ou simulée, ou en partie sincère et en partie simulée, permit à beaucoup de gens d'obtenir des honneurs et des subsides du vulgaire [FN: § 1180-1]. Il convient de noter que tous les hommes ne ressentent pas également les douleurs physiques ; et, de même qu'autrefois il y avait des gens qui résistaient longtemps à la torture, et d'autres qui en étaient aussitôt accablés, de même il y en a qui supportent facilement, par ascétisme, des douleurs que d'autres ne pourraient tolérer en aucune façon. L'histoire des tatouages, des mutilations diverses, des cruautés employées contre les prisonniers de guerre, chez les sauvages américains et chez d'autres peuples, confirment ces déductions [FN: § 1180-2].
§ 1181. En Orient, on observa des faits extraordinaires d'ascétisme, et on en observe encore. Ces peuples ont pour la douleur physique l'endurance des sauvages et des brutes: aussi n'est-il pas très étonnant qu'il se trouve parmi eux des gens qui, pour se faire admirer, et parfois aussi pour gagner de l'argent, se soumettent à de cruelles pratiques. Sonnerat décrit bien les multiples formes de l'ascétisme, aux Indes [FN: § 1181-1]. Il suffira que nous rapportions ici cette citation. Elle peut servir de type à un grand nombre d'autres semblables, qu'on pourrait trouver pour divers pays.
§ 1182. Depuis les temps anciens, on trouve aux Indes des moines et des ascètes. L'étudiant des Veddas doit habiter auprès de son maître, lui obéir et le servir. On voit bien ici les résidus de la hiérarchie se mêler à ceux de l'ascétisme, tels qu'on les retrouve aussi chez les moines des couvents chrétiens. L'étudiant des Veddas doit être absolument chaste, tempérant, humble et vivre dans la pauvreté [FN: § 1182-1]. Le bouddhisme possède un code complet de la vie ascétique, en partie semblable à celui imaginé par Saint François d'Assise. C'est l'un des cas si nombreux, où des institutions semblables sont constituées spontanément sans qu'il y ait eu imitation (§ 733 et sv.). Avec peu de variantes, on trouve des pratiques analogues, en divers temps et chez différents peuples. Même à notre époque, il y a encore des gens qui les admirent. M. Paul Sabatier ne se sent pas de joie, en racontant les pratiques ascétiques, parfois très sales, de Saint François d'Assise [FN: § 1182-2]. Le résidu joue donc encore un rôle qu'on ne saurait négliger, dans les sentiments de certains hommes de notre époque. Les dérivations mettent de grandes différences entre les malpropretés des ascètes hindous, des cyniques d'Athènes, des Franciscains et d'autres sectes semblables ; mais toutes contiennent des résidus identiques.
§ 1183. Les hommes qui ne sont pas sous l'empire des sentiments correspondant à ces résidus, répètent, au sujet des ascètes de ce genre, ce que le vieux Rutilius disait déjà des moines de son temps [FN: § 1183-1], quand il s'étonnait de les voir fuir les dons de la fortune ; ou bien ils en rient, comme Lucien, de Peregrinos [FN: § 1183-2]. Comme d'habitude, les hommes louent les ascètes qui ont la même foi qu'eux et blâment les autres. Les chrétiens se moquent des ascètes hindous et admirent les leurs. Les humanitaires ne peuvent souffrir l'ascétisme chrétien, et exaltent l'ascétisme anti-alcoolique et anti-sexuel. Il y a des gens qui entrent dans une ardente colère contre l'Église catholique, à cause du célibat des prêtres, et ne voudraient pas que les jeunes gens connussent l'étreinte féminine avant le mariage. Ils ne s'aperçoivent pas, dans leur misère intellectuelle, que ces deux choses sont absolument identiques et procèdent de causes semblables.
§ 1184. Diogène [FN: § 1184-1] « en été, se roulait dans le sable brûlant ; en hiver, il embrassait les statues couvertes de neige, s'accoutumant à toute chose ». Pour vaincre ses désirs charnels, Saint François se jetait nu dans la neige [FN: § 1184-2]. Que ces récits appartiennent à l'histoire ou à la légende, ceux qui transmirent l'histoire ou composèrent la légende démontrent également, par Diogène et par Saint François, l'existence du résidu qui pousse à fuir les joies de la vie et à en rechercher les douleurs, quelle que soit d'ailleurs la raison qu'il plaise d'assigner à cette attitude. Les cyniques dégénérèrent, comme autrefois les Francicains dégénérèrent. Mais précisément le fait que tous deux, bien que dégénérés, continuaient cependant à être en faveur, démontre quelle force avaient, dans la population, les résidus qui procuraient cette faveur ; et les moqueries des gens de bon sens ne la diminuaient pas [FN: § 1184-3].
§ 1185. Philon le Juif composa un traité pour décrire la vie contemplative des Thérapeutes. On s'est demandé si le traité était bien de Philon, et aussi, avec des raisons plus sérieuses, si ces Thérapeutes furent des hommes en chair et en os, ou de simples imaginations de l'auteur. Cela importe peu, vu le but que nous poursuivons. Le fait qu'un auteur quelconque a décrit ces faits, réels ou imaginaires, démontre qu'au temps où il écrivit, il y avait un fort courant d'ascétisme. Pour le moment, c'est tout ce qu'il nous importe de noter. Les femmes étaient admises dans la secte, mais devaient rester vierges, L'horreur des rapports sexuels est une manie qui fait rarement défaut dans l'ascétisme, spécialement quand il est très intense et se rapproche des maladies mentales.
§ 1186. L'existence des Esséniens est certaine. Ils sont semblables aux ascètes hindous, et les parfaits des Albigeois leurs ressemblèrent [FN: § 1186-1]. « À l'occident, mais à une distance du rivage où il n'y a rien à craindre des exhalaisons, sont les Esséniens, nation solitaire, singulière pardessus toutes les autres, sans femme, sans amour, sans argent, vivant dans la société des palmiers. Elle se reproduit de jour en jour, grâce à l'affluence de nouveaux hôtes ; et la foule ne manque pas de ceux qui, fatigués de la vie, sont amenés par le flot de la fortune à adopter ce genre de vie ». Flavius Josèphe dit [FN: § 1186-2] « qu'ils possèdent leurs biens en commun, de telle sorte que le riche n'en jouit pas plus que le pauvre. Il y a plus de quatre mille hommes qui font ainsi. Ils n'ont ni femmes ni serviteurs, parce que ceux-ci sont une cause d'injustice, celles-là de disputes ». Il est très probable que l'auteur substitue ces causes à celles de l'ascétisme, qu'il n'a pas bien comprises.
§ 1187. Parmi les nombreuses folies des ascètes, celle des Stylites n'est pas la dernière. On donne ce nom de Stylites à certains dévots chrétiens qui passèrent une partie de leur vie sur une colonne. Le premier de ceux-ci dont on fasse mention est Saint Siméon [FN: § 1187-1], dit justement le Stylite, qui vécut au Ve siècle. Il naquit en Cilicie ; et dès sa prime jeunesse, il entra dans un monastère, puis alla dans un autre où il resta dix ans, menant une vie plus qu'austère, à tel point que, si nous voulons nous en tenir à ce que rapporte Théodoret, il ne mangeait qu'une fois la semaine, tandis que les autres moines mangeaient de deux jours l'un. En outre, il se mortifiait d'autres façons jugées tellement excessives par ses supérieurs qu'ils l'expulsèrent. Ensuite il alla s'enfermer dans une cellule, près d'Antioche, où il s'infligea des souffrances que nous nous abstiendrons de rapporter ici. Il y resta trois ans, après lesquels il se rendit sur le sommet d'une montagne, où, ceint d'une très lourde chaîne de fer, il demeura muré dans un endroit resserré. Des gens venaient à lui de toutes les parties de la terre, et il faisait toutes sortes de beaux et grands miracles [FN: § 1187-2]. À la fin, ennuyé d'un si grand concours de gens, il se tint debout sur une colonne. Il s'en fit faire d'abord une de six coudées ; puis successivement d'autres de douze, de vingt-deux, de trente-six coudées. « Il voulait ainsi voler vers le ciel et quitter la terre ». Pour le justifier, le bon Théodoret rappelle les pénitences d'Isaïe, de Jérémie, d'Osée, d'Ézéchiel [FN: § 1187-3] ; et cela devait imposer silence à ceux qui se moquaient du Stylite. Perché sur sa colonne, Saint Siméon convertit beaucoup de gens qui venaient le visiter, et Théodoret dit les avoir vus. Il n'était pas permis aux femmes d'entrer dans l'enceinte où s'élevait sa colonne, et il ne permit pas même à sa mère de le voir (§ 1172). On discute pour savoir combien d'années il demeura ainsi perché [FN: § 1187-4]. Il eut un successeur spirituel. Ce fut Daniel, qui voulut lui aussi vivre sur une colonne [FN: § 1187-5]. Ces saints hommes eurent d'autres imitateurs. On les mentionne jusqu'en l'an 806, où nous avons une lettre de Théodore Studite, qui les nomme précisément, en conseillant à l'empereur Nicéphore de choisir le patriarche de Constantinople parmi les évêques, les stylites et les reclus [FN: § 1187-6].
§ 1188. Si nous ne connaissions que les faits des stylites chrétiens, nous pourrions demeurer dans le doute, et estimer que l'acte de ces personnes était une conséquence logique de leurs croyances (§ 186, § 714, § 829). Mais on observe des faits parfaitement semblables, là où ces croyances font entièrement défaut. C'est pourquoi il se peut que ces deux genres de faits aient une cause commune, indépendante des croyances, et à laquelle rien n'empêche qu'on puisse ajouter les croyances; ajouter, disons-nous, et non substituer. De même, dans les actes d'ascétisme visant à faire pénitence, les résidus de l'intégrité personnelle (Ve classe) se mêlent à ceux de l'ascétisme ; car le pénitent a aussi en vue de se laver de ses fautes. Mais ceux de l'ascétisme reparaissent, quand la pénitence est faite pour les fautes d'autrui.
§ 1189. Quel que soit l'auteur de la Déesse syrienne, il est certain qu'il n'était pas chrétien, et qu'il ne décrivait pas des coutumes chrétiennes. Mais nous trouvons justement, dans cet écrit, d'autres stylites, au moins temporaires [FN: § 1189-1], et un genre d'ascétisme qui, en considérant les effets matériels, s'écarte peu de celui de Saint Siméon. Nous avons quatre explications du fait du stylite de la Déesse syrienne ; et, après tout, elles sont bien dignes de figurer avec celles que l'on donne des stylites chrétiens.
§ 1190. La flagellation ascétique a été un phénomène très répandu, dans l'espace et dans le temps. La flagellation des jeunes Spartiates auprès de l'autel d'Artémis Orthia, et celle des pénitents chrétiens au moyen âge, sont célèbres. Les auteurs ont recueilli un grand nombre d'autres faits semblables. Assez nombreuses sont les explications qu'on a données de ces faits. On les a considérés comme des preuves de courage et d'indifférence à la douleur ; et en cela il y a du vrai. On a dit que Lycurgue avait voulu accoutumer ses concitoyens à supporter patiemment les mauvais traitements. Les explications de ce genre sont toujours peu probables. On a dit que c'étaient les restes d'un antique usage de sacrifices humains. Cela peut être ; mais les preuves font entièrement défaut. On a dit que par la flagellation on éloignait les mauvais démons. C'est là une dérivation ; et il est probable qu'elle cache un résidu. On a dit qu'on transmettait à la victime la force et la vitalité des choses employées pour flageller. C'est là une autre dérivation. On a voulu que la flagellation eût pour effet de purifier celui qui était flagellé. Comme d'habitude, c'est une dérivation. Pour les chrétiens, la flagellation fut une manière de faire pénitence.
§ 1191. Enfin, l'explication totémique ne pouvait manquer, car maintenant le totémisme joue un rôle en toute chose. S. Reinach la fait sienne, en suivant Thomsen [FN: § 1191-1] : « (p. 180) C'est avec des baguettes de coudrier que l'on fouette les jeunes Spartiates, et la déesse qui préside à la cérémonie est elle-même la déesse du coudrier (Lygodesma, du grec lygos, coudrier). C'est avec des lanières de cuir de bouc ou de chèvres que les Luperques frappent les Romaines, et la déesse qui préside à la cérémonie, dea Luperca, participe à la fois de la louve et de la chèvre (lupus, hircus). Donc le but de la flagellation, c'est de faire passer dans le corps du patient la force et la vitalité soit de l'arbre, soit de l'animal, c'est-à-dire sans doute un ancien totem ». Ce donc est tout à fait merveilleux. Il serait vraiment à désirer que la conclusion fût unie aux prémisses avec un peu plus d'efficacité. Notez, en attendant, que l'explication ne changerait pas, quelle que soit la matière employée pour flageller. Est-ce qu'il n'y a de force et de vitalité que chez le boue et la chèvre ? Ne pourrait-on pas répéter l'explication pour le cuir d'un autre animal quelconque ? Et puis il faut admirer le saut gigantesque que l'on fait, en concluant que, si l'on veut faire passer dans celui qui est flagellé la force et la vitalité de la matière du fouet, ou que représente le fouet, ce dernier est nécessairement un ancien totem. Quand on se contente de preuves aussi faibles et aussi fragiles, on peut démontrer tout ce qu'on veut.
§ 1192. Ici, comme nous l'avons souvent dit déjà (§ 23, 670), nous ne recherchons pas les « origines », par trop obscures des phénomènes : nous cherchons, au contraire, quels sont les sentiments qui produisent certains actes. Nous ne tâchons pas de deviner ce qui s'est passé en un temps pour lequel les documents nous font défaut : nous voulons seulement étudier les faits qui nous sont connus par des documents historiques.
§ 1193. Tout d'abord, observons que les phénomènes concrets de la flagellation ne sont pas nécessairement homogènes ; et il se pourrait même, par exemple, que les coups, assurément peu douloureux, reçus par les Romaines, aux Lupercales, n'eussent que peu ou point à faire avec la flagellation très douloureuse des Spartiates. Voyons donc si nous pouvons trouver quelque phénomène de flagellation qui soit très simple et qui, par conséquent, nous fasse mieux connaître certains résidus.
§ 1194. Casati décrit justement l'un de ces faits [FN: § 1194-1]. Des jeunes gens se flagellent pour montrer leur courage et se faire admirer par les jeunes filles. Naturellement, les totémistes diront que le fouet étant en cuir d'hippopotame, le but de la flagellation est de faire passer dans les jeunes gens la force de l'hippopotame, lequel est un ancien totem. Et si le fouet était fait du cuir d'un autre animal A ou d'un végétal B, il suffirait de substituer A ou B à l'hippopotame, pour avoir toujours la même explication, qui, à la vérité, ne peut jamais faire défaut, car enfin le fouet doit pourtant être fait de quelque chose. Mais, si nous laissons de côté ces explications nuageuses, nous trouvons dans le fait raconté par Casati l'expression de sentiments que nous savons être largement répandus parmi les hommes, et qui se retrouvent donc probablement en d'autres phénomènes analogues.
§ 1195. Il serait étonnant qu'ils eussent fait défaut dans la flagellation des jeunes Spartiates. Les Spartiates s'appliquaient dans tous leurs actes à se montrer ennemis des commodités de la vie, témoignant de l'indifférence et du mépris, non seulement pour la douleur, mais aussi pour la mort. Il serait alors étonnant qu'ils eussent abandonné ces sentiments précisément dans la flagellation, où ils sont au contraire le mieux à leur place. L'idée des anciens, que la flagellation fut instituée par un artifice du légendaire Lycurgue, est erronée ; mais il est très probable que ce fut une manifestation des sentiments d'endurcissement à la douleur et du sacrifice de l'individu à la collectivité, sentiments qui étaient si puissants à Sparte. Un pays où les mères repoussaient leurs fils, quand ils fuyaient de la bataille ou s'échappaient seuls, tandis que leurs compagnons étaient morts (§ 1148-1), où les hommes menaient une vie plus que dure, devait nécessairement avoir des enfants qui recherchaient les douleurs que comportait leur âge. Le fait que la flagellation avait lieu auprès de l'autel d'Artémis Orthia est secondaire. Si cette déesse avait manqué, on aurait eu vite fait d'en trouver une autre. Le fait concret de Sparte paraît donc différer de celui que raconte Casati, en ce qu'à un résidu commun, qui consiste à se glorifier de supporter la douleur, on ajoute, à Sparte, le sentiment que cette douleur est infligée au nom de la collectivité et de ses dieux, par conséquent le sentiment du sacrifice individuel.
§ 1196. Au moyen âge, la flagellation volontaire reparaît. Il serait vraiment ridicule d'y voir aucune trace de totémisme ou de l'intention de se fortifier. L'histoire de Saint Dominique l'Encuirassé, qui propagea la coutume de la flagellation, nous est bien connue ; et rien, absolument rien en elle ne rappelle les idées indiquées plus haut. Saint Dominique l'Encuirassé se flagellait afin de faire pénitence pour lui et pour autrui. C'est la dérivation qui recouvrait le résidu de l'ascétisme. Il n'y a pas lieu de s'étonner si, quand on inventait toutes sortes d'austérités, pour satisfaire le besoin d'ascétisme, la flagellation s'est trouvée parmi ces austérités. Il serait étonnant qu'elle eût fait défaut. Condamnée par beaucoup de personnes, cette nouvelle mortification de la chair trouva un défenseur en Saint Damien, qui observe très judicieusement qu'on ne peut la condamner, si l'on ne condamne pas en même temps les autres mortifications des Saints Pères. À ceux qui objectaient que Jésus-Christ, les apôtres, les martyrs avaient été flagellés par d'autres et ne s'étaient pas infligé la peine spontanément, il répond que nous pouvons nous punir par nous-mêmes, et que nous pouvons nous châtier par nos propres mains de la même façon que nous jeûnons volontairement [FN: § 1196-1].
§ 1197. Dans la vie de Saint Dominique l'Encuirassé, on nous dit qu'il eut ce surnom parce qu'il porta toujours une tunique de fer, et qu'il resta vierge jusqu'à sa mort, pratiquant toutes sortes de pénitences corporelles. Il passa sa vie à réciter des psaumes, à s'agenouiller, à se fustiger. Peu d'années avant de mourir, il s'aperçut que le fouet de cuir produisait une douleur plus grande que les verges d'osier ; aussi laissa-t-il celles-ci pour celui-là. Son cas appartient à l'aliénation mentale. Mais, de même que la mégalomanie est une maladie mentale qui manifeste l'excès de l'orgueil, les folies de Saint Dominique manifestent l'excès d'un sentiment par lequel l'individu perd tout souci de son intégrité personnelle. Il faut remarquer que Saint Dominique faisait pénitence pour les péchés des autres ; il se sacrifiait pour sauver autrui. Un admirable calcul, rapporté par Saint Damien, démontre qu'on pouvait satisfaire à cent ans de pénitence, en récitant vingt psaumes, en se battant de verges ou en se fouettant. Il paraît que Saint Dominique accomplit cette opération en six jours [FN: § 1197-1]. Une fois, au commencement du carême, Saint Dominique pria Saint Damien de lui imposer mille ans de pénitence, et paya presque entièrement sa dette avant la fin du carême.
§ 1198. Pierre Damien, qui veut étendre l'usage de se fouetter, ressemble toutes proportions gardées, à nos ascètes contemporains, qui veulent ôter à la vie humaine toute joie matérielle, et qui persécutent ainsi sans pitié le sourire de la femme et la chaleur du vin [FN: § 1198-1]. Et, si l'on peut considérer ces derniers comme des pseudo-ascètes, la comparaison s'établit entre ceux qui les admirent et ceux qui admiraient les flagellations du saint encuirassé [FN: § 1198-2].
§ 1199. Les œuvres de Saint Damien nous ont conservé le souvenir des pénitences de Saint Dominique l'Encuirassé, et il est probable que d'autres, fussent-elles moins austères, auront existé, dont le récit ne nous est pas parvenu. Quoi qu'il en soit, vers 1260, une épidémie de flagellation sévit en Italie [FN: § 1199-1] ; elle dura quelques années et en différentes contrées, tantôt s'affaiblissant et s'éteignant, tantôt se rallumant. Muratori veut que les flagellants de ce temps aient donné naissance à « (p. 364) beaucoup de Confraternités modernes ; car cette idée ayant profondément pénétré dans l'esprit des gens, que s'administrer la discipline était un acte très salutaire de pénitence, et l'ardeur de la religion bouillonnant en eux, ils formèrent des sociétés pieuses sous leurs gonfalons, faisant ensuite diverses processions, chantant les choses de Dieu et se réunissant aux jours de fête, dans leur église où, s'administrant la discipline et implorant la divine miséricorde, ils exécutaient d'autres actes de dévotion chrétienne » [FN: § 1199-2].
§ 1200. L'Église romaine, toujours modérée, condamna l'excès d'ascétisme des flagellants. De même, aujourd'hui, l'Église officielle anglaise demeure hostile aux enthousiasmes du Réveil gallois.
L'épidémie des flagellants de 1260 s'étendit aussi à l'Allemagne et y fit grand bruit. Raynaldo, continuateur des Annales de Baronio, tire de Stero la description des pénitences des flagellants allemands [FN: § 1200-1], et nous apprend aussi comment cette secte devint hérétique. Il dit : « (loc. cit., VIII) Cette piété des pénitents dégénéra ensuite en une hideuse hérésie, malgré une si grande pompe de sainteté et un si beau commencement. Par l'œuvre du démon, elle se changea en scélératesse et en ribauderie ». On recommence à parler des flagellants, en Allemagne, dans l'année 1349 ; et nous les voyons surgir pour apaiser la colère divine, qui se manifestait par la peste dont ces malheureuses contrées étaient accablées [FN: § 1200-2]. Comme d'habitude, la superstition se mêlait à l'ascétisme, et toujours comme d'habitude, l'hypocrisie cachait les mauvaises actions. On lisait une lettre reçue en l'église de Saint-Pierre, à Jérusalem, où elle avait été apportée par un ange ; elle portait que Jésus-Christ était irrité des crimes du monde, et que, prié par la Vierge et les anges de faire miséricorde, il prescrivait que chacun devait s'exiler pendant trente-quatre jours et se flageller. Les réponses pseudo-scientifiques dont se prévalent nos contemporains qui voudraient supprimer l'usage du vin et les rapports avec la femme, sont également absurdes, au moins en partie.
§ 1201. L'auteur de la vie du pape Clément VI dit des flagellants que « sous le couvert de pénitence et de bonnes œuvres, ils perpétraient secrètement beaucoup de mauvaises actions ». Dans une bulle adressée à l'archevêque de Magdebourg, le même pape dit que : « sous une apparence de piété, ils mettent cruellement la main à des œuvres impies. Ils répandent le sang des Juifs (que la pitié chrétienne accueille et protège, ne permettant de les offenser en aucune façon) et souvent des chrétiens, et accaparent sans raison les biens des clercs et des laïques » (RAYN., loc. cit., ann. 1349, XXI). En conséquence, le pape ordonne de condamner et de disperser les flagellants. L'Université de Paris rendit aussi une sentence contre eux, et le roi Philippe leur défendit, sous peine de mort l'entrée du royaume.
§ 1202. Les flagellants reparaissent de nouveau à Misura, en 1414, et sont de nouveau persécutés et dispersés. Ils disaient que le baptême usuel par l'eau était vain et devait être remplacé par le baptême du sang, de la flagellation. En 1417, on les voit en Aragon ; et Gerson écrit un traité contre l'abus de la flagellation, qu'il admet seulement dans une mesure modérée et imposée par les supérieurs. Henri III de France institua des congrégations de flagellants, en 1582. Mais là, le phénomène dévie et l'érotisme s'y mêle [FN: § 1202-1]. C'est ainsi que, même après cette époque, beaucoup de personnes, bien que très religieuses, furent hostiles à la flagellation, parce que souvent elle servait à de perverses jouissances érotiques. Ces faits sont entièrement ou en grande partie étrangers à l'ascétisme.
§ 1203. Il faut de même exclure des faits comme ceux des Luperques, à Rome, que les totémistes veulent, sans justes motifs, rapprocher de la flagellation des jeunes Spartiates. La douleur éprouvée par ceux qui étaient flagellés constituait la partie principale de cette flagellation; elle était exclue des Lupercales, ou du moins n'apparaissait pas. On sait qu'aux Lupercales, les Luperques couraient par la ville avec des lanières de cuir taillées dans les peaux des victimes, et en frappaient les femmes qui, de cette façon, devaient devenir fécondes. C'est là simplement une des si nombreuses pratiques imaginées par la fantaisie humaine, pour faire cesser la stérilité des femmes [FN: § 1203-1], à l'égal des autres pratiques non moins nombreuses, imaginées aussi pour remédier à l'impuissance des hommes. Il se pourrait encore que, parmi les motifs bizarres de ces imaginations, il y eût aussi celui que donnent les totémistes ; en ce cas, ils auront deviné, comme on peut deviner des faits sur lesquels tout renseignement certain fait défaut. Pausanias (VIII, 23) dit qu'à Aléa, en Arcadie, on célèbre une fête en l'honneur de Bacchus, « et qu'en cette fête de Bacchus, suivant un oracle de Delphes, on fouette les femmes, comme les éphèbes spartiates auprès de Orthia ». Avec si peu de renseignements, vouloir connaître le pourquoi du fait, c'est comme chercher à deviner les numéros du loto. Il est inutile de s'en occuper.
§ 1204. À notre époque, chez les peuples civilisés, les manifestations de l'ascétisme qui apparaissaient dans les jeûnes et les flagellations ont presque disparu. Déjà en 1831, dans une instruction aux confesseurs, il est écrit [FN: § 1204-1] : « (p. 311) La manière vraie et directe de dompter la pétulance de la chair rebelle, est justement l'usage du jeûne ou d'autres macérations, telles que le cilice, le fouet et autres semblables. Ce sont là, en majeure partie, les œuvres pénitentielles qui sont prescrites par les Saints Pères. Il n'est cependant pas toujours possible ou convenable d'imposer des jeûnes formels, comme ils se pratiquent dans l'Église, ou tels qu'on les détermine dans les Canons sacrés, uniquement en pain et en eau, plusieurs fois la semaine et pendant plusieurs années. Qui, de nos jours, parmi les pénitents, les accepterait, ou qui les observerait ? Donc, les jeûnes et toute autre mortification corporelle doivent être modérés dans la mesure du possible, suivant la discipline présente et l'usage commun des sages Confesseurs ». Aujourd'hui moins que jamais, on ne peut parler de cilice et de discipline, de jeûnes stricts, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. On dit qu'on en fait encore un usage modéré en Espagne.
§ 1205. De même, chez les Israélites modernes de nos pays, le vœu du naziréat paraît être tombé en désuétude, car on ne voit vraiment pas de ces Nazirs. Mais ils sont en partie remplacés par les anti-alcooliques de toute religion, et même sans religion. D'après la Bible (Nomb. VI), le Nazir devait s'abstenir de la consommation de vin et de toute autre boisson alcoolique, de vinaigre, de toute boisson tirée du raisin, de raisin frais et de raisin sec [FN: § 1205-1]. Il ne devait pas se couper les cheveux et devait observer d'autres règles pour se maintenir pur. Le naziréat était fixé à trente jours ou à un autre temps déterminé, ou perpétuel. Le Talmud en traite longuement [FN: § 1205-2].
§ 1206. Les manifestations d'ascétisme, sous forme de macérations corporelles, continuent chez les mahométans, les Hindous et d'autres peuples peu civilisés. Elles étaient fréquentes aussi chez les peuples sauvages plus avancés, tandis qu'elles sont beaucoup plus rares chez les peuples qui ont une vie presque bestiale. Chez les peuples civilisés modernes, l'évolution de l'ascétisme aboutit à l'anti-alcoolisme [FN: § 1206-1], à la phobie de tout ce qui rappelle l'acte sexuel, à l'humilité pathologique de quelques humanitaires de bonne foi. Occasionnellement, on voit diverses autres manifestations, telles que les jeûnes prolongés, recommandés maintenant au nom de la sacro-sainte Science, après avoir été si longtemps suggérés ou imposés au nom de quelque autre divinité.
Aux résidus de l'ascétisme s'ajoutent ceux de l'instinct des combinaisons (Ire classe) ; et l'on a une casuistique très étendue, qui, pour un genre donné d'ascétisme, paraît ridicule à ceux qui n'ont pas les sentiments correspondant à ce genre. Mais souvent ils en ont d'autres, correspondant à un autre genre d'ascétisme, et font usage d'une casuistique exactement semblable à celle dont ils se moquent.
De tous ces genres d'ascétismes, rendus plus virulents, en certains cas, par la casuistique, et qu'on veut imposer à autrui, provient une somme énorme de souffrances qui ont affligé et affligent encore la race humaine. En les tolérant, en les acceptant même souvent de bon gré, au lieu de les repousser et de détruire comme des serpents venimeux ceux qui les leur suscitent, les hommes démontrent clairement quelle puissance ont les sentiments correspondants, qui sont proprement une perversion de l'instinct de sociabilité, sans lequel la société humaine n'existerait pas.
[649]
Chapitre VIII↩
Les résidus (Suite). Examen des Ve - et VIe classes. [(§1207 à §1396),vol. 1, pp. 649-784]
§ 1207. Ve CLASSE. Intégrité de l'individu et de ses dépendances. Cette classe est constituée par les sentiments concernant l'intégrité de l'individu et de ses dépendances ; elle est donc, en un certain sens, le complément de la classe précédente. Défendre ses biens et tâcher d'en accroître la quantité sont deux opérations qui se confondent souvent. La défense de l'intégrité et le développement de la personnalité sont par conséquent deux opérations qui peuvent ne pas différer beaucoup et même se confondre. Cet ensemble de sentiments qu'on appelle « les intérêts » est de la même nature que les sentiments auxquels correspondent les résidus du présent genre. Donc, à la rigueur, il devrait en faire partie ; mais il est d'une si grande importance intrinsèque pour l'équilibre social, qu'il est utile de l'envisager à part des résidus.
§ 1208. (V-α) « Sentiments qui contrastent avec les altérations de l'équilibre social. Cet équilibre peut être celui qui existe réellement ou bien un équilibre idéal, désiré par l'individu. De toute façon, quand il est altéré ou qu'on le suppose tel, l'individu souffre, même s'il n'est pas atteint directement par le fait de l'altération, et quelquefois, mais rarement, même s'il en retire aussi avantage.
§ 1209. Chez un peuple où existe l'esclavage, par exemple chez les anciens Grecs, un citoyen, même s'il n'a pas d'esclaves, ressent l'offense qu'on fait à un maître, en lui enlevant son esclave. C'est une réaction contre un acte qui vient à troubler l'équilibre existant. Un autre citoyen voudrait maintenir les Barbares en esclavage et en retirer les Grecs : il a en vue un équilibre partiellement idéal, pour ces temps. Un autre citoyen encore voudrait qu'il n'y eût pas du tout d'esclaves : il a en vue un équilibre entièrement idéal, toujours pour ces temps.
§ 1210. Si un état d'équilibre existant vient à être altéré, des forces naissent, qui tendent à le rétablir. C'est là tout simplement la définition de l'équilibre (§ 2068 et sv.) Ces forces sont principalement des sentiments qui nous sont manifestés par les résidus du genre que nous étudions maintenant. Passivement, ils nous font sentir l'altération de l'équilibre, et, activement, nous poussent à refouler, éloigner, compenser les causes d'altération, et se transforment donc en les sentiments du genre (δ) (§ 1305 et sv.). Les forces ou sentiments qui naissent du trouble de l'équilibre social sont presque toujours perçus sous une forme spéciale, par les individus qui font partie de la société. Il va sans dire que ces individus ignorent les forces et l'équilibre. C'est nous qui donnons ces noms aux phénomènes. Les membres de la société où l'équilibre est altéré ressentent dans leur intégrité, telle qu'elle existait à l'état d'équilibre, un trouble désagréable, et qui peut être même douloureux, très douloureux. Comme d'habitude, ces sensations font partie des catégories indéterminées qui portent le nom de juste et d'injuste. Celui qui dit : «Cette chose est injuste » exprime que cette chose blesse ses sentiments, tels qu'ils sont dans l'état d'équilibre social où il vit.
§ 1211. Là où existe un certain genre de propriété, il est injuste de l'enlever à un homme. Là où elle n'existe pas, il est injuste de la lui donner. Cicéron veut que ceux qui gouvernent l'État s'abstiennent de ce genre de libéralité qui enlève à certaines personnes pour donner à d'autres [FN: § 1211-1] . « Il y en a beaucoup – dit-il – particulièrement s'ils sont avides de faste et de gloire, qui enlèvent à quelques-uns ce dont ils gratifient les autres ». C'est là, au contraire, le principe des lois dites « sociales », si cher aux hommes de notre époque. Les soldats qui partagent le butin fait sur l'ennemi appellent injuste le fait d'altérer les règles en usage dans ce partage. De même, ce sentiment existe chez les voleurs qui se répartissent leur prise. D'autres résidus se trouvent aussi dans cette nébuleuse du juste et de l'injuste, mais ce n'est pas ici le lieu d'en traiter.
§ 1212. Les diverses parties de l'équilibre social sont peu distinctes, surtout quand les sciences sociales sont peu avancées. Aussi le sentiment qui pousse à résister à l'altération de cet équilibre met-il sur le même pied les altérations de parties insignifiantes et celles de parties très importantes ; il estime également justes la sentence qui condamne au bûcher un antitrinitaire, et celle qui condamne à mort un assassin. Le seul fait de se vêtir autrement que le veut l'usage commun heurte ce sentiment, à l'égal d'autres transgressions beaucoup plus importantes de l'ordre social. Même aujourd'hui, chez les peuples qui se disent civilisés, on ne tolère pas qu'une femme se promène habillée en homme.
§ 1213. Le résidu que nous examinons donne lieu à une observation de grande importance, bien qu'elle ne semble pas telle, au premier abord. Supposons une collectivité où l'homicide devienne fréquent : elle est évidemment en train de se dissoudre. Pour s'opposer à cette dissolution, il n'est pas nécessaire que le sentiment correspondant à notre résidu agisse : l'intérêt immédiat des membres de la collectivité suffit. Dans le langage ordinaire, on dira que l'individu qui s'oppose à cet état de choses est mu, non par un « idéal de justice », mais par l'instinct de conservation ; instinct qu'il possède en commun avec les animaux, et qui n'a rien à voir avec l' « idéal de justice». Supposons ensuite une autre collectivité, très nombreuse, où le nombre des homicides soit très restreint. La probabilité qu'un individu soit victime d'un de ces homicides est très petite, égale ou inférieure à la probabilité de tant d'autres dangers (rencontre d'un chien enragé, accidents de chemin de fer, etc.) auxquels l'individu ne prend aucunement garde. Le sentiment de la défense directe de sa vie agit en ce cas très faiblement. Au contraire, un autre sentiment surgit et agit vivement : celui de répulsion pour ce qui trouble l'équilibre social, tel qu'il existe et tel que l'individu l'accepte.
§ 1214. Si ce sentiment n'existait pas, toute altération naissant dans l'équilibre social et légère ne rencontrerait que peu ou point d'opposition, et pourrait par conséquent aller en croissant impunément, jusqu'à ce qu'elle frappât un nombre d'individus assez grand pour donner lieu à la résistance de ceux qui veulent directement éviter le dommage. Cela se produit en effet dans certaines proportions, en toute société, même dans les plus civilisées ; mais ces proportions sont réduites par le fait de l'intervention du sentiment de répulsion contre l'altération de l'équilibre, quel que soit le nombre d'individus qui en pâtissent. En conséquence, l'équilibre social devient beaucoup plus stable : une action beaucoup plus énergique se produit aussitôt qu'il commence à être altéré [FN: § 1214-1].
§ 1215. Les exemples de ces phénomènes sont excessivement nombreux. L'un des derniers est donné par la France, en 1912. Pendant de longues années, on avait fait preuve d'une indulgence toujours croissante pour les malfaiteurs. L'école laïque était devenue une chaire d'anarchie, et sous une quantité d'autres formes, on était en train de dissoudre l'agrégat social. Les effets se manifestèrent par les sabotages dans les arsenaux, sur les chemins de fer, etc., et finalement par les exploits de la bande anarchiste Bonnot, Garnier et Cie. Alors se produisit un peu de réaction. Assurément, la crainte d'un danger direct pour les habitants de Paris et des environs y avait part ; mais enfin la probabilité, pour un citoyen, d'être frappé par ces malandrins était très petite. Le sentiment de s'opposer au trouble de l'équilibre social existant intervint avec une force plus grande. Il est en partie analogue, dans la société, à l'instinct qui, chez l'animal, fait fuir ce péril.
§ 1216. On comprend donc comment, en ajoutant au résidu que nous envisageons maintenant les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats), on forme des résidus composés, de grande importance sociale, correspondant à des sentiments vifs et puissants, exactement semblables à ceux qui, avec très peu de précision, sont désignés par le terme « idéal de justice ». Au point de vue logico-expérimental, dire que « l'injustice », aussi bien celle qui est faite à une seule personne qu'à un grand nombre de gens, offense également « la justice », n'a pas de sens. Il n'existe pas de personne appelée justice, et nous ne savons pas ce que peuvent être les offenses qu'elle recevrait. Mais l'expression seule est défectueuse, et, au fond, par elle on exprime le sentiment, peut-être indistinct, inconscient, qu'il est utile que l'opposition aux troubles de l'ordre social ne soit pas en raison directe du nombre d'individus lésés, mais ait une valeur notable, indépendante de ce nombre.
§ 1217. Revenant à l'exemple de la bande Bonnot, Garnier et Cie, plusieurs fidèles de la sacro-sainte Science, qui n'a rien affaire avec la science logico-expérimentale, observèrent avec douleur que la réaction qui se manifestait était absurde, qu'on ne pouvait affirmer que ces malfaiteurs fussent le produit d'une des causes contre lesquelles on réagissait ; et ils répétaient cela pour chacune de ces causes, en faisant le sophisme habituel de l'homme chauve. Ils ajoutaient que des malfaiteurs, il y en avait toujours eu, en tout temps et dans toutes les sociétés [FN: § 1217-1].
§ 1218. En tout cela, il y a une part de vérité : c'est que la réaction qui s'est produite est déterminée, non par la logique, mais au contraire par l'instinct. On pourrait ajouter que si la logique avait dominé, il n'y aurait pas eu de réaction, pour la bonne raison que l'action aussi aurait fait défaut. Instinctive était la pitié qui renvoyait les malfaiteurs impunis, qui prêchait l'anarchie aux jeunes gens, qui détachait tout lien de hiérarchie ; instinctive était par conséquent aussi la crainte qui poussait les hommes à réagir contre ces faits ; instinctif est l'acte de l'animal qui s'approche de l'appât placé pour le capturer ; instinctif aussi l'acte qui le fait fuir si, près de l'appât, il découvre des traces de danger, réel ou imaginaire.
§ 1219. De tout cela, on peut seulement tirer cette conséquence que les actions non-logiques jouent un grand rôle dans la vie sociale, et qu'elles produisent parfois le mal, parfois le remède à ce mal.
§ 1220. (V-β) Sentiment d'égalité chez les inférieurs. Ce sentiment est souvent une défense de l'intégrité de l'individu appartenant à une classe inférieure, et une façon de le faire monter dans une classe supérieure. Cela se produit sans que l'individu qui éprouve ce sentiment soit conscient de la diversité qu'il y a entre le but réel et le but apparent. Au lieu de son propre intérêt, il met en avant celui de sa classe sociale, simplement parce que c'est là la façon usuelle de s'exprimer.
§ 1221. Des tendances marquées tirent leur origine de la nature de ce sentiment, et paraissent, au premier abord, contradictoires. D'un côté, il y a la tendance à faire participer le plus grand nombre possible de personnes aux avantages que l'individu demande pour lui-même. D'un autre côté, il y a la tendance à restreindre ce nombre autant que possible. La contradiction disparaît, si l'on considère que la tendance est de faire participer à certains avantages tous ceux dont le concours peut être efficace pour obtenir ces avantages, de manière que leur intervention produise plus qu'elle ne coûte, et en outre d'exclure tous ceux dont le concours n'est pas efficace ou l'est si peu qu'il produit moins qu'il ne coûte. De même, à la guerre, il était utile d'avoir le plus grand nombre possible de soldats pour la bataille, et le plus petit nombre pour le partage du butin. Les demandes d'égalité cachent presque toujours des demandes de privilèges.
§ 1222. Voici une autre contradiction apparente. Les inférieurs veulent être égaux aux supérieurs, et n'admettent pas que les supérieurs soient leurs égaux. Au point de vue logique, deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps ; et si A est égal à B, il s'en suit nécessairement que B est égal à A. Mais la contradiction disparaît, si l'on considère que la demande d'égalité n'est qu'une manière déguisée de réclamer un privilège. Celui qui appartient à une classe et demande l'égalité de cette classe avec une autre, entend en réalité doter la première d'un privilège à l'égard de la seconde. Si, poser que A est égal à B signifie en réalité que A est plus grand que B, affirmer que B est plus petit que A n'est pas le moins du monde contradictoire. Au contraire, c'est parfaitement logique. On parle de l'égalité pour l'obtenir en général. On fait ensuite une infinité de distinctions pour la nier en particulier. Elle doit appartenir à tous, mais on ne l'accorde qu'à quelques-uns [FN: § 1222-1] .
§ 1223. Les Athéniens avaient très à cœur d'être égaux devant la loi, ![]() , et chantaient les louanges d'Armodius et d'Aristogiton qui les avaient rendus égaux ; mais l'égalité ne s'appliquait pas aux étrangers, aux métèques, et pas même au fils dont le père seul était citoyen ; et parmi les citoyens mêmes, on ne considérait pas comme contraire à l'égalité que les pauvres opprimassent les riches. Les citoyens spartiates qui jouissaient de tous leurs droits étaient les égaux, les
, et chantaient les louanges d'Armodius et d'Aristogiton qui les avaient rendus égaux ; mais l'égalité ne s'appliquait pas aux étrangers, aux métèques, et pas même au fils dont le père seul était citoyen ; et parmi les citoyens mêmes, on ne considérait pas comme contraire à l'égalité que les pauvres opprimassent les riches. Les citoyens spartiates qui jouissaient de tous leurs droits étaient les égaux, les ![]() ; mais, en fait, ils constituaient une aristocratie très restreinte, dont le nombre des membres allait toujours en diminuant. Même le seul fait de ne pouvoir prendre part au repas commun faisait disparaître l'égalité. Parmi nos contemporains, l'égalité des hommes est un article de foi ; mais cela n'empêche pas qu'en France et en Italie il n'y ait d'énormes inégalités entre les « travailleurs conscients » et les « travailleurs non-conscients », entre les simples citoyens et ceux qui sont protégés par des députés, des sénateurs, de grands électeurs, etc. Avant de rendre un jugement, les magistrats regardent bien avec qui ils ont affaire [FN: § 1223-1] . Il y a des tripots auxquels la police n'ose pas toucher, parce qu'elle y trouverait des législateurs ou d'autres gros personnages. Parmi ceux-ci, en Italie, combien ont des canifs dont la lame a plus de quatre centimètres ? Une loi vraiment absurde l'interdit aux simples citoyens, mais pas à ceux qui appartiennent à l'aristocratie politique ou qui jouissent de sa protection. C'est ainsi qu'en d'autres temps il était permis au noble de porter des armes, interdit au plébéien.
; mais, en fait, ils constituaient une aristocratie très restreinte, dont le nombre des membres allait toujours en diminuant. Même le seul fait de ne pouvoir prendre part au repas commun faisait disparaître l'égalité. Parmi nos contemporains, l'égalité des hommes est un article de foi ; mais cela n'empêche pas qu'en France et en Italie il n'y ait d'énormes inégalités entre les « travailleurs conscients » et les « travailleurs non-conscients », entre les simples citoyens et ceux qui sont protégés par des députés, des sénateurs, de grands électeurs, etc. Avant de rendre un jugement, les magistrats regardent bien avec qui ils ont affaire [FN: § 1223-1] . Il y a des tripots auxquels la police n'ose pas toucher, parce qu'elle y trouverait des législateurs ou d'autres gros personnages. Parmi ceux-ci, en Italie, combien ont des canifs dont la lame a plus de quatre centimètres ? Une loi vraiment absurde l'interdit aux simples citoyens, mais pas à ceux qui appartiennent à l'aristocratie politique ou qui jouissent de sa protection. C'est ainsi qu'en d'autres temps il était permis au noble de porter des armes, interdit au plébéien.
§ 1224. Tout le monde connaît bien ces choses ; c'est même pour cela qu'on n'y fait plus attention ; et si quelque naïf s'en plaint, on a pour lui un sourire de commisération comme pour celui qui se plaindrait de la pluie ou du soleil ; ce qui n'empêche pas qu'on croit de bonne foi avoir l'égalité. Il y a des endroits, aux États-Unis d'Amérique, où, dans les hôtels, on ne peut faire cirer ses bottines, parce qu'il est contraire à la sainte égalité qu'un homme cire les bottines d'un autre. Mais ceux-là mêmes qui ont cette haute conception de l'égalité veulent chasser des États-Unis les Chinois et les Japonais, sont estomaqués à la seule idée qu'un petit Japonais puisse s'asseoir sur un banc d'école à côté d'un de leurs fils, ne permettent pas qu'un nègre soit logé dans un hôtel dont eux-mêmes occupent une chambre, ne permettent pas non plus qu'il prenne place dans un vagon de chemin de fer qui a l'honneur de les contenir ; enfin, chose qui serait incroyable si elle n'était vraie, ceux qui, parmi ces ardents fidèles de la sainte Égalité, croient que Jésus-Christ est mort pour racheter tous les hommes, qu'ils appellent leurs frères en Jésus-Christ, et qui donnent leur obole aux missionnaires qui vont convertir les Africains et les Asiatiques, refusent de prier leur Dieu dans un temple des États-Unis où il y a un nègre [FN: § 1224-1] !
§ 1225. La démocratie européenne et celle d'Amérique prétendent avoir pour fondement l'égalité parfaite des êtres humains ; mais cette égalité ne s'applique qu'aux hommes et non aux femmes. « Un homme, un vote ! » crient les énergumènes ; et ils se voilent la face, saisis d'une sainte horreur, si quelqu'un émet l'avis que le vote de l'homme cultivé ne devrait pas être égal à celui de l'ignorant, le vote de l'homme malhonnête à celui de l'homme honnête, le vote du vagabond à celui du citoyen utile à sa patrie. Il faut une égalité parfaite, parce qu'un être humain est égal à un autre être humain. Mais ensuite on oublie ces beaux principes, s'il s'agit des femmes. L'égalité des êtres humains devient, par un joli tour de passe-passe, l'égalité des mâles, et même de certains mâles [FN: § 1225-1]. Notez encore que les mêmes personnes qui tiennent le principe du suffrage universel pour un dogme indiscutable, supérieur à toute considération d'opportunité ou de convenance, dénient ensuite ce suffrage aux femmes, pour des motifs d'opportunité et de convenance, parce que, disent-ils, le vote des femmes renforcerait le parti clérical ou conservateur.
§ 1226. Ici, nous ne recherchons pas quelle peut être l'utilité sociale de ces mesures. Elle peut être grande, même si les raisonnements par lesquels on veut la démontrer sont absurdes ; de même qu'elle peut ne pas exister. Maintenant, nous étudions seulement ces raisonnements et les sentiments dont ils partent. Si les raisonnements sont faux à l'évidence, et sont toutefois approuvés et acceptés, comme cela ne peut avoir lieu en raison de leur force logique, il faut bien que cela se produise par la puissance des sentiments qu'ils recouvrent. C'est justement le fait qu'il nous importe de relever.
§ 1227. Le sentiment qui, très mal à propos, porte le nom de sentiment d'égalité est vif, actif, puissant, précisément parce qu'il n'est pas effectivement d'égalité, parce qu'il ne se rapporte pas à une abstraction, comme le croient encore quelques naïfs « intellectuels », mais parce qu'il se rapporte aux intérêts directs de personnes qui veulent se soustraire à des inégalités qui leur sont contraires, et en instituer d'autres en leur faveur. Ce but là est pour eux le principal.
§ 1228. Les résidus que nous avons encore à examiner, c'est-à-dire les genres (γ) et (δ), ont un caractère commun qui est le suivant. L'intégrité ayant été altérée en quelque façon, on vise à la rétablir, si possible, ou bien à obtenir des compensations à l'altération soufferte. Si le rétablissement s'obtient par des opérations se rapportant aux sujets qui ont subi l'altération de l'intégrité, on a le genre (V-γ), qui se subdivise en (V-γ 1), si les sujets sont réels, et en (V-γ 2), s'ils sont imaginaires. Si le rétablissement s'obtient par des opérations se rapportant à ceux qui ont altéré l'intégrité, on a le genre (V-δ), que l'on peut aussi subdiviser en (V-δ 1), si l'agent de l'altération est réel, et en (V-δ 2), s'il est imaginaire.
§ 1229. (V-γ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant aux sujets, qui ont souffert l'altération. À ce genre appartiennent les purifications, très usitées dans les sociétés anciennes, et qui continuent à l'être chez les peuples sauvages ou chez les barbares. Maintenant, chez les peuples civilisés, elles ne sont que peu ou point employées ; aussi pourrions-nous nous borner à les mentionner ; mais elles nous présentent d'excellents exemples de la manière dont les résidus agissent et germent avec les dérivations. Par conséquent, l'étude de ces purifications nous est indirectement utile pour bien comprendre des phénomènes analogues. C'est la raison pour laquelle nous nous en entretiendrons quelque peu.
§ 1230. Le sujet est assez complexe ; aussi convient-il de faire des distinctions. D'abord, nous avons à envisager les phénomènes: (a) au point de vue des individus et des choses, réelles ou imaginaires, qui y jouent un rôle ; ce qui constitue une étude objective du sujet; (b) au point de vue des sentiments des personnes qui interviennent dans les opérations de purification ou de rétablissement de l'intégrité ; c'est alors une étude subjective.
§ 1231. (a) Aspect objectif. Il faut faire les trois distinctions suivantes.
1° Les sujets qui souffrent l'altération. Là aussi, il y a différents points de vue.
Nature des sujets. Ils peuvent être réels ou imaginaires ; ce qui nous donne la division des genres (V-γ 1) et (V-γ 2). Il y aurait encore à considérer les sujets qui sont des abstractions de sujets réels, comme la famille, la nation, etc. Pour ne pas multiplier sans nécessité le nombre des genres, nous les comprendrons dans le genre (V-γ 2). Si l'on voulait envisager les actions au point de vue logique, on pourrait penser que la conception de l'altération de l'intégrité fut primitive pour l'homme, et fut ensuite étendue, par similitude ou par la persistance des agrégats, aux choses, aux abstractions, aux êtres imaginaires. Mais nous n'avons aucune preuve de ce fait, qui peut s'être produit à certains moments et pas à d'autres. Il peut aussi être arrivé que le passage ait eu lieu parfois en sens inverse, c'est-à-dire des choses aux hommes. Mais, si on laisse de côté les origines, et qu'on ne se préoccupe que de la mutuelle dépendance des faits, il devient manifeste que la similitude et la permanence des agrégats tendent à maintenir en une masse homogène les altérations de l'intégrité des hommes, des choses, des êtres abstraits ou imaginaires ; et souvent, on peut bien dire que, pour ces motifs, le concept des altérations passe de l'un à l'autre de ces sujets. Puisque l'homme est pour nous le sujet principal, on comprend que ce passage ait habituellement lieu de l'homme aux autres sujets. Les sujets réels peuvent être des hommes, des animaux, des plantes, des choses, des édifices, des villes, des territoires, des collectivités, par exemple une armée, des familles, des nations, etc. Ils sont extrêmement nombreux et variés.
Extension dans l'espace. Ici aussi, sans vouloir rien affirmer à propos des origines, nous pouvons observer que, dans les conceptions, l'être humain apparaît souvent comme un noyau dont l'altération s'étend ensuite aux divers groupes dont l'homme est supposé faire partie. Parmi ces groupes, les suivants sont importants : la famille, la parenté plus ou moins étendue, les groupes ethniques, comme la tribu, la cité, la nation et même tout le genre humain. La permanence des agrégats fait qu'on n'envisage pas seulement les individus qui composent ces groupes, mais que les groupes eux-mêmes acquièrent une existence indépendante. L'altération de l'intégrité suit souvent aussi une voie inverse : des groupes indiqués tout à l'heure, elle s'étend à l'individu. Chez un grand nombre de peuples, les actions non-logiques font de la famille une unité qui est ensuite considérée comme telle, par les dérivations logiques ou pseudo-logiques. Ce caractère, qui était général chez nos ancêtres gréco-latins, est encore très accusé dans la société chinoise. Le fait est en dépendance étroite avec celui de la responsabilité de la famille, et avec des phénomènes singuliers comme le lévirat ou l'épiclérat, par lesquels on rétablit, dans les limites du possible, l'intégrité d'un homme qui n'a pas de fils, et l'on maintient l'intégrité de sa descendance ou de l'agrégat qui porte le nom de famille.
Extension aux animaux, aux êtres inanimés, aux êtres abstraits ou imaginaires. La voie directe, allant de l'homme à ces êtres, est habituelle ; mais la voie inverse ne fait pas défaut non plus. Tous ces êtres peuvent être envisagés comme des personnes et souffrir d'altérations de l'intégrité.
Extension dans le temps. Elle ne peut faire défaut, quand l'altération ne subsiste pas matériellement, au moment du rétablissement. Les deux opérations étant successives, on suppose implicitement que le sujet est unique (§ 1055). Si un homme fait pénitence pour une faute qu'il a commise, on suppose l'unité de celui qui a péché et de celui qui fait pénitence. Mais l'extension dans le temps a lieu en beaucoup d'autres cas. L'altération et le rétablissement s'étendent des ancêtres aux descendants. On sait que les Chinois préfèrent la première façon et les Européens la seconde. Poussée à son extrême limite, l'extension à la descendance donne naissance à l'idée du péché originel (§ 1288). Une autre extension dans le temps fait sortir des bornes de la vie terrestre ; alors apparaissent les divers phénomènes de la métempsycose, du nirvana, des âmes récompensées ou punies, de la rédemption, etc.
2° L'altération . Elle peut aussi être réelle ou imaginaire. Ce peut être une altération matérielle ou une altération de conditions immatérielles ; et les considérations présentées tout à l'heure sur les diverses espèces d'extensions s'appliquent à elles.
La manière dont se transmet l'altération. Ce peut être un contact, l'effet de certains rapports entre les sujets, par exemple la descendance. Ce peut être des actes ayant des effets réels ou imaginaires, etc. Comme d'habitude, grâce à la persistance des agrégats, on étend la conception des formes réelles aux formes imaginaires.
3° Les moyens par lesquels l'altération se produit et ceux par lesquels le rétablissement a lieu. Eux aussi peuvent être réels ou imaginaires. Les résidus des combinaisons interviennent et donnent une immense variété de pratiques considérées comme efficaces pour altérer, et un plus grand nombre encore, pour rétablir l'intégrité. Il faut ajouter à ces moyens les opérations magiques et beaucoup de pratiques religieuses. Celui qui considère toutes les actions comme logiques donne habituellement la première place aux moyens, et croit que les purifications ont lieu en vertu de certains raisonnements. Celui qui connaît le rôle important des actions non-logiques accorde la première place aux sentiments, considère les moyens comme subordonnés, et sait que les raisonnements ne sont que l'enveloppe des sentiments qui engendrent les purifications (§ 1239). Il faut prendre garde que le choix des moyens peut être important pour l'utilité sociale. En cas d'épidémie, les anciens se purifiaient par de copieux lavages [FN: § 1231-1], tandis que les hommes du moyen âge se purifiaient par des processions et des pénitences, restant comme avant dans un état de saleté repoussant. C'étaient diverses enveloppes d'un même sentiment ; mais la première était utile aux hommes, la seconde inutile et même nuisible par les contacts entre gens sains et malades, dans les processions, et par les accrocs que les pénitences faisaient à l'hygiène.
§ 1232. Ajoutons quelques considérations communes aux distinctions que nous venons de faire. En toutes ces distinctions, nous trouvons des cas réels bien constatés. Non seulement un homme peut souffrir des altérations matérielles de son intégrité, mais il peut en souffrir dans sa réputation ; et cela non seulement personnellement, mais encore comme faisant partie de certains groupes. L'extension de l'altération à la famille est effective, quand les lois interviennent pour l'imposer, et même sans l'intervention des lois. L'homme qui s'enrichit met sa famille dans l'aisance ; celui qui se ruine la rend misérable. Il y a des maladies héréditaires qui font souffrir les enfants par la faute des parents. Les peuples souffrent des erreurs de leurs gouvernants, et profitent de leurs opérations heureuses. Les façons dont l'altération se transmet effectivement ne sont pas seulement matérielles : la parole est aussi un moyen puissant, et la diffamation peut être pire qu'une blessure corporelle. Souvent on ne s'aperçoit pas du passage du réel à l'imaginaire, et souvent on ne peut le fixer avec précision, pas même avec l'aide de la science moderne. Par exemple, on est encore dans le doute, au sujet de l'hérédité de certaines maladies ; et tous les doutes ne sont pas dissipés sur les manières dont les maladies se transmettent. Il ne semble pas que le contact du porc puisse nuire à l'homme, comme le croient les musulmans. D'autre part, nous savons maintenant que les rats sont un puissant moyen de diffusion de la peste. On pourrait rechercher l'origine de la croyance, lorsqu'il s'agit de cas imaginaires, dans l'observation qu'on aurait faite des cas réels ; et cela peut avoir eu lieu quelquefois ; mais on ne peut l'admettre en général, car ce serait croire qu'à l'origine des connaissances humaines, on trouve la science rigoureusement logico-expérimentale, qui dégénère ensuite en connaissances imaginaires ; tandis que tous les faits connus démontrent que c'est le contraire qui a lieu. Dans les préceptes que l'antiquité nous a laissés, nous trouvons mélangés des remèdes dont l'efficacité est réelle, et d'autres dont l'efficacité est imaginaire. Il est certain que les hommes n'ont pas commencé par connaître les premiers, étendant ensuite l'idée d'efficacité aux seconds ; ils les ont connus mélangés ; et il ne manque pas de cas où ils ont commencé par les seconds pour arriver ensuite aux premiers.
§ 1233. Les cas réels ont contribué à engendrer une croyance générale indistincte, qui acceptait ensemble les cas réels et les cas imaginaires, et qui était renforcée, tant par l'observation des cas réels que par les effets supposés de cas imaginaires, comme aussi grâce à certains instincts de répugnance pour certaines choses ; instinct dont l'origine, chez la race humaine, nous est inconnue, de même qu'elle nous est inconnue chez les races d'animaux. Les dérivations interviennent ensuite largement, pour accroître la complexité des phénomènes concrets.
§ 1234. (b) Aspect subjectif. Au point de vue des sentiments des personnes qui recourent au rétablissement de l'intégrité, nous distinguerons : 1° le sentiment que l'individu a de son intégrité et de celle de ses dépendances, avec les diverses extensions déjà mentionnées (§ 1231); 2° le sentiment que si cette intégrité est altérée, elle peut être rétablie ; 3° les sentiments qui poussent à user de certains moyens pour atteindre ce but.
§ 1235. La variabilité de ces sentiments s'accroît du 1er aux 3es, tandis que leur importance diminue pour l'équilibre social. Voyons-les maintenant en détail.
1° Le sentiment de l'altération de l'intégrité est tout d'abord indistinct, comme sont tous les sentiments semblables. On ne distingue pas ou l'on distingue mal les divers genres d'intégrité, telle que l'intégrité matérielle, morale, politique, etc. On ne distingue pas bien non plus l'intégrité de l'homme, de l'animal, des choses. Puis, peu à peu, les diverses espèces d'intégrité se séparent et donnent lieu à diverses théories. La même confusion existe pour les causes d'altération de l'intégrité. D'abord, on se préoccupe peu de savoir si cette cause vient d'une action de l'individu dont l'intégrité est altérée ou de l'action d'un autre. Mais bientôt on distingue les deux choses. Plus tard et plus difficilement, on sépare la cause volontaire de la cause involontaire. Dans cette considération de la volonté, il entre un peu de métaphysique.
§ 1236. On fait d'autres distinctions et l'on sépare d'autres modes d'altération de l'intégrité. Une distinction importante est celle des altérations permanentes et des altérations temporaires. Le type de la première est la souillure de l'homicide, en Grèce, au temps où il devait être purifié, ou bien l'état de péché mortel du catholique. Le type de la seconde est l'état d'un individu frappé par un sortilège, ou bien du catholique tenté par le démon.
§ 1237. 2° Les mêmes confusions et les mêmes distinctions que celles mentionnées tout à l'heure ont lieu pour le rétablissement de l'intégrité. Par exemple, en un cas extrême, le rétablissement de l'intégrité s'opère exclusivement par des actes extérieurs, mécaniques (§ 1252), qui peuvent même se faire à l'insu de l'individu dont l'intégrité doit être rétablie. Dans un autre cas extrême, le rétablissement de l'intégrité s'opère exclusivement grâce à des actes intérieurs, volontaires, de l'individu. Les cas intermédiaires, qui se rencontrent plus que d'autres, chez les peuples civilisés, sont ceux dans lesquels le rétablissement de l'intégrité a lieu moyennant des actes extérieurs mécaniques, auxquels s'ajoutent des actes intérieurs, volontaires. Les premiers et les seconds ont des importances diverses.
§ 1238. 3° Le sentiment qui pousse au choix des moyens correspond aux résidus des combinaisons (Ire classe), qui donnent un très grand nombre de moyens, lequel s'accroît encore par les dérivations. Parfois subsiste le sentiment qu'il doit y avoir un moyen, sans qu'on puisse précisément déterminer lequel, et la purification s'effectue par quelque chose d'indéterminé ; ou bien on emploie des moyens nombreux et variés, dans l'espoir que celui qui est convenable se trouve parmi eux.
§ 1239. La forme des usages, dans les purifications, est le plus souvent de peu d'importance pour l'équilibre social. Le sentiment que l'intégrité est altérée chez qui transgresse une certaine règle, un tabou, est de grande importance. Le sentiment que cette intégrité peut être rétablie est aussi très important. Mais, en général, il importe peu que ce rétablissement s'effectue en touchant un plat d'étain (§ 1252-1), ou d'une autre manière. Dans la théorie des actions logiques, on renverse cette gradation d'importance, car on suppose que c'est la foi aux moyens de purification qui pousse les hommes à se purifier, et fait naître en eux les sentiments qui se rapportent à la purification (§ 1231).
§ 1240. (V-γ 1) Sujets réels. En traitant de ce genre, nous devrons faire aussi une allusion au genre suivant (V-γ 2), à cause de la complexité des phénomènes. Chez les hommes, le sentiment de l'intégrité est parmi les plus puissants et a ses racines dans l'instinct de conservation de la vie ; mais il s'étend bien au delà. L'altération de l'intégrité est souvent aussi ressentie instinctivement, et donne naissance à un très grand nombre de phénomènes concrets.
§ 1241. Ce qu'on appelle le remords est une manifestation de l'idée d'altération de l'intégrité. Si celui qui a l'habitude d'observer certaines règles vient à les transgresser, il ressent, par ce seul fait, un malaise ; et il lui semble être en quelque sorte diminué dans sa personnalité. Pour faire cesser cet état pénible, il cherche et emploie quelque manière d'effacer cette tache et de rétablir son intégrité en l'état primitif. Les pratiques usitées pour éviter les conséquences d'une transgression d'un tabou montrent ce phénomène sous une forme assez simple.
§ 1242. Quand on veut tout réduire en actions logiques, on fait une grande différence entre le remords qui suit la transgression d'une règle de vraie morale ou de vraie religion, et celui qu'on éprouve pour avoir transgressé des règles de la superstition. Mais, au point de vue des actions non-logiques, ces deux cas sont tout à fait identiques. Naturellement chacun croit vraie sa morale et sa religion [FN: § 1242-1] . Le musulman rit du catholique qui éprouve du remords pour avoir mangé gras un vendredi. Le catholique rit du musulman qui éprouve du remords pour avoir touché un porc avec le pan de son habit ; et l'athée anti-alcoolique rit de tous les deux, lui qui éprouve du remords pour avoir bu un peu de vin. On a souvent cité comme extraordinaire un cas de remords des indigènes australiens [FN: § 1242-2] ; mais en somme il fait partie de la même classe que beaucoup de remords des peuples civilisés. Le remords, au moins en partie, n'est pas l'effet du raisonnement ; il naît spontanément, instinctivement, du sentiment d'une transgression qui altère l'intégrité personnelle. On a cité un grand nombre de faits qui démontrent que le remords existe aussi chez le chien.
§ 1243. Il n'est pas possible de faire que ce qui a été n'ait pas été ; mais on peut opposer à une force une autre force, égale et contraire, de sorte qu'elles se contrebalancent et que l'effet soit nul. Un fait peut être compensé par un autre fait, de manière que l'impression du second efface celle du premier. On peut sécher un homme qui a été mouillé, le réchauffer s'il a eu froid, le nettoyer s'il a été sali. À cause de la persistance des abstractions, ces opérations matérielles ou d'autres semblables s'étendent à la partie intellectuelle et morale de l'homme ; elles germent, poussent des rameaux et donnent une abondante moisson d'actions diverses.
§ 1244. L'intégrité peut être profondément ou légèrement altérée ; si bien que le rétablissement peut être une régénération de l'individu ou un simple acte qui en compense un autre, lequel souille l'individu. L'Église catholique fait une distinction de ce genre dans la classification des péchés mortels et véniels. Un sortilège altère l'intégrité d'un individu qui en est victime ; mais ce n'est pas une tache indélébile, comme le serait un homicide accompli par lui. En général, mais spécialement pour les altérations profondes, le rétablissement a pour but de replacer l'individu en l'état primitif où il était avant les actes qui l'ont souillé.
§ 1245. La souillure qu'on suppose ainsi exister peut être considérée comme une conséquence matérielle de certains actes, et s'efface matériellement aussi par l'effet d'autres actes. Ou bien, avec l'aide d'autres résidus et grâce à des dérivations, la souillure dépend de certaines conditions, parmi lesquelles il y a très souvent la volonté de l'individu. De même, des conditions identiques ou analogues doivent être réunies pour effacer la souillure.
§ 1246. D'une manière semblable, pour rétablir l'intégrité, on peut employer des moyens exclusivement matériels, exactement comme si l'on avait à effacer une souillure matérielle. On peut user de moyens exclusivement moraux [FN: § 1246-1] , intellectuels ; mais généralement ils sont accompagnés de moyens matériels. Très souvent, il semble qu'il y ait eu une évolution par laquelle des concepts moraux, spirituels, se sont ajoutés aux moyens matériels [FN: § 1246-2] ; et en avançant dans l'évolution, ces concepts dominent exclusivement, tandis que les moyens matériels apparaissent comme de simples symboles, sont entièrement secondaires. Cela donne facilement lieu à l'erreur d'après laquelle ils auraient toujours été tels, et n'auraient joué d'autre rôle que celui de donner une forme extérieure aux concepts moraux et spirituels. L'eau enlève les souillures matérielles : on suppose qu'elle peut enlever aussi les souillures morales [FN: § 1246-3] . Elle est habituellement employée par les hommes, pour se nettoyer des souillures matérielles ; de même, elle est l'un des principaux éléments qui enlèvent les souillures morales. On ajoute parfois d'autres choses à l'eau, soit matériellement, soit verbalement [FN: § 1246-4]. De très nombreuses combinaisons provenant des résidus de la Ire classe y jouent un rôle. Le sang, le soufre, d'autres matières ont aussi été employées dans les purifications. Remarquable est l'idée de purification suivant laquelle on crut que le déluge était une purification de la terre [FN: § 1246-5].
§ 1247. Chez un grand nombre de peuples anciens, les souillures matérielles et les souillures morales, qu'elles soient l'effet d'actes involontaires ou d'actes volontaires, ont été considérées comme identiques. Souillent de la même façon le fait d'être sale ou criminel, l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, l'impureté de la femme qui enfante et celle de l'homme accusé de quelque méfait. La souillure matérielle peut être de saleté réelle, mais aussi de saleté imaginaire [FN: § 1247-1]. La souillure contractée par un individu peut s'étendre, par contact ou autrement, à d'autres individus, à des choses, à des abstractions.
§ 1248. Comme d'habitude, les idées d'altération de l'intégrité dépendent directement des sentiments, et ne sont qu'en relation indirecte avec les utilités des individus et de la société, justement au moyen des sentiments (§ 2115). Par conséquent ces deux modes d'envisager les altérations de l'intégrité sont entièrement différents. Quand on regarde les phénomènes synthétiquement, et qu'on accorde la première place à des considérations éthiques ou d'utilité sociale, il y a non seulement une grande différence, mais encore une opposition entre des phénomènes qui apparaissent comme semblables au point de vue des résidus et des dérivations. Ainsi, au point de vue botanique, le persil (Carum Petroselinum) et la ciguë (Aethusa Gynapium) sont des espèces très voisines d'ombellifères.
§ 1249. Dans l'évangile de Marc (VII, 3 et sv.), Les pharisiens reprochent à Jésus-Christ que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, comme tous les Israélites avaient l'habitude de le faire ; mais Jésus répond, puis explique à ses disciples que ce ne sont pas les choses matérielles qui rendent l'homme impur, mais bien les choses morales, comme les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les homicides, etc. Durant un très grand nombre de siècles, les chrétiens se sont complu à opposer leur religion idéale à la religion matérielle des Israélites, sans s'apercevoir que, par des voies détournées, ils revenaient exactement à ces mêmes pratiques qu'ils reprochaient aux pharisiens ; et les catholiques ont cru et croient encore que manger de la viande le vendredi souille l'homme, précisément comme les pharisiens croyaient que prendre un repas sans s'être lavé les mains le souillait. Si grande est la force des résidus, qu'ils amènent des doctrines opposées au même point ; et si grande est la force des dérivations que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas de ce contraste. Jésus avait dit [FN: § 1249-1] : « Il n'y a rien hors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais c'est ce qui vient de lui qui peut le souiller ». On ne saurait être plus clair ; et les explications données aux disciples font vraiment disparaître tous les doutes. Et pourtant les catholiques croient que la viande, qui est hors de l'homme, mangée le vendredi, souille l'homme, et qu'il faut certaines pratiques pour le laver de cette souillure. Les dérivations ne manquent pas : il y en a tant qu'on veut pour démontrer qu'il n'y a pas la moindre contradiction entre affirmer que rien de ce qui est hors de l'homme ne peut le souiller, en entrant en lui, et la doctrine suivant laquelle la viande qui entre en lui, le vendredi, le souille. C'est là un des si nombreux cas où l'on voit que, pour l'équilibre social, l'importance des résidus dépasse de beaucoup celle des dérivations. Ceux-là se modifient difficilement ; celles-ci s'étirent dans le sens qu'on veut, comme la gomme élastique.
§ 1250. Le fait relevé tout à l'heure, de l'Évangile, est un cas particulier d'un phénomène général. Quand le résidu du rétablissement de l'intégrité agit seul ou presque seul, on peut accepter les moyens exclusivement matériels, pour rétablir l'intégrité. Mais ensuite il s'y ajoute d'autres résidus de la classe de la persistance des agrégats. Grâce à cette persistance, on a pris l'habitude de placer dans une classe supérieure des hommes présentant certains caractères ; et ce sentiment est froissé quand, par les moyens matériels des purifications, ou d'autres, on place dans la classe supérieure des hommes auxquels font défaut les caractères que la persistance de la sensation unit à elle. Diogène exprime bien cela quand il dit [FN: § 1250-1] : « Il est ridicule qu'Agésilas et Épaminondas soient dans la fange, tandis qu'une abjecte populace qui est initiée sera dans les îles des bienheureux ».
§ 1251. Dans les exemples suivants, pour éviter de fastidieuses et inutiles répétitions, nous serons obligés de traiter ensemble le fait d'effacer la souillure et les moyens de le faire ; mais il sera facile au lecteur de séparer les deux choses.
§ 1252. Un individu qui a transgressé un tabou éprouve des sentiments d'avilissement, de crainte ; il les fait disparaître et rétablit son intégrité par certains actes (§ 1481). Souvent, on compense les transgressions du tabou par certaines actions mécaniques [FN: § 1252-1] où il n'y a rien de moral. Nous avons ainsi un type de purification par des pratiques exclusivement matérielles. D'autres résidus s'y ajouteront ensuite et surtout des dérivations, et l'on aura d'autres types très nombreux. Le caractère du défaut de l'élément moral, ou au moins de celui qui consiste dans le repentir, dans le désir de ne pas faire le mal, se trouve aussi dans les purifications préventives : celles qui précèdent l'acte qu'elles doivent compenser. Si nous devons en croire Ovide [FN: § 1252-2], la prière qu'il met dans la bouche des marchands qui invoquent Mercure, pour qu'il les absolve des péchés passés et futurs, nous fournit un exemple de purification préventive. On sait que l'Église catholique ne
§ 1253. En Grèce, à une certaine époque, on voit apparaître l'usage de purifier l'homicide volontaire ou involontaire. Nous ne recherchons pas ici si cet usage est indigène ou s'il vient d'autres pays. Il est certain qu'on ne le trouve pas dans Homère ; mais cela ne suffit pas pour résoudre le problème. En tout cas, postérieurement, il est général. Il consiste alors en certains actes qui doivent être accomplis par une personne qui ne soit pas l'homicide. Cette personne n'est pas nécessairement le prêtre d'une divinité ; mais ce n'est pas non plus le premier venu. Il paraît que ce doit être un personnage important. La souillure est la conséquence automatique de l'homicide, indépendamment des circonstances dans lesquelles il est commis, même si c'est pour une cause réputée légitime. Là se voit le résidu pur de notre genre. Hérodote (I, 35) raconte comment un homme vint vers Crésus pour être purifié : «(2) Étant venu dans la maison de Crésus, il le pria de le purifier suivant le rite du pays. Crésus le purifia. Le rite de la purification est semblable chez les Lydiens et chez les Grecs ». C'est seulement une fois la cérémonie accomplie que Crésus s'informe du nom et de la condition de son visiteur. Il lui dit: « (3) Homme, qui es-tu ? et de quel endroit de la Phrygie es-tu venu t'asseoir à mon foyer ? Quel homme ou quelle femme as-tu tué ? » Le caractère matériellement automatique du rite est ici bien clair. Quel que soit l'homme, quel que soit l'homicide, crime ou justice faite, c'est tout un : la purification doit être accomplie et se fait de la même manière. Le Phrygien dit son nom, celui de son père et de son grand-père, et ajoute: « (4) J'ai tué involontairement mon frère ». Voilà donc que l'homicide involontaire souille précisément comme l'homicide volontaire. Observons que, chez Hérodote, il n'est fait aucune allusion aux dieux : leur intervention est une adjonction postérieure ; elle apparaît avec de nouveaux résidus qui s'agglomèrent avec le résidu principal. Dans la Bibliothèque d'Apollodore (I, 9, 24), pour que les Argonautes sachent qu'ils sont poursuivis par la colère de Zeus à cause du meurtre d'Absirte, il est nécessaire que le navire leur parle et les avise du fait, ajoutant que cette persécution ne cessera pas, tant qu'ils ne seront pas purifiés par Circé. Ensuite l'auteur dit simplement que « s'étant présentés à Circé comme des suppliants, elle les purifia ».
§ 1254. Apollonius de Rhodes nous fait connaître les détails de cette purification. Il suit probablement d'anciennes traditions, auxquelles il ajoute des tentatives d'explications logiques, où il fait intervenir Zeus. Tout d'abord, les Argonautes souffrent de nombreux malheurs sur mer, précisément comme celui qui a transgressé un tabou et ne s'est pas purifié. Puis le navire Argo parle et leur dit « (IV, 585-588) qu'ils ne pourraient éviter d'errer longuement ni les terribles tempêtes, si Circé ne les purifiait du cruel homicide d'Absirte ». Après un voyage difficile, ils arrivent à l'île de Circé. Jason et Médée entrent dans le palais de la déesse et, sans mot dire, s'asseyent auprès du foyer, suivant l'usage des suppliants. Jason plante en terre le fer dont il a tué Absirte. Voyant cela, Circé comprit ce qu'on lui voulait. Après avoir adoré la justice du Zeus des suppliants (702-709), « elle fit les sacrifices au moyen desquels, par les ablutions, on purifie les criminels suppliants, quand ils viennent s'asseoir au foyer. D'abord, elle plaça sur l'autel la victime expiatoire : un petit cochon de lait [FN: § 1254-1] , et, l'ayant égorgé, elle mouilla leurs mains de sang. De nouveau, elles les purifia par d'autres libations, invoquant Zeus qui purifie, protecteur des prières qui vengent le sang répandu ».
§ 1255. Chez Apollodore, les purifications apparaissent comme des opérations régulières, après les homicides. Les filles de Danaos, ayant tué les fils d'Aegyptos, sont purifiées par Athéna et par Hermès, qui agissent suivant l'ordre de Zeus (II, 1, 5). Héraclès, ayant tué ses fils dans un accès de folie, est purifié par Thestios (II, 4, 12). Il doit aussi se faire purifier du meurtre des Centaures (II, 5, 12). Dans un nouvel accès de folie, il tue Iphitos, fils d'Eurytos, puis demande à Nélée de le purifier ; mais celui-ci, étant ami d'Eurytos, refuse ; aussi Héraclès se fait-il purifier par Déiphobe (II, 6, 2). Il faut remarquer que, malgré la purification, il est frappé d'une grave maladie, en expiation du meurtre d'Iphytos, et qu'il n'en est délivré qu'après s'être vendu comme esclave, et avoir donné le prix de la vente au père d'Iphytos (II, 6, 2). On voit une autre tradition se superposer à la première sans que l'auteur essaie même de les faire concorder. La légende nous donne d'autres nombreux exemples de purifications d'homicides involontaires. Pélée est purifié pour deux homicides de ce genre [FN: § 1255-1] . Il y a plus. L'œuvre de Thésée qui détruit les brigands est méritoire : pourtant il doit être purifié [FN: § 1255-2] . Apollon lui-même doit être purifié du meurtre du serpent Python. Plutarque, qui vivait en des temps très postérieurs à ceux où cette légende prit naissance, estime ridicule qu'un dieu doive être purifié [FN: § 1255-3] . Ajax se purifie après avoir massacré des moutons, dans un accès de folie [FN: § 1255-4] . Il y a des gens qui vont jusqu'à vouloir la purification des chasseurs et des chiens qui reviennent de la chasse [FN: § 1255-5] . Le caractère purement mécanique de la souillure de l'homicide et de la purification qui en est la conséquence, ressort bien d'un récit de Pausanias [FN: § 1255-6] . Un enfant, en s'amusant, se frappe la tête contre un bœuf de bronze et meurt. Cette statue est réputée souillée par l'homicide. « Les Éléens voulaient déporter hors de l'Altis le bœuf [de bronze], accusé de l'homicide ; mais le dieu de Delphes leur prescrivit de purifier le bœuf par les rites que pratiquaient les Hellènes pour les homicides involontaires ».
§ 1256. La légende d'Oreste est l'un des cas où l'on voit la purification simplement matérielle se transformer, au moins partiellement, en purification morale. Oreste est purifié à Delphes par Apollon ; mais cela ne suffit pas, et son procès à Athènes est bien connu. Pausanias, l'auteur, raconte comment le roi spartiate Pausanias tua involontairement une jeune fille du nom de Kléonice. Il eut ensuite recours à toutes sortes de purifications, sans qu'elles suffisent à le laver de la souillure contractée par cet homicide ; c'est pourquoi il fut le seul qui ne fut pas sauvé par l'asile de Chalcioicos [FN: § 1256-1] .
§ 1257. Les rapports sexuels, légitimes ou non, entre l'homme et la femme, passaient pour une cause d'impureté, chez les anciens Grecs comme chez d'autres peuples. Là aussi, nous avons le passage de l'impureté exclusivement matérielle à l'impureté morale. La pythagoricienne Théano, à qui l'on demandait: « Combien de jours après avoir eu des rapports avec un homme la femme devient-elle pure ? », répondit : « Si c'est avec son mari, immédiatement ; si c'est avec un autre homme, jamais [FN: § 1257-1] ».
§ 1258. Chez un grand nombre de peuples, et principalement chez les peuples barbares ou sauvages, ce n'est pas seulement l'acte sexuel qui est cause d'impureté, mais aussi les menstruations de la femme [FN: § 1258-1]. À ce propos, on pourrait citer un très grand nombre d'exemples. La Bible contient des prescriptions remarquables [FN: § 1258-2] que les chrétiens n'observent plus. L'accouchement est considéré, chez un très grand nombre de peuples, comme une cause d'impureté. Dans l'île de Délos, il ne devait y avoir ni morts ni enfantements. À Rome et à Athènes, le nouveau-né était aussi purifié.
§ 1259. En Grèce, le contact ou la vue d'un mort était une cause d'impureté. Un vase, pris dans une autre maison et plein d'eau, était placé devant la maison mortuaire, pour purifier ceux qui en sortaient [FN: § 1259-1] . Ceux qui avaient assisté à des funérailles se purifiaient [FN: § 1259-2].
§ 1260. Très nombreuses étaient les formes d'impureté, qui toutes correspondaient à un sentiment, réel ou imaginaire, de l'altération de l'intégrité personnelle, et qu'on faisait disparaître grâce à d'opportunes pratiques de purification. Au milieu d'un si grand nombre de causes d'impuretés, l'homme superstitieux craint tout. Théophraste nous le montre sortant du temple, après s'être lavé les mains et aspergé d'eau lustrale, et se promenant tout le jour avec des feuilles de laurier dans la bouche. Il purifie sa maison à chaque instant. Il n'ose pas aller auprès d'une tombe ni d'une accouchée. Il va à la mer pour s'asperger d'eau de mer. S'il fait une rencontre réputée mauvaise, il se purifie en se versant de l'eau sur la tête, et en faisant porter autour de lui une scille maritime et un petit chien [FN: § 1260-1]. Cynthie purifie la chambre après avoir chassé les courtisanes avec lesquelles elle avait surpris Properce [FN: § 1260-2]. Pour qui fixe son attention principalement sur les dérivations, il y a un abîme entre les purifications des crimes et ce jeu amoureux ; pour qui s'arrête au contraire aux parties constantes et importantes des phénomènes, il y a similitude parfaite. Juvénal décrit les purifications que pratique la femme superstitieuse [FN: § 1260-3] . En hiver, elle se plonge trois fois dans le Tibre et, timide, se lave la tête.
§ 1261. L'impureté s'étend de celui qui l'a contractée à toute autre personne qui a contact ou rapport avec lui : des parents aux enfants, d'un individu à la collectivité dont il fait partie, aux animaux, aux choses matérielles, à un pays entier. Si nous devons ajouter foi aux lois dites de Manou, même le seul fait de la mort d'un conjoint est une cause d'impureté, sans qu'il faille voir ou toucher le mort [FN: § 1261-1]. On voit donc que le phénomène assume la forme d'une nébuleuse qui s'étend plus ou moins loin autour d'un noyau.
§ 1262. Quand on envisage la famille comme l'unité sociale, la conséquence en est que toute altération de l'intégrité d'un des membres de la famille se répercute sur toute celle-ci, dans l'espace et dans le temps [FN: § 1262-1], comme la blessure faite à un membre du corps d'un être vivant se répercute sur tout le corps. Dans les pénalités qui frappent une famille entière, pour le crime commis par l'un de ses membres, il y a une action logique : on vise à agir sur l'affection qu'on suppose que cet individu a pour sa famille; mais il y a aussi le résidu qui fait considérer la famille comme l'unité sociale. C'est pourquoi ces pénalités collectives disparaissent quand l'individu devient cette unité, comme il est arrivé en Europe, tandis qu'elles subsistèrent jusqu'à notre époque en Chine, où la famille est l'unité.
§ 1263. Si un homme n'a ni fils ni filles, l'intégrité de la famille est altérée. On néglige les filles, quand la famille se maintient par les mâles. Il faut rétablir cette intégrité. Aussi a-t-on les diverses dispositions qui permettent à l'homme dont la femme est stérile d'en prendre une autre, en répudiant ou en conservant la première. Si l'homme est mort sans laisser de fils, ce remède ne sert plus ; et l'on a alors les dispositions de l'épiclérat, à Athènes, du lévirat, chez les Israëlites, ou d'autres institutions semblables. Les dérivations recouvrent ensuite ces faits ; mais pas au point d'en cacher le fond à celui qui les observe attentivement. Pour donner une idée de ces phénomènes, il suffira de transcrire ici les dispositions des lois de Manou [FN: § 1263-1]. Les traiter à fond est la tâche de la sociologie spéciale qui fera suite à cette sociologie générale.
§ 1264. Les prescriptions bibliques, développées ensuite dans le Talmud, nous donnent un exemple d'une épaisse forêt de règles touchant les impuretés et les purifications. En traiter longuement ici serait perdre son temps ; mais il sera utile d'en avoir au moins une idée, car, de ce cas particulier, on tire une vue du phénomène en général. Les objets impurs ou immondes se disposaient en une série d'impuretés décroissantes, comme de père à fils. Tout en haut, on trouve l'ancêtre des immondices [FN: § 1264-1] suivent les pères des immondices et quatre degrés de descendances des fils des immondices. Le contact avec l'ancêtre donne naissance à certains pères. Le premier degré des fils comprend les objets devenus impurs par le contact avec les pères ; le second degré des fils contracte l'impureté, du contact avec le premier; le troisième, du contact avec le second ; le quatrième, du contact avec le troisième. Père et fils peuvent être suivant la loi, ex lege, ou bien suivant les commentateurs : ex instituto scribarum. L'ancêtre des immondices, c'est le cadavre humain. Les pères suivant la loi sont au nombre de trente-deux [FN: § 1264-2] : les reptilia, les cadavres des bêtes, des hommes, etc. Les reptilia sont énumérés dans la Bible. Ce sont certains animaux ; mais lesquels ? On ne le sait pas précisément ; car les interprètes ne sont pas d'accord sur les noms [FN: § 1264-3]. Les partisans des actions logiques peuvent s'évertuer tant qu'ils veulent : ils ne réussiront jamais à trouver pourquoi justement ces animaux seraient immondes, et d'autres pas. Les pères des immondices sont au nombre de vingt-neuf, suivant les sages [FN: § 1264-4]. Les fils des immondices ont aussi ce caractère, ou de par la loi ou par institution des sages. Dans les choses profanes, le premier degré est immonde et engendre l'impureté par le contact ; le second ne l'engendre pas. Dans les choses saintes, les trois premiers degrés sont immondes et engendrent l'impureté, le quatrième ne l'engendre pas. Les pères des immondices contaminent hommes et récipients ; les fils seulement les mets et les boissons. « Si un homme a touché un reptile, il contracte une immondice du premier degré, et contamine l'huile, s'il l'a touchée. Si, à son tour, cette huile a touché du miel, elle le contamine... et si ce miel a touché de l'eau, il la contamine; et de cette façon, l'huile, le miel et l'eau ont chacun le premier degré d'immondice [FN: § 1264-5] ». L'impureté dure plus ou moins longtemps, et il y a un grand nombre de prescriptions sur cette matière. Sur la lèpre, le Talmud a tout un livre, et ajoute beaucoup de prescriptions à celles, déjà fort nombreuses, de la Bible.
§ 1265. Quand on a bien reconnu les immondices, il faut les faire disparaître. Il est recommandé de se laver avec de l'eau ; c'est toujours autant et cela profitera à la propreté. Des prescriptions minutieuses guident le fidèle dans cette opération ; la Bible en donne plusieurs et le Talmud les amplifie.
§ 1266. Semblablement à ce qui arrive chez d'autres peuples, on fait des purifications avec des eaux spéciales et en usant de modes déterminés. Chez les Israélites, le sacrifice de la vache rousse est remarquable. Elle doit être sans tache et sans défauts. Une fois tuée, le prêtre en prend le sang et en asperge la tente d'assignation. C'est ainsi que les Grecs purifiaient avec le sang de petits cochons ; et Aristophane, plaisantant cet usage, suppose que l'assemblée des femmes s'ouvre par le sacrifice de la luxurieuse belette [FN: § 1266-1] . La vache était brûlée de la manière prescrite, et la cendre recueillie et mêlée à l'eau, donnait l'eau de purification [FN: § 1266-2]. Les Romains avaient coutume de sacrifier, vers la mi-avril, la vache forda, c'est-à-dire portante et féconde. Les prêtres extrayaient du ventre des mères les veaux, qui étaient brûlés par la plus ancienne des Vestales (Virgo Vestalis Maxima), et la cendre était conservée pour purifier le peuple, le jour de Palès [FN: § 1266-3] (fêtes Palilies ou Parilies). Auparavant déjà, dans le même but, on avait conservé le sang du cheval sacrifié, en octobre, au Champ de Mars [FN: § 1266-4] . Le 21 avril, on célébrait les Palilies. Le peuple allait chercher à l'autel de Vesta le sang du cheval, la cendre des veaux et des tiges sèches de fèves. Ensuite, il se faisait asperger d'eau avec un rameau de laurier ; il faisait des fumigations de soufre, et sautait sur de la paille enflammée [FN: § 1266-5]. De cette fête nous sont restés les feux d'allégresse qu'on allume encore en plusieurs contrées. Le mercredi des cendres, les catholiques brûlent les palmes de l'année précédente et, avec les cendres, font le signe de la croix sur le front des fidèles [FN: § 1266-6] .
§ 1267. On voit ici disparaître la propriété qu'a l'eau de laver un homme ou une chose, puisque toucher l'eau de purification entraîne une souillure. Le caractère imaginaire prévaut sur le caractère réel. Comme d'habitude, le Talmud subtilise sur cet effet de l'eau de purification. On distingue les eaux dont la quantité est suffisante pour être répandues, de celles dont elle ne l'est pas. Les premières souillent celui qui les porte ; les secondes seulement celui qui les touche. Et prenons bien garde que « si une ficelle est attachée à la chose immonde, et que l'homme soulève la chose immonde au moyen de la ficelle, comme la pesanteur de la chose immonde le touche, il est souillé par l'immondice du poids, de telle sorte qu'à son tour il souille ses vêtements et tous les vêtements et les vases qu'il touche, excepté les vases de terre » [FN: § 1267-1].
§ 1268. La casuistique portant sur les circonstances matérielles des faits est abondante et subtile. En voici un exemple. Un gallinacé avale un reptile et passe par un four. S'il demeure vivant, il ne souille pas le four ; s'il meurt, il le souille [FN: § 1268-1] . Si quelqu'un fait tomber du lait du sein d'une femme dans un four, celui-ci est immonde ; de même si, en balayant le four, la femme se pique un doigt et le met dans sa bouche [FN: § 1268-2] . Il y a plusieurs observations sur les belettes ou les chattes qui se promènent avec un reptile dans la gueule [FN: § 1268-3] , sur les crachats purs et immondes, semi-fluides et secs, en un lieu public et en un lieu privé [FN: § 1268-4] . Enfin, sur les questions sexuelles, il ne manque pas de nombreuses dissertations allant de pair avec celles que les anti-cléricaux reprochent d'une façon si acerbe aux jésuites [FN: § 1268 note 1268-5]. On discute longuement sur le mode et sur l'efficacité des ablutions ; il y a des choses qui séparent, et d'autres qui ne séparent pas l'eau, du corps, suivant les circonstances [FN: § 1268-6].
§ 1269. Maintenant, si nous considérons les choses d'un peu haut, en négligeant les menus détails, comme on fait pour dessiner une carte géographique, nous verrons aisément la forme qu'assume le phénomène. Le noyau est une répugnance instinctive pour les cadavres et pour diverses espèces d'ordures. En certains cas, cette répugnance est utile aux hommes, de même qu'il est utile aux animaux de s'abstenir d'aliments vénéneux. C'est l'un des très nombreux cas d'actions non-logiques dont nous avons parlé au chapitre II.
§ 1270. Comment se fait-il que ces instincts soient utiles aux animaux ? Nous n'en savons rien. Le fait est certain. Les bœufs, les chèvres, les moutons laissent de côté les plantes vénéneuses, dans les pâturages, et il est remarquable qu'ils les mangent au contraire dans le foin. Les oiseaux laissent de côté les graines vénéneuses. On pourra dire avec les darwinistes que, par sélection, les animaux qui n’avaient pas cet instinct ont péri ; on pourra trouver d'autres causes ; mais, de toute façon, le fait subsiste, et nous nous en tenons là.
§ 1271. Pour l'homme, à ce noyau s'ajoutent deux appendices (§ 1273 et sv.). Le premier tire son origine de l'adjonction des résidus de la Ire classe, qui poussent à une infinité de combinaisons et à leurs explications logiques. Nous avons cité le Talmud, justement parce qu'il donne un exemple remarquable de ces combinaisons matérielles et de leurs explications, lesquelles restent dans un domaine juridique, avec très peu de considérations métaphysiques ou théologiques, l'autorité de la Bible étant principalement invoquée, comme celle des lois écrites le serait par un juriste.
§ 1272. Les subtilités hébraïques ne sont point exceptionnelles : on en trouve d'autres, semblables, chez d'autres peuples, spécialement chez les Hindous et chez les mahométans. Un grand nombre de prescriptions des Hindous sont presque identiques à celles des Israélites [FN: § 1272-1].
§ 1273. Dans les actions non-logiques de l'impureté et de la purification, on trouve d'excellents exemples du second et du quatrième genre d'actions non-logiques, dont nous avons parlé aux § 151 et sv. Ces actions non-logiques ont un but logique subjectif, qui est d'obéir à des prescriptions religieuses. Une partie n'ont pas de but logique objectif ; par exemple le fait de ne pas soulever de loin un objet impur ; elles appartiennent au second genre. Une partie ont un but logique objectif, car elles sont utiles à l'hygiène, par exemple le fait de tenir pour souillées les boissons dans lesquelles est tombé un lambeau de cadavre. Ce but serait accepté par le sujet, s'il le connaissait; nous avons donc des actions non-logiques de l'espèce (4 α) (§ 151 et sv.).
§ 1274. Il en est résulté que les actions de cette dernière partie ont été prises pour des actions logiques, et cela a contribué en outre à étendre cette conception à des actions qui n'appartiennent pas à l'espèce (4 α). Mais ce caractère logique n'existe pas. On peut soutenir que les prescriptions concernant les menstrues de la femme sont d'ordre hygiénique ; mais il est impossible, à ce point de vue, de distinguer les menstrues de l'Israélite de celles de la païenne, comme aussi le cadavre de l'Israélite du cadavre du païen.
§ 1275. Le second appendice tire son origine du besoin d'expliquer, non plus matériellement, les combinaisons, mais les principes mêmes qui leur donnent naissance, ou bien du désir de rendre logiques les actions non-logiques. Ici agissent non seulement les résidus du besoin de logique (I-ε), mais aussi les résidus de la persistance des agrégats (II-α). Cet appendice se divise en deux. D'une part, nous avons les explications pseudo-expérimentales ; de l'autre, celles qui dépassent l'expérience.
§ 1276. Un type des explications pseudo-expérimentales est celui qui eut tant de crédit, et suivant lequel on croyait que la prohibition de la viande de porc était un principe hygiénique, auquel on ajoutait une sanction religieuse [FN: § 1276-1].
§ 1277. Le totémisme, qui explique tout, explique aussi la répulsion des Sémites pour le porc, qui serait un ancien totem, et, comme tel, respecté et exclu de l'alimentation. Cela pourrait être vrai, et il y a des faits qui viennent à l'appui de cette théorie. Burckhardt rapporte [FN: § 1277-1] : « (p. 162) Il y a quelques années qu'un vaisseau anglais échoua près de Djidda [en Arabie], et parmi les débris du naufrage était un porc, animal que probablement on n'avait pas vu encore à Djidda. Ce porc, lâché dans la ville avec deux autruches, devint la terreur de deux marchands de pain et de légumes, car le contact d'un animal aussi immonde que le porc, ne le touchât-on qu'avec le bord de la robe, rend un musulman impur et hors d'état de faire sa prière sans des ablutions particulières : on garda l'animal pendant six mois, et enfin il mourut à la grande satisfaction des habitants ». Il y a là tous les caractères du respect pour le totem ; et si tous les faits étaient de ce genre, l'explication donnée deviendrait très probable. Mais il y en a d'autres qui ne concordent pas avec cette explication. D'abord, nous observons que, dans la Bible, le porc n'est pas seul dans la classe des animaux qui ne doivent pas être mangés, mais qu'il a de nombreux compagnons. S'ils étaient peu nombreux, on pourrait croire que ce sont tous des totems ; mais est-il bien possible que tous ces animaux si nombreux soient des totems ? que, par exemple, tous les animaux aquatiques, en grande partie inconnus des Hébreux, et qui n'ont ni nageoires ni écailles, fussent des totems ? [FN: § 1277-2] On pourrait répondre : « La prescription de ne pas manger les totems a été postérieurement étendue à d'autres animaux ». Admettons-le. Reste maintenant à savoir si le porc était le totem dont provint la prohibition, ou bien un animal auquel elle fut étendue, à partir d'autres animaux qui étaient totems. Là-dessus nous n'avons pas le moindre renseignement. Concluons donc qu'il se peut bien que le porc fût un ancien totem, mais que cela doit être démontré par des preuves spéciales, qui, pour le moment, nous font défaut ; tandis que le fait général de la répulsion pour l'emploi de sa chair ou pour son contact ne prouve rien, parce qu'il prouverait trop.
§ 1278. Rabbinowicz veut expliquer la prescription suivant laquelle, à propos de certaines lois de l'impureté, un mort païen doit être considéré comme pur ; mais les dérivations auxquelles il recourt sont ensuite réfutées par lui-même [FN: § 1278-1].
§ 1279. Les païens sont considérés comme purs en certains cas, principalement parce que, dans le noyau des actions non-logiques, celles-ci se rapportaient aux membres de la collectivité, c'est-à-dire aux Hébreux. Mais ensuite, par le raisonnement, elles s'étendirent aussi aux étrangers. Rabbinowicz dit que les Hébreux ne pouvaient distinguer les tombes des païens. Mais ils ne pouvaient pas non plus distinguer les crachats des païens ; et, en ce cas, le Talmud donne une solution diamétralement opposée à la première ; Rabbinowicz lui-même la rappelle : « (p. 411) S'il y a une païenne dans la ville, les salives sont impures (pour les haberim qui s'engageaient à observer les lois mosaïques sur la pureté, car la femme païenne peut se trouver à l'époque des menstrues) [FN: § 1279-1] ». Nous avons beaucoup d'autres problèmes semblables, avec des solutions diverses, lesquelles ne peuvent pas toujours être réduites à des considérations de commodité pour les Israëlites qui devaient vivre avec les païens [FN: § 1279-2].
§ 1280. Les explications qui dépassent l'expérience ont pour but de donner le pourquoi des prescriptions en lesquelles on a foi, et qui imposent certaines pratiques. Elles commencent par les simples affirmations des tabous, pour s'élever peu à peu aux plus abstruses subtilités métaphysiques et théologiques. Dans le Lévitique, on trouve une forme simple d'explications : les règles de la pureté et de la purification sont données comme venant de Dieu. Puis on renforce l'affirmation par quelque exhortation [FN: § 1280-1] . Enfin, suit une des explications habituelles des tabous : on dit que celui qui les transgresse court le danger de mort, et l'on y ajoute aussi une explication religieuse [FN: § 1280-2] .
§ 1281. Le christianisme ajouta une autre couche d'explications. Les Israëlites faisaient des sacrifices et, de même que d'autres peuples, se servaient du sang de la victime, pour purifier [FN: § 1281-1] . Les chrétiens voulurent supprimer cet usage, et non contents de cela, ils voulurent aussi expliquer pourquoi ils le supprimaient. Saint Paul dit que le sang de Christ, répandu une fois pour toutes, est le plus parfait des sacrifices et se substitue aux anciens [FN: § 1281-2]. Mais cette raison est bien celle des dérivations, qui sera traitée dans le chapitre suivant. Nous avons fait ici cette digression pour montrer, par un autre exemple, ajouté à ceux que nous avions déjà donnés, comment, des phénomènes concrets complexes, on extrayait les résidus. Il convient de remarquer la persistance des agrégats, par laquelle les chrétiens n'osent pas faire disparaître entièrement l'idée du sacrifice, mais se contentent de transformer ce sacrifice, en sorte que cette idée persiste, mais sous une forme différente.
§ 1282. Les résidus de l'intégrité rendue aux personnes et aux choses se rencontrent en un grand nombre d'autres cas. L'Église catholique réconciliait les pénitents et continue à réconcilier les églises et les cimetières [FN: § 1282-1].
§ 1283. La persistance des agrégats fait que des pratiques qui s'appliquent aux hommes, par exemple les actes juridiques et le rétablissement de l'intégrité, s'étendent aux animaux et aux choses. Mais on ne doit pas conclure qu'il y a imitation directe ; elle peut exister en partie ; d'un autre côté, on a aussi des conséquences directes d'un même sentiment.
§ 1284. De même, on étend dans l'espace l'idée de la purification. Il y a certains signes qui montrent qu'un péril indéterminé menace une collectivité, un pays entier, et il faut pourvoir à son éloignement.
§ 1285. Comme type de ces phénomènes, on peut noter la procuration des prodiges des Romains [FN: § 1285-1]. Un prodige était une menace de dangers futurs : il fallait courir au remède. En outre, il souillait, et il fallait purifier. Celui qui a pris un poison par inadvertance doit se procurer un contre-poison qui en neutralise l'effet. Dans la description qui nous est restée de ces faits, on voit clairement le sentiment qu'on devait faire quelque chose, et la recherche pressante de ce quelque chose.
§ 1286. En certains cas, on savait avec précision quelle avait été l'altération de l'intégrité, altération qu'on appelait piaculum ; et le même nom désignait les mesures prises pour rétablir cette intégrité altérée. Pour un sacrifice qui n'avait pas été accompli rigoureusement selon les rites, on rétablissait l'intégrité en renouvelant le sacrifice. Pour diverses autres transgressions, on avait divers sacrifices. Aulu-Gelle raconte que le Sénat, ayant appris que, dans le sanctuaire, les javelots de Mars s'étaient spontanément remués, ordonna de sacrifier à Jupiter et à Mars ; si d'autres victimes venaient à être nécessaires – si quid succidaneis opus est – on sacrifierait à Robigus. Aulu-Gelle disserte longuement sur le terme succidaneae, et conclut que ce sont des victimes qui servent de complément, si les premières ne suffisent pas. « Pour le même motif, on appelle praecidaneae les victimes qui sont sacrifiées la veille des sacrifices solennels. Et de même, on appelle Porca praecidanea la truie qu'on avait coutume de sacrifier à Cérès, en guise de piaculum, avant la nouvelle poussée des plantes, si dans la famille où quelqu'un était mort, ou n'avait pas fait, ou l'on avait mal fait les purifications nécessaires [FN: § 1286-1] ».
§ 1287. On confond souvent la lustratio et le piaculum, car tous deux visent en somme à rétablir l'intégrité. Les Arvales fratres devaient nécessairement entrer dans le bois sacré, avec des instruments de fer tranchants, pour accomplir les sacrifices. D'autre part, il était défendu de porter ces instruments dans le bois. Par conséquent, cette prescription, transgressée à chaque instant, nécessitait le secours d'une fonction pour rétablir l'intégrité. C'était la tâche du Magister ou du Pro-Magister, qui, le matin, faisait le sacrifice expiatoire de deux porcs et d'une génisse, et attendait, dans l'après-midi, les Arvales. Cela se passait durant la solennité annuelle, qui avait lieu en mai ou en juin. Mais ensuite, chaque fois qu'il y avait quelque travail à exécuter dans le bois sacré, il fallait des sacrifices expiatoires spéciaux. Dans ces usages fort anciens du collège des Arvales, apparaît clairement le caractère mécanique du rétablissement de l'intégrité ; rétablissement qu'on voit être une opération tout à fait semblable à celle qu'on ferait pour aiguiser à nouveau la hache qui a servi à la coupe d'un arbre. Il y a une chose que l'on doit faire, que l'on fait régulièrement, et il n'y a pas de faute à la faire ; mais il est nécessaire d'y opposer une autre opération, pour rétablir un certain équilibre troublé par la première.
§ 1288. L'idée de l'altération de l'intégrité s'étend aussi dans le temps, et aboutit à la responsabilité des descendants pour les fautes des ascendants, et ainsi à la conception chrétienne du péché originel, et à d'autres analogues, comme celle des Orphiques [FN: § 1288-1], d'après lesquels l'intégrité des êtres humains avait été primitivement altérée. Comme conséquence de semblables idées, on croyait que diverses expiations et purifications étaient nécessaires. Platon déjà [FN: § 1288-2] fait mention des devins qui se donnent aux riches comme possédant des purifications capables d'effacer les crimes des hommes et de leurs ancêtres. Ovide reproduit les récits qu'on faisait, de son temps, sur la tache originelle du genre humain [FN: § 3] . À vrai dire, toutes ces historiettes, ces dérivations par lesquelles se manifeste le sentiment de la tache originelle, importent assez peu ; et pourtant, c'est d'elles que s'occupent beaucoup de ceux qui disent étudier les religions, tandis qu'ils négligent les sentiments, les résidus manifestés de cette, façon, et qui agissent principalement pour déterminer l'équilibre social.
§ 1289. On trouve, dans le baptême chrétien, le type du rétablissement de l'intégrité depuis le péché originel. Nous n'avons pas à traiter ici des innombrables dérivations aux-quelles cet acte donna lieu, et moins que jamais de sa valeur spirituelle, sujet qui sort entièrement du domaine expérimental où nous voulons demeurer. Mais, au point de vue des résidus, il est impossible de ne pas rapprocher le baptême chrétien du baptême de Saint Jean-Baptiste et des ablutions que pratiquèrent et pratiquent encore tant de peuples. Dans le baptême chrétien, l'effet de l'une de ces ablutions a pris une forme précise, quant au rétablissement de l'intégrité, et le baptême ôte non seulement le péché originel, mais tout autre péché qui peut avoir souillé l'individu, jusqu'au moment précis du baptême [FN: § 1289-1]. Innombrables sont les passages des saints Pères qui y font allusion, et qu'on peut résumer par le passage suivant qu'on trouve dans les œuvres de Saint Augustin, et qui est d'un auteur inconnu [FN: § 1289-2] : « Rémission des péchés. Le saint baptême efface entièrement tout péché, les péchés originels et les propres péchés : péchés de langue, de faits, de pensée, connus, inconnus, tous sont remis. Celui qui fit l'homme renouvelle l'homme... »
§ 1290. C'est pourquoi, celui qui raisonnait logiquement tirait la conséquence qu'il était profitable d'attendre d'être à l'article de la mort pour se faire baptiser, parce qu'ainsi, tout péché étant effacé, on devait nécessairement être sauvé ; et il appuyait cette opinion sur l'autorité de l'Évangile, où il est dit (Matth. XX) que les ouvriers de la dernière heure seront payés comme ceux de la première. Mais on sait que la logique n'a aucune place dans de semblables raisonnements, et qu'une dérivation peut également prouver le pour et le contre. L'Église s'opposa fortement à ces interprétations qui, à vrai dire, auraient condensé toute la religion en une simple action mécanique, à l'article de la mort [FN: § 1290-1]. De même, elle condamna comme hérétiques les Hémérobaptistes. Ceux-ci, raisonnant aussi en bonne logique, se baptisaient tous les jours, pour effacer les taches morales, comme en nous lavant tous les jours, nous effaçons les taches matérielles [FN: § 1290-2].
§ 1291. On peut envisager l'intégrité avant la naissance et aussi après la mort ; mais tandis que dans le premier cas elle produit ses effets sur un sujet réel, c'est-à-dire sur l'homme vivant, dans le second, elle se rapporte à un sujet abstrait ou imaginaire.
§ 1292. Il fut un temps où, dans l'Empire romain, les purifications par le sang de taureau (taurobole) ou par le sang de bouc (criobole) devinrent assez fréquentes [FN: § 1292-1]. Le taurobole était usité soit comme sacrifice public pour la santé de l'empereur, soit pour la régénération d'un simple particulier. Un homme descendait dans une fosse au-dessus de laquelle on égorgeait un taureau ou un bouc, et il recevait le sang de l'animal. Cela le purifiait, soit pour toujours, soit pour un certain temps, après lequel on devait répéter l'opération [FN: § 1292-2]. Naturellement, les chrétiens étaient indignés de la concurrence que ces purifications faisaient aux leurs. Firmicus Maternus dit: « (28-29) Pourquoi le Taurobole ou le Criobole te recouvre-t-il de sang, par des taches scélérates ? Pour laver les taches qui sont sur toi, demande une fontaine claire, demande de l'eau pure, afin qu'après de nombreuses taches, tu te nettoies grâce au sang de Christ, parle Saint-Esprit ». Tertullien dit que dans les mystères des païens, le démon imite les sacrements de la religion chrétienne [FN: § 1292-3] . Il se pourrait encore qu'il eût raison, car nous ignorons qui est ce démon ainsi que ses us et coutumes. « Il asperge ses croyants et fidèles, et leur promet d'effacer leurs crimes par cette ablution ». Ailleurs [FN: § 1292-4] , traitant de l'efficacité du baptême chrétien, il dit: « Les Gentils aussi, étrangers à toute compréhension des puissances spirituelles, attribuent la même efficacité à leurs idoles. Mais, veuves de toute vertu, leurs eaux sont trompeuses. Par une ablution, ils initient à une Isis ou à une Mithra ; ils aspergent leurs propres dieux. Du reste, ils aspergent d'eau les fermes, les maisons, les temples et les villes entières, tout autour, et expient partout. En certains jeux d'Apollon et d'Éleusis, ils se baignent et pensent être régénérés et gagner l'impunité des parjures. De même, chez les anciens, celui qui s'était souillé d'homicide recourait à des eaux purificatrices ».
§ 1293. On comprend que dans une si grande variété de rites, le choix restât douteux. Si le sentiment qui pousse à la purification naissait de la croyance en une puissance purificatrice, on devrait déduire le sentiment de cette croyance. Au contraire, on observe que le sentiment existe d'abord, puis qu'on cherche la façon de le satisfaire par un rite ; et parfois, celui qui veut se purifier ne sait à qui recourir.
§ 1294. C'est ce qui eut lieu dans la célèbre purification d'Athènes faite par Épiménide [FN: § 1294-1] . « Il prit des brebis noires et blanches, les conduisit auprès de l'Aréopage, et, de là, les laissa aller où elles voulaient, ordonnant à ceux qui les suivaient de les sacrifier au dieu de l'endroit, n'importe où elles se seraient arrêtées. Après cela, la peste cessa. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, pour les dèmes athéniens, on trouve des autels sans noms, qui rappellent les expiations faites alors ». Juvénal [FN: § 1294-2] nous montre la matrone romaine prêtant attention à toutes sortes de charlatans. Elle écoute et prie le prêtre de la mère des dieux, la Juive, le Chaldéen.
§ 1295. Selon Zosime [FN: § 1295-1] , Constantin se serait décidé en faveur de la religion chrétienne, parce qu'elle avait des expiations purificatrices de ses crimes, qu'il ne trouvait pas dans la religion païenne. Il se peut que le fait ne soit pas tout à fait exact. Constantin avait d'autres et peut-être de plus puissants motifs ; par exemple, celui du grand nombre de soldats chrétiens qui se trouvaient dans ses légions. Mais, d'autre part, la superstition agit aussi sur les criminels. On connaît assez le fait de brigands qui portent sur eux des images de la Madone. Après avoir fait tuer sa mère, Néron « fit faire un sacrifice aux mages, pour essayer d'en invoquer et d'en apaiser l'ombre. Dans son voyage en Grèce, il n'osa pas se faire initier aux mystères d'Éleusis, parce que la voix du héraut en éloigne les impies et les scélérats [FN: § 1295-2] ». Dans sa Vie de Constantin, Eusèbe [FN: § 1295-3] dit qu'avant de marcher contre Maxence, Constantin rechercha à quel dieu il devait se fier pour gagner la bataille, et qu'il se décida pour le Dieu des chrétiens, parce que les empereurs, adorateurs des dieux païens, avaient eu un sort contraire. Donc, le fait de la recherche à laquelle se serait adonné Constantin, pour trouver la religion qui pouvait lui être le plus profitable, est rapporté également par Zosime qui lui est hostile, et par Eusèbe qui lui est favorable. Ces auteurs ne divergent que dans les motifs du choix. Dans le récit de Zosime, on trouve le résidu du rétablissement de l'intégrité. Dans le récit d'Eusèbe, il y a, comme résidu, le sentiment de l'intérêt individuel. Dans les deux cas s'ajoutent les résidus des combinaisons (Ire classe).
Les résidus par lesquels, moyennant une certaine consécration, on donne à des hommes, à des animaux, à des choses, des qualités qu'ils n'ont pas, pour obtenir une certaine intégrité imaginaire, sont tout proches des résidus du rétablissement de l'intégrité; à tel point qu'on les confond parfois avec eux. Ici, l'intégrité ne se rétablit pas, après qu'elle a été altérée : elle se crée en perfectionnant ce qui était imparfait.
§ 1296. (V-γ 2). Sujets imaginaires ou abstraits. Dans ce genre, on trouve des composés des résidus des genres précédents, unis à ceux de la persistance des agrégats. Commençons par les cas où ceux-ci dominent. La persistance d'une abstraction (II-δ) donne à cette abstraction une personnalité dont l'intégrité peut être atteinte ; et tout individu qui sent profondément l'abstraction sent aussi l'atteinte qu'on porte à cette intégrité, non seulement comme si c'était sa propre chose, mais aussi comme si c'était une chose appartenant à la collectivité ; c'est pourquoi, au genre de résidus indiqué tout à l'heure s'ajoute le genre (β) de la IVe classe.
§ 1297. Ainsi s'expliquent les pénalités qui, chez tant de peuples, à toute époque, frappent les atteintes portées à la religion dominante, aux coutumes du peuple, à des abstractions de tout genre [FN: § 1297-1]. Prêcher que le Père est antérieur au Fils, ou quelque autre erreur théologique semblable, crier simplement un vivat ou un à bas, reproduire sur une carte postale les belles formes de Pauline Borghèse, sculptée dans le marbre par Canova, passent pour des crimes graves, et troublent profondément un grand nombre d'hommes, parmi lesquels beaucoup sont très indulgents pour les exploits des voleurs et des assassins. Innombrables sont les cas dans lesquels, aux siècles passés, le peuple s'ameutait contre les hérétiques, les maltraitait, les dépouillait, les tuait. Nos contemporains les pangermanistes ne tolèrent pas la moindre contradiction au dogme qui proclame le peuple allemand de beaucoup supérieur à tous les peuples qui ont existé, existent et existeront sur notre globe terrestre, peut-être même dans le système solaire, passant sous silence, par modestie, les planètes qui peuvent graviter autour d'autres soleils, et les peuples qu'elles peuvent héberger. À chaque instant, les journaux publient la protestation furibonde de quelque pangermaniste, mis hors de lui parce que le menu d'un restaurant est écrit en français. Dans d'autres journaux s'allume une sainte colère, parce que les horaires de chemins de fer portent Genève plutôt que Genf. Il y a des gens qui perdent la tête à la seule idée que les amoureux s'écrivent poste restante, à entendre roucouler les colombes, à constater l'absence d'une feuille de vigne, et qui, d'envie ou mus par quelque autre haine, deviennent semblables aux chiens enragés, si l'idée leur vient que d'autres pourraient contempler de belles nudités féminines. Pourtant, l'austérité est souvent plus apparente que réelle. Naturellement, les dérivations surviennent, comme toujours, pour démontrer que ces élucubrations sont logiques, très logiques, et qu'elles ont pour seul et unique but le bien public ; que ceux qui « ont introduit de nouveaux dieux dans la cité » devaient autrefois à juste titre, et pour le bien du peuple, être condamnés à boire la ciguë, et doivent, de nos jours, faire de la prison ou du moins payer des amendes variées.
§ 1298. Dans le phénomène concret, on trouve d'habitude les éléments suivants : 1° il y a les résidus de la persistance des agrégats, qui permettent de considérer comme réel un sujet abstrait ou imaginaire ; 2° il est nécessaire qu'il y ait quelque fait réel ou imaginaire, par lequel on croit ou l'on suppose que l'intégrité du dit sujet a été atteinte ; 3° les résidus du rétablissement de l'intégrité interviennent pour pousser à des actes qui compensent l'atteinte portée ; 4° il s'y ajoute les résidus qui s'opposent à l'altération de l'équilibre social. Les dérivations transforment des sujets et des actes imaginaires en sujets et actes réels, et substituent aux sentiments manifestés par les résidus, des déductions logiques et pseudo-expérimentales.
§ 1299. Il y a d'autres cas où la persistance des agrégats, tout en jouant un rôle notable, ne domine pas entièrement. Le sentiment qui, chez tant de peuples et à diverses époques, fait accepter une législation pénale, est constitué par les trois genres de résidus indiqués tout à l'heure. En général, les résidus de la persistance des agrégats disparaissent ou sont insignifiants, quand la loi pénale n'existe pas et que la vengeance personnelle règne seule ; mais ils apparaissent déjà là où la vengeance s'étend et devient un devoir de la famille, de la tribu. Là aussi, les dérivations voudraient nous faire croire que ces législations ont des motifs exclusivement logiques. Tel les cherche dans la volonté d'un dieu ; tel dans celle d'un législateur semi-divin ou très sage ; tel, dans la sagesse des ancêtres ; tel, dans la volonté populaire ; tel, dans des abstractions métaphysiques ; tel, dans des buts de défense sociale, dans l'amendement du délinquant ou dans d'autres conceptions analogues.
§ 1300. Notez que tous ces raisonnements différents et parfois contradictoires aboutissent très souvent au même but. Il est donc manifeste qu'ils sont secondaires, et que le but et les sentiments qui les font accepter constituent le facteur principal. Un quidam tue l'un de ses concitoyens, en des circonstances telles que 1'opinion publique ne l'excuse pas. Il sera en butte à la vengeance de la famille de sa victime, aux pénalités décrétées par un dieu, par un législateur légendaire, par le souverain, par le peuple, par l'invention subtile des légistes ; mais, comme dit le proverbe, tout chemin mène à Rome, et quelle que soit la voie suivie, on finit également par infliger une certaine peine à l'homicide. Depuis tant de siècles que les savants cherchent comment et pourquoi cela peut ou doit se faire, ils n'ont pas encore pu s'accorder sur une théorie unique, et ils continuent à disputer, chacun pour défendre la sienne. Il demeure donc manifeste qu'historiquement, aussi bien que logiquement, la conclusion précède les prémisses ; ce qui démontre qu'elle n'en résulte pas, mais qu'au contraire on imagine les prémisses pour lui attribuer une raison.
§ 1301. Un cas qui s'est produit de nos jours, en France, est digne d'attention. Les humanitaires avaient, en fait, supprimé la peine de mort. Le Président de la République graciait tous les condamnés à la peine capitale. Le Parlement avait supprimé le crédit affecté au traitement du bourreau. Grâce aux résidus humanitaires et aux dérivations, la peine de mort n'existait plus. Le cas Soleilland se produisit : une brute viola et tua cruellement une enfant du peuple. L'assassin fut condamné à mort, puis, conséquence des théories humanitaires, il obtint la grâce. Les dérivations ne sont efficaces que lorsqu'elles correspondent aux résidus, qui sont les vrais moteurs des actions humaines. Dans le cas cité, cette correspondance n'existait pas. Les résidus de l'intégrité personnelle et de la persistance des agrégats existant toujours dans l'âme populaire des Français, ne s'accordaient pas avec la dérivation humanitaire ; aussi les faits tournèrent-ils contrairement à celle-ci et dans le sens des résidus [FN: § 1301-1] Le Président de la République dut se résigner à approuver des condamnations capitales ; le Parlement rétablit le crédit en faveur du bourreau ; les pires homicides recommencèrent à être justiciés. Un fait semblable se produisit postérieurement, quand la bande Bonnot et Garnier semait le carnage parmi les bons bourgeois. L'instinct de conservation se réveilla en eux [FN: § 1301-2]. Un autre fait semblable eut lieu dans de bien moindres proportions, en Suisse. Après le verdict des excellents jurés d'Interlaken, qui fit condamner à une peine insignifiante l'« héroïne » Tatiana Léontieff, les terroristes russes, raisonnant logiquement, conclurent que la Suisse devenait un pays favorable à leurs exploits. C'est pourquoi, peu de temps après, ils tentèrent une « expropriation » dans une banque de Montreux, procédant à l'« exécution », vulgairement appelée assassinat, de ceux qui s'y opposaient. Mais le bon sens du peuple se réveilla, et l'instinct de conservation l'emporta sur les stupidités des humanitaires. On peut citer des faits analogues en tout pays et en tout temps.
§ 1302. Les théories sur l'antimilitarisme et sur l'antipatriotisme n'ont pas changé, durant ces dernières années, en France et en Italie ; mais les résidus de la IVe classe, et spécialement ceux du genre (δ) de cette classe, ont changé d'intensité, quelles qu'en soient les causes ; aussi jurés et magistrats condamnèrent-ils des actes anti-militaristes et anti-patriotiques pour lesquels ils acquittaient jadis, sans que la législation fût changée le moins du monde [FN: § 1302-1]. Le gouvernement italien expulsa Hervé, qu'il aurait peut-être accueilli au moins avec indifférence, quelques années plus tôt, au temps de la bienveillante indulgence envers ceux qui insultaient l'armée. Les sages changent avec les temps. Là, les faits apparaissent plus clairement, parce qu'une seule cause et un seul effet se manifestent, et parce que le changement suit à bref délai ; mais ils sont précisément semblables aux autres faits du droit pénal, où plusieurs causes s'entrecroisent avec leurs effets, lesquels se produisent en un plus long espace de temps. Le droit pénal correspond plus directement aux résidus que le droit civil ; c'est pourquoi celui-ci paraît souvent être plus logique que celui-là.
§ 1303. Les religions qui admettent la métempsycose font renaître l'être sous une forme humaine ou animale, pour le purifier. Platon parle aussi d'une manière fictive de ce fait, dans la République et le Timée [FN: § 1303-1], où cet illustre rêveur, qui a encore des admirateurs parmi nos contemporains, imagine une foule d'absurdités, sur la façon dont le monde a été créé. Mais on suppose que chez ceux même qui ont définitivement disparu de cette terre, persiste un sentiment d'intégrité qui s'ajoute aux nombreux résidus de la IIe classe, pour déterminer les actions des vivants à l'égard des morts.
§ 1304. Dans l'Iliade, Patrocle demande à Achille de l'ensevelir promptement, pour qu'il puisse entrer au séjour des morts [FN: § 1304-1]. De même, et pour un motif semblable, dans l'Odyssée, l'ombre d'Elpénor parle à Ulysse [FN: § 1304-2] . L'Énée de Virgile voit les âmes de ceux dont le corps gît sans sépulture errer pendant cent ans, avant de pouvoir entrer dans l'Érèbe. Dante voit les âmes des contumaces de l'Église gardées dans l'Anti-Purgatoire durant un espace de temps égal à trente fois celui de leur vie. Le résidu reste le même, tandis que les dérivations croissent, varient, se modifient.
§ 1305. Toujours de ce même résidu naquit la dérivation catholique du Purgatoire et des moyens liturgiques de rétablir l'intégrité des âmes qui y séjournent. Plaisantant sur les superstitions de son temps, Lucien raconte comment Dèmaenétè, après sa mort, apparut à son mari Eucratès. Celui-ci dit [FN: § 1305-1] : « Le septième jour après sa mort, je gisais sur ce lit où je suis maintenant... Et voici qu'entre Dèmaenétè, elle-même, et qu'elle s'assied auprès de moi ; ... lorsque je la vis, en l'embrassant, je me mis à pleurer et à me lamenter ; mais elle me fit taire et me reprocha de lui avoir fait don de tous ses effets personnels et de ne lui avoir pas brûlé l'une de ses sandales brodées d'or. Elle me dit que cette sandale se trouvait sous le coffre où elle était tombée. C'est pourquoi, ne l'ayant pas découverte, nous en avions brûlé une seule. Tandis que nous parlions encore, un maudit petit chien maltais qui était sous le lit aboya, et à cet aboiement elle disparut. On trouva la sandale sous le coffre, et on la brûla aussi ». Dans le même écrit, Lucien fait raconter par Arignôtos (31) comment un spectre hantait une maison, et disparut lorsque le cadavre fut retrouvé et enseveli.
§ 1306. Cette fable est d'un type dont il y a une infinité d'exemples chez les Gentils et chez les chrétiens. Un mort apparaît et tourmente les gens jusqu'à ce qu'on ait pourvu à son ensevelissement, chez les Gentils ; à son ensevelissement et à des messes, oraisons, etc., en sa faveur, chez les chrétiens. L'origine de la dérivation est manifeste. Pline le Jeune [FN: § 1306-1] , par exemple, raconte l'histoire d'une maison d'Athènes, hantée par un fantôme. Le philosophe Athénodore l'achète à vil prix. Un fantôme enchaîné lui apparaît. Athénodore le suit jusqu'à un endroit où le fantôme disparaît. On creuse en cet endroit : on trouve des ossements avec des chaînes ; on les ensevelit honorablement, et le fantôme n'apparaît plus.
§ 1307. Chez les chrétiens, les fantômes demandent des prières [FN: § 1307-1]. Mais la dérivation continue à s'allonger, parce qu'on se demande si ce serait, non pas l'âme du mort, mais plutôt un démon, qui fait cette demande. Tertullien dit [FN: § 1307-2] : « (3) Nous faisons tous les ans des oblations pour les défunts et pour les anniversaires [des martyrs] ». Et il ajoute: « (4) Si vous demandez une prescription de l'Écriture sur ces disciplines et sur d'autres, vous n'en trouvez aucune. Mais on vous mettra devant les yeux la tradition qui en est la source, l'usage qui les confirme, la foi qui les observe ». Cela paraît bien d'accord avec tous les faits connus. Le résidu du rétablissement de l'intégrité donnait lieu à des dérivations variées, qui apparaissaient dans la tradition, étaient confirmées et modifiées par l'usage, et finissaient par faire partie de la foi.
§ 1308. Avec la doctrine du Purgatoire, l'Église catholique n'a fait que donner une forme précise à des dérivations d'un résidu aussi vieux que l'histoire de nos races, et même de beaucoup d'autres [FN: § 1308-1] ; et depuis le temps où, dans nos pays, on faisait des libations sur les tombes des morts, ce résidu est parvenu jusqu'à nous. Cette doctrine peut avoir tiré profit de l'existence de ce résidu, comme elle peut avoir tourné à son avantage d'autres forces sociales, mais elle ne peut avoir créé ce résidu, qui existait nombre de siècles avant son apparition. Dom Calmet a donc parfaitement raison, quand il écrit: « Ceux qui prétendent que tout ce qu'on dit des Esprits, et du retour des âmes, n'est qu'une invention de certaines gens d'Église, qui ont intérêt à entretenir les peuples dans cette opinion, ne font pas attention que les Païens, qui ne tiroient aucun avantage de ces apparitions, et que les peuples barbares du Septentrion, par exemple, qui n'y entendoient aucune finesse, parlent des Esprits, des apparitions, des folets, des Démons, des bons Génies à peu près comme en parlent les Chrétiens et les Ecclésiastiques [FN: § 1308-2] ». Mais il y a aussi une autre erreur dans laquelle on tombe en concluant que si de tels phénomènes ne sont pas un produit de la fraude, ils ont nécessairement une existence objective. Le dilemme supposé n'existe pas. Il y a une troisième hypothèse, qui correspond souvent à la réalité : que ces phénomènes manifestent seulement l'existence subjective de certains résidus, qui persistent et prennent des formes variées et changeantes avec le temps.
§ 1309. Le concile de Trente dit que l'Église catholique enseigne [FN: § 1309-1] « qu'il y a un Purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues reçoivent du soulagement par les suffrages des fidèles, et principalement par le sacrifice de l'autel, toujours agréé de Dieu ». Si nous voulons résumer les croyances de nos ancêtres gréco-romains, et plus généralement des Indo-Européens, nous dirons « qu'il est un lieu (la demeure de ![]() , le séjour des inferi) où les âmes sont détenues, et que celles-ci profitent du culte que les vivants leur rendent, et principalement de la nourriture que les descendants de chaque mort portent sur sa tombe ». Comme d'habitude, ceux qui accordent la première place aux dérivations estiment qu'entre ces deux croyances, il y a un abîme. Ceux pour lesquels l'étude des phénomènes sociaux n'est qu'un prétexte pour prêcher la « vertu » ou le « progrès » ne peuvent tolérer qu'on ose comparer une croyance où la paix des morts dépend, au moins en partie, de leurs bonnes actions, et une croyance où elle dépend d'opérations mécaniques, telles que les libations et les offrandes d'aliments.
, le séjour des inferi) où les âmes sont détenues, et que celles-ci profitent du culte que les vivants leur rendent, et principalement de la nourriture que les descendants de chaque mort portent sur sa tombe ». Comme d'habitude, ceux qui accordent la première place aux dérivations estiment qu'entre ces deux croyances, il y a un abîme. Ceux pour lesquels l'étude des phénomènes sociaux n'est qu'un prétexte pour prêcher la « vertu » ou le « progrès » ne peuvent tolérer qu'on ose comparer une croyance où la paix des morts dépend, au moins en partie, de leurs bonnes actions, et une croyance où elle dépend d'opérations mécaniques, telles que les libations et les offrandes d'aliments.
§ 1310. Ils ont raison les uns et les autres, quand on envisage les choses au point de vue sous lequel il leur plaît de les étudier ; mais il y a aussi un autre aspect : c'est l'aspect exclusivement scientifique, sous lequel on envisage les phénomènes sociaux comme le naturaliste envisage les plantes et les animaux ; et sous cet aspect, les deux croyances mentionnées tout à l'heure sont entièrement semblables. Elles sont des dérivations des résidus de persistance des agrégats et du rétablissement de l'intégrité altérée.
§ 1311. Non seulement l'intégrité de l'âme peut être altérée, mais aussi celle du cadavre. On raconte de nombreux faits de cadavres d'excommuniés, qui sortaient de l'église où ils étaient ensevelis, quand le diacre disait: « Que ceux qui ne communient pas se retirent [FN: § 1311-1] ». Un autre conte est celui de l'incorruptibilité du cadavre des excommuniés. Dom Calmet écrit: « (p. 344) C'est une très ancienne opinion que les corps des excommuniés ne pourrissent point. Cela paroît dans la vie de S. Libentius, Archevêque de Brême, mort le 4 de janvier 1013. Ce S. Prélat ayant excommunié des Pirates, l'un d'eux mourut, et fut enterré en Norvège. Au bout de 70 ans on trouva son corps entier et sans (p. 345) pourriture, et il ne fut réduit en cendres qu'après avoir reçû l'absolution de l'Evêque Alvarede. (p. 345) Les Grecs modernes, pour s'autoriser dans leur schisme, et pour prouver que le don des miracles et l'autorité Episcopale de lier et de délier, subsiste dans leur Église, plus visiblement même, et plus certainement que dans l'Église Latine et Romaine, soutiennent que parmi eux les corps de ceux qui sont excommuniés ne pourrissent point [FN: § 1311-2] ». On sait que les corps des saints sont aussi incorruptibles. Comme d'habitude, la même dérivation prouve le pour et le contre.
§ 1312. (V-δ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant à ceux qui l'ont altérée. Il existe un sentiment qui pousse l'animal ou l'homme à réagir contre celui qui l'a offensé, à rendre le mal pour le mal. Tant que cela n'a pas eu lieu, l'homme éprouve un sentiment de malaise, comme si quelque chose lui manquait. Son intégrité est altérée, et ne revient à son état primitif que lorsqu'il a accompli certaines opérations portant sur son agresseur. On trouve des types de ces sentiments dans ceux qui poussent à la vengeance [FN: § 1312-1] ou au duel.
§ 1313. (V-δ 1) Agent réel d'altération. [Note ajoutée par l’auteur à l’édition française [FN: § 1313-1] Ce genre est de beaucoup le plus important, et même presque le seul qu'il vaille la peine d'envisager. L'offense frappe souvent des collectivités plus ou moins étendues, même si elle est faite à un seul des individus qui en font partie. Les conjoints, les parents, les subordonnés, les compagnons, les concitoyens et jusqu'aux animaux (par exemple, le chien qui défend son maître) de l'homme auquel l'offense est faite, peuvent la ressentir comme une offense personnelle, avoir le sentiment que leur intégrité est altérée ; et par conséquent, le besoin du rétablissement de l'intégrité peut naître chez eux ; besoin qui les pousse à réagir contre l'offenseur. De là proviennent les nombreuses variétés du devoir de vengeance, du droit au prix du sang, qu'on observe chez les peuples barbares ou semi-barbares. Souvent ces résidus se confondent avec ceux du genre (V-α).
De nos jours, chez les peuples civilisés, si un citoyen est offensé à l'étranger, le gouvernement du pays de ce citoyen prend souvent prétexte de l'offense pour obtenir des compensations ; et c'est là une simple action logique. Mais beaucoup de gens sont poussés à approuver cette façon de procéder, par le même sentiment que celui qui, en d'autres temps, faisait de la vengeance un devoir. Un Européen est tué dans un pays barbare. On bombarde un village où les coupables ne sont pas, et l'on tue nombre d'innocents. Ainsi est rétablie l'intégrité des citoyens du pays civilisé, aux dépens des citoyens du pays barbare.
§ 1314. Cette Tatiana Léontieff, que les très sages jurés d'Interlaken condamnèrent à une peine fort légère, avait tué un malheureux M. Muller, croyant frapper le ministre Durnovo, sur lequel, disait cette héroïne, elle voulait venger les souffrances des socialistes russes. Au juge qui lui demandait si elle regrettait son erreur, elle répondit négativement, parce que « ce M. Muller était aussi un bourgeois ». En sorte que la thèse de cette mégère, acceptée par les bons jurés, paraît avoir été la suivante. Le ministre Durnovo avait offensé les socialistes russes ; donc, il était juste de tuer un M. Muller, qui n'avait pas pris une part, même lointaine, aux faits du ministre Durnovo, mais qui était un « bourgeois ».
§ 1315. Au point de vue logique, ce raisonnement est absurde et stupide ; aussi ne vaut-il pas par la logique, mais par les sentiments qu'il manifeste, lesquels correspondent justement aux résidus que nous étudions. Pour venger un de ses ressortissants, le gouvernement russe tue des gens qui n'offensèrent en rien ce ressortissant, mais qui sont de la même nation que l'offenseur. Pour venger certains amis, entre autres un grand ami, Tatania Léontieff tue un malheureux qui n'avait pris part ni de près ni de loin aux offenses dont on se plaignait, mais qui appartenait à la même collectivité (la bourgeoisie) que l'offenseur. Dans les deux cas, l'intégrité de certains A, qui a été altérée, se rétablit en altérant l'intégrité de certains B. Quant aux jurés, ils estimaient que l'intégrité de certaines de leurs conceptions humanitaires avait été offensée par le gouvernement russe ; c'est pourquoi ils tenaient pour excusable tout acte qui eût pour cause ou pour prétexte le désir de rétablir cette intégrité.
§ 1316. On ne sait pas pourquoi Tatiana Léontieff devait choisir justement M. Muller pour victime expiatoire, et non pas son père à elle, qui était non seulement un « bourgeois », mais par dessus le marché un employé du gouvernement russe ; ou bien l'un de ces braves jurés, qui étaient aussi des « bourgeois » ; ni pourquoi elle trouvait bon de mener la vie large avec l'argent qui lui venait de son père, bourgeois et payé par le gouvernement russe ; ni pourquoi messieurs les humanitaires veulent qu'on tue un chien enragé, et qu'on laisse au contraire courir le monde aux pires criminels ou déséquilibrés. Mais il est inutile, de chercher des motifs logiques aux actions non-logiques.
§ 1317. Celui qui est exclu d'une collectivité voit, par ce fait, son intégrité altérée, et cette altération peut être ressentie assez fortement pour jouer le rôle d'une peine très grave. Sans même aller jusqu'à l'exclusion, la seule déclaration que l'intégrité d'un individu n'existe plus peut équivaloir à une peine infligée par la force [FN: § 1317-1].
§ 1318. Cela explique pourquoi, en plusieurs droits primitifs, on trouve des sentences sans sanction d'aucune sorte, et des sentences à l'exécution desquelles ne veille aucune autorité publique. Les juristes auxquels ces faits causèrent de la surprise, devraient faire attention que de nos jours nous avons encore les sentences des jurys d'honneur, qui sont du même genre ; et bien qu'il n'y ait pas de force publique pour exécuter ces sentences, la simple déclaration qu'elles contiennent peut être une peine beaucoup plus grave que celles de quelques jours de prison, subis en suite de jugement régulier d'un tribunal ordinaire. Des sentences qui n'ont pas directement de sanction peuvent en avoir une indirectement, parce qu'elles altèrent l'intégrité de l'homme qu'elles frappent. Par ce fait, l'homme en question ne peut plus traiter sur un pied d'égalité avec les autres hommes qui étaient ses égaux. Mais il faut prendre garde que cette conséquence est accessoire ; le fait principal est la diminution de l'intégrité déclarée par certaines personnes d'autorité. César observa qu'en Gaule la force des sentences des druides provenait de ces conséquences indirectes [FN: § 1318-1]. Il aurait pu comparer ce fait avec celui de la note du censeur, à Rome, ou avec la déclaration sacer esto des anciennes lois [FN: § 1318-2] Dans les faits concrets, les résidus interviennent presque toujours en très grand nombre ; mais parmi les faits que nous venons de citer se dégage principalement le résidu par lequel le malfaiteur est déclaré privé de son intégrité ; il déchoit ; il est exclu de la collectivité. Les anciennes lois de l'Irlande nous montrent des faits semblables [FN: § 1318-3], que Sumner Maine compara opportunément avec d'autres faits juridiques des Indes, et dont nous avons déjà parlé (§ 551).
§ 1319. De ce sentiment, qui veut opposer à une altération de l'intégrité une autre altération analogue, naissent en nombre immense les dispositions qui fixent la manière et la quantité de l'altération qui sert de compensation. Sous le rapport de la quantité, des règles très simples du talion, nous arrivons par un long chemin jusqu'à la dosimétrie (ainsi l'appelle Enrico Ferri) aussi savante que ridicule, du code de Zanardelli. Ce n'est pas ici le lieu de discuter de tout cela. Le phénomène est complexe, et l'on a un substratum de résidus variés, recouvert de dérivations plus ou moins complexes.
§ 1320. (V-δ 2) Agent imaginaire ou abstrait d'altération. Le résidu apparaît clairement, quand les hommes s'en prennent à leur fétiche, à quelque saint, à des êtres spirituels, à leur dieu. Si c'était utile, on pourrait citer à ce propos un très grand nombre d'exemples. On peut les résumer de la façon suivante. l° Les hommes traitent l'être imaginaire comme un être réel ; ils le louent et le blâment, l'exaltent et l'injurient, font avec lui contrat, lui promettent des cadeaux s'il leur procure des avantages, le menacent de représailles s'il les laisse subir des dommages, en adorent l'image, s'il les satisfait, le négligent ou le traitent avec mépris, vont même jusqu'à le frapper, s'il les mécontente. 2° On explique et l'on justifie ensuite par les dérivations ces simples associations d'idées et les actions non-logiques qui en sont la conséquence. L'être imaginaire peut être considéré comme toujours bon. Le contrat prend alors la forme d'une simple promesse de manifester sa reconnaissance par des cadeaux. Par exemple, le contrat que les Romains faisaient avec Jupiter, pour qu'il leur donnât la victoire ; ou bien la promesse d'un cadeau des catholiques modernes, si Saint Antoine de Padoue leur fait retrouver une chose perdue. L'être imaginaire peut être considéré comme tantôt bon, tantôt mauvais, et l'on tâche de le traiter de manière à ce qu'il soit bon. Il peut être considéré comme principalement ou exclusivement mauvais [FN: § 1320-1], et l'on tâche de l'apaiser par de bons traitements ou de le punir en le maltraitant. Enfin, il peut être considéré comme essentiellement mauvais, tel le démon des chrétiens ; et les mauvais traitements sont tout ce qu'il mérite. De cette façon, on passe graduellement des simples associations d'idées à une ingénieuse et subtile théologie. Mais au fond, les résidus recouverts des dérivations sont les mêmes.
§ 1321. On sait assez que les peuples qui ont des fétiches les abandonnent ou les maltraitent, quand ils en sont mécontents, et il ne semble pas qu'ils fassent là-dessus de nombreux raisonnements [FN: § 1321-1] . Elles n'en font pas davantage, nos bonnes femmes qui maltraitent l'image du saint qui ne leur a pas accordé la grâce demandée ; ni ceux qui blasphèment, non par mauvaise habitude, mais dans l'intention bien arrêtée d'offenser Dieu ou la Madone. Tout cela n'est pas seulement le propre d'une foule ignorante. L'ancienne Grèce admirait les poèmes d'Homère, où les mortels combattent contre les dieux. Dans les temps les plus anciens, cela ne paraît nullement avoir fait scandale. Plus tard, Platon s'indigne des aventures des dieux d'Homère. Plus tard encore, en commentant les poèmes homériques, les Alexandrins s'efforcent de les ramener à une meilleure leçon. Dans l'Iliade, Diomède frappe Aphrodite, puis Arès [FN: § 1321-2] . Il existe une tentative de justification, car Athéna conseille et protège Diomède, qui peut ainsi se considérer comme le moyen dont se sert Athéna pour frapper Arès. Pour consoler sa fille Aphrodite, Dionée rappelle que nombre de dieux eurent à supporter de terribles souffrances de la part des hommes. Dans l'Iliade [FN: § 1321-3] aussi, Hélène injurie Aphrodite. Beaucoup plus tard, nous trouvons un fait analogue dans les Dionysiaques [FN: § 1321-4]. Au point de vue de la réalité, les deux récits sont également imaginaires ; mais comme indices de sentiments, la valeur en est inégale. La popularité ancienne de l'Iliade montre que les injures d'Hélène ne provoquaient aucun scandale dans le peuple, et par conséquent le récit qu'elle contient est un indice de sentiments très généraux. Au contraire, le récit des Dionysiaques n'est que l'indice des sentiments d'un nombre restreint de lettrés, et c'est peut-être seulement un artifice poétique.
§ 1322. Quand Platon s'indigne contre les poètes, à cause des fables qu'ils racontent sur les dieux [FN: § 1322-1] , il représente la réaction de la logique contre ces associations d'idées non-logiques. Mais il faut comprendre que les hommes qui croient à ces aventures des dieux n'en tirent nullement les conclusions logiques qu'elles pourraient entraîner, et que, par conséquent, la vénération qu'ils portent à leurs dieux ne diminue nullement ; de même qu'à notre époque, la vénération de la bonne femme pour le saint qu'elle maltraite parce qu'il ne l'a pas exaucée, ne diminue pas le moins du monde ; de même que l'amour des Gallois mystiques pour certains de leurs chefs trop experts au jeu de la bourse, ne diminue pas ; de même que ne diminue pas le respect des « prolétaires » pour certains de leurs chefs, qui font argent du socialisme [FN: § 1322-2] , ou pour d'autres gens qui n'ont de « prolétaire » que le nom, étant au fond de riches bourgeois.
§ 1323. Pausanias (III, 15) parle d'une statue d'Aphrodite portant les fers aux pieds, et rapporte deux traditions. Suivant la première, Tindare fit faire la statue de cette façon, pour montrer allégoriquement que les femmes devaient être soumises à leurs maris. Suivant l'autre, il fit cela pour se venger d'Aphrodite, qui avait induit Hélène et Clytemnestre à mal faire. Il semble ridicule à Pausanias de supposer que, par ce moyen, on puisse se venger de la déesse. Arien [FN: § 1322-1] rapporte, mais sans trop y attacher créance, qu'Alexandre le Grand, très affligé de la mort d'Ephestion, fit renverser le temple d'Esculape, pour se venger de ce dieu, qui n'avait pas sauvé Ephestion. Suétone [FN: § 1322-2] rapporte qu'à la mort de Germanicus, le peuple lapida les temples des dieux et en renversa les autels. Ces sentiments paraissent étranges ; mais il y en a d'analogues, même à notre époque, non seulement parmi le vulgaire qui injurie Saint Janvier si le sang tarde à bouillir, mais aussi parmi des personnes cultivées [FN: § 1323-3].
§ 1324. VIe CLASSE. Résidu sexuel. Le simple appétit sexuel, bien qu'il agisse puissamment sur la race humaine, ne doit pas nous occuper ici, cela pour les motifs exposés au § 852. Nous devons surtout étudier le résidu sexuel de raisonnements et de théories. En général, ce résidu et les sentiments dont il tire son origine se rencontrent dans un très grand nombre de phénomènes ; mais ils sont souvent dissimulés, spécialement chez les peuples modernes.
§ 1325. L'antiquité gréco-latine envisagea l'acte sexuel comme la satisfaction d'un besoin, à l'égal de boire, de manger, de s'orner, etc., et les regarda tous avec indifférence, condamnant en général l'abus, et souvent la recherche dans le plaisir. Dans un passage célèbre du discours contre Nééra, l'orateur dit [FN: § 1325-1] : « Nous avons les hétaïres pour la volupté, les concubines pour les soins journaliers du corps, les femmes pour avoir des enfants légitimes et garder fidèlement les choses de la maison ». Pour Rome, nous avons d'abord une division entre les femmes qui devaient garder la chasteté et celles qui n'avaient pas ce devoir [FN: § 1325-2]. Il est évident que la loi a uniquement en vue des buts civils, qu'elle impose aux ingénues certains devoirs réputés utiles à l'État, et qu'elle laisse les hommes libres de commettre le péché charnel, s'il ne nuit pas à l'État. Pour nos vertuistes, tous les amours libres sont illicites. Pour les Romains, les uns étaient licites, les autres illicites [FN: § 1325-3]. Ils n'avaient pas pour l'adultère des matrones les indulgences faciles de nos vertuistes, et leurs sectaires n'éprouvaient aucune indignation contre les amours avec les affranchies ou avec d'autres femmes semblables. C'étaient non pas les résidus sexuels qui les guidaient, mais des considérations d'utilité pour l'État. Une inscription trouvée à Isernia nous apprend que les auberges exposaient le tarif, non seulement des mets, mais aussi des filles qu'elles fournissaient au public [FN: § 1325-4]. Un voyageur dépense un as pour le pain, deux as pour les victuailles, huit as pour la fille et deux as pour le foin du mulet. Dans le Digeste [FN: § 1325-5], Ulpien nous apprend qu'en beaucoup d'endroits les lupanars appartenaient à d'honnêtes gens. Dans la suite, pour des causes encore partiellement obscures, vers la fin de l'empire romain, la considération de l'acte sexuel s'impose, prédominante, à l'esprit des hommes, et prend des formes religieuses, se manifestant souvent par une sainte horreur. Il est vraiment extraordinaire que maintenant, chez les peuples civilisés, ce tabou soit resté la dernière religion à laquelle le bras séculier accorde son appui. On peut impunément blasphémer Dieu et les saints, prêcher la guerre civile, le carnage et le pillage, mais on ne peut publier de livres ou de figures obscènes. De même, les Wahabites estiment que fumer du tabac est le pire des crimes, bien autrement infâme que de tuer ou de voler. Le fait de renverser ainsi l'échelle de gravité des crimes, comme cela semble à qui n'a pas certains sentiments religieux, est justement un caractère essentiel de la répression des hérésies religieuses, et de la puissance du sentiment qui pousse à agir ainsi les hommes dont l'esprit est opprimé par le préjugé et par certains sentiments.
§ 1326. Dans nos races, trois tabous d'abstinence persistent à travers les siècles ; ce sont, par ordre d'intensité croissante, l'abstinence de la viande, celle du vin et celle de tout ce qui concerne les rapports sexuels. On peut faire remonter l'abstinence de la viande jusqu'à Pythagore. Plutarque nous a laissé deux discours tendant à éloigner les hommes de l'usage de la viande. Il nous reste un traité entier de Porphyre, sur l'abstinence de la viande. Les chrétiens la recommandèrent et l'imposèrent sous diverses formes. Finalement, nous avons les végétariens modernes [FN: § 1326-1]. Dans l'antiquité, on traite beaucoup de la modération dans l'usage du vin, mais peu ou pas de l'abstinence totale. Les premiers chrétiens conseillèrent un usage restreint ou même l'abstinence du vin, comme celle de la viande, soit pour faire pénitence, soit encore plus pour réprimer les tentations qui poussent au péché charnel. Nous avons, là-dessus, un grand nombre de prescriptions des saints Pères [FN: § 1326-2] . Pourtant, l'Église catholique, qui visa toujours au juste milieu, tout en imposant l'abstinence de la viande en certains jours, permettait l'usage du vin, se montrant ainsi beaucoup plus libérale que certains de nos pseudo-savants contemporains. Aujourd'hui, les sectaires anti-alcooliques reproduisent les exploits des fanatiques religieux. L’abstinence des plaisirs de l'amour et de tout ce qui peut les rappeler, même de loin, s'observe, au moins en théorie, chez les premiers chrétiens, et maintenant, toujours en théorie, elle a de nouveau donné lieu à un fanatisme de pudeur pathologique.
§ 1327. Les résidus de ces phénomènes sont complexes. On y peut distinguer au moins trois parties. 1° La partie la moins importante est celle d'un résidu de combinaisons par lequel une secte est poussée à prendre un signe quelconque qui la distingue du vulgaire, de l'étranger, ou d'autres sectes. Par exemple, on observe la prohibition de certains aliments, chez un très grand nombre de peuples. Quand la Bible défend l'usage de la viande de lièvre, il est impossible d'y voir aucun motif d'ascétisme ou autre semblable (§ 1276 suiv.): c'est un simple résidu de combinaisons. Ce résidu est souvent mêlé à un autre résidu, d'intégrité personnelle : à l'orgueil; la combinaison a non seulement pour but de distinguer, mais aussi d'exalter [FN: § 1327-1] . Il est probable qu'il y a en des résidus de ce genre chez les chrétiens, qui voulaient rester distincts des Gentils. 2° La partie la plus importante, dans les deux premiers tabous, très importante aussi dans le troisième, est un résidu d'ascétisme. Il se manifeste en ce que ces tabous sont accompagnés d'abstinences et de macérations qui appartiennent certainement à l'ascétisme. C'est plus que clair chez les chrétiens ; chez d'autres abstinents, c'est moins manifeste ; chez quelques-uns, on l'aperçoit à peine ; par exemple, chez nos anti-alcooliques contemporains, qui prétendent ne rechercher que l'utilité publique ; mais ce n'est pas seulement le hasard qui, généralement, les rend humanitaires, religieux, moralistes, pudibonds : peut-être, sans que plusieurs d'entre eux s'en aperçoivent, ne sont-ils pas exempts de résidu ascétique. 3° Des sentiments accessoires de l'ascétisme, tels que la vanité, l'envie envers qui jouit de ce qu'on ne peut avoir soi-même, le désir de l'estime et de l'admiration d'une collectivité, etc. Nous avons déjà traité de tout cela (§ 1169 à 1171). 4° Le besoin de manifester par des actes extérieurs sa foi ascétique ; besoin auquel correspondent les résidus de la IIIe classe.
§ 1328. Il y a des cas d'exaltation religieuse pour les trois tabous mentionnés tout à l'heure. Pour le tabou de la viande, on peut observer la forme religieuse aux Indes, mais non dans nos pays. Pour le tabou du vin, on peut voir quelques cas, çà et là, parmi nos contemporains. Pour le tabou du sexe, c'est un phénomène général, des temps passés aux nôtres.
§ 1329. Pour les tabous de la viande et du vin, il y a effectivement des pays où ils sont à peu près observés ; c'est-à-dire qu'il y a réellement des collectivités qui s'abstiennent de viandes et de boissons fermentées. Toutefois, quant à ces boissons, l'abstinence n'est souvent qu'apparente, comme à notre époque en Turquie. Mais pour le tabou sexuel, les différences de fond sont peu nombreuses, et l'on observe seulement de notables différences de forme. La prostitution est interdite dans les pays musulmans ; mais elle y est remplacée, non seulement par le concubinage, mais aussi par de pires pratiques. Elle était interdite aussi dans nos contrées, en des temps où les mœurs étaient loin d'être meilleures que celles d'aujourd'hui. C'est l'un des cas si nombreux où la puissance des sentiments rend le fond presque constant et ne laisse varier que la forme [FN: § 1329-1]. Le contraste est si grand qu'on est induit à admettre le paradoxe suivant lequel c'est justement là où la morale et les lois condamnent le plus sévèrement l'immoralité, que celle-ci est la plus grande. De nombreux faits portent à croire que c'est le cas de plusieurs États de l'Amérique ; mais nous ne pouvons pas, de cas particuliers, tirer une règle générale.
§ 1330. Dans la religion sexuelle, comme en un grand nombre d'autres religions, la rigueur de la forme engendre la perversion [FN: § 1330-1] et l'hypocrisie : l'histoire du fruit défendu est de tous les temps [FN: § 1330-2] .
Au moyen âge et même un peu plus tard, quand la manie religieuse était à l'état aigu, les invocations au diable et les pactes avec lui étaient fréquents. Aujourd'hui que cette manie a énormément diminué, qui pense encore à ces pratiques ? Beaucoup de débordements obscènes ont peut-être eu, au moins en partie, une origine semblable à celle de l'invocation du diable. Henri III de France, qui alternait habituellement les pratiques de l'ascétisme religieux avec celles des vices contre nature, n'est qu'un type d'une classe très étendue. De nos jours, justement dans les pays qui affectent le plus d'être pudibonds, se produisirent des faits extrêmement obscènes, comme ceux du procès Taw, aux États-Unis d'Amérique, la traite des vierges, révélée par la Pall Mall Gazette, le procès Oscar Wilde, en Angleterre, le procès Eulenbourg et d'autres semblables, en Allemagne. En outre, là où les mœurs de Cythère sont exclues, on voit, à la place, les usages de Sodome et de Lesbos. Le résidu est constant, et si on lui enlève sa forme naturelle, il en prend d'autres.
Les gens qui ont l'esprit hanté par une idée fixe sont poussés à des actes ridicules, qui font rire ceux qui sont exempts de tels préjugés. C'est ainsi que beaucoup d'actes du culte de peuples barbares et aussi de peuples civilisés nous semblent risibles. Les manifestations du résidu sexuel n'échappent pas à cette règle générale. Aujourd'hui, en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, on observe des faits de pudeur sexuelle, hypocrite ou sincère, aussi ridicules que ceux des plus étranges tabous [FN: § 1330-3].
§ 1331. Le résidu sexuel n'existe pas seulement dans les idées qui ont en vue l'union des sexes ou un souvenir complaisant de cette union, mais aussi dans les idées qui révèlent un blâme, une répugnance, de la haine pour cette union. Cela peut paraître étrange ; pourtant de nombreux faits montrent que l'idée de la chasteté, là où elle domine l'esprit, peut avoir un résidu sexuel [FN: § 1131-1] ; et beaucoup ont été conduits par cette voie à quelque vice secret.
§ 1332. Le résidu sexuel peut exister dans des relations très innocentes et très chastes, et c'est une erreur manifeste de supposer que là où existe ce résidu, des rapports physiques existent nécessairement aussi. Il y a un très grand nombre d'exemples de femmes qui, sous l'empire d'une forte passion religieuse, suivaient des hommes et les traitaient avec une grande affection, sans qu'il y eût aucune trace d'amour physique. On a pu le voir dans le Réveil au Pays de Galles, en 1904, où Evan Roberts était l'objet de la tendre admiration de femmes qui demeuraient, semble-t-il, tout à fait pures [FN: § 1132-1]. Ces faits doivent nous porter à ne pas accorder trop facilement créance aux accusations que les adversaires se lancent mutuellement à ce propos. On a dit, par exemple, que la comtesse Mathilde avait eu pour le pape Grégoire plutôt les sentiments d'une amante que ceux d'une fille ; cela paraît très peu probable.
§ 1333. D'autre part, l'existence du résidu sexuel, aussi bien dans des discours et des écrits chastes que dans des discours et des écrits obscènes, doit nous enseigner que, pour pousser à des actes d'amour physique, il peut y avoir ou non diversité entre les premiers et les seconds. Cela dépend des individus. Il y a des gens qui sont plus facilement portés à des actes d'amour physique par des discours et des écrits chastes, et d'autres, au contraire, qui y sont portés par des écrits obscènes. On a dit, et il se peut, que le Pastor fido entraîna plus de femmes aux plaisirs amoureux que le Décaméron [FN: § 1333-1].
§ 1334. On trouve le résidu sexuel dans une très grande partie de la littérature. Drames, comédies, poésies, romans, s'en passent difficilement. Les modernes distinguent, on ne sait trop d'après quel critère, une certaine littérature « morale » d'une autre littérature, « immorale » ; et souvent ce n'est rien d'autre qu'une hypocrisie de gens qui s'offusquent du nom plus que de la chose, et préfèrent les actes aux paroles. En tout cas, s'il n'est pas absolument impossible d'écrire un roman, une comédie, un drame, sans amour, tout en intéressant le lecteur, il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des cas très rares ; ce qui montre le grand pouvoir des résidus sexuels, dont on ne peut se passer dans les œuvres littéraires. Le public accourt nombreux pour entendre des procès où il s'agit d'amour, et les écoute d'autant plus avidement qu'on y traite davantage de faits obscènes. Dans ce public, il ne manque pas d'hommes, et encore moins de femmes, qui, ailleurs, s'évertuent à défendre la morale et à réprimer l'immoralité [FN: § 1334-1] .
§ 1335. Bien souvent déjà, nous avons dû remarquer comment les résidus sexuels se manifestent par des phénomènes semblables à ceux qu'on appelle religieux, et qui constituent ainsi un ensemble auquel il convient d'accorder une place dans cette classe. Nous pouvons ajouter que la religion sexuelle a, comme les autres, ses dogmes, ses croyants, ses hérétiques, ses athées ; nous avons dû souvent déjà rappeler tout cela ; mais comme cette opinion est opposée à celle qui est généralement admise, il ne sera pas superflu d'ajouter d'autres preuves à celles que nous avons déjà données.
§ 1336. Nous rappelons qu'il s'agit ici exclusivement de savoir si certains phénomènes ont ou n'ont pas des caractères donnés il ne s'agit pas d'en apprécier les effets individuels ou sociaux (§ 74). Quand nous aurons reconnu que ces phénomènes constituent un agrégat semblable à d'autres qui portent le nom de religion, nous ne saurons pas encore s'ils appartiennent au genre des phénomènes utiles ou à celui des phénomènes nuisibles. Il y a des religions nuisibles, d'autres anodines, d'autres utiles, d'autres encore très utiles ; et les recherches faites ici ne nous apprendront pas dans quelle classe la religion sexuelle doit être placée.
§ 1337. En général, les religions n'admettent pas d'être subjectives : elles veulent être objectives, et entendent que la science logico-expérimentale confirme entièrement leurs dogmes. Peu développées, elles se contentent de la partie matérielle ; plus avancées, elles veulent des parties intellectuelles, abstruses et principalement mystérieuses. On voile certains objets du culte ; on ne prononce pas certains noms, ou bien on ne les prononce qu'avec un saint respect ou une sainte horreur. Les Hébreux ne prononçaient pas le nom de leur Dieu ; les Romains avaient pour leur ville un nom ignoré du vulgaire ; les Athéniens punissaient sévèrement celui qui tentait de dévoiler les mystères d'Éleusis. Souvent, on trouve dans les religions un sentiment mêlé d'amour et de crainte, même de terreur, pour les êtres qui sont l'objet du culte. Les dogmes, comme les prescriptions des tabous, sont les prémisses et jamais les conclusions de raisonnements logiques. Le seul fait de les nier est un crime ou du moins révèle une nature perverse. Le croyant fervent en est profondément ému et venge souvent l'offense faite à ses théories, non pas en opposant d'autres raisonnements, faits, ou observations, mais en recourant à la force, soit directement, soit au moyen de l'autorité publique. Les procès pour impiété se soustraient souvent aux règles générales de la procédure : la seule accusation d'un crime si grave suffit pour enlever à l'inculpé les garanties usuelles qu'on ne refuse pas pour d'autres crimes. La défense d'une religion donnée devient la défense de « la morale », de « la justice », de « l'honnêteté », et doit par conséquent être approuvée même par qui n'appartient pas à cette religion, pourvu seulement qu'il soit « moral », « juste » et « honnête ». Tel ne pouvait être le non-chrétien, au moyen âge ; tel encore ne peut être, pour beaucoup de musulmans, celui qui n'est pas musulman. On rencontre tous ces caractères dans l'ensemble des phénomènes qui constituent la religion sexuelle présente. Ajoutons qu'elle admet les maximes connues sous le nom de « raison d'État », en vertu desquelles la fin justifie les moyens ; et par conséquent, quand le but est d'une très haute importance, ces maximes enjoignent de ne pas se préoccuper de frapper l'innocent, pourvu que le coupable n'échappe pas (§ 1012-1).
§ 1338. Chez les peuples anciens et aussi chez des peuples sauvages modernes, les organes et les actes sexuels font partie du fétichisme général. Nous les séparons, parce que nous jugeons les faits avec nos conceptions où le fétichisme sexuel persiste, tandis que les autres fétichismes ont disparu ou se sont affaiblis. Il serait superflu d'apporter ici les preuves de ces faits du fétichisme sexuel chez les divers peuples, car, d'un côté ces faits sont bien connus, de l'autre, ils n'appartiennent pas à la matière de la sociologie générale : ils ne doivent avoir leur place que dans la sociologie spéciale, où l'on étudie à fond le fétichisme. Mais nous devons rappeler quelques faits qui servent à prouver la continuité du phénomène dans nos nations et l'importance du résidu sexuel, car il nous faut connaître tous les résidus qui peuvent agir sur l'équilibre social. Comme d'habitude, nous portons nos regards principalement sur la civilisation qui, de la Grèce et de Rome, s'étend maintenant à nos contrées.
§ 1339. Nous avons vu que, chez les anciens Romains, presque toutes les actions non-logiques de la vie donnaient lieu, grâce à la persistance des agrégats, à des conceptions qui apparurent plus tard comme autant de petits dieux (§ 176 et sv.) Il y en avait principalement pour tous les actes de l'homme, dès la conception jusqu'à la mort. Si nous les disposons en ordre, par catégories [FN: § 1339-1] , nous observerons que, pour les modernes, il y a un hiatus considérable, là où pour les anciens Romains il y avait continuité. 1° Dieux des actes précédant la consommation du mariage ; c'est-à-dire: Iuno iuga, ou Iuno pronuba, qui unit par le mariage; Deus Iugatinus, qui préside à l'union matrimoniale ; Afferenda, pour le transport de la dot ; Domiducus, qui conduit l'épouse dans la maison du mari ; Domitius, qui l'y fait rester ; Manturna, qui la fait demeurer avec l'époux ; Unxia, qui présidait à l'onction que l'épouse faisait à la porte ; Cinxia, qui présidait à l'enlèvement de la ceinture de l'épouse [FN: § 1339-2], Virginiensis dea, qui préside à la virginité de l'épouse. Les modernes parlent de tout cela librement et même avec complaisance ; la conception fétichiste n'existe plus pour aucun de ces actes. Mais l'hiatus se manifeste avec la catégorie suivante. 2° Dieux qui président à la consommation du mariage [FN: § 1339-3]. Ils sont aussi nombreux que ceux des autres catégories ; et, pour les Romains, ce genre de fétichisme n'était pas différent des autres, tandis que les peuples modernes l'ont seul conservé, abandonnant les autres. Au delà de l'hiatus, nous avons les catégories suivantes dont, de nouveau, les modernes parlent librement. Les dieux et les déesses de l'enfantement font transition entre la catégorie présente et les suivantes. 3° Dieux qui président à la naissance. Iuno Lucina, invoquée par les femmes en couches ; Diespiter, qui préside à la naissance ; Candelifera, à cause de la chandelle allumée, à l'accouchement ; les deux Carmentes: Prorsa et Postverta ; Egeria; Numeria. 4° Dieux à invoquer après la naissance. Intercidona ;... Deus Vagitanus, qui ouvre la bouche au nouveau-né pour qu'il vagisse ; Cunina, qui s'occupe du berceau ; etc. Nous en connaissons 10 en tout. 5° Dieux qui président à l'enfance. Potina et Educa enseignent à boire et à manger... Il y en a 13 en tout (§ 176-2). 6° Divinités de l'adolescence. Il y a en 26. Suivent une infinité de dieux et de déesses, pour toutes les occupations de la vie, jusqu'à la mort, où apparaissent Libitina et Nenia.
§ 1340. L'hiatus apparaît avec un caractère nettement religieux, chez les Pères de l'Église ; et tant qu'il demeure tel, il échappe à tout jugement de toute personne qui veut rester dans le domaine expérimental, et qui, par conséquent, ne peut traiter des phénomènes religieux qu'en les envisageant extrinsèquement, comme des faits sociaux.
§ 1341. Précisément à ce point de vue, il convient de remarquer que lorsque la lutte contre le paganisme s'apaisa, ce caractère apparut comme subordonné à la religion chrétienne. Mais, tant que durait la lutte, c'était au contraire la religion sexuelle qui venait à l'aide pour soutenir la religion chrétienne et en démontrer la vérité. L'idée de Saint Augustin et d'autres Pères de l'Église est manifestement la suivante : « La religion païenne est fausse, parce qu'elle est obscène ». Cela montre combien forts sont les sentiments de la religion sexuelle, puisqu'ils pouvaient être invoqués comme arbitres. On voit, en outre, qu'on ne peut accepter l'affirmation si souvent répétée jusqu'à nos jours, que c'est la religion chrétienne qui a introduit le culte de la chasteté dans le monde. Au contraire, c'est ce culte, sincère ou hypocrite, qui a puissamment contribué au triomphe de la religion chrétienne. Il suffit de lire les Pères de l'Église pour voir aussitôt, sans le moindre doute, que pour défendre leurs dérivations, ils tablaient sur les sentiments favorables à la chasteté, contraires aux plaisirs sexuels, et qui existaient non seulement chez leurs disciples, mais aussi chez les Gentils. Ils se prévalaient de ces sentiments afin de parvenir jusqu'à l'esprit de ceux qui repoussaient encore leurs dogmes, et pour essayer de les persuader qu'ils devaient accepter une religion qui exprimait si bien des sentiments préexistants en eux.
Ce cas ne paraîtra pas nouveau au lecteur, après les exemples très nombreux que nous avons cités, et qui montrent que les dérivations suivent, ne précèdent pas les sentiments ; ce qui n'empêche pas qu'elles puissent ensuite les renforcer. Le cas dans lequel nous voyons les sentiments sexuels appelés à juger des religions et des sectes religieuses n'est pas rare ; il apparaît au contraire comme faisant partie d'une série très étendue d'autres faits semblables. Les adeptes des diverses religions et de leurs différentes sectes s'accusent réciproquement d'obscénité et d'immoralité. Les agapes des chrétiens étaient traitées par les païens d'obscènes promiscuités d'hommes et de femmes ; et les chrétiens orthodoxes répétèrent la même accusation contre les réunions des hérétiques. Les protestants se firent une arme de l'accusation habituelle d'obscénité et d'immoralité contre le clergé catholique. En même temps, les chrétiens croyants la tournèrent contre les athées, et il y eut un temps où libéraux et libertins étaient synonymes [FN: § 1341-1]. Les philosophes du XVIIIe siècle se servirent avec insistance de cette arme qui, non encore émoussée, est toujours employée en France et en Italie, et constitue, contre la religion chrétienne, l'argument sinon unique, du moins principal de nombreux journaux quotidiens.
§ 1342. Nous n'avons pas à rechercher ici quelle part de vérité ou d'erreur peuvent renfermer ces accusations. Nous devons seulement remarquer que le fait d'avoir été produites en si grande quantité et pendant tant de siècles jusqu'à nos jours, démontre incontestablement le grand pouvoir qu'ont ces sentiments dans nos sociétés ; ce qui est encore confirmé par un très grand nombre d'autres faits.
§ 1343. Le culte des organes de la génération a existé dans beaucoup de pays ; et cela ne doit pas surprendre, si l'on observe qu'il faisait partie du fétichisme général [FN: § 1343-1], là où l'hiatus que nous avons mentionné au § 1339 ne s'était pas encore produit. Dans l'antiquité gréco-latine, nous trouvons le culte du Phallus, non seulement là où la fantaisie est exubérante, comme en Grèce, mais aussi dans la grave et austère Rome, où il n'est en rien un produit de la décadence, mais où il apparaît comme un fétichisme ayant survécu à d'autres, qui s'éteignaient peu à peu. Le christianisme triomphant le trouva encore en pleine vigueur et ne réussit pas à l'éteindre entièrement. Au contraire, il persista pendant tout le moyen âge, et l'on sait assez qu'aux temps où la foi chrétienne était le plus intense, on ne cessa de sculpter des figures obscènes, jusque dans les cathédrales, de les dessiner dans les miniatures des livres sacrés [FN: § 1343-2], et que les saints chrétiens héritèrent des fonctions des dieux de la génération. L'Église eut beaucoup à faire pour éliminer ces obscénités de tous genres. [Voir Addition A24 par l’auteur]
§ 1344. Comme d'habitude, les résidus persistent tandis que les dérivations changent, et aujourd'hui l'hiatus qu'on observe là où, pour les Romains, il y avait continuité, on veut le justifier par des arguments à la mode, c'est-à-dire de pseudo-science, transformant ainsi les actions non-logiques en actions logiques. On dit que les persécutions contre ceux qui, en hérétiques, méconnaissent l'hiatus inexistant pour les Romains, sont nécessaires pour avoir une jeunesse forte et énergique. Mais est-ce que vraiment la jeunesse romaine, qui conquit tout le bassin de la Méditerranée, n'était pas forte et énergique ? [FN: § 1344-1] Mais étaient-ils faibles les soldats de César, qui vainquirent les Gaulois et d'autres peuples, sans compter les légions mêmes de Pompée ? Dirons-nous que César s'entendait moins à la guerre que M. Bérenger ? [FN: § 1344-2]. On dit encore que ces persécutions sont nécessaires pour sauvegarder les vertus familiales, comme si elles étaient rares et faibles chez les anciens Romains, quand l'image du Phallus protégeait les enfants, les hommes et jusqu'aux triomphateurs, contre le mauvais œil [FN: § 1344-3]. On dit qu'elles protègent la chasteté des femmes, comme si les matrones romaines des beaux temps de la République étaient moins chastes que ne le sont les femmes modernes de plusieurs États, où l'hypocrisie sexuelle règne en souveraine.
§ 1345. On pourrait faire beaucoup d'autres observations semblables ; mais les suivantes suffiront. Aux États-Unis, la poste refuse de transporter un roman anglais, parce qu'on l'estime trop « sensuel » ; elle transporte sans le moindre scrupule des écrits où l'on prêche l'assassinat des bourgeois et le pillage de leurs biens [FN: § 1345-1]. Mais est-ce qu'à s'en tenir à la logique et à l'expérience seules, on doit vraiment juger ces actes moins nuisibles à l'individu et à la société qu'un peu de « sensualité » ? Le sénateur Bérenger, qui, pour sauvegarder la morale, scrute attentivement les costumes des danseuses, est l'auteur d'une loi grâce à laquelle nombre de malfaiteurs sont remis en circulation, et peuvent continuer à accomplir leurs exploits. Mais est-ce que ces exploits sont vraiment moins dignes de blâme que la vue des jambes ou même des cuisses d'une danseuse ? Il y a des villes, aux États-Unis, où l'autorité charge des femmes de se promener pour provoquer les déclarations amoureuses des hommes qui sont attirés par leurs avances, et pour les faire arrêter. Cette autorité n'enrôle pas de même des hommes pour provoquer les anarchistes à faire du mal et pour les arrêter. Donc, a-t-on reconnu par la logique et l'expérience que faire un compliment amoureux à une femme qu'on rencontre sur son chemin, est plus nuisible à l'individu et à la société que tuer, incendier, voler ? (§ 1325). Le 28 mars 1913, la Chambre française discutait la loi d'amnistie. On proposait d'amnistier ceux qui avaient fait de la propagande anti-militariste, en incitant les citoyens à ne pas répondre à l'appel sous les armes, ou, s'ils y étaient contraints, à faire feu sur leurs officiers plutôt que sur l'ennemi, et en leur enseignant comment ils devaient faire pour détériorer les canons, de manière à ce qu'ils ne pussent plus tirer. Après une très vive discussion, cette proposition d'amnistie fut repoussée par 380 voix contre 171. On proposait aussi d'amnistier ceux qui avaient fait de la propagande malthusienne [FN: § 1345-2] ; et cette proposition fut repoussée par 471 voix contre 16. Donc, trahir son pays, tuer les officiers, détruire le matériel de guerre, livrer sa patrie aux ennemis, est un moindre crime que d'exposer librement son avis sur cette question : convient-il de tenir compte des contingences économiques dans la procréation des enfants ? Tout cela ne tient pas debout, et le caractère non-logique, religieux, d'une semblable façon d'agir est évident.
§ 1346. Plus modeste, mais pas meilleur, est l'argument qui veut justifier l'hiatus en disant qu'il tend à éviter l'image de choses malpropres. Mais qu'y a-t-il de plus malpropre qu'un cadavre en décomposition, grouillant de vers ? Pourtant, on en peut parler librement, et il n'est pas nécessaire, pour désigner le cadavre, la pourriture, les vers, d'employer des termes grecs ou latins. Il est donc manifeste que pour produire l'hiatus un autre sentiment agit, qui n'est pas seulement la répulsion pour ce qui est malpropre.
§ 1347. Ce sentiment appartient à la classe de ceux qui poussent les hommes à employer le mystère dans leurs religions ; et l'hiatus qu'on observe est plus de forme que de fond : il apparaît comme une oscillation dans l'extension du mystère, lequel ne faisait pas défaut chez les anciens Romains, mais enveloppe aujourd'hui un grand nombre de choses qu'on laissait autrefois en pleine lumière.
§ 1348. Si nous voulons étudier ces faits en restant dans le domaine logico-expérimental, nous ne devons participer en aucune façon aux sentiments religieux dont ils tirent leur origine, ou du moins en faire abstraction, pendant que nous accomplissons cette étude.
§ 1349. Ces sentiments peuvent être d'une grande utilité pour la vie sociale ; ils sont certainement très nuisibles aux recherches théoriques qui se font dans le domaine logico-expérimental. Donc, les personnes qui ne se sentent pas l'esprit tout à fait libre à cet égard feront mieux de ne pas continuer à lire ce chapitre. De même, ceux qui croient à l'origine divine du Coran agiront sagement en ne lisant pas une critique historique de ce livre et de la vie de Mahomet.
§ 1350. Un homme peut être guidé par le scepticisme expérimental, en une matière, et par la foi, dans une autre ; mais il ne peut, sans tomber en contradiction, être en même temps et dans la même matière, sceptique et croyant. Le croyant, précisément parce qu'il est croyant, ne peut faire autrement que tenir sa propre religion pour vraie et les autres pour fausses ; par conséquent, il juge et doit juger les faits d'après ce critère. Des actions qui, expérimentalement, sont tout à fait semblables, sont estimées par lui bonnes ou mauvaises, suivant qu'elles appartiennent à sa religion ou à une autre ; il voit très facilement la paille qui est dans l'œil de son prochain, mais n'aperçoit pas la poutre qui est dans le sien.
§ 1351. Ainsi que le croyant d'une autre religion, le croyant de la religion sexuelle repousse a priori tout argument quelconque, opposé à sa religion ; et il estime qu'on doit contraindre les autres gens à embrasser sa foi, tandis qu'il se plaindrait amèrement, si l'on voulait lui imposer une religion qui n'est pas la sienne. Là où il jouit de l'appui du bras séculier, il réalise par la force ce qu'il ne réussit pas à obtenir par la persuasion. Dans un grand nombre de pays chrétiens, on peut injurier le Christ tant qu'on veut, sans que les tribunaux interviennent pratiquement, tandis qu'ils condamnent promptement un écrit obscène [FN: § 1351-1].
§ 1352. Les anciens Romains lisaient sans la moindre colère les vers où Horace désigne les parties sexuelles de la femme par leur nom latin, et n'auraient toléré ni l'anti-patriotisme ni l'anti-militarisme. Chez les modernes, il y a beaucoup de gens qui tolèrent ces sentiments, et qui crient à tue-tête pour demander la punition de ceux qui écrivent comme Horace. Le grand prêtre Caïphe, entendant Jésus offenser ses sentiments religieux, déchira ses vêtements : scidit vestimenta sua, en disant: « Tu as blasphémé ! » De même M. Bérenger, grand prêtre de nos vertuistes, entre en fureur à la seule pensée que Regina Badet se montre sur la scène avec un costume trop rudimentaire. Les musulmans ont horreur du porc et ne voudraient en manger à aucun prix, tandis qu'ils s'entretiennent librement des rapports sexuels. Nos vertuistes ont – ou du moins feignent d'avoir – horreur de ces conversations, tandis qu'ils mangent allègrement la viande de porc. Dubois [FN: § 1352-1] rapporte que: « (p. 252) Un Européen de ma connaissance avait écrit une lettre à un de ses amis en faveur d'un brahme que je lui avais recommandé. Sa lettre finie, il la cacheta avec un pain à cacheter qu'il avait humecté en le mettant sur le bord de sa langue : le brahme s'en aperçut, ne voulut pas recevoir la lettre, sortit de fort mauvaise humeur, comme une personne qui se croyait grièvement insultée, et aima mieux renoncer aux avantages qu'il aurait pu retirer de cette recommandation, que d'être porteur d'une missive souillée de la sorte ». Un de nos vertuistes, de ceux qui sont si habiles à voir la paille dans l'œil de leur prochain, rira de l'absurdité de ce brahme, sans prendre garde qu'il ferait exactement de même, si, par exemple, le cachet de la lettre reproduisait l'image de ce phallus que les Romains employaient sans aucun scrupule, pour repousser le mauvais œil [FN: § 1352-2].
§ 1353. On trouve le résidu sexuel mélangé à d'autres résidus, dans un grand nombre de phénomènes, et nous devrons répéter ici en partie les remarques faites à propos de l'ascétisme [FN: § 1353-1] .
§ 1354. Comme d'habitude, nous excluons la simple hypocrisie, qui est d'ailleurs beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Elle est souvent un art d'accomplir certaines actions logiques, et ne trouve pas sa place parmi les résidus.
§ 1355. Le résidu sexuel fait partie d'un grand nombre d'effusions religieuses, et parfois on le reconnaît immédiatement ; d'autres fois, il est presque impossible à discerner et à séparer du sentiment exclusivement religieux [FN: § 1355-1] . Les ennemis de l'Église catholique ont voulu le voir même là où il n'était pas ; les amis ont voulu le nier même là où il est évident. Beaucoup de prêtres qui abandonnent l'Église catholique sont poussés par le besoin de la femme [FN: § 1355-2] ; parfois ils s'en rendent compte ; parfois non. Ce besoin n'est pas étranger à un grand nombre de critiques des modernistes, pas plus que le désir de faire la cour à la Démocratie, pour obtenir des avantages.
§ 1356. Le culte de la femme [FN: § 1356-1] apparaît explicitement ou implicitement, d'une manière ouverte ou à peine voilée, dans un très grand nombre de religions ; et là-dessus on pourrait écrire un gros volume. N'oublions pas les générations des êtres divins, où se manifeste le résidu sexuel, ni les allégories et les personnifications masculines ou féminines d'abstractions ou d'autres agrégats fantaisistes. Tout cela montre qu'à chaque instant l'idée du sexe vient à l'esprit. Il est certain que la chasteté forcée, surtout quand elle est sincèrement observée, provoque le sentiment sexuel, là où il n'y a et ne peut y avoir de rapports érotiques. Cela se voit déjà en germe dans l'affection passionnée de certaines fillettes pour leurs poupées, pour un animal, pour leurs amies ; quelquefois il est uni à l'amour filial, à l'insu du sujet. On peut s'en rendre compte en remarquant ce qui se passe lorsque la jeune fille se marie ou s'unit de tout autre façon à un homme : alors ces formes d'affection disparaissent ou diminuent. Des femmes séparées de l'homme ont souvent pour un petit chien un sentiment dans lequel, à leur insu, entre l'amour. D'autres se vouent à des œuvres de bienfaisance, à des propagandes humanitaires, à des pratiques religieuses. Beaucoup de féministes sont simplement des hystériques auxquelles manque un homme.
§ 1357. La vénération et la haine d'une certaine chose peuvent être également des formes d'une religion qui a cette chose pour objet. Cette religion n'est exclue que par l'indifférence (§ 911). C'est pourquoi l'hiatus que nous avons relevé plus haut tient plus à la forme qu'au fond. Le nègre qui maltraite son fétiche, le catholique qui blasphème son saint, font preuve d'une religion que n'a pas l'homme auquel ce fétiche et ce saint sont indifférents. Cela est bien connu pour l'amour ; il y a longtemps déjà qu'on a observé que l'amour et la haine sont très voisins et s'opposent à l'indifférence. C'est aussi une ancienne observation, que les hommes qui disent le plus de mal des femmes sont aussi ceux qui les aiment le plus [FN: § 1357-1] .
§ 1358. Le fait que souvent le désir sexuel conduit à la haine de l'acte sexuel et, chez les saints chrétiens, à la haine de la femme, ne doit pas nous étonner. Dans les invectives des ascètes, apparaît souvent, mêlé à un sentiment de simple ascétisme, le sentiment du besoin sexuel inassouvi. Celui-ci peut devenir assez intense pour provoquer des hallucinations ; et le chrétien est persuadé que le diable le tente pour l'induire au péché d'impureté. Cette imagination n'est pas entièrement vaine : ce diable existe réellement dans l'esprit d'un homme, et serait chassé par la femme plus sûrement que par les exorcismes.
§ 1359. Qu'on lise seulement une partie de ce que le bon frère Bartolomée de San Concordio [FN: § 1359-1] accumula contre les femmes, et l'on verra que chez les Pères de l'Église, il y a, sur ce sujet, de quoi composer un grand nombre de volumes.
§ 1360. Ceux qui de bonne foi se repaissent volontiers de ces discours sont poussés, par l'ardeur de leurs sens inassouvis, à penser toujours à la femme : ils la fuient par crainte d'un danger imminent ; ils la haïssent parce qu'ils l'aiment trop ; ils envient, sans s'en apercevoir, celui qui la possède ; et ce sentiment se mêle, dans l'exaltation de la virginité, aux louanges adressées aux époux qui, vivant en parfaite continence, n'usent pas des droits du mariage, à l'horreur de la fornication. Chez les saints, la bonne foi paraît vraiment parfaite. C'est justement cette bonne foi qui rend les sentiments plus vifs et les fortifie.
§ 1361. Chez d'autres non plus, la bonne foi peut ne pas faire défaut. L'empressement que mettent les prêtres et les moralistes à éloigner les femmes des « tentations » peut être l'effet d'un simple zèle religieux ou moral ; mais quelquefois il s'y mêle la jalousie sexuelle, qui peut exister même en l'absence de relations charnelles, car l'eunuque, c'est bien connu, est souvent jaloux et même très jaloux ; et dans nos contrées on observe combien peut être vive la jalousie de l'impuissant. Il y a aussi des béguines humanitaires, laides et vieilles, et d'autres femmes semblables qui, bien que n'ayant pas de rapports charnels avec un jeune homme, en sont fort jalouses et entrent en fureur si elles le voient regarder une femme jeune et belle, et surtout s'il parle avec elle. Tout cela peut se produire sans que le sujet s'aperçoive du résidu sexuel qui existe en lui. L'envie peut aussi se mêler au sentiment sexuel, de manière à ne pouvoir en être séparée, même par la personne qui éprouve ces sentiments complexes.
§ 1362. Vers la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, l'idée était générale que seuls les théologiens chrétiens voulaient priver l'homme des plaisirs des sens et, par conséquent, des jouissances sexuelles que lui offre la « Nature » [FN: § 1362-1] ; mais les faits survenus dans la suite, et surtout dès 1900, démontrent que les théologiens de la libre-pensée ne restent pas en arrière des théologiens chrétiens dans cette œuvre, et que les inquisiteurs modernes du crime d'hérésie dans la religion sexuelle sont les dignes compagnons des anciens inquisiteurs du crime d'hérésie dans la religion catholique.
§ 1363. Il est remarquable que la religion chrétienne, et principalement la religion catholique, tout en réprouvant les plaisirs amoureux, en tire la plus grande partie des métaphores dont elle se sert dans les manifestations de la foi. Sans parler de l'Église, qui est l'épouse de Christ, ni des interprétations de l'érotisme du Cantique des Cantiques, grâce auxquelles un chant d'amour, à la vérité quelque peu grossier et ridicule, devient l'épithalame de l'Église, épouse de Christ, on peut remarquer que les religieuses sont appelées les épouses de Christ, lui consacrent leur virginité et brûlent pour lui d'un amour où le céleste se mêle au profane, et que les saints Pères ne savent s'entretenir un peu longuement d'un sujet sans faire allusion, ne fût-ce que métaphoriquement, à l'amour. L'image de la femme encombre leur esprit et, chassée d'un côté, elle revient d'un autre.
§ 1364. Déjà dans l'Évangile, il y a des passages dans lesquels apparaît discrètement le résidu sexuel. Par exemple, on ne voit pas pourquoi la parabole des dix vierges ne pourrait être remplacée par une autre, dans laquelle on n'amènerait pas la pensée à s'arrêter sur les femmes vierges et sur la consommation du mariage. Mais c'est principalement dans le développement postérieur du christianisme que règne la femme, élevée même aux splendeurs du trône céleste, sous la forme de la Vierge Marie.
§ 1365. Qu'on veuille comparer ces écrits avec les Mémorables de Socrate, composés par Xénophon. Chez l'auteur grec, l'amour de la femme est un besoin physique comme tant d'autres dont la satisfaction n'est pas blâmée, et dont l'excès seul est nuisible. L'auteur s'en occupe peu, de même qu'il s'occupe peu des autres besoins semblables à celui de manger ; l'amour n'encombre pas son esprit : on voit que d'autres soins réclament toute son attention. Au contraire, on s'aperçoit que le désir de la femme pèse sur l'esprit des saints Pères comme un cauchemar, et qu'il provoque chez eux des sentiments semblables à ceux que le damné de Dante, torturé par la soif, éprouvait à la pensée de l'eau désirée [FN: § 1365-1].
§ 1366. Dans un passage très connu [FN: § 1366-1], Saint Paul accepte le mariage comme un moindre mal : mieux vaudrait demeurer sans avoir commerce avec la femme ; mais à celui qui ne peut s'en abstenir, il est permis de se marier. Saint Paul est certainement misogyne ; mais nous connaissons trop peu de choses de lui pour savoir si ce sentiment venait, comme chez Leopardi, de ce qu'il était contrefait, ou de ce qu'il était repoussé par les femmes, ou de quelque autre motif semblable, ou bien du simple mysticisme.
§ 1367. Saint Cyprien écrit [FN: § 1367-1] : « Maintenant, notre discours s'adresse aux vierges pour lesquelles notre sollicitude doit être d'autant plus grande que leur gloire est sublime. Elle [la virginité] est la fleur née de l'Église, l'honneur et l'ornement de la grâce spirituelle, nature joyeuse, œuvre intègre et pure de la gloire et de l'honneur, image de Dieu répondant à la sainteté du Seigneur, partie la plus illustre du troupeau du Christ. La glorieuse fécondité de notre mère l'Église se réjouit pour elles [les vierges], et fleurit abondamment en elles, et plus la virginité augmente en nombre, plus s'accroît l'allégresse de la mère ». En écrivant ces louanges si chaleureuses, le saint croyait certes être mu simplement par le sentiment religieux ; mais il est très probable qu'à son insu le sentiment sexuel agissait sur lui.
§ 1368. Saint Augustin nous dit avoir aimé les femmes, dans sa jeunesse ; mais il nous apprend qu'après sa conversion il devint l'adversaire de tout commerce avec elles, fût-il légitime [FN: § 1368-1].
§ 1369. Chez Saint Jérôme, la puissance des sentiments pour tout ce qui touche à la femme et aux plaisirs amoureux est vraiment remarquable. Saint Jérôme ne cesse de conseiller, d'encourager, de sermonner, de reprendre les vierges et les veuves. Il s'occupe beaucoup moins des femmes mariées et il semble vraiment que, peut-être sans s'en apercevoir, il considère le mari comme un rival. Il se plaint « d'avoir été accusé par la fureur hérétique de condamner le mariage [FN: § 1369-1] ». Mais il faut reconnaître qu'il avait bien donné quelques motifs à cette accusation.
§ 1370. S'adressant à la vierge Eustochia, il fait allusion aux maux profanes du mariage : la grossesse, les pleurs des nourrissons, la jalousie excitée par les maîtresses du mari, les soins du ménage [FN: § 1370-1]. Il fait dire à la vierge qu'elle ne veut pas tomber sous le coup de la sentence de la Genèse : Tu enfanteras avec douleur et dans l'angoisse. « Cette loi est celle des femmes et non la mienne ». (loc. cit., p. 144 b). En ce qui concerne la crainte de la grossesse, il est le précurseur de nos néo-malthusiens contemporains. M. Bérenger, qui a la manie des dénonciations, devrait s'adresser au procureur de la République pour le faire punir, ou, comme cela n'est pas possible, puisqu'il est mort depuis si longtemps, pour faire au moins expurger ses livres. On pourrait, d'autre part, invoquer en faveur du saint le fait que, sans avoir besoin d'espions, il notait les sévères punitions qu'encoururent ceux qui avaient éloigné les vierges de la chasteté [FN: § 1370-2].
§ 1371. Le pauvre saint était tourmenté par l'idée de la femme ; idée rendue dominante par les désirs inassouvis, et qui résistait à la macération. Il raconte que, retiré dans le désert « en compagnie des scorpions et des bêtes sauvages, souvent le chœur des jeunes filles me tourmentait. Mon visage pâlissait à cause des jeûnes, et mon esprit brûlait dans mon corps glacé ; dans la chair déjà morte d'un homme, seuls les feux de la luxure brûlaient » [FN: § 1371-1] . Ces hallucinations sont trop connues pour que nous nous y arrêtions. Les démons tourmentaient sans cesse les saints ascètes, et les tentaient sous des formes féminines. Outre son propre exemple, Saint Jérôme en cite d'autres et, d'une façon générale, la vie des saints n'en manque pas [FN: § 1371-2].
On comprend facilement que Saint Jérôme, chez lequel le résidu sexuel était si puissant, ait été en butte aux accusations qu'il repousse dédaigneusement, et peut-être avec raison, de trouver trop de plaisir dans la compagnie des femmes. Il dit [FN: § 1371-3] : « Souvent, beaucoup de vierges m'entourèrent. Souvent, j'ai expliqué les livres saints comme j'ai pu, à un grand nombre d'entre elles. La leçon engendra l'assiduité ; l'assiduité, la familiarité ; la familiarité, la confiance. Qu'elles disent si elles trouvèrent jamais en moi autre chose que ce qui convenait à un chrétien ? Acceptai-je jamais de l'argent ? Ne méprisai-je pas les cadeaux, petits ou grands ? L'argent d'autrui sonna-t-il dans ma main ? Fus-je immodeste dans mes discours ou dans mes regards ? On ne me reproche que mon sexe ; et c'est la seule chose qu'on me reproche, à cause du voyage de Paula et de Mélanie à Jérusalem ».
§ 1372. Pourtant, ses entretiens étaient un peu dangereux, et ces perpétuels discours sur les plaisirs amoureux devaient mettre en péril la chasteté. Il dit à la vierge Eustochia [FN: § 1372-1] : « Il est difficile que l'âme humaine n'aime pas quelque chose, et il est nécessaire que notre esprit se prenne d'affection pour quelque chose. L'amour charnel est vaincu par l'amour spirituel. Le désir est éteint par le désir [c'est un peu dangereux]. D'autant celui-ci diminue, d'autant celui-là s'accroît. Répète souvent sur ton lit : « Dans la nuit, j'ai cherché celui qu'aime mon âme ». Ces paroles du Cantique des Cantiques se rapportent – ou mieux le saint croyait qu'elles se rapportaient – à un époux spirituel ; mais, hélas ! elles évoquent aussi l'image d'un époux matériel, surtout si on les prononce sur un lit. Il y a dans tout cela, même si c'est fait innocemment, le résidu sexuel ; de même qu'il existe aussi dans l'œuvre d'un certain pasteur français qui, poussé par la haine de la pornographie, étudie curieusement la longueur des jupes des danseuses et cherche si elles dissimulent bien l'entre-jambes.
§ 1373. Les hérétiques ne le cédaient en rien aux orthodoxes, en fait de préoccupations sexuelles. Comme nous l'avons dit déjà (§ 1341 et sv.), il faut ajouter peu de foi aux accusations d'obscénité qu'échangent les différentes sectes religieuses ; mais elles servent à nous faire connaître le pouvoir et la force de la religion sexuelle qui fournit ainsi aux hommes des armes pour leurs disputes, et au nom de laquelle s'exercèrent et s'exercent toujours des persécutions, grandes ou petites, comme il s'en exerça au nom de tant d'autres religions.
§ 1374. Dans le livre de Saint Augustin sur les hérésies [FN: § 1374-1], nous trouvons un grand nombre d'affirmations sur les mauvaises mœurs qu'à tort ou à raison on impute aux hérétiques. Le saint traite longuement des Manichéens ou Cathares. D'une part, il les dépeint comme voyant le mal dans la matière, et par conséquent comme très rigoureux pour réprouver tout ce qui est charnel ; d'autre part, il les accuse de turpitudes. D'après ce que nous savons de leurs successeurs, au moyen âge, c'est-à-dire des Albigeois, il semblerait probable qu'ils furent d'une rigueur ascétique excessive [FN: § 1374-2] et exempts de toute turpitude ; mais nous ne pouvons rien dire de certain. Saint Augustin prétend qu'ils affirmaient que les vertus saintes se changeaient en mâles pour attirer les femelles de la nation ennemie, et en femelles pour allumer la concupiscence des mâles [FN: § 1374-3]. Qu'il soit vrai ou qu'on ait imaginé que les Manichéens parlaient de cette façon, le fait subsiste que le résidu sexuel jouait un rôle important dans leurs raisonnements ou dans ceux de leurs adversaires.
§ 1375. Saint Épiphane, auquel Saint Augustin emprunte une partie de ces renseignements, ajoute des détails obscènes, spécialement au sujet des Gnostiques, en les tirant de Saint Irénée [FN: § 1375-1]. Ces derniers détails paraissent difficilement pouvoir être vrais en tous points, et semblent avoir été inventés, au moins en partie, par quelque esprit lascif.
§ 1376. Un peuple chez lequel les unions sexuelles seraient absolument interdites disparaîtrait bientôt, s'il ne se rénovait pas, comme les Esséniens, au moyen d'individus provenant d'autres peuples. Par conséquent une religion qui veut s'étendre beaucoup ou être universelle, doit nécessairement admettre l'union des sexes, et se limiter à la régler, si elle ne vise pas à l'extinction de ses disciples et du genre humain. Saint Paul ne paraît pas y avoir pensé ; et, en admettant le mariage, il songeait uniquement à éviter le péché très grave de la fornication ; mais ces considérations ne furent pas étrangères à l'attitude que prit l'Église à l'égard du mariage, quand elle devint un pouvoir social important et espéra devenir le régulateur suprême de la société humaine. De petites sectes hérétiques ont bien pu supprimer la concession faite par l'apôtre à propos du mariage, condamner absolument et pour tous les hommes tout commerce sexuel, et, pour éviter plus sûrement l'union sexuelle abhorrée, aller même jusqu'à recommander ou à prescrire la castration. Mais l'Église catholique sut tenir un juste milieu, en décidant que le mariage était un état louable, moins digne toutefois que la virginité. Diverses opinions furent ensuite émises sur les mariages subséquents, qui furent tolérés, blâmés, interdits ; sur le divorce et sur un très grand nombre d'autres sujets dont il n'y a pas lieu de parler ici.
§ 1377. Si l'on écarte un très petit nombre de sectes hérétiques, en des cas d'ailleurs souvent douteux, tous les chrétiens admettent avec Saint Paul que l'impudicité est l'un des plus grands péchés. Dans cette idée, qui appartient aussi à nombre d'incroyants ou d'athées modernes, le résidu sexuel apparaît manifestement. Il persiste tandis que changent les dérivations religieuses qui le dissimulent.
§ 1378. Cette réprobation du péché charnel fut-elle vraiment très efficace pour l'empêcher en pratique ? Il y a lieu d'en douter, quand on lit l'histoire sans idées préconçues, en y cherchant ce qui s'est passé, et non ce que nous voudrions qu'il se fût passé. D'abord, en général, si nous trouvions qu'avec l'augmentation de la foi en une religion qui condamne le péché charnel, les mauvaises mœurs diminuent, et vice versa, nous pourrions voir dans cette coïncidence un certain indice montrant que les théories contre les mauvaises mœurs ont probablement agi sur les faits. Mais si, au contraire, nous trouvons que des temps de foi vive sont aussi des temps de très mauvaises mœurs, nous aurons un indice différent. Nous ne conclurons pas que la foi favorise les mauvaises mœurs, puisqu'il est évident que bien d'autres causes peuvent avoir agi. Nous ne conclurons pas non plus que la foi n'a en rien favorisé les bonnes mœurs, car enfin, nous ne savons pas si, à son défaut, les mauvaises mœurs n'auraient pas été pires. Mais nous pourrons bien conclure que les résidus sexuels sont assez puissants pour vaincre souvent les prescriptions de la foi ; puisque nous ne faisons ainsi que résumer les nombreux faits en une expression générale. Cette conclusion peut aussi être acceptée par des croyants fervents, par exemple par de fervents catholiques ; seulement ceux-ci s'expriment d'une façon différente. Quand nous parlons de la puissance des résidus, ou mieux des sentiments manifestés par les résidus, ils parlent de la puissance du démon, qui rôde quaerens quem devoret. Du reste, s'ils veulent être logiques, ils ne peuvent même pas nier que ces faits démontrent le peu d'utilité des théories, puisqu'ils expriment la même chose de façon différente, en disant que pour résister aux pièges du démon, l'homme a besoin de la grâce divine.
§ 1379. Un très grand nombre de faits nous apprennent que chez certains peuples et en certains temps, la foi vive peut être unie aux mauvaises mœurs. Des premiers siècles du christianisme jusqu'en des temps très proches du nôtre, on n'entend que des plaintes sur les mauvaises mœurs des chrétiens. Même en faisant une large part à la rigueur des censeurs et en admettant qu'ils voyaient le mal plus grave qu'il n'était réellement, pouvons-nous croire que toutes ces plaintes n'eussent pas le moindre fondement dans le monde concret ? Et puis, outre les discours, il y a les faits. Supposons aussi qu'ils aient été en partie inventés ; mais est-il possible qu'ils l'aient été tous ? Si on voulait l'admettre, on devrait aussi mettre en doute tout fait historique considéré comme certain. Les sophismes employés pour nier la vérité n'ont jamais fait défaut. Tel a cru pouvoir opposer aux vices présents les vertus d'un passé qui ne fut jamais un présent pour personne, et qui par conséquent n'existait que dans son imagination. Tel a voulu opposer aux vices de son pays les prétendues vertus des pays étrangers. Ce fut en partie le cas de Tacite [FN: § 1379-1] , quand il écrivit la Germanie, et ce préjugé engendra les déclamations de Salvien [FN: § 1379-2]. Celui-ci oppose avec prolixité les vertus des Barbares aux vices des Romains. Mais s'il disait vrai, il faut croire que ces vertus ne durèrent pas longtemps, puisque, à peine un siècle après le temps où écrivait Salvien, nous avons l'histoire de Saint Grégoire de Tours, qui nous montre les Barbares avides de sang, d'argent, de luxure [FN: § 1379-3].
§ 1380. De notre temps, les admirateurs du moyen âge ne veulent admettre en aucune façon que ce fut un temps de mauvaises mœurs. Il n'est sorte de sophismes auxquels ils n'aient recours pour se soustraire à l'évidence des faits. Par exemple, ils affirment que les figures obscènes sculptées ou dessinées, et parvenues du moyen âge jusqu'à nous (1343-2) et le parler indécent que nous trouvons dans un grand nombre d'écrits médiévaux, par exemple dans les nouvelles et les fabliaux [FN: § 1380-1] , bien loin d'être l'indice de mœurs corrompues, révèlent au contraire l'état sain et moral de gens qui peuvent sans danger appeler les choses par leur nom. À entendre certains auteurs, on serait tenté de croire que les hommes et les femmes du moyen âge étaient aussi naïfs que Daphnis et Chloé. De tels raisonnements pourraient être acceptés comme probants, si l'on voulait tirer la conclusion d'immoralité sexuelle uniquement des sculptures, des dessins, du langage inconvenant ; et il est parfaitement vrai qu'un parler châtié dissimule parfois des mœurs plus corrompues qu'un parler rudement obscène. Mais ces raisonnements ne sont pas probants, parce que dans les écrits en question, ce n'est pas la forme seule qui est obscène, mais aussi le fond. Qu'on transcrive en langage châtié, même très châtié, les nouvelles et les fabliaux, qu'on fasse entendre seulement par des périphrases ce qui y est dit brutalement : le fond restera toujours, et il est aussi obscène que possible.
§ 1381. Outre les écrits [FN: § 1381-1], il y a les faits que nous apprennent les chroniques et autres documents ; et vraiment il y en a plus qu'il ne faut pour pouvoir assurer avec certitude que le moyen âge ne fut pas plus chaste que notre époque : il semble au contraire qu'il fut plus corrompu. Certains auteurs ne veulent pas accepter pour preuve des mauvaises mœurs du temps les faits de mauvaises mœurs du clergé ; ils en rejettent la faute sur la religion, l'« idolâtrie catholique », la « papauté », comme disaient les Réformateurs ; mais c'est là un autre sophisme démenti par les faits. Les mœurs du clergé n'étaient pas pires que les mœurs des gens, en général ; elles étaient même meilleures ; et si beaucoup d'évêques étaient aussi corrompus que beaucoup de barons féodaux, un grand nombre d'autres donnaient des exemples de vertu qu'on trouvait difficilement chez les laïques. Enfin, souvent, quand les anciennes chroniques relèvent des faits de mauvaises mœurs du clergé, on voit clairement que de tels faits étaient tenus pour coutumiers chez les laïques, et que si elles s'en indignent, c'est uniquement parce qu'il s'agit de prêtres. Il y aurait trop à dire, si nous voulions rapporter ici une partie, même très petite, des faits si nombreux qui démontrent qu'au moyen âge, et même dans les temps qui précédèrent et qui suivirent, les mauvaises mœurs se trouvaient dans les actes et non pas seulement dans les termes. Il serait d'ailleurs de peu d'utilité de rappeler des choses très connues, que seule la passion sectaire peut oublier. Les mesures mêmes prises par les conciles, les souverains, les communes, les autorités de toute espèce et de toute qualité, contre les mauvaises mœurs, en démontrent l'existence ; car on n'interdit pas d'une façon répétée ce qui n'existe pas. Les taxes établies en maints endroits sur les prostituées montrent qu'elles n'étaient pas en petit nombre, car autrement la taxe n'aurait rapporté que peu de chose ou rien du tout [FN: § 1381-2]. Nous connaissons beaucoup de procès pour bestialité ; et un grand nombre d'animaux inculpés furent brûlés. Avec les documents sur les mauvaises mœurs des croisés, on pourrait composer une bibliothèque. Admettons qu'une partie des faits aient été exagérés ; il est cependant impossible que tous n'aient aucun fondement dans la réalité [FN: § 1381-3].
§ 1382. Parmi les dogmes de la religion sexuelle qui règne de nos jours, il y a celui en vertu duquel la prostitution est un mal « absolu ». Tout dogme religieux échappe, de par son essence même, à la discussion. Mais, au point de vue expérimental, il reste à savoir si la prostitution est ou non le métier qui convient le mieux à la nature de certaines femmes, auxquelles il plait plus que d’autres métiers qu'elles pourraient exercer, et s'il est ou non, entre certaines limites, utile à la société entière (§ 1382-3). Les croyants de la religion sexuelle moderne ne donnent pas la moindre preuve que la question se résout dans le sens qui leur plaît. Il faut croire à leurs affirmations, comme on croyait autrefois à l'existence de Iuppiter optimus maximus, et comme les musulmans croient encore que le contact du porc est la cause d'une très grave impureté. Ces dogmes peuvent être utiles ou non à la société en certaines circonstances ; mais ce n'est pas ici l'objet de notre étude, qui a exclusivement pour but de reconnaître la nature des résidus et leur intensité (§ 1336).
La prostitution sacrée a existé chez un grand nombre de peuples. Cela surprend quiconque est sous l'impression de l'hiatus mentionné au § 1339, mais non l'observateur qui, se soustrayant à cette impression, prend garde qu'en somme la conception dont l'hyatus découle n'est pas d'une autre nature que les sacrifices de divers genres, y compris les sacrifices humains, qu'on avait l'habitude d'offrir aux dieux, ou que les consécrations semblables à celle du ver sacrum des Romains (§ 930). Nous n'avons pas à nous occuper de ce sujet, qui sera mieux à sa place dans la sociologie spéciale [FN: § 1382-1].
La prostitution vulgaire se voit chez tous les peuples civilisés et en tous les temps. Elle existait chez le peuple hébreu, élu de Dieu [FN: § 1382-2], et ne faisait pas défaut chez les païens. Les Romains et les Grecs considéraient les courtisanes comme ayant une profession qui, tout en étant inférieure à d'autres, était pourtant nécessaire [FN: § 1382-3]. La prostitution persista, après cette époque ; le christianisme ne la fit pas disparaître ; elle s’est maintenue jusqu'aujourd'hui, et il est probable qu'elle durera encore, malgré l'indignation de certains de nos contemporains, souvent plus chastes en théorie qu'en pratique. L'hypocrisie des croyances médiévales, et ensuite des modernes, poussa parfois les gouvernements à frapper la prostitution par des lois, qui n'eurent que peu ou point d'effet ; ce qui est une nouvelle preuve de la puissance des résidus que nous étudions. La prostitution ne fit pas défaut chez le peuple très catholique du moyen âge. Nous en trouvons la preuve dans les nombreux règlements qu'on lit à son sujet et dans les incessantes menaces de punir les prostituées, menaces qui, précisément parce qu'elles sont toujours renouvelées, apparaissent inefficaces. Déjà dans les lois barbares il est question des prostituées [FN: § 1382-4] . Dans les capitulaires du pieux empereur Charlemagne, on parle de prostituées qui s'introduisaient jusque dans le palais [FN: § 1382-5] , ainsi que de graves dérèglements qui compromettaient la prospérité de l'empire ; et l'on statue des peines contre des vices infâmes [FN: § 1382-6]. Dans les constitutions du royaume de Sicile, il est interdit de faire violence aux courtisanes [FN: § 1382-7].
§ 1383. Le bon roi Saint Louis découvrit que dans son camp, à Damiette, on avait établi des lupanars près de son pavillon [FN: § 1383-1] . Souvent, à propos du roi des ribauds [FN: § 1383-2], on fait allusion aux prostituées qui suivaient la cour, et à d'autres qui étaient sous la juridiction de ce personnage. Quand, ensuite, au XVIe siècle, nous voyons déborder la corruption, nous devons remarquer qu'elle n'apparaît pas ex novo, mais que c'est seulement une des nombreuses oscillations d'un phénomène continu [FN: § 1383-3]. En un mot, la prostitution existe chez presque tous les peuples civilisés et en tout temps. Il y a de notables différences de forme et très peu de différences de fond.
§ 1384. Jusqu'ici, nous avons parlé de la population en général. Examinons les diverses classes en particulier. Si, cela faisant, nous trouvions que, chez les hommes qui occupent une haute situation dans une organisation religieuse où le péché charnel est condamné, les mauvaises mœurs disparaissent, nous aurions un indice d'effet probable de la doctrine sur les faits. Mais si cela n'arrive pas, si là où la foi apparaît plus forte les mœurs ne sont pas meilleures, nous conclurons encore, comme précédemment, non pas que la foi est malfaisante, ni qu'elle est absolument inefficace, mais bien qu'en de nombreux cas elle ne suffit pas à vaincre les résidus sexuels.
§ 1385. Des reproches, quant aux mœurs, adressés aux anciens philosophes de la Grèce et de Rome, en passant par les accusations portées contre le clergé catholique ou, en général, contre le clergé chrétien, on arrive jusqu'à ceux qu'à notre époque on pourrait adresser aussi aux vertuistes.
§ 1386. Celui qui incline à donner aux actions logiques une importance grande ou exclusive, est poussé, en observant que peu ou beaucoup de croyants d'une religion sont malhonnêtes, à conclure que cette religion est « fausse », vaine, nuisible. Mais celui qui sait quelle grande part les actions non-logiques ont dans les faits et gestes des hommes, sait aussi que cette conclusion ne tient pas debout. La philosophie n'est pas condamnable par le fait qu'il y eut des philosophes malhonnêtes, ni la religion catholique parce qu'il y eut des prêtres coupables, ni la religion des vertuistes, parce qu'il y a parmi eux des gens dissolus. Il faut juger ces religions et les autres avec d'autres critères. Remarquez qu'en plusieurs cas, même en négligeant la considération des actions non-logiques et en restant strictement dans le domaine des actions logiques, ces reproches ne sont pas justifiés.
§ 1387. Par exemple, on a vivement reproché aux jésuites de traiter dans leurs œuvres des cas de conscience relatifs à l'acte sexuel. Ce reproche pourrait peut-être se justifier logiquement, s'il émanait de qui pense que ni la morale ni la loi ne doivent se préoccuper de ce sujet ; mais s'il émane, comme il arrive souvent, de qui veut au contraire que la morale et la loi interviennent, il est injustifié, puisqu'il est manifestement impossible de régler une matière quelconque sans en parler [FN: § 1387-1]. Remarquez d'ailleurs que les jésuites ne furent pas le moins du monde les seuls à suivre cette voie : ils furent précédés par les Pères de l'Église et se trouvent en compagnie de tous ceux, croyants ou athées, qui voulurent ensuite régler l'acte sexuel.
§ 1388. Les abolitionnistes qui, à notre époque, veulent abolir la prostitution, s'expriment avec plus d'obscénité que les jésuites, et de plus s'expriment en langue vulgaire, tandis que les jésuites écrivaient en latin. Nos vertuistes, qui combattent les mauvaises mœurs, s'y prennent souvent de telle manière qu'ils font venir l'eau à la bouche. Ne parlons pas de ceux qui, sous le prétexte d'instruire la jeunesse, afin de la maintenir chaste, écrivent des livres pour l'instruire des détails de l'acte sexuel.
§ 1389. Il y a surabondance et même pléthore de témoignages prouvant que les théories sur les bonnes mœurs sont loin de concorder toujours avec les faits relatifs à la conduite des adeptes de ces théories. Nous devons nous tenir sur nos gardes au sujet de ces faits, et en exclure plusieurs. En attendant, ceux qui sont rapportés par les adversaires sont suspects, parce qu'ils peuvent, même si l'on admet la bonne foi, manifester uniquement la malveillance, qui, pour se donner libre cours, se sert des armes efficaces fournies par les résidus sexuels. Les témoignages des indifférents ne sont pas toujours acceptables sans réserve, parce que l'effet sur notre esprit, du contraste entre les discours vertueux et la mauvaise conduite, nous fait voir avec un verre grossissant les vices de celui qui prêche la vertu. Il ne faut pas non plus toujours accueillir sans réserve les témoignages des croyants d'une religion contre leurs prêtres, parce que la tendance à exagérer le mal pour le corriger et à substituer le prêche à la froide observation, est naturelle à l'homme. Mais, autant pour l'indifférent que pour le croyant, notre remarque s'applique aux commentaires des faits plutôt qu'aux faits eux-mêmes. Tout est possible, mais il est peu probable qu'un croyant invente de toutes pièces un fait, pour le seul plaisir de médire des gens qui ont la même foi que lui, et qu'un indifférent qui a le désir de bien observer les faits, les invente. Enfin, ce sont là les causes d'erreur qu'on trouve dans tous les documents historiques ; et si nous voulons absolument les exclure, nous devons aussi renoncer à nous occuper de toute recherche historique, quelle qu'elle soit.
§ 1390. Voyous un cas concret, à l'appui des observations théoriques que nous venons de faire. Saint Jérôme nous apprend que, de son temps déjà, il y avait des prêtres ressemblant aux petits abbés galants que vit le XVIIIe siècle, de même qu'il y avait des femmes ressemblant beaucoup à nos vertuistes contemporaines, lesquelles, par seul amour de la vertu, ne se lassent jamais d'étudier la prostitution. Ces observations du saint et les lois que les empereurs durent rendre pour faire disparaître la trop grande familiarité des ecclésiastiques avec les femmes, écartent le doute qu'il y ait une calomnie dans ce qu'écrit Ammien Marcellin, des pontifes romains de son temps [FN: § 1390-1] : « En considérant le faste de cette dignité dans la ville de Rome, je comprends l'avidité à l'obtenir et pourquoi on se la dispute de toutes ses forces ; car celui qui l'obtient sera sûr de s'enrichir par les oblations des matrones, et de se promener en voiture, vêtu avec recherche, jouissant de banquets splendides, à tel point que leurs tables surpassent celles des rois ».
§ 1391. Dans le code Théodosien, nous avons une loi qui défend aux ecclésiastiques et à ceux qui se disent « continents » d'aller dans les maisons des veuves et des pupilles, et de recevoir d'elles des libéralités sous prétexte de religion [FN: § 1391-1]. Une autre loi leur défend de garder dans leurs maisons des femmes avec lesquelles la vie en commun était un scandale [FN: § 1391-2]. On trouve des lois de ce genre dans d'autres législations ; nous en avons dans les Capitulaires de Charlemagne [FN: § 1391-3] . La longue lutte des papes contre le clergé concubinaire, au moyen âge, est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en apporter ici des preuves.
§ 1392. Le mal était ancien ; et si l'on veut qu'avoir commerce avec les femmes soit une décadence et une corruption du christianisme, il faut avouer que cette décadence et cette corruption commencèrent bientôt. Saint Cyprien, qui vivait au IIIe siècle, en traite longuement. Dans une lettre qu'il écrit à Pomponius, avec d'autres prêtres, il s'exprime ainsi [FN: § 1392-1] : « Très cher frère, nous avons lu la lettre que tu nous as envoyée par Paconius, notre frère, demandant et désirant que nous te répondions ce que nous pensions de ces vierges qu'on trouve dans le même lit que des hommes, tandis qu'elles avaient décidé de demeurer en leur état et d'observer fermement la continence. Tu dis que, parmi ces hommes, il y a un diacre, et que ces vierges, tout en confessant ouvertement avoir dormi avec un homme, certifient être intactes. » Le saint, s'appuyant sur des citations bibliques, réprouve ces mœurs : « ... On ne peut souffrir que les vierges habitent avec des hommes, je ne dis pas seulement qu'elles dorment avec eux, mais aussi qu'elles vivent ensemble... Enfin, combien de ruines graves voyons-nous se produire ici chez beaucoup de gens, et que de vierges voyons-nous avec la plus grande douleur être corrompues par cette union illicite et dangereuse... Si vraiment elles ne veulent ou ne peuvent persévérer, il vaut mieux qu'elles se marient, plutôt que de tomber dans le feu, pour leur péché [FN: § 1392-2] ». Les femmes mariées et les veuves qui fréquentaient trop les prêtres ne faisaient pas mieux [FN: § 1392-3].
§ 1393. Aux reproches que les Pères de l'Église et ses dignitaires font au sujet des mauvaises mœurs du clergé, on a l'habitude d'objecter que ces reproches ne correspondent pas à la vérité, parce que les Pères et les dignitaires de l'Église feignent le mal pour obtenir le bien. Cette objection a été faite, parmi beaucoup d'autres, au cardinal Damien [FN: § 1393-1]. Mais est-il possible d'admettre que Saint Cyprien ait inventé la lettre de Pomponius à laquelle il répond ? que tout ce qu'il dit soit fiction ? Même si l'on faisait cette concession, on ne saurait admettre l'objection, parce qu'il y a les actes des conciles et un très grand nombre d'autres documents qui confirment que des femmes vivaient avec les clercs. Mais, pour défendre le clergé, il n'est pas nécessaire de taxer toutes ces preuves de fausseté : il suffit d'observer qu'en somme les mœurs du clergé n'étaient pas pires, et paraissent au contraire avoir été meilleures que les mœurs générales du temps.
§ 1394. On appelait les femmes qui vivaient avec les clercs sousintroduites, étrangères, sœurs, agapètes [FN: § 1394-1]. Il en est souvent fait mention dans les actes des conciles. Saint Jean Chrysostôme a deux homélies entières contre ces femmes. Dans la première [FN: § 1394-2] , il dit qu'autrefois nos ancêtres connurent deux causes pour lesquelles les femmes cohabitaient avec les hommes : l'une, juste et rationnelle, le mariage ; l'autre, plus récente, injuste et illégale, la fornication, qui est l'œuvre des mauvais démons. À son époque, on a vu une troisième cause, étrange et paradoxale. Il y a des hommes, en effet, qui, sans mariage et sans rapports charnels, introduisent des jeunes filles dans leurs maisons et vivent avec elles jusqu'à la vieillesse. Les motifs qu'ils en donnent, le saint les tient pour imaginaires, et pense que la principale cause consiste en ce qu'« il y a une certaine volupté à habiter avec une femme, non seulement avec le lien conjugal, mais aussi sans mariage ni commerce charnel [FN: § 1394-3] ». Il ajoute que cette volupté est même plus grande que celle de l'union conjugale, car dans celle-ci, par ses continuels rapports sexuels, l'homme se rassasie de la femme, qui d'ailleurs se fane plus vite que la vierge. Il paraît que l'intimité était poussée assez loin, puisque le saint, après avoir rappelé un dicton qui met en lumière le danger du baiser, ajoute : « Et moi, je ne devrais pas aussi dire cela à ceux qui embrassent et caressent la femme qui habite avec eux ! » [FN: § 1394-4] Il continue longuement et réfute les prétextes qu'on invoquait pour justifier cette cohabitation. Dans la seconde homélie [FN: § 1394-5] , le saint s'en prend aux femmes qui cohabitent avec l'homme. Il ne veut pas que les vierges se vêtent avec recherche. Quant à celles qui vivent avec un homme, le saint voudrait qu'elles fussent ensevelies vivantes. Il parle de certaines preuves honteuses qu'elles prétendent donner de leur virginité [FN: § 1394-6] . Il réfute, il prêche, il gémit, il réconforte. Il serait vraiment étrange que de si longs discours n'eussent aucun fondement dans les faits réels. Au contraire, ils démontrent à l'évidence que le scandale existait et ne devait pas être des moindres. D'ailleurs, il ne manque pas d'un grand nombre d'autres témoignages de faits semblables.
§ 1395. En l'année 314, le concile d'Ancyre, en Galatie, par son 19e canon, interdit aux vierges d'habiter avec les hommes sous le nom de sœurs. En l'année 325, le concile de Nicée défend aux clercs d'avoir des femmes sousintroduites [FN: § 1395-1], excepté la mère, la sœur, la tante et d'autres personnes insoupçonnables. Ensuite, l'Église ne cessa de lutter, mais avec peu de succès, pour empêcher que ses prêtres n'eussent des maîtresses ou des concubines. On sait combien grave et difficile devint, au moyen âge, la répression du clergé concubinaire. Il y eut certainement des papes qui se préoccupèrent peu de la morale sexuelle ; mais il y en eut, non moins certainement, d'autres qui, de tout leur pouvoir, voulurent l'imposer sévèrement. Enfin, à grand'peine, on put obtenir que le scandale public cessât ; mais on n'obtint pas grand'chose quant au fond [FN: § 1395-2].
§ 1396. Si l'on réfléchit à la puissance des armes spirituelles, morales, matérielles, dont disposait l'Église, et aux résultats presque insignifiants qu'elle a obtenus, on ne tardera pas à voir quelle est la force considérable des résidus sexuels, et combien sont ridicules ces pygmées qui, aujourd'hui, s'imaginent pouvoir les réfréner.
ADDITIONS↩
Volume I
AVERTISSEMENT. – La guerre européenne actuelle constitue une expérience sociologique de grande importance. Il est utile à la science que l'on compare ses enseignements à ceux des faits antérieurs. C'est pourquoi, afin d'avoir l'un des termes de la comparaison, l'auteur aurait désiré que ces volumes eussent été publiés avant les déclarations de guerre, le manuscrit de l'ouvrage étant achevé dès l'année 1913. Mais comme cela n'a pas été possible, il a voulu du moins s'efforcer de séparer les conséquences théoriques des faits connus avant la conflagration, de celles des faits connus après.
Pour réaliser son intention, d'une part, l'auteur s'est rigoureusement abstenu d'introduire, dans les épreuves corrigées après le mois d'août 1914, n'importe quel changement qu'auraient pu suggérer, même d'une manière très indirecte, les événements de la guerre européenne, les quelques citations qui se rapportent à l'année 1913 n'ayant rien de commun avec cette guerre. D'autre part, l'auteur se propose d'étudier, dans un Appendice, les résultats théoriques de l'expérience sociologique aujourd'hui en cours de développement. Ce travail ne pourra être accompli que lorsque la guerre actuelle aura pris fin.
Les chiffres précédés de § désignent le paragraphe ou la note ; précédés d'un p. : la page. L'indication 1. 2 d signifie : ligne 2 en descendant ; l’indication 1. 3 r : ligne 3 en remontant. Les lignes se comptent dans le paragraphe ou le fragment de paragraphe contenu à la page indiquée. Dans les additions, la petite lettre a placée en apostrophe indique, une note à ajouter. Elle remplace les chiffres 1, 2,... en apostrophe, employés dans le corps de l'ouvrage.
[Addition 1]
p. 1 § 2 1. 3 r. Le but seul nous a ) importe...
2 a En ce qui concerne l'emploi du pronom personnel de la première personne du pluriel ou du singulier, pour désigner l'auteur, je suis, dans cet ouvrage, l'usage des écrivains latins. Cet usage est exprimé de la façon suivante par ANTOINE, dans sa Grammaire de la langue latine : « (p. 133) Le latin dit en parlant de lui-même à la première personne nos (nostri, nobis), noster, au lieu de ego, meus, quand il veut présenter son affirmation avec une (p. 134) certaine réserve comme étant aussi celle des lecteurs ou des auditeurs, ou bien une action à laquelle il les fait participer ; il met au contraire ego quand il exprime son opinion personnelle en l'opposant à celle de tous les autres »
[Addition 2]
p. 28 § 59 1. 7 d. ... de ces principes sur l'expérience a )
59 a L'impression du présent chapitre était déjà achevée quand fut publié, dans la Revue de Théologie et de Philosophie (n° 16, septembre-octobre 1915), un article du prof. ADRIEN NAVILLE, dans lequel sont fort bien exprimées, par opposition aux théories de Bergson, des conceptions semblables à celles qui sont exposées ici. Il est utile de relever les conclusions auxquelles aboutit un éminent philosophe tel que Naville. « (p. 18 de l'extrait) Ma conclusion au sujet du procès de la science et de la théorie des deux vérités est donc que la science est limitée, relative, partiellement conventionnelle, qu'elle baigne dans le mystère et laisse ouvert tout un monde de questions qui relèvent de la spéculation transcendante, mais que dans son domaine et là où elle se prononce, il n'y a pas d'autorité supérieure à la sienne ». Il est bon de nous arrêter aussi à d'autres passages de l'article de Naville. « (p. 3) Il s'est produit en effet de nos jours un phénomène assez étonnant, c'est que la royauté de la science a été contestée. Et cela non par des intelligences attardées, routinières, par (p. 4) des tenants de l'ignorance ou d'une dogmatique qui voudrait s'éterniser. Au contraire ce sont les esprits les plus vifs, les plus ouverts, les plus agiles, ce sont des novateurs très éclairés et très hardis qui intentent à la science un véritable et grave procès. Ce n'est pas sans doute que son culte ait entièrement disparu. Peut-être même s'est-il généralisé et les adorateurs de la science sont-ils plus nombreux aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Les masses populaires professent pour son nom un respect qui paraît encore grandissant [§ 2360] et leurs chefs les entretiennent dans ce sentiment [voir à la Table IV : Religions et métaphysiques diverses – Du Progrès – De la Raison –De la Science]... Mais si la science a conservé tout son prestige pour ceux qui habitent les régions inférieures ou les régions moyennes du monde intellectuel, il en est autrement pour ceux qui se promènent sur les sommets. Ceux-ci sont devenus défiants, ils discutent la science, ils la critiquent, ils lui intentent formellement un procès ». Après avoir rappelé plusieurs de ces critiques, l'auteur ajoute : « (p. 16) M. Bergson, je l'ai déjà dit, est un des critiques les plus sévères de la science qu'il y ait jamais eu. Non assurément qu'il en fasse fi ; il en proclame la valeur autant que personne, mais à la condition qu'elle reste dans sa fonction qui est, si j'ose dire ainsi, de formuler la vérité utile et non la vérité vraie [voir Table IV : Vérité. Sens divers de ce mot]. La vérité vraie ne peut être obtenue que par des procédés tout différents de ceux de la science ». Ainsi, de la simple étude des faits et sans aucun préjugé, Naville est conduit à noter un cas particulier d'un phénomène dont nous donnerons la théorie générale au chapitre XII (§ 2339 et sv.). Et, toujours de l'étude directe des faits, il est conduit aussi à noter des cas particuliers du même phénomène. « (p. 6) Qu'il y ait deux vérités [bien plus ! elles sont en nombre infini : quot homines, tot sententiae], une vérité profonde, la philosophie, et une autre, moins profonde et en somme moins vraie, c'est une thèse qui a bien souvent paru au cours de l'histoire ». Considérée au point de vue de la logique et de l'expérience, cette théorie des vérités différentes est une pure divagation, un entrechoquement de mots vides de sens. Mais au point de vue des sentiments et de leur utilité individuelle et sociale (§ 1678 et sv.), elle témoigne, ne fût-ce qu'en opposant une erreur à une autre, du désaccord entre l'expérience et l'opinion de ceux qui estiment que les actions non-logiques tirent leur origine exclusivement de préjugés surannés, absurdes et nuisibles (§ 1679). « Dans l'Europe occidentale, elle [la théorie des deux vérités] s'est produite (p. 7) avec une insistance particulière aux derniers siècles du moyen âge. Son apparition marquait le déclin et annonçait la fin de la scolastique. La scolastique avait été l'alliance de la doctrine ecclésiastique et de la philosophie. Il y a eu en Europe deux scolastiques, une chrétienne, et une juive… quand on apprit le grec et qu'on fit connaissance intime avec Aristote, l'Église se demanda si elle devait tourner le dos à la pensée et à la science grecques ou les accepter comme des auxiliaires et des alliées ; elle prit ce dernier parti. Et cette alliance, ce fut la scolastique. La synagogue juive prit un parti analogue... Toutefois l'alliance entre la doctrine ecclésiastique et la recherche philosophique n'avait pas été conclue sur le pied de l'égalité. L'Église s'attribuait la haute main, elle était (p. 8) maîtresse ; la recherche philosophique, libre entre certaines limites, ne devait pas les dépasser... Vers la fin du moyen âge le nombre des esprits émancipés alla en augmentant et c'est alors que se produisit d'une manière assez générale dans certains milieux universitaires, à Paris et à Padoue, par exemple, la théorie des deux vérités ». Alors, elle servait à passer de la théologie du sentiment à la théologie de la raison, et profitait indirectement à la science expérimentale. Aujourd'hui, elle sert à passer de la théologie de la raison à la théologie du sentiment ; elle pourra aussi servir à la science expérimentale, en faisant connaître expérimentalement l'utilité individuelle et sociale des actions non-logiques.
[Addition 3]
p. 59 § 1321 2 r. ... où il ne soit pas admissible a )
132 a ADRIEN NAVILLE, loc. cit. p. 28 § 69 a : « (p. 11) Je sais fort bien que le déterminisme sourit au savant et procure à l'esprit scientifique [pour être précis, il faut dire : à la Théologie de la Raison] une grande satisfaction. Le déterminisme c'est la croyance [ce terme suffit pour nous avertir que nous dépassons les limites de la science expérimentale] que tout peut être expliqué, or le savant cherche des explications : le déterminisme c'est la croyance que tout phénomène peut être compris, c'est-à-dire rattaché à d'autres phénomènes qui l'enveloppent et le produisent... Mais pour naturel que soit ce penchant [au déterminisme], il ne prouve rien. Et nous ne le voyons pas se produire chez tous les savants ».
[Addition 4]
p. 95 § 182 1. 1 d ... voyant un scorpion on dit deux a.…
182 a On trouve de nombreux faits semblables. Par exemple : THIERS : Traité des superstitions... Avignon, 1777, t. I. L'auteur compte parmi les superstitions : « (p. 415) Arrêter un serpent en le conjurant avec ces mots (Mizauld. Cent. 2, num. 93) : “Adiuro te per eum qui creavit te, ut maneas : quod si nolueris, maledico maledictione qua Dominus Deus te exterminavit” » Il est évident que, dans le phénomène, le fait principal est le sentiment que l'on peut agir sur certains animaux au moyen de mots déterminés (partie (a) du § 798), et que le fait accessoire réside en ces mots (partie (b) du § 798). Le fait principal fait partie d'une classe très nombreuse, dans laquelle rentrent les sentiments qui servent à faire croire à l'homme qu'il peut agir sur les choses au moyen des mots (genre (1-gamma) du § 888). Il est à remarquer que si notre auteur croit vaines quelques superstitions, il n'attribue pas à toutes ce caractère. « (p. VIII) J'ai rapporté les Superstitions dans toute leur étendue, lorsque j'ai jugé que cela ne pourrait avoir de mauvaises suites, et qu'il était en quelque façon nécessaire de n'en rien retrancher, pour les mieux faire comprendre. Mais, j'ai souvent caché sous des points et des ET caetera, certains mots, certains caractères, certains signes, certaines circonstances, dont elles doivent être revêtues pour produire les effets qu'on (p. IX) en espère, parce que j'ai eu crainte d'enseigner le mal en voulant le combattre ».
[Addition 5]
p. 100 § 189 In fine :
Dans les Géopontiques (I, 14), on rappelle plusieurs manières de sauver les champs de la grêle ; mais l'auteur du recueil conclut en disant qu'il a transcrit ces ouvrages uniquement afin de ne pas paraître omettre des choses transmises par les anciens. En somme, il a simplement différentes croyances.
[Addition 6]
p. 100 § 190 1. 1 r. ... explications a ).
190 a Il existe des inscriptions latines avec invocations aux vents. C. I. L, VIII, 2609, 2610. ORELLI, 1271 : Iovi O. M. tempestatium divinarum potenti leg. III. Aug. dedicante... A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr., t. I « (p. 166) Les vents furent aussi adorés par les populations primitives de la Grèce : mais leur culte, qui joue un si grand rôle dans le Rig- Veda, s'était singulièrement affaibli chez les Hellènes. Ils continuent sans doute à être personnifiés, mais on ne les invoque plus que par occasion et en (p. 167) certaines localités spéciales ». Plus loin, en note : « (p. 169) (2). Le culte des vents et des montagnes était associé chez les Chinois à celui des cours d'eau (Tcheou-li, trad. édit. Biot, t. II, p. 86). Lorsque l'empereur passait en char sur une montagne, le cocher faisait un sacrifice au génie de la montagne (Ibid. t. II, p. 249). – (3) Les anciens Finnois invoquaient aussi les vents comme des dieux, surtout ceux du sud et du nord. Ils adressaient aux vents froids des formules déprécatoires ».
[Addition 7]
p. 107 § 196 1. 3 d. Le noyau est un concept mécanique ; a )...
196 a Il apparaît presque à nu dans le fait de la « pierre pluviale » qu'il suffisait de porter à Rome, pour conjurer la pluie. FESTUS, s. r. Aquaelicium : « On l'emploie [ce terme] quand l'eau pluviale est attirée par certaines pratiques, de même que pour le passé on dit, avec la “pierre pluviale” promenée par la ville ». S. r. Manalis tapis : Manalem vocabant lapidera etiam petram quandam, quae erat extra portam Capenam iuxta aedem Martis, quam cum propter nimiam siccitatem in urbem pertraherent, insequebatur pluvia statim, eumque, quod aquas manarent, manalem lapide dixere. Donc, il suffisait de promener cette pierre par la ville, et aussitôt venait la pluie. Des usages semblables paraissent avoir existé chez des peuples voisins. F. P. FULGENTII expositio sermonum antiquorum, s. r. Quid sint manales lapides, p. 112 Teubner, 169 M, 769 St. : Labeo qui disciplinas Etruscas Tagetis et Bacitidis quindecim voluminibus explanavit, ita ait : « Fibrae iecoris sandaracei coloris dum fuerint, manales tunc verrere opus est petras », id est quas solebant antiqui in modum cilindrorum per limites trahere pro pluviae commutandam inopiam. Cfr. NONIUS ; 1. XV, s. r. Trulleum, p. 547 Mercier.
[Addition 8]
p. 107 § 196 1. 1 r. race humaine a )
196 a PAUS. ; VIII, Arcad., 38. L'auteur parle de la fontaine Agno, sur le mont Lycée. « Quand la sécheresse a duré longtemps, et que par conséquent les semences dans la terre et les arbres commencent à souffrir, alors le prêtre de Zeus Lycéen, après avoir adressé des prières et sacrifié à l'eau, suivant les, règles établies, touche avec une branche de chêne la surface, mais non le fond de la fontaine. L'eau étant remuée, il s'élève une vapeur semblable à une nuée. Peu après la nuée devient nuage, et, attirant à elle les autres nuages, elle fait tomber la pluie sur la terre, pour les Arcadiens ». Nous verrons (§ 203) que les sorcières faisaient pleuvoir ou grêler, par des moyens semblables. Les différences sont les suivantes : 1° C'est le démon des chrétiens qui intervient, au lieu des divinités païennes. Il est naturel que chaque peuple fasse intervenir les êtres divinisés par sa religion. 2° Chez Pausanias, l'opération est bienfaisante au plus haut point ; chez les chrétiens, elle peut l'être, mais, en général, elle est malfaisante. Il est naturel que les êtres divinisés agissent chacun suivant sa nature ; or la nature du démon est essentiellement malfaisante. Dans le présent exemple, nous voyons un fait imaginaire expliqué de différentes manières. Les sentiments correspondant au fait imaginaire constituent évidemment la partie constante du phénomène ; les explications en sont la partie variable.
[Addition 9]
p.108 § 197 1. 1 r. ... d'autres calamités semblables a ).
197 a Savamment et longuement, les auteurs du Malleus recherchent si le démon doit toujours agir de concert avec le sorcier, ou s'ils peuvent agir séparément. : Prima pars, secunda quaestio : An catholicum sit asserere quod ad effectum maleficialem semper habeat daemon cum malefico concurrere, vel quod unus sine altero, ut daemon sine malefico, vel e converso talem effectum possit producere. Par exemple, pour démontrer que l'homme peut agir sans l'aide du démon, ou en général la « force inférieure » sans la « force supérieure », quelques-uns citent le fait rapporté par Albert, que la sauge pourrie d'une certaine manière et jetée dans un puits suscite la tempête. Le Malleus n'a aucun doute sur ce fait, mais il l'explique. Il commence par distinguer les effets en : ministeriales, noxiales, maleficiales et naturales. Les premiers sont produits par les bons anges, les seconds par les mauvais, les troisièmes par le démon avec l'aide des sorciers et des sorcières ; les derniers ont lieu grâce à l'influence des corps célestes. Cela dit, il est facile de comprendre comment le fait de la sauge se produit sans l'intervention du démon. Et ad tertium de salvia putrefacta et in puteum proiecta dicitur, quod licet sequatur effectus noxialis absque auxilio daemonis, licet non absque influentia corporis coelestis.
[Addition 10]
p. 115 § 2033 In fine.
Peut-être Delrio avait-il sous les yeux d'autres passages du Fourmilier ou du Malleus. Par exemple, pour ce dernier, le fait rapporté secunda pars, quaestio 1, cap. tertium : super modum quo de loco ad locum corporaliter transferuntur. Une sorcière n'avait pas été invitée à certaines noces. Elle appelle à son aide le démon. Celui-ci, à la vue de quelques bergers, la transporte sur une montagne où, manquant d'eau, elle emploie son urine et fait grêler sur les invités de la noce. Ipsa indignata, vindicare se aestimans, daemonem advocat, et suae tristitiae causam aperuit, ut grandinem excitare vellet, et cunctos de chorea dispergere petiit, quo annuente, psam sublevavit, et per aera ad montem prope oppidum, videntibus certis pastoribus, transvexit, et ut postmodum fassa fuerat, cum aqua sibi deesset ad fundendam in foveam, quem modum, ut patebit, ubi grandines excitant, observant, ipsa in foveam quam parvam fecerat, urinam loco aquae immisit, et cum digito, more suo, astante daemone, movit, et daemon subito illum humorem sursum elevans, grandinem vehementem in lapidibus super chorisantes (sic) tantummodo et oppidanos immisit. Unde ipsis dispersis, et de causa illius mutuo conferentibus, malefica oppidum postea ingreditur, unde suspitio magis aggravatur. Nous rions de ces absurdités, mais les sentiments qu'elles manifestent ont été cause de bien des souffrances et d'un grand nombre de morts. La pauvre femme dont il s'agit fut brûlée. Unde capta, et fassa quod ea de causa, nimirum quia invitata non fuerat, talia perpetrasset, ob multis etiam aliis maleficiis ab ea perpetratis FN1 [probablement certains méfaits du même genre], incinerata fuit. Voir aussi : NICOLAI REMIGI... daemoriolatreiae libri tres, lib. I, cap. 25.
[FN1] Par un usage incorrect, mais non isolé en ces temps-là, les auteurs construisent ici la préposition ob avec l'ablatif au lieu de l'accusatif.
[Addition 11]
p. 157 § 263 1. 1 r. ... d'autres sciences naturelles a ).
263 a Tandis que le présent ouvrage était en cours d'impression, deux livres importants ont été publiés sur l'économie mathématique : ANTONIO OSORIO : Théorie mathématique de l'échange. Paris, 1913 – JACQUES MORET ; L'emploi des mathématiques en économie politique. Paris, 1915.
[Addition 12]
p. 160 § 272 1. 4 d. ... à laquelle on arrive a ).
272 a On observe des contradictions analogues dans les controverses métaphysiques et les disputes théologiques sur le « libre arbitres », la « prédestinations », la « grâce efficace » (§ 280) etc. Pascal tourne agréablement en dérision quelques-unes de ces contradictions, mais comme il raisonne en métaphysicien et en théologien, il y substitue des raisonnements qui ont peu et parfois moins de valeur. Il avait commencé par dire (Ie Provinciale) : « (p. 31). je ne dispute jamais du nom, pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on lui donne ». Il paraissait ainsi vouloir se placer entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale (§ 119) ; mais aussitôt après il s'en écarte pour aller dans celui de la métaphysique, de la théologie, du sentiment.
[Addition 13]
p. 253 § 469 1. 5 r. ... séparent a ).
469 a On trouve une autre analogie dans le fait que la philologie scientifique est une science moderne, que même des hommes éminents ont ignorée durant des siècles et des siècles, et qui naquit et se développa grâce à l'emploi de la méthode expérimentale. Par exemple, la grammaire grecque est beaucoup mieux connue des hommes de science modernes que des hommes de science de la Grèce ancienne. Il semble impossible qu'Aristote, ou l'auteur de la Poétique, quel qu'il soit, ait pu écrire : « ... puisque dans les noms composés nous n'avons pas coutume de donner un sens à chaque partie, ainsi dans ![]() n'a aucun sens »...
n'a aucun sens »... ![]()
![]() . [Poet., 20, 8, p. 1456]. Les éditions « critiques », obtenues par la méthode expérimentale, sont modernes ; les humanistes n'en avaient aucune idée. Il ne faut pas confondre la philologie scientifique avec les fantaisies de l'hypercritique. Celles-ci d'ailleurs ne sont pas nouvelles. Les changements et les suppressions que plusieurs philologues modernes se permettent arbitrairement dans les textes grecs et dans les latins, sont entièrement semblables aux altérations dont les poésies homériques furent victimes au temps des critiques alexandrins ; et pour justifier de tels arrangements, les raisons invoquées par les modernes le disputent en subtilité et parfois en absurdité à celles qui furent données par les anciens.
. [Poet., 20, 8, p. 1456]. Les éditions « critiques », obtenues par la méthode expérimentale, sont modernes ; les humanistes n'en avaient aucune idée. Il ne faut pas confondre la philologie scientifique avec les fantaisies de l'hypercritique. Celles-ci d'ailleurs ne sont pas nouvelles. Les changements et les suppressions que plusieurs philologues modernes se permettent arbitrairement dans les textes grecs et dans les latins, sont entièrement semblables aux altérations dont les poésies homériques furent victimes au temps des critiques alexandrins ; et pour justifier de tels arrangements, les raisons invoquées par les modernes le disputent en subtilité et parfois en absurdité à celles qui furent données par les anciens.
[Addition 14]
p. 292 § 541 1. 1 r. ... pas d'accord avec eux a ).
541 a Un fait encore à noter. Les éditions critiques nous permettent de remonter, avec une probabilité plus ou moins grande, aux archétypes des manuscrits qui nous sont parvenus, mais elles ne peuvent pas nous apprendre dans quel rapport ces archétypes se trouvent avec la pensée de l'auteur. Cette pensée pourrait ne pas nous être entièrement connue, même si nous avions le texte original dicté par l'auteur. Que l'on prenne garde, en effet, à ce qui arrive souvent aujourd'hui, lorsqu'on fait usage de l'imprimerie : en lisant les épreuves, l'auteur s'aperçoit d'imperfections qui lui avaient échappé en lisant le manuscrit, surtout s'il l'a dicté à quelqu'un d'autre, et il y apporte des modifications.
[Addition 15]
p. 316 § 587 1. 1 r. ... proie et aux corbeaux a )
587 a Jeté à l'eau, un homme qui ne sait ou ne peut nager, est submergé et se noie. Si, au contraire, il surnage, on a cru autrefois que cela se produisait parce qu'il était innocent ; de même on a cru que cela se produisait parce qu'il était coupable (Additions 956). Le Père Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses, Paris, 1732, t. II, relève cette étrange contradiction. Après avoir rappelé des miracles d'innocents qui surnageaient, par exemple, le suivant : « On la lie [une femme accusée d'un crime] en effet comme on lioit ceux qu'on éprouvoit par l'eau froide, et du haut d'un pont d'une hauteur prodigieuse, on la précipite dans la rivière. Mais par l'intercession de la très-sainte Vierge, elle demeura toujoûrs sur l'eau qui la porta saine et sauve sur le sable... », il conclut : « (p. 256) Il est assés évident que ces miracles sont opposez à l'épreuve de l'eau froide. Par ces miracles les innocens n'enfonçoient pas dans l'eau (p. 257), soûtenus par une protection visible de Dieu qui a paru dans cent autres miracles pareils. Mais par une bizarrerie surprenante, qui fit introduire l'épreuve de l'eau froide, il plût à des personnes que les innocens enfonçassent dans l'eau, et que les coupables n'y pussent enfoncer ».
[Addition 16]
p. 464 § 884 1. 2-3 d. ... que nous exposons a )
884 a On pourrait relever un grand nombre d'autres analogies. Il suffira de citer la suivante, entre l'abus de la méthode historique en sociologie et la critique à outrance des textes S. REINACH ; Manuel de philologie, t. I : « (p. 48) Bœckh a très bien signalé le cercle vicieux auquel n'échappe pas la critique philologique. Pour expliquer un texte, il faut le lire sous une certaine forme, et pour le lire sous cette forme et l'y laisser, il faut pouvoir l'expliquer et le comprendre. De là, chez bien des savants, la tendance à corriger ou à supprimer tous les passages qu'ils ne comprennent pas ». Beaucoup de ceux qui recherchent « les origines » des phénomènes procèdent d'une manière analogue. Reinach ajoute en note : « Nauck, dans le Sophocle de Schneidewin, 7e édit. : “La conjecture qui peut prétendre à la vraisemblance est celle qui, à tous les points de vue, réalise le mieux ce que l'esprit le plus exigeant veut trouver chez un tragique grec”. On dirait que c'est pour lui que Bœckh a écrit : “Les Athéniens avaient interdit, sur la proposition de Lycurgue, d'altérer le texte des tragiques : on voudrait presque que les anciens classiques fussent protégés aujourd'hui par une défense analogue” ». Aujourd'hui, avec la recherche des « origines », chacun admet uniquement ce qui concorde avec sa foi. Trouvez donc, si vous le pouvez, un humanitaire qui accepte des récits de faits contraires à sa foi, un marxiste qui ne subordonne pas les faits à la doctrine du capitalisme !
[Addition 17]
p. 482 § 915 1. 5 r. ... aux métaphysiciens et aux théologiens a )
915 a M. PSELLI de operatione daemonum, Kiloni, 1688, p. 85. L'auteur blâme les médecins qui ne veulent pas reconnaître l'œuvre du démon, et qui recourrent à des explications de faits expérimentaux : (p. 85) ![]() ...
... ![]()
![]() (p. 86)
(p. 86) ![]()
![]() . « Aucun sujet de s'étonner, si les médecins parlent ainsi, eux qui ne voient rien au delà de ce qui tombe sous le coup des sens, et ne se préoccupent que du corps ». C'est précisément ce qu'aujourd'hui les métaphysiciens, admirateurs de Hegel, de Kant ou des concepts sublimes du droit des gens, reprochent à ceux qui veulent demeurer dans le domaine de la réalité expérimentale.
. « Aucun sujet de s'étonner, si les médecins parlent ainsi, eux qui ne voient rien au delà de ce qui tombe sous le coup des sens, et ne se préoccupent que du corps ». C'est précisément ce qu'aujourd'hui les métaphysiciens, admirateurs de Hegel, de Kant ou des concepts sublimes du droit des gens, reprochent à ceux qui veulent demeurer dans le domaine de la réalité expérimentale.
[Addition 18]
p. 491 § 927 2 1. 5 d. ... dans l'antiquité a ).
927 a ZADOC KAHN ; La Bible traduite du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn, grand Rabbin. Paris, 1899, t. I : « (p. 6) Or quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que ![]() des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent ».
des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent ».
[Addition 19]
p. 512 § 954 1 1. 1 r. ...les résidus des combinaisons a ).
954 a J. B. THIERS ; Traité des superstitions qui regardent les sacremens, Paris, 1777, t. II. « (p. 20) Après que le Cardinal de Cusa a observé qu'il y a de la Superstition à faire servir les choses saintes à d'autres usages qu'à ceux auxquels elles sont destinées, il apporte pour exemple l'eau bénite que l'on boit pour recouvrer la santé quand on l'a perdue, dont on fait des aspersions dans les terres et les champs pour les rendre plus fertiles, et que l'on donne à boire aux animaux pour les délivrer des maladies qui les tourmentent... Mais, ce sçavant Cardinal, en déclarant ces trois pratiques Superstitieuses, ne faisoit pas attention aux paroles dont l'Église se sert dans la bénédiction de l'eau. Car, elle marque bien nettement que l'eau- bénite est d'un grand usage pour (p. 21) exterminer les Démons, pour chasser les maladies, pour dissiper le mauvais air et les mauvais vents, pour purifier les maisons, et tous les autres lieux où elle est repandue, et pour en éloigner tout ce qui peut troubler la paix et la tranquilité des fidéles qui l'habitent... Si bien qu'il n'y a nulle Superstition à faire boire de l'eau-bénite aux hommes et aux bêtes malades, ni à en jetter dans les maisons et sur les terres des Chrétiens, pourvû qu'on le fasse avec une foi pure, et une confiance entiere en la bonté et en la toute-puissance de Dieu ».
[Addition 20]
p. 515 § 956 1. 12 r. ... de vêtements a ).
956 a Au moyen âge et même postérieurement, on attribue cette propriété aux individus coupables d'un crime, spécialement celui d'hérésie et surtout celui de sorcellerie ; aussi croit- on pouvoir les découvrir par « l'épreuve de l'eau froide ». Le B. P. PIERRE LE BRUN ; Histoire critique des pratiques superstitieuses, Paris, 1732, t. II : « (p. 240) L'epreuve de l'eau froide se faisoit en cette maniere : On dépoüilloit un homme entierement, on lui lioit le pied droit avec la main gauche, et le pied gauche avec la main droite, de peur qu'il ne pût remuer ; et le tenant par une corde, on le jettoit dans l'eau. S'il alloit au fond, comme y va naturellement un homme ainsi lié, qui ne peut se donner aucun mouvement, il étoit reconnu (p. 241) innocent, mais s'il surnageoit sans pouvoir enfoncer, il étoit censé coupable ». En d'autres cas, au contraire, la personne qui, jetée dans l'eau, surnageait, on la supposait protégée par Dieu (Additions § 587). Là, on voit bien l'action mystérieuse de certains actes. On estime que le fait de surnager n'est pas naturel ; donc il doit être uni à certains caractères éthiques de l'individu ; mais il peut aller aussi bien avec l'innocence qu'avec la culpabilité. Comme d'habitude, les « explications » de fait ne manquent pas. Pour l'innocent, on dira que Dieu protège celui qui n'est pas coupable. « (p. 284) Les Fideles ont toûjours crû avec raison qu'il falloit un miracle pour préserver ceux qu'on jettoit dans l'eau ; et des personnes innocentes et pieuses, implorant le secours de Dieu, ont été souvent préservées des eaux où on les avoit jettées pour les noyer ». Pour le coupable, nous avons diverses explications dues à l'ingéniosité subtile des auteurs. « (p. 253) Sa principale ressource [d'Hincmar] est que depuis Jesus-Christ, plusieurs choses ont été changées, et que l'eau destinée à sanctifier les hommes par le baptême, et consacrée par l'attouchement du corps de Jesus-Christ dans le Jourdain ne doit plus recevoir dans son sein les méchans, lors qu'il est nécessaire d'être informé de leurs crimes ». Un autre auteur, Adolphe Seribonius, philosophe de grand renom, vit, en 1583, procéder à des épreuves de l'eau froide ; il chercha les causes des effets qu'elles produisaient. « (p. 271)... il prétendit que les Sorciers étoient nécessairement plus legers que les autres hommes, parce que le démon, dont la substance est spirituelle et volatile, pénétrant toutes les parties de leur corps, leur comuniquoit de sa legereté, et qu'ainsi devenus moins pésans que l'eau, il n'étoit pas possible qu'ils enfonçassent »
[Addition 21]
p. 524 § 963 1. 1 r. qu'il fit »a ).
963 a Après avoir nommé la Sainte Trinité, SAINT ÉPIPHANE, De numerorum mysteriis, écrit un chapitre intitulé : « Que le nombre même de la trinité, qui est écrit dans les Saintes Écritures, est de nature mystérieuse et admirable ». Il rapporte un très grand nombre de faits pour le prouver. Les suivants nous suffiront à titre d'exemples : Il y a trois choses en nous : l'intelligence, l'esprit, la raison. Il y a trois choses qu'on ne peut rassasier : l'enfer, l'amour de la femme, la terre aride. Il y a trois vertus : la Foi, l'Espérance et la Charité. C'est pendant trois jours et trois nuits que Jonas demeura dans le ventre de la baleine. L'auteur loue ensuite le nombre six et le déclare parfait.
Afin que d'autres nombres ne soient pas navrés de tant de louanges adressées à certains d'entre eux, rappelons l'ouvrage de NICOMACHUS GERASENUS, qui a pour titre : Arithmetica theologica, dans lequel tous les nombres de un à dix reçoivent un tribut de juste louange. Photius, Bibliotheca, c. 187, ose dire que cet ouvrage ne contient que des raisonnements vains, et que l'auteur considère arbitrairement les nombres comme des dieux et des déesses.
[Addition 22]
p. 557 § 1047 1. 2 d. ... un crime très grave a ) ;
1047 a Comtesse LYDIE ROSTOPTCHINE ; Les Rostoptchine. Paris. « (p. 222) J'ai dit plus haut combien ma grand'mère détestait l'ivrognerie, ce vice naturel facilité par l'inclémence du climat, elle ne distinguait pas entre le buveur invétéré et celui qui avait bu par hasard, histoire de s'amuser ou d'oublier, tous deux étaient également dignes du Knout et de la Sibérie. (p. 225) Un autre jour, douloureusement gravé dans ma mémoire, nous nous promenions de rechef dans l'allée, lorsqu'une femme, ses vêtements déchirés et ensanglantés, apparut et courant à toutes jambes, poursuivie par les palefreniers, elle s'était enfuie de l'écurie où elle recevait les verges, la malheureuse tomba en sanglotant aux pieds de ma grand'mère. Jamais je n'oublierai l'horreur de cette scène. la victime prostrée et l'implacable suzeraine lui demandant sévèrement la cause du châtiment ordonné par (p. 226) Timothée. En entendant le nom abhorré de vootka, sourde aux supplications véhémentes de ma mère et à celles plus timides de mon père, ignorante de nos larmes, celle que je m'indignais en ce moment d'appeler ma grand'mère se détourna en silence et continua sa promenade, les palefreniers s'approchèrent, empoignèrent la victime et l'entraînèrent pour lui faire subir le reste de son châtiment – et la malheureuse était enceinte ».
[Addition 23]
p. 621 §1168 1. 2 r. ... vanité a ).
1168 a Dans un très grand nombre d'écrits des anti-alcoolistes, on considère uniquement l'effet, estimé mauvais, du vin et d'autres boissons alcooliques sur la santé, sans tenir compte du plaisir que l'homme éprouve en buvant modérément. Il semblerait donc que l'homme doive se soucier uniquement de sa santé, et que le plaisir n'est que vanité. Si l'on raisonnait logiquement, ce qui n'arrive pas dans les raisonnements par accord de sentiments, on devrait, de cette façon, condamner presque toutes les actions de l'homme : il ne devrait pas sortir de chez lui, pour éviter de recevoir une tuile sur la tête, ou de rencontrer un chien enragé, ou d'être frappé de quelque autre malheur ; il ne devrait pas nager, par crainte de se noyer ; ni aller dans la montagne, de peur de tomber dans un précipice ; ni donner un baiser à celle qu'il aime – et cela a été dit sérieusement – par crainte des microbes ; ni aller au théâtre ou dans d'autres lieux fermés, parce que l'air renfermé n'est pas sain ; en somme, pour le dire brièvement et en latin, il devrait propter vitam vivendi perdere causas.
[Addition 24]
p. 740 § 1343 1 In fine.
Voir aussi : D'ANSSE DE VILLOISON ; De triplici Theologia Mysteriisque Veterum commentatio, p. 246 et sv., dans DE SAINTE-CROIX ; Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des anciens peuples ou recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme. Paris, 1784.